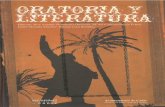Sous le regard de Rodin. Réflexions sur les pratiques d’acculturation dans l’iconographie de la...
-
Upload
univ-tours -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Sous le regard de Rodin. Réflexions sur les pratiques d’acculturation dans l’iconographie de la...
LE BANQUET DU MONARQUE
DANS LE MONDE ANTIQUE
Sous la direction de
Catherine GRANDJEAN
Christophe HUGONIOT
Brigitte LION
Collection « Tables des hommes »
Presses universitaire de Rennes
Presses universitaires François-Rabelais
2013
!!""
Sous le regard de Rodin. Ré!exions sur les pratiques d’acculturation
dans l’iconographie de la consommation du vin étrusque"
Natacha Lubtchansky
Approches anthropologiques : la manière grecque ou étrusque de Rodin
Les assemblages
À partir de #$"%, Rodin se met à composer ce qu&on nomme les «'assem-blages'» ((g. #) : une (gure féminine, plus rarement masculine, placée à l&intérieur d&un vase ancien, tel qu&on en trouve dans sa collection d&objets archéologiques, coupes ou skyphoi grecs, coupes en bucchero étrusque, par exemple. C&est un type de composition qui se développera dans l&art contem-porain, consistant à inclure les objets de la vie quotidienne, ou plus généra-lement de la réalité, dans les œuvres). Ici, c&est l&objet archéologique qui est intégré dans la sculpture. Les «'assemblages'» de Rodin proposent un jeu
#. Ce dossier a été présenté une première fois lors du séminaire de master d&Alain *ote et Stéphane Verger, « Pratiques alimentaires et consommations cérémonielles », à l&EPHE, le $ juin +,,". Merci à Claude Pouzadoux pour son regard de « barbare » !
+. Garnier B., Rodin. L!Antique est ma jeunesse. Une collection de sculpteur, Paris, +,,+, p.'-#'sq. ; Id., «'Tel un dieu antique'», in Rodin, Freud, collectionneurs. La passion à l!œuvre, Catalogue d&exposition, Paris, +,,", p.'$! sq. ; Viéville D., «'Rodin, fragments et assemblages'», in Rodin, Freud…, op."cit., note +, p.'#.+ sq.
NATACHA LUBTCHANSKY
/,,!
avec la fonction du vase : le personnage, le plus souvent (guré nu, s&immerge dans le vase, y plonge ou en ressort, comme s&il était plein de vin.
La coupe d’Aulus Vibenna (inv. TC 980)
0uelques années auparavant, Rodin acquiert une coupe qui a dû inspirer ces #semblages1. C&est un vase devenu célèbre chez les céramologues, une kylix de près de !, cm de diamètre avec les anses, exécutée par un peintre de
!. D&après Viéville D., «'Rodin…'», art.'cit., note +, p.'#.+, n2 #%$./. Avant son passage dans la collection de Rodin, on connaît l&appartenance de la coupe à
celle de Désiré Raoul-Rochette. La collection du savant est mise en vente en #$%%, mais on perd ensuite la trace de la coupe, jusqu&à ce qu&elle soit identi(ée parmi les Antiques de la collection de Rodin, cf. Plaoutine N., «'An Etruscan Imitation of an Attic Cup'», Journal of Hellenic Studies %., #"!., p.'++-+.. Rodin ne commence sa collection d&an-tiques que vers #$"!.
Fig. $. Assemblage de Rodin, nu agenouillé penché vers l!avant dans une coupe3.
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/,#
(gures rouges vers !-, av. J.-C. ((g. +)4. Le médaillon représente deux satyres en plein jeu de vin : celui de droite au premier plan, couronné, est assis en équilibre sur le pied d&un cratère en calice. Le vase est renversé sur le sol, et le vin ruisselle. Notre satyre tire la barbichette de son compagnon, que Nicolas Plaoutine interprétait comme son serviteur. Celui-ci, debout au second plan, tient dans son dos une outre remplie d&une nouvelle provision de vin, pour prolonger la joie de ce kômos.
%. Plaoutine N. et Roger J., Corpus vasorum antiquorum. France $%, Musée national Rodin, Paris, #"/%, p.' !"-/#, pl.'+$-!,. Voir en dernier lieu l&article de Nina Strawczynski [«'Adaptations étrusques de vases athéniens'», in P.'Rouillard et A.'Verbanck-Piérard (dir.), Le vase grec et ses destins, Catalogue d&Exposition du musée Royal de Mariemont (+$ mai-+$'septembre +,,!) et du musée Calvet d&Avignon (mars-juin +,,/), Munich, +,,!, p.'#$.-#"+] qui résume les di5érentes propositions de datation.
-. Plaoutine N. et Roger J., Corpus vasorum antiquorum…, op. cit., note %, pl. !,, #.
Fig. &. Médaillon de coupe étrusque à 'gures rouges. [Musée Rodin, inv. TC "$,-]
NATACHA LUBTCHANSKY
/,+!
Ce motif du jeu avec le vin et les vases de son service, (guré sur la coupe antique, a bien retenu l&attention de Rodin : il revient dans une œuvre en marbre du sculpteur. Le Bacch( à la Cuve, daté de #",/, (gure un satyre à la romaine (il est aussi appelé Le Chèvre Pied)6, les quatre fers en l&air, s&en-fonçant dans un cratère plein de vin qui déborde de son récipient. L&œuvre montre le cheminement de la ré7exion de l&artiste depuis la coupe à (gures rouges en passant par les #semblages.
Or, la coupe à (gures rouges est étrusque : cela a été établi en #"!. par Nicolas Plaoutine8. Rodin, comme toutes les publications à partir de la seconde moitié du 9:9;'siècle, devait sans doute la considérer comme une œuvre grecque<. Aussi, le sculpteur s&est-il laissé inspiré par un esprit grec ou un esprit étrusque en reprenant le motif de cette coupe ? Les jeux avec le vase ou le vin, que ce soit celui des jeunes (lles de Rodin, qui se baignent dans une coupe, ou du satyre, qui fait l&équilibriste sur le pied d&un cratère retourné de manière déréglée, relèvent-ils d&une imagerie grecque ou étrusque ?
.. Viéville D., «'Rodin…'», art.'cit., note +, p.'#.+.$. Plaoutine N., «'An Etruscan Imitation…'», art.'cit., note /.". La plus ancienne publication du vase remonte à #$!-, cf. De Witte J.J.A.M., Description
des antiquités qui composent le cabinet de feu M. le Chevalier Durand, Paris, #$!-. Après la période d&étruscomanie –'essentiellement pendant le 9=:::;'siècle'– qui retenait tous les vases trouvés en Italie comme des œuvres d&ateliers étrusques, la connaissance d&une production grecque de la céramique (gurée se dessine peu à peu, pour être générale-ment admise vers le milieu du 9:9;'siècle : on regardera sur ce point Gran-Aymerich E. et Lubtchansky N., « Raoul-Rochette, Désiré », in Dictionnaire critique des historiens de l!art : http://www.inha.fr/spip.php?article+%,- (site consulté en juillet +,#,). Dans ce mouvement de réattribution, les vases de facture étrusque, moins nombreux que les vases grecs, ne sont pas identi(és comme tels, selon les critères en usage aujourd&hui. Les vases en bucchero restent identi(és comme étrusques. Les vases à (gures noires sont dans un premier temps maintenus comme étrusques, de même que la céramique corin-thienne. C&est le degré d&habileté du peintre qui est pris en compte pour établir son origine grecque ou étrusque. Voir Heurgon J., «'La découverte des Étrusques au début du 9:9;'siècle'», Comptes rendus des séances de l!Académie des inscriptions et belles-lettres, #".!, p.'%"#--,,. Repris dans Scripta Varia, Bruxelles, #"$- (Latomus'#"#), #"$-, p.'/-%-/.%. En ce qui concerne Rodin, les travaux actuels tendent à montrer que l&artiste a une connaissance précise de l&Antiquité. Dans un de ses textes, l&artiste semble plutôt s&in-téresser aux Étrusques pour leur sculpture et leur manière de (gurer le corps humain : «'Les Étrusques sont plus sombres'», dit-il à propos des statuettes étrusques [«'La leçon de l&antique : propos d&Auguste Rodin'», Le Musée. Revue d!art antique, vol.'I, n2'#, janvier-février #",/, p.'#%-#$. Article réédité dans De Butler A. (dir.), Auguste Rodin. Éclairs de pensée. Écrits et entretiens sur l!art, Paris, +,,!].
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/,!
Une spécificité étrusque dans l’iconographie du symposion ?
Ce regard de Rodin sur l&Antiquité, à travers sa collection archéologique et ses propres œuvres, me permet donc ici de relire les images étrusques du sympo-sion selon une perspective anthropologique, et de m&interroger sur ce qui, dans l&iconographie, fait qu&une représentation de symposion ou une scène liée au vin peut être identi(ée comme relevant d&un esprit grec ou étrusque. À part le fait assez bien connu que les femmes –'les matrones'– (gurent dans les banquets étrusques, à la di5érence de ce qui se passe à Athènes>?, y a-t-il dans l&image des indices précis d&un caractère étrusque de l&iconographie de la consommation du vin ? Cette interrogation se révèle d&autant plus délicate que l&iconographie étrusque de la consommation du vin, tout comme certainement la pratique même des Étrusques de boire le vin, sont inspirées par le modèle grec. Dans cette recherche de la spéci(cité étrusque de l&iconographie du symposion, la question est alors de comprendre comment fonctionne ce modèle grec.
Banquets «"barbares"» ou banquets à la grecque : ré!exions méthodologiques
Contacts culturels
0uand on s&intéresse à la culture étrusque et particulièrement au thème de la consommation du vin (guré dans les images, il importe en e5et de passer par une ré7exion de type anthropologique concernant le contact entre les cultures, ici grecque et étrusque>>. Dans ce dossier, il convient d&envisager la question de la reprise d&un motif iconographique grec par les Étrusques, mais aussi de prendre en compte le fait que les pratiques étrusques elles-mêmes sont empreintes des modes grecques de consommer le vin.
#,. Cf. in)a pour les images attiques (gurant aussi des épouses au symposion.##. Le concept d&acculturation, emprunté à l&anthropologie culturelle, est utile pour ce type
de ré7exion, mais il y en a d&autres : les Italiens (en particulier les chercheurs de l&uni-versité de Salerne) utilisent le néologisme de «'refonctionnalisation'». Plus tradition-nellement, on parle de modèle ou d&in7uence iconographique. En dernier lieu, et sur le thème de la consommation du vin, voir Cerchiai L. et d&Agostino B., «'Il banchetto e il simposio nel mondo etrusco'», *esaurus cultus et rituum antiquorum'II, +,,/, p.'+%/-+-.. Pour des questions de méthode, voir Gruzinski S. et Rouveret A., «'“Ellos son como ninos”. Histoire et acculturation dans le Mexique colonial et l&Italie méridio-nale avant la romanisation'», Mélanges de l!École )ançaise de Rome : Antiquité'$$, #".-, p.'#%"-+#" ; Cristofani M., «'Storia dell&arte e acculturazione: le pitture tombali arcaiche di Tarquinia'», Prospettiva ., #".-, p.'+-#,.
NATACHA LUBTCHANSKY
/,/!
C&est en fonction de cette interrogation anthropologique que mon propos se rattache aux ré7exions sur le banquet du monarque et du «'bar-bare'», développées dans ce volume. Il convient toutefois de préciser ce qu&on entend ici par «'barbare'», dans la mesure où le terme est emprunté aux sources grecques, qui portent, comme on va le voir, un regard stigmati-sant sur les mœurs étrusques. Il véhicule ainsi un jugement négatif sur cette culture non-grecque.
Athénée et le banquet «!barbare!» des Étrusques
Les textes anciens, et particulièrement Athénée de Naucratis, décrivent les banquets étrusques comme «'barbares'», c&est-à-dire comme luxueux et comme s&éloignant de la modération athénienne. Ils sont condamnables à cause du comportement des femmes mariées, aristocrates, qui y prennent part. L&auteur décrit ces banquets étrusques à deux reprises. Au livre I, où il cite Aristote, est évoquée la place des femmes qui «'banquettent avec les hommes, couchées sous la même couverture>)'». Au livre XII, la mention est plus précise et stigmatisante. La source d&Athénée est un autre historien du :=;'siècle, *éopompe de Chios, la «'plus mauvaise langue'» de l&historio-graphie antique (Cornelius Nepos)>3 :
*éopompe apud Athénée, Le Banquet des Savants, XII, %#.d : Les femmes des Tyrrhéniens se mettent à table non auprès de leur propre mari, mais auprès des premiers venus des assistants, et même elles por-tent la santé de qui elles veulent. Elles sont du reste fort buveuses et fort belles à voir.>1
Ce comportement des femmes est ce qu&il y a de plus connu. Mais la suite du passage implique aussi les jeunes gens, et évoque les pratiques éro-tiques qui ont cours lors de ces banquets :
Les Tyrrhéniens élèvent tous les enfants qui viennent au monde, ne sachant de quel père est chacun d&eux. Ces enfants vivent de la même façon que leurs nourriciers, passant la plupart du temps en beuveries, et ayant commerce avec toutes les femmes indistinctement. Il n&y a point
#+. Athénée, Le Banquet des Sophistes, I, +!d.#!. La citation est de Jacques Heurgon (La vie quotidienne chez les Étrusques, Paris, #"-#, p.'/$).#/. Athénée, Le Banquet des Sophistes, XII, %#.d sq. La traduction est d&Alexandre-Marie
Desrousseaux, transmise par Jacques Heurgon (La vie quotidienne…, op."cit., note #!, p.'/$-/").
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/,%
de honte pour les Tyrrhéniens à être vus eux-mêmes faisant en public un acte vénérien, ni même le subissant ; car cela est aussi une mode du pays. Et ils sont si loin de regarder la chose comme honteuse que, lorsque le maître de maison est à faire l&amour, et qu&on le demande, ils disent : «'Il fait ceci ou cela'», donnant impudemment son nom à la chose. Lorsqu&ils ont des réunions, soit de société, soit de parenté, ils font comme ceci : d&abord, quand ils ont (ni de boire, et sont disposés à dormir, les serviteurs font entrer auprès d&eux, les 7ambeaux encore allumés, tantôt des courtisanes, tantôt de fort beaux garçons, tantôt aussi leurs femmes ; lorsqu&ils ont pris leur plaisir avec eux ou elles, ce sont des jeunes gens en pleine force qu&ils font coucher avec ceux ou celles-là. Ils font l&amour et prennent leurs ébats parfois à la vue les uns des autres, mais le plus souvent en entourant leurs lits de cabanes faites de branches tressées, et en étendant dessus leurs manteaux.
Ces symposia étrusques font partie des banquets démesurés, décrits et condamnés par Athénée. En e5et, ils se rattachent aux comportements de la truphè, auxquels s&est particulièrement intéressée la littérature grecque du :=;'siècle av. J.-C.>4. Or, pour certaines de ces traditions sur les ban-quets, recueillies par Athénée et ses sources, il est permis de mettre au jour un (lon historiographique, d&orientation assez di5érente, à l&origine des notices transmises.
Par exemple, concernant les valses de cavaliers, qui étaient présentées au cours des banquets sybarites, pour servir de distraction à cette voluptueuse population, comme Athénée nous le raconte, il est plus pertinent de retenir que ces pratiques étonnantes recouvrent des comportements d’habrosuné –'plutôt que de truphè"–, qu&une enquête à la fois historique et ethnographique permet de décrypter>@. Loin d&être devenue une cité s&adonnant entièrement à la mol-lesse –'selon le point de vue des auteurs qui stigmatisent la truphè"–, Sybaris, jusqu&à la (n du =:;'siècle, a su développer des techniques de cavalerie parti-culièrement sophistiquées pour le combat, qui ont pu donner lieu à des spec-tacles particuliers, mais qu&une partie des Grecs, et en l&occurrence Athènes, qui a valorisé le combat hoplitique, n&était pas prête à envisager autrement que
#%. Sur la truphè, voir Passerini A., «'La tryphé nella storiogra(a ellenistica'», Studi italiani di 'lologia classica ", #"!/, p.'!%-%- ; Cozzoli U., «'La tryphè nella interpretazione delle crisi politiche'», in Tra Grecia e Roma. Temi antichi e metodologie moderne, Rome, Biblioteca internazionale di cultura, !, #"$,, p.'#!!-#/, ; Nenci G., «'Tryphé e coloniz-zazione'», in Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes, Actes du colloque de Cortone (&+-,- mai $./$), Pise-Rome, Collection de l&École fran-çaise de Rome, -., #"$!, p.'#,#"-#,!#.
#-. Lubtchansky N., Le cavalier tyrrhénien. Représentations équestres dans l!Italie archaïque, Rome, +,,%, p.'%,'sq.
NATACHA LUBTCHANSKY
/,-!
comme des développements techniques «'barbares'». Il s&agit donc, dans une perspective anthropologique, de retrouver, derrière ces topoi littéraires, une autre réalité, et de comprendre de quelle manière elle a été déformée.
Nous ne ferons pas autrement ici, avec la tradition sur ces banquets inconvenants des Étrusques : les représentations (gurées nous fournissent une documentation en mesure de nous faire comprendre ce que recèlent ces racontars transmis par Athénée>6.
Travaux antérieurs sur le banquet étrusque et ses représentations figurées
La question du banquet étrusque, ou plus précisément du symposion, n&a certes pas été négligée dans les travaux des trente dernières années. Loin de là. Outre les deux passages bien connus d&Aristote et de *éopompe, la docu-mentation archéologique étrusque, qui est souvent liée à cette question du symposion, a été amplement étudiée. En e5et, de nombreuses représentations (gurées se rattachent à ce thème, et les mobiliers archéologiques provenant des tombes sont en grande partie des pièces appartenant au service du ban-quet. Les travaux d&analyse s&inscrivent dans une ré7exion sociale et cultu-relle. Ils ont souligné la fonction valorisante de ces documents, qui indiquent le statut privilégié –'aristocratique'– de leur propriétaire>8. Ils s&intéressent d&autre part à mettre en évidence les in7uences proche-orientales ou grecques
#.. Les images étrusques forment un langage bien spéci(que, qu&il faut considérer en tant que tel. Ainsi, par rapport aux pratiques de banquet envisagées, elles ne sauraient les reproduire automatiquement ; elles rendent compte de ces pratiques à travers un (ltre culturel. Il faut prendre en compte le lien de l&image par rapport à la pratique, ainsi que le lien de l&image par rapport au modèle grec, car les ateliers répondent aux deside-rata des commanditaires mais aussi aux modes formelles, en l&occurrence aux modèles iconographiques grecs contemporains (mode ionienne à l&époque archaïque ; mode attique à l&époque classique : voir in)a).
#$. De nombreux travaux de synthèse vont dans ce sens, notamment ceux de Mauro Cristofani [Saggi di storia etrusca, Rome, #"$. ; «'I santuari: tradizioni decorative'», in M. Cristofani (dir.), Etruria e Lazio arcaico, Atti dell!incontro di studio (Rome, $--$$"no0embre $./%), Rome, #"$., p.'"%-#+,] et Filippo Delpino («'Il principe e la ceremonia del banchetto'», in Principi etruschi, tra Mediterraneo ed Europa, Catalo-gue d&exposition, Bologne, +,,,, p.'#"#-++,). On consultera aussi les contributions aux colloques généraux sur la consommation du vin antique, comme celles d&Annette Rathje [«'*e Adoption of the Homeric Banquet in Central Italy in the Orientalizing Period'», in O.'Murray (dir.), Sympotica. A Symposium on the Symposion, Oxford, #"", (#A;'édition en #"$/), p.'+."-+$$] et Angela Pontrandolfo [«'Simposio e Élites sociali nel mondo etrusco e italico'», in O.'Murray et M. Tecusan (dir.), In vino veritas, Oxford, #""%, p.'#.--#"%].
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/,.
qui ont joué dans la formation de la tradition étrusque de la consommation du vin><, ainsi que les formes proprement locales de cette pratique)?.
En ce qui concerne plus particulièrement les représentations (gurées, elles ont fait l&objet de plusieurs travaux de Bruno d&Agostino et Luca Cerchiai, qui, en dernier lieu, ont rédigé la notice du *esaur( cult( 1 rituum antiquorum sur le symposion étrusque)>. Ces deux auteurs ont valorisé tout particulièrement la matrice grecque des images de la consommation du vin, en allant jusqu&à proposer que «'l&Étrurie est une des provinces de la culture grecque))'». Faut-il voir une provocation dans cette assertion ? Les Étrusques dépendent-ils à ce point des modèles grecs ? Sont-ils à ce point experts dans la pratique du sym-posion à la mode grecque, ce qui alors démentirait la vision de la barbarie du banquet étrusque, qui est dénoncée par les textes anciens ? Il nous faut donc dans un premier temps apprécier ce degré d&hellénisation de la culture étrusque du vin, que nous envisagerons à travers deux exemples.
Deux histoires d’outre au kômos étrusque
Ces deux dossiers montrent que la question reste aujourd&hui délicate. Chaque document n&o5re en e5et pas une lecture tout à fait limpide du contexte de création et de réception de l&image. Il en résulte qu&il n&est pas facile d&apprécier ce degré d&hellénisation des Étrusques)3.
#". Sur le modèle homérique, voir Rajthe A., «'*e Adoption of the Homeric Banquet…'», art.'cit., note #$.
+,. Pour la valorisation des éléments autochtones, voir Torelli M., «'Primi appunti per un&antropologia del vino degli Etruschi'», in D. Tomasi et C. Cremonesi (dir.), L!avventura del vino nel Bacino del Mediterraneo. Itinerari storici ed archeologici prima e dopo Roma (Simposio internazionale, Conegliano, ,- settembre-& ottobre $../), Conegliano, +,,,, p.'$"-#,,.
+#. Cerchiai L. et d&Agostino B., «'Il banchetto…'», art. cit., note ##, avec la bibliographie antérieure.
++. Id., Il mare, la morte, l!amore. Gli Etruschi, i Greci e l!immagine, Rome-Paestum, #""", p.'XIX. Pour une présentation de la démarche des auteurs, voir Rouveret A., «'Rites et imaginaire de la mort dans les tombes étrusques archaïques'», Cahiers des thèmes trans-versaux ArScAn II. *ème +. Images, textes et sociétés, +,,,-+,,#, p.'#"$-+,%. Agnès Rouveret confronte une démarche di5érente développée par Mario Torelli, dans la mesure où elle met davantage en évidence l&importance des traditions locales étrusco-italiques, cf.'Torelli'M., Il rango il rito e l!immagine. Alle origini della rappresentazione storica romana, Milan, #""..
+!. Voir les deux attitudes opposées par rapport à la culture hellénisante des Étrusques : Hampe'R. et Simon E., Griechische Sagen in der )ühen etrusckischen Kunst, Mayence, #"-/ ; Camporeale G., «'Banalizzazioni etrusche di miti greci III'», Studi Etruschi !., #"-", p.'%"-.-.
NATACHA LUBTCHANSKY
/,$!
Première histoire d’outre : le lever de jambe (*anaskelos) et le jeu de l’outre (askoliasmos)
Le premier dossier nous est o5ert par le corpus nombreux des tombes peintes de Tarquinia, qui mettent souvent en image des scènes de symposion et de kômos, particulièrement à l&époque archaïque. Ces scènes ont été longue-ment étudiées par Bruno d&Agostino et Luca Cerchiai, qui ont montré le haut degré de culture hellénisante qu&il faut repérer dans cette iconographie de la consommation du vin)1. Je mettrai l&accent sur un exemple, développé par Luca Cerchiai, parce qu&il souligne la diBculté d&établir ce contexte de réception de la culture grecque en Étrurie)4.
L&auteur a mis en évidence la récurrence, dans les images de banquet et de kômos, d&un mouvement du corps, qui lui semble propre à la ges-tuelle grecque du culte de Dionysos Or2os, «'il dio che “fa balzare” (pedan) sotto la spinta dell&entusiasmo del vino)@'». Ce mouvement consiste, pour les banqueteurs pris de vin, à lever la jambe : c&est l’*an#kelos, qu&on peut repérer, selon l&auteur, dans plusieurs tombes peintes, la Tombe de la Souris, la Tombe des Inscriptions ((g.'!) et la Tombe des Olympiades,
+/. Voir la bibliographie donnée dans Cerchiai L. et d&Agostino B., «'Il banchetto…'», art.'cit., note ##.
+%. Cerchiai L., «'La Tomba del Topolino'», Annali dell!Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione Archeologia e storia antica $, +,,#, p.'""-#,/.
+-. Ibid., p.'"".+.. Weber-Lehmann C., «'Spätarchaische Gelagebilder in Tarquinia'», Mitteilungen des
Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung "+, #"$%, p.'#"-//, pl.'##, !.
Fig. ,. Tombe des Inscriptions de Tarquinia. Fronton de la paroi d!entrée)6.
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/,"
toutes à Tarquinia. Il faut donc supposer que les commanditaires de ces tombes et/ou leur peintre faisaient ainsi référence à un des moments du symposion grec, jusque dans les détails précis de sa chorégraphie. À tel point que, comme le souligne l&auteur, dans la Tombe de la Souris, l&hippocampe du fronton aussi «'soulève la jambe'».
À y regarder de près, toutefois, le dossier sur l’*an#kelos n&est pas aussi clair. Les articles des linguistes rappellent que l’*an#kelos n&est qu&une reconstitution supposée des modernes à l&origine d&un jeu ou d&un geste rituel, qui est mentionné au plus tôt par Didyme, soit à la (n du :;A'siècle av.'J.-C. Ce jeu est alors désigné par le verbe #koliazein et rap-proché d’#kos (outre), par une étymologie populaire. Il s&agit de «'sauter à cloche-pied sur une outre gon7ée d&air et enduite de graisse'», selon une description, chez Suétone, d&un jeu qui existe à son époque)8. Mais la véritable étymologie est *an#kelos (ana et skelos), terme non attesté impliquant que le mouvement consistait simplement, à l&origine, à lever la jambe, sans intervention d&outre.
Faut-il donc supposer que les Étrusques reproduisent un geste ancien, l’*an#kelos, qui, en Grèce, n&était pas encore lié à l&outre ? A-t-on d&autres traces de l&existence du mouvement de lever la jambe en Grèce, à part cette reconstitution étymologique ? Les satyres ((g.'/) et les banqueteurs des vases attiques sont aussi souvent (gurés à demi allongés au symposion, en train de lever une jambe, ou debout, en équilibre sur un pied. Le corpus de ces représentations est à construire, de même que sont à établir les liens de ce geste avec celui, habituel, du banqueteur à demi couché, une jambe 7échie, le pied posé sur la kliné, ou bien celui d&un danseur qui, lors du kômos, se tient sur une jambe. Ces images sont nombreuses. Il convient peut-être aussi, dans un premier temps, de laisser de côté les mots : il semble hasardeux de rapprocher ces satyres levant la jambe, sur les images, avec le culte de Dionysos Orthos ou celui de Dionysos Sphaleô3s)<, et plus encore avec l&ancêtre du jeu de l&outre, l’*an#kelos ((g.'/). Notons, dès à présent, que ces satyres attiques sont en tout cas les cousins des satyres à la jambe levée du fronton de la Tombe des Inscriptions ((g.'!). Le motif existe ; il est partagé par les deux cultures3?.
+$. Taillardat J., Suétone. Des termes injurieux, des jeux grecs, Paris, #"-., p.'#.#.+". Détienne M., Dionysos à ciel ouvert, Paris, #"$-, p.'.!'sq. ; Lissarrague F., Un 4ot d!images.
Une esthétique du banquet grec, Paris, #"$., p.'-- sq.!,. Selon Cornelia Weber-Lehmann («'Spätarchaische Gelagebilder…'» art.'cit., note +.,
p.'!+), ce geste est lié aux excès du kômos.
NATACHA LUBTCHANSKY
/#,!
L’outre d’Aulus Vibenna
La seconde histoire d&outre nous est donnée par la coupe Rodin. Elle montre à nouveau qu&il est diBcile d&apprécier de quelle manière la culture grecque est reçue par les Étrusques. La collection la plus anciennement connue à laquelle ait appartenu la coupe Rodin est celle du Chevalier Durand, dont le catalogue rédigé par Jean J.A.M. de Witte date de #$!-3). Même si ce catalo-gue fait provenir la coupe de la région des Pouilles, c&est toutefois majoritai-rement à partir des fouilles du site de Vulci que s&est constituée la collection du Chevalier33. C&est la provenance géographique du vase que l&on peut proposer, à titre d&hypothèse.
Une con(rmation est apportée par l&inscription peinte avant cuisson sur le vase31. Le texte avles vpin#/naplan a été expliqué par Jacques Heurgon comme désignant le nom du vase ainsi que son propriétaire : «'l&outre d&Aule Vipinas'», c&est-à-dire, selon l&auteur, la «'coupe d&Aulus Vibenna34'». Or, Aulus Vibenna est un héros de Vulci, qui, au =:;'siècle, aurait aidé le roi
!#. Lissarrague F., Un 4ot d!images…, op. cit., note +", (g. %!.!+. De Witte J.J.A.M., Description des antiquités…, op."cit., note ", p.'/-, n.'#!/. Voir supra.!!. Voir le commentaire dubitatif de Nicolas Plaoutine sur cette provenance des Pouilles :
Plaoutine N. et Roger J., Corpus vasorum antiquorum…, op."cit., note %, p.'/#.!/. Le vase a donc été conçu avec l&inscription, qui n&a pas été rajoutée dans un second temps
à Vulci.!%. Heurgon J., «'La coupe d&Aulus Vibenna'», in J. Heurgon, G. Picard et W.'Seston (dir.),
Fig. +. Détail d!un canthare attique du peintre de Brygos3>.[New York, Metropolitan Museum of Arts inv. #+.+!/.%]
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/##
Servius Tullius à prendre le trône à Rome : pour les commentateurs du vase, la référence au héros légendaire de Vulci rehausse le prestige de la coupe, en certi(ant qu&elle a appartenu à un grand personnage3@. Voilà donc con(rmé le lien du vase avec Vulci.
On a depuis longtemps rapproché la coupe Rodin d&une autre coupe, attique, peinte par le peintre d&Œdipe, dont la provenance de Vulci est cette fois certi(ée36. Les décors extérieurs des deux coupes, celle du peintre d&Œdipe et celle de Rodin, semblent calqués l&un sur l&autre ((g.'%38) ; plus précisément, il n&y a pas d&autre solution pour expliquer les similitudes entre les vases que de supposer que le peintre de la coupe Rodin avait celle du peintre d&Œdipe sous les yeux pour exécuter, à main levée, le décor extérieur de son vase.
Ceci montre l&ascendance de la culture grecque sur les Étrusques, du point de vue des techniques de la céramographie mais aussi pour ce qui concerne l&iconographie du vin : le kômos (guré à l&extérieur de la coupe Rodin témoigne des processus d&acculturation entre Athènes et Vulci, allant jusqu&à ne laisser aucune place à une originalité étrusque. Nicolas Plaoutine va même plus loin dans l&appréciation négative du travail du peintre étrusque : la coupe Rodin étant d&un diamètre inférieur à la coupe du peintre d&Œdipe, le peintre a dû supprimer deux personnages de la scène externe. La suppres-sion du Silène enfant, sur le vase étrusque, laisse seul avec sa sandale mena-çante le Silène qui s&apprête à corriger le plus jeune : le sens en est donc perdu, et le peintre étrusque ne semble pas s&en être rendu compte.
Ainsi, en reprenant quasiment à l&identique un modèle attique de kômos, les Étrusques ne semblent pas être les meilleurs représentants de la culture grecque, puisque c&est avec une certaine passivité, voire une réelle incompréhension, que le motif est reproduit, avec la reprise erronée du châ-timent à la sandale3<.
0uant au médaillon ((g. +), qui ne reprend pas le dessin de celui de la coupe du peintre d&Œdipe, il est aussi très proche de compositions attiques,
Mélanges d!archéologie, d!épigraphie et d!histoire o5erts à Jérôme Carcopino, Paris, #"--, p.'%#%-%+-.
!-. Une synthèse de cette question est aussi présentée par Nina Strawczynski («'Adapta-tions étrusques de vases athéniens'», art. cit., note %).
!.. Plaoutine N., «'An Etruscan Imitation…'», art. cit., note /. Et plus récemment, Strawczynski N., «'Adaptations étrusques de vases athéniens'», art. cit., note %. La coupe est conservée au Vatican, Musée grégorien étrusque, inv. #-.%/#.
!$. Strawczynski N., «'Adaptations étrusques de vases athéniens'», art. cit., note %, (g. ! et /.!". Mais on peut aussi concevoir qu&une autre scène est ainsi créée avec la suppression de
l&enfant. Le satyre à la sandale se dirige désormais vers le dernier personnage à droite, qui a aujourd&hui disparu. Il a pu composer avec le satyre à la sandale une scène pleine de sens, qui nous échappe par son aspect lacunaire.
NATACHA LUBTCHANSKY
/#+!
Fig. 6a et b. Comparaison de la scène extérieure de la coupe du musée Rodin, in0. TC ./-, et de la coupe du Vatican, in0. $%.6+$.
comme on en voit chez le peintre de Panaitios1?. Il n&y a pas d&innovation étrusque dans cette iconographie du satyre irrespectueux, à califourchon sur le cratère renversé : l&image paraît composée dans un esprit tout à fait grec, et non «'barbare'», étrusque. Par rapport au kômos externe, néanmoins, il y a ici un élément qui dénote une intervention du peintre ou du commanditaire
/,. Strawczynski N., «'Adaptations étrusques de vases athéniens'», art.'cit., note %.
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/#!
étrusque. Jacques Heurgon, on l&a vu, lit l&inscription peinte comme une évocation feinte1> du prestigieux propriétaire de la coupe, Aulus Vibenna. Pourtant, si le terme «'naplan'» désigne bien l&outre, ne renvoie-t-il pas plutôt ici à l&outre portée par le satyre du second plan, plutôt qu&à la coupe porteuse de l&image ? Il y aurait alors peut-être dans cette inscription un jeu de mots que nous ne comprenons plus, évoquant cette outre, d&un des frères Vibenna, qu&on apporte au kômos des silènes.
Comme pour le dossier précédent, il convient donc, pour comprendre ces images, de se placer à la frontière entre les deux cultures, la culture grecque et la culture étrusque. L&aristocratie étrusque connaissait sans doute très bien la consommation du vin selon la lettre grecque et, dans son mode de réception de la culture grecque, elle incluait des éléments de sa propre culture. Ainsi d&Athènes à Tarquinia, à la (n du =:;'siècle, même si nous ne comprenons plus aujourd&hui toutes les signi(cations du geste de lever la jambe au banquet, nous percevons une communauté de représentation ; d&Athènes à Vulci, au début du :=;'siècle, nous comprenons l&image de la punition à la sandale, mais se dessine (nalement un hiatus entre les deux cultures, qu&il s&agisse de la san-dale du silène (à rattacher au monde grec) ou du héros vulcien, Aulus Vibenna (à rattacher au monde étrusque).
Des topoi sur la barbarie étrusque au principe d’altérité
Après ce premier développement, qui illustre l&impossibilité de généraliser un discours sur la manière dont fonctionnait le modèle grec dans l&icono-graphie étrusque, et la nécessité de prendre en compte chaque contexte de l&image individuellement, chaque milieu de création et de réception de celle-ci, revenons aux topoi littéraires sur le banquet étrusque, ou plutôt à ce que nous enseignent les images sur ces topoi, à savoir la participation des femmes et les comportements d’hubr7.
L&appréciation de ces deux topoi doit prendre en compte ce qu&on pour-rait appeler la norme grecque de la consommation du vin ou, pour nous référer à une expression de François Lissarrague, «'l&expérience grecque du vin1)'». À cet égard, en e5et, les travaux menés après les années #"., sur le symposion ont valorisé deux notions, celle d&identité et celle d&altérité, qui sont utiles pour cette ré7exion d&ordre anthropologique sur le rapport entre banquet grec et banquet barbare (ou non-grec).
/#. Car la coupe est plus récente de deux siècles./+. Lissarrague F., Un 4ot d!images…, op."cit., note +", p.'..
NATACHA LUBTCHANSKY
/#/!
La culture grecque du vin : «!le bon usage du vin!» et ses transgressions
Ces travaux, qui se sont développés en France, en Grande-Bretagne et en Italie, ont dé(ni ce qu&est le bon usage du vin, qui composait cette identité grecque, en soulignant les di5érentes transgressions, constamment sous-jacentes dans la pratique13. Dans le cadre de la consommation du vin, le principe d&altérité opèrait sur plusieurs plans. J&en évoquerai seulement deux, car ils ont un lien avec les topoi sur le banquet étrusque.
Le premier concerne l&opposition entre mesure et démesure. En partant de la documentation littéraire grecque, Ezio Pellizer a en e5et reconstruit une morphologie du symposion, en évoquant les règles du bien boire, repo-sant sur le mélange vin et eau11. Il met ainsi en évidence la dichotomie entre le symposion et la danse du kômos, où de nombreux excès sont permis. Cette opposition entre symposion et kômos a d&autre part été interprétée par Oswyn Murray en termes juridiques14. L&auteur britannique rattache les excès du kômos à l’hubr7, qui (t l&objet d&une loi de Solon précisément, en relation avec la pratique du symposion. Il compare ainsi cette limitation de l’hubr7 du kômos aux lois somptuaires, qui avaient pour but de limiter la puissance aris-tocratique à la vue de tous, dans la mesure où la danse du kômos se déroulait à l&extérieur, en public. C&est dans ce cadre qu&on trouve des images qui sont très proches de celles des assemblages de Rodin, et que le contexte transgressif du kômos permet d&expliquer ((g.'-)1@.
La seconde opposition est envisagée d&un point de vue social et anthro-pologique. Elle s&observe entre les citoyens, masculins et aristocrates, qui par-ticipent à la consommation du vin sur un pied d&égalité à Athènes, et ceux
/!. C&est en premier lieu le cas de François Lissarrague (Un 4ot d!images…, op."cit., note +").//. Pellizer E., «'Outlines of a Morphology of Sympotic Entertainment'», in O. Murray
(dir.), Sympotica…, op."cit., note #$, p.'#..-#$/./%. Murray O., «'La legge soloniana sulla hybris'», Annali dell!Istituto Universitario Orien-
tale di Napoli. Sezione Archeologia e storia antica ", #"$., p.'##.-#+%./-. C&est le cas sur ce médaillon d&une coupe attique à (gures rouges à Oxford, avec un jeune
homme se baignant dans un cratère : Oxford, inv. #"+". /-% (CVA, Grande-Bretagne'", Oxford +, pl. %#, !). On trouve d&autres exemples, où le protagoniste est un satyre qui joue à l&intérieur d&un vase à vin : lécythe attique à (gures rouges de Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, inv. B #$#/ (CVA, Allemagne ., Karlsruhe, Badisches Landesmu-seum'#, pl.'+-, /) ; coupe attique à (gures rouges de Genève, Musée d&Art et d&Histoire, inv.'#-'",# (CVA, Suisse #, Genève, Musée d&Art et d&Histoire #, pl. ") ; coupe attique à (gures rouges de Vienne, Kunsthistorisches Museum, inv. #"!, (CVA, Austria #, Vienna, Kunsthistorisches Museum #, pl.'+, !).
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/#%
qui, soit en sont exclus –'c&est le cas des femmes18'–, soit le consomment sans en respecter les règles –'c&est le cas des Barbares, qui sont stigmatisés par les auteurs anciens et les buveurs, qui appartiennent au temps du mythe et du monde sauvage (par exemple Polyphème1<, les satyres, etc.).
Ces deux principes d&altérité sont-ils repris dans l&iconographie de la consommation du vin étrusque ? Les Étrusques consomment-ils le vin comme des «'barbares'», ou au contraire adoptent-ils ces règles du bien boire, repo-sant, selon ce que nous apprennent les chercheurs, sur ce principe d&altérité ?
La participation des femmes au symposion étrusque
Le premier topos sur la barbarie des banquets étrusques concerne la participa-tion des femmes, dont on a vu qu&elle ne serait pas concevable à Athènes. Les images semblent concorder avec la tradition littéraire. En e5et, sur di5érents types de support –'décors architecturaux en terre cuite, vases en céramique peints, peinture funéraire'– et dès l&époque orientalisante, on observe que la
/.. D&après CVA, Great Britain ", Oxford +, pl. %#, !./$. On ré7échira sur les propos de François Lissarrague : «'Le symposion est un moment de
convivialité masculine […]. Il n&y a pas de place pour les femmes. Les épouses n&assistent pas au symposion, ni les (lles. Les seules femmes présentes le sont à titre d&accessoires, si l&on peut dire : compagnes de plaisir, servantes ou musiciennes.'» Lissarrague'F., «'Femmes au (guré'», in P.'Schmitt-Pantel (dir.), Histoire des femmes en Occident I : L!Antiquité, Paris, #""#, p.'+!".
/". Id., Un 4ot d!images…, op."cit., note +", p.'--.
Fig. %. Médaillon de coupe attique à 'gures rouges du peintre Euergides16.[Oxford, Ashmolean Museum, inv. 1929. 465]
NATACHA LUBTCHANSKY
/#-!
femme, et plus précisément l&épouse, participe au symposion et au kômos. Là encore, les travaux de Bruno d&Agostino sont pionniers4? : il a proposé le terme de symposia ou de kômoi conjugaux, expressions qui n&auraient aucun sens en Grèce, pour désigner ces scènes où le vin est partagé au sein du couple conjugal et où la danse, qui suit la consommation, est exécutée par le seigneur étrusque et son épouse. L&auteur a d&ailleurs analysé le fronton du fond de la seconde chambre de la Tombe de la Chasse et de la Pêche, en mettant en évidence une spécialisation des deux moitiés de l&espace ((g.'.) : celle de droite consacrée à l&homme, celle de gauche au mund( muliebr74>. Ainsi, ce banquet étrusque a toute l&apparence d&un banquet grec, mais il reste «'barbare'», dans la mesure où nous voyons l&épouse comme protagoniste de la scène. Pourtant, cela est-il bien certain ? Cette présence de la femme relève-t-elle vraiment d&un compor-tement «'barbare'» ? C&est ce que semblent nous dire les auteurs du :=;'siècle, Aristote et *éopompe, conservés par Athénée. Or, les images attiques plus anciennes, dès la (n du =:;'siècle, n&adoptent pas ce discours univoque.
Les travaux des quinze dernières années sont en e5et revenus sur la place de la femme dans la société grecque, particulièrement dans son rapport au vin43. Pauline Schmitt-Pantel a ainsi souligné comment des critères d&orienta-tion historiographique de la recherche, particulièrement sur l&homoérotisme, peuvent expliquer qu&on ait trop rapidement identi(é toutes les femmes, participant aux scènes de la consommation du vin et du banquet, comme des hétaïres ou des servantes, par opposition aux jeunes gens41. Ces derniers n&ont (nalement pas un rôle si di5érent dans les scènes retenues par l&auteur. De plus, rien dans l&image ne permet d&identi(er le statut sociologique des
%,. D&Agostino B., «'L&immagine, la pittura e la tomba nell&Etruria arcaica'», Prospettiva'!+, #"$!, p.'+-#+.
%#. Ibid.%+. Weber-Lehmann C., «'Spätarchaische Gelagebilder…'», art.'cit., note +., pl.'%, /.%!. Villard L., «'Le vin et les femmes : un texte méconnu de la collection hippocratique'»,
Revue des études grecques #,$, #""%, p.'!/-!% ; Noël D., «'Femmes au vin à Athènes'», Archives de sciences sociales des religions #,., #""", p.'#/.-#$%.
%/. Schmitt-Pantel P., «'Le banquet et le “genre” sur les images grecques, propos sur les com-pagnes et les compagnons'», Pallas -#, +,,!, p.'$!-"%.
Fig. 8. Tombe de la Chasse et de la Pêche de Tarquinia. Fronton de la paroi du fond4).
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/#.
di5érentes femmes étudiées et d&en faire systématiquement des dépendantes. Convient-il par conséquent de revoir ce caractère «'barbare'» de l&iconogra-phie de la femme étrusque au banquet, dans la mesure où les Athéniens, déjà, sur leurs vases peints, (guraient le pendant féminin du citoyen grec, manipu-lant et consommant le vin ?
Un courant de la littérature archéologique a proposé une interprétation alternative à ce phénomène de développement de l&iconographie féminine du vin à Athènes. Les vases (gurant des femmes au banquet auraient été destinés à la clientèle étrusque, ce qui explique la création de cette iconographie étran-gère aux mentalités grecques. Ces images n&illustreraient pas un autre type de société grecque, auquel la recherche n&avait pas suBsamment prêté atten-tion, mais elles répondraient à leur contexte de réception étrusque. Cette hypothèse a été proposée pour la première fois par Cornelia Isler-Kerényi, à propos des 9amnoi attiques à (gures noires, dont la forme est uniquement attestée dans le service étrusque du vin44. De cette forme étrusque, adoptée par les ateliers attiques pour leur clientèle habituelle, on peut ainsi passer à une iconographie de type étrusque, elle aussi pour décorer le vase. Le 9amnos de Würzburg a été exécuté à Athènes pour une clientèle étrusque, qui pou-vait apprécier aussi bien la forme du vase (9amnos) que son iconographie (banquet de couples maritaux), toutes deux typiquement étrusques ((g.'$)4@. L&hypothèse a ensuite été étendue, en particulier par Sian Lewis, à d&autres types de productions attiques adoptant des scènes féminines en général46. Malgré la pertinence du dossier sur les 9amnoi, beaucoup d&hellénistes ne sont toutefois pas prêts à suivre cette interprétation48.
Si le symposion du 9amnos de Würzburg, par exemple, semble très voi-sin de celui du fronton de la Tombe de la Chasse et de la Pêche ((g.'.), ce qui fait la spéci(cité de l&iconographie étrusque n&est (nalement pas tant l&aspect conjugal du banquet, auquel participent des couples mariés, que la version familiale de cette scène. Dans la scène de la Tombe de la Chasse et de la Pêche de Tarquinia, on peut en e5et parler de symposion familial, car ce sont les membres de la maisonnée (le couple, certes, mais aussi les enfants et les domestiques) qui sont les acteurs de cette cérémonie, imitant les di5érents
%%. Isler-Kerényi C., Stamnoi, Lugano, #"...%-. Weber-Lehmann C., «'Spätarchaische Gelagebilder…'», art.' cit., note +., p.' +# ;
Beazley'J.D., Attic Black-'gure Vase-painters , Oxford, #"%-, p.'!/+, /.%.. Lewis S., «'ShiCing Images: Athenian Women in Etruria'», in T. Cornell et K. Lomas
(dir.), Gender and Ethnicity in Ancient Italy, Londres, #""., p.'#/#-#%/.%$. Voir par exemple Schmitt-Pantel P., «'Le banquet et le “genre”…'», art.'cit., note %!,
p.'$-, n.'#/.
NATACHA LUBTCHANSKY
/#$!
gestes et comportements qui sont ceux des banqueteurs athéniens@?. Il y a une réinterprétation en terme familiaux de la pratique citoyenne grecque. Ce qui (nalement peut sembler barbare.
Les images de détournement existent-elles ?
Le second dossier choisi pour analyser ces topoi étrusques du banquet o5re une conclusion semblable. Les comportements transgressifs que l&on peut pointer dans les images étrusques trouvent une explication dans le cadre de l&oppo-sition grecque symposion/kômos. Il semble ainsi demeurer, entre production étrusque et production grecque, une communauté idéologique, même si des
%". Weber-Lehmann C., « Spätarchaische Gelagebilder… », art. cit., note +., pl. !#, #.-,. Lubtchansky N., «'Divine ou mortelle ? Les femmes de la Tombe du Baron de Tarqui-
nia'», in F.-H. Massa Pairault (dir.), L!image antique et son interprétation, Rome, +,,-, p.'+#"-+!-.
Fig. /. Stamnos attique de Würzburg4<. [Martin von Wagner Museum]
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/#"
di5érences singularisent chacune d&elles. Ainsi, en considérant le motif du kômos dans les fresques étrusques, on peut observer des cas de renversement de la norme, comme c&est le cas sur les vases attiques, lorsque les satyres, ou même de simples kom#tes, jouent avec les vases à vin.
Une petite série de tombes (gure en e5et des kom#tes masculins, a5ublés du bonnet aristocratique féminin, le tutul(, proposant ainsi des images de transgression. Au kômos, qui se développe sur les quatre parois de la première chambre de la Tombe de Chasse et de la Pêche, participe un aulète (guré à demi couché sur le sol, une jambe levée (!). Il ne porte aucun vêtement, à l&exception d&un bonnet pointu à motif de 7eurs sur la tête, un couvre-chef qui a tout l&air du tutul( féminin ((g.'")@>. On retrouve le même procédé dans la Tombe des Inscriptions de Tarquinia. Trois des kom#tes qui dé(lent sur la moitié droite de la tombe, portent un bonnet proéminent, assorti de couronnes ((g.'#,)@). Les deux peintres ont-ils voulu précisément (gurer le couvre-chef féminin et déguiser ainsi nos kom#tes en femmes, en leur faisant ainsi adopter un comportement inversant la norme des genres ? Le motif se confond à s&y méprendre avec celui des danseuses, par exemple, sur la Tombe des Vases Peints@3. Et les hommes ne le portent habituellement pas dans d&autres scènes. Cette inversion sexuelle, ce renversement des valeurs sont rendus possibles par le rituel du kômos, où sont permis les excès de l’hubr7@1. Ces deux exemples semblent indiquer qu&on puisse attribuer à l&iconographie étrusque du vin le même fonctionnement que l&imagerie attique quant aux valeurs d&altérité et d&identité.
-#. http://icar.tge-adonis.fr/icardb/scene.php?idscene=TARQ.,c (site consulté le +#'juillet +,#,). Pour la comparaison avec une 7ûtiste adoptant une posture assez sem-blable dans la céramique grecque, voir Ducati P., «'Osservazioni cronologiche sulle pitture arcaiche tarquiniesi'», Studi Etruschi #!, #"!", p.'+## sq., pl.'XI. Notre 7ûtiste est bien un homme, comme l&indique la couleur de sa peau.
-+. http://icar.tge-adonis.fr/icardb/scene.php?idscene=TARQ-"c (site consulté le +# juillet +,#,).
-!. http://icar.tge-adonis.fr/icardb/scene.php?idscene=TARQ-"c (site consulté le +# juillet +,#,).
-/. Voir supra.
NATACHA LUBTCHANSKY
/+,!
-%. D&après Ducati P., «'Osservazioni cronologiche…'», art.'cit., note -#, pl.'##, #.--. D&après Blank H. et Weber-Lehmann C., Malerei der Etrusker in Zeichnungen des $..
Jahrhunderts: Dokumentation 0or der Photographie aus dem Archiv des Deutschen Archäo-logischen Instituts in Rom, Mayence, #"$., pl.'#+.
Fig. .. Tombe de la Chasse et de la Pêche de Tarquinia. Détail du kômos@4.
Fig. $-. Tombe des Inscriptions de Tarquinia. Angle du fond à droite@@.
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/+#
Conclusion : les Étrusques se considèrent-ils vraiment comme «"barbares"» ?
La composition de la collection d&antiques de Rodin (la coupe étrusque ins-crite du nom d&Aulus Vibenna) et les œuvres de l&artiste elles-mêmes (les #semblages et le Bacch( à la Cuve) nous ont servi à pointer la question de la spéci(cité étrusque de l&iconographie du symposion et du kômos par rapport au modèle grec. Les images, insérées dans leur contexte de création et de récep-tion, semblent indiquer que les Étrusques connaissaient parfaitement l’«'expé-rience grecque du vin'» : le médaillon de la coupe, qui a sans doute inspiré les assemblages de Rodin, est de facture étrusque, mais son iconographie n&a rien de «'barbare'» pour un esprit grec ; le satyre irrespectueux, qui se balance sur le pied d&un cratère, après en avoir renversé le contenu sur sol, se rattache à l&ico-nographie grecque du kômos. Même si on peut déceler des degrés divers de l&as-similation de la culture grecque du vin dans les œuvres étrusques –'avec même des exemples de contre-sens dans la compréhension des images attiques'–, on ne peut nier la culture hellénisante de l&aristocratie étrusque.
En outre, ce qui peut apparaître comme «'barbare'» dans la pratique étrusque de la consommation du vin, comme la participation des femmes, doit être relativisé au regard de certains vases attiques : soit on réévalue le rôle de la femme grecque au banquet, soit on prend en compte la clientèle étrusque d&une grande quantité de ces vases. De même, ce qui peut apparaître comme transgressif, comme des hommes déguisés en femmes, trouve sa place dans le cadre des excès du kômos selon la lettre grecque.
Une dernière image témoignera que sur cette question de la consomma-tion du vin, les Étrusques ne se considèrent dé(nitivement pas comme des «'barbares'». Il s&agit du cratère d&Aristonothos, vase de céramique peinte du =::;'siècle, provenant de Cerveteri ((g.'##)@6. Il représente, sur l&une des deux faces, l&épisode de l&aveuglement de Polyphème par Ulysse et ses com-pagnons. Le géant Cyclope symbolise le monde barbare, que le héros grec traverse pour retrouver son foyer. En tant que barbare et autre, il ne sait pas consommer le vin comme les Grecs. Son régime alimentaire est fondé sur le lait : il est berger et consomme le lait de ses brebis, comme on le voit dans l&image du cratère. En e5et, à droite de la scène, derrière le Cyclope, est (gu-rée une claie où sèchent les fromages, tandis que Polyphème, dans sa barbarie, est trop plein du vin qu&il n&a pas su boire.
-.. Voir la (che de Martelli M. (dir.), La ceramica degli Etruschi, Novare, #"$., p.'+-!-+-/.
NATACHA LUBTCHANSKY
/++!
Les exégètes ont souvent mis en évidence l&opposition qu&il y a, dans l&image, entre la partie gauche du vase, où se trouvent les Grecs, qui savent correctement boire le vin, et la droite, avec le barbare, même si sur le cra-tère d&Aristonothos, à la di5érence d&autres versions de la même scène, Polyphème ne tient pas le vase à boire@<. Pour ces exégètes, il faut faire inter-venir le contexte de réception du vase dans l&interprétation de la scène, c&est-à-dire celui de la clientèle étrusque, puisque le vase provient sans doute d&une tombe d&un aristocrate étrusque de la grande cité de Cerveteri. Il y a en e5et un lien logique avec la scène de la seconde face, où sont opposées pareillement
-$. D&après Monumenti Inediti, IX, #$-", pl.'/.-". Voir en particulier Torelli M., «'La religione'», in M.'Pallottino (dir.), Rasenna, Milan,
#"$-, p.'#.# ; Martelli M. (dir.), La ceramica…, op."cit., note -- ; Izzet V., «'Changing Perspectives: Greek Myth in Etruria'», in P. Attema, A. Nijboer et A.'Zi5erero (dir.), Papers in Italian Archaeology VI: Communities and Settlements )om the Neolithic to the Early Medieval Period (Proceedings of the %:; Conference of Italian Archaeology held at the University of Groningen, Groningen Institute of Archaeology, *e Netherlands, April"$6:;-$8:; &--,), Oxford, +,,%, p.'$++-$+..
Fig. $$. Cratère d!Aristonothos@8. [Rome, Musées capitolins]
PRATIQUES D’ACCULTURATION DANS L’ICONOGRAPHIE DU VIN ÉTRUSQUE
!/+!
deux entités : il s&agit d&une bataille navale entre un navire de guerre à gauche et un navire marchand à droite. Les deux moitiés de chaque face sont ainsi mises en miroir. Pour Marina Martelli, par exemple, les Étrusques sont situés à droite dans l&image ; ils représentent le camp des barbares, c&est-à-dire, dans la scène navale, les pirates, opposés aux Grecs, qui font des opérations de police sur mer (voir la tradition historiographique sicéliote). Pour Mario Torelli en revanche, les Étrusques s&identi(ent aux Grecs et sont situés à gauche dans la scène navale. Face à eux sont les Grecs de Sicile, qui, en s&ins-tallant sur l&île, sont les héritiers de Polyphème.
Le point de vue de Mario Torelli me paraît plus convaincant. Comment imaginer en e5et qu&un Étrusque ait voulu avoir dans sa tombe un vase stig-matisant le peuple étrusque, en tant que «'barbare'» ? En outre, ne faut-il pas aussi valoriser ici le fonctionnement antique de l&image ? La scène mytho-logique (Ulysse et Polyphème) pourrait aider à comprendre la scène «'réa-liste'» (la bataille navale), et d&indiquer le sens de la lecture, comme ce sera encore le cas, par exemple, trois siècles plus tard, dans la Tombe François de Vulci, où, dans une conception cyclique de l&histoire, le sacri(ce des prison-niers troyens par les Grecs annonce le massacre des Romains par les héros de Vulci, les frères Vibenna, les nouveaux Grecs, aidés par Macstarna, et plus tard encore la victoire de Vel Saties sur Rome.
Sur le cratère d&Aristonothos, pour comprendre la signi(cation de bataille navale, il faut là aussi se servir du parangon mythologique, qui montre où se trouve le camp barbare, –'emblématisé par le géant qui ne sait pas boire le vin correctement'–, et où sont les vainqueurs : les Étrusques, aussi civilisés que les Grecs.