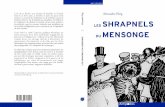Salsmann 2012 « Du mot mensonge », dans Carel M. (éd.) Argumentation et polyphonie. De Saint...
Transcript of Salsmann 2012 « Du mot mensonge », dans Carel M. (éd.) Argumentation et polyphonie. De Saint...
189
MARGOT SALSMANN (EHESS, CRAL)
DU MOT MENSONGE
Lequel est le vrai menteur, de celui qui dit le faux pour ne pas tromper, ou de celui qui dit le vrai pour tromper, le premier sachant ou croyant qu’il dit une fausseté ; et le second sachant ou croyant qu’il dit une chose vraie ?
Saint Augustin, Du mensonge
Afin de s’opposer à « toute espèce de mensonge », saint Augustin pose d’abord la question « qu’est-ce que le mensonge ? », il a besoin de décrire ce qu’il va entendre par « mensonge », de délimiter l’objet du péché, car c’est sur cette définition qu’il pourra asseoir sa condamnation. Pour ce faire, il commence par départager les situations dans lesquelles on peut dire qu’il y a mensonge de celles dans lesquelles on ne le peut pas. Or ce faisant, il répond en fait à une autre question : « que signifie le mot mensonge ? », puisqu’il ne s’agit plus de savoir ce qu’il se passe quand il y a mensonge (c’est-à-dire ce qu’est le mensonge), mais ce qu’il se passe quand on dit qu’il y a mensonge (c’est-à-dire le sens du mot mensonge). C’est donc la signification qu’il donne du mot mensonge, qui lui permet d’identifier et de caractériser les faits en question, autrement dit de déterminer quels faits sont condamnés par la Religion et quels sont ceux qui ne le sont pas.
C’est en cherchant à séparer ce qui est de l’ordre du mensonge de ce qui s’en écarte, que saint Augustin est conduit à poser la question en exergue. Cette question est complexe
190
parce qu’elle comprend en fait plusieurs questions : sur le sens du mot dans la langue, sur son emploi par les sujets parlants et la valeur que ceux-ci lui accordent, et sur les situations du monde auxquelles ce mot est attribué. Cette étude se propose donc de séparer ces questions ; les relations entre la langue, le langage et le monde, seront abordées à travers l’analyse du mot mensonge afin de décider, avec saint Augustin, de la nature du « vrai » menteur.
1 LANGUE, LANGAGE ET MONDE : INTRODUCTION AU PROBLÈME
De nombreux philosophes se sont attachés à questionner le langage de manière interne, et ont approché linguistiquement les problèmes philosophiques, suivant en cela le Socrate de Platon, qui commence son questionnement en explicitant ce à quoi nous pensons quand nous employons tel ou tel mot, et transforme de ce fait un problème philosophique en un problème de langage.
Selon Socrate en effet, le langage serait une voie d’accès à la vérité : en interprétant et en définissant les mots, nous pourrions déterminer le concept de la chose, ce qu’elle est en soi, pourvu que nous ne laissions pas les incorrections nominatives de la langue corrompre notre connaissance des êtres. Cependant, si la connaissance des noms peut nous enseigner quelque chose, elle serait souvent insuffisante et surtout défaillante pour nous parler de ce qui est, car la transposition d’une forme en un nom n’est pas toujours adéquate. On constatera dans ce sens que le type d’enquête linguistique que Socrate met en œuvre dans les dialogues de Platon « aboutit toujours à un échec, à une aporie, et ne sert qu’à préparer le terrain pour une saisie directe, intuitive, de la notion (saisie qui ne se produit d’ailleurs que dans certains dialogues, les dialogues « achevés »). » (Ducrot et Schaeffer 1995 : 243)
Les échecs de la démarche proposée par Socrate ont, selon Nietzsche, une autre cause que l’inadéquation accidentelle du nom et de la chose, cause qui rend cette inadéquation inévitable. Selon lui en effet, le langage ne permet jamais d’atteindre ce
191
qu’est la chose en soi, mais seulement ce que nous avons établi comme étant la chose en soi. De sorte que les échecs de Socrate découlent de l’hypothèse selon laquelle le nom et la chose sont en relation de correspondance : cette relation est en elle-même trompeuse, ce que nous appelons des « vérités » sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont. « Le philosophe est pris dans les filets du langage. » (Le livre du philosophe : 83), écrivait Nietzsche, il se sert des mots pour appréhender « l’X énigmatique de la chose en soi » (Ibid. : 120) et a besoin du discours pour articuler ce qu’il en découvre. En fait, les vérités auxquelles ce philosophe parvient ont, pour Nietzsche, la forme de la tautologie, elles sont des « cosses vides » dont nous ne pouvons nous contenter : la réalité est inaccessible, car nous ne la rencontrons que par des métaphores (perceptives, langagières, musicales, picturales, etc.), or échanger une vérité pour une autre vérité, expliquer une métaphore par une autre métaphore, réduit la validité de notre démonstration sur l’en-soi des choses.
On notera que la critique que mène Nietzsche à l’encontre du langage ne vise pas tant ce dernier que la valeur que nous lui accordons et l’usage que nous en faisons, il s’agit pour lui de détruire la notion de vérité objective (soit l’adéquation de l’intellect et de la chose) vers laquelle la pensée et le langage sont censés tendre. Les différentes langues nous montrent que chacune d’elles contient une vérité du monde, l’interprétation qu’elle en donne ; la vérité est dès lors relative à la langue qui la constitue. Pour Nietzsche, le langage et la vérité sont dès le début indissociables, la législation de la langue est même l’expression des premières lois de vérité, car elle fixe « une désignation des choses uniformément valable et obligatoire » (Ibid. : 119). Les relations des hommes aux choses sont nommées après un jeu de métaphores : l’X de la chose est traduit en excitation nerveuse, elle-même traduite en image sonore qui, enfin, est associée à un sens ; aussi, puisque les mots sont des métaphores, nées des impressions que le réel a eues sur nous, et cristallisées par la langue, ils n’expriment pas l’essence des choses, mais « la métamorphose du monde en les hommes » (Ibid. : 125).
192
En occultant le fait que nous entretenons à travers le langage un rapport métaphorique au monde, et en objectivant en concepts des choses les représentations qu’il véhicule, nous condamnons l’accès à la réalité que le langage aurait pu être. Nietzsche appelait à retrouver les réalités (ou les fictions) que construisent les langues, à révéler les visions du monde qu’elles contiennent. Pour cela, il nous faut abandonner la croyance selon laquelle le réel que décrit notre langue correspond à ce qui est (le réel en soi) ; la prétention du langage à être le monde ne doit pas nous leurrer et nous porter à oublier que les mots ne sont pas les choses ou les expériences que nous en avons. Ce que signifie un mot, son concept, ne doit pas être substantialisé, et devenir le signe d’une entité originelle qui existerait dans le monde ou en nous-mêmes :
Tout mot devient immédiatement concept par le fait qu’il ne doit pas servir justement pour l’expérience originale, unique, absolument individualisée, à laquelle il doit sa naissance, c’est-à-dire comme souvenir, mais qu’il doit servir en même temps pour des expériences innombrables, plus ou moins analogues, c’est-à-dire, à strictement parler, jamais identiques et ne doit donc convenir qu’à des cas différents. Tout concept naît de l’identification du non identique. (Ibid. : 122)
En définitive, qu’est-ce que le mensonge que saint Augustin essaye de caractériser ? C’est un concept capable de désigner des faits dont la singularité et les caractéristiques propres sont abandonnées au profit de leurs ressemblances, rassemblées derrière le mot mensonge ; il n’existe pas dans le monde quelque chose qui aurait la forme de ce concept, une qualitas occulta dont « mensonge » serait le nom. Pour comprendre le mot mensonge et parvenir à son concept, nous devons omettre l’individuel et le réel ; c’est pourquoi, pour Nietzsche, le philosophe doit se faire linguiste et travailler sur les mots afin de révéler l’interprétation du monde qu’ils expriment en eux-mêmes. La vérité de chaque concept est un événement du langage, c’est donc en déchiffrant les signes que nous accéderons aux représentations structurées et conservées par chaque langue, chacune d’elles ayant érigé un dôme conceptuel complexe à partir de ces métaphores résiduelles (les signes).
193
Nietzsche proposait de revenir à la genèse des mots et d’observer leur transformation, l’étymologie était pour lui un moyen de découvrir la généalogie des concepts et de retrouver l’interprétation subjective qui fut à leur origine1. D’inspiration nietzschéenne, cette étude, quant à elle, ne portera pas sur l’histoire du mot mensonge, mais sur son sens. Partant du fait que la signification que nous donnons d’un mot dépend de la théorie de la langue dans laquelle nous nous inscrivons, j’ai choisi de décrire le sens que les mots mensonge, mentir, menteur et mensonger ont dans une langue conçue de manière argumentative, en menant cette analyse lexicale avec les outils que propose la Théorie des Blocs Sémantiques (TBS), car la TBS défend, elle aussi, l’idée que la signification constitue un domaine indépendant, ce qui permet d’approcher les représentations linguistiques comme des réalités en elles-mêmes, sans avoir à les mettre en rapport avec les choses qu’elles sont supposées représenter.
Il existe en effet différentes propositions dans la manière de concevoir la langue et, par suite, d’appréhender la signification des mots et des phrases : la sémantique référentielle, la sémantique cognitive, la sémantique pragmatique et la sémantique argumentative. La sémantique référentielle postule que les expressions linguistiques renvoient à quelque chose dans le monde, à une réalité extralinguistique (une propriété, un objet ou un état de chose). La sémantique cognitive associe aux mots des représentations mentales et cherche à comprendre comment s’articulent le langage et la pensée. Pour ces deux sémantiques, le contenu représentationnel d’une expression linguistique est premier, son emploi dépend de ce qu’elle représente. La sémantique pragmatique considère au contraire l’emploi d’un mot (ou sa fonction) comme l’élément fondamental de la signification ; donner le sens d’une expression linguistique, c’est d’abord spécifier son emploi, ce à quoi elle sert (« Don’t ask for the meaning, ask for the use. » –
1 Nietzsche mène une telle analyse étymologique dans Généalogie de la morale (1887).
194
Wittgenstein). Le contenu d’un mot dépend de sa fonction, mais l’association d’un mot et d’une fonction peut quelquefois être équivalente à l’association d’un mot et de ce qu’il représente, car représenter fait partie de ce que peut faire un mot. Dans ces trois sémantiques, la relation de référence d’une expression linguistique à quelque chose d’extérieur à la langue est toujours présumée, qu’elle soit au fondement de la signification, l’emploi dérivant du sens, dans les approches référentielles et cognitives, ou qu’elle soit subsumée par la fonction dans les approches pragmatiques. La singularité de la sémantique argumentative est de construire le sens d’une expression linguistique dans une perspective « non paralléliste » suivant laquelle la signification d’un terme ne reflète ni le monde, ni la pensée, ni son emploi (au sens que Wittgenstein donne à emploi), mais d’autres expressions linguistiques. Les représentations linguistiques ne sont pas mises en correspondance avec des entités extralinguistiques, car la langue est appréhendée comme un système autonome de sens, ayant sa propre intelligibilité, les discours sont donc interprétés par d’autres discours (argumentatifs), ceux-ci ne comportent aucun élément informatif, car ils évoquent uniquement des argumentations – linguistiques (cf. introduction de Marion Carel).
De manière générale, la sémantique argumentative présente l’idée d’une linguistique « moins fondée sur les contenus communiqués que sur les rapports intersubjectifs liés à leur communication » (Ducrot 1984 : 66). Les langues sont vouées à l’interaction des sujets parlants, elles ont :
[…] une toute autre fonction que de véhiculer des informations […] leur fonction première […] est d’offrir aux interlocuteurs un ensemble de modes d’actions stéréotypés leur permettant de jouer et de s’imposer mutuellement des rôles : parmi ces modes d’actions conventionnels préexistants à leur emploi par les sujets parlants, je place les virtualités argumentatives constitutives, pour moi, de la signification. » (Ibid. : 111-112)
La phrase contient dans sa signification les enchaînements argumentatifs qui peuvent la paraphraser. Quand nous employons un mot pour décrire une situation (par exemple,
195
quand nous disons qu’il y a mensonge), quand nous mobilisons sa signification et faisons appel aux argumentations que ce mot exprime, nous prédiquons, c’est-à-dire que nous donnons à la situation une perspective pour la comprendre, nous apposons sur le monde une cohérence sémantique que notre interlocuteur est contraint d’adopter s’il veut répondre à notre propos.
Toute réflexion sur la nature d’une chose semble confondre (mêler étroitement) deux types de questions, celles qui portent sur la chose en elle-même ou sur la manière dont nous la pensons, et celles qui concernent les mots servant à en parler. Bien que fondamentalement noués, ces deux questionnements sont bien distincts ; les questions qui traitent des situations que nous jugeons mensongères, autrement dit des situations auxquelles nous associons ce mot, doivent être différenciées de celles qui ont pour objet ce que nous entendons par le mot mensonge, soit sa signification. Nous avons d’un côté l’emploi du signe mensonge dans une situation donnée – que cet emploi soit autorisé ou non – et de l’autre, sa signification dans la langue. La TBS permet de séparer ces questions en proposant une analyse qui va des mots à la réalité (et non pas des réels à la langue), en dépliant dans un autre sens les liens entre la signification d’un mot, son emploi et la situation dans laquelle il est employé. Elle apparaît adaptée au programme de Nietzsche, puisqu’il nous faut, selon lui, connaître les concepts signifiés par la langue si l’on veut les décoder et atteindre le monde.
Parce qu’elle se fonde sur les expressions linguistiques
attachées au mensonge pour comprendre ce qu’il est, cette étude partage avec la philosophie analytique une même méthode et un même projet ; cependant, l’analyse lexicale qu’elle présente est très différente, d’abord parce qu’elle se rattache à une autre théorie sémantique, argumentative et non pas pragmatique, mais aussi parce qu’elle suit un mouvement qui va de la signification des mots à leurs emplois, et non pas des situations dans lesquelles nous les employons à leurs emplois.
La méthode analytique propose en effet d’aborder certains problèmes philosophiques, non plus sur un plan conceptuel, mais sur un plan sémantique, en ne s’interrogeant pas sur les
196
choses dont on parle, mais sur la manière dont on en parle. Pour les philosophes analytiques, le langage ordinaire est un moyen d’atteindre le réel, de le faire apparaître, car les multiples expressions que nous employons pour parler d’un phénomène nous guident dans sa compréhension, en nous révélant les expériences que les hommes ont eues de lui, les distinctions et les rapprochements qu’ils ont observés. Comme la variation des expressions pour désigner une « même » situation ne semble pas être arbitraire, il doit y avoir dans la situation quelque chose qui explique pourquoi nous choisissons une tournure plutôt qu’une autre, et c’est justement la difficulté à expliquer ce choix qui témoigne de la complexité de la situation dont il est question. C’est pourquoi Austin propose que les expressions dont nous nous servons pour parler d’un phénomène servent de données (data) à partir desquelles nous l’observons. En délimitant un préalable sur lequel il est possible de s’accorder, le datum sémantique permettrait de dépasser les divergences quant à l’appréhension du phénomène, qui sont liées aux différentes perspectives théoriques à partir desquelles nous pouvons l’appréhender. Notre perception du monde étant sujette à caution, le langage ordinaire formerait un donné objectif (compte tenu qu’il est accessible à tous et validé par la communauté) à partir duquel nous pourrions fonder notre connaissance. Le plan sémantique constituerait dès lors « une certaine manière, une, de décrire et de saisir les faits. » (Austin 1962 : 334)
Cette étude décrira également le mensonge en se fondant sur le champ sémantique qui lui est associé, mais recourra à une autre théorie sémantique. Austin s’inscrit dans une sémantique pragmatique et interroge l’emploi des mots, il veut moins décrire l’usage du langage qu’en révéler les normes afin de pouvoir parler du réel :
Quand nous examinons […] quels mots employer dans quelles situations, encore une fois, nous ne regardons pas seulement les mots (ou les « significations », quelles qu’elles soient), mais également les réalités dont nous parlons avec les mots ; nous nous servons de la conscience affinée que nous avons des mots pour affiner notre perception, qui n’est toutefois pas l’arbitre ultime, des phénomènes. (Austin 1961 : 144)
197
Pour que l’emploi d’un mot ait une raison d’être, soit pertinent, il lui faut des circonstances qui motivent son apparition, ce sont les raisons de dire quelque chose qui déterminent ses conditions d’usage. C’est pourquoi Austin pose d’abord la question « que disons-nous quand… ? » afin de répertorier les différentes expressions employées dans les situations liées au phénomène étudié, c’est-à-dire afin de faire l’inventaire de ce que nous disons ou de ce qu’il convient de dire en telle ou telle circonstance liée à ce phénomène. Pour Austin, cet emploi « correct » ou « normal » du langage est légitime, car c’est le respect des conditions d’usage du langage qui conditionne le sens de toute parole. C’est pourquoi, en rendant plus fine notre perception des différences dans le langage, nous percevrions plus clairement les différences dans le réel ; cette méthode vise alors à dégager les normes du langage en tant qu’il parle de la réalité, à faire émerger les revendications des choses en tant qu’elles sont dites (S. Cavell).
En suivant ce type d’analyse pour traiter du mensonge, nous serions portés à nous référer constamment aux situations dans lesquelles nous employons ce mot, nous ne nous séparerions pas de la réalité et serions conduits à poser encore la question « est-ce – vraiment – un mensonge ou pas ? ». L’enquête que je propose ici, si elle cherche également à expliciter les différences dans le langage pour peut-être mieux comprendre le réel, commence par contre par prendre une certaine distance avec celui-ci : le lien entre la langue et le monde n’est pas présupposé pour décrire la langue, il est véritablement découvert. En travaillant d’abord sur le mot mensonge, il s’agit de montrer le filet du langage dans lequel nous sommes pris quand nous cherchons à connaître ce qu’est le mensonge, quand nous cherchons à décrire les situations que nous nommons mensonge. C’est en partant du réseau sémantique du mot mensonge que nous pourrions observer la réalité et non l’inverse (nous ne le ferons pas ici), nous nous fonderions sur la signification de cette expression pour comprendre ce qui détermine son intervention dans un discours, c’est-à-dire que nous suivrions le mouvement contraire de celui de la méthode analytique, qui se fonde sur les situations de paroles motivant l’emploi d’un mot, pour ensuite caractériser les raisons de celui-
198
ci. Il ne s’agit donc pas de décrire les situations dites mensongères, mais de montrer ce que les emplois du mot mensonge ont en commun, à savoir les prédicats argumentatifs inscrits dans la signification de mensonge ; en d’autres termes, il s’agit d’établir les liens argumentatifs qui existent entre les différents traits sous lesquels sont observées les situations auxquelles nous attribuons le prédicat mensonge.
L’adoption d’une perspective argumentative permet ainsi de ne pas oublier que ces situations sont décrites avec la langue, qu’elles ne sont pas « objectives », puisqu’elles nous apparaissent en mots. La TBS nous aide à accepter de rester dans la langue en nous incitant à garder présent le filet du langage dans lequel nous sommes pris, car elle réglemente notre relation à la situation, soit : quand nous employons le mot mensonge pour décrire une situation, nous consentons à la décrire avec les argumentations inscrites dans la signification de mensonge. Par ailleurs, puisque les mots ne sont pas définis par leurs relations avec le monde, nous pouvons accepter le fait que ce n’est pas parce qu’un mot est utilisé pour décrire une situation qu’il décrit correctement la situation. En somme, cette étude cherche à définir ce que nous entendons communiquer quand nous décrivons une chose comme étant un mensonge, autrement dit, à caractériser les jugements argumentatifs que peut formuler un locuteur quand il fait appel au mot mensonge, que son emploi soit justifié ou non.
Décrire argumentativement un mot, c’est établir son
potentiel argumentatif, à savoir les argumentations que ce mot est capable d’exprimer quand il est employé dans un discours. À travers l’analyse du vocabulaire du mensonge, c’est donc la représentation que nous avons de celui-ci dans la langue qui est examinée. Il s’agit de montrer quels blocs sémantiques peuvent être mobilisés au moyen du mot mensonge, et comment son emploi nous conduit à percevoir d’une certaine manière les situations qu’il entend décrire. C’est pourquoi cette étude s’attachera à déterminer uniquement les aspects argumentatifs que la langue a associés au mot mensonge, uniquement ceux qui ont été lexicalisés (c’est-à-dire que l’argumentation est préfigurée dans la langue – de manière structurelle – et non
199
créée provisoirement dans un discours – de manière contextuelle)2.
Cette différence de cheminement entre l’analyse lexicale argumentative et l’analyse lexicale pragmatique conduit à appréhender l’emploi que font les philosophes du mot mensonge de manière différente. La TBS présente l’avantage d’établir la réalité proprement linguistique que recouvre le mot mensonge, en isolant les propriétés sémantiques de cette représentation linguistique. Dès lors, fondant notre questionnement sur une assise plus stable, l’emploi du mot mensonge (c’est-à-dire ce que nous faisons avec cette représentation linguistique) peut être interrogé et les situations dans lesquelles le mot est employé, que cet emploi soit correct ou non, peuvent être étudiées. Une telle analyse lexicale permet ainsi de non seulement révéler le type d’actions langagières (les argumentations) que la langue met à la disposition des sujets parlants, mais aussi d’observer la manière dont ceux-ci les manipulent, et en particulier saint Augustin, quand il demande si l’on peut nommer menteur celui qui dit le faux pour ne pas tromper, et celui qui trompe en disant le vrai.
Différents travaux philosophiques portant sur le mensonge m’ont guidée tout au long de cette étude, travaux dans lesquels j’ai observé la façon dont le mot mensonge est questionné. Après avoir explicité les traits argumentatifs inscrits dans la signification de mensonge auxquels ils ont fait appel ou sur lesquels ils se sont interrogés, nous verrons comment certains philosophes questionnent la langue quand ils s’interrogent sur le mensonge, comment ils se positionnent par rapport à ces argumentations, soit qu’ils les acceptent et les utilisent, soit qu’ils s’y opposent et construisent de nouvelles argumentations (dites contextuelles), susceptibles de rendre compte plus adéquatement de leur perspective sur le mensonge. Ainsi, je ne 2 Aussi, bien que nous puissions dire du nez de Pinocchio qu’il s’allonge quand il ment, l’argumentation mentir donc nez qui s’allonge ne sera pas inscrite dans la signification de mentir ; cette argumentation est contextuelle, elle n’est pas le fait de la signification du mot, mais de l’intervention du locuteur (même si, avec le temps, il semble qu’elle intègre la langue).
200
chercherai pas à évaluer le questionnement des philosophes, mais à déterminer ce qu’ils nous révèlent à travers leurs propres emplois de ce mot à propos du mot mensonge. Les résultats de notre enquête seront, dans une dernière partie, appliqués à l’analyse d’un extrait du texte de saint Augustin.
2 PRÉSENTATION DE L’ARGUMENTATION INTERNE DE MENSONGE
[Rappel] Un aspect argumentatif A sera dit appartenir à l’argumentation interne d’une expression E si (a) E exprime A et (b) E n’intervient matériellement dans aucun segment d’aucun enchaînement relevant de A. (Carel 2011 : 107)
La description des prédicats argumentatifs qui constitueront
l’argumentation interne du mot mensonge se heurtera au choix du contenu et du mode : quels sont les segments et quel est le connecteur ? Il nous faudra choisir non seulement un aspect qui préfigure les enchaînements argumentatifs qu’évoquent les énoncés dans lesquels le mot mensonge intervient sémantiquement, mais aussi un aspect qui appréhende un bloc sémantique cohérent (les autres aspects qui composent ce bloc doivent être porteurs de sens). De nombreuses hypothèses ont été éprouvées au cours du travail préliminaire, nous en étudierons quelques unes et verrons en particulier les raisons pour lesquelles certaines sont abandonnées. Nous nous reporterons alors aux critères argumentatifs, proposés dans (Ducrot 2001), qui permettent de choisir entre plusieurs solutions, nous demanderons si l’aspect répond correctement à l’effet de la négation et de la gradualité, et s’il est bien lexicalisé. Je rappelle qu’il ne s’agit pas de trouver une argumentation qui décrive ce que serait le mensonge en soi, mais d’établir les jugements argumentatifs que communique l’emploi du mot. Les aspects que j’ai supposé fonctionnels seront donc mis en situation afin de s’assurer que les enchaînements argumentatifs qu’ils évoquent décrivent bien ce que nous entendons par mentir quand nous disons de quelqu’un qu’il ment.
201
N.B. : Les termes pleins de la langue ne sont pas isolément signifiants, ils ont pour vocation d’apparaître dans des discours, le sens des énoncés n’est donc pas de même nature que celui des mots :
Je rendrai compte de cela en décrivant l’adjectif [le nom ou le verbe] par des aspects et seulement par des aspects, tandis que je décrirai les énoncés à la fois par des aspects et par les enchaînements qui les paraphrasent. (Carel 2011 : 79)
Je fais le choix de décrire le verbe mentir, l’adjectif mensonger et les noms mensonge et menteur, avec les mêmes aspects argumentatifs, et j’admets que seules leurs concrétisations dans des enchaînements argumentatifs les différencient.
Pour décrire l’argumentation interne du mot mensonge, nous
prendrons comme point de départ la définition que donne le dictionnaire ATILF du verbe mentir et du nom mensonge :
MENTIR : (a) Affirmer, dire pour vrai ce qu’on sait être faux, nier quelque chose de vrai. (b) Contenir, exprimer des choses fausses. Emploi factitif : faire mentir. (c) Emploi particulier : tromper. Emploi pronominal : refuser de s’avouer la vérité à soi-même.
MENSONGE : (a) Affirmation contraire à la vérité faite dans l’intention de tromper. (b) Par extension : Tromperie, illusion, artifice.
L’argumentation interne du prédicat mensonge se concentrera sur les sens (a) de mentir et mensonge ; nous ne traiterons pas immédiatement de l’emploi particulier décrit par le sens (c) de mentir et le sens (b) de mensonge. Le mensonge n’est en effet apparenté à la tromperie que parce qu’il en est une tentative, le menteur ne trompant que s’il réussit son mensonge, la relation qu’entretient le mensonge à la tromperie sera inscrite dans la signification de mensonge au niveau de son argumentation externe : MENTIR DC TROMPER / MENTIR PT NEG TROMPER. Ainsi, en excluant – temporairement – du mensonge la tentative de tromperie, nous travaillerons sur une définition moins large ; le mensonge sera décrit comme une affirmation fausse, connue comme telle par celui qui l’énonce, et communiquée en vertu de cette fausseté (mentir renverrait à l’acte consistant à faire cette
202
fausse affirmation). Le sens (b) de mentir va être, quant à lui, explicité tout au long de cette étude, car la relation du mensonge à la notion de fausseté est problématique.
Effectivement, nous rencontrerons plusieurs difficultés dans la description de ce que nous entendons par « faux ». D’une part, il s’agira d’être attentif au fait que la notion de fausseté peut être définie différemment selon le type de vérité avec laquelle elle est en opposition. Le mensonge tisse ainsi plusieurs sortes de faux, l’affirmation est fausse : 1- par rapport à une vérité transcendante, au sens où le contenu affirmé ne correspond pas aux faits ; 2- par rapport à ce que sait le menteur, il y a duplicité ; 3- par rapport à l’autre, au sens où l’affirmation veut l’induire en erreur, donner lieu à une croyance erronée. D’autre part, les notions de vrai et de faux pourraient ne pas être les deux seules valeurs et devoir être complétées par des positions intermédiaires, comme le soutiennent les logiques non classiques qui admettent plus de deux valeurs de vérité. En effet, on ne peut se décider de manière définitive sur les relations qu’entretiennent les notions de vrai et de faux : la langue contenant à la fois les expressions est vrai et est faux, mais aussi leur négation n’est pas vrai et n’est pas faux, devons-nous considérer que dire la fausseté est l’équivalent de ne pas dire la vérité, et inversement ? De plus, le fait de dire sciemment quelque chose de faux implique-t-il de savoir ce qui est vrai ? Nous serons donc portés à nous interroger sur ce que dissimule le menteur, est-ce un savoir (un contenu qui est vrai) ou le fait de savoir que ce qu’il énonce est faux ? Son caractère « double et trompeur » porte-t-il sur un contenu représentationnel, dans le sens où une représentation fausse est substituée à une vraie ? Ou renvoie-t-il à l’intention du menteur, au sens où celui-ci prétend faire quelque chose (informer son interlocuteur) et fait autre chose (l’induire en erreur) ? Les réponses à ces questions seront décisives quant au choix du contenu et du mode des prédicats argumentatifs qui décriront le mot mensonge.
203
2.1 LE CONTENU ET LE MODE DU PRÉDICAT ARGUMENTATIF MENSONGE
Afin de construire l’argumentation interne de mentir, je déterminerai d’abord les segments qui composent l’argumentation (son contenu), puis je déciderai du connecteur qui les relie (le mode) ; trois hypothèses seront proposées, chacune correspondant à une manière d’entendre le mensonge.
En paraphrasant par des enchaînements argumentatifs le sens (a) que donne le dictionnaire ATILF du verbe mentir, nous obtenons :
- Affirmer pour vrai ce qu’on sait être faux : SAVOIR QUE C’EST FAUX CONN AFFIRMER POUR VRAI (N.B. : CONN est ici une abréviation de connecteur).
- Nier quelque chose de vrai : SAVOIR QUE C’EST VRAI CONN AFFIRMER POUR FAUX
Nous pouvons synthétiser ces deux aspects en un seul, celui qui ment affirmerait une chose qu’il sait être fausse (que ce soit en faisant passer pour vrai une chose fausse ou en faisant passer pour fausse un chose vraie), nous obtenons ainsi l’aspect SAVOIR QUE C’EST FAUX CONN AFFIRMER ; celui-ci constituera notre première hypothèse (H1). Le prédicat argumentatif, formalisé par H1, définit le menteur comme quelqu’un qui affirme un contenu faux, c’est-à-dire non conforme avec ce qui est, et ce, délibérément, car il le sait.
Pour saint Augustin (Du mensonge : Chap. III), par contre, le mensonge ne reposerait pas tant sur la fausseté réelle du contenu énoncé, compte tenu que le menteur peut être dans l’erreur, mais sur la duplicité du menteur qui croit quelque chose (qu’il suppose vraie) et dit autre chose (qu’il suppose fausse) :
Ainsi donc mentir, c’est avoir une chose dans l’esprit, et en énoncer une autre soit en paroles, soit en signes quelconques. C’est pourquoi on dit du menteur qu’il a le cœur double, c’est-à-dire une double pensée : la pensée de la chose qu’il sait ou croit être vraie et qu’il n'exprime point, et celle de la chose qu’il lui substitue, bien qu’il la sache ou la croie fausse. D’où il résulte qu’on peut, sans mentir, dire une chose fausse, quand on la croit telle qu’on la
204
dit, bien qu’elle ne soit pas telle réellement ; et qu’on peut mentir en disant la vérité, quand on croit qu’une chose est fausse, et qu’on l’énonce comme vraie, quoiqu’elle soit réellement telle qu’on l’énonce, car c’est d’après la disposition de l’âme, et non d’après la vérité ou la fausseté des choses mêmes, qu’on doit juger que l’homme ment ou ne ment pas.
Nous aurions alors un aspect du type CROIRE QUELQUE CHOSE CONN DIRE LE CONTRAIRE, définissant le menteur comme quelqu’un qui dit autre chose que ce qu’il croit, le contenu énoncé est faux au sens où il ne correspond pas à la représentation à laquelle le menteur adhère. Pour les raisons qui suivent, je reformulerai cet aspect par SAVOIR CE QUI EST VRAI CONN DIRE QUELQUE CHOSE DE FAUX et ce prédicat constituera notre deuxième hypothèse (H2).
En choisissant le verbe savoir pour décrire la relation du menteur au contenu qu’il communique, j’insiste sur le fait que ce contenu est jugé faux par rapport à une vérité transcendante, tandis qu’en préférant le verbe croire, je souligne que la distinction entre le vrai et le faux concerne moins la fiabilité du savoir du menteur que le crédit qu’il lui accorde, ce qu’il juge vrai pouvant être faux et inversement. En ce sens, le locuteur de l’énoncé Jean sait que P est faux communique que Jean connaît la fausseté de la représentation P et qu’il partage avec Jean cette connaissance ; alors qu’avec le verbe croire, l’énoncé Jean croit que P est faux permet au locuteur de ne pas prendre position et de seulement communiquer que la représentation P est jugée fausse par Jean, le locuteur pouvant ne pas partager avec lui cette croyance. C’est pourquoi on peut dire Jean croit P, mais P est faux et non *Jean sait P, mais P est faux3. Aussi, il me semble que c’est le verbe savoir qu’il faut retenir.
En effet, quand nous accusons quelqu’un de mentir, nous statuons sur le contenu que nous qualifions de mensonger, nous
3 Ce serait en vertu de cette différence sémantique que nous ajouterions croire à savoir quand nous voulons communiquer que quelqu’un, qui prétend savoir quelque chose, est dans l’erreur : il croit savoir.
205
n’insinuons pas de doute quant à sa fausseté ; le contenu d’un mensonge n’est pas déclaré faux uniquement parce qu’il ne reflète pas la croyance du menteur, mais aussi selon une vérité transcendante, supposée connue de lui et partagée avec d’autres. Saint Augustin suppose que, pour qu’il y ait mensonge en soi, une seule condition est nécessaire : la duplicité du menteur qui sait que ce qu’il dit est faux (que ce soit réellement faux ou pas). Mais, pour qu’une communication soit qualifiée de mensongère par quelqu’un d’autre que le menteur (par quelqu’un qui n’est pas Dieu), une seconde condition doit être ajoutée : celui qui déclare qu’il y a mensonge doit penser que le propos est faux, et c’est cette affirmation fausse qu’il accuse d’être délibérée. Dès lors, la fausseté de la proposition ne serait pas seulement subjective (non conforme avec les croyances du menteur), mais également intersubjective (non conforme avec les croyances du menteur et du locuteur qui déclare la proposition fausse).
Il serait pourtant possible de conserver la proposition de saint Augustin d’une duplicité du menteur tout en rendant compte de cette objection, en précisant la première formulation de H2, en lui ajoutant l’adjectif vrai : AVOIR UNE CROYANCE VRAIE CONN DIRE LE CONTRAIRE. Mais, comme le souligne Austin (La vérité, 1961), l’expression croyance vraie est peu courante en dehors de la philosophie et de la théologie : avoir une croyance vraie, c’est « croire en quelque chose de vrai » (croire P – P est vrai) ou « croire que quelque chose de vrai est vrai » (croire que P est vrai – P est vrai) ; notre relation à la vérité correspondrait alors, selon lui, au fait d’attribuer à la proposition P l’expression est vraie. C’est pourquoi, même si le verbe croire est en mesure de décrire l’attitude du menteur par rapport au contenu qu’il qualifie de vrai ou de faux, je ne le choisis pas afin d’éviter les ambiguïtés de langage, et lui préfère le verbe savoir qui a l’avantage de renvoyer immédiatement à un contenu représentationnel évalué en terme de vérité ou de fausseté selon qu’il est en adéquation ou pas avec une réalité
206
partagée4. De plus, si le mensonge s’inscrit bien dans le champ de la véridicité (de ce qu’on croit être vrai ou pas), la croyance dont il est question concerne d’abord le destinataire que le menteur cherche à tromper, il y a fausse croyance dans la réception (j’esquiverai la question du mensonge à soi et tous les problèmes qu’elle soulève).
Pour toutes ces raisons, je reformule CROIRE QUELQUE CHOSE CONN DIRE LE CONTRAIRE par H2 SAVOIR CE QUI EST VRAI CONN DIRE QUELQUE CHOSE DE FAUX. De sorte que cette reformulation permet de conserver la perspective sur le mensonge défendue par saint Augustin, qui insiste sur la duplicité du menteur, sur sa dissimulation, en formulant l’écart entre ce que sait le menteur (une vérité) et ce qu’il dit (une fausseté), et d’abandonner l’idée selon laquelle le vrai et le faux du propos mensonger dépendent des seules croyances du menteur. La nouvelle formulation de H2 souligne ainsi que ces croyances sont aussi celles du locuteur qui affirme qu’il y a mensonge. Si bien que ce qui différencie H1 et H2 est le savoir que ce locuteur suppose au menteur : dans H1, c’est uniquement que le contenu communiqué est faux, et dans H2 que ce contenu faux dissimule une vérité.
Il est cependant possible d’envisager une troisième hypothèse. Le mot mensonger contenant l’idée de ne pas dire la vérité, de cacher ou taire ce que l’on sait être vrai, mentir apparaît comme une manière de ne pas être vérace, peut-être même est-il l’exact antonyme de vérace. Le mot véracité pouvant être décrit par l’aspect SAVOIR CE QUI EST VRAI DC DIRE, en conséquence, si l’aspect décrivant mensonge était le 4 Le choix du verbe savoir ne doit pas être entendu dans un sens fort, dans une dimension ontologique : le « savoir » du menteur renvoie bien à un contenu représentationnel auquel celui-ci croit ; en ce sens, c’est bien une croyance. Mais, comme le locuteur affirmant qu’il y a mensonge sous-entend que ce contenu est vrai, le « savoir » du menteur renvoie également à un contenu représentationnel auquel d’autres croient : c’est une croyance partagée (ou partageable), une connaissance, une sorte de savoir sur le monde, les faits, les choses, etc. C’est donc dans un sens très général que j’emploierai le mot savoir, il ne réfère pas à un contenu représentationnel effectivement vrai d’un point de vue ontologique.
207
converse de vérace, nous obtiendrions alors une hypothèse (H3) dont le connecteur est transgressif : SAVOIR CE QUI EST VRAI PT NEG DIRE. (N.B. : DC et PT sont des abréviations pour les significations exprimables grosso modo par donc et pourtant.)
Des trois prédicats H1, H2 et H3, qui sont candidats pour appartenir à l’argumentation interne de mensonge, seul H3 est entièrement défini (au sens où le connecteur est spécifié). Il nous faut encore déterminer les connecteurs intérieurs à H1 et H2. Pour cela, nous allons nous aider de la remarque précédente : mentir est une manière de ne pas être vérace, qu’il en soit l’antonyme (H3) ou une négation.
C’est ce sens que Derrida donne au mot mensonge. Selon lui, en effet, le fait de dire ce qui est vrai n’a de sens que parce que l’homme peut mentir ; le menteur transgresse un engagement implicite envers son interlocuteur, il ne respecte pas le contrat qui le lie à l’autre et selon lequel sa parole se doit d’être vraie. Le lien social repose effectivement sur un devoir de véracité (pour Kant, c’est même un impératif moral catégorique, aucun droit de mentir ne saurait être invoqué), autoriser le mensonge rendrait caduque la possibilité même de contrat social, compte tenu que tout contrat se fonde sur une confiance en la parole donnée. De même, selon Grice, la parole se doit de respecter un certain nombre de « maximes conversationnelles », parmi lesquelles la maxime de sincérité qui est au fondement de la « communication informative » (Ducrot et Schaeffer : 70). Cet engagement à dire la vérité se présente donc comme une condition nécessaire pour que nous puissions discuter avec autrui, pour que nous ne doutions pas systématiquement de ce qui nous est communiqué et supposions que ce qui est dit est pensé par son locuteur comme vrai. Quand on parle, on s’engage implicitement à être vérace, ainsi :
Quand on ment, […] on trahit l’essence et la finalité même du langage, qui sont la promesse de la vérité ; et par conséquent, d’une certaine façon, on ne parle pas, on manque à la parole. (Derrida 2005 : 101)
Le mensonge n’est compréhensible que parce qu’il s’oppose à l’idée d’une communication où la relation entre ce qui est pensé
208
et ce qui est dit est normative : « on dit ce qu’on pense et on pense ce qu’on dit ». Seul un connecteur transgressif décrit correctement l’enchaînement argumentatif de l’aspect associé à mensonge, en révélant la doxa selon laquelle parler, c’est promettre de dire la vérité : mentir, c’est communiquer quelque chose et pourtant ne pas dire la vérité. Nous avons alors trois hypothèses transgressives :
H1 – SAVOIR QUE C’EST FAUX PT AFFIRMER
H2 – SAVOIR CE QUI EST VRAI PT DIRE QUELQUE CHOSE DE FAUX
H3 – SAVOIR CE QUI EST VRAI PT NEG DIRE
Ces hypothèses décrivent le mensonge sous trois perspectives : dans H1, le mensonge est entendu comme l’affirmation délibérée de quelque chose de faux ; dans H2, le mensonge est l’affirmation de quelque chose de faux bien que ce qui est vrai soit connu ; dans H3, le mensonge désigne le fait de ne pas dire la vérité tout en la sachant.
Il faut être attentif au fait que le choix d’un connecteur transgressif ne reflète pas une quelconque réprobation du mensonge. Ainsi, la bêtise est certes décrite par un prédicat transgressif (FACILE PT NEG COMPRENDRE), mais l’intelligence aussi (DIFFICILE PT COMPRENDRE). Ce que je soutiens, c’est que la langue impose une relation normative entre le fait de parler et de dire la vérité. Je rejoins sur ce point Nietzsche qui dénonce cette normativité ; cette consécution linguistique, structurelle, est pour lui au fondement de la tendance morale à la vérité. La langue a intériorisé le devoir de loyauté que la société impose à ses membres, à savoir de dire, toujours, la vérité et rien que la vérité. Mentir consistant à prendre l’attitude contraire, les aspects internes à mensonge, converses de ceux imposés par la morale sociale, sont transgressifs.
Une dernière remarque avant de mettre les trois prédicats
H1, H2 et H3, à l’épreuve des critères que propose la TBS pour une bonne description lexicale. On aura noté que leur caractérisation fait allusion aux mots vrai et faux de la langue sans recourir pour autant à une notion définie de Vérité. Aucun moyen ne nous est donné pour savoir si quelqu’un a oui ou non
209
menti. Ce qui nous est décrit par la TBS, c’est ce que nous disons en employant le verbe mentir ; et ce qui nous est montré, ce sont les liens que la langue établit entre ce terme et les mots dire, vrai et faux. En revanche, aucune réalité n’est donnée au mensonge lui-même. Est-ce à dire qu’il est vain de chercher à distinguer, dans le monde, divers comportements langagiers, l’un qui serait « dire la vérité » et l’autre « mentir » ? Je ne le pense pas. Ce que je défends, c’est que le mot mensonge de la langue n’en comporte pas la définition, et nous cache au contraire la réalité de ce comportement. À ce titre, la définition que Nietzsche propose du mensonge, qui ne contient aucune allusion aux prédicats H1, H2 et H3 que nous avons isolés, et qui le libère ainsi des filets du langage, me semble plus apte à décrire nos comportements langagiers.
Pour Nietzsche en effet, être véridique, c’est employer les métaphores usuelles, c’est se conformer à « l’obligation de mentir selon une convention ferme, de mentir grégairement dans un style contraignant pour tous » (Le livre du philosophe : 123) L’obéissance à la désignation conventionnelle des choses, le respect des conditions d’usage du langage, constitue ce que nous appelons « dire la vérité ». La vérité équivaut à l’interprétation de la réalité contenue dans la langue (ou au mensonge qu’elle constitue), tandis que le mensonge en est une interprétation différente :
Le menteur fait usage des désignations valables, les mots, pour faire que l’irréel apparaisse réel (…). Il mésuse des conventions fermes au moyen de substitutions volontaires ou d’inversions de noms. (Ibid. : 121)
Nietzsche pose dès lors la fiction comme origine commune au fait de mentir ou de dire la vérité, parler consistant à donner une interprétation (singulière ou conventionnelle) de la réalité au moyen du langage. Prétendre dire la vérité serait interpréter le monde en faisant sien le mensonge de la langue, les vérités étant des illusions dont on a oublié qu’elles le sont, et mentir serait recréer la subjectivité des premières métaphores.
Ainsi, Nietzsche donne une valeur positive à l’acte de mentir, habituellement déprécié par la morale sociale. Et pour ce faire, il ne change pas de connecteur. En effet, ce n’est pas le
210
connecteur transgressif qui manifeste la réprobation du mensonge, mais plutôt une argumentation externe du type mentir donc faire une mauvaise action (avec pour alternative mentir pourtant ne pas faire une mauvaise action), l’acte de dire la vérité étant quant à lui associé à l’argumentation dire la vérité donc faire une bonne action (avec pour alternative dire la vérité pourtant ne pas faire une bonne action)5. Pour s’opposer à ces associations conventionnelles qui évaluent les comportements langagiers, Nietzsche attribue au contraire à l’acte de mentir la propriété d’être bien (mentir donc faire une bonne action), et à l’acte de dire la vérité la propriété d’être mal (dire la vérité donc faire une mauvaise action). L’emploi, que fait Nietzsche des expressions mensonge et dire la vérité, serait dès lors quelque peu différent de celui des moralistes auxquels il adresse ses critiques, car ces expressions n’ont plus les mêmes valeurs. Selon lui, le philosophe doit critiquer le langage s’il veut s’opposer aux visions du monde des dominants, qui créent les valeurs et les instituent vérités par l’intermédiaire du langage ; c’est en revenant à la genèse des mots qu’il pourrait transmuter les valeurs que ceux-là ont imposées aux autres membres de la société.
2.2 LE JUGEMENT MENSONGE ET LES JUGEMENTS ARGUMENTATIVEMENT APPARENTÉS
Nous avons donc trois prédicats transgressifs susceptibles de décrire l’argumentation interne de mensonge. Pour s’assurer que ces trois aspects sont opératoires, je les concrétiserai dans un discours décrivant une situation mensongère, ou plutôt dans une situation dans laquelle le mot mensonge est employé. L’effet de la négation étant un des critères permettant de discriminer l’AI (abréviation pour argumentation interne) d’un mot, je concrétiserai ensuite leurs converses (ne pas mentir) 5 De sorte que, d’un point de vue langagier, comme Austin le soulignait pour les propositions vériconditionnelles, notre relation à la moralité consisterait (en partie) à attribuer à des propositions ou à des termes les expressions c’est bien et c’est mal.
211
dans un discours décrivant une situation comme « non mensongère ». Je conclurai alors à l’abandon de H3. Enfin, j’examinerai la cohérence du bloc sémantique dans lequel les aspects H1 et H2 s’inscrivent, en portant mon attention sur les prédicats avec lesquels ils sont en relation de transposition et de réciprocité.
2.2.1 MISE EN SITUATION
Pierre a écrit un poème et l’a donné à lire à son ami Jean qui, à son tour, l’a fait lire à Marie. Quand celle-ci demande à Jean qui l’a écrit, celui-ci répond qu’il en est l’auteur. On peut assurément dire de Jean qu’il ment ; nos trois prédicats sont-ils capables de communiquer ce même jugement ? Pour le vérifier, je paraphraserai l’énoncé (5), qui attribue à Jean le prédicat argumentatif menteur, par des enchaînements argumentatifs relevant des aspects H1, H2 et H3.
(5) « Jean ment à Marie »
H1’ – Jean sait qu’il n’a pas écrit le poème pourtant il l’affirme à Marie.
H2’– Jean sait que Pierre a écrit le poème pourtant il affirme à Marie que c’est lui-même.
H3’ – Jean sait qui est l’auteur du poème pourtant il ne le dit pas à Marie.
L’enchaînement argumentatif H1’ communique le fait que Jean a dit une chose qu’il savait fausse (SAVOIR QUE C’EST FAUX PT AFFIRMER) ; H1’ attribue bien à Jean la propriété de mentir, même s’il n’est pas fait mention de la chose vraie. L’aspect concrétisé dans H2’ (SAVOIR CE QUI EST VRAI PT DIRE QUELQUE CHOSE DE FAUX) décrit la duplicité du menteur, l’écart entre ce que sait Jean (le vrai) et ce qu’il affirme à Marie (le faux), il dit bien de Jean qu’il ment. Ce qui n’est pas le cas de H3’ qui concrétise SAVOIR CE QUI EST VRAI PT NEG DIRE : même si la vérité n’est pas dite, cet enchaînement ne communique pas qu’il y a eu mensonge. Pour cela, il aurait fallu que quelque chose de faux soit communiqué : en disant de Jean qu’il tait le vrai sans induire à la fausseté, on ne dit pas qu’il ment. On objectera que
212
la langue elle-même, à travers l’expression mensonge par omission contient l’idée que l’omission est un mensonge. Je répondrai que l’expression mensonge par omission n’indique pas seulement l’omission d’une vérité, mais signale de plus que la vérité non communiquée rend faux ce qui est communiqué. Mentir serait communiquer la fausseté (on retrouve là le sens (b) de mentir donné par ATILF) et non ne pas dire la vérité : H3, construit comme la négation de vérace, ne permet pas de dire le mensonge de Jean.
2.2.2 EFFET DE LA NÉGATION
Selon le deuxième critère, celui de la négation, l’expression ne pas mentir doit pouvoir être associée aux converses des prédicats choisis pour décrire mentir. Rappelons que la relation de conversion comporte une inversion du mode argumentatif : l’aspect mensonge étant transgressif, l’aspect non mensonge sera normatif (le connecteur PT NEG deviendra un DC, et le connecteur PT deviendra un DC NEG) :
Converse de H1 – SAVOIR QUE C’EST FAUX DC NEG AFFIRMER
Converse de H2 – SAVOIR CE QUI EST VRAI DC NEG DIRE QUELQUE CHOSE DE FAUX
Converse de H3 – SAVOIR CE QUI EST VRAI DC DIRE
La situation est la suivante : Pierre a écrit un poème et l’a donné à lire à son ami Jean qui, à son tour, l’a fait lire à Marie. Celle-ci a demandé qui en était l’auteur, Jean a pensé lui faire croire que c’était lui, puis ne l’a pas fait (ou quelqu’un pense qu’il aurait pu le faire – ce peut-être le locuteur, l’interlocuteur, un tiers, etc.).
(6) « Jean n’a pas menti à Marie »
Converse de H1’ – Jean sait qu’il n’a pas écrit le poème donc il ne l’affirme pas à Marie.
Converse de H2’ – Jean sait que Pierre a écrit le poème donc il n’affirme pas à Marie que c’est lui-même.
Converse de H3’ – Jean sait qui est l’auteur du poème donc il le dit à Marie.
213
Le converse de H1’ communique bien que Jean n’a pas menti puisqu’il n’a pas dit faux ; néanmoins, il n’a pas dit la vérité. Ne pas être menteur n’impliquerait donc pas d’être vérace. Le converse de H2’ attribue également à Jean la propriété de n’avoir pas menti, il ne communique pas quelque chose de faux et ne dit pas non plus la vérité. Le converse de H3’, en revanche, n’attribue pas à Jean la propriété de n’être pas menteur, mais d’être vérace. Afin de ne pas mentir, il serait donc suffisant de ne pas dire quelque chose de faux, la vérité n’a pas besoin d’être énoncée. Cette distinction est importante pour la morale, puisqu’elle permet de ne pas dire la vérité sans pour autant mentir. C’est pourquoi saint Augustin – on se souvient qu’il donne le sens H2 au verbe mentir –, après avoir condamné le prêcheur qui, pour convertir plus facilement, recourt au mensonge dans l’enseignement de la religion et dans l’étude des Écritures, l’invite plutôt à ne pas dire la vérité :
[…] il lui est permis, dis-je, de taire dans l’occasion tout ce qu’il croit devoir passer sous silence ; mais il ne peut jamais mentir, par conséquent jamais rien cacher par un mensonge. (Du mensonge : Chap. X)
Taire le vrai n’est pas mentir, puisqu’il n’y a pas eu remplacement du vrai par le faux. Mentir n’est pas l’antonyme de dire la vérité (être vérace), ces deux termes appartiennent à des blocs sémantiques différents ; nous pouvons donc éliminer H3.
214
2.2.3 LES BLOCS SÉMANTIQUES DE H1 ET H2
Bloc sémantique de H1
mentir SAVOIR QUE C’EST FAUX
PT AFFIRMER Bien qu’il sache que c’est faux, Jean l’affirme.
ne pas parler sans savoir NEG SAVOIR QUE C’EST FAUX
PT NEG AFFIRMER Il ne sait pas que c’est faux,
pourtant Jean ne l’affirme pas
parler sans savoir NEG SAVOIR QUE C’EST FAUX
DC AFFIRMER Jean ne sait pas que c’est faux donc il l’affirme.
ne pas mentir
SAVOIR QUE C’EST FAUX DC NEG AFFIRMER
S’il sait que c’est faux, Jean ne le dira pas.
Le bloc sémantique de H1 a l’avantage de mettre en
parallèle différentes communications fausses, dire faux involontairement quand on ne sait pas que ça l’est (parler sans savoir) et volontairement quand on le sait (mentir). La transposition présente une gradation cohérente, énoncer faux sans le savoir (NEG SAVOIR QUE C’EST FAUX DC AFFIRMER) est une communication fausse moins conséquente qu’énoncer faux en le sachant (SAVOIR QUE C’EST FAUX PT AFFIRMER). Cependant, le transposé de ne pas mentir, l’aspect NEG SAVOIR QUE C’EST FAUX PT NEG AFFIRMER, est surprenant, comment comprendre qu’en ne sachant pas que c’était faux, Jean ne l’ait pourtant pas dit ? Il me semble tout de même qu’il est possible d’attribuer ce prédicat. On imaginera pour cela qu’une fausse information circule, elle est admise par beaucoup de monde, mais pas par Jean. Un locuteur pourrait parler de lui en exprimant cet aspect : « Il ne savait pas que cette information était fausse, pourtant il ne l’a pas propagée. » Cette argumentation correspond à l’expression ne pas parler sans savoir.
215
Bloc sémantique de H2
mentir SAVOIR CE QUI EST VRAI
PT DIRE QQC DE FAUX Bien que Jean connaisse la vérité, il dit faux.
ne pas dire n’importe quoi NEG SAVOIR CE QUI EST VRAI
PT NEG DIRE QQC DE FAUX Jean ne sait pas ce qui est vrai,
pourtant il ne dit pas faux. dire n’importe quoi NEG SAVOIR CE QUI EST VRAI
DC DIRE QQC DE FAUX Jean ne sait pas ce qui est vrai, donc il dit faux.
ne pas mentir SAVOIR CE QUI EST VRAI
DC NEG DIRE QQC DE FAUX Si Jean sait ce qui est vrai,
il ne dit pas faux.
Dans le bloc de H2, le transposé de mentir ne renvoie pas à parler sans savoir, le fait de dire faux est intentionnel. Dans H1, l’aspect transposé, NEG SAVOIR QUE C’EST FAUX DC AFFIRMER, exprime le fait d’affirmer faux sans le savoir – malgré soi, alors que dans H2, l’aspect NEG SAVOIR CE QUI EST VRAI DC DIRE QUELQUE CHOSE DE FAUX exprime encore le fait d’affirmer faux sans savoir ce qui est vrai, mais il semble difficile d’ajouter le « malgré soi ». Cet aspect rendrait l’interdépendance sémantique problématique : peut-on dire volontairement faux sans savoir ce qui est vrai, puisque le propos pourrait tout aussi bien être vrai ? Cela semble possible. Par exemple, cet aspect pourrait décrire quelqu’un trouvant quelque chose à dire, n’importe quoi, plutôt que de reconnaître qu’il ne sait pas. La gradation serait cohérente, il y aurait bien l’idée d’une surenchère : « il dit n’importe quoi et peut-être même ment-il. » Cet aspect pourrait également décrire quelqu’un dans l’incertitude, qui sait que ce qu’il dit est peut-être faux parce qu’il ne sait plus ce qui est vrai :
« Personne ne peut voir mon visage, pensa Ulrich. Je ne sais pas moi-même si je mens. » Il parlait comme on résume, en un moment d’incertitude, le résultat d’une certitude de longues années. Il se souvint que le rêve de jeunesse qu’il exposait maintenant à Walter s’était vidé de toute substance depuis longtemps. Il ne voulut pas continuer. (Musil 1989 : 272)
216
[En un moment d’incertitude] Ulrich énonce quelque chose qu’il a longtemps pensé et prend conscience en le communiquant qu’il n’y adhère plus, il a le sentiment de dire faux. Ulrich feindrait de savoir, mais ne mentirait pas, il dirait seulement « n’importe quoi » (transposé normatif de mentir, le groupe verbal dire n’importe quoi affaiblit mentir). L’aspect ne pas dire n’importe quoi, NEG SAVOIR CE QUI EST VRAI PT NEG DIRE QUELQUE CHOSE DE FAUX, poserait un problème similaire, comment quelqu’un peut-il ne pas dire quelque chose de faux bien qu’il ne sache pas ce qui est vrai ? Reprenons l’exemple de la rumeur : « Jean ne savait pas ce qui s’était vraiment passé, pourtant il n’a pas colporté cette rumeur qu’il pensait être fausse. »
3 OBJECTIONS SUR LE CONTENU ET LE MODE DE L’ARGUMENTATION INTERNE DE MENSONGE
Je retiendrai deux prédicats pour décrire l’argumentation interne de mensonge : SAVOIR QUE C’EST FAUX PT AFFIRMER (H1) / SAVOIR CE QUI EST VRAI PT DIRE QUELQUE CHOSE DE FAUX (H2). En choisissant, à l’intérieur de chacun des prédicats, un connecteur oppositif pour relier le premier segment au second, et les verbes dire ou affirmer, j’ai défini le mensonge comme une « anomie » de la communication verbale (présupposée véridique), comme une transgression, au sens technique du terme, de la loi de la parole consistant à dire la vérité quand nous la connaissons. Le verbe mentir est selon moi doxal. Dire de quelqu’un qu’il est menteur, ce n’est pas dire qu’il suit d’autres lois ; c’est dire qu’il contrevient aux lois de la parole ordinaire. Quant à la tentative de tromperie, intrinsèque au mensonge, j’ai choisi d’en rendre compte dans les argumentations externes. Deux objections peuvent cependant être faites à cette description : sur le connecteur transgressif et sur les verbes dire et affirmer. Le leurre intentionnel du mensonge ne devrait-il pas être inscrit dans l’argumentation interne, en préférant dans H1 et H2 un connecteur normatif ? Le mensonge est-il bien propre au langage ?
217
3.1 LE LEURRE INTENTIONNEL DU MENSONGE : UN ÉLÉMENT DE L’AI OU DE L’AE ?
Si l’on considérait l’énonciation du point de vue du menteur, dont l’acte consiste à communiquer, avec ou sans raison, un contenu faux dans l’intention d’être cru, la loi du discours mensonger serait de dire la fausseté, d’affirmer quelque chose parce que c’est faux et non pas bien que cela soit faux. La relation entre les deux segments serait alors normative (le connecteur serait un DC) et non transgressive comme je le propose. Les hypothèses H4 et H5 décrivent le contenu de H1 et de H2 basculé en mode normatif :
H4 – SAVOIR QUE C’EST FAUX DC AFFIRMER
H5 – SAVOIR CE QUI EST VRAI DC DIRE FAUX
Prenons pour exemple Pinocchio6 : celui-ci a reçu cinq pièces du marionnettiste dont il a été le prisonnier, afin de les remettre à son père. Peu après, victime d’un mensonge, il se les fait voler : deux brigands lui ont raconté qu’en les semant dans le Jardin des miracles, un arbre pousserait et porterait des pièces d’or en guise de fruits. Le but des brigands est de dire le faux pour que la ruse fonctionne, on pourrait décrire leur comportement par :
H4’ – Les brigands savent que les arbres ne font pas pousser des pièces d’or, donc ils l’affirment.
H5’ – Les brigands savent que les arbres ne font pas pousser des pièces d’or, donc ils disent à Pinocchio que les arbres du Jardin des miracles le font.
Mais ces deux enchaînements ne développeraient pas l’argumentation interne de ils ont menti. Ici, c’est le second segment qui, à lui seul, signifie ils mentent (le pronom le de ils l’affirment renvoie à cette proposition fausse) et les enchaînements dans leur entier expliquent pourquoi ils ont
6 Je me réfère au film Les Aventures de Pinocchio de Luigi Comencini (1972).
218
menti : ils ont affirmé quelque chose de pourtant faux, parce qu’ils voulaient voler Pinocchio. Ils posent, non pas la feinte des brigands, mais leur volonté de feinter. Prenons un autre exemple : Pinocchio rencontre la fée et lui raconte son histoire, elle lui demande combien de pièces le marionnettiste lui a donné, il répond quatre, ce qui est faux, son nez s’allonge, il ment. Afin de justifier son mensonge, il se reprend : « Cinq et j’en ai donné un aux pauvres », son nez s’allonge un peu plus, il ment encore. La raison du premier mensonge est incompréhensible, puisque l’argent a été volé, dire quatre, trois ou deux plutôt que cinq ne change rien à la perte. Et les descriptions par H4’ et H5’ de cette première situation sont impossibles :
H4’ – Pinocchio sait que le marionnettiste ne lui a pas donné quatre pièces, donc il l’affirme à la fée.
H5’ – Pinocchio sait que le marionnettiste lui a donné cinq pièces, donc il dit à la fée qu’il lui en a donné quatre.
Certes, Pinocchio ment, mais on ne comprend pas la logique de feinteur de Pinocchio. En revanche, on peut utiliser H4’ et H5’ pour décrire le second mensonge, compte tenu qu’il y a cette fois un motif, justifier le premier mensonge.
H4’ – Pinocchio sait que, sur les cinq pièces, il n’en a pas donné une aux pauvres, donc il l’affirme.
H5’ – Pinocchio sait qu’il n’a rien donné aux pauvres, donc il dit à la fée que, sur les cinq pièces, il leur en a donné une.
Il apparaît ainsi que la motivation du mensonge relève d’une pratique du mensonge, je ne l’introduirai donc pas dans l’argumentation interne de mensonge. Comment décririons-nous sinon les expressions mentir sans raison ou mentir pour mentir, faudrait-il les interpréter comme ne pas vraiment mentir ? En outre, choisir un connecteur normatif construirait un aspect paradoxal : mentir consisterait dès lors à affirmer une chose parce qu’on sait qu’elle est fausse (H4) ou à dire faux parce qu’on connaît le vrai (H5). Il faut en effet distinguer le transgressif du paradoxal, le prédicat transgressif est un refus du prédicat normatif, mais il reconnaît en même temps sa légitimité, car ils appréhendent tous deux le même bloc ; par
219
contre, le prédicat paradoxal conteste un des blocs inscrits dans la signification d’un de ses segments :
Dire qu’un aspect A de type X CONN Y est paradoxal, c’est dire que l’entité X ou l’entité Y possèdent dans leur argumentation externe structurelle un aspect antithétique à A. (Ducrot 2001 : 24)
Il est inscrit dans la signification d’affirmer ou de dire une relation normative à la vérité : on affirme quelque chose parce qu’on le pense vrai et non parce qu’on le pense faux.
Ainsi, quelles que soient les raisons de mentir, l’argumentation interne est transgressive. Certes, le mensonge suppose l’intention de tromper et il est une manière de la mettre en acte ; il appartient à la catégorie des leurres, sa particularité est d’être intentionnel. Mais, pour rendre compte des motifs du trompeur et de ses intentions, je recourrai à l’argumentation externe gauche de mensonge en tant que leurre intentionnel (MOTIF DC INTENTION DE TROMPER / NEG MOTIF PT INTENTION DE TROMPER), c’est le second de ces aspects qui sera sous-jacent aux expressions mentir sans raison et mentir pour mentir. Cette argumentation externe, au même titre que l’argumentation externe droite de mensonge (MENSONGE DC TROMPER / MENSONGE PT NEG TROMPER), constitue un point de vue supplémentaire sur le mot mensonge, elle appartient, avec d’autres, à sa signification de manière externe (nous traiterons de ces questions dans la partie 4). C’est le connecteur du prédicat normatif MOTIF DC INTENTION DE TROMPER que nous entendons quand nous pensons à la logique des menteurs et non celui de l’AI de mentir : le menteur affirme délibérément faux parce qu’il a une raison de chercher à tromper et non parce qu’il connaît le vrai.
3.2 LE MENSONGE : UN LEURRE LANGAGIER ?
Le mensonge est-il un leurre langagier ? Le proverbe On sait mentir sans parler signifie-t-il que le mensonge pourrait ne pas être uniquement une feintise par le langage ? Les verbes dire et affirmer dans la définition de mentir sont-ils nécessaires ? Si nous ancrons le mensonge dans le langage, à quoi renvoie ce
220
qui est nommé mensonge bien que cela soit de l’ordre de l’image ou du comportement ?
L’expression mensonge du corps invite à qualifier de menteur un comportement qui n’est pas accompagné de la parole, où le geste n’est pas en relation avec une communication langagière mensongère, mais est lui-même une communication mensongère. Le mensonge du corps renverrait alors à un écart entre ce qui est montré et ce qui est vécu : s’adressant à un regard extérieur, on simulerait des attitudes, des émotions, des sentiments que l’on ne ressent pas. C’est la raison pour laquelle le sens (b) de mentir (contenir ou exprimer des choses fausses) invite à entendre le mensonge de manière moins stricte, suivant la catégorie plus générale à laquelle il appartient, celle du faux, des feintes, des leurres – intentionnels. Dans un énoncé tel que « Rien que de traverser rapidement un intérieur parisien, je savais juger les habitudes, les mœurs, et, bien que les meubles mentent autant que les visages, il était rare que je me trompasse… » (Mirbeau), il faut entendre le mensonge des meubles comme signifiant que leurs propriétaires veulent faire croire au visiteur qu’ils ont telle ou telle qualité alors qu’il n’en est rien. Le leurre doit être entendu comme une communication fausse faisant accroire, trompant l’autre, de sorte que le mensonge entre dans cette catégorie et ne serait pas spécifiquement langagier.
Je ne retiendrai pas cette objection et maintiendrai que le verbe mentir, dans tous ses emplois, fait allusion au verbe dire. En effet, on aura noté que l’objection précédente repose sur deux hypothèses. La première, que j’accepte, est que l’emploi de mentir dans le passage de Mirbeau est à prévoir dans la signification de ce verbe, même si la tradition le classerait parmi les emplois métaphoriques. Comme le montre Schulz (2002), l’analyse lexicale doit tenir compte de tous les emplois et ne doit pas commencer par un classement des emplois en littéraux et en figurés. La seconde, que par contre je refuse, est que le verbe dire, dans tous ses emplois, renvoie à l’action proprement humaine d’articuler des sons significatifs. Tel n’est pas le cas par exemple dans les monuments nous disent beaucoup des temps passés. Attacher H1 et H2 au verbe mentir, ce n’est pas prévoir que tous les mensonges passent par les
221
mots ; c’est prévoir que tous les emplois seront paraphrasables par des discours, d’un certain type, comportant en particulier le verbe dire. Or c’est bien le cas du passage de Mirbeau : le fragment les meubles mentent autant que les visages peut se paraphraser par autant que les visages, les meubles disent des choses fausses.
Mais l’exemple de Mirbeau pourrait donner lieu à une autre objection quant aux segments des prédicats choisis pour décrire mentir, du fait que même si les meubles disent des choses fausses, ils ne savent pas ce qui est vrai. Il n’est en effet pas possible de dire les meubles savent ce qui est vrai pourtant ils disent le faux. La paraphrase serait plutôt les propriétaires savent ce qui est vrai pourtant leurs meubles disent ce qui est faux. Ainsi, même si l’exemple de Mirbeau n’est pas métaphorique, il serait quand même un peu déviant, puisque ce n’est pas le même sujet grammatical que l’on retrouve dans les deux segments. On notera cependant que ce que dit finalement ce passage de Mirbeau, c’est qu’il y a une unité entre le propriétaire et ses meubles : la déviance du passage (deux sujets grammaticaux) ne serait qu’apparente.
4 PRÉSENTATION DES ARGUMENTATIONS EXTERNES DE MENSONGE
Carel (2011) propose deux définitions de l’argumentation externe. Celle qui est à l’origine de la TBS et selon laquelle :
Un aspect argumentatif A sera dit appartenir à l’argumentation externe d’une expression E si (a) E exprime A, (b) E intervient matériellement et sémantiquement dans certains enchaînements relevant de A, soit dans leurs premiers segments, soit dans leurs seconds segments. (p. 109)
Et une définition plus abstraite suivant laquelle :
Tout aspect attaché à un mot de même que son converse appartient de fait à l’argumentation externe droite de ce mot, que ce mot apparaisse ou non dans les enchaînements de l’aspect. (p. 118)
Dans les deux cas, l’argumentation externe apparaît comme une description supplémentaire du mot, ne se déduisant pas de
222
l’argumentation interne, mais s’ajoutant à elle afin de pallier ses manques. On a vu plus haut que j’ai choisi la seconde définition : c’est elle qui me permettra le mieux de décrire les liens entre mensonge et tromperie.
Le mensonge appartient à la catégorie générale des leurres, il est une communication langagière visant à tromper, à ancrer son destinataire dans une fausse croyance, cette appartenance est structurelle à la langue, car elle est inscrite dans la signification même de mensonge, et selon moi, au niveau de ses argumentations externes. Le mot mensonge en tant que leurre intentionnel, en tant que tentative de tromperie, bénéficie dès lors des relations sémantiques des mots leurre et intention de tromper, et exprime, comme eux, des interdépendances sémantiques avec les notions de simulation, de dissimulation, de vraisemblance, de motif et de confiance.
Je me pencherai dans un premier temps sur la principale argumentation externe de mensonge, l’alternative MENSONGE DC TROMPER / MENSONGE PT NEG TROMPER, ou plus précisément, en utilisant la seconde définition de l’argumentation externe, sur l’alternative LEURRE DC FAIRE ACCROIRE / LEURRE PT NEG FAIRE ACCROIRE. J’expliciterai en particulier le choix des connecteurs de cette alternative, l’argumentation normative il a menti donc il a fait croire à faux ne donnant pas au mensonge un pouvoir de conviction (Swift jouera avec cette idée). Dans un deuxième temps, je décrirai le mensonge comme intention de tromper, dans les alternatives INTENTION DE TROMPER DC SIMULATION / INTENTION DE TROMPER PT NEG SIMULATION, INTENTION DE TROMPER DC DISSIMULATION / INTENTION DE TROMPER PT NEG DISSIMULATION et MENSONGE DC VRAISEMBLANCE / MENSONGE PT NEG VRAISEMBLANCE qui caractérisent la mise en œuvre du mensonge. En effet, pour tromper en mentant, il est non seulement nécessaire d’énoncer sciemment faux, mais aussi que cette énonciation ait l’air vérace, que le vrai soit bien dissimulé et que le faux énoncé ait l’air vraisemblable. Enfin, pour rendre compte de ce qui motive le mensonge et de l’intention de tromper qu’il suppose, nous étudierons l’argumentation externe qui exprime la relation entre le motif et la tentative de tromperie : MOTIF DC MENTIR / NEG MOTIF PT
223
MENTIR, et plus généralement MOTIF DC INTENTION DE TROMPER / NEG MOTIF PT INTENTION DE TROMPER.
4.1 ARGUMENTATIONS EXTERNES LIÉES À LEURRE
Bien qu’un mensonge soit souvent assimilé à une tromperie, il n’en est qu’une tentative, le verbe mentir est en effet un verbe d’action qui, en tant que tel, « indique une activité orientée vers l’obtention d’un résultat sans impliquer que ce résultat a été obtenu […]. » (Ducrot 2002 : 6) Le mensonge est une visée vers la tromperie et non la tromperie elle-même, il peut réussir (bien mentir) ou échouer (mal mentir), il a donc dans son argumentation externe le fait de tromper ou de ne pas tromper. Le menteur ment afin de faire accroire, la tromperie est effective uniquement si le menteur est cru.
4.1.1 LE BLOC SÉMANTIQUE DE TROMPER EN MENTANT ET DE NE PAS TROMPER EN MENTANT
Bloc sémantique des prédicats tromper et ne pas tromper
tromper sans leurrer NEG LEURRE PT FAIRE ACCROIRE Même s’il n’y a pas eu de leurre, cela a fait croire à faux.
ne pas tromper tout en leurrant LEURRE PT NEG FAIRE ACCROIRE
Bien que Jean ait feinté, il n’a pas fait accroire.
tromper en leurrant LEURRE DC FAIRE ACCROIRE Il communique quelque chose de faux, donc il fait accroire.
ne pas tromper sans leurrer NEG LEURRE DC NEG FAIRE ACCROIRE
S’il ne ment pas, il ne fera pas croire à faux.
Le connecteur DC de l’aspect tromper en leurrant (LEURRE
DC FAIRE ACCROIRE) n’exprime pas une relation normative entre la communication d’un contenu faux et le fait de croire, cette relation étant toujours transgressive (FAUX PT CROIRE), mais entre la visée (leurrer) et son résultat (tromper). Si le connecteur est un DC, cela ne signifie pas que l’on croit à ce qui est dit par le menteur parce que c’est faux, mais parce qu’il y a leurre ; il faut ainsi distinguer Jean a menti à Marie pourtant elle l’a cru (FAUX PT CROIRE) et Jean a menti à Marie
224
donc il lui a fait croire à quelque chose de faux (LEURRE DC FAIRE ACCROIRE).
Si nous nous autorisions un connecteur normatif : Jean ment à Marie donc elle le croit (FAUX DC CROIRE), nous attribuerions au faux un pouvoir de conviction, seul un connecteur transgressif peut décrire l’opposition inhérente au fait de croire à quelque chose de faux : Jean ment à Marie pourtant elle le croit (FAUX PT CROIRE). Dire que Marie croit au mensonge de Jean, c’est employer le mot mensonge en décalage et communiquer qu’est faux ce à quoi Marie croit. Il serait effectivement difficile de dire que Marie croit à un mensonge sans admettre du même coup qu’elle croit à quelque chose bien que cela soit faux. Quand on croit à un mensonge sans savoir que cela en est un, on ne peut pas dire il me ment et je le crois, mais il me parle et je le crois ; on ne croit, généralement, à un discours mensonger que parce qu’on le suppose vrai, ce n’est que rétrospectivement qu’on apprend qu’on a cru à quelque chose de faux. La doxa de la langue impose donc que le connecteur qui relie faux à croire soit transgressif (FAUX PT CROIRE), et, du fait que mentir est une activité ayant pour visée la tromperie, elle impose que mensonge soit connecté normativement à tromperie (LEURRE DC FAIRE ACCROIRE). De sorte que l’alternative constituée par l’argumentation externe LEURRE DC FAIRE ACCROIRE / LEURRE PT NEG FAIRE ACCROIRE peut être également évoquée par les expressions réussir un mensonge et mentir en vain ou sans succès, dont la première sélectionne l’obtention du résultat (réussir un mensonge, c’est tromper) et la seconde l’échec (mentir sans succès, c’est ne pas tromper).
On aura noté que je distingue les liens que mentir entretient avec le couple LEURRE DC FAIRE ACCROIRE / LEURRE PT NEG FAIRE ACCROIRE et avec le couple FAUX DC NEG CROIRE / FAUX PT CROIRE. Seul le premier couple est inscrit dans la signification de mensonge : par définition, le mensonge est un leurre ; ce n’est par contre que par un effet de décalage du mot mentir, entendu dans une forme très générale (cf. le sens (b) « exprimer des choses fausses » que ATILF donne à mentir), que mentir consiste à dire faux et donc à ne pas être cru (FAUX DC NEG CROIRE).
225
On peut trouver des illustrations de ces prédicats dans les
écrits qui traitent des usages et des conséquences du mensonge et de la vérité. Leurs auteurs interrogent les relations du mensonge à la tromperie, ainsi que la manière dont s’articulent l’acte de dire la vérité et le fait de tromper. Certains d’entre eux acceptent les blocs sémantiques doxaux auquel appartiennent ces prédicats, et privilégient, à l’intérieur de ceux-ci, tel(s) prédicat(s) plutôt que tel(s) autre(s) ; tandis que d’autres construisent un bloc sémantique paradoxal et proposent un autre type d’interdépendance sémantique entre mentir et tromper, et entre dire la vérité et tromper. En s’opposant aux blocs doxaux, ils communiquent l’idée que le mensonge n’est pas trompeur parce qu’il permettrait mieux de dire la vérité que l’acte de dire la vérité lui-même (ce qu’exprimerait le prédicat doxal MENTIR PT NEG TROMPER), et créent un nouveau prédicat, paradoxal : MENTIR DC NEG TROMPER.
Avec le concept du mentir vrai, Aragon (1980) propose d’entendre le mensonge, non pas comme une tentative de tromperie, mais comme une tentative de non tromperie. Le mensonge vrai qu’il propose ne consiste pas à énoncer le faux même si on détient la vérité afin d’empêcher l’autre d’y accéder et ainsi le tromper, mais à dire le faux tout en connaissant la vérité pour que l’autre puisse se représenter celle-ci de manière plus juste, et ne soit pas trompé. Ce n’est pas un mensonge qui ne trompe pas malgré sa visée et qui renverrait au prédicat doxal MENTIR PT NEG TROMPER, c’est un mensonge qui ne trompe pas justement parce qu’il ne prétend pas être vrai, le mensonge étant, pour Aragon, plus à même d’exprimer le vrai que l’acte de dire la vérité. C’est à un prédicat paradoxal qu’il renvoie : MENTIR DC NEG TROMPER. Pour énoncer qu’un menteur ne cherche pas à nous tromper en nous mentant, nous sommes contraints d’ajouter une explication : ce mensonge ne nous trompe pas parce qu’il exprime mieux la vérité que l’acte de dire la vérité. Nietzsche défend également l’idée selon laquelle le mensonge permettrait de mieux représenter le réel que la vérité, mais cela, parce que le mensonge trompe moins que la vérité, étant donné qu’il ne prétend pas dire ce qui est. De sorte que Nietzsche, comme le fera Aragon, attribue à
226
mensonge l’aspect paradoxal MENTIR DC NEG TROMPER, mais il relie également dire la vérité à l’aspect paradoxal DIRE LA VÉRITÉ DC TROMPER. Le basculement de ces prédicats en mode paradoxal participe peut-être aux nouvelles valeurs que Nietzsche a attribuées aux actes de mentir (mentir donc bonne action, puisqu’il n’y a pas recherche de tromperie) et de dire la vérité (dire la vérité donc mauvaise action, puisqu’il y a recherche de tromperie).
4.1.2 LES SYNTAGMES BIEN MENTIR ET MAL MENTIR
Pour comprendre certaines constructions syntagmatiques, il est nécessaire de différencier les mots qui, dans le syntagme, communiquent un contenu argumentatif, et les mots qui, dans le syntagme, servent d’outils et qui, dans cette fonction d’outil, ne communiquent aucun aspect argumentatif. Parmi les « mots outils », Ducrot place les connecteurs qui sont au fondement du sens, les articulateurs (mais, puis, etc.) qui articulent des argumentations, et les opérateurs :
Nous entendons par « opérateur » un mot Y qui, appliqué à un mot X, produit un syntagme XY dont le sens est constitué d’aspects contenant les seuls mots pleins déjà présents dans l’AI et dans l’AE de X. En d’autres termes l’opérateur ne fait que combiner d’une façon nouvelle, que bricoler, que réorganiser, les constituants sémantiques de X. Certains opérateurs n’ont eux-mêmes, dans aucun de leurs emplois, d’AI et d’AE : c’est le cas, je pense, pour les différentes formes de négations. Mais il arrive aussi que des mots ayant, dans certains emplois, une AI et une AE, et y jouant donc le rôle de mots pleins, aient, dans d’autres emplois, fonction de purs opérateurs. (Ducrot 2002 : 3)
Ainsi, les adverbes mal et bien dans les construction bien mentir et mal mentir ne joueront pas leur rôle de mots pleins, mais devront être considérés comme des opérateurs ; de même pour transparent dans mensonge transparent ou sans raison dans mentir sans raison.
Les adverbes mal et bien sont, à l’intérieur des syntagmes mal mentir et bien mentir, des opérateurs, mais de quelle nature ? Sont-ils des internalisateurs (c’est-à-dire qu’ils sélectionnent une des possibilités de l’alternative qui constitue
227
l’argumentation externe de mentir) ou sont-ils des modificateurs (c’est-à-dire qu’ils renforcent (les réalisants) ou affaiblissent (les déréalisants) l’AE externe de mentir) ? Si mal devait être interprété comme un modificateur déréalisant – atténuateur ou inverseur (Ducrot 1995), mal mentir serait équivalent à mentir un peu ou à peu mentir (un peu et peu étant les modèles des modificateurs déréalisants). Or une telle interprétation apparaît injustifiée : dire de quelqu’un qu’il a mal menti, ce n’est pas dire qu’il n’a pas menti ou qu’il n’a pas vraiment menti7. On notera dans ce sens, conformément aux critères permettant de décider quelle est l’action d’un mot sur un autre (Carel 2011 et Ducrot 1995), qu’il est possible de dire il ment beaucoup mais mal alors qu’il est impossible de dire il ment beaucoup mais peu. Mentir mal n’est pas une manière de peu mentir ou de ne pas mentir. Quand nous disons de quelqu’un qu’il ment mal, nous lui attribuons la propriété de ne pas réussir à faire croire à ses mensonges, ce qui porte à entendre l’adverbe mal comme un internalisateur. Mal contraint à sélectionner l’une des argumentations externes de mentir, celle dans laquelle la visée, faire accroire, est en échec. Ce que confirme l’analyse de bien mentir, puisque celui qui ment bien est, au contraire, capable de faire croire n’importe quoi ; bien sélectionne l’AE dans laquelle la tentative de tromperie réussit8. On remarquera ainsi qu’il est possible de dire il ment et même beaucoup et qu’il est impossible de dire *il ment et même bien. L’adverbe bien ne réalise donc pas mentir, il n’est pas une manière de beaucoup mentir.
7 Si mal était un modificateur déréalisant atténuateur, l’acte de mentir serait amoindri et mal mentir aurait la même AI que mensonge ; s’il était inverseur, nous opérerions alors une négation de mentir et attribuerions à mal mentir l’AI converse de mentir, à savoir celle de ne pas mentir. 8 Si bien devait être un modificateur réalisant, il renforcerait l’argumentation interne de mentir, il aurait la même orientation argumentative, le bon menteur serait alors décrit comme quelqu’un qui réussirait bien à dire quelque chose de faux à partir de ce qu’il sait être vrai. Nous attribuerions alors à bien mentir la même AI qu’à mentir.
228
En conséquence, comme mal fait échouer la visée de mentir (tromper), l’AI de mal mentir sera constituée uniquement de l’externe de mentir : MENTIR PT NEG TROMPER (LEURRE PT NEG FAIRE ACCROIRE). Nous parlerons alors d’internalisation transgressive par la droite (il est question de l’argumentation externe droite de mentir dans laquelle seul l’aspect transgressif est retenu). Ainsi, dire que Jacques ment mal, c’est lui attribuer le fait de mentir et pourtant de ne pas tromper (il ne fait pas croire à son mensonge). Au contraire, bien mentir c’est rendre l’autre incapable de saisir la fausseté de son discours et donc être cru. L’internalisateur bien a donc pour fonction de choisir l’AE normative de mentir (nous parlerons d’internalisation normative par la droite) ; nous aurons alors comme AI de bien mentir l’aspect MENTIR DC TROMPER (LEURRE DC FAIRE ACCROIRE). Bien mentir, c’est réussir la visée du mensonge, aussi dire que Jeanne ment bien, c’est dire qu’elle trompe quand elle ment. En conséquence, bien mentir serait équivalent à mentir avec succès et mal mentir à mentir sans succès.
4.2 ARGUMENTATIONS EXTERNES LIÉES À INTENTION DE TROMPER
4.2.1 LES RELATIONS DU MENSONGE À LA SIMULATION, LA DISSIMULATION ET LA VRAISEMBLANCE
Comme bien mentir et mal mentir, les syntagmes savoir mentir et ne pas savoir mentir, ainsi qu’être capable de mentir et être incapable de mentir ni ne réalisent ni ne déréalisent mentir, mais ont pour argumentation interne certaines de ses argumentations externes. Tous ces syntagmes expriment l’idée que le menteur possède, ou non, une aptitude à tromper, sans lever l’ambiguïté quant aux raisons pour lesquelles il maîtrise, ou non, l’art du mensonge. Ainsi, le mauvais menteur peut être incompétent, soit parce qu’il ne réussit pas à simuler une énonciation vérace, soit parce qu’il ne parvient pas à dissimuler la vérité, soit parce que son mensonge est invraisemblable. Savoir mentir et être capable de mentir peuvent exprimer l’idée selon laquelle le menteur est un bon simulateur, un bon dissimulateur ou un bon inventeur (le propos mensonger étant
229
crédible), tandis que ne pas savoir mentir ou ne pas être capable de mentir décrivent le menteur comme essayant de mentir sans réussir à simuler la véracité, à dissimuler ce qu’il sait, ou à communiquer quelque chose auquel on peut croire. Ces différents syntagmes caractérisent donc les aptitudes requises pour être un bon menteur (qui ment bien et est cru) ou un mauvais menteur (qui ment mal et n’est pas cru).
Une première AE relie l’intention de tromper (mentir) et la simulation (paraître vérace) : INTENTION DE TROMPER DC SIMULATION / INTENTION DE TROMPER PT NEG SIMULATION. Ainsi, l’expression mensonge transparent peut être interprétée comme un mensonge qui est appréhendé comme tel par son récepteur. Cette tentative de tromperie est limpide, elle ne trompe pas parce que le mensonge ressemble à ce qu’il est, il est perçu comme une énonciation fausse et ne simule pas une énonciation vérace. Transparent internalise mensonge et choisit dans l’AE le prédicat INTENTION DE TROMPER PT NEG SIMULATION9.
Une seconde AE connecte l’intention de tromper (mentir) et la dissimulation (empêcher l’autre d’accéder à la vérité) : INTENTION DE TROMPER DC DISSIMULATION / INTENTION DE TROMPER PT NEG DISSIMULATION. Afin d’illustrer la façon dont ces prédicats peuvent apparaître dans des discours, observons l’énoncé : Jean cache quelque chose, mes tripes ne mentent pas. Dans cet énoncé, le locuteur exprime le sentiment que Jean lui dissimule quelque chose, mais est-ce parce qu’il ment ou est-ce parce qu’il ne dit pas toute la vérité ? Dans les deux cas, il y a dissimulation de quelque chose, les actes de ne pas dire toute la vérité ou de mentir partagent en effet un même bloc sémantique, celui qui relie intention de tromper et dissimulation. Dans le premier cas, la dissimulation est la conséquence d’une intention de tromper liée à l’aspect INTENTION DE TROMPER DC DISSIMULATION, elle est le signe d’un mensonge ; et dans le second cas, la dissimulation ne
9 Conformément aux critères qui permettent de reconnaître un internalisateur, il est possible de dire : il ment beaucoup, mais de manière transparente.
230
provient pas d’une tentative de tromperie, elle renvoie à un autre aspect du bloc, à savoir l’aspect NEG INTENTION DE TROMPER PT DISSIMULATION, ce qui est passé sous silence dans l’omission de la vérité traduirait autre chose qu’une volonté de tromper, ce n’est pas un mensonge par omission.
J’inscris également dans la signification de mensonge, l’argumentation externe INTENTION DE TROMPER DC VRAISEMBLANCE / INTENTION DE TROMPER PT NEG VRAISEMBLANCE, qui constitue le troisième couple d’aspects décrivant la mise en œuvre du mensonge. Ce sont ces aspects de la signification de mentir que Swift (Traité de Pseudologie, 1733) met en avant quand il parle de « l’art de mentir ».
En effet, l’art du mensonge, tel que se le représente Swift en ce qui concerne la politique, impliquerait, comme tout art, un savoir faire, une technique, un entraînement, permettant que l’œuvre, le mensonge, atteigne la perfection. Pour avoir le droit de mentir, il faut non seulement savoir mentir, mais le faire avec art, et ainsi démontrer qu’on a les compétences nécessaires pour débiter des mensonges. Il s’agit de dissimuler son mensonge avec raffinement, de forger des mensonges vraisemblables auxquels le peuple puisse croire, car :
Le mensonge politique est, dit-il, l’Art de convaincre le peuple, l’art de lui faire accroire des faussetés salutaires, et cela pour quelque bonne fin. (Ibid. : 44)
Il l’appelle un Art, afin de le distinguer de l’action de dire la vérité pour laquelle il semble qu’il n’est pas besoin d’art ; mais, supposé sa définition, cela ne se doit entendre que par rapport à l’invention, parce qu’en effet :
Il faut plus d’art pour convaincre le peuple d’une vérité salutaire, que pour lui faire accroire et recevoir une fausseté salutaire. (Ibid.)
Pour Swift, la règle d’or est la vraisemblance, il fait du prédicat INTENTION DE TROMPER DC VRAISEMBLANCE l’élément fondamental de l’art de bien mentir. En effet, Swift condamne ces grossiers menteurs, politiques ou journalistes, qu’il considère comme :
[…] les hommes les plus vils et les plus petits génies […] qui n’ont pour tout mérite qu’une forte inclination à la profession
231
qu’ils exercent, qui semblent d’ailleurs ignorer entièrement les règles de la Pseudologie, et qui n’ont ni les qualités, ni les talents nécessaires pour qu’on leur confie un emploi si important. (Ibid. : 61)
L’art du mensonge en politique exige que les hommes politiques soient les meilleurs en matière de mensonge, qu’ils soient « des artistes de l’illusion » ou « des princes du mirage politique ». Ils doivent être des menteurs imperturbables, c’est-à-dire mentir mieux qu’ils ne respirent, sans cela ils ne sont pas à leur place et doivent être évincés ; Swift invite donc à se méfier des hommes authentiques, sincères, incapables de mentir, car ils sont susceptibles de ruiner les actions entreprises. Il s’agit pour lui de rationaliser le mensonge politique, d’instaurer des règles pour que la « société de menteurs » soit efficace et équitable, de sorte que tous usent du mensonge admirablement. Être un bon menteur, c’est faire en sorte que le propos mensonger ne soit pas contradictoire ou falsifiable immédiatement, qu’il n’ait pas déjà été utilisé précédemment, qu’il soit mesuré et surtout, qu’il soit vraisemblable, il ne suffit pas de dire le faux, il faut aussi que celui-ci ait l’air vrai :
L’art du mensonge est un art savant du juste milieu, une technique subtile du dosage. Il faut savoir proportionner la tromperie à la vérité, aux circonstances, au but que l’on vise. (Ibid. : 15)
Le grossier mensonge est ainsi un mensonge invraisemblable, son propos est immédiatement perçu comme faux (il n’a pas l’air vrai, il n’est pas raffiné) ; grossier est un internalisateur de mensonge et invite à choisir l’aspect MENSONGE PT NEG VRAISEMBLANCE10. De sorte que dire qu’une histoire est trop invraisemblable pour être vraie, c’est dire qu’elle est fausse, voire qu’elle est mensongère.
10 On peut en effet dire : il ment beaucoup, mais grossièrement (critère des internalisateurs).
232
4.2.2 MENTIR POUR MENTIR, MENTIR SANS RAISON
Les expressions mentir pour mentir ou mentir sans raison incitent à décrire l’action de mentir comme motivée par autre chose que de simplement chercher à tromper, on mentirait parce que l’on aurait un intérêt à le faire, un motif justifiant la tromperie. Le mensonge vise à faire accroire, mais il aurait également une motivation autre que de simplement y parvenir, la réussite du mensonge (la tromperie) serait la condition pour obtenir autre chose. Si l’on peut trouver une infinité de raisons de mentir, on peut cependant les réduire à deux qualificatifs, bénéfiques ou nuisibles, à mettre en relation avec le bénéficiaire du mensonge ou avec celui qui en pâtit, que ce soit autrui ou soi-même (nous admettons les différentes combinaisons possibles de ces quatre variables). Le mensonge officieux est ainsi un mensonge qui sert les intérêts d’un tiers, et le pieux mensonge un mensonge ayant de nobles fins. L’AE NEG MOTIF PT MENTIR / MOTIF DC MENTIR, et l’AE plus générale NEG MOTIF PT INTENTION DE TROMPER / MOTIF DC INTENTION DE TROMPER, décriront l’acte de mentir comme une intention de tromper intéressée (quelle que soit la manière dont sont combinées les quatre variables), le choix du mot motif dans les aspects ci-dessus permettra de dépasser la difficulté qu’impose le mot intérêt, fonctionnant pour une motivation égoïste, mais peu utilisé pour un acte altruiste.
Nous n’avons pas inscrit la motivation du mensonge dans son argumentation interne, car nous aurions établi une équivalence entre avoir une raison de mentir et mentir. S’il est possible de rétorquer à quelqu’un qui accuserait un autre de mentir : Mais il n’a aucune raison de te mentir !, afin de prendre en charge le fait qu’il n’y a peut-être pas eu de mensonge, c’est à cause de l’aspect NEG MOTIF DC NEG INTENTION DE TROMPER et non à cause d’une équivalence entre mentir et mentir avec raison ; il est effectivement difficile de conclure qu’il n’y a pas de mensonge, parce qu’il n’y a pas de raison de mentir. Si la structure linguistique du syntagme mensonge sans raison donne le sentiment que mensonge est partiellement nié, c’est parce que sans raison est un
233
internalisateur transgressif par la gauche, c’est-à-dire qu’il sélectionne l’aspect transgressif d’une alternative composée d’un aspect et de son transposé11. Sans raison sélectionne le prédicat NEG MOTIF PT MENTIR, et l’expression avoir une raison de mentir le prédicat transposé MOTIF DC MENTIR.
5 LE PROBLÈME DE SAINT AUGUSTIN
Pour conclure, nous allons poser, avec saint Augustin, la question :
Lequel est le vrai menteur, de celui qui dit le faux pour ne pas tromper, ou de celui qui dit le vrai pour tromper, le premier sachant ou croyant qu’il dit une fausseté ; et le second sachant ou croyant qu’il dit une chose vraie ? (Du mensonge : Chap. IV)
et en tentant d’y répondre, nous verrons comment la signification argumentative du mot mensonge peut permettre de comprendre que ce qui préoccupe vraiment saint Augustin n’est pas tant un problème de nomination qu’une inquiétude quant aux conséquences que peut avoir la signification des mots sur les préceptes religieux.
Pour expliciter la question de saint Augustin, je considérerai à nouveau les relations du mensonge avec le fait de croire, en portant mon attention sur les conséquences de la tromperie, la perte de confiance, qui fait que le menteur pourrait ne plus être cru ultérieurement. Le mensonge est en effet intimement lié à la confiance que l’interlocuteur accorde au menteur : on croit à un menteur parce qu’on lui fait confiance, on ne le croit plus quand il trahit notre confiance, parfois on continue à lui faire confiance bien qu’il soit un menteur, etc. Cette confiance, accordée à l’autre et le créditant d’être vérace, résulte de la loi de la parole qui instaure un cadre pragmatique dans lequel les partenaires de l’échange entendent se dire la vérité, le trompé croit que le trompeur respecte les règles du jeu, et c’est en cela
11 Il est possible d’énoncer il ment beaucoup, mais sans raison, ce qui permet de reconnaître un internalisateur.
234
qu’il lui fait confiance et que sa confiance est trahie. Pour comprendre la question de saint Augustin, nous devons penser à des situations dans lesquelles les protagonistes entretiennent certaines relations de méfiance, qui permettent de ne pas tromper en énonçant une proposition fausse, ou encore de tromper en énonçant une proposition vraie, car l’interlocuteur, n’ayant confiance, dans aucun des deux cas, préférera inverser les propositions.
5.1 RELATIONS ARGUMENTATIVES ENTRE MENSONGE ET CONFIANCE
Prenons la situation dans laquelle Jean ment à Jacques qui le croit. Comme nous l’avons vu précédemment, la relation normative (*mensonge donc croire) ne fonctionne pas : l’aspect décrivant le fait de croire à un mensonge (à quelque chose qui est faux) est transgressif (FAUX PT CROIRE). C’est parce que Jacques suppose que Jean est vérace qu’il le croit (VRAI DC CROIRE) ; il ajoute foi à ce qui est dit, parce qu’il se trouve dans un cadre pragmatique dans lequel les participants entendent se dire la vérité, il pense que Jacques respecte la règle que ce cadre impose et selon laquelle ce qui est dit doit être vrai, il fait confiance à Jean et c’est pour cela qu’il le croit (CONFIANCE DC CROIRE).
Bloc sémantique reliant confiance et croire
NEG CONFIANCE PT CROIRE Tout en n’ayant pas confiance, Jacques croit Jean.
CONFIANCE PT NEG CROIRE Jacques a confiance en Jean,
pourtant il ne le croit pas.
CONFIANCE DC CROIRE Comme Jean a confiance en Jean, il le croit.
NEG CONFIANCE DC NEG CROIRE Jacques n’a pas confiance en Jean,
donc il ne le croit pas.
C’est parce qu’il y a ce rapport de confiance que Jean, s’attendant à être cru par Jacques, essaye de le tromper, et que Jacques, pensant pouvoir croire Jean, est trompé par celui-ci. Pour décrire cela, nous distinguons deux relations du mensonge à la confiance, chacune correspondant à un point de vue sur le
235
mensonge, celui du menteur et celui de la personne à qui l’on ment. Dans la perspective du menteur, on peut dire qu’il ment parce que son interlocuteur lui fait confiance (CONFIANCE DE L’AUTRE DC MENTIR) ou bien que son interlocuteur ne lui fasse pas confiance (NEG CONFIANCE DE L’AUTRE PT MENTIR). Ces deux prédicats expriment une relation à la confiance dans laquelle le mensonge est conséquent, et constituent donc des argumentations externes gauches de mensonge. Dans la perspective de celui à qui l’on ment, on peut dire qu’il ne fait pas confiance à son interlocuteur parce qu’il est un menteur (MENTEUR DC NEG CONFIANCE) ou qu’il fait confiance à son interlocuteur bien que celui-ci soit un menteur (MENTEUR PT CONFIANCE). Cette alternative construit un rapport entre mensonge et confiance dans lequel le segment mensonge est antécédent, ces deux aspects forment ainsi des argumentations externes droites de mensonge.
Il est bon pour un menteur de se prémunir contre les
conséquences de la tromperie et d’éviter ainsi de perdre la confiance de son interlocuteur. C’est une mise en garde contre de telles conséquences que propose la morale de l’histoire « Le berger qui criait au loup », elle nous porte à prendre la mesure du prédicat normatif de l’AE droite de mensonge MENTEUR DC NEG CONFIANCE. Un énoncé du type Si tu racontes des mensonges, personne ne saura quand il faut te croire peut donc être paraphrasé par : comme tu seras considéré comme un menteur, les autres n’auront pas confiance en toi et ils ne te croiront pas, énoncé qui accorde l’aspect MENTEUR DC NEG CONFIANCE et qui prend en charge l’aspect NEG CONFIANCE DC NEG CROIRE.
Saint Augustin redoute également la perte de confiance en la parole des représentants de Dieu, qui pourrait avoir lieu si ceux-ci s’autorisaient quelquefois le mensonge. Les prêcheurs ne doivent pas mentir pour procurer aux autres la vie éternelle et les mener à la vérité, car même un pieux mensonge ébranle la confiance accordée à la religion et incite au péché. Comme la croyance est argumentativement liée à la confiance (CONFIANCE DC CROIRE), faire accroire dissout la confiance (MENTEUR DC NEG CONFIANCE) et empêche de croire (NEG CONFIANCE DC
236
NEG CROIRE). D’autre part, si les hommes qui incarnent l’autorité religieuse et qui ont, en vertu de cette position, le devoir de montrer l’exemple, s’autorisaient le mensonge, alors naîtrait l’idée que l’on peut parfois mentir. Or le mensonge est un péché grave et doit donc être impérativement proscrit. Mais surtout, dans la mesure où cette religion repose sur la croyance en des choses indémontrables, la foi en sa vérité serait diminuée si la confiance en celui qui nous y invite était fragilisée. Même si le prêcheur devait avoir une bonne raison de mentir, comme de permettre un meilleur enseignement, il menacerait la croyance, car le mensonge mène à la suspicion : un pécheur qui aurait perdu confiance en la parole du prêcheur serait empli de doutes et d’incertitudes quand celui-ci lui commande de croire, ce qui l’empêcherait de croire et de comprendre, et il perdrait dès lors la voie de la conversion. De sorte qu’en se fondant sur le mensonge pour enseigner la foi, le prêcheur détruit la possibilité même de conversion, car :
Dès que la vérité est détruite, ou même légèrement atteinte, tout retombe dans l’incertitude : car on ne peut croire vrai ce qu’on ne tient pas pour certain. (Du mensonge : Chap. X)
Saint Augustin veut donc mettre en garde contre les conséquences de la tromperie : la perte de confiance en ce qui est dit, et intitule d’ailleurs le chapitre IV de Contre le mensonge : « Quand on ment sur un point, on ne peut plus être cru sur d’autres ». Il invite le prêcheur à préserver la voie de la confiance en ne s’autorisant jamais le mensonge, de façon à ce que le pécheur puisse considérer comme certaine la vérité que le prêcheur proclame et croire que les gens de bien ne mentent jamais. (Chez Kant également, c’est pour préserver la confiance en la parole de l’autre que le devoir de véracité est posé comme un impératif moral catégorique, mais cela, parce qu’en autorisant le mensonge, nous mettrions en péril le principe même du « contrat » sur lequel la société se fonde. En effet, la perte de confiance qu’impliquerait d’autoriser parfois le mensonge ferait que nous ne pourrions plus croire l’autre quand il nous donne sa parole, quand il s’engage verbalement sur quelque chose.)
237
5.2 LA SITUATION PROBLÉMATIQUE DE SAINT AUGUSTIN
Que dire de celui qui sait qu’une chose est fausse et la dit, cependant, parce qu’il sait qu’on ne le croira pas, et qu’il veut empêcher de croire au mensonge celui à qui il la dit et qu’il sait bien ne devoir pas y ajouter foi ? Si mentir est énoncer une chose autrement qu’on la connaît ou qu’on la croit, cet homme ment, dans le dessein de ne pas tromper ; mais si le mensonge suppose nécessairement l’intention de tromper ; il ne ment pas, puisque, quoique convaincu que ce qu’il dit est faux, il le dit cependant pour que celui à qui il parle et qu’il sait ou pense ne devoir pas le croire, précisément ne le croie pas et ne soit pas trompé. Mais si, d’un côté, il semble possible que quelqu’un dise une chose fausse exprès pour que celui à qui il la dit ne la croie pas, de l’autre nous rencontrerons le cas contraire, celui où quelqu’un dira la vérité pour tromper. En effet celui qui dit la vérité précisément parce qu’il pense qu’on ne le croira pas, la dit évidemment pour tromper : car il sait ou pense que ce qu’il dit pourra être réputé faux justement parce qu’il le dit. Ainsi donc, en disant le vrai dans l’intention de le faire passer pour faux, il dit la vérité pour tromper.
En effet si mentir est parler avec l’intention d’exprimer une chose fausse, le menteur sera plutôt celui qui a voulu dire une chose fausse, et qui l’a réellement dite, bien qu’il l’ait dite pour ne pas tromper. Si, au contraire, mentir c’est parler avec l’intention de tromper, ce n’est point celui-ci qui aura menti, mais bien celui qui voulait tromper même en disant la vérité. Enfin, si mentir, c’est parler avec la volonté d’énoncer une chose fausse, tous les deux ont menti, parce que l’un a réellement voulu énoncer une chose fausse, et que l’autre a eu l’intention de faire passer pour fausse la vérité qu’il exprimait. Que si mentir c’est énoncer une chose fausse sciemment et dans l'intention de tromper, ni l’un ni l’autre n’a menti, parce que l’un, en disant une chose fausse, a eu l’intention d’en faire croire une vraie, et que l’autre en a dit une vraie pour en faire croire une fausse. Ainsi pour éviter absolument toute témérité et tout mensonge, il faut énoncer, quand la circonstance l’exige, ce que nous savons être vrai ou digne de foi, et vouloir persuader de ce que nous énonçons. (Du mensonge : Chap. IV)
En cherchant à savoir qui de ces deux hommes est un menteur, celui qui dit le faux pour ne pas tromper ou celui qui dit le vrai pour tromper, saint Augustin voudrait en fait répondre à une autre question : « Pour mentir, faut-il avoir
238
l’intention de tromper et cette intention suffit-elle ? » (Du mensonge : Chap. II) Il s’oppose aussi bien à l’idée qu’il n’y a pas de mensonge quand on dit le faux pour ne pas tromper, qu’à l’idée qu’il peut y avoir intention de tromper sans qu’il y ait mensonge (c’est-à-dire quand la vérité est dite), et il voudrait conclure que toute énonciation fausse ou provenant d’une intention de tromper est un mensonge. Conformément à la description que nous avons proposée du mot mensonge, pouvons-nous donner raison à saint Augustin quand il entend l’employer pour décrire tout autant celui qui dit la fausseté pour ne pas tromper que celui qui dit la vérité pour tromper ? En somme, il s’agit de caractériser la singularité du menteur parmi les trompeurs.
En portant notre attention aux termes dans lesquels saint
Augustin construit la situation à partir de laquelle il s’interroge, nous pouvons voir que la formulation de son problème contient dans sa matière même, les mots, les éléments de la réponse. Aussi, approchons ces questions en les paraphrasant par des argumentations.
D’abord, que dire de celui qui a la propriété de SAVOIR CE QUI EST VRAI PT DIRE LE FAUX, mais qui ne veut pas tromper ? Saint Augustin élude volontairement l’emploi du mot mensonge associé à ce prédicat car il demande si justement nous pouvons nommer celui-là menteur. Dans une perspective argumentative, saint Augustin cherche à déterminer si le fait qu’un mensonge soit affaibli quand on lui ôte l’intention de tromper, agit sur la signification interne (ce n’est pas un mensonge) ou sur l’externe (c’est un mensonge moindre parce qu’il ne veut pas tromper). Selon moi, ce problème illustre parfaitement la confusion que nous avons exposée dans l’introduction, entre la signification et l’emploi des mots. La signification du mot mensonge renvoie à la fois à son argumentation interne SAVOIR CE QUI EST VRAI PT DIRE LE FAUX et, en tant qu’intention de tromper, à l’argumentation externe constituée par l’alternative MENSONGE DC TROMPER / MENSONGE PT NEG TROMPER. Le fait qu’il existe des situations dans lesquelles nous pouvons mobiliser le mot mensonge tout en ajoutant, au moyen d’un mais, que ce mensonge a été fait dans l’intention de ne pas tromper, ne doit
239
pas nous conduire à changer la signification du mot mensonge. Par ailleurs, il est important de noter l’enchaînement parce qu’il sait qu’on ne le croira pas, qui nous décrit – sémantiquement – la situation spécifique dans laquelle nous nous trouvons : l’interlocuteur ne se laissera pas tromper parce qu’il regarde le locuteur comme un menteur et ne lui fait pas confiance, il est donc décidé à ne pas le croire. Ce cas de figure mobilise deux argumentations : parce que c’est un menteur, il ne lui fait pas confiance (contenu accordé : MENTEUR DC NEG CONFIANCE), et donc il ne le croit pas (contenu pris en charge : NEG CONFIANCE DC NEG CROIRE). Ces deux argumentations doivent être considérées comme des sortes de postulats qui invitent l’interlocuteur à choisir l’argumentation externe de mensonge MENTIR PT NEG TROMPER. Nous pouvons donc paraphraser l’énoncé de ce problème par : Il a menti, mais n’avait pas l’intention de tromper, puisqu’il savait qu’on ne le croirait pas. Le locuteur accorde le prédicat dire le faux [SAVOIR CE QUI EST VRAI PT DIRE LE FAUX], refuse le prédicat tromperie [MENSONGE DC TROMPER] et prend en charge le prédicat non tromperie [MENSONGE PT NEG TROMPER]. En conséquence, même si quelqu’un ment dans l’intention de ne pas être cru, il est tout de même un menteur, toutefois, ce menteur n’est pas un trompeur, puisqu’il conduit l’autre, par son mensonge, à la vérité. C’est justement ce qui contrarie saint Augustin ; pour lui, il n’est jamais permis de mentir, il faut toujours dire la vérité et, même si le mensonge devait être plus propre à mener à la vérité que la véracité, il faut toujours préférer convaincre par la vérité que par le mensonge. Un mensonge, même moins grave d’un point de vue moral, compte tenu qu’il ne cherche pas à tromper, reste un mensonge.
Réciproquement, que dire de celui qui a la propriété SAVOIR CE QUI EST VRAI DC DIRE, mais qui veut tromper ? Dans ce cas de figure, saint Augustin voudrait ne pas avoir à employer le mot vérace car comment admettre que dire la vérité puisse être une tentative de tromperie ? Il demande donc si dire la vérité pour faire accroire, peut nous autoriser à employer le qualificatif menteur plutôt que vérace. L’intention de tromper, sous-jacente à cette énonciation vérace, suffit-elle à l’interpréter
240
comme une énonciation mensongère ? C’est ce que conclut saint Augustin :
[…] tout énoncé d’une chose provenant de l’intention de tromper, est évidemment un mensonge. (Du mensonge : Chap. IV)
Je souligne le mot évidemment qui permet de suspendre la démonstration au nom de l’évidence, qui incite l’interlocuteur à voir une conclusion contestable comme obligée, inévitable. Je suis conduite à m’opposer fermement à cette conclusion, qui résulte, selon moi, d’une assimilation du mot mensonge à une de ses AE tromperie en leurrant (LEURRE DC FAIRE ACCROIRE) d’une part, et d’autre part, d’un manque d’attention aux prédicats associés au fait de tromper : tromperie en leurrant, et tromperie sans leurrer (NEG LEURRE PT FAIRE ACCROIRE). L’énoncé de la situation dans laquelle quelqu’un dit la vérité pour tromper, parce qu’il sait qu’on ne le croira pas (du fait qu’on le croit menteur), peut être paraphrasé par : il a été vérace, mais il avait l’intention de tromper, puisqu’il savait qu’on ne le croirait pas. C’est un trompeur, il porte à croire faux, mais ce n’est pas un menteur, car même s’il dit le vrai pour le faire passer pour faux, il n’énonce pas le faux en tant que tel, c’est uniquement l’autre qui croit que son propos est faux alors qu’il ne l’est pas.
Pourquoi saint Augustin tient-il donc tant à désigner par le
mot mensonge une tromperie par la vérité alors qu’il a défini celui-ci comme une tromperie par la fausseté ? En quoi est-il obligé de conclure qu’une tromperie par la vérité est évidemment un mensonge ? Selon moi, la volonté de saint Augustin résulte davantage d’un problème religieux que d’un problème de langage.
Pour saint Augustin, il y a des actions qui, quand elles sont mises en rapport avec la fin qu’elles se proposent, sont bonnes ou mauvaises, et il y a des actions bonnes ou mauvaises en elles-mêmes. Ainsi, mentir pour ne pas tromper est une bonne action du point de vue de l’intention, mais une mauvaise action en elle-même. Le mensonge est en effet considéré par la religion comme un grave péché, car Dieu est Vérité, et le pécheur, s’il veut s’unir à Dieu, doit tourner son âme vers la
241
vérité, la possession du vrai étant une condition nécessaire à la béatitude. Le mensonge est le pire des péchés, car il est signe d’une fausseté de l’âme, d’une communion non pas avec Dieu mais avec le Diable. C’est pourquoi, même s’il est important de savoir avec quelle intention une chose est faite, nous ne pouvons nous délester d’un péché en prétextant une bonne cause ; si nous acceptions de ne pas condamner le mensonge quand il est commis avec une bonne intention, nous serions contraints d’admettre du même coup une proposition du type [il y a des péchés qui sont justes], ce qui serait, pour saint Augustin, absurde. D’un point de vue sémantique, cette proposition n’est cependant pas absurde, elle communique un enchaînement argumentatif du type : même si c’est un péché, c’est juste (MAUVAISE ACTION PT JUSTE). C’est un choix de saint Augustin que de refuser ce prédicat et de prendre en charge son converse : si c’est un péché alors ce n’est pas juste (MAUVAISE ACTION DC NEG JUSTE).
Or celui qui trompe en disant la vérité ne commet aucun péché, au contraire, il accomplit une bonne action, et c’est là le problème, car même si son intention est condamnable, l’acte en lui-même ne l’est pas. Ce qui nous conduit à choisir les prédicats NEG MAUVAISE ACTION PT NEG JUSTE (ce n’est pas un péché pourtant ce n’est pas juste) ou BONNE ACTION PT NEG JUSTE (c’est une bonne action pourtant ce n’est pas juste). Saint Augustin voudrait que cet acte soit lui aussi condamnable, qu’il soit un péché comme l’est celui de mentir ; aussi, pour décrire ce trompeur par la vérité, il préfère ne pas avoir à choisir ces prédicats et recourir plutôt au même aspect que pour mensonge : MAUVAISE ACTION DC NEG JUSTE (c’est un péché donc ce n’est pas juste). Mais comment peut-il se risquer à affirmer que dire la vérité est, dans certaines circonstances, un péché ? Pour ne pas avoir à affirmer cela, il corrige la langue et considère comme un mensonge toute tentative de tromperie au moyen du langage. On remarquera que c’est également vers cette correction sémantique que nous oriente Derrida en affirmant que toute tentative d’égarer l’autre par la langue, de lui faire accroire par un discours, est un mensonge. Quelles modifications de la signification de mensonge suivent l’acceptation d’une telle proposition ?
242
L’analyse lexicale argumentative du mot mensonge a tenu compte de l’intentionnalité du menteur (faire accroire, tromper), mais aussi de la manière dont est mise en œuvre cette intention (mentir, dire sciemment le faux alors que le vrai est connu). Ainsi, la visée du mensonge a été décrite au niveau de son argumentation externe, et la manière de la mettre en acte au niveau de son argumentation interne. Si nous devions décrire le mensonge en tenant compte uniquement de l’intention du menteur, comme le proposent saint Augustin et Derrida, nous serions conduits à modifier l’AI de mensonge en ne décrivant plus l’acte de mentir par l’enchaînement dire le faux tout en connaissant le vrai, mais par une forme très générale, savoir ce qui est vrai et pourtant dire quelque chose [qui porte à croire faux], l’AE continuant à exprimer la visée. En modifiant ainsi la description de l’acte de mentir, la mauvaise action du mensonge provient d’abord de l’intention, et le fait de dire le faux ou de dire le vrai devient secondaire. Du même coup, le mensonge n’étant plus défini comme une tentative de tromperie dont la spécificité serait de dire le faux, mais comme une tentative de tromperie par le langage, celui qui dit la vérité pour tromper est un menteur et non plus quelqu’un de vérace, et son acte est décrit par le fait de mentir et non plus par celui de dire la vérité. On peut donc dire de ce trompeur par la vérité qu’il commet un péché, puisqu’il « ment » (même si, pour ce faire, il use de la vérité). Ainsi, les actes de dire la vérité et de dire la fausseté continuent d’être associés parallèlement aux prédicats BONNE ACTION DC JUSTE pour le premier et NEG BONNE ACTION DC NEG JUSTE (ou MAUVAISE ACTION DC NEG JUSTE) pour le second.
Notons enfin que saint Augustin, en définissant le mensonge comme une tentative de tromperie par la langage (que cela soit en disant le faux ou en disant le vrai), cherche à condamner le trompeur par la vérité, et non à disculper celui qui dit faux pour faire croire le vrai. Dire le faux, même s’il s’agit d’un pieux mensonge, est un péché ; aussi, en questionnant les conséquences, bonnes ou mauvaises, des actes de dire un mensonge, de dire la vérité ou de se taire, insiste-t-il sur le fait que le mensonge est une mauvaise action d’abord parce qu’il est en relation avec la fausseté et non pas seulement parce que
243
le menteur peut avoir de mauvaises intentions. Même un pieux mensonge conserve cette relation à la fausseté et doit donc être condamné.
Posons alors la fameuse question : si un homme, injustement condamné à mort, se cachait et que nous connaissions sa cachette, faudrait-il le dénoncer à ceux qui le recherchent et nous questionnent ? Saint Augustin fait-il, à l’instar de Kant, de l’acte de dire la vérité un devoir – un impératif moral catégorique ? Contrairement à Kant, saint Augustin offre une alternative, celle de ne pas dire la vérité, au sens de la passer sous silence et non de la travestir par un mensonge, il mobilise alors le prédicat SAVOIR CE QUI EST VRAI PT NEG DIRE qui constituait l’hypothèse H3. Plutôt que dire la vérité et sacrifier son prochain, on peut sacrifier sa propre vie pour sauver celle du prochain en gardant le silence ; et si notre silence ou notre réponse évasive devait le trahir en faisant naître « un soupçon qui est bien près de la certitude » (Du mensonge : Chap. XIII), il nous faudrait alors répondre que nous le savons, mais ne le dirons pas. Pour saint Augustin, la seule échappatoire au mal est le silence et l’abnégation ; en condamnant le mensonge, il n’exige donc pas de toujours dire la vérité, mais de ne jamais dire la fausseté, dire la fausseté étant associé à l’aspect MAUVAISE ACTION DC NEG JUSTE.
CONCLUSION
L’analyse lexicale argumentative du vocabulaire du mensonge permet de comprendre que le problème posé par saint Augustin n’est pas tant un problème de langage qu’un problème religieux. Elle permet, de cette manière, d’aller au-delà des buts que les philosophes analytiques ont donnés à l’analyse linguistique, et qui consistent à mettre à jour les faux problèmes philosophiques et ainsi, à les résoudre. On voit ici que, si l’analyse linguistique d’un problème peut effectivement conduire à lui apporter des réponses, elle permet aussi de retrouver le questionnement qui l’a fait naître, en montrant comment celui qui a posé ce problème s’est débattu avec la langue, et quels éléments sémantiques sont véritablement en jeu
244
dans son questionnement. En effet, quand nous nous sommes confrontés à la question de saint Augustin, nous avons vu qu’en posant cette question, saint Augustin veut moins redéfinir le mot mensonge (corriger sa signification) qu’échapper au constat que l’étude de ce mot a fait naître : les expressions mentir ou dire la vérité autorisant chacune une relation à la tromperie et à la non tromperie, dire le faux peut être l’instrument du bien et dire la vérité celui du mal. Cet état de choses peut effectivement être difficile à accepter quand on défend l’idée que la vérité est la condition nécessaire à la béatitude, que seule l’âme vraie est du côté de Dieu.
Nous avons également vu que c’est davantage l’expression dire quelque chose de faux qui marque le mensonge comme négatif plutôt que le fait qu’il soit une tentative de tromperie. Pourquoi l’expression dire la vérité conserve-t-elle une valeur positive même si l’acte auquel elle se réfère est une tentative de tromperie ? Le mot faux est-il en lui-même négatif et le mot vrai en lui-même positif ? En admettant que les notions de vrai et de faux sont d’abord langagières, et qu’il est difficile de les définir absolument, puisqu’elles prennent leur sens d’après le terme avec lequel elles entretiennent une interdépendance sémantique, il serait intéressant d’élargir notre étude et de les étudier en observant la manière dont la langue les a lexicalisées, sous une autre perspective que le mot mensonge. Nous pourrions alors peut-être déterminer si les valeurs, positives ou négatives, que nous leur attribuons, sont dans la langue ou si, comme le suggère Nietzsche quand il dénonce la connexion normative entre la vérité et le fait de la dire, la langue est l’expression d’une certaine morale.
245
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DE L’OUVRAGE
Abélard, P. (1994). Des intellections, éd. et trad. de P. Morin, Vrin, Paris.
Aragon, L. (1980). Le mentir vrai, folio Gallimard, Paris.
Arendt, H. (1969). Du mensonge à la violence, Calmann-Lévy, Paris.
Aristote (1991). Métaphysique (T. 1 – Livres A-Z), Vrin, Paris.
Aron, P. (2004). « Parodie », dans P. Aron et autres (éds.), Le dictionnaire du littéraire, PUF, Paris.
saint Augustin (1866). « Contre le mensonge », Oeuvres complètes (XII), trad. de M. l’abbé Devoille, dans M. Raulx (éd.), Éd. L. Guérin, Bar-le-Duc, 218-240. En ligne : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/contremensonge/index.htm
saint Augustin (1866). « Du mensonge », Oeuvres Complètes (XII), trad. de M. l’abbé Devoille, dans M. Raulx (éd.), Éd. L. Guérin, Bar-le-Duc, 195-217. En ligne : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/dumensonge/index.htm
Austin, J. L. (1994). Écrits philosophiques (Philosophical Papers), Éd. du Seuil, Paris.
Austin, J. L. (1962). La Philosophie analytique. Cahiers de Royaumont. Philosophie, 4, Éd. de Minuit, Paris.
Bally, C. (1912). « Le style indirect libre en français moderne » (I et II), Germanische Romanische Monatschrift, fas.4.
Bally, C. (1965). Linguistique générale et linguistique française, Éd. Francke, Berne.
Balzac, H. de (1976). La Comédie humaine (II), éd. de P. G. Castex, Gallimard, Coll. « La Pléiade », Paris.
246
Barthes, R. (1954). « Littérature objective », Critique, vol. XV, no. 86-87, 581-591.
Barthes, R. (1962). « Le point sur Robbe-Grillet », Essais Critiques, Éd. du Seuil, Paris, 198-205.
Bennett, A. (2005). The Author, Routledge, Abingdon.
Benveniste, E. (1966). Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris.
Berkeley, G. (1991). Principes de la connaissance humaine, Gallimard, Paris.
Berrendonner, A. (1982). Éléments de pragmatique linguistique, Éd. de Minuit, Paris.
Blanchot, M. (1949). La part du feu, Gallimard, Paris.
Booth, W. (1961). Rhetoric of Fiction, Chicago University Press, Chicago.
Borges, J. L. (1997). Obras completas (I à IV), Emecé, Buenos Aires.
Borges, J. L. (1993). Œuvres Complètes (I), dans J.-P. Bernès (éd.), Gallimard, Coll. « La Pléiade », Paris.
Borges, J. L. (1999). Œuvres Complètes (II), dans J.-P. Bernès (éd.), Gallimard, Coll. « La Pléiade », Paris.
Brée, G. (1959). « Midnight Novelists », Yale French Studies, no. 24, 87-90.
Buridan, J. (1993). Sophismes, éd. et trad. de J. Viard, Vrin, Paris.
Cantarino, V. (1976). « Borges, filósofo de Dios : Argumentum Ornithologicum », XXXI, 2, 288-299.
Camus, A. (1998). L’étranger, folio Gallimard, Paris.
Carel M. (2001). « Argumentation interne et argumentation externe au lexique : Des propriétés différentes », Langages, 142, 11-21.
247
Carel, M. (2002). « Argumentation interne aux énoncés », Revue de Sémantique et de Pragmatique, 11, 101-119.
Carel, M. (2005). « La construction du sens des énoncés », Revue Romane, 40, 1, 79-97.
Carel, M. (2008). « Polyphonie et argumentation », dans M. Birkelund, H. Mosegaard, M.-B. et C. Norén (éds.), L’énonciation dans tous ses états, Peter Lang, Bern.
Carel, M. (2011). L’entrelacement argumentatif. Lexique, discours et blocs sémantiques, H. Champion, Paris.
Carel, M. (à paraître). « Polyphonie et évidentialité », dans C. Rossari (éd.), L’énonciation et les théories évidentielles.
Carel, M. et O. Ducrot (1999). « Le problème du paradoxe dans une sémantique argumentative », Langue française, 123, 06-26.
Carel, M. et O. Ducrot (2009). « Mise au point sur la polyphonie », Langue française, 164, 33-44.
Christie, A. (2007). Le meurtre de Roger Ackroyd, trad. de F. Jamoul, Livre de Poche, Paris.
Comencini, L. (1972). Les Aventures de Pinocchio.
Dante (2011). La Divine Comédie – L’Enfer, Le Purgatoire, Le Paradis, trad. de J. Risset, Flammarion, Paris.
Dendale, P. et L. Tasmowski (1994). « Présentation. L’évidentialité ou le marquage des sources du savoir », Langue française, 102, 3-7.
Derrida, J. (2005). « Du mensonge en politique », Sur parole. Instantanés philosophiques, Éd. de l’Aube, La Tour d’Aigues, 91-114.
Di Cesare, D. (1986). « Langage, oubli, vérité dans la philosophie de Nietzsche », Histoire. Epistémologie. Langage, VIII, 1, 91-106.
Diderot, D. (2006). Jacques le fataliste, Pocket, Paris.
Ducrot, O. (1984). Le dire et le dit, Éd. de Minuit, Paris.
248
Ducrot, O. (1994). « À quoi sert le concept de modalité ? », dans N. Dittmar et A. Reich (éds.), Modality in language – Modalité et acquision des langues, de Gruyter, Berlin, 111-129.
Ducrot, O. (1995). « Les modificateurs déréalisants », Journal of pragmatics, 24, 145-165.
Ducrot, O. (2001). « Critères argumentatifs et analyse lexicale », Langages, 142, 22-40.
Ducrot, O. (2002). « Les internalisateurs », dans H. L. Andersen et H. Nølke (éds.), Macrosyntaxe et macrosémantique. Actes du colloque international d’Aarhus (17-19 mai 2001), Peter Lang, Berne, 301-322.
Ducrot, O. (2010). « Ironie et négation », dans V. Atayam et U. Wienen (éds.), Ironie et un peu plus.
Ducrot, O. et M. Carel (2006). « Description argumentative et description polyphonique : le cas de la négation », dans L. Perrin (éd.), Le sens et ses voix. Dialogisme et polyphonie en langue et en discours, Recherches linguistiques, 28 Université Paul Verlaine, Metz, 169-181.
Ducrot O. et J.-M. Schaeffer (1999). Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Éd. du Seuil, Paris.
Duhamel, G. (1934). Vue de la terre promise, Mercure de France, Paris.
Eco, U. (1985). Lector in fabula, Grasset, Paris.
García de la Garza, E. (2007). « El Dios del silogismo », dans A. de Toro (éd.), Jorge Luis Borge : Ciencia y Filosofía, Olms, Hildesheim, 147-160.
Genette, G. (1969). Figures II, Éd. du Seuil, Paris.
Genette, G. (1972). Figures III, Éd. du Seuil, Paris.
Genette, G. (1979). Fiction et diction, Éd. du Seuil, Paris.
Genette, G. (1983). Nouveau discours du récit, Éd. du Seuil, Paris.
249
Genette, G. (2004). Métalepses, Éd. du Seuil, Paris.
Henriot, E. (1957). « La vie littéraire. La Jalousie d’Alain Robbe-Grillet ; Tropismes de Nathalie Sarraute. Le nouveau roman », Le Monde, 22 mai 1957.
Graham O. (1995). Ontological Arguments and Belief in God, Cambridge University Press.
Ishiguro, K. (2010). Les vestiges du jour, trad. de S. Mayoux, Gallimard, Paris. 2010, Sophie,
Kant, E. (1986). « Sur un prétendu droit de mentir par humanité », Oeuvres philosophiques. Les derniers écrits (III), Gallimard, Coll. « La Pléiade », Paris, 435-441.
Koyré, A. (1996). Réflexions sur le mensonge, Éd. Allia, Paris.
Lescano, A. (2009). « Pour une étude du ton », dans M. Birkelund, H. Nølke et R. Therkelsen (éds.), Langue française, 164, 45-60.
Machiavel (1983). Le prince, Le livre de poche, Paris.
Martínez-Bonati, F. (1980). « Representation and Fiction », Dispositio, V, 13-4, 19-33.
de Maupassant, G. (2006). Le Horla. Et autres contes d'angoisse, Flammarion, Paris.
de Montaigne, M. (2009). Essais, dans E. Naya, D. Reguig-Naya et A. Tarrête (éds), Coffret Montaigne - Essais I, II et III, Gallimard, Paris.
Musil, R. (1989). L’homme sans qualités (t. 1), trad. de P. Jaccottet, Éd. du Seuil, Paris.
Nef, F. (1980). « Maintenant 1 et maintenant 2 : sémantique et pragmatique de « maintenant » temporel et non temporel », dans J. David et R. Martin (éds.), La notion d’aspect, Université de Metz, Metz, 145-166.
Nietzsche, F. (1991). « Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral », Le livre du philosophe, trad. de A. Kremer-Marietti, GF Flammarion, Paris, 115-140.
250
Nølke, H. et M. Olsen (2002). « Le passé simple subjectif 2 », Polyphonie-linguistique et littéraire, 5, Université de Roskilde, Danemark, 101-118.
Nølke, H., K. Fløttum et C. Noren (2004). ScaPoLine. La Théorie Scandinave de la Polyphonie, Kimé, Paris.
Pier, J. et J.-M. Schaeffer (2005). Métalepses. Entorses au pacte de la représentation, Éd. de l’EHESS, Paris.
Platon (2000). Hippias mineur, trad. de M. Croiset, Les Belles lettres, Paris.
Poe, E. A. (1975). Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, Gallimard, Paris.
Poe, E. A. (2011). Double Assassinat dans la rue Morgue ; La Lettre volée, Larousse, Paris.
Rabatel, A. (1998). La Construction textuelle du point de vue, Delachaux et Niestlé, Lausanne, Paris.
Racine, J. (2008). Andromaque, Larousse, Paris.
Recanati, F. (2004). « Indexicality and context-shift », paper presented at the Workshop on indexicals, speech acts and logophors (20/11/2004), Harvard University.
Recanati, F. (2008). Philosophie du langage (et de l’esprit), Folio essais Gallimard, Paris.
Robbe-Grillet, A. (1957). La Jalousie, Éd. de Minuit, Paris.
Romero, O. E. (1977). « Dios en la obra de Jorge L. Borges : su teología y su teodice », Revista Iberoamericana, XLIII, no. 100-101, 465-501.
de Saussure, L. (2008). « Maintenant : présent cognitif et enrichissement pragmatique », dans M. Vuillaume (éd.), Ici et maintenant, Cahiers Chronos, 20, Rodopi, Amsterdam, 53-76.
Schaeffer, J.-M. (1999). Pourquoi la fiction ?, Éd. du Seuil, Paris.
251
Schaeffer, J.-M. (2005). « Vérités de la fiction. Quelles vérités pour quelles fictions ? », L’Homme. Revue française d’anthropologie, no. 175-176, 19-36.
Schulz, P. (2002). « Plaidoyer contre une interprétation des énoncés en termes de « métaphore » », dans M. Carel (éd.), Les facettes du dire. Hommage à Oswald Ducrot, Kimé, Paris, 325-339.
Searle, J. R. (1972). Les actes de langage. Essai de philosophie du langage, Hermann, Paris.
Searle, J. (1982). « Le statut logique du discours de la fiction », dans Sens et Expression, Éd. de Minuit, Paris.
Swift, J. (2007). Traité de pseudologie. L’art du mensonge politique, trad. de J. J. Courtine, J. Million, Grenoble.
Traugott, E. (1989). « On the Rise of Epistemic Meanings in English : An Example of Subjectification in Semantics », Language, 57, 33-65.
Voltaire (1999). Zadig ou La destinée, Gallimard, Paris.
Weinrich, H. (1973). Le temps, Éd. du Seuil, Paris.
Wilde, O. (2003). Le déclin du mensonge : une observation, Éd. Allia, Paris.
Wittgenstein, L. (1958). Le cahier bleu et le cahier brun, Gallimard, Paris.
253
TABLE DES MATIÈRES
MARION CAREL (EHESS, CRAL)
INTRODUCTION
……………………………………………………….... 7
1 LA THÉORIE ARGUMENTATIVE DE LA POLYPHONIE 8
2 LA THÉORIE DES BLOCS SÉMANTIQUES ………….. 26
3 PRÉSENTATION …………………………………… 56
ANOUCH BOURMAYAN (EHESS, Institut Jean Nicod)
DOUTE, CERTITUDE OU VÉRITÉ RESTREINTE ?
LES PARADOXES DE LA VALEUR SÉMANTIQUE DE SANS DOUTE
……………………………………………………….... 59
INTRODUCTION ……………………………………….. 59
1 ÉTUDE DES OCCURRENCES DU SYNTAGME SANS DOUTE DANS LE RÉQUISITIONNAIRE DE BALZAC ….
60
254
2 DESCRIPTION SÉMANTIQUE DU SYNTAGME SANS DOUTE ……………………………………………..
71
3 LA VALEUR POLYPHONIQUE DE SANS DOUTE ……... 79
CONCLUSION ………………………………………….. 82
MAGDALENA CÁMPORA (CONICET, UCA, Argentine)
MISE EN SCÈNE ET DÉSAVEU DU LOCUTEUR
DANS L’ARGUMENTUM ORNITHOLOGICUM DE BORGES
……………………………………………………….... 85
1 LE CHANGEMENT DE TON ………………………..... 87
2 LE JE DE L’EXPÉRIENCE ………………………....... 88
2.1 L’ÉCONOMIE NARRATIVE ……………………. 88
2.2 UNE EXPÉRIENCE CLOSE SUR ELLE-MÊME …... 91
2.3 LE JE INTERNE ……………………………….. 93
3 LE JE RAISONNEUR ………………………............... 96
3.1 LE JE EXTERNE ………………………………. 97
3.2 BERKELEY .…………………………………... 99
CONCLUSION ………………………………………….. 102
255
DARIO COMPAGNO (Université de Sienne, Italie)
DOUBLE ÉNONCIATION D’AUTEUR ET DE NARRATEUR.
ANALYSE POLYPHONIQUE DU DISCOURS DE FICTION
ET DE LA MÉTALEPSE.
……………………………………………………….... 105
INTRODUCTION ……………………………………….. 105
1 LE DISCOURS DE FICTION ………………………..... 106
1.1 « FAIRE SEMBLANT » …...……………………. 106
1.2 AUTEUR EFFECTIF ET AUTEUR APPARENT .…... 107
2 L’ORIGINE POLYPHONIQUE DU DISCOURS ………... 110
2.1 SUJET PARLANT ET LOCUTEUR ………………. 110
2.2 LOCUTEUR, ÉNONCIATEURS ET PERSONNES ÉNONCIATIVES ……………………………….
111
2.3 LOCUTEUR PREMIER ET LOCUTEUR SECOND … 112
2.4 LOCUTEUR L ET LOCUTEUR Λ ………………... 113
3 ANALYSE POLYPHONIQUE DU DISCOURS DE FICTION …………………………………………… 114
3.1 HYPOTHÈSE 1 : LA FICTION COMME LOCUTION 114
3.2 HYPOTHÈSE 2 : LA FICTION COMME MISE À DISTANCE POLYPHONIQUE …………………... 115
256
3.3 HYPOTHÈSE 3 : LA FICTION COMME DISCOURS RAPPORTÉ ……………………………………. 116
3.4 HYPOTHÈSE 4 : LA FICTION COMME ÉNONCIATION ………………………………... 117
3.5 HYPOTHÈSE 5 : LA FICTION COMME DOUBLE ÉNONCIATION ………………………………... 118
3.6 DOUBLE ÉNONCIATION ET RÉCIT FACTUEL ….. 121
4 DOUBLE ÉNONCIATION ET MÉTALEPSE …………... 123
4.1 MÉTALEPSE DE L’AUTEUR ET AUTRES CAS DE CROISEMENT ENTRE AUTEUR ET NARRATEUR 123
4.1.1 Métalepse et antimétalepse …………...... 124
4.1.2 Autofiction ………………………………... 125
4.1.3 Fausse chronique ………………………... 126
4.2 LE « PARADOXE » GENETTE-SEARLE ………... 128
4.2.1 La fiction continue de Genette …………. 129
4.2.2 La fiction intermittente de Searle ……… 131
4.2.3 L’irréductible indétermination de la métalepse …………………………………. 132
4.3 ANALYSE POLYPHONIQUE DES EXEMPLES PRÉSENTÉS …………………………………… 134
4.3.1 Zadig ………………………………………. 135
4.3.2 Jacques le fataliste ………………………. 137
257
ALFREDO LESCANO (Université de Toulouse ENFA, UMR EFTS – EHESS, CRAL)
DEUX (AUTRES) MAINTENANT.
AVEC UNE APPLICATION À L’ANALYSE DE LA JALOUSIE
DE ROBBE-GRILLET.
……………………………………………………….... 145
1 MAINTENANT ………………………………………. 145
1.1 MAINTENANT DE TRANSFORMATION …………. 146
1.1.1 Maintenant-temporel n’est pas déictique ………………………………….. 147
1.1.2 Le contraste comme inversion argumentative ……………………………. 148
1.1.3 Maintenant introduit une transformation …………………………… 149
4.3.3 La Divine Comédie ……………………. 139
4.3.4 Le Horla ………………………………… 141
4. 4 CONCLUSION …………………………………. 143
258
1.2 MAINTENANT-SCÉNIQUE …………………....... 154
1.2.1 Détour sur les temps de la narration et de l’énonciation ………………………….. 155
1.2.2 Retour à maintenant-scénique ……….... 159
1.2.3 Maintenant-scénique n’exprime pas une transformation …………………………… 165
1.2.4 Maintenant « non temporel », maintenant-scénique et maintenant de transformation ………………………… 168
1.2.5 Combien de maintenant ? .................... 171
2 LA JALOUSIE ……………………………………………. 172
2.1 LE ROMAN ET SA CRITIQUE …………………... 173
2.2 LE MAINTENANT DE TRANSFORMATION DANS LA JALOUSIE ………………………………………. 174
2.3 LE MAINTENANT-SCÉNIQUE DANS LA JALOUSIE 177
2.3.1 Scènes sonores ………………………….. 177
2.3.2 Maintenant-scénique dans des énoncés comportant une transformation 179
2.3.3 L’ombre du pilier ………………………. 180
2.4 LES LECTURES DE LA JALOUSIE ………………… 185
CONCLUSION ………………………………………….. 188
259
MARGOT SALSMANN
(EHESS, CRAL)
DU MOT MENSONGE
………………………………………………………… 189
1 LANGUE, LANGAGE ET MONDE : INTRODUCTION AU PROBLÈME ………………………………………… 190
2 PRÉSENTATION DE L’ARGUMENTATION INTERNE DE MENSONGE …………………………………………….... 200
2.1 LE CONTENU ET LE MODE DU PRÉDICAT ARGUMENTATIF MENSONGE ……………………. 203
2.2 LE JUGEMENT MENSONGE ET LES JUGEMENTS ARGUMENTATIVEMENT APPARENTÉS ………... 210
2.2.1 Mise en situation …………………........... 211
2.2.2 Effet de la négation ……………………… 212
2.2.3 Les blocs sémantiques de H1 et H2 …… 214
3 OBJECTIONS SUR LE CONTENU ET LE MODE DE L’ARGUMENTATION INTERNE DE MENSONGE ………. 216
3.1 LE LEURRE INTENTIONNEL DU MENSONGE : UN ÉLÉMENT DE L’AI OU DE L’AE ? ……………… 217
3.2 LE MENSONGE : UN LEURRE LANGAGIER ? ....... 219
4 PRÉSENTATION DES ARGUMENTATIONS EXTERNES DE MENSONGE ………………………………………….. 221
260
4.1 ARGUMENTATIONS EXTERNES LIÉES À LEURRE 223
4.1.1 Le bloc sémantique de tromper en mentant et de ne pas tromper en mentant 223
4.1.2 Les syntagmes bien mentir et mal mentir 226
4.2 ARGUMENTATIONS EXTERNES LIÉES À INTENTION DE TROMPER …………………………. 228
4.2.1 Les relations du mensonge à la simulation, la dissimulation et la vraisemblance ………………………… 228
4.2.2 Mentir pour mentir, mentir sans raison 232
5 LE PROBLÈME DE SAINT AUGUSTIN ………………. 233
5.1 RELATIONS ARGUMENTATIVES ENTRE MENSONGE ET CONFIANCE ……………………. 234
5.2 LA SITUATION PROBLÉMATIQUE DE SAINT AUGUSTIN ……………………………………. 237
CONCLUSION …………………………………………. 243
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DE L’OUVRAGE … 245
TABLE DES MATIÈRES ……………………………….. 253