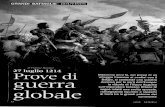Rhétorique et mythe de la Performance Globale L’analyse des discours de la Global Reporting...
-
Upload
univ-montpellier -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Rhétorique et mythe de la Performance Globale L’analyse des discours de la Global Reporting...
Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
Contents lists available at ScienceDirect
Critical Perspectives on Accounting
journal homepage: www.elsev ier .com/ locate /cpa
Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desdiscours de la Global Reporting Initiative
Jean-Noel Chauvey a,*, Gerald Naro a, Amelie Seignour b
a Universite Montpellier 1, Montpellier Recherche Management - Comptabilites et Societeb Universite Montpellier 2, Montpellier Recherche Management
A R T I C L E I N F O
Historique de l’article :
Recu le 29 juin 2013
Recu sous la forme revisee le 25 aout 2014
Accepte le 2 septembre 2014
Disponible sur Internet le xxx
Mots cles:
Global Reporting Initiative
Performance Globale (PG)
Triple Bottom Line (TBL)
Reporting Societal
Responsabilite societale de
l’entreprise (RSE)
R E S U M E
La Global Reporting Initiative (GRI) est une organisation internationale qui a reussi a
imposer ses lignes directrices dans les pratiques de reporting societal de la plupart des
grandes entreprises mondiales. Le modele de performance globale qu’elle vise a
promouvoir est vehicule dans un discours qui repose sur le postulat d’une convergence
entre les dimensions economiques, sociales et environnementales du developpement
durable. Ce faisant, le discours de la GRI occulte les contradictions et conflits liees aux
enjeux paradoxaux de ces dimensions et aux attentes differenciees des parties prenantes.
L’article repose sur l’hypothese selon laquelle les strategies discursives de la GRI
participent a l’instauration d’une vision mythifiee de la performance globale qui vise a
masquer la dimension eminemment politique et socialement construite de la
responsabilite sociale de l’entreprise (RSE). Les fondements de l’entreprise et, au-dela,
du systeme de regulation macro-economique et societal dans lequel elle s’insere, ne sont
nullement questionnes. Afin de mettre en lumiere les strategies de persuasion contenues
dans le discours de la GRI, visant a naturaliser le concept de RSE et a mythifier celui de
performance globale, l’etude est fondee sur une analyse linguistique et rhetorique des
textes du referentiel GRI. Celle-ci montre que, s’appuyant sur une pretendue rationalisa-
tion des enonces et sur le langage expert de la comptabilite, le discours de la GRI procede
d’une rhetorique de l’evidence–et non de l’argumentable–qui interdit tout debat
democratique.
� 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction
Une etude recente realisee par KPMG1 indique que 95% des 250 plus grandes entreprises mondiales realisent un reportingsocietal. 80% d’entre elles adopteraient les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) qui s’est ainsi imposeecomme la premiere reference mondiale en matiere de reporting societal. Sans conteste, elle a joue et continue a jouer un roletres influent dans le developpement a grande echelle d’une approche du reporting societal fondee sur la Triple Bottom Line
(Gray, 2006). En cela, elle est emblematique d’un courant dominant dans le domaine du reporting societal consistant a
* Auteurs correspondants.
E-mail address: [email protected] (J.-N. Chauvey).1 KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011 (http://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/corporate-
responsibility2011.pdf)
Please cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desdiscours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
1045-2354/� 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx2
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
promouvoir l’idee selon laquelle les entreprises doivent rendre compte autant des consequences sociales etenvironnementales de leurs activites, que de leurs resultats financiers. Elle institue ainsi un modele de reporting fondesur une representation « globale » de la performance, integrant performances economiques, sociales et environnementales.En promouvant ce reporting ‘‘global’’, la GRI promeut, sans l’afficher clairement et sans le justifier, un ideal de PerformanceGlobale, fonde sur l’hypothese d’une convergence vertueuse entre les enjeux economiques, sociaux et environnementaux et,au-dela, entre les interets des differentes parties prenantes2.
La GRI apparaıt ainsi comme une innovation manageriale qui s’est largement diffusee au point d’imposer une normeinternationale de reporting institutionnalisant une vision de la Responsabilite Societale des Entreprises (RSE). Les recherchessur l’entrepreneuriat ou le travail institutionnels (Di Maggio, 1988; Suddaby & Greenwood, 2005; Lawrence & Suddaby,2006), de meme que les travaux sur les modes manageriales (Abrahamson, 1996; Kieser, 1997), ont montre le role majeur dela rhetorique et des mythes dans les processus d’institutionnalisation des innovations et des idees dont elles sontporteuses (Abrahamson, 1993; Kieser, 1997). A l’instar de ces auteurs, nous considerons dans cet article que la PerformanceGlobale telle qu’elle est vehiculee par la GRI, releve des discours et mythes manageriaux contemporains en ce qu’elle proposeun nouveau recit de la performance et, au-dela, de l’entreprise. Barthes ecrivait en 1957 que le mythe est une parole depolitisee
qui evacue la qualite contingente, historique et socialement construite de ce qu’il tend a signifier, afin de le restituer sous laclarte d’une nature par essence indiscutable. Ainsi, alors que la notion de responsabilite sociale de l’entreprise repose surl’opposition de dimensions antithetiques - economiques, sociales, environnementales–, l’existence potentielle de conflits etde contradictions entre ces dimensions est occultee dans le mythe fondateur de la Performance Globale (Gray, 2010).
La these qui sous-tend cet article est qu’en tant que modele representatif d’une conception dominante du reporting societal,la GRI participe au processus d’institutionnalisation d’un nouveau paradigme de l’entreprise qui tend a denier toute dimensionpolitique aux concepts de developpement durable et de responsabilite sociale de l’entreprise. Les normes de reporting societal,et tout particulierement celles de la GRI, sont elaborees par un reseau d’experts et de representants du monde des affaires ausein duquel la profession comptable joue un role central (Malsch, 2013). Ce reseau promeut un discours expert qui emprunte aulangage comptable son apparence de neutralite et de rationalite. Fondees sur le mythe de la Performance Globale, ces normestendent a imposer une representation naturalisee de la performance et, au-dela, des finalites de l’entreprise.
Heritiers des travaux de Foucault dont l’objet est de deconstruire les normes sociales et les mecanismes de pouvoirs’exercant au travers de pratiques pretendument neutres, divers courants critiques de la recherche en comptabilite seproposent aujourd’hui d’analyser les discours comptables dominants en devoilant qu’ils ne doivent rien a la nature deschoses mais sont au contraire le fruit de luttes sociales dans un contexte historique3. Ils s’inscrivent dans l’approchelinguistique - « linguistic turn » - adoptee notamment par les courants post-structuralistes en sciences humaines et socialesqui, accordant une place centrale au langage, traitent les objets de recherche comme des textes en ayant recours auxmethodes de l’analyse litteraire, de la semiotique ou de la linguistique4. C’est dans cette perspective que s’inscrit ce travail derecherche. A partir d’une triple analyse linguistique des systemes enonciatif, referentiel et argumentatif, il questionne lesrepresentations de la Performance Globale ainsi que les modes de justification vehicules par la GRI.
Nous y discutons d’abord les fondements conceptuels du concept de PG en relevant qu’ils s’inscrivent dans un ideal desynthese fonde sur un deni des conflits et paradoxes de la responsabilite sociale de l’entreprise (2). Apres avoir presente lecorpus et la methodologie de l’analyse du discours (3), nous analysons ensuite les strategies discursives deployees dans lechapitre « « Sustainability Reporting Guidelines » qui introduit la troisieme version du rapport GRI sur son site Web5 en montrantque celui-ci vehicule un mythe moderne, pretendument rationnel: celui de la Performance Globale (4). Nous concluons sur uneinterrogation generale portant sur le role et les modalites du reporting RSE dans une societe democratique (5).
2. Les fondements conceptuels du reporting societal: vers le mythe de la performance globale
Les fondements conceptuels du reporting societal et les modeles de RSE sur lesquels repose son instrumentation,semblent orientes vers la poursuite d’un ideal de synthese, dont la notion de Performance Globale (PG) semble archetypale(2.1). Du fait des conflits et contradictions durables qu’elle met en jeu, la RSE presente cependant une naturefondamentalement paradoxale, niee par le modele de la PG (2.2). Les dimensions conflictuelles et politiques de la RSE sont eneffet occultees au travers de strategies discursives qui, par la promotion de la PG, participent a la construction d’un mythemanagerial contemporain (2.3).
2.1. De la Stakeholder Theory a la Performance Globale: a la poursuite d’un ideal de synthese
L’actuel developpement de modeles integres de reporting et de mesure des performances est patent, tant sur un planconceptuel que sur celui de l’instrumentation. Ces modeles puisent leurs fondements conceptuels dans les cadres theoriques
2 Nous considerons les termes de Triple Bottom Line (TBL) et de Performance Globale (PG), comme synonymes.3 Pour une revue de la litterature voir notamment Macintosh (2002).4 Ces recherches mobilisent alors plusieurs auteurs francais que l’on a coutume de classer parmi les penseurs de la « French theory » [Foucault (Miller et
O’Leary, 1987; Hopwood, 1987), Derrida (Macintosh, 2002), Baudrillard (Macintosh et al., 2000), etc.], Barthes (Macintosh, 2002; Malsch et Gendron, 2009),
etc.5 Nous justifions le choix de ce corpus dans la partie 3 de cet article.
Please cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desdiscours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx 3
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
d’une part de la Stakeholder Theory (SHT), d’autre part des theories de la Corporate Social Responsibility (CSR), qui donnentnaissance aux concepts de Corporate Social Performance (CSP), et, plus recemment, de Triple Bottom Line (TBL). Dans tous lescas, il s’agit de developper un concept synthetique, celui de Performance Globale, permettant d’integrer, dans un mememodele, des criteres de performance economiques, sociaux et environnementaux. Une caracteristique commune a cesmodeles est de postuler de facon implicite le caractere conciliable de ces dimensions et d’en occulter le caractere conflictuelet paradoxal. Il en est de meme des tentatives d’instrumentation auxquelles a donne lieu cette evolution des representationsde la performance. Face aux pressions institutionnelles et sociales, obeissant tantot aux contraintes de la legislation, tantot ades logiques de divulgation volontaire, des entreprises de plus en plus nombreuses s’engagent dans des pratiques dereporting societal. Cette evolution vers des modeles integres de performance fait echo a l’emergence, durant les annees1990 notamment, de modeles normatifs multidimensionnels de mesure des performances fondes precisement sur desrepresentations de la performance qui mettent en avant les concepts d’integration et d’equilibre (Ittner & Larcker, 1998).
2.1.1. De la Stakeholder theory (SHT) a la Corporate Social Performance
La SHT s’oppose a la ‘‘Stockholder Theory’’ en mettant en avant l’obligation pour les entreprises, d’agir dans l’interet del’ensemble des individus ou groupes d’individus pouvant affecter ou etre affectes par la realisation des objectifsorganisationnels (Freeman, 1984), et pas seulement dans l’interet des seuls actionnaires. C’est en particulier le cas dansl’approche ‘‘normative’’ de la SHT qui affirme que « chacune des parties prenantes possede le droit d’etre traitee comme une fin en
elle-meme, et non comme un moyen pour les fins d’autres parties prenantes » (Evan & Freeman, 1988).Cependant, si le principal apport de la SHT reside dans l’elargissement des finalites de la firme par la prise en compte des
attentes differenciees d’un ensemble etendu de parties prenantes, sa principale limite est d’ordre operationnel. Mettre enavant l’egalite des stakeholders et s’interdire d’etablir des priorites entre eux (Freeman, 1984) ne permet pas, en effet, degerer l’opposition des interets. A l’inverse, accepter une hierarchie des parties prenantes (Donaldson & Preston, 1995; Etzioni,1998), conduit a defendre des modes de gestion en contradiction avec les fondements memes de la SHT.
Face a cette contradiction, la SHT n’indique jamais comment les stakeholders peuvent etre representes ou commentdistribuer le pouvoir de facon a assurer la protection des interets de chacun (Ambler & Wilson, 1995). Elle ne revele donc pasla complexite induite par la coexistence de parties prenantes aux interets divergents, ni les conflits qui les opposent.
Deux approches de la SHT different par la nature de leur argumentation. La premiere, l’approche instrumentale, suggereune gestion ‘‘strategique’’ des stakeholders et s’inscrit dans la logique du « business case » (Carroll & Shabana, 2010) enconsiderant la satisfaction des stakeholders comme un moyen pour l’entreprise d’atteindre ses objectifs et de satisfaire sesactionnaires (Clarkson, 1995; Hill & Jones, 1992). La seconde, l’approche normative, affirme, a l’inverse, que « chacune des
parties prenantes possede le droit d’etre traitee comme une fin en elle-meme, et non comme un moyen pour les fins d’autres parties
prenantes » (Evan et Freeman (1988). Cette approche conduit a repenser la nature de l’entreprise qui apparaıt des lors commeun moyen de satisfaire les objectifs des differents stakeholders et de coordonner leurs interets (Evan et Freeman, 1988). Bienque pertinente, elle paraıt toutefois incomplete en raison de sa difficulte a hierarchiser les priorites entre les stakeholders et adeterminer des criteres de hierarchisation.
S’appuyant sur la SHT, le courant Business and Society pose la question de la definition, puis de la mesure de la Corporate
Social Performance (CSP) notamment a partir des notions de Corporate Social Responsibility (CSR1, mettant en avant lesobligations des entreprises envers la Societe) et de Corporate Social Responsiveness (CSR2, centree sur les strategies dereponse adoptees face aux pressions sociales). Le modele de Caroll (1979) fournit dans ce domaine une base conceptuelle,source de nombreux approfondissements, sinon de discussions, dans des recherches ulterieures (Wartick & Cochran, 1985;Wood, 1991; Clarkson, 1995; Mitnick, 1995; Wood & Jones, 1995). Cependant, de nombreux auteurs en relevent lesfaiblesses conceptuelles et empiriques (Clarkson, 1995; Wood, 1991; Wood & Jones, 1995), et notamment le fait qu’il nepropose pas de definition solide des concepts de CSP, CSR1 et CSR2.
Ainsi, a l’instar de la SHT, le courant Business and Society occulte les tensions et contradictions resultant de la divergencedes attentes des parties prenantes, ainsi que les difficultes du management de celles-ci. Au contraire, ces travaux semblentfondes, mais de facon implicite, sur l’hypothese d’une convergence possible entre les interets des parties prenantes enpresence. Ils ouvrent ainsi la voie a une conception equilibree, voire integree de la performance.
2.1.2. Triple Bottom Line (TBL) et Performance globale (PG): la quete de l’equilibre
Les reflexions sur les definitions de la CSP conduisent naturellement a la question de sa mesure d’une part, et a la facond’en rendre compte d’autre part (reporting).
Les tentatives d’instrumentation de la mesure et du reporting de la CSP aupres d’un ensemble elargi de parties prenantesreposent sur le concept de « Performance Globale » qui traduit l’ideal d’un equilibre harmonieux entre performanceseconomique, sociale et environnementale. Cette notion de Performance Globale reflete une conception europeenne de laresponsabilite sociale6. Elle peut etre consideree comme la declinaison du concept de developpement durable a l’echelle de
6 « A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a
voluntary basis ». Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. COM 2001. 366. A renewed EU strategy 2011-14 for
Corporate Social Responsibility.
Please cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desdiscours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx4
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
l’entreprise (Capron & Quairel-Lanoizelee, 2006). Ce concept rejoint celui de la TBL ou modele du « Triple P » ou « People,
Planet, Profit » (Elkington, 1997).Ces representations de la performance participent plus generalement de l’evolution des modeles normatifs de mesure des
performances apparus dans les annees 1990 et fondes sur une representation multidimensionnelle de la performance et ladefinition de mesures non financieres (Ittner & Larcker, 1998). Le Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996) est unexemple emblematique7 de ces innovations. Ces modeles de mesure et de representation de performance reposent sur un apriori normatif selon lequel les mesures traduisant les interets des diverses parties prenantes devraient s’equilibrer entreelles et etre integrees (Brignall & Modell, 2000). Les adjectifs « global », « equilibre » ou « integre » renvoient ainsi a l’idee d’unesynthese harmonieuse et consensuelle qui masque la nature paradoxale de la CSR. On peut considerer que, loin d’etre neutreset anodins, de tels adjectifs revelent la vision du monde que les concepteurs des modeles de reporting societaux tendent, plusou moins intentionnellement, a promouvoir.
Gray (2010, p 808) montre d’ailleurs que, meme dans les reporting inspires de la TBL reposant sur un equilibre entre lestrois dimensions de la performance, les conflits entre un reporting societal et la poursuite des interets economiques sontenglobes (shrouded) et souvent occultes (obfuscated).
2.2. Le deni des paradoxes de la RSE comme instrument de legitimite
2.2.1. La nature fondamentalement paradoxale de la RSE
Les ideaux de synthese et d’equilibre portes par les notions de PG et le modele de la TBL peuvent etre interpretes commedes formes de deni ou d’occultation du caractere paradoxal de la RSE. Ils correspondent en effet a certaines formes de reponsea des paradoxes manageriaux mises en evidence par la litterature lorsque ceux-ci ne sont pas fondamentalement acceptes etassumes.
La notion de paradoxe fait etymologiquement reference a une proposition contraire au sens commun (la doxa) et quisemble illogique car contenant des dimensions contradictoires qui apparaissent vraies simultanement. Dans un contextemanagerial, une situation paradoxale peut par exemple correspondre a une situation dans laquelle il est necessaire desatisfaire deux objectifs opposes, sans qu’il soit possible de choisir entre eux, tout au moins pas de facon durable (Smith &Lewis, 2011, Cameron & Quinn, 1988). La RSE apparaıt ainsi fondamentalement paradoxale et potentiellement conflictuellepour au moins trois raisons qui font reference aux trois conditions cumulatives de la definition des paradoxes proposee parPoole & Van de Ven, 1989:
- l
st
es entreprises ont a prendre en compte de facon simultanee des objectifs contradictoires, les attentes et interets des partiesprenantes etant souvent opposes;
- c
es differentes composantes sont inter-reliees, l’entreprise ne peut pas choisir de faire disparaıtre l’une ou l’autre desparties prenantes qui sont en general, a des titres divers, inherentes a sa propre existence;- c
ette situation de conflit est structurelle, a la difference d’autres types de contradictions qui peuvent se resoudre par unchoix.2.2.2. Synthese, decouplage et traitement des paradoxes de la RSE
La litterature manageriale qui etudie les paradoxes fait souvent reference a la typologie de Poole & Van de Ven, 1989 quiidentifie 4 strategies generiques de traitement des paradoxes. La premiere strategie consiste a accepter le paradoxe et aapprendre a vivre avec, sans chercher a le resoudre, et sans le nier. Cette position implique un relachement des attentes derationalite rassurante et simplificatrice et l’acceptation que les contradictions demeurent non resolues (Clegg, Cuhna etCuhna, 2002). Une des caracteristiques de cette strategie est qu’elle fait coexister les tensions en cherchant le moyen derepondre aux exigences divergentes de facon parallele et durable. La seconde strategie consiste a tenter de resoudre lacontradiction en considerant que chacun des deux termes de celle-ci concerne un niveau d’analyse different, par exemple,une approche micro versus macro, ou encore, global versus individuel. La troisieme strategie gere les contradictions entraitant chacun des termes a des moments ou sur des horizons differents. Enfin, la quatrieme strategie vise la synthese etconsiste a chercher une facon d’accommoder les forces opposees dans une sorte de ‘‘voie du milieu’’, un concept qui englobeles deux termes opposes. Telle que presentee par Poole & Van de Ven, 1989, la strategie de l’acceptation reconnaıt l’existencedu paradoxe et ne tente pas de le faire disparaıtre. A l’inverse, les trois autres strategies tentent de ‘‘resoudre’’ le paradoxe etapparaissent ainsi comme une forme de deni de sa nature profonde, dans la mesure ou elles tentent de faire disparaıtre sacaracteristique principale qui est l’imbrication durable des tensions contradictoires.
La notion de PG, de par l’ideal de synthese qu’elle vise a promouvoir, peut relever de la quatrieme strategie lorsqu’elle apour effet de masquer les conflits et contradictions. Il existe egalement un risque que les reporting etablis dans l’esprit de laTBL s’apparentent a la deuxieme ou a la troisieme strategie si les indicateurs de performance des trois domaines sontpresentes de facon dissociee sans etablir de lien entre eux et sans faire ressortir leurs oppositions. A la suite des travaux de
7 Dans un article qui oppose une virulente critique a la SHT, Jensen (2001) considere que le Balanced Scorecard represente « l’equivalent managerial de la
akeholder theory » (Jensen, 2001, p. 17).
Please cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desdiscours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx 5
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
Meyer and Rowan, 1977 puis de Di Maggio & Powel, 1983, les pratiques des entreprises en matiere de RSE ont souvent eteanalysees comme les instruments d’un ceremonial visant a garantir leur legitimite au sein de leur champ institutionnelplutot que comme des pratiques traduisant une volonte de divulgation d’informations vis a vis des parties prenantes (Patten,1991, Deegan, 2002, Cho & Patten, 2007). Les comportements ‘‘hypocrites’’ (Brunsson, 1989), ainsi que les pratiques dedecouplage des discours entre eux, ou des discours avec les actes, qui fondent cette strategie de legitimation, sont tout a faitsusceptibles d’exister en matiere de reporting RSE. Les critiques et prolongements de la theorie neo-institutionnelle(Abernethy & Chua, 1996; Oliver, 1991; Suchman, 1995; Weaver, Trevino, & Cochran, 1999), ont mis en evidence le fait queles entreprises ne se limitaient pas a reagir mecaniquement aux attentes de leur environnement institutionnels, maispouvaient deployer differentes strategies pour conquerir, maintenir, ou reparer leur legitimite (Suchman, 1995). On pourraitalors s’interroger sur le role d’un modele de reporting tel que celui de la GRI dans les strategies de communication et dedivulgation d’informations societales adoptees par les entreprises. L’ideal de synthese que vehicule le concept de PG, ou lapossibilite de dissociation qui existe avec la TBL, pourraient en effet leur offrir, fort opportunement, une opportunited’assurer leur legitimite, sans avoir a resoudre la complexite de la gestion des paradoxes de la RSE. Les strategies discursivesalors developpees participeraient a l’edification du mythe de la performance globale.
2.3. Le discours sur la performance globale ou la construction d’un mythe managerial
Les developpements recents de la theorie neo-institutionnelle sur l’entrepreneuriat ou le travail institutionnels (DiMaggio, 1988; Suddaby & Greenwood, 2005), de meme que les travaux sur les innovations manageriales (Abrahamson, 1993;Kieser, 1997), decrivent « the purposive actions of individuals and organizations aimed at creating, maintaining and disrupting
institutions » (Lawrence & Suddaby, 2006, p. 215). Le recours a la rhetorique et aux mythes dans les mecanismes par lesquelsles logiques institutionnelles prennent place, tandis que de nouvelles idees s’ancrent dans la societe comme « allant de soi »,sont alors mis en lumiere.
Les strategies discursives et l’edification des mythes sont egalement au cœur d’une recherche critique d’inspiration poststructuraliste qui s’emploie a deconstruire les discours dont la comptabilite est porteuse (Macintosh, 2002). Ce « courant
linguistique » (« linguistic turn »), mobilise notamment les travaux de Michel Foucault (1966, 1975, 1977), pour montrer qu’entant que pratique sociale et institutionnelle (Hopwood & Miller, 1994), la comptabilite, ses concepts, le langage et lesdiscours dont elle est porteuse, s’inscrivent dans un episteme, c’est-a-dire dans un ensemble reliant les discours, leursrelations et leurs controverses, a une epoque historique donnee (Foucault, 1975). Ancree dans l’episteme de son temps, la PGconstituerait l’un des mythes manageriaux contemporains.
Or, comme l’indique Barthes (1957): « Le mythe est une parole depolitisee (. . .) En passant de l’histoire a la nature lemythe fait une economie: il abolit la complexite des actes humains, leur donne la simplicite des essences, il supprime toutedialectique, toute remontee au-dela du visible immediat, il organise le monde sans contradictions parce que sansprofondeur, un monde etale dans l’evidence, il fonde une clarte heureuse: les choses ont l’air de signifier toutes seules »(Barthes, 1957, p. 230-231). Pour Barthes (1957), l’une des fonctions sociales du mythe consiste precisement a assurer lemaintien de l’ordre social: « Car la fin des mythes, c’est d’immobiliser le monde. Il faut que les mythes suggerent et mimentune economie universelle qui a fixe une fois pour toutes la hierarchie des possessions » (Barthes, 1957, p. 243). En cela,instaurant une « douce violence » a travers la « clarte heureuse d’un monde sans contradiction » (Barthes, 1957), le mythedevient un instrument de domination symbolique: « Il ne sortait pas de cette idee sombre, que la vraie violence, c’est celle ducela-va-de-soi: ce qui est evident est violent, meme si cette evidence est representee doucement. . . » (Barthes, 1957).
Finalement, en occultant ainsi la nature eminemment subjective et politique des questions relatives a la RSE, le mythe dela PG procederait d’un mecanisme de reification, d’un « processus par lequel le monde social, qui est ineluctablement subjectif, est
presente sous une forme objective. Ce voilement de la subjectivite contribue a desamorcer la dispute sociale et au-dela, a preserver
l’ordre social et la domination qui s’y exerce » (Bourguignon, 2005)8.En ramenant la complexite des problematiques de la valeur et de la performance a des concepts englobant et synthetiques
tels que celui de la PG ou en eludant tout questionnement sur le caractere polysemique et politique de ces concepts, commede ceux relatifs a la RSE, les modeles de reporting societal font de ces derniers de puissants mythes. Le mythe de la PGcommunique a travers le reporting societal apparaıt alors tout a la fois comme le reflet et le medium d’une nouvelle doxamanageriale9.
Il apparaıt des lors interessant d’etudier dans quelle mesure la GRI, a travers ses strategies discursives et les rhetoriquesmobilisees, contribue a l’edification du mythe de la Performance globale et a la depolitisation de la RSE fondee sur le deni deson caractere paradoxal et conflictuel.
8 S’appuyant sur les travaux de Lukacs (1959), Bourguignon (2005) en extrait quatre caracteristiques principales de la reification: « elle contient un
glissement de la subjectivite vers l’objectivite; qui a pour consequence de masquer la nature fondamentalement subjective du monde, et au-dela, ses conflits
potentiels; ce qui previent la dispute sociale; afin, finalement, de preserver l’ordre social » (Bourguignon, 2005).9 Le sociologue francais Pierre Bourdieu definit la doxa comme « une foi pratique » (Bourdieu, 1980, p. 113), un « rapport de croyance immediate (. . .) qui nous
porte a accepter le monde comme allant de soi » (Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 52).
Please cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desdiscours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx6
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
3. L’analyse du discours de la GRI: corpus et methodologie
Apres avoir presente le corpus sur lequel s’appuie notre etude des textes de la GRI (3.1), nous exposons le cadreconceptuel et la methodologie d’analyse de discours mobilises (3.2).
3.1. Les textes de la GRI: au cœur d’un modele de regulation de type « soft law »
3.1.1. Organisation et acteurs: culture anglo-saxonne et auto-legitimation
Creee en 1997 par la CERES10 (Coalition for Environmentally Responsible Economies) en partenariat avec le Programmedes Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), la GRI est une organisation internationale, a but non lucratif, dont lamission est de promouvoir le developpement durable et de developper, avec le concours d’entreprises, d’ONG, de syndicatsou d’organisations internationales, un referentiel en matiere de reporting RSE. Celui-ci propose aux organisations quellesqu’elles soient, une serie d’indicateurs ainsi qu’une demarche leur permettant de rendre compte de leurs performanceseconomiques, environnementales et sociales et, plus precisement, de preparer leurs rapports RSE a partir d’un formatstandard.
GRI comprend trois organes de gouvernance. Le Conseil d’administration, actuellement compose de 15 membres, a laresponsabilite fiduciaire, financiere et legale. Il constitue par ailleurs l’autorite decisionnelle finale en matiere de lignesdirectrices, d’indicateurs et de plans d’action figurant dans le referentiel GRI. Le Comite d’experts technique, constitue de12 experts, a pour missions d’emettre des preconisations visant a garantir la qualite et la coherence du systeme de reportinget de pratiquer une veille sur l’evolution des normes internationales en matiere de RSE. Quant au Conseil des partiesprenantes, ses 48 membres conseillent le Conseil d’administration sur les sujets politiques et strategiques et contribuent al’elaboration du modele de reporting.
Outre ces instances de gouvernance, La GRI comporte deux autres categories d’acteurs. La premiere est constituee par lereseau des « parties prenantes organisationnelles » Ce sont les quelque 600 organisations provenant de plus de 60 pays quiont recours au referentiel propose par la GRI pour concevoir leur propre systeme de reporting RSE. Leur contribution a la GRIest double: collaborer a la definition des strategies et indicateurs; participer a son financement a partir de cotisationsannuelles dont le montant est calcule au prorata de leur chiffre d’affaires.
La seconde categorie d’acteurs est composee de sponsors - qu’il s’agisse d’organisations internationales, degouvernements et de fondations publiques telles que la Commission europeenne, le gouvernement australien, le ministerenorvegien des affaires etrangeres, l’Agence de protection de l’environnement americaine, . . . ou de fondations etd’entreprises privees: les fondations Bill et Melinda Gates, Ford, Rockfeller Brothers, GM, Shell, BP, RBC financial group, Alcan,HP, Microsoft, Deloitte, Ernst & Young, KPMG. . . - qui proposent une aide financiere ou logistique.
Le systeme GRI appelle une double remarque:- Comme l’ecrivent Capron & Quairel-Lanoizelee, 2003, bien que se voulant universel, il est fortement marque par une
empreinte anglo-saxonne. En temoignent le nombre de financeurs americains ainsi que la predominance des membresd’origine anglo-saxonne dans ses conseils et comites. Il s’inscrit ainsi dans une approche de la regulation de type « soft law »,fondee sur des initiatives volontaires qui evacuent les dimensions de pouvoir et de conflits.
- Son mode de fonctionnement, fonde sur la participation des acteurs, c’est-a-dire principalement de dirigeantsd’entreprises, fait que ces derniers, tout a la fois « legislateurs, policiers et juges, au mepris de la plus elementaire separation des
pouvoirs » (Delmas-Marty, 1998) se dotent eux-memes, a partir d’un processus d’auto-legitimation, des indicateurs surlesquels ils sont evalues. Ils s’affranchissent ainsi de reglementations plus strictes et des processus democratiques, integrantnotamment les contre-pouvoirs que pourraient imposer les pouvoirs publics.
3.1.2. Le referentiel GRI, un modele consensuel
Depuis sa creation, la GRI a developpe quatre versions successives de ses lignes directrices, la derniere en date etant,depuis le 22 mai 2013, la version GRI G411.
Cette derniere version propose un referentiel d’indicateurs visant a aider les organisations, qu’elles soient privees,publiques ou non-gouvernementales, a evaluer et a rendre compte de leurs performances economiques, environnementaleset sociales. Elle comporte 79 indicateurs, dont 49 indicateurs de base et 30 indicateurs dits supplementaires repartis en7 domaines: economie; environnement; droits de l’Homme; relations sociales et travail decent; responsabilite vis-a-vis desproduits et societe. L’etude des strategies discursives du modele de reporting GRI et de la notion centrale de « performance » aete menee sur la troisieme version du rapport GRI - appelee GRI G3 - parue en 2006. En 2013, paraıt une quatrieme version,toutefois celle-ci ne comporte plus le chapitre « Sustainability Reporting Guidelines », qui introduisait le referentiel G3 enpresentant le systeme de valeurs et de representations. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’etudier non pas laderniere mais l’avant-derniere version du rapport GRI. Notons toutefois que le fait que la version 4 ne comprenne plusd’introduction presentant « l’esprit » GRI ne saurait etre neutre. Cela pourrait par exemple signifier que les redacteurs des
10 Le CERES est une organisation basee a Boston regroupant des ONG environnementalistes, des investisseurs institutionnels, des gestionnaires de fonds
ethiques, des organisations syndicales et religieuses.11 Pendant une periode transitoire de deux ans, les entreprises pourront encore utiliser la version G3, creee en 2006.
Please cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desdiscours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx 7
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
nouveaux textes considerent que ces principes sont desormais acquis par le lecteur et qu’il n’y a plus lieu de lesproblematiser et de les legitimer. Ils seraient ainsi desormais mis en « boıte noire » (Callon et Latour, 2006). Une autreexplication serait au contraire a rechercher dans l’apparition de profonds desaccords, entre ses differentes parties prenantes,sur « l’esprit » de la GRI. La suppression de ce chapitre, permettrait alors d’eluder tout objet de polemique. Mais il ne s’agit laque d’hypotheses qui meriteraient d’etre soumises a une etude plus approfondie.
Le reporting RSE mis en œuvre par les entreprises utilisatrices du modele GRI doit ainsi fournir trois ensemblesd’informations sur la « strategie et le profil de l’entreprise », son « approche manageriale » et ses « indicateurs deperformances ». Ceux-ci, presents dans le guidelines de la GRI, sont alors classes en plusieurs groupes: indicateurseconomiques, environnementaux, sociaux (« Labor practices and decent work Performance Indicators »; « Human rightPerformance Indicators »; « Society Performance Indicators »), auxquels la GRI rajoute des indicateurs portant sur laresponsabilite du produit, en particulier vis-a-vis des consommateurs (« customer health and safety »; « customer privacy »).
Ainsi, la notion de « sustainability » telle qu’elle apparaıt dans le referentiel de la GRI s’inscrit explicitement dans lalogique de la TBL ou de la PG presentees dans la partie 2 de cet article: une dimension economique (la profitabilite a longterme); une dimension sociale (la justice sociale) et une dimension environnementale (la protection de l’environnement).
Notons par ailleurs que le referentiel GRI est fonde sur le principe d’une recherche de consensus entre les differentsstakeholders, dans la droite ligne des approches conceptuelles decrites plus haut, telles la Stakeholder Theory et la TBL:
12 Cito13 « L’h
a tradu14 Bou15 Ma16 « A
tactique
Pleadisc
‘‘GRI believes that multi-stakeholder engagement is the best way to produce universally applicable reporting guidance that
meets the needs of report makers and users. All elements of the Reporting Framework are created and improved using a
consensus-seeking approach, and considering the widest possible range of stakeholder interests. Stakeholder input to the
Framework comes from business, civil society, labor, accounting, investors, academics, governments and sustainability
reporting practitioners’’ (Website of GRI).
D’apres cette premiere presentation, le modele de reporting de la GRI, semble proposer une vision synthetique - globaleou integree - de la performance et presupposer un consensus « naturel » entre les attentes des differentes parties prenantes.
Il apparaıt ainsi necessaire d’approfondir ces premieres observations par une analyse discursive du referentiel GRI dontl’enjeu est d’en deconstruire les representations, presupposes et modes de justification.
3.2. Cadre conceptuel et methodologie de l’analyse de discours
L’objectif central du referentiel GRI etant de proposer une methodologie de type universaliste visant a unestandardisation des rapports RSE, il nous semble important de deconstruire les presupposes et representations dureporting societal et in fine, de la RSE et de la notion de performance globale que celui-ci vehicule partout dans le monde. Al’instar de Capron & Quairel-Lanoizelee, 2006, nous apprehendons ce modele de reporting comme un outil decommunication - et plus precisement comme un texte argumentatif - permettant d’acculturer ses destinataires a sonideologie dominante. C’est pourquoi nous en etudions egalement les modes d’argumentation permettant d’en apprehenderle systeme de legitimation.
Nos analyses s’inscrivent dans une approche du langage et des discours et se situent dans un cadre de reference qu’ilconvient dans un premier temps de presenter et d’expliciter.
La plupart des specialistes du langage12 considerent d’une part que le langage ne reflete pas la « realite » mais cree unerealite, decrite comme « un chantier en permanente construction » (Ghiglione, 1998)13 ou « realite de second ordre » (Sfez, 1992),d’autre part que le fait meme de parler a un destinataire vise a modifier ses representations et comportements. SelonBourdieu, « L’on peut agir sur le monde social en agissant sur la connaissance qu’ont les agents de ce monde. Cette action vise aproduire et a imposer des representations du monde social qui soient capables d’agir sur ce monde en agissant sur larepresentation que s’en font les agents14». Ainsi, un discours ne decrit pas une realite qui lui preexisterait mais construit larepresentation de la realite que l’enonciateur souhaite faire partager par son allocutaire. De ce fait, la plupart des discours,notamment politiques, publicitaires et manageriaux, sont consideres comme des enonces argumentatifs, a visee normative.
Ces enonces argumentatifs regroupent trois principaux types de textes (Boissinot, 1992). Les textes a tendancedemonstrative, pretendument logiques, comportent de nombreux connecteurs15 et procedes de raisonnement telsl’induction, la deduction, l’analogie. Tout en proposant une these, les textes a tendance expositive masquent instancesd’enonciation et procedes de raisonnement sous un contenu « purement » informationnel. Enfin, les textes a tendancedialogique fonctionnent comme un lieu de confrontation de theses et sont construits, de maniere plus ou moins patente, sousla forme d’un dialogue16. Les referentiels de reporting societal en general et celui de la GRI en particulier font avant toutpartie des enonces argumentatifs expositifs. Leur strategie discursive repose principalement sur une naturalisation de leurs
ns par exemple Adam, Bourdieu, Ducrot, Kerbrat-Orecchioni, respectivement, 2005, 1982, 1980, 1986
omme communicant n’est pas le miroir reflechissant d’une realite, mais le constructeur incessant de ses realites (. . .) La realite sociale n’est pas une donnee
ire en langue, mais un chantier en permanente construction. » Ghiglione, 1998, p.24
rdieu, 1982, p.195
is, car, parce que, afin que,...
rgumenter, c’est, par fonction, repondre a un (des) discours d’autrui. Meme si la parole de l’autre ne semble pas se faire entendre parce qu’elle est
ment reduite au silence, elle existe virtuellement. » (Boissinot, 1992).
se cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx8
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
theses et une reification de leurs indicateurs dans le but de faire adherer leurs destinataires a une representationpretendument neutre et a-conflictuelle de la RSE.
Les analyses de discours que nous developpons s’inscrivent dans le double champ de la linguistique de l’enonciation et del’analyse du systeme d’argumentation.
La linguistique de l’enonciation se caracterise par le rejet des postulats sur lesquels reposait la linguistique jusque dans lesannees 1980, c’est a dire par le double refus, d’une part de limiter l’etude de la langue a une etude du code envisage « en soi »,en dehors de toute mise en œuvre, et d’autre part de privilegier la fonction referentielle du langage, percu comme un simplemoyen d’informer ou de dire le reel (Ducrot, 1980; Kerbrat-Orecchioni, 1986). Il s’agit ainsi pour ces linguistes de tenircompte de l’ensemble du phenomene communicationnel, a savoir la prise en charge de l’enonce par l’enonciateur. Il s’agitaussi, en se demarquant d’une conception structuraliste de la langue percue comme un systeme clos et resumee dans lecelebre aphorisme de Greimas17, de prendre en consideration le contexte dans lequel s’inscrit le discours.
Quant a l’analyse du systeme argumentatif, son enjeu est d’identifier les theses en presence dans un enonce ainsi que lesmodes d’argumentation employes par l’enonciateur. Ce champ d’investigation trouve ses fondements dans la rhetoriqueantique. Aristote distinguait trois voies argumentatives dans « l’invention » c’est-a-dire dans la phase de recherche desarguments (Robrieux, 1993): l’ethos qui designe les qualites dont est dote l’orateur; Le pathos qui denote, l’ensemble desemotions que le locuteur cherche a provoquer chez ses interlocuteurs; Le logos qui represente l’argumentation logique,s’adressant a la raison et ayant pour finalite de prouver.
A partir des elements precites, voici, quatre propositions issues de nos choix epistemologiques
- L
1
e discours a un objectif performatif: c’est un acte volontariste d’influence. Enoncer c’est vouloir agir sur autrui.
- L e contexte est determinant pour comprendre un enonce: les actes de langage doivent etre resitues dans leurs contextesenonciatifs.
- U n enonce ne decrit un reel qui lui preexiste; il construit une representation du reel. - E nfin, dernier point, determinant pour quiconque souhaite analyser un discours: un discours contient des marqueurs, des« traces » de sa visee persuasive que le chercheur peut identifier (Ducrot, 1980).
Ces assertions se traduisent au plan methodologique par une triple analyse que nous mobilisons au cours de notre etudedes strategies discursives mises en œuvre par la GRI:
1. L
7
Pd
’analyse du systeme d’enonciation, c’est-a-dire de la facon dont l’emetteur et le recepteur s’inscrivent dans l’enonce. Nousprivilegions l’etude des pronoms personnels sujets, tout en etant conscients qu’un simple comptage des occurrences deces marqueurs linguistiques ne peut permettre de qualifier un enonce d’ « objectif » ou de « subjectif »: le discours le plussubjectif peut se parer d’une apparence d’objectivite, l’enonce etant alors presente comme une demonstrationuniversellement pertinente et non comme un argumentaire assume par un sujet.
2. L
’analyse du referentiel du discours. Si produire un discours, c’est faire partager une representation, l’etude des champssemantiques, soit de l’ensemble des mots utilises pour caracteriser une notion, une activite, une personne, permetd’analyser les representations de l’emetteur et/ou les representations qu’il souhaite « imposer » au destinataire. Analyserle champ semantique d’une notion, c’est relever dans un enonce tous les termes s’y rattachant.3. L
’analyse du circuit argumentatif repose sur l’etude de la nature des arguments (ethos, pathos ou logos) et de leurstructure. L’analyse de cette structure permet de mettre en evidence la logique persuasive du discours. Les textesargumentatifs sont generalement construits sur le principe d’une confrontation entre une - ou des - these(s) proposee(s)par l’auteur et une - ou des - these(s) refusee(s). Ce schema peut etre explicite - le discours se presente clairement dans sadimension dialogique - ou bien implicite, l’argumentation prenant alors les apparences d’une presentation neutre oud’une demonstration logique.4. Les strategies discursives de la GRI ou l’edification du mythe de la Performance Globale
Alors que la deuxieme partie de cet article a montre que le concept et les pratiques de RSE s’inscrivaient au cœur deparadoxes et de contradictions, il semblerait que les systemes de reporting societal dont celui, emblematique, de la GRI, enoccultent le caractere fondamentalement ambivalent. A partir d’une analyse communicationnelle et discursive du referentielGRI (version 3) et plus particulierement de l’analyse de la fonction referentielle du discours, c’est-a-dire des representationsque celui-ci vehicule, cette quatrieme a pour objectif de repondre aux questions suivantes: le referentiel GRI integre-t-il dansses discours des dimensions antithetiques, ou est-il dans le deni voire dans la denegation de cette antinomie? Tente-t-il, touten les reconnaissant, de depasser de maniere dialectique les oppositions qui fondent la RSE, ou les masque-t-il sous lastrategie discursive de la synthese ou sous une « logique de l’evidence » (Breton & Proulx, 1993) visant a naturaliser lesconcepts enonces et a mythifier celui de Performance globale?
Par ailleurs, afin de deconstruire de facon plus approfondie les modes de justification sur lesquels est fonde ce rapport, lessystemes d’enonciation - c’est-a-dire la facon dont le locuteur s’implique (ou non) dans sa production et y implique (ou non)
« Hors du texte, point de salut. Rien que le texte et rien hors du texte » Greimas, A.J. (1974).
lease cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desiscours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx 9
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
ses destinataires - et d’argumentation de ce document seront egalement analyses (Garric & Leglise, 2006). Par quellesstrategies communicationnelles et discursives ce referentiel RSE legitime-t-il sa posture? Se presente-t-il comme un enonce« objectif » et purement informationnel, l’enonciateur ayant gomme toute marque d’adhesion ou de distance par rapport al’enonce ou, a contrario, comme un enonce « subjectif », le locuteur se presentant alors comme source et garant de l’assertion?Ce sont les reponses a ces questions que l’analyse des strategies discursives et des modes de legitimation mis en œuvre dansce referentiel vise a apporter.
Le referentiel GRI G3 comprend sept chapitres. Six proposent des indicateurs economiques, environnementaux, sociauxet societaux, le premier, intitule « Sustainability Reporting Guidelines », presente le systeme de valeurs et de representationssur lequel la GRI a fonde sa demarche de reporting societal. S’y developpe une rhetorique subtile visant a faire adherer lelecteur au discours propose, principalement presente comme neutre et objectif. C’est la raison pour laquelle nous avonschoisi d’analyser plus particulierement ce chapitre, en nous centrant tout d’abord sur la presentation generale du documentpuis sur la preface, l’introduction ainsi que sur le paragraphe « Stakeholder Inclusiveness »18. C’est sur ce meme corpus quenous effectuons l’etude semantique du terme « performance », au cœur de notre question de recherche. Au cours de cetteanalyse, nous nous referons aux divers indicateurs enonciatifs, referentiels et argumentatifs presentes precedemment.
Rappelons que l’objectif cle de cette analyse de discours est triple. Il s’agit d’une part de montrer que ce referentiel estfonde sur le deni du caractere paradoxal et conflictuel de la RSE, de presenter d’autre part les strategies discursivespermettant d’acculturer le lecteur a cette representation de la RSE et en dernier lieu d’analyser la facon dont le terme centralde « performance » est utilise comme mythe moderne afin de naturaliser ou « neutraliser » le discours propose.
4.1. Positionnement et pacte d’ecriture
Le rapport de la GRI - G3 - comporte une table des matieres, une preface, un glossaire ainsi que, presentes selon les normesuniversitaires, des schemas, des notes de bas de pages et des references bibliographiques. Il adopte ainsi les criteres d’unrapport d’expert - voire academique - sobre et rigoureux, vehiculant de maniere pedagogique, un certain « savoir » objectif. Niles emetteurs ni les destinataires du document ne sont situes et nommes. C’est dans cette illusion d’objectivite d’undocument qui, jusque dans sa presentation formelle, existe « en soi » que se situent les principales strategiescommunicationnelles et discursives du rapport GRI et plus particulierement de la force perlocutoire, c’est-a-dire d’influence,d’un tel positionnement.
Le titre meme du document « Sustainability Reporting Guidelines » presente l’apparence de neutralite d’un referentieltechnique. Pourtant s’afficher comme « lignes directrices en matiere de reporting societal », proposer a ses lecteurs unepremiere de couverture sur laquelle ne figurent, au centre de la page, que les deux lettres « RG » en majuscules blanches–quisignifie, a condition d’en rechercher le sens, « Reporting Guidelines » - puis en dessous, dans une plus petite police de caractere,les termes « Sustainability Reporting Guidelines » alors que l’acronyme de l’emetteur du document, « GRI », est pratiquementinvisible, c’est se presenter comme « Le » referentiel RSE unique et inconteste, dans lequel toute instance d’enonciation estgommee. Le mode de justification de ce referentiel repose ainsi sur ce positionnement de surplomb de celui qui edicte lanorme, sans etre nomme donc situe.
Ce referentiel unique est en fait auto-referentiel: il est lui-meme le garant de son existence. Sa legitimite repose ainsi treslargement sur sa propre construction discursive. Cette analyse va dans le sens de l’affirmation de Capron & Quairel-Lanoizelee, 2003 selon laquelle la credibilite du modele de reporting de la GRI serait fondee sur un processus d’auto-legitimation.
En temoigne en premier lieu la presence d’une preface qui a pour specificite enonciative de n’etre assumee, ni par unetierce personne, ni par le l’auteur lui-meme. Or, une preface signee par une tierce personne, le plus souvent un expert ou unleader d’opinion, vise a legitimer par des propos generalement laudateurs le document qu’elle introduit. Lorsqu’elle estsignee par l’auteur lui-meme, elle a pour objectif de presenter, avec un certain recul, le propos, le positionnement oul’argumentaire du locuteur, ce qui n’est pas ici le cas.
En temoigne en second lieu la presence d’une partie intitulee « Defining Report Content, Quality and Boundary » qui explicitele sens d’un certain nombre de notions relatives au reporting societal, telles que « Stakeholder Inclusiveness », « Sustainability
Context », « Comparability », « Accuracy », « Reliability », . . . Chaque terme est d’abord defini puis explique et enfin, a l’instar decertains ouvrages a finalite normative permettant au lecteur d’autocontroler son degre de comprehension de ce qu’il a lu, un« test » comprenant 4/5 assertions est propose pour chaque terme. Chacune de ces assertions est classiquement precedeed’un petit carre a cocher. Toutefois, la « mystification » est assumee puisque tous les carres sont deja coches, le « test » n’etantque la synthese des points cles que le lecteur se doit de retenir.
Cet artifice affiche comme tel signifie tout d’abord que les definitions apportees par le referentiel GRI sont « Les »definitions » et non de simples acceptions relatives et contingentes, ce d’autant que l’instance d’emission estsystematiquement occultee. Tout comme dans le glossaire–voir infra–le rapport GRI cree son propre sociolecte, c’est-a-dire sa propre norme langagiere. Cela signifie ensuite que ce rapport se presente non pas comme un discours situe, affichantdes prises de position mais comme un document pedagogique, c’est-a-dire un outil au service d’un savoir et d’unemethodologie neutres, au-dessus de tout soupcon, qu’il convient aux destinataires engages en faveur de la RSE d’acquerir, ce
18 Dans la partie intitulee « Defining Report Content, Quality and Boundary ».
Please cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desdiscours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx10
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
faux test fonctionnant alors comme un « effet de reel » (Barthes, 1968). Cela lui confere un potentiel d’acculturation d’autantplus fort qu’il est insidieux.
4.1.1. La preface
Conformement a ce que nous ecrivions dans la partie precedente, la preface n’est pas signee, elle est ecrite a la troisiemepersonne du singulier ou au passif et ne comporte que deux indicateurs enonciatifs, l’adjectif possessif « our » que l’onretrouve dans les deux syntagmes suivants: « the risks and threats to the sustainability of our social relations, environment and
economies » et « the urgency and magnitude of the riks and threats to our «collective sustainability ». Dans les deux cas, « our » estprecede de termes relevant du champ lexical de la menace et qualifie « l’etre humain » entendu selon une acception tresgenerique.
L’enonce se presente comme un article de fond demontrant le bienfonde d’une « these » enoncee explicitement dansl’intitule de cette preface: « Sustainable Development and the Transparency Imperative ». Cette preface, presentant unargumentaire rigoureux, legitimee des la premiere phrase par une definition du Developpement durable proposee en1987 par le World Commission on Environment and Development, a pour principale voix argumentative (voir supra) leLogos. Elle comporte egalement deux champs lexicaux antagonistes relevant du Pathos: le premier est celui de la pauvrete etde la menace qui pese sur notre « sustainability ». (« the continuing burden of poverty and hunger on millions of people’’;« alarming information »); le second, presente comme virtuel, est celui du progres et du developpement social de la planetequi pourrait exister a condition que l’on pense et agisse autrement. Ainsi, la these de cette preface est la suivante: laglobalisation de nos economies cree des situations contrastees de qualite de vie de certains et d’extreme pauvrete d’autres.Cette situation est risquee et l’etre humain est aujourd’hui confronte a un defi qui suppose des « new and innovative choice and
ways of thinking ». La GRI propose un outil centre sur l’articulation entre les logiques economiques, sociales etenvironnementales et sur la collaboration des diverses parties prenantes permettant de relever ce defi.
Dans ce premier discours auquel est confronte le lecteur du referentiel RSE, les logiques economiques, sociales etenvironnementales ne sont pas apprehendees comme antagonistes et/ou au cœur d’arbitrages. Les parties prenantes ne sont,quant a elles, jamais nommees, ni de facon exhaustive - « a diverse range of stakeholders, including business, labor, NGO,
investors, accountancy, and others » ni de facon personnalisee. A l’exception notable des « investors », on ne parle pas d’acteurs -a meme de developper des strategies - mais d’entites ou de notions desincarnees, voire reifiees (« business, labor, accountancy
») auxquelles on ne peut pas attribuer de buts ou de strategie explicite qui seraient susceptibles d’entrer en contradiction lesunes avec les autres. C’est d’ailleurs le champ lexical du consensus qui est utilise pour qualifier ces « parties prenantes », cequi masque l’existence potentielle d’interets contradictoires (on compte une occurrence de « consensus », une de« collaboration » et deux de « consultations » en deux phrases). En outre, la GRI n’est jamais definie; on ne connaıt ni l’identite,ni le statut de ses membres. Elle n’apparaıt qu’a trois reprises, personnifiee, comme sujet de l’enonce: c’est elle qui peutpermettre aux parties prenantes de communiquer entre eux, de penser autrement et de parvenir a une prise en compteharmonieuse de la RSE. Enfin, le terme de « performance » n’est l’objet d’aucune definition ou explicitation.
4.1.2. L’introduction du rapport, « Overview of Sustainability Reporting »
Elle propose elle aussi un discours explicatif et pedagogique centre cette fois sur le dispositif de reporting societal.Dans l’introduction du referentiel, le reporting societal est tout d’abord defini comme une pratique visant a mesurer et
mettre au jour la performance organisationnelle au regard du developpement durable mais rien n’est dit sur l’identite ou lestatut de(s) acteur(s) ou instance(s) qui mesure(nt) ce dispositif: le management seul? A quel niveau local/global? Lesorganisations syndicales? Des parties prenantes exterieures a l’entreprise? Il apparaıt d’autre part, que la methode dereporting s’inscrit dans une approche consensuelle entre les diverses parties prenantes: ‘‘a process that seeks consensus
through dialogue between stakeholders from business, the investor community, labor, civil society, accounting, academia, and
others.’’ Cette methode repose enfin sur une representation equilibree et raisonnable de la performance durable: « A
sustainability report provides a balanced and reasonable representation of the sustainability performance of the reporting
organization, including both positive and negative contributions’’Ce sont ainsi les qualites de « raison » et de temperance qui permettent une approche consensuelle et harmonieuse entre
les parties prenantes. Voici en effet la definition de ‘‘partie prenante’’ (Stakeholder) dans le glossaire du rapport: « Stakeholders
are defined broadly as those groups or individuals: (a) that can reasonably19 be expected to be significantly affected by the
organization’s activities, products, and/or services; or (b) whose actions can reasonably be expected to affect the ability of the
organization to successflully implement its strategies and achieve its objectives.’’Par ailleurs, dans le paragraphe intitule ‘‘Stakeholder Inclusiveness’’, on compte jusqu’a six occurrences de ‘‘reasonable
expectations and interests’’ associees a ‘‘stakeholders’’. Or, que signifie etre « raisonnablement affecte » ou avoir des «attentesraisonnables»? Qui en decide? Ces questions pourtant centrales sont absentes de l’argumentaire propose.
Il n’existe aucune vision en termes de domination et de rapports de force: la representation qui domine est celle d’unepartie prenante - qui n’est jamais clairement definie - sensee et temperee. De fait, les attentes des parties prenantes peuventdiverger mais, selon le document de la GRI cette opposition peut etre resolue par la raison et par une approche equilibree desproblemes.
19 C’est nous qui soulignons.
Please cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desdiscours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx 11
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
« An organization may encounter conflicting views or differing expectations among its stakeholders, and will need to beable to explain how it balanced these in reaching its reporting decisions.’’
La representation de l’etre humain et des rapports sociaux qui parcourt ces lignes est fondee sur l’idee de la raison et labonne volonte. Le presuppose est que les conflits peuvent etre resolus par la transparence, la rationalite et la « bonnevolonte », c’est-a-dire par des qualites qui proviennent d’une « nature » humaine.
Pour renforcer cette idee, le paragraphe se termine par cette phrase: ‘‘Accountabilty strengthens trust between thereporting organization and its stakeholders. Trust, in turn, fortifies report credibility.’’ La double occurrence de « trust »souligne l’idee que les conflits ne sont pas mus par des oppositions majeures entre stakeholders, par des interetsfondamentalement contradictoires ou par des enjeux de domination mais qu’ils peuvent etre resolus par une simpleouverture (d’esprit) des parties prenantes.
La GRI occulte donc les paradoxes essentiels–au sens etymologique du terme–du developpement durable et n’inscritjamais son propos dans une approche politique qui supposerait que des arbitrages soient pris. Elle produit ainsi des discoursconsensuels fondes sur l’instrumentalisation de concepts tels celui de la « raison » ou de « l’equilibre ». C’est toutefois lanotion de performance qui est au cœur de cette strategie discursive consensuelle et apolitique.
4.2. La rhetorique de la « performance »
Montrons de facon synthetique la facon dont est utilise, dans le corpus de textes de la GRI precedemment selectionne, leterme « performance ».
Il n’est jamais defini, ni dans l’argumentaire propose au lecteur, ni meme dans le glossaire. Supposee aller de soi, laperformance est ainsi un element majeur de la rhetorique de l’evidence, qui fonde le systeme de legitimation de la GRI. Des lapremiere phrase de l’introduction du chapitre « Sustainability Reporting Guidelines », la « performance » est presentee commecentrale dans le dispositif GRI, consistant precisement a « mesurer, evaluer et comparer » la performance d’une organisation(4 occurrences) en termes de developpement durable. Toute une methode se construit ainsi autour d’une notion complexe etabstraite qui n’est jamais precisee mais neanmoins omnipresente.
Dans l’introduction et dans la premiere partie du chapitre « Sustainability Reporting Guidelines » - soit 14 pages - oncompte environ cinquante occurrences de « performance ». Seize d’entre elles sont integrees dans l’expression tres floue de« performance de l’organisation ». A sept reprises, le terme de performance est utilise en soi, sans etre qualifie. Il est a deuxreprises suivi de « globale » et « integree », sans que ces qualificatifs ne soient explicites. Par ailleurs, aucune des quatreoccurrences de « performance economique, environnementale et sociale » n’aborde la question d’une possiblecontradiction entre ces trois dimensions. Enfin, la performance est presentee comme consensuelle et rationnelle; elles’apprecie de facon « fondee, raisonnable, equilibree et pertinente ». Or, a l’instar de Mouffe, nous considerons que « la
croyance en la possibilite d’une reconciliation finale grace a la raison empeche que l’on reconnaisse la possibilite, toujours
presente, de l’antagonisme ». (2010).Au cœur d’une pensee magique, fonctionnant de facon incantatoire et parfois tautologique, le mythe de la performance
permet d’occulter la question de l’existence de conflits reels et/ou potentiels entre parties prenantes, c’est-a-dire de denier ala RSE sa dimension paradoxale.
4.3. Une strategie discursive complexe
Le tableau suivant presente une synthese des principaux resultats de l’analyse de discours GRI a partir des triplesindicateurs enonciatifs, referentiels et argumentatifs.
Indices enonciatifsPronoms
personnels et
adjectifs possessifs
Please cite this article indiscours de la Global Re
Titre et
introduction
press as: Chauvporting Initiative
Instances d’enonciation gommees; textes ecrits a la 38 personne du singulier ou au mode passif
Preface
2 occurrences de « our » apres une double occurrence de « the riks and threats » et devant« social relations, environment and economies » et « collective sustainability »
Indices referentielschamps semantiques
Preface
Pauvrete et risquesDeveloppement social de la planete
Introduction
Raison, temperance et ouverture d’espritConsensus
Performance
Indices argumentatifsnature des arguments
these en presence
Preface
Pathos (la menace)These: risques et opportunites dus a la globalisation en termes de Developpement Durable.
Defi qui suppose un changement de paradigme
Reponse: RSE et reporting societal GRI
Introduction
Logos (le progres)These: une approche consensuelle, rationnelle et equilibree de la RSE de la part de
parties prenantes ouvertes et conscientes de leur responsabilite permettrait,
avec l’aide du dispositif GRI, une articulation harmonieuse des logiques economiques,
sociales et environnementales.
L’analyse discursive du referentiel GRI a montre que, bien que celui-ci prenne parfois l’apparence d’un texte argumentatifdialogique affichant des valeurs humanistes, ses prises de positions ethiques ne s’accompagnent jamais d’une vision
ey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse des. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx12
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
politique des rapports sociaux. Ainsi, le « rapport d’expert » GRI, dont les positions ideologiques sont occultees, se presentecomme un enonce objectif, universellement pertinent, qui denie l’existence de tensions dans le champ de la RSE en general etdu reporting societal en particulier. C’est cette pretendue objectivite qui lui permet de proposer et de legitimer le mythe« rationnel » de la performance globale.
5. Conclusion
A l’analyse du discours de la GRI, il semblerait que l’acceptation innocente du discours doxique sur la Performance Globalereside dans l’instillation d’une douce violence, armee dans un « gant de velours rhetorique » (« rhetorical velvet glove »,Covaleski, Dirsmith, & Rittenberg, 2003, p. 349). Produits d’une culture d’experts, les modeles de reporting societaux, entaisant les conflits et contradictions inherents a la problematique de la responsabilite sociale de l’entreprise, semblent ainsiconcus pour passer les controverses sous silence. Bien plutot, la rhetorique de l’evidence sur laquelle s’appuie l’enonciationde leurs cadres conceptuels, presente leurs concepts et arguments comme des faits indiscutables (matters of fact) participantainsi a la creation d’une nouvelle realite. Or, « en communiquant la realite, on construit la realite » (Hines, 1988). La GRI semblepostuler que les controverses sont desormais closes, les idees sont a present stabilisees, les principes sont « generalement
acceptes »: ils ont fait l’objet d’une « mise en boıte noire » (Callon & Latour, 2006). Or, comme l’indique Gray (2006), la notion dedeveloppement durable n’est pas reductible au management a l’echelle de l’organisation, il s’agit d’un concept systemique etmacro-economique. En cela, elle interroge les fondements meme de l’entreprise et, au-dela, la societe et les choix politiques.Cela nous invite alors a denaturaliser et (re)politiser les concepts de valeur et de performance et a envisager une autreconception du reporting societal au service d’une societe democratique. C’est la « boıte noire » de la performance globale qu’ilnous faut sans doute ouvrir pour, enfin, assumer son caractere paradoxal. Rappelons-nous qu’au-dela de l’ideal mythique dela synthese d’un cote, et du constat neo-institutionnel d’un couplage lache de l’autre, les travaux sur la gestion des paradoxessuggerent une alternative fondee sur leur acceptation (Cf. § 2.2.). C’est peut-etre dans cette voie qu’il conviendraitd’envisager un reporting societal democratique. Au lieu de masquer le caractere fondamentalement paradoxal et conflictueldes dimensions du developpement durable et des attentes differenciees des parties prenantes, sous l’apparence de faussesevidences, celui-ci permettrait au contraire de les reveler dans toute leur complexite et de favoriser, par la meme, un debatdemocratique et l’exercice eclaire de choix politiques. Cela supposerait alors, que l’ensemble des points de vue desdifferentes parties prenantes en presence soit pris en compte dans les etats de reporting societal, que leurs attentes ne soientplus considerees comme « allant de soi », mais fassent l’objet d’une enquete visant a definir la nature des « reponses »qu’attendent les stakeholders. Cela impliquerait egalement de construire des mesures de performance qui revelent auxdecideurs la dynamique des influences systemiques qu’entretiennent entre elles les differentes dimensions economiques,sociales et environnementales. Les paradoxes, loin d’etre nies et occultes seraient alors assumes et deviendraient des objetsde reddition et d’evaluation.
En s’attaquant a la demystification des mythes manageriaux contemporains et en mettant a jour, afin de mieux lesassumer, les paradoxes que masquent les fausses evidences de la doxa manageriale, le projet du « language turn », offre uneperspective salutaire pour la democratie.
Pleadisc
« En passant de l’histoire a la nature le mythe fait une economie: (. . .) il organise le monde sans contradictions parce que sans
profondeur, un monde etale dans l’evidence, il fonde une clarte heureuse: les choses ont l’air de signifier toutes seules »
(Roland Barthes, 1957, p. 230-231).
References
Abernethy, M. A., & Chua, W. F. (1996). A field study of control system redesign: the impact of institutional processes on strategic choice. Contemporary AccountingResearch, 13(2), 569–606.
Abrahamson, E. (1993). Management Fashion. Academy of Management Review, 21, 254–285.Adam JM. La linguistique textuelle. Introduction a l’analyse textuelle des discours, Paris, A., Colin, coll. Cursus, 2005.Ambler T, Wilson, Problems of stakeholder theory, Business Ethices: An European Journal, 1995; 4 (1):30–35.Barthes, R. (1957). Mythologies. Paris Editions du Seuil.Barthes, R. (1968). L’effet de reel. Communications, 2, 84–89.Boissinot, A. (1992). Les textes argumentatifs. CRDP Toulouse.Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Paris: Minuit.Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire. Paris: Fayard.Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1992). Reponses Pour une anthropologie reflexive. Paris: Le Seuil.Bourguignon, A. (2005). Management accounting and value creation: the profit and loss of reification. Critical Perspectives on Accounting, 16, 353–389.Breton, P., & Proulx, S. (1993). L’explosion de la communication. Paris: La decouverte.Brignall, S., & Modell, S. (2000). An Institutional Perspective on Performance Measurement and Management in the New Public Sector. Management Accounting
Research, 11, 281–306.Brunsson, N. (1989). The Organization of Hypocrisy. New York: John Wiley.Callon, M., & Latour, B. (2006). Le Leviathan s’apprivoise-t-il? In M. Akrich, M. Callon, & B. Latour (Eds.), Sociologie de la traduction. Textes fondateurs. (pp. 11–32).
Paris: Presses de l’Ecole des Mines de Paris.Cameron, K., & Quinn, R. (1988). Organisational paradox and transformation. In R. Quinn & K. Cameron (Eds.), Paradox and transformation: toward a theory of change
in organization and management; 1-18. Cambridge, MA: Ballinger.Capron M, Quairel-Lanoizelee F. Reporting societal: limites et enjeux de la proposition de normalisation internationale « Global Reporting Initiative ». 24eme
congres de l’AFC, 2003.
se cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013
J.-N. Chauvey et al. / Critical Perspectives on Accounting xxx (2014) xxx–xxx 13
G Model
YCPAC-1873; No. of Pages 13
Capron, M., & Quairel-Lanoizelee, F. (2006). Evaluer les strategies de developpement durable des entreprises: l’utopie mobilisatrice de la PG. Revue del’Organisation Responsable, 1, 5–16.
Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. The Academy of Management Review, 4(4), 497–505.Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: a review of concepts, research and practice. International Journal of
Management Reviews, 12(1), 85–105.Cho, C., & Patten, D. M. (2007). The role of environmental disclosures as tools of legitimacy: A research note. Accounting, Organizations and Society, 32(7-8), 639–
647.Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. The Academy of Management Review, 20(1), 92–
117.Clegg, S. R., Cuhna, J. V., & Cunha, M. P. (2002). Management paradoxes: a relational view. Human Relations, 55, 483–503.Covaleski, M., Dirsmith, M. W., & Rittenberg, L. (2003). Jurisdictional disputes over professional work: The institutionalization of the global knowledge expert.
Accounting, Organizations and Society, 28, 325–355.Deegan, C. (2002). The legitimizing effect of social and environmental disclosures–A theoretical foundation. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 15(3),
282–311.Delmas-Marty, M. (1998). Trois defis pour un droit mondial. Seuil: Paris.Di Maggio, P. J. (1988). Interest and agency in institutional theory. In L. G. Zucker (Ed.), Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment. (3–22).
Cambridge, MA: Ballinger.Di Maggio, P. J., & Powel, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited; Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American
Sociological Review, 48, 147–160.Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation Concepts Evidence and Implications. The Academy of Management Review, 20(1),
65–91.Ducrot, O. (1980). Dire et ne pas dire, principes de semantique linguistique. Paris: Editions Hermann.Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.Etzioni, A. (1998). A Communitarian Note on Stakeholder Theory. Business Ethics Quaterly, 8(4), 679–691.Evan, W. M., & Freeman, R. E. (1988). A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism. In T. L. Beauchamp & N. E. Bowie (Eds.), Ethical Theory
and Business (pp. 75–93). Englewood Cliffs: Prentice Hall.Foucault, M. (1966). Les mots et les choses. Paris: Gallimard.Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard.Foucault, M. (1977). Dits et ecrits II. 1976-1988. Paris: Gallimard 1977.Freeman, R. E. (1984). Strategic Management A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.Garric N, Leglise I, Point S. Le rapport RSE, outil de legitimation–Le cas Total a la lumiere d’une analyse de discours. Revue de l’organisation responsable 2006; n82,
5-19.Ghiglione, R. (1998). (sous la direction de). L’analyse automatique des contenus. Paris: Dunod.Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability, and how would we know? An exploration of narratives of organisations and
the planet. Accounting Organizations and Society, 35, 47–62.Gray, R. (2006). Social, environmental and sustainability reporting and organisational value creation? Whose value? Whose creation? Accounting, Auditing.
Accountability Journal, 19(6), 793–819.Greimas A. J. L’enonciation. Une posture epistemologique. Significacao, Revista Brasileira de Semiotica, 1974 n. 1. Ribeirao Preto: CE: 9-25.Hill, C. W. L., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder Agency-Theory. Journal of Management Studies, 29(2), 131–154.Hines RD., Financial accounting: in communicating reality we construct reality, Accounting, Organizations and Society, 1988 Vol. 13, n8 3, pp. 251-261.Hopwood, A. G. (1987). The Archeology of Accounting Systems, Accounting. Organizations and Society, 12(3), 207–234.Hopwood, A., & Miller, P. (1994). Accounting as Social and Institutional Practice. London: Cambridge University Press.Ittner, C. D., & Larcker, D. F. (1998). Innovations in Performance Measurement: Trends and Research Implications. Journal of Management Accounting Research, 10,
205–238.Jensen, M. C. (2001). Value maximisation, stakholder theory, and the corporate objective function. European Financial Management., 17(3), 297–317.Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard. Boston: Harvard Business School Press.Kieser, A. (1997). Rhetoric and Myth in Managerial Fashion. Organization, 4, 49–74.Kerbrat-Orecchioni, C. (1986). L’implicite. Paris: A Colin.Lawrence, T. B., & Suddaby, R. (2006). Institutions and Institutional Work. In S. Clegg, C. Hardy, W. R. Nord, & T. Lawrence (Eds.), Handbook of Organizations Studies.
Londres: Sage.Lukacs G. Histoire et conscience de classe. Paris: Editions de Minuit, 1959 (original edition: Geschichte undklassenbewusstsein. Berlin: Malik-Verlag, 1923).Macintosh, N. B. (2002). Accounting, Accountants and Accountability Postructuralist positions. London and New York: Routledge.Macintosh, N. B., Shearer, T., Thornton, D. B., & Welker, M. (2000). Accounting as Simulacra and Hyperreality: Perspectives on Income and Capital. Accounting,
Organizations and Society, 25(1), 13–50.Malsch, B. (2013). Politicizing the expertise of the accounting industry in the realm of corporate social responsibility. Accounting, Organizations and Society, 38,
149–168.Malsch, B., & Gendron, Y. (2009). Mythical representations of trust in auditors and the preservation of social order in the financial community. Critical Perspectives
on Accounting, 20, 735–750.Meyer, J. W., Rowan, B., & Institutional Organizations: Formal (1977). Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363.Miller, P., & O’Leary, T. (1987). Accounting and the Construction of the Governable Person. Accounting, Organizations and Society, 12(3), 235–265.Mitnick BM. Systematics and CSR, The Theory and Processes of Normative Referencing, Business &Society 1995; vol. 34, n81, 5-33.Mouffe C., « Antagonisme et hegemonie. La democratie radicale contre le consensus neoliberal », in La Revue Internationale des Livres et des Idees, 2010. http://
www.revuedeslivres.net/articles.Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 16(1), 145–179.Patten, D. M. (1991). Exposure: legitimacy and social disclosure. Journal of Accounting and Public Policy, 10(4), 297–308.Poole, M. S., & Van de Ven, A. (1989). Using paradox to build management and organizational theory. Academy of Management Review, 14, 562–578.Robrieux, J. J. (1993). Elements de rhetorique et d’argumentation. Dunod: Paris.Sfez, L. (1992). Critique de la Communication. Paris: Editions du Seuil.Smith, W. K., & Lewis, M. W. (2011). Toward a theory of paradox: a dynamic equilibrium model of organizing. Academy of Management Review, 36(2), 381–403.Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571–610.Suddaby, R., & Greenwood, R. (2005). Rhetorical Strategies of Legitimacy. Administrative Science Quaterly, 50, 35–67.Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The evolution of corporate social performance model. The Academy of Management Review, 20(4), 758–769.Weaver, G. R., Trevino, L. K., & Cochran, P. L. (1999). Integrated and decoupled corporate social performance: Management commitments, external pressures, and
corporate ethics practices. Academy of Management Journal, 45(5), 539–542.Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. The Academy of Management Review, 16(4), 691–718.Wood, D. J., & Jones, R. E. (1995). Stakeholder mismatching: a theoretical problem in empirical research on corporate social performance. The International Journal
of Organizational Analysis, 3(3), 229–267.
Please cite this article in press as: Chauvey, J.-N., et al. Rhetorique et mythe de la Performance Globale L’analyse desdiscours de la Global Reporting Initiative. Crit Perspect Account (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2014.09.013