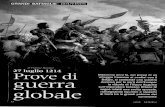La tentation du monde : "histoire globale" et récit symétrique (2013)
-
Upload
sciences-po -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La tentation du monde : "histoire globale" et récit symétrique (2013)
In Christophe GRANGER (dir.), A quoi pensent les historiens ? Science et
insouciance de l’Histoire au XXIe siècle, Paris, Autrement, pp. 181-196.
LA TENTATION DU MONDE : « HISTOIRE GLOBALE » ET
« RÉCIT SYMÉTRIQUE » 1
Romain Bertrand (CERI-Sciences Po)
« À force de voir toujours le Même dans l’Autre – de dire que sous le masque de l’autre,
c’est “nous” qui nous contemplons nous-mêmes –, on finit par se contenter de raccourcir
le trajet qui nous conduit droit au but et à ne s’intéresser qu’à ce qui “nous intéresse”, à
savoir : nous-mêmes. »
Eduardo Viveiros de Castro2
Bonnes ventes ne sauraient mentir : le succès d’ouvrages se réclamant de l’« histoire globale »
atteste l’engouement des historiens et de leurs publics pour un nouveau domaine d’objets3.
Les contours de celui-ci ne sont évidemment pas faciles à cerner. S’agit-il de « tailler plus
large » dans l’étoffe revêche de l’archive, et ce faisant de traquer les itinérances des hommes,
des biens et des idées à l’échelle des océans et des continents ? Ou bien est-il question de
« resserrer la focale » et de scruter le détail d’une situation de « premier contact » au plus près
de ses traces ?
On trouve, rangés pêle-mêle sous une même bannière historiographique, des travaux dont les
choix de méthode diffèrent du tout au tout. Certains, plus sensibles aux biffures des livres de
compte qu’aux péroraisons des « récits de voyage », creusent le sillon d’une histoire
antihéroïque de l’« expansion européenne », et ramènent ce faisant les premières pénétrations
ibériques en Asie à leurs justes dimensions d’intrusions interstitielles4. D’autres prennent alibi
1 Un très grand merci à Jacques Revel pour sa relecture attentive d’une première version de ce texte.
2 Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthropologie post-structurale, trad.
O. Bonilla, Paris, PUF, 2009, p. 5. 3 On pense ici, notamment, au succès amplement mérité de Patrick Boucheron (dir.), Le Monde au XV
e siècle,
Paris, Fayard, 2009. 4 Sanjay Subrahmanyam, Vasco de Gama. Légende et tribulations du vice-roi des Indes, trad. M. Dennehy, Paris,
Alma éditeur, 2012 [1997].
d’une bataille méconnue pour inverser les polarités politiques de l’Eurasie, en pointant tout ce
que le mouvement du monde moderne doit aux Moghols et aux Mandchous5.
Nous voudrions montrer ici, en guise de « troisième voie » et à partir de l’exemple modeste de
l’Insulinde, que l’étude à nouveaux frais des situations de contact entre sociétés distantes à
l’époque moderne (XVIe-XVIII
e siècle) peut devenir le laboratoire d’une expérimentation
historiographique originale, laquelle consiste en l’exploration thématique souple – et non en la
comparaison structurelle rigide – d’univers de sens et de pratique irréductibles les uns aux
autres.
Se déprendre de l’illusion du « géométral » de la rencontre
On sait ce qu’il en est des rencontres : il en est de bonnes comme de mauvaises. Certaines
sont prélude à de durables complicités, d’autres tournent court ou tournent mal. Parler de
« premières rencontres » pour évoquer les situations de contact entre Européens et sociétés
extra-européennes à l’âge moderne ne revient donc pas nécessairement à opter pour une
vision outrancièrement irénique d’échanges qui, s’ils n’étaient pas encore tout à fait inégaux,
n’en étaient pas moins déjà striés de part en part de rapports de force.
En visant l’un seulement de ses domaines d’acceptions, le procès intenté au terme de
« rencontres (impériales ou coloniales) » se trompe de cible6. Car la question n’est ni la
tonalité morale (toujours ambivalente) de la « rencontre » – fût-elle diplomatique,
commerciale ou militaire –, ni l’appréciation raisonnée des asymétries de pouvoir qui
émergent et opèrent dans le cours même de ses interactions constitutives. Le problème gite
bien plutôt dans un « effet de cadrage » qui demeure le plus souvent implicite. Telle
5 Alessandro Stanziani, Bâtisseurs d’empires. Chine, Russie et Inde à la croisée des mondes, XV
e-XIX
e siècle,
Paris, Raisons d’agir, 2011. 6 Il semble, sous réserve d’inventaire, que Michel Mollat ait été le premier, en France, à suggérer l’« emploi du
mot ‘‘rencontre’’, [qui] désigne le face à face des explorateurs et des ‘‘explorés’’, des découvreurs et des
‘‘découverts’’ », et ce afin de « tenir compte des deux parties en présence » (Michel Mollat Les Explorateurs du
XIIIe au XVIe siècle. Premiers regards sur les mondes nouveaux, Paris, CTHS, 2005 (1984), p. 6). Pierre
Chaunu, qui en revenait alors à une histoire on ne peut plus événementielle et héroïque des « Grandes
découvertes » en louant le « génie » de Colomb, répliqua vertement à la proposition : « On s’empoigne sur les
mots. « Découverte » rappelle ma jeunesse ? « Rencontre » fait plus poli. Cela me fait penser à l’« interruption
de grossesse ». « Invasion » satisfait l’indigénisme dont aucun leader n’a le teint cuivré. C’est un privilège des
Blancs et ça se pratique dans les salons » (Pierre Chaunu, Colomb ou la logique de l’imprévisible, Paris, Bourin,
1993, p. 57).
qu’utilisée par les historiens du fait colonial, la notion de « rencontre » présuppose le huis-
clos et le face-à-face : un jeu à deux, duel ou duo, qui fait d’emblée la part trop belle à la
version européenne des faits. Sous couvert de faire entendre la « voix des colonisés » et de
restituer à la situation coloniale sa dimension « dialogique7 », certains ont, à leur corps
défendant, épousé la forme principielle de l’archive coloniale et cédé à l’illusion d’une
conversation en vis-à-vis. L’enfer de l’européocentrisme est pavé de bonnes intentions.
Que des mondes sociaux aient pu, par l’entremise d’une poignée de leurs agents, se
« rencontrer », pour combattre ou converser, est un postulat lourd de conséquences
analytiques. La « rencontre » implique tout d’abord l’existence d’un lieu commun, d’un
« espace intermédiaire (middle ground)8 » régi par des règles d’action partagées et doté de
coordonnées spatiales et temporelles stables et universellement intelligibles par les acteurs en
présence. Or, les situations de « premiers contacts » ont cette particularité de n’être
qu’épreuves et incertitude, puisque même les registres de « rationalité » usités de part et
d’autre ne peuvent être tenus d’emblée pour similaires9. Épreuves : le terme signale, en
pointant la conflictualité qui lui est inhérente, un mouvement, donc un moment.
L’incommensurabilité n’est de fait pas l’attribut intrinsèque d’une situation de contact10
: elle
n’est que son état premier, la propriété transitoire d’une relation évolutive, laquelle a
précisément pour projet et pour effet de la dissiper par l’institution de dispositifs pratiques de
mise en équivalence – glossaires, étalons de pesée, taux de change.
L’idée du monde commun de la « rencontre » charrie, en second lieu, le motif du face-à-face
exclusif entre les « Européens » et les « Autres » (« Asiatiques », « Indiens »,
« Amérindiens », etc.). Outre qu’elle met en jeu des totalités tout aussi imprécises
qu’anachroniques, et promeut ce faisant une lecture « civilisationnelle » aux dépens d’une
analyse sociologique, cette rhétorique du vis-à-vis oblitère la complexité de situations
marquées au sceau de l’intermédiation et de la polyglossie. Lorsqu’ils jettent l’ancre dans la
rade de la cité-État de Banten en juin 1596, les Hollandais de la Première Navigation en sont
7 Jean et John Comaroff, Of Revelation and Revolution, vol. 2 : The Dialectics of Modernity on a South African
Frontier, Chicago, Chicago, University of Chicago Press, 1997. Pour la reprise de ce paradigme dans l’espace
français, voir Emmanuelle Saada (dir.), « La parole est aux ‘‘indigènes’’ », Genèses, 2007, n° 69. 8 Richard White, The Middle Ground. Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650-1815,
Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 9 Marshall Sahlins, How « Natives » Think: About Captain Cook, for Example, Chicago, University of Chicago
Press, 1996. 10
Sanjay Subrahmanyam, « Par-delà l’incommensurabilité. Pour une histoire connectée des empires aux temps
modernes », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2007/5, n° 54-4bis, pp. 34-53.
réduits à communiquer avec leurs interlocuteurs javanais par l’entremise tantôt de casados
portugais venus de Malacca, tantôt de marchands arabes italianophones, tantôt encore du
truchement du Régent du lieu. Et lorsqu’ils arpentent les marchés de jour de la ville en quête
de poivre noir à bon prix, c’est à des changeurs gujératis et à des grossistes sino-javanais
qu’ils ont affaire11
.
Au temps des « premiers contacts », la relation – contrainte ou volontaire – avec les
« Européens » ne constitue jamais l’unique horizon moral et stratégique des sociétés
politiques extra-européennes. Pour les princes et les érudits de Banten, l’Empire ottoman, la
Chine impériale, les sultanats d’Aceh et de Johore sont des interlocuteurs autrement plus
pertinents que les nouveaux venus hollandais, et ce aussi bien au plan commercial qu’en
termes d’alliances politiques ou de transactions littéraires et religieuses. Le modèle
« dialogique » de la « rencontre » réplique, souvent sans même y prendre garde, l’égotisme
historiographique qui devient, aux XVIIe et XVIII
e siècles, la marque de fabrique des littératures
européennes du lointain12
. Dans les faits, cependant, la capacité d’un potentat à ne pas tenir
compte des « Européens », c’est-à-dire à ne pas s’enferrer dans une relation exclusive avec
eux, mais tout au contraire à maintenir un faisceau d’alliances rituelles avec d’autres sociétés
politiques locales, pouvait être une suprême manifestation de puissance et de prestige. Du
point de vue des « sociétés fortes », qui constituaient le centre de gravité de réseaux
commerciaux ou politiques préexistants, il existait un intérêt au désintérêt à l’égard des
Européens13
.
Qu’elle ait été un choix stratégique ou la simple conséquence d’un « angle mort » de
perception, l’indifférence à l’endroit des « Européens » a d’ailleurs été, en mondes asiatiques,
l’un des modes vernaculaires usuels des « premiers contacts14
». Toutefois, que l’on ne s’y
méprenne pas : l’absence des « Européens » dans les chroniques malaises ou dans les annales
de royauté javanaises n’est aucunement le signe d’une inaptitude insulindienne au réalisme
figuratif ou à l’exactitude chronologique. À preuve le fait qu’à la même époque, les scribes
d’Aceh et de Johore produisent des récits circonstanciés de l’accueil d’ambassades chinoises
11
Les exemples concernant les situations insulindiennes sont tous extraits, sauf indication contraire, de Romain
Bertrand, L’Histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVII
e siècle), Paris, Le Seuil,
2011. 12
Jean-Marc Moura, La Littérature des lointains, Paris, Champion, 1998. 13
Kathleen DuVal, The Native Ground. Indians and Colonists in the Heart of the Continent, Philadelphie,
University of Pennsylvania Press, 2006. 14
Stuart B. Schwartz (dir.), Implicit Understandings. Observing, Reporting, and Reflecting on the Encounters
between Europeans and Other Peoples in the Early Modern Era, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
ou de l’envoi de légations au Siam ou à Constantinople. Cette absence est bien plutôt le
symptôme d’un principe particulier – mais profondément cohérent – de sélection des faits
exemplaires : un principe qui assigne une modalité argumentative et un horizon de pertinence
spécifiques à la fabrique narrative de l’« histoire vraie (sejarah) », et qui signale par là-même
l’irréductible autonomie d’un univers historiographique local obéissant, tout comme celui des
chroniqueurs des Premières Navigations ou de l’Estado da India, à ses propres conventions
descriptives et calendaires.
Comment parler encore de « rencontre » lorsque les acteurs en présence habitent des univers
historiographiques aux prémisses dissemblables et ne s’accordent en aucune manière sur les
faits appelés à devenir, narration et remémoration aidant, des évènements ? Tandis que, de
retour à Amsterdam, les Hollandais célèbrent avec emphase leur entrée tumultueuse en monde
insulindien, les chroniques malaises et javanaises ne consacrent pas une seule ligne à
l’expédition de Cornelis de Houtman. Cette extrême asymétrie historiographique interdit,
pour tisser le récit véritablement équitable d’une « rencontre » qui n’a pas eu lieu, de recourir
au modèle, commode mais inapproprié, des « regards croisés ». Grand chasseur de nuisibles,
Paul Veyne avait autrefois débusqué l’aporie : impossible, en l’absence de quelque point
d’intersection documentaire que ce soit, de reconstruire en toute sérénité le « géométral »
kaléidoscopique de l’événement15
. Il nous faut donc renoncer à l’illusion d’une histoire
naturelle des situations de contact, laquelle procéderait par colligation, par assemblage savant
de matériaux disparates, « européens » et « extra-européens ». Pour autant que l’on souhaite
assigner une égale dignité documentaire à des univers textuels obéissant à des conventions
historiographiques distinctes, la narration-patchwork n’est pas à disposition : on ne coud pas
la pierre et la laine. Dès lors, que faire ?
Décrire le contact entre des mondes
Non plus travailler seulement sur le monde du contact, c’est-à-dire sur les lieux et les
moments de particulière intensité de l’échange marchand ou diplomatique, mais aussi, et d’un
même mouvement, sur les mondes qui, se « rencontrant » ou pas, coexistent et coalescent en
ces lieux. Ce changement de perspective – ou plutôt : ce saut dans le perspectivisme – impose
de mener de front toute une série d’opérations. Il contraint, en premier lieu, à œuvrer à
15
Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, Paris, Le Seuil, 1970, p. 58.
périmètre réduit. La multiplication des entités pertinentes du récit, et par contrecoup
l’attention égale accordée à leurs manifestations et à la façon dont elles s’énoncent à la
première personne, se paye du prix d’une prolifération d’actants16
proportionnelle au degré
d’ouverture de la « focale17
» d’analyse. La leçon nous vient tout aussi bien de la micro-
histoire que de la sociologie pragmatique : pour remettre en suspens simultanément
l’ensemble des désignations d’acteurs, pour caractériser sociologiquement ces derniers au plus
près de leur propos, et ce afin d’échapper à la prise de la formulation rétrospective binaire de
leurs identités, il n’est d’autre moyen que de s’immerger dans le détail du plus grand nombre
possible de comptes rendus18
. Impossible, pour cela, de voyager trop loin, trop vite et trop
longtemps : l’étude d’une situation donnée de « premier contact », limitée dans le temps et
l’espace, suffit à la peine.
L’« ici et maintenant » d’une interaction de contact de l’âge moderne reste cependant, qu’on
le veuille ou non, un « ailleurs » et un « autrefois ». Le choix de l’empirisme radical – on dira
plus doctement : de l’inscription dans une « tradition casuistique » de la « pensée par cas19
» –
n’est pas qu’affaire de parti-pris descriptif : il est aussi, en l’espèce, une réponse pratique au
double péril de l’européocentrisme et de l’anachronisme. Il est en effet question, non pas de
conjurer d’emblée l’étrangeté relative d’un énoncé portugais ou javanais de la fin du
XVIe siècle, mais tout au contraire de la convoyer aussi longtemps que possible dans le récit.
Ceci oblige à rendre problématiques, et ce faisant visibles dans le corps même du texte, les
opérations de traduction. Prenons un exemple – javanais comme il se doit. Dans un ouvrage
célèbre, Clifford Geertz ferraille contre l’universalisme indu de la définition wébérienne de
l’État en lui opposant la notion javanaise de negara, qu’il traduit d’entrée de jeu par « État-
16
Cette notion d’« actants » est à prendre au sens que lui confère la sociologie des sciences et des techniques,
partant comme incluant aussi les « non-humains », objets et entités animales et minérales. Le projet d’une
histoire des situations de contact centrée sur les dispositifs pratiques de commensurabilité implique de porter une
attention particulière aux instruments qui équipent les agents (le galion, la balance à fléau, l’astrolabe, etc.), et
qui non seulement leur permettent de « traduire » leur environnement, mais aussi leur prescrivent des cours
d’action spécifiques. Ce projet s’accorde tout spécialement au programme descriptif de la sociologie
pragmatique. 17
Sur ce point, et à rebours de la polémique stérile entre « histoire globale » et micro-histoire, voir l’introduction
au dossier « Une histoire à l’échelle globale », Annales HSS, 2001, vol. 56, n° 1. 18
Bruno Latour, Changer de société. Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2006 ; Laurent Thévenot,
L’Action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Découverte, 2006. Pour une illustration
parmi bien d’autres de ce « tournant pragmatique », accompli en l’espèce au moyen de la réhabilitation des
théorisations interactionnistes, voir Daniel Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Théories de l’action collective,
Paris, La Découverte, 2007. 19
Jean-Claude Passeron et Jacques Revel (dir.), Penser par cas, Paris, EHESS, 2005, dans le sillage, bien sûr, de
Carlo Ginzburg, « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire », in C. Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces.
Morphologie et histoire, Paris, Verdier, 1989 [1986], pp. 218-294.
théâtre20
». L’objectif est clair : en rabattre à l’impérialisme des versions matérialistes de
l’État par le moyen d’une notion vernaculaire érigée en réservoir d’une « tradition autre » de
centralisation politique – une tradition qui en appelle non pas à la concentration
monopolistique de « moyens de puissance » d’or et de fer, mais à celle des « moyens
symboliques », immatériels, d’un pouvoir qui ne fait, pour exister, que se mettre en scène.
L’hypothèse d’un pouvoir opérant par « irradiation rituelle » plutôt que par mise au pas
militaire et prédation fiscale est séduisante, bien qu’elle ait été radicalement invalidée par
d’autres historiens, plus attentifs au détail des luttes intestines des royautés balinaises qu’à
leurs rodomontades rituelles21
. Reste que l’avocat de la « description dense » accomplit ici
une traduction pour le moins ténue. Car au vu de la déroutante variété de ses acceptions dans
les sources malaises et javanaises classiques et modernes – où il désigne tour à tour un lieu
d’essartage, la capitale d’un royaume, le domaine d’autorité d’un dynaste, les cités concédées
en apanage aux grands seigneurs, les « villages et vergers » ou le « monde des plaines » par
opposition à celui des « forêts sauvages », une condition d’optimale humanité impliquant le
respect d’une règle de dévotion, etc. –, le terme de negara gagne à ne pas être trop hâtivement
ramené à un objet rassérénant de la philosophie politique contemporaine et occidentale.
Ressaisi dans la trame de ses occurrences, suivi à la trace comme un gibier cavaleur dont
l’itinéraire même dessine peu à peu le contour, il permet en revanche de prendre pied au cœur
du domaine notionnel qui spécifie, en mondes malais et javanais, l’exercice de la
souveraineté. Cette dernière n’y est pas pensée seulement comme emprise sur des territoires,
mais aussi, et surtout, comme formation de sujets par leur insertion dans un régime de
civilité : un réseau dense de « normes du gouvernement de soi (aturan) » qui qualifie les êtres
comme susceptibles d’accéder à la dignité de l’obéissance.
En refusant de céder à la tentation de la fixation préalable des frontières sémantiques du terme
negara, on accède par son entremise à un réseau de faits et de lieux qui correspond très
précisément aux manifestations concrètes de la majesté royale, ici fréquemment pensée
comme puissance d’ordonnancement harmonieux du monde par un « raja-jardinier » qui –
nous apprend un coutumier du Pahang de la fin du XVIe siècle – veille sur son royaume
comme sur un parterre de fleurs. Ces énonciations dévoilent l’importance, dans les
20
Clifford Geertz, Negara, the Theatre-State in Nineteenth Century Bali, Princeton, Princeton University Press,
1981. 21
Voir tout particulièrement Henk-Schulte Nordholt, The Spell of Power. A History of Balinese Politics, 1650-
1940, Leyde, KITLV, 1996.
théorisations malaises et javanaises de l’autorité, des répertoires de la musicalité et de la
fragrance du pouvoir : selon la Sejarah Melayu (1612), la souveraineté porte aussi loin que le
son des « tambours de royauté (nobat) », tandis que d’après le Serat Cabolek (1730),
l’inélégance d’un roi se paye de la « puanteur » de son royaume – manière d’indiquer que le
« bon gouvernement » a bonne odeur. On le voit : il y a beaucoup à gagner, chemin faisant,
lorsque l’on accepte de s’égarer dans le maquis des acceptions du negara.
Repérer une connexion pour bâtir une comparaison
Tout autant que les traductions ténues, les comparaisons préalables sont dommageables à
l’économie narrative d’une description centrée sur l’« ici et maintenant » d’une interaction de
contact. La « connexion » qui s’établit entre deux sociétés distantes offre certes le cadre idéal
d’une comparaison terme à terme entre celles-ci : du moins soustrait-elle à l’arbitraire d’un
appariement purement intuitif de « cas ». Mais ce type de comparaison attente
irrémédiablement au rendu réaliste d’une série de choix individuels accomplis sous contrainte
de situation et en condition d’incertitude. Les agents de contact – marins zélandais ou jésuites
portugais – ne savaient rien, ou presque, de mondes dans lesquels ils pénétraient, pour ainsi
dire, par effraction. Il leur fallait néanmoins, car le temps et les moyens leur étaient comptés,
agir vite. Aussi étaient-ils amenés à « improviser22
», c’est-à-dire à manœuvrer au coup par
coup, sans plan préconçu ni connaissance adéquate des jeux de pouvoir locaux.
Toutefois, il n’est pas d’improvisation qui ne soit guidée, sur les modes contraires du respect
tacite ou de la transgression volontaire, par des « codes de conduite », par quoi il faut entendre
des ensembles relativement stabilisés de normes pratiques de comportement : des répertoires
de la « présentation de soi » et du rapport aux autres incorporés par les agents au terme de
parcours de socialisation accomplis au sein de milieux et sous la houlette d’instances
spécifiques (parentèles, guildes, cités, confréries, milices, etc.)23
. Ainsi Cornelis de Houtman
n’agit-il ou ne réagit-il pas, « en situation », face à ses interlocuteurs bantenois, de façon
totalement aléatoire. Porteur d’un style de comportement particulier, propre aux milieux
marchands dont il est issu et qu’il a si longtemps fréquentés, le capitaine hollandais est en
22
Timothy Brook, Vermeer’s Hat. The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World, New York,
Bloomsbury, 2008, pp. 19, 21. 23
Erving Goffman, La Mise en scène de la vie quotidienne, vol. 1 : La Présentation de soi, trad. A. Accardo,
Paris, Minuit, 1973 [1956].
outre habité d’une vision phantasmatique des normes de la bienséance nobiliaire – dont il n’a
jamais fait l’expérience directe mais dont il a probablement, n’étant pas un illettré, entrevu les
fastes par le biais des libelles célébrant la souveraineté orangiste ou des satires tournant en
dérision la cour bruxelloise. L’ethos de Houtman est celui du marchand, mais il se donne des
airs de grand seigneur : sa personnalité de protagoniste d’un drame de « premier contact » se
situe à mi-chemin de ce qu’il est et de ce qu’il désire paraître24
.
Les acteurs témoignant rarement en nom propre de leurs dispositions inconscientes, nous en
sommes souvent réduits, pour ce qui est de rattacher leurs actions à des systèmes normatifs, à
la simple conjecture. Tout est, dès lors, affaire de tamisage prudent du « grain fin » de la
documentation. Quoiqu’il en soit, c’est lorsque l’on tente de saisir le comportement des agents
de contact comme socialement déterminé que l’on procède, de façon indirecte, à une
comparaison entre les mondes en présence. Cette comparaison n’est plus menée au niveau
d’entités surplombantes (« États » ou « sociétés »), ni préalablement à la description de
l’interaction de contact : elle s’effectue au contraire sous la forme de l’exploration thématique
conjointe et parallèle des secteurs de la « raison pratique25
» qui oriente le déroulement de
l’interaction – sens du rang, savoir-faire de négoce ou de combat, gestuelles de prestance, etc.
Pour mettre au jour les morphologies sociales qui orientent le cours d’une interaction de
contact, il ne faut pas se contenter de scruter à distance le monde qu’arpentent les acteurs : il
faut encore l’arpenter à leur manière, le dévoiler au rythme de leurs étonnements, de leurs
embarras et de leurs faux-pas.
Il faut, autrement dit, lorsque la chose est possible, accorder une égale importance aux
« grands textes » prescriptifs qui déclament la lettre des conduites (traités de cosmographie et
d’art nautique, livres de piété, manuels de convenances ou de confession, etc.) et aux « petits
textes » qui recèlent, à des degrés divers, l’esprit de la pratique (correspondances intimes et
officielles, routiers, logbooks, livres de comptes, « récits de voyage », inventaires après décès
d’effets de bord, etc.). Puisqu’à Banten se sont croisés des marins hollandais et des marins
malais et javanais, et puisque leur monde ordinaire était avant tout celui des ports et des
bâtiments de haute mer, il y a quelque intérêt à s’essayer à une exploration parallèle des
24
Sur l’importance de la prise en compte, non seulement des trajectoires sociales objectives, mais aussi des
appartenances fantasmées des agents de contact coloniaux pour déchiffrer leur comportement face aux élites des
sociétés locales, voir George Steinmetz, The Devil’s Handwriting. Precoloniality and the German Colonial State
in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa, Chicago, University of Chicago Press, 2007. 25
Pierre Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Le Seuil, 1994.
ensembles documentaires ayant trait, en Europe du Nord comme en Insulinde, à la vie
maritime et à ses vicissitudes. Pour les navires de haut bord de la Compagnie hollandaise des
Indes orientales (VOC), on piochera avec profit dans l’artickelbrief (l’exposé circonstancié
des règles de la vie à bord, lu avant départ aux équipages), dans les « chants de matelots
(matrozenlieden) », dans les traités détaillant l’« art des pilotes (konst der stuerluyden) », dans
les journaux de bord des commis, dans le registre des sentences des présidents de comptoirs,
ou encore dans les manuels de piété écrits tout spécialement à destination des « gens de mer
(varensmannen) ». Côté malais, on trouvera dans les Lois maritimes de Malacca et dans un
traité de « droit coutumier (adat) » du Kedah (Malaisie péninsulaire) quantité de dispositions
réglant les rapports d’autorité et la pratique religieuse en mer. Le Hikayat Hang Tuah
(« Épopée de Hang Tuah ») recèle en outre de précieuses notations sur le rôle et le crédit du
« maître-pilote (muallim) » qui officiait à bord des nefs malaises et javanaises26
.
Menée dans l’enceinte restreinte d’un espace de stricte contemporanéité des documentations,
cette opération produit un tableau de concordances et de dissemblances. Sous certains aspects
– comme l’éloge de la connaissance pratique acquise par les pilotes, la répartition complexe
de l’autorité entre capitaines-armateurs, boscos et simples marins, ou la pratique de rituels de
supplique destinés à apaiser la colère des flots –, le rapport à la mer des marins malais et de
leurs homologues hollandais présente de troublantes analogies. Sous d’autres aspects, comme
l’existence d’un « droit de la prise » plus ou moins formalisé ou la relation entre navigation
commerciale et marine royale, ce rapport se révèle en revanche radicalement dissemblable. Il
est parfaitement possible, et probablement de saine méthode, dans le cadre de la production
du récit à dominante non pas explicative mais compréhensive de la « raison pratique » d’une
interaction de contact, de s’en tenir à ce tableau sans chercher à imputer à son
ordonnancement une quelconque ultima ratio.
26
Ce à quoi il faut encore ajouter, bien évidemment, un autre registre de traces : celles, matérielles, que nous
dévoile l’archéologie maritime, et qui nous aident à décrire au plus près cette scène d’action(s) si particulière
qu’était l’espace de vie fragmenté d’un navire de haut bord.
Mais si l’on souhaite véritablement éclairer le pourquoi des « étranges parallèles27
» qui se
dessinent entre des mondes apparemment si distants et si peu « connectés », trois hypothèses
se présentent logiquement à l’esprit28
. La première est de l’ordre d’un universalisme
anthropologique. Elle part de la prémisse d’une surdétermination de l’activité sociale humaine
par sa nature d’espèce biologiquement homogène : les homologies formelles qui s’observent
en des points distants de l’Eurasie ne sont que les manifestations d’un commun capital
génétique collectif. Outre qu’elle nous amène à naviguer dans les eaux troubles de la
sociobiologie, cette hypothèse a l’inconvénient de faire fi de la seconde colonne du tableau –
celle qui répertorie les dissemblances.
La seconde hypothèse est celle d’un contact direct ignoré, d’un circuit d’emprunts réciproques
et d’influences mutuelles non-encore attesté entre les mondes qui « se ressemblent ». Dans le
cas qui nous occupe, impossible de nier que le « bassin eurasiatique », reliant par voies
terrestres le « finistère » ouest-européen à la Chine impériale, a fonctionné pendant des siècles
comme milieu d’échanges et d’incubation idéologique et technologique. Le long des Routes
de la soie et des côtes de l’Océan indien ont joué, depuis le XIIIe siècle, quantité de médiations
– génoises, vénitiennes, nestoriennes, yéménites, ottomanes, etc. Il est tout sauf impossible
que les « codes de la mer » aient subi, au gré des flux et reflux de ces courants médiateurs,
une harmonisation relative de leurs grammaires de clauses – une harmonisation rendue par
ailleurs impérative aux points de confluence de ces courants : les cités portuaires où se
négociaient les contrats d’affrètement et s’arbitraient les litiges entre armateurs, capitaines et
équipages.
Le fait est que même en l’absence d’un texte-tiers – arabe, persan ou portugais – reliant en
zigzag un artickelbrief hollandais à un traité d’adat malais, ou un « miroir au prince »
hispanique à un traité de bon gouvernement de Johore ou d’Aceh, l’hypothèse d’une
transmission au long cours ne peut jamais être exclue pour ce qui concerne le « bassin
eurasiatique ». C’est là, d’ailleurs, ce qui différencie irrémédiablement l’analyse des
pénétrations européennes en Asie (du Sud, du Sud-Est et orientale) de celle des situations de
27
Victor Lieberman, Strange Parallels. Southeast Asia in Global Context, c. 800-1830, vol. 1 : Integration on
the Mainland, vol. 2 : Mainland Mirrors. Europe, Japan, China, South Asia, and the Islands, Ann Arbor,
University of Michigan Press, 2003 et 2009. 28
Ces rapides réflexions sur le traitement analytique des homologies formelles entre documentations distantes
s’inscrivent dans la lancée des travaux de Carlo Ginzburg, et notamment de « Freud, l’homme aux loups et les
loups-garous », in C. Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces…, op. cit., pp. 334-350. Elles font aussi directement
écho à Roger Chartier, « La conscience de la globalité (commentaires) », Annales HSS, 2006, vol. 56, n° 1,
pp. 119-123.
contact entre le monde hispanique et les sociétés méso-américaines. Si l’on peut – et l’on
doit29
– tenir compte de la synchronie de ces situations pour apprécier à sa pleine mesure la
« démesure » des ambitions impériales ibériques, on ne peut les ramener à un seul et même
type de situations. En Asie, tout « premier contact » rejoue, en feignant de l’ignorer ou en la
reformulant du tout au tout, une série de relations antérieures.
Troisième et dernière hypothèse : un modèle médian de « polygénisme écologique », qui
suppose que la congruence (mais non pas nécessairement la convergence) d’un certain
nombre de processus de transformation sociale, dictée en dernier ressort par l’adaptation à un
jeu similaire de contraintes topographiques et climatiques, se traduit par l’éclosion, en un
point de conjoncture donné, d’un ensemble relativement homogène de pratiques et
d’énoncés30
.
Plaçons le curseur imaginaire du comparatisme thématique aux alentours de 1600. On
constate à l’époque, dans une diversité prodigieuse de mondes politiques maillant le tronçon
central de l’espace eurasiatique, l’existence d’un genre spécifique de traités de « juste
gouvernement ». Ces traités ont ceci de spécifique, donc de commun, qu’ils lient étroitement
la légitimité du pouvoir d’un souverain à son respect de normes d’excellence morale, qu’ils
n’hésitent pas à épeler par le menu. Ils évoquent également ouvertement la possibilité de la
déposition ou du régicide en cas de rupture par ledit souverain du « pacte de justice » qui le lie
à ses sujets. Non seulement les critiques de la ragion di Stato à Venise et Bologne, les
Monarchomaques à Genève et le jésuite Mariana à Tolède, mais encore al-Jauhari à Johore ou
Aceh, les auteurs ottomans de « conseils aux princes (nasihatname) » à Constantinople et les
compilateurs moghols de traités de « civilité (adab) » à Agra débattent, au tournant du
XVIIe siècle, des devoirs du souverain et des conditions de licéité du régicide
31.
29
Comme le prouve le profit heuristique tiré de cette opération par Serge Gruzinski dans L’Aigle et le Dragon.
Démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle, Paris, Fayard, 2012.
30 C’est ce modèle de polygénisme, ciblant les phénomènes macro-politiques et lié en dernier ressort à la thèse de
l’adaptation à une gamme de contraintes écologiques spécifiques, que développe Victor Lieberman dans Strange
Parallels…, op. cit. Mais si l’argumentation théorique liminaire du premier volume séduit, l’échappée belle du
second volume dans le comparatisme le plus abstrait et le plus débridé ne laisse pas de faire douter de la
possibilité même de mener à terme le projet d’ensemble. 31
Pour les exemples hispanique, italien, genevois et malais, voir R. Bertrand, L’Histoire à parts égales…,
op. cit., chap. XIII. Pour le cas ottoman, voir Baki Teczan, The Second Ottoman Empire. Political and Social
Transformation in the Early Modern World, Cambridge, Cambridge University Press, 2010. Pour les littératures
indo-persanes, voir Muzaffar Alam, The Languages of Political Islam. India, 1200-1800, Chicago, University of
Chicago Press, 2004.
Surprenante « conjoncture constitutionnaliste32
», dont il n’est pas déraisonnable de penser
qu’elle s’articule à, et procède pour partie d’une série de transformations sociales de grande
ampleur prenant place simultanément dans les lieux considérés : émergence de nouvelles
bourgeoisies marchandes urbaines et de noblesses robines de plus en plus actives
politiquement, montée en puissance corrélative d’une élite de juristes rompus à la défense des
franchises collectives et des droits de propriété individuels, etc.
Redisons-le cependant : il n’est nul besoin, dans le cadre de l’analyse compréhensive d’une
situation de contact donnée, de recourir à l’un ou l’autre de ces mastodontes théoriques. Le
comparatisme explicatif rigide, qui opère à l’échelle des structures très larges et des temps très
longs, reste superfétatoire, pour le type de récit qui nous occupe, eu égard au comparatisme
thématique souple, qui travaille le détail local des énonciations. Le mystère des similitudes
n’a pas besoin d’être levé pour que soit engrangé le bénéfice de son surgissement.
Épilogue : de quelques méprises concernant l’« histoire globale »
Au moment de mettre un terme à ce bref voyage en mondes lointains, un constat s’impose :
s’il bâtit sur le socle de l’histoire critique des « expansions ibériques » et s’inscrit dans le
sillage de l’« histoire connectée33
», le cahier des charges théoriques et méthodologiques d’un
projet d’« histoire symétrique » des situations de contact ne s’applique tout bonnement pas à
la quasi-totalité des travaux de langue anglaise qui font, de nos jours, usage de l’étiquette
d’« histoire globale ». Travail de sources de première main à « focale » réduite, mise en
suspens des catégories explicatives surplombantes au profit d’une traduction compréhensive
des énoncés vernaculaires, égale attention conférée aux acteurs et à leurs instruments, recours
à la comparaison thématique souple en lieu et place de la comparaison structurelle terme à
terme : voilà bien plutôt l’anti-cahier des charges de ces vastes fresques de global history qui
enjambent allègrement les siècles et les continents.
32
Je forge l’expression en écho à celle de « conjoncture millénariste » avancée, puis amendée, par Sanjay
Subrahmanyam (« Du Tage au Gange au XVIe siècle : une conjoncture millénariste à l’échelle eurasiatique »,
Annales HSS, 2001, vol. 56, n° 1, pp. 51-84). 33
Sanjay Subrahmanyam, Explorations in Connected History, vol. 1 : From the Tagus to the Ganges, vol. 2 :
Mughals and Franks, Oxford, Oxford University Press, 2005 ; Serge Gruzinski, Les Quatre Parties du monde.
Histoire d’une mondialisation, Paris, La Martinière, 2004.
Certes, les étiquettes importent peu, et seuls comptent, au final, les démarches et les résultats
de recherche. Mais précisément : si l’« histoire globale » n’est rien d’autre que cette histoire à
majuscules, ce grand récit sans visages et sans paysages, sans saveurs et sans surprises que
certains se plaisent à ânonner un peu trop complaisamment, en quête soit de collisions
inéluctables, soit de confortables précédents, alors tout incite à s’en détourner pour faire, à son
encontre, le pari de l’étrangeté. En dépit de ce que croient y lire certains esprits chagrins, il
n’y a, dans ce projet en forme de pari, nulle volonté gratuite de saccage des paisibles
étagements européens du temps et de l’espace, mais simplement le désir de déposer, dans les
rayonnages de la bibliothèque encore si peu universelle des temps modernes, des paroles et
des pensées trop longtemps ignorées ou minorées.

























![[Amend-1]Quarterly Report - Monde Nissin](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633975850971b993d60182a7/amend-1quarterly-report-monde-nissin.jpg)