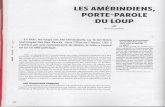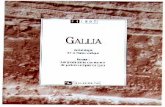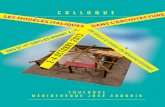Représenter la classe ouvrière. Organisations, porte-parole et idées ouvrières en France au XIXe...
Transcript of Représenter la classe ouvrière. Organisations, porte-parole et idées ouvrières en France au XIXe...
CNRS 2015 Samuel Hayat
1
Représenter la classe ouvrière
Organisations, porte-parole et idées ouvrières en
France au XIXe siècle (1791-1905)
Samuel Hayat
Candidature pour un poste de Chargé de Recherche au CNRS, section 40
Année 2015
I. Résumé .................................................................................................................................... 2
II. Problématique de la recherche ............................................................................................... 3
A. Genèse du projet ................................................................................................................ 3
1. Une histoire de la République démocratique et sociale de 1848 .................................... 3
2. Une nouvelle histoire sociale de la classe ouvrière ........................................................ 5
B. Pour une histoire de la représentation de la classe ouvrière .............................................. 5
C. Axes de recherche .............................................................................................................. 7
1. Sociologie historique des répertoires organisationnels ouvriers .................................... 8
2. Sociologie des porte-parole ouvriers .............................................................................. 9
3. Histoire sociale des pratiques intellectuelles ouvrières ................................................ 10
III Mise en œuvre de la recherche ............................................................................................ 12
A. Terrains ............................................................................................................................ 12
1. L’industrie du livre à Paris ........................................................................................... 12
2. La soierie lyonnaise ...................................................................................................... 12
3. Bassin minier du Nord .................................................................................................. 13
4. Espaces de circulation .................................................................................................. 14
B. Méthodes et sources ......................................................................................................... 14
1. Une démarche pluridisciplinaire .................................................................................. 14
2. Sources ......................................................................................................................... 16
C. Calendrier de recherche et de valorisation de la recherche ............................................. 18
D. Insertion dans des laboratoires de recherche ................................................................... 18
IV. Bibliographie ...................................................................................................................... 20
CNRS 2015 Samuel Hayat
2
I. Résumé
Ce projet de recherche vise à étudier, dans une perspective d’histoire sociale des idées,
l’ancrage des idées politiques des ouvriers français au XIXe siècle, en particulier leur
conception de la représentation, dans leurs pratiques collectives d’organisation. En 1791,
l’interdiction brutale des corporations, par la loi Le Chapelier et le décret d’Allarde, prive les
travailleurs de toute existence collective légale, forçant ces derniers à réfléchir collectivement
sur leurs formes d’organisation dans le cadre nouveau de la France post-révolutionnaire. Ils
engagent pour cela des pratiques intellectuelles collectives dont on peut retrouver les traces
dans les règlements d’association, les pétitions, les manifestes, etc. Ces textes, produits
collectivement au nom de la classe ouvrière, participent à l’institution de cette classe comme
sujet politique et à la construction symbolique des représentations collectives de ce qu’est la
classe ouvrière.
L’hypothèse centrale de ce projet est que tout au long du XIXe siècle, les organisations
ouvrières sont soumises à un double mouvement, en partie contradictoire : d’un côté, la
diffusion des formes d’organisation, de dispositions et de discours issus du monde des
ouvriers de métier ; d’un autre côté, l’adaptation au triomphe du gouvernement représentatif
et des cadres qu’il impose à l’action politique, en particulier la compétition électorale. Les
syndicats, les associations et les partis ouvriers qui apparaissent à la fin du XIXe siècle
comme trois formes distinctes d’organisation ouvrière, constitueraient alors trois solutions à la
tension entre ces deux processus.
Pour mettre à l’épreuve cette hypothèse, je mènerai une analyse socio-historique
localisée en étudiant l’ancrage des organisations et de leurs membres au sein de trois milieux
ouvriers, qui renvoient à trois formes différentes d’organisation du travail : l’imprimerie
parisienne, en particulier la typographie, exemple paradigmatique du monde de l’atelier ;
l’industrie textile, et plus spécifiquement de la soie, à Lyon, organisée autour du modèle de la
fabrique ; les mines du bassin houiller du Nord, notamment celles de la compagnie d’Anzin,
qui relèvent de la grande industrie rurale. Je rendrai ensuite compte des circulations
régionales, nationales et internationales des pratiques et des idées produites localement.
Dans chacun de ces milieux je considérerai trois dimensions de l’organisation
ouvrière, constituant chacune un axe de recherche lié à mon hypothèse générale :
- Les répertoires organisationnels mis en œuvre et la spécialisation progressive des
organisations ouvrières.
- Les caractéristiques sociales des porte-parole et ses effets sur les représentations
collectives de la classe ouvrière.
- Les discours collectifs produits, en lien avec les activités de production,
d’association et de revendication.
CNRS 2015 Samuel Hayat
3
II. Problématique de la recherche
Au cours du XIXe siècle, dans différents pays dont la France, des organisations
(partis, syndicats, associations) entendant parler au nom de la classe ouvrière sont apparues.
Ces organisations ont joué un rôle politique et social majeur au XXe siècle, au point que la
question des raisons de leur émergence a pu sembler ne plus se poser. Aujourd’hui que les
processus de légitimation des organisations ouvrières semblent de moins en moins efficaces et
que l’idée même de classe ouvrière peut paraître dépassée, cette évidence perd aussi de sa
force, faisant naître de nombreuses interrogations. Au moment de leur apparition, par quels
moyens ces organisations légitiment-elles, vis-à-vis des ouvriers, des patrons, des autorités,
cette position de porte-parole ? Alors que les gouvernements représentatifs ne sont censés
reconnaître que les citoyens électeurs, exprimant une opinion individuelle par le bulletin de
vote, comment expliquer l’émergence et le succès de partis se présentant comme ouvriers,
disant en cela représenter un groupe social ? Tandis que ces régimes entendent canaliser
l’action politique par le seul biais de l’élection et des institutions étatiques, comment rendre
compte du développement de syndicats et d’associations qui cherchent à agir au nom de la
classe ouvrière par d’autres moyens que l’action électorale ? Et au fond, quelle est cette
« classe ouvrière » au nom de laquelle ces organisations sont construites et agissent, et qui
par-là contribuent à lui donner forme ?
Ces différentes questions renvoient au problème de la représentation de la classe
ouvrière dans toutes les acceptions de l’expression : les moyens de représentation des
ouvriers, c’est-à-dire les organisations qui agissent et qui répartissent le pouvoir d’agir en
leur nom ; les rapports entre les ouvriers et les institutions du gouvernement représentatif,
notamment la compétition électorale ; les processus de construction symbolique des
représentations collectives de la classe ouvrière. Ce problème a une acuité particulière en
France : dans ce pays qui connaît sous l’Ancien Régime une organisation corporative de la
plupart des métiers, toute forme d’organisation de travailleurs est brutalement interdite en
1791 par la loi Le Chapelier et le décret d’Allarde (Kaplan et Minard 2004). Comment la
classe ouvrière française est-elle représentée entre cette date et l’apparition de syndicats et de
partis ouvriers unifiés, la Confédération générale du travail (CGT) en 1895, la Section
française de l’Internationale ouvrière (SFIO) en 1905 ? Envisagé dans la continuité d’un
travail de thèse sur la représentation politique autour de la révolution de 1848 (A), ce
projet vise à faire la socio-histoire de la représentation de la classe ouvrière française au
XIXe siècle (B), à travers l’exploration de trois axes : la sociologie historique des
répertoires organisationnels ouvriers, la sociologie des porte-parole ouvriers et l’histoire
sociale des pensées collectives ouvrières (C).
A. Genèse du projet
Ce projet s’inscrit dans un parcours de recherche qui m’a mené de l’histoire du
concept de représentation politique pendant la révolution de 1848 (1) à l’histoire sociale de la
classe ouvrière (2).
1. Une histoire de la République démocratique et sociale de 1848
J’ai soutenu en 2011 une thèse de science politique intitulée « Au nom du peuple
français ». La représentation politique en question autour de la révolution de 1848, menée au
LabTop (Université Paris 8), qui a obtenu un prix de thèse de la Chancellerie des Universités
et qui a été publiée en 2014 aux éditions du Seuil. Cette thèse relevait de l’histoire des idées
CNRS 2015 Samuel Hayat
4
en contexte, selon une méthode inspirée de l’Ecole de Cambridge (Skinner 2002), mais
appliquée à des discours profanes (débats parlementaires, articles de journaux, proclamations,
procès-verbaux de séances de clubs, affiches, manifestes, etc.) plutôt qu’à des textes savants
ou philosophiques. En étudiant ces discours, j’entendais saisir, à travers les controverses
autour du concept de représentation au printemps 1848, le processus de construction
antagoniste et l’affrontement de deux conceptions de la République, la République
modérée et la République démocratique et sociale, affrontement qui débouche après l’échec
de l’insurrection de juin 1848 sur le triomphe de la République modérée. Un des apports de
mon travail a été de montrer que la République démocratique et sociale, en tant que doctrine,
était fondée sur des principes opposés à ceux du gouvernement représentatif (Manin 1996) :
une forme de représentation politique plurielle (reposant sur une pluralité d’institutions de
représentation), sociale (prenant en compte les caractéristiques sociales des représentés) et
inclusive (favorisant la participation directe des représentés). J’ai par la suite essayé
d’intégrer cette forme alternative de représentation dans une réflexion plus large sur la
représentation au-delà du gouvernement représentatif, notamment dans le cadre d’un post-
doctorat de sociologie politique sur la représentation et la démocratie participative au
CRESPPA-CSU (Université Paris 8) et d’un groupe de recherche de l’Association française
de science politique, le GRePo.
Cependant, une question restait en suspens : celle des origines de cette conception
alternative de la République dont j’avais vu l’émergence au printemps 1848, et qui était
avant tout portée alors par des travailleurs manuels urbains, se présentant comme ouvriers,
parlant au nom des ouvriers et souvent membres d’organisations définies comme ouvrières.
Comment une pensée politique cohérente, en rupture avec les cadres du gouvernement
représentatif, avait pu être produite par des ouvriers malgré les obstacles à leur activité
intellectuelle et leur séparation apparente avec la sphère de la discussion savante ? Pour
étudier ces idées ouvrières, les méthodes de l’histoire des idées, centrées sur la production
intellectuelle d’auteurs dénombrables et identifiables, écrivant en leur nom propre, sont
insuffisantes. Comme le montrent notamment les écrits d’Alain Cottereau, les idées ouvrières
sont une production intellectuelle collective, conflictuelle et réflexive (Cottereau 1984 ;
Cottereau 2002 ; Cottereau 2006), ancrée dans le monde du travail. Pour retrouver les idées
ouvrières portées par les organisations et leurs membres, il est donc nécessaire de mobiliser
les outils de l’histoire sociale des idées (Pudal 2006 ; Hauchecorne 2013 ; Matonti 2012), ce
qui suppose de s’interroger sur les formes sociales de production et de circulation des
textes. L’utilisation des méthodes de l’histoire sociale des idées pour étudier les pratiques
intellectuelles des ouvriers peut alors permettre d’éviter de reconduire le partage
« légitimiste » entre une histoire intellectuelle centrée sur le monde savant et une histoire
sociale inattentive aux idées ouvrières (Grignon et Passeron 1989 ; Pudal 1991).
Pour comprendre le processus de construction d’une conception ouvrière de la
représentation, je cherche donc actuellement à rendre compte, dans une perspective d’histoire
sociale des idées, de la genèse des idées politiques des ouvriers organisés, sur le temps long
et en les inscrivant dans leurs conditions sociales d’émergence et de circulation.
Commencée dans le cadre d’un séjour en tant que Visiting Fellow à l’Université Queen Mary
de Londres, sous la direction de Gareth Stedman Jones, puis prolongée actuellement dans un
post-doctorat au laboratoire Histoire des technosciences en société du Conservatoire national
des arts et métiers, cette recherche, qui est au fondement du projet présenté ici, a donc
consisté à tenter de reconstruire les pratiques ouvrières dans lesquelles la République
démocratique et sociale trouvait son origine et son sens.
CNRS 2015 Samuel Hayat
5
2. Une nouvelle histoire sociale de la classe ouvrière
Ainsi, la poursuite de mon travail sur l’histoire des idées républicaines en 1848 m’a
amené à rencontrer, à partir d’une approche de science politique, le programme de l’histoire
sociale de la classe ouvrière (Noiriel 1989 ; Eley 1992 ; Berlanstein 1992 ; Welskopp 2002 ;
Jarrige 2012). Jusqu’aux années 1960, l’histoire de la classe ouvrière était fractionnée en
deux corpus séparés. D’un côté, une histoire largement focalisée sur le mouvement ouvrier
organisé faisait la part belle aux chefs politiques de stature nationale et internationale, ainsi
qu’aux théories et aux théoriciens socialistes (Droz 1972). D’un autre côté, une histoire
économique empruntait ses méthodes à la sociologie quantitative, focalisée sur la production,
l’échange et la consommation des ouvriers (Halbwachs 2011)1. Leur cloisonnement était
étanche : l’histoire « par en bas » était économique, l’histoire « par en haut » était
politique. Cette séparation était largement due à l’importance du marxisme en histoire
sociale : dans la perspective des marxistes, la classe en soi est exclusivement définie par sa
position objective dans les rapports de production ; quant à l’apparition d’une classe pour soi,
elle résulte d’une prise de conscience subjective avant tout guidée par des penseurs et des
savoirs situés en dehors du monde ouvrier lui-même (Marx 1982, 397).
La publication, en 1963, de l’ouvrage d’Edward Palmer Thompson sur la classe
ouvrière anglaise, a provoqué un profond renouvellement de cette question, donnant naissance
à ce que l’on a appelé la new social history, la nouvelle histoire sociale (Thompson 1963)2.
E.P. Thompson, tout en s’inscrivant dans le marxisme, montre que l’apparition d’une
conscience de classe chez les ouvriers anglais résulte avant tout des transformations de la
culture ouvrière face à des bouleversements politiques et sociaux. Appliqué au cas
français, ce tournant historiographique a donné lieu à de nombreux travaux (Cottereau 1986 ;
Noiriel 1986 ; Perrot 1986 ; Dewerpe 1989 ; Magraw 1992). Ceux-ci ont montré le rôle dans
la formation de la classe ouvrière française des ouvriers de métier (c’est-à-dire des
travailleurs partageant des savoirs techniques spécifiques, souvent artisanaux), généralement
organisés dans des dispositifs issus du monde corporatif (Bernard H. Moss 1985 ; Sewell
1983). Cette focalisation sur le monde des ouvriers de métier et leurs transformations a induit
un intérêt spécifique pour les multiples structures coopératives et mutualistes (Desroche
1981 ; Dreyfus 2001), pour les luttes au sein du monde artisanal (J. W. Scott 1974 ; Stewart
1984 ; Gourden 1992) et pour les interactions entre les artisans et le prolétariat industriel
naissant (Hanagan 1980 ; Cottereau 2004). Le projet présenté ici consiste à reprendre les
méthodes et les résultats de la nouvelle histoire sociale pour répondre à la question de la
genèse des conceptions ouvrières de la représentation.
B. Pour une histoire de la représentation de la classe ouvrière
En appliquant les méthodes de la nouvelle histoire sociale au problème de l’origine de
la conception ouvrière de la représentation, émerge l’hypothèse qui se trouve au fondement du
présent projet de recherche : cette conception de la représentation, qui s’incarne par
exemple en 1848 dans l’idée de République démocratique et sociale, trouve son origine dans
les pratiques concrètes de représentation mises en œuvre par les ouvriers de métiers,
notamment dans les organisations au sein desquelles ces derniers distribuent le droit à parler
1 Sur l’importance de l’histoire économique quantitative pour les historiens français, voir la préface à la seconde
édition de (Perrot 2001). 2 Cet ouvrage a été traduit en français en 1988, et a fait l’objet d’une réédition en poche en 2012 : (Thompson
2012) Pour une introduction, voir les textes rassemblés dans (Kaye et McClelland 1990)
CNRS 2015 Samuel Hayat
6
et à agir en leur nom. Mais de la même manière que la classe ouvrière anglaise est née d’une
rencontre entre une culture populaire traditionnelle et une culture politique qui lui était
initialement extérieure, la conception ouvrière de la représentation en France serait le résultat
du croisement, peut-être conflictuel, entre deux éléments : les formes de représentation et
d’organisation des ouvriers de métier et les modes de représentation politique qui
s’imposent en France après la Révolution, et que l’on peut désigner sous le concept de
gouvernement représentatif (Manin 1996).
Selon cette hypothèse, la construction de la conception ouvrière de la représentation
est directement liée aux transformations des pratiques de représentation des ouvriers :
l’histoire des idées ouvrières sur la représentation est indissociable de l’histoire des
pratiques de représentation des ouvriers, c’est-à-dire ici des formes d’organisation par
lesquelles les ouvriers sont représentés. Dans cette recherche, je souhaite explorer les
processus par lesquels les formes de représentation des ouvriers de métier, issues du
monde corporatif, se diffusent au-delà des corps d’état et se transforment dans
l’interaction avec les institutions du gouvernement représentatif, en évitant ainsi les deux
écueils opposés d’une surestimation culturaliste de la cohérence et de la continuité des formes
d’organisation des ouvriers (Judt 1986 ; B. H. Moss 1993), et d’une réduction du processus à
un simple « apprentissage » par les ouvriers des procédures du gouvernement représentatif
supposément hégémonique.
La perspective de ce projet de recherche, inspirée notamment des subaltern studies, est
donc d’étudier les conditions matérielles, institutionnelles et intellectuelles qui rendent
possibles le maintien et les transformations de certaines formes d’organisation issues du
monde des ouvriers de métier dans le contexte nouveau de la France post-
révolutionnaire où les formes de représentation connaissent un processus d’unification
autour de l’élection à intervalles réguliers de gouvernants indépendants de leurs électeurs.
Pour reprendre une expression de Ranajit Guha, on peut concevoir la situation des ouvriers au
XIXe siècle comme une « domination sans hégémonie » (Guha 1997) : malgré des obstacles
multiples à leur émergence et malgré la prééminence, dans l’espace public, de formes
d’organisation adaptées au gouvernement représentatif et soutenues par de multiples discours
savants, des pratiques ouvrières (d’organisation, de lutte, de savoir…) existent, et il est
possible d’en retrouver les traces dans les textes collectifs produits par les ouvriers
(règlements d’association, pétitions, manifestes, etc.). Ces pratiques et les idées qui en
découlent ont une certaine autonomie, toujours partielle et précaire, et elles peuvent dans
certaines circonstances (faiblesse des institutions, crises politiques, transformations
structurelles…) mettre en péril les visées hégémoniques des institutions et des discours
dominants. Ces pratiques sont indissociables des formes de domination qui les contraignent,
mais elles ne s’y réduisent pas, et sont prises dans un rapport dialectique dont la dynamique
doit être reconstituée historiquement.
En mettant ces pratiques au centre de l’étude, je tenterai d’opposer à l’image du XIXe
siècle comme moment d’« apprentissage » des procédures du gouvernement représentatif par
les travailleurs, selon le modèle de la « descente de la politique vers les masses » (Agulhon
1979), un autre récit : celui de la lutte entre deux façons de penser la représentation
ancrées dans des mondes différents, en lien avec des pratiques différentes et des « styles de
groupe » (Eliasoph et Lichterman 2003) dont le contenu reste à élucider. De cette manière, je
pourrai aborder de façon nouvelle la question de la politisation des classes populaires
(Lagroye 2003 ; Aït-Aoudia, Bennani-Chraïbi et Contamin 2011 ; Schwartz s.d.), en montrant
que les formes de politisation qui relèvent de l’opération électorale et de la politique
institutionnelle (Offerlé 1984 ; Offerlé 1989 ; Guionnet 1997 ; Hincker 1997 ; Offerlé 2007 ;
Déloye et Ihl 2008 ; Ihl 2010), sont en tension constante avec d’autres modes de politisation,
CNRS 2015 Samuel Hayat
7
relevant notamment de traditions issues du monde des ouvriers de métier. En cela, cette
recherche pourra contribuer aux travaux contemporains de théorie politique sur la
représentation politique au-delà de l’élection et sur la représentation des groupes
dominés (Phillips 1995 ; Mansbridge 1999 ; Urbinati et Warren 2008 ; Saward 2010), en
prenant en compte pour cela les pratiques et la production intellectuelle, souvent collective,
des travailleurs.
Ce projet entend se concentrer d’abord sur la France du XIXe siècle, où la question
de la représentation des ouvriers se pose de façon spécifique. En effet, dans la France
d’Ancien Régime, le système corporatif, hiérarchisé et relativement autonome, encadre
strictement l’existence collective des travailleurs. Puis, en 1791, l’interdiction brutale des
corporations, par les lois Le Chapelier et d’Allarde, prive les travailleurs de toute existence
collective légale. De ce fait, le cadre des corps d’état, qui encadrait juridiquement,
socialement et symboliquement l’activité et l’identité même des travailleurs autour du métier,
perd son évidence. Le métier n’est plus le cadre unique par lequel les travailleurs
s’organisent et se pensent, ce qui ouvre la possibilité d’une reformulation du sujet ouvrier
lui-même. Cette situation amène les ouvriers de métier (mais qui ne sont justement plus aussi
évidemment que sous l’Ancien Régime des ouvriers avant tout de métier), sur leur lieu de
travail, au sein d’espaces de sociabilité hérités du monde corporatif, en lien avec des formes
traditionnelles de protestation, à réfléchir collectivement sur les formes d’organisation les
plus adaptées pour échapper aux contraintes juridiques liées à l’interdiction des corporations,
pour s’adapter aux transformations économiques et techniques ou pour faire valoir leurs
intérêts et leurs droits – c'est-à-dire à développer ce que Luc Boltanski appelle des activités
« métapragmatiques » (Boltanski 2009). Les syndicats, les associations et les partis ouvriers
qui apparaissent à la fin du XIXe siècle comme trois formes distinctes de représentation de la
classe ouvrière, constitueraient alors trois solutions à une même tension entre deux processus
largement contradictoires : d’un côté, la diffusion de formes d’organisation, de dispositions et
de discours issus du monde des ouvriers de métier ; d’un autre côté, l’adaptation au
triomphe du gouvernement représentatif libéral et des cadres qu’il impose à l’action
politique, en particulier la compétition électorale.
L’étude de ces transformations des formes d’organisation et de représentation ouvrière
permettra de reprendre à nouveaux frais le problème des représentations collectives de la
classe ouvrière elle-même. En effet, comme le remarque Pierre Bourdieu, c’est « le porte-
parole qui fait le groupe. C’est parce que le représentant existe, parce qu’il représente (action
symbolique), que le groupe représenté, symbolisé, existe et qu’il fait exister en retour son
représentant comme représentant d’un groupe. » (Bourdieu 1984a, 49) Dès lors, l’étude des
organisations parlant et agissant au nom des ouvriers est une entrée privilégiée pour saisir le
travail d’institution de la classe ouvrière comme sujet politique et, de manière corollaire,
la construction symbolique des représentations collectives de ce qu’est la classe ouvrière
(Boltanski 1982). Les transformations des formes de représentation des ouvriers sont alors
indissociables du processus de définition même de la classe ouvrière, en interaction avec les
autres discours sur les ouvriers, produits à partir d’une position extérieure aux mondes du
travail.
C. Axes de recherche
A quel niveau saisir ce processus de reformulation par les ouvriers d’une culture
de métier préexistante, dans un rapport dialectique avec le processus d’imposition du
gouvernement représentatif ? Le choix fait dans le cadre de ce projet, en adéquation avec la
perspective de la nouvelle histoire sociale, sera d’étudier ces transformations au plus près de
CNRS 2015 Samuel Hayat
8
l’expérience ouvrière, dans le cadre d’une analyse localisée du politique (Sawicki et Briquet
1989). Pour cela, je développerai mes questions de recherche sur trois terrains, la typographie
parisienne, la soierie lyonnaise, l’industrie minière du Nord. Le choix de ces trois milieux
vient de leur caractère fortement différencié, dans leur implantation (entièrement urbaine pour
les typographes parisiens, à cheval entre la ville et ses environs pour la soierie lyonnaise, et
entièrement rurale dans les mines du Nord), dans la place accordée aux ouvriers de métier
(très majoritaires dans l’imprimerie à Paris, prééminents mais interagissant avec des ouvriers
et surtout des ouvrières non qualifiées à Lyon, minoritaires dans les mines du Nord) comme
dans les formes d’organisation qui y sont mises en œuvre (organisation unitaire chez les
typographes, multitude de sociétés de secours mutuel chez les canuts lyonnais, pas
d’organisation indépendante officielle dans les mines du Nord jusqu’à la Troisième
République). Pour étudier ces terrains, je m’inspirerai des travaux de sociologie politique qui
étudient l’encastrement local des partis (Sawicki 1988 ; Sawicki 1994 ; Mischi 2003), les
rapports entre les partis et les groupes qu’ils prétendent représenter (Lefebvre 2006 ; Mischi
2007 ; Mischi 2010) et la pluralité des organisations, des formes d’engagement et des
reconversions possibles dans un milieu donné (Lacroix 1981 ; Schöttler 1981 ; Tissot,
Gaubert et Lechien 2005 ; Bereni 2006). Cependant, si la question première sera bien celle
des transformations locales d’organisations issues du monde corporatif, je m’intéresserai
ensuite aux circulations nationales et internationales des pratiques et des savoirs produits
localement, pour rendre compte du processus par lequel des expériences éparses peuvent
s’agréger en différents modèles de représentation ouvrière, distincts à la fois des organisations
corporatives et du gouvernement représentatif, et eux-mêmes pluriels.
Dans cette perspective, je commencerai par m’interroger sur les organisations
ouvrières elles-mêmes, telles qu’elles se constituent à partir du monde des ouvriers de métier,
en essayant de rendre compte des transformations des répertoires organisationnels mis en
œuvre (1). Dans un second temps, j’essaierai de saisir les tensions entre les normes issues du
monde corporatif et les normes du gouvernement représentatif à travers une sociologie des
porte-parole ouvriers (2). Enfin, retrouvant en cela le projet initial issu de ma thèse, à savoir,
saisir la genèse des conceptions ouvrières de la représentation, je réaliserai une histoire
sociale des idées développées dans les discours de ces organisations et de leurs membres (3).
1. Sociologie historique des répertoires organisationnels ouvriers
Le premier axe de cette recherche portera sur les transformations du « répertoire
organisationnel » (Clemens 1993) du mouvement ouvrier français. Le concept de
répertoire organisationnel, qui fait écho à celui de répertoire d’action (Tilly 1984), désigne
les formes d’organisation disponibles et mises en œuvres par les ouvriers organisés. En
mettant l’accent sur les pratiques organisationnelles et sur les réflexions sur ces pratiques, cet
outil permet de mettre en regard les transformations des règlementations des organisations
ouvrières (Leroy 1913), les modifications du cadre juridique de ces organisations (Didry
2009) et les politiques publiques de surveillance, de contrôle et de répression des « classes
dangereuses » successivement mises en œuvre par l’Etat (Faure 1990 ; Faure 1987 ; Chevalier
2002). Il permet aussi d’intégrer la question de l’organisation dans l’histoire des répertoires
d’action du mouvement ouvrier en constitution, comme le bris de machine (Jarrige 2009), la
manifestation (Favre 1990 ; Robert 1996 ; Fillieule 1997 ; Fillieule et Tartakowsky 2008), la
barricade (Corbin et Mayeur 1997 ; Harsin 2002 ; Traugott 2010), le banquet (Robert 2010),
le meeting (Cossart 2010), la grève (Aguet 1954 ; Shorter et Tilly 1974 ; Perrot 2001 ; Chueca
2008), etc.
CNRS 2015 Samuel Hayat
9
L’arrière-fond général de cet axe de recherche sera l’hypothèse de l’existence d’un
processus de long terme de spécialisation des répertoires organisationnels, passant de la
grande diversité des formes d’organisation ouvrière au début du XIXe siècle (corporations, compagnonnages, sociétés de secours mutuel mais aussi sociétés secrètes,
associations de consommation ou de production, l’ensemble étant souvent organisé par
métiers et par zone géographique) à ce qui peut apparaître, au début du XXe siècle, comme
une fixation de la représentation ouvrière légitime autour des trois structures
concurrentes que sont les partis, les associations et les syndicats (Huard 1996 ; Soubiran-
Paillet 1999)3 – fixation jamais totalement réalisée, et dont il faudra saisir les ratés, les
brèches, les exceptions. La mise à l’épreuve de cette hypothèse passera par l’exploration
d’une série de questions : comment ces différents types d’organisation se définissent-ils
progressivement au cours du siècle ? Comment évoluent-ils avec la transformation des
différents espaces locaux auxquels appartiennent les travailleurs – lieux de sociabilité
(Agulhon 1977 ; Agulhon 1988 ; Clavier 2006), lieux de travail, mais aussi espaces
domestiques (Lynch 1988 ; Kok 2002) –, avec les changements des conditions juridiques,
sociales et politiques des relations de travail (Castel 1995) et avec la circulation
internationale des pratiques organisationnelles, surtout à partir de la création de la première
Internationale (Katz 1992 ; Archer 1997 ; Cordillot 2010 ; Léonard 2011)4 ? Enfin, pour
mettre à l’épreuve notre hypothèse générale d’un croisement, dans les organisations ouvrières,
entre les formes de représentation des ouvriers de métier et les institutions du gouvernement
représentatif, quel rapport particulier à la représentation politique est mis en œuvre dans
les partis qui intègrent le jeu parlementaire (Offerlé 1989), dans les syndicats qui se
spécialisent dans la représentation professionnelle (Rosanvallon 1987 ; Karila-Cohen et
Wilfert 1998 ; Béroud, Le Crom et Yon 2013) et dans les associations (mutuelles, bourses du
travail, associations d’éducation populaire…) qui développent des répertoires d’actions
relevant plutôt d’un modèle « éducationniste-réalisateur » (Manfredonia 2007) ?
2. Sociologie des porte-parole ouvriers
Le deuxième axe de ce projet porte sur les membres des organisations ouvrières et
les personnes qui occupent des positions de porte-parole au sein de ces organisations. Au
cours du XIXe siècle, les transformations des organisations vont-elles de pair avec une
modification dans la composition du groupe des porte-parole autorisés des ouvriers ? La
question est d’autant plus importante pour l’étude de la représentation de la classe ouvrière
que les caractéristiques sociales des représentants ont une influence sur les
représentations collectives des caractéristiques du groupe (Bourdieu 1981 ; Bourdieu
1984b). En particulier, l’exclusion des femmes, qui constituent pourtant un tiers des
travailleurs industriels tout au long du XIXe siècle, a des effets sur la construction de la
définition de l’identité ouvrière (J. W. Scott 1984 ; J. Scott 1988 ; McMillan 2000 ; Harden
Chenut 2005), tout comme la sous-représentation des travailleurs ruraux et des travailleurs
non qualifiés. Systèmes corporatif comme représentatif donnent une certaine image du monde
ouvrier, dont certaines portions sont mises à l’honneur et d’autres, invisibilisées. Si le monde
3 On peut faire l’hypothèse qu’il existe une continuité entre l’homogénéisation du répertoire organisationnel et
l’homogénéisation du répertoire d’action des mouvements sociaux dans son ensemble. Sur la pluralité des
formes d’action au XIXe siècle – et sa réduction progressive – voir (Tilly, Tilly et Tilly 1975 ; Tilly 1986 ;
Calhoun 1993 ; Tilly 2006). 4 Pour une perspective d’histoire connectée du mouvement ouvrier, voir les publications liées à Marcel van der
Linden et à l’International Institute of Social History d’Amsterdam, par exemple (Holthoon et Linden 1988 ;
Linden et Thorpe 1990 ; Linden et Rojahn 1990 ; Linden 2008a ; Linden 2008b). En français, voir (Devin 1990 ;
Wolikow et Cordillot 1993).
CNRS 2015 Samuel Hayat
10
corporatif est organisé par les différences de statut, le gouvernement représentatif est fondé
sur le principe d’égalité entre les individus (masculins) électeurs – ce qui n’empêche pas le
maintien d’un principe de distinction, voire d’un « cens caché » dans le processus de sélection
des représentants (Gaxie 1978). L’hypothèse d’une rencontre entre les logiques issues du
monde des ouvriers de métier et celles du gouvernement représentatif permet-elle de
rendre compte de la composition des organisations ouvrières et des caractéristiques de
leurs responsables ? Les organisations qui intègrent le jeu du gouvernement représentatif
développent-elles les mêmes formes de distinction que les autres partis politiques, et quel type
de sélection a lieu dans les autres organisations ? Pour le savoir, je mènerai une analyse
prosopographique sur une population large d’ouvriers organisés, pour ensuite la croiser
avec la sélection d’un certain nombre de trajectoires de dirigeants d’organisations
ouvrières.
Cette perspective ouvre plusieurs questions : est-ce que les ouvriers de métier ont vu
leur place parmi les travailleurs se modifier suite aux transformations des formes
d’organisation des travailleurs ? Peut-on observer au cours du siècle un processus de
spécialisation et de professionnalisation de la fonction de porte-parole ouvrier ? Ce
processus est-il distinct selon le type d’organisation considérée ? La différenciation entre
syndicats, partis et associations va-t-elle de pair avec l’émergence d’autres groupes en
dehors des ouvriers de métier (ouvriers non qualifiés, penseurs professionnels, employés…)
parmi les dirigeants des organisations ouvrières ? Dans quel type d’organisation les
travailleurs généralement exclus du monde des ouvriers de métier, en particulier les
femmes, mais aussi les travailleurs ruraux et les travailleurs non qualifiés, peuvent-ils accéder
à des positions de représentation ?
3. Histoire sociale des pratiques intellectuelles ouvrières
Enfin, le dernier axe de ce projet de recherche vise à définir l’effet de la
transformation des organisations issues du monde des ouvriers de métier sur la « parole
ouvrière » (Rancière et Faure 2007), pour mettre en lumière la construction, à partir de
l’activité même d’organisation des ouvriers, de conceptions ouvrières de la représentation. En
particulier, on cherchera à mettre à l’épreuve l’hypothèse de l’existence d’une tradition de
pensée spécifiquement ouvrière, fondée sur la réinterprétation des cadres corporatifs à l’aune
des principes démocratiques post-révolutionnaires, capable de constituer une forme de
socialisme distincte du socialisme savant qui triomphe au XXe siècle. La question de la
représentation se double ici d’une question épistémologique : le triomphe du gouvernement
représentatif est-t-il concomitant de la promotion d’une figure purement individuelle du
savant, de l’auteur, du penseur, par opposition aux formes collectives de savoir du monde
corporatif ? La tension entre les formes de représentation issues du monde corporatif et celles
mises en œuvre par le gouvernement représentatif est-elle liée à une opposition entre les
savoirs des ouvriers de métier et les savoirs savants sur les ouvriers, produits en dehors
du monde du travail ?
Cette opposition entre les savoirs individuels et collectifs s’observe dans différents
domaines de connaissance liés au monde ouvrier (Hilaire-Pérez 2000 ; Caron 2010). Au plus
près de l’activité de travail, une partie des pratiques intellectuelles des ouvriers organisés
concernent le processus de production lui-même. Sous l’Ancien Régime, les règles corporées
définissaient strictement les modes de transmission des savoirs liés au travail, en particulier
dans les métiers jurés. Au XIXe siècle, de nouvelles institutions de codification et de
transmission des savoirs professionnels apparaissent, par exemple le Conservatoire des arts
CNRS 2015 Samuel Hayat
11
et métiers5. La maîtrise de la production et de la transmission des savoirs devient de ce fait un
enjeu central des organisations ouvrières, face à l’apparition de modes de qualification
excluant les idées ouvrières des savoirs techniques légitimes. Deuxième domaine, l’activité
d’organisation, dont les cadres ont été radicalement modifiés par la Révolution puis ne
cessent de se transformer au cours du XIXe siècle, est elle-même l’objet de réflexions portant
sur les normes qui doivent régler les pratiques de représentation des ouvriers. Enfin, un
troisième ensemble d’idées ouvrières portent sur les revendications. Sur ce plan, le conflit
principal au XIXe siècle a pour enjeu le rôle des travailleurs manuels dans la définition de
leur horizon d’action. L’apparition au sein des mouvements ouvriers de penseurs
professionnels, monopolisant la production doctrinale, transforme radicalement la définition
même du champ des revendications ouvrières. La perspective révolutionnaire ouverte par ces
penseurs (des concepteurs d’utopie aux socialistes dits scientifiques) tout à la fois ouvre
l’horizon des possibles pour les revendications ouvrières et participe à la dépossession des
ouvriers – posant la question de la construction du rôle des « intellectuels » au sein des
organisations ouvrières (Matonti 2005 ; Lomba et Mischi 2013).
L’hypothèse générale qui parcourt cet axe du projet de recherche sera celle de la
tension, dans les pratiques intellectuelles ouvrières, entre deux types d’idées. D’une part, des
idées et des savoirs valorisent l’identité de métier, passant par la revendication de la maîtrise
des savoirs techniques et par la volonté de privilégier des formes fédéralistes d’organisation et
de lutte laissant leur autonomie aux ouvriers de différents métiers. D’autre part, des idées sont
centrées sur la construction d’une identité ouvrière commune définie comme celle du
prolétariat, « une classe qui soit la dissolution de toutes les classes » (Marx 1998, 37), allant
de pair avec l’invisibilisation des lignes de fractures et des rapports de domination qui
traversent le monde du travail (la division de genre, les distinctions de statut, l’opposition
entre monde rural et monde urbain, entre travailleurs français et étrangers, etc.). Cette
invisibilisation a des effets ambivalents : elle est indissociablement le moyen par lequel sont
créées des « chaînes d’équivalence » au-delà des barrières d’appartenance sociale (Laclau
et Mouffe 2001) et une voie par laquelle s’opère la réduction de la diversité du monde ouvrier
et donc une minoration des savoirs ancrés dans une connaissance pratique du métier.
Comment cette dichotomie s’articule-t-elle avec la tension entre les formes de représentation
du monde corporatif et celles du gouvernement représentatif ? Quelle place est donnée aux
savoirs ouvriers dans les différents types d’organisation de travailleurs ? Quelles formes
prennent les productions des travailleurs, et quelle est leur réception, au sein des organisations
et au-delà ? Cette dernière série de questions permettra de rendre compte de la production
intellectuelle des ouvriers organisés et de leur contribution, généralement minorée, à l’histoire
des idées politiques.
5 Les pratiques d’enseignement au Conservatoire des arts et métiers sont l’objet de ma recherche postdoctorale
en cours au sein du laboratoire Histoire des technosciences en société du Cnam.
CNRS 2015 Samuel Hayat
12
III Mise en œuvre de la recherche
Pour mener à bien ce projet de recherche, j’étudierai l’ancrage des organisations, des
porte-parole et des idées des ouvriers au sein de trois milieux qui renvoient à trois formes
différentes d’organisation du travail, puis je m’intéresserai aux organisations se situant à des
échelles plus larges (A). J’adopterai pour cela une approche pluridisciplinaire (B). Ce
travail se déroulera sur quatre ans (C) et pourra s’inscrire dans différents laboratoires de
recherche (D).
A. Terrains
Ce projet de recherche vise à explorer la question de la formation, du contenu et des
effets des idées ouvrières à partir de trois terrains déterminés : l’industrie de l’imprimerie à
Paris et notamment le milieu des typographes (1) ; le textile à Lyon, qui est largement
dominé par le secteur de la soie (2) ; les mines de charbon du Nord, et plus particulièrement
la Compagnie d’Anzin (3) ; enfin, je m’intéresserai aux circulations régionales, nationales
et internationales à partir de ces espaces locaux (4).
1. L’industrie du livre à Paris
Le milieu des ouvriers d’imprimerie (ou ouvriers du livre) à Paris constitue un
exemple paradigmatique du monde de l’atelier (Chauvet 1964 ; Rebérioux 1981).
L’imprimerie est une industrie de taille moyenne, la cinquième à Paris, employant environ dix
fois moins de personnes que la première, le textile. Elle connaît néanmoins un grand
développement au XIXe siècle, passant de 4 500 ouvriers en 1807 à 35 000 en 1901
(Laroulandie 1997, 5)6. Ce milieu professionnel est initialement très masculin, mais connaît
une féminisation croissante au cours du siècle. Les différences de statut entre métiers
(typographes, protes, correcteurs, imprimeurs/conducteurs, margeurs, fondeurs, imprimeurs
en taille-douce, lithographes et relieurs) y sont importantes au début du XIXe siècle mais
perdent progressivement en force, notamment du fait de l’introduction des machines (presses
mécaniques au début du siècle, puis rotatives autour des années 1860 et enfin linotypes à la
fin du siècle) (Jarrige 2007). Ce milieu est pris dans des circuits industriels courts faisant
peu intervenir les travailleurs ruraux. Enfin, les ouvriers y ont un rapport spécifique à
l’écrit, comme en témoigne le nombre d’hommes de lettres venus de ce milieu (notamment
les théoriciens socialistes Pierre Leroux et Proudhon, l’historien Michelet, le chansonnier
Béranger). Héritière d’une forte tradition de métier née sous l’Ancien Régime, l’imprimerie
parisienne connaît au long du siècle de multiples formes d’organisation, la plus importante
étant la Société typographique, fondée en 1830 et qui se fond dans la Fédération française
des travailleurs du livre (FFTL) puis dans la Confédération générale du travail (CGT) à la fin
du XIXe siècle.
2. La soierie lyonnaise
L’industrie textile à Lyon, organisée autour du modèle de la fabrique, est dans une
situation tout à fait différente de l’imprimerie parisienne. D’abord, c’est de loin la plus
importante industrie de la ville, et elle est entièrement concentrée, en tout cas au début du
XIXe siècle, sur la seule production de la soie (Bezucha 1974 ; Sheridan 1981 ; Stewart
6 Sur les ouvriers de Paris, voir aussi (Gossez 1968 ; Gaillard 1997 ; Gould 1995 ; Berlanstein 1984).
CNRS 2015 Samuel Hayat
13
1984 ; Frobert 2009). En 1789, sur 120 000 habitants à Lyon, 40 000 dépendent directement
de cette activité (Cottereau 2004, 101). Il s’agit d’une industrie très féminisée (plus de la
moitié des ouvriers sont des femmes), mais où les différences de statut créent une division du
travail très sexuée7. Loin d’être entièrement concentrée dans l’atelier où s’effectue le tissage,
la fabrique de la soie mobilise largement des travailleurs hors de la ville, pour un ensemble
d’activités annexes, notamment l’apprêt et la teinture, reléguées dans l’espace rural. C’est une
industrie de luxe, florissante au début du XIXe siècle, qui connaît un fort développement avec
l’ouverture des marchés, notamment anglais, et repose majoritairement sur l’exportation
(Lequin 1977, 65). Cependant, elle connaît une grave crise en 1877, dont elle ne se relèvera
jamais : l’essaimage de la fabrique vers d’autres communes, la mécanisation du métier,
l’apparition de la maladie du ver à soie et le développement de la production étrangère
(Rothstein 2002) aboutissent à la disparition de la fabrique de soie lyonnaise au début du XXe
siècle. C’est un milieu ouvrier caractérisé par une organisation précoce et constante,
structuré en de multiples groupes traditionnels de solidarité et de coopération et dominé
par les canuts, les chefs d’ateliers (Frobert 2009).
3. Bassin minier du Nord
Ce troisième et dernier terrain, contrairement aux deux premiers, n’est pas directement
lié à une ville, mais à un département, le Nord (Gillet 1973 ; Debrabant et Dumont 2007).
L’industrie minière d’extraction de charbon se déploie en effet géographiquement sur des
territoires ruraux, progressant à mesure que des gisements s’épuisent et que d’autres sont
découverts. Bien qu’il soit exploité de longue date, le bassin minier du Nord prend toute
son importance au milieu du XIXe siècle, notamment du fait de la découverte des gisements
du Pas-de-Calais voisin. A partir de 1860, le Nord-Pas-de-Calais constitue ainsi le premier
bassin houiller de France, devant celui de la Loire. Comparée à la typographie parisienne et à
la soierie lyonnaise, l’exploitation minière relève clairement de la grande industrie. Le
milieu ouvrier est très masculin parmi les travailleurs du fond, mais les travaux de jour
connaissent une féminisation croissante – même si elle reste relative. Les travailleurs exercent
des métiers divers au service d’une activité productive unifiée et centralisée. Les travaux de
fond mettent en jeu mineurs creusant la roche, piqueurs et abatteurs exploitant la veine – avec
l’aide de boiseurs, de raccommodeurs et de remblayeurs dans la deuxième partie du siècle, et
traîneurs (ou ercheurs) puis rouleurs, ouvriers subalternes transportant le charbon. Les travaux
de jour, autour de la mine, rassemblent ouvriers des corps d’état (forgerons, menuisiers,
charpentiers, charrons, bourreliers), machinistes, chauffeurs, manœuvres, etc. La définition de
ces métiers, leur qualification, les salaires qui y sont associés et les solidarités qui peuvent se
créer au-delà des barrières professionnelles sont des questions cruciales tout au long de la
période, en particulier dans les industries faisant intervenir des travailleurs de nombreux
métiers. L’activité minière dans le bassin du Nord est dominée par la Compagnie d’Anzin,
fondée en 1757. Elle est dirigée depuis la Révolution par des financiers conservateurs,
notamment Casimir Perier, qui en prend la direction dans les années 1820. Si elle est
concurrencée puis dépassée en taille par les nouvelles compagnies créées durant le second
XIXe siècle pour exploiter les ressources du Pas-de-Calais, elle reste tout au long de la
période un acteur central. Milieu faiblement organisé de façon officielle jusqu’à l’apparition
du syndicalisme, il connaît une tradition gréviste importante qui se transmet de façon
informelle.
7 On pourra ici comparer utilement avec d’autres études sur les femmes dans l’industrie textile, notamment
(Coffin 1996)
CNRS 2015 Samuel Hayat
14
4. Espaces de circulation
Si les organisations des ouvriers de métier, qui constituent le point de départ
chronologique de cette recherche, sont principalement ancrées dans des espaces locaux, des
formes de circulation des travailleurs (et avec eux des répertoires organisationnels et des
idées) existent dès l’Ancien Régime. Je m’intéresserai en particulier aux formes
d’organisation régionales, nationales et internationales qui se donnent comme objectif
explicite d’être des lieux de coordination des ouvriers de différents métiers et de différentes
localités. En premier lieu, j’étudierai les sociétés compagnonniques post-révolutionnaires :
leur caractère secret a permis un maintien, là où les corporations n’existaient que parce
qu’elles avaient un pouvoir légalisé de contrainte et d’organisation. De ce fait, les devoirs
compagnonniques jouent un rôle de premier plan dans la première moitié du XIXe siècle,
d’autant que les projets d’union des différents devoirs sont parmi les premières tentatives pour
constituer des organisations ouvrières unifiées (Perdiguier 1840 ; Coornaert 1966).
Deuxièmement, je me focaliserai sur les formes de coordination entre organisations locales
(partisanes, syndicales, associatives…) qui se mettent en place brièvement à l’occasion de la
révolution de 1848 puis qui s’institutionnalisent sous le Second Empire et la Troisième
République : si ces organisations sont au cœur du présent projet de recherche, je les étudierai
avant tout comme lieux de circulation de répertoires organisationnels, de militants et d’idées
dont j’aurai restitué le mode de formation local. Enfin, je me concentrerai sur les canaux
transnationaux de circulation et de solidarité ouvrières qui se mettent en place dans la
deuxième partie du XIXe siècle, notamment autour des expositions universelles, en accordant
une place particulière à l’Association internationale des travailleurs.
B. Méthodes et sources
La démarche de ce projet sera résolument pluridisciplinaire (1). Elle s’appuiera sur
l’exploitation de sources de différentes natures, localisées dans plusieurs centres
d’archives en France et en Europe (2).
1. Une démarche pluridisciplinaire
L’étude de la représentation ouvrière proposée ici se situant à la fois au niveau des
organisations, de leurs membres et des idées qu’ils portent, l’application des différentes
questions de recherche aux terrains choisis supposera une démarche pluridiscipinaire,
empruntant à la sociologie historique des organisations, à la sociologie du militantisme et à
l’histoire sociale des idées.
Pour rendre compte des transformations des manières dont s’organise la prise de
parole en tant qu’ouvrier ou au nom des ouvriers dans les trois milieux étudiés, je
commencerai par répertorier, dans chacun de ces milieux, les différentes organisations
ouvrières dans lesquelles une parole ouvrière se formule, pour arriver à construire une
typologie des répertoires organisationnels ouvriers. Chacun des milieux ouvriers
considérés connaît des formes organisationnelles spécifiques : domination de la Société
typographique dans le cas de l’imprimerie parisienne, associations traditionnelles de solidarité
et de coopération des canuts à Lyon, absence d’organisation officielle dans les mines du Nord.
Tout l’enjeu sera de mettre en lumière, à partir d’une analyse en termes de répertoire
organisationnel, des continuités, des emprunts, des transformations et des spécialisations
menant à l’apparition de partis, de syndicats et d’associations – quitte à affiner cette typologie
CNRS 2015 Samuel Hayat
15
pour différencier entre organisations à l’intérieur d’un même type. Pour ce faire, je porterai
une attention particulière au corpus des règlements internes d’organisations ouvrières.
Celles-ci ont beau se situer dans une zone légale incertaine, elles n’en produisent pas moins
des textes qui entendent régler les rapports en leur sein. De la même façon que les règlements
d’atelier peuvent, comme le remarque Alain Cottereau, « contribuer à éclairer [l]es univers de
légitimité ou illégitimité des rapports patrons/ouvriers » (Cottereau 1984), les règlements
d’association nous renseignent sur la construction d’un ordre légitime des rapports entre
ouvriers – ce que Maxime Leroy a appelé la « coutume ouvrière » pour désigner les normes
mises en œuvre dans les syndicats (Leroy 1913).
Pour réaliser le second axe de cette recherche, je passerai de l’analyse des
organisations à la réalisation d’une étude sociologique de leurs membres et de leurs
responsables, dans le but de saisir leurs caractéristiques et leurs trajectoires spécifiques
(Passeron 1990 ; Dubar 1998), en m’intéressant plus particulièrement à la question de
l’évolution du poids des ouvriers de métier dans les différentes organisations, et à l’apparition
de nouvelles catégories de porte-parole ouvriers. Pour ce faire, je commencerai par réaliser
une prosopographie des ouvriers membres de ces différentes organisations ou
participant à leurs activités8. Ce projet prosopographique s’appuiera en premier lieu sur le
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier (Maitron et Pennetier 1964)9, complété par
les sources nouvelles mises au jour au cours de la recherche. Quand ce sera possible, cet
aspect de ma recherche sera réalisé en collaboration avec les autres entreprises de
prosopographie des militants ouvriers, par exemple avec l’équipe, dirigée par Marie-Cécile
Bouju et Claude Pennetier, qui prépare actuellement un Dictionnaire biographique des
ouvriers du livre et du papier. Je croiserai ensuite cette prosopographie avec la sélection d’un
certain nombre de trajectoires étudiées plus en détail comme des carrières militantes
spécifiques10
. En cela, cet axe de recherche s’inscrira dans la sociologie du militantisme
(Fillieule et Pudal 2010) : j’étudierai les trajectoires des ouvriers qui prennent la parole et qui
s’organisent en tant qu’ouvriers comme des « carrières militantes » (Fillieule 2001 ; Leclercq
et Pagis 2011) au cours desquelles ils accumulent un « capital militant » (Matonti et Poupeau
2004) qui, de la même manière que le capital politique des représentants professionnels, crée
une distance entre eux et les groupes au nom desquels ils entendent parler (Gaxie 1978).
Pour mener à bien le dernier axe de cette recherche, j’étudierai les textes collectifs
produits au sein des organisations, liés aux domaines de la production (cahiers d’atelier,
journaux ouvriers, traités et manuels techniques publiés pour ou par les travailleurs, procès-
verbaux de situations formalisées où des travailleurs mobilisent des savoirs techniques comme
les prud’hommes ou la justice de paix, etc.), de l’organisation (règlements, traités
réformateurs, débats dans les organisations, notamment aux échelles nationale et
internationale…) et de la revendication (pétitions, manifestes, affiches, journaux ouvriers,
ainsi que les comptes-rendus policiers et judiciaires des manifestations et des grèves). A
travers l’étude de ces textes, je chercherai principalement à saisir quelles conceptions de la
classe ouvrière, de son rôle et de ses formes d’organisation (tant dans le cadre du processus
de production, dans celui de la lutte ou de la solidarité) sont défendues. Il s’agira ainsi de
comprendre le rôle de ces idées ouvrières à la fois dans l’histoire des catégories par lesquelles
les travailleurs sont désignés et dans l’histoire des formes d’organisation et des projets
réformateurs des ouvriers.
8 Pour des éléments de méthode, (Keats-Rohan 2007 ; Lemercier et Zalc 2008)
9 Sur ce dictionnaire et ses usages, voir (Dreyfus, Pennetier et Viet-Depaule 1996)
10 Pour un exemple du pouvoir heuristique de cette voie de recherche sociologique sur un terrain et des questions
proches, voir (Pudal 1989).
CNRS 2015 Samuel Hayat
16
2. Sources
Ce projet s’appuie à la fois sur des sources imprimées et archivistiques11
. S’il est
impossible de définir a priori l’ensemble des fonds qui seront utilisés, les premières
recherches porteront sur les corpus et les fonds suivants :
- Les écrits imprimés issus des organisations ouvrières et de leurs membres (journaux,
pamphlets, brochures mémoires). Localisation : Bibliothèque nationale de France, Institut
d’histoire sociale (fondation Boris Souvarine), Institut français d’histoire sociale, bibliothèque
du CEDIAS-Musée social, bibliothèque du musée d’histoire vivante de Montreuil,
International Institute of Social History d’Amsterdam12
.
- Les enquêtes ouvrières du XIXe siècle, en particulier celles menées par l’école de Le Play,
conservées à la Bibliothèque nationale de France et à la bibliothèque du CEDIAS-Musée
social, et celles de la Chambre de Commerce de Paris.
- Les fonds privés de porte-parole ouvriers. Je m’intéresserai en particulier à ceux
conservés à l’Institut français d’histoire sociale et aux archives nationales (Tourtier-Bonazzi
et Huart 1973).
- Les archives ministérielles et administratives (série F) des Archives nationales, en
particulier la série F12
du Commerce et Industrie, notamment :
- F12
4618-4638 : Prêt aux associations ouvrières (1843-1863)
- F12
4647-4650 : Conseils de prud’hommes, livrets ouvriers (an X-1882)
- F12
4651-4689 : Grèves et coalitions (1853-1899)
- F12
4812-4822 : Sociétés de secours mutuels, caisses de retraite (1810-1877)
- F12
5343-5409 : Sociétés de secours mutuels (1850-1912)
- Et dans ces mêmes archives, la série F7, c'est-à-dire les archives administratives de la
police générale, notamment :
- F7 12357-14064 : Sociétés et associations (1870-1914)
- F7 12773-12793 : Grèves (1849-1914)
- F7 12912-12920 : Grèves (1884-1925)
-Les archives du ministère de la Justice (série BB), conservées aux Archives nationales,
notamment :
- BB18
49 BL : syndicats professionnels (XIXe siècle-1934)
- BB18
56 BL : Anarchistes (1873-1950)
- BB27
102-109 : Affaires politiques
- Les archives des organisations ouvrières, dont une grande partie est regroupée depuis
2006 dans les Archives nationales du monde du travail, à Roubaix. Ces fonds pourront être
complétés par ceux conservés à l’International Institute of Social History d’Amsterdam.
11
Les sources de l’histoire ouvrière ont fait l’objet de nombreux guides. J’utiliserai en particulier (Brécy 1963 ;
Dreyfus 1983 ; Dreyfus 1987) Pour le Nord, voir (Dhérent 1986). Le Collectif des centres de documentation en
histoire ouvrière et sociale (Codhos) constitue aussi une source précieuse pour l’orientation dans les différents
fonds. 12
J’utiliserai notamment comme outils (Dolléans et al. 1950 ; Dale 1969).
CNRS 2015 Samuel Hayat
17
- Les fonds de l’Institut CGT d’histoire sociale, notamment concernant les organisations
constitutives de la CGT (la Fédération nationale des syndicats et la Fédération nationale des
Bourses du Travail), ainsi que les collections des instituts professionnels (IHS-CGT Livre
parisien, IHS-CGT Mines Energie) et territoriaux (IHS-CGT Nord-Pas-de-Calais, IHS-CGT
Paris, IHS-CGT Rhône).
- Les collections des musées d’arts et métier et des bibliothèques spécialisées : le Musée
national des arts et métiers, la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière de Troyes, la
bibliothèque Forney à Paris.
- Pour l’étude des mineurs du Nord, j’irai en priorité voir les archives du Centre historique
minier de Lewarde, qui contient notamment les archives de la Compagnie de mines d’Anzin.
J’utiliserai en particulier les fonds 3.5 (Organisation : ouvriers) et 3.9 (Organisation :
syndicats, grèves, agitation, délégués). Je m’intéresserai aussi aux archives départementales
du Nord, en particulier :
- 61 J : Archives de la Compagnie des mines d’Aniche à Anzin (1773-1944)
- M 134-163 : Police politique
- M 215-226 : Associations, sociétés de secours mutuels
- M 155-487 : Coopératives
- M 595-601 : Syndicats
- M 619-629 : Travail, grève
- Pour l’étude des ouvriers du textile à Lyon, je dépouillerai en priorité la série R des archives
communales de Lyon sur les sociétés de secours mutuel et les fonds des archives
départementales du Rhône :
- 2 J : Fonds Léon Galle sur l’industrie à Lyon au XIXe siècle
- 4 M 237-244 : Cris, écrits, attitudes séditieuses
- 4M 246-269 : Procès-verbaux des réunions de partis politiques. Associations
politiques Congrès. Manifestations (1815-1940)
- 4 M 275-305 : Individus signalés, recherchés, surveillés (an VII-1940)
- 4 M 306-342 : Anarchistes (1822-1894)
- 4 M 343-363 : Individus signalés, recherchés, surveillés (an IX-1923)
- 4 M 499-507 : Réunions, cercles, congrès, expositions (1832-1939)
- 4 M 522-640 : Associations
- Pour les ouvriers de l’imprimerie à Paris, je complèterai les archives ministérielles sur
l’imprimerie et la librairie (série F18
) par certains fonds conservés aux archives de l’ancien
département de la Seine :
- M4 : Police : surveillance de l’imprimerie et de la librairie
- M13
: grèves, manifestations et insurrections
- J’utiliserai aussi les archives de la préfecture de police de Paris, notamment :
- AA 418-434 : Evénements politiques (1814-1870)
- BA 28-40 : congrès socialistes et ouvriers (1876-1896)
- BA 41-50 : manifestations du 1er
mai (1891-1898)
CNRS 2015 Samuel Hayat
18
- BA 73-80 : mouvement anarchiste (1882-1896)
C. Calendrier de recherche et de valorisation de la recherche
Ce projet se déroulera sur cinq ans, de 2015 à 2020, et donnera lieu à une série de
publications et à l’organisation de plusieurs événements scientifiques.
La première année de recherche (2015-2016) sera consacrée à la mise en œuvre du
premier axe de recherche : répertorier l’ensemble des organisations ouvrières des trois milieux
étudiés et les organisations de coordination situées à une échelle plus large, pour réaliser une
chronologie des répertoires organisationnels ouvriers. Ce sera l’occasion de commencer à
rassembler le corpus de textes ouvriers à étudier dans le troisième axe. Cette recherche
s’accompagnera de la finalisation d’un ouvrage court, à destination d’un public de non-
spécialistes, sur les différents modes d’organisation de la classe ouvrière au XIXe siècle, dont
la publication est prévue en 2016 à La Découverte.
La seconde année (2016-2017), je focaliserai mes recherches sur les organisations
ouvrières construites à une échelle plus large (régionale, nationale et internationale) et sur la
circulation des répertoires organisationnels décrits l’année précédente.
Les recherches de la troisième année (2017-2018) porteront sur la réalisation d’une
prosopographie des échantillons de militants des organisations répertoriées et je complèterai
le corpus de textes collectifs.
La quatrième année de recherche (2018-2019) consistera à identifier des ouvriers
organisés pour lesquels je réaliserai une étude de la carrière militante. J’essaierai de
reconstituer leur trajectoire et de compléter mon corpus en répertoriant l’ensemble de leurs
écrits.
La cinquième année de recherche (2019-2020) sera centrée sur l’ analyse des textes de
mon corpus dans une perspective d’histoire sociale des idées.
L’ensemble de ces recherches donnera lieu à la rédaction d’un ouvrage de synthèse sur
l’histoire sociale des organisations, des militants et des petites pensées ouvrières au XIXe
siècle.
D. Insertion dans des laboratoires de recherche
Ce projet de recherche pourrait s’insérer dans les travaux de deux laboratoires, le
Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales (CERAPS) de
l’Université Lille 2 et le Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP) de
l’Université Paris 1.
Le choix du CERAPS se justifie par les nombreux échos qui existent entre mon projet
et l’axe thématique n°2 du CERAPS, « Mobilisations, participations, représentations ». Les
affinités les plus évidentes sont celles qui le lient aux sous-axes « Mobilisations et
Socialisations » et « Professionnels de la Représentation ». Au-delà de cette adéquation, c’est
le croisement entre études de différentes formes d'engagement qui m’a amené à demander le
soutien du CERAPS. L’objet de ce projet de recherche se situe en effet au croisement de la
représentation politique, de la participation et du mouvement social, trois champs de
recherche constitutifs de l’axe 2 du CERAPS. Cette proximité dans les thèmes de recherche
est renforcée par l’existence de liens avec certains chercheurs du CERAPS, notamment avec
Rémi Lefebvre et Karel Yon, qui appartiennent au groupe de recherche AFSP sur la
CNRS 2015 Samuel Hayat
19
représentation politique (GRePo) que je co-anime, et surtout avec Julien Talpin, qui a
participé au programme de recherche PUCA dans lequel j’ai réalisé un post-doctorat, qui est
rédacteur en chef du comité de rédaction de la revue Participations, et avec qui j’ai organisé à
l’automne 2013 un cycle de trois journées d’étude intitulé « Participation et délibération au
prisme de l’histoire » à la Maison européenne des sciences et de la société de Lille (avec deux
autres chercheuses lilloises, Marion Carrel et Paula Cossart, membres du CeRIES).
Une seconde possibilité serait de mener cette recherche dans le cadre du CESSP. Mon
projet s’inscrirait principalement dans l’axe « Pouvoirs et rapports de domination », dont les
thématiques « Sociologie des élites », « Métiers et milieux de la politique » et « Structures
sociales et travail de domination » trouvent des échos à différents niveaux dans la recherche
que je propose. L’importance du travail du concept de représentation dans ce laboratoire, dont
témoigne notamment l’investissement de plusieurs membres (Loïc Blondiaux, Frédérique
Matonti, Guillaume Petit et Lamprini Rori) dans les activités du GRePo, amènerait
certainement à des échanges fructueux. Enfin, le projet d’une Encyclopédie des sciences
historiques et sociales du politique, porté notamment par le CESSP dans le Labex TEPSIS,
rencontre fortement mon intérêt de longue date pour l’histoire conceptuelle.
CNRS 2015 Samuel Hayat
20
IV. Bibliographie
Aguet, Jean-Pierre. 1954. Contribution à l’histoire du mouvement ouvrier français : les grèves
sous la Monarchie de Juillet (1830-1847). Genève: E. Droz.
Agulhon, Maurice. 1977. Le Cercle dans la France bourgeoise : 1810-1848, étude d’une
mutation de sociabilité. Paris: A. Colin, École des hautes études en sciences sociales.
———. 1979. La République au village: les populations du Var, de la Révolution à la IIe
République. Paris: Éditions du Seuil.
———. 1988. « Classe ouvrière et sociabilité avant 1848. » In Histoire vagabonde, 1:60‑97.
Paris: Gallimard.
Aït-Aoudia, Myriam, Mounia Bennani-Chraïbi et Jean-Gabriel Contamin. 2011. « Indicateurs
et vecteurs de la politisation des individus : les vertus heuristiques du croisement des
regards. » Critique internationale 50 (1): 9‑20. doi:10.3917/crii.050.0009.
Archer, Julian P. W. 1997. The First International in France, 1864-1872: Its Origins, Theories
and Impact. Lanham New York Oxford: University press of America.
Bereni, Laure. 2006. « Lutter dans ou en dehors du parti ? » Politix (73): 187‑209.
Berlanstein, Lenard R. 1984. The Working People of Paris, 1871-1914. Baltimore: Johns
Hopkins University Press.
———. 1992. « The Distinctiveness of the Nineteenth-Century French Labor Movement. »
The Journal of Modern History 64 (4): 660–685.
Béroud, Sophie, Jean-Pierre Le Crom et Karel Yon. 2013. « Représentativités syndicales,
représentativités patronales. Règles juridiques et pratiques sociales. Introduction. »
Travail et emploi 131 (3): 5‑22.
Bezucha, Robert J. 1974. The Lyon uprising of 1834: social and political conflict in the early
July Monarchy. Cambridge: Harvard University Press.
Boltanski, Luc. 1982. Les cadres: la formation d’un groupe social. Paris: Éditions de Minuit.
———. 2009. De la critique précis de sociologie de l’émancipation. Paris: Gallimard.
Bourdieu, Pierre. 1981. « La représentation politique – éléments pour une théorie du champ
politique. » Actes de la recherche en sciences sociales (36-37): 3‑24.
———. 1984a. « Délégation et fétichisme politique. » Actes de la recherche en sciences
sociales (52-53): 49‑55.
———. 1984b. « Espace social et genèse des “classes.” » Actes de la recherche en sciences
sociales (52-53): 3‑12.
Brécy, Robert. 1963. Le mouvement syndical en France: 1871-1921 : essai bibliographique.
Paris: Mouton et Cie.
Calhoun, Craig. 1993. « “New Social Movements” of the Early Nineteenth Century. » Social
Science History 17 (3): 385‑427.
Caron, François. 2010. La dynamique de l’innovation changement technique et changement
social (XVIe-XXe siècle). [Paris]: Gallimard.
Castel, Robert. 1995. Les métamorphoses de la question sociale: une chronique du salariat.
Paris: Fayard.
Chauvet, Paul. 1964. Les ouvriers du livre en France: de 1789 à la constitution de la
Fédération du livre. Paris: M. Rivière.
Chevalier, Louis. 2002. Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première
moitié du XIXe siècle. Paris: Perrin.
Chueca, Miguel, dir. 2008. Déposséder les possédants: la grève générale aux « temps
héroïques » du syndicalisme révolutionnaire, 1895-1906. Marseille: Agone.
Clavier, Laurent. 2006. « “Quartier” et expériences politiques dans les faubourgs du nord-est
parisien en 1848. » Revue d’histoire du XIXe siècle (33): 121‑142.
CNRS 2015 Samuel Hayat
21
Clemens, Elisabeth. 1993. « Organizational repertoires and institutional change: Women’s
groups and the transformation of US politics, 1890-1920. » American Journal of
Sociology: 755–798.
Coffin, Judith G. 1996. The Politics of Women’s Work: The Paris Garment Trades, 1750-
1915. Princeton: Princeton university press.
Coornaert, Émile. 1966. Les compagnonnages en France: du moyen âge à nos jours. Paris: les
Éditions ouvrières.
Corbin, Alain et Jean-Marie Mayeur, dir. 1997. La barricade : actes du colloque organisé les
17, 18 et 19 mai 1995 par le Centre de recherches en histoire du XIXe siècle et la
Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle. Paris:
Publications de la Sorbonne.
Cordillot, Michel. 2010. Aux origines du socialisme moderne: la Première Internationale, la
Commune de Paris, l’Exil recherches et travaux. Ivry-sur-Seine: Éd. de l’Atelier.
Cossart, Paula. 2010. Le meeting politique : de la délibération à la manifestation (1868-1939).
Rennes: Presses universitaires de Rennes.
Cottereau, Alain, dir. 1984. Les règlements d’ateliers: 1798-1936. Paris: Bibliothèque
nationale.
———. 1986. « The distinctiveness of working-class cultures in France, 1848-1900. » In
Working-class formation: nineteenth-century patterns in Western Europe and the
United States, sous la dir. de Aristide R. Zolberg et Ira Katznelson, 111‑154.
Princeton, NJ: Princeton university press.
———. 2002. « Droit et bon droit. » Annales. Histoire, Sciences Sociales 57 (6): 1521‑1557.
———. 2004. « La désincorporation des métiers et leur transformation en “publics
intermédiaires”: Lyon et Elbeuf, 1790-1815. » In La France, malade du
corporatisme ? : XVIIIe-XXe siècles, sous la dir. de Steven Laurence Kaplan et
Philippe Minard, 97‑145. Paris: Belin.
———. 2006. « Sens du juste et usages du droit du travail : une évolution contrastée entre la
France et la Grande-Bretagne au xixe siècle. » Revue d’histoire du XIXe siècle (33):
101‑120.
Dale, Leon A. 1969. A Bibliography of French Labor, with a Selection of Documents on the
French Labor Movement. New York: A.M. Kelley.
Debrabant, Virginie et Gérard Dumont, dir. 2007. Les trois âges de la mine, Volume 2: L’ère
du charbon roi, 1830-1914. Lille: « La Voix du Nord » éd.
Déloye, Yves et Olivier Ihl. 2008. L’acte de vote. Paris: les Presses de Sciences Po.
Desroche, Henri. 1981. Solidarités ouvrières, tome 1. Sociétaires et compagnons dans les
associations coopératives, 1831-1900. Paris: Editions ouvrières.
Devin, Guillaume, dir. 1990. Syndicalisme: dimensions internationales. La Garenne-
Colombes: Ed. Européennes Erasme.
Dewerpe, Alain. 1989. Le Monde du travail en France, 1800-1950. Paris: A. Colin.
Dhérent, Catherine. 1986. Archives du monde du travail: région Nord-Pas-de-Calais guide de
recherche. Lille: Archives départementales du Nord Office régional de la culture et de
l’éducation permanente Nord-Pas-de-Calais.
Didry, Claude. 2009. « Droit, démocratie et liberté au travail dans le système français de
relations professionnelles. » Terrains & travaux (14): 127‑148.
Dolléans, Edouard, Michel Crozier, Renée Lamberet, Eugène Zaleski et Carlos M Rama.
1950. Mouvements ouvriers et socialistes: chronologie et bibliographie. Paris: Éditions
ouvrières.
Dreyfus, Michel. 1983. Guide des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale.
Paris: Editions ouvrières.
CNRS 2015 Samuel Hayat
22
———. 1987. Les sources de l’histoire ouvrière, sociale et industrielle en France, XIXème et
XXème siècles: guide documentaire. Paris: Éditions ouvrières.
———. 2001. Liberté, égalité, mutualité: mutualisme et syndicalisme, 1852-1967. Paris: les
Éd. de l’Atelier-Éd. Ouvrières Mutualité française.
Dreyfus, Michel, Claude Pennetier et Nathalie Viet-Depaule. 1996. La part des militants:
biographie et mouvement ouvrier : autour du "Maitron, dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier français. Paris: Les Éd. de l’Atelier-les Éd. ouvrières.
Droz, Jacques, dir. 1972. Histoire générale du socialisme, 1: Des origines à 1875. Paris:
Presses universitaires de France.
Dubar, Claude. 1998. « Trajectoires sociales et formes identitaires. Clarifications
conceptuelles et méthodologiques. » Sociétés contemporaines (29): 73‑85.
Eley, Geoff. 1992. « De l’histoire sociale au “tournant linguistique” dans l’historiographie
anglo-américaine des années 1980. » Genèses (7): 163‑193.
Eliasoph, Nina et Paul Lichterman. 2003. « Culture in Interaction. » American Journal of
Sociology 108 (4): 735‑794.
Faure, Alain, dir. 1987. Maintien de l’ordre et polices en France et en Europe au XIXe siècle
[colloque de Paris et Nanterre, 8-10 décembre 1983]. Paris: Créaphis.
———, dir. 1990. Répression et prison politiques : en France et en Europe au XIXe siècle
[actes du colloque de 1986]. Paris: Créaphis.
Favre, Pierre, dir. 1990. La Manifestation. Paris: Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques.
Fillieule, Olivier. 1997. Stratégies de la rue : les manifestations en France. Paris: Presses de
Sciences po.
———. 2001. « Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel. »
Revue française de science politique Vol. 51 (1): 199‑215.
Fillieule, Olivier et Bernard Pudal. 2010. « Sociologie du militantisme. » In Penser les
mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les sociétés
contemporaines, sous la dir. de Éric Agrikoliansky, Isabelle Sommier, et Olivier
Fillieule, 163‑184. Paris: la Découverte.
Fillieule, Olivier et Danielle Tartakowsky. 2008. La manifestation. Paris: Sciences Po, les
Presses.
Frobert, Ludovic. 2009. Les Canuts ou La démocratie turbulente: Lyon, 1831-1834. Paris:
Tallandier.
Gaillard, Jeanne. 1997. Paris, la ville: 1852-1870. Paris Montréal: l’Harmattan.
Gaxie, Daniel. 1978. Le Cens caché : inégalités culturelles et ségrégation politique. Paris:
Seuil.
Gillet, Marcel. 1973. Les Charbonnages du Nord de la France au XIXe siècle. Paris: Mouton.
Gossez, Rémi. 1968. Les ouvriers de Paris. 1 : L’Organisation, 1848-1851. Paris: Société
d’histoire de la Révolution de 1848.
Gould, Roger V. 1995. Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from
1848 to the Commune. Chicago: University of Chicago Press.
Gourden, Jean-Michel. 1992. Le peuple des ateliers: les artisans du XIXe siecle. Paris:
Creaphis éditions.
Grignon, Claude et Jean-Claude Passeron. 1989. Le savant et le populaire misérabilisme et
populisme en sociologie et en littérature. Paris: Gallimard Le Seuil.
Guha, Ranajit. 1997. Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India.
Cambridge: Harvard University Press.
Guionnet, Christine. 1997. L’apprentissage de la politique moderne : les élections municipales
sous la monarchie de juillet. Paris: l’Harmattan.
CNRS 2015 Samuel Hayat
23
Halbwachs, Maurice. 2011. Le destin de la classe ouvrière. Sous la dir. de Christian Baudelot
et Roger Establet. Paris: Presses universitaires de France.
Hanagan, Michael P. 1980. The Logic of Solidarity: Artisans and Industrial Workers in Three
French Towns 1871-1914. Chicago: University of Illinois press.
Harden Chenut, Helen. 2005. The Fabric of Gender: Working-Class Culture in Third Republic
France. University Park (Pa.): Pennsylvania State University Press.
Harsin, Jill. 2002. Barricades: The War of the Streets in Revolutionary Paris, 1830-1848. New
York: Palgrave.
Hauchecorne, Mathieu. 2013. « Faire du terrain en pensée politique. » Politix (100): 149‑165.
Hilaire-Pérez, Liliane. 2000. L’invention technique au siècle des Lumières. Paris: Albin
Michel.
Hincker, Louis. 1997. « La politisation des milieux populaires en France au XIXe siècle :
construction d’historiens. Esquisse d’un bilan (1948-1997). » Revue d’histoire du
XIXe siècle (14).
Holthoon, Frits L. van et Marcel van der Linden, dir. 1988. Internationalism in the labour
movement, 1830-1940. 2 vol. Leiden: E. J. Brill.
Huard, Raymond. 1996. La naissance du parti politique en France. Paris: Presses de la
Fondation nationale des sciences politiques.
Ihl, Olivier. 2010. « L’Urne et le fusil. » Revue française de science politique 60 (1): 9‑35.
Jarrige, François. 2007. « Le mauvais genre de la machine. » Revue d’histoire moderne et
contemporaine 54 (1): 193‑221.
———. 2009. Au temps des tueuses de bras: les bris de machines à l’aube de l’ère
industrielle, 1780-1860. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
———. 2012. « Discontinue et fragmentée? Un état des lieux de l’histoire sociale de la
France contemporaine. » Histoire, économie & société 31 (2): 45–59.
Judt, Tony. 1986. Marxism and the French left: studies in labour and politics in France 1830-
1981. Oxford: Clarendon press.
Kaplan, Steven Laurence et Philippe Minard, dir. 2004. La France, malade du corporatisme ? :
XVIIIe-XXe siècles. Paris: Belin.
Karila-Cohen, Pierre et Blaise Wilfert. 1998. Leçon d’histoire sur le syndicalisme en France.
s.l.: Presses Universitaires de France.
Katz, Henryk. 1992. The Emancipation of Labour: A History of the First International.
Westport: Greenwood press.
Kaye, Harvey J. et Keith McClelland, dir. 1990. E.P. Thompson: Critical Perspectives.
Cambridge: Polity press.
Keats-Rohan, Katharine Stephanie Benedicta. 2007. Prosopography Approaches and
Applications a Handbook. Oxford: Unit for Prosopographical Research, Linacre
College, University of Oxford.
Kok, Jan, dir. 2002. Rebellious Families: Household Strategies and Collective Action in the
Nineteenth and Twentieth Centuries. New York: Berghahn books.
Laclau, Ernesto et Chantal Mouffe. 2001. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a
Radical Democratic Politics, 2e éd. London New York: Verso.
Lacroix, Bernard. 1981. L’utopie communautaire: histoire sociale d’une révolte. Paris:
Presses universitaires de France.
Lagroye, Jacques. 2003. « Le processus de politisation. » In La politisation, 359‑372. Paris:
Belin.
Laroulandie, Fabrice. 1997. Les ouvriers de Paris au XIXe siècle. Paris: Éd. Christian.
Leclercq, Catherine et Julie Pagis. 2011. « Les incidences biographiques de l’engagement. »
Sociétés contemporaines n° 84 (4): 5‑23.
CNRS 2015 Samuel Hayat
24
Lefebvre, Rémi. 2006. « Le socialisme français et la « classe ouvrière ». » Nouvelles
FondationS (1): 64‑75.
Lemercier, Claire et Claire Zalc. 2008. Méthodes quantitatives pour l’historien. Paris: La
Découverte.
Léonard, Mathieu. 2011. L’émancipation des travailleurs: une histoire de la Première
Internationale. Paris: la Fabrique éd.
Lequin, Yves. 1977. Les ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914). 1, La formation de la
classe ouvrière régionale. Lyon: Presses universitaires de Lyon.
Leroy, Maxime. 1913. La Coutume ouvrière. 2 vol. Paris: Giard.
Linden, Marcel van der. 2008a. Workers of the World: Essays toward a Global Labor History.
Leiden: Brill.
———. 2008b. « The “Globalization” of Labour and Working-Class History and Its
Consequences. » In Global Labour History: A State of the Art, sous la dir. de Jan
Lucassen, 13‑36. Bern: Peter Lang.
Linden, Marcel van der et Jürgen Rojahn, dir. 1990. The Formation of Labour Movements,
1870-1914: An International Perspective. Vol. 1. 2 vol. Leiden: E. J. Brill.
Linden, Marcel van der et Wayne Thorpe, dir. 1990. Revolutionary Syndicalism: An
International Perspective. Aldershot: Scolar press.
Lomba, Cédric et Julian Mischi. 2013. « Ouvriers et intellectuels face à l’ordre usinier. »
Actes de la recherche en sciences sociales (196-197): 4‑19.
Lynch, Katherine A. 1988. Family, Class and Ideology in Early Industrial France: Social
Policy and the Working-Class Family, 1825-1848. Madison: University of Wisconsin
press.
Magraw, Roger. 1992. A History of the French Working Class. 2 vol. Oxford: Blackwell.
Maitron, Jean et Claude Pennetier. 1964. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier
français. Paris: Editions ouvrières.
Manfredonia, Gaetano. 2007. Anarchisme et changement social: insurrectionnalisme,
syndicalisme, éducationnisme-réalisateur. Lyon: Atelier de création libertaire.
Manin, Bernard. 1996. Principes du gouvernement représentatif. Paris: Flammarion.
Mansbridge, Jane. 1999. « Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women?
A Contingent ‘Yes’. » The Journal of Politics (61): 628‑657.
Marx, Karl. 1982. Œuvres: Philosophie. s.l.: Gallimard.
———. 1998. Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Paris: Editions
Allia.
Matonti, Frédérique. 2005. Intellectuels communistes: essai sur l’obéissance politique « La
Nouvelle critique », 1967-1980. Paris: Éd. la Découverte.
———. 2012. « Plaidoyer pour une histoire sociale des idées politiques. » Revue d’histoire
moderne et contemporaine 59 (4bis): 85‑104.
Matonti, Frédérique et Franck Poupeau. 2004. « Le capital militant. Essai de définition. »
Actes de la recherche en sciences sociales (155): 4‑11.
McMillan, James F. 2000. France and Women, 1789-1914: Gender, Society and Politics.
London: Routledge.
Mischi, Julian. 2003. « Travail partisan et sociabilités populaires. Observations localisées de
la politisation communiste. » Politix 16 (63): 91‑119.
———. 2007. « Le PCF et les classes populaires. » Nouvelles FondationS (6): 15‑23.
———. 2010. Servir la classe ouvrière sociabilités militantes au PCF. Rennes: Presses
universitaires de Rennes.
Moss, Bernard H. 1985. Aux origines du mouvement ouvrier français : le socialisme des
ouvriers de métier, 1830-1914. Traduit par Michel Cordillot. Paris: les Belles lettres.
CNRS 2015 Samuel Hayat
25
Moss, B. H. 1993. « Republican Socialism and the Making of the Working Class in Britain,
France, and the United States: A Critique of Thompsonian Culturalism. » Comparative
Studies in Society and History 35 (2): 390‑413.
Noiriel, Gérard. 1986. Les Ouvriers dans la société française: XIXe-XXe siècle. Paris: Seuil.
———. 1989. « Une histoire sociale du politique est-elle possible? » Vingtième Siècle.
Revue d’histoire (24): 81‑96.
Offerlé, Michel. 1984. « Illégitimité et légitimation du personnel politique ouvrier en France
avant 1914. » Annales ESC 39 (4): 681‑716.
———. 1989. « Mobilisation électorale et invention du citoyen : l’exemple du milieu urbain
français a la fin du XIXe siècle. » In Explication du vote. Un bilan des études
électorales en France, sous la dir. de Daniel Gaxie, 149‑174. Paris: Presses de Sciences
po.
———. 2007. « Capacités politiques et politisations : faire voter et voter, xixe-xxe siècles
(1). » Genèses (67): 131‑149.
Passeron, Jean-Claude. 1990. « Biographies, flux, itinéraires, trajectoires. » Revue française
de sociologie 31 (1): 3‑22.
Perdiguier, Agricol. 1840. Le livre du compagnonage. Paris: l’auteur.
Perrot, Michelle. 1986. « On the formation of the French working class. » In Working-class
formation: nineteenth-century patterns in Western Europe and the United States, sous
la dir. de Aristide R. Zolberg et Ira Katznelson, 71‑110. Princeton, NJ: Princeton
university press.
———. 2001. Les ouvriers en grève: France, 1871-1890, 2e éd. 3 vol. Paris: Editions de
l’EHESS.
Phillips, Anne. 1995. The Politics of Presence. Oxford: Clarendon press.
Pudal, Bernard. 1989. Prendre parti: pour une sociologie historique du PCF. Paris: Presses de
la Fondation nationale des sciences politiques.
———. 1991. « Le populaire à l’encan. » Politix 4 (14): 53‑64.
———. 2006. « De l’histoire des idées politiques à l’hitsoire sociale des idées politiques. » In
Les formes de l’activité politique: éléments d’analyse sociologique, du XVIIIe siècle à
nos jours, sous la dir. de Antonin Cohen, Bernard Lacroix, et Philippe Riutort,
185‑192. Paris: Presses universitaires de France.
Rancière, Jacques et Alain Faure, dir. 2007. La parole ouvrière : 1830-1851. Paris: la
Fabrique.
Rebérioux, Madeleine. 1981. Les Ouvriers du livre et leur fédération: un centenaire 1881-
1981. Paris: Temps actuels.
Robert, Vincent. 1996. Les chemins de la manifestation, 1848-1914. Lyon: Presses
universitaires de Lyon.
———. 2010. Le temps des banquets : politique et symbolique d’une génération, 1818-1848.
Paris: Publications de la Sorbonne.
Rosanvallon, Pierre. 1987. La Question syndicale: histoire et avenir d’une forme sociale.
Paris: Calmann-Lévy.
Rothstein, Natalie. 2002. « Silk : The Industrial Revolution and after. » In The Cambridge
History of Western Textiles, sous la dir. de David Trevor Jenkins, 790‑808.
Cambridge: Cambridge university press.
Saward, Michael. 2010. The representative claim. Oxford: Oxford University Press.
Sawicki, Frédéric. 1988. « Questions de recherche : pour une analyse locale des partis
politiques. » Politix 1 (2): 13‑28.
———. 1994. « Configuration sociale et genèse d’un milieu partisan. Le cas du parti
socialiste en Ille-et-Vilaine. » Sociétés contemporaines 20 (1): 83‑110.
CNRS 2015 Samuel Hayat
26
Sawicki, Frédéric et Jean-Louis Briquet. 1989. « L’analyse localisée du politique. » Politix 2
(7): 6‑16.
Schöttler, Peter. 1981. « Politique sociale ou lutte des classes: notes sur le syndicalisme
“apolitique” des Bourses du Travail. » Le Mouvement social (116): 3‑20.
Schwartz, Olivier. s.d. « Peut-on parler des classes populaires ? » La Vie des Idées. Consulté
le 27 décembre 2012. http://www.laviedesidees.fr/Peut-on-parler-des-classes.html.
Scott, Joan. 1988. « Genre : Une catégorie utile d’analyse historique. » Les Cahiers du GRIF
37 (1): 125‑153.
Scott, Joan Wallach. 1974. The Glassworkers of Carmaux: French craftsmen and political
action in a 19th century city. Cambridge: Harvard university press.
———. 1984. « Men and Women in the Parisian Garment Trades: Discussions of Family and
Work in the 1830s and 1840s. » In The Power of the Past: Essays for Eric Hobsbawm,
sous la dir. de Pat Thane, Geoffrey Crossick, et Roderick Floud, 67‑93. Paris
Cambridge: Éd. de la Maison des sciences de l’homme Cambridge university press.
Sewell, William Hamilton. 1983. Gens de métier et révolutions : le langage du travail, de
l’Ancien régime à 1848. Traduit par Jean-Michel Denis. Paris: Aubier-Montaigne.
Sheridan, George Joseph. 1981. The Social and Economic Foundations of Association among
the Silk Weavers of Lyons, 1852-1870. 2 vol. New York: Arno Press.
Shorter, Edward et Charles Tilly. 1974. Strikes in France, 1830-1968. London: Cambridge
University press.
Skinner, Quentin. 2002. Visions of Politics. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.
Soubiran-Paillet, Francine. 1999. L’invention du syndicat, 1791-1884: itinéraire d’une
catégorie juridique. Paris: Maison des sciences de l’homme : Réseau européen Droit et
société : LGDJ.
Stewart, Mary Lynn. 1984. The Artisan republic: revolution, reaction, and resistance in Lyon,
1848-1851. Montreal Gloucester: McGill-Queen’s university press A. Sutton.
Thompson, Edward Palmer. 1963. The making of the English working class. London: V.
Gollancz.
———. 2012. La formation de la classe ouvrière anglaise. Traduit par Gilles Dauvé, Mireille
Golaszewski, et Marie-Noëlle Thibault. Paris: Seuil.
Tilly, Charles. 1984. « Les origines du repertoire de l’action collective contemporaine en
France et en Grande-Bretagne. » Vingtième Siècle. Revue d’histoire (4): 89.
———. 1986. La France conteste: de 1600 à nos jours. Traduit par Éric Diacon. Paris:
Fayard.
———. 2006. Regimes and Repertoires. Chicago (Ill.): University of Chicago press.
Tilly, Charles, Richard H Tilly et Louise Tilly. 1975. The Rebellious century, 1830-1930.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Tissot, Sylvie, Christophe Gaubert et Marie-Hélène Lechien, dir. 2005. Reconversions
militantes. Limoges: PULIM.
Tourtier-Bonazzi, Chantal de et Suzanne d’Huart. 1973. Archives privées état des fonds de la
série AP. Tome 1. Paris: S.E.V.P.E.N.
Traugott, Mark. 2010. The Insurgent Barricade. Berkeley: University of California Press.
Urbinati, Nadia et Mark E. Warren. 2008. « The Concept of Representation in Contemporary
Democratic Theory. » Annual Review of Political Science 11: 387‑412.
Welskopp, Thomas. 2002. « L’histoire sociale du XIXe siècle : tendances et perspectives. »
Le Mouvement Social 200 (3): 153‑162.
Wolikow, Serge et Michel Cordillot, dir. 1993. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ?:
les difficiles chemins de l’internationalisme, 1848-1956. Dijon: EUD.