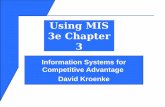liste des conseillers du salaire du departement du rhone ...
RENARD (C. M.). — 2004, Première caractérisation des industries lithiques du 3e millénaire en...
Transcript of RENARD (C. M.). — 2004, Première caractérisation des industries lithiques du 3e millénaire en...
Anthrop alo gica et P r æhistorica, L15, 2004, 103-113
Première caractérisation des industries lithiques du3u millénaire en Centre-Nord de la France
Les armatures de flèches de la fin du 4e et du 3u millénaire dans lebassin de la Seine
Caroline RErueRp
RésuméÀ partir de la documentation réunie par le Programme Collectif de Recherche sur le 3e millénaire dans le Centre-Nord
de la France/ une étude a été menée sur les armatures de flèches de la fin du 4e et du 3e millénaire av. J.-C. dans le bassinde la Seine. Cet article présente notamment la typologie établie et les résultats liés aux trois thèmes abordés : les typesd'armature et lâttribution chronologique des sites, la répartition géographique des types d'armature, les types dârmatureet la nature de l'occupation.
Abstract
From documentation collected by the "Programme Collectif de Recherche" on the third millennium BC in the Centre-North of France,a study utas undertaken on arrowheads of the end of the fourth and of the third millennium BC in the Seine basin. This articlepresents in particular the typology and results stemming from three topics studied: kinds of arrowheads and chronological attribution ofthe sites, geographical distribution of arroznheads, types of anowheads and the nature of occupation.
1.. INTROpUCTIoN
Dans le bassin de la Seine, la premièrecaractérisation des industries lithiques s'estfaite en partie par le biais d'un mémoire deD.E.A., traitant des armatures de flèches dela fin du 4" et du 3" millénaire av. I.-C.Lors de la mise en place du ProgrammeCollectif de Recherche sur le 3" millénairedans le Centre-Nord de la France (coordonnépar L. Salanova et R. Cottiaux), les objectifspour l'étude de l'industrie lithique étaient desélectionner rigoureusement les séries, puis de< comprendre en quoi l'abondance d'un Vped'outil sur un site peut être un fait culturel oucorrespond à un environnement particulier, oubien est lié à un geste technique ',, de < validerou d'invalider les "fossiles directeurs", c'est-à-dire définir ces objets à valeur de "marqueurs
culturels" , (Salanova et a1.,2000). Uarmature deflèche fait partie de ces demiers. En attendantune étude typologique et technologique desséries dans leur ensemble, nous nous sommesattachés à ce seul trait.
Depuis le Néolithique ancien jusqu'au Chas-séert il semble que les armatures soient de formetriangulaire ou trapézciidale et qu'il n'existe pasune grande variété de types. Mais, vers la findu Chasséen apparaît un nouveau modèle :l'armature à pédoncule et ailerons. Avec elle,
on observe au cours de la fin du Néolithiqueune diversification morphologique. C'est préci-sément pour cette variabilité que nous avonschoisi d'étudier cet outil : on suppose quecertains types sont porteurs d'une informationculturelle, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques àune zone et/ou à une durée de temps et/ouà un contexte d'occupation. Investir du temps,de lénergie et de la matière première pourmodifier ou créer une nouvelle morphologiedârmafure n'est pas anodiry et les variationsque l'on observe ont une signification. De plus,l'apparition de l'armature à pédoncule et aile-rons intervient dans un contexte particulier oril'on suppose l'existence déchanges de biens surdes longues distances (silex turonien supérieurde la région du Grand-Pressigny, roches alpineset armoricaines, cuivre) et où lbn observe denouvelles habitudes lors de I'inhumation desdéfunts (objets enterrés liés à un individu). Ona donc choisi détudier les armatures de flèchespour leur variabilité morphologique, pour lecontexte particulier oir elles apparaissent maisaussi pour deux autres raisons : il n'existe pasde synthèse sur ce thème qui prenne en compteles découvertes récentes du Bassin parisien eton dispose d'une documentation conséquente etdéjà en partie triée grâce au Programme Collectifde Recherche sur le 3" millénaire.
1.04 Caroline RpNaRp
tA6 ,?s :*'r /s g+'32^7g \zo tl 7ere---;_, 0.,, 03., oluu
.'?l.qttii
,' i*fu'll,,,u,t,
: armatures illustrées
: armatures non illustrées
: numéro de I'assemblage
Fig. 1 - Répartition des assemblages comprenant des armatures illustrées ou non.
2. PnÉSENTATToN DE ilÉTUDE
La zorre étudiée est celle drainée par laSeine et ses affluents, coïncidant avec le bassinsédimentaire de Paris (fig. 1). L'ensemble estformé par les régions d'Île-de-France, de Picar-die, de Haute-Normandie et des départementsd'Eure-et-Loir, du Loiret, du Loir-et-Cher, del'Yonne, de la Marne, de lAube et des Ardennes.D'un point de vue chronologique, les armaturesétudiées ici (toutes en silex) proviennent d'oc-cupations fouillées, attribuées à la fin du 4" et au3u millénaire. Dans notre zorre, ces treize sièclesenviron sont divisés en trois périodes (nomméesdâprès la terminologie française) :- le Néolithique récent qui est assimilé au
groupe de Seine-Oise-Marne (ou SOM);- le Néolithique final avec le Gord dans le
bassin de la Seine puis le Campaniforme (cesgroupes ne possèdent pas la même extensiongéographique et névoluent pas en mêmetemps);
- le Bronze ancien que lbn identifie au Groupedes Urnes à Décor Plastique (GUDP). Lesoccupations attribuées à ce groupe ont
été écartées car sa définition, ses limitesgéographiques et chronologiques sont tou-jours incertaines.
Cette étude est le fruit de recherches biblio-graphiques et aucune armafure n'a été observéedirectement. Les objectifs qui sont fixés sontdonc adaptés à cette contrainte. Le premierd'entre eux est de donner un état de la do-cumentation, de la trier et de conserver leséléments exploitables. Dans un second temps,les principaux types d'armature présents à la findu 4" et au 3" millénaire sont définis. Ensuite, lesrecherches ont pour but dâpporter des élémentsde réponse à trois questions de base :- peut-on distinguer des types présents à
léchelle du groupe culturel ?- que suggère la répartition géographique des
types ?- les types présents varient-ils en fonction de la
nature de l'occupation ?
Après avoir achevé f inventaire, l'attributionculturelle de chaque occupation a été vérifiéeet corrigée. Cette étape est indispensable caron ne peut prendre en compte les datations
Première caractérisation des industries lithiques du 3" millénaire en Centre-Nord de la France 105
proposées par G. Bailloud (1974), qri reposentplus sur l'architecture du monument que sur sonmobilier. Pour résoudre ce problème, nous noussommes basés sur la présence de certains élé-ments caractéristiques qui ont permis d'attribuerchaque occupation à un ou plusieurs groupesculturels. Une liste de ces éléments a été établiepar P. Chambon et L. Salanova (Chambon &Salanova, 1996), à partir du mobilier découverten contexte sépulcral dans le bassin de la Seine.Uattribution chronologique s'est faite sur la basedu mobilier diagnostique présent, sans tenircompte de l'attribution culturelle généralementadmise de certaines armatures. Elles ne sontdonc pas datées a priori, mais uniquement parrapport au mobilier diagnostique présent.
Une étude rigoureuse des assemblages per-met de les classer selon la précision de leurattribution culturelle. Quatre catégories sontdéfinies :- assemblages de catégorie A, dont le matériel
est attribué à une seule période et à une seuleculture de la fin du Néolithique;
- assemblages de catégorie B, dont le matérielest attribué à plusieurs périodes et donc àplusieurs cultures de la fin du Néolithique;
- assemblages de catégorie C, dont le matérielest attribué à plusieurs périodes et à plusieurscultures du Néolithique ancien (voire duMésolithique) ou moyen et de la fin duNéolithique;
- assemblages de catégorie D, dont le matérielest impossible à attribuer.
Selon la question posée, on choisit d'étudierl'une ou l'autre catégorie d'assemblages. Concer-nant l'attribution culfurelle des armatures, ilest indispensable de prendre en compte cellesissues d'occupations datées avec précision, doncde catégorie A. Les cartes de répartition pré-sentent les types mentionnés sur les assemblagesde catégories A et B afin de montrer d'éventuelscourants d'influences à la fin du 4" et au coursdu 3" millénaire. Pour aborder la représentationdes classes et des types d'armafures en fonctionde la nature de l'occupatiory nous examinons lesassemblages de catégories A et B.
Sur les 175 occupations recensées, on dé-nombre au moins 1,929 armafures de flèches.Concernant les 87 occupations pour lesquellescertaines armafures sont dessinées, il y en aau minimum L 269. On possède une illustrationpour 745 d'entre elles, mais seules 638 sontlisibles :
- 68 proviennent des 13 assemblages de catégo-rie A;
- 394 proviennent des 43 assemblages de caté-gorie B;
- 58 proviennent des 8 assemblages de catégo-rie C;
* 118 proviennent des 23 assemblages de catégo-rie D.
La typologie a été établie à partir des462 armafures issues des 56 assemblages decatégories A et B (assemblages attribués à uneou plusieurs cultures de la fin du Néolithique).
3. PnÉsswTATroN DE LA TypolocrE
Une typologie des armatures de flèches aété établie. Elle regroupe deux familles (lesarmatures < perçantes > et les armatures < tran-chantes "), sept classes (les armatures à pédon-cule et ailerons, losangiques, triangulaires, folia-cées, trapézoïdales, atypiques et les fragmentsd'armatures). Celles-ci se subdivisent en typeset sous-types (h5.2).Ce classement, adapté aumobilier du bassin de la Seine, est inspiré destypologies de M. Honegger (Honegger, 2001) etde S. Saintot (Saintot, 1998).
La typologie regroupe deux familles, septclasses, divisées en types, eux-mêmes subdivisésen sous-types :- la forme de la partie supposée ,. active >>
détermine la famille : extrémité pointue pourles < perçantes > (classes 100 à 400) et filplus ou moins large pour les ,. tranchantes >(classes 500);
- la forme générale de l'armature détermine laclasse (symbolisée par le chiffre des centaines :L00, 200 . . . ) ;
- les variations majeures (établies sur l'aspectdes ailerons, de la base, sur les variationsmoins sensibles de la forme générale) déter-minent le type (symbolisé par le chiffre desdizaines :110, 120, 210 ...);
- les variations mineures (établies sur la déli-néation des bords) déterminent le sous-type(symbolisé par le chiffre des unités :111, 112,121 . . . ) .
Voici la définition de chacune des classes etdes types (fig. 2).100. Armature à pédoncule et ailerons : les
pointes de flèche de cette classe se carac-térisent par des ailerons marqués et bienséparés du pédoncule.
106 Caroline RENaRp
type 110 type t40
type 320
type 420
Fig.2 - Présentation des types dârmatures. Type 110 : Saint-Maurier-aux-Riches-Hommes/Courgenay <La pierreCouverte" (Fajorç T984);Type120: Méry-sur-Mame..La Remise> (Cointirç in Renard,2002); fypes 130 et 230:Saint-Pouange (La Voie Ménant> (Langry-François, 2002); Type 140: Augy <La Ferme Champagné" (Fajoo l9g4);Type 210 : Verneuil-sous-Coucy < Le Mont des Rosières > (Ancient & Leboilô ch,7987);Type 220, ïi1q.r"rrr < r--HommeMort" (Bailloud & Brézillorç 1968); Type 310 : Poses <Le Vivier - Le Clos Saint-Quôntin,, ensembleT (Billard etal., 1994); Typ"t 320,420 et 430: Montivilliers <.Grand Epaville> (Watté, 1987, 1gg0); Type 410: Val-des-Marais< Mont-Aimé " hypogée II (Crubé zy &xMaziëre,1991) ; Type 510 : Villevenard < Moulin Brû1é oli{oland, 1925);Type 520 :Grands-Laviers (Billard et aL, 1990); Type 530: Bardouville <Carrière de Beaulieu, (Cailloud C fagnéi p6n.
type t20
@type 230
&type 310
type 130
fype 210
type 220
type 410 fype 430
type 510 type 520 type 530
Première caractérisation des industries lithiques du 3" millénaire en Centre-Nord de la France 107
110. Armature à pédoncule et ailerons nais-sants : le pédoncule est assez large parrapport à l'ensemble de la pièce,les aileronssont de ce fait peu marqués.
120. Armature à pédoncules et ailerons déga-gés : les ailerons sont bien dégagés parrapport au pédoncule qui est étroit. Il n'y apas d'encoche formant une cavité à la basedes ailerons.121. Armature à pédoncule et ailerons
dégagés, à bords rectilignes.122. Armature à pédoncule et ailerons
dégagés, à bords barbelés.l-30. Armature à pédoncule et ailerons récur-
rents : les ailerons sont bien individuali-sés par l'aménagement d'encoches plus oumoins profondes.131. armature à pédoncule et ailerons
récurrents, à bords rectilignes.132. armature à pédoncule et ailerons
récurrents, à bords barbelés.140. Armature à pédoncule et ailerons équarris :
lêxtrémité des ailerons ne se termine pasen pointe, mais elle est équarrie d'une façonplus ou moins régulière.
200. Armature losangique : cette classe re-groupe les modèles dont la forme se rap-proche du losange.
210. Armature losangique sans ergot: les quatrecôtés sont rectilignes et la forme est prochedu losange.
220. Arrnature Iosangique à ergots : les ex-trémités latérales se prolongent par desexcroissances, ce qui confère une certaineconcavité aux quatre côtés de la pièce.
230. Armature losangique asymétrique : la sy-métrie verticale entre la moitié gauche etla moitié droite de l'armafure n'est plusrespectée. Un côté peut être retouché demanière à aménager une concavité.
300. Armature triangulaire : l'armature est deforme triangulaire et ne présente que peude variations morphologiques, si ce n'estl'allure de sa base.
310. Armature triangulaire à base rectiligne : cemodèle possède une base plus ou moinsdroite.
320. Armature triangulaire à base concave :on observe une concavité plus ou moinsmarquée à la base, permettant de dégagerdes ailerons, parfois équarris.321. Armature triangulaire à base concave
à ailerons pointus.
322. Armature triangulaire à base concaveà ailerons équarris.
400. Armature foliacée : il s'agit de pièces dontles deux côtés convexes se rejoignent auxextrémités.
410. Armature foliacée à base appointée : la baseest pointue, souvent plus épaisse et moinsacérée que l'extrémité servant de tête deflèche. Les deux côtés sont régulièrementconvexes. La partie médiane de la pièce estla plus large.
420. Armature foliacée à base convexe : la base,qui est la partie la plus large de la pièce, estplus ou moins arrondie. Elle est dépourvued'angles à ses extrémités latérales.
430. Armature foliacée à base concave : la baseforme une concavité, mais à la différencedes armatures triangulaires à base concave,elle est dépourvue d'angles à ses extrémitéslatérales.
500. Armature trapézoïdale : cette classe re-groupe les modèles dont la forme se rap-proche du trapèze.
510. Armature trapézoïdale à bords divergents :les deux bords divergents sont sensible-ment symétriques.SLL. Armature trapézciidale à bords diver-
gents rectilignes.512. Armature trapézciidale à bords diver-
gents concaves.520. Armature trapézciidale à bords quasiment
parallèles : les angles entre les bases et lescôtés sont proches de 90..
530. Armature trapézciidale à bords quasimentsécants : les deux côtés tendent à se re-joindre. La base est ainsi quasiment in-existante. Si lbn s'en tient uniquement àcette phrase, ce type devrait faire partie dela classe des armafures triangulaires mais,à mon sens, cela serait une erreur. Pourargumenter ce choix, on doit considérerdes critères qui ne sont pas pris en consi-dération dans le reste de la typologie :le module, f inclinaison de la retouche etle support. En effet, les trois types de laclasse 500 ont plusieurs points communs :une forme générale proche du trapèze, desdimensions comparables, des bords retou-chés de manière abrupte et probablementle même genre de support (l'arête parallèleau tranchant, très souvent présente, seraitcelle d'une précédente lame). Cet ensemblede caractères suggèrent que ce type, bien
108 Caroline Rpruenp
que de forme sub-triangulaire, fait partiede la classe des armafures trapézciidales.
600. Armature de forme atypique : il s'agitde pointes dont la forme, irrégulière etsouvent inachevée, n'est pas caractéristiqued'un des types définis.
700. Fragments d'armature : le fragment est troppetit pour que la pièce puisse être attribuéeà l'un des types définis.
Les classes des < Armatures de forme aty-pique " (classe 600) et des ., Fragments d'arma-ture > (classe 700) ne figurent pas dans l'analyse.Les éléments de la première sont trop différentset trop peu nombreux (on dénombre dix ar-matures, soit 2 % du corpus, réparties sur troisassemblages) pour pouvoir être comparés à ceuxdes autres classes. Quant aux huit fragments(1,,7 % du corpus) répartis sur cinq assemblages,il est préférable de ne pas les prendre en comptecar, pour le moment, ils ne peuvent pas livrerbeaucoup d'informations.
4. ANeLYSE ET INTERPRÉTATIoN
Les armatures des 13 assemblages de ca-tégorie A ont été classées chronologiquementpour distinguer les types présents à l'échelle dugroupe culfurel et mettre en évidence une pos-sible évolution morphologique (fig. 3). D'aprèscette figure, et en écartant les exemplairesmentionnés sur des assemblages du Groupedes Urnes à Décor Plastique, oR observe queles armatures losangiques à ergots (type 220)et les armatures trapézoïdales à bords diver-gents concaves (type 512) seraient spécifiquesau Seine-Oise-Marne. Les armatures à pédon-cule et ailerons dégagés à bords rectilignes(Vpe 121) et les armatures losangiques asymé-triques (type 230), seraient, elles, spécifiques auGord. Une possible évolution morphologiquedes armafures est mise en évidence : dans un pre-mier temps, diverses trapézoïdales coexistentau Seine-Oise-Marne, puis on note la présencede losangiques et des premières pédonculéesavant l'apparition du groupe du Gord. Celui-ciconserve tout dâbord quelques trapézoïdalespuis développe, comme au Campaniforme, lesarmatures pédonculées et triangulaires. Cettetendance est un premier résultat encourageantmais elle doit impérativement être confirmée parl'observation des armatures non dessinées desassemblages de catégorie A et si possible par denouvelles séries.
La répartition spatiale des armatures meten évidence que certains types ne sont pasdistribués uniformément dans le bassin de laSeine : il existe dans quelques cas des concen-trations qui prouvent l'existence de préférenceslocales. En délimitant un secteur où un type aété préférentiellement utilisé, on souhaite distin-guer des zones dont les habitants partagent cesmêmes préférences. Nous savons que f industriecéramique est le support le plus adéquat et leplus fiable pour obtenir ce résultat. Cependan! ilest vraisemblable que la présence des L9 typeset sous-types différenciés varie en fonction del'attribution chronologique, de la nature desassemblages (voir plus haut) mais aussi deleur position géographique. Cette question peutêtre abordée par les récipients céramiques etles armatures car la morphologie (ainsi quele décor et la composition de la pâte pour lacéramique) de ces éléments est très variée etque les choix qui sont faits peuvent être dictéspar des préférences locales. De ces cartes derépartition on peut retenir deux informationsprincipales. Le type le plus couranf l'armaturetrapézciidale à bords divergents (type 5L0), estaussi le seul à être manifestement présent danstout le bassin de la Seine, de manière uniforme.Dans la mesure où il est implanté dans tout lesecteur, iI est caractéristique de la zorre étudiée :dans n'importe quel endroit du bassin de laSeine, il semble qubn ait utilisé ce type d'arma-ture. Il est incontestablement emblématique duNéolithique récent et final de cette zone. D'autrepart, deux zones de ,. tradition " différente ontété distinguées durant le SOM et le Gord (fig. a).Au nord et à l'ouest de la vallée du Grand Moriryon développe les armatures trapézoïdales àbords quasiment parallèles ou quasiment sé-cants (types 520,530) pendant qu'au sud-sud-estdu Canal de l'Ourcq, les armafures à pédonculeet ailerons naissants ou dégagés (types n0,120)sont préférées. Grossièrement, la situation est lasuivante:- sur trois Vpes de trapézoïdales, un est réparti
sur l'ensemble du bassin de la Seine et deuxsont présents au nord/nord-ouest de la zone;
- au sein des quatre types d'armafures à pédon-cule et ailerons, on distingue deux tendances :les armatures à ailerons naissants et aileronsdégagés présentes au sud/sud-ouest de lazorre, les armafures à pédoncule et aileronsrécurrents et ailerons équarris présentes dunord-ouest au sud-est (le long de l'axe de laSeine).
Première caractérisation des industries lithiques du 3" millénaire en Centre-Nord de la France 109
No del'assemblage
Attributionculturelle
Types et sous-types
512 520 511 220 110 121 230 131 310 L40
48 SOM V UUu SOM V U50 SOM UU31 Gord UU22 Gord U75 Gord
M Gord A"\-^J
64 Gord A"\-,N56
Gord etCampaniforme
4 Campaniforme AFig. 3 - Typ"r d'armatures présents sur neuf assemblages de catégorie A et unde catégorie B, attribués au Seine-oise-Mame, au Gord ou au Campaniforme.
110 Caroline RnruaRo
Fig. 4 - Situation des deux zones mises en évidence par la présence d'armatures trapézoidales à bords quasimentparallèles et quasiment sécants (secteur no 1) et d'armatures à pédoncule et ailerons dégagés et naissants (sectèur no 2).
On a supposé plus haut qu'au SOM, diversesarmatures trapézoïdales (dont celles à bordsquasiment parallèles) coexistent dans un pre-mier temps. Or, d'après les cartes précédentes,ces mêmes armafure s trapézoïdales à bordsquasiment parallèles sont présentes au nord/nord-ouest de la zone. Les assemblages attribuésau SOM seraient-ils alors situés préférentielle-ment au nord/nord-ouest de la zone ? D'aprèsla figure 5, il est difficile de se prononcer surce point : seuls deux assemblages attribués auSOM possèdent des armatures trapézoïdales àbords quasiment parallèles. Ljun (Montivilliers" Grand Epaville r,, no 48) est situé effectivementà l'extrême nord-ouest de la zone, à proximitéde I'embouchure de la Seine. L'autre en revanche(Morains-le-Petit o Pré aux Vaches rr, no 50) setrouve dans la vallée du Grand Moriry là où lesdeux secteurs se chevauchent.
De même, on a supposé plus haut quele groupe du Gord conserve tout d'abordquelques armatures trapézoïdales puis déve-loppe les types pédonculés (à ailerons naissants,dégagés ou récurrents). Or, d'après les cartes
précédentes, ces mêmes armatures à aileronsnaissants et dégagés sont présentes au sud/sud-ouest du bassin de la Seine. Les assem-blages attribués au Gord seraient-ils alors situéspréférentiellement au sud/sud-ouest ? D'après lafigure 5, seul un assemblage sur quatre permetde supposer le contraire : Grands Laviers (no 31)situé dans la Somme et possédant des armaturestrapézciidales à bords quasiment parallèles.
L'-analyse de la figure 6 a pour objectif derépondre à la troisième question : les typesprésents varient-ils en fonction de la naturede l'occupation ? Seuls trois types sont trouvésexclusivement dans un contexte : les armafurestriangulaires à base rectiligne (type 310) etles foliacées à base convexe (type a2Q sontdécouvertes en habitat, les armafures foliacéesà base appointée (type 410) uniquement ensépulture. Certaines classes et dâutres typesdépendent aussi du contexte : c'est le cas desarmatures trapézoïdales (plus fréquentes et plusvariées en contexte sépulcral), des armafuresà pédoncule et ailerons (proportionnellementplus fréquentes en habitat), du type à ailerons
Première caractérisation des industries lithiques du 3" millénaire en Centre-Nord de la France I11
II0*t|
: présence d'armature trapézoidale à bords quasiment parallèles
: présence d'armature à pédoncule et ailerons dégagés
: présence d'armature à pédoncule et ailerons naissants
: assemblage attribué au S.O.M.
: assemblage attribué au Gord
Fig. 5 - Situation des assemblages de catégorie A attribués au SOM ou au Gord avecdes armatures trapézoïdales à bords quasiment parallèles (type 520), quasiment sécants(type 530), des armatures à pédoncule et ailerons naissants (type 110) ou dégagés (type 120).
60
50@oo,8 + oEoo
_E 30rcp8 2 05o
1 0
01OO-habitat 100- 20O-habitat
sépulture200- 3OO-habitat 300- 40O-habitat 400- SOO-habitat 500-
sépulture sépulture sépulture sépulture
Classes
n Type to @ Type 2o ! Type go I Type 4o
r M
@ Mffi n f f i t-l
Fig. 6 - Quantité dâssemblages de catégorie B en fonction des classes, des types d'armatures présents et du contexte.
1r2 Caroline RgNaRp
équarris (le plus courant de la classe L00 encontexte funéraire).
Enfiry f influence méridionale, présente sousforme d'armatures à pédoncule et ailerons déga-gés à bords barbelés et de losangiques asymé-triques, est celle qui apparaît le plus clairementdans le bassin de la Seine. Lorigine de cesdernières serait "d'obédience péri-Ferrières,(Saintot, 1998); elles sont datées en Suisse dela première moitié du Néolithique final selonM. Honegger (2001). Des armatures à pédon-cule et ailerons dégagés à bords barbelés sontmentionnées dans le Centre-Ouest et les Causses(D. Hamart in Bach, 1995) et datées en Suissede la deuxième moitié du Néolithique finalselon M. Honegger (2001). Ces influences sup-posées se manifestent sous forme de quelquesexemplaires : elles sont donc à considérer avecprécaution.
5. CoNcrusroN
Malgré les limites imposées par une étudebibliographique, chaque question posée au dé-part a obtenu des éléments de réponse. Commeil a été exposé en introduction, l'armafure deflèche est un outil dont la charge informativeest considérable pour deux raisons : f investis-sement en temps et en matière première aumoment de sa réalisation peut être considérable,et sa morphologie est très variable. Au vu desrésultats obtenus, cette variabilité a une signi-fication culturelle, chronologique, contextuelleet spatiale et cet outil semble prendre uneimportance particulière à la fin du Néolithique.
Compte tenu du nombre d'armatures quirestent à documenter (environ 500), la massed'informations à en extraire devrait être as-sez conséquente : cela permettra probablementd'approfondir et de préciser les apports de cemémoire concernant la typologie, lévolutionmorphologique supposée et l'existence de deuxsecteurs dans le bassin de la Seine. Mais l'intérêtd'une étude plus complète réside aussi dansde nouvelles problématiques concernant les in-fluences extérieures et la technologie lithique. Lesupport choisi, le schéma de fabrication et la re-touche pourraient être précisés d'après lbbserva-tion directe, améliorant ainsi nos connaissancessur l'industrie lithique de la fin du Néolithique.
Bibliographie
ANcrsN A.-M. & LEsorLocH M.-A., 1987. Lasépulture Seine-Oise-Marne de Verneuil-sous-Coucy (Aisne). Reaue Archéologique dePicardie, 34 :17-28.
BecH S., 1995. La sépulture collective deCuiry-les-Chaudardes " Le Champ Tortu >(Aisne). In : Actes du 19' colloque interrégio-nal sur Ie Néolithique, Amiens, 1992. RevueArchéologique de Picardie, no spécial 9 :155-164.
BarlrouD C., 1974. Le Néolithique dans Ie Bassinparisien. Supplément à Gallia Préhistoire, 2.Paris C.N.R.S., 433 p.,7 pl" hors-texte.
BarlrouD G. & BnÉznLoN M.,1968. r-"hypogéede l'Homme-Mort à Tinqueux. Bulletin deIa S o ciét é P r éhistori qu e F r anç ais e, 65 : 479 -504.
BnraRp C., CoruAUX R. & Ducnoce T., 1990.Un site d'habitat chalcolithique à GrandsLaviers (Somme). Reaue Archéologique dePicardie, 34 : L5-26.
BrneRo C., AunRv 8., BLeNCeUAERT G., Bou-RHrs I.-R., HanaseuE G., MaRrNvaL P.,PINET- C. & RopeRS A., 1994. Poses, LeVivier Le Clos Saint Quentin (Eure),l'occupation de la plaine inondable au Néo-lithique et au début de lâge du Bronze.Reaue Archéologique de I'Ouest,1"L : 53-LL3.
CanrauD R. & LecruEL E., 1967. La sépulturecollective de Bardouville, Carrière de Beau-lieu (Seine-Maritime). Annales de Normandie17 (4) :281-315.
CtleunoN P. & SaraxovA L., 1996. Chronolo-gie des sépultures du IIIe millénaire dansle bassin de la Seine. Bulletin de la SociétéPréhistorique Française,93 (1) : 103-L19.
CnueÉzY E. & MazIÈnE G., l99L.Iihypogée IIdu Mont-Aimé à Val-des-Marais (Mame).Note préliminaire. In : Actes du 15' colloqueinterrégional sur Ie Néolithique (ChâIons-sur-MArne, 1988) :117-136.
FaIoN P., 1984. Le Néolithique final du bassin deI'Yonne. Mémoire de Maîtrise, Université deParis I.
FnaNçoIS-LANGRv F., 2002. Implantations hu-maines au III' millénaire aaant l.-C. dans lesdépartements de I'Aube et de I'Yoruee. Mémoirede Maîtrise, Université de Bourgogne.
HoNEccER M., 2001". L'industrie lithique tailléedu Néolithique moyen et finnl de Suisse.
Première caractérisation des industries lithiques du 3" millénaire en Centre-Nord de la France IIg
Monographie du C.R.A.,24. Paris, C.N.R.S.,349 p.
RnruaRp C., 2002. Implantation humaine auIII' millénaire en Seine-et-Marne.Mémoire deMaîtrise, Université de Paris I.
Roraxp A., 1935. Découverte d'une grotte fu-néraire néolithique à Villevenard (Marne).Bulletin de Ia Société Préhistorique Française,32 (6) :321-326.
Sarruror S., 1998. Les armatures de flèchesen silex de Chalain et Clairvaux. GaIIiaPréhistoire, 40 : 204-241.
SereNovR L., AucrRrau A., BRururr p.,BnuNEr V., Corrraux R., Hevtotrt T.,]aurNrau C., MrrrE B. & ponoNr A.,
2000. Le III' millénaire aaant l.-C. dans leCentre-Nord de la France : définitions et inter-actions des groupes culturels. Ministère de laCulture, Projet de Programme Collectif deRecherche.
WanrÉ I.-P., 1987. Aspects du Néolithique et deI'Age du Bronze en Seine-Maritime. Mémoirede Thèse, IJniversité de Paris I.
WanrÉ I.-P., 1990. Le Néolithique en Seine-Maritime. Supplément au Bulletin trimes-triel de la Société Géologique de Normandieet des amis du musée du Havre, 77 (2).Éditions du musée du Havre.
Adresse de l'auteur :
Caroline RsNenpDoctorante, Université de Paris I
UMR 7041, "Protohistoire européenne >)Maison de lArchéologie et de l'Ethnologie
21, aIlée de l'UniversitéFR-92023 NanterreCedex