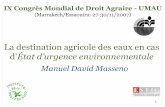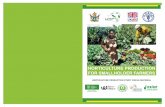Production agricole - l'IMIST
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Production agricole - l'IMIST
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 3
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Bactéries colonisant un champignon nématophage
Production agricole
Brèves Des champignons nématophages pour attaquer les parasites des cultures
Les nématodes, parasites des cultures, associés à la plupart des cultures tropicales et subtropicales, parasitent les espèces maraîchères (tomates, aubergines, etc.). Au cours de ces dernières décennies, la lutte contre ces nématodes phytoparasites utilisait essentiellement des produits chimiques très toxiques (bromure de méthyle, carbofuran,etc). L’utilisation de microorganismes antagonistes, bactéries ou champignons nématophages, se révèle aux scientifiques comme une alternative intéressante à ces traitements nocifs. Malheureusement, lorsque les agents microbiens, préalablement sélectionnés en laboratoire et testés en milieu contrôlé, ont été utilisés
dans des conditions réelles de production, les résultats se sont avérés aléatoires et finalement très insatisfaisants. Des recherches menées au Sénégal par des équipes de l’IRD (Institut de Recherche pour le
Développement- France) ont cependant montré que l’efficacité des champignons contre les nématodes du genre Meloïdogyne dans les cultures maraîchères pouvait être stimulée par la présence de bactéries augmentent de manière significative la production des organes permettant aux champignons nématophages de capturer et digérer le nématode. L’association de ces deux microorganismes a donné au champ des résultats convaincants. Pour en savoir plus www.itab.asso.fr www.ipgri.cgiar.org/publications/ Le bonheur est dans le pré ! Actuellement, la production agricole est plutôt fondée sur une utilisation intensive de produits chimiques. Pourtant, les pesticides sont loin d'être bénéfiques pour l'environnement. Ils vont jusqu'à empoisonner certains animaux, se retrouver dans les aliments et donc dans nos assiettes. Alors que diriez-vous d'utiliser plutôt la manière douce: de mignonnes coccinelles qui vont vous soulager des indésirables? C'est une alternative que propose le biocontrôle. Le biocontrôle est une lutte biologique contre les parasites. Il utilise des "guerriers naturels", tels que les insectes, les bactéries, les champignons, pour se débarrasser des ravageurs de cultures, insectes ou mauvaises herbes. Il ne consiste pas à les éliminer complètement mais à les contrôler selon les besoins, afin de maintenir la biodiversité. Concrètement, le biocontrôle se présente sous plusieurs formes. Les pièges peuvent utiliser des phéromones, attractifs sexuels, pour attirer les insectes nuisibles et les tuer. On prépare également des insecticides biologiques à base de protéines produites par le bacille de Thuringe, une bactérie trouvée en abondance dans le sol, de 10000 à 20000 souches de ce bacille, il faut donc identifier les plus efficaces et maximiser leurs effets. Le biocontrôle peut avoir recours au génie génétique. Par exemple, le génome d'une plante va renfermer des pesticides qui ne sont toxiques que pour les insectes nuisibles. Les plantes peuvent aussi être génétiquement modifiées pour résister à une gamme étendue d'herbicides ou pour devenir toxique pour un insecte. Pour en savoir plus www.agora.qc.ca www.scom.ulaval.ca
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 4
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Etats-Unis : Le clonage ne change pratiquement rien au boeuf et au lait Une étude menée par des scientifiques de l’Université du Connecticut et par des scientifiques au Japon a montré que le lait et la viande produits par du bétail cloné n’étaient pas significativement différents de ceux produits par du bétail conventionnel. L’étude publiée dans les rapports de l’Académie Nationale des Sciences a comparé 1000 échantillons de lait produit par des animaux clonés avec le lait produit par du bétail conventionnel et n’a pas trouvé de différences significatives. Les tests sur le bœuf ont eu le même résultat, renforçant les demandes de l’industrie de mettre en vente les produits clonés. Aquaculture et Qualité des Eaux naturelles L’entreprise « Aquaculture et qualité des eaux naturelles » à El Jadida, offre des aliments naturels de qualité destinés aux aquaculteurs pour des animaux aquatiques en élevage (poissons, mollusques, crustacés…). L’un des aliments de base est les Cystes d’Artémia naturellement récoltés, nettoyés, purifiés, traités et stockés dans des conditions scientifiquement bien étudiées. L’activité de cette entreprise permet de combler d’éventuels déficits relatifs à la demande du secteur des pêches et constitue un moyen efficace pour soulager la pression exercée sur les ressources halieutiques entre autres, par les exploitants. L’entreprise « Aquaculture et qualité des eaux naturelles » est le fruit d’un projet soutenu par le Laboratoire d’Hydrobiologie de la Faculté des sciences d’El Jadida. Il a été doublement parrainé par les sociétés SMVE Maroc (société marocaine de valorisation de l’environnement) et SMVE France. Contact Le Centre universitaire d’incubation de la faculté des sciences de l’université Bouchaib doukkali – El Jadida Tél. : 023 34 30 03 / 023 34 23 25
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 5
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Technologie et procédés Brèves Un emballage alimentaire qui repousse les insectes Une compagnie Japonaise – Dai Nippon Printing – a mis au point et commercialise des emballages alimentaires qui repoussent les insectes pendant plusieurs mois. Ces emballages contiennent un répulsif encapsulé dans des microsphères poreuses de silice (0,1 à 2 µm) qui se volatilise de la même manière qu’un additif alimentaire d’origine naturelle. L’avantage de l’utilisation de ces microsphères est double. La taille et la porosité des microsphères permettent de libérer, de manière lente, le principe actif pendant une longue période (environ 6 mois) et donc en très faibles quantités ; ce qui limite le risque de contamination de la nourriture par l’odeur du répulsif. La mise en œuvre de ces microsphères se fait en les incorporant, soit dans des encres soit dans des agents pour enduits, et sont ensuite appliquées sur les emballages en papier ou en carton par une technique similaire à l’impression classique. Pour les emballages souples, la technique d’application est encore à l’étude. Notons que l’utilisation d’insecticides qui agissent par contact direct entre le principe actif et les insectes n’est pas envisageable quand il s’agit de nourriture. Pour en savoir plus Dossier : «les emballages alimentaires» www.gret.org/tpa/bulletins/bulletin16/index.htm Contrôle optique en temps réel des produits carnés Des chercheurs, en génie productique et automatisation de l’Institut allemand Fraunhofer, ont développé un système optique de contrôle de la production des produits carnés. Ce système se base sur les propriétés de fluorescence des différents tissus qui constituent la viande. On peut donc relever tous les paramètres de contrôle de la production en temps réel, en flux continu et sans contact direct avec le produit. La mise au point de ce détecteur est inspirée des méthodes du génie biomédical. Le principe consiste à stimuler les produits métaboliques, présents dans les différents tissus du produit, à l’aide d’un faisceau lumineux. Selon leur composition chimique, les tissus osseux, musculaires ou graisseux, réagissent différemment et émettent une fluorescence caractéristique qu’on mesure ensuite par spectroscopie. Un algorithme prend en charge les données spectroscopiques pour identifier les types de tissus et pour caractériser et vérifier la qualité sur la ligne de production. L’équipe développe aujourd’hui l’aptitude du dispositif à identifier les variations des paramètres microbiologiques, chimiques et physiques des produits. Pour en savoir plus www.ipa.fraunhofer.de/
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 6
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Des serres légères et tout terrain! La société Française Alyzios a développé et breveté un nouveau concept de serres de production agricole modulables et rapides à monter. Dans le nouveau dispositif, les arceaux des anciens modèles de serres sont remplacés par des câbles d’acier permettant une plus grande souplesse à l’ossature de la serre. Le nouveau concept Alyzios est parfaitement modulable, il ne nécessite aucun nivellement du terrain, s’adapte à ses différentes formes et accélère la mise en place des serres. En outre, la mise en tension de la couverture plastique est assurée par un mécanisme centralisé. Les systèmes de tension des bâches et d'escamotage de la couverture permettent l'installation même sur des zones vallonnées. Les difficultés de remplacement des bâches plastiques, particulièrement par temps de vent, sont à présent surpassées et l’opération est plus rapide et plus sûre. Ce système, résistant aux intempéries, est également hermétique aux insectes et peut s’adapter aux différents systèmes technologiques de gestion du climat, de l’énergie et du contrôle phytosanitaire. Pour en savoir plus www.agrimondial.com Contact M. Bruno Schmitt [email protected] Un procédé pour éliminer le cholestérol de l’œuf et du lait Des chercheurs argentins du Conseil national de recherche scientifique et technique (CONICET) et de la Faculté de médecine de l’Université de Buenos Aires (UBA), ont étudié le Tetrahymena ; c’est un micro-organisme composé d’une seule cellule, capable de se reproduire des millions de fois en une journée. Mais le plus important est sa capacité à éliminer 90 % du cholestérol contenu dans le lait ou dans l’œuf. Le Tetrahymena ne réduit pas uniquement le cholestérol du lait et de l’œuf, il transforme également 5 % du cholestérol restant en pro vitamine D; très importante pour la formation des os. Ce micro-organisme est toujours en phase d’expérimentation dans les laboratoires. Cependant, plusieurs investisseurs privés s’y intéressent et sont en pleines négociations avec l’équipe de recherche argentine pour son application industrielle. L’agroalimentaire attend avec impatience du lait et des œufs nutraceutiques se rapprochant, dans leurs effets, des médicaments sans perte de saveur. Cette découverte émane d’un travail de recherche qui a été reconnu «d’intérêt scientifique et social» par le Sénat d’Argentine. Liens utiles www.conicet.gov.ar/ www.ciliate.org/ www.stolaf.edu/depts/biology/tetrahymena/
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 7
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Produits / Marchés
Accord de libre échange Maroc – Etats-Unis d’Amérique : Un marché potentiel pour les exportateurs marocains ! La conclusion d’un accord de libre échange avec les Etats-Unis d’Amérique s’inscrit dans la stratégie globale de l’ouverture de l’économie marocaine sur le marché mondial. Ayant une vocation exclusivement économique et commerciale, l’accord du libre échange avec les Etats-Unis a pour objectif d’organiser le développement des échanges de biens et services entre les deux pays. Il contribue également à consolider le processus de réforme et de modernisation économique engagé par le Maroc depuis plusieurs années.
La négociation de l’accord de libre échange (ALE) entre le Maroc et les Etats-Unis constitue la consécration d’un processus bilatéral marqué par une succession d’accords économiques entre les deux pays : Accord sur la non double imposition de 1977, Accord sur les investissements de 1985 et enfin, le Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) signé en 1995. Le TIFA constitue l’étape préliminaire à la conclusion d’un accord de libre-échange. Lancées en Janvier 2003, les négociations de l’ALE ont fait l’objet de sept rounds pour aboutir en mars 2004. Sous la coordination du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, des réunions se sont tenues avec différents départements ministériels et des représentants de diverses associations et fédérations professionnelles. Cette démarche basée sur la concertation et le dialogue entre les différents acteurs économiques nationaux visait à tirer le meilleur parti de cet accord et à arrêter une position marocaine commune et cohérente. Opportunités pour le Maroc Les échanges commerciaux entre le Maroc et les Etats-Unis sont faibles. Les Etats-Unis sont le 6ème client du Maroc et son 9ème fournisseur. Le Maroc, quant à lui, ne vient qu’au 73ème rang des partenaires commerciaux des Etats-Unis. Les économistes affirment que l’ALE avec les Etats-Unis revêt une grande importance pour le Maroc ; il accordera aux exportateurs marocains une plus grande ouverture du marché américain et aux importateurs du Maroc, une plus grande
compétitivité au niveau des sources d’approvisionnement. En outre, cet accord présente un important potentiel de croissance des flux des investissements américains. Il vise à développer l’attractivité du Maroc, aussi bien pour les investisseurs américains désireux de s’installer au Maroc et exporter vers les Etats -Unis, l’Europe, l’Afrique ou le monde arabe, que pour les entreprises d’autres pays voulant entrer sur le marché américain à des conditions préférentielles. En somme, les opportunités offertes au Maroc par la conclusion de l’ALE avec les Etats - Unis se résument comme suit :une réelle possibilité pour accroître significativement les exportations vers les Etats - Unis; l’amélioration de la compétitivité du Maroc en matière d’attractivité de l’investissement. La valorisation du Maroc en tant que plate forme de production et d’exportation.
Les exportations vers les Etats-Unis représentent 2,9 % du total des exportations marocaines, soit 2793 MDH. Les exportations vers le Maroc représentent
0,08 % du total des exportations américaines. Les importations en provenance des Etats -
Unis représentent 3,4 % du total des importations marocaines, soit 4382 MDH. Les importations des Etats-Unis en
provenance du Maroc représentent 0,03 % des importations totales américaines.
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 8
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Accès aux marchés Marocain et Américain Pour ce qui est de l’accès au marché, un calendrier de démantèlement tarifaire a été défini sur cinq paniers et sera appliqué dès l’entrée en vigueur de l’accord. Le Maroc a pu obtenir un accès libre à la quasi-totalité des produits industriels et de la pêche marocains sur le marché américain. Soit une exonération de 99,73 % des exportations marocaines dès l’entrée en vigueur de l’accord. Le démantèlement des droits d’importation sur les produits d’origine américaine à destination du Maroc a été fixé de la façon suivante : les produits fabriqués au Maroc sont dans le
panier 1 et seront démantelés sur une période de 9 ans (pour atteindre 0 % en 2013 si l’accord entre en vigueur en 2005); les produits non fabriqués localement ont été
répartis entre les paniers 1, 2 et 3 et seront exonérés complètement sur 5 ans ; les produits usagés sont placés dans le panier 5
et seront donc démantelés sur 10 ans. Différents secteurs sont touchés par l’ALE avec les Etats-Unis : industries agroalimentaires, industries du textile, de l’habillement et du cuir, télécommunications et e-commerce, propriété intellectuelle, etc.
Témoignages des professionnels du secteur agroalimentaire La conclusion de l’ALE avec les Etats-Unis a poussé les opérateurs de l’agro-alimentaire à découvrir les potentialités de ce « méga-marché » et à assimiler les conditions d’accès. Parmi les associations et les fédérations professionnelles du secteur qui ont été impliquées dans la conclusion de cet accord, nous citons : la fédération de l’agroalimentaire (FENAGRI), la fédération des conserves de produits agricoles (FICOPAM), l’association des exportateurs de fruits et légumes (l’APEFEL), la fédération nationale des minoteries, les semouleries du Maroc, et l’association nationale des viandes rouges. Le Directeur Général de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE) affirme que le marché américain, à très fort potentiel de consommation, est en fait constitué d’une multitude de marchés fortement segmentés, selon des critères régionaux, démographiques, ethniques, etc. L’exportateur est donc amené à repérer une niche de marché dans laquelle il présente un avantage compétitif. Il ajoute que « si les normes de distribution, les délais de livraison et les consignes commerciales sont respectées, la relation entre les deux parties peut s’inscrire dans la durée ». Pour sa part, le Directeur de la Production industrielle au ministère de l’Industrie, du commerce et de mise à niveau de l’économie, voit que les normes et les conditions sanitaires d’accès ne sont pas vraiment infranchissables. « Elles sont certes, très strictes mais claires et précises. Si les procédures sont scrupuleusement respectées, l’accès au marché se déroule sans grande difficulté », précise t-il. Les professionnels du domaine sont donc appelés à mutualiser leurs efforts pour pouvoir saisir les opportunités qui leurs sont offertes par l’ALE avec les Etats-Unis. L’accès au marché américain permettra sans doute une diversification des débouchés des exportations industrielles marocaines
.
.
Pour en savoir plus www.maec.gov.ma (Ministère des Affaires étrangères et de la coopération) www.mcinet.gov.ma (Ministère de l’Industrie, du commerce et de mise à niveau de l’économie) www.eacce.org.ma (Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations www.cabinetseddik.com : Cabinet SEDDIK
Calendrier de démantèlement tarifaire
Panier 1 : exonération immédiate ;
Panier 2 : démantèlement sur 2 ans ;
Panier 3 : démantèlement sur 5 ans ;
Panier 4 : démantèlement sur 9 ans ;
Panier 5 : démantèlement sur 10 ans.
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 9
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Brèves Un riz transgénique résistant à la bactériose Grâce au génie génétique, la Chine est sur le point de commercialiser une nouvelle variété de riz, le Xa21, qui contient un gène issu d’un riz sauvage africain. Ce nouveau riz transgénique a été identifié par l’International Laboratory for Tropical Agricultural Biothechnology (ILTAB), situé aux Etats-Unis, en collaboration avec l’Université de Davis en Californie. Les scientifiques garantissent que le gène transféré, le Xa21, ne présente pas de risques biologiques et permet au riz de résister à l’une des maladies bactériennes les plus néfastes aux cultures en Afrique et en Asie (la bactériose Xanthomonas oryzae). Les études en laboratoire menées par l’Académie des sciences agricoles de Chine et les tests en champs ont montré une diminution des pertes de production et de l’utilisation de traitements chimiques. Au-delà des effets bénéfiques attendus pour la riziculture dans les pays en développement, ce résultat offre de larges possibilités de transférer aux espèces cultivées, dans des délais rapides et avec des moyens modestes, la richesse génétique que recèlent les plantes sauvages. Pour en savoir plus : www.planetark.com Contact Claude Fauquet / ILTAB, Californie E-mail: [email protected] Des tomates nouvelle génération Une société Italienne vient de développer un nouveau génotype de tomate appelé tomate HighCaro (HC). Il s’agit d’une plante génétiquement modifiée dont les propriétés permettent d’accroître la teneur des tomates en carotène B. Cette dernière est produite par la conversion enzymatique de la lycopène présente dans les tomates et dans d’autres tissus. Des études agricoles ont montré que les tomates HC résistent mieux dans des environnements pauvres en eau et affichent un meilleur rendement par hectare par rapport aux autres légumes qui contiennent des quantités similaires de carotène B. Le béta-carotène, précurseur de la vitamine A, est un candidat anti-cancer très prometteur grâce à ses propriétés anti-oxydantes. La tomate HC pourrait ainsi être utilisée pour combler les déficiences en vitamines et servir de bio-usine pour la production à grande échelle de carotène B. Les procédures de dépôt de brevet de ce nouveau produit sont en cours. Les développeurs cherchent des partenaires afin d’augmenter la production et de commercialiser le produit final. Pour en savoir plus http://www.phytone.co.uk/french/carotene.htm Contact LECCE, Maria Giovanna E-mail : [email protected]
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 10
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Une nouvelle clé diététique grâce aux fibres végétales Une recherche franco – anglo - irlandaise a révélé que les produits riches en fibres risquent de trouver des débouchés fructueux, notamment dans la biscuiterie et la charcuterie. Ils présentent l’avantage d’être fonctionnels et nutraceutiques ; tels sont les deux critères qui intéressent les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques à la recherche de nouveaux produits. Onze végétaux, riches en fibres de bonne qualité nutritionnelle, ont été étudiés. Quatre sources de fibres particulièrement intéressantes ont été retenues : le blé, la pomme, le pois et le chou-fleur. Plusieurs produits ont été par la suite confectionnés pour tester la texture et le goût apportés par les fibres sélectionnées, en étudier la stabilité, ou encore afin d’observer leur comportement en présence d’autres ingrédients. Il s’agit de cakes, biscuits, sauces tomates, desserts et produits de charcuterie. Les retombées les plus concrètes concernent les pommes, le pois et le blé. Le chou-fleur possède de bonnes propriétés fonctionnelles et nutritionnelles mais l’aspect saisonnier de ce légume risque d’être une barrière à son utilisation industrielle. Pour en savoir plus www.hc-sc.gc.ca/foodaliments Contact: Fabienne GUILLON, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Tél.: +33-40675016 Du « Super maïs » en Chine De nouvelles variétés de maïs viennent d’être développées par le Centre de recherche sur le maïs de l’Académie d’agriculture et de foresterie de Pékin. Le Centre a sélectionné quatre combinaisons de maïs hybrides parmi environ 10 000 variétés, qui ont permis de produire près de 13 500 kg de maïs par hectare. Ces variétés ont des critères de rendement, de qualité et de résistance proches du super maïs. Rappelons que pour être qualifiée de « super maïs », la variété doit permettre un rendement de 15 tonnes par hectare, être résistante aux insectes et à la sécheresse. Pour en savoir plus www.most.gov.cn/eng/newsletters/2005
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 11
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Qualité et sécurité alimentaire
Peut- on réduire le risque alimentaire à zéro? Aujourd’hui, nous connaissons cinq fois plus de pathogènes que ce que nous connaissions auparavant. Nos connaissances en ce qui concerne les gens les plus vulnérables aux maladies, la façon dont les pathogènes se développent, la façon de rendre la nourriture plus sécuritaire et comment les microbes arrivent à nous déjouer se sont beaucoup améliorées au cours des 20 dernières années. En réalité, nous sommes maintenant en mesure de détecter des cas de maladies d’origine alimentaire qui étaient passés inaperçus il y a 10 ans. Le fait d’être mieux informé peut donner l’impression que les cas de maladies d’origine alimentaire sont en expansion fulgurante. Cependant, la connaissance n’est pas la coupable; au contraire elle démontre l’efficacité du système de production, de transformation et de mise en marché des aliments qui a permis d’augmenter le niveau de santé et la longévité de la population.
Il est évident que la nourriture, particulièrement celle qui n’a subi que peu ou pas de transformation, n’est pas stérile. Excepté les aliments mis en conserve ou irradiés, les aliments contiennent des micro-organismes, dont certains peuvent être dommageables pour certaines personnes sans toutefois l’être pour d’autres. Certains aliments sont reconnus comme comportant des risques plus élevés : fruits de mer consommés crus, œufs et viandes insuffisamment cuites, fruits et légumes non lavés, lait non pasteurisé, pour ne nommer que les plus connus. La question de savoir jusqu’où le risque est-il acceptable, demeure sans réponse. Mais il ne peut pas être réduit à zéro ! Ainsi assurer la sécurité alimentaire de l’humanité correspond à la capacité pour toute personne de posséder à tout moment un accès à une alimentation saine et suffisante pour mener une vie active en pleine santé. La sécurité alimentaire est d’abord biologique… Nous vivons parmi des micro-organismes comme des moisissures, des levures et des bactéries. Leur biodiversité est immense et la plupart sont nécessaires à la conservation de notre milieu de vie. Une minorité seulement de ces micro-organismes sont des bactéries ou des moisissures pathogènes, c'est-à-dire capables de provoquer des maladies. Bien que les virus et les prions ne soient pas reconnus spécifiquement comme des micro-organismes, ils sont considérés comme des agents pathogènes. Les infections ou les intoxications microbiologiques sont les principales causes de ces maladies que l'on peut imputer à l'alimentation. Les principaux agresseurs parmi ceux-ci sont: les moisissures et bactéries (par exemple: Salmonella, Campilobacter, Listeria); les virus (par exemple:
hépatites A et E) et les parasites (le ver solitaire, l'ascaris, le trichinella) … chimique, Des matières étrangères peuvent s'introduire dans notre alimentation, en provenance du milieu ou du processus de production lui-même. Il convient de faire une différence entre les contaminants, les additifs, les produits phytosanitaires, et les médicaments pour animaux. Les additifs sont des substances volontairement introduites, pour des raisons techniques, aux aliments lors de la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, l'emballage, le transport ou l'entreposage de denrées alimentaires dans le but de remplir à terme les exigences posées par le consommateur quant à ces produits. Ils sont considérés comme des ingrédients de l'aliment. Quelques exemples: agents de conservation, exhausteurs de goût, stabilisants, colorants, acides alimentaires, enzymes, anti-oxydants. etc. Les contaminants sont par contre des matières ajoutées aux aliments involontairement. Ils sont bel et bien présents mais ils proviennent, pour la plupart, du milieu environnant. Un exemple classique est celui des dioxines provenant des incinérateurs de déchets. Elles sont transmises aux vaches et aux poulets de batterie via l'herbe et se transmettent par cette voie au lait et aux oeufs. Les produits phytosanitaires : un produit phytosanitaire est un produit contenant une ou plusieurs substances chimiques ou micro-organismes, destiné à protéger ou améliorer la production agricole, ainsi qu'à l'entretien des zones non cultivées. Il est utilisé notamment pour : protéger les végétaux contre les organismes nuisibles (animaux, végétaux, bactéries), détruire les végétaux ou des parties de végétaux jugés indésirables, limiter la croissance des végétaux
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 12
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
(par exemple pour lutter contre la verse) et assurer la conservation des graines et des fruits.
Médicaments pour animaux : dans la production animale, des produits de protection sont également utilisés, à savoir les médicaments à usage vétérinaire. Les antibiotiques représentent un groupe important. La prescription, l'administration et la fourniture de médicaments pour animaux relève de la responsabilité du vétérinaire. C'est pour cette raison qu'une bonne gestion du stock et du registre des médicaments par les établissements d'élevage est indispensable. Le responsable des animaux doit respecter les conditions d'utilisation de la notice concernant le respect de la posologie (le dosage) et le délai de conservation.
…et aussi physique!
La contamination physique est causée par la présence de morceaux de métal, de verre, de plastique qui peuvent affecter l'alimentation. Ces métaux peuvent nuire à la santé. Cette contamination peut avoir lieu durant la récolte ou pendant le processus de production. Il existe des technologies très sophistiquées pour détecter et évincer les corps étrangers. Mais prévenir vaut mieux que guérir et ceci n'est possible que si l'attention nécessaire est apportée à la contamination tout au long de la chaîne de production.
En somme, que ce soit biologique, chimique ou physique, la sécurité alimentaire est confrontée à des risques. Toutefois, l’aspect scientifique du risque n’est plus le seul critère d’évaluation. D’autres critères à caractère sociétal interviennent pour juger le niveau du danger alimentaire.
L'analyse du risque : vers de nouvelles pratiques Une analyse du risque est une analyse méthodique de l'existence d'un danger pour comprendre sa nature et prendre les mesures de maîtrise adaptées. La procédure d’analyse du risque est composée de trois étapes : l’évaluation du risque, la gestion du risque et la communication du risque.L'évaluation du risque est définie comme ''une appréciation scientifique des dangers ou des dangers probables qui peuvent survenir dans un contexte déterminé.'' Les différentes étapes de cette appréciation sont: l'inventaire des dangers biologiques, chimiques ou physiques possibles, leur description, l'évaluation de l'exposition au danger et l'évaluation du risque final lié au danger. Sur la base des résultats de cette évaluation du risque, on peut déterminer le niveau de protection adapté et les mesures qui sont nécessaires pour y parvenir. C'est la gestion ou le management du risque. En ce qui concerne l'alimentation, la gestion du risque déterminera le
seuil de risque ; le risque qui peut être considéré comme acceptable. Il sera tenu compte des éventuelles alternatives possibles qui engendrent moins de risques. Quand il n'y a pas d'alternative possible, il peut être décidé d'accepter temporairement un risque plus important. Pour cette prise en compte, d'autres critères que les critères scientifiques peuvent intervenir, comme l'acceptation sociale. Par exemple : tant que l'utilisation de nouvelles technologies dans l'agriculture et l'alimentation, comme la modification génétique, ne sera pas suffisamment acceptée par la société, l'application de ces nouvelles technologies peut être interdite, ou des normes de sécurité plus sévères que celles indiquées logiquement par des évaluations scientifiques du risque peuvent être établies.
Tout au long de la procédure de l'analyse de risque, on doit fournir des explications. L’explication ne peut se limiter à l'information comme pour une notice, mais elle doit consister en une communication avec tous les intéressés. C'est ce qu'on appelle la communication de risque.
HACCP : outil de référence pour produire des aliments salubres acceptables Le concept « Hazard Analysis Critical Control Points » (HACCP) est né dans les années 40 aux États-Unis et a été utilisé et développé dans l'agro-alimentaire par la Pillsbury Company dans le cadre d'une coopération étroite avec l'armée américaine et la NASA pour assurer la sécurité alimentaire lors des programmes aéronautiques habités. En dehors d'applications très pointues, ce concept n'avait pas ou presque pas été utilisé par l'industrie alimentaire jusqu'à ce que l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), le Codex Alimentarius et la Commission Internationale pour la Définition des Caractéristiques Microbiologiques des Aliments (ICMSF) en fassent leur cheval de bataille pour la mise en place d'un référentiel international de production plus salubre. Aujourd'hui, l'HACCP est l'outil de référence en agro-alimentaire lorsque l'on parle de sécurité des aliments. La réglementation européenne a repris le concept HACCP dans les principaux textes de la nouvelle approche. Les règlements 852/2004, 853/2004 et 854/2004, publiés en avril 2004, imposent désormais la mise en place d'un HACCP qui respecte les principes du Codex Alimentarius. Ces règlements seront mis en application à partir du 1er janvier 2006. Une sonnette d’alarme est tirée pour l’industrie agroalimentaire nationale.
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 13
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Nous disons souvent "claire comme de l'eau de source" pour souligner la simplicité d'une idée. Cet adage ignore que l’eau n'est plus si claire, à cause des pesticides, nitrates et autres polluants…et c’est le cas de la salubrité de tout aliment source de vie. Veiller sur la sécurité alimentaire des humains c’est assurer la longévité
de leur vie. De leur part les législateurs éditent des lois et normes sécuritaires, les industriels respectent ces normes et l’être humain est un consommateur actif, plus exigent, plus informé sur les produits alimentaires qu’il consomme et souciant des aléas environnementaux de ce jour !.
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 14
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Brèves L'aloe vera, élixir de jouvence et plante aux immenses bienfaits. Ce n'était pas l'ignorance des vertus de la plante aloe qui retarda son utilisation mais ce fut le fait que son gel s'oxydait très vite et qu'on ne savait pas le conserver. L'aloe vera est un véritable bio-régulateur organique contenant plus de 140 substances actives. L’aloe recèle plusieurs éléments riches en: polysaccharides (acemannan), lignines, saponines (effet antimycotiques, anti-cholesterolemiante, régulateur du glucose), et anthraquinones parmi lesquelles certaines sont antibiotiques (barbaloine, isobarbaloine, acide aloétique, emodine d’aloe), d’autres tranquillisantes, anesthésiques ou analgésiques (ester d’acide cinnamique, huile etheriale, isobarbaloine, acide salicylique) ou encore fongicides (acide cinnamique, acide chrysophanique), anti-cancérigènes (bio et isoflavonoides). Elle contient du Tannin et de nombreuses vitamines A, B1, B2, B3, B6, B9, acide folique, B12, C, E et choline, inositol, niacine (régulateur métabolique)... Ainsi que des minéraux : calcium, phosphore, potassium, fer, sodium, chlore, manganèse, magnésium, cuivre, chrome, zinc, sélénium (anti radicaux libres), Elle contient également des enzymes dont certaines facilitent la digestion (cellulase, lipase, amylase, protéase) ou régulent les fonctions hépatiques (phosphatase alcaline), d’autres stimulent les défenses immunitaires (bradykinase), ou président à la vie du muscle (créatine phosphokinase)… Et enfin des acides aminés dont, parmi les essentiels, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, theonine, valine et acides gras essentiels. Pour en savoir plus www.biogassendi.ifrance.com www.univers-nature.com www.aloe-vera.org
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 15
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Matériaux au contact des aliments et Sécurité alimentaire La modélisation de la migration de composés d'un matériau en contact avec l'aliment est essentielle à la sécurité du consommateur. En effet, en Europe, la réglementation impose qu'aucun matériau ne cède plus de 60 mg de composés chimiques par kg d'aliment en contact. Cette réglementation s'applique aux équipements des industries agroalimentaires, ustensiles de cuisine et emballages. De plus, la migration spécifique de tel ou tel composé est réglementairement limitée en fonction de sa toxicité. Ainsi un composé toxique aura une Limite de Migration Spécifique (LMS) de 0 alors qu'un composé non toxique aura une LMS de 60 mg/kg d'aliment. Tout migrant a ainsi une LMS comprise entre 0 et 60 mg/kg. Dans le cas d'un contact entre un aliment et un matériau, la prévision de la date de franchissement de la limite de migration autorisée est importante et doit imposer la date limite d'utilisation optimum. Pour en savoir plus www.hc-sc.gc.ca/food-aliment www.caducee.net/DossierSpecialises/inra/Emballages_alim.asp La norme" de sécurité alimentaire Une toute nouvelle norme internationale est actuellement en cours de développement pour HACCP: ISO 22000. Cette norme de gestion de la sécurité alimentaire offre une réponse au problème de la "multiplication" des normes et référentiels HACCP qui existaient jusqu'à maintenant. Plus de 30 pays participent à l’élaboration de cette norme. Le Bureau de Normalisation du Québec (BNQ) s'assure du suivi du dossier, de rendre l'information disponible aux entreprises du Québec et, lorsque le moment sera venu, d'offrir la certification ISO 22000. La version finale de cette norme est prévue pour l'automne 2005. ISO 22000 est déjà perçue comme "la norme" de sécurité alimentaire qui deviendra l'exigence des clients, des producteurs et fabricants alimentaires de tous les continents. S'y préparer n'est déjà plus un choix... Contact Christine Dupuis, BNQ, (514) 383-1550
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique - IMIST page 16
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Consommation et nutrition
Le neem…l’arbre sacré Le neem, appelé aussi margousier ou lilas de perse ou encore chez les hindous « sarve roga nirvarini », c'est-à-dire l’arbre qui guérit toutes les affections et les maladies, est connu en Inde depuis des siècles pour ses vertus médicinales et thérapeutiques. Ses nombreuses substances qui exercent, entre autres, des activités anti-oxydantes, anti-inflammatoires, anti-bactériennes et immunostimulantes lui confèrent le titre de remède universel.
Originaire du sud de l’Himalaya, le neem est présenté dans les textes sanskrit comme une plante miracle car
toutes ses parties ont des vertus ; ses fruits, ses graines, son huile, ses feuilles, sa racine et son écorce sont utilisés depuis des siècles par la médecine ayurvédique pour traiter divers problèmes de santé et de nutrition. Très présent en Afrique, le neem appartient à la famille des Méliacées et sa hauteur ne dépasse pas 10 à 12 m au Sénégal, mais peut atteindre 25-30 m dans son pays d’origine (l’Inde).
Neem…usage agricole et alimentaire
L'huile de neem est un produit naturel qui peut être utilisé de différentes façons dans le soin des plantes. Elle agit sur les insectes nuisibles (les chenilles, les larves de coléoptères, les sauterelles, les araignées rouges, les cochenilles et les poux) en induisant leurs dégradations physiologiques et détruit les parasites par influence sur leur reproduction. Elle protège les plantes d'un nouvel envahissement d'insectes parasites avec une utilisation permanente pendant toute la période de végétation. Elle constitue aussi un répulsif effectif contre les moustiques et les mouches. En ce qui concerne le domaine alimentaire, les nutritionnistes confirment l’activité antioxydante d’extrait de graines de neem qui a été d’ailleurs démontrée in vivo ; l’extrait de neem réduit la peroxydation lipidique et simule l’activité antioxydante liée à la glutathion peroxydase (enzyme qui favorise l’antioxydation). Le même extrait diminuerait de façon significative les
niveaux de la glycémie et prévenait l’hyperglycémie induite par le glucose.
Neem…usage antiseptique
Des études ont démontré que des préparations à base d’extraits de neem sont efficaces contre plusieurs maladies de peau, de plaies ou de brûlures infectées. En outre, l’application de ses feuilles sous forme de cataplasmes ou de décoction s’avère efficace dans les cas de furoncles, d’ulcères ou d’eczémas. L’huile de neem est utilisée, quant à elle, surtout pour les pathologies cutanées comme les scrofules, les ulcères indolents ou l’herpès. Le neem promet aussi des pistes non encore confirmées en ce qui concerne les traitements anti-inflammatoires, hypotenseurs ou antiulcéreux.
Neem…usage anti-fongique et antibacté-rien
Les maladies fongiques sont traditionnellement traitées dans la médecine ayurvédique grâce à l’utilisation de l’huile de graine de neem, d’extraits aqueux et de la poudre de ses feuilles, ou par la fumée de ses feuilles sèches. Le neem a montré son efficacité contre certains champignons que les fongicides synthétiques ont du mal à contrôler. L’efficacité d’une préparation à base de neem sur des cultures de 14 champignons courants incluant des membres des familles, entre autres, des trichophytons (champignon qui infecte les cheveux et les ongles), des épidermophyton (herpès qui touche la peau et les ongles des pieds) et des microsporum (herpès qui touche les cheveux et la peau). Le neem exerce une action anti-bactérienne contre les micro-organismes tels le M. tuberculosis et des souches résistantes à la streptomycine.
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 17
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Neem…usage parodontal Une pratique ancienne du neem est l’utilisation de ses brindilles comme brosse à dents ; le neem prévoit efficacement la maladie parodontale. Les résultats d’une étude ont prouvé que l’extrait aqueux de tige de neem a des effets inhibiteurs sur l’agrégation, la croissance et l’adhérence de bactéries qui favorisent la formation de la plaque dentaire. Le neem inhibe effectivement la synthèse de glucans insolubles (dérivés insolubles de glucose) et pouvait réduire la capacité de certains streptocoques à se mettre à la surface des dents. Une autre étude a montré que le gel contenant l’extrait de neem a remarquablement réduit l’index de la plaque dentaire et le nombre de bactéries.
Neem…contre le paludisme et le cancer
Les populations du Niger et d’Haïti utilisent les feuilles séchées pour soigner la malaria. Cette dernière connue comme l’une des fièvres les plus fréquentes et les plus tueuses en Inde et sous les tropiques. Des extraits aqueux ou alcooliques de feuilles de neem ont montré leur efficacité contre des souches de parasites de la malaria sensibles ou résistantes à la chloroquine21. En ce qui concerne son activité anti-cancéreuse, les praticiens de la médecine
ayurvédique ont utilisé avec succès le neem pour réduire les tumeurs. C’est toujours l’extrait alcoolique de feuille de neem qui en est capable.
Le très fort intérêt du neem explique le nombre important de brevets déposés aux USA et au Japon pour ses diverses propriétés, ses principes actifs et ses processus d’extraction. On parle même de biopiraterie de cette plante miracle ; le service des contentieux de l'Office européen des brevets à Munich a annulé un brevet déposé en 1990 par le ministère de l'Agriculture des Etats-Unis et la firme multinationale W.R.Grace, basée à New York connue par son monopole du neem.
Pour en savoir plus www.neemfoundation.org www.afrik.com/article8336.html www.glfc.cfs.nrcan.gc.ca/mou www.fao.org
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 18
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Brèves Huile d’olive et cancer du sein Une série d'expériences conduites par des chercheurs américains de l'Université Northwestern à Chicago sur des lignées de cellules cancéreuses du sein ont montré que l'acide oléique, présent dans l’huile d’olive, réduisait de façon importante les niveaux du gène cancéreux appelé Her-2/neu encore connu sous le nom de «erb B-2». Les chercheurs ont observé des taux élevés de ce gène dans 20 % des cancers du sein. "Les résultats de nos recherches tendent aussi à confirmer les études épidémiologiques ayant montré que le régime alimentaire dit méditerranéen, riche notamment en huile d'olive, a des effets protecteurs contre le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le vieillissement", a noté le Dr Menendez, principal auteur de l'étude. Il est à noter que des études ont été conduites sur des populations du sud de l'Europe et avaient déjà montré que l'acide gras monoinsaturé pourrait avoir des effets protecteurs contre le cancer du sein, mais, selon les chercheurs américains, des expériences sur des animaux en laboratoire n'ont pas donné jusqu'à présent de résultats concluants. Les études épidémiologiques, d'expérimentations in-vitro ou effectuées chez l'animal s’accordent toutes pour estimer que l'alimentation est un facteur étiologique important des cancers. Pour en savoir plus www.food-info.net/fr/products/olive/ www.algerie-dz.com/forums/archive www.1sante.com/news/ Les vitamines E et C contre la maladie d’Alzheimer Une recherche américaine parue dans l'édition de janvier 2004 de Archives of Neurology a montré que les personnes âgées qui prennent régulièrement des suppléments de vitamines C et E à haute dose sont moins susceptibles que les autres d'être atteintes de la maladie d'Alzheimer. Pris en combinaison, ces antioxydants détruisent les radicaux libres qui causent la destruction des cellules du cerveau (neurones). Cette recherche vient confirmer deux autres études, réalisées en 2002, sur l’intérêt d’une alimentation riche en vitamine E ou en vitamine C et E pour diminuer le risque de la maladie d'Alzheimer, notamment chez les fumeurs. Selon des recherches préliminaires, les personnes qui consomment beaucoup de matières grasses d’origine animale et de calories pourraient courir plus de risques d’atteinte d’Alzheimer. Une étude japonaise a aussi montré que les habitudes alimentaires des personnes atteintes différaient sensiblement de celles du groupe contrôle : elles n'aimaient ni le poisson ni les légumes verts ou jaunes et mangeaient plus de viande que celles du groupe contrôle. Elles absorbaient donc moins de vitamine C et de bêta-carotène et consommaient nettement moins d'acides gras polyinsaturés oméga-3. Notons que la consommation à haute dose des vitamines E et C ne serait pas dangereuse pour la santé. Pour en savoir plus www.caducee.net/breves/ www.e-sante.fr/magazine
.
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 19
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Du chocolat contre la toux Des chercheurs du Collège Impérial de Londres ont découvert que la théobromine, un alcaloïde présent dans le chocolat, serait un antitussif plus efficace que la codéine. La théobromine inhibe l'activité des nerfs vagues qui provoquent la toux. Elle ne cause pas les effets secondaires de la codéine, en particulier la somnolence et n’exerce pas d’effets adverses sur le système cardio-vasculaire ou le système nerveux, ce qui pourrait permettre d'utiliser de plus fortes doses. Bon nombre de sirops contre la toux sont élaborés à partir de codéine ; « les sirops pour la toux fonctionnent principalement grâce à l’effet placebo : comme les gens pensent que le sirop agit, ils se sentent mieux. Mais il faut trouver de meilleurs remèdes pour l’avenir » explique Dr Peter J Barnes ; un des auteurs de l’étude. Afin de comparer l’efficacité de la théobromine avec la codéine, les chercheurs ont réalisé des essais sur dix volontaires, qui ont reçu un placebo, de la codéine ou de la théobromine avant d'être exposé à de la capsaicine (une molécule irritante que l'on trouve dans les piments). Il a fallu 30% de capsaicine de plus pour provoquer la toux chez les sujets qui avaient reçu de la théobromine que chez ceux qui avaient reçu de la codéine. Notons que la dose de théobromine utilisée dans l’étude correspond à celle que l’on retrouve dans 200 grammes de chocolat noir. Il reste cependant de le tester chez plus de volontaires afin de s’assurer qu’il est sécuritaire. Pour en savoir plus www.sur-la-toile.com/print_384.html www.healthandfood.be Un lait plus riche et un beurre qui ne durcit pas au frigo Anna Fearon, chercheur à l’Université Quenn’s (Belfast) à réussi à améliorer la qualité du lait pour le rendre plus bénéfique pour la santé humaine et d’en tirer un beurre qui ne durcit pas au réfrigérateur. Cela est possible en ajoutant des grains de colza au menu des vaches. Le colza est une plante riche en gras insaturés, meilleurs pour les artères que les gras saturés. Plus l’alimentation de la vache contient le colza, plus la proportion de bon gras du lait augmente. La consommation d’un kilogramme de colza par jour a donné un lait contenant 26 % en moins d’acide palmitique (un gras saturé) et 35 % de plus d’acide oléique (un gras insaturé). Le beurre issu de ce lait ne durcit pas au réfrigérateur car l’acide oléique est liquide à la température ambiante et solide mais encore mou à 4 degré Celsius (température d’un réfrigérateur). Ce beurre est déjà commercialisé en Irlande du nord.
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 1 – AVRIL 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 20
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Valorisation non alimentaire
La valorisation non-alimentaire : une révolution de l’agro-ressource Le non-alimentaire est un sujet en émergence. Ses acteurs sont issus d'industries très diverses allant de l'automobile à l'agriculture, en passant par les cosmétiques, le pétrole et les matériaux. L’avancée scientifique et technologique, la complexité des applications industrielles et les impératifs environnementaux poussent les entreprises et les chercheurs à remodeler leur vision de l’agro-ressource. Les industriels redécouvrent alors l’agro-ressource et réapprennent à la valoriser en utilisant des techniques devenues, avec le progrès technologique, économiquement viables.
Parmi les agro-ressources les plus utilisées dans le non-alimentaire, on peut retrouver les éléments nutritifs conventionnels (les glucides, les protéines et les lipides), mais leur valorisation est d’autant plus intéressante que la complexité des techniques mises en œuvre. Les glucides Elles regroupent plusieurs variétés dont les plus importantes sont : l’amidon, Le saccharose et Les fibres cellulosiques.
L'amidon est le polysaccharide le plus synthétisé par les plantes, après la cellulose. L’amidon brut est obtenu, par des procédés physiques, chimiques ou thermomécaniques, sous forme de poudre ou de sirop. Il est valorisé sous plusieurs formes : Polymérisée native Le Malto-dextrine et le maltose (substrats
chimiques pour oxydation, réduction et dégradation). Le glucose (substrat de fermentation pour
composés chimiques ou de polymères).
Le saccharose est une agro-molécule complexe qui trouve ses débouchés dans la fabrication de mousses polyuréthanes rigides ou des tensioactifs non ioniques et comme substrat de fermentation pour la production d'alcool, de levures, d'acides organiques ou aminés et d'antibiotiques.
Les fibres cellulosiques présentent deux constituants majeurs, la cellulose et les hémicelluloses. Ils sont valorisés par deux voies : chimique dans le cas des principaux
constituants des hémicelluloses : l'arabinose est utilisé comme émulsifiant et texturant et le xylose. sous forme de matériaux comme le papier, le carton, les nouveaux matériaux pour le textile ou autres industries et les dérivés
cellulosiques traités pour obtenir une fibrillation (épaississant, stabilisant, etc.). Les protéines À part la caséine du lait, l’exploitation des protéines d'origine végétale dans le domaine non-alimentaire est plus développée que celles d'origine animale. Les protéines végétales (albumine, globuline ou prolamine) offrent une grande variété de propriétés fonctionnelles et de nombreuses modifications chimiques et enzymatiques possibles (solubilité, propriétés tensioactives, propriétés gélifiantes et filmogènes et viscoélasticité). Elles sont utilisées en encapsulation de médicaments, comme tensioactif biodégradable ou améliorant de propriétés mécaniques… Les lipides La principale utilisation non-alimentaire des lipides est la fourniture d'acides gras pour les lubrifiants. On utilise les productions végétales appelées oléagineuses, car elles possèdent des acides gras intéressants comme les acides stéariques et érucique du colza et l'acide linoléique du tournesol. Ces agro-ressources trouvent leurs débouchés dans des secteurs aussi divers et hétérogènes que complexes. Quelques unes viennent concurrencer des produits prestigieux (pétrole, huiles minérales) et préparer leur transition, d’autres ont su se positionner grâce à leurs caractéristiques intrinsèques (renouvelables, biodégradables, etc.) en profitant des nouvelles notions du développement durable et responsable. Parmi les secteurs les plus développés, citons : les biocarburants, les biolubrifiants, les tensioactifs, les séquestrants et agents de blanchiment, les solvants, les biopolymères, les intermédiaires et adjuvants
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 21
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
chimiques, les produits pharmaceutiques et de cosmétique, les acides aminés pour l'alimentation animale, les combustibles d'origine agricole etc. Les biocarburants Il existe deux types de biocarburants développés sur le marché: l'éthanol qui sert à fabriquer l'ETBE (Ethyl tertiobutyl ether) lui-même incorporé dans l'essence et les EMHV (Esters méthyliques d'huiles végétales) destinés à être incorporés dans le gazole ou le fioul domestique. Ces incorporations ne nécessitent ni adaptation des moteurs, ni correction de l'injection, ni mise en place d'un réseau de distribution spécifique. Par ailleurs, les EMHV bénéficient d’un pouvoir anti-usure dans les gazoles à basse teneur en soufre, tandis que l'ETBE a un avantage qui concerne l'indice d'octane et la plus faible volatilité. A ce titre, l'adjonction d'ETBE dans les essences peut, sur le plan technique, accompagner avantageusement leur reformulation Les biolubrifiants La troisième génération des biolubrifiants correspond à des esters élaborés qui sont équivalents aux meilleures bases pour huiles minérales de synthèse destinées aux moteurs 4 temps. Leur meilleure biodégradabilité reste un avantage sensible puisque la moitié des huiles des moteurs usagées ne sont pas récupérées. Les tensioactifs Composants essentiels, entre autres, des produits d'hygiène et des détergents, les tensioactifs sont composés de deux parties : une partie lipophile et une partie hydrophile (principalement d'origine pétrolière). Il existe peu de tensioactifs 100 % végétales (glucide - alcool gras). Une première série APG (Alkyl Poly Glucosides) est entrain de faire une percée remarquable aux USA, en Allemagne et en France. Les séquestrants et agents de blanchiment Le marché le plus important est celui des séquestrants du calcium qui ont pour rôle de favoriser l'action des tensioactifs et d'éviter la redéposition des salissures. Deux voies sont disponibles: celle des amidons oxydés (de blé ou de maïs) et celle des dérivés de sucres et de mélasses. Les composants d'origine naturelle présentent des avantages notoires. Le consommateur cherche l’absence de toxicité et la biodégradabilité mais à des prix compétitifs.
Les solvants Compte tenu des nouvelles directives internationales concernant la toxicité de quelques solvants et les émissions de composés organiques volatils, plusieurs solvants d'origine pétrolière devront disparaître à l’horizon 2007. Les catégories des solvants visés sont ceux de type chloré, fluoré, et pour certains, hydrocarboné ou oxygéné. Les solvants à base végétale (à base d'esters d'huiles végétales ou de composés glycériques) peuvent remplacer les solvants d'origine pétrochimique dans de nombreux domaines d'application comme le nettoyage, la formulation de peintures, vernis et assimilés, l'élaboration de liants bitumineux pour la construction routière... Les biopolymères La cellulose est le biopolymère le plus utilisé en industrie. Certaines de ces applications (le papier) sont en croissance régulière. D'autres (les textiles artificiels) ont cédé la place à des polymères issus de la pétrochimie. Les amidons (du maïs, blé ou pomme de terre) sont très liés au papier et à son recyclage. Ils trouvent également d’autres applications dans les colles, le textile, l'hygiène, la dépollution, les peintures et l'agrochimie. En dehors de la cellulose et de l'amidon, aucun biopolymère ne peut concurrencer les grands thermoplastiques et thermodurcissables. Par contre, il existe des niches rentables, mais de taille modeste, pour des polymères tels que le xanthane, le polyhydroxybutyrate, les polylactates...La recherche dans ce domaine est active et les perspectives paraissent favorables en terme de valeur ajoutée. Les intermédiaires et adjuvants chimiques Ce sont les alcools, acides organiques, esters, éthers, cétones... Leur développement est dû essentiellement à l'amélioration des techniques biochimiques et séparatives. Dans le domaine des plastifiants, les huiles époxydées trouvent leur place grâce à leur avantage de meilleure rétention des composés volatils du produit fini. La production par fermentation paraîtrait prometteuse pour les acides acétiques et fumariques mais aussi pour d'autres acides tels que les acides propionique et butyrique.De plus, dans l'hypothèse d'une baisse régulière des prix de revient des produits agricoles certains marchés de produits à très gros tonnage
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 1 – AVRIL 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 22
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
pourraient devenir accessibles à la biomasse par des voies chimiques ou biotechnologiques (butanol...). Pharmacie, médical, cosmétiques, parfums De nombreux produits d'origine agricole sont utilisés en pharmacologie, soit pour extraire des molécules actives (antibiotiques), soit pour l'enrobage ou l'encapsulation de ces molécules ou leur transfert à travers la peau. En outre, les modifications génétiques des plantes permettent de produire des molécules élaborées: vaccins, vitamines, colorants, intermédiaires de synthèse. Les industries de la cosmétique sont également des utilisateurs importants de lipides et d'additifs d'origine naturelle. Les nouvelles valorisations dans la cosmétique peuvent être de deux types : constituer la matière active du produit ou en être l'excipient. Les acides aminés pour l'alimentation animale L'optimisation du coût et de la performance de l'alimentation animale passe par l'utilisation d'acides aminés de synthèse (essentiellement lysine et méthionine), en complément de l'apport d'origine naturelle. L'enrichissement en acides aminés, par modifications génétiques, des végétaux utilisés en alimentation animale fait l'objet, en particulier aux Etats-Unis, d'alliances, d'investissements et de programmes de Recherche & Développement, très importants, focalisés sur le soja et le maïs. Les combustibles d'origine agricole La combustion des composés lignocellulosiques de la plante en vue de la production de chaleur
et/ou d'électricité a un bilan énergétique et économique plus favorable que celui des filières des biocarburants. Toutefois, l'énergie produite sous forme de chaleur est difficilement distribuable et celle produite sous forme d'électricité (cogénération) suppose encore des progrès technologiques (gazéification) pour atteindre des rendements compétitifs. Finalement, la valorisation non-alimentaire de l’agro-ressource est considérée comme un passage obligé pour garantir la pérennité de la vie humaine sur terre et pour maintenir un rythme de croissance proportionnel au développement démographique et à l’épuisement des ressources conventionnelles. Beaucoup de gouvernements ont pris conscience de ce tournant. L’importance de la recherche scientifique et technique dans ce sens n’est pas un hasard.
Pour en savoir plus www.ifp.fr/IFP/fr/ifp/fb13.htm www.valbiom.be/intro.html www.iterg.com/
L’homme a besoin, pour se nourrir, de glucides, de protéines et de lipides. La valorisation non-alimentaire de ces éléments nutritifs lui en a fait découvrir d’autres usages…
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 23
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Brèves Du tournesol pour produire un biodiesel Pour valoriser le tournesol cultivé localement, des chercheurs, de l'Université de Tsukuba au Japon, ont mis au point une technologie qui permet de produire un biocarburant à partir de l’huile de tournesol. A cet effet, une entreprise a été créée et commercialise le produit au Japon et en Thaïlande. Le biodiesel en question est obtenu par une réaction de l'huile de tournesol et du méthanol. L’adjonction d’un additif spécial lui confère des caractéristiques intéressantes. L’une de ces caractéristiques est de ne pas se solidifier même à basse température. Ce projet s’inscrit également dans une logique de développement durable puisque le tournesol exploité sera cultivé à Tsukuba et dans la préfecture de Shimane. La production du biodiesel se limitera à Tsukuba. L'entreprise projette aussi d’exploiter des terres agricoles inutilisées dans le nord-est de la Thaïlande pour la culture du tournesol et produire localement le biodiesel. Lien utile www.pozza.org/tournesol/ Des plastiques biodégradables à base de maïs La société Plantic Technologies Limited (Australie) a mis au point un nouveau plastique, à base de maïs, biodégradable et plus facile à mettre en œuvre. Ses coûts de production et ses performances sont semblables à ceux des plastiques traditionnels. Il est également non toxique et peut être recyclé ou composté. Sa constitution est faite d'un mélange d'amidon naturel, d'amidon modifié, d'un polymère soluble ou d'un copolymère contenant des unités vinylalcool, du glycerol (un plastifiant polyol) et de l’acide stéarique (un acide gras). La plupart des produits similaires sont difficiles à mettre en œuvre à cause de la sensibilité de la structure moléculaire de l’amidon au cisaillement et à la température ; deux facteurs essentiels de transformation des plastiques. Le nouveau matériau de Plantic Technologies est fondu et mis en œuvre à 130 °C - 160°C, puis la température est réduite et le mélange est extrudé ou injecté dans un moule 85-105°C. Les premières applications concernent l’emballage des produits agroalimentaires (chocolat, biscuits, etc.). D’autres utilisations sont à l’étude ; des fabricants de GSM seraient intéressés pour la production de composants internes. Pour en savoir plus www.plantic.com.au/
Plus besoin de détruire la nature pour produire du papier Des chercheurs espagnols, du département d’Ingénierie Chimique de l’Université de Cordoue (UCO), étudient la possibilité de remplacer le pin et l’eucalyptus, largement utilisés dans la fabrication du papier, par des résidus agricoles. Les travaux se focalisent principalement sur les résidus d’espèces végétales, produits en Andalousie, tels que les tiges de tournesol, la paille des céréales, les tailles d’olivier, les tiges de coton et les sarments de vigne. Même si ces études n’ont pas encore été appliquées à l’échelle industrielle, les scientifiques se disent satisfaits des premiers résultats et les qualifient d’excellents. Les chercheurs de l’UCO travaillent également, en collaboration avec l’Université de Huelva, sur un projet qui a pour objectif de développer la culture d’espèces végétales à croissance rapide, telles que Leucoena, Paulonia et Tagasaste. Ces cultures permettront, non seulement, de diversifier les matières premières pour la fabrication du papier, mais aussi, de diminuer la charge sur les espèces actuellement utilisées, dont la croissance est plus lente et qui sont confrontées à la surexploitation. Liens utiles www.copacel.fr/ www.atl.ec.gc.ca/udo/wastepap_f.html www.greenpeace.fr/foretsanciennes/papier.php3
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 24
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Programmes de recherche Brèves
La recherche italienne séduit la Chine La Chine récolte les fruits d’une recherche italienne qui a donné lieu à la première plantation d’OGM à ciel ouvert en Italie. Il s’agit de tomates génétiquement modifiées capables de repousser les assauts du virus de la mosaïque du concombre (CMV) qui a menacé d’extinction les plantations de San Marzano ces dernières années. La technique a été brevetée en 2001 par le Laboratoire Metapontum Agrobios, mais n’a pas pu être exploitée vu l’impossibilité d’utiliser des semences OGM en Italie jusqu’à 2006, ou même au-delà de cette date. Ce brevet séduit la Chine, où les installations pour la transformation des tomates sont rigoureusement « Made in Italy ». Il trouvera donc à Pekin ce que l’Italie refuse encore. Des spécialistes voient que des cultures résistantes aux virus, seraient pour ce pays, l’idéal pour envahir les marchés européens. Il est à signaler que malgré l’approbation par le gouvernement italien de la liberté de choix en matière d’OGM qui permettrait, à partir de 2006, la coexistence des cultures biologiques, traditionnelles et génétiquement modifiées, le futur des OGM en Italie dépendra de la volonté des régions qui, pour la quasi totalité, se sont déclarées « sans OGM ». Pour en savoir plus www.ifn.asso.fr/publi/lettre/52.htm Les pois chiches: une solution de rechange pour le soja Si le soja est connu par ses graines très nutritives et riches en huile, il est susceptible de provoquer des allergies. C’est dans ce cadre que l’Union Européenne finance un projet de recherche CHICKFOOD qui porte sur la mise au point de nouveaux types de pois chiches qui pourraient remplacer le soja dans la production de produits alimentaires. Les chercheurs ont affirmé que les pois chiches sont une source végétale de protéines et de substances phytochimiques susceptibles d’être non allergéniques. Ils présentent des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles exceptionnelles qui les rendent très intéressantes pour l’alimentation humaine. Différentes variétés de pois chiches ont été étudiées du point de vue de leur teneur en protéines, flavonoïdes et saponines. La valeur nutritive des pois chiches dépend des méthodes de cultures et des conditions climatiques. Un procédé d’extraction des protéines a été mis au point, mais il revient plus cher que le procédé d’extraction classique du soja. Bien que les pois chiches ne soient pas toujours viables commercialement en tant qu’agents moussants, émulsifiants et gélifiants, ils pourraient servir sous forme d’ingrédients actifs dans des produits à base de protéines texturées. Le projet CHICKFOOD jette les bases d’une amélioration de la qualité nutritionnelle des pois chiches. Les porteurs de ce projet sont à la recherche de partenariats académiques et industriels et de collaborations en matière de soutien au développement. Pour en savoir plus www.chickfood.info/ Contact AVNI, Noam E-mail: [email protected]
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 25
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Etude des bienfaits des aliments fonctionnels Un projet de recherche financé par l’Union Européenne vient de prouver les vertus bénéfiques des aliments fonctionnels pour l’amélioration de la qualité de vie et la santé humaine. L’étude a porté sur la caséine phosphopeptide (CPP); un type d’ingrédient alimentaire nutraceutique / fonctionnel utilisé dans l’alimentation et les produits pharmaceutiques. Des recherches ont été menées sur la production, l’utilisation, l’efficacité et la sûreté de ces peptides fixatifs de minéraux. Grâce à ce projet, on a pu valider un outil très utile servant à la détection et à la semi-quantification de mélanges de CPP pouvant être utilisés dans des aliments fonctionnels. Il comprend un nouveau dosage enzymo-immunologique qui permet, non seulement, de contrôler les adjonctions de fragments de CPP dans les produits alimentaires mais également de vérifier leur présence après traitement ou stockage. Pour avoir des résultats plus exploitables, ce projet a également étudié les caractéristiques physico-chimiques et fonctionnelles de coproduits pauvres en CPP. En outre, le potentiel allergène de la CPP a été évalué et aucune réaction grave n’a été constatée chez les consommateurs allergiques ingérant de la CPP. Ce projet a donc permis le développement des connaissances scientifiques sur la CPP. Il intéresse à la fois, les nutritionnistes, les cliniciens et les législateurs. Pour en savoir plus http://www.agr.gc.ca/ Contact Richard, FITZGERALD / University of Limerick E-mail: [email protected] Pour un tabagisme plus sain ! Les scientifiques s’accordent tous sur le fait que les différentes formes de tabac – cigarettes, pipes et cigares- peuvent provoquer des cancers du poumon, des emphysèmes et autres maladies respiratoires. Une société de recherche italienne a découvert une méthode révolutionnaire permettant de réduire les composés chimiques dans la fumée de tabac, tout en préservant le goût et l’arôme de celui-ci. Le processus comprend trois étapes : l’extraction, la séparation et la restauration de la nicotine et des arômes. « Moins de composés chimiques pour un tabagisme plus sain », telle est la devise de ce projet de recherche. Il permettra de donner aux fumeurs, qui ne peuvent pas résister à la tentation de la cigarette, une chance de prendre du plaisir en limitant les risques pour la santé. Contact Giuseppe, SERRA E-mail: [email protected]
.
BULLETIN D’INFORMATION TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE NUMERO 2 – JUILLET 2005
Institut marocain de l’information scientifique et technique – IMIST page 26
CONS
OMM
ATIO
N ET
NU
TRIT
ION
PRO
GR
AM
MES
D
E R
ECH
ERC
HE
SOU
RC
ES
UTI
LES
PRO
DU
CTI
ON
A
GR
ICO
LE
TEC
HN
OLO
GIE
ET
PR
OC
EDES
PRO
DU
ITS
/ M
AR
CH
ES
QU
ALI
TE E
T SE
CU
RIT
E A
LIM
ENTA
IRE
VALO
RIS
ATI
ON
NO
N AL
IMEN
TAIR
E
Sources utiles GOURMET : salon des avides d’information Du 14 au 17 septembre 2005, se tiendra au Centre International des Foires et Congrès de Tunis (Tunisie) la 4ème édition du salon international de l’ alimentation : GOURMET. GOURMET est l’occasion pour gagner de nouveaux clients, présenter de nouveaux produits et services, augmenter la vitesse et le volume des ventes des entreprises et renforcer leur image de marque. Ce salon est ouvert à toute entreprise qui œuvre, entre autres, dans l’activité des ingrédients et additifs, des produits laitiers et œufs, des viandes et triperies fraîches, des volailles et gibiers frais, des poissons, mollusques, crustacés frais et semi – conserves, de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie, de l’horticulture, de la charcuterie et des salaisons Pour plus d’information www.sogefoires.com.tn/sw_fr/sls/gourmet.htm www.eventseye.com/index_fr.html
HORTIMAT : rendez-vous de la production horticole et maraîchère. Du 07 au 09 septembre 2005 se tiendra au parc des expositions à Orléans val de loire (France) le salon international des matériels et des techniques de production horticoles et maraîchères HORTIMAT. A la fois un salon au cœur d'un bassin de production, un salon technique convivial à dimension humaine et un salon de business conçu pour les filières de l'horticulture, de la pépinière, du maraîchage, HORTIMAT est l’occasion de rencontrer les acteurs professionnels du domaine maraîcher. Pour retrouver la liste des exposants au salon, le concours de l’innovation organisé à la marge du salon ainsi que la revue de presse qui s’y rattache, consulter le site www.hortimat.biz/
Salon international du vin Les 29 et 30 novembre et le 1er décembre 2005 se tiendra à Ifema - Parque Ferial Juan Carlos I à Madrid (Espagne) la 6ème édition du salon international du vin. L’Espagne est le troisième producteur de vin au monde, juste derrière la France et l’Italie. Le salon est ainsi une occasion pour les entreprises qui oeuvrent dans le domaine du vin, de la viticulture et des spiritueux pour s’informer en nouveautés techniques et technologiques relatives aux machines, aux procédés de fabrication. C’est aussi une occasion pour conclure des accords de coopération et des partenariats avec les entreprises étrangères. Pour plus d’information www.salondelvino.com/
BioFack America : Hommage aux aliments Bio Du 09 au 11 septembre 2005 se tient à Washington D.C. Convention Center (Etats-Unis) BioFack America ; le salon des produits bio. BioFack America est l’occasion pour les entreprises marocaines pour mieux s’informer en nouveautés relatives au monde des produits bio ainsi que sur les marchés potentiels à conquérir. Le secteur de l’alimentation biologique constitue un créneau porteur pour l’industrie agro-alimentaire marocaine et l’opportunité pour diversifier ses débouchés. L’édition 2004 du salon était l’occasion de rencontre de 20 681 visiteurs avec 193 entreprises de 14 pays qui ont exposé leurs produits bio. Plus de 80 % de ces entreprises ont estimé que ce salon était une réussite. Pour plus d’information www.biofach-america.com
Abonnement au Bulletin d’Information Technologique Agroalimentaire L’abonnement au BIT agroalimentaire est gratuit pour sa première année de publication (numéros trimestriels 1 à 4 - avril 2005 à janvier 2006).
A compter du numéro 5 (avril 2006), le tarif d’abonnement sera de 400 DH HT pour un an, soit 4 numéros.
L’abonnement au BIT inclut un service d’alerte par courrier électronique, qui vous apporte régulièrement des informations concernant le domaine agroalimentaire, relatives à : des opportunités d’affaires, des événements majeurs : congrès, salons, manifestations… des nouvelles publications et sources d’informations pertinentes, des réponses rapides à des demandes d’informations ponctuelles (hors frais
éventuels d’achats d’informations)
Envoyer le présent coupon d’abonnement dûment rempli par fax à l’attention de :
Mme Nassima Akariou, Fax : 037 68 63 87 IMIST-Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST).
52, bd Omar Ibn El Khatab. B.P 8027-10 102 Agdal- Rabat. Tél. : 037 68 14 62 Fax : 037 68 63 87 E-mail : [email protected]
Je souhaite m’abonner au Bulletin d’information technologique agroalimentaire
□ je souhaite recevoir gratuitement les numéros 3 et 4 et profiter du service d’alerte jusqu’en avril 2006 *
□ je souhaite recevoir gratuitement les numéros 3 et 4 et je m’abonne dès à présent pour les 4 numéros suivants (numéros 5 à 8) pour une valeur de 400 DH HT. Je souhaite également profiter du service d’alerte jusqu’en avril 2007 *.
Nom : ……………………………………………………………………………………….………………………..……
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale :…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………
Adresse postale :……………………………………………………………………………………..………….………..
……………………………………………………………………………………………………… ………………………
Tél. : …………………………………………………………………………………………………..……………….……
Fax : ……………………………………………………..……………….……… ………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………………………..……………..……………....
* ne pas oublier d’indiquer impérativement votre adresse e-mail