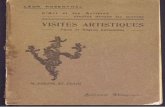Pratiques artistiques et enseignement-apprentissage des langues et des cultures à la rencontre des...
Transcript of Pratiques artistiques et enseignement-apprentissage des langues et des cultures à la rencontre des...
Pratiques artistiques et
enseignement-apprentissage
des langues et des cultures à
la rencontre des émotions
Expérience de stage à l’Atelier du Coteau,
centre de création et de loisirs artistiques
Anne-Lise Bécavin Sous la direction d’Andy Arleo
Mémoire de Master 2 Didactique des Langues et des Cultures Année 2014-2015
Faculté des Langues et Cultures Etrangères - Université de Nantes
Soutenu publiquement le 27 mai 2015
1
Résumés et mots clés
Cherchant à définir les liens étroits entre émotions et apprentissages et leurs implications
pour la didactique des langues et des cultures, ce mémoire relate un travail de recherche à
l’Atelier du Coteau, centre de création et de loisirs artistiques nantais. Au cœur des ateliers
multi-activités plurilingues, une artiste plasticienne iranienne accueille chaque semaine des
enfants de 3 à 8 ans pour un éveil artistique et un éveil aux langues et aux cultures où les
émotions sont au cœur de l’expérience proposée à ces jeunes apprenants. Comment les arts et
les pratiques artistiques peuvent-ils mettre à profit l’action des émotions dans des situations
d’éveil aux langues et aux cultures ? Fil rouge d’une démarche praxéologique, cette question
jalonne la présentation d’un parcours de recherche associé à un travail de terrain qui se
caractérise par une étude du contexte, la définition d’un cadre théorique et une analyse des
nombreuses données recueillies sur trois mois menant à la conception d’un dispositif didactique
original au confluent des arts, des langues, des cultures et des émotions dans la rencontre des
enfants avec l’Autre et l’Ailleurs.
Mots clés : émotions – apprentissages – éveil aux langues et aux cultures – arts – pratiques
artistiques – didactique des langues et des cultures.
Looking for a definition of how emotions underlie learning processes and what it implies
for the teaching of languages and cultures, this Master’s thesis deals with research conducted
at l’Atelier du Coteau, a centre for creation and artistic activities in Nantes. Inside the multi-
activities plurilingual workshop, a female Iranian artist receives every week children aged from
3 to 8 to provide them with a blend of awakening to arts and awakening to languages and
cultures that set emotions in the heart of these young learners’s experience. How can awakening
to languages and cultures activities benefit from the power of emotion thanks to the arts and
artistic practices? Following a praxeological approach, this question works as a thread through
the presentation of a research project associated with fieldwork. The presentation of the learning
context, the research literature and data analysis merge to help design an original teaching
program combining the arts, languages, cultures and emotions to allow children to experience
an enriching encounter with other people and other places.
Key words: emotions – learning – awakening to languages and cultures – arts – artistic practices
– teaching of languages and cultures.
2
Remerciements
Mes premiers remerciements vont à M. Andy Arleo pour son suivi bienveillant, ses
conseils éclairés et ses encouragements constants au fil de cette année et de ce travail. Sa
confiance en ma démarche et une passion partagée pour mon sujet de recherche sont les deux
véritables fondements de ce mémoire.
Je tiens également à remercier Elisa, Xavier, Mehregan, Hélène et Alexis de l’Atelier
du Coteau pour m’avoir accueillie en stage à leurs côtés et offert un terrain de recherche riche
entre pratiques artistiques et éveil aux langues et aux cultures. Je remercie tout particulièrement
Mehregan pour son accueil et la gentillesse avec laquelle elle m’a reçue dans ses ateliers. Un
grand merci à Hélène également pour son enthousiasme et ses nombreux conseils d’ancienne
étudiante du Master ; la passion avec laquelle elle exerce son métier a été une véritable source
d’inspiration.
Merci à tout le corps professoral du Master de Didactique des Langues et des Cultures
de l’Université de Nantes pour la qualité de leurs enseignements et de leur encadrement pendant
toute cette année. Je remercie notamment Madame Marie Salaün pour sa formation à la
réflexivité qui est et restera un de mes outils de travail les plus précieux, ainsi que Madame
Vaitea Jacquier pour toute la formation méthodologique et les conseils personnalisés qu’elle
avait à cœur de nous prodiguer dans ses cours. Je remercie aussi mes compagnons de promotion
pour le bout de chemin parcouru ensemble cette année : nos nombreux échanges, collaborations
et témoignages de soutien ont encouragé nos réussites individuelles et collectives.
Un grand merci à mes parents et à mes sœurs pour les longues discussions autour de
mon travail et leurs encouragements continus à toujours faire de mon mieux, ainsi qu’à Pierre
qui a su m’accompagner au quotidien et supporter les éclats de nerfs et de joie apportés par la
rédaction de ce mémoire en prêtant ses conseils et compétences à la relecture de mes écrits.
Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour mes anciens collègues professeurs
d’Edimbourg et pour leurs élèves, qui, il y a trois ans déjà, se sont prêtés au jeu de mes activités
artistiques dans leurs cours de français, me portant alors sans le savoir vers ce Master et ce
mémoire qui marquent l’aboutissement de cinq ans d’études passionnées.
3
Table des matières
Résumés et mots clés ................................................................................................................... 1
Remerciements ............................................................................................................................ 2
Table des matières ....................................................................................................................... 3
Sigles employés dans ce mémoire ................................................................................................. 8
Introduction au mémoire .............................................................................................................. 1
Chapitre I : Contexte de la recherche ............................................................................................ 3
Parte I. Présentation générale de l’Atelier du Coteau .................................................................... 4
I.1. Situation géographique et organisation des lieux ...................................................................... 4
I.2. Présentation de l’association ...................................................................................................... 5
I.2.a. Les activités de l’Atelier du Coteau ................................................................................ 6
I.2.b. Une association inscrite dans son quartier .................................................................... 7
I.2.c. De l’école à l’Atelier : une association impactée par la réforme des rythmes scolaires .... 8
I.2.d. Santé financière de la structure .................................................................................... 9
I.3. Valeurs et lignes de travail .......................................................................................................... 9
I.4. Vers une ébauche de formulation des objectifs de projet ........................................................ 10
Partie II. Les ateliers artistiques plurilingues ................................................................................ 11
II.1. Une mise en œuvre originale selon la dynamique de l’Atelier du Coteau .............................. 12
II.2. Acteurs des ateliers artistiques plurilingues ............................................................................ 12
II.2.a. Hélène et les ateliers musiques plurilingues ............................................................... 13
II.2.b. Mehregan et les ateliers multi-activités plurilingues ................................................... 13
II.2.c. Evènements communs ............................................................................................... 14
II.2.d. Les enfants ................................................................................................................ 15
II.3. Fonctionnement des ateliers multi-activités plurilingues ....................................................... 17
II.3.a. L’organisation de l’espace .......................................................................................... 17
II.3.b. Préparation, objectifs d’apprentissage et évaluation des AMP .................................... 18
II.3.c. L’organisation des ateliers .......................................................................................... 20
II.3.d. Le projet d’exposition ................................................................................................ 21
II.3.e. La place de l’éveil aux langues et aux cultures dans les ateliers multi-activités
plurilingues et le projet d’exposition ................................................................................... 22
II.3.f. Une occupation de l’espace symbolique entre pratiques artistiques et éveil aux langues
et cultures .......................................................................................................................... 23
CONCLUSION DU CONTEXTE ET PROBLEMES DE TERRAIN SOULEVES ......................................................... 25
Chapitre II : Cadre théorique .................................................................................................... 27
INTRODUCTION AU CADRE THEORIQUE .............................................................................................. 28
4
Partie I. Emotions et apprentissages ........................................................................................... 30
I.1. Les émotions dans le fonctionnement cérébral ........................................................................ 30
I.2. Le triangle émotion, cognition et motivation ........................................................................... 31
I.3. L’expérience physique des apprentissages ............................................................................... 32
I.4. Le pouvoir des émotions sur la mémoire .................................................................................. 33
I.5. Les émotions dans les situations d’apprentissage : une question fondamentalement
individuelle ...................................................................................................................................... 35
I.6. Le stress dans les apprentissages .............................................................................................. 35
I.7. Métacognition et réflexivité au service des émotions dans l’apprentissage ........................... 36
I.8. Cultiver l’intelligence émotionnelle .......................................................................................... 37
Partie II. Emotions et didactique des langues et des cultures ....................................................... 38
II.1. Evolution de la considération des émotions en didactique des langues et des cultures ........ 39
II.2. La question de l’anxiété langagière .......................................................................................... 40
II.3. Apprentissage d’une langue-culture et répercussions sur la personnalité de l’apprenant .... 41
II.4. Le cas particulier de l’enseignement-apprentissage de l’arabe............................................... 42
II.5. Premiers bénéfices de la prise en compte des émotions en didactique des langues et des
cultures ............................................................................................................................................ 44
II.6. Le concept d’empathie : une compétence émotionnelle clé pour l’enseignement-
apprentissage des langues et des cultures ...................................................................................... 45
II.7. Les approches plurielles à la rencontre des émotions en didactique des langues et des
cultures ............................................................................................................................................ 46
II.8. Implications de ces résultats dans la formation des enseignants ........................................... 48
Partie III. Au confluent des émotions et de l’enseignement-apprentissage des langues et des
cultures : l’apport des pratiques artistiques ................................................................................ 49
III.1. Les arts comme Disciplines Non Linguistiques d’exception .................................................... 50
III.2. Les émotions : amont et aval des pratiques artistiques ......................................................... 51
III.3. Réintégrer la place du corps dans les apprentissages ............................................................ 52
III.4. Arts et focalisation de l’attention ........................................................................................... 54
III.5. Le dessin à la découverte des représentations ....................................................................... 55
III.6. Neurones miroirs et empathie ................................................................................................ 56
III.7. Emotions, didactique des langues et des cultures et pratiques artistiques vers une
pédagogie de la créativité ............................................................................................................... 57
CONCLUSION DU CADRE THEORIQUE ................................................................................................. 60
IMPLICATIONS POUR LE PROJET DE RECHERCHE ................................................................................... 62
Chapitre III : Recueil et analyse des données ............................................................................... 65
INTRODUCTION AU RECUEIL ET A L’ANALYSE DES DONNEES .................................................................... 66
Partie I. Une association à la recherche d’elle-même ................................................................... 67
5
I.1. Un engagement personnel ........................................................................................................ 68
I.1.a. A l’arrière-plan d’un projet de vie, les émotions .......................................................... 68
I.1.b. Une association comme « deuxième maison » ............................................................ 69
I.2. Une démarche réflexive ............................................................................................................ 69
I.2.a. Les arts et les pratiques artistiques au cœur des réflexions .......................................... 70
I.2.b. Vers d’autres formes d’apprentissage ......................................................................... 71
I.2.c. Tension entre autonomie des intervenants et projet d’association ............................... 72
I.2.d. Le dialogue avec les parents ....................................................................................... 73
I.3. Un éveil aux langues et aux cultures informel .......................................................................... 74
I.3.a. La valorisation du locuteur natif .................................................................................. 74
I.3.b. Arts et éveil aux langues et aux cultures entre rencontres et distinctions ..................... 76
I.3.c. L’évaluation informelle ............................................................................................... 77
I.4. Bilan de ces analyses au regard du projet de recherche ........................................................... 78
Partie II. Les ateliers multi-activités plurilingues : cohérence avec les valeurs de l’Atelier du Coteau
et remarques didactiques ........................................................................................................... 82
II.1. Analyse des données recueillies sur les ateliers multi-activités plurilingues au regard du
fonctionnement et des valeurs de l’Atelier du Coteau ................................................................... 84
II.1.a. Exposition « Mehregan Kazemi et ses élèves » : la professionnelle et les amateurs en
miroir ................................................................................................................................. 84
II.1.b. Des ateliers multi-activités......................................................................................... 85
II.1.c. L’imagination, la parole et le corps : des valeurs de l’association aux valeurs des ateliers
multi-activités plurilingues .................................................................................................. 87
II.2. Analyse des données recueillies sur les ateliers multi-activités plurilingues au regard de la
didactique des langues et des cultures ........................................................................................... 89
II.2.a. Eveil ou apprentissage ?............................................................................................. 89
II.2.b. Un éveil aux langues et aux cultures non loin de l’Eveil aux Langues comme approche
institutionnelle ................................................................................................................... 91
II.2.c. Projet d’exposition et contraintes d’organisation ........................................................ 92
II.2.d. Des enfants des ateliers multi-activités plurilingues aux apprenants en éveil de la
didactique des langues et des cultures ................................................................................. 94
II.3. Emotions et rapport aux langues et aux cultures dans le travail de Mehregan ...................... 94
II.3.a. Le ressenti en tant qu’artiste animatrice des ateliers multi-activités plurilingues ......... 95
II.3.b. Rapport aux langues et aux cultures de Mehregan : vers la définition d’une biographie
langagière ........................................................................................................................... 96
II.3.c. Biographie langagière de Mehregan et perspectives de compréhension et d’évolution
des ateliers multi-activités plurilingues ................................................................................ 98
II.4. Bilan de ces analyses au regard du projet de recherche ........................................................ 100
6
Partie III. Recueil de données auprès des enfants et de leurs parents : biographies langagières et
enquête de satisfaction ............................................................................................................. 102
III.1. Portraits d’apprenants en éveil ............................................................................................. 104
III.1.a. Marie, Victor et Lucien : portraits d’apprenants du mardi ......................................... 105
III.1.b. Arthaud, Rosemay, Maya, Thomas, Adèle et Rose : portraits d’apprenants du mercredi
.......................................................................................................................................... 108
III.1.c. Marie, Alix et Agathe : portraits d’apprenants du vendredi ....................................... 111
III.2. Résultats de l’enquête menée auprès des parents ............................................................... 114
III.2.a. Pourquoi inscrire son enfant aux ateliers multi-activités plurilingues de l’Atelier du
Coteau ? ............................................................................................................................ 115
III.2.b. Que doivent apporter ces ateliers aux enfants ? ....................................................... 118
III.2.c. Ces ateliers donnent-ils satisfaction jusqu’à aujourd’hui ? ......................................... 120
III.3. Bilan de ces analyses au regard du projet de recherche ....................................................... 121
CONCLUSION DU RECUEIL ET DE L’ANALYSE DES DONNEES .................................................................... 122
Chapitre IV : Conception et mise en œuvre du dispositif didactique ............................................ 125
INTRODUCTION A LA CONCEPTION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DIDACTIQUE ............................. 126
Partie I. Conception du dispositif didactique .............................................................................. 127
I.1. Description du dispositif initial................................................................................................ 127
I.1.a. Vers la construction du dispositif initial ...................................................................... 128
I.1.b. Formulation du déroulement du dispositif initial ........................................................ 129
I.1.c. Justification du dispositif par rapport au contexte ...................................................... 130
I.1.d. Justification du dispositif par rapport au cadre théorique ........................................... 131
I.2. Evolutions dans la conception du dispositif ............................................................................ 133
I.2.a. La contrainte du temps .............................................................................................. 134
I.2.b. Pallier une contrainte, ajouter une limite ................................................................... 135
I.2.c. Autres limites du dispositif ......................................................................................... 136
I.2.d. Reformulation du dispositif définitif .......................................................................... 137
Partie II. Mise en place du dispositif ........................................................................................... 139
II.1. Premières séances .................................................................................................................. 140
II.1.a. L’Espagne avec le groupe du mercredi ....................................................................... 140
II.1.b. L’Inde avec le groupe du vendredi ............................................................................. 143
II.1.c. La Côte d’Ivoire avec le groupe du mardi ................................................................... 144
II.2. Deuxièmes séances................................................................................................................. 146
II.2.a. La Chine et l’Inde avec le groupe du mercredi ............................................................ 147
II.2.b. Le Japon et la Roumanie avec le groupe du mardi...................................................... 150
II.2.c. La Chine et le Moyen-Orient avec le groupe du vendredi ............................................ 153
II.3. Troisièmes séances ................................................................................................................. 156
7
II.3.a. Dessins, photos et échanges avec le groupe du mercredi ........................................... 156
II.3.b. Dessins, photos et échanges avec le groupe du mardi ................................................ 159
Partie III. Evaluation du dispositif et conclusion du chapitre ....................................................... 161
III.1. Bilan général : limites et apports du dispositif ..................................................................... 162
III.2. Bilan au regard des hypothèses de travail ............................................................................ 166
Conclusion du mémoire ............................................................................................................. 171
Bibliographie ............................................................................................................................. 175
Annexes .................................................................................................................................... 185
Annexe 1 : Extrait du livret de présentation des activités de l’Atelier du Coteau 2014-2015 ......... 186
Annexe 2 : Photos des lieux ....................................................................................................... 189
Annexe 3 : Statuts de l’association ............................................................................................. 191
Annexe 4 : Dossier d’inscription aux ateliers artistiques hebdomadaires ..................................... 194
Annexe 5 : Tableau d’intervention dans les écoles ...................................................................... 198
Annexe 6 : Journal de bord ........................................................................................................ 200
Annexe 7 : Grilles d’observation abandonnées ........................................................................... 224
Annexe 8 : Grilles d’entretiens ................................................................................................... 233
Annexe 8.1 : Entretien d’Elisa Commeyne et Xavier Fauvelle, directrice et trésorier-secrétaire de
l’Atelier du Coteau ......................................................................................................................... 236
Annexe 8.2 : Entretien de Mehregan Kazemi, artiste plasticienne animatrice des AMP et tutrice de
stage ............................................................................................................................................... 262
Annexe 8.3 : Entretiens des enfants. Biographies langagières. ...................................................... 285
Annexe 9 : Questionnaire à destination des parents ................................................................... 348
Annexes 9.1 : Questionnaires reçus ............................................................................................... 352
Annexe 9.2 : Bilan des questionnaires ............................................................................................ 375
Annexe 10 : Tableau adapté des compétences du CARAP ........................................................... 379
Annexes 11 : Evolution du dispositif didactique .......................................................................... 383
Annexe 11.1 : Photographies présentées aux enfants ................................................................... 391
Annexe 11.2 : Références des chants et musiques utilisés ............................................................. 396
Annexe 13 : Affiche de l’exposition ............................................................................................ 397
8
Sigles employés dans ce mémoire
AMP : Ateliers Multi-activités Plurilingues
CARAP : Cadre de Référence pour les Approches plurielles
CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
DLC : Didactique des Langues et des Cultures
DNL : Discipline Non Linguistique
EA : Enseignement-Apprentissage
ELCO : Enseignement des Langues et Cultures d’Origine
SEP : Sentiment d’Efficacité Personnel
1
Introduction au mémoire
Il y a 3 ans, je terminais une année d’assistanat à Edimbourg, en Ecosse, où j’ai eu la
chance de pouvoir enseigner le français et les cultures francophones dans trois collèges-lycées.
Cette expérience s’est révélée très riche tant on m’a fait confiance pour construire et mener des
projets intégrant les arts à l’enseignement des langues : cela m’a permis de monter une chorale
francophone, de créer des cours à base d’improvisation théâtrale et d’animer deux clubs de
théâtre dans l’optique de leur participation aux festivals des Rencontres Théâtrales organisés
par l’Institut Français d’Ecosse à Edimbourg et Glasgow. La rédaction d’un article relatant mes
expériences à la demande du SCILT – Scotland National Centre for Languages – s’est révélé
être le point de départ de nombreuses réflexions personnelles qui m’ont amenée aujourd’hui à
entreprendre un Master 2 en Didactique des Langues et des Cultures à l’Université de Nantes.
Forte du travail mené lors de cette année à l’étranger, mon intérêt pour l’intégration des
arts aux situations d’enseignement-apprentissage (désormais EA) des langues s’est intensifié.
Mes lectures m’ont fait prendre conscience qu’il y avait un réel engouement scientifique autour
de ce sujet. Je me suis rendue compte que l’un des dénominateurs communs entre les pratiques
artistiques et l’EA des langues et des cultures était les émotions, sujet sur lequel j’ai réalisé un
dossier au semestre dernier et qui forme les fondements du cadre théorique de ce mémoire. J’ai
alors souhaité approfondir mes connaissances et mes expériences par la pratique en effectuant
mon stage dans un lieu qui mêlait les arts aux langues et cultures afin de mieux percevoir la
place des émotions dans ce contexte où leur valorisation se confirmerait comme bénéfique au
parcours des apprenants dans leur découverte de langues et cultures étrangères. C’est ainsi que
j’ai pris contact avec l’Atelier du Coteau, centre de création et de loisirs artistiques à Nantes,
qui propose pour la deuxième année consécutive des ateliers artistiques plurilingues pour
enfants.
Comment les arts et les pratiques artistiques peuvent-elles mettre à profit l’action des
émotions dans des situations d’éveil aux langues et aux cultures ? Ma recherche de terrain à
l’Atelier du Coteau m’a avant tout permis d’effectuer un travail de compréhension de la
démarche de cette structure encore en lancement, et de faire le point sur les avantages et les
limites d’un enseignement à l’origine purement artistique qui s’est enrichi d’un éveil aux
langues et aux cultures sans projet didactique clairement défini. Ce mémoire se veut être un état
des lieux et un bilan de mes observations, lectures, analyses et actions vers une valorisation des
émotions des apprenants grâce à l’association des pratiques artistiques et de l’Eveil aux Langues
2
et aux Cultures 1 au sein de l’Atelier du Coteau. Pour commencer, nous détaillerons le
fonctionnement du lieu de stage comme contexte de mon projet de recherche avant d’effectuer
un état de l’art de la littérature scientifique concernant le rôle des émotions dans les
apprentissages et l’apport des pratiques artistiques à leur valorisation dans des contextes d’EA
des langues et des cultures. Puis, je présenterai mon travail dans la mise en place d’un dispositif
didactique permettant d’expérimenter la corrélation de ses éléments auprès des enfants inscrits
aux ateliers artistiques plurilingues de mon terrain de recherche.
1 Il convient de préciser au lecteur que je distingue l’« éveil aux langues et aux cultures » comme dénomination
générale qui caractérise le travail des artistes de l’Atelier du Coteau de la démarche officialisée par le Cadre de
Référence pour les Approches Plurielles (CARAP) qui sera alors mentionnée dans ce mémoire avec des
majuscules : Eveil aux Langues et aux Cultures.
4
Parte I. Présentation générale de l’Atelier du Coteau
L’Atelier du Coteau se présente comme un centre de création et de loisirs artistiques où
les arts et les activités de bien-être sont à l’honneur (L’Atelier du Coteau, 2015a). La variété
des ateliers proposés invite enfants, adolescents et adultes à se côtoyer au sein de l’association.
Le fonctionnement de l’association est central pour comprendre les dynamiques internes à
chaque activité car il pose les fondements de tout ce qui est réalisé au nom de l’Atelier du
Coteau.
I.1. Situation géographique et organisation des lieux
L’Atelier du Coteau se situe au 18, rue du Coteau à Nantes, dans le quartier de Procé, à
proximité du parc portant le même nom. Le centre se trouve dans une ruelle à sens unique très
peu passante, et seuls deux panneaux sur l’un des murs du bâtiment indiquaient son
identité jusqu’à fin avril 2015 : l’Atelier du Coteau et l’Ecole de Danse Elisa Commeyne (qui
occupe les mêmes lieux et est gérée par la même direction). Aujourd’hui, la façade présente
plus de signalétique : elle présente désormais l’Atelier du Coteau, l’Ecole de Danse Elisa
Commeyne mais aussi la Galerie 18 qui est l’espace d’exposition de l’association (voir photos
supplémentaires en annexe 2).
Façade du bâtiment avant fin avril
Façade depuis fin avril
Le bâtiment donne l’apparence d’une maison d’habitation sur deux étages. Un panneau
en plexiglas fixé à côté de la porte d’entrée présente diverses informations qui font l’actualité
du centre, à savoir l’affiche de l’exposition en cours ainsi que quelques documents présentant
les activités proposées par la structure et les horaires qui leur correspondent. Cette porte d'entrée
n’est pas l’accès principal de l’Atelier car elle donne également sur le lieu de vie des dirigeants
5
de l’association. L’accès principal se trouve derrière un grand portail en métal brun donnant sur
une cours invisible depuis l’extérieur qui permet d’accéder au centre par le côté du bâtiment.
Une fois à l’intérieur, les visiteurs sont accueillis dans un hall équipés de tables basses,
de chaises, d’un canapé et de quelques jouets en bois pour les enfants. Tous les murs sont peints
en blanc et le sol arbore un rouge soutenu. A l’entrée de ce hall, plusieurs flyers présentant les
activités des différents intervenants de l’Atelier sont à disposition sur une étagère et une table
basse. Les murs donnant directement sur la porte d’entrée sont couverts d’affiches présentant
les activités qui se déroulent dans l’association et spécifie les dates, horaires et tarifs de ces
prestations. La porte d’entrée fait face aux grandes portes battantes donnant sur la salle de danse
avec parquet de cent mètres carrés. Si le visiteur avance plus loin dans ce hall d’accueil, il arrive
dans l’espace comprenant table basse et canapé. Les murs présentent alors des œuvres en
exposition. Il s’agit du premier espace de la Galerie 18 qui présente les œuvres des artistes en
résidence à l’Atelier du Coteau. La pièce dessert d’un côté des toilettes et au fond le couloir
donnant sur le reste du bâtiment (et la suite de l’exposition de la Galerie 18), et de l’autre côté
les deux petits vestibules équipés de bancs en bois et de porte-manteaux. Le vestibule de gauche
donne accès à la salle de danse, et celui de droite permet d’accéder à la pièce nommée « atelier »
où se déroulent les activités qui ont fait l’objet de mon étude et dont je parlerai plus en détails
ultérieurement. Les deux vestibules sont isolés l’un de l’autre, mais il est possible de les faire
communiquer grâce à une porte située au fond de ces deux pièces mitoyennes.
I.2. Présentation de l’association
L’Atelier du Coteau est une association loi 1901 déclarée en préfecture depuis mars
2012. Elle est dirigée par Elisa Commeyne et Xavier Fauvelle, respectivement directrice et
trésorier de la structure. Ils sont depuis lors les deux seuls membres du bureau, ce qui se présente
pour eux comme un choix (voir entretien en annexe 8.1) : leurs parcours dans le milieu libéral
les a formés à être des professionnels indépendants et autonomes pouvant endosser des
responsabilités nombreuses et variées, compétences qu’ils ont tous deux dans leurs domaines
respectifs – les arts et la gestion – et qui se complètent pour faire fonctionner l’association.
Habitués à ne compter que sur eux-mêmes, ils pensent être plus réactifs à deux pour faire face
aux demandes des autres que s’ils étaient plus nombreux, et compensent en quelque sorte la
taille de leur bureau par un réseau fort de coopérations avec les artistes qui interviennent à
l’Atelier du Coteau. Ainsi, ils écartent les relations de subordination au profit d’un faire
ensemble qui correspond à leur ligne de pensée pour l’association et qui bénéficie à tous en
6
favorisant le transfert des compétences et le développement de l’autonomie de chacun, ce qui
sert en retour au bon fonctionnement de la structure (voir annexe 8.1).
Tous les intervenants viennent donc proposer leurs activités en indépendants mais
bénéficient de la gestion administrative et financière d’Elisa et Xavier qui leur mettent à
disposition un local, gèrent les dossiers d’inscription et offrent, par leur travail de
communication, un apport en clientèle. Ainsi, la prise de risque est limitée au noyau décisionnel
de l’Atelier du Coteau. Pour le moment, ce fonctionnement semble porter ses fruits car depuis
l’année dernière, année de lancement de l’association, le nombre de membres a doublé : il y a
aujourd’hui environ soixante membres inscrits pour des activités hebdomadaires, auxquels
s’ajoutent une trentaine de personnes supplémentaires participants aux stages proposés pendant
les vacances scolaires (voir annexe 8.1).
A ce système d’organisation doit être ajouté le fait que l’Atelier est aussi un lieu de
résidence artistique pour plusieurs artistes et compagnies qui bénéficient alors d’un espace de
recherche et de création au sein de l’association, ainsi que d’un espace d’exposition pour les
artistes plasticiens avec la Galerie 18 (L’Atelier du Coteau, 2015b). L’Atelier du Coteau se
dessine donc comme un véritable foyer de création où Elisa et Xavier prêtent leurs services aux
artistes et intervenants au profit d’un développement commun.
I.2.a. Les activités de l’Atelier du Coteau
Les activités proposées au sein de l’Atelier du Coteau concernent principalement les
pratiques artistiques comme la danse contemporaine (au sein de l’Ecole de Danse Elisa
Commeyne), le hip-hop et le lindy-hop, le théâtre, les arts plastiques, et le chant. A ces activités
s’ajoutent les ateliers d’éveil musical et de multi-activités dit multilingues destinés aux enfants.
Ces deux ateliers répondent à la dénomination d’ateliers artistiques multilingues que je
mentionnerai dorénavant comme ateliers artistiques plurilingues dans un souci de rigueur
didactique. Le contenu de ces ateliers sera précisé plus loin dans ce mémoire, ceux-ci étant
l’objet de mon travail de recherche. La danse et les arts plastiques sont également proposés en
interventions dans les écoles sur le temps périscolaire dans le cadre de l’application de la
réforme des rythmes scolaires (voir supra paragraphe I.2.c). Enfin, l’association héberge
également des activités liées au bien-être comme la danse des cinq rythmes, le do in shiatsu, de
la gymnastique stretching, des pilates, du qi-gong/taï chi chuan, de la sophrologie, du yoga, de
la danse libre et de la relaxation au gong (voir extrait du livret de présentation des activités en
annexe 1).
7
I.2.b. Une association inscrite dans son quartier
L’Atelier du Coteau est une association qui est très attachée à son quartier. Elle porte le
nom de la rue où se situe son siège social et ses activités, et l’espace d’exposition qu’elle a
développé est connu sous le nom de Galerie 18, rappelant encore une fois la situation
géographique de la structure au 18, rue du Coteau. Cet attachement particulier semble avant
tout être personnel, Elisa Commeyne ayant appris la danse depuis son enfance dans une école
rue Littré (à moins de 500 mètres de l’Atelier du Coteau). C’est aussi l’endroit où elle a fait ses
débuts en tant que professeure de danse jusqu’à ce que cette école soit démolie dans le cadre
des nombreuses constructions de logements qui façonnent encore le paysage du quartier. C’est
ce qui l’a poussé avec Xavier à établir son école de danse en 2010 rue du Coteau, projet qui
aura rapidement donné lieu à la création de l’association deux ans plus tard (voir entretien en
annexe 8.1).
Le fleurissement immobilier aux alentours semble être l’un des facteurs ayant déterminé
l’implantation de l’association à cet endroit afin de répondre aux besoins en loisirs artistiques
et de bien-être des habitants. Les nombreux travaux de construction renforcent la dimension
déjà très résidentielle du quartier où se côtoient maisons et immeubles de standing avec vues
sur le parc de Procé. Les professions des parents des enfants inscrits aux ateliers artistiques
plurilingues proposés par l’Atelier du Coteau confirment un profil relativement aisé des
environs, la majorité d’entre eux ayant un poste de cadre ou d’ingénieur ou exerce une
profession libérale dans le milieu de la santé (voir bilan des questionnaires en annexe 9.2)2.
Aujourd’hui, la communication des activités de l’Atelier est centrée de manière quasi exclusive
sur le quartier. Rien que pour les enfants participant aux ateliers multi-activités plurilingues, on
remarque que les écoles où ils sont inscrits se concentrent dans un rayon inférieur à 3 kilomètres
(voir portraits d’apprenants au chapitre III). Si l’on se fie aux lieux d’habitation des enfants
participants à ces mêmes ateliers, on remarque que le rayon est sensiblement le même, les
quartiers mentionnés par les parents ayant répondu au questionnaire étant Procé, Canclaux,
Zola, La Contrie et au plus loin Chantenay (voir les questionnaires en annexes 9.1 et leur bilan
en annexe 9.2). Le rayon d’intervention est similaire concernant les activités proposées par
l’association dans les écoles sur les temps périscolaires puisque les écoles les recevant sont les
écoles Châtaigniers, Ampère, Contrie, Dervallières-Chézine et Fraternité (voir tableau
d’intervention dans les écoles en annexe 4), toutes situées à moins de 3 kilomètres de l’Atelier.
2 Sur 14 parents ayant répondu au questionnaire, 9 d’entre eux font partie des cadres ou des ingénieurs, et 2 sont
dans le milieu libéral, totalisant 11 parents sur 14 au sein de ces catégories socio-professionnelles (voir bilan des
questionnaires en annexe …).
8
I.2.c. De l’école à l’Atelier : une association impactée par la réforme des rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires a été et continue d’être un vrai sujet de réflexion pour
Elisa et Xavier, car cette réforme n’a pas été sans conséquences dans l’organisation de leurs
activités destinées aux enfants. Elisa, qui auparavant proposait des cours de danse dès le
mercredi matin s’est vue contrainte de repenser son planning pour faire face à l’ajout d’une
cinquième matinée d’école pour les enfants. Mais cela ne s’est pas arrêté là car la réforme a
aussi inquiété les parents pour qui le changement de rythme allait poser problème en termes de
garde d’enfants, notamment le soir après l’école. C’est en ce sens que l’association a pris la
décision de proposer un service de pedibus suivi d’un temps calme de 16h à 17h à l’Atelier les
lundis, mardis, jeudis et vendredis pour permettre aux parents d’avoir quelqu’un qui se charge
d’aller chercher leur enfant à l’école et de le garder en sécurité jusqu’à ce qu’ils puissent venir
le récupérer, et ce, tout en valorisant alors les ateliers artistiques plurilingues se déroulant de
17h à 18h, puis de 18h à 19h les mêmes soirs. De fait, tous les participants inscrits à ces ateliers
sont également inscrits au service de pedibus.
La réforme des rythmes scolaires a conditionné en partie l’offre de l’Atelier du Coteau
auprès des enfants et de leurs parents, mais aussi auprès des écoles qui se retrouvent désormais
avec des temps d’activités périscolaires assurés partiellement par des intervenants extérieurs
professionnels. Ces temps privilégiés sont l’occasion pour les enfants de s’initier à certaines
pratiques artistiques, sportives et parfois mêmes linguistiques avec des initiations à l’anglais ou
des séances d’éveil aux langues. C’est dans ce cadre que l’association intervient régulièrement
dans certaines écoles, depuis la rentrée 2014, pour effectuer des animations en danse et en arts
plastiques. Ce type de prestations représente une véritable source de développement pour
l’Atelier du Coteau qui réfléchit et travaille à la valorisation des interventions de professionnels
des arts et du bien-être en milieu scolaire, et qui souhaiterait proposer pour la rentrée prochaine
des interventions dans huit disciplines différentes : arts plastiques, photographie, théâtre,
théâtre clown, hip-hop, sophrologie-relaxation et capoeira (voir entretien en annexe 8.1). Cela
reste encore sous condition de validation par la mairie de Nantes et les écoles, mais il s’agit
d’une part importante du travail de l’association qui pourrait s’avérer bénéfique aux finances
de l’Atelier.
9
I.2.d. Santé financière de la structure
L’Atelier du Coteau bénéficie de deux sources principales de financement, d’un côté les
apports personnels d’Elisa et Xavier notamment pour le lancement de ce projet associatif, et
d’un autre côté l’argent dégagé sur les inscriptions aux activités et les prestations réalisées dans
les écoles. Il s’agit là d’un système de financement limité, car l’association ne perçoit qu’un
pourcentage des frais d’inscription aux ateliers se déroulant entre ses murs ; en effet, l’Atelier
centralise l’argent versé par les personnes inscrites à chacune des activités, garde un
pourcentage pour assurer son propre fonctionnement (achat de matériel, impressions,
communication – affiches, flyers –, loyer, électricité, site internet, …) et le reste permet de
payer les factures remises par les artistes et intervenants pour couvrir le coût de leurs
prestations.
Ne touchant vraisemblablement pas de subventions, ce système ne permet pas à Elisa et
Xavier de se dégager un salaire. Cela est une source de préoccupation plutôt relativisée par le
noyau décisionnel de l’association qui revendique travailler avant tout par passion, dans un
esprit d’engagement citoyen envers les autres (voir entretien en annexe 8.1), et notamment
envers les enfants, leur éducation et l’accompagnement nécessaire à leur épanouissement
personnel, ainsi qu’envers les artistes qui sont souvent en manque de structures pouvant les
aider à se développer. De plus, Elisa considère que cela les oblige à rester actifs et réactifs pour
pouvoir faire face aux difficultés et aux besoins d’adaptation et d’évolution, attitude qui lui
semble moins évidente à conserver lorsqu’une association bénéficie de subventions régulières
où le confort financier apporterait le risque de plus d’oisiveté que de combativité (voir annexe
8.1).
I.3. Valeurs et lignes de travail
L’Atelier du Coteau cherche, malgré le caractère indépendant de tous ses intervenants,
à garder une cohérence d’ensemble autour d’un dialogue entre professionnels et amateurs. Par
les activités, les résidences et les expositions où les artistes sont présents pour présenter leurs
œuvres, la cohabitation et les échanges entre les deux groupes sont un point d’orgue de
l’association. Elisa n’hésite pas à invoquer le concept de « deuxième maison » (voir entretien
en annexe 8.1), et notamment pour les enfants pour qui l’Atelier représente souvent une
transition entre l’école et le foyer familial. Le dialogue entre professionnels et amateurs est
aussi pensé à leur échelle avec la réalisation d’un projet d’année qui les met à l’honneur en tant
10
que jeunes artistes grâce à un spectacle ou à une exposition des créations réalisées pendant
l’année.
L’approche actionnelle est alors au cœur du fonctionnement des ateliers de pratiques
artistiques où l’enfant est lui-même créateur, acteur de ses activités et accompagné dans la
recherche de son expression personnelle pour l’aider à mieux se comprendre et à évoluer dans
un parcours qui se veut complémentaire et à la fois différent des expériences scolaires. Le
décloisonnement entre les disciplines artistiques est pensé comme un moyen de développer
l’expression de chacun des enfants et de valoriser ce que la directrice définit elle-même comme
des intelligences multiples (voir annexe 8.1). L’apprentissage n’est pas perçu comme une fin
en soi mais comme un processus ludique qui peut revêtir des formes différentes de celles
véhiculées par l’école et qui s’inscrit particulièrement dans l’action.
Sept valeurs encadrent les activités de l’Atelier du Coteau : le vivant, le corps, la
réflexion, l’écoute, la parole, l’échange et l’imaginaire. Les deux premières sont mentionnées
comme globale et centrale, alors que les cinq autres sont définies comme périphériques dans
les statuts de l’association (voir annexe 3). Or, l’imagination est revendiquée comme un pilier
de travail majeur tant par Elisa et Xavier à la direction de l’Atelier que par Mehregan, animatrice
des ateliers multi-activités plurilingues (voir entretiens en annexes 8.1 et 8.2) et elle est de fait
très sollicitée avec les enfants. Il s’agit d’une opportunité de s’inventer en amont mais aussi en
aval de l’action pour pouvoir affirmer sa singularité, ainsi qu’une invitation à l’ouverture et à
la prise de recul sur les schémas préconstruits qui nous conditionnent. Les enfants gagnent alors
en perspective tout en pratiquant leur liberté de penser et de s’exprimer. Nous développerons
plus amplement ce point à d’autres reprises dans ce mémoire.
I.4. Vers une ébauche de formulation des objectifs de projet
Même si l’Atelier du Coteau ne peut répondre entièrement d’une logique propre à la
didactique, il me semble important de chercher à dégager des observations jusqu’alors
mentionnées quelques grandes lignes qui correspondraient aux objectifs de projet de
l’association et qui seront prises en compte plus loin pour la construction de mon dispositif. Ces
objectifs sont l’expression d’analyses personnelles que l’on ne pourrait attribuer officiellement
à l’association, celle-ci ne les ayant définis elle-même et n’ayant pas de structure interne offrant
une possibilité de réflexion à ce sujet de manière conjointe entre la direction et les artistes. Il y
a bien un dialogue d’établi entre Elisa, Xavier et les intervenants, mais il ne se réalise pas de
manière régulière, notamment sous forme de réunion de coordination par exemple. Cela reste
11
difficile à organiser en termes de disponibilité de chacun des acteurs tout en exigeant une
révision de la conception majoritairement indépendante des prestations des artistes et
intervenants de l’Atelier (voir entretien en annexe 8.1).
Tout cela pris en compte, je propose la formulation des objectifs de projet suivants pour
synthétiser les lignes de travail de l’association :
- Faire se rencontrer amateurs et professionnels vers un partage de pratiques,
d’expériences et de compétences nourrissant les deux partis ;
- Véhiculer et travailler autour de valeurs communes tout en respectant le caractère
indépendant et singulier de chacun des acteurs de l’association ;
- Réfléchir et travailler au développement des enseignements artistiques en complément
des enseignements scolaires vers plus d’épanouissement pour les enfants ;
- Valoriser et développer l’imaginaire et l’expression des enfants par un décloisonnement
des disciplines artistiques et une démarche actionnelle où l’enfant est lui-même créateur
et acteur de ses apprentissages ;
- Impulser et soutenir la création sous toutes ses formes.
Après la présentation de l’Atelier du Coteau comme association de loisirs et de création
artistique, focalisons-nous à présent sur la description et l’analyse des ateliers artistiques
plurilingues et plus spécifiquement des ateliers multi-activités plurilingues comme contexte de
stage et de recherche en didactique des langues et des cultures.
Partie II. Les ateliers artistiques plurilingues
L’Atelier du Coteau a pour originalité d’être l’une des seules structures nantaises
proposant des ateliers d’éveil artistique accompagnés d’une démarche d’éveil aux langues et
aux cultures. J’ai donc souhaité m’intéresser tout particulièrement à ces ateliers mis en place en
septembre 2013. Il y a plusieurs raisons à cette offre mêlant pratiques artistiques et éveil aux
langues et aux cultures. Tout d’abord il s’agit d’une rencontre avec Elena Galimberti,
travailleuse indépendante proposant des ateliers d’éveil musical, linguistique et culturel sur la
région nantaise et qui a inspiré l’Atelier du Coteau pour créer ses propres ateliers d’éveil (voir
entretien en annexe 8.1). Dans le contexte de la réforme des rythmes scolaires, ce projet tombait
à point nommé : proposer aux enfants de pratiquer les arts tout en s’éveillant à des langues et
cultures différentes qui allaient être apportées par les intervenants eux-mêmes, Elena ayant des
origines italiennes et parlant italien, et Mehregan iranienne ayant pour langue maternelle le
persan. Ainsi, les ateliers artistiques plurilingues sont nés de rencontres décisives dans la
12
conjoncture d’une réforme invitant à développer des activités à mi-chemin entre l’école et le
monde extra-scolaire.
II.1. Une mise en œuvre originale selon la dynamique de l’Atelier du
Coteau
La mise en place de ces ateliers semblait cohérente avec le fonctionnement de
l’association telle qu’elle fonctionnait déjà puisqu’il n’était pas anodin qu’elle reçoive des
artistes et/ou des intervenants d’origines étrangères, comme cela est notamment le cas pour
l’atelier de la danse des cinq rythmes où l’un des intervenants est Anglaise et, parlant très peu
français, anime ses activités dans sa langue maternelle. L’arrivée de Mehregan parlant
couramment persan et anglais a renforcé cette dynamique qui s’apprête à être encore
développée à la rentrée prochaine avec la mise en place d’ateliers de capoeira animés par un
intervenant Brésilien parlant peu français. Dans ce cas précis, l’éveil à la langue et à la culture
brésilienne est une évidence pour Elisa et Xavier qui expliquent que les participants à ces
ateliers venant découvrir la capoeira repartiront de manière presque certaine avec un bagage
linguistique et culturel dont ils n’auraient pas obligatoirement conscience lors de leur
inscription (voir entretien en annexe 8.1). L’art est un élément culturel qui s’avère être alors
une source d’éveil au monde et à l’Autre naturelle qui, dans le cadre de l’Atelier du Coteau, ne
se limite pas aux ateliers artistiques plurilingues.
La proposition originale de l’association, face notamment aux Petits Bilingues qui
étaient leur concurrent direct lors du lancement du projet (voir annexe 8.1), est que ces ateliers
sont animés par des artistes dont le bagage linguistique et culturel sert de base à la dimension
plurilingue des activités. Aucune méthode n’est utilisée, et l’apprentissage n’est pas perçu
comme un objectif à atteindre : il s’agit d’un éveil tant artistique que linguistique et culturel.
L’Eveil aux Langues et aux Cultures tel qu’il est institutionnalisé par le CARAP n’est pas
invoqué ici car, une fois de plus, l’originalité de ces ateliers est qu’ils sont avant tout des ateliers
artistiques animés par des artistes. Deux ateliers différents sont proposés : un atelier d’éveil
musical et un atelier multi-activités où dominent les arts plastiques.
II.2. Acteurs des ateliers artistiques plurilingues
Les ateliers artistiques plurilingues dans leurs deux déclinaisons (musique et multi-
activités) sont animés respectivement par Hélène Bernier et Mehregan Kazemi auprès d’enfants
de 3 à 8 ans. Ces trois partis sont les acteurs directs de ces ateliers où les différentes disciplines
13
artistiques sont décloisonnées au profit d’un éveil qui se veut épanouissant pour tous et où les
langues et les cultures s’intègrent de diverses manières dans les activités.
II.2.a. Hélène et les ateliers musiques plurilingues
Hélène anime les ateliers d’éveil musical plurilingues les lundis et jeudis de 17h à 18h
et de 18h à 19h. Passionnée par la musique et le chant, Hélène est dans une démarche de
formation constante en étant membre de chorales et en enchaînant les stages et master-class
aussi souvent qu’elle le peut. Diplômée du Master en Didactique des Langues et des Cultures
de l’Université de Nantes, elle se construit en tant qu’intervenante indépendante et propose des
ateliers d’éveil musical et d’éveil aux langues et aux cultures aux enfants. A l’Atelier du Coteau,
Hélène s’adresse très fréquemment aux enfants en anglais, et ce, dès le temps du pedibus. Dans
ses activités, elle leur propose également de l’allemand et de l’italien et va parfois plus loin
encore en leur apprenant des chansons en chinois ou en dialectes d’Afrique de l’Ouest, parmi
de nombreuses autres langues. Elle adopte une véritable approche plurielle qui ne connaît pas
de frontières, recourant à l’auto-formation dès qu’elle en a besoin pour lui permettre d’aborder
des langues et des cultures variées. A chaque atelier, elle arrive avec une petite liste d’activités
possibles qu’elle adapte en fonction des états et des demandes des enfants. Son objectif
principal avec eux est qu’ils s’épanouissent et sortent heureux des ateliers. Alternant entre
lectures d’histoires, chants, danses, découvertes d’instruments de musique et sorties au parc de
Procé (parmi d’autres activités que je n’ai pas eu l’occasion de voir lors du stage), elle veille à
suivre le rythme des enfants qui montrent parfois le besoin de se défouler pour être plus
concentrés par la suite, ou qui se trouvent fatigués après la journée d’école. Dans tous les cas,
il y a un certain équilibre entre l’utilisation du français et des langues étrangères par Hélène lors
d’un même atelier.
II.2.b. Mehregan et les ateliers multi-activités plurilingues
Mehregan anime des ateliers d’arts plastiques tous les jeudis de 17h à 18h et de 18h à
19h et intervient tous les mardis à l’école La Fraternité pour effectuer des activités similaires
avec les enfants inscrits aux activités des temps périscolaires. Elle anime également les ateliers
multi-activités plurilingues (désormais AMP) les mardis et vendredis de 17h à 18h et de 18h à
19h, et les mercredis de 17h à 18h. Ce sont ces ateliers qui forment l’objet de ma recherche et
que nous allons désormais aborder tout au long de ce mémoire.
14
Artiste plasticienne iranienne vivant en France depuis 2010, Mehregan a commencé à
travailler à l’Atelier du Coteau en 2013 en tant que stagiaire dans le cadre d’études d’art
contemporain et des nouveaux médias à l’Université Paris VIII. Après avoir cumulé les
expériences d’art-thérapie et d’enseignement des arts, du persan et de l’anglais en Iran (voir
entretien en annexe 8.2), son bagage artistique, linguistique et culturel riche a incité Elisa et
Xavier à lui proposer d’animer ses propres ateliers artistiques plurilingues qui, au départ, ne
tournaient qu’autour des arts plastiques.
La rentrée 2014 a apporté le basculement vers l’appellation d’atelier multi-activités pour
trois raisons principales. Tout d’abord, cela apportait une plus grande liberté à Mehregan en
tant qu’artiste. Ensuite les ateliers s’inscrivaient dans la ligne de travail de l’association sur le
décloisonnement des différentes disciplines artistiques. Enfin cela permettait de concilier les
demandes particulières des parents en termes d’éveil artistique (certains demandaient plus de
musique, d’autres plus dessins, d’autres plus de théâtre, etc.) tout en réunissant chacun des
enfants au sein d’un groupe à effectif suffisant pour ouvrir un atelier (voir entretien en annexe
8.1). Ainsi, le multi-activités est censé recouvrir les arts plastiques, les arts visuels, l’expression
corporelle, l’expression scénique, la musique et le chant (voir annexe 8.1). Nous verrons plus
loin que ces ateliers plurilingues sont principalement composés d’arts plastiques/visuels, de
chant et d’expression corporelle.
Quant à l’approche plurilingue, celle-ci se trouve quelque peu limitée puisqu’elle ne
comprend qu’un éveil à l’anglais et au persan auquel Mehregan tient à ajouter un éveil à un
accent et une manière de parler en français différente de ce dont les enfants ont l’habitude
d’entendre (voir annexe 8.2). L’anglais et le persan sont notamment abordés dans les ateliers
par des comptines et la découverte des couleurs avec les pots de peinture. L’anglais tend à être
dominant sur le persan puisque Mehregan traduit parfois ses consignes ou ses demandes
d’imagination aux enfants dans cette langue, mais les activités restent majoritairement menées
en français. Les AMP bénéficient donc de quelques interventions en langues étrangères, mais
cela se limite à l’emploi de mots et de quelques phrases courtes de manière ponctuelle et inégale
d’un atelier à un autre.
II.2.c. Evènements communs
Même si Hélène et Mehregan forment l’équipe d’animation des ateliers artistiques
plurilingues de l’Atelier du Coteau, elles ne se réunissent presque jamais pour se concerter et
travailler ensemble à des objectifs ou des méthodes communes. Comme nous l’avions évoqué
plus haut dans la présentation générale de l’Atelier du Coteau, il n’existe pas, à l’heure actuelle,
15
de temps de coordination entre les différents artistes et intervenants de l’association. Cela
répond notamment de l’état d’esprit de la direction qui souhaite vraiment respecter
l’indépendance de ses acteurs pour qu’ils puissent s’approprier plus facilement les lieux, mais
aussi pour que leur autonomie les amène à se réunir spontanément (voir entretien annexe 8.1).
Dans le cas d’Hélène et Mehregan, cela semble être dû tout d’abord à une question de
disponibilités communes difficiles à dégager, mais aussi à des parcours différents entre Hélène
et Mehregan qui n’abordent donc pas leurs ateliers de la même manière. De plus, nous verrons
plus loin qu’elles ne partagent pas le même rapport aux langues et aux cultures, ce qui se
présente sans doute comme un point de discordance dans la préparation de leurs animations.
Malgré tout, depuis le début de la rentrée 2014, toutes deux ont réussi à se retrouver
ponctuellement, même si c’était le plus souvent de manière informelle autour d’ateliers
communs. Pour Halloween, elles ont participé à l’animation organisée à l’Atelier en décorant
les lieux et préparant des sketches à jouer dans chacune des pièces du bâtiment. Hélène,
déguisée en sorcière, racontait une histoire aux enfants dans l’un des vestiaires. Pour
Thanksgiving, Mehregan et une enfant d’un atelier du jeudi ont rejoint Hélène et son groupe
pour partager ensemble un key lime pie. De la même manière, dans les temps de Noël, les
groupes se sont rassemblés pour évoquer les traditions d’Europe de Nord et manger un stollen.
Lors de la Chandeleur, tous ont fêté groundhog day en réalisant des pancakes à partir d’une
recette américaine en anglais. Enfin, en mars, les enfants de l’atelier d’Hélène ont rejoint le
groupe de Mehregan pour célébrer la fête du feu et le nouvel an perse (voir journal de bord en
annexe 6).
II.2.d. Les enfants
Les ateliers artistiques plurilingues sont destinés aux enfants de 4 à 10 ans. En ce qui
concerne plus précisément les AMP, on compte un total de 11 enfants inscrits entre 3 et 8 ans.
Ceux-ci sont répartis en trois groupes correspondant aux jours de déroulement des activités : le
groupe du mardi compte donc trois enfants, celui du mercredi en comprend six et celui du
vendredi à nouveau trois, dont une enfant qui participe également aux ateliers du mardi. Il est
important de préciser que je ne compte-là que les enfants des ateliers se déroulant de 17h à 18h,
les effectifs étant trop faibles sur les créneaux de 18h à 19h pour pouvoir les inclure dans mon
travail de recherche ; en effet, seuls un à deux enfants restent la deuxième heure les mardis et
vendredis, et il peut arriver que certains de ces ateliers soient annulés car les parents de ces
enfants viennent occasionnellement les chercher dès 18h. Afin d’assurer une meilleure
compréhension de mes écrits au fil de ce mémoire et de ses annexes, j’ai décidé de conserver
16
les prénoms des enfants, d’autant plus qu’ils apparaissent publiquement sur l’affiche de
l’exposition de leurs créations et que celle-ci est diffusée largement, y compris sur les réseaux
sociaux.
Les groupes des ateliers multi-activités plurilingues sont donc définis ainsi :
- Groupe du mardi : Marie, Lucien et Victor ;
- Groupe du mercredi : Arthaud, Rosemay, Maya, Thomas, Adèle et Rose ;
- Groupe du vendredi : Marie, Agathe et Alix.
Tous participent aux AMP depuis septembre 2014, à l’exception d’Agathe qui a commencé
en septembre 2013, Marie en janvier 2014 et Victor en avril 2014. Ainsi, tous n’ont pas la même
ancienneté au sein de l’association, ce qui est un facteur d’influence sur leur comportement
dans les ateliers. Un autre facteur important est que certains d’entre eux ont été et/ou sont
inscrits à d’autres activités proposées au sein de l’Atelier, ce qui influence également leur
rapport avec les lieux et leurs acteurs. L’année dernière, Agathe participait également aux
ateliers musique plurilingues. Marie est présente toute la semaine : en plus de participer aux
ateliers multi-activités plurilingues les mardis et vendredi, elle est aussi inscrite aux ateliers
musique plurilingues les lundis et jeudi et à la danse les mercredis. Victor et Alix accompagnent
Marie aux ateliers musique plurilingues les lundis. Rosemay suit le même cours de danse que
Marie les mercredis avant de participer à l’atelier multi-activité plurilingue auquel elle est
inscrite. Ces informations sont également pertinentes pour mieux comprendre les relations des
enfants entre eux. De fait, Marie connaît Agathe depuis la saison précédente, elle est dans la
même classe que Lucien et vient en pedibus les vendredis avec Alix qui est scolarisée dans la
même école en plus de vivre les ateliers musique plurilingues ensemble les lundis, et ce avec
Victor également. Dans le groupe du mercredi, on compte deux binômes de frères et sœurs :
Arthaud et Rosemay d’un côté, Maya et Thomas de l’autre (voir portraits d’apprenants au
chapitre III).
Tous les participants aux AMP ont le français pour langue maternelle, et aucun d’entre
eux n’ont de parent ayant une autre langue que le français comme langue maternelle (voir
portraits d’apprenants au chapitre III et questionnaires à destination des parents en annexes 9).
Le travail d’éveil aux langues et aux cultures effectué dans les AMP ne peut donc répondre
d’une recherche d’intégration facilitée d’enfants de familles immigrées au bagage linguistique
et culturel étendu comme cela a pu être le cas avec les ELCO – Enseignements des Langues et
Cultures d’Origine – ou lors du lancement du projet Evlang à la fin des années 1990 (Billiez,
2002). L’Atelier du Coteau s’inscrit plutôt dans une démarche d’ouverture linguistique et
17
culturelle s’appuyant sur les origines et les expériences linguistiques et culturelles de Mehregan,
l’artiste animatrice des AMP (voir entretien d’Elisa et Xavier en annexe 8.1).
II.3. Fonctionnement des ateliers multi-activités plurilingues
Nous allons maintenant entrer plus en détail sur le fonctionnement des AMP afin de
clore la présentation du contexte de ma recherche sur ce qui s’est avéré être mon sujet
d’observation, d’analyse et d’expérimentation autour des pratiques artistiques et de l’éveil aux
langues et aux cultures. Après avoir présenté les lieux dans lesquels se déroulent les AMP,
j’aborderai l’organisation de ces ateliers tels que j’ai pu les observer pendant la première partie
de mon stage.
II.3.a. L’organisation de l’espace
Les AMP ont lieu dans une petite salle d’environ 30 mètres carrés mitoyenne à l’un des
petits vestiaires. Le vestiaire est une pièce importante qui marque la transition entre le hall
d’accueil et la salle d’atelier : les enfants y déposent leurs affaires (manteau, cartable, …),
s’assoient et y prennent le goûter. C’est dans cette salle que se déroule le temps calme de 16h à
17h suite au pedibus. Avant d’accéder à l’atelier proprement dit, les enfants doivent quitter leurs
chaussures.
Quatre marches grises permettent de descendre du vestiaire à la salle qui, comme le hall
d’entrée, est dominée par la couleur blanche sur les murs et le plafond, ainsi qu’au sol qui
présente un parquet blanc-gris. Seules les créations plastiques des enfants accrochées aux murs
apportent de la couleur à la pièce. Les deux sources principales de lumière sont une applique
murale et une lampe halogène toutes deux placées le long du mur droit de la salle d’atelier.
Dans le coin inférieur gauche, l’espace de stockage représente un espace intermédiaire entre la
pièce et le portail du garage toujours fermé donnant sur la rue du Coteau ; en haut de ce portail
se trouvent une lignée de petites fenêtres rectangulaires qui laissent filtrer faiblement la lumière
du jour. L’espace peut se schématiser de la manière suivante :
18
Figure 1 : Schéma représentant les vestiaires et la salle d’atelier
Si la pièce est personnalisée par les productions des enfants, il me semble important de
préciser que rien, à l’exception d’un globe terrestre gonflable stocké dans un petit bac en
plastique au-dessus de l’armoire, ne peut faire penser aux langues et aux cultures.
L’environnement est donc éminemment dominé par l’expression artistique des enfants, sans
laisser entrevoir toute une dimension des ateliers auxquels ils participent. Cela semble répondre
de la politique générale de l’Atelier du Coteau qui tient avant tout à ce que ses ateliers soient
des ateliers artistiques, mais j’aborderai plus loin une autre raison liée au déroulement et au
contenu des AMP.
II.3.b. Préparation, objectifs d’apprentissage et évaluation des AMP
Mehregan a commencé l’animation des ateliers arts plastiques plurilingues puis AMP
lors de son stage de fin d’étude en 2013. Elle prépare ses ateliers de l’année principalement
pendant l’été qui est une période plus creuse en termes d’activité. Elle note dans un cahier les
thèmes sur lesquels elle souhaiterait réaliser des créations plastiques avec les enfants aux
différentes périodes de l’année, mais elle se donne la flexibilité de revoir son programme au fur
et à mesure des AMP. La veille de chaque atelier, elle établit mentalement un plan des activités
qu’elle prévoit de faire, ce qui lui permet de faire preuve de plus d’adaptabilité au jour le jour
(voir entretien en annexe 8.2).
Lui demandant comment elle résumerait son travail dans ces ateliers, elle répond :
19
« En fait ces ateliers-là sont destinés pour faire apprendre aux enfants les
cultures, les langues les accents différents du monde. Et le fait que je sois d'un
pays étranger, eux ils voient toujours tous les jours que voilà, il y a un étranger
qui parle français, qui peut faire des fautes, avec un accent mais voilà, c'est
pas choquant quoi. Qui parle d'autres langues aussi. Et là, on travaille, je
travaille surtout sur l'art plastique avec eux. […] en fait bon voilà c'est les
ateliers multi-activités multilingues, mais je suis plutôt concentrée sur l'art
plastique... […] je travaille beaucoup sur les imaginations, au début on a
travaillé sur un petit peu l'histoire d'art, de l'art... et […] on fait des chansons,
par exemple en perse la langue que j'ai, je connais mieux quand même, on fait
des chansons en perse, on fait des chansons en anglais, et … on essaye de faire
une performance avec, bouger avec ces chansons-là. » (voir annexe 8.2).
Les AMP sont donc des ateliers avec une vocation d’éveil aux langues et aux cultures forte, car
c’est ce qui fait leur particularité en comparaison avec les autres activités proposées par l’Atelier
du Coteau. Cet éveil est impulsé par Mehregan elle-même à partir de son propre bagage
linguistique et culturel, ce qui pour les enfants lui semble être aussi une opportunité de découvrir
leur langue maternelle sous la perspective d’un nouvel accent, d’une manière différente de
parler. Cet éveil aux langues et aux cultures passe principalement par le recours à des chansons
en persan et en anglais. L’animatrice précise plus loin dans l’entretien (voir annexe 8.2) que
l’objectif n’est pas que les enfants apprennent à parler ces langues, il n’y a pas d’obligation de
résultats à avoir dans ce domaine ; ce qui importe selon elle, c’est avant tout qu’ils prennent
conscience de l’existence d’autres langues, cultures et accents que celle et celui dans lequel ils
grandissent. C’est la distinction que Mehregan effectue entre une démarche d’apprentissage et
une démarche d’éveil dont je soulèverai plus loin les complexités. Enfin, les AMP, bien qu’ils
soient mentionnés sur tous les supports de l’association comme multi-activités sont en réalité
principalement axés sur les arts plastiques dans une démarche de développement de
l’imagination des enfants.
C’est d’ailleurs l’imagination qui est pour Mehregan le point de rencontre entre les arts
et les langues-cultures. Elle définit cette faculté comme une porte ouverte vers un monde
individuel, personnel et propre à chacun qui peut être différent du monde tangible dans lequel
nous vivons. Pouvoir développer son imagination, franchir cette porte, c’est aussi être capable
d’accepter ce qui est différent de ce que nous connaissons déjà, d’aller plus loin que ce qui nous
entoure. Si l’enfant peut accepter de voir ou concevoir quelque chose qui n’existe pas pour de
vrai dans la réalité, il sera sans doute plus à même d’accepter une autre langue, une autre culture.
20
Tous ces éléments qui forment la conception des AMP par Mehregan peuvent être
synthétisés sous la forme des objectifs d’apprentissage suivants :
- Développer son imagination et l’expression de celle-ci dans la création d’œuvres
plastiques ;
- Faire prendre conscience à l’enfant de l’existence de langues et cultures différentes à
travers un éveil à l’anglais et au persan ;
- Le sensibiliser aux différents accents que peut revêtir sa propre langue maternelle grâce
à une animatrice allophone.
Aucun système d’évaluation formel n’est mis en place pour vérifier que ses objectifs
sont atteints. Le développement de l’imagination peut se percevoir, selon Mehregan, dans les
créations plastiques des enfants (voir annexe 8.2) qui restent cependant des indicateurs peu
fiables car ils répondent d’un regard subjectif sur ces productions, sans même mentionner le
fait que l’imagination est une faculté difficilement quantifiable. Quant aux deux objectifs
restants, ils répondent plutôt de la construction et du développement de savoirs-être qui sont
eux aussi difficilement quantifiables et qui peuvent se révéler sur des périodes de temps plus
ou moins longues sous des formes diverses.
II.3.c. L’organisation des ateliers
Dans l’ensemble, les AMP se résument à deux activités principales : des activités de
dessin, peinture et collage qui inscrivent les ateliers dans une approche dominée par les arts
plastiques et des écoutes, chants et mimes de comptines en anglais et en persan à partir de
documents audio ou vidéos lus sur l’ordinateur portable de Mehregan. Le plus souvent, les
ateliers commencent par la comptine « Good morning » où les enfants miment leur réveil et
forment une ronde pour chanter et danser et ainsi marquer le début des activités. Ensuite,
Mehregan poursuit généralement avec le visionnage de vidéos sur son ordinateur pour découvrir
et chanter d’autres comptines telles que « 1, 2, 3, 4, 5, once I caught a fish alive » ou encore
« Old MacDonald had a farm ». Les enfants abordent ainsi le vocabulaire des chiffres et des
animaux en chantant en anglais. Puis, s’en suit une activité relevant des arts plastiques dont je
n’aborderai pas les détails dans ce mémoire car le lecteur peut les trouver dans le journal de
bord (voir annexe 6), d’autant plus que le contenu purement artistique de ces activités ne
concerne pas mon projet de recherche. De temps à autre, en fin d’atelier, Mehregan demande
aux enfants de l’aider à ranger le matériel en chantant la comptine « Clean up ! Clean up !
Everybody clean up ! » et leur fait ensuite regarder la vidéo d’une comptine iranienne sur
laquelle les enfants chantent et dansent en découvrant le vocabulaire des animaux en persan.
21
Naturellement, ce déroulé n’est pas fixe et peut être amené à changer d’un atelier à
l’autre, en fonction du temps que Mehregan souhaite dédier aux activités d’arts plastiques et
aussi en fonction de certains éléments ponctuels comme la célébration de la fête du feu et du
nouvel an perses la semaine du 21 mars qui a intégralement modifié le contenu des ateliers. De
la même manière, les jours de beau temps sont souvent une occasion d’emmener les enfants au
parc de Procé plutôt que de rester entre les murs de l’Atelier, ce qui change également les
activités effectuées avec eux (voir journal de bord en annexe 6). Enfin, il arrive que les effectifs
varient lors d’un atelier (enfants malades, absences ponctuelles, …), ce qui parfois amène
Mehregan à remettre en cause et modifier le déroulement de ses ateliers à la dernière minute.
Les AMP peuvent donc suivre une certaine routine, mais ils sont également sujets à flexibilité ;
cela peut se révéler être un véritable avantage pour diversifier leur contenu et les expériences
offertes aux enfants, mais cela peut aussi s’avérer être un inconvénient lorsqu’il s’agit de devoir
planifier des activités précises qui doivent alors être adaptables aux changements possibles.
II.3.d. Le projet d’exposition
L’un des facteurs de planification du contenu des AMP est notamment le projet
d’exposition des créations des enfants du 28 mai au 25 juin prochains, avec l’évènement du
vernissage le samedi 30 mai. Ce projet d’exposition est un véritable moteur pour les enfants
qui, dans la logique du dialogue amateurs-professionnels prônée par l’Atelier du Coteau, vont
exposer leurs œuvres au même titre que leur animatrice artiste plasticienne Mehregan, leur
permettant ainsi d’être eux-aussi considérés comme des artistes et de découvrir les coulisses de
l’organisation et du déroulement d’une exposition. Cela inscrit alors le fonctionnement des
AMP dans une démarche actionnelle qui valorise les travaux réalisés tout au long de l’année
par les enfants. Chaque œuvre commencée dans les ateliers n’est alors pas simplement une
activité d’arts plastiques mais bien un pas de plus vers la réalisation de l’exposition, ce qui est
une source de motivation certaine pour les enfants. Lors d’une conversation informelle avec
Elisa et Mehregan, celles-ci m’ont confié qu’une enfant avait d’ailleurs demandé s’ils allaient
vendre leurs œuvres, comme le font les artistes exposant le reste de l’année à l’Atelier. Cela
n’aura pas lieu cette année, mais c’est une idée conservée pour les projets à venir qui pourraient,
en plus de valoriser les créations des enfants, apporter des fonds pour une association caritative
par exemple, ajoutant un facteur de motivation supplémentaire.
Bien que ce projet soit intéressant au regard de la didactique, il est aussi une source de
pression et de stress pour Mehregan qui tient à avoir un certain nombre d’œuvres à exposer,
exigeant alors une optimisation de la productivité des enfants dans les AMP les mois précédant
22
l’exposition. Il s’agit-là d’une contrainte que je ne pourrai ignorer lors de la conception de mon
dispositif et qui s’avèrera être une réelle difficulté lors de sa mise en place.
II.3.e. La place de l’éveil aux langues et aux cultures dans les ateliers multi-activités plurilingues
et le projet d’exposition
En tant que stagiaire en didactique des langues et des cultures, je me suis intéressée à la
manière dont les langues et les cultures étrangères étaient abordées dans ces ateliers à
dominance artistique. Comme nous l’avons déjà précisé, l’input en langue étrangère se fait
principalement par l’intermédiaire de comptines que les enfants écoutent, miment et chantent à
différemment moment des ateliers. A aucun moment ces chansons font l’objet d’une séquence
d’apprentissage ou de mémorisation : après leur avoir fait écouté la comptine en regardant son
clip sur l’ordinateur, Mehregan dégage le sens global des paroles pour les enfants en leur
demandant d’expliquer ce qu’ils ont compris par les images de la vidéo puis en révélant elle-
même, dans les grandes lignes, le contenu du texte. Ensuite, la chanson est relancée et Mehregan
invite les enfants à chanter avec elle par-dessus l’enregistrement. Pour la comptine « 1, 2, 3, 4,
5, once I caught a fish alive », après avoir chanté à l’unisson en mimant avec la vidéo, les
enfants chantent un par un, à tour de rôle avec leur animatrice, la chanson a cappella. Pour «Old
MacDonald had a farm », Mehregan interrompt la lecture de la vidéo lors du deuxième tour de
chant à l’unisson pour demander, avant que le mot ne soit prononcé en anglais, « How do we
say (chien, chat, vache,…) in English ? », question à laquelle les enfants doivent répondre pour
relancer la suite de la vidéo. En général, les enfants chantent avec Mehregan, mais ils ne le font
franchement que sur certaines portions des paroles dont ils connaissent les mots ou ont retenu
les sons, c’est-à-dire les fragments où l’on compte ou bien les débuts et fins de phrases, en
marmonnant du mieux qu’ils le peuvent tout ce qui est chanté entre les deux. Cette description
est à nuancer pour certains enfants qui semblent connaître l’intégralité des paroles par cœur et
qui les chantent parfaitement, ce qui est souvent le cas pour les enfants comme Marie ou Agathe
qui assistent à plus d’un atelier par semaine ou qui avaient déjà abordé ces comptines l’année
précédente. Dans l’ensemble, la mémorisation des comptines comme unités de sens est
difficilement évaluable en fonction de chacun, les enfants les retenant par principe d’immersion
auditive et de répétitions à chaque atelier, ce qui selon Mehregan répond plus d’une démarche
d’éveil que d’apprentissage. Pour le projet d’exposition, il est prévu de valoriser ces comptines
sous forme de happenings le jour du vernissage où les enfants chanteraient et mimeraient les
chansons découvertes dans les AMP devant leurs parents.
23
Les inputs en langue étrangère se trouvent aussi dans les discours de Mehregan qui
donne souvent ses consignes en anglais, en les traduisant parfois en français de manière
consécutive, sauf pour les consignes ou mots répétés régulièrement et que les enfants ont fini
par mémoriser comme cut, scissors, colour, pen, paint,… Lors de ma période de stage,
Mehregan a augmenté petit à petit les inputs en persan, notamment lorsqu’elle demande aux
enfants de choisir les couleurs de peinture avec lesquelles ils souhaitent réaliser leur création.
Ainsi, il semble que la plupart des enfants sont en mesure de nommer les différentes couleurs
en anglais, et les termes persans sont actuellement en cours de mémorisation. Certains enfants
semblent même en avoir acquis certains. La mémorisation du nom des couleurs en anglais et en
persan est renforcée de temps en temps par un petit jeu toujours plébiscité par les enfants : ce
jeu se fait à base de carrés, ronds, triangles, mains et flèches découpés dans des pièces de
caoutchouc rouges, bleues, vertes et jaunes que Mehregan tend un à un aux enfants qui doivent
alors nommer la forme et la couleur de la pièce en anglais, ou bien sa couleur en persan avant
de la rattraper au vol lorsque Mehregan la lance dans la pièce.
Enfin, il est fréquent que certains travaux en arts plastiques soient initiés par un moment
où les enfants doivent fermer les yeux et imaginer ce qu’ils voient dans un environnement
auquel Mehregan les mène par une petite histoire qu’elle énonce en français et en anglais, et
parfois même ponctuellement en persan. De la même manière, certains mots de vocabulaire en
langue étrangère sont abordés pendant la réalisation des œuvres lorsqu’un enfant dessine
quelque chose que Mehregan nomme alors en anglais et quelque fois en persan.
Sur le plan culturel, les apports sont plus rares, mais la semaine thématique sur le nouvel
an perse a donné lieu à la réalisation en découpage-collage d’une table du nouvel an avec les
éléments symboliques que les Iraniens y posent à cette occasion. C’est là l’une des seules, si ce
n’est la seule production des enfants qui présente, dans la pratique artistique même, la
dimension d’éveil aux langues et aux cultures que revêtent les AMP. Mise à part cette création,
l’éveil linguistique et culturel est bien présent dans les ateliers mais ne se trouve pas pleinement
associé aux pratiques artistiques des enfants, et notamment à leurs expériences plastiques qui,
mises à part les consignes données en anglais ou persan, ne s’appuient pas sur des thématiques
ou du vocabulaire précis ou encore sur des éléments culturels que les enfants auraient découvert.
II.3.f. Une occupation de l’espace symbolique entre pratiques artistiques et éveil aux langues et
cultures
L’occupation de l’espace par Mehregan et les enfants lors des activités de création
artistique montre une artiste-animatrice qui se met à la hauteur des enfants : elle est assise par
24
terre avec eux au centre de la pièce et elle leur montre ce qu’elle attend d’eux en réalisant elle-
même une œuvre et en la créant jusqu’au bout lorsque cela est possible, en suivant le rythme
auquel vont les enfants sur leur propre création. Elle apporte parfois une aide individualisée aux
enfants les plus jeunes pour qui toutes les étapes d’une création ne sont pas toujours faciles à
réaliser seuls (découper, emballer,...). Dans l’ensemble, cela révèle un travail sur l’autonomie
des apprenants dans leurs réalisations artistiques. Cette autonomie est favorisée par la
stimulation de l’imagination lorsque Mehregan demande aux enfants de fermer les yeux et
d’imaginer un lieu et ses éléments caractéristiques qui seront le point de départ de l’œuvre à
créer. Ainsi, tous les enfants réalisent une même création tout en la personnalisant par leur
propre imagination.
D’un autre côté, lors du visionnage de vidéo-clips de comptines en anglais ou persan,
Mehregan est assise sur un tabouret et les enfants sont assis par terre, face à elle, dans le coin
supérieur droit de la pièce (se référer au schéma présenté en page 17). Il y a là une
différenciation de positionnement entre l’artiste-animatrice et les apprenants qui ne se trouvent
pas à la même hauteur. Il est délicat de chercher à analyser ce changement d’organisation des
acteurs dans l’espace, mais il semblerait que le rapport à l’art et le rapport aux langues
n’impliquent pas la même relation pédagogique entre Mehregan et les enfants : pour les
comptines, l’artiste-animatrice adopte une posture ressemblant à celle d’un enseignant face à
ses élèves. Même si nous pouvons comprendre que sa place lui permet de manipuler
l’ordinateur plus facilement en étant à sa hauteur, la manière dont l’activité est menée corrobore
l’idée d’un changement de paradigme dans la relation pédagogique. Les enfants ne sont plus en
autonomie, ils suivent l’activité entièrement menée par Mehregan qui a le contrôle sur la
diffusion de la comptine et incite les enfants à chanter par-dessus l’enregistrement puis les fait
chanter un par un avec elle, insistant pour qu’ils effectuent les gestes s’il y en a ou en leur posant
des questions de vocabulaire.
Tout cela parait refléter une séparation entre les dimensions artistiques et plurilingues
des ateliers. L’art et les langues et cultures sont considérés comme deux mondes à part entière
qui tendent à se rencontrer mais ne sont jamais associés ; ils ne semblent pas perçus comme
complémentaires. L’impression générale qui se détache est bien que l’art est au cœur des
activités de l’Atelier du Coteau, mais que l’approche plurilingue s’y est ajoutée comme un
élément indépendant en ce qui concerne les AMP. Cette approche ne peut se laisser deviner par
la décoration de la salle d’atelier et apparaît comme détachée des expériences et contenus
artistiques où elle n’apparaît que dans la découverte de comptines et très peu dans la manière
d’aborder la création d’une œuvre par exemple.
25
CONCLUSION DU CONTEXTE ET PROBLEMES DE TERRAIN SOULEVES
La démarche de l’Atelier du Coteau dans la mise en place des ateliers artistiques
plurilingues répond de rencontres et de valeurs fortes qui participent à la construction de
l’identité de cette association encore au stade de construction. L’approche actionnelle apportée
par le projet d’exposition et le travail sur le développement de l’imagination et de l’ouverture
des enfants vers les autres et le monde offre un terrain de recherche intéressant pour la
didactique des langues et des cultures, mais cela reste dans certaines limites. Il est question ici
d’ateliers qui ne répondent pas d’une conception didactique à proprement parler : les AMP sont
peu préparés en ce qui concerne l’éveil aux langues et aux cultures, les objectifs restent très
généraux et surtout implicites, et aucun système d’évaluation n’est mis en place, ne serait-ce
que pour faire le point sur l’atteinte ou non de ceux-ci, ou sur la satisfaction des enfants et de
leurs parents dont les attentes n’ont pas été interrogées. L’Atelier du Coteau n’est pas un terrain
de recherche institutionnel qui suit une exigence de résultats, mais avant tout un centre de
création et de loisirs artistiques proposant des ateliers enrichis d’éveil aux langues et aux
cultures, ce qui fait là son originalité mais aussi sa contrainte pour mon travail de recherche qui
ne pourra s’appuyer sur des fondements didactiques préexistants.
Alors que l’approche proposée dans les AMP invite à penser que l’éveil artistique peut
à la fois compléter et se compléter d’un éveil linguistique et culturel, j’ai pu remarquer sur le
terrain qu’il n’y avait pas d’association franche de réalisée entre ces deux domaines, ce qui
semble limiter leur renforcement mutuel dans le parcours des enfants. Or, les deux semblent
être une source d’émotions positives qui participent notamment au développement de
l’imagination des apprenants, qui n’est alors mentionné explicitement dans les ateliers que lors
des temps de créations purement artistiques. Dans le cadre d’un centre cherchant à offrir une
approche complémentaire mais différente de celle de l’école, les AMP perpétuent pourtant une
distinction de forme entre les activités artistiques et les activités d’éveil aux langues et aux
cultures qui reprennent le schéma disciplinaire scolaire auprès d’enfants qui arrivent justement
fatigués voire énervés de leur journée en classe. Que se passerait-il avec une véritable
association des pratiques artistiques et de l’éveil aux langues et aux cultures ?
Il semblerait probable que l’un des chaînons manquants à cette véritable association des
arts, des langues et des cultures au bénéfice des enfants soit un élément que j’ai été surprise de
ne pas trouver parmi les valeurs de l’Atelier du Coteau, ni de voir beaucoup valorisé pendant
les AMP et qui pourtant est omniprésent dans les deux domaines qui nous occupent : les
26
émotions. Comment les arts et les pratiques artistiques peuvent-ils mettre à profit l’action des
émotions dans des situations d’éveil aux langues et aux cultures ? C’est ce que nous allons
traiter dans le chapitre suivant en nous penchant sur la littérature scientifique et ses apports
théoriques à la détermination du rôle des émotions dans les processus d’apprentissage puis plus
particulièrement dans les situations d’EA de langues et cultures. L’objectif sera enfin de définir
la pertinence des pratiques artistiques comme vecteurs et créateurs d’émotions pouvant donc
renforcer voire enrichir le parcours d’un apprenant de langues et cultures étrangères.
28
INTRODUCTION AU CADRE THEORIQUE
Les recherches autour des liens entre cognition et émotions se sont multipliées depuis
une quinzaine d’années, affirmant chacune les unes après les autres la corrélation incontestable
entre ces deux éléments que la pensée populaire avait alors toujours considéré comme la
dichotomie du cœur et de la raison. Zoltán Dörnyei (2009) reprend à ce sujet les mots de Lewis
(2005) et déclare que la cognition et l’émotion n’ont jamais été deux systèmes parfaitement
indépendants l’un de l’autre mais bien « a unitary phenomenon in which interpretation and
relevance emerge together ». Or, cela fait bien plus longtemps que la « dialectique cognitive et
émotionnelle » (Sauvayre, 2010) est en jeu dans de nombreux processus, notamment dans les
cas d’adhésion à certains dogmes extrêmes comme ceux véhiculés par les sectes par exemple :
les nouveaux adeptes sont mis en confiance dans un environnement et une communauté
présentés comme sûrs, accueillants et tolérants tout en recevant des discours factuels dont le
but est de donner une crédibilité au groupe. L’adhésion se finalise lorsque ces éléments
émotionnels et pseudo-rationnels sont intériorisés par l’expérience que le nouvel adepte se fera
au sein de la secte (Sauvayre, 2010). On remarque alors que tout ce qui a été intégré et fait sien
par l’individu s’est réalisé par une association du cognitif, de l’émotionnel et de l’expérience.
Ce trio ne pourrait-il pas être pris en compte de manière vertueuse dans le cadre des situations
d’EA pour favoriser l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être par les apprenants ?
Si ce trio renvoie à trois points fondamentaux que nous traiterons dans cette partie – à
savoir la cognition, l’émotion et l’expérience par le corps –, nous souhaitons nous arrêter dans
un premier temps sur la place des émotions dans l’apprentissage. Nous définissons alors
l’émotion comme un « état psychologique multidimensionnel dans lequel un individu peut se
trouver en réaction ou en réponse à un évènement externe ou interne (cognition), et lui
permettant de gérer ses objectifs par rapport à la situation confrontée » (Masmoudi et al., 2010).
Cette définition nous semble intéressante car elle met en valeur la part active de l’émotion dans
la modulation des décisions et réactions d’un individu comme cela peut être le cas dans des
situations d’apprentissage. Nous distinguons ensuite quatre étapes dans la production d’une
émotion : les sentiments comme expérience subjective, l’activation physiologique (accélération
du rythme cardiaque, frissons, …), les réactions visibles du corps qui fait passer l’expérience
émotionnelle dans la sphère publique (sourire, larmes, visage qui rougit, …) puis l’ « état
motivationnel » qui permettra à l’individu de faire face à la situation (Masmoudi et al., 2010).
Ainsi, nous différencions l’émotion du sentiment, la première répondant avant toute chose
29
d’une expérience physique et déclenchant la création du deuxième comme une expérience
intrinsèque et personnelle à l’individu. L’émotion se caractérise donc par des « états
physiques » tandis que le sentiment correspond plutôt à des « représentations » de l’esprit, les
deux pouvant se définir comme des affects (Piccardo, 2013).
Comment utiliser et tirer parti de cette dimension émotionnelle des apprentissages ?
Après avoir fait un point sur les recherches autour de l’émotion et des apprentissages dans un
cadre global, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’émotion dans les situations d’EA
des langues et des cultures où nous connaissons déjà notamment le poids des représentations et
leur influence positive ou négative sur l’acquisition d’une langue étrangère. Nous proposerons
enfin de nous intéresser plus particulièrement au recours aux pratiques artistiques comme outil
éminemment lié aux émotions pour favoriser les processus d’apprentissage des langues-cultures
en réalisant un état de l’art des recherches à ce sujet afin de trouver des réponses à notre question
de recherche : comment les arts et les pratiques artistiques peuvent-elles mettre à profit l’action
des émotions dans des situations d’éveil aux langues et aux cultures ? Nous mentionnons ici les
arts et les pratiques artistiques comme deux éléments conjoints bien qu’ils ne supposent pas la
même réalité. Ainsi, les arts regroupent la musique, le chant, le théâtre, la littérature, la peinture,
la sculpture, la danse et toute autre discipline pouvant se considérer comme appartenant au
domaine des arts. Les pratiques artistiques, quant à elles, renvoient plus précisément à la
pratique réelle de ses disciplines en tant qu’expériences sensorimotrices qui peuvent être à la
fois individuelles et collectives, et qui supposent le plus souvent un acte de création. Enfin, les
situations d’éveil aux langues et aux cultures recouvrent ici un sens général pour désigner tous
les contextes où il est question d’activités destinées à de jeunes apprenants menant à la
découverte de langues et de cultures étrangères, les termes d’Eveil aux Langues employés avec
des majuscules renvoyant plus précisément à l’approche officialisée par le Conseil de l’Europe
avec le CARAP.
30
Partie I. Emotions et apprentissages
Se poser la question de la place des émotions dans l’apprentissage n’est pas infondé : notre
propre expérience d’apprenant nous rappelle que nous avons connu la peur devant un examen,
la joie pendant une expérience ludique, l’ennui lors de certains cours, la déception face à une
mauvaise note. Les émotions peuvent être suscitées par le contexte et l’atmosphère
d’apprentissage, mais aussi par ses acteurs : enseignants, apprenants, collègues et entourage.
Ces deux facteurs émotionnels peuvent avoir des impacts positifs sur l’apprentissage lorsqu’ils
génèrent des émotions positives, mais ils peuvent aussi faire l’effet inverse lorsqu’ils génèrent
des émotions négatives, et cela vaut tant pour l’apprenant que pour l’enseignant ou le formateur,
même si pour ces derniers la question des apprentissages est moins évidente. Comme le sous-
entend Michel Perraudeau (2006), la prise en compte de ces facteurs est d’autant plus
primordiale dans le cadre des perspectives constructivistes et socioconstructivistes qui
dominent actuellement tant elles cherchent à ce que l’apprenant soit acteur de son
apprentissage : cela nécessite qu’il soit lui-même conscient du rôle des émotions, de ses
émotions, lorsqu’il réalise une tâche. Voyons plus en détail à présent pourquoi les émotions
méritent une attention particulière dans le monde de l’enseignement grâce à un état des lieux
des recherches transdisciplinaires menées en psychologie et neurosciences sur les liens entre
cognition et émotions.
I.1. Les émotions dans le fonctionnement cérébral
Les chercheurs sont d’accords pour définir les émotions primaires comme la surprise, le
bonheur, la colère, la peur, le dégoût et la tristesse d’après les travaux de Damasio et de Le
Doux à la fin des années 1990 (Puozzo Capron, 2013; McNeil, 2009). Ces émotions sont
considérées comme indispensables à la survie de l’homme car elles sont la source des
modulations de son comportement (McNeil, 2009). On distingue alors ces émotions primaires
des émotions secondaires et d’arrière-plan que sont « l’embarras, la jalousie, la culpabilité ou
l’orgueil » et « le bien-être ou le malaise, le calme ou la tension » (Puozzo Capron, 2013).
Frank McNeil (2009) nous explique que, dans tous les cas, les émotions sont aussi
importantes dans les processus de développement du cerveau chez l’embryon et le jeune enfant
que dans les processus d’apprentissage de n’importe quel être humain. Reprenant la théorie de
MacLean (1990) sur le cerveau triunique, il affirme que les émotions sont contrôlées par le
système limbique et que celui-ci a la possibilité de détourner d’autres parties du cerveau lorsque
31
cela est nécessaire. Les émotions peuvent donc agir sur le cerveau reptilien qui a en charge les
fonctions de préservation vitales et sur le néocortex qui traite les mouvements, la raison, les
symboles et les capacités d’abstraction entre autres choses. Sans régulation de la part du
système limbique et des émotions, le cerveau reptilien prédominerait sur le reste du
fonctionnement cérébral et impliquerait que nous n’agissions que par sang-froid, dans l’absence
totale d’émotions (Amini et al., 2000 cité par McNeil, 2009). En plus d’agir comme régulateur
de notre propre fonctionnement cérébral, le système limbique explique aussi le phénomène
d’interdépendance physiologique : c’est lui qui permet la modulation des émotions des
personnes auxquelles nous sommes attachées comme cela peut arriver entre une mère et son
bébé. « Who we are and who we become depends, in part, on whom we love » affirme ainsi
Amini (2000). Même si la relation enseignant-apprenant est loin d’être aussi fusionnelle que
celle de la maternité, il convient de reconnaître que les émotions d’un enseignant ont un impact
sur les émotions de ses apprenants, et vice-versa. Il s’agit là d’un élément sur lequel nous
reviendrons plus loin. Enfin, diverses recherches ont prouvé que le stress ou la peur
endommagent les connexions entre le système limbique et le cortex frontal, affectant ainsi « le
jugement social » et « la performance cognitive » (Masmoudi et al., 2010). Les émotions ont
donc un impact incontestable sur le fonctionnement cérébral puisqu’elles servent notamment
de régulateur des fonctions primitives de survie et modulent les fonctions cognitives, ce qui ne
peut être sans conséquence sur les processus d’apprentissage.
I.2. Le triangle émotion, cognition et motivation
Si les liens entre cognition et émotions sont aujourd’hui évidents, on ne peut écarter la
motivation de l’équation : « […] studying cognition in isolation from motivation and affect
cannot yield a valid picture of the workings of the mind » (Dörnyei, 2009). Si la perspective
phénoménologique tend à toujours distinguer ces trois pôles car ils relèvent d’expériences
différentes, la perspective neurologique se doit de les étudier comme un ensemble tant ils sont
en constante relation sur le plan cérébral. Comme nous l’avons mentionné en introduction,
l’ « état motivationnel » (Masmoudi et al., 2010) est déclenché pour permettre à l’individu de
faire face à ce qu’il ressent. McNeil (2009) explicite cette idée en reprenant l’étymologie du
mot « émotion » – le terme latin movere – qui implique l’acte de mouvement ; il en déduit que
l’émotion est donc un mouvement vers l’extérieur, une extériorisation de nos états et besoins
internes fondamentaux. La motivation est donc ce qui connecte l’émotion et l’action. Le bilan
32
de nos lectures à ce sujet nous permet alors d’établir le schéma suivant, enrichi d’éléments que
nous aborderons ultérieurement :
Figure 2 : Schématisation du triangle Emotion-Cognition-Motivation
L’articulation de ces trois pôles est parfaitement résumée par Lewis et Todd (2005) : « the
biological function of emotion is to impel appropriate behaviour, given past learning and
present circumstances, by steering attention toward useful options for acting on the world and
urging one to pursue them » (cités par Dörnyei, 2009). L’émotion suscite un état motivationnel
qui invite à l’action que la cognition conditionne en fournissant une analyse de la situation
présente en fonction du vécu de l’individu. N’est-ce pas là également le fondement de tout
processus d’apprentissage spontané lorsque l’apprenant est intéressé par un sujet spécifique et
cherche de lui-même à en apprendre davantage ?
I.3. L’expérience physique des apprentissages
Le corps est le récepteur des sens qui déclenchent les émotions et les sentiments dans le
cerveau (McNeil, 2009). Comme le suppose la triade émotion-cognition-motivation que nous
Emotion
Motivation Cognition Augmente la performance cognitive.
Fournit les capacités d’analyse de la situation en fonction de l’expérience de l’individu pour optimiser les prises de décision dans l’action.
33
venons d’aborder et qui aborde le principe d’action dans les phénomènes émotionnels, il existe
une connexion indissociable entre émotions, cerveau et corps. De fait, nous savons que les
émotions donnent lieu à des manifestations physiques et cérébrales comme l’expliquait déjà
Damasio en 1999 : “All emotions use the body as their theatre of internal milieu, including
visceral, vestibular and musco-skeletal systems. However emotions also affect the mode of
operation of numerous brain circuits” (cité par McNeil, 2009). L’effet physique et
physiologique des émotions s’explique notamment par les connexions directes qui relient
l’amygdale (appartenant au système limbique) et le cortex en cas de danger afin de déclencher
certains mécanismes de survie comme l’augmentation du rythme cardiaque et de la tension
artérielle (Le Doux, 1998, cité par McNeil, 2009).
Les liens entre émotions, action physique et apprentissages sont alors de plus en plus
mis en valeur. Pour Aleta Margolis du Center for Inspired Teaching de Washington D.C.,
l’expérience physique des apprentissages est fondamentale car elle donne du sens au contenu
abordé et permet aux apprenants d’intérioriser les savoirs en savoir-faire et savoir-être par
l’action. Contrairement à ce qui est communément pensé, inviter les élèves à se lever et
effectuer des activités physiques en classe n’est pas une source de chaos mais bien une
opportunité d’optimiser les processus d’apprentissages (Margolis, 2015). L’activité physique
développe certaines parties du cerveau favorisant la mémoire et la régulation des activités
cognitives, assure l’intégrité structurelle du cerveau, ce qui favorise ainsi de meilleures
connexions entre ses différentes zones et optimise les fonctions cérébrales liées à la
concentration (Chaddock-Heyman cité par Corder Meagher, 2015).
I.4. Le pouvoir des émotions sur la mémoire
L’impact des émotions sur le fonctionnement de la mémoire semble reconnu dans de
nombreux domaines tant cela ne dépend pas seulement des situations d’enseignement-
apprentissage. Si, comme nous allons le préciser plus loin, les émotions positives facilitent les
processus de mémorisation, les émotions négatives ont un impact encore plus grand. Par
exemple, nous pouvons nous rappeler sans trop de difficultés ce que nous faisions lors d’un
évènement tragique. Cela a été démontré publiquement lors d’une émission télévisée où le
médecin présentateur Michel Cymes a évoqué le 11 septembre 2001 à ses invités, et où tous ont
affirmé se rappeler très précisément de ce qu’ils faisaient et où ils étaient lorsque les attentats
ont éclaté (Carné, 2015). Léa Salamé, l’une des invités présents sur le plateau et vivant à New
York à cette date a même été en mesure de raconter sa journée dans les moindres détails, même
34
dans les moins significatifs (elle racontait notamment être en train de manger un pain aux raisins
en sortant de son immeuble).
Depuis les travaux d’Oatley et Jenkins (1996) sur les états émotionnels, nous sommes
en mesure d’affirmer que ceux-ci impliquent « une modalité spécifique du fonctionnement
cérébral » (cité par Masmoudi et al., 2010). Or, cela n’est pas sans conséquence sur la mémoire :
lorsqu’un état émotionnel en particulier est sollicité chez un individu, cela lui donne accès au
souvenir d’évènements passés qui ont été teintés de ce même état émotionnel. Ces premières
conclusions ont amenés les chercheurs à travailler sur le concept de la rémanence de l’émotion
que Slim Masmoudi et ses collègues (2010) ont défini selon trois plans : le plan cognitif, le plan
émotionnel et le plan social. La rémanence de l’émotion sur le plan cognitif implique que les
pensées d’un individu à un moment T caractérisé par un état émotionnel spécifique sont
amenées à réapparaître sous forme de ruminations mentales, de pensées intrusives ou d’images
mentales récurrentes pendant une période donnée allant de quelques heures à plusieurs mois.
Les pensées associées à un état émotionnel particulier sont donc plus à même de revenir à la
conscience d’un individu au fil du temps. Sur le plan émotionnel, la rémanence de l’émotion se
caractérise par le phénomène inverse : les pensées d’un individu peuvent réactiver l’expérience
de certains états émotionnels pendant lesquels ces pensées sont apparues. Enfin, sur le plan
social, la rémanence des émotions peut provoquer un sentiment de solitude qui pousse
l’individu à parler de son état émotionnel avec des proches. Il s’agit d’un partage social de
l’émotion qui ne peut cependant se produire dans les cas de honte ou de culpabilité qui inhibent
le besoin de contact. Ce partage social de l’émotion est important car il créé une « dynamique
socio-affective » entre l’individu et son interlocuteur dont le développement ne peut être que
bénéfique dans le cadre de relation enseignant-apprenant par exemple. Dans le cas d’émotions
à valence négatives, le partage ne peut apporter de solution curative mais il génère une
« affection mutuelle chez les participants » tout en facilitant le sentiment d’« intégration
sociale » de l’individu qui cherchera alors à se défaire émotionnellement de l’épisode
douloureux s’il est encouragé à y travailler (Masmoudi et al., 2010).
Le rapport des émotions à la mémoire peut tout à fait être valorisé dans le cadre de
situations d’EA. Les travaux de Vygotsky, mais aussi plus récemment ceux de Lubart,
conceptualisent l’association d’une expérience émotionnelle et d’un concept en un endocept
(Puozzo Capron, 2013). L’endocept reprend le principe de rémanence émotionnelle dans le
cadre d’apprentissages : la rémanence émotionnelle « se déclenche lorsqu’[un] concept est
réactivé dans un apprentissage ultérieur. Ce facteur émotionnel entre en résonance, car il met
en lumière le potentiel de l’émotion sur l’apprentissage et son ancrage dans le long terme. »
35
(Puozzo Capron, 2013). Ainsi, le recours aux émotions dans les situations d’EA peut faciliter
la fixation de certains concepts dans la mémoire à long terme.
I.5. Les émotions dans les situations d’apprentissage : une question
fondamentalement individuelle
La structuration des apprentissages se réalise selon trois pôles : le pôle individuel, le
pôle social et le pôle contextuel (Perraudeau, 2006). Il est alors intéressant de remarquer que le
pôle individuel concentre à lui seul les composantes cognitives, conatives et affectives des
apprentissages. Les deux dernières composantes sont particulièrement importantes car elles
renvoient, pour la première, aux questions de confiance et d’estime de soi, à la motivation et à
la conception individuelle des notions de réussite et d’échec, et pour la deuxième à
l’investissement et aux liens que l’apprenant tisse avec l’école, ses pairs et les enseignants. Tous
ces éléments se reflètent dans ce que McNeil (2009) a désigné comme les trois facteurs agissant
sur la dimension émotionnelle des apprentissages. Le premier facteur comprend les objectifs
que l’apprenant doit atteindre : comme le valorise la perspective socioconstructiviste,
l’apprentissage est facilité lorsque ces objectifs allient challenge et validité sociale pour
l’apprenant. Le deuxième facteur est la conception que l’apprenant a de l’intelligence comme
entité fixe ou flexible : s’il conçoit que l’intelligence est soumise à des changements et qu’elle
peut revêtir des formes différentes, ses apprentissages en bénéficieront. Enfin, le troisième
facteur dépend de ce que l’on étudiera plus loin comme l’intelligence émotionnelle (Lafortune,
2005), incluant entre autres choses la capacité de bien s’entendre avec autrui et de s’adapter à
l’environnement d’apprentissage et à ses acteurs. Nous ajouterons à ces facteurs ce que Bandura
a défini comme le Sentiment d’Efficacité Personnelle (désormais SEP), à savoir la « perception
préalable que l’apprenant a de ses compétences et qui va lui permettre de s’engager ou non dans
une tâche » (cité par Puozzo Capron, 2014). Ce quatrième facteur répond de la dimension
émotionnelle des apprentissages et nous verrons dans d’autres parties de ce chapitre en quoi sa
prise en compte peut favoriser le travail des apprenants.
I.6. Le stress dans les apprentissages
Comme nous l’avons vu plus haut, le stress affecte les connexions entre le système
limbique et le cortex, ce qui n’est pas sans conséquence dans le cadre de situations d’EA où le
stress peut être récurrent voire chronique chez certains apprenants, notamment dans des
contextes d’évaluation ou d’examen. Le stress est d’autant plus préjudiciable à la performance
36
cognitive lorsqu’il est ressenti sur des périodes longues induites par le phénomène
d’anticipation de problèmes potentiels ou de situations angoissantes (Sapolsky, 2004 cité par
McNeil, 2009). La solution à ces dérèglements liés au stress se trouve souvent dans
l’extériorisation par la parole que prouve la métaphore de l’éléphant dans la salle (Watkins et
al, 2007 cité par McNeil, 2009) : imaginons plusieurs personnes discutant assises à une table
dans une salle de réunion. Si un éléphant est installé dans cette même salle et que personne
n’ose le mentionner, l’éléphant devient rapidement une source d’angoisse. En revanche, sitôt
que sa présence est énoncée par l’un des individus, la peur s’arrête ou tout du moins diminue et
quelque chose peut être fait pour sortir cet éléphant de la salle. Il en est de même pour les
émotions dans les situations d’apprentissage : celles-ci ont besoin d’être exprimées pour
pouvoir les réguler (McNeil, 2009).
Bien évidemment, si l’origine du stress ou de la peur est inconnue, cela peut être difficile
de la verbaliser, mais un travail autour d’elle est nécessaire pour apaiser cet « état émotionnel
de tension » (Perraudeau, 2006) qui perturbe les capacités cognitives des apprenants. Il y a vingt
ans déjà, les travaux d’Hannaford (1995) montraient que la libre expression des émotions chez
les enfants leur permettait de les utiliser à leur avantage de manière constructive et créative tout
au long de leur vie (McNeil, 2009). Aujourd’hui, les pratiques artistiques sont mises en avant
pour faciliter l’extériorisation des émotions parasites à l’apprentissage, ce qui sera l’objet de la
troisième partie de ce chapitre.
I.7. Métacognition et réflexivité au service des émotions dans
l’apprentissage
Pouvoir s’exprimer sur ce qui nous stresse ou de manière plus générale sur les émotions
ressenties pendant les apprentissages répond d’une démarche réflexive et ce car « la nature de
l’émotion est déterminée par une appréciation cognitive appelée appraisal » (Masmoudi et al.,
2010). Il s’agit donc pour l’apprenant de mieux connaître les liens entre cognition et émotions
pour pouvoir en tirer parti. « Celui-ci doit être amené à réfléchir sur ce qu’il fait, comment et
pourquoi, pour mieux comprendre ce qui sous-tend la réussite ou l’échec d’une tâche qu’il a
entreprise » (Altet, 1997) en recourant à ce qu’on appelle alors la métacognition, c’est-à-dire la
« connaissance qu’on a de ses propres processus cognitifs, de leurs produits et de tout ce qui y
touche, par exemple les propriétés pertinentes pour l’apprentissage d’informations ou de
données » (Flavell, 1990 cité par McNeil, 2009). De fait, en incluant plus de métacognition
dans leurs cours, les enseignants pourraient aider les apprenants à comprendre comment ils
37
apprennent et offrir un espace d’expression des émotions pour en faire de véritables atouts si ce
n’est des compétences transversales nécessaires à tout apprentissage.
I.8. Cultiver l’intelligence émotionnelle
Il n’est pas anodin, après tout ce que l’on vient d’exposer, de se tourner à présent vers
le concept d’intelligence émotionnelle. Etant donné l’importance des émotions pour le
fonctionnement cérébral et ses conséquences sur les processus d’apprentissage, il nous semble
intéressant d’envisager le développement des compétences émotionnelles des enseignants et
des apprenants pour optimiser nos apprentissages et la manière dont nous les construisons. Cela
supposerait alors de revoir la formation des enseignants et formateurs, mais aussi de mettre à
plat les représentations des apprenants sur l’apprentissage pour qui les émotions ne semblent
pas toujours avoir leur place dans les processus cognitifs. Lafortune (2005) présente la
compétence émotionnelle en huit points :
- La conscience de ses propres états émotifs, soit la métaémotion ;
- L'habileté à reconnaître et à comprendre les émotions des autres ;
- L'habileté à utiliser le vocabulaire associé aux émotions à l'aide ;
- La capacité d'empathie ("ressentir avec les autres") pour favoriser la communication ;
- L'habileté à comprendre que l'état émotif interne ne correspond pas nécessairement à ce
qui est exprimé ;
- La capacité à gérer des émotions d'aversion ou de détresse en utilisant des stratégies
d'autorégulation ;
- La conscience que la nature des relations ou de la communication dépend des émotions
- La capacité d'accepter ses expériences émotives et de développer un sentiment
d'autoefficacité ou, pour reprendre la théorie de Bandura, le SEP.
Ces huit points ne peuvent évidemment être tous abordés en même temps, mais ils
pourraient donner lieu à des modules de formation qui non seulement auraient des conséquences
positives sur les apprentissages mais aussi sur les relations entre les individus et les
environnements d’EA. D’après les travaux de Mayer et Salovey (1997), ces huit compétences
peuvent se réduire au quatre branches de l’intelligence émotionnelle que sont « la perception et
l’évaluation verbales et non-verbales des émotions, la capacité d’intégration et d’assimilation
des émotions pour faciliter et améliorer les processus cognitifs et perceptuels, la connaissance
du domaine des émotions (de leurs mécanismes, de leurs causes et de leurs conséquences) et la
gestion de ses propres émotions et de celles des autres » (Masmoudi et al., 2010). La
38
valorisation de la métacognition, de la métaémotion et de l’intelligence émotionnelle peut
s’avérer être un début de réponse à de nombreux obstacles des apprentissages.
Avant même d’aborder la question des pratiques artistiques comme outils de
valorisation des émotions dans les apprentissages, nous savons désormais que les recherches
effectuées dans les domaines de la psychologie et des neurosciences démontrent chaque jour de
plus en plus l’impact des émotions sur les situations d’enseignement-apprentissage et leurs
acteurs. Plus que leur impact, il s’agit de processus complexes qui ne peuvent être négligés dans
la conception d’un dispositif didactique afin que celui-ci soit efficient. Voyons à présent ce qui
caractérise les émotions dans le domaine plus précis de l’EA des langues et des cultures et
comment nous pouvons les mettre à profit pour favoriser les apprentissages.
Partie II. Emotions et didactique des langues et des
cultures
Cela fait déjà de nombreuses années que les chercheurs en didactique des langues et des
cultures (désormais DLC) travaillent notamment sur la question des représentations dans les
situations d’EA. Si le contexte et l’ambiance du lieu où s’effectuent les apprentissages a un
impact positif ou négatif sur les émotions des apprenants, les représentations positives ou
négatives que ceux-ci peuvent avoir d’une langue, de ses locuteurs ou d’un pays dans lequel
elle est employée ont des conséquences sur le déroulement des apprentissages. Enseigner une
langue correspond à un véritable travail de « médiation affective » (Goutéraux, 2010) entre un
monde familier et un monde répondant d’une langue et d’une culture étrangères. De surcroît,
l’Union Européenne perçoit l’EA des langues et des cultures comme un moyen de réduire la
haine, le racisme et l’intolérance entre les individus alors même que les langues « ne sont pas
de simples moyens de communication mais les vecteurs de nos affects, de nos croyances et de
nos identités » (Aden, 2010). A cette pression politique s’ajoute la pression économique de
l’EA des langues, celles-ci étant devenues de véritables facteurs d’employabilité pouvant
parfois faire la différence entre deux candidats à un même poste. Ainsi, outre les dimensions
affectives et émotives intrinsèques aux langues et aux cultures, il nous faut prendre en compte
les pressions extérieures qui ajoutent une charge émotive supplémentaire au fait d’enseigner et
d’apprendre une langue étrangère. Nous nous proposons alors, dans cette partie, de chercher à
y voir plus clair dans les relations entre émotions et EA des langues et des cultures afin de
39
comprendre comment nous pouvons les mettre à profit au bénéfice des apprenants et des
enseignants.
II.1. Evolution de la considération des émotions en didactique des
langues et des cultures
Si l’on considère les différences individuelles face à l’apprentissage d’une langue
seconde, Dörnyei (2009) explique qu’elles sont en général un mélange de facteurs cognitifs,
affectifs et motivationnels, ce qui a du sens si l’on considère les quatre grands types de stratégie
d’apprentissage intervenant dans l’acquisition d’une langue-culture. Il s’agit de stratégies
cognitives pour appréhender et s’approprier l’input langagier et culturel, de stratégies
métacognitives pour l’observation, l’analyse, l’évaluation et l’organisation des processus
d’apprentissage, de stratégies sociales pour favoriser le recours à la communication en langue
cible avec des tiers et enfin de stratégies affectives pour contrôler les contextes et les
expériences émotives qui impliquent l’apprenant de manière subjective dans ses apprentissages
(Dörnyei & Skehan, 2005).
Alors que ces quatre grands types de stratégie interviennent dans toute situation d’EA
des langues et des cultures, nous sommes en mesure d’avancer qu’elles n’ont pas toujours été
considérées comme interdépendantes au fil des approches didactiques mises en place. Enrica
Piccardo (2013) en fait le constat dans un panorama historique de la prise en considération des
émotions en DLC. Elle nous explique qu’au début du XXème siècle, les émotions étaient
comprises comme relevant de la langue maternelle des individus, et qu’une langue étrangère
était alors un moyen d’expression impliquant une distance entre ce qui était dit et la nature
subjective de l’apprenant. Plus tard, le behaviorisme a quelque peu inclus les émotions dans les
processus d’apprentissage par renforcement émotionnel positif ou négatif en fonction des
productions des apprenants : le renforcement positif appelait à la répétition de ce qui était
attendu, et le négatif impliquait une correction de la production. Dans l’approche
communicative, la dimension émotive a été entièrement délaissée, les didacticiens considérant
alors que communiquer, dans quelque langue que ce soit, ne se réduisait qu’à transmettre des
informations. Avec la valorisation de l’interculturel et l’arrivée progressive de ce que l’on
appelle aujourd’hui les approches plurielles à partir des années 1990, les émotions ont été
intégrées aux préoccupations de validité sociale de l’EA des langues-cultures en cherchant à
valoriser des cadres et buts d’apprentissage authentiques. Puis, le cognitivisme s’est intéressé à
la distinction des émotions qui d’un côté favorisent et de l’autre freinent les processus
40
d’apprentissage mais en inscrivant les émotions comme facteurs propres à l’apprenant. Le
socioconstructivisme a apporté le rapport manquant en définissant les émotions comme facteurs
externes, c’est-à-dire, liés à l’environnement d’apprentissage, pour en définir les impacts sur
l’apprenant. Aujourd’hui, l’approche actionnelle par le projet ou les tâches est reconnue comme
favorisant les émotions positives des apprenants, et donc, leurs apprentissages des langues et
des cultures lorsque les projets ont une finalité claire, valorisent leurs compétences et sont en
lien avec leurs ambitions professionnelles (Berdal-Masuy & Botella, 2013).
II.2. La question de l’anxiété langagière
Le parcours d’apprentissage d’une langue et culture étrangères semble générer un stress
différent de celui que peut ressentir un apprenant en mathématiques ou en philosophie par
exemple ; la raison de cela est que l’apprentissage d’une langue-culture ne peut que
difficilement être effectuée sans être évalué à l’oral, contrairement à d’autres disciplines dans
le contexte scolaire institutionnel notamment (Puozzo Capron, 2014). Les évaluations des
compétences de production orale génèrent le plus souvent des émotions parasites qui alimentent
le stress de l’apprenant en langue étrangère. Dans ses travaux, Arnold (2000) explique ce
phénomène stressant de l’oral pour ce qu’il suppose d’investissement personnel de la part de
l’apprenant. Si les méthodes basées exclusivement sur de l’écrit comme « la méthode
grammaire-traduction » sont moins sources d’anxiété, l’approche communicative et au-delà
encore l’approche actionnelle sont porteuses d’une charge émotionnelle beaucoup plus
importante (cité par Puozzo Capron & Piccardo, 2013). Ce type d’anxiété pourrait être
rapproché du concept de « performance anxiety » (MacKenzie, 2014) ou « trac » qui caractérise
l’état de stress dans lequel une personne peut se trouver avant de se produire ou de parler en
public, comme cela peut être le cas dans des situations d’EA des langues et des cultures.
Certains chercheurs, et notamment MacIntyre et Gardner (1994) se sont alors intéressés
à l’anxiété langagière, cette « sensation de tension et d’appréhension associée aux contextes où
la langue seconde est présente, tant pour communiquer (parler, comprendre) que pour
l’apprendre » (cité par Brewer, 2010). Il s’agit là d’une anxiété langagière particulière, propre
à l’EA des langues et des cultures, qui est vectrice d’émotions négatives nombreuses chez
l’apprenant. De fait Stephen Scott Brewer (2010) définit cinq facteurs principaux de l’anxiété
langagière. Le premier est la sensation que l’apprentissage d’une langue est un projet sur très
long terme qui exige une implication importante de la part de l’apprenant. Le deuxième facteur
est le sentiment d’incompétence que certains apprenants peuvent ressentir lorsqu’ils
41
interagissent avec des personnes dont le niveau en langue cible est perçu comme supérieur, ce
qui peut s’accompagner d’une peur de non-compréhension des discours à l’oral, troisième
facteur de l’anxiété langagière. Puis, certains apprenants exigeants envers eux-mêmes s’auto-
infligent de la pression et du stress face à l’erreur dans leurs productions, erreur qu’ils
n’acceptent pas et que leur entourage peut aussi rejeter, plaçant ainsi la pression d’exigence
comme quatrième facteur. Enfin, le dernier facteur de l’anxiété langagière est la dimension
inconnue ou moins familière d’une langue-culture cible qui suscite une peur de remise en cause
personnelle forte dont nous reparlerons ultérieurement. L’anxiété langagière n’agit donc pas
exclusivement sur les capacités cognitives des apprenants mais les fait se sentir incapables
d’apprentissage ; elle affaiblit leur perception de leur propre coping cognitif, ce qui nécessite
d’entreprendre un travail autour du SEP ou encore autour de l’agentivité : il est question
d’effectuer un travail sur chaque apprenant dans sa capacité « d’imaginer, anticiper et planifier
l’avenir, d’agir intentionnellement, de motiver et réguler sa propre activité et d’examiner
réflexivement ses propres actions et pensées » (Brewer, 2010). Nous pouvons avancer que
l’action agentique complète ce que nous abordions autour de la réflexivité, de la métacognition
et de la métaémotion dans la partie précédente, avec l’avantage que cette démarche
développerait les cellules cérébrales intervenant dans les processus d’apprentissage et de
mémorisation (Brewer, 2010).
II.3. Apprentissage d’une langue-culture et répercussions sur la
personnalité de l’apprenant
Il n’est pas anodin que le Conseil de l’Europe, tant avec le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL) qu’avec le plus récent Cadre de Référence pour les
Approches Plurielles (CARAP) fasse émerger la notion de savoir-être dans les situations d’EA
des langues et des cultures (Piccardo, 2013). Elle implique la relation indéfectible entre
cognition et émotion dans le domaine, et lie par la même occasion les compétences linguistiques
et pragmatiques nécessaires à toute réalisation en langue et culture cibles. Tout comme la
personnalité fait partie des facteurs individuels interférant dans les processus d’apprentissage
d’une langue étrangère, aussi difficile soit-elle à identifier et quantifier (Lightbown & Spada,
2006), il ne faut pas oublier qu’apprendre une langue étrangère suppose des altérations de la
personnalité de l’apprenant par la découverte d’une autre manière de se représenter le monde
et de le dire (Aguilar Río, 2013). En effet, « apprendre une autre langue, c’est d’abord accepter
de quitter la sécurité des schémas cognitifs que nous avons développés dans un groupe, une
42
culture, une langue, et aller à la rencontre de la différence qui remet les normes en perspective »
(Aden J. citée par Puozzo Capron & Perrin, 2014).
Plus que les normes, c’est bien des « façons de faire, dire, voir, sentir » (Berchoud,
2013) qui sont bouleversées, ce qui nous amène à nous demander si l’apprentissage d’une
langue-culture n’impliquerait pas une évolution ou plutôt un développement des émotions de
l’apprenant. Nous pensons alors à ces émotions pour lesquelles nous ne pouvons parfois trouver
de mot pour les exprimer que dans une langue autre que notre langue maternelle, et qui
pourraient sans doute être un signe d’enrichissement de la personnalité de l’apprenant, la preuve
d’une découverte d’une réalité émotionnelle nouvelle, offerte par l’apprentissage d’une langue-
culture étrangère à la nôtre. Nous pourrions trouver un appui à cette hypothèse dans les mots
de Blandine Rui (2013) qui voit dans l’apprentissage des langues et des cultures une opportunité
de « subjectivation » de l’apprenant : « […] la langue étrangère est un espace de
questionnement pour un sujet l’entrainant à un retour inconscient sur son rapport à la langue
des origines et à ce qu’elle charrie de décisif pour son fonctionnement psychique. Elle l’incite
à revisiter et à transformer sa relation aux mots, à soi et au monde ». Imaginons alors ce que
cela peut supposer chez des personnes bi ou plurilingues par l’expérience de l’immigration, et
combien l’usage ou l’apprentissage d’une langue ou d’une autre peut provoquer des « conflits
intérieurs et identitaires » (Piccardo, 2013) que la DLC ne peut ignorer parmi ses enjeux.
II.4. Le cas particulier de l’enseignement-apprentissage de l’arabe
Catherine Pinon (2013) reprend une définition de Livet pour nous ouvrir à une autre
perspective sur les émotions dans l’apprentissage des langues et des cultures : les émotions
seraient des « réactions à la perception d’un différentiel », que celui-ci soit culturel, religieux,
historique et/ou social. Et c’est ce qui nous amène à considérer à présent l’EA de l’arabe en
France, car les représentations et par conséquent les émotions qui en découlent sont
particulièrement représentatives des freins qu’elles peuvent générer lors des processus
d’apprentissage d’une langue. L’EA de l’arabe en France suscite de nombreux enjeux affectifs,
d’une part parce que cette langue dispose d’un statut et de représentations particulières auprès
des non-arabophones, et de l’autre parce qu’elle fait l’objet d’une sacralisation théologique
voire idéologique auprès des arabophones, ce qui lui confère une charge émotionnelle forte.
L’enseignement de cette langue dans les écoles françaises s’est d’abord réalisé dans le cadre
des Enseignements des Langues et Cultures d’Origines (ELCO), or, l’appellation même de ce
dispositif pose problème en ce qu’elle suppose de marginalisation linguistique et culturelle :
43
enseigner ce que l’on nomme « langue d’origine » participe au phénomène d’étiquetage des
apprenants en fonction de leurs origines, origines auxquelles ils n’ont pas forcément envie
d’être toujours associés, sans pour autant les renier (Billiez, 2002). A ce problème de
marginalisation s’ajoute un phénomène de culpabilisation et d’insécurité linguistique pour les
élèves dialectophones qui ne parlent pas forcément l’arabe moderne enseigné à l’école, ou qui
ne savent pas le lire ou n’en connaissent pas tous les mots alors même qu’il représente un
« facteur d’identification » et « un vecteur de la mémoire familiale » (Pinon, 2013). Les
émotions négatives liées au fait de suivre un cours d’arabe pour un dialectophone sont
nombreuses car d’un côté il se sent marginalisé comme non-francophone et/ou non de culture
française en France, et de l’autre côté on lui reproche de ne pas être un « bon » arabophone ni
d’être réellement de culture arabe dans les pays arabes. Il est donc un « individu sans culture et
sans langue » (Billiez, Biiché et Abouzaïd, 2012, cités par Pinon, 2013).
Ces élèves font alors face à un paradoxe supplémentaire : alors qu’on leur fait remarquer
leurs possibles faiblesses face à l’usage du français à l’école et dans la société, leur bilinguisme
et leur éventuelle expérience de l’immigration représentent un atout pour l’apprentissage
d’autres langues car ils ont conscience des différences de perception du monde en fonction de
langues différentes (Wharton, 1995, 1996, citée par Billiez, 2002). Tout comme Enrica Piccardo
(2013) parlait de « conflits intérieurs et identitaires », on comprend le poids des émotions que
ces paradoxes revêtent pour les élèves dialectophones en cours d’arabe, notamment à
l’adolescence où l’apprenant peut refuser d’apprendre par rejet de l’influence familiale ou se
sentir stigmatisé d’apprendre une langue qu’il serait déjà censé parler. Avec le principe de
rémanence des émotions que nous avons abordé antérieurement, nous pouvons comprendre que
ces émotions négatives sont renforcées par l’obligation d’assister à un cours que l’élève veut
abandonner, et qu’il vit alors comme une véritable violence (Pinon, 2013). Il ne faut pas oublier
qu’aux émotions des apprenants s’ajoutent aussi celles de l’enseignant qui se caractérisent par
des réactions aux éventuels préjugés de ses collègues, au statut informel associé à la langue
qu’il enseigne et au mal-être des élèves dialectophones qui assistent à son cours (Pinon, 2013).
La seule solution aux nombreuses difficultés auxquelles fait face l’EA de l’arabe est de
favoriser les émotions positives en présentant la langue et la culture d’origine de l’apprenant
comme un bien collectif aux yeux de tous, sans réduire son identité à cette langue et à cette
culture. Il s’agit de valoriser son bi ou plurilinguisme sans pour autant le restreindre à cela, et
lui permettre d’élargir ses horizons d’apprentissages linguistiques et culturels (Billiez, 2002).
Mettre à plats les stéréotypes et les idées reçues des apprenants dès le premier cours puis tout
au long de l’année, éviter les dérives de folklorisation et accompagner les apprenants à
44
découvrir la diversité de la langue et des cultures arabes, en faisant en sorte de ne pas les mettre
en échec pour renforcer leur sentiment de sécurité linguistique (Pinon, 2013).
II.5. Premiers bénéfices de la prise en compte des émotions en
didactique des langues et des cultures
Avant d’aborder la question de l’empathie en DLC, nous voulons mentionner ici certains
bénéfices supplémentaires qu’apporte la prise en compte des émotions dans les situations d’EA
des langues et des cultures. Ces bénéfices sont bien souvent liés au développement des
compétences émotionnelles dont nous avons parlé en première partie de ce chapitre, car ils
replacent tout d’abord l’autonomie émotionnelle comme « finalité transversale » de l’école
(Puozzo Capron & Piccardo, 2013). L’un des outils mis en œuvre dans cette optique est la
biographie ou l’autobiographie langagière qui amène les apprenants à réfléchir sur leur relation
avec les langues et les cultures : les langues qu’ils parlent, apprennent, avec lesquelles ils sont
ou ont déjà été en contact, celles qu’ils voudraient apprendre, les cultures qu’ils aimeraient
découvrir. Ce type de démarche encourage la réflexivité tant des apprenants que des enseignants
pour mieux comprendre les rapports de chacun avec les langues et les cultures, et en dégager
les représentations et liens affectifs positifs ou négatifs qui se sont créés et qui peuvent expliquer
aujourd’hui les facilités ou au contraire les difficultés de certains apprenants dans leur processus
d’apprentissage, mais aussi de certains formateurs dans l’exercice de leur métier auprès des
apprenants (Perregaux, 2002). La biographie langagière est notamment présente dans le
Portfolio Européen des Langues promu par le Conseil de l’Europe (2011). Enfin, Goutéraux
(2010) rappelle que l’expression des émotions des apprenants est nécessaire, et cela suppose de
créer des environnements et des relations de confiance et de respect entre les acteurs de
l’apprentissage pour que tous se sentent libres de parler. Elle explique que cela peut s’intégrer
dans les programmes d’EA des langues et des cultures en cherchant la réalisation de tâches à
but appréciatif ou esthétique plus qu’analytique lors de l’étude d’un texte par exemple. Il serait
alors question d’interroger les élèves sur ce que le texte réveille en eux, sur leur éventuelle
identification avec un personnage ou encore sur la réponse qu’ils aimeraient apporter au texte :
ces méthodes libèrerait la parole de tous, contribuerait à la consolidation de la relation de
confiance entre le groupe et l’enseignant et favoriserait les processus d’apprentissage en
impliquant l’apprenant de manière plus personnelle dans ce qu’il entreprend.
45
II.6. Le concept d’empathie : une compétence émotionnelle clé pour
l’enseignement-apprentissage des langues et des cultures
Comme nous venons de le présenter avec les recherches de Pascale Goutéraux,
l’implication personnelle de l’apprenant dans son apprentissage d’une langue-culture est
primordiale pour que celui-ci soit efficient. Joëlle Aden (2010) le souligne à sa manière en
affirmant que « tout dispositif didactique doit prendre en compte non seulement le contexte
d’enseignement/apprentissage et les compétences requises pour interagir efficacement dans une
autre langue-culture, mais qu’il doit parallèlement donner une place à la perception subjective
que l’apprenant a de lui-même et de l’autre, processus qui nécessite un travail concret sur les
émotions liées à l’expérience de la rencontre de la différence dans la mesure où toute perception
passe par le filtre émotionnel ». Apprendre une langue et une culture suppose, de fait, de se
confronter à un monde moins familier voire différent que notre subjectivité nous fait percevoir
à travers le prisme de notre langue-culture maternelle. Pour espérer la réussite de l’apprenant,
il faut alors chercher à tirer parti du rôle des émotions dans l’apprentissage pour développer
l’empathie, cette « compétence dans le développement de l’intercompréhension langagière et
de la relation culturelle » (Aden, 2010). Or, il ne faut pas confondre l’empathie avec le fait de
s’attacher émotionnellement à une langue-culture ou à ses locuteurs (Parcherie, 2004, cité par
Aden, 2010). La dimension émotionnelle du processus d’apprentissage d’une langue-culture
réside particulièrement dans le fait que la représentation que se fait l’apprenant de l’Autre
implique nécessairement une représentation de lui-même. L’empathie est alors l’« aptitude à se
mettre à la place de l’autre tout en restant conscient d’être soi-même » (Aden, 2010), ce qui
nous ramène à la considérer comme une véritable compétence émotionnelle qui favorise la
communication (Lafortune, 2005) et qui développe des émotions positives dans le cadre de
situations d’EA des langues et des cultures.
L’empathie est d’autant plus importante qu’elle pourrait permettre à l’apprenant d’avoir
une connaissance plus affective de la langue qu’il apprend, c’est-à-dire qu’il pourrait parfois
mieux appréhender la dimension profondément émotionnelle qu’elle revêt (Mallet, 2013). Nous
pourrions notamment penser que le développement de l’empathie chez les apprenants de
langues et cultures leur offrirait de mieux percevoir le contraste entre deux phrases similaires
sur le plan sémantique mais différentes en termes de charge émotionnelle. En guise d’exemple,
nous pouvons comparer « La Guerra Civil fue difícil » et « La Guerra Civil ha sido difícil »,
deux phrases signifiant toutes deux la même chose mais impliquant une charge émotionnelle
très différente pour un Espagnol. Dans le premier cas, le recours au verbe au passé simple
46
implique que, dans l’esprit du locuteur, la Guerre Civile est désormais révolue, et il déclare
comme factuel le fait qu’elle ait été difficile. En revanche, dans la deuxième phrase, l’utilisation
du passé composé donne une dimension émotionnelle forte puisque ce temps définit un passé
dont les conséquences se font encore ressentir dans le présent, signifiant donc que le souvenir
de la Guerre Civile est encore douloureux pour le locuteur. Après ce que nous venons de
montrer avec les travaux de Joëlle Aden et de Claire Mallet, il nous semble que le
développement de l’empathie comme compétence émotionnelle permettrait sans doute
d’éclairer jusqu’à certains usages grammaticaux d’une langue étrangère, et affirmerait le lien
indéfectible entre langue(s) et culture(s) dans l’esprit des apprenants, tout en renforçant leurs
compétences pragmatiques au moment de s’exprimer en langue étrangère.
II.7. Les approches plurielles à la rencontre des émotions en didactique
des langues et des cultures
Les approches plurielles regroupent les quatre démarches suivantes : l’approche
interculturelle, l’intercompréhension entre les langues parentes, la didactique intégrée des
langues et l’éveil aux langues. C’est bien l’éveil aux langues qui nous intéresse ici tel qu’il a
été conçu « comme accueil des élèves dans la diversité des langues (et de leurs langues !) dès
le début de la scolarité, comme vecteur d’une meilleure reconnaissance dans le contexte scolaire
des langues ‘apportées’ par les élèves allophones, […] comme accompagnement des
apprentissages linguistiques tout le long de la scolarité » (Candelier, 2007). Il s’agit, pour
reprendre les mots de Françoise Le Lièvre (2014), de considérer l’ « aspect social » du
plurilinguisme, au-delà de sa dimension institutionnelle déjà reconnue.
Dans ses nombreuses recherches sur les approches plurielles et l’éveil aux langues,
Jacqueline Billiez (2002) nous montre comment ces démarches anticipent voire incluent la
dimension émotionnelle des apprentissages en langues et cultures étrangères. Selon elle, les
approches plurielles favorisent une « conscientisation » du contact des langues, de leurs
différences et de leurs ressemblances tout en cherchant à ce que les apprenants comprennent le
principe de relativisme linguistique selon lequel chaque langue façonne une vision particulière
de la réalité. Dans le cadre de l’EA de langues minorisées comme l’arabe dont nous parlions
plus haut, Billiez décrit l’apport réflexif des approches plurielles sur les questions de différence
de statut entre les langues pour permettre aux apprenants de comprendre que ces différences ne
sont pas justifiées, ce qui favorise le développement de représentations et d’attitudes plus
positives envers les langues et l’Autre qui est alors reconnu dans sa singularité comme dans son
47
universalité. De même, les approches plurielles permettent la reconnaissance de la biographie
langagière des apprenants dans leur objectif de décloisonnement des langues pour en faire un
support d’évolution des compétences métalangagières et ainsi faciliter les apprentissages futurs
(Lörincz, 2014). Mais elles permettent aussi à l’apprenant de mieux définir son rapport aux
langues et ainsi développer son intelligence émotionnelle dans la reconnaissance des émotions
ressenties et suscitées par les langues et les cultures dans sa vie de tous les jours comme dans
les situations d’EA dans lesquelles il peut se trouver.
Si l’on s’arrête exclusivement sur l’éveil aux langues auprès de jeunes apprenants, il
nous semble important de rappeler que la valorisation d’une approche émotionnelle des
apprentissages se réalise justement parce qu’il n’y a pas d’exigence d’apprentissage en tant que
telle : « […] l’acquisition possible ne se mesure pas en termes de progression quant au contenu,
mais en termes d’enrichissement personnel, divers selon la personnalité, l’arrière-plan
linguistique de chacun. […] l’essentiel n’est pas d’y vérifier un savoir mais d’y amorcer un
changement personnel, source d’un tout autre rapport aux langues (apprises plus tard) et à soi »
(Bourdet, 2014). C’est la dimension affective et personnelle de la rencontre avec les langues et
les cultures qui est mise en avant. Joëlle Aden l’affirme à son tour en faisant remarquer que
« ce ne sont pas les connaissances sur les langues qui priment mais les liens qu’il faut imaginer,
les chemins qu’il faut parcourir ensemble, pour qu’émerge un sens partagé » (Aden & Leclaire,
2014): l’éveil aux langues est avant tout une expérience dont les résultats sont qualitatifs avant
d’être quantitatifs. Les apports de l’ouverture à la diversité linguistique et culturelle et la
valorisation des démarches réflexives sur les langues et la communication auprès de jeunes
enfants ont pu être observés notamment dans le cadre du projet européen Evlang mis en place
à la fin des années 1990. Alors que le bilan quantitatif de cette démarche instaurant l’éveil aux
langues dans des classes de maternelle et primaire ne s’est pas révélé aussi concluant qu’espéré,
le bilan qualitatif a lui prouvé que ce type de démarche participait à la construction d’une culture
des langues et du langage qui offrait une meilleure compréhension des situations de
plurilinguisme dans lesquelles vivaient les enfants. Outre l’engouement général de la part de
tous les acteurs du projet qui a développé les émotions positives lors des apprentissages, Evlang
a permis de mettre en lumière l’apport de l’éveil aux langues et des approches plurielles en
termes de favorisation de représentations positives des langues : les enfants francophones en
contact avec une langue de migration ayant participé au projet ont davantage manifesté l’envie
d’apprendre cette langue à l’école que les enfants n’ayant pas bénéficié de ce dispositif (Billiez,
2002).
48
II.8. Implications de ces résultats dans la formation des enseignants
Tout ce que nous avons pu aborder jusqu’à présent dans ce chapitre suppose, comme
nous l’avons déjà suggéré, d’entreprendre un travail en amont des situations d’EA des langues
et des cultures, au niveau de la formation des enseignants et des formateurs. Ceux-ci ont besoin
de connaître le rôle et l’impact des émotions dans les apprentissages pour comprendre comment
ils peuvent en bénéficier au profit de leurs apprenants. Une des premières implications pour
l’enseignant ou le formateur est de faire se sentir l’apprenant comme compétent dans ses
apprentissages en valorisant son SEP (Puozzo Capron, 2014) par la mise en place de tâches ou
de projets qui valorisent ses compétences. Cela permettra à l’élève de subjectiver ses
apprentissages. Concernant le stress, il est certain que l’enseignant peut chercher à le diminuer
(tant il est difficile de pouvoir l’éliminer) en générant une atmosphère d’apprentissage positive.
Mais il peut aussi le faire en apprenant à l’élève à gérer son stress de lui-même car le travail sur
l’environnement seul n’est pas suffisant pour les personnalités anxieuses (Brewer, 2010) : le
stress étant un phénomène individuel, l’apprenant est celui qui est le plus à même de le contrôler
en l’aidant à en prendre conscience et en lui donnant des outils pour le faire. C’est ce que peut
apporter la mise en place d’une démarche agentique par les enseignants qui aideraient alors les
apprenants à contrôler leurs émotions, maîtriser leur attention et être autonomes et persévérants
dans leurs apprentissages sur le long terme (Brewer, 2013). Alors que la préoccupation
principale des enseignants et des formateurs est souvent de savoir comment motiver leurs
élèves, Brewer (2013) nous rappelle que le véritable enjeu est avant tout de savoir comment les
aider à se motiver eux-mêmes, ce qui les placera au cœur de leurs apprentissages comme le
préconise la perspective sociocognitiviste.
Or, la formation des enseignants et formateurs ne doit pas seulement être orientée vers
les apprenants : « tout enseignant entretient des rapports affectifs, cognitifs et sociaux très
particuliers avec les langues et variétés de langues qui composent son répertoire langagier
personnel, quelle que soit celle(s) qu’il a à enseigner dans l’exercice de son métier […] »
(Simon & Thamin, 2012). Ces rapports doivent être pris en compte et abordés dans la formation
des professionnels. Aguilar Río (2013) explique que cette formation doit avant tout faire
prendre conscience aux acteurs de l’enseignement de leurs propres émotions pour pouvoir
mieux y répondre et indirectement mieux répondre à celles de leurs apprenants. Ils doivent se
montrer confiants dans leur utilisation de la langue qu’ils enseignent tout en l’employant de
manière adaptée pour les élèves et prendre conscience des messages émotionnels qu’ils peuvent
leur transmettre : ceux-ci peuvent tout à fait servir à l’instauration d’une atmosphère
49
d’apprentissage qui valorise le « sens de groupe », l’ « attitude amicale » et le « soutien ». La
prise en compte des émotions dès la formation des enseignants et formateurs est un moyen de
leur faire prendre conscience de leur rôle dans le développement des « compétences
émotionnelles des apprenants » (Aguilar Río, 2013) pour ainsi faciliter à la fois leur
enseignement et les apprentissages de leurs élèves.
Si les émotions ne peuvent être dissociées des aspects cognitifs des apprentissages, la
DLC ne fait pas exception, d’autant plus que les situations d’EA des langues et des cultures
revêtent à elles-seules des dimensions émotionnelles et affectives qui ont une influence sur les
enseignants et les apprenants, mais aussi plus largement sur les sociétés dans leur construction
de représentations pouvant freiner voire bloquer les apprentissages. La découverte d’une langue
et d’une culture étrangères implique la remise en cause d’une vision du réel propre à l’apprenant
qui peut se révéler être une source de déstabilisation profonde, et ce alors même que son
implication doit être entière pour répondre aux exigences d’une approche actionnelle. Sa parole
est également mise en jeu pour satisfaire la dimension orale d’un tel apprentissage. La
valorisation des approches plurielles et particulièrement de l’éveil aux langues dès le plus jeune
âge peut apporter une réponse au besoin de préparation des apprenants à cette expérience
émotionnelle qu’est l’apprentissage de langues-cultures. L’approche ludique, teintée
d’émotions positives, semble être une véritable invitation pour les pratiques artistiques qui,
comme nous allons le voir à présent, peuvent être une véritable médiation entre l’EA des
langues et des cultures et les enjeux émotionnels que celle-ci comporte.
Partie III. Au confluent des émotions et de
l’enseignement-apprentissage des langues et des
cultures : l’apport des pratiques artistiques
Les raisons sont nombreuses de vouloir intégrer les pratiques artistiques dans les
apprentissages, quels qu’ils soient. A l’école Bates Middle School d’Annapolis dans le
Maryland, les arts sont présents dans chaque discipline depuis 2009. La danse est utilisée pour
comprendre le principe des mouvements en physique, les toiles d’Andy Warhol pour
comprendre les fractions en mathématiques. Et en trois ans, le taux de rappel à l’ordre et de
suspension a diminué de 23%, les élèves ont montré plus d’investissement personnel en classe
et leurs résultats présentent les preuves d’une compréhension et d’une intériorisation des savoirs
accrues (Nobori, 2012). L’évolution de l’implication des apprenants s’est aussi révélée grâce
50
au recours aux arts dans les recherches menées par Joëlle Aden (2010) : l’expérience
émotionnelle vécue lors d’une identification d’un apprenant avec un personnage d’une pièce de
théâtre ou d’un film étudié en cours a des effets positifs sur sa motivation à réaliser la tâche
demandée et sur la qualité de ses productions. C’est que l’art et les pratiques artistiques ont,
comme les langues et les cultures, cette ambivalence entre le personnel et le commun : « l’art
donne lieu à des expériences qui sont en même temps partageables et individuantes : je ne peux
partager que ce qui est mien et, réciproquement, ce que je reconnais comme moi est ma
contribution personnelle au monde commun » (Zask, 2008). La dimension éminemment
émotionnelle, qu’elle soit individuelle et/ou collective, des pratiques artistiques, nous semble
être un atout pour les apprentissages, et particulièrement pour l’apprentissage des langues et
cultures étrangères dont nous allons parler dans cette partie.
III.1. Les arts comme Disciplines Non Linguistiques d’exception
Dans les établissements du second degré, les disciplines non-linguistiques (désormais
DNL) sont de plus en plus proposées en langue étrangère dans le cadre de sections européenne
ou internationale. Si le plus courant est de voir des disciplines comme l’histoire ou la littérature
se définir comme DNL, les pratiques artistiques n’en sont pas moins valorisées dans ce cadre
car elles offrent de larges possibilités d’association avec l’EA des langues et des cultures. De
fait, les cours de langues et cultures étrangères par les arts répondent d’une approche culturelle
que l’on pourrait considérer comme évidente tant la littérature, les beaux-arts, le cinéma ou la
musique sont entrés dans les programmes d’EA des langues. A l’inverse, lorsqu’une œuvre se
révèle plus évocatrice que référentielle, notamment dans le domaine musical, l’opportunité se
présente de pouvoir exprimer des interprétations diverses formées à partir des ressentis et de
l’imagination des apprenants qui se développent alors (Arleo, 2000). Mais les arts permettent
aussi d’offrir une « entrée esthétique » (Gardner, 1996 cité par Perraudeau, 2006) des
apprenants dans l’apprentissage en cherchant par exemple à introduire un thème par l’étude
d’une œuvre qui va elle-même participer à la construction de connaissances. De plus, la
perspective esthétique de l’étude d’une œuvre plastique par exemple permet d’apprendre à
regarder pour pouvoir mieux dire ensuite : des apprenants de Français Langue Etrangère
(désormais FLE) initiés à l’expression écrite par l’intermédiaire de photographies témoignent
notamment d’un développement des compétences méthodologiques liées à l’activité visuelle
comme la mise en page, la présentation et la structure des textes qu’ils rédigent (Borgé, 2014).
Dans un autre contexte, Stéphanie Witzigmann utilise l’image comme levier de parole dans une
51
classe de DNL mêlant arts plastiques et FLE dans un collège allemand : l’instauration d’un code
visuel a permis de faciliter la compréhension et la mémorisation en langue cible et les
performances artistiques des élèves se sont révélées être de véritables productions
interactionnelles permettant l’appropriation des contenus disciplinaires via des actions
multisensorielles concrètes (Witzigmann, 2014). Cette approche holistique de l’apprentissage
d’une langue-culture a permis de réveiller des émotions chez les apprenants qui ont multiplié
leurs interventions spontanées en langue cible pour exprimer leur subjectivité face aux notions
abordées.
Plus globalement, les situations d’EA mêlant les arts aux langues et cultures tendent à
développer l’imagination, la compréhension mais aussi la motivation des apprenants (Boddie,
2014), ce qui est corroboré par les recherches en neurosciences. Slim Masmoudi et son équipe
de chercheurs (2010) affirment que la motivation « joue un rôle relais entre [les] processus
[créatifs] et les autres processus cognitifs. […] [Elle] accompagne toujours, à travers son rôle
relais, les liens entre les entrées sensorielles, les styles cognitifs et les processus créatifs », ce
qui nous invite à penser que la démocratisation des pratiques artistiques comme DNL peut être
tout à fait pertinente dans la recherche de favorisation des apprentissages en langues et cultures
étrangères.
III.2. Les émotions : amont et aval des pratiques artistiques
Maintenant que nous avons défini le bien fondé des associations entre arts et EA des
langues et des cultures, il nous semble important de mettre en lumière en quoi ces deux éléments
se retrouvent également sur le plan des émotions. Cela passe tout d’abord par la prise en
considération des émotions comme phénomène qui est souvent à l’origine de la naissance
d’œuvres d’art : l’artiste tend à créer lorsque des émotions le traversent et qu’il a besoin de les
exprimer, de les sublimer à travers une pratique artistique. Nous pouvons l’observer à travers
certaines œuvres picturales comme le Guernica de Pablo Picasso qui rassemble toute la douleur,
la souffrance, la tristesse et la colère d’un artiste face au bombardement d’un village espagnol
par l’aviation allemande en 1937. De la même manière, il s’agit bien d’extérioriser des émotions
qui travaillent l’artiste lorsque Bob Dylan compose puis chante The times they are a-changing
en 1964 ou de manière plus parlante encore, lorsque les associations pour les Droits Civiques
des Afro-Américains entonnent des freedom songs pour revendiquer leur égalité. Bien
évidemment, nous pourrions reprocher à ces exemples d’être nés de convictions, mais si les
émotions n’en sont pas à l’origine, elles apparaissent lors de l’expression de ces œuvres. C’est
52
d’ailleurs les émotions exprimées qui, à leur tour, peuvent en susciter chez le destinataire de
l’œuvre. Sur un plan pédagogique, il s’agit d’un phénomène important car l’interpellation des
émotions de l’apprenant l’implique personnellement dans l’activité réalisée (Arleo, 2000). Jean
Luc Leroy (2008) affirme par exemple que le pouvoir émotionnel d’une mélodie peut apporter
plusieurs bénéfices, notamment en classe où la diffusion d’une musique peut enclencher un
processus « d’accordage émotif intra et interpersonnel » qui consolide la dimension
communautaire parmi les apprenants tout en les rendant individuellement plus réceptifs aux
opportunités d’apprentissage.
Les émotions ne sont donc pas obligatoirement le déclencheur de productions
artistiques, mais elles apparaissent tout à fait comme résultat d’une performance artistique.
C’est ce qu’affirme Isabelle Puozzo Capron (2014) en s’appuyant sur les travaux de Holley qui
définissent la relation étroite qui existe entre œuvre, émotion et cognition : l’émotion esthétique
ressentie face à une œuvre est d’abord perçue grâce « aux constituants élémentaires de
l’œuvre » comme peuvent l’être la couleur pour un tableau, la mélodie pour une musique ou
encore la poésie pour une pièce de théâtre. Puis, la personne qui reçoit l’œuvre y ajoute des
apports cognitifs qui accompagnent le plaisir esthétique par des « connaissances, de[s]
références [et d]es comparaisons ». Pour Puozzo Capron, ces liens sont à la base de sa
pédagogie de la créativité dont nous parlerons plus en détail à la fin de cette partie ; ils sont
aussi, en ce qui nous concerne, une démonstration de la compatibilité des arts et des situations
d’EA d’autres disciplines que nous nous proposons d’approfondir dans les lignes suivantes.
III.3. Réintégrer la place du corps dans les apprentissages
Dans la première partie de ce chapitre, nous avions établi les relations entre cognition,
émotion et mouvement par les neurosciences, ces trois pôles étant intimement liés dans les
processus d’intégration des apprentissages par un individu. Du côté des pratiques artistiques,
c’est la danse mais surtout le théâtre qui ont été étudié dans le cadre de recherches alliant
pratiques artistiques et EA des langues et des cultures, et qui placent le mouvement, le geste,
au centre de leurs préoccupations. Pour Claire Mallet (2013), le jeu dramatique est
particulièrement pertinent pour enrichir les pratiques en DLC car « le comédien est par
définition l’incarnation de la langue. Chez lui, corps et langue sont intimement liés. Il ne peut
se contenter d’une compréhension intellectuelle des mots, mais doit les éprouver, les faire chair
pour les appréhender et donner à voir et entendre leur sens » : le théâtre permettrait donc une
appropriation plus directe des mots d’une langue étrangère par l’expérience physique qui
53
enrichit le processus d’apprentissage. Or, le théâtre permet aussi à des apprenant de langues et
cultures étrangères d’exprimer par le mouvement ce qu’ils ressentent en eux, étant donné
qu’une langue et ses sons ne résonnent pas de la même manière en chacun, que les mots ne
supposent pas toujours une même expérience corporelle en fonction des langues (Oida, 1998,
Lecoq, 1997, cités par Mallet, 2013).
Dans le cadre d’un travail de recherche sur l’apprentissage de l’anglais dans une classe
de primaire, Marie Potapushkina Delfosse (2014) explique que l’association du geste à la parole
facilite la mémorisation en langue cible par le principe d’intussusception emprunté à Marcel
Jousse (1978). L’intussusception consiste à « saisir une action perçue en la recevant et en la
rejouant de manière à ce qu’elle devienne un geste », transformant ainsi le geste un en
déclencheur mnésique, c’est-à-dire, en un mouvement qui ramène à la mémoire un mot ou une
phrase qui lui a été associé. Au fur et à mesure de ses travaux, Potapushkina Delfosse s’est
rendue compte qu’en choisissant des gestes qui accompagnent les sons des mots, les apprenants
ne faisaient pas seulement preuve de mémoire en langue cible, mais aussi d’une mémoire
phonologique impulsée par le geste et d’une mémoire de l’environnement dans lequel le geste
a été effectué et associé à un mot ou une expression, développant ainsi les compétences
mnésiques des enfants et facilitant leurs apprentissages en langue étrangère. Des recherches
similaires sur les apports du cinéma en classe de langue à l’université ont proposé la conclusion
suivante : « toute connaissance énactée émerge et se manifeste dans et par l’action » (Dubrac,
2014), rappelant l’indissociabilité du corps, de la cognition et de l’émotion.
Dans ses nombreux travaux sur le théâtre et la didactique des langues, Joëlle Aden
précise que les comédiens « s’appuient sur le langage non verbal, l’imitation, les gestes et les
mouvements pour construire le cadre sémantique de l’action. […] il ne s’agit pas de faire des
jeux dramatiques qui permettraient d’entraîner des structures linguistiques dans une autre
langue. Tout jeu dramatique est d’abord esthétique et sert un besoin de « se » dire, de « se »
raconter, de « se » comprendre, de relier les savoirs entre eux et il est donc nécessaire que les
activités de théâtre soient des briques dans la construction de projets qui font sens pour les
élèves » (citée par Puozzo Capron & Perrin, 2014). Ainsi, le théâtre en situation d’EA des
langues et des cultures est un medium d’expression et de compréhension de soi et des autres
qui unit corps, parole et connaissances tout en proposant la découverte et l’expérimentation. Il
invite à l’appropriation physique des connaissances développées en langue cible. Nous verrons
plus loin en quoi ces pratiques sont également pertinentes pour le rapport à l’Autre qu’elles
suscitent en donnant alors toute sa place à la compétence émotionnelle d’empathie en EA des
langues et des cultures.
54
III.4. Arts et focalisation de l’attention
Il nous semble important de mentionner ici un paradoxe que j’ai eu l’occasion
d’observer personnellement et dont l’expérience a également été relatée par des chercheurs,
sans pour autant pouvoir l’expliquer sur le plan scientifique. Il s’agit de ce que nous appellerons
le paradoxe de l’attention dans l’apprentissage, et dans notre cas, dans l’EA des langues et des
cultures. Ce paradoxe consiste à observer que les productions des apprenants en langue cible
sont souvent d’une plus grande qualité lorsque leur attention n’est pas focalisée sur la langue
elle-même au moment de leur production, mais sur un objet ou une activité transitionnelle
comme une œuvre d’art ou la réalisation d’une performance artistique.
Dans le cadre de mon assistanat de français au Royaume-Uni, j’ai eu l’occasion de
remarquer ce paradoxe en proposant, entre autres choses, des activités de lecture théâtrale en
langue cible aux apprenants. En leur demandant de se concentrer sur la manière de lire un texte
(par exemple, comme un politicien, comme un enfant en bas âge, comme une personne très
triste ou au contraire très joyeuse) plus que sur la compréhension de son contenu, les apprenants
ont proposé des lectures dont la prononciation était de bien plus grande qualité que lorsque leur
attention était focalisée sur la compréhension du texte (Bécavin, 2014). Suivant la même
logique, Anne-Laure Dubrac (2014) explique que ses apprenants en études de droit rejouant des
scènes de films en anglais montraient une parole plus fluide et une meilleure syntaxe lorsqu’ils
se concentraient sur la mobilisation du regard, le contrôle de leurs mimiques, de leurs attitudes
et de leur position dans l’espace. Enfin, un phénomène similaire est relaté dans les travaux de
Nathalie Borgé (2014) qui, cherchant à améliorer les compétences d’expression écrite en
français d’étudiants allophones à partir d’analyse de clichés photographiques, note le
développement d‘une aisance dans la maîtrise de la langue écrite des apprenants alors que leur
concentration semble moins porter sur les formes écrites comme outils d’expression que sur la
photographie comme œuvre esthétique. Les arts, en détournant l’attention du linguistique vers
l’esthétique, offriraient donc de nouvelles perspectives dans les situations d’EA des langues et
des cultures en mettant en valeur la spontanéité de l’expression des émotions des apprenants en
langue cible. Il se dégagerait de ces activités un certain lâcher-prise quant à la peur de se
tromper, l’attention étant portée sur l’intention du message plus que sur la forme. La conscience
de l’emploi d’une langue étrangère semblerait presque s’effacer au profit de la réalisation de
l’activité en tant que telle. Cela n’est pas sans nous rappeler, dans le domaine de la
pratique musicale et du jazz, le concept d’effortless mastery mis à l’honneur par Kenny Werner
en 1996. Ce concept correspond à un espace « beneath the activity of the conscious mind »,
55
auquel nous avons tous déjà eu accès : « We’ve all fallen into that space, usually by accident.
Maybe when a breeze comes. Or watching the leaves turn. Or reading a paper! Or playing, and
for a moment you fall into that space and you’re playing great. And then the mind says: “Wow,
really playing great!” and you’re out of the space » (Werner, 2011). Le corps et l’esprit seraient
donc véritablement en mesure de s’affranchir de la dimension consciente des pratiques
humaines pour atteindre une capacité d’expression libre qui, défaite de la peur de se tromper,
présente une véritable appropriation des connaissances grâce aux pratiques artistiques.
III.5. Le dessin à la découverte des représentations
Christiane Perregaux (2009) propose d’utiliser l’art en situation d’EA des langues et des
cultures pour faire émerger les représentations que les apprenants peuvent avoir d’une langue
et/ou d’une culture donnée. Dans son dispositif mis en place auprès d’enfants de maternelle et
primaire, elle demande aux apprenants de « dessiner une langue ». Cette activité se découpe en
plusieurs étapes, la première étant de dessiner des langues données, à savoir le chinois, l’arabe,
le français et l’allemand ; puis l’objectif pour l’apprenant est de dessiner une langue qu’il
connaît et enfin une langue qu’il voudrait apprendre. Chacun de ces dessins s’accompagne de
commentaires des enfants qui expliquent comment ils ont voulu représenter ces langues. Les
résultats de ce dispositif et de ces recherches montrent qu’avant un certain âge, les enfants ne
font pas de différences entre plusieurs personnages dessinés parlant des langues différentes : ce
qui est affirmé, c’est l’association de l’homme et de langage. Ensuite, les représentations
tournent autour des stéréotypes de la population parlant la langue cible et s’accompagnent
généralement de jugements de type esthétique sur les langues. A ces stéréotypes s’ajoutent des
symboles plus généraux comme les drapeaux ou les monuments célèbres des pays associés aux
langues. Ce n’est qu’avec les plus grands que les langues ont été représentées par des signes
graphiques, notamment pour le chinois et l’arabe où des traits se rapprochant d’idéogrammes
ou de l’alphabet arabe ont pu être remarqués. Dans tous les cas, les enfants ont manifesté
l’impossibilité de dessiner une langue sans connaître au préalable quelqu’un ou quelque chose
de lié à cette langue dans leur environnement proche : les représentations que l’on se fait des
langues ne peuvent donc exister sans cette dimension affective d’attachement à une personne
ou un objet familier, ce que le dessin a permis de mettre en valeur.
56
III.6. Neurones miroirs et empathie
En 1996, le neurophysiologiste Giacomo Rizzolati révèle la découverte de « neurones
qui s’activent non seulement quand nous accomplissons une action, mais aussi quand nous
observons un autre individu accomplir la même action, ou même lorsque nous imaginons une
telle action » (Piccardo, 2013). Ces neurones sont désormais connus sous le nom de neurones
miroirs et semblent être le fondement possible d’une explication neurophysiologique de
l’empathie. Cette découverte est tout d’abord importante par ce qu’elle explique nos émotions
lorsque nous sommes face à une performance artistique : l’émotion transmise par un danseur
ou un comédien à un spectateur se réaliserait donc par empathie (Aden, 2014), car la perception
du mouvement de l’artiste activerait les mêmes aires du cerveau chez le spectateur que s’il
effectuait lui-même ce mouvement, créant ainsi une connexion émotionnelle directe entre les
deux individus. Ainsi, « le corps sait des choses que la pensée ne sait pas encore » (Lecoq, 1997,
cité par Aden, 2014) car les neurones miroirs permettent une compréhension en amont de la
parole, ce qui n’est pas sans implication dans le développement de l’intégration des pratiques
artistiques dans les situations d’apprentissage, et plus particulièrement dans l’EA des langues
et des cultures.
C’est ainsi que Nathalie Borgé (2014) explique notamment pourquoi l’expression des
émotions est facilitée par un phénomène d’identification de l’apprenant aux sujets présents sur
les photos qui lui servent de support pour réaliser une activité d’expression écrite. Cette
identification au sujet d’une photo ou d’une toile, ou au comédien ou danseur sur une scène, où
à un acteur dans une œuvre cinématographique, s’explique par le principe de fonctionnement
des neurones miroirs qui implique alors de l’empathie entre l’apprenant et le sujet auquel il
s’identifie. Cette empathie engage émotionnellement l’apprenant qui, alors qu’il ressent avec le
sujet de l’œuvre, prend aussi conscience de sa propre perception du monde. La phase
d’expression écrite répond alors de l’énaction, c’est-à-dire de l’émergence à partir du support
artistique de la propre conscience de l’univers que l’apprenant perçoit (Varela, 1993 cité par
Borgé, 2014). Or, cette définition de l’énaction ne peut qu’entrer en résonnance avec les
phénomènes impliqués par l’expérience d’apprentissage d’une langue et d’une culture
étrangère. Comme l’explique Joëlle Aden (2010) en parlant des apports des pratiques théâtrales
aux situations d’EA des langues et des cultures, « deux processus fondamentaux sont
constamment à l’œuvre dans le cerveau : l’un de résonance avec autrui par imitation,
simulation, empathie et l’autre de prise de distance par rapport à autrui et à soi-même au moyen
de phénomènes d’inhibition et du langage verbal ».
57
Cet aller-retour constant que proposent les pratiques artistiques pour enrichir les
processus d’apprentissage des langues par l’expérience physique, cognitive et émotionnelle
définit alors le translangager, cet « acte dynamique de reliance à soi, aux autres et à
l’environnement par lequel émerge en permanence des sens partagés entre les humains » (Aden,
2014). Les pratiques artistiques invitent les apprenants à développer la capacité de changer de
référent corporel, émotionnel, linguistique et culturel en développant des compétences
d’empathie nécessaires à un apprentissage des langues et des cultures cohérent avec ce qu’il
suppose d’impacts émotionnels pour l’apprenant. Or, cette empathie venant de l’action des
neurones miroirs, elle ne peut se développer que par l’expérience sensorimotrice et la prise de
conscience de la place du corps de l’individu dans l’espace et des dimensions cognitives de
l’affect (Aden, 2010), expériences que les pratiques artistiques sont le plus à même de fournir
aux apprenants de langues et cultures étrangères.
III.7. Emotions, didactique des langues et des cultures et pratiques
artistiques vers une pédagogie de la créativité
Si l’empathie offre aux apprenants de langues et cultures étrangères la capacité de
changer de référentiel, la créativité valorise cette démarche comme « capacité à changer de
perspective, à envisager tous les possibles d’une situation, physiquement et mentalement, à
résister à la peur de l’inconnu » (Aden citée par Puozzo Capron & Perrin, 2014). Pratiques
artistiques et EA des langues et des cultures pourraient donc se rejoindre dans ce qu’Isabelle
Puozzo Capron (2013) définit comme la « pédagogie de la créativité » que nous allons chercher
à définir et comprendre comme synthèse de ce chapitre.
Pour Francisco Varela, le monde nous façonne comme nous le façonnons à notre tour,
ce qui définit les connaissances qu’on en a comme créatives, car la création répond de
l’énaction, de la construction des connaissances par l’expérience physique, sensorimotrice.
« Ainsi pour apprendre on ne peut pas déconnecter le corps, les émotions, l’expérience et
l’intellect » résume Joëlle Aden en précisant la place des langues et de la communication dans
ce paradigme : « langager est en soi un acte créatif, c’est le moyen que notre espèce a élaboré
pour nous relier les uns aux autres, au-delà du temps et au-delà de l’espace » (citée par Puozzo
Capron & Perrin, 2014). S’attachant alors à l’explication de la créativité comme processus
cérébral, elle synthétise les recherches réalisées dans ce domaine à trois réseaux de neurones
qui interviennent dans l’acte de création :
- le réseau de contrôle de l’attention,
58
- le réseau de l’imagination qui implique dans le processus la mémoire procédurale, « les
expériences personnelles passées, utilisées pour créer des lieux ou des évènements
futurs ou fictifs » et l’empathie pour se mettre à la place de personnages inventés,
- le réseau de saillance ou de « flexibilité attentionnelle » qui « contrôle en permanence
la perception des évènements extérieurs (extéroception), des évènements intérieurs
(introception) ainsi que le flot interne de la conscience » et qui permet à l’individu de
naviguer d’un type de perception à un autre en fonction de l’objet à créer.
Développer la créativité présente donc l’avantage de mobiliser plusieurs réseaux neuronaux et
aires cérébrales qui sont nécessaires à toute activité d’apprentissage sur le plan cognitif mais
aussi sur le plan émotif puisque la création est souvent un medium d’expression des émotions.
En établissant sa pédagogie de la créativité, Isabelle Puozzo Capron (2014) associe dans
une triade la créativité, l’émotion et la cognition dans le but premier de favoriser l’adaptation
des apprenants aux situations dans lesquelles ils peuvent être amenés à se trouver. De fait, il
n’est pas difficile d’imaginer certains contextes dans lesquels des apprenants d’une langue-
culture étrangère pourraient se retrouver et où la créativité se révèlerait être une compétence
avérée. Nous pouvons penser, par exemple, au besoin de présenter un projet de développement
d’entreprise dans le cadre professionnel, ou encore de préparer un voyage à l’étranger pour
découvrir un pays où la langue cible est parlée dans un cadre plus scolaire. Mettre en place des
projets de création en classe de langue convient parfaitement à l’approche par les tâches où ce
qui est créé suscite un plaisir esthétique avec une implication émotionnelle forte de la part de
l’apprenant qui se retrouve acteur de son apprentissage, et où l’objectif cognitif est « d’identifier
le contenu disciplinaire dans l’œuvre créative » (Puozzo Capron, 2014). La création devient
alors une véritable traduction concrète des apprentissages des apprenants de langues et de
cultures étrangères. Ils se sont approprié les connaissances par l’action, par intériorisation dans
la mémoire procédurale, ce qui assure une acquisition qui perdure dans le temps. Les conditions
de mise en place d’un dispositif d’EA des langues et des cultures dit créatif sont nombreuses
mais importantes pour que celui-ci fonctionne. Il doit apporter une dimension nouvelle tout en
ayant un rapport avec ce qui est au programme des apprentissages, doit comporter plusieurs
tâches menant à un tout final, chaque tâche cherchant à développer des savoirs et des savoir-
faire précis et il doit chercher à augmenter le SEP des apprenants par un départ défini en
fonction de leurs compétences seuil et qui les amènera ensuite à se dépasser. Le dispositif doit
également se caractériser par une « émotion d’arrière-plan » renvoyant au calme. Il se doit
également de valoriser toutes les tâches favorisant la construction d’endocepts chez l’apprenant
59
et de laisser un degré d’autonomie suffisant à celui-ci pour qu’il puisse prendre conscience de
ce qui se joue sur le plan cognitif et émotionnel en menant ce projet (Puozzo Capron, 2013).
Enfin, il nous paraît important de souligner ici qu’un tel dispositif ne peut exister sans
transdisciplinarité que son auteure qualifie d’étayage (Puozzo Capron, 2013), ce qui est un
cadre propice à l’intégration de pratiques artistiques qui ont toute leur place dans les dispositifs
didactiques d’EA des langues et des cultures tant elles représentent des media créatifs et
d’expression de la créativité qui peuvent engager les apprenants sur le plan physique, cognitif
et émotionnel. Dans tous les cas, ce type de démarche aboutit le plus généralement sur une
situation similaire à celle d’artiste et spectateur au moment de présenter les créations des
apprenants. Puozzo Capron (2014) explique que les apprenants ayant bénéficié de ce type de
dispositif ont manifesté beaucoup d’engouement pour la présentation orale de leur travail
devant la classe, car cela mettait en valeur leurs compétences de manière concrète, développant
alors leur SEP. Cela a généré des émotions positives intenses pour l’apprenant amplifiées par
la réaction des observateurs de la présentation qui s’exclamaient du travail réalisé, tout comme
un public le ferait devant une performance artistique réussie.
La créativité faite pédagogie apporte donc la démarche artistique comme chemin
d’autonomisation, d’appropriation et de valorisation de l’apprenant et de ses apprentissages,
que cela soit dans le domaine de l’EA des langues et des cultures ou dans tout autre discipline.
La conclusion du cadre théorique va nous permettre de faire le point, dès la page suivante, sur
la manière dont le cycle émotions-pratiques artistiques-EA des langues et des cultures se ferme
au regard notre projet de recherche.
60
CONCLUSION DU CADRE THEORIQUE
Les enjeux émotionnels de tout apprentissage, et plus particulièrement de
l’apprentissage d’une langue et d’une culture étrangère en tant qu’expérience déstabilisante de
la perception de soi, de l’Autre et du monde d’un individu, peuvent être mis à profit très tôt.
Les dispositifs d’Eveil aux Langues, dans leur optique d’ouverture sans exigence
d’apprentissages actés, permettent de valoriser chez les apprenants les plus jeunes l’importance
de l’expérience, du chemin qui mène à l’Autre en agissant comme médiateur de la dimension
affective et personnelle de la rencontre avec une langue et une culture étrangère (Aden &
Leclaire, 2014 ; Bourdet, 2014). En amont des apprentissages, la dimension émotionnelle des
situations d’EA des langues et des cultures est déjà inclue dans l’Eveil aux Langues et apporte
aux enfants les fondements d’un rapport positif à ces langues et ces cultures en valorisant les
bagages langagiers de chacun et en érigeant le plurilinguisme comme une richesse individuelle
tout autant qu’un bien commun (Lörincz, 2014 ; Billiez, 2002). L’Eveil aux Langues se présente
donc comme une préparation ludique à l’expérience que supposera plus tard l’apprentissage
d’une langue et d’une culture étrangère. Dans cette approche ludique, les pratiques artistiques
semblent pouvoir trouver leur place, mais comment peuvent-elles mettre à profit l’action des
émotions dans des situations d’éveil aux langues et aux cultures ?
L’input en langues et cultures étrangères en situation d’EA, lorsqu’il est apporté par des
media artistiques, créé une réponse émotionnelle individuelle mais aussi collective par
phénomène d’accordage intra et interpersonnel (Leroy, 2008 ; Zask, 2008), ce qui lie les
apprenants sur leur chemin à la découverte de l’Autre. Les arts et les pratiques artistiques
peuvent alors agir comme supports émotionnels et affectifs afin d’accompagner l’apprenant
enfant dans l’ouverture de son monde à des langues et des cultures nouvelles pour lui ; sans
cette dimension émotionnelle et affective, il pourrait exprimer des difficultés à reconnaître ces
éléments qui pourraient alors rester non-familiers pour lui (Perregaux, 2009). De fait, les arts,
par leur pouvoir évocateur, sont à même de développer la réception sensorimotrice, la réception
émotionnelle et l’imagination des individus (Arleo, 2000), capacités transversales et nécessaires
à tout apprentissage, à l’instar de chacune des compétences comprises comme participant de
l’intelligence émotionnelle (Masmoudi et al., 2010 ; Lafortune, 2005).
Le pouvoir évocateur des arts et l’expérience artistique en tant que telle permettent
d’aborder les apprentissages par la perspective esthétique qui offre l’avantage de convoquer
l’émotion avant la cognition (Puozzo Capron, 2014). La réponse émotionnelle première permet
61
alors, dans certain cas, d’accéder à des capacités d’expression en langue étrangère d’excellente
qualité car défaites du contrôle conscient des processus cognitifs, laissant alors place à la
spontanéité et à l’intention du discours, redonnant sa dimension émotionnelle à l’expression
humaine (Bécavin, 2014 ; Borgé, 2014 ; Dubrac, 2014 ; Werner, 2011). La réception
émotionnelle peut aussi devenir un véritable levier de parole (Borgé, 2014, Witzigmann, 2014)
qui va motiver l’expression et l’extériorisation des émotions, ce qui peut d’ailleurs se réaliser à
nouveau par les pratiques artistiques : l’œuvre se fait alors traduction concrète des émotions et
des représentations de l’apprenant (Perregaux, 2009). Passée cette phase, l’émotion esthétique
finit par solliciter enfin le fonctionnement cognitif du cerveau en permettant à l’apprenant de
s’approprier les items abordés par des mécanismes de comparaison, d’association ou plus
généralement de référence avec des éléments déjà acquis et présents en mémoire (Puozzo
Capron, 2014). Ainsi, l’entrée esthétique permet de mettre à profit la dimension émotionnelle
des apprentissages tout en optimisant ensuite les processus cognitifs impliqués dans l’acte
d’apprendre.
En sollicitant la réception émotionnelle des individus, les arts et pratiques artistiques
impliquent personnellement l’apprenant dans son parcours d’apprentissage (Aden, 2010 ;
Arleo, 2000) : celui-ci prend la place d’acteur central qui lui revient selon la perspective
actionnelle car la stimulation émotionnelle, lorsqu’elle est assurément positive, le rend plus
motivé, ce qui se corrobore sur le plan cérébral d’après le triangle vertueux émotion-cognition-
motivation présenté en première partie de ce chapitre (Boddie, 2014 ; Masmoudi et al., 2010).
La motivation, selon son étymologie latine, suppose que l’apprenant se mette alors en
mouvement, ce qui peut être accompagné par des pratiques artistiques comme la danse ou
encore le théâtre qui vont lui permettre d’enrichir et de renforcer ses apprentissages par
l’expérience physique. Le geste, l’expression corporelle vont lui permettre de donner du sens à
ce qu’il découvre et de le mémoriser plus facilement en lui offrant des supports mnésiques
concrets qu’il pourra convoquer à nouveau (Dubrac, 2014 ; Potapushkina Delfosse, 2014 ;
Puozzo Capron & Perrin, 2014 ; Mallet, 2013). L’ensemble de ces éléments soulignent l’apport
des pratiques artistiques aux apprentissages en les replaçant dans le domaine de l’expérience
qui permet à l’apprenant de se les approprier par subjectivation : c’est lui qui fait l’expérience
de ces apprentissages.
La notion de faire sien est aussi importante dans l’expérience de l’apprentissage d’une
langue et d’une culture étrangères où viennent à se côtoyer soi et l’Autre. Cette rencontre, pour
être positive, suppose d’atteindre un certain degré d’empathie afin de s’ouvrir à ce qui nous est
alors inconnu pour l’accueillir dans notre monde où nous sommes avec l’Autre tout en restant
62
conscient de qui nous sommes. Ici les arts et les pratiques artistiques se révèlent à nouveau
comme des media de développement de cette compétence émotionnelle grâce à la sollicitation
des neurones miroirs qui vont permettre d’accéder à une compréhension précédant l’acte de
parole (Aden, 2014, 2010 ; Borgé, 2014). Tout comme nous le définissions plus haut, le rapport
à l’Autre et au monde se crée par la réception et l’expression émotionnelle qui devance le
contrôle cognitif. L’empathie est une clé d’accès au « translangager » (Aden, 2014) comme
partage de sens entre soi, l’Autre et le monde, offrant ainsi à l’apprenant le développement de
ses capacités à changer de référent corporel, spatial, langagier, culturel, … Les arts et les
pratiques artistiques peuvent ainsi développer les capacités d’adaptation des apprenants de
langues et cultures étrangères.
Or, cette capacité d’adaptation suppose également une opportunité de faire preuve de
créativité. La créativité se retrouve ainsi au centre de tous les éléments jusqu’alors abordés : les
émotions suscitées par les arts peuvent être extériorisées par des actes de création dans la
pratique de ces disciplines, ces émotions pouvant également donner de la matière à
l’imagination qui, à son tour, peut également donner lieu à une création concrète. Les émotions,
l’imagination mais aussi l’implication personnelle et la motivation suscitent des actes de
création qui naissent de l’expression d’une créativité de l’apprenant qui, dans sa rencontre avec
une langue et une culture étrangères, s’ouvre au non-familier, l’invitant à s’adapter. Toutes ces
invitations à la créativité font intervenir le domaine de l’expérience physique, où c’est
l’apprenant, corps et esprit, qui fait sien les objets d’apprentissage et les traduit en création. De
surcroît, la créativité s’autoalimente en stimulant les réseaux cérébraux du contrôle de
l’attention, de l’imagination, de l’empathie et de la saillance qui donne accès à tous les canaux
de perception de l’apprenant, internes et externes. Une véritable « pédagogie de la créativité »
est ainsi formulée (Puozzo Capron, 2014, 2013) qui, finalement, offre à l’apprenant
l’expérience même de l’artiste qui crée à partir de ce qu’il ressent dans un besoin de s’exprimer,
mais aussi dans un besoin de s’approprier les éléments et de le prouver par une création qui
pourra alors être valorisée devant un public, qu’il soit de spectateurs ou d’enseignants et
d’apprenants, augmentant ainsi son SEP d’un apprentissage dont il aura été pleinement acteur.
IMPLICATIONS POUR LE PROJET DE RECHERCHE
Toutes ces considérations théoriques m’amènent à reconsidérer mon projet de recherche
au sein de l’Atelier du Coteau à la lumière de la question suivante : la recherche de la
valorisation des émotions des acteurs des ateliers artistiques plurilingues de Mehregan peut-elle
63
apporter à l’Atelier du Coteau une amorce de démarche didactique lui permettant d’associer
pleinement éveil artistique et éveil aux langues et aux cultures dans ses AMP ?
Au regard des problèmes de terrain soulevés en conclusion du chapitre précédent et de
la littérature scientifique que nous venons d’exposer, nous émettons l’hypothèse que le CARAP,
en tant que cadre de référence de l’Eveil aux Langues, pourrait être un outil adapté aux valeurs
artistiques de l’association. Il favoriserait la définition d’objectifs d’apprentissage qui
faciliteraient à leur tour la préparation des AMP selon des principes didactiques explicitement
définis prenant en compte la dimension émotionnelle des activités d’éveil aux langues et aux
cultures. Cette hypothèse pourrait se vérifier si nous arrivons à identifier des compétences
définies dans les tableaux du CARAP et déjà implicitement développées dans les AMP, et si
nous arrivons à concevoir et mettre en place un dispositif didactique associant arts, pratiques
artistiques et éveil aux langues et aux cultures s’appuyant sur ce cadre. La validation de cette
hypothèse risque cependant de n’être que partielle car seule une étude sur le long-terme pourrait
confirmer ou non l’adéquation du CARAP aux ateliers artistiques plurilingues de l’Atelier du
Coteau, si tant est que ses dirigeants et animateurs se l’approprient comme outil de travail.
Un système d’évaluation des apprentissages en langues et cultures étrangères des
apprenants n’est pas envisageable dans le cadre d’ateliers qui sont avant tout de loisirs et dont
la démarche d’éveil suppose le développement de compétences difficilement évaluables en
termes de savoir-être sur si court-terme et dans un contexte si restreint. Néanmoins, nous
supposons qu’une connaissance plus approfondie des enfants et de leur environnement
langagier et culturel, ainsi que des attentes et suggestions de leurs parents, pourrait être une
base de réflexion pour la création d’activités qui valoriseraient le bagage initial des enfants et
leur évolution dans les AMP à leurs yeux et aux yeux de leurs parents, générant ainsi une
atmosphère et des émotions positives propices à l’épanouissement des ateliers et de leurs
acteurs. Cela pourra se vérifier si l’établissement d’un portrait des enfants comme apprenants
et la réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des parents apportent des éléments
jusqu’alors non pris en compte dans les AMP et si la conception et la mise en place d’un
dispositif les prenant en compte génère des réactions positives de la part des enfants et de leurs
parents. La validation de cette hypothèse nécessitera notamment de réaliser un travail de recueil
de données par questionnaire, entretiens et observations qui, dans un contexte si peu
institutionnalisé, demandera beaucoup d’adaptation et de flexibilité pour obtenir une analyse
compréhensive des données. Il faudra alors tenir compte de la subjectivité des observations et
de leurs analyses, mais aussi de la possible relativité des discours recueillis, ceux-ci pouvant
dénoter d’une réalité que les personnes interrogées ne souhaiteraient pas aborder ou présenter
64
telle qu’elle existe vraiment. Enfin, à l’instar de l’hypothèse précédente, notre sujet de recherche
ne nous permettra d’affirmer ou d’infirmer la validation de cette hypothèse-ci que de manière
limitée à des résultats sur court-terme.
Pour finir, nous formulons l’hypothèse que le développement de l’imagination impulsé
par les arts en amont et traduit par un acte créatif en aval jusqu’alors uniquement valorisé lors
d’activités purement artistiques dans les AMP pourrait s’appliquer à des activités d’éveil aux
langues et aux cultures : le pouvoir évocateur des arts serait alors un point de rencontre
émotionnel de l’apprenant avec une langue et une culture étrangères. Cette hypothèse pourra se
voir validée si, lors de la mise en œuvre du dispositif didactique, les apprenants sont capables
de se figurer un pays à partir d’un support artistique et s’ils sont à même d’exprimer ce qu’ils
s’imaginent de ce pays. Les contraintes pouvant se présenter alors seraient principalement
d’ordre individuel, les capacités d’imagination des apprenants pouvant se trouver difficiles à
convoquer lorsque ceux-ci sont fatigués de leur journée d’école ou bien lorsqu’ils sont agités et
cherchent à se défouler alors qu’une activité stimulant l’imagination requiert un certain degré
de concentration.
Bien que les possibilités de validation de ces hypothèses soient en partie conditionnées
par des contraintes liées au contexte et à ses acteurs, il est de ma responsabilité de pouvoir les
anticiper pour limiter leur impact sur le dispositif didactique conçu et mis en œuvre pour
valoriser les émotions des apprenants dans une tentative d’association complémentaires des
arts, des pratiques artistiques et d’activités d’éveil aux langues et aux cultures. Le prochain
chapitre s’attache à l’exposition de la méthodologie employée sur mon lieu de stage pour mener
à bien mon projet de recherche et réaliser un dispositif adapté au contexte et à ses acteurs selon
une démarche didactique.
66
INTRODUCTION AU RECUEIL ET A L’ANALYSE DES DONNEES
Si une partie de mon travail méthodologique est orienté vers l’objectif de validation ou
d’invalidation de mes hypothèses de recherche, il m’a surtout permis d’adopter une démarche
compréhensive envers le fonctionnement de l’Atelier du Coteau, des AMP et de ses acteurs.
Cela me semblait indispensable car cette démarche me permettait de réaliser un travail qualitatif
adapté à mon sujet de recherche, le domaine des émotions pouvant difficilement donner lieu à
une étude de type quantitatif. Au-delà de cela, mon terrain de recherche ne pouvait se prêter à
une autre démarche étant donnée la variabilité du contexte, la diversité des acteurs et l’absence
d’un cadre didactique ou institutionnel établissant des lignes de travail explicites et suivies par
tous. De plus, le faible effectif d’apprenants et la taille de la structure m’oblige à prendre en
compte les données recueillies comme intimement subjectives car propres au contexte auquel
elles renvoient.
Cette approche, aussi connue sous le terme de méthode empirico-inductive, me
demandait alors de m’intéresser dans un premier temps au contexte global de mon terrain de
recherche afin de pouvoir analyser toutes les données individuelles au regard de ce contexte
particulier. En effet, quelles qu’elles soient, les méthodes empirico-inductives consistent « […]
à rechercher des réponses dans les données, celles-ci incluant les interactions mutuelles entre
les diverses variables observables dans le contexte global d’apparition du phénomène, dans son
environnement, ainsi que les représentations que les sujets s’en font […]. II s’agit de
comprendre (c’est-à-dire de ‘‘donner du sens à des évènements spécifiques’’) et non
d’expliquer (c’est-à-dire d’établir des lois universelles de causalité) » (Blanchet, 2000).
C’est pourquoi la validation ou l’invalidation des hypothèses précédemment définies ne
peut se réaliser sans auparavant chercher à comprendre le fonctionnement de l’Atelier du
Coteau, des AMP et de leurs acteurs. De plus, dans un souci de rigueur professionnelle, la
compréhension de mon terrain de recherche dans son ensemble m’apparaissait comme
primordiale afin de pouvoir proposer en fin de stage la mise en place d’un dispositif didactique
respectant les valeurs et la manière de fonctionner de l’association et de ma tutrice dans les
AMP, cherchant notamment dans ma propre démarche la prise en compte des émotions
individuelles et collectives des acteurs de ce contexte. Ainsi, ce chapitre abordera dans un
premier temps les données recueillies en interne à l’échelle de la direction de l’association, puis
à l’échelle de Mehregan dans le cadre des AMP avant de terminer par les données recueillies
auprès des enfants et de leurs parents, ce qui nous permettra enfin de répondre aux questions
posées par une partie de nos hypothèses de travail et d’entamer la conception de notre dispositif.
67
Partie I. Une association à la recherche d’elle-même
Afin de comprendre au mieux le fonctionnement de l’Atelier du Coteau et ses lignes de
travail, j’ai réalisé un entretien avec Elisa Commeyne, directrice de l’association, et Xavier
Fauvelle, secrétaire et trésorier. Ce sont eux qui sont à l’origine de la naissance de cette structure
en 2010. Ma motivation première pour cet entretien était de comprendre ce qui les avait poussés
à créer les ateliers artistiques plurilingues. En effet, ils insistent souvent sur la nature artistique
de leurs activités comme l’essence de leur travail, les arts restant, même dans le cas des ateliers
plurilingues, le cœur de leurs préoccupations. Pourquoi donc proposer une ouverture
linguistique et culturelle ?
L’entretien s’est déroulé sur presque deux heures un vendredi après-midi, dans le petit
vestiaire mitoyen à la salle d’atelier. Il s’agissait d’un entretien semi-directif me permettant
ainsi de chercher des réponses précises à mes questions tout en donnant la liberté à Elisa et
Xavier de digresser ou plus exactement de se laisser porter par le flot de leur propre expression
sur ce qui représente un véritable projet de vie pour eux : le développement de l’Atelier du
Coteau. Nous avons donc abordé leurs parcours respectifs, la naissance et la vie de l’association
jusqu’à aujourd’hui, les ateliers artistiques plurilingues et leurs animateurs et enfin les
perspectives d’avenir de la structure et de ses activités. Toutes les informations détaillées dans
cette partie sont tirées de la transcription de l’entretien que le lecteur pourra trouver en annexe
8.1.
De cet entretien sont ressortis plusieurs éléments qui nous paraissent important pour
comprendre ce qui sous-tend le fonctionnement global et particulier de l’association et des
activités qu’elle propose avec ses intervenants. Nous verrons alors que ce projet encore en
construction repose avant tout sur la démarche à la fois professionnelle et personnelle d’Elisa
et Xavier, ceux-ci cherchant à adopter une démarche réflexive autour de l’évolution qu’ils
souhaitent générer pour leur association que ce soit en interne ou en externe avec les
opportunités d’intervention dans le contexte scolaire. Nous aborderons ensuite la question d’un
dialogue parfois difficile avec les parents avant d’exposer quelques observations sur le rapport
que les deux dirigeants entretiennent avec les langues et cultures étrangères ainsi qu’avec la
didactique de celles-ci pour chercher à comprendre comment cela définit une partie du
fonctionnement des AMP dont nous parlerons plus en détail dans la partie suivante.
68
I.1. Un engagement personnel
Comme nous avons déjà pu le préciser dans la présentation du contexte de la recherche
dans le premier chapitre de ce mémoire, la naissance de l’Atelier du Coteau est avant tout
l’histoire d’Elisa et Xavier qui en ont fait, en plus d’un projet professionnel qui les occupe à
plein temps, un projet de vie qui apporte une dimension émotionnelle forte à leur démarche et
qui impacte le fonctionnement actuel et les perspectives d’évolution futures de l’association.
I.1.a. A l’arrière-plan d’un projet de vie, les émotions
En relatant la naissance de l’Atelier du Coteau, Elisa et Xavier résument leur démarche
en affirmant tour à tour qu’il « fallait oser » : après la démolition de l’école de danse où Elisa
travaillait, il leur fallait trouver un autre lieu d’activité alors même que leurs statuts de
professionnelle libérale et d’étudiant représentaient un frein à la confiance des agents
immobiliers et des banques, car il s’agissait-là d’un projet financier non sans risques.
L’obtention de la propriété des lieux s’est donc révélée être un véritable combat personnel qui
est resté, bien que sous une forme différente, dans le fonctionnement actuel de l’association :
les travaux dans le bâtiment, la création administrative de l’association, la fédération d’un
réseau d’artistes et d’une clientèle pouvant faire vivre le lieu et ses intervenants n’a pas été
réalisée sans un investissement important de la part des dirigeants, et ce tant sur le plan
professionnel que financier. Rappelons-nous qu’Elisa et Xavier ne sont pas encore à même de
se dégager un salaire sur les revenus de l’association et qu’ils travaillent donc « bénévolement »
à son fonctionnement, se reconnaissant dans la dimension « bienveillante » de cette démarche.
La bienveillance du travail de bénévoles qu’ils exercent, ils l’illustrent dans leur
démarche d’accueil d’artistes en résidence et/ou ne pouvant gérer seuls leur activité, se
proposant alors de prendre en charge ce qui relève des tâches fastidieuses (administration,
communication, finances) pour leur permettre de se lancer et de s’épanouir dans leur profession
en minimisant la prise de risques qu’ils assument alors à leur place. Xavier met d’ailleurs un
point d’orgue à fédérer ces artistes sans enfreindre leur autonomie, voyant dans l’Atelier du
Coteau un cadre propice à une formation implicite par l’engagement individuel à tous les
niveaux : tant les artistes comme les participants aux ateliers finissent par s’engager dans une
démarche de création pour évoluer, se développer, se former en somme. Se considérant avec
Elisa comme des « citoyens actifs », il travaille d’ailleurs sur la rédaction d’un dossier dans le
69
cadre des interventions en milieu scolaire sur le thème de « l’engagement entre apprenti et
éducateur » comme miroir de leur méthode de fonctionnement3.
I.1.b. Une association comme « deuxième maison »
L’Atelier du Coteau est une association fortement inscrite dans son quartier : comme
détaillé dans le premier chapitre de ce mémoire, les inscrits aux ateliers résident en majorité
dans le quartier Canclaux-Procé ou les quartiers limitrophes, et les interventions extérieures
sont réalisées dans des écoles situées à moins de trois kilomètres de l’établissement. Cette
attachement au quartier semble trouver ses origines dans le parcours d’Elisa qui a appris à
danser et fait ses premiers pas en tant que professeure de danse à quelques rues de distance de
l’emplacement actuel de l’Atelier du Coteau : même si elle ne l’a pas affirmé lors de notre
entretien, il semble y avoir un attachement affectif à cet endroit qui, en plus d’être son lieu de
travail, est encore aujourd’hui son lieu de vie. De fait, Elisa et Xavier résident tous les deux au-
dessus des locaux de l’association, mêlant encore une fois vie privée et professionnelle.
Ces éléments corroborent le sentiment de « deuxième maison » que peut revêtir le lieu
notamment pour les enfants pour qui il s’agit d’une transition entre l’école et le domicile
familial le soir après l’école. C’est Elisa qui l’exprime elle-même dans sa réponse au sujet des
retours des enfants sur leurs activités dans l’association : « J’ai l’impression qu’ils se sentent,…
c’est un peu une deuxième maison, il y a quelque chose comme ça. ». Il s’agit alors d’un lieu
qui, outre le caractère indépendant de ses intervenants, pèse sur le fonctionnement des activités
qui se déroulent en son sein. Il y a une recherche pour créer des liens entre la structure globale
et chacun des ateliers, notamment par l’organisation de l’exposition des créations des enfants
des AMP et des ateliers arts plastiques dans la Galerie 18 ou encore par la création d’un
spectacle de danse s’inspirant du travail des artistes résidents de l’Atelier du Coteau et ayant
exposé leurs œuvres dans l’année.
I.2. Une démarche réflexive
Dans leur volonté de proposer quelque chose de novateur en termes d’offre de pratiques
artistiques et d’activités de bien-être au sein d’une même structure, Elisa et Xavier revendiquent
une démarche dynamique de réponse aux attentes des intervenants et participants aux ateliers
ainsi qu’une démarche de réflexion constante quant aux perspectives d’évolution de
l’association. Bien plus qu’un lieu de pratique, leur attention est aussi portée sur la manière
3 Nous précisons que la notion d’engagement revient à treize reprises dans l’entretien.
70
dont ils peuvent promouvoir les arts et les pratiques artistiques en interne et en externe en
valorisant l’apport des expériences créatives à l’épanouissement de chacun, et notamment des
plus petits. Cette réflexivité est aussi primordiale, d’après Elisa, quand on ne souhaite pas
recevoir de subventions et que l’équilibre financier de la structure ne peut se devoir qu’à son
bon fonctionnement, ce qui nécessite de se remettre en question fréquemment et d’être toujours
à la recherche de ce qui fera la bonne santé financière de celle-ci. Voyons alors sur quels thèmes
se concentrent les réflexions de la direction de l’Atelier du Coteau.
I.2.a. Les arts et les pratiques artistiques au cœur des réflexions
La focalisation sur les arts est sans nul doute ce qui fait la spécificité de l’Atelier du
Coteau lorsqu’il s’agit d’aborder la question des offres d’éveil aux langues et aux cultures dans
la région nantaise. Même s’il existe des artistes qui animent des ateliers d’éveil linguistique et
culturel comme Elena Galimberti avec une approche par la musique, ou encore Sabine Moore
avec une approche par les arts plastiques, aucune structure de ma connaissance ne propose un
éveil plurilingue pensé en association avec la pluridisciplinarité des arts et des pratiques
artistiques 4 . Lors du lancement des ateliers artistiques plurilingues, Elisa et Xavier ne
mentionnent que les P’tits Bilingues comme concurrent direct, même si finalement la
distinction s’est effectuée rapidement par la perspective artistique qu’offrait l’Atelier du
Coteau : « on n’était pas non plus dans la même démarche parce qu’on n’avait pas forcément
de méthode d’apprentissage et que justement la différence c’est que le point de vue, de notre
point de vue on partait vraiment du sens d’avoir des professionnels de l’art avant tout ». Associé
à une volonté de décloisonnement des disciplines artistiques au sein des ateliers née du travail
même d’Elisa avec ses élèves de l’école de danse, les ateliers artistiques plurilingues sont nés
dans l’optique de faire « appréhender l’apprentissage des langues de manière ludique », dans
l’action, et en ouvrant les perspectives d’éveil des enfants par un éventail large d’arts et de
pratiques artistiques au sein d’un même atelier. Les arts deviennent ainsi un moyen de
s’intéresser aux langues, et les langues deviennent un moyen de s’intéresser aux arts.
Ainsi, la perspective artistique pluridisciplinaire a été transférée aux ateliers artistiques
plurilingues sous la forme des AMP qui, malgré leur dominance arts plastiques, amènent les
enfants à naviguer d’un art à un autre. Mais cette volonté de décloisonnement est aussi source
4 Elena Gallimberti travaille selon la méthode Music Together au sein du projet La Joie de Grandir qu’elle a elle-
même initié avec Gergana Georgieva en 2013 (http://www.lajoiedegrandir.com/). Sabine Moore propose des
ateliers d’arts plastiques et de découverte de l’anglais (Art and English) dans le cadre de son association Au fil de
l’art avec laquelle elle intervient dans plusieurs structures nantaises comme la Maison des Arts ou Le Dix
(http://www.buttesainteanne.org/pages/Art_and_English-3650546.html et [email protected]).
71
de réflexion pour de futurs projets, notamment entre Mehregan et Alexis, deux membres de la
compagnie Krapo Roy qui souhaiteraient proposer des ateliers mélangeant arts plastiques et
théâtre sur le thème des contes perses sous forme de stage pendant les vacances scolaires. Les
arts et les pratiques artistiques sont donc des sujets de réflexion constants qui, bien qu’ils ne
soient pas associés à des réflexions autour d’une démarche didactique mêlant éveil artistique et
éveil aux langues et aux cultures, définissent l’offre de l’Atelier du Coteau comme singulière.
I.2.b. Vers d’autres formes d’apprentissage
Elisa a évoqué à plusieurs reprises sa démarche personnelle dans son travail de
professeure de danse et de directrice de l’Atelier, notamment dans leur envie avec Xavier de
permettre aux plus jeunes de développer d’autres formes d’apprentissage grâce à
l’enseignement artistique. Cette envie est née de prises de conscience dans la pratique même de
son métier, réalisant au contact des enfants qu’elle découvrait elle-même son propre rapport
aux apprentissages et ce que notamment la danse lui avait permis d’assimiler par l’expérience
ce qu’elle n’avait pas réussi à acquérir à l’école. Pour elle, les arts sont une porte d’entrée vers
les apprentissages, une porte que l’institution scolaire ne propose pas et qui pourtant pourrait
bénéficier à de nombreux enfants. Les pratiques artistiques offrent la possibilité d’intérioriser,
par l’expérience même, de nombreux concepts qui peuvent parfois rester obscurs lorsque leur
enseignement n’est basé que sur un enseignement en classe, ce qui n’est pas sans nous rappeler
les constats effectués à Bates Middle School (Nobori, 2012) abordés dans le chapitre précédent.
Ce qui change, c’est notamment la perte de la vision de l’apprentissage comme obligation ou
contrainte dans les pratiques artistiques où le savoir se révèle à l’individu. Elisa l’explique
ainsi : « Enfin, voilà, dans mon métier, enfin il y avait […] une révélation, une jouissance […]
de s’dire mais c’est extraordinaire en fait, je prends conscience que… là ça ne me parlait pas
dans ce cadre-là, mais quand en fait je suis en train de pratiquer et d’utiliser ce phénomène-là,
[…]… Mais parce que je suis dans un cadre aussi dans lequel je me plais, dans lequel je
décloisonne et j’ouvre, […] C’que je veux dire c’est que je ne me sens pas contrainte, je ne me
sens pas… et que, […] de trouver des moments de vie en reliant les choses beaucoup plus les
unes aux autres, on pourrait certainement en fait encore mieux accompagner les enfants selon
leur intelligence ». Elisa souhaite apporter aux enfants inscrits à l’Atelier d’autres perspectives
d’apprentissage. Selon elle, l’expérience artistique permet de faire des liens à une échelle plus
large que celle de la classe, et de découvrir ainsi qu’un élément incompris dans un domaine
peut parfois se révéler dans un autre, apportant ainsi des éléments de métacognition avec
lesquels les enfants, mais aussi les intervenants, peuvent accéder à une certaine connaissance
72
de leur propre fonctionnement dans des situations d’EA. Ainsi, les arts et les pratiques
artistiques sont des sources de diversification des méthodes d’apprentissage pouvant amener
l’apprenant à mieux comprendre son propre fonctionnement et à en tirer le meilleur pour ses
apprentissages, éléments corroborés par la littérature scientifique précédemment abordée
(Brewer, 2010 ; McNeil, 2009 ; Altet, 1997).
Toutes ces prises de conscience dans la pratique même de leur métier ont motivé Elisa
et Xavier à valoriser les approches artistiques au sein même des écoles en proposant
l’intervention de leur artistes animateurs sur les temps d’activités périscolaires dégagés sur
l’emploi du temps des enfants depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Ces
interventions ont été le point de départ d’une démarche réflexive sur l’apport des pratiques
artistiques au cadre scolaire afin de faire évoluer l’offre d’interventions de l’Atelier du Coteau
pour la rentrée prochaine mais surtout afin d’ouvrir la réflexion à l’échelle des écoles
concernées sur le bienfondé de ce type de démarche qui est le sujet de l’étude actuellement en
cours de rédaction par Xavier.
I.2.c. Tension entre autonomie des intervenants et projet d’association
La dynamique d’action et de réflexion impulsée par Elisa et Xavier donne un poids à
l’Atelier du Coteau comme association et structure globale des ateliers proposés. Or, la volonté
de préserver l’autonomie des intervenants dans leurs ateliers rend parfois le projet d’association
difficile à diffuser à toutes ses échelles, d’autant plus que celui-ci est encore en cours
d’élaboration. La principale difficulté selon Elisa est de réaliser un projet global qui n’enferme
pas le déroulement des ateliers et leurs acteurs dans une logique de planification qui ferait perdre
les apports du présent : il s’agirait de définir un « fil rouge » qui permettrait d’articuler les
activités de l’association et les activités réalisées dans les ateliers tout en laissant la flexibilité
nécessaire aux intervenants pour s’adapter aux propositions et aux évolutions des enfants au
cours de l’année. La difficulté de définir un tel projet, qui, finalement, renvoie à une question
de mise en place d’objectifs au sein de l’Atelier, est justement qu’il puisse prendre en compte
cette capacité d’évolution qui n’est pas toujours appréhendable dans un domaine aussi disposé
à la libre expression de ses acteurs que celui des pratiques artistiques.
Néanmoins, la difficulté de mise en place d’un projet d’association (ou, pour reprendre
les termes propres à la didactique, d’objectifs de projet) semble surtout se devoir à l’absence de
temps de coordination entre Elisa et Xavier et leurs intervenants, ne serait-ce que dans une
logique de restitution et de mise en commun des travaux de chacun. Concernant les ateliers
artistiques plurilingues, mis à part les ateliers communs que peuvent parfois réaliser Mehregan
73
et Hélène sans toutefois passer par une phase de préparation à deux, il n’existe pas de temps de
discussion autour des activités de chacune au sein de l’association, alors même qu’elles
partagent l’animation d’ateliers relevant de la même dynamique. Mehregan confirme cela dans
son entretien (voir annexe 8.2) en expliquant qu’après avoir exposé ses points de vue et ses
envies sur l’animation des AMP lors d’une réunion de début de saison, aucune autre réunion
n’a été organisée pour évoquer l’évolution de chacun en équipe. L’Atelier du Coteau fonctionne
donc actuellement selon une logique de coopération plus que de collaboration, la somme des
ateliers représentant l’activité générale de l’association qui ne sait pour le moment comment
respecter l’autonomie de ses intervenants tout en mettant en place un cadre d’action global qui,
pourtant, se présente pour Elisa et Xavier comme un prochain pas dans leur démarche de
associative.
I.2.d. Le dialogue avec les parents
Dans le contexte d’une association dont les activités ciblent principalement un public
jeune, et notamment d’enfants, la question se pose de la communication avec les parents. En
effet, les parents sont ceux qui, le plus souvent, sont à l’origine de l’inscription des enfants à
des activités extrascolaires et surtout ceux qui déboursent l’argent nécessaire à leur
fonctionnement. Ils sont donc des acteurs à part entière de l’Atelier du Coteau qu’il m’a semblé
important de mentionner lors de mon entretien avec Elisa et Xavier.
Dans un premier temps, la relation entre la direction de l’association et les parents
apparaît d’abord comme pédagogique. Elisa souhaite faire prendre conscience aux parents que
ce qu’elle propose avec les intervenants dans leurs ateliers est complémentaire de l’expérience
que les enfants vivent à l’école : « ça fait vraiment partie de la vie de l’enfant, de sa construction
sociale…». Les intervenants travaillent à l’accompagnement de l’enfant dans son
épanouissement en tant qu’individu et en tant qu’apprenant, grâce à la découverte d’autres
manières d’apprendre. Xavier explique notamment qu’il s’agit de faire prendre conscience de
l’apport des arts et des pratiques artistiques « dans la compréhension du monde sur n’importe
quel domaine » en partant du développement de la perception sensorielle comme première
relation à ce monde.
Dans un second temps, j’ai pu remarquer que la relation avec les parents n’était pas
toujours évidente, en tout cas lorsqu’il s’agissait d’obtenir des retours critiques sur l’offre en
activités de l’association. De fait, après cinq ans d’existence de l’Atelier du Coteau et bientôt
deux ans de fonctionnement des ateliers artistiques plurilingues, aucune enquête de satisfaction
n’a encore été effectuée auprès de ceux qui représentent une source de financement importante
74
de la structure. La directrice confesse qu’elle trouve cet exercice « très délicat », mais je ne suis
pas en mesure de déterminer si elle considère cela comme une démarche délicate pour les
parents interrogés ou pour l’association et ses intervenants dont les actions pourraient
éventuellement se voir remises en question. Cependant, cela pourrait s’avérer être un moyen
d’évaluer les ateliers et d’enrichir l’approche réflexive déjà menée pour les actions en milieu
scolaire et les perspectives d’évolution de l’Atelier : « ça aussi ça fait partie de ce qu’on peut
transmettre aux parents, que l’on est aussi dans cette démarche d’accueillir des personnes en
formation et que […] ça nous permet nous aussi de continuer notre réflexion ». A cette
intervention d’Elisa, j’ai pu comprendre qu’il y avait de véritables attentes de sa part et de celle
de Xavier pour mener une enquête auprès des parents dans le cadre de mon stage, ce dont nous
aborderons plus loin les détails.
I.3. Un éveil aux langues et aux cultures informel
Comme cela a déjà été précisé plus haut dans l’analyse de l’entretien, Elisa et Xavier
présentent leurs ateliers artistiques plurilingues comme originaux dans leur approche artistique
mais ne répondent d’aucun cadre ni d’aucune méthode d’enseignement de l’éveil aux langues
et aux cultures. De fait, les deux créateurs de l’association ne sont pas formés à l’enseignement
des langues et des cultures, Mehregan n’a pas reçu de formation spécifique pour animer les
AMP, et seule Hélène se réclame de la didactique des langues et des cultures, étant diplômée
du Master de Didactique des Langues et des Cultures de l’Université de Nantes depuis 2013. Si
nous avons pu déterminer les raisons qui ont amené l’Atelier du Coteau à proposer des ateliers
d’éveil artistique, linguistique et culturel, l’entretien d’Elisa et Xavier a permis d’éclaircir le
principe de leur démarche au regard de la didactique.
I.3.a. La valorisation du locuteur natif
La mise en place des ateliers artistiques plurilingues est née de rencontres et d’une
recherche de mise à profit de la réforme des rythmes scolaires. Mais cette mise en place s’inscrit
aussi dans la démarche plus globale de l’Atelier qui a reçu et reçoit encore des intervenants
étrangers : un couple d’Américains animait des séances théâtrales l’année dernière, une
danseuse britannique anime la danse des cinq rythmes cette année, un intervenant brésilien
mettra en place la capoeira à la rentrée prochaine, sans oublier Mehregan, Iranienne, qui assure
les arts plastiques depuis l’année dernière. L’accueil de ces artistes est pour Xavier un élément
supplémentaire dans la cohérence de leur démarche sur l’éveil aux langues et aux cultures, car
75
il est question d’ « une approche purement artistique avec des intervenants plutôt étrangers [qui]
valorise[r] l’apport culturel qui porte sur eux quand ils viennent enseigner en France ». Pour
Elisa, avoir des intervenants étrangers est aussi un moyen de montrer que les arts et leur
enseignement ne connaissent pas de « frontières », affirmant ainsi que les arts disposent de cette
dimension universelle tout en apportant des regards sur l’Ailleurs et sur l’Autre.
Dans son entretien, Mehregan confirme l’intérêt de son identité étrangère à plusieurs
reprises pour son travail au sein de l’association. Elle affirme d’abord que cela a été un atout
pour qu’elle obtienne ce poste : « En fait vu que je suis étrangère, et que je parle par exemple
d'autres langues tout ça, j'ai trouvé ça hyper sympa et Elisa aussi pour que je puisse donner des
cours ici ». Puis justifie cet atout pour les enfants après l’avoir justifié pour l’Atelier : « Et le
fait que je sois d'un pays étranger, eux ils voient toujours tous les jours que voilà, il y a un
étranger qui parle français, qui peut faire des fautes, avec un accent mais voilà, c'est pas
choquant quoi. Qui parle d'autres langues aussi » ; « Tu vois moi je pense qu’on peut profiter
du fait que j’ai un accent tu vois. J’ai un accent, même là je parle je fais beaucoup de fautes
mais au fur et à mesure que les années passent je fais moins de fautes mais je vais garder
toujours mon accent. Donc pourquoi pas, on peut en profiter » (pour les trois citations
précédentes, voir entretien en annexe 8.2).
Cette ouverture apportée par des intervenants étrangers est également valorisée pour le
bien-être de l’intervenant lui-même qui, pour Xavier, n’a pas à se sentir complexé de ne pas
forcément parler français car c’est l’association qui fera preuve d’adaptation. Nous retrouvons
alors cette volonté de développer les lieux comme une véritable maison dans laquelle tous se
sentent accueillis et où tous peuvent échanger, quelle que soit la langue dans laquelle ils
communiquent. A première vue, cette valorisation d’une atmosphère ouverte à l’Autre à
l’échelle de l’association confirme la cohérence de pratique et de pensée d’Elisa et Xavier dans
le développement d’ateliers artistiques plurilingues. Néanmoins, les discours de justification de
cette démarche paraissent plus orientés vers la valorisation de l’artiste intervenant comme
locuteur natif que dans la valorisation des contenus et des méthodes utilisées dans les ateliers
pour transmettre aux enfants cette richesse plurilingue et pluriculturelle pourtant cultivée par
l’association. Nous retiendrons cependant que cette attention portée à l’accueil et au bien-être
de l’artiste étranger peut être source d’émotions positives de la part de celui-ci qui sera alors
plus à même de les communiquer à son tour dans l’exercice de sa profession auprès des plus
jeunes.
76
I.3.b. Arts et éveil aux langues et aux cultures entre rencontres et distinctions
S’il existe une tension entre respect de l’autonomie des intervenants et volonté de
fédérer un projet collectif, il existe aussi une certaine tension entre le degré de mélange des arts
et de l’éveil aux langues et celui de leur distinction au sein des ateliers artistiques plurilingues.
Sur les deux types d’ateliers (musique et multi-activité), les deux intervenantes représentent des
approches différentes, l’une en tant qu’artiste et l’autre en tant que didacticienne des langues et
des cultures. Pour reprendre ce qui a déjà été précisé plusieurs fois, les deux intervenantes
animent parfois des ateliers en commun mais travaillent et préparent leurs ateliers séparément,
ce qui illustre de fait une distinction entre une approche artistique d’un côté et une approche
plus linguistique et culturelle de l’autre, alors que le concept même d’ateliers artistiques
plurilingues supposent un certain degré de fusion entre ces deux approches que chacune réalise
respectivement dans ses interventions.
Cette distinction, Elisa et Xavier en font le constat dans leur entretien, expliquant que la
place de l’éveil aux langues et aux cultures dans chacun des ateliers répond du bagage personnel
de Mehregan et Hélène. Ainsi, ils présentent cette dernière comme une animatrice « sans limites
sur toutes les langues » de par sa formation en didactique qui lui ferait adopter une perspective
« différente », vraisemblablement plus orientée vers la dimension linguistique et culturelle.
L’apport clairement plurilingue et pluriculturel d’Hélène seraient facilité, d’après Elisa, par sa
discipline artistique de spécialité qu’est la musique et le chant qui lui semblent « peut-être »
plus adaptés aux approches plurielles. Bien que la musique soit au cœur de nombreuses
recherches pour son application dans des situations d’EA (Leroy, 2008 ; Arleo, 2000), cette
remarque d’Elisa me parait plutôt relever du domaine des représentations quant à l’apport des
arts à la didactique des langues et des cultures. En effet, nous avons eu l’occasion de présenter
plusieurs exemples concluants de recherches employant d’autres disciplines que la musique ou
le chant associées à l’expérience d’apprentissage d’une langue et d’une culture (Aden, 2014,
2010 ; Bécavin, 2014 ; Borgé, 2014 ; Dubrac, 2014 ; Potapushkina Delfosse, 2014 ; Puozzo
Capron & Perrin, 2014 ; Witzigmann, 2014 ; Mallet, 2013 ; Nobori, 2012 ; Perregaux, 2009 ;
Perraudeau, 2006 ; …). Ce type de représentation n’est pas isolé à l’Atelier du Coteau, puisque
lors d’une première rencontre avec Alexis, animateur des ateliers théâtre, j’avais déjà pu
entendre qu’il ne voyait pas comment proposer des ateliers théâtre plurilingues car cette
discipline artistique était trop attachée à la langue. Le profil d’Hélène abordé, Elisa aborde celui
de Mehregan en contraste, expliquant que l’artiste plasticienne n’aborde pas autant de langues
que sa collègue des ateliers musique : les AMP comprennent un éveil à l’anglais et au persan,
77
avec une ouverture future possible pour l’espagnol car Mehregan a commencé à se former en
tant que débutante dans cette langue. Il s’agit ici d’un plurilinguisme qui s’appuie sur le bagage
personnel de Mehregan qui, selon la directrice, souhaiterait certainement proposer une
ouverture culturelle plus large mais manque de temps pour le concrétiser avec son occupation
d’artiste en résidence.
La rencontre entre les arts et l’éveil aux langues est plutôt pensée à l’échelle des enfants
qui « sont en âge de tout absorber » et qui peuvent le faire avec le minimum de préjugés, de
représentations sur les arts et les langues et les cultures. Elisa conçoit le double enseignement
artistique/linguistique et culturel comme une possibilité de faire se réaliser l’apprentissage par
« l’instinct » grâce à une approche ludique : il s’agit d’accompagner l’enfant sur ce que Xavier
nomme « le chemin de l’engagement ». L’apprentissage ne se fait pas par contrainte mais par
intériorisation par la pratique, par l’expérience encouragée. Ainsi, c’est l’enfant lui-même qui
est acteur dans cette démarche, c’est lui qui « décide de faire quelque chose » et qui va, par son
propre engagement, apprendre sans obligatoirement s’en rendre compte, par expérience
instinctive donc. Pour les deux créateurs de l’Atelier du Coteau, l’enfant est acteur et l’adulte
accompagnateur de cette découverte des arts, des langues et des cultures, reprenant alors les
fondements de la démarche actionnelle. Cette perception reste cependant à considérer en dehors
de toute pratique effective menée dans les ateliers artistiques plurilingues et plus spécifiquement
dans les AMP dont nous ferons le bilan des observations plus loin afin de voir si cette perception
correspond à ce qui est réalisé au quotidien avec les enfants.
I.3.c. L’évaluation informelle
N’ayant pas d’objectifs précis de définis mais des valeurs qui servent de cadre au travail
réalisé au sein de l’Atelier du Coteau, il n’y a pas de système d’évaluation formel d’instauré,
que ce soit à l’échelle de l’association ou à l’échelle des ateliers afin de savoir si l’enseignement
artistique et l’éveil aux langues et aux cultures ont des apports avérés auprès des enfants.
L’absence d’évaluation est compréhensible dans le cadre d’un centre de loisirs qui n’a pas
d’obligation de résultats quantitatifs : contrairement à l’école, l’objectif n’est pas de questionner
l’acquisition de connaissances et de compétences, mais simplement de s’assurer de
l’épanouissement de l’enfant dans les pratiques qui lui sont proposées. Cela n’empêche pas
certains processus d’apprentissage d’entrer en jeu et qu’il y ait un développement des savoirs,
savoir-faire et surtout savoir-être chez les participants aux ateliers. De fait, Elisa fait le constat,
en particulier pour les enfants des ateliers artistiques plurilingues, du développement progressif
d’une ouverture à l’Autre, d’attitudes de respect et de signes de prise de confiance en soi depuis
78
le lancement de l’association et de ces ateliers. Les remarques sur ces notions qui relèvent des
savoir-être et du développement personnel comme bilan actuel de l’évolution des enfants au
sein de l’Atelier du Coteau confirment en quelque sorte l’absence de système d’évaluation qui
ne pourrait standardiser ce type d’apprentissages.
Au sein des AMP, Mehregan procède également à une évaluation informelle de
l’évolution des enfants à ses côtés. La progression sur le plan artistique est, selon elle, visible à
travers le panorama des créations réalisées qui traduisent le degré de compréhension de ce qui
a été expliqué et de ce qu’elle pouvait attendre des enfants. Dans le domaine linguistique et
culturel, elle apprécie se rendre compte que certains enfants arrivent à retenir certains mots de
persan notamment. Même si elle note des acquisitions de vocabulaire en anglais, pour elle
l’appropriation de termes dans une langue aussi peu familière pour les enfants que le persan est
un signe positif, car cela signifie qu’ils peuvent se laisser « porter par cette langue » alors
qu’elle n’est pas aussi présente dans leur environnement que l’anglais. De la même manière,
c’est un phénomène qu’elle aime constater à partir de la découverte d’éléments culturels comme
la fête du feu ou le premier de l’an iraniens. Dans l’ensemble, elle s’appuie sur l’expression des
enfants pour savoir s’ils s’épanouissent dans ses ateliers : par exemple, selon elle, Agathe,
Marie, Lucien et Maya aiment participer aux ateliers car elle les a déjà entendu l’affirmer, ou
bien l’une demande à rester parfois la deuxième heure d’atelier parce qu’elle ne veut pas partir
dès 18h, ou l’autre montre beaucoup d’excitation ou sourit franchement dès la sortie de la classe
pendant le pedibus. Elle reconnait que certains enfants peuvent parfois s’ennuyer car un thème
ne leur plait pas, mais dans l’ensemble, même auprès de ceux qui montrent parfois plus de
caractère à accepter une activité et pas une autre, le bilan lui parait très positif. L’évaluation se
fait aussi auprès des parents qui, pour certains, affirment leur contentement auprès de
Mehregan, ou bien racontent que leur enfant a pu ressortir de mémoire quelques mots en anglais
ou en persan dans la sphère familiale, ce qui peut être porté au crédit de l’Atelier du Coteau
lorsque les enfants concernés n’ont pas d’autres occasions d’aborder ces langues au quotidien,
dans d’autres contextes.
I.4. Bilan de ces analyses au regard du projet de recherche
Afin de tirer parti des émotions des acteurs de l’Atelier du Coteau pour amorcer une
démarche didactique dans le développement du projet d’association et plus spécifiquement dans
le développement des AMP vers plus de cohérence entre éveil artistique et éveil aux langues et
aux cultures, il convenait d’effectuer un état des lieux des émotions à l’origine du projet,
79
régissant de manière plus ou moins implicite le fonctionnement global de la structure. Ainsi,
l’analyse des données de l’entretien d’Elisa et Xavier m’amènent à considérer les éléments
suivants comme importants à prendre en compte dans mon projet de recherche :
- L’Atelier du Coteau représente un investissement personnel et professionnel fort de la
part de la direction de l’association car il répond d’un réel projet de vie : Elisa et Xavier
y travaillent à plein temps sans rémunération, dans un quartier où ils éprouvent un
attachement affectif de longue date. Leurs activités leur tiennent à cœur car ils y trouvent
des réponses à leurs propres expériences, passées et présentes. La dimension
émotionnelle de leur engagement se transmet au lieu qu’ils développent comme une
« deuxième maison » pour eux, pour les artistes intervenants et pour les personnes
(enfants, adolescents et adultes) fréquentant les ateliers.
- L’identité de l’association se forge autour des arts et des pratiques artistiques comme
levier de développement personnel, d’apprentissage et, dans le cas des ateliers
artistiques plurilingues, de perspective ludique originale. Cette définition de l’identité
de l’Atelier du Coteau est toujours en construction, nourrie d’une démarche réflexive
sur la conception de leur travail en interne et en externe avec des projets de
développement en milieu scolaire.
- Cette approche réflexive les amène à pouvoir justifier leur démarche à la recherche des
apports des arts et des pratiques artistiques auprès des enfants. Ainsi, ils revendiquent
une perception des apprentissages comme cheminement individuel et/ou collectif libre
de toute obligation ou contrainte favorisant l’expérience physique pour une
appropriation directe de savoirs et compétences, rejoignant certains aspects de la
littérature scientifique exposée dans notre cadre théorique confirme (Corder Meagher,
2015 ; Margolis, 2015 ; Aden, 2014, 2010 ; Dubrac, 2014 ; Puozzo Capron & Perrin,
2014 ; Mallet, 2013 ; Piccardo, 2013 ; Potapushkina Delfosse, 2014 ; McNeil, 2009…).
Enfin, le décloisonnement entre les disciplines artistiques au sein d’un même atelier
offre des opportunités d’apprentissages variées qui s’avèrent cohérentes avec la volonté
d’Elisa de prendre en considération la question des « intelligences multiples » et qui, de
surcroit, correspond à la logique de décloisonnement des enseignements de langues et
cultures prônée par les approches plurielles (Conseil de l’Europe & Centre Européen
pour les Langues Vivantes, 2015).
- Néanmoins, l’entretien dévoile également certaines frustrations comme la difficulté de
construire un projet collectif global à l’heure où une importance a été accordée au
respect de l’autonomie des artistes intervenants pour qu’ils s’engagent dans leur propre
80
développement et dont le travail s’inscrit plus dans une logique de coopération que de
collaboration au sein de l’Atelier. De plus, Elisa et Xavier font face à la complexité de
la gestion d’emploi du temps multiples pour dégager des temps de coordination, étant
eux-mêmes très pris par leurs obligations administratives, financières et logistiques
propres des nécessité de gestion d’une structure.
- La définition d’objectifs et leur contrôle par un système d’évaluation restent donc
difficiles à mettre en place, d’autant plus que l’Atelier du Coteau, en tant que centre de
loisirs artistiques avant tout, ne peut fonctionner de la même manière qu’une école ayant
des obligations de résultats, des programmes et d’autres éléments caractéristiques d’un
cadre institutionnel. L’imposition d’objectifs et de systèmes d’évaluation n’est pas une
démarche adaptée au contexte de notre recherche, bien qu’une interrogation des enfants
et de leurs parents dans le cadre des AMP puisse par exemple apporter des éléments
nourrissant la démarche réflexive d’Elisa et Xavier tout en rendant celle-ci publique
comme valeur de travail auprès de tous les acteurs de l’association. Une logique de
planification de projet n’est pas non plus évidente à adopter lorsque les intervenants de
l’association tiennent aussi à pouvoir rester en phase avec l’évolution et les besoins ou
demandes des enfants pendant l’année. La solution se trouverait sans doute plus
facilement dans la formulation d’un fil rouge donnant un thème à suivre mais une liberté
dans l’adaptation des activités proposées.
- La mise en place des ateliers artistiques plurilingues répond d’une initiative innovante
mais qui présente cependant des éléments critiquables sur le plan didactique : si
l’animation d’ateliers d’éveil artistique requiert certaines formations et/ou expériences,
il en est de même pour l’animation d’ateliers d’éveil aux langues et aux cultures,
d’autant plus lorsque ces deux approches sont associées, au risque de rester dans une
logique de séparation des deux domaines. Cette séparation ne semble constatée que dans
la perception d’une différence d’approche des deux intervenantes, et l’apport mutuel de
chacun des deux éveils peut alors se trouver compromis. La valorisation des artistes
comme « locuteurs natifs » permet certes de conforter la dimension accueillante et
« sans frontière » de l’Atelier du Coteau tout en mettant à profit leur bagage plurilingue
et pluriculturel auprès des enfants. Cependant, si la focalisation se fait principalement
sur l’intervenant, l’interrogation du bagage langagier et culturel des enfants comme
support possible d’enrichissement et d’adaptation des ateliers n’est pas pris en compte,
délaissant alors une opportunité de favoriser les émotions positives de tous les acteurs
de ces ateliers artistiques plurilingues.
81
Tous ces éléments pris en compte, nous pouvons avancer que, suivant notre première
hypothèse sur les apports du CARAP comme outil de définition d’objectifs, celui-ci pourrait
être invoqué dans les AMP dans une mesure raisonnable, respectant la dimension de loisir de
l’association. L’avantage de ce cadre est qu’il intègrerait des formulations d’objectifs propres
au développement de savoir-être déjà suscités par le parcours d’éveil aux langues et aux cultures
proposé dans les ateliers artistiques plurilingues et apporterait des possibilité d’évolution des
activités vers de nouvelles compétences pour les enfants. En plus de participer aux préparations
des ateliers, le CARAP pourrait aussi être abordé comme outil d’auto-évaluation pour situer le
travail effectué avec les enfants au regard de ce qui est effectué dans d’autres structures y
compris scolaires, valorisant alors la démarche de l’Atelier du Coteau en interne mais aussi en
externe pour leurs interventions futures dans les écoles nantaises.
Le besoin de travailler concrètement au test de notre deuxième hypothèse est confirmé
afin de répondre à la demande d’Elisa et Xavier concernant l’interrogation des parents sur leur
opinion au sujet des AMP. Mais cela permettra aussi d’équilibrer la valorisation du bagage de
Mehregan par la valorisation du bagage des enfants participant à ses ateliers en réalisant leur
biographie langagière, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux activités proposées tout en
cherchant à générer des émotions positives chez tous les acteurs des ateliers.
Enfin, la conception de mon dispositif devra prendre en compte l’atmosphère affective
impulsée par Elisa et Xavier dans leur association et reprendre la perspective artistique
dominante, tout en cherchant à l’associer au mieux à l’éveil aux langues et aux cultures pour
enrichir l’expérience des enfants et continuer à les accompagner dans leur épanouissement
personnel. Mon dispositif devra nécessairement suivre la logique de décloisonnement
disciplinaire parmi les arts, ce qui me permettra, en miroir, de proposer un décloisonnement des
langues et des cultures abordées avec les enfants des AMP en fonction du bilan des biographies
langagières réalisées. Ce dispositif pourra également se nourrir des retours des parents des
enfants dont nous pourrons chercher à satisfaire certaines attentes en accord avec l’approche
didactique utilisée. Pour finir, l’objectif sera de rendre ce dispositif cohérent avec le travail
effectué jusqu’alors par Mehregan tout en proposant des activités nouvelles facilement
adaptables ou renouvelables optimisant le mélange des éveils artistiques, linguistiques et
culturels dans une atmosphère positive.
Afin de continuer à mettre à l’épreuve mes hypothèses de travail et perfectionner la
conception d’un dispositif adapté au contexte de ma recherche, nous allons maintenant nous
82
intéresser plus précisément au recueil et à l’analyse des données tirées d’un entretien avec
Mehregan et des observations réalisées lors des AMP.
Partie II. Les ateliers multi-activités plurilingues :
cohérence avec les valeurs de l’Atelier du Coteau et
remarques didactiques
Après avoir fait le point sur ce qui définissait le fonctionnement de l’Atelier du Coteau
et les raisons qui ont donné naissance aux ateliers artistiques plurilingues, j’ai décidé de me
concentrer pleinement sur ce qui était mon terrain de recherche, à savoir, les AMP animés par
Mehregan. Mon objectif était double pour réussir à cerner dans le détail ce qui caractérisait ces
ateliers. Je voulais d’abord effectuer un état des lieux de ce qui se passe dans les AMP au regard
des lignes de travail et de réflexion impulsées par Elisa et Xavier pour déterminer les cohérences
et les éventuelles incohérences entre la macro et la microstructure. Puis, je souhaitais réaliser
la même démarche au regard de la didactique des langues et des cultures afin de préciser la
conception de mon dispositif dans le respect de l’association, de Mehregan et de sa manière de
travailler, et de la didactique.
Le recueil des données s’est réalisé de trois manières différentes : par observation
participative des AMP, par observation distancée sur grilles d’observation et enfin par
l’organisation d’un entretien semi-directif avec Mehregan. L’observation participative a été ma
méthode de recueil de données principale pendant le stage, et ce pour plusieurs raisons. Il
s’agissait en premier lieu d’un choix personnel appuyé par Mehregan pour que les enfants se
sentent à l’aise en ma présence avant de passer à la réalisation d’observations extérieures munie
de grilles d’observation. Ce choix s’est révélé judicieux car la majorité des enfants n’a montré
aucun signe extérieur de gêne quant à ma présence, le temps du goûter avant le début des ateliers
a donné lieu à de petites conversations informelles où les enfants m’ont raconté spontanément
des histoires personnelles en lien avec l’école ou leur famille, et une enfant m’a même invitée
à son anniversaire, une semaine à peine après le début du stage. Ces conversations informelles
m’ont permis de collecter des données préliminaires sur chacun des enfants afin d’apprendre à
les connaitre rapidement. Nous noterons que l’observation participative comporte cependant
l’inconvénient majeur de ne pas pourvoir effectuer de prise de notes en direct mais exige un
retour sur l’expérience vécue en dehors des heures de stage : la mémoire des évènements n’est
alors pas entièrement fiable, d’autant plus que certains éléments n’ont pas pu être relevés car
83
mon attention s’est parfois portée sur un enfant qui avait besoin d’aide pour réaliser une œuvre
ou que je devais accompagner aux toilettes par exemple. En revanche, la mémoire globale des
évènements relatés après les ateliers m’a sans doute permis de distinguer les grandes étapes de
la structure des ateliers et de relever des éléments importants qu’il me fallait impérativement
prendre en compte dans ma recherche. De plus, avoir relevé ce qui me semblait évident par
observation participative allait m’offrir de me concentrer ensuite sur des détails qui ne
pouvaient s’observer que par une observation rigoureuse. Toutes les données recueillies selon
cette méthode sont consignées dans le journal de bord en annexe 6.
Dès la deuxième semaine de stage, j’ai cherché à réaliser des observations sur grilles en
m’installant en observateur dans un coin de la pièce où se déroulent les AMP afin de
m’intéresser plus en détail à la place de l’éveil aux langues et aux cultures dans les ateliers. Ces
grilles sont accessibles pour le lecteur en annexe 7. Après deux premières grilles testées sur le
terrain et une tentative de préparation d’une troisième grille, j’ai dû faire le constat que cet outil
de recueil de données n’était pas adapté au contexte de mon stage. La réalité changeante des
AMP entre séances en intérieur et séances au parc de Procé rendait compliquée la prise de notes,
le recours aléatoire aux langues et cultures étrangères de Mehregan invalidait régulièrement la
formulation et le classement des items que je souhaitais observer et la diversité des interactions
entre Mehregan et les enfants et les enfants entre eux étaient impossibles à relever dans leur
intégralité par un seul observateur. Ces constats m’ont cependant permis d’émettre l’hypothèse
d’une absence de lignes de travail explicites qui encadreraient le déroulement des AMP et
permettraient d’effectuer une observation d’éléments isolés que suppose l’utilisation d’une
grille d’observation. Cela impliquait alors que la manière de fonctionner de Mehregan dans la
préparation et l’organisation de ses ateliers m’échappait certainement, ce pour quoi j’ai décidé
de réaliser un entretien avec elle afin de mieux cerner les tenants et aboutissants de son travail.
Le mercredi 25 mars après l’heure d’AMP, Mehregan et moi-même nous sommes donc
installées dans la salle d’atelier pour réaliser un entretien que j’ai voulu semi-directif, pour les
mêmes raisons qu’avec Elisa et Xavier. Cela dit, Mehregan a semblé moins se laisser porter par
ce qu’elle souhaitait me dire que par mes questions auxquelles elle a répondu dans l’ordre,
s’assurant par demandes régulières que ses réponses étaient compréhensibles et correspondaient
à ce que je voulais savoir. L’entretien s’est donc certainement plus rapproché d’un mode
d’organisation directif à certains passages, rappelant le principe d’une interview journalistique.
Même si aucun mode d’entretien ne peut revendiquer le recueil d’une parole absolument
authentique, il n’est pas improbable que le discours de Mehregan ait été plus contrôlé que celui
de la direction de l’Atelier du Coteau. Néanmoins, il m’a apporté de nombreux éléments de
84
compréhension et il a pu donner lieu à l’établissement d’une ébauche de biographie langagière
dont nous traiterons dans cette partie. La transcription de cet entretien apparait en annexe 8.2.
L’ensemble des données recueillies par observation des AMP et par l’entretien réalisé
avec Mehregan sont analysées selon trois perspectives différentes : nous aborderons pour
commencer la question de la cohérence entre le travail effectué par Mehregan avec les enfants
et les valeurs prônées par l’Atelier du Coteau, confirmant le degré d’influence de l’association
sur les activités qu’elle héberge. Puis, nous chercherons à analyser les caractéristiques des AMP
au regard de la didactique des langues et des cultures avant de nous attarder sur la définition
des expériences et des émotions qui définissent la relation de ma tutrice à son travail et apportent
des éléments de réponse complémentaires à la compréhension du fonctionnement et des
possibilités de développement des AMP qui pourront enrichir mon projet de dispositif.
II.1. Analyse des données recueillies sur les ateliers multi-activités
plurilingues au regard du fonctionnement et des valeurs de l’Atelier du
Coteau
Ayant commencé à travailler à l’Atelier du Coteau en tant que stagiaire en 2013,
Mehregan a commencé par animer des ateliers d’arts plastiques et des ateliers d’arts plastiques
plurilingues, avant d’entamer en septembre 2014 les ateliers multi-activités plurilingues qui
sont au cœur de mon travail de recherche. Son intégration au sein de l’association remonte donc
à deux ans pendant lesquels elle semble avoir tissé des liens d’amitié avec Elisa et Xavier5. En
totale adéquation avec les valeurs défendues par l’Atelier, Mehregan compare à deux reprises
sa manière de travailler avec celle d’Elisa ou d’Alexis dans leurs disciplines respectives que
sont la danse et le théâtre (annexe 8.2). Voyons à présent ce que l’observation des AMP a permis
de confirmer, et, dans certains cas, de nuancer.
II.1.a. Exposition « Mehregan Kazemi et ses élèves » : la professionnelle et les amateurs en
miroir
L’une des démarches de Mehregan qui montrent le plus de cohérence avec les lignes de
travail et de réflexion de l’association est sans nul doute celle de la valorisation d’un échange
entre pratique professionnelle et pratiques amateurs. Ne laissant passer un seul AMP sans
effectuer une création relevant du domaine des arts plastiques avec les enfants, Mehregan est
5 Xavier raconte notamment qu’il leur est arrivé avec Elisa d’aller dîner chez Mehregan et Alexis (voir entretien
en annexe 8.1), ce que je me permets d’interpréter comme un signe d’amitié confirmé par les échanges entre la
direction de l’association et ses artistes dont j’ai pu être témoin à plusieurs reprises pendant mon stage.
85
dans la transmission de ce qui fait sa profession d’artiste. Ayant à cœur de faire expérimenter
aux enfants la diversité de cette discipline, j’ai pu observer qu’en trois mois tous les enfants ont
réalisé les activités suivantes : peinture au pinceau, peinture au doigt et à la main, collage,
découpage, dessin aux crayons de couleur, aux feutres, aux pastels, créations en 2D et en 3D,
préparation d’installations et photographie. Tout cela s’est accompagné d’un travail constant
sur les couleurs auquel s’est ajoutée une découverte d’un pan de l’histoire de l’art et notamment
de l’Impressionnisme : les enfants ont vu un portrait photographique de Claude Monet ainsi que
des clichés et des peintures de ses jardins autour desquelles les enfants ont réalisé une création.
Mais c’est surtout dans le projet d’exposition intitulé « Mehregan Kazemi et ses élèves »
que la notion de dialogue entre professionnels et amateurs est le plus parlante. Découvrant la
réalité du métier d’artiste qui expose ses œuvres dans une galerie et les présente en personne
lors du vernissage de son exposition, les enfants sont invités, par ce projet, à s’imaginer comme
de véritables artistes dont les créations vont être véritablement présentées du 28 mai au 25 juin
prochains à la Galerie 18. Ils exposent ainsi à l’instar des artistes en résidence à l’Atelier du
Coteau et qui ont eu l’occasion de présenter leurs
œuvres lors d’expositions mensuelles pendant l’année.
Mais ce dialogue est aussi envisagé selon une deuxième
dimension dans ce projet d’exposition car Mehregan
présentera, en miroir des œuvres des enfants de ses
ateliers, une série de créations personnelles qui sont
elles-mêmes en lien avec les enfants qu’elle a
accompagné tout au long de la saison. Il s’agit d’une
présentation de portraits photographiques en argentique
de chacun des enfants qu’elle a eu l’occasion de réaliser
au parc de Procé lors des sorties mentionnées dans le
journal de bord (voir annexe 6). L’une des affiches de
cette exposition présente même, à l'arrière-plan, l’un de ces portraits (voir ci-contre), illustrant
de manière concrète cet échange entre amateurs et professionnels que Mehregan cultive dans
les AMP et met ainsi en exergue parmi les lignes de travail impulsées par Elisa et Xavier pour
leur association.
II.1.b. Des ateliers multi-activités
Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre I de ce mémoire décrivant le
contexte de la recherche, les ateliers plurilingues qui ont fait l’objet de mes observations sont
86
définis comme « multi-activités » afin que tous les enfants puissent se retrouver et faire une
première découverte des disciplines artistiques dans leur diversité. Ces disciplines sont les
suivantes (telles que mentionnées par Elisa en entretien – voir annexe 8.1) : les arts plastiques,
les arts visuels, l’expression corporelle, l’expression scénique, la musique et le chant, tout en
gardant en tête que la spécialité de Mehregan se trouve dans les arts plastiques et els arts visuels
qui sont donc au cœur de son travail dans les AMP.
Or, si l’on se fie aux observations consignées dans le journal de bord (voir annexe 6),
nous pouvons remarquer que les enfants ont effectivement découvert les arts plastiques, les arts
visuels grâce à la photographie, l’expression corporelle lors des activités de mime des
comptines et le chant pour ces mêmes éléments, mais ils n’ont pas eu l’occasion d’effectuer des
activités d’expression scénique ou de musique. Nous tenons à nuancer ces propos en précisant
à notre lecteur qu’il s’agit-là d’un constat effectué sur trois mois d’observations, ce qui ne peut
refléter de manière fiable la réalité concrète des activités proposées dans les AMP depuis leur
mise en place. Nous remarquons donc que pendant trois mois, les enfants ont eu accès à des
disciplines artistiques variées dans le cadre des ateliers animés par Mehregan, à l’exception de
l’expression scénique et de la musique pour lesquelles nous pouvons trouver des compensations
dans les activités de mime qui peuvent s’intégrer dans la première discipline et pour la
découverte et le chant de comptines qui pourraient s’intégrer dans la deuxième. Néanmoins,
lors d’une conversation informelle ayant eu lieu lors de ma première semaine de stage,
Mehregan m’exprime que certains parents des enfants inscrits dans les AMP sont en attente de
plus d’activités chantées que ce qu’elle propose alors. Celle-ci m’explique alors que, de fait,
elle est bien en charge d’animer des ateliers multi-activités devant intégrer notamment le chant
et la musique, mais qu’elle considère les arts plastiques et les arts visuels comme primordiaux
étant donnée sa formation et profession d’artiste plasticienne, ce pourquoi elle ne souhaite pas
dédier plus de temps qu’elle ne le faisait déjà à d’autres activités.
La pluridisciplinarité des AMP est donc bien respectée mais pas selon un temps égal
d’une activité à une autre, ce que nos observations sur grilles ont confirmé par un calcul de la
durée de chaque activité lors des deux séances observées selon cette méthode (voir annexes 7).
Ainsi, 50 minutes sur 60 ont été dédiées à la réalisation de créations plastiques lors de la
première séance observée sur grille, et 42 minutes pour la deuxième, impliquant que 67% à
83% du temps de déroulement de ces ateliers ont été dédiés aux arts plastiques. Cette tendance
s’est confirmée et a été consignée de manière plus implicite dans le journal de bord relatant
certains AMP où la majorité de l’heure d’atelier consistait à effectuer des activités propres aux
arts plastiques (voir annexe 6). Cette dominance des arts plastiques n’étant pas explicitement
87
présentée sur les documents de communication de l’Atelier du Coteau, cela semble
vraisemblablement générer des attentes non satisfaites pour certains parents des enfants inscrits
aux AMP, tout en remettant légèrement en cause la définition de « multi-activités » apportée
par Elisa lors de notre entretien. Notre dispositif se devra sûrement de prendre cet élément en
compte afin de correspondre au cadre établi par l’association et aux attentes des parents, et cela
sans délaisser pour autant la spécialité artistique de Mehregan.
II.1.c. L’imagination, la parole et le corps : des valeurs de l’association aux valeurs des ateliers
multi-activités plurilingues
Parmi les sept valeurs déclarées comme définissant les axes de travail de l’Atelier du
Coteau (voir statuts de l’association en annexe 3), trois ressortent particulièrement au sein des
AMP. L’imagination et son développement correspond au premier objectif d’apprentissage
formulé dans le chapitre I de ce mémoire. Mehregan met un point d’orgue à toujours convoquer
l’imagination de chaque enfant avant d’entamer la réalisation d’une nouvelle création qui peut
à son tour faire appel à l’imagination de son spectateur. Pour Mehregan, mettre l’imagination
au cœur de ses activités est une évidence avec les enfants car selon elle, « à cet âge-là ils ont un
esprit très ouvert » et présentent rarement de difficultés à s’imaginer ailleurs et observer ce qui
se passe autour d’eux dans un monde autre que la réalité.
La parole est aussi très présente dans les AMP, Mehregan invitant les enfants à
s’exprimer individuellement à chaque séance pour raconter ce qu’ils ont vu en imaginant un
parcours suggéré au bord de la mer ou sur la route pour se rendre à Paris, ou encore pour
annoncer les couleurs qu’ils souhaitent utiliser dans leur création. Néanmoins, il s’agit-là
d’intervention des enfants sur demande de leur animatrice qui est toujours l’instigatrice du
déroulement des ateliers, du cadre des œuvres réalisées et du choix des comptines écoutées par
exemple. Il est arrivé, pendant la durée du stage, que certains enfants aient exprimé
spontanément qu’une comptine ne leur plaisait pas, ou qu’ils n’avaient pas envie de faire une
activité et se soient mis à l’écart, évènements que Mehregan considère comme relatifs au
comportement des enfants qui peuvent apprécier une activité et pas une autre, mais pour
lesquels elle n’a pas semblé chercher d’explication auprès de l’enfant lui-même par exemple
(voir entretien en annexe 8.2). Comme nous l’avons expliqué dans notre cadre théorique,
l’expression des raisons et des émotions qui ont fait que l’enfant n’avait pas envie de participer
à une activité serait sans doute importante à stimuler pour permettre à celui-ci de ne pas s’arrêter
sur une situation plutôt négative (Masmoudi et al., 2010) et de trouver d’autres réactions
88
possibles pour exprimer son désaccord ou son mécontentement de façon à ce que sa démarche
reste positive.
Le corps, un des deux principaux axes de travail de l’Atelier du Coteau, est de fait
sollicité lors des AMP, par exemple lorsque les enfants dansent en ronde en chantant des
comptines ou en les mimant, en déambulant dans la salle afin de s’imaginer se promener dans
les jardins de Claude Monet ou encore en célébrant la fête du feu iranienne par plusieurs sauts
au-dessus d’un petit feu préparé pour l’occasion dans la cours du bâtiment de l’association.
Cependant, cette intégration du corps et du mouvement physique aux activités reste ponctuel et
ne m’a pas semblé être toujours mis à profit dans les ateliers. De fait, les enfants participant aux
AMP des mardis et vendredis arrivent souvent à l’Atelier fatigués ou énervés après toute une
journée à l’école et montrent clairement des signes d’agitation au début de la séance : ils
courent, sautent, se laissent tomber et parfois même crient, cherchant certainement à extérioriser
l’énergie emmagasinée à rester dans un état de concentration et d’attention quasi constant en
classe. Une fois les activités commencées, ils montrent parfois des difficultés à tenir en place,
alternant la position assise en tailleur à couchés sur le ventre ou sur le dos, ou se retournant
fréquemment pour changer de position. L’une des seules séances où ce type de comportement
n’a pas été noté en début d’atelier fut quand Alexis, l’animateur des ateliers théâtre, a assuré la
première demi-heure de l’AMP en question par des petits jeux où les enfants devaient se tenir
debout et exécuter des gestes à vitesse variable, ou encore courir pour échapper aux coups d’une
épée imaginaire. Les participants à cet atelier ont même exprimé leur déception de voir partir
Alexis avant la fin de la séance, regrettant de ne pas pouvoir faire plus d’activités de ce type.
J’ai alors remarqué que les postures que pouvaient adopter les enfants lors des activités ne
semblaient pas prises en compte dans l’organisation des AMP : sur les trois mois observés, la
majorité des créations plastiques ont été réalisées alors que les enfants travaillaient assis ou
couchés au sol, et moins de cinq séances ont montré les enfants installés sur des chaises, à une
table adaptée à leur taille. Abordant la question du mouvement dans la description de son travail
à l’Atelier du Coteau, Mehregan explique les activités liées aux comptines en langue étrangère
ainsi : « […] au début on reste assis pour apprendre la chanson mais au fur et à mesure on essaye
de … de danser ou peut-être je ne sais pas de faire … un mouvement avec ces chansons-là »
(voir entretien en annexe 8.2). Il apparait alors que la position assise, statique, correspond à la
phase d’apprentissage de la comptine et que l’intégration des mouvements du corps renvoie à
une deuxième phase que nous pourrions comprendre comme ne relevant pas du processus cité
précédemment. Ces mots pourraient traduire une certaine confusion entre une posture
d’apprentissage qui ressemble à la posture adoptée par les enfants en milieu scolaire et une
89
posture active où ils sont invités à bouger, à se mettre en mouvement pour que commence la
partie ludique propre des pratiques artistiques. Nous retrouvons alors à nouveau un signe
implicite de séparation des arts et de l’éveil aux langues et aux cultures dans les AMP qui cette
fois-ci n’est pas qu’une contradiction ou tout du moins d’un décalage entre ce qui promu par
Elisa et Xavier à l’échelle de l’association et ce qui est réalisé avec les enfants dans les ateliers.
Il s’agit aussi d’un enjeu didactique, la DLC et la recherche sur les situations d’EA
approfondissant de plus en plus la question de la place du corps dans les apprentissages
(Margolis, 2015 ; Corder-Meagher, 2015 ; Aden citée par Puozzo Capron et Perrin, 2014 ;
Dubrac, 2014 ; Mallet, 2013 ; Masmoudi et al., 2010 ; Dörnyei, 2009 ; McNeil, 2009 ; …).
Penchons-nous donc à présent sur les autres données recueillies dans les AMP et leur analyse
relevant plus particulièrement du domaine de la DLC.
II.2. Analyse des données recueillies sur les ateliers multi-activités
plurilingues au regard de la didactique des langues et des cultures
Ayant déjà apporté des éléments de description du déroulement des AMP, des types
d’activités réalisées, de l’occupation de l’espace et des inputs en langues et cultures étrangères
dans parties ou chapitres précédents, nous nous proposons ici de nous arrêter sur quelques
points importants des ateliers de Mehregan relevant du domaine de la DLC et susceptibles
d’influencer la conception de mon dispositif.
II.2.a. Eveil ou apprentissage ?
Interrogée lors de l’entretien sur la distinction qu’elle fait entre les notions d’éveil et
d’apprentissage, Mehregan répond ainsi :
« Bon l'apprentissage c'est comme les ateliers ...vivants... De langues vivantes, tu vois.
On est là pour apprendre une langue, on est concentré pour apprendre [à] bien parler
une langue, apprendre la grammaire, le vocabulaire... […] Mais un éveil … c'est plutôt
pour faire réveiller quelque chose […] Pour montrer aux enfants que … y a pas que la
France, y a pas que cette langue, y a d'autres langues, y a d'autres cultures, y a d'autres
accents, y a les gens qui habitent dans les autres pays […]. L’éveil aux langues c'est un
petit peu mettre l'enfant en face de, d'autres cultures et d'autres langues, pour moi. […]
ils ne sont pas obligés quand ils sortent des ateliers, ils ne sont pas obligés de savoir
parler, machin, mais, au moins dans leurs têtes, ils savent que, là, ça existe des choses,
de, telles choses […] dans les autres pays, y a des cultures différentes ... voilà. […]
vraiment pour des ateliers apprentissage de langues, c’est autre chose. C’est pas où on
90
est là» (voir annexe 8.2).
Les deux concepts semblent alors considérés de manière quasi indépendante : l’apprentissage
consiste à apprendre à parler une langue en maîtrisant sa grammaire et son vocabulaire, alors
que l’éveil relève de domaine de la prise de conscience, pour les enfants, de l’existence de
l’Autre et de l’Ailleurs. L’idée est qu’ « ils se laissent porter » par les langues, qu’ils soient
bercé dans un environnement où elles sont présentes, sans qu’ils aient une obligation d’en
retenir quoi que ce soit. Ainsi, lorsque Mehregan fait découvrir une comptine aux enfants en
anglais ou en persan, elle cherche à ce qu’ils comprennent le sens général de l’histoire racontée
par les paroles et n’insiste pas sur les items langagiers de façon isolée. Les vidéo-clips animés
sur les comptines est un outil intéressant dans le sens où il apporte du sens par l’image, et
certains enfants sont alors capables de comprendre l’histoire racontée avant toute explication
par Mehregan, comme ce fut le cas pour Alix qui a été capable d’expliquer la comptine « 1, 2,
3, 4, 5, once I caught a fish alive » aux autres membres de son groupe dès la fin du premier
visionnage du vidéo-clip (voir journal de bord en annexe 6). A ce visionnage s’ajoute alors
l’intégration de mimes par Mehregan qui viennent compléter ou renforcer la compréhension de
la comptine abordée. Ces activités peuvent cependant donner lieu à des acquisitions de
vocabulaire par les enfants, surtout lorsque celui-ci est mobilisé régulièrement séance après
séances : les couleurs, les chiffres, et les animaux sont des familles lexicales dans lesquelles
tous les enfants des AMP semblent avoir acquis certains mots en anglais et/ou persan. En effet,
d’une semaine sur l’autre, ils se sont montrés capables de se remémorer certains items lorsque
Mehregan leur posait des questions sans avoir fait d’activité de révision de ce vocabulaire au
préalable.
Néanmoins, certaines activités proposées par Mehregan ont parfois mis à jour une
certaine contradiction entre la démarche d’éveil et la volonté des susciter l’apprentissage. J’ai
pu assister par exemple à une séance de 18h à 19h un mardi en début de stage avec un enfant
ayant déjà effectué la séance précédente pendant laquelle Mehregan a semblé chercher à ce
qu’il retienne six mots anglais commençant par la lettre A en recourant à une comptine sur
l’alphabet. Sur une heure, l’enfant a visionné la comptine une première fois, puis une deuxième
pendant laquelle il devait dessiner sur une feuille une représentation de chaque mot
commençant présenté à l’écran. A la fin de chaque dessin, l’animatrice lui demandait alors
« How do we say [mot en français désignant le dessin réalisé] in English ? » afin qu’il répète le
vocabulaire. Dès ce moment, l’enfant a commencé à montrer des signes de fatigue et d’ennui :
il soupirait, alternait entre une position assise et allongée et bien qu’il répétait chaque mot à la
suite de Mehregan, il n’était pas en mesure de les mémoriser, répondant à chaque question un
91
« Je sais plus » (voir journal de bord en annexe 6). La suite de la séance s’est composée de
diverses activités autour de ces six mêmes mots (jeu de mimes, pictionary, prononciation d’un
mot auquel il devait associer un des dessins réalisés, répétition à l’oral de ces mots en ronde
avec l’animatrice et moi-même), et ce jusqu’à 19h. Il m’est apparu que, contrairement au
discours assuré sur le principe de l’éveil, Mehregan semblait chercher, pendant cette séance, à
ce que l’enfant soit vraiment dans une posture d’apprentissage où l’acquisition des six mots
était l’objectif de l’heure. Il semble donc y avoir une certaine confusion ponctuelle entre les
deux notions dans les faits qui en réalité illustrerait la complémentarité de l’éveil et de
l’apprentissage : même si le deuxième n’est pas obligatoire, dans des situations d’éveil l’enfant
se retrouve malgré tout dans une posture d’apprentissage qui ne peut pas être laissée de côté ni,
au contraire, forcée.
II.2.b. Un éveil aux langues et aux cultures non loin de l’Eveil aux Langues comme approche
institutionnelle
Rappelons ici deux des objectifs d’apprentissage définis dans le premier chapitre de ce
mémoire :
- Faire prendre conscience à l’enfant de l’existence de langues et cultures différentes à
travers un éveil à l’anglais et au persan ;
- Le sensibiliser aux différents accents que peut revêtir sa propre langue maternelle grâce
à une animatrice allophone
Le premier objectif est ici plutôt générique quant à la direction donnée par le CARAP pour
l’Eveil aux Langues, bien que nous puissions reprocher à ces ateliers plurilingues de ne
proposer un éveil qu’à deux langues dont l’anglais qui ne fait pas partie des langues que l’Ecole
n’a pas la vocation d’enseigner (Candelier, 2007). Cela dit, Mehregan a implicitement
conscience de cette particularité des préconisations du Conseil de l’Europe car elle accorde
beaucoup d’importance au fait d’éveiller les enfants à une autre langue que l’anglais et qui de
surcroît n’est pas enseignée et n’a pas la vocation d’être enseignée dans les établissements
scolaires français : le persan. Dans notre entretien (voir annexe 8.2), elle explique comprendre
l’engouement pour l’apprentissage de l’anglais qu’elle a elle-même appris très jeune pour
pouvoir l’enseigner dès ces 16 ans, mais elle pense que cette langue est source de pression de
la société, de l’Ecole et des parents alors même qu’elle fait déjà partie de l’environnement des
enfants. A l’école, à la télévision, à la radio, l’anglais est « une langue très connue » alors que
le persan ne l’est presque pas, pour ne pas dire pas du tout. Faire en sorte que les enfants puissent
se laisser bercer par une langue comme le persan et connaître des éléments de la culture
92
iranienne est quelque chose que l’animatrice des AMP définit clairement comme un objectif de
son travail auprès des enfants. Ayant déjà abordé cette question avec ma tutrice au début de
mon stage, j’ai pu remarquer les effets du « paradoxe de l’observateur » tel que défini par Labov
(1973, cité par Gadet, 2003) dans l’utilisation de l’anglais et du persan lors de la réalisation de
créations plastiques avec les enfants dans les AMP. Dès ma première observation de séance sur
grille dans un coin de la pièce, Mehregan est passée du recours à quelques mots d’anglais et de
rares termes en persan à l’utilisation de phrases ou de petits discours en anglais et d’un ensemble
de termes en persan venant enrichir le vocabulaire plurilingue des enfants dans les ateliers. Sur
mes trois mois de stage, j’ai pu observer une égalisation relative des input en anglais et des
input en persan que les enfants ont, pour bon nombre d’entre eux, confirmée en se montrant à
chaque séance en possession de termes anglais et persan pour chaque couleur, ou pour plusieurs
chiffres. Utilisant les deux langues à chacune des séances, bien que sans schéma préparé
concernant la manière de passer d’une langue à l’autre, Mehregan conserve ainsi une démarche
de décloisonnement entre toutes les disciplines invoquées dans les AMP, artistiques comme
langagières.
Le deuxième objectif d’apprentissage relevant de l’éveil à différents accents de la langue
maternelle de l’enfant n’est pas à proprement parler un élément officialisé par l’Eveil aux
Langues, mais il nous parait tout de même pertinent dans ce contexte. Les enfants participant
aux AMP ayant, nous l’aborderons plus loin, peu voire pas de contact avec des personnes
originaires de pays étrangers et/ou allophones dans leur environnement proche, Mehregan
adopte ce rôle pour eux de locuteur du français dans ses variétés d’accent voire d’usage. En
effet, elle ne se cache pas du fait de se tromper parfois dans son utilisation de la grammaire ou
de la prononciation lorsqu’elle parle français avec eux, ce qui pourrait s’avérer être, selon nous,
une ouverture vers moins de complexes chez les enfants au moment de parler une langue
étrangère, relativisant alors la peur de se tromper dont Mehregan souffre la première au moment
de s’adresser aux parents (voir entretien en annexe 8.2).
II.2.c. Projet d’exposition et contraintes d’organisation
Le projet d’exposition mené dans les AMP et valorisé à l’échelle de l’Atelier du Coteau
est une véritable illustration des possibilités d’adéquation des pratiques artistiques et de l’éveil
aux langues et aux cultures dans le cadre d’une approche actionnelle. Néanmoins, j’ai pu
ressentir beaucoup de stress de la part de Mehregan qui s’apprête alors à dévoiler publiquement
les travaux réalisés avec les enfants, stress qui je ne peux négliger dans la préparation de mon
dispositif. Dès ma première semaine de stage, ma tutrice m’a confié lors d’une conversation
93
informelle après un AMP qu’elle manquait de temps pour pouvoir réaliser tout ce qu’elle
souhaitait réaliser avec les enfants pour l’exposition. Elle aimerait augmenter la durée des
ateliers d’un quart d’heure à une demi-heure car selon elle, le temps passé sur les comptines en
langue étrangère empiète sur les activités propres aux arts plastiques qu’elle considère comme
centrales dans ses ateliers. A une semaine de la mise en place effective de mon dispositif auprès
de chaque groupe d’enfants, Mehregan me demande en fin d’entretien (voir annexe 8.2) si je
ne peux pas réserver mes interventions aux groupes des mardis et vendredis, car les effectifs de
l’AMP du mercredi sont importants et réalisent les créations plastiques moins vite, ce qui
accentue sa sensation de retard dans la préparation de l’exposition6. La question du temps pose
alors un véritable problème d’un point du vue plus large : l’accent doit être porté sur la
réalisation des créations plastiques en dépit des autres activités donnant son caractère
pluridisciplinaire aux AMP, caractère auquel les parents ont souscrit en début de saison pour
leur(s) enfant(s), certains d’entre eux ayant déjà revendiqué auprès de Mehregan de réelles
attentes concernant la réalisation d’activités chantées. Il y a là un enjeu à entrevoir dans
l’optimisation du temps des AMP entre chaque discipline artistique que mon dispositif se devra
de chercher à concilier.
Une autre difficulté apportée par l’organisation de cette exposition est celle de la
question de la valorisation de la dimension d’éveil aux langues et aux cultures des AMP dans
l’exposition, alors même que cette dimension reste peu intégrée aux activités de créations
plastiques sur lesquelles Mehregan doit donc se concentrer. A mon arrivée à l’Atelier du
Coteau, il était question de faire des cartels de présentation des œuvres des enfants en français
et en anglais, et d’utiliser les comptines mimées et/ou dansées sous forme de happening le jour
du vernissage. Cette dernière idée m’a alors semblée particulièrement intéressante car elle
valorisait la dimension vivante de l’éveil aux langues et aux cultures dans les AMP, mais
comporte aussi l’inconvénient de n’exister que le jour du vernissage, laissant le caractère
linguistique et culturel des ateliers mis de côté pendant la durée de l’exposition. Cela confirme
notre diagnostic initial de séparation de fait entre pratiques artistiques et éveil aux langues et
aux cultures que auquel notre dispositif devra chercher d’éventuelles solutions, permettant peut-
être d’optimiser le temps entre chaque activité dans les AMP également.
6 Cette demande sera abordée à nouveau et dans son intégralité dans le chapitre IV.
94
II.2.d. Des enfants des ateliers multi-activités plurilingues aux apprenants en éveil de la
didactique des langues et des cultures
Depuis le début de ce mémoire nous avons toujours qualifié les participants aux AMP
d’enfants, et non d’apprenants comme l’exigerait l’étude d’un contexte d’EA des langues et des
cultures. Cela vient de caractère duel de ces participants qui sont sans nul doute des enfants,
mais qui sont aussi des apprenants sans l’être entièrement car les objectifs visés avec eux ne
sont pas des objectifs d’apprentissage mais des objectifs d’éveil. Mais il y a aussi le poids du
contexte d’un centre de loisirs artistiques qui ne peut se revendiquer d’avoir des apprenants,
mais bien des enfants qui viennent pour avant tout pour se divertir par l’expérience artistique.
Enfin, la définition de profils d’apprenants nécessaire à toute démarche didactique ne pourrait
se réaliser que s’il y avait véritablement des informations rassemblées sur chacun des enfants,
au moins concernant ses relations avec les langues et les cultures étrangères pour pouvoir les
utiliser comme support de construction des AMP.
L’Atelier du Coteau et surtout Mehregan en tant qu’animatrice de ces ateliers se
placeraient alors dans la recherche de la reconnaissance et de la valorisation du bagage initial
des enfants, générant ainsi des émotions positives favorisant leur bien-être dans ce contexte et
l’enrichissement apporté par l’éveil aux langues et aux cultures pour de futures rencontres des
enfants avec l’Autre et l’Ailleurs. De plus, cela viendrait mettre à profit les éventuels
apprentissages en visant la « zone proximale de développement » des enfants-apprenants
(Robbes, 2009). Or, si Mehregan a bien mentionné qu’elle souhaitait apprendre à connaître les
enfants participant à ses ateliers, et ce, depuis son stage de fin d’étude (voir entretien en annexe
8.2), cette connaissance n’est attestée que par son contact hebdomadaire avec eux et non par
une démarche attestée de recherche d’informations auprès des enfants voire même de leurs
parents. Cette démarche pourrait pourtant lui donner des pistes dans la préparation des AMP ou
encore dans la définition d’objectifs qu’elle pourrait chercher à atteindre avec eux. Ce constat
m’a donc amené à réaliser la biographie langagière des enfants dont nous verrons les détails
dans la troisième partie de ce chapitre.
II.3. Emotions et rapport aux langues et aux cultures dans le travail de
Mehregan
Afin d’aller au-delà de l’explication du fonctionnement des AMP, mon entretien avec
Mehregan me donne l’occasion d’aborder plus précisément la question de ses propres émotions
concernant son travail d’animatrice, puis celle de son rapport personnel aux langues et aux
95
cultures. Il s’agissait alors de déterminer pourquoi, par exemple, elle ne recourt qu’à l’anglais
et au persan avec les enfants, ou bien encore quel est son potentiel linguistique et culturel global
sur lequel elle pourrait s’appuyer pour enrichir la dimension d’éveil aux langues et aux cultures
des AMP.
II.3.a. Le ressenti en tant qu’artiste animatrice des ateliers multi-activités plurilingues
Mehregan porte un regard très positif sur son travail et le déroulement des AMP :
interrogée sur ce qu’elle aime dans son métier, elle répond qu’elle est « hyper contente » et se
sent « heureuse » au quotidien car elle aime travailler avec les enfants. A deux reprises dans
l’entretien, elle insiste sur ce fait qu’elle explique par l’imagination (voir annexe 8.2) ; de fait,
pour elle, les enfants avec lesquels elle travaille montrent beaucoup d’imagination, ce qui
représente une source d’inspiration permanente pour son propre parcours d’artiste plasticienne.
Les voir s’impliquer dans les activités est un autre gage de satisfaction pour Mehregan qui
considère qu’à cet âge, les enfants sont francs et n’hésitent pas à s’exprimer lorsque quelque
chose ne leur plait pas ; puisque ceux des AMP sont très investis à ses yeux, la question ne se
pose donc plus..
Parallèlement, lorsque je lui demande quelles sont les difficultés ou les obstacles
auxquels elle a déjà été confrontée dans l’animation des AMP, il semble très difficile pour elle
de trouver de la matière à me fournir. Elle réfléchit longuement, me demande d’attendre et finit
par me dire qu’elle ne voit vraiment pas, ou bien qu’il s’agit de choses vraiment minimes par
rapport au plaisir qu’elle prend à faire ce métier. Elle mentionne le fait qu’il n’est pas facile
d’avancer au même rythme avec le groupe du mercredi qu’avec les autres groupes parce que le
premier comporte plus d’effectifs, mais elle semble plus rapprocher cette difficulté de la durée
restreinte des ateliers que de la taille ou de la disparité d’âge du groupe en question. La seule
difficulté reconnue comme telle est avec une enfant participant aux ateliers d’arts plastiques des
jeudis, ateliers qui n’entrent pas dans ce mémoire comme objet d’étude.
Ce ressenti plus que positif est compréhensif bien qu’étonnant pour moi car il est très
peu extériorisé justement auprès des enfants dans les AMP : observant les ateliers, je m’étais
rendue compte que Mehregan avait très peu de variations de ton dans ses animations. Sa voix
apparait comme monotone (au sens original de « ton unique »), les consignes, les questions et
les exclamations (aussi peu nombreuses que puissent être ces dernières) ne présentent que très
peu de différences d’intention à l’oral, alors que ses discours envers les travaux réalisés par les
enfants sont souvent très positifs (voir journal de bord et grilles d’observation en annexes 6 et
7). Les émotions, élément éminemment individuel (Puozzo Capron, 2014 ; Brewer, 2013 ;
96
Dörnyei, 2009 ; McNeil, 2009 ; Lightbown &Spada, 2006 ; Perraudeau, 2006 ; Dörnyei et
Skehan, 2005) ne sont vécues ou perçues de la même manière d’une personne à une autre et,
dans ce cas, d’observateur à observé. La difficulté tient dans le fait de ne jamais pouvoir les
interpréter réellement, justement à cause de leur caractère subjectif, mais aussi parce que, dans
ce contexte précis, Mehregan mène les ateliers dans une autre langue que sa langue maternelle,
ce qui peut être une difficulté au moment d’exprimer ou d’extérioriser des émotions qui, de
plus, peuvent ne pas s’extérioriser et s’exprimer selon les mêmes codes dans la culture d’origine
de ma tutrice.
II.3.b. Rapport aux langues et aux cultures de Mehregan : vers la définition d’une biographie
langagière
La relation de chacun avec les langues et les cultures est unique et a un impact sur la
manière dont nous allons évoluer avec celles-ci, car à travers cette relation nous construisons
des représentations de notre monde, de notre réalité à un moment donné (Piccardo, 2013 ;
Goutéraux, 2010 ; Perregaux, 2009). Dans le cadre de ma recherche, il m’a paru intéressant de
chercher à définir ce qui caractérisait le lien que Mehregan entretenait avec les langues et les
cultures, dans les limites que cette démarche suppose, à savoir qu’il serait bien ambitieux de
prétendre analyser et définir ce type de rapport dont les dimension personnelles et émotionnelles
sont fortes et appartiennent à chacun. Néanmoins, l’entretien en a révélé quelques pistes qui
peuvent nous permettre de mieux comprendre comment ma tutrice aborde la dimension d’éveil
linguistique et culturel avec les enfants dans les AMP en élaborant une ébauche de biographie
langagière.
Tout d’abord, nous savons que Mehregan a commencé à enseigner les langues dès son
adolescence (vers 15 ans – voir entretien en annexe 8.2), et ce dans le contexte d’organisations
non-gouvernementales venant en aide aux personnes défavorisées résidentes en Iran ou encore
aux réfugiés afghans. Il a alors été question d’enseigner l’anglais et le persan à des personnes
dans le besoin et dont la rencontre a dû supposer un impact émotionnel fort, Mehregan mettant
notamment en place des ateliers d’art-thérapie afin que ceux-ci puissent s’exprimer sur des
parcours eux-mêmes chargés d’émotions.
Avant cette expérience, à 12 ans, elle a eu l’occasion de voyager en tant que touriste
avec sa mère en Turquie et dans plusieurs pays d’Europe, ce qui a été la source d’un certain
choc à la rencontre de l’Autre et de l’Ailleurs qui lui paraissaient alors très différents de ce
qu’elle connaissait jusqu’alors. Mehregan explique cette réaction par le fait qu’à 12 ans, au
début de l’adolescence, elle commençait tout juste à prendre conscience du monde qui
97
l’entourait en dehors de l’Iran, mais que cette conscience était encore trop restreinte pour
appréhender les différences culturelles qui allaient se présenter à elle à l’étranger. C’est pour
cette raison que son deuxième départ pour l’étranger à 23 ans n’a pas revêtu les mêmes enjeux :
elle avait déjà une idée de ce à quoi s’attendre en ayant développé plus de connaissances sur le
monde, et surtout en retournant dans des pays qui ne relevait plus du non-familier puisqu’elle
y était déjà allée une fois auparavant.
Arrivée à Paris en 2010, sa relation aux langues et aux cultures prend un nouveau
tournant : ne parlant pas du tout français, elle doit apprendre cette nouvelle langue pour pouvoir
faire ses études à l’université et construire sa vie dans ce pays dont la toute première rencontre
à 12 ans a été marquée par beaucoup de surprises dont la valence est apparue plutôt comme
négative par l’expérience d’un véritable choc entre sa culture iranienne et la française. De plus,
cette installation en France ne semble pas avoir été un véritable choix : « […] je voulais jamais
venir en France tu vois avant. Je me suis vraiment retrouvée dans une situation merdique tu
vois : ‘‘Putain, je dois apprendre une langue que j’aime pas du tout… euh, j’suis obligée,
merde’’ tu vois » (voir annexe 8.2). Elle a donc suivi des cours de « la langue et la civilisation
française à la Sorbonne » tout en réalisant ses études d’art contemporain et en travaillant comme
agent de surveillance au musée du Quai Branly.
Finalement, Mehregan construit désormais sa vie à Nantes, parlant une langue qu’elle a
appris à apprécier par le quotidien, mais aussi en réalisant que cette langue lui avait permis de
réaliser ses études, trouver du travail et rencontrer son compagnon avec qui elle a créé la
compagnie Krapo Roy qui regroupe le théâtre et les arts plastiques et grâce à laquelle elle
travaille aujourd’hui à l’Atelier du Coteau. Malgré toutes ces évolutions, elle considère toujours
le français comme « difficile » et son rapport avec cette langue reste parfois compliqué car au
moment de s’adresser aux parents des enfants qui viennent à ses ateliers, elle avoue avoir peur
de se tromper lorsqu’elle échange avec eux et s’en veut à elle-même de ne pas réussir à
s’exprimer sans faire de « fautes de langue ». Le contact avec des personnes non familières
génère du stress en elle qui perturbe son utilisation de la langue et son aisance de
communication, alors qu’avec les enfants des AMP elle n’expérimente pas ce problème.
Le rapport aux langues et aux cultures étrangères de Mehregan est donc passé de
l’expérience du choc des cultures à l’enseignement de l’anglais et du persan auprès de personnes
pour qui ces langues étaient indispensables pour faciliter leur (re)construction personnelle,
inscrivant ce rapport dans le domaine des émotions plutôt négatives. En grandissant, les
voyages sont devenus enrichissants et sources d’émotions positives, alors que son installation
en France l’a fait vivre, bien que de manière différente, ce qu’en quelque sorte avaient vécu les
98
réfugiés afghans auprès de qui elle avait travaillé à l’adolescence, cherchant à tirer le meilleur
pour elle d’une langue et d’un pays dans lequel elle construit aujourd’hui sa vie.
II.3.c. Biographie langagière de Mehregan et perspectives de compréhension et d’évolution des
ateliers multi-activités plurilingues
Complétant les éléments abordés précédemment, la biographie langagière de Mehregan
réalisée lors de notre entretien peut se synthétiser sous la forme du tableau suivant :
Langues
parlées
Langue en
cours
d’apprentissage
Langues
pouvant être
comprises
mais non
parlées
Langues
que
Mehregan
aimerait
apprendre
Pays
visités
Contacts
dans des
pays
étrangers
Langues
étrangères
utilisées
dans les
AMP
Persan
Anglais
Français
Espagnol (« un
petit peu »)
Espagnol (cours
débutants au
Centre Culturel
Franco-
Espagnol de
Nantes)
Français (vie
quotidienne)
Portugais
Arabe
Turc
Portugais
Italien
Turquie
Pays-Bas
Allemagne
Italie
Danemark
Belgique
Sicile
Tante à
Copenhague
De la
famille en
Allemagne
Anglais
Persan
Quelques
mots
d’espagnol
pendant la
durée de mon
stage
Figure 3 : Tableau récapitulatif de la biographie langagière de Mehregan
Il est bien sûr question ici d’une biographie sélective, dans le sens où elle n’est pas aussi
complète que certains modèles de biographie langagière proposés par le Conseil de l’Europe,
mais cette sélection d’éléments répond d’une volonté d’adaptation de cet exercice au contexte
de ma recherche mais aussi au temps qui m’était accordé pour en recueillir et analyser les
données. La même démarche a été effectuée pour la réalisation des biographies langagières des
enfants dont nous parlerons dans la partie suivante. Cet outil de recueil de données a été
construit au regard de divers documents officiels fournis sur le site du Portfolio Européen des
Langues (Conseil de l’Europe, 2014, 2011 ; Little & Simpson, 2011 ; Conseil de l’Europe, n.d.-
a, n.d.-b).
Abordant les langues qu’elle parle, Mehregan cite l’espagnol en ajoutant « mais j’ose
pas trop » (voir entretien en annexe 8.2). Elle dit savoir le lire et réussir à le comprendre au
moins partiellement mais son statut d’apprenante débutante dans cette langue est un frein selon
99
elle. C’est la raison pour laquelle elle ne l’intègre pas dans son travail dans les AMP : « Je
connais pas la langue assez bien pour pouvoir me permettre… faire apprendre aux enfants »,
contrairement au persan qui est sa langue maternelle et à l’anglais dont elle se rappelle
seulement l’avoir appris dans des écoles privées en Iran. Si elle ne pense pas maîtriser
suffisamment une langue, elle ne peut pas envisager l’utiliser avec les enfants, à l’inverse
d’Hélène qui recourt parfois à cette démarche. D’ailleurs Mehregan n’hésite pas à se positionner
en opposition dans sa manière de travailler : « Mais moi j’y arrive pas. […] j’arrive pas parce
que je me permets pas. […] je préjuge pas du tout mais moi je préfère avoir assez de
connaissances pour, tu vois, pour pouvoir faire… Pour me sentir bien ou pour pouvoir faire
apprendre des choses aux enfants, je me sens mieux comme ça ». La connaissance approfondie
des langues qui, dans le cas de Mehregan avec le persan, l’anglais et le français, prend la
dimension d’une maîtrise très avancée, représente un cadre rassurant compréhensible, d’autant
plus qu’elle se sent parfois encore en difficulté avec le français quand elle discute avec certaines
personnes, et que ces difficultés se ressentent selon elle sur son apprentissage de l’espagnol.
Lorsqu’il s’agit d’aborder des règles de grammaire similaires dans les deux langues mais qu’elle
ne maîtrise pas déjà en français, cela lui fait vouloir perfectionner ses compétences en français
avant de chercher à se former dans d’autres langues.
Cependant, si ce fonctionnement est compréhensible, il est aussi contradictoire avec la
logique d’éveil aux langues et aux cultures qu’elle mène dans les AMP. En effet, elle considère
que les apprentissages ne sont en rien des objectifs avec les enfants, souhaitant simplement
qu’ils découvrent des langues et des cultures étrangères et se laissent porter par celles-ci, ce qui,
à l’avenir, pourrait porter ses fruits pour faciliter leurs expériences d’apprenants de langues
(Billiez, 2002). De plus, son accent et son utilisation du français qu’elle perçoit comme une
richesse apportée aux enfants sur leur langue maternelle peut aussi les aider à ne pas se sentir
gênés ou complexés au moment de s’exprimer dans une langue étrangère (voir infra, même
chapitre, partie II.2.b.). Or, elle se sent elle-même complexée d’employer une langue qu’elle ne
maîtrise pas forcément. L’espagnol, en tant que langue qu’elle apprend actuellement, peut être
une possibilité de développement du caractère plurilingue des AMP sans pour autant représenter
une grande prise de risque pour Mehregan qui, dans le cadre de sa démarche d’éveil, n’a pas la
responsabilité de l’enseigner aux enfants mais simplement de leur faire découvrir. La
conception de mon dispositif pourra chercher à prendre en compte cet élément dans le but de
conforter Mehregan dans son utilisation de l’espagnol, possibilité à laquelle elle ne se montre
pas fermée sur plus long terme (voir annexe 8.2).
100
La suite des données de la biographie langagière apporte d’autres possibilités de
développement de la dimension plurilingue des AMP grâce aux langues que Mehregan
comprend bien qu’elle ne les parle pas : le portugais cumule l’avantage d’être une langue
qu’elle arrive à comprendre et qu’elle souhaiterait apprendre si elle le pouvait car, en
association avec l’espagnol, cela lui ouvrirait des opportunités de s’intéresser plus
particulièrement à l’Amérique latine. L’arabe et le turc offrent des possibilités de développer
un éveil à des langues que l’Ecole n’a pas vocation d’enseigner tout en offrant des termes
communs avec le persan, ce qui peut se révéler intéressant pour réaliser un éveil avec des
activités de type comparatif pour découvrir les points communs et différences entre ces langues.
Si l’on ajoute à ces langues l’envie d’apprendre l’italien et tout le bagage culturel accumulé ou
accessible à Mehregan grâce aux pays dans lesquels elle a voyagé et aux contacts qu’elle a dans
certaines contrées, cela représente une base de développement de l’éveil aux langues et aux
cultures dans les AMP qui s’appuie sur les compétences et les envies de l’animatrice, pouvant
alors être source de motivation et donc d’émotions positives tant pour Mehregan que pour les
enfants.
II.4. Bilan de ces analyses au regard du projet de recherche
Si l’on reprend les éléments traités dans cette deuxième partie de chapitre, nous pouvons
déjà affirmer que notre première hypothèse concernant le CARAP comme outil adapté au
développement des AMP est partiellement confirmée car nous en avons rempli le premier
critère : le fonctionnement actuel des ateliers de Mehregan suivent certains axes et conceptions
de l’Eveil aux Langues, même si cela reste pour le moment encore implicite. Il nous faudra finir
de valider cette hypothèse par la mise en place de notre dispositif en s’appuyant nous-même sur
ce cadre pour le concevoir. Nos deux autres hypothèses, bien que pas encore validées, sont
confirmées comme des formulations d’hypothèses valides car nous avons justifié à nouveau
dans cette partie le besoin d’aller interroger les enfants et leurs parents pour accompagner les
perspectives d’évolution des AMP à partir de la définition de biographies langagières des
enfants et de la prise en compte des attentes et des suggestions de leurs parents.
Enfin, notre dispositif se devra d’être conçu selon un véritable décloisonnement tant
artistique que linguistique et culturel, offrant de découvrir des langues que les enfants n’ont
sans doute pas encore eu l’occasion d’entendre dans les AMP mais qui pourront être familières
pour Mehregan comme l’espagnol ou l’arabe afin qu’elle puisse trouver un moyen de se les
approprier dans son travail. Toujours dans le but de rendre ce dispositif réutilisable ou
101
réadaptable par Mehregan, il devra présenter comme discipline artistique centrale les arts
plastiques, sans pour autant que celle-ci apparaisse comme dominante dans les activités. Le fait
de conserver les arts plastiques comme discipline centrale offrira la possibilité de faire créer
aux enfants des œuvres supplémentaires à exposer à partir du 28 mai qui sauront rendre compte
de la dimension d’éveil aux langues et aux cultures des AMP tout au long du mois d’exposition.
Ainsi, il présentera une possibilité d’optimisation du temps passé avec les enfants par une
association plus franche des pratiques artistiques et de la découverte linguistique et culturelle
afin que les deux domaines n’empiètent plus l’un sur l’autre mais se complètent et s’enrichissent
de leur contact. Le dispositif devra chercher à conserver l’accent porté sur le développement de
l’imagination des enfants comme objectif d’apprentissage, et valoriser le travail autour de la
parole et du corps, le premier pour favoriser l’expression des émotions des enfants et le
deuxième pour mieux répondre aux besoins d’extériorisation physique de l’énergie et de la
fatigue accumulées pendant la journée d’école. Enfin, je devrai travailler à la réalisation d’un
dispositif d’éveil aux langues et aux cultures qui puisse être une source d’apprentissages
linguistiques et culturels pour les enfants, sans que cela soit pour autant un objectif nécessitant
des résultats concrets : cette ouverture de l’éveil vers de possibles apprentissages permettra sans
doute d’apporter aux enfants les plus demandeurs des éléments qu’ils pourront s’approprier
sans pour autant qu’il s’agisse d’un dispositif d’EA de langues et de cultures.
Quelques données nous manquent encore pour pouvoir proposer à l’Atelier du Coteau,
aux AMP et à leurs acteurs un dispositif adapté qui valorise les émotions positives de tous au
profit d’un épanouissement individuel et collectif. Il s’agit de mieux connaître les enfants qui
sont les premiers bénéficiaires des ateliers ainsi que les attentes de leurs parents afin de se placer
dans une démarche holiste cherchant aussi à satisfaire ceux qui représentent une source de
financements et donc de survie de l’association et de ses activités. Voyons alors dans la dernière
partie de ce chapitre ce que ces deux groupes nous apportent comme informations nécessaires
à la recherche d’un dispositif efficient pour les plus jeunes et prenant en compte les suggestions
des plus grands.
102
Partie III. Recueil de données auprès des enfants et de
leurs parents : biographies langagières et enquête de
satisfaction
Afin de proposer la mise en place d’un dispositif alliant pratiques artistiques et éveil aux
langues et aux cultures qui soit adapté au public concerné, le recueil de données auprès des
enfants était dans tous les cas incontournable. J’ai pris la décision de chercher à établir la
biographie langagière de chacun des participants des AMP afin, d’une part, de constituer un
dossier de données sur le rapport des enfants aux langues et aux cultures qui me servirait à
mieux les connaitre et à intégrer, dans mon dispositif, des choix éclairés en fonction de l’analyse
de ces biographies. Et d’autre part, je pourrai ensuite transmettre ce dossier à Mehregan pour
qu’elle puisse éventuellement s’appuyer sur les données collectées pour construire ses propres
ateliers. L’objectif principal était de repérer si les enfants pouvaient avoir un niveau seuil ou
avaient eu accès à un éveil à certaines langues et cultures étrangères en dehors de l’Atelier du
Coteau et s’ils avaient un réel intérêt pour cela, cherchant même, lorsque c’était le cas, à déceler
les langues et/ou les pays que les enfants aimeraient découvrir. Afin d’établir ces biographies
langagières, j’ai organisé des entretiens avec chacun des enfants des trois groupes d’AMP. Etant
donné leur âge et le fait que ces entretiens devaient être réalisés sur le temps des ateliers, ces
derniers ont été pensés pour ne pas dépasser dix minutes. Tous les entretiens ont été réalisés
dans le petit vestiaire mitoyen avec la salle d’atelier, et chaque enfant a été interrogé
individuellement afin de limiter les risques de réponses influencées par un enfant ou un autre.
Le type d’entretien effectué était directif, car cela semblait être le plus adapté au temps qui
m’était alloué avec chacun des enfants, bien que cela impliquait également une standardisation
des questions quand leurs expériences pouvaient être très variées et l’envie de s’exprimer aussi,
ce qui écartait automatiquement la possibilité d’organiser des entretiens semi-directifs ou non-
directifs. Nous ne pouvons prétendre à recueil de données entièrement fiable, d’une part parce
qu’il s’agissait d’un premier entretien pour tous les enfants et que ceux-ci pouvaient parfois se
laisser aller à des divagations fréquentes sur ce qu’ils avaient fait pendant les vacances, à l’école
ou avec leurs parents, rallongeant une durée d’entretien qui les faisait perdre patience ou
m’obligeant à leur rappeler mes questions de manière assez superficielle. Cela a été une limite
très importante de ce recueil de données car il m’a demandé de contraindre les enfants à
répondre à des questions qu’ils ne s’étaient jamais posées auparavant et auxquelles ils pouvaient
ne pas trouver grand intérêt, ne sachant pas toujours quoi répondre. Néanmoins, ils se sont tout
103
de même sentis valorisés dans ma démarche en leur expliquant qu’en répondant à mes
questions, ils allaient m’aider dans mon travail pour l’université, me permettant malgré toutes
les limites citées d’obtenir des données exploitables.
Pour corroborer les dires des enfants qui parfois semblaient se laisser aller à des
inventions7 dans leurs réponses, j’ai décidé de préparer un questionnaire à l’intention de leurs
parents. Ce questionnaire avait un double objectif : me permettre d’enrichir la biographie
langagière des enfants en interrogeant l’intérêt que les parents avaient pour les langues et les
cultures étrangères et avoir une meilleure idée de l’environnement linguistique et culturel dans
lequel grandit l’enfant, mais aussi apporter à l’Atelier du Coteau et à Mehregan une idée quant
à la satisfaction des attentes des parents dans les AMP, ce qui avait d’ailleurs été souligné en
entretien avec Elisa et Xavier (voir annexe 8.1). Le questionnaire mélangeait la forme structurée
avec des réponses à cocher parmi diverses propositions à chaque question et la forme non-
structurée avec des questions ouvertes sans suggestions de réponses. Ce questionnaire avait été
prévu au format papier mais a finalement été distribué par email suite à la suggestion d’Elisa
qui m’a communiqué la liste des coordonnées nécessaires. Il a été envoyé à l’ensemble des
parents ayant un enfant inscrit aux AMP, ce qui représentait 9 questionnaires pour 11 enfants
inscrits, deux familles ayant deux enfants inscrits aux ateliers8. Le changement de mode de
distribution a entraîné une légère inadéquation de la forme du questionnaire qui était préparé
sur un logiciel de traitement de texte alors qu’un système automatisé en ligne aurait été plus
adapté à ce type de distribution. Envoyés le 23 mars, il m’a fallu recontacter les enquêtés à deux
reprises par la suite car tous ne m’avaient pas répondu. A la fin du stage, 7 questionnaires m’ont
été retournés, correspondant alors à 7 enfants inscrits aux AMP. Mise à part la question de la
forme d’envoi d’un questionnaire prévu pour être distribué sur papier, les limites du choix de
ce type de recueil de données est qu’il n’y a pas pu avoir de phase test du questionnaire sur un
échantillon restreint car le nombre de personnes à interroger était déjà très limité. Aucun
entretien n’a pu être réalisé par la suite pour approfondir les réponses données par manque de
temps de mon côté pour tout organiser et analyser, mais aussi par des disponibilités assez
limitées pour les parents qui viennent chercher leurs enfants aux AMP à la sortie de leur travail
à 18h voire 19h, une heure déjà tardive pour proposer ensuite d’effectuer des entretiens.
Malgré tout, j’ai pu établir une biographie langagière de chaque enfant, même si quatre
de ces biographies s’appuient exclusivement sur les données recueillies en entretien avec les
7 L’une des enfants m’a notamment raconté de manière très théâtrale qu’elle était déjà allée au Pôle Nord, ce qui,
d’après ses parents, n’est jamais arrivé (voir les entretiens en annexe 8.3). 8 Les parents comprennent ici le père et la mère en une seule entité.
104
enfants et ne bénéficient pas de complément d’information de la part des parents. Ces
biographies seront traitées dans les lignes suivantes, avant d’aborder l’analyse des réponses des
parents sur leurs attentes envers les AMP, terminant ainsi un état des lieux des préoccupations
de tous les acteurs de l’Atelier du Coteau pouvant influencer la conception de mon dispositif
didactique.
III.1. Portraits d’apprenants en éveil
La réalisation de la biographie langagière des enfants a pour but de compléter les
données déjà mentionnées dans le chapitre I (âge, lieu de résidence, milieu social, …) d’un
portrait en lien avec les langues et les cultures qui me permettent alors de mieux connaître les
enfants. Elle permet aussi d’offrir des données pouvant servir à la préparation de mon dispositif
ainsi qu’à la préparation des AMP par Mehregan, car ces données révèlent au moins en partie
certains centres d’intérêt pouvant être valorisés dans les ateliers pour favoriser la motivation et
les émotions positives des enfants, mais aussi parfois des sujets de tension ou de souvenirs
malheureux qu’il sera important d’éviter ou au contraire d’aborder de manière réfléchie.
Les questions abordées avec chacun des enfants en entretien sont les suivantes :
- Quelles langues parles-tu ?
- Quelle est ta langue maternelle ?
- Est-ce que tu apprends des langues à l’école ? Lesquelles ?
- Quelles langues découvres-tu à l’Atelier du Coteau ?
- Est-ce que tu découvres ou apprends des langues ailleurs qu’à l’école ou à l’Atelier du
Coteau ?
- Quelles langues as-tu déjà entendues (même sans forcément les comprendre) ?
- Quelles langues as-tu déjà vu écrites ?
- Ton papa et ta maman parlent-ils d’autres langues que le français ? Et d’autres
membres de ta famille ?
- Et tes amis ? Certains parlent-ils d’autres langues que le français ?
- Quelles langues aimerais-tu apprendre ?
- Es-tu déjà allé(e) en voyage, en vacances ailleurs qu’en France ? Où ?
- Quels pays aimerais-tu visiter ?
Il est arrivé que je ne pose pas toutes les questions à certains enfants, compromettant certes la
rigueur du recueil de données mais respectant alors l’état de fatigue dans lequel ils pouvaient
être, m’exprimant qu’ils trouvaient l’entretien trop long, sentiment que je ne voulais pas
105
accentuer à quelques semaines à peine de mes premières intervention auprès d’eux dans les
AMP.
Ces questions ont été recoupées et/ou complétées par d’autres interrogations posées
cette fois-ci aux parents dans le questionnaire qu’ils ont reçu. Ils ont alors apporté des précisions
à la biographie langagière de leur enfant en précisant si celui-ci parlait couramment une autre
langue que le français, s’il apprenait des langues étrangères à l’école et/ou dans un autre cadre
que celui de l’Atelier du Coteau. Ils ont également été interrogés sur leur propre rapport aux
langues et aux cultures en spécifiant leur langue maternelle, les langues étrangères qu’ils ont
appris au cours de leur vie, leur éventuelle utilisation de ces langues avec leur enfant et les pays
dans lesquels ils ont voyagé en leur compagnie. Toutes des données ont été synthétisées sous
forme de tableaux regroupant les portraits d’apprenants de chaque enfant en fonction du jour
auxquels ils participent aux AMP, permettant ainsi d’anticiper le facteur groupe qui
conditionnera en partie la conception du dispositif décrit en chapitre IV de ce mémoire.
III.1.a. Marie, Victor et Lucien : portraits d’apprenants du mardi
Marie, Lucien et Victor sont tous les trois inscrits aux AMP des mardis de 17h à 18h.
Ils viennent à l’Atelier du Coteau en pedibus, c’est-à-dire que Mehregan va chercher Marie et
Lucien à leur sortie de l’école, et Alexis fait de même pour Victor. Ils prennent ensuite leur
goûter dans le petit vestiaire avant d’entamer les activités. Habituellement, Marie reste
également à l’AMP de 18h à 19h, mais pendant la durée de mon stage elle s’en allait dès 18h
car son père pouvait venir la chercher plus vite, alors que Victor, lui, restait de 18h à 19h seul
avec Mehregan. Au sein de l’Atelier, Marie a le plus d’ancienneté car elle participe aux AMP
depuis janvier 2014 et est présente toute la semaine dans l’association car elle participe aussi
aux AMP des vendredis, aux ateliers musique plurilingues des lundis et jeudis et à un cours de
danse donné par Elisa le mercredi. Elle connait donc le fonctionnement des activités et a déjà
noué des relations avec les animatrices. Victor est inscrit depuis avril 2014, peut donc être aussi
considéré comme un habitué des lieux et des animatrices ainsi que de Marie qu’il a rencontré
l’année dernière et qui partage avec lui les ateliers musique plurilingues d’Hélène les lundis.
Lucien n’est arrivé que depuis septembre dernier, mais se trouve dans la même classe que Marie
à l’école, ce qui lui a permis de ne pas se retrouver dans un environnement complètement
inconnu. Ces liens entre les enfants sont importants car ils supposent un certain attachement
affectif qui ne peut pas être mis de côté lorsque l’on souhaite mettre à profit les émotions de
chacun. Dans ce groupe, nous pouvons nous attendre à ce qu’il n’y ait pas forcément de
problème de gêne ou de retenue face au regard des autres enfants. Ayant effectué quelques
106
services de pedibus pour Victor et Marie, ces deux enfants se sont rapidement habitués à ma
présence qui n’a pas non plus semblé perturber Lucien avec qui il était facile de discuter pendant
les temps de goûter.
Le profil d’apprenants de ces enfants peut se synthétiser sous la forme du tableau
présenté en page suivante qui regroupe les données générales que nous venons de commenter
et, en deuxième partie, le récapitulatif de leur biographie langagière :
Groupe du mardi :
Marie Victor Lucien
Date de naissance/Age
3 juillet 2009 / 5 ans et demi 7 novembre 2010 / 4 ans et
demi 17 mars 2009 / 6 ans
Classe/Ecole Grande section / Ecole maternelle
publique Maisdon Pageot
Moyenne section / Ecole maternelle publique Les
Réformes
Grande section / Ecole maternelle publique Maisdon
Pageot
Liens avec les autres enfants
Dans la même classe que Lucien à l’école ; participait aux même ateliers qu’Agathe (groupe du vendredi) l’année précédente.
Dans la même classe que
Marie à l’école
Autres ateliers suivis à l’Atelier du Coteau
Suit les ateliers multi-activités multilingues des mardis et
vendredis + ateliers musique multilingues les
lundis et jeudis + cours de danse le mercredi
= à l’Atelier du Coteau toute la semaine (9h/semaine en temps
normal ; 5h/semaine depuis mars pour congé maladie du papa)
Suit l’atelier musique multilingue les lundis
= à l’Atelier du Coteau les lundis et mardis (4h/semaine en mars-
avril)
Aucun = à l’Atelier du Coteau le mardi (1h/par semaine)
Date de première inscription
Janvier 2014 Avril 2014 Septembre 2014
Pedibus Oui Oui Oui
(Auto)Biographie langagière (selon l’enfant et complétée par les réponses au questionnaire des parents):
Langues parlées Français Français Français
Langues en apprentissage à l’école
Anglais avant, plus maintenant -----------------------------------------------
Selon les parents : anglais 30 mn/semaine
RAS ---------------------------------------- Selon les parents : anglais en
initiation 30 mn/semaine pendant un trimestre
Anglais --------------------------------------
Selon les parents : Lucien n’apprend pas de langues à
l’école
Langues en apprentissage à l’Atelier du Coteau
Avec Hélène (musique) : Espagnol, italien, anglais, français Avec Mehregan (multi-activités) :
Persan
Avec Hélène (musique) : Espagnol, allemand, italien,
anglais Avec Mehregan (multi-
activités) : Anglais, italien, espagnol,…
« Toutes les langues »
Anglais, persan
107
Groupe du mardi :
Marie Victor Lucien
Langues en apprentissage ailleurs
Cours d’anglais une heure par semaine dans un centre de langues (MariaPop ! School)
depuis septembre 2013
Langues déjà entendues
Anglais, français Espagnol
Langues déjà vues écrites
Italien
Langues parlées par les membres de la famille (tous niveaux confondus)
Anglais par les deux parents. -----------------------------------------------
Selon les parents :
Père : anglais, allemand, japonais, suédois, roumain et
russe. Mère : anglais, suédois,
allemand, italien, japonais et arabe.
------------------------------------------- Parlent de temps en temps en anglais avec leur fille (jeux et
devinettes)
Anglais par les deux parents. -------------------------------------------
Selon les parents : anglais et allemand
------------------------------------------- Parlent de temps en temps en
anglais avec leur fils (vocabulaire, chansons, lectures
d’histoires)
RAS --------------------------------------
Selon les parents :
Père : anglais, allemand, latin
Mère : anglais, allemand, latin, espagnol, italien
----------------------------------- N’utilisent pas les langues
avec leur fils
Langues parlées par des ami(e)s
Peut-être espagnol par un
copain de classe mais ne l’a jamais entendu le parler.
Langues que j’aimerais apprendre
Allemand, italien, anglais, japonais Allemand, espagnol, africain Espagnol, russe, marocain
Pays visités
Espagne (Ibiza) -------------------------------------------
Selon les parents : Egypte, Thaïlande, Espagne et Grèce
Tunisie (deux fois)
Pays que j’aimerais visiter
Inde Afrique « Les pays où je parle les langues que j’ai dites »
Figure 4 : Tableau récapitulatif de la biographie langagière des enfants du groupe du mardi
Ici, les trois enfants partagent la même langue maternelle mais une exposition aux langues et
aux cultures étrangères différente. Marie et Lucien ont tous deux commencé à aborder l’anglais
à l’école, mais les parents de Marie ont un bagage linguistique et culturel assez important qu’ils
n’hésitent pas à partager avec leur fille, surtout par des jeux en anglais, alors que les parents de
Lucien n’ont pas cette démarche avec leur fils et semblent ne pas être au courant qu’il a déjà
fait un peu d’anglais à l’école. Ce rapport des parents aux langues et aux cultures étrangères est
en quelque sorte confirmée par Lucien lui-même qui ne sait pas si son père et sa mère
connaissent d’autres langues que le français. Victor, plus jeune que ses deux compagnons
108
d’AMP, n’a eu qu’une initiation à l’anglais pendant un trimestre à l’école, mais suit en revanche
ce qu’il nomme lui-même des « cours d’anglais » tous les mercredis dans un centre de langues
spécialisé pour les enfants. Cela qui implique qu’il a finalement été plus exposé à l’anglais que
Lucien, d’autant plus qu’il participe à deux ateliers artistiques plurilingues hebdomadaires où
l’anglais est abordé et que ses parents affirment faire quelques activités dans cette langue à la
maison. Parmi les opportunités d’expériences interculturelles, Victor se rappelle bien être allé
en Espagne et ses parents ajoutent qu’il est aussi allé en Egypte, en Thaïlande et en Grèce avec
eux : étant donné l’âge de Victor, ne pas se rappeler de tous ces pays n’est pas étonnant, mais
l’Espagne a vraisemblablement laissé des souvenirs marquants. Lucien est allé à deux reprises
en Tunisie, expérience qu’il affirme avoir beaucoup appréciée. Interrogé sur les langues qu’il
aimerait apprendre et les pays qu’il aimerait visiter, Lucien créé une corrélation entre langues
et pays en déclarant vouloir apprendre l’espagnol, le russe et le marocain pour pouvoir aller en
Espagne, en Russie et au Maroc. Victor, lui, aimerait apprendre l’allemand et l’espagnol mais
semble particulièrement passionné par l’Afrique où il aimerait voyager et dont il aimerait
apprendre les langues. Lors d’un atelier avec Hélène sur ce continent, j’ai pu remarquer qu’il
s’agissait, en effet, d’un lieu et de cultures qui semblaient susciter son intérêt. Marie est la seule
qui, en entretien, ne fait pas de corrélation entre les langues qu’elle aimerait apprendre et les
pays qu’elle souhaiterait visiter, voulant apprendre l’allemand et l’italien qu’elle a abordé dans
les ateliers d’Hélène, l’anglais dans ceux d’Hélène et de Mehregan ainsi qu’à la maison et à
l’école, et enfin le japonais dont elle pourrait avoir entendu parler par ces parents. En revanche,
elle cite l’Inde comme pays de prédilection. Ces dernières informations sont d’un grand intérêt
car elles fournissent des pistes de langues et de pays pouvant intéresser les trois enfants pour
proposer un dispositif basé sur la valorisation d’émotions positives dans la rencontre avec un
Autre et un Ailleurs qui attise déjà leur curiosité. Même s’il n’y a pas que des éléments
communs entre les trois enfants, je pourrai sûrement chercher à proposer des interventions qui
puissent les contenter à tour de rôle, tout en leur donnant alors de futurs sujets d’échange en
fonction de l’intérêt qu’ils portent à ces langues et ces pays.
III.1.b. Arthaud, Rosemay, Maya, Thomas, Adèle et Rose : portraits d’apprenants du mercredi
Le groupe du mercredi présente une configuration quelque peu différente des deux
autres groupes, d’une part parce que les effectifs sont plus importants, l’écart d’âge entre les
enfants aussi (le plus grand a 8 ans et le plus petit seulement 3 ans) et enfin parce que ce sont
les seuls qui participent aux AMP sans avoir eu toute une journée d’école avant. Il s’agit moins
ici d’un système de garde ludique que d’une activité de loisirs. Le groupe ne s’est formé tel
109
quel qu’en septembre 2014, aucun enfant n’a plus d’ancienneté qu’un autre. Néanmoins,
Rosemay suit aussi des cours de danse avec Elisa, ce qui confère à l’association une importance
sans doute plus grande pour elle qui y passe tous ses mercredis après-midi. Les relations entre
les membres du groupe sont variées : il y a deux binômes de frères et sœurs (Arthaud et
Rosemay d’un côté, Maya et Thomas de l’autre) et deux jeunes filles de cinq ans qui semblent
très réservées par rapport aux autres enfants qui montrent de l’assurance, certainement confortés
par le fait d’avoir à leur côté un membre de leur famille qui rend l’environnement familier.
Les parents d’Arthaud et Rosemay ainsi que de Maya et Thomas n’ont pas retourné mon
questionnaire, aussi les éléments mentionnés dans le tableau suivant ne proviennent que des
enfants pour lesquels je n’ai que peu de données concernant le rapport aux langues et aux
cultures dans leur environnement familial. Les profils d’Adèle et Rose sont eux bien complétés
des données de l’entretien avec chacune d’entre elle et des données recueillies par les réponses
de leurs parents au questionnaire.
Groupe du mercredi :
Arthaud Rosemay Maya Thomas Adèle Rose
Date de naissance/Age
8 ans 6 ans 6 ans 3 ans 31 janvier 2010
/ 5 ans 22 décembre 2009 / 5 ans
Classe/Ecole CE2 / Ecole élémentaire
Léon Say
CP / Ecole élémentaire
Léon Say CP Petite section
Moyenne section / Ecole maternelle La
Contrie
Grande section / Ecole
Notre Dame de Toutes
Joies
Liens avec les autres enfants
Frère de Rosemay
Sœur d’Arthaud Sœur de Thomas
Frère de Maya
Autres ateliers suivis à l’Atelier du Coteau
Cours de danse
le mercredi avant l’atelier
Date de première inscription
Septembre 2014
Septembre 2014 Septembre
2014 Septembre
2014 Septembre
2014 Septembre
2014
Pedibus Non Non Non Non Non Non
(Auto)Biographie langagière (selon l’enfant et complétée par les réponses au questionnaire des parents):
Langues parlées
Français, anglais
Français Français Français Français,
« anglais un p’tit peu »
Ne se rappelle plus du nom
(Français)
Langues en apprentissage à l’école
Anglais Français
Langues en apprentissage à l’Atelier du Coteau
Persan, anglais
Anglais, « la langue de
Mehregan » et Ne sait pas
Anglais, chinois
Anglais Anglais
110
Figure 5 : Tableau récapitulatif de la biographie langagière des enfants du groupe du mercredi
Dans ce groupe, les enfants partagent tous la même langue maternelle mais certains n’hésitent
pas à ajouter l’anglais parmi les langues qu’ils parlent ne serait-ce que partiellement. Leur
contact avec les langues et les cultures reste assez varié, mais nos données restent incomplètes
pour pouvoir le caractériser avec précision. Arthaud précise qu’il apprend l’anglais à l’école,
mais Rosemay et Maya qui sont toutes deux en CP et donc susceptibles d’avoir quelques
enseignements de langue étrangère disent ne pas apprendre de langues à l’école alors que plus
loin dans l’entretien, Rosemay notamment abordera une activité autour du chinois réalisée
une autre langue
Langues en apprentissage ailleurs
Langues déjà entendues
Anglais Anglais Anglais Anglais
Langues déjà vues écrites
Anglais, vieux français,
latin, portugais
Chinois Chinois, anglais
Langues parlées par les membres de la famille (tous niveaux confondus)
Papa : langues
parlées en Belgique
(flamand ?), maman :
portugais. Les 2
parents : anglais sûr et
peut-être italien
Papa : anglais, maman : anglais
et peut-être d’autres langues
Papa : anglais
Maman : anglais et chinois, papa : anglais
RAS ------------------
Selon les parents :
principalement anglais
-------------------- Ils n’utilisent
pas cette langue avec
leur fille
RAS -----------------
Selon les parents : anglais et espagnol
----------------- Ils n’utilisent
aucune de ces langues
avec leur fille Langues parlées par des ami(e)s
Italien et anglais par un copain
Anglais par
une copine de sa classe
Langues que j’aimerais apprendre
Allemand,
italien « La langue de
Mehregan » Anglais, chinois
Anglais,
espagnol
Pays visités Portugal,
(Allemagne – Europa Park)
Angleterre (Londres)
« Je sais pas » ---------------------
Selon les parents : RAS
Espagne -------------------
Selon les parents : RAS
Pays que j’aimerais visiter
Grèce, Italie, Etats-Unis,
Canada
« Dans le pays des Vahinés »
Chine
« Des pays où l’on parle
français ou anglais »,
Chine
« Je sais pas » Chine
111
« avec la maîtresse ». Ainsi, mis à part Arthaud, tous les enfants situent leurs principaux
contacts avec les langues et les cultures étrangères à l’Atelier du Coteau. Si nous ne pouvons
nous prononcer pour les quatre premiers enfants présentés dans le tableau, nous savons par les
parents d’Adèle et Rose que ceux-ci, bien qu’ils aient des connaissances en anglais et/ou en
espagnol, n’emploient pas ces langues à la maison avec leur fille et n’ont pas effectué de voyage
à l’étranger avec elles, même si Rose m’a parlé avec beaucoup de plaisir d’un voyage en
Espagne. Arthaud et Rosemay ont tous les deux des opinions différentes quant aux langues que
peuvent parler leurs parents, ce qui nous fait supposer que ceux-ci n’utilisent probablement pas
de langues étrangères avec leurs enfants. De la même manière, Maya n’attribue à ses parents
que l’anglais, alors que Thomas insiste sur le chinois qui serait parlé par sa maman et parle d’un
voyage à Londres dont Maya, plus grande, n’aurait pas souvenir. Concernant les éventuels
intérêts des enfants pour des langues et des cultures particulières, deux d’entre eux ont annoncé
en entretien ne pas avoir envie d’apprendre d’autres langues, et Maya et Thomas semblent avoir
une curiosité commune pour la Chine, née du dessin animé Mulan en ce qui concerne Thomas.
Arthaud évoque des envies de voyages précises, liées à un intérêt fort pour l’Histoire, ce qui
éclaire certaines de ses interventions dans les AMP où il fait preuve de beaucoup de
connaissances sur le monde à travers les âges, mentionnant même une fois l’empire perse
lorsque Mehregan parlait de l’Iran. Rosemay aimerait voyager « dans le pays des Vahinés »
suite à un film qu’elle aurait vu à la télévision et après lequel elle aurait partagé cette envie de
voyage avec ses parents, souhaitant arborer elle-aussi un paréo et danser à l’image de ces
femmes dont elle ne connaît pas le pays de résidence. Adèle, l’enfant la plus introvertie du
groupe, s’est aussi peu exprimée en entretien qu’elle ne le fait dans les AMP, réalisant souvent
les créations proposées par Mehregan de son côté, sans échanger avec les autres enfants du
groupe ni avec Mehregan ou moi-même ; cette enfant semble n’avoir aucun contact avec les
langues et les cultures étrangères ailleurs qu’à l’Atelier du Coteau et ne savait pas dans quel
pays elle aimerait voyager. Cela sera à prendre en considération dans la conception d’un
dispositif qui devra chercher à la faire s’exprimer dans un groupe où les enfants sont nombreux
et, dans le cas des frères et sœurs, se connaissent suffisamment pour s’exprimer spontanément,
étouffant parfois les possibilités d’intervention de Rose et Adèle.
III.1.c. Marie, Alix et Agathe : portraits d’apprenants du vendredi
Le groupe du vendredi dans les AMP est aussi restreint que celui du lundi et entièrement
féminin. L’enfant ayant le plus d’ancienneté à l’Atelier n’est plus Marie mais Agathe qui
participe aux AMP pour la deuxième année consécutive, même si elle n’est plus inscrite aux
112
ateliers musique plurilingues d’Hélène auxquels elle assistait aussi l’année précédente. Marie
et Agathe se connaissent donc bien pour avoir fait de nombreuses activités ensemble en un an
et demi, mais Alix n’est pas pour autant délaissée car elle participe depuis cette année aux AMP
des vendredis mais aussi aux ateliers musiques plurilingues des lundis en compagnie de Marie
avec qui elle rentre de l’école à l’Atelier du Coteau en pedibus deux fois par semaine. Très
dynamique, Alix a en plus un caractère assez fort qui lui permet de s’imposer auprès des deux
plus grandes.
L’intégralité des données recueillies dans les entretiens réalisées avec Agathe, Marie et
Alix ainsi que dans les questionnaires renvoyés par leurs parents sont résumées dans le tableau
ci-après dans lequel nous n’avons cependant pas rapporté les données de Marie déjà présentées
dans le paragraphe III.1.a.
Groupe du vendredi :
Marie Agathe Alix
Date de naissance/Age
Voir détails dans le groupe du mardi
5 février 2008 / 7 ans 23 juin 2010 / 4 ans et demi
Classe/Ecole CP / Ecole de La Fraternité Moyenne section / Ecole
maternelle Maisdon Pageot
Liens avec les autres enfants
Connait Marie depuis 2013 grâce aux ateliers
Est dans la même école que Marie ; partage le pedibus les
lundis et vendredis.
Autres ateliers suivis à l’Atelier du Coteau
Aucun cette année. L’année précédente, ateliers
arts plastiques multilingues et ateliers musique multilingues
les lundis de 17h à 18h.
Ateliers musique multilingues les lundis de 17h à 18h
Date de première inscription
Septembre 2013 Septembre 2014
Pedibus Oui Oui
(Auto)Biographie langagière (selon l’enfant et complétée par les réponses au questionnaire des parents):
Langues parlées
Français Français
Langues en apprentissage à l’école
Anglais ----------------------------------------
Pour les parents : leur fille n’apprend pas de langues à
l’école
Langues en apprentissage à l’Atelier du Coteau
Anglais et perse
Avec Hélène : Allemand, italien et anglais
Avec Mehregan : Allemand, français, anglais
Langues en apprentissage ailleurs
Allemand avec papi et mamie ----------------------------------------
Pour les parents : aucune
113
Groupe du vendredi :
Marie Agathe Alix
Langues déjà entendues
Anglais et espagnol (espagnol dans la série TV Violeta)
Langues déjà vues écrites
Langues parlées par les membres de la famille (tous niveaux confondus)
Anglais beaucoup par papa, maman un peu
---------------------------------------- Selon les parents : anglais
pour les deux, allemand en plus pour la maman
---------------------------------------- Ils utilisent rarement l’anglais avec leur fille (mots de temps
en temps et jeux)
Anglais par papa et maman -------------------------------------
Pour les parents : maman : Allemand, Anglais ;
papa : Anglais, Espagnol, Chinois
---------------------------------------- Ils leur arrivent de parler un
peu anglais avec leur fille pour qu’elle prenne conscience de l’existence d’autres langues
Langues parlées par des ami(e)s
Vraisemblablement arabe par une camarade de classe
Allemand par trois amis
Langues que j’aimerais apprendre
Espagnol, arabe Allemand, anglais
Pays visités
RAS pour elle-même mais ses parents sont allés à New-York et des amis en Afrique du Sud ---------------------------------------- Selon les parents : République Dominicaine, projet d’aller à
Londres.
Le Pôle Nord et la campagne ---------------------------------------- Selon les parents : Edimbourg quand leur fille avait deux ans.
Pays que j’aimerais visiter
New-York, Espagne Espagne et Canada
Figure 6 : Tableau récapitulatif de la biographie langagière des enfants du groupe du vendredi
Ici, nous remarquons que les trois enfants partagent à nouveau la même langue maternelle et
que Marie et Agathe suivent toutes deux des enseignements d’anglais à l’école, contrairement
à Alix qui est encore en moyenne section. Agathe plus grande, a accès à une série qui lui plaît
beaucoup appelée Violeta dans laquelle l’héroïne chante en espagnol, et Agathe connaît presque
l’intégralité de ses chansons par cœur. Cet apport est donc d’un type différent que celui que
Marie et Alix peuvent recevoir de la part de leurs parents qui utilisent parfois l’anglais à la
maison pour s’amuser, alors que les parents d’Agathe utilisent très peu cette langue avec leur
fille, bien qu’ils aient le projet d’aller à Londres avec elle. Alix prétend avoir divers contacts
avec l’allemand, contacts non confirmés par les parents, même si nous savons qu’elle y a été
initiée avec Hélène dans les ateliers musique plurilingues. Alors que Marie n’a pas encore
d’expérience à l’étranger, Agathe est déjà allée en République Dominicaine mais n’en a
114
vraisemblablement pas gardé de souvenirs car elle n’a parlé que de voyages réalisés par ses
parents ou par des amis avec qui elle a eu l’occasion d’en discuter et de voir des photos. Alix
est allée en Ecosse mais ne s’en rappelle peut-être pas, mentionnant plutôt le Pôle Nord dont
elle parle souvent dans les ateliers : cela semble être un lieu qui l’attire et où elle rêve de se
balader en traineau avec ses chiens. Il nous faut préciser ici qu’Alix était malade le jour où nous
avons réalisé l’entretien et qu’elle n’était vraiment pas en forme pour répondre à mes questions,
répondant finalement à partir de ce dont elle avait envie plus que de ce qui correspondait à la
réalité. Poussée par l’envie de dialoguer avec sa camarade de classe, Agathe aimerait apprendre
l’arabe mais aussi l’espagnol pour pouvoir aller en Espagne à l’image de son héroïne de
télévision. Alix parle de l’Espagne et du Canada pour de futurs voyages, mais nous ne
connaissons pas les raisons de ces envies.
Toutes les données recueillies auprès des enfants et de leurs parents nous permettent
désormais de mieux prendre en compte la diversité du type et de la quantité de relations que les
enfants des AMP peuvent avoir avec les langues et les cultures, nous donnant par la même
occasion des pistes pour notre dispositif qui cherchera à valoriser le bagage existant des enfants
pour le valoriser et générer des émotions positives en abordant des langues et des pays qui les
intéressent. Cela permettra de proposer des rencontres avec des Ailleurs différents de ceux déjà
proposés par Mehregan, complétant ainsi la logique de décloisonnement linguistique et culturel
propre de l’Eveil aux Langues, mais aussi de rencontres qui devraient être perçues comme des
expériences positives pour donner envie aux enfants, à plus long terme, de développer leur
envie d’aller vers l’Autre et de découvrir les langues et les cultures du monde dans lequel ils
vivent. Voyons à présent le bilan de l’enquête diffusée auprès des parents pour nous permettre
de comprendre leurs attentes envers les AMP et voir si celles-ci peuvent être aussi prises en
compte dans la conception de mon dispositif.
III.2. Résultats de l’enquête menée auprès des parents
La diffusion d’un questionnaire de satisfaction auprès des parents des enfants inscrits
aux AMP était certes un moyen de connaître plus en détail l’environnement linguistique et
culturel des enfants me permettant de leur proposer la mise en place d’un dispositif didactique
prenant en compte ces éléments, mais il s’agissait également d’un souhait d’Elisa et Xavier que
d’avoir un retour de la part des parents sur leurs activités. Après cinq ans de fonctionnement de
l’association, et deux ans des ateliers artistiques plurilingues, la question d’un bilan à mi-
parcours se posait, et mon arrivée en tant que stagiaire a permis de concrétiser cela. Cependant,
115
il nous faut préciser que le questionnaire n’a été diffusé qu’aux parents ayant un ou plusieurs
enfant(s) inscrit(s) dans les AMP de Mehregan, ce qui amène donc des éléments de réflexion
pour ces ateliers-là mais pas sur l’ensemble des ateliers artistiques plurilingues qui
comptabilisent également ceux animés par Hélène. Si ce bilan donne un premier aperçu des
attentes et des suggestions des parents envers les AMP et l’Atelier du Coteau, il m’est apparu
comme utile dans mon travail de terrain car il me permettait d’interroger l’ensemble des acteurs
des AMP, car les parents sont ceux qui font l’acte d’inscription pour leur enfant et qui financent
ces ateliers. En participant financièrement au bon fonctionnement de l’association, leur avis me
semblait important à interroger et à prendre en compte pour chercher un équilibre entre les axes
de travail de l’Atelier, ceux des AMP et de Mehregan, les parcours et envies des enfants et donc
les attentes de leurs parents pour proposer un dispositif didactique cohérent avec le contexte
dans lequel il s’inscrit. Comme nous l’avons déjà précisé, nous n’avons malheureusement pas
récupéré les réponses de deux couples de parents qui avaient chacun deux enfants inscrits aux
AMP, ce qui porte le taux de participation à 78% des parents initialement enquêtés, représentant
à peine 64% des enfants participant aux AMP de 17h à 18h les mardis, mercredis et vendredis
(ce qui correspond à 7 questionnaires récupérés sur 9) . Les données recueillies et présentées
ci-dessous sont donc à nuancer à la lumière de ces chiffres.
III.2.a. Pourquoi inscrire son enfant aux ateliers multi-activités plurilingues de l’Atelier du
Coteau ?
L’une de mes premières interrogations, partagée notamment par Xavier, concernait les
motivations qui avaient poussées les parents à inscrire leur enfant aux AMP. En effet, était-ce
lié à la notion de service avec le pedibus et la garde des enfants à la sortie de l’école avant le
retour du travail, ou bien était-ce pour un réel intérêt envers les pratiques artistiques et/ou l’éveil
aux langues et aux cultures ? Et entre ces deux derniers domaines, certains parents voient-ils
leur association comme un avantage ?
La question touchant aux motivations des parents était posée ainsi : « quelles sont les
principales raisons qui vous ont poussé à inscrire votre enfant aux ateliers artistiques
multilingues9 de l’Atelier du Coteau ? ». Plusieurs suggestions de réponse était proposées parmi
lesquelles les enquêtés devaient en choisir au maximum 4 afin d’établir une notion de priorité
parmi ces raisons dans le cas où toutes pouvaient s’appliquer. Les suggestions étaient réparties
comme suit :
9 Le terme « multilingue », bien qu’inadéquat, avait été conservé dans le questionnaire afin de ne pas créer de
confusion pour les parents qui connaissaient les ateliers sus cette appellation.
116
- Des suggestions concernant la dimension de service :
o Par commodité pour que votre enfant soit récupéré à l’école et gardé en attendant
votre retour du travail
o Parce que c’est un centre de loisirs proche de chez vous
o Parce que les tarifs sont accessibles
- Des suggestions sur un principe d’exclusivité des contenus :
o Surtout pour qu’il fasse des activités artistiques
o Surtout pour qu’il découvre des langues et cultures étrangères
o Surtout pour qu’il apprenne des langues étrangères
- Des suggestions concernant l’association de l’éveil artistique et de l’éveil aux langues
et aux cultures :
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et
des cultures de manière ludique
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et
des cultures par le biais des arts
A ces suggestions étaient ajoutée une option « Autre(s) » qui permettait aux parents de
compléter les suggestions proposées par d’autres motivations. La distinction proposée entre la
découverte et l’apprentissage me semblait aussi importante pour chercher à définir un éventuel
degré des attentes liées à l’éveil aux langues et aux cultures des AMP.
Sur les 7 couples de parents enquêtés et ayant répondu au questionnaire, 1 couple n’a
donné que 2 raisons, 2 couples n’en ont donné que 3 et 4 couples en ont donné 4. Aucun couple
n’a invoqué de motivation exclusivement utilitaire, artistique ou linguistique et culturelle,
confirmant la complémentarité des propositions de l’Atelier du Coteau pour le bon
fonctionnement de ses AMP. 71,5%, soit 5 couples sur 7, ont invoqué des raisons à la fois
artistiques, linguistiques et culturelles. Un seul couple a invoqué des raisons à la fois utilitaires,
linguistiques et culturelles. Un couple a invoqué des raisons à la fois utilitaires, artistiques,
linguistiques et culturelles. Ces chiffres peuvent se schématiser par un entrecroisement de
cercles présentés sur la page suivante :
117
Figure 7 : Cercles des motivations des parents à l’inscription aux AMP
En entrant dans le détail des réponses sélectionnées, nous obtenons le diagramme suivant qui
présente horizontalement le nombre de couples ayant sélectionné chacune des motivations
décrites verticalement. Les motivations apparaissant dans le questionnaire mais pas dans ce
diagramme n’ont pas été sélectionnées par les enquêtés.
Figure 8 : Diagramme des motivations sélectionnées par les parents
6
6
4
2
1
1
1
2
0 1 2 3 4 5 6 7
FAIRE DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
DÉCOUVRIR/APPRENDRE DES LANGUES ET DES CULTURES DE MANIÈRE LUDIQUE
DÉCOUVRIR DES LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES
DÉCOUVRIR/APPRENDRE DES LANGUES ET DES CULTURES PAR LE BIAIS DES ARTS
MODE DE GARDE APRÈS L'ÉCOLE
PROXIMITÉ DU CENTRE DE LOISIRS
APPRENDRE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
AUTRES
118
Il convient de préciser ici que les deux motivations « Autres » ont été données par deux couples
différents, l’un signalant le pedibus et l’autre que ce sont des ateliers moins ennuyants que le
périscolaire pour leur enfant. Ainsi, les activités artistiques et l’éveil aux langues et aux cultures
sont deux domaines également plébiscités suivis de près par la notion d’association des deux
pour une découverte et un apprentissage des langues et des cultures par le biais des arts, l’intérêt
utilitaire ou lié au service rendu par l’association n’arrivant qu’ensuite. Il semble donc que,
d’après ces réponses, les motivations qui ont poussé les parents enquêtés ayant répondu au
questionnaire à inscrire leurs enfants aux AMP de l’Atelier du Coteau soient en accord avec la
démarche originale de l’association d’associer les deux domaines qui font l’objet de notre
travail de recherche. Il s’agit là d’un élément positif à reconnaître car il démontre un réel intérêt
de la part des parents pour la formation à l’expérience artistique et à l’expérience linguistique
et culturelle de leur enfant, même si, comme nous allons le voir plus loin, il y a deux degrés
d’attentes concernant ce dernier type d’expérience. Le premier est plus proche de la notion de
découverte et l’autre plus proche de la notion d’apprentissage associée à des souhaits de
résultats. Quelles sont donc les attentes des parents envers ces ateliers pour leur enfant ?
III.2.b. Que doivent apporter ces ateliers aux enfants ?
Interrogés désormais par une question ouverte attendant des réponses libres, les parents
se sont exprimés sur ce qu’ils attendaient des AMP pour leur enfant. Reprenant les réponses
recueillies dans chaque questionnaire, j’ai pu distinguer plusieurs attentes récurrentes. Pour 3
couples sur 7 ayant répondu au questionnaire, le plus important pour leur enfant est :
- Qu’il prenne du plaisir, qu’il s’amuse,
- Qu’il ait une première expérience des arts et qu’il développe sa sensibilité dans ce
domaine,
- Qu’il découvre et apprenne de manière ludique sous forme d’activités variées et
notamment en chanson, en musique et en réalisant des œuvres plastiques,
- Qu’il se familiarise avec des langues étrangères, et plus précisément avec des sonorités,
du vocabulaire et des manières de communiquer différentes,
- Qu’il s’ouvre à d’autres cultures.
A première vue, ces attentes semblent correspondre à ce que nous avons pu définir du travail
réalisé par Mehregan dans les AMP. En allant plus loin dans l’analyse des réponses, je remarque
que deux couples ont abordé la question d’une découverte voire même d’un apprentissage de
l’anglais comme prioritaire sur les autres langues, et d’une attente d’animation entièrement en
langue étrangère, de préférence par des intervenants étrangers, et plus particulièrement
119
anglophones. Ce type d’attente va donc plus loin que la démarche proposée par l’Atelier, mais
témoigne aussi d’un intérêt particulier pour l’anglais qui est bien pris en compte par Mehregan
mais qui ne pourrait être utilisé prioritairement avec les enfants sous peine de sortir de la logique
d’éveil aux langues et aux cultures dans leur ensemble, et surtout de reléguer au second plan
les langues que l’Ecole n’a déjà pas la vocation d’enseigner. Ces attentes doivent néanmoins
être prises en compte, même si elles n’ont pas été relevées par une majorité des parents
enquêtés : il s’agit d’une réelle préoccupation qui pourrait amener l’Atelier du Coteau à élargir
ou adapter son offre pour obtenir des membres supplémentaires ou bien revoir ses supports de
communication pour plus de clarté sur ce point quant à la démarche adoptée dans les AMP.
A l’heure actuelle, les parents estiment que les AMP ont eu des influences positives sur
leur enfant. Sur le plan de l’épanouissement individuel, 2 couples sur 7 affirment que leur enfant
est content de se rendre aux ateliers, un autre que l’enfant a pris confiance en lui, et un troisième
que l’enfant semble plus épanoui. Sur le plan artistique, 3 couples sur 7 mentionnent que leur
enfant a plus envie de peindre, dessiner et colorier qu’avant son inscription aux ateliers.
Individuellement, certains parents évoquent aussi que leur enfant a fini par aimer les arts
plastiques, ou qu’il a fait des progrès en dessin, ou encore qu’il a développé ses capacités
d’imagination. Sur le plan linguistique et culturel, un couple mentionne le fait que les langues
sont devenues une source d’amusement, un autre confirme que son enfant comprend de plus en
plus de mots en langue étrangère. D’autres font la remarque que leur enfant pose des questions
sur le vocabulaire en anglais, et d’autres encore qu’il s’intéresse aux différents pays. Seuls 2
couples sur 7 n’ont pas remarqué d’évolution chez leur enfant depuis qu’il fréquente les AMP,
et 3 couples sur 7 signalent que leur enfant ne s’exprime pas spontanément en langue étrangère
à la maison. Néanmoins, l’absence d’évolution peut être normale chez les enfants qui n’ont
commencé à participer aux AMP que cette année, d’autant plus que chaque enfant évolue à un
rythme propre qui n’est pas forcément le même que ses compagnons d’atelier. Il en est de même
pour la question de l’utilisation des langues étrangères à la maison : certains enfants peuvent
d’ailleurs vouloir garder ces expériences pour eux ou au sein du contexte où ils les découvrent,
car ils ne voient pas forcément de validité sociale à s’exprimer en persan à la maison si personne
ne comprend ou parle cette langue et qu’elle ne fait donc pas partie de l’environnement familier
de l’enfant. Les lignes suivantes vont nous permettre de mieux cerner ces éventuelles
inquiétudes des parents et de voir ce qui peut être fait dans les AMP pour les apaiser.
120
III.2.c. Ces ateliers donnent-ils satisfaction jusqu’à aujourd’hui ?
D’après ce que nous avons pu mentionner jusqu’à présent, les attentes des parents envers
les AMP semblent plutôt satisfaites. L’ensemble des parents enquêtés ayant répondu au
questionnaire l’affirme, et presque la moitié d’entre eux affirme que leur propre enfant est
satisfait de ces ateliers. 3 couples sur 7 voient même dans les AMP une offre d’activités riche
et de qualité ainsi qu’une pédagogie adaptée. Un couple mentionne le fait d’avoir des groupes
à petit effectifs comme un véritable atout, un autre trouve que les animatrices sont compétentes
et savent gérer la fatigue des enfants et un dernier considère que ces ateliers offre une bonne
transition entre l’école et la maison, l’agitation et le calme. Pour 2 couples sur 7, l’absence de
communication de leur enfant sur ce qu’il a fait et/ou appris en termes de langues et cultures
étrangères dans les AMP est réitérée comme une préoccupation car cela semble décevoir une
attente de résultats ou en tout cas de preuves de ce qui est abordé. Même s’il n’est pas
concevable de chercher à ce que les enfants échangent à tout prix avec leurs parents sur ce qu’ils
ont fait dans les AMP, il m’apparait cependant envisageable de chercher à valoriser les thèmes
et éventuellement le vocabulaire en langue étrangère abordés avec eux. Certaines créations ou
certains supports pourraient se concevoir comme des objets que les enfants pourraient rapporter
chez eux et qui deviendraient alors des sujets de discussion possible, un élément des AMP
s’immisçant dans le cercle familial, mais aussi un élément concret traduisant au moins une
partie des contenus des ateliers aux parents.
Alors que 3 couples sur 7 n’ont pas apporté de suggestions à la fin du questionnaire, 2
ont proposé de chercher à mettre plus en avant les langues étrangères en organisant les ateliers
comme des espaces-temps d’immersion linguistique pour que l’enfant soit vraiment bercé par
un environnement plurilingue tout en développant ses expériences artistiques. Cela nous parait
réalisable sur un plan théorique, mais l’environnement plurilingue resterait alors limité aux
langues que maîtrise Mehregan et délaisserait alors une ouverture vers de nombreuses langues
et de nombreux pays. De plus, cela nécessiterait une formation de l’animatrice aux recherches
et théories liées à l’alternance des codes langagiers avec les enfants afin que l’immersion
plurilingue soit préparée sans risque de générer des confusions chez des apprenants qui sortent
souvent fatigués d’une journée d’école. D’autres suggestions liées aux horaires de déroulement
des AMP ont été mentionnées par 2 couples sur 7, mais nous ne les traiterons pas ici car elles
nous feraient nous écarter de notre sujet de recherche. Le lecteur peut retrouver l’intégralité des
questionnaires récupérés ainsi qu’un bilan de ceux-ci en annexes 9.
121
III.3. Bilan de ces analyses au regard du projet de recherche
Afin d’achever l’analyse des données recueillies auprès de l’ensemble des acteurs des
AMP, nous nous sommes intéressés aux enfants et à leurs parents qui nous ont permis de définir
des éléments à prendre en compte pour un meilleur fonctionnement de ces ateliers aux yeux de
tous, remplissant ainsi le premier critère de notre deuxième hypothèse de travail. Une
connaissance plus approfondie des enfants et de leur environnement langagier et culturel, ainsi
que des attentes et suggestions de leurs parents, pourrait effectivement être une base de
réflexion pour la création d’activités qui valoriseraient le bagage initial des enfants et leur
évolution dans les AMP à leurs yeux et aux yeux de leurs parents, générant ainsi une atmosphère
et des émotions positives propices à l’épanouissement des ateliers et de leurs acteurs. Même si
nous n’avons pu recueillir les réponses au questionnaire de l’ensemble des parents ayant un
enfant inscrit aux ateliers de Mehregan, nous sommes tout de même en mesure de retenir trois
attentes principales offrant une base de réflexion et d’évolution à l’Atelier du Coteau. Ces trois
points correspondent aux attentes de l’épanouissement des enfants, des attentes de véritables
ateliers multi-activités qui offrent un panorama d’expériences artistiques variées, et enfin des
attentes d’une familiarisation avec des langues et cultures étrangères qui, dans une logique de
familiarisation, répond d’une démarche d’éveil aux langues et aux cultures qui, pour satisfaire
certains parents, pourraient accorder une attention particulière envers l’anglais, sans pour autant
que cela se fasse au détriment d’autres langues et cultures possibles à aborder.
Nous chercherons donc, dans la conception de notre dispositif, à ce que les enfants
s’amusent et ressentent des émotions positives en s’appuyant sur leurs biographies langagières
pour aborder des langues et des pays qu’ils souhaiteraient découvrir et qu’ils n’ont pas encore
eu l’occasion de rencontrer à l’Atelier du Coteau afin que la diversité des profils d’apprenants
en termes d’ancienneté et de rapport aux langues et aux cultures étrangères ne soit pas un
obstacle à l’épanouissement de chacun. Il s’agira alors de respecter la démarche propre des
approches plurielles, tant dans l’éveil linguistique et culturel qu’artistique, car les parents des
enfants montrent un réel intérêt envers la pluridisciplinarité des AMP qui est un atout fort de
l’offre de l’Atelier du Coteau. Enfin, nous ferons en sorte que notre dispositif suppose la
création d’œuvres valorisant la dimension d’éveil aux langues et aux cultures des AMP, non
seulement au cours de l’exposition, mais aussi plus directement dans l’environnement familial
des enfants par le recours à des supports qu’ils pourront rapporter chez eux et qui traduiront les
éléments abordés aux parents en attente de retours sur ce qui se passe dans les ateliers.
122
CONCLUSION DU RECUEIL ET DE L’ANALYSE DES DONNEES
Ce chapitre se clôt ici après l’analyse des données recueillies dans l’entretien d’Elisa et
Xavier, dans l’entretien de Mehregan, dans les entretiens réalisés auprès des enfants, dans le
questionnaire rempli par les parents et enfin dans le journal de bord et les grilles d’observation
qui retracent le déroulement et le contenu des AMP pendant ma période de stage. Toutes ces
données nous ont déjà permis de valider un critère pour chacun de nos deux premières
hypothèses de travail : le CARAP pourrait être un outil adapté pour l’Atelier du Coteau dans
ses ateliers artistiques plurilingues car certains de ses principes fondamentaux sont déjà
appliqués par Mehregan, et la parole des enfants et de leurs parents ont apporté des pistes de
réflexion pour le développement des activités de ces ateliers. Par la même occasion, nous avons
pu construire une biographie langagière de chacun des enfants inscrits aux AMP qui peut être
élevé au rang d’outil pour adapter la dimension d’éveil aux langues des cultures des activités
en fonction des expériences de leurs participants.
Alors que le recueil de toutes ces données nous a apporté de nombreux éléments de
réponses concernant les enjeux autour desquels travaillent Elisa, Xavier et Mehregan à l’échelle
de l’association et à l’échelle des AMP, nous avons pu retenir divers éléments pour la
conception de notre dispositif. Celui-ci devra avant tout être orienté vers la recherche de
l’épanouissement des enfants qui devront y trouver une source d’émotions positives qui feront
office de médiatrices dans leur rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs grâce à l’utilisation des
biographies langagières pour valoriser leur bagage individuel. Ces émotions positives pourront
être accompagnées dans leur rôle de médiatrices de la rencontre avec d’autres langues et
d’autres cultures par une stimulation de l’imagination des enfants, l’imagination étant l’un des
principaux axes de travail de l’Atelier et de Mehregan. Afin de s’assurer le bien-être des enfants
pendant la mise en place de ce dispositif, il me faudra prendre en compte leur rythme et leur
état de fatigue à leur arrivée de l’école et mettre à profit une intégration de la stimulation
corporelle dont nous connaissons les avantages détaillés dans le cadre théorique et dans ce
chapitre, et dont nous savons aussi qu’il répond d’une valeur fondatrice de l’association reprise
par Mehregan dans son travail. Tous les enfants ayant un bagage langagier différent, mon
dispositif devra les faire s’intéresser à des langues et des cultures qu’ils n’ont pas déjà abordées
dans les AMP afin que tous soient dans une démarche de découverte. Cela pourra
s’accompagner, pour ceux prêts à approfondir leur expérience, de possibilités d’apprentissage
de vocabulaire et/ou d’items culturels qu’ils pourront partager alors avec leurs parents en
rapportant chez eux un objet traduisant ces éventuelles acquisitions et en les faisant transparaître
123
dans la création d’œuvres qui seront exposées et ainsi valorisées lors de l’exposition du mois
de juin. Enfin, il me faudra travailler à la conception du dispositif en portant une attention
particulière au recours aux arts plastiques tout en assurant un degré minimum de
décloisonnement tant pour les pratiques artistiques que pour les langues et les cultures abordées.
Cette démarche permettra de nous inscrire dans la logique des approches plurielles dans leur
sens le plus large, s’assurant ainsi la satisfaction des attentes des parents quant à la notion de
« multi-activités » qui définit les AMP. De plus, ce sera l’occasion d’apporter à Mehregan des
perspectives possibles d’évolution de ses ateliers sans qu’elle se sente en insécurité dans le
recours à des langues qu’elle ne maîtrisera pas forcément. Enfin, nous ferons en sorte que le
dispositif assure un décloisonnement entre les pratiques artistiques et l’éveil aux langues et aux
cultures qui permettra une réelle association de ces deux domaines pour une optimisation des
activités et donc de la durée des AMP, mais surtout pour une optimisation des expériences des
enfants qui pourront profiter des apports mutuels d’une discipline à l’autre.
Nous pouvons déjà anticiper que ce dispositif ne pourra se concevoir en dehors de
certaines contraintes. Le temps en sera une importante : afin de ne pas retarder Mehregan dans
ses projets pour l’exposition, je ne pourrai intervenir longtemps avec chacun des groupes. Sur
une heure d’AMP, il est fort probable que je ne puisse pas monopoliser plus de quinze minutes
pour la mise en place du dispositif, ce qui risque de rester malgré tout une source de stress pour
Mehregan. De plus, il ne reste que cinq semaines avant la fin du stage, supposant alors deux
semaines de conception pour trois semaines pendant lesquelles je pourrai effectuer mon
animation avec les enfants : le peu de temps que cela représente ne me permettra pas de passer
par une phase de test du dispositif en amont et compromet la réalisation d’une évaluation en
aval. Enfin, je suis consciente de certaines limites que le dispositif pourra difficilement
repousser. Il ne pourra, par exemple, prétendre satisfaire l’ensemble des attentes des acteurs de
l’Atelier du Coteau et des AMP. Le contexte dans lequel il sera mis en place fait que je ne
pourrai pas évaluer autrement qu’informellement ses réussites et ses échecs qui sont en réalité
dépendants d’objectifs plutôt généraux qui répondront plus de la dimension de projet que
d’apprentissage. Il s’agira de proposer une rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs qui suscite des
émotions positives dont l’évaluation sera nécessairement subjective et cantonnée aux résultats
sur courts termes, alors qu’un regard sur les résultats sur moyen voire long termes permettrait
de mieux appréhender l’impact sur l’évolution des enfants de ce dispositif d’éveil aux langues
et aux cultures associés aux pratiques artistiques. Passons alors au quatrième et dernier chapitre
de ce mémoire pour aborder, dans le détail, la conception et la mise en œuvre de ce dispositif
didactique.
126
INTRODUCTION A LA CONCEPTION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU
DISPOSITIF DIDACTIQUE
Le dispositif que nous allons présenter maintenant incarne la dernière étape de notre
stage et de ce mémoire. Il s’agit de la mise en place d’une intervention didactique concrète
auprès des enfants des AMP qui, avant toute chose, a été pensée dans le respect des valeurs, des
axes de réflexion et des manières de travailler propres à l’Atelier du Coteau et à Mehregan. Ne
suivant pas d’approche didactique particulière ou en tout cas clairement établie et ayant une
identité artistique forte, mon objectif premier pour l’association et ses acteurs était de proposer
un dispositif qui se trouve à la croisée des chemins entre leur fonctionnement et celui de la
didactique des langues et des cultures à laquelle j’ai été formée pendant cette année. Il était
donc question de trouver un équilibre entre ces deux éléments pour qu’ils puissent s’enrichir
mutuellement. Mais la conception et la mise en œuvre du dispositif suivait aussi l’objectif de
trouver une réponse à notre question initiale : la recherche de la valorisation des émotions des
acteurs des ateliers artistiques plurilingues de Mehregan peut-elle apporter à l’Atelier du Coteau
une amorce de démarche didactique lui permettant d’associer pleinement éveil artistique et éveil
aux langues et aux cultures dans ses AMP ?
Afin d’atteindre ce deuxième objectif, nous avons formulé trois hypothèses dont la
vérification repose au moins partiellement sur notre dispositif. En effet, celui-ci doit confirmer
la pertinence de l’utilisation du CARAP comme un outil adapté aux AMP en s’appuyant sur ce
cadre pour associer arts, pratiques artistiques et éveil aux langues et aux cultures dans les
activités qu’il propose. Il doit également confirmer l’importance du recours aux données
recueillies auprès des enfants et de leurs parents dans la construction de leurs biographies
langagières dans le but de générer chez les jeunes apprenants des émotions positives grâce à la
valorisation de leur propre bagage et de leurs envies de découverte. Enfin, il doit mettre à profit
le travail déjà effectué dans les AMP sur l’imagination pour que celle-ci se fasse la médiatrice
d’une rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs à partir de supports artistiques évocateurs.
Comment cela peut-il se traduire concrètement sur le terrain ? Voilà ce qui va nous
occuper dans ce chapitre qui traitera en premier lieu des ressorts de la conception du dispositif
et de son évolution avant d’aborder les détails de sa mise en place et la manière dont les enfants
ont vécu ce dispositif. Enfin, nous chercherons à en tirer un bilan des échecs et des réussites au
regard de notre question et de nos hypothèses de recherche.
127
Partie I. Conception du dispositif didactique
La perception de la cohérence du fonctionnement des AMP et de l’Atelier du Coteau
s’est réalisée au fur et à mesure de mon stage, ce qui m’a amené à penser mon dispositif très tôt
et à l’ajuster au fur et à mesure de mes recueils de données. Mon travail de conception s’est
donc beaucoup réalisé par tâtonnements, cherchant d’abord à répondre aux problèmes de
terrains observés plutôt qu’à la question de recherche, m’amenant alors à penser au déroulement
du dispositif avant d’en définir préalablement des objectifs de projet et d’apprentissage. Ce
fonctionnement révèle un manque de rigueur didactique certain de ma part, mais il reflète aussi
les difficultés liées à la réalisation d’un travail de terrain en didactique dans une structure qui
ne répond pas de cette approche et de sa méthodologie. Mon dispositif a donc subi plusieurs
révisions initiales dont je vais essayer de rendre compte ici, évoluant au fil de l’avancée de mon
stage et des analyses que j’ai pu tirer des données recueillies sur le contexte et ses acteurs,
intégrant petit à petit les filons de l’association complexe entre théories et pratiques.
Essayant de rassembler en son sein les attentes de chacun des acteurs des AMP tout en
gardant pour objectif la question qui fait l’objet de notre étude, la conception du dispositif
didactique est une étape importante de notre travail car elle reflète l’adaptation nécessaire à de
nombreuses données du contexte pour mener un travail de recherche compréhensif ne pouvant
revendiquer de conditions de recherche en laboratoire. A partir de l’analyse des données
recueillies et du cadre théorique définis plus haut, le dispositif se construit dans sa première
version avant de devoir nécessairement évoluer pour optimiser sa mise en place future. Voyons,
dans cette première partie, quelles ont été les différentes étapes de sa définition.
I.1. Description du dispositif initial
Dans les premières étapes de la conception d’un dispositif didactique, plusieurs
éléments entrent en compte : la durée, le matériel à disposition, les contenus à aborder, les
supports à choisir, les objectifs à définir,… Et tous ces éléments doivent être pensés en
conscience du contexte et du cadre théorique qui doivent apporter des justifications à nos choix
d’étudiant stagiaire en didactique des langues et des cultures. La description du dispositif initial
que nous nous proposons de réaliser à présent reprend les éléments des annexes 11 qui
apporteront au lecteur des détails supplémentaires que nous n’aborderons pas forcément
intégralement ici par souci de concision.
128
I.1.a. Vers la construction du dispositif initial
Le dispositif initial, dans son déroulement, a été pensé selon trois grands types
d’objectifs. Le premier est un objectif de projet de terrain, à savoir proposer un dispositif mêlant
arts, langues et cultures dans les AMP pouvant être valorisé lors de l’exposition des œuvres des
enfants en juin. Le deuxième correspondait à des objectifs de recherche cherchant à mettre en
lumière le potentiel émotionnel des arts au bénéfice d’un éveil aux langues et aux cultures, faire
émerger les représentations autour de langues et cultures étrangères par la musique, la danse et
les arts visuels et souligner l’efficacité d’un apprentissage multi sensoriel, ce qui s’attachait
alors aux références théoriques encadrant mon travail. Enfin, les objectifs d’apprentissage
étaient formulés comme suit :
- Développer la compétence émotionnelle des enfants en stimulant leur sensibilité
artistique :
o Prendre conscience des états émotionnels impulsés par la musique
o Mobiliser des stratégies d’expression de ces émotions : par le corps, par le dessin
et par les mots
- Exprimer par le corps, le dessin puis les mots les représentations que l’on peut avoir
d‘une culture
- S’éveiller aux différentes manières de saluer à travers le monde
- Apprendre le mot « bonjour » dans différentes langues
Ces derniers objectifs ont alors défini les grandes lignes du déroulement de notre dispositif
initial qui s’appuyait aussi en partie sur un type d’activité que Mehregan connaissait pour l’avoir
déjà utilisé dans des contextes d’art thérapie mais qu’elle n’avait jamais fait avec les enfants
des AMP. Celui-ci consistait à faire écouter aux enfants une sélection de chansons
traditionnelles de pays étrangers et de les inviter à se déplacer et bouger dans l’espace au gré
de ce que pouvaient leur évoquer ces pièces musicales et chantées. Ensuite, ces évocations
pouvaient être mises en dessins pour donner lieu à une discussion autour des différentes
réalisations qui aurait aussi été l’occasion d’extérioriser par le verbe les émotions ressenties
pendant l’activité. Puis, le dialogue aurait donné lieu à la découverte du pays d’où était
originaire la pièce musicale et chantée en utilisant le globe terrestre présent dans la salle
d’atelier. Enfin, nous aurions proposé aux enfants d’apprendre comment saluer quelqu’un de
ce pays en abordant un mot équivalent à « bonjour » ainsi qu’une éventuelle posture ou geste
l’accompagnant. Ainsi, le dispositif aurait permis de mobiliser la musique, l’expression
129
corporelle et le dessin tout en servant une activité d’éveil aux langues et aux cultures qui pouvait
durer entre 15 et 20 minutes.
I.1.b. Formulation du déroulement du dispositif initial
Après un échange avec mon directeur de recherche et plusieurs jours de réflexion, le
dispositif s’est précisé petit à petit de manière à ce qu’il corresponde à la définition de la
structure d’une séance destinée aux enfants des AMP. Celle-ci reprend de manière plus détaillée
les idées exposées précédemment, mais ajoute un élément théâtral qui complète alors la
pluridisciplinarité artistique recherchée tout en rendant plus cohérent l’enchaînement d’une
activité à une autre. Cet élément théâtral est en réalité une marionnette en peluche de la forme
d’une tortue qui sert de prétexte aux activités mais aussi de capteur d’attention par sa dimension
nouvelle dans les AMP10.
Le dispositif commencerait donc par la présentation de Lulu la Tortue qui est une grande
voyageuse et qui vient parler de ses voyages aux enfants grâce à de la musique qu’elle ramène
de chacun des pays où elle a séjourné. Lulu lancerait donc un enchaînement de musiques de
plusieurs pays sur lequel les enfants pourraient bouger voire même danser librement en
occupant l’espace de la salle d’atelier. L’objectif serait de voir des changements de mouvements
ou de rythmes de déplacement d’un extrait musical à un autre afin de vivre l’expérience des
changements d’états émotionnels impulsés par la musique, puis prendre conscience de la
dimension culturelle de celle-ci en demandant aux enfants s’ils peuvent deviner dans quels pays
Lulu a pu voyager à partir de ce qu’ils ont entendu. En ne conservant qu’un extrait musical à la
fin de cette première activité, nous nous concentrerions ainsi sur un pays à deviner.
Afin d’aider à deviner quel est ce pays, Lulu présenterait aux enfants différentes
manières d’y dire « bonjour ». Ces « bonjour » pourraient se matérialiser sous la forme de petits
bouts de papier ou d’étiquettes comportant les différents mots rapportés à l’écrit afin de faire
office de souvenirs de voyage que les enfants pourraient choisir puis insérer dans leur dessin.
Ainsi, chaque enfant aurait le choix du « bonjour » qu’il souhaite avoir et intégrer à son dessin.
L’activité suivante consisterait à faire écouter les yeux fermés aux enfants une musique
chantée originaire de ce pays afin qu’ils prennent le temps d’imaginer ce que cela leur évoque,
puis de leur faire écouter une deuxième fois pendant laquelle ils pourraient dessiner ce qu’ils
10 Pendant toute la durée du stage, je n’ai assisté qu’à une seule séance où des activités théâtrales étaient mobilisées
et avaient beaucoup plu aux enfants, et celles-ci n’impliquaient pas le recours à une marionnette qui devient alors
du ressort de la nouveauté pour les enfants dans mon dispositif. Je n’ai appris que plus tard que Mehregan avait
utilisé une marionnette en forme de chat dans les AMP au tout début de la saison 2014-2015, ce qui n’a pas
empêché ma tortue de capter l’attention des enfants à chaque intervention.
130
ont imaginé. Ici, le défi posé aux enfants serait de réussir à réaliser leur dessin sur le temps de
la pièce musicale chantée afin de leur apporter une approche dynamique tout en limitant la
durée totale du dispositif qui ne peut utiliser toute l’heure prévue pour l’AMP.
Une fois les dessins réalisés, nous les accrocherions au mur afin qu’ils soient visibles
par tout le groupe pour que chacun puisse raconter ce qu’il a voulu dessiner et dévoiler
finalement, si cela ne s’est pas réalisé plus vite, le nom du pays dans lequel Lulu est partie. Lulu
présenterait alors quelques photos de son voyage qui pourraient donner lieu à un échange avec
les enfants. L’objectif ici est de permettre aux enfants de s’exprimer sur ce qu’ils voient,
éventuellement de faire des comparaisons avec ce qu’ils ont dessiné ou simplement imaginé en
écoutant la musique et de les laisser aller à l’expression de ce qu’ils ressentent, ce qui nous
permettra d’avoir une idée des émotions mobilisées pendant le dispositif.
I.1.c. Justification du dispositif par rapport au contexte
Bien qu’à ce stade la conception du dispositif soit encore très générale, elle répond aux
éléments définis dans le chapitre précédent comme lignes à suivre pour l’adéquation de notre
proposition aux enjeux liés au contexte de mise en place. Tout d’abord, il prend en compte
l’objectif de génération d’émotions positives en jouant sur la dimension affective que peut
apporter Lulu la Tortue à la rencontre des enfants avec une autre langue et une autre culture.
Entamer les activités par un temps de déplacements et de mouvements permettra aux enfants
d’extérioriser l’énervement et la fatigue accumulés dans la journée avant d’aborder la suite du
dispositif pour laquelle ils auront sans doute besoin de plus de concentration.
Le fait que Lulu rapporte aux enfants des « bonjour » comme souvenirs de voyage
confortera une atmosphère positive où ces mots prendront une dimension affective renforcée
par le fait que chacun pourra choisir celui qui lui plaît. En les intégrant aux dessins ensuite
réalisés, les « bonjour » des pays abordés avec Lulu apparaîtront directement sur les œuvres
exposées, valorisant ainsi cette dimension des AMP lors de l’exposition. Enfin, ces souvenirs
sont aussi des opportunités d’apprentissage pour les enfants qui pourraient être en mesure de
mémoriser ceux qu’ils ont choisi, et ainsi aller plus loin que l’expérience d’éveil pour ceux qui
le peuvent et le souhaitent.
En mobilisant l’input théâtral avec Lulu, la musique, l’expression corporelle et le
dessin, le dispositif répond à l’objectif de décloisonnement des disciplines artistiques tout en
conservant les arts plastiques en guise d’activité principale, respectant ainsi l’attente de multi-
activités des parents tout en restant dans des activités facilement réutilisables ou réadaptables
par Mehregan. De plus, nous conservons la mobilisation de l’imagination des enfants comme
131
base des dessins créés, ce qui prolonge le travail d’Elisa et Xavier, celui de Mehregan mais
aussi ses convictions quant aux apports de l’imagination à l’éveil aux langues et aux cultures
des enfants qui peuvent ainsi plus facilement « se laisser porter » par de nouveaux horizons,
même lorsque ceux-ci ne sont pas forcément familiers (voir entretien en annexe 8.2).
Ainsi, le dispositif propose une véritable association des arts, des pratiques artistiques
et de l’éveil aux langues et aux cultures en utilisant les premiers comme supports de découvertes
d’une langue et d’un pays, mais aussi en utilisant les langues et les cultures comme supports de
création plastique. Chaque discipline apporte alors quelque chose à l’autre et les deux sont donc
mutuellement valorisées. Mais notre dispositif n’est pas seulement conçu pour répondre aux
enjeux posés par le contexte de sa mise en œuvre, il s’appuie aussi sur les éléments développés
dans notre cadre théorique.
I.1.d. Justification du dispositif par rapport au cadre théorique
Au regard de notre cadre théorique, le dispositif proposé cherche à mettre à profit le
pouvoir évocateur des arts (Arleo, 2000), et notamment, dans notre cas, de la musique, pour
déclencher une réponse émotionnelle chez les enfants (Leroy, 2008 ; Zask, 2008). Cette réponse
émotionnelle est valorisée comme levier d’expression artistique par le temps d’expression
corporelle et de réalisation des dessins, mais aussi finalement comme levier de parole (Borgé,
2014 ; Witzigmann, 2014) avec la discussion proposée sur les dessins affichés et les photos
rapportées par Lulu en fin de dispositif. Les enfants seront ainsi accompagnés dans le passage
de la réponse émotionnelle impulsée par la musique à l’interprétation cognitive de ce que celle-
ci leur aura évoqué (Puozzo Capron, 2014) en prolongeant cette expérience avec le
commentaire des dessins et des photos. Ainsi, les dessins réalisés traduiront à la fois les
émotions et les représentations des enfants sur les langues et cultures abordées, à l’instar de ce
qu’a pu déjà mettre en place Christiane Perregaux (2009) dans ses recherches sur le dessin
réflexif.
La suscitation d’une réponse émotionnelle puis cognitive chez les enfants va donc les
impliquer personnellement dans le dispositif (Aden, 2010 ; Arleo, 2000), ce qui sera appuyé
par une invitation à choisir individuellement un « bonjour ». Le choix de ces « bonjour » permet
alors de personnaliser l’investissement de chacun des enfants dans les activités et dans son
rapport à la langue et au pays présentés ; ce processus se poursuivra ensuite avec la réalisation
des dessins. L’implication se fera également par le recours au corps en début de dispositif mais
aussi au moment d’aborder certains gestes ou postures de salutations qui pourraient
éventuellement servir de support mnésique au mot signifiant « bonjour » dans le pays où ce
132
geste ou cette posture sont mobilisés pour saluer quelqu’un (Dubrac, 2014 ; Potapushkina
Delfosse, 2014 ; Puozzo Capron & Perrin, 2014 ; Mallet, 2013).
L’éveil aux langues et aux cultures dans le dispositif se fera médiateur de la rencontre
des enfants avec l’Autre et l’Ailleurs (Aden & Leclaire, 2014 ; Bourdet, 2014) par l’expérience
artistique, mais il sera aussi incarné par Lulu la Tortue qui concrétise alors la « médiation
affective » (Goutéraux, 2010) nécessaire à toute entreprise d’éveil ou d’EA d’une langue et
d’une culture étrangères. La valorisation des bagages langagiers des enfants par la sélection de
pays qu’ils aimeraient visiter ou de langues qu’ils aimeraient apprendre favorisera cette
médiation affective qui enrichit des parcours des apprenants les dispositifs d’éveil aux langues
et aux cultures (Lörincz, 2014 ; Billiez, 2002 ; Perregaux, 2002). Grâce à l’atmosphère impulsée
par la musique qui caractérise la base du dispositif, les enfants seront ainsi invités à changer de
référents corporels et sonores, démarche accompagnée ensuite par le choix des « bonjour » qui
impliquera une certaine appropriation de la rencontre par l’enfant. Il sera ainsi dans un
processus de subjectivation de l’expérience apportée par le dispositif qui cherche alors à
réveiller une forme d’empathie en lui (Aden, 2014, 2010), donnant « une place à la perception
subjective qu[‘il] a de lui-même et de l’autre » (Aden, 2010) traduite dans la réalisation des
dessins.
Enfin, notre dispositif reprend les principes de la « pédagogie de la créativité »
d’Isabelle Puozzo Capron (2014, 2013). Il apporte une dimension nouvelle aux AMP sans en
modifier les contenus et il est divisé en plusieurs tâches menant à la réalisation d’un dessin
exposé lors de l’exposition. Il cherche à augmenter le SEP des enfants par un choix de pays
abordés correspondant à des sources de motivation dans leur biographie langagière, les amenant
ainsi à dépasser leurs premières expériences de rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs et il favorise
la construction d’endocepts par la génération d’émotions positives dans cette découverte d’une
langue et d’une culture étrangère. De plus, le recours à l’imagination du pays où a voyagé Lulu
grâce à la musique permet de développer la créativité des enfants qui s’appuie elle-même sur
les réseaux neuronaux de l’imagination (Aden citée par Puozzo Capron & Perrin, 2014).
Plus concrètement, notre dispositif se construit aussi autour d’objectifs issus du
CARAP. Ainsi, parmi les objectifs de savoirs, notre dispositif permet aux enfants d’avoir des
connaissances sur la diversité des langues (descripteur K5). Cela passe par exemple, par la
présentation d’un voyage de Lulu dans un pays où plusieurs langues sont employées, lui
permettant alors de rapporter aux enfants des « bonjour » dans plusieurs langues différentes
pour un même pays visité. Cela permet alors aux enfants de savoir qu’il existe une grande
pluralité de langues à travers le monde (K5.1), mais aussi une grande diversité d’univers sonores
133
(K5.2) apportée par les « bonjour » en plusieurs langues mais aussi par les musiques écoutées
et de savoir qu’il existe une grande diversité de systèmes d’écriture (K5.3) en découvrant des
pays et des « bonjour » ne recourant pas à l’alphabet latin. Le dispositif permettra aussi de
savoir qu’il existe (encore) une grande pluralité de cultures à travers le monde (K12.1) en
permettant aux enfants de découvrir au moins deux voyages différents effectués par Lulu. Dans
le domaine des savoir-être, notre dispositif permettra de développer une sensibilité des enfants
aux différences langagières/culturelles (A2.2), éventuellement même d’accepter qu’une autre
langue/culture puisse comporter des éléments différents de leur propre langue/culture (A4.3).
Même si cela ne sera pas concrètement évaluable, des résultats pourraient peut-être se percevoir
sur le long terme quant au développement de leur confiance en leurs propres capacités
d’apprentissage linguistique (A17.4) grâce à un dispositif qui, par la présentation des
« bonjour » et des manières de saluer dans plusieurs pays familiers comme moins familiers,
rendrait accessible l’expérience du premier pas vers un Autre avec qui les enfants ne partagent
pas la même langue maternelle. Parmi les savoir-faire, Lulu la Tortue apporte aux enfants des
AMP une opportunité de savoir observer les sons et les écritures dans des langues peu ou pas
connues (S1.2 et S1.3), mais aussi, pour ceux à même de passer ce cap, d’être capable de
mémoriser des éléments non familiers (S7.1) et de savoir les reproduire (S7.2) avec les
possibilités d’apprentissage des « bonjour » rapportés comme souvenirs de voyage. En ayant
réussi à accorder notre dispositif mêlant l’éveil aux langues et aux cultures aux arts et aux
pratiques artistiques aux descripteurs du CARAP, nous venons donc d’effectuer un pas
supplémentaire vers la validation de notre première hypothèse de travail qui pourra se confirmer
une fois le dispositif mis en place et évalué pour déterminer si les objectifs définis ici ont été
atteints avec les enfants.
I.2. Evolutions dans la conception du dispositif
Bien que le dispositif établi initialement soit justifié en termes d’adéquation avec le
contexte de mise en place et le cadre théorique de notre recherche, celui-ci a dû être remodelé
pour pallier certaines limites et surtout faire face à des contraintes qui se sont accentuées ou
ajoutées avant sa mise en place. Plus que sur le plan théorique, c’est sur le plan pratique que
notre dispositif a dû être révisé afin de répondre à certaines difficultés imposées par le contexte
des AMP, ce qui nous amène à présent à définir les limites et contraintes à l’origine de ses
modifications, jusqu’à sa formulation définitive en vue de sa mise en place.
134
I.2.a. La contrainte du temps
L’une des plus grosses difficultés qui se sont imposées à nous a été le temps. Comme
nous l’avions déjà anticipé en conclusion du chapitre précédent, à la suite du recueil et de
l’analyse des données a commencé un compte à rebours de cinq semaines avant la fin du stage,
ce que nous avions cherché à diviser en deux semaines de conception et trois semaines de mise
en place du dispositif. L’objectif était que je puisse intervenir avec chaque groupe pendant
environ 15 minutes sur les trois dernières semaines de stage. Or, à moins de deux mois du
vernissage de l’exposition des créations des enfants, Mehregan commençait à courir après le
temps pour réussir à réaliser avec chaque groupe un minimum d’œuvres, sachant que ces deux
mois étaient entrecoupés par deux semaines de vacances pendant lesquelles les AMP n’étaient
pas ouverts. La mise en œuvre de mon dispositif allait amputer chaque atelier d’environ 15
minutes qui se révélaient alors précieuses pour les projets d’arts plastiques de Mehregan,
d’autant plus que certains supposaient de se rendre au parc de Procé pour lequel il fallait
compter 10 à 15 minutes de déplacement aller-retour. Même si ce que je proposais de réaliser
avec les enfants apportait des créations supplémentaires à exposer, cela ne pouvait remplacer
ce que Mehregan souhaitait faire avec les enfants, et des décisions ont dû être prises.
A une semaine de la mise en place de mon dispositif, ma tutrice a cherché à gagner du
temps en demandant aux parents s’ils étaient d’accords pour que leurs enfants restent 15
minutes de plus à chaque atelier, ce qui n’a pas été possible. Ma tutrice m’a alors demandé s’il
était possible pour moi de préparer un dispositif qui puisse se réaliser en extérieur lors des
sorties au parc. Etant donné le matériel que supposait d’avoir mon dispositif et le besoin de
focaliser l’attention des enfants sur chaque activité, je me suis retrouvée dans l’obligation de
décliner la proposition de Mehregan au risque de devoir entièrement repenser mon dispositif,
ce qui n’était pas envisageable en moins d’une semaine. Au parc, les bruits ambiants et les
nombreux passages de promeneurs auraient été des perturbateurs d’attention sans laquelle la
réussite du dispositif était mise à mal. Le seul compromis restant était alors de réduire le temps
de réalisation de mon dispositif à chaque séance de 10 à 15 minutes au lieu de 15 à 20 minutes.
Ce changement de durée allait alors engendrer un certain nombre de changements, d’autant plus
que mon dispositif présentait déjà le risque d’être trop long tel qu’il était conçu. De surcroît, je
ne réaliserai que plus tard que le calendrier civil allait lui aussi m’ajouter la contrainte de deux
vendredis fériés au retour des vacances de printemps, m’obligeant à réduire mon dispositif à
seulement deux interventions pour le groupe du vendredi contre trois pour les groupes du mardi
et mercredi.
135
I.2.b. Pallier une contrainte, ajouter une limite
Tel qu’il était conçu initialement, mon dispositif ne pouvait être réalisé à chaque séance
en seulement 10 à 15 min. Chaque activité s’associait aux autres dans un ordre qui rendait
cohérente ma démarche de terrain et de recherche, mais il me fallait maintenant faire des choix
qui allaient me permettre d’en réaliser un maximum tout en ayant conscience que certaines
parties devraient disparaître. Mes premières réflexions se sont tournées vers les possibilités
d’aménagement de ce qui avait été conçu sur les trois séances prévues avec chacun des groupes.
Chercher à aborder un pays par séance avec toutes les activités décrites plus haut n’était pas
envisageable bien que cela aurait permis de travailler sur une unité d’activités complètes à
chaque fois. Une autre solution était d’utiliser la première séance pour faire les temps
d’expression corporelle, d’écoute de la pièce musicale chantée et de réalisation du dessin, la
deuxième séance à la découverte des « bonjour » et à la discussion sur les dessins et enfin la
troisième à la découverte des photos. Or, cette solution supposait de n’aborder qu’un pays par
groupe, ce qui me semblait préjudiciable à un dispositif se réclamant des approches plurielles
et du décloisonnement entre les langues et les cultures.
Mon choix s’est donc porté sur la suppression de l’activité d’expression corporelle
initiale qui avait pour but principal de permettre aux enfants d’évacuer l’énervement et la
fatigue de leur journée pour être plus réceptifs aux activités suivantes. Cela impliquait alors que
mon dispositif écartait une grande partie du travail d’expérimentation sur les apports de la
sollicitation du corps à la situation d’EA et répondait moins aux besoins liés au rythme des
enfants des AMP. Il s’agit là d’une limite très importante du dispositif tel qu’il a finalement été
réalisé car il n’a pas permis aux enfants d’extérioriser par le mouvement ce qu’ils pouvaient
ressentir avant d’entamer les autres activités. Cette limite s’est accentuée après la première
semaine de mise en œuvre lorsque Mehregan a suggéré que j’entame mon intervention avec les
groupes des mardis et vendredis sur la fin des temps de goûter afin d’empiéter le moins possible
sur le temps des AMP. Si cela a certes été nécessaire pour ma tutrice qui avait besoin de temps
avec les enfants pour préparer au mieux l’exposition, cela s’est fait en dépit des enfants qui ont
vu leur temps de pause entre la sortie de l’école et le début des activités diminuer, sans même
pouvoir évacuer physiquement les tensions accumulées par une activité corporelle.
La recherche d’adaptation à la contrainte du temps n’a donc pas été concluante en
générant une limite à notre dispositif mais en renforçant aussi un paradoxe. Alors que mon
travail cherchait à susciter des émotions chez les enfants et à leur donner un temps et un espace
d’expression, il me fallait concevoir un dispositif de courte durée qui allait donc me faire
136
accorder plus d’attention au déroulement de chaque activité dans le respect du temps qui m’était
accordé qu’à l’écoute des réactions des enfants. Cela a d’ailleurs fini par se matérialiser
concrètement par la réduction de moitié de la surface de la feuille sur laquelle les enfants
devaient dessiner ce que la musique leur évoquait, musique dont la durée fixait déjà une limite
de temps à leur expression graphique. Ce changement de format a été décidé dès la fin de ma
première intervention avec le groupe du mercredi, premier groupe auprès duquel le dispositif a
été mis en place. A la fin de l’AMP, une fois les enfants partis, Mehregan m’a expliqué que le
format d’une feuille A4 était trop important pour le temps qui était accordé à la réalisation du
dessin et qu’un format A5 conviendrait mieux, d’autant plus qu’il pouvait donner l’illusion d’un
format carte postal pertinent dans le cadre d’une découverte des voyages de Lulu la Tortue.
Même si cela s’est révélé judicieux sur la suite de la mise en place du dispositif, il représentait
encore une réduction des possibilités d’expression des enfants, ce qui ne correspondait pas à la
démarche pensée initialement en accord avec le fonctionnement du contexte et le cadre
théorique présentés dans la première moitié de ce mémoire.
I.2.c. Autres limites du dispositif
La durée du dispositif à chaque séance restant limitée, il nous faut préciser ici que nos
interventions présentent l’inconvénient de devoir aborder un pays et sa ou ses langues en moins
de 15 minutes, ce qui implique de faire des choix de supports musicaux et photographiques
évocateurs mais qui pour autant n’enferment pas les visions des enfants au peu qui leur aura été
présenté. Cela comporte un risque d’autant plus important que nous n’aurons pas suffisamment
de temps pour pouvoir mettre à plat les éventuels stéréotypes que les enfants pourront exprimer
ou se construire à chaque intervention.
Or, risquer de se confronter aux représentations stéréotypées que les enfants peuvent
avoir d’une culture est déjà ce qui sous-tend la réalisation des dessins à partir de l’écoute des
pièces musicales chantées qui seront choisies pour leur pouvoir évocateur des pays d’où elles
sont originaires. De fait, notre dispositif trouve aussi une limite dans sa supposition que les
enfants vont être portés par la musique et qu’ils vont effectivement avoir des idées quant à ce
qu’ils vont dessiner, sans parler du fait que nous supposons aussi qu’ils seront à même de
deviner les pays dans lesquels Lulu est partie grâce à la musique et aux « bonjour » rapportés.
Il s’agit-là d’un pari osé qui pourrait mener à d’éventuels dysfonctionnements du dispositif.
De plus, la présentation des « bonjour » en milieu d’intervention ne semble pas
forcément pertinente sur le plan de la validité sociale, les salutations ayant plus de sens si elles
sont abordées en début de séance. Néanmoins, cette limite est compensée ici par le fait qu’il
137
s’agit d’une enquête où les « bonjour » font office d’indices dans la recherche du pays dans
lequel la tortue a voyagé. Outre cela, nous pouvons critiquer l’intégration de mots écrits dans
un dispositif destiné à des enfants qui ne maîtrisent pas tous la lecture. En effet, l’introduction
de la dimension écrite d’une langue peut être une source de controverses11 que nous écarterons
ici car ce qui importe dans le cadre des AMP n’est pas tant que les enfants puissent lire les
« bonjour » rapportés par Lulu mais qu’ils puissent simplement remarquer les changements
graphiques que supposent des alphabets ou des systèmes d’écriture différents de celui qu’il
peuvent observer dans leur vie quotidienne.
I.2.d. Reformulation du dispositif définitif
Etant données les contraintes et les limites de notre dispositif tel qu’il était conçu
initialement, nous avons cherché à le préciser et le modifier de manière à ce qu’il soit plus
adapté au contexte de sa mise en œuvre et qu’il puisse être plus efficient pour les enfants. Il est
désormais détaillé par séance dans une logique évolutive sur les trois semaines de déroulement
prévues. Ainsi, les deux premières interventions suivent le même fonctionnement, et la dernière
servira de temps de conclusion du dispositif avec les enfants.
Les deux premières séances suivront donc le déroulement suivant : Lulu la Tortue se
présente aux enfants en les invitant à un jeu où leur mission consiste à trouver dans quel pays
elle est partie en voyage. Elle commence par leur expliquer qu’elle leur a rapporté des souvenirs
qui sont en fait des « bonjour » du pays à deviner. Après avoir découvert ces « bonjour »,
chaque enfant choisit l’expression de son choix en la disant à voix haute à Lulu qui lui remet
alors un « bonjour » qui correspond à l’expression choisie. Il prend la forme d’un véritable petit
cadeau constitué de l’expression choisie par l’enfant écrite sur étiquette autocollante et écrite
une deuxième fois sur un petit bout de papier. Le petit bout de papier est pour l’enfant, il peut
le garder pour le rapporter chez lui s’il le souhaite. L’étiquette servira à orner le dessin qu’il
s’apprête à faire. Lulu pourra d’ores et déjà demander aux enfants s’ils ont une idée du pays
qu’elle a visité. Puis, en guise de deuxième indice, la tortue leur fait écouter une pièce musicale
et chantée provenant de ce pays. Pendant cette première écoute, ils pourront fermer les yeux et
prendre le temps de définir ce que la musique leur évoque en termes de couleurs, de paysages,
de personnes, … Si le pays n’a pas encore été deviné, Lulu pourra alors demander à nouveau si
quelqu’un pense connaitre le nom du pays d’où vient la musique écoutée. Enfin, la musique
11 Lors du premier semestre du Master 2 Didactique des Langues et des Cultures, nous avions abordé cette question
avec le jury d’examen de la conception d’un dispositif didactique d’éveil aux langues en ligne dans lequel nous
avions déjà choisi de recourir à la dimension graphique de différents systèmes d’écritures.
138
sera relancée une dernière fois pour que chaque enfant dessine ce qu’il a pu imaginer du pays
en question. Lorsque la musique est terminée, on arrête de dessiner. Au préalable, on aura
demandé aux enfants de coller sur leur feuille l’étiquette de « bonjour » qu’ils ont reçu pour
que cela accompagne leur dessin. Lorsque le pays aura été deviné, il pourra être cherché sur le
globe terrestre.
Pour la réalisation de ces deux premières séances, il faudra avoir à disposition pour
chacun des trois groupes un appareil pouvant diffuser de la musique, une feuille de papier par
enfant et des crayons de couleur, des crayons feutres et des pastels afin que chaque enfant puisse
avoir accès à tout moment de la réalisation du dessin aux couleurs qu’ils souhaitent utiliser. Il
faudra également veiller à ce que le globe terrestre soit facilement accessible pendant
l’intervention. Afin de ne pas déranger Mehregan en lui empruntant son ordinateur avec lequel
elle diffuse habituellement de la musique pendant les AMP, je prévois un lecteur portable
personnel et je me charge également de la préparation des « bonjour » sur les étiquettes
enveloppées de papier, le tout scellé par une petite gommette de couleur. L’ensemble de
l’intervention se déroulera au sol où je disposerai des coussins en cercle au centre de la salle
pour que les enfants puissent s’asseoir confortablement. Dans le cercle un coussin est prévu
pour Mehregan et un autre pour moi afin que tous les acteurs du dispositif soient à même
hauteur, dans une disposition qui permette le dialogue.
La troisième séance, si elle peut exceptionnellement durer cinq minutes
supplémentaires, reprendra alors le même schéma de déroulement que les deux premières à la
découverte d’un troisième et dernier pays pour les enfants avant de passer à une discussion
autour des dessins réalisés par chaque groupe pendant ces trois semaines. Il faudra alors afficher
l’ensemble des dessins du groupe au mur afin que tous puissent les voir et discuter librement
de ce qui a été représenté. L’objectif est que chaque enfant s’exprime sur ce qu’il a dessiné et
pourquoi. Puis, Lulu montrera quelques photos de ses voyages qui pourront enrichir les
échanges avec les enfants entre ce qu’ils avaient pu imaginer et ce qu’ils perçoivent des photos.
En passant en revue les dessins et les photos, nous pourrons chercher à redemander aux enfants
s’ils se rappellent des « bonjour » des trois pays visités.
Cette troisième séance nécessitera le même matériel que les deux précédentes en plus
de matériaux permettant d’accrocher les dessins au mur ainsi que de quoi diffuser les
photographies. Pour les mêmes raisons que pour la diffusion de la musique, j’apporterai ma
tablette personnelle pour la réalisation de cette dernière activité. Cette dernière intervention
pourra également se dérouler assis par terre sur des coussins, mais cette fois-ci face au mur sur
lequel les dessins auront été accrochés.
139
Chaque intervention a été pensée par groupe autour des pays suivants dont nous
justifions le choix au regard de la biographie langagière des enfants des AMP (voir infra
chapitre III partie III.1) :
- Pour le groupe du mercredi : l’Espagne afin de commencer par un pays qui peut sembler
plutôt familier aux enfants et dont Rose, l’une des enfants les plus timides, semble
garder des souvenirs très positifs ; la Chine car c’est un pays qui attire notamment Maya,
Thomas et Rose et qui nous permettra d’aborder un système d’écriture différent de celui
que les enfants connaissent ; Tahiti en référence à Rosemay qui souhaiterait visiter « le
pays des Vahinés ».
- Pour le groupe du vendredi : l’Inde pour Marie qui souhaiterait y voyager et un pays du
Moyen-Orient pour Agathe qui souhaiterait apprendre l’arabe ; malheureusement, la
question d’un troisième pays a été remise en cause par la prise de conscience des
vendredis fériés du mois de mai qui ne me laissaient plus que deux interventions
possibles avec ce groupe avant la fin de mon stage.
- Pour le groupe du mardi : un pays d’Afrique pour Victor qui est attiré par ce continent,
le Japon pour Marie qui aimerait apprendre le japonais et la Russie pour Lucien qui
aimerait y voyager.
Ces premiers choix seront révisés, comme nous le mentionnerons plus loin, par des ajustements
réalisés sur le dispositif en cours de mise en place mais qui ne pourront s’expliquer que par un
bilan des premières séances que nous nous apprêtons à décrire et analyser dans la partie
suivante.
Partie II. Mise en place du dispositif
Le dispositif a été mis en place à partir du mercredi 1er avril jusqu’au mardi 5 mai, dans
les AMP se déroulant de 17h à 18h au sein du bâtiment de l’Atelier du Coteau. Afin de conserver
une atmosphère propice au calme et à la focalisation des enfants sur les différents supports
utilisés, l’intégralité des interventions se sont déroulées dans la salle d’atelier. Afin de ne pas
faire perdre trop de temps à Mehregan mais aussi afin d’inviter les enfants à entrer dans mon
dispositif dès le début, je préparais la salle et le matériel avant leur arrivée, ce qui leur permettait
à tous d’entrer et de pouvoir tout de suite s’asseoir sur les coussins, prêts à commencer l’activité.
Etant donnée mon implication active dans le déroulement du dispositif, aucun recueil de
données n’a pu être effectué par un observateur extérieur ; l’ensemble du déroulement de mes
140
interventions a été détaillé dans le journal de bord (voir annexe 6) le soir, à la suite de chaque
AMP. Pour permettre au lecteur de comprendre la logique de certains changements effectués
sur le dispositif au cours de sa mise en place auprès des enfants, la partie suivante est divisée
selon les trois séances organisées, qui sont elles-mêmes divisées selon les trois groupes d’AMP.
Nous commencerons donc, à chaque fois, par aborder le déroulement des séances avec le groupe
du mercredi, puis avec celui du vendredi et enfin avec celui du mardi puisque c’est dans cet
ordre que le dispositif a été mis en place.
II.1. Premières séances
La première séance avec chaque groupe a véritablement servi à la rencontre des enfants
avec Lulu la Tortue et à leur appréhension de l’organisation des activités qu’ils allaient faire
pendant trois semaines avec moi en début d’AMP. Nous verrons que cette première séance a
aussi fait office de test pour mieux préparer les séances suivantes en fonction de différents
paramètres comme la véritable durée de l’intervention, la valence (positive/négative) des
réactions des enfants à ces nouvelles activités ainsi que les retours de Mehregan qu’il allait
falloir que je prenne en compte pour la suite du dispositif.
II.1.a. L’Espagne avec le groupe du mercredi
Pour cette première séance du dispositif, tous les enfants du groupe des AMP du
mercredi étaient présents, à l’exception de Rose. Cette absence était quelque peu regrettable car
le choix du premier pays à découvrir s’était porté sur l’Espagne, choix qui était notamment en
lien avec sa biographie langagière dans le but de favoriser son implication dans l’activité.
Néanmoins, la découverte de ce pays nous a permis de commencer avec la rencontre d’une
langue et d’une culture qui n’était pas entièrement étrangères aux enfants.
Afin d’immiscer le calme parmi les enfants sans pouvoir effectuer d’introduction
impliquant de l’expression corporelle, je leur ai expliqué, alors qu’ils étaient encore dans le
petit vestiaire, qu’ils allaient rencontrer une amie à moi qui allait venir leur raconter l’un de ses
voyages. Or, cette amie était plutôt timide, et il fallait donc aller s’installer dans le calme, sans
faire de bruit puis fermer les yeux pour qu’elle arrive. Cette petite histoire a été très efficace
pour faire entrer les enfants dans un cadre calme et canaliser leur attention sur les activités que
Lulu la Tortue allait leur proposer. Lorsqu’ils se sont installés dans la salle d’atelier et ont
ouverts les yeux pour découvrir la marionnette, ils ont tous semblé agréablement surpris et se
141
sont tout de suite focalisés sur elle, s’adressant directement à elle lorsqu’ils voulaient poser des
questions.
Parmi les trois « bonjour » rapportés comme souvenirs, Maya, Adèle et Thomas ont
choisi « Hola », Rosemay « Buenos días » et Arthaud « Buenas tardes ». Lorsque Lulu les
prononçait, les enfants les répétaient spontanément et ont eux-mêmes été capables de redonner
le nom du « bonjour » qu’il souhaitait avoir comme souvenir. Ils ont semblé accorder de
l’importance à la dimension matérielle de ces salutations sous forme de souvenirs. En allant au
parc après mon intervention, plusieurs enfants ont fait la réflexion qu’ils avaient laissé leur
« bonjour » dans l’atelier et qu’ils ne voulaient pas oublier de le récupérer avant de rentrer chez
eux. Certains ont même demandé à avoir les autres « bonjour » pour les garder chez eux ou
faire un autre dessin sur l’Espagne à la maison.
Dès la première écoute de la pièce musicale et chantée (un extrait d’un titre flamenco
contemporain dont la référence se trouve en annexe 11.2), Arthaud a été en mesure de trouver
que Lulu était partie en Espagne après quelques autres propositions données par ses
compagnons d’AMP. Nous avons cherché sur le globe terrestre où se trouvait la France et où
se trouvait l’Espagne, puis nous avons lancé la deuxième écoute pour réaliser le dessin. Cette
phase de la séance a souligné deux difficultés chez certains enfants. Tout d’abord, Maya et
Adèle ont exprimé des difficultés à ressentir des choses pendant la première écoute et elles se
sont senties un peu prises au dépourvu au moment de dessiner. Au moment de leur expliquer
qu’ils allaient dessiner, tout en réécoutant la musique, ce qu’ils avaient pu imaginer du pays où
Lulu était partie, Maya s’est exclamée qu’elle n’avait rien vu en fermant les yeux, et Adèle a
précisé qu’elle n’avait rien vu non plus. J’ai donc essayé de les rassurer en leur disant de se
laisser porter par la deuxième écoute et qu’elles réussiraient à dessiner quelque chose qui leur
fait penser à l’Espagne. Ensuite, la deuxième difficulté a été de devoir terminer leur dessin sur
un temps restreint. Cela n’a pas posé de problèmes à Rosemay qui a terminé un peu avant la fin
de la musique, mais Maya notamment s’est sentie frustrée de ne pas avoir eu le temps de finir
ce qu’elle souhaitait dessiner, se plaignant de cela tout le long du chemin pour aller au parc. En
entendant cela, Mehregan a donc proposé que les enfants qui le souhaitaient terminent leur
dessin en attendant l’arrivée de leurs parents à la fin de l’AMP. Une fois rentrés, seule Adèle
est partie aussitôt ; j’ai donc remis la musique à ceux qui restaient et ils ont pu aller au bout de
ce qu’ils voulaient dessiner. Ils semblaient très contents et auraient aimé rapporter leur dessin
chez eux. Je leur ai proposé, s’ils le souhaitaient, de faire un autre dessin sur le thème de
l’Espagne chez eux et de le rapporter la semaine prochaine.
Les dessins réalisés par ce groupe sur le thème de l’Espagne sont les suivants :
142
Dessin de Maya Dessin d’Arthaud
Dessin d’Adèle Dessin de Rosemay
Dessin de Thomas
Dans l’ensemble, les dessins présentent des couleurs vives et certains enfants ont dessiné des
éléments que nous pourrions considérer comme symboliques des représentations que les enfants
pouvaient avoir en écoutant la musique : cheval (dessins de Rosemay, Arthaud et Maya),
danseuses en robe de couleur (dessins de Rosemay et Maya), fleur qui danse (dessin de
Thomas), château et castagnettes (dessin d’Arthaud). Seul le dessin d’Adèle est plus difficile à
interpréter. La discussion prévue lors de la troisième séance pourra nous apporter plus de
précisions quant à ce que les enfants ont voulu dessiner.
A la fin de cette séance, Mehregan et moi nous sommes mises d’accord pour réduire le
format de la feuille de dessin des enfants du format A4 au A5 afin que ce soit plus cohérent
avec le temps qu’ils ont pour dessiner (ce qui pourrait peut-être aussi limiter les risques de
143
frustration abordés plus haut) et aussi pour avoir des dessins au format carte postale à présenter
comme un tour du monde lors de l’exposition.
II.1.b. L’Inde avec le groupe du vendredi
Cette première séance avec le groupe du vendredi s’est révélée être assez particulière
car sur les trois enfants inscrits à l’AMP de ce jour, seule une était présente. Il m’a donc fallu
mener mon dispositif avec Marie de manière individuelle, mais le choix du pays à découvrir
s’était fait à partir de sa biographie langagière et son envie de voyager en Inde, ce qui devait
donc être une intervention qui suscite son intérêt et sa curiosité.
La rencontre avec Lulu la Tortue s’est effectuée de la même manière qu’avec le groupe
précédent, et Marie y a tout de suite porté beaucoup d’attachement : elle cherchait à lui faire
des caresses, demandait si elle pouvait lui faire un bisou ou un câlin. Ce type de réaction a donc
tout de suite créé un lien affectif entre elle et la marionnette.
En découvrant les « bonjour » rapportés par Lulu en hindi, bengali et tamil (नमस्ते,
नमस्कार et வணக்கம்), Marie a appris que ces « bonjour » étaient accompagnés d’un geste
(mains jointes à hauteur de la poitrine, tête inclinée vers le bas) qu’elle n’a pas hésité à effectuer
à chacune des trois formes de salutation présentées. Elle a finalement choisi le terme tamil avant
de passer à la première écoute de la pièce musicale et chantée (un extrait de la comédie musicale
Bharati référencée en annexe 11.2). En écoutant la pièce pour la première fois, elle répondait à
mes invitations à s’imaginer ce que ce morceau pouvait lui évoquer en s’exprimant à haute voix
et elle n’a pas voulu attendre la fin de l’extrait pour commencer
à dessiner. Son dessin représente un arbre au tronc marron et au
feuillage vert. Il y a un trou au milieu du tronc. Il y a un
personnage de chaque côté de cet arbre : une fille et ce qui
semble être un garçon. Les couleurs utilisées sont le vert, le
marron et le noir.
Marie nous a semblée assez fatiguée et montrait
beaucoup de difficultés pour se concentrer pendant la séance.
Elle n’a pas vraiment écouté la pièce musicale et chantée
puisqu’elle s’est mise très rapidement à verbaliser ce qu’elle
imaginait sans vraiment prêter attention au rythme et à la mélodie diffusés. Le choix des
couleurs de son dessin dénote de ce qu’elle a l’habitude de choisir dans les dessins spontanés
que je l’ai déjà pu voir réaliser, à savoir des couleurs vives comme le rose, le violet, l’orange
144
ou le rouge. Habituellement la première à répéter spontanément des mots ou phrases en langue
étrangère, elle n’a répété que le premier « bonjour » présenté et s’est contentée de reproduire le
geste de salutation en découvrant les deux autres. En écoutant la pièce musicale et chantée, elle
pensait entendre de l’italien. Lui rappelant que les Italiens disent « Buongiorno » pour se saluer
(item qu’elle connait très bien et qu’elle a elle-même énoncé car elle le chante régulièrement
dans les ateliers d’Hélène) et non « Namaste », « Namaskar » ou « Vaṇakkam », elle continuait
à penser que Lulu avait voyagé en Italie. J’ai fini par lui expliquer, via la marionnette, que le
pays concerné était l’Inde, et lui ai montré sur le globe gonflable où se trouvait ce pays et, en
comparaison, où nous nous situons en France. Elle a aussitôt fait tourner le globe entre mes
mains pour me montrer une île où Hélène a déjà voyagé.
Ce type de réaction était assez surprenant de la part de Marie qui est une enfant toujours
très investie et ravie de faire absolument toutes les activités qu’on lui propose, en montrant à
chaque fois un intérêt certain pour les langues et les cultures étrangères. Je pense que mes
attentes envers elle sur ce dispositif n’ont pas été comblées car elle était vraiment agitée et avait
plus besoin de se dépenser que de canaliser son attention sur une activité comme celle-ci. Elle
l’a dit elle-même à sa grand-mère en sortant de l’atelier, affirmant qu’elle n’aimait pas qu’on
lui fasse faire des choses qui lui demandent de la concentration quand elle avait envie de se
défouler. Cela confirme le fait que mon dispositif initial comportant une phase introductive
d’expression corporelle était certainement plus adapté au rythme des enfants, phase que j’ai dû
abandonner pour répondre aux contraintes de temps qui m’ont été imposées. Je pense également
que le fait de s’être retrouvée toute seule dans l’atelier, un vendredi soir après l’école et avant
de participer à un concert pour son école ont été des facteurs compromettant la réussite du
dispositif. Les conditions n’étaient pas réunies et vraisemblablement l’appui sur sa biographie
langagière n’a pas été concluant.
II.1.c. La Côte d’Ivoire avec le groupe du mardi
Lors de cette première séance avec le groupe du mardi, tous les enfants habituellement
inscrits à cet AMP étaient présents, à savoir Marie, Lucien et Victor. S’il s’agissait bien d’une
première séance avec moi pour Lucien et Victor, il nous faut rappeler que ce n’était pas le cas
pour Marie qui avait déjà rencontré Lulu le vendredi précédent et qu’elle était alors déjà
familiarisée avec le déroulement de mon intervention. Le découverte de la Côte d’Ivoire a été
décidée à partir de la biographie langagière de Victor qui souhaiterait pourvoir voyager en
Afrique et dont je connaissais l’intérêt pour ce continent suite à l’observation d’un atelier
musique plurilingue animé par Hélène plus tôt dans mon stage. Le choix de la Côte d’Ivoire est
145
parti de la pièce musicale et chantée que j’avais choisie auparavant pour le dispositif et qui
correspondait à une chanson traditionnelle pour enfant de ce pays (pour la référence complète
de l’extrait, voir annexe 11.2).
Les « bonjour » rapportés par Lulu offraient, comme dans le cas de l’Inde, une ouverture
sur la diversité linguistique au sein d’un même pays : la tortue a donc présenté aux enfants le
« bonjour » sénoufo, « Fatchangana », le « bonjour » dioula « Ani woula » et le « bonjour »
bambara « Ani tlé ». Marie a choisi le terme dioula, et Lucien et Victor ont tous deux choisi
celui du peuple bambara. A peine la première écoute de la pièce musicale et chantée entamée,
les trois enfants ont pu affirmer que Lulu la Tortue était partie en Afrique, ce qui m’a amené à
préciser, en utilisant le globe, qu’elle était partie sur le continent africain, dans le pays appelé
Côte d’Ivoire. Le fait que les enfants aient pu deviner l’Afrique répondait déjà amplement à
mes attentes.
Lors de la deuxième écoute pour la réalisation des
dessins, les enfants semblent s’être appuyés tant sur la
musique que sur les représentations qu’ils pouvaient déjà
avoir de l’Afrique, même si cela n’est pas forcément
évident à comprendre du dessin de Lucien qui a privilégié
la couleur rouge pour des formes dont nous connaîtrons
l’interprétation lors de la troisième séance du dispositif. Marie a étonnamment dessiné quelque
chose de très similaire à ce qu’elle avait réalisé la semaine
antérieure sur l’Inde : un grand arbre à côté duquel se tiennent
deux bonshommes dessinés en bâtons, le tout reprenant les
couleurs marron et vert. Cela pourrait venir du fait qu’il
s’agisse de couleurs et de motifs qu’elle aime dessiner, ce qui
impliquerait alors que la musique n’a pas forcément été un
facteur d’évocations particulières pour elle.
Victor quant à lui a commencé par dessiner deux
arbres, un vert aux branches éparses et un ocre plus robuste qui
ressemblerait à un baobab. Comme Victor restait la deuxième heure de l’atelier et que je
remplaçais alors ma tutrice à l’animation de cette deuxième séance d’AMP, celui-ci m’a
demandé s’il pouvait poursuivre son dessin, ce que j’ai encouragé car je souhaitais valoriser sa
demande, même si cela impliquait un certain déséquilibre de temps passé sur le dispositif par
rapport à ces deux autres compagnons qui partaient dès 18h. Il a alors ajouté une cabane dans
les arbres et ce qui semble être un troisième arbre. Rapidement, lors de cette deuxième heure,
146
Victor m’a expliqué qu’il allait dessiner la guerre
sur son dessin car il savait que certains pays étaient
en guerre au moment où nous parlions : je
comprends là qu’il a pu voir récemment ou
entendre parler de l’attaque qui a eu lieu dans une
université kenyane il y a quelques jours. Il dessine
donc un bonhomme tenant un pistolet, des traits
orange symbolisant des éclairs de bombe et un bonhomme en rouge étalé sur le sol. Je réalise
que Victor n’est alors plus dans le ressenti et les évocations de la musique mais bien dans la
réflexion et le recours à des mécanismes cognitifs pour faire le lien entre l’Afrique et les
actualités, évolution que nous savions déjà expliquée par certains chercheurs mentionnés dans
notre cadre théorique (Puozzo Capron, 2014). Je décide donc d’inviter Victor qui a bien rempli
sa feuille à terminer son dessin pour passer à une autre activité.
Dans l’ensemble, le dispositif semble avoir bien fonctionné pour cette première séance
avec le groupe du mardi au complet, les enfants demandant à repartir avec les « bonjour » qu’ils
ont abordés en début d’atelier à l’instar des enfants du groupe du vendredi. Il semble donc, pour
le moment, que notre dispositif soit source d’émotions positives où la rencontre avec l’Autre et
l’Ailleurs pourrait être vécue comme un présent que l’on souhaite rapporter chez soi, comme
pour le faire passer d’un espace extérieur à celui de la maison, du familier. Voyons si cela se
confirme dans le détail des séances suivantes.
II.2. Deuxièmes séances
Pour la deuxième semaine de mise en place du dispositif, nous avons choisi d’effectuer
quelques modifications liées à l’organisation des activités entre les deuxièmes et troisièmes
séances avec chaque groupe. La troisième et dernière intervention étant portée sur un échange
avec les enfants et la présentation de photos de voyages avec Lulu la Tortue, il nous apparaît
plus judicieux d’avancer la découverte du troisième pays dès la deuxième séance pour éviter
les débordements de temps de mon dispositif sur les activités de Mehregan. Ainsi, lors de leur
deuxième séance avec moi, les enfants, familiarisés avec le déroulement de mes interventions,
vont partir à la découverte de deux pays dans lesquels Lulu est partie en voyage, ce qui nous
permettra d’éventuellement aborder une perspective comparative entre les systèmes d’écritures
des langues présentées. La troisième séance donnera tout le temps nécessaire au retour sur les
dessins des enfants et à la discussion autour des photos rapportées par Lulu.
147
Pour le groupe du vendredi, cette deuxième séance est en réalité la dernière pour Marie,
Alix et Agathe car les vendredis suivants étaient fériés. J’ai donc fait le choix de privilégier la
découverte de deux pays plutôt que le temps d’échange sur les dessins réalisés et le visionnage
de photos. Il s’agit-là d’une décision discutable car elle remet en cause la rigueur didactique qui
supposait d’appliquer un même dispositif pour chacun des groupes, mais d’une décision
nécessaire à la vue des contraintes de notre contexte. Deux des enfants ayant été absentes à la
séance précédente, il me semblait plus judicieux de leur donner l’opportunité de découvrir deux
pays et leur(s) langue(s) par les arts et les pratiques artistiques, cherchant alors à valoriser leur
expérience de la rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs plus que l’échange sur un nombre très
restreint de dessins, discussion que nous pourrons néanmoins amorcer si nous en avons le
temps.
Pour cette dernière raison, nous aborderons donc en premier lieu les deuxièmes séances
du dispositif pour les groupes de mercredi et mardi, puis nous finirons par la description de la
dernière séance du groupe de vendredi. Les autres changements apportés au dispositif seront
détaillés au fur et à mesure de la description des séances.
II.2.a. La Chine et l’Inde avec le groupe du mercredi
Pour la deuxième séance avec le groupe du mercredi, je décide d’aborder la Chine en
référence aux biographies langagières de Maya, Thomas et Rose pour qui il s’agit d’un pays
qui les invite au voyage, ainsi que l’Inde afin d’apporter plus de dessins sur ce pays pour
l’exposition car seule Marie était présente lors de la découverte de ce pays le vendredi
précédent. Lors de cette séance, seuls trois enfants étaient présents : Arthaud, Rosemay et
Adèle. Les enfants dont les éléments de la biographie langagière avaient été valorisés étaient
donc absents.
L’introduction de deux pays sur une seule intervention m’amène à modifier légèrement
l’organisation des différents éléments du dispositif. Par peur de réaliser un dispositif plus long
que 15 minutes, je fais le choix de ne pas faire parler Lulu pendant la séance. Je réduis le nombre
de « bonjour » présentés à deux par pays, et je place une étiquette de chaque terme devant
chaque enfant, au milieu du cercle. Ainsi, chaque enfant retrouve face à lui quatre étiquettes
représentant quatre « bonjour » répartis en deux colonnes, chaque colonne dépendant d’un pays
différent. L’objectif consiste à ce que les enfants puissent associer les pièces musicales et
chantées écoutées au bon duo de « bonjour ».
Ainsi, en entrant dans l’atelier, nous prenons le temps de regarder les « bonjour » sous
leur forme écrite et de remarquer que ces « bonjour » ne se présentent pas selon le même
148
système d’écriture que celui avec lequel les enfants sont familiers. Les termes de salutation
associés à l’Inde étaient les « bonjour » en hindi et en bengali (voir infra, même chapitre, partie
II.1.b) et les termes chinois étaient 你好 et 你们好. Contrairement aux attentes mais démontrant
les principes liés aux jeux de devinettes, lors de l’écoute de l’extrait musical sur la Chine, les
enfants ont montré les « bonjour » en hindi et bengali comme correspondants à l’extrait, et
inversement lors de l’écoute de l’extrait sur l’Inde (ils ont montré les « bonjour » en chinois)12.
Je leur ai donc demandé s’ils savaient dans quels pays Lulu avait voyagé à partir de l’écoute
des deux extraits. Après avoir mentionné plusieurs pays (Espagne, Russie, Japon), je leur ai fait
réécouter les extraits pour les associer aux « bonjour » au milieu du cercle, puis je leur ai
demandé de me montrer sur le globe dans quelle région du monde Lulu avait pu aller. Tâtonnant
entre l’Asie et l’Océanie, j’ai fini par leur révéler qu’elle était partie en Chine et en Inde, leur
montrant l’emplacement de ces pays sur le globe et précisant à quel extrait musical
correspondait chaque pays. Nous avons donc commencé la session d’écoute et de dessin avec
la Chine, puis avec l’Inde.
Rosemay m’a tout de suite fait part de ses difficultés à savoir quoi dessiner car elle me
disait ne rien connaitre de ces pays. J’ai cherché à la rassurer en lui disant que ce n’était pas
grave, que le plus important était qu’elle dessine ce que la musique pouvait lui évoquer. Ses
deux dessins semblent finalement assez similaires, tous deux réalisés en pastel bleu clair et
représentant une jeune fille au milieu d’éléments de paysage. Pour la Chine, on distingue en
plus de la jeune fille un pot d’où sortent des branches et des gouttes de pluie dans l’air. Pour
l’Inde, la jeune fille a une fleur dans les cheveux, il y a un soleil et d’autres éléments de paysages
indistincts.
Dessin de Rosemay sur la Chine Dessin de Rosemay sur l’Inde
12 Pour les références des pièces musicales et chantées, voir annexe 11.2.
149
Adèle s’est très peu exprimée pendant l’atelier. Comme Rosemay, elle a affirmé ne rien
connaître de ces pays et a réalisé ses deux dessins en violet et rose, celui sur la Chine
représentant une jeune fille en bâtons auprès d’une maison, et celui sur l’Inde une sorte de vase
d’où sortent de grandes branches et des gouttes de pluie tout autour.
Dessin d’Adèle sur la Chine Dessin d’Adèle sur l’Inde
J’ai pu remarquer qu’à plusieurs reprises pendant la séance, Adèle regardait ce que faisaient
Arthaud et Rosemay, comme si elle cherchait l’inspiration dans les dessins de ses compagnons.
Cela reflète beaucoup son attitude générale lors des ateliers : timide, elle semble être dans sa
bulle. Elle répète souvent qu’elle ne sait pas faire toute seule et attend de l’aide de la part de
Mehregan. En entretien pour la réalisation de sa biographie langagière, Adèle a répondu à mes
questions par de nombreux « Je sais pas » (voir annexe 8.3), sans en ajouter plus. Néanmoins,
il nous faut relever que, contrairement à la semaine précédente, nous pouvons distinguer des
éléments dans ses dessins qu’elle a pu terminer sur le temps des pièces musicales et chantées,
ce qui démontre une certaine adaptation ou familiarisation au dispositif.
Arthaud, quant à lui, a réalisé des dessins aux tons chauds (rouge, orange, marron,
jaune). Celui sur la Chine représente une maison avec un toit rappelant les toits asiatiques, et
celui sur l’Inde comporte une habitation sur plusieurs étages avec trois toits d’influence
asiatique et une personne assise sur un éléphant. Il est le seul enfant à avoir apporté à ses dessins
des éléments répondant de représentations sur la Chine et l’Inde, ce qui ne nous étonne pas au
regard de son âge et de la culture générale dont il fait montre régulièrement dans les AMP.
Dessin d’Arthaud sur la Chine Dessin d’Arthaud sur l’Inde
150
Rosemay m’a demandé pourquoi Lulu ne parlait pas aujourd’hui, et semblait déçue de
cela. Mon choix de ne pas l’intégrer à cette séance de manière à empiéter le moins possible sur
le temps d’atelier de Mehregan s’est fait au détriment des enfants qui ont semblés moins investis
émotionnellement. Ils étaient concentrés à trouver les pays où Lulu était partie mais ils
semblaient plus être dans une démarche de réflexion : l’absence de Lulu était peut-être
l’élément manquant de l’activité pour que les enfants se laissent porter par la dimension
émotionnelle des musiques et s’inquiètent moins de ne pas savoir quoi dessiner.
II.2.b. Le Japon et la Roumanie avec le groupe du mardi
Reprenant la même organisation que pour la séance décrite ci-dessus, Lulu la Tortue a
fait découvrir à Lucien et Marie le Japon et la Roumanie pour leur deuxième séance. Victor
était malheureusement absent ce jour-là. Le Japon avait été intégré à mon dispositif à partir de
la biographie langagière de Marie qui avait émis le souhait d’apprendre le japonais, d’autant
plus que ses parents connaissent quelques mots dans cette langue. La Roumanie est un choix
qui s’est réalisé à partir de la sélection de la pièce musicale et chantée que je n’ai pu trouver en
russe pour correspondre aux envies de découvertes linguistiques et culturelles dont Lucien
m’avait parlé en entretien. La Roumanie n’a pas pour autant été un second choix car parler d’un
voyage de Lulu la Tortue là-bas me permettait de voir ce qui se passait chez les enfants
lorsqu’on les invitait à rencontrer un Autre et un Ailleurs complètement inconnus pour eux.
Alors que Marie et Lucien terminaient de prendre leur goûter dans le petit vestiaire,
Marie a jeté un coup d’œil à la salle d’atelier dont la disposition était prête pour le déroulement
de mon dispositif. En apercevant cela, elle s’est exclamée joyeusement par un « Tiens ! On va
voyager aujourd’hui ! », ce qui m’a amené à comprendre que mes interventions étaient passées
dans le domaine du familier pour elle, mais aussi qu’elles étaient une source de contentement ;
elle semblait ravie de retrouver Lulu et de partir à la découverte d’autres pays.
Une fois l’intervention commencée, Lulu a d’abord salué les enfants en reprenant les
« bonjour » de la Côte d’Ivoire abordés avant les vacances. Les deux enfants ont renvoyé son
« bonjour » à Lulu en répétant les mêmes termes. Cela a permis de se rappeler rapidement ce
qui avait été fait avant les vacances et dont les enfants gardaient encore le souvenir. En regardant
les « bonjour » sur le tapis au milieu du cercle, Lucien a rapidement demandé si certains étaient
en chinois, et les deux ont su remarquer qu’une des langues utilisait les mêmes lettres qu’en
français alors que l’autre présentait des signes inconnus pour eux.
151
Nous avons commencé par écouter la pièce musicale et chantée traditionnelle de la
Roumanie. Les enfants n’avaient pas d’idée précise du pays où s’était déroulé le voyage de
Lulu, ou bien pensaient qu’il s’agissait de la Chine. Je leur ai donc annoncé le nom du pays où
était partie Lulu en leur montrant où cela se trouvait sur le globe par rapport à la France. Nous
avons ensuite vu les « bonjour » en roumain, à savoir salut et bună. Le premier les a fait rire en
réalisant que c’était très proche du français et que la prononciation était pourtant un peu
différente avec le [t] sonore en fin de mot. Marie a choisi bună et Lucien salut parmi les
étiquettes à coller sur leur feuille pour le dessin. Avant de commencer cette nouvelle étape du
dispositif, Marie a fait la remarque qu’ils n’allaient pas savoir quoi dessiner, ce qui n’a pas
semblé poser problème plus longtemps lorsque je leur ai dit que ce n’était pas grave et que le
plus important était de dessiner ce que la musique pouvait leur évoquer. Marie a dessiné à
nouveau ce qui semble être un arbre au milieu de brins d’herbe. L’arbre est réalisé avec un tronc
et des branches en noir et marron, et le feuillage se devine par de grands tracés bleus en forme
de nuages. Il y a un soleil dans le coin supérieur droit. Lucien a
dessiné au feutre vert clair quelque chose de ressemblant à un
immeuble, ce que nous tenterons de mieux interpréter lors de la
dernière séance.
Dessin de Lucien sur la Roumanie Dessin de Marie sur la Roumanie
Ensuite, nous avons écouté la pièce musicale et chantée sur le Japon, et c’est Marie qui,
une fois que Lucien avait exclu la Chine comme réponse possible, a trouvé le pays dans lequel
avait voyagé Lulu. Lucien m’a alors demandé si le karaté était japonais, ce que j’ai confirmé et
il a souri comme s’il venait de comprendre quelque chose, disant : « Ah, d’accord, je connais ».
Je leur ai alors demandé s’ils savaient comment on pouvait se saluer en japonais, ce à quoi
Marie a répondu « Vanakkam ». Cela ne correspondait pas à mes attentes mais c’était
néanmoins un signe de mémorisation du terme de salutation tamil qu’elle avait choisi trois
semaines auparavant pour son dessin sur l’Inde, lors de ma première intervention avec elle. En
152
lui rappelant qu’il s’agissait d’un « bonjour » découvert lors de ma première intervention, Marie
attrape l’une des deux étiquettes en face d’elle et me signale que c’est le « bonjour » japonais
qu’elle a choisi, avant même de l’avoir entendu. Je leur fait donc découvrir ce bonjour qu’est
こんにちは. En reprenant l’exemple du salut en Inde où la gestuelle et la posture tient une
place importante, j’introduis donc ce premier « bonjour » avec la posture de salutation qui
l’accompagne au Japon. Lucien se lève pour l’effectuer avec moi et me signale que c’est la
même posture utilisée pour saluer son adversaire au karaté. Cela semble être un point
d’accroche familier pour lui car il lie ainsi ce que nous faisons à une activité qu’il pratique et
apprécie, ce qui pourrait être un facteur positif dans sa découverte du Japon et du japonais, aussi
succincte soit-elle pendant la séance.
Nous abordons ensuite le deuxième « bonjour », おはよう. C’est celui que Lucien
choisit de mettre sur sa feuille dessin. Nous écoutons donc l’extrait musical sur le Japon à
nouveau et les enfants dessinent. Marie reprend un motif d’arbre très similaire au précédent,
avec un tronc marron, un feuillage en nuages rose et un trou dans le tronc en noir et gris. Quant
au dessin de Lucien, nous ne sommes pas en mesure de reconnaître ce qu’il a voulu dessiner :
il semble y avoir un carré marron surplombé d’un rectangle jaune par-dessus lequel sont
dessinés quatre triangles de la même couleur. Nous chercherons à en savoir plus lors de la
séance suivante.
Dessin de Lucien sur le Japon Dessin de Marie sur le Japon
Dans l’ensemble, Marie et Lucien semblait très contents de cette deuxième séance de voyages
avec Lulu la Tortue, arborant un sourire quasi constant et montrant une grande concentration
au moment de dessiner.
153
II.2.c. La Chine et le Moyen-Orient avec le groupe du vendredi
Pour cette deuxième et dernière séance avec le groupe du vendredi, Marie et Alix étaient
présentes. Seule Agathe n’aura donc pas participé à mon dispositif dans ce groupe. Or, cette
séance s’est révélée être très particulière, d’une part parce qu’il s’agissait du vendredi marquant
le début des vacances de printemps, impliquant une certaine excitation mais aussi une certaine
fatigue chez les enfants. Et d’autre part parce que ma tutrice, Mehregan, s’est retrouvée en arrêt
de travail : j’ai donc dû assurer l’animation de l’AMP dans son intégralité ce soir-là, sans pour
autant avoir une grande marge de manœuvre quant à une adaptation de mon dispositif pour
l’occasion car j’ai été prévenue de son absence à peine une heure avant le début de l’atelier,
alors que j’assurais le service de pedibus en allant chercher les enfants à l’école. Malgré tout,
le fait d’avoir animé seule cet AMP m’a permis de ne pas avoir à me limiter dans le temps pour
la réalisation de mon dispositif et donc de suivre le rythme et les réactions des enfants. Ce jour-
là, le dispositif a donc duré près d’une demi-heure.
J’ai pris la décision d’aborder la Chine pour cette dernière séance avec Alix et Marie car
le groupe précédant ayant fait l’activité sur ce pays était assez restreint, ce qui me permet
d’augmenter le nombre de productions sur ce thème pour l’exposition. Le choix du Moyen-
Orient était lié à la volonté d’aborder l’arabe comme langue pouvant bénéficier de l’éveil aux
langues pour limiter sa minorisation (Billiez, 2002), mais surtout car c’est une langue
qu’Agathe, dans son entretien, a mentionnée comme langue qu’elle souhaiterait apprendre. Je
n’ai appris que le jour même qu’Agathe serait absente, les choix de découvertes se sont donc
tout de même arrêtés sur la Chine et le Moyen-Orient.
Afin de ne pas répéter la déception des enfants comme dans le groupe du mercredi, j’ai
fait animer la séance par Lulu qui a engendré énormément d’intérêt et de tendresse de la part
des enfants. Celles-ci demandaient à lui faire des bisous et des câlins, et elles s’adressaient
directement à elle lorsqu'elles avaient des questions. Alix, dont je craignais les envies fréquentes
de ne pas participer aux activités, s’est montrée vraiment très investi, prenant des initiatives,
tout autant que Marie d’ailleurs. Elles ont fait preuve de beaucoup de concentration et
d’application dans ce que j’ai pu leur demander.
Nous avons donc commencé l’atelier par l’arrivée de Lulu qui a dit bonjour
individuellement à Marie et Alix. Le fait que la marionnette s’adresse nominativement à
chacune des enfants a suscité leur participation de manière quasi immédiate, puisque les deux
ont renvoyé ses « bonjour » à Lulu en français, puis en anglais. C’était un temps important car
il permettait aussi à Alix de faire la rencontre de Lulu la Tortue que Marie connaissait déjà.
154
Nous avons ensuite fait le lien avec l’atelier de la semaine précédente : Marie a expliqué à Alix
qu’elle avait découvert l’Inde avec Lulu et a salué son amie d’un « Namaste », terme et posture
reprises. Ensuite, nous avons regardé les « bonjour » des étiquettes posées au centre du cercle.
Nous avons pu remarquer que les mots n’utilisaient pas le même alphabet que celui avec lequel
les filles écrivent leur prénom. Les « bonjour » rapportés pour cette séance étaient les mêmes
que ceux présentés au groupe du mercredi pour la Chine (voir infra, même chapitre, partie
II.2.a) et السالم et ً مرحبا pour le Moyen-Orient. Alors je leur ai demandé si elles savaient d’où
venaient ces « bonjour » : Alix a spontanément proposé de chercher sur le globe.
Afin de réduire la recherche, je leur fait écouter la pièce musicale et chantée pour la
Chine. Alix propose l’Espagne, Marie le Japon. J’annonce alors que ce n’est pas le Japon mais
bien un pays proche que l’on peut trouver sur le globe. Les filles découvrent alors que Lulu est
partie en Chine et finissent d’écouter le morceau. On y associe aussitôt les « bonjour » : je les
prononce, et les filles répètent spontanément. Elles choisissent leur « bonjour » et se préparent
pour pouvoir aussitôt poursuivre avec le dessin sur la Chine en écoutant l’extrait une deuxième
fois. Je les invite à fermer les yeux pour s’imaginer les paysages,
les animaux et les habitants que leur évoque la musique, puis elles
réalisent leur dessin. Comme nous ne sommes pas pressées par le
temps et qu’elles n’ont pas fini leur dessin, je relance l’extrait une
dernière fois. Marie dessine un grand arbre en pastels, avec les
couleurs jaune, rose et violet. Au pied de l’arbre se tient ce qui
semble être un personnage réalisé dans les mêmes couleurs. Alix
dessine une petite fille chinoise avec un vêtement rouge. Je
demande à chacune des filles d’expliquer à Lulu ce qu’elles ont
dessiné. Marie précise
que le personnage au pied de l’arbre est une petite fille
et Alix ajoute que la forme à côté de sa petite fille
représente un arbre à l’envers. Je leur demande alors
si ces dessins correspondent à ce qu’elles avaient
imaginé en écoutant la pièce musicale et chantée
chinoise, ce à quoi Alix répond : « La Chine, c’est très important de l’imaginer parce que sinon,
si on n’imagine pas, on connaît plus où c’est la Chine ! ». L’importance de l’imagination
semble être acquise chez Alix qui reconnaît implicitement que cette faculté lui permet de
voyager dans des pays lointains et de reconnaître leur existence, même si celle-ci reste dans le
domaine de son esprit.
155
On entame ensuite la même séquence sur le Moyen-Orient en écoutant l’extrait musical
correspondant. Avant de commencer l’écoute, je leur demande si elles savent dans quel pays
on peut retrouver les « bonjour » qui restent devant elles. En écoutant l’extrait, les filles
devinent petit à petit que l’extrait est lié à l’Afrique, et je précise plus particulièrement l’Afrique
du Nord, mais aussi d’autres pays plus à l’est que nous cherchons ensuite sur le globe. Nous
découvrons ensuite les « bonjour » et je révèle que ceux-ci sont en arabe. Marie réagit aussitôt
en me disant qu’un garçon de sa classe sait parler arabe, donc je lui demande si elle a déjà
entendu comment on pouvait se saluer dans cette langue. Marie ne sait pas, donc nous
enchaînons avec la prononciation des « bonjour ».
Les filles, après avoir choisi chacune leur
« bonjour », saluent Lulu en arabe. Elles
commencent à être un peu plus dissipées, elles ont
des difficultés à se concentrer, et se mettent à parler
de jouets qu’elles ont chez elles. Je comprends que
mon
dispositif commence à traîner en longueur pour elles.
Nous réalisons alors la deuxième écoute de l’extrait et
les filles dessinent. Marie représente un personnage en
rouge et vert avec le visage marron. Elle explique que
c’est une petite fille qui rentre dans sa maison. Alix a
représenté une petite fille en rose, puis en jaune un
soleil, un loup et une voiture, et en marron un arbre.
Pour terminer la séance liée à mon dispositif, j’installe tous les dessins des filles, y
compris celui de Marie sur l’Inde de la semaine précédente, de façon à ce que nous puissions
tous les voir d’un seul coup d’œil. Je demande alors pourquoi nous n’avons pas exactement les
mêmes dessins pour chaque pays. Alix répond : « Parce que ils sont pas pareils, parce que ils
sont différents. […] Ils ont pas la même ville, ils ont pas la même couleur de ville et pas les
mêmes choses qu’ils fabriquent », ce qui témoigne d’une certaine conscience de la diversité des
paysages (des « villes ») et des pratiques (ils ne fabriquent pas la même chose). Même si Alix
présente ici l’Autre et l’Ailleurs dans leurs différences avec sa langue et culture maternelle, elle
ne s’y montre pas pour autant hermétique, au contraire, elle semble ravie d’avoir partagé les
expériences de voyages de Lulu et affirme que c’est elle qui a maintenant envie de voyager.
Marie, dont nous nous sommes habitués aux dessins d’arbres depuis le début du dispositif, a ici
réalisé un arbre pour la Chine mais un personnage pour le Moyen-Orient, apportant ainsi un
156
changement de représentation entre ces deux régions. Elle explique ce changement d’un dessin
à un autre par envie : « Parce que j’avais envie de les faire différents », répond-elle. Nous
obtenons alors un début de réponse quant au positionnement de Marie dans mes interventions :
elle dessinerait bien ce qu’elle souhaite plus que ce que la musique peut lui évoquer, remettant
en cause le fonctionnement de mon dispositif. Nous confirmerons ou nuancerons cela avec la
description de la dernière séance avec le groupe du mardi que nous allons aborder dans les
paragraphes suivants.
II.3. Troisièmes séances
Pour ces troisièmes séances, seuls les groupes du mercredi et du mardi sont concernés
car celui du vendredi ne pouvait plus se retrouver avant la fin de mon stage à cause des jours
fériés du mois de mai. Ces dernières séances représentent la dernière étape de réalisation de
mon dispositif auprès des enfants, une étape d’échanges autour des dessins réalisés
précédemment et de découverte de quelques photos des pays dans lesquels Lulu la Tortue a
voyagé.
II.3.a. Dessins, photos et échanges avec le groupe du mercredi
Pour cette dernière séance avec le groupe du mercredi, tous sont présents. Rose n’étaient
pas là avant les vacances et n’a donc pas fait les séances de découverte en musique et dessin, et
seuls trois enfants ont pu faire les dessins sur l’Inde et la Chine la semaine avant les vacances.
Cela représente une certaine difficulté pour pouvoir les faire tous participer alors qu’ils n’ont
pas tous participé à l’intégralité du dispositif.
En commençant la séance, les enfants demandent pourquoi il n’y a pas de coussins au
centre, je leur explique donc que nous allions regarder les dessins réalisés avant les vacances et
des photos que Lulu a rapportées de chacun de ses voyages. Les enfants semblent enjoués.
Arthaud s’exclame « Génial ! », Rosemay, « Super ! ». Avant leur arrivée, j’avais accroché les
dessins des enfants sur l’un des murs de l’atelier, disposant les dessins sur l’Espagne les uns en
dessous des autres, et ceux sur l’Inde et la Chine respectivement dans une deuxième et troisième
colonne, faisant en sorte que si l’on regardait l’ensemble par ligne, chaque ligne reprenait les
dessins d’un même enfant.
Maya s’exclame très vite qu’elle est déçue de ne pas avoir pu faire autant de dessins que
les autres car elle était absente au dernier AMP. Elle explique qu’elle aimerait les faire tout de
suite, ce que malheureusement je suis obligée de refuser par manque de temps. Cela se révèle
157
donc être un point faible de mon dispositif : l’évolution sur plusieurs semaines pour arriver à
un tout n’était pas le plus adapté si j’avais su anticiper le fait que les enfants peuvent être absents
à certaines séances. Il aurait sans doute été moins frustrant pour chacun de faire des séances où
le dispositif comprend trois activités complètes par semaine.
Lorsque Lulu arrive, elle salue les enfants en reprenant les « bonjour » des trois pays
visités. Certains enfants répondent en répétant ces bonjours voire en les anticipant pour Arthaud
qui a dit « Buenas tardes Lulu » avant même que je le dise. Puis, je lance la musique sur
l’Espagne et demande à Rose si elle a une idée du pays d’où cette musique est originaire. Elle
ne sait pas mais les autres enfants s’écrient très vite qu’il s’agit de l’Espagne. Je demande donc
à chacun d’entre eux de raconter ce qu’ils avaient voulu dessiner. Mis à part les dessins dont
nous avons pu décrire les éléments lors de la description de la séance (voir infra, même chapitre,
partie II.1.a), Thomas a apporté plus de précisions sur le sien en expliquant qu’il avait dessiné
un sous-marin car il avait l’impression d’en avoir entendu un dans la musique. Seule Adèle ne
se rappelle plus de ce qu’elle a dessiné, et, toujours aussi timide, n’intervient pas spontanément
et n’exprime que quelques mots lorsque je l’invite à parler de son dessin. Une fois tous passés,
je leur demande s’ils se rappellent des « bonjour » en espagnol. Ensemble, ils retrouvent les 3
« bonjour ». Je demande à Rose de me dire ce qu’elle aurait dessiné pour l’Espagne : elle
nomme un cheval avec une petite fille sur son dos et sa maman qui tirerait le cheval. Nous
remarquons que le cheval est un élément récurrent dans les dessins réalisés. Je décide alors de
leur montrer quelques photos d’Espagne sur ma tablette (pour le détail des photos, voir annexe
11.1). J’aborde la couleur blanche des maisons pour les préserver de la chaleur, les palais pour
lesquels Arthaud ne manque pas de préciser qu’ils ont notamment été construits par les
musulmans, puis apparaissent des photos avec des chevaux. Les enfants semblent agréablement
surpris de les trouver en commun sur les photos et leurs dessins. Afin de parler d’actualité, j’ai
aussi présenté quelques photos de la feria de Séville pour pouvoir montrer aux enfants les robes
flamencas qu’y portent les femmes, et Maya s’écrie dès la première photo : « Waouw ! C’est
trop beau ! Moi aussi j’veux m’habiller comme ça ! ». Rosemay raconte qu’elle a déjà eu une
robe similaire blanche. Tous les enfants sont souriants, ils sont captivés par les photos et se
montrent très impatients d’en voir d’autres.
Voyant que le retour sur ce premier voyage de Lulu a pris plus de temps que prévu, je
décide de passer en revue les dessins sur l’Inde. Je diffuse donc la pièce musicale et chantée
choisie pour ce pays, et nous commençons par rappeler les termes et la posture de salutation
que nous avions abordés. Les enfants présents lors de la deuxième séance ne semblent pas se
rappeler des termes mais retrouvent rapidement la posture associée. En regardant les dessins,
158
Rosemay explique qu’elle avait dessiné une jeune fille qui dansait, et Arthaud un temple
bouddhiste avec un éléphant à côté. Adèle ne se rappelle plus de ce qu’elle a dessiné et reste
muette, je préfère ne pas insister. Je leur montre donc quelques photos reprenant les saris des
femmes, le Taj Mahal (pour lequel Arthaud précise qu’il s’agit d’une tombe et non d’un palais),
les épices et la fête de Holi qui s’était déroulée dans les mêmes temps que le premier de l’an
perse que les enfants avaient fêté fin mars. Les photos sont aussi évocatrices d’émotions
positives, j’entends des « Waouw » devant les couleurs des tissus et des épices, des rires devant
la célébration d’Holi et les gens tâchés de toutes les couleurs. Maya répète alors sa demande de
pouvoir faire un dessin sur l’Inde à ce moment-là, son frère aussi. Je suis presque arrivée au
bout des 15 minutes qui m’étaient laissées pour cette dernière intervention et je dois donc à
nouveau refuser, ce qui est très frustrant, tant pour moi que pour les enfants.
Je lance alors la musique sur la Chine et nous revoyons les « bonjour » abordés pour ce
pays. Prise par le temps, je privilégie le visionnage des photos au retour sur les dessins, ce qui
est un choix préjudiciable pour les enfants ayant fait des dessins sur ce pays ; néanmoins, il
s’agissait aussi d’une bonne décision pour que tous les enfants du groupe se sentent impliqués
car le visionnage des photos était une activité nouvelle pour tous contrairement aux dessins qui
ne reprenaient l’expérience que de la moitié des enfants du groupe. Nous découvrons alors la
muraille de Chine, les rizières et les chapeaux traditionnels qu’ils définissent vite comme
« chapeaux chinois » et quelques images de l’architecture urbaine parmi lesquelles Arthaud
reconnaît très vite la Cité Interdite.
Pour finir mon intervention, je demande aux enfants pourquoi les dessins réalisés ne
présentent pas tous les mêmes éléments. Arthaud répond spontanément : « Parce que c’est pas
les mêmes pays. Parce que c’est pas les mêmes cultures », inscrivant l’expérience vécue dans
le dispositif comme une rencontre avec ce qui est différent chez l’Autre. J’essaie alors de
solliciter les autres membres du groupe en leur demandant s’ils avaient imaginé des éléments
similaires à ce qu’ils ont vu sur les photos quand nous écoutions les musiques, ce à quoi ils ont
tous répondu « non ». Nous en venons finalement à aborder la question de l’imagination dans
le dispositif. Pourquoi a-t-on cherché à imaginer ces pays ? Comme précédemment, Arthaud
répond aussitôt et de manière très spontanée : « Bah, parce qu’on travaille dessus ! ». Surprise
par sa réponse, je m’avoue un peu déçue car je ne pensais pas que mon dispositif ait pu donner
la sensation de travailler, mais je comprends aussi qu’Arthaud est un enfant avec des
connaissances très entendues dans de nombreux domaines, et un enfant qui aime apprendre et
qui aime l’école où, selon lui, il « travaille ». Les autres enfants n’ont pas souhaité apporter
159
d’autres réponses à ma dernière question, aussi je mets fin à mon intervention en replaçant
l’ensemble des activités réalisées ensemble dans le cadre de l’exposition.
II.3.b. Dessins, photos et échanges avec le groupe du mardi
Pour cette dernière intervention avec le groupe du mardi, je me retrouve avec les mêmes
difficultés qu’avec le groupe précédent : un enfant était absent (Victor) lors de la deuxième
séance, il n’a donc effectué qu’un dessin alors que les autres en ont réalisé trois. Cependant,
Victor n’a pas exprimé de regret de ne pas avoir pu faire les autres dessins. La deuxième
difficulté était de proposer cette séance de discussion comme bilan des deux séances
précédentes, alors que le temps séparant la réalisation des dessins et la discussion supposait une
distanciation émotionnelle avec les expériences vécues dans le dispositif : au lieu de rester dans
une valorisation des réactions émotionnelles, nous avons plutôt abordé les dessins de manière
rétrospective et analytique. Cela présente des avantages dans l’amorce d’une autre étape de
l’expérience de la rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs, mais cela a aussi apporté des dissonances
dans l’explication des dessins entre ce que les enfants avait voulu faire au moment de les réaliser
et ce qu’ils en percevaient une à trois semaines après.
Après avoir installé les dessins sur le mur, je demande d’abord aux enfants s’ils
reconnaissent quels sont leurs dessins respectifs. Comme tous retrouvent leurs dessins, je lance
la pièce musicale et chantée traditionnelle de Côte d’Ivoire et demande aux enfants s’ils se
rappellent où Lulu avait fait son premier voyage avec eux : tous les trois sont capables de me
nommer spontanément l’Afrique. Victor est le premier à m’expliquer son dessin : il dit avoir
imaginé une cabane dans les arbres et un serpent et ne reprend pas un seul élément lié à la
question des conflits dont il m’avait parlé en terminant son dessin lors de la première séance.
Marie affirme avoir voulu dessiné un arbre en montrant le dessin qu’elle avait réalisé sur le
Japon. Je lui explique donc qu’il ne s’agit pas du dessin qu’elle avait fait pour l’Afrique : en lui
montrant les dessins qu’elle avait réalisé sur la Chine et l’Inde dans un autre groupe, elle réalise
que c’est parce qu’elle a dessiné des arbres pour chaque pays. Lucien explique à son tour qu’il
a voulu représenter un volcan, expliquant les dessins au pastel rouge que je n’avais pas su
déchiffrer avant les vacances. Nous regardons ensuite quelques photos de la Côte d’Ivoire (voir
annexe 11.1) : nous abordons les femmes qui portent les charges sur leur tête, l’architecture
particulière des églises, les cases, les instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest (djembé,
balafon, …), les éléphants et le cacao. Les enfants semblent curieux, leurs réactions déclenchent
les échanges : Lucien pense que les charges de bois doivent être lourdes à porter sur la tête, et
160
lorsque je préviens qu’ils vont peut-être être surpris en découvrant une église ivoirienne, Victor
dit qu’il comprend que l’architecture puisse être différente là-bas. Pour les instruments, Victor
dit que la photo est comme une chanson, Marie note que les musiciens se déplacent tout en
jouant, et Lucien nomme spontanément le tambour. Enfin, ils semblent admiratifs devant les
éléphants auxquels ils n’avaient pas pensé pour leur dessin et se montrent franchement surpris
en découvrant les fèves de cacao à l’origine de la fabrication du chocolat qu’ils boivent
notamment le matin au petit-déjeuner. Aucune réaction négative n’a été notée pendant l’activité.
Je demande ensuite à Marie et Lucien d’expliquer à Victor dans quels pays Lulu les a
emmenés la semaine précédente. Lucien dit la Chine et Marie corrige en disant le Japon. Je
lance la musique correspondante en fond. Lucien ne se rappelle plus de ce qu’il a voulu dessiner,
et Marie explique qu’elle avait aussi dessiné un arbre, ce qui me permet de faire une transition
vers les cerisiers qui apparaissent sur les photos que je m’apprête à leur montrer. Marie et
Lucien affirment qu’ils ont des cerisiers chez eux ou chez des membres de leur famille, et Victor
remarque sur la première photo que l’édifice ressemble à la maison des Ninjago, série animée
créée par la maison LEGO où l’intrigue reprend des mythes chinois et japonais. Je réalise à ce
moment-là que les enfants sont en train d’associer ce qu’ils voient à des éléments familiers pour
eux, ce qui semble fonctionner comme une médiation de la rencontre avec ce pays. Nous
continuons le visionnage des photos avec les tenues traditionnelles des femmes en kimono (qui
rappellent à Lucien les kimonos utilisés dans les arts martiaux), les sushis que Victor se rappelle
avoir déjà mangé et Marie aussi « dans un restaurant chinois à Paris ». Je leur demande alors si
les sushis se mangent avec une fourchette, et tous les trois m’affirment vivement que non, ça se
mange avec des baguettes, affirmant ainsi posséder certaines connaissances relevant du
domaine culturel. Enfin, je leur montre la photo de deux personnes qui se saluent dans la posture
que nous avions expliquée la semaine précédente et demande si les enfants savent ce qu’ils sont
en train de faire. Lucien répond aussitôt : « se saluer !». Nous profitons de cette occasion pour
revoir les « bonjour » japonais que nous avions découvert : Lucien dit ne pas s’en rappeler mais
Marie prononce le mot « Konnishiwa » tout de suite, ce qui prouve qu’il y a eu un certain degré
d’acquisition dans mon dispositif ou en tout cas un renforcement d’acquis si Marie avait déjà
eu l’occasion d’entendre ce mot auparavant par ces parents qui parlent un peu le japonais.
Nous terminons par le retour sur le dernier pays dont Marie et Lucien ne se rappellent
pas spontanément. Je lance la musique correspondante et profite de la situation pour demander
à Victor s’il a une idée du pays d’où provient cette chanson : il ne sait pas. Je commence à
prononcer la première syllabe du nom du pays et Lucien termine pour moi en retrouvant le nom
de la Roumanie. Je demande alors s’ils se rappellent des « bonjour » en roumain. Lucien et
161
Marie ne se rappelaient pas des termes, Lucien me proposant « Salaam » au moment où je
prononçais la première syllabe de « Salut ». Je précise alors que « Salaam » signifie bien
« Bonjour » mais en arabe, me rappelant que nous avions parlé de cette langue avec Lucien lors
de notre entretien pour établir sa biographie langagière. Je recentre aussitôt l’attention sur le
roumain en redonnant les deux « bonjour » abordés la semaine précédente. Tous répètent
spontanément les deux mots. Victor me dit qu’il n’aime pas trop la chanson, la trouvant « un
peu triste ». Je propose donc de regarder quelques photos afin de découvrir la Roumanie
autrement que par la chanson. Nous abordons les couleurs des tenues traditionnelles, les
châteaux de Transylvanie pour lesquels j’ai fait référence à la légende de Dracula que les
enfants ne connaissaient pas13. Nous regardons également des photos des déplacements en
charrettes tirées par un cheval et les couleurs variées des maisons en ville.
Lulu vient alors saluer les enfants en reprenant les « bonjour » vus au fil des trois pays
et leur demande « Pourquoi a-t-on cherché à imaginer ces pays ? ». Victor affirme que c’est
« parce qu’on voulait voir [c]es pays » et que l’imagination l’a « aidé beaucoup » à le faire.
Marie et Lucien ne semblent pas vouloir intervenir. Je fais donc remarquer que parfois le
changement de pays leur a fait réaliser des dessins différents ou, dans le cas de Marie, des
dessins similaires, Marie me confirmant qu’elle avait envie de dessiner des arbres à chaque fois.
Je valorise donc les deux démarches en affirmant que tout était possible, et que Lulu était
contente d’avoir fait ce tour du monde avec eux. Terminant l’intervention, j’invite les enfants à
retrouver Mehregan pour la suite de l’atelier, ce qu’ils mettent du temps à faire, m’expliquant
qu’ils avaient envie de faire d’autres voyages. Cela a clos cette dernière intervention et mon
dispositif de manière très positive en un signe d’ouverture ou tout du moins d’intérêt et de
curiosité pour les voyages à l’étranger à la découverte d’autres langues et cultures.
Partie III. Evaluation du dispositif et conclusion du
chapitre
Bien que notre domaine de recherche et les caractéristiques du contexte de mise en place
du dispositif ne nous permettent pas d’établir une évaluation rigoureuse de celui-ci, les données
recueillies dans le journal de bord (annexe 6) relatant le déroulement de chacune des
interventions nous permettent tout de même d’établir un premier bilan des limites et des apports
13 La référence était sans doute un peu trop osée étant donné l’âge des enfants, mais cela pourra fournir une
référence plus tard lorsqu’ils en entendront parler à nouveau.
162
du dispositif auprès des enfants, mais aussi de faire le point sur l’éventuelle confirmation de
nos hypothèses de travail.
III.1. Bilan général : limites et apports du dispositif
La durée du dispositif fortement restreinte par la contrainte de temps inhérente au
contexte de mise en place nous a obligé à faire le choix de supprimer la phase introductive des
interventions qui mettait en jeu l’expression corporelle des enfants. La suppression de cette
phase qui devait fonctionner comme un sas de décompression après la journée d’école et comme
une introduction dynamique au dispositif a été préjudiciable pour l’obtention d’une focalisation
de l’attention des enfants sur la suite des activités mais aussi plus simplement pour leur bien-
être au sein de l’atelier. Les difficultés de concentration de Marie lors de la première séance
avec elle le soir des vacances en est un exemple concret. Nous pourrions supposer que la
conservation de cette première activité aurait peut-être permis à une enfant introvertie comme
Adèle de pouvoir se détendre plus facilement pour ensuite libérer plus facilement sa parole et
son imagination pendant la suite du dispositif. Nous ne pouvons affirmer que la suppression de
l’expression corporelle ait été un facteur décisif dans son comportement, mais cela aurait peut-
être été un mode d’expression qui lui convenait mieux et qui nous aurait permis de constater
chez elle une éventuelle évolution entre la première et la dernière séance, évolution qui nous
échappe malheureusement aujourd’hui.
Une autre question a été soulevée pendant les trois semaines d’interventions, et il s’agit
de la question de l’appui sur les biographies langagières des enfants pour construire le contenu
des séances. Même s’il s’agit d’une démarche tout à fait valorisante des motivations de chacun
des enfants, nous avons parfois pu remarquer que nous n’obtenions pas toujours l’engouement
escompté. Par exemple, Marie qui avait émis le souhait de vouloir visiter l’Inde lors de notre
entretien n’a pas été en mesure de reconnaître ce pays lors de la séance dédiée à ce pays. De la
même manière, cela a pu se retrouver chez Rose qui, lors de la troisième séance, n’avait aucune
idée de l’origine espagnole de la pièce musicale et chantée qu’elle écoutait alors qu’elle avait
longuement parlé de l’Espagne dans la construction de sa biographie langagière. Ce type de
décalage entre nos attentes et la réalité peut s’expliquer par une possible corruption des données
recueillies lors des entretiens si les enfants ont parfois cherché à me donner des réponses plus
pour me satisfaire que pour exprimer leurs envies réelles, ce qui remet donc en cause la fiabilité
des données recueillies. Mais cela peut aussi répondre plus simplement du peu de connaissances
que peuvent avoir des enfants si jeunes sur des langues et des cultures étrangères, ce qui suppose
163
que mon dispositif leur aura peut-être permis de découvrir une facette qu’ils ne connaissaient
pas d’un pays qui les attire.
L’appui sur les biographies langagières des enfants a aussi mis en lumière une mauvaise
adéquation du déroulement du dispositif avec la réalité du terrain qui est sujette à des absences
de certains enfants lors d’ateliers ponctuels. En effet, la moitié des interventions a été préparée
en référence aux biographies langagières d’enfants qui allaient pourtant être absents, ce qui ne
rend pas optimale la valorisation des motivations individuelles. L’organisation d’un dispositif
autour de séances qui se suffisent à elles-mêmes aurait sans doute été plus adaptée au contexte
qu’un dispositif évolutif d’une semaine à l’autre, d’autant plus que deux semaines de vacances
interrompaient cette approche évolutive dans le temps. Avec les deux semaines de pause, le
retour sur les activités réalisées supposait plus une démarche réflexive qu’émotionnelle de la
part des enfants, ce qui nous a amené à l’obtention d’interprétations parfois divergentes de
certains dessins. Cependant, aborder une organisation de séances individuelles plus
qu’évolutives nous aurait aussi obligés à réduire la durée de certaines activités, voire même
d’en supprimer certaines pour respecter les contraintes de temps imposées, ce qui finalement
aurait peut-être également desservi notre travail de recherche sur le terrain.
Ce problème d’organisation du dispositif doit également être reconnu dans la mauvaise
adaptation au calendrier d’interventions du groupe du vendredi : je n’ai pas su anticiper à temps
la présence de vendredis fériés sur mes dates de stage et je n’ai pas pleinement tiré profit du fait
de pouvoir animer la dernière séance avec ce groupe seule, mise à part la suppression de la
restriction de temps pour effectuer les activités du dispositif. Une meilleure anticipation de ce
type de situation m’aurait sans doute permis d’offrir à Alix et Marie une expérience de la
rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs plus complète en ayant avec moi les photos de voyages de
Lulu, ce qui aurait également permis de limiter les variations d’un groupe à un autre déjà
observées dans le temps laissé aux enfants pour effectuer leur dessin. De fait, tous les enfants
du groupe du mercredi à l’exception d’Adèle ont eu plus de temps que programmé pour pouvoir
finir leur dessin sur l’Espagne, Victor a eu plus de temps que ses compagnons du groupe du
mardi pour réaliser son dessin sur la Côte d’Ivoire et Marie et Alix ont pu prendre le temps dont
elles avaient besoin pour dessiner leur vision de la Chine et du Moyen-Orient lors de la seconde
séance du dispositif. Néanmoins, même si ces variations de temps ont porté préjudice à la
rigueur que suppose la mise en place d’un dispositif didactique, elles ont permis de limiter la
frustration des enfants quant à la limitation du temps de réalisation des dessins, ce qui me
semblait important dans le cadre d’un travail autour de la mise à profit des émotions dans les
situations d’EA.
164
Une autre critique que nous pouvons formuler à l’encontre de notre dispositif est
l’introduction de l’écrit auprès d’enfants qui ne sont pas tous à même de lire, ce que nous avons
déjà justifié dans la première partie de ce chapitre. Le fait que les étiquettes soient préparées
par mes soins a permis de faciliter la découverte d’autres systèmes d’écriture que celui que les
enfants connaissent, mais il nous faut reconnaître que la dimension esthétique de la calligraphie
aurait pu, idéalement, être intégrée au dispositif en permettant aux enfants de s’essayer à
l’écriture arabe, hindi ou encore japonaise, ce qui aurait enrichi la dimension artistique des
activités.
D’autres éléments apportent un bilan plus nuancé des limites et des apports de notre
dispositif. Par exemple, le passage du format A4 à A5 pour les feuilles de dessin a été judicieux
car plus adapté au temps dont les enfants disposaient. Cela était plus facile pour eux d’occuper
un petit format en si peu de temps et surtout moins frustrant que de n’utiliser que partiellement
une feuille A4. Dans un contexte où le temps n’aurait pas été une si grande contrainte, il nous
semble qu’un format moyen à grand serait malgré tout plus indiqué dans le cadre d’une étude
où l’objectif est de laisser libre cours à l’imagination et à l’expression des acteurs.
Le pouvoir évocateur des pièces musicales et chantées a été vérifié lors de certaines
séances, notamment avec le groupe du mardi à la découverte de la Côte d’Ivoire, mais il a aussi
parfois été remis en cause lorsque les enfants n’arrivaient pas à se figurer un pays ou des images
que pouvaient leur transmettre la musique. Nous supposons alors que la musique peut, de fait,
être évocatrice, et plus particulièrement lorsque celle-ci reprend des éléments familiers que
l’auditeur peut facilement identifier. Dans les cas où son pouvoir évocateur a semblé limité,
nous entrevoyons deux explications possibles : soit le choix des pièces musicales et chantées
n’a pas été judicieux, c’est-à-dire qu’elles nous sont apparues subjectivement comme
évocatrices mais ne l’étaient pas objectivement pour les enfants. Soit les enfants ne pouvaient
être en mesure de deviner les pays dans lesquels Lulu avait voyagé grâce à ces morceaux car
ceux-ci ne comportaient aucun son qui leur était effectivement familier et/ou les enfants n’avait
strictement aucune connaissance de ces pays et de leur musique pour pouvoir les identifier.
De la même manière, les dessins n’ont pas toujours révélés des représentations des
enfants sur les pays abordés. Marie était dans la démarche de dessiner ce qui lui faisait envie et
a donc représenté des arbres dans tous ses dessins sauf un. D’autres enfants ne savaient tout
simplement pas ce qu’ils pouvaient dessiner car ils ne connaissaient pas du tout les pays
présentés, notamment avec le groupe du mardi et la découverte de la Roumanie. Dans
l’ensemble, les dessins présentant des éléments qui relèvent du monde des représentations ont
été réalisés par les enfants les plus âgés des AMP, et en particulier Arthaud qui a pu s’appuyer
165
sur ses connaissances dans de nombreux domaines. Les enfants les plus jeunes comme Thomas,
Adèle ou Alix ont réalisé des dessins qui n’ont pour trait caractéristique de l’étranger que les
étiquettes de « bonjour ». Ces constatations corroborent les analyses de Christiane Perregaux
(2009) sur « les dessins des jeunes enfants » comme révélateurs de l’apparition de
représentations sur les langues et les cultures qu’à partir d’un certain âge ou encore uniquement
lorsque les langues ou cultures abordées renvoient à des éléments familiers pour les enfants.
Malgré ses limites, notre dispositif a aussi présenté un certain nombre de points positifs
comme l’intégration de la marionnette qui s’est révélée être un véritable outil dans le cadre de
séances d’éveil aux langues et aux cultures. Capteur d’attention, accroche affective et
médiatrice de la rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs par le biais de la théâtralisation, Lulu la
Tortue est apparue comme un fil rouge dans le dispositif. Elle a générée des émotions positives
chez les enfants, leur apportant surprise, comédie et tendresse comme partenaires de voyage
privilégiées, ce qui semble avoir construit les bases d’une rencontre avec des langues et des
cultures étrangères dans une atmosphère dénuée de sensations désagréables et d’émotions
négatives.
Le fait d’apporter les « bonjour » comme souvenirs rapportés par la marionnette avec
laquelle les enfants ont très vite créé des liens a été un autre point fort du dispositif, car ceux-ci
semblent les avoir perçus comme de véritables cadeaux. Contents de pouvoir les rapporter chez
eux, c’est en quelque sorte une trace de leur rencontre avec une langue et une culture étrangères
qu’ils ont pu transférer de l’Atelier du Coteau à leur environnement familier. En réalisant cela,
ces nouvelles langues et ces nouvelles cultures ne seront désormais plus complètement
étrangères pour eux, ce qui devrait favoriser d’éventuelles retrouvailles futures ou faciliter
d’autres rencontres. L’action de ces « bonjour » souvenirs comme pont entre le lieu d’éveil et
le monde familier a été renforcée, pour certains enfants, par l’association de découvertes
effectuées pendant les séances du dispositif à des éléments ou des personnes déjà présents dans
leur vie (des camarades de classe parlant l’arabe, des activités de loisir comme le karaté,
certaines séries télévisées et des cerisiers dans le jardin des grands-parents rappelant le Japon).
Tous ces éléments participent de la complexité de la mise en place d’un dispositif dans
un contexte comme celui des AMP de l’Atelier du Coteau, mais témoignent aussi de la
possibilité, bien qu’informelle, d’évaluer ne serait-ce que partiellement un dispositif dans un
environnement étranger aux approches de la didactique. C’est l’association originale des
pratiques artistiques à un éveil aux langues et aux cultures qui apportent ici des bénéfices tant
pour les enfants que pour la valorisation de la démarche de cette association. Voyons à présent
166
ce que notre dispositif apporte à notre question de recherche et à nos hypothèses de travail dans
le point suivant.
III.2. Bilan au regard des hypothèses de travail
La mise en place de notre dispositif comportait des enjeux liés à la validation de nos
trois hypothèses de travail, et le bilan de ce chapitre nous permet à présent de conclure sur les
points forts et les limites de ce dispositif dans le cadre de notre démarche praxéologique.
L’objectif de cette démarche était de concilier la recherche de solutions aux problèmes de
terrain et l’application de certaines théories didactiques nous permettant de valoriser les
émotions des acteurs des AMP vers une meilleure association de l’éveil aux langues et aux
cultures et des pratiques artistiques.
Notre première hypothèse stipulait que le CARAP, en tant que cadre de référence de
l’Eveil aux Langues, pourrait être un outil adapté aux valeurs artistiques de l’association
favorisant la définition d’objectifs d’apprentissage qui faciliteraient à leur tour la préparation
des AMP selon des principes didactiques explicitement définis prenant en compte la dimension
émotionnelle des activités d’éveil aux langues et aux cultures. Après avoir diagnostiqué en quoi
le fonctionnement existant des AMP et de l’Atelier du Coteau reprenait déjà des valeurs et des
objectifs du CARAP, prouvant une possibilité de recours à ce cadre comme outil adapté à notre
terrain de recherche, nous avons mis sur pied un dispositif s’appuyant sur certains objectifs plus
précis fixés par ce même cadre afin de confirmer sa pertinence comme outil didactique dans le
contexte des AMP et de l’Atelier du Coteau. Ces objectifs ont été atteints selon le détail suivant :
- Les enfants ont pu avoir un aperçu de la grande pluralité des langues à travers le monde
(K5.1) en permettant à chaque groupe de découvrir trois pays mobilisant des langues
différentes, et parmi eux des pays revendiquant l’utilisation de plusieurs langues au sein
de leur territoire. Ils ont ainsi pris conscience de l’existence d’une grande diversité
d’univers sonores (K5.2), tant par les pièces musicales et chantées rapportées par Lulu
que par les « bonjour » abordés au fil des deux premières séances. Ils ont également pu
découvrir une pluralité de systèmes d’écriture (K5.3) grâce à la découverte de la Chine,
du Japon, de l’Inde, et du Moyen-Orient pour lesquels ils ont été à même de remarquer
que les « bonjour » de ces régions du monde ne recouraient pas à l’alphabet latin qu’ils
découvrent et/ou utilisent notamment à l’école. Grâce à l’échange instauré autour des
photos de voyage dans les groupes du mardi et du mercredi, nous pensons pouvoir
167
affirmer que les enfants de ces groupes ont également pu approfondir leur conscience
de l’existence d’une grande pluralité de cultures à travers le monde (K12.1).
- Même si nous ne pouvons affirmer que les enfants savent observer les sons dans des
langues peu ou pas connues (S1.2) car le dispositif ne cherchait pas à ce qu’ils traitent
les sons en tant que tels mais sous forme d’images évoquées, nous pouvons néanmoins
affirmer qu’ils ont eu l’opportunité d’exercer leur oreille pour chercher à définir des
éléments d’une musique et d’un chant écouté. Nous avons pu remarquer que certains
enfants comme Marie, Rosemay, Arthaud, Alix et Lucien notamment, ont été capables
de mémoriser des éléments non familiers comme les « bonjour » (S.7.1) mais aussi de
les reproduire (S7.2) d’une séance sur l’autre, parfois suite à une question posée, parfois
spontanément au moment de saluer Lulu la Tortue.
- Pour les objectifs de savoir-être, il est plus difficile d’émettre un bilan certain étant
données les difficultés supposées pour mettre en place une évaluation de ces objectifs.
Malgré tout, les enfants ayant participé aux séances du dispositif ont pu dans une
certaine mesure développer leur sensibilité aux différences langagières et culturelles
(A2.2) que suppose la rencontre avec un Autre et un Ailleurs. Etant donné l’ensemble
des réactions positives remarquées lors du visionnage des photos pour les groupes du
mardi et du mercredi, les interventions spontanées d’Alix lors de la seconde séance avec
le groupe du vendredi et l’absence de réactions de rejet ou d’opposition pendant la mise
en place du dispositif, les enfants semblent accepter qu’une autre langue/culture puisse
comporter des éléments différents de leur propre langue/culture (A4.3). Nous ne
sommes malheureusement pas en mesure d’affirmer qu’au moins certains enfants aient
développé ou renforcé une confiance en leurs propres capacités d’apprentissage
linguistique (A17.4) car il s’agit-là d’un savoir-être évaluable sur le long terme et les
trois semaines de mise en place du dispositif n’ont pas été suffisantes pour le constater.
Même si tous les enfants n’ont pas atteints l’intégralité de ces objectifs ou en tout cas à des
degrés différents les uns des autres, notre dispositif proposait tout le nécessaire pour en atteindre
la très grande majorité.
Notre deuxième hypothèse prenait en compte les difficultés de mise en place de
systèmes d’évaluation des AMP étant donné le rapport aux loisirs et à l’éveil dominants sur les
éventuels résultats d’apprentissage dans la démarche de l’Atelier du Coteau. Pour compenser
ces difficultés, nous supposions qu’une connaissance plus approfondie des enfants et de leur
environnement langagier et culturel, ainsi que des attentes et suggestions de leurs parents,
pourrait être une base de réflexion pour la création d’activités qui valoriseraient le bagage initial
168
des enfants et leur évolution dans les AMP à leurs yeux et aux yeux de leurs parents, générant
ainsi une atmosphère et des émotions positives propices à l’épanouissement des ateliers et de
leurs acteurs. Nous avons validé le premier critère de cette hypothèse dans le chapitre précédent
en établissant un portrait des enfants comme apprenants et en effectuant une enquête de
satisfaction auprès des parents pour faire le point sur d’éventuels éléments jusqu’alors non pris
en compte dans les AMP. Le deuxième critère supposait de prendre en compte ces données
dans la conception et la mise en place de notre dispositif afin de générer des émotions positives
de la part des enfants et de leurs parents. Pour le premier groupe d’acteurs des AMP, nous avons
vu dans le point antérieur que les bénéfices de l’appui sur les portraits d’apprenants pour
valoriser les motivations des enfants dans le dispositif n’ont pas toujours été évaluables à cause
des absences remettant en cause cette dimension du dispositif. Néanmoins, les enfants ont
semblé apprécier mes interventions au point de regretter qu’elles ne durent pas plus longtemps
ou qu’elles se terminent après seulement trois semaines de mise en place, ce qui pourrait être
perçu comme un signe de génération d’émotions positives liée au dispositif. L’évaluation de la
satisfaction des parents n’a malheureusement pas pu être réalisée et aucun signe particulier n’a
pu être relevé, si ce n’est dans le cas de l’un des parents récupérant son enfant à la sortie d’une
de mes interventions : après avoir expliqué les pays et « bonjour » abordés lors de la séance au
parent demandant ce que nous avions fait, celui-ci a répondu d’un « A voir ce qu’ils ont retenu
de tout ça ! ». Ce type de réaction a notamment reflété la difficulté de conciliation des attentes
des parents pour leurs enfants à la frontière entre la reconnaissance des bénéfices de l’éveil et
le souhait de résultats en termes d’apprentissages concrets. Notre deuxième hypothèse n’est
donc que partiellement confirmée.
Notre troisième et dernière hypothèse s’intéressait au développement de l’imagination
impulsé par les arts en amont et traduit par un acte créatif en aval jusqu’alors uniquement
valorisé lors d’activités purement artistiques qui pourrait s’appliquer à des activités d’éveil aux
langues et aux cultures : le pouvoir évocateur des arts serait un point de rencontre émotionnel
de l’apprenant avec une langue et une culture étrangères. Cette troisième hypothèse reposait
entièrement sur la conception et la mise en place de notre dispositif et comprenait la capacité
des enfants à se figurer un pays à partir d’un support artistique en guise de premier critère et la
capacité d’exprimer ce qu’ils s’imaginent de ce pays comme deuxième critère. Or, comme nous
l’avons déjà mentionné dans le bilan général sur les limites et les apports du dispositif nous ne
pouvons confirmer cette hypothèse au regard de ses deux critères car les enfants n’ont pas
toujours réussi à se figurer un pays à partir de l’écoute des pièces musicales et chantées et tous
ne se sont pas exprimés sur ce qu’ils ont pu imaginer. Ces critères n’étaient tout simplement
169
pas adaptés à la réalité des processus en jeu : les musiques pouvaient ne pas être évocatrices ou
bien les enfants pouvaient tout simplement n’avoir aucune connaissance sur les pays abordés et
être dans une approche de découverte totale, ce qui ne leur permettait pas de se figurer quoi que
ce soit. Ensuite, la diversité des caractères et des personnalités ont fait qu’Adèle notamment ne
s’est jamais exprimée sur ce qu’elle avait pu imaginer. Seul un nombre restreint d’enfants ont
pu remplir ces critères au moment d’aborder certains pays, et cela ne suffit pas à valider dans
son intégralité notre dernière hypothèse. Malgré tout, le pouvoir évocateur des arts a pu
fonctionner dans une certaine mesure comme un point de rencontre émotionnel de l’apprenant
avec une langue et une culture étrangères puisque la musique, les dessins et les photos ont bien
eu le rôle de médiateurs dans cette rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs qui ne pouvaient
physiquement venir aux enfants dans les AMP : ces supports ont permis une approche à distance
certes, mais tout de même sensorielle de langues et de cultures étrangères.
171
Conclusion du mémoire
Après trois mois de stage au sein des AMP de l’Atelier du Coteau, nous faisons le bilan
d’un travail praxéologique complexe où théories et pratiques didactiques s’invitent dans un
contexte au départ exclusivement artistique. Cette démarche originale de l’association nous a
permis de découvrir un terrain de recherche mêlant arts, pratiques artistiques et éveil aux
langues et aux cultures dans lequel nous avons cherché à comprendre ce qui faisait l’identité de
cette structure encore en construction pour y proposer une démarche didactique adaptée. Voyant
dans les émotions un point de rencontre entre les deux grands domaines qui font l’identité des
ateliers multi-activités plurilingues, nous avons cherché à vérifier si la recherche de la
valorisation des émotions des acteurs des ateliers de Mehregan pouvait apporter à l’Atelier du
Coteau une amorce de démarche didactique lui permettant d’associer pleinement éveil artistique
et éveil aux langues et aux cultures dans ses AMP.
Après une longue interrogation du fonctionnement de l’association, du fonctionnement
des AMP, du travail de Mehregan, des motivations et du potentiel des enfants et des attentes de
leurs parents, nous avons cherché à mettre en place un dispositif conçu en pensant à l’ensemble
de ces acteurs. Nous avons donc voulu un dispositif qui soit en accord avec les valeurs
véhiculées par Elisa et Xavier dans leur travail quotidien, respecte le mode de travail de
Mehregan, prenne en compte une partie des attentes des parents et surtout valorise la dimension
émotionnelle d’une association des arts, des pratiques artistiques et de l’éveil aux langues et
aux cultures auprès d’enfants dans le cadre de l’organisation d’une exposition de leurs créations.
Nos résultats nous amènent à considérer le CARAP comme un outil propre à l’Eveil aux
Langues mais tout à fait adaptable au travail mené dans les AMP. En définissant des objectifs
clairs et compréhensibles aussi pour les parents des enfants inscrits aux ateliers, les tableaux de
compétences du CARAP pourraient participer de la création d’un projet pédagogique à l’échelle
de l’association et de ses ateliers artistiques plurilingues en apportant également des repères
utiles à toute éventuelle démarche d’évaluation. Seuls les savoir-être restent difficiles à évaluer
dans ce contexte : le bilan de notre dispositif ne nous a pas permis de confirmer par exemple
que les enfants avaient développé une confiance en leurs propres capacités d’apprentissage car
cela dépend d’une perception subjective de la confiance en soi qui pourrait ne se révéler que
sur moyen ou long terme, et notamment dans d’autres milieux que celui de l’Atelier du Coteau
comme l’école. Ensuite, l’adaptation du CARAP au fonctionnement des AMP ne peut que
véritablement se vérifier au long court, si Elisa, Xavier et Mehregan font le choix d’y recourir
ou non.
172
La collecte de données auprès des enfants et des parents apporte sans nul doute des
perspectives de réflexion à l’évolution des AMP, et nous avons pu montrer par notre dispositif
qu’il était possible de tirer profit de leur analyse pour générer des émotions positives dans les
ateliers, même si il nous a été plus complexe d’en obtenir des signes chez les parents pour qui
les attentes oscillent entre éveil et apprentissage. Il s’agit d’un enjeu important pour l’Atelier
du Coteau qui doit définir clairement son positionnement entre ces deux pôles afin d’adapter sa
communication auprès des parents et de l’extérieur. Une fois de plus, le recours au CARAP
pourrait s’avérer utile pour rassurer les parents sur la présence d’une démarche didactique pour
la dimension plurilingue des ateliers artistiques qui semble plus, à l’heure actuelle en tout cas,
s’orienter vers un éveil aux langues et aux cultures qui n’est pas sans générer des apprentissages
selon une approche artistique originale. Pour être reconnus, il nous paraît important que ces
apprentissages soient valorisés auprès des enfants, de leurs parents et de l’extérieur, ce que le
projet d’exposition peut assurer s’il est véritablement pensé dans une association des arts, des
pratiques artistiques et de l’éveil aux langues et aux cultures. Dans cet objectif, les dessins que
les enfants ont réalisés sur chaque pays abordés dans le cadre de mon dispositif doivent donner
lieu à une installation lors du vernissage de l’exposition. Cette installation reprendra la diffusion
des pièces musicales et chantées comme un cadre sonore, mais aussi pour offrir aux visiteurs,
et notamment aux parents, de vivre l’expérience de leur enfant en ayant à disposition des feuilles
et des crayons de couleur leur permettant à leur tour de dessiner ce que ces musiques leur
évoquent, ce qui pourrait donner lieu à de nouvelles analyses didactiques que ne peut
malheureusement comprendre ce mémoire étant donné les délais propres à sa réalisation.
Nous n’avons pas pu valider notre troisième hypothèse qui cherchait à s’appuyer sur
l’imagination comme valeur de travail de l’association et de Mehregan et capacité susceptible
de développer les compétences émotionnelles des enfants dans leur rencontre avec l’Autre et
l’Ailleurs. Les critères établis n’étaient pas adaptés à la réalité des processus en jeu dans notre
dispositif. L’imagination peut véritablement être le médiateur d’une rencontre avec l’étranger,
mais nous avons oublié que cette capacité repose avant tout sur des perceptions ou des
expériences antérieures que les enfants ne pouvaient pas toujours posséder dans la découverte
de certains pays comme la Roumanie notamment. Le recours aux biographies langagières peut
nous permettre d’identifier certaines perceptions et expériences des enfants révélant le potentiel
de ceux-ci dans la découverte de langues et de cultures dont ils ont déjà connaissance, mais
proposer un éveil à des langues et des cultures complètement étrangères aux enfants devrait se
concevoir différemment. Nous pourrions par exemple concevoir un dispositif partant de la
découverte d’œuvres d’art, de photographies, de musiques ou encore d’histoires propres de ces
173
terres encore inconnues aux enfants pour les aider dans la construction d’éléments qui viendront
ensuite nourrir leur imagination pour réaliser d’autres activités.
Bien que nous n’ayons pas réussi à confirmer chacune de nos hypothèses dans leur
totalité, nous faisons un bilan positif de la conception et de la mise en place de notre dispositif
qui, malgré les contraintes de temps et de contretemps, a réussi à proposer aux enfants des
activités à la rencontre de l’Autre et de l’Ailleurs selon une perspective artistique
pluridisciplinaire conservée au cœur de chacune des activités proposées. L’expression de la
déception des enfants au moment de mettre fin à une intervention ou celle de leur envie de
découvrir d’autres pays, voire d’y voyager « comme Lulu » semblent être des signes d’un bilan
qualitatif très satisfaisant sur le court-terme puisqu’il s’agit bien d’émotions positives générées
et valorisées dans chacun des groupes.
Les apports de ce dispositif à Mehregan et à l’Atelier du Coteau sont encore difficiles à
évaluer car mon travail de stagiaire a avant tout permis de générer des supports de réflexion
pour d’éventuelles évolutions des AMP à partir de l’enquête de satisfaction des parents, des
biographies langagières établies pour chaque enfant et du dossier des tableaux de compétences
du CARAP adaptés au contexte de l’association (voir annexe 10). Ces outils doivent être
présentés prochainement en réunion de bilan de stage pendant laquelle nous pourrons avoir une
meilleure idée de leur pertinence pour les acteurs encadrant les activités de l’Atelier du Coteau.
Sur un plan plus personnel, ce travail de fin d’étude en didactique des langues et des
cultures m’aura permis d’effectuer des recherches sur un sujet que je trouve passionnant et qui
avait marqué mes premiers pas dans le domaine de l’enseignement il y a bientôt quatre ans.
Effectuer mon stage à l’Atelier du Coteau m’a offert d’apprécier la complexité de la démarche
praxéologique qui ne peut toujours rester en parfait équilibre entre théories et pratiques, la
réalité opposant ses résistances à celui qui chercherait à expliquer avant de comprendre dans un
cadre qui ne peut revendiquer de conditions de recherche en laboratoire. L’ensemble des
enseignements reçus lors du premier semestre de cette année de Master auront été des
ressources précieuses pour mener à bien mon étude du contexte, aussi difficile et essentielle
soit-elle dans une structure ne répondant pas explicitement d’une approche didactique. Je pense
que cette étude m’a permis de développer et d’affiner mes compétences d’observation et
d’analyse, compétences indispensables pour exercer un métier dans le domaine de
l’enseignement et de la formation, tout comme la compétence réflexive qui ne peut qu’être mise
à l’épreuve au quotidien pour espérer être chaque jour un meilleur professionnel.
Que mon avenir se dessine entre l’Eveil aux Langues ou la didactique des langues et des
cultures auprès de publics plus âgés dans des contextes ne se revendiquant pas obligatoirement
174
des approches plurielles, mon année de Master 2 et ce mémoire tout particulièrement m’auront
ouvert des portes vers une meilleure compréhension des enjeux liés à la rencontre avec l’Autre
et l’Ailleurs. Convaincue des apports des arts et des pratiques artistiques à la résolution de ces
enjeux éminemment émotionnels, il est certain que je chercherai à nourrir mon parcours de cette
approche interdisciplinaire pour une enseignement des langues et des cultures étrangères plus
efficient et respectueux de la dimension individuelle des apprentissages, que ce soit dans le
milieu professionnel ou celui de la recherche.
175
Bibliographie
Emotions et apprentissages
Carné, T. (2015). Tout le monde joue avec la mémoire. Studio 130 : La Plaine Saint-Denis.
Disponible sur http://www.france2.fr/emission/tout-le-monde-joue-avec-la-memoire.
Emission diffusée le mardi 21 avril 2015 à 20h55 sur France 2.
Dörnyei, Z. (2009). The psychology of second language acquisition. Oxford New York :
Oxford University Press.
Dörnyei, Z., & Skehan, P. (2005). Individual differences in L2 learning. Dans The
handbook of second language acquisition (pp. 589‑630). Oxford : Blackwell.
Lafortune, L. (Éd.). (2005). Pédagogie et psychologie des émotions : vers la compétence
émotionnelle. Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec.
MacKenzie, K. (2014). Performance anxiety in students: a pedagogical reference guide.
Arizona State University. Disponible sur
http://repository.asu.edu/attachments/140897/content/MacKenzie_asu_0010E_14457.
pdf. Consulté le 24 avril 2015.
Masmoudi, S., Naceur, A., Rimé, B., Baddeley, A. D., Lafortune, L., & Reeve, J. (2010). Du
percept à la décision intégration de la cognition, l’émotion et la motivation. Bruxelles:
De Boeck.
McNeil, F. (2009). Learning with the brain in mind. Los Angeles London: SAGE.
Werner, K. (2011). Effortless Mastery Kenny Werner: The 4 Steps How to Play Jazz Videos.
Jazz Improvisation Lessons. Disponible sur
https://www.youtube.com/watch?v=I_uAhg6cy5s&feature=youtube_gdata_player.
Consulté le 26 avril 2015.
176
Emotions et didactique des langues et des cultures
Aden, J. (2010). L’empathie, socle de la reliance en didactique des langues. Dans Enseigner les
langues-cultures à l’ère de la complexité : approches interdisciplinaires pour un monde
en reliance. Interdisciplinarity approaches for an interrelated world. Actes du colloque
international « Vers un paradigme de la reliance : univers de croyance en didactique
des langues-cultures », 27 au 29 novembre 2009, Université de Cergy-Pontoise
(Université de Cergy-Pontoise, pp. 23‑44). Bruxelles Bern Berlin [etc.] : P.I.E. P. Lang.
Aguilar Río, J. I. (2013). L’enseignement d’une langue comme pratique émotionnelle :
caractérisation d’une performance, ébauche d’une compétence. Dans Lidil L’Emotion
et l’Apprentissage des Langues, 48 (LIDILEM, pp. 137‑156). Grenoble : Ellug.
Berchoud, M. (2013). I learn English because it’s my mother tongue: redonner place au sujet
qui apprend. Dans L’intime et l’apprendre. La question des langues vivantes (pp.
35‑60). Bern Berlin Bruxelles [etc.] : Peter Lang.
Berdal-Masuy, F., & Botella, M. (2013). La pédagogie par le projet favorise-t-elle
l’apprentissage linguistique ? Mesure de l’impact émotionnel de ce type d’approche sur
les apprenants. Dans Lidil L’Emotion et l’Apprentissage des Langues, 48 (LIDILEM,
pp. 57‑76). Grenoble : Ellug.
Brewer, S. S. (2010). Un regard agentique sur l’anxiété langagière. Dans Enseigner les langues-
cultures à l’ère de la complexité : approches interdisciplinaires pour un monde en
reliance. Interdisciplinarity approaches for an interrelated world. Actes du colloque
international « Vers un paradigme de la reliance : univers de croyance en didactique
des langues-cultures », 27 au 29 novembre 2009, Université de Cergy-Pontoise
(Université de Cergy-Pontoise, pp. 75‑88). Bruxelles Bern Berlin [etc.] : P.I.E. P. Lang.
Brewer, S. S. (2013). Entre émotions et contrôle de soi : un enjeu essentiel pour l’autonomie
dans l’apprentissage des langues. Dans Lidil L’Emotion et l’Apprentissage des Langues,
48 (LIDILEM). Grenoble : Ellug.
Goutéraux, P. (2010). L’affect, un outil de médiation pour l’appropriation des représentations
culturelles et linguistiques en langue étrangère. Dans Enseigner les langues-cultures à
l’ère de la complexité : approches interdisciplinaires pour un monde en reliance.
177
Interdisciplinarity approaches for an interrelated world. Actes du colloque
international « Vers un paradigme de la reliance : univers de croyance en didactique
des langues-cultures », 27 au 29 novembre 2009, Université de Cergy-Pontoise
(Université de Cergy Pontoise, pp. 103‑118). Bruxelles Bern Berlin [etc.]: P.I.E. P.
Lang.
Lightbown, P. M., & Spada, N. M. (2006). How languages are learned (3rd edition). Oxford :
Oxford University Press.
Piccardo, E. (2013). Evolution épistémologique de la didactique des langues : la face cachée
des émotions. Dans Lidil L’Emotion et l’Apprentissage des Langues, 48 (LIDILEM).
Grenoble : Ellug.
Pinon, C. (2013). Gérer la charge émotionnelle liée à la langue arabe : un défi pour le professeur
de langue étrangère. Dans Lidil L’Emotion et l’Apprentissage des Langues, 48
(LIDILEM, pp. 115‑136). Grenoble : Ellug.
Puozzo Capron, I., & Piccardo, E. (Éds). (2013). « Au commencement était l’émotion » :
Introduction. Dans Lidil L’émotion et l’apprentissage des Langues, 48 (LIDILEM).
Grenoble : Ellug.
Rui, B. (2013). Travailler à sa liberté de sujet dans la rencontre avec une langue étrangère - Une
approche anti-utilitariste et humaniste de l’enseignement-apprentissage des langues.
Dans L’ intime et l’apprendre la question des langues vivantes (pp. 61‑80). Bern
Berlin Bruxelles [etc.] : Peter Lang.
Sauvayre, R. (2010). La croyance à l’épreuve. Une dialectique émotionnelle et cognitive. Dans
Enseigner les langues-cultures à l’ère de la complexité : approches interdisciplinaires
pour un monde en reliance. Interdisciplinarity approaches for an interrelated world.
Actes du colloque international « Vers un paradigme de la reliance : univers de
croyance en didactique des langues-cultures », 27 au 29 novembre 2009, Université de
Cergy-Pontoise (Université de Cergy-Pontoise, pp. 119‑132). Bruxelles Bern Berlin
[etc.] : P.I.E. P. Lang.
178
Didactique des langues et des cultures, arts et pratiques artistiques
Aden, J. (2014). Empathie et pratiques théâtrales en didactique des langues. E-CRINI, 6 (Actes
du colloque Langues en mouvement : didactique des langues et pratiques artistiques, 6
et 7 septembre 2012). Disponible sur http://www.crini.univ-
nantes.fr/1403000125802/0/fiche___pagelibre/&RH=1402999468883. Consulté le 8
septembre 2014.
Arleo, A. (2000). Music, song and foreign language teaching. Les Cahiers de l’APLIUT, 19
(juin 2000), 5‑19.
Bécavin, A.-L. (2014). Artistic expression in modern languages: skills improvement and self-
actualisation. SCILT - Scottish Languages Review, 27. Disponible sur
http://www.scilt.org.uk/ResourceView/tabid/1092/articleType/ArticleView/articleId/3
049/Artistic-expression-in-modern-languages-skills-improvement-and-self-
actualisation.aspx.
Boddie, C. J. (2014). Common Core in Action: Using the Arts to Spark Learning. Edutopia.
Disponible sur http://www.edutopia.org/blog/common-core-and-creative-learning-
courtney-boddie. Consulté le 21 janvier 2015.
Borgé, N. (2014). Exploitation pédagogique de la photographie d’art et production écrite en
français langue étrangère dans un dispositif pédagogique de niveau avancé. E-CRINI, 6
(Actes du colloque Langues en mouvement : didactique des langues et des pratiques
artistiques, 6 et 7 septembre 2012). Disponible sur http://www.crini.univ-
nantes.fr/1403000125802/0/fiche___pagelibre/&RH=1402999468883. Consulté le 8
septembre 2014.
Dubrac, A.-L. (2014). Jouer des extraits cinématographiques afin d’apprendre une langue cible.
E-CRINI, 6 (Actes du colloque Langues en mouvement : didactique des langues et
pratiques artistiques, 6 et 7 septembre 2012). Disponible sur http://www.crini.univ-
nantes.fr/1403000125802/0/fiche___pagelibre/&RH=1402999468883. Consulté le 8
septembre 2014.
Leroy, J.-L. (2008). La musique produit-elle des effets bénéfiques sur l’apprentissage du
langage ? Quelques réflexions à partir des données de la psychologie de la musique.
179
Dans Apprentissage des langues et pratiques artistiques. Créativité, expérience
esthétique et imaginaire (pp. 195‑215). Paris: Ed. le Manuscrit.
Nobori, M. (2012). How the Arts Unlock the Door to Learning. Edutopia. Disponible sur
http://www.edutopia.org/stw-arts-integration-reform-overview. Consulté le 22 janvier
2015.
Puozzo Capron, I. (2014). Pour une pédagogie de la créativité en classe de langue. Réflexion
théorique et pratique sur la triade : créativité, émotion, cognition. Voix plurielles, 11.1,
101‑111.
Puozzo Capron, I., & Perrin, N. (2014). La créativité et l’apprentissage des langues, des
mathématiques et du sport. Entretien de Joëlle Aden, Odette Bassis et Marie-Cécile
Crance. L’Educateur, (La créativité. Une finalité ? Une passerelle pour apprendre ?).
Puozzo Capron, I. (2013). Pédagogie de la créativité. De l’émotion à l’apprentissage. Education
et socialisation - Les Cahiers du CERFEE, 33 (Education relative à
l’environnement/Education au développement durable - Varia).
Witzigmann, S. (2014). L’art dans tous ses états : synergies entre le français langue étrangère
et les arts plastiques. E-CRINI, 6(Actes du colloque Langues en mouvement : didactique
des langues et pratiques artistiques, 6 et 7 septembre 2012). Disponible sur
http://www.crini.univ-
nantes.fr/1403000125802/0/fiche___pagelibre/&RH=1402999468883. Consulté le 8
septembre 2014.
Zask, J. (2008). L’éducation et l’expérience de l’art. Dans Apprentissage des langues et
pratiques artistiques. Créativité, expérience esthétique et imaginaire (pp. 51‑64). Paris :
Ed. Le Manuscrit.
Sur le rôle du corps, du mouvement et du geste dans les apprentissages
Corder Meagher, M. (2015). Science Says Your Classroom Needs More Dance Parties.
TeacherPop. Disponible sur http://teacherpop.org/2015/01/science-says-your-
classroom-needs-more-dance-parties/. Consulté le 22 janvier 2015.
180
Mallet, C. (2013). Geste de la langue et corps du sujet - Une approche humaniste centrée sur le
corps en didactique des langues. Dans L’ intime et l’apprendre la question des
langues vivantes (pp. 81‑134). Bern Berlin Bruxelles [etc.]: Peter Lang.
Margolis, A. (2015). Letting kids move in class isn’t a break from learning. It IS learning. The
Washington Post. Disponible sur http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-
sheet/wp/2015/01/19/letting-kids-move-in-class-isnt-a-break-from-learning-it-is-
learning/. Consulté le 22 janvier 2015.
Potapushkina Delfosse, M. (2014). Débuter l’apprentissage de l’anglais par le geste : de la
démarche d’enseignement aux stratégies mnésiques des élèves. E-CRINI, 6 (Actes du
colloque Langues en mouvement : didactique des langues et pratiques artistiques, 6 et
7 septembre 2012). Disponible sur http://www.crini.univ-
nantes.fr/1403000125802/0/fiche___pagelibre/&RH=1402999468883. Consulté le 8
septembre 2014.
Eveil aux Langues et approches plurielles
Aden, J., & Leclaire, F. (2014). Eveil aux langues et théories de la complexité : reconfigurations
linguistiques et identitaires. Dans Didactique du plurilinguisme. Approches plurielles
des langues et des cultures : autour de Michel Candelier (pp. 141‑148). Rennes : PUR.
Billiez, J. (2002). De l’assignation à la langue d’origine à l’éveil aux langues : vingt ans d’un
parcours socio-didactique. Ville - Ecole - Intégration Enjeux, 130, 87‑101.
Bourdet, J.-F. (2014). Eveil en langues, du plaisir à la découverte. Dans Didactique du
plurilinguisme. Approches plurielles des langues et des cultures : autour de Michel
Candelier (pp. 135‑140). Rennes : PUR.
Candelier, M. (2007). A travers les langues et les cultures. CARAP, Cadre de Référence pour
les Approches Plurielles des langues et des cultures (Version 2, juillet 2007).
Strasbourg : Conseil de l’Europe.
Conseil de l’Europe, & Centre Européen pour les Langues Vivantes. (2015). CARAP. Un Cadre
de Référence pour les Approches Plurielles. Disponible sur
181
http://carap.ecml.at/Accueil/tabid/3577/language/fr-FR/Default.aspx. Consulté le 6
janvier 2015.
Le Lièvre, F. (2014). Didactique de l’anglais et du plurilinguisme en France : quelques pistes
de réflexion. Dans La didactique plurilingue et pluriculturelle à l’épreuve du terrain
éducatif : contraintes, résistances, tensions [Recueil de contributions faisant suite au
colloque international Quelle didactique plurilingue et pluriculturelle en contexte
mondialisé ? Plurilingualism and pluriculturalism in a globalised world, which
pedagogy ?, réalisé à l’initiative de l’Équipe de recherche PLIDAM-INALCO, Paris,
17-19 juin 2010] (pp. 117‑126). Paris : EAC, Éd. des Archives contemporaines.
Little, D., & Simpson, B. (2011). Expérience et conscience interculturelles. Conseil de
l’Europe. Disponible sur http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-
reg/Source/Templates/ELP_Language_Biography_Intercultural_Component_Templat
es_FR.pdf. Consulté le 12 mars 2015.
Lörincz, I. (2014). Réflexivité et approches plurielles. Mise en œuvre d’un projet d’éveil aux
langues en Hongrie. Dans Didactique du plurilinguisme. Approches plurielles des
langues et des cultures : autour de Michel Candelier (pp. 129‑134). Rennes : PUR.
Perregaux, C. (2009). Dans les dessins des jeunes enfants, les langues sont des images. Dans
Le dessin réflexif élément pour une herméneutique du sujet plurilingue (pp. 31‑44).
Cergy-Pontoise : Université de Cergy-Pontoise, CRTF.
Biographies langagières
Conseil de l’Europe. (2014). Autobiographie de rencontres interculturelles. Conseil de
l’Europe. Disponible sur http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_FR.asp?.
Consulté le 12 mars 2015.
Conseil de l’Europe. (2011). La biographie langagière. Conseil de l’Europe : Portfolio
européen des langues. Disponible sur http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-
reg/elp_biography_FR.asp. Consulté le 12 mars 2015.
Conseil de l’Europe. (n.d.-a). Listes de repérage pour les PEL destinés aux jeunes apprenants :
principes et propositions. Conseil de l’Europe. Disponible sur
182
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-
reg/Source/Templates/ELP_Language_Biography_Checklists_for_young_learners_FR
.pdf. Consulté le 12 mars 2015.
Conseil de l’Europe. (n.d.-b). Profil plurilingue de l’utilisateur. Présentation de l’apprenant.
Conseil de l’Europe. Disponible sur http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-
reg/Source/Templates/ELP_Language_Biography_Plurilingual_Profile_FR.pdf.
Consulté le 12 mars 2015.
Perregaux, C. (2002). (Auto)biographies langagières en formation et à l’école: pour une autre
compréhension du rapport aux langues. Bulletin suisse de linguistique appliquée, (76),
81‑94.
Simon, D.-L., & Thamin, N. (2012). Mettre le biographique au travail en formation : un levier
pour une didactique du plurilinguisme. Dans Éveil aux langues et approches plurielles :
de la formation des enseignants aux pratiques de classe (pp. 285‑302). Paris:
l’Harmattan.
Autres références théoriques et méthodologiques
Altet, M. (1997). Les pédagogies de l’apprentissage. Paris : Presses Universitaires de France -
PUF.
Blanchet, P. (2000). Approche méthodologique : des enquêtes aux synthèses interprétatives.
Dans La linguistique de terrain. Méthode et théorie. Une approche ethno-
sociolinguistique (pp. 28‑40). (S.l.) : PUR.
Gadet, F. (2003). Derrière les problèmes méthodologiques du recueil de données. Texto !
Disponible sur http://icar.univ-
lyon2.fr/ecole_thematique/idocora/documents/Gadet_Derriere_le_probleme_methodol
ogique.pdf. Consulté le 10 mai 2015.
Perraudeau, M. (2006). Les stratégies d’apprentissage : comment accompagner les élèves
dans l’appropriation des savoirs. Paris : A. Colin.
183
Robbes, B. (2009). La pédagogie différenciée : historique, problématique, cadre conceptuel et
méthodologie de mise en œuvre (34 p.). Disponible sur
http://meirieu.com/ECHANGES/bruno_robbes_pedagogie_differenciee.pdf. Consulté
le 10 mai 2015.
L’Atelier du Coteau
L’Atelier du Coteau. (2015a). Atelier du Coteau. Atelier du Coteau. Disponible sur
http://www.latelierducoteau.com/. Consulté le 12 janvier 2015.
L’Atelier du Coteau. (2015b). Galerie 18. Atelier du Coteau. Disponible sur
http://www.latelierducoteau.com/. Consulté le 12 janvier 2015.
189
Annexe 2 : Photos des lieux
Façade de l’Atelier du Coteau avant mai 2015 Façade après mai 2015
Vue sur l’entrée latérale depuis la cour
Détail de la signalétique sur la façade principale
Entrée latérale de l’Atelier
198
Annexe 5 : Tableau d’intervention dans les écoles
Associations Jour P2 P3 P4 P5
2 travers et Cie 1 lundi Contrie Contrie Ampère Ampère
2 travers et Cie 2 mardi Chézine Chézine Chataigniers Chataigniers
2 travers et Cie 3 Jeudi Fraternité Fraternité Fraternité Fraternité
2 travers et Cie 4 vendredi Mulo Mulo Longchamp Longchamp
ALD Echecs 1 lundi G Carcouet G Carcouet Chézine Chézine
ALD Echecs 2 mardi Plantes Plantes Prévert Prévert
ALD Echecs 3 Jeudi Ampère Ampère Longchamp Longchamp
ALD Echecs 4 vendredi Fraternité Fraternité Contrie Contrie
Stade Nantais 1 lundi Plantes Plantes
Stade Nantais 2 mardi Contrie Contrie
Stade Nantais 3 Jeudi Longchamp Longchamp
Stade Nantais 4 vendredi Prévert Prévert
CSC Laetitia 1 lundi Longchamp Longchamp Longchamp Longchamp
CSC Laetitia 2 mardi Longchamp Longchamp G Carcouet G Carcouet
CSC Laetitia 3 Jeudi Prévert Prévert Prévert Prévert
CSC Laetitia 4 vendredi Plantes Plantes Plantes Plantes
Les gens debout 1 lundi
Les gens debout 2 mardi
Les gens debout 3 Jeudi
Les gens debout 4 vendredi G Carcouet G Carcouet
Mundelé Mundi 1 lundi Plantes Plantes
Mundelé Mundi 2 mardi Fraternité Fraternité
Mundelé Mundi 3 Jeudi Longchamp Longchamp
Mundelé Mundi 4 vendredi Prévert Prévert
Cie Frasques 1 lundi
Cie Frasques 2 mardi
Cie Frasques 3 Jeudi Chézine ou Chataigniers ou G Carcouet
Cie Frasques 4 vendredi
Fête le mur 1 lundi Chézine Chézine Chataigniers Chataigniers
Fête le mur 2 mardi Prévert Prévert Plantes Plantes
Fête le mur 3 Jeudi Longchamp Longchamp Mulo Mulo
Fête le mur 4 vendredi Contrie Contrie Fraternité Fraternité
ASPTT 1 lundi Fraternité Fraternité Fraternité Fraternité
ASPTT 2 mardi Ampère Ampère Ampère Ampère
ASPTT 3 Jeudi Contrie Contrie Contrie Contrie
ASPTT 4 vendredi Chézine Chézine Chataigniers Chataigniers
NAP jeux 1 lundi Mulo Mulo Mulo Mulo
NAP jeux 2 mardi Longchamp Longchamp Longchamp Longchamp
NAP jeux 3 Jeudi Fraternité Fraternité Ampère Ampère
NAP jeux 4 vendredi Chataigniers Chataigniers Chézine Chézine
NAP livres 1 lundi Longchamp Longchamp Longchamp Longchamp
NAP livres 2 mardi Mulo Mulo Mulo Mulo
NAP livres 3 Jeudi Contrie Contrie Chézine Chézine
NAP livres 4 vendredi Fraternité Fraternité Ampère Ampère
Base Ball Mariners 1 lundi
Base Ball Mariners 2 mardi Longchamp Longchamp
Base Ball Mariners 3 Jeudi
199
Base Ball Mariners 4 vendredi
Danse Corinne Brenon 1 lundi Prévert Prévert Prévert Prévert
DanseCorinne Brenon 2 mardi Carcouet Carcouet
Danse Corinne Brenon 3 Jeudi Plantes Plantes
Danse Corinne Brenon 4 vendredi Longchamp Longchamp Mulo Mulo
L'atelier du coteau Danse 1 lundi Ampère Ampère Contrie Contrie
L'atelier du coteau Danse 2 mardi Chataigniers Chataigniers Chézine Chézine
L'atelier du coteau Danse 3 Jeudi
L'atelier du coteau Danse 4 vendredi
Musique M Hériveau 1 lundi
Musique M Hériveau 2 mardi Contrie Contrie
Musique M Hériveau 3 Jeudi Mulo Mulo
Musique M Hériveau 4 vendredi Ampère Ampère
200
Annexe 6 : Journal de bord
Mardi 24 février 2015
Observation participative. Atelier de 17h à 18h.
3 participants : Marie, Lucien et Victor. Activité 1 : Les maisons en boîte de carton Les enfants sont assis par terre au milieu de la pièce. Création des maisons en boîte de carton pour Lucien et Victor avec l’aide de Marie et la mienne (Marie avait déjà commencé la sienne lors d’une journée de stage pendant les vacances). Emballage du carton dans du papier kraft et dessin des fenêtres à l’adhésif pour peinture ; peinture en jaune des ouvertures des fenêtres. Activité 2 : Comptine 1, 2, 3, 4, 5 Once I caught a fish alive Visionnage du video-clip sur Youtube via l’ordinateur de Mehregan: https://www.youtube.com/watch?v=CsnuED9h4OQ Les enfants s’assoient par terre en arc de cercle devant l’ordinateur de Mehregan ; Mehregan est assise devant eux sur un petit tabouret à côté de l’ordinateur posé sur la table basse.
- Mehregan demande à Marie de raconter l’histoire de la chanson à Lucien et Victor (Marie a découvert la chanson en participant à une journée de stage pendant les vacances, Lucien et Victor ne la connaissent pas du tout).
- Un visionnage du vidéo-clip : Mehregan, Marie et moi-même chantons par-dessus l’enregistrement (sur demande de Mehregan).
- Mehregan reprend la comptine a cappella avec chacun des participants à tour de rôle en mimant l’histoire par un geste associé à chaque phrase ; elle la chante d’abord avec Marie, puis moi, puis Lucien puis Victor.
→ Lors de cette dernière partie de l’activité, Mehregan insiste auprès des enfants pour qu’ils miment la comptine
tout en la chantant avec elle. Marie chante et mime sans difficultés apparentes, elle semble bien connaître la mélodie
et les paroles, ou tout du moins les sons que celles-ci supposent. Lucien et Victor montrent plus de difficultés : ils
marmonnent les paroles en suivant la voix de Mehregan mais n’articulent pas d’items langagiers compréhensibles
sauf au moment de chanter les chiffres qui semblent être des points de repère pour eux : l’articulation des sons est
plus claire et en rythme avec la mélodie.
Activité 3 : Comptine Old MacDonald had a farm Visionnage du video-clip sur Youtube via l’ordinateur de Mehregan: https://www.youtube.com/watch?v=LIWbUjHZFTw Comme pour la comptine précédente, il s’agit d’une découverte pour Lucien et Victor mais pas pour Marie qui l’a déjà entendue et chantée en stage pendant les vacances.
- Le clip est visionné une première fois : Mehregan chante par-dessus l’enregistrement et les enfants essaient d’en faire de même.
- Le clip est visionné une deuxième fois et Mehregan interrompt la lecture avant chaque mot d’animaux pour demander aux enfants « What are those ? ». Marie répond à la grande majorité des questions en donnant le nom des animaux en anglais.
Activité 4 : Suite de la réalisation des maisons en boîte de carton Les enfants décorent leur maison en dessinant une porte et en décorant les murs avec des feutres et des pastels. Ils sont assis par terre au centre de la pièce
201
Activité 5 : Les formes et les couleurs Mehregan sort de dessous la table basse une caisse en plastique dans laquelle se trouve des pièces de caoutchouc en forme de carrés, ronds, triangles, pieds et mains de couleur différente (rouge, vert, bleu et jaune). Les enfants sont debout au milieu de la pièce et regardent Mehregan. Celle-ci leur présente une à une les pièces de caoutchouc en disant « This is one … » et attend que l’un des enfants trouve la suite de la phrase en donnant en anglais la couleur et la forme de la pièce de caoutchouc présentée, par exemple « …red square. ». Lorsqu’un enfant a trouvé la réponse attendue par Mehregan, celle-ci lance la pièce de caoutchouc au milieu de la salle et en présente une autre, et ainsi de suite. Après cinq ou six lancés, elle ajoute à la réponse des enfants le nom de la couleur de la pièce de caoutchouc en espagnol et en persan et leur demande de répéter.
Observation participative. Atelier de 18h à 19h
1 participant : Victor. Séance particulière car habituellement Marie reste à ce second atelier avec Victor qui cette fois-ci se
retrouve seul en compagnie de Mehregan et moi-même.
Heure autour de l’alphabet et des mots commençant par A en anglais / Comptine « A, B, C » : Mehregan fait visionner un nouveau clip sur Youtube à Victor via son ordinateur : https://www.youtube.com/watch?v=zAlX1V3lK5s Victor est assis par terre devant l’ordinateur, Mehregan est assise sur le petit tabouret à côté de la table basse sur laquelle est l’ordinateur et regarde Victor.
- Avant de lancer le clip, elle s’assure de savoir si Victor connaît l’alphabet en français et lui fait réciter.
- En lançant le clip, elle invite Victor à chanter par-dessus l’enregistrement de l’alphabet en anglais.
- Après l’alphabet, la chanson change pour présenter six mots qui commencent par la lettre A (apple, ant, alligator, aeroplane, axe, ass) : après un premier visionnage de cette partie, Mehregan lance un deuxième visionnage en arrêtant le clip après la présentation de chaque mot pour que Victor dessine ce qu’il voit et répète le mot en anglais. Une fois chaque dessin terminé, elle demande à Victor « How do we say pomme/fourmi/crocodile/avion/hâche/mule in English ? » pour lui faire répéter les mots.
→ Dès cette partie de l’activité, Victor semble montrer des signes de fatigue et d’ennui : il a du mal à rester assis
dans la même position, s’allonge et se relève sans arrêt. Alors qu’il répète chacun des mots lorsque Mehregan les
prononce et lui demande de les dire à son tour, il n’arrive pas à les mémoriser et répond par un « Je sais plus » dès
que celle-ci lui demande « How do we say pomme/fourmi/etc. in English ? ».
Remarquant les difficultés de mémorisation de Victor, Mehregan lui fait faire des activités complémentaires autour des six mots commençant par A présentés dans la comptine :
- Mime : elle propose à Victor de mimer chaque mot pour me les faire deviner et donner leur nom en anglais, puis nous échangeons les rôles pour qu’il soit celui qui prononce les mots.
→ La compréhension du mime ne semble pas poser de problème à Victor mais les difficultés pour se
remémorer les mots correspondant en anglais persistent.
- Dessin : à tour de rôle, Mehregan, Victor et moi devons annoncer un mot en anglais et les deux autres doivent mettre le doigt sur le dessin correspondant.
- Répétition : assis tous les trois par terre dans le coin de la pièce où s’est déroulé l’intégralité de l’atelier, Mehregan demande à Victor de sélectionner un des six mots en anglais et de le faire répéter à l’une de nous en nous désignant d’un geste de la main. Le geste sert de
202
passeur du mot choisi d’une personne à une autre, et chacun doit le dire à haute voix dès qu’il est désigné. Cette activité a été répétée pour chaque mot.
Mercredi 25 février
Observation participative. Atelier de 17h à 18h30 (cet atelier ne dure habituellement qu’une heure, mais Mehregan rattrape
une partie d’une séance où elle a été absente). 6 participants : Arthaud, Rosemay, Maya, Thomas, Adèle et Rose.
Activité 1 : Nouvelles des vacances Tout le monde s’assoit en cercle au milieu de la pièce et Mehregan demande à chacun comment se sont passées leurs vacances. Tous sont interrogés à l’exception de Rosemay, la petite sœur d’Arthaud, une fois que celui-ci a raconté leurs vacances communes. Activité 2 : Comptine « Good Morning » Mehregan dispose de cette comptine comme fichier audio sur son ordinateur. Mehregan fait découvrir cette comptine aux enfants en leur expliquant d’abord qu’ils vont la mimer. Elle leur demande de s’allonger sur le sol et de faire comme s’ils se réveillaient un matin en entendant l’introduction instrumentale de la comptine : ils s’assoient, s’étirent, se frottent les yeux puis se mettent debout, forment une ronde et tournent alors que les paroles se font entendre. Mehregan et moi-même chantons par-dessus l’enregistrement en faisant la ronde avec les enfants, et Mehregan leur demande de chanter avec nous. Petit à petit, les enfants nous accompagnent au chant en essayant de suivre les sons qu’ils perçoivent des paroles. Activité 3 : Finition des créations sur le coucher de soleil Avant les vacances, les enfants avaient préparé des feuilles peintes aux couleurs chaudes du coucher de soleil, et d’autres aux couleurs de la nuit. Lors de la séance, ils ont découpé des formes de ce qu’ils pouvaient imaginer pour leur paysage dans la feuille aux couleurs nocturnes pour ensuite les coller sur le fond de couleurs chaudes. Activité 4 : Comptine perse Visionnage d’un vidéo-clip sur Youtube via l’ordinateur de Mehregan. Les enfants sont d’abord assis en arc de cercle devant l’ordinateur, Mehregan est assise sur le tabouret à côté de la table basse où se trouve l’ordinateur. Elle raconte aux enfants l’histoire de la comptine perse, celle d’un oncle revenu de son voyage pendant lequel il est allé jeter toutes les tristesses des enfants de l’autre côté de la montagne. La comptine demande à l’oncle les animaux qu’il a rencontré sur son chemin.
- Visionnage du vidéo-clip - Formation d’une ronde au milieu de la salle avec tous les enfants, Mehregan et moi-même :
Mehregan chante la comptine et fait répéter chaque phrase aux enfants tout en dansant sur la première partie de la comptine, puis en mimant la deuxième partie et enfin en imitant le bruit de chaque animal mentionné.
→ Lors de la danse sur la comptine, seul le mot pour dire « oui » et le mot correspondant pour chaque animal en
persan ont été explicitement révélés aux enfants. La mémorisation progressive de la comptine dans son ensemble ne
repose pas sur la compréhension de chaque item langagier pour Mehregan, mais simplement sur la connaissance
globale de l’histoire et la mémorisation des sons en chanson. Selon elle, la différence entre éveil et apprentissage se
situe là.
203
Vendredi 27 Février
Observation participative. Atelier de 17h à 18h.
3 participants : Marie, Agathe et Alix.
Activité 1 : Comptine « 1, 2, 3, 4, 5, Once I caught a fish alive » Les enfants s’assoient sur des tabourets en arc de cercle devant l’ordinateur de Mehregan pour regarder le vidéo-clip tiré de Youtube. Mehregan est assise sur un tabouret à côté de l’ordinateur. Marie connaît déjà la comptine.
- Premier visionnage du vidéo-clip : Mehregan, Marie et moi-même chantons par-dessus l’enregistrement.
- Alix explique qu’elle pense avoir compris l’histoire, énonce ce qu’elle a compris et demande confirmation à Mehregan. Celle-ci lui confirme qu’elle a bien compris l’histoire.
- Mehregan reprend la comptine a cappella en y ajoutant les gestes associés à chaque phrase, d’abord en chantant avec Marie, puis avec Agathe, puis Alix, puis moi.
→ Comme avec le groupe du lundi, Marie montre une bonne mémorisation globale de la comptine, particulièrement
pour les chiffres mais aussi pour le reste des phrases qu’elle réussit à chanter presque mot pour mot. En revanche,
Agathe et Alix montrent plus de difficultés et marmonnent la plupart des paroles, à l’exception des chiffres.
- Mehregan demande à tout le monde de se lever et de former un cercle au milieu de la pièce. Tous chantent ensemble, a cappella avec les gestes, la comptine.
Activité 2 : Démarrage d’une nouvelle œuvre – La mer. Mehregan et les enfants s’assoient en cercle au milieu de la pièce. Tous ont une planche de bois sur laquelle est scotchée une grande feuille blanche posée devant eux. Au milieu du cercle sont disposées plusieurs bouteilles de peinture de couleurs différentes et des palettes en plastique blanches.
- Mehregan demande aux enfants de fermer les yeux et d’imaginer qu’ils prennent un bateau sur la mer Méditerranée. Au milieu de la mer, le bateau s’arrête et ils plongent jusqu’à atteindre le fond. A ce moment, Mehregan demande à chacune des filles ce qu’elles voient au fond de la mer, et plus particulièrement les couleurs de l’eau. Mehregan commence en décrivant les couleurs qu’elle imagine au fond de l’eau en anglais et en persan. Chacune des filles décrit en français, et Mehregan leur demande de reformuler le nom des couleurs en anglais ou bien reformule elle-même à la suite des filles le nom des couleurs annoncées en anglais ou en persan.
- Mehregan prépare les palettes en redemandant les couleurs que les filles veulent, et elle leur demande de donner le nom de ces couleurs en anglais ou en persan.
- Mehregan montre ensuite comment poser les couleurs au pinceau sur la feuille, et toutes se mettent à peindre.
Une fois la feuille de chacune peinte, Mehregan leur donne une deuxième feuille vierge sur laquelle les filles doivent réaliser la même opération mais avec les couleurs qu’elles imaginent pour les poissons et les algues qui se trouvent au fond de la mer. Cette deuxième partie de l’activité est entamée mais pas terminée car commencée 10 minutes avant la fin de l’atelier.
Observation participative. Atelier de 18h à 19h.
1 participant : Agathe.
Habituellement seule Marie reste à cet atelier. Agathe y participe ponctuellement mais de manière non-régulière.
204
Activité 1 : Fin du fond de couleurs pour le projet La Mer. Agathe termine le fond de couleurs qu’elle imaginait pour les poissons et les algues. Activité 2 : Peinture de mains Afin de ne pas gâcher la peinture restante sur les palettes, Mehregan sort une feuille vierge de format A2 et propose de s’enduire les mains de peinture et de déposer les traces sur la feuille, jusqu’à ce que celle-ci soit remplie. Activité 3 : Agathe joue à la maîtresse sur la comptine « A, B, C » Mehregan m’explique qu’Agathe aime jouer à la maîtresse quand elle peut rester à l’atelier de 18h à 19h. Elle lui propose donc de jouer avec la comptine sur l’alphabet en anglais. Agathe s’asseoit sur un tabouret à côté de l’ordinateur, sans s’asseoir sur le tabouret habituellement utilisé par Mehregan. Mehregan est assise à sa place habituelle. Je suis assise sur un tabouret face à l’ordinateur.
- Agathe lance la vidéo et nous demande de chanter par-dessus l’enregistrement. Elle-même chante ponctuellement sur la chanson, mais elle semble plus porter son attention sur l’observation du clip animé.
- Lorsque la comptine passe à la découverte de mots commençant par A, Agathe stoppe le clip et nous demande de dessiner chaque mot donné sur une feuille pour Mehregan, sur une ardoise blanche pour moi.
Après ces semaines, la décision est prise de ne plus compter comme objet d’observation les ateliers où seul un participant est présent. Cette décision a été prise d’un commun accord entre Mehregan, M. Arleo mon directeur de recherche et moi-même.
Mardi 3 mars
Observation : test d’une première grille d’observation. Atelier de 17h à 18h.
Participants: Marie, Lucien et Victor.
Cette première version de grille d’observation s’est révélée non concluante, tout du moins pour sa deuxième partie qui s’intéressait à l’étude des types d’interaction entre les acteurs de l’atelier et à la manière dont les langues étaient utilisées. Le détail de ce qui a été fait pendant cette séance est détaillé dans l’annexe correspondant à la grille d’observation 1.
Mercredi 4 mars
Observation : test d’une deuxième grille d’observation. Atelier de 17h à 18h.
Participants: Arthaud, Rosemay, Maya, Adèle et Sacha (nouvelle) ; Thomas et Rose absents.
Cette deuxième version de la grille d’observation n’a pas été plus concluante que la première car elle se voulait beaucoup trop exhaustive et tout ne pouvait pas être observé.
205
Le détail de ce qui a été fait pendant cette séance est détaillé dans l’annexe correspondant à la grille d’observation 2.
Vendredi 6 mars
Observation participative. Atelier de 17h à 18h.
Participants: Marie et Agathe; Alix absente. Mehregan a organisé l’intégralité de l’atellier dans le parc de Procé. Je n’ai donc pas pu faire d’observations sur grille car nous étions en déplacement constant. Une fois arrivées au parc, Mehregan a commencé par photographier Marie et Agathe individuellement puis ensemble dans différents endroits du parc pour un projet artistique qu’elle a en tête pour l’exposition. Ensuite, nous avons observé une jonquille que les enfants ont essayé de dessiner aux crayons de couleur sur leur cahier de manière réaliste. Nous sommes rentrées à l’Atelier du Coteau en chantant sur le chemin la comptine perse de Mehregan et « 1, 2, 3, 4, 5, once I caught a fish alive ».
Mardi 10 mars
Observation par prises de notes libres. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Marie, Lucien et Victor.
Observation par prises de notes car la nouvelle grille d’observation n’est pas encore au point. La séance a commencé par le mime et la danse sur la comptine « good morning » puis par le chant et de la comptine iranienne à deux reprises. Ensuite les enfants ont regardé le clip de la comptine « 1, 2, 3, 4, 5, Once I caught a fish alive » pour le chanter avec Mehregan. On ressent de la fatigue et de la lassitude : les enfants sont passés de la posture assis en tailleur à couchés à plat ventre, Victor afiirme à haute voix qu’il n’a pas envie de chanter. Après les comptines, l’atelier s’est poursuivi par la réalisation de l’atelier peinture sur le thème de la Mer Méditerranée. Mehregan leur a demandé d’imaginer les yeux fermés leur plongée sous l’eau en les guidant en français et en anglais, puis leur a demandé un à un les couleurs qu’ils avaient vu. Mehregan est assise par terre comme les enfants pendant cette activité, mais les enfants sont en ligne devant elle. Elle reprend souvent le pinceau de Victor pour lui montrer sur sa feuille ce qu’elle attend de lui. Son ton est relativement uniforme, presque monocorde : il n’y a pas de variations dans l’intonation. Les enfants se complimentent beaucoup sur leurs réalisations, signifiant qu’ils trouvent la peinture des autres jolies, qu’ils aiment les couleurs, etc. Mehregan s’adresse aux enfants en anglais et en persan pour définir les couleurs de manière assez aléatoire. Il n’y a pas de schéma de changement de langue d’input particulier.
206
Pour finir la séance, Mehregan propose aux enfants de jouer avec les formes de couleur en caoutchouc et en profite pour revoir les couleurs en persan et en anglais. Spontanément Marie a demandé à jeter les formes elle-même, ce que Mehregan lui a accordé. Cette situation est intéressante car l’un des enfants devient animateur le temps de l’activité, mais cela a aussi généré l’inconvénient que Marie était la seule à délivrer tout le vocabulaire, les garçons ne faisaient qu’attraper les formes au vol.
Mercredi 11 mars
Observation participative. Atelier de 17h à 18h.
Participants: Adèle, Rose, Arthaud; Rosemay, Maya et Thomas absents.
Sortie au parc de Procé pour que Mehregan puisse prendre des portraits photographiques des
enfants. Les observations ne se sont pas révélées possibles dans ce cadre.
Lorsqu’un ou deux enfants allaient avec Mehregan pour faire des clichés, les autres essayaient de réaliser le portrait d’un de leurs copains en dessin, sur leur petit cahier.
Vendredi 13 mars
Observation participative. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Marie et Alix ; Agathe absente. Entretien avec Elisa et Xavier l’après-midi.
L’atelier s’est ensuite déroulé autour d’une table où Alix devait raconter une histoire à Marie qui la dessinait au feutre noir sur une feuille A2. Ensuite les deux enfants ont peint le dessin ensemble. Cette activité a duré toute l’heure. Mehregan répétait parfois ce que disait Alix en anglais, mais l’input en langue étrangère a été très faible sur cette séance.
Mardi 17 mars
Une semaine thématique commence sur le thème du nouvel an perse qui a lieu le vendredi 20 mars.
Observation participative. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Marie, Victor et Lucien.
Le 17 mars marque la fête du feu en Iran. Avant la fin du goûter des enfants, Mehregan leur explique qu’il s’agit d’une fête traditionnelle qui sert à « dire au revoir à l’hiver » et à accueillir l’arrivée du printemps. A cette occasion, en Iran, les gens font un grand feu par-dessus lequel ils sautent pour laisser derrière eux les malheurs et s’attirer le bonheur. C’est aussi l’occasion de faire des vœux pour l’année à venir. Sur son portable, Mehregan présente aux enfants une petite vidéo animée en persan qui présente cette fête.
207
Pendant l’heure de l’atelier, les enfants ont pu sauter par-dessus un petit feu préparé avec des brindilles dans la cour de l’association pour célébrer la fête du feu perse. Au saut de chaque enfant, Mehregan annonce à haute voix la phrase qui se dit traditionnellement en persan lors de cette célébration. Elle encourage les enfants à la dire en même temps qu’elle, mais ceux-ci semblent avoir des difficultés à la retenir et à se l’approprier. Les enfants essaient parfois de prononcer quelques bribes ou sons qui tombent sur des points accentués de la phrase mais jusqu’à la fin c’est bien Mehregan qui prononce cette phrase à chaque saut.
Mercredi 18 mars
Observation participative. Atelier de 17h à 18h.
Participants: Adèle, Rose, Arthaud, Rosemay, Thomas, Maya. La veille, Mehregan avait prévu de célébrer la fête du feu à nouveau avec ce groupe, mais elle a préféré finalement préparer un collage avec eux sur le thème de la table du nouvel an perse. Avant l’arrivée des enfants, elle m’explique en quoi consiste la table de nouvel an perse à partir d’un article de Wikipedia en anglais, et me demande confirmation sur certains mots de vocabulaire en français. Mehregan commence par expliquer aux enfants que vendredi 20 mars, jour du printemps, est aussi le jour du nouvel an en Iran, selon le calendrier perse. Elle est alors assise sur la table basse et les enfants sont assis devant elle à l’écouter. Elle explique que sur cette table doivent se trouver plusieurs éléments dont le nom commence par la lettre « sin » en persan. Les éléments les plus courants sont l’ail, les pommes, le miroir, des herbes, des jacinthes, certaines épices et des poissons rouges. Certains éléments sont des symboles de la vie, de la santé, du renouveau, de la force. En nommant ces éléments en français, elle donne également leur nom en persan. Seul Arthaud répète les mots en persan. Elle demande ensuite individuellement à chacun de dessiner et découper dans des feuilles peintes certains de ces éléments :
- Thomas et Maya des poissons - Arthaud et Rosemay des herbes et un pot - Rose une jacinthe avec l’aide Mehregan - Adèle des pommes avec mon aide.
Le temps que les enfants dessinent et découpent leurs éléments, Mehregan prépare ce qui représentera la table à base d’une grande feuille cartonnée et de papier kraft. De temps à autre, elle leur demande comment se disent certains des éléments de cette table du nouvel an en persan, mais les enfants ne s’en rappellent pas. Elle pose donc la question et y répond aussitôt. Au fur et à mesure que les enfants terminent ce qu’ils préparaient, ils vont ensuite dessiner avec des pastels des fleurs sur ce qui sera la table. L’atelier se termine et les enfants regagnent le vestiaire en chantant à la queue-leu-leu derrière Mehregan « Here comes the train ! ».
Vendredi 20 mars
208
Observation participative faible : réalisation d’entretien avec chacun des enfants. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Agathe, Marie et Alix. Lors de la pause goûter Alix m’explique qu’elle est malade. Elle a très mal au ventre. Marie est
également malade. Agathe va bien mais elle est un peu fatiguée car elle a été malade dans la
semaine.
C’est le premier jour où je commence les entretiens avec les enfants pour établir une petite biographie langagière de chacun. Je commence avec Agathe le temps que Mehregan commence l’atelier avec Alix et Marie. Après Agathe, Alix vient avec moi et je termine les entretiens du jour avec Marie. Lorsque je regagne l’atelier, Mehregan, Alix et Agathe terminent avec Marie le collage de la table du nouvel an perse (dont la fête officielle est le jour-même) à partir des éléments que les enfants du groupe du mercredi avaient dessinés et découpés. Tous les enfants réalisent le collage sur une table basse, assis sur des petits tabourets. Mehregan les aide à tout coller.
Mardi 24 mars
Observation participative entre deux entretiens. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Marie, Lucien et Victor. Un peu avant le début de l’atelier je réalise l’entretien de Lucien pour faire sa biographie langagière puis nous rejoignons Marie, Victor et Mehregan vers 17h05 dans l’atelier. Activité 1 : Quiz en dessins Mehregan demande à Lucien un mot en anglais et Marie et Victor ont 10 secondes pour dessiner ce que désigne ce mot. Mehregan est assise en tailleur sur la table basse, Lucien est assis à côté d’elle. Marie et Victor dessinent avec des feutres sur des feuilles blanches vierges ; ils sont assis par terre et dessinent sur le sol. Mehregan effectue le décompte des 10 secondes en persan. Activité 2 : Comptines Mehregan invite les enfants à faire une ronde avec elle et moi au centre de la pièce pour d’abord chanter « 1, 2, 3, 4, 5 once I caught a fish alive » avec les mimes et un petit changement qu’a proposé Marie : au lieu de simplement lever légèrement les bras, paumes vers le haut pour signifier l’interrogation sur les phrases « Why did you let it go ? » et « Which finger did it bite ? », on effectue le même geste en tournant une fois sur nous-même. Mehregan propose ensuite de chanter la comptine perse qui mélange une danse en ronde et quelques mimes. Les enfants semblent se prêter plus volontiers au chant et aux gestes que d’habituel. Victor recherche beaucoup Lucien. Les animaux énoncés dans la comptine sont : le chat, le chien, la vache, le mouton et le coq. Activité 3 : Poursuite de la réalisation en peinture et collage sur le fond de la mer Les enfants récupèrent le fond de peinture qu’ils ont réalisé pour représenter le fond de la mer Méditerranée et découpent d’autres feuilles peintes en formes de poissons, algues, buissons etc. pour compléter leur fond de mer.
209
Tout le monde est assis par terre et réalise ses créations au sol. Mehregan aide les enfants à découper leurs formes et à les coller. De temps à autre, Mehregan donne quelques mots de vocabulaire en anglais et en persan liés aux formes que préparent les enfants : poisson, requin. Un peu avant la fin de l’atelier, Mehregan me propose de faire l’entretien de Victor pour réaliser sa biographie langagière. Une fois l’entretien terminé, nous retrouvons Marie et Victor dans l’atelier pour leur dire au revoir avant qu’ils ne partent avec leurs parents.
Mercredi 25 mars
Observation participative nulle : réalisation d’entretien avec chacun des six enfants. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Maya, Thomas, Arthaud, Rosemay, Adèle et Rose. La réalisation des entretiens s’est effectuée sur l’intégralité de l’heure. Quand les enfants n’étaient pas en entretien individuel avec moi, ils réalisaient leur collage sur le thème de la Mer Méditerranée.
Vendredi 27 mars
Observation participative. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Agathe, Marie et Alix.
Les enfants ont terminé leur collage sur la Mer Méditerranée. Cette activité a pris toute l’heure et Mehregan n’a évoqué que quelques mots ponctuels en anglais et en persan, notamment pour les mots « poisson » et « requin ».
Mardi 31 mars
Observation participative. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Marie, Victor et Lucien.
Activités 1 : Echauffement théâtral Alexis, l’animateur théâtre de l’Atelier du Coteau a fait faire deux petits exercices théâtraux aux enfants pendant la première demi-heure.
- Le premier exercice est le jeu du « Ya » où les enfants et les animateurs (Alexis, Mehregan et moi-même) forment un cercle au milieu de la pièce. Tout le monde est debout. Alexis lance un « Ya » (objet invisible) vers l’un de ses voisins en l’accompagnant d’un mouvement de bras (en faisant comme s’il lançait ce « ya » vers l’autre, le bras allant de haut en bas vers l’autre). Chacun lance tour à tour ce « ya » à son voisin : le « ya » fait donc le tour du cercle. A ce « ya » s’intercalent d’autres mots et mouvements qui changent le sens de circulation du « ya » dans le cercle, ou qui font changer les participants de place, etc.
- Le deuxième exercice est le « Jeu de l’épée ». Tous les participants (enfants, Mehregan et moi-même) font face à Alexis qui tient une épée invisible dans la main. Les participants doivent se déplacer dans l’espace en fonction de là où tombe l’épée dirigée par Alexis.
210
Mehregan propose de le faire en anglais : Alexis accompagne chacun de ses mouvements d’épée par un mot anglais qui décrit l’espace. Right quand l’épée tombe à droite (et les participants doivent aller à gauche), left quand l’épée tombe à gauche (et les participants doivent aller à droite), middle quand l’épée tombe au milieu (et les participants doivent aller sur les côtés), up lorsque l’épée balaye en hauteur et oblige les participants à se baisser, down lorsque l’épée balaye le sol et oblige les participants à sauter.
Les enfants ont semblé beaucoup apprécier ces activités. Ils en redemandaient alors qu’Alexis devait partir. Activité 2 : Poisson d’avril Pendant la deuxième demi-heure, les enfants ont découpé des poissons d’avril dans des feuilles peintes en couleur pour les rapporter ensuite chez eux.
Mercredi 1er avril
Première intervention didactique. Atelier de 17h à 18h.
Participants: Adèle, Arthaud, Rosemay, Maya, Thomas; Rose absente.
Première intervention didactique : l’Espagne. Lulu la Tortue a rapporté aux enfants des souvenirs d’Espagne. Voir le déroulé de l’intervention dans l’annexe relatant le dispositif didactique. Arthaud a trouvé le pays dans lequel était partie Lulu après l’écoute du morceau de musique (Triana, puente y aparte de Miguel Póveda, flamenco contemporain). Choix des « bonjour » :
- Arthaud : « Buenas tardes » - Rosemay : « Buenos días » - Maya, Thomas et Adèle : « Hola »
Les enfants ont semblé apprécier l’activité. La marionnette s’est avérée être un bon capteur d’attention : elle a suscité de la curiosité et de l’intérêt chez les enfants. Ceux-ci ont été calmes et concentrés très vite, et tout au long de l’activité. Arthaud a demandé si Lulu pouvait apporter des photos la prochaine fois, ce que je vais sans doute chercher à intégrer de manière à valoriser cette démarche de demande qui témoigne d’une certaine curiosité. Ils ont semblé accorder de l’importance au mot sur les papiers et étiquettes autocollantes (les « bonjours »). En allant au parc, beaucoup ont fait la réflexion qu’ils avaient oublié leur « bonjour » dans l’atelier et qu’ils ne voulaient pas oublier de le récupérer avant de rentrer chez eux. Certains ont même demandé à avoir les autres « bonjour » pour les garder chez eux ou faire un autre dessin. Certains enfants (Maya notamment) se sont sentis très frustrés d’avoir un temps limité pour dessiner. Maya n’avait pas terminé son dessin avant de partir au parc, et elle nous a fait comprendre qu’elle n’était pas contente de ne pas avoir pu finir son dessin. Le temps que les parents arrivent pour récupérer leurs enfants à la fin de l’atelier, Mehregan a proposé que ceux qui le souhaitent termine leur dessin. Je leur ai donc remis la musique et ils ont pu aller au bout de ce qu’ils voulaient dessiner. Ils semblaient très contents et auraient aimé rapporter leur dessin chez eux. Je leur ai proposé, s’ils le souhaitaient, de faire un autre dessin sur le thème de l’Espagne chez eux et de le rapporter la semaine prochaine.
211
Les dessins présentent dans l’ensemble des couleurs vives et certains enfants ont dessiné des éléments que nous pourrions considérer comme symboliques des représentations que les enfants pouvaient avoir en écoutant la musique : cheval, danseuses en robe de couleur, fleur qui danse, château, castagnettes, etc. Maya et Adèle ont eu des difficultés à ressentir des choses pendant la première écoute et elles se sont senties un peu prises au dépourvu au moment de dessiner. Mehregan s’est plainte que l’activité a duré trop longtemps ; nous avons commencé à 17h05 le temps que tous les enfants soient arrivés et tous étaient prêts à partir au parc à 17h20, soit une intervention de 15 minutes. Nous avons longuement discuté toutes les deux à la fin de l’atelier pour trouver une solution, car il m’est difficile de faire plus court et Mehregan stresse de ne pas réussir à terminer les œuvres qu’elle avait prévues pour l’exposition, bien que mon intervention apporte des productions de la part des enfants. Pour les groupe des mardis et vendredis, nous nous sommes mises d’accord pour commencer l’atelier à 16h50 comme les enfants sont sur place dès leur retour de l’école avec le pedibus. Cela me gêne pour les enfants car mon intervention ampute une partie de leur temps de goûter alors qu’ils rentrent souvent fatigués et énervés de l’école. Cela semble pourtant être le seul compromis possible pour laisser à Mehregan l’intégralité du temps de l’atelier avec les enfants. Reste le groupe du mercredi pour lequel Mehregan a demandé aux parents si leurs enfants pouvaient rester un quart d’heure de plus en fin d’atelier, mais cela n’arrange pas tous les parents qui reviennent donc chercher leurs enfants dès 18h. Il est sûr que la prochaine intervention sera plus rapide pour ce groupe car ils connaitront déjà son organisation, ce qui limitera les temps d’explication des activités. Il nous reste à espérer que cela suffira ! Après concertation, nous nous sommes mises d’accord pour réduire le format de la feuille de dessin des enfants du format A4 au A5 afin que ce soit plus cohérent avec le temps qu’ils ont pour dessiner et aussi pour avoir des dessins au format carte postale à présenter comme un tour du monde lors de l’exposition. Reste de la séance : Les enfants sont allés au parc de Procé pour que Mehregan puisse les photographier. Ceux qui n’étaient pas avec Mehregan à poser pour les photos restaient avec moi et essaient de dessiner une partie du paysage de manière réaliste sur leur cahier.
Vendredi 3 avril
Première intervention didactique avec ce groupe. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Marie seule ; Agathe et Alix absentes. Marie devait exceptionnellement partir à 17h45.
Intervention didactique : L’Inde Marie a rencontré Lulu la Tortue qui lui a rapporté des souvenirs de l’Inde. Voir le déroulé de l’intervention dans l’annexe relatant le dispositif didactique. Le morceau de musique écouté était un extrait de la comédie musicale Bharati. Les « bonjours » étaient :
- नमस्ते
212
- नमस्कार (namaskar) en bengali - வணக்கம் (vaṇakkam) en tamil
Marie a choisi le « bonjour » des Tamouls. Elle a appris que ces « bonjours » étaient accompagnés d’un geste (mains jointes à hauteur de la poitrine, tête inclinée vers le bas). En écoutant la musique la première fois, elle répondait à mes invitations à s’imaginer ce que ce morceau pouvait lui évoquer et elle s’est exprimée à haute voix. Elle n’a pas voulu attendre la fin de l’extrait pour commencer à dessiner. Son dessin représente un arbre au tronc marron et au feuillage vert. Il y a un trou au milieu du tronc. Il y a un personnage de chaque côté de cet arbre : une fille et ce qui semble être un garçon. Les couleurs utilisées sont le vert, le marron et le noir. Marie nous a semblée assez fatiguée et montrait beaucoup de difficultés pour se concentrer. Elle n’a pas vraiment écouté la musique puisqu’elle s’est mise très rapidement à verbaliser ce qu’elle imaginait sans vraiment prêter attention au rythme et à la mélodie de la musique. Le choix des couleurs dénote de ce qu’elle a l’habitude de choisir dans les dessins spontanés que j’ai déjà pu voir, à savoir des couleurs vives comme le rose, le violet, l’orange ou le rouge. Habituellement la première à répéter spontanément des mots ou phrases en langue étrangère, elle n’a répété que le premier bonjour présenté. En revanche, elle a reproduit spontanément la posture de salutation à chaque « bonjour » énoncé. Elle n’a pas trouvé que le pays concerné par l’intervention est l’Inde, elle pensait entendre de l’italien. Même en lui faisant se rappeler que les Italiens disent buongiorno pour se saluer (item qu’elle connait très bien et qu’elle a elle-même énoncé car elle le chante régulièrement dans les ateliers d’Hélène) et non namaste, namaskar ou vaṇakkam, elle continuait à insister sur l’Italie. En lui annonçant qu’il s’agissait en fait de l’Inde, je lui ai montré sur le globe gonflable où se trouvait ce pays et où nous nous situons en France. Elle a aussitôt fait tourner le globe entre mes mains pour me montrer une ile où Hélène a déjà voyagé. Ce type de réaction était assez surprenant de la part de Marie qui est une enfant toujours très investie et ravie de faire absolument toutes les activités qu’on lui propose, en montrant à chaque fois un intérêt certain pour les langues et les cultures étrangères. Je pense que mes attentes envers elle sur ce dispositif n’ont pas été comblées car elle était vraiment agitée et avait plus besoin de se dépenser/défouler que de canaliser son attention sur une activité comme celle-ci. Elle l’a dit elle-même à sa grand-mère en sortant de l’atelier, affirmant qu’elle n’aimait pas qu’on lui fasse faire des choses qui lui demandent de la concentration quand elle a envie de se défouler. Cela confirme le fait que mon dispositif initial comportant une phase introductive d’expression physique était certainement plus adapté au rythme des enfants, phase que j’ai dû abandonner pour répondre aux contraintes de temps qui m’ont été imposées. Je pense également que le fait de s’être retrouvée toute seule dans l’atelier, un vendredi soir après l’école et avant de participer à un concert pour son école ont été des facteurs compromettant la réussite du dispositif. Les conditions n’étaient pas réunies.
Reste de la séance : Mehregan a fait poursuivre Marie sur les dessins des mots commençant par une lettre de l’alphabet précise en anglais pendant 25 minutes, jusqu’à ce que l’atelier se termine.
213
Mardi 7 avril 2015
Première intervention didactique avec ce groupe. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Marie, Lucien et Victor.
Intervention didactique : la Côte d’Ivoire Les enfants ont rencontré Lulu la Tortue qui leur a rapporté des souvenirs de la Côte d’Ivoire. Voir le déroulé de l’intervention dans l’annexe relatant le dispositif didactique. Le morceau de musique écouté était un extrait de l’album Comptines et berceuses du baobab nommé « So diyara ». Les bonjours étaient :
- Fotchangana en sénoufo - Ani woula en dioula - Ani tlé en bambara
Ils ont trouvé que Lulu était partie en Afrique dès la première écoute du morceau de musique. Lucien a privilégié la couleur rouge dans son dessin (qui reste encore à expliciter par l’enfant en termes de symbolique), Marie a étrangement dessiné quelque chose de très similaire au dessin qu’elle avait réalisé la semaine antérieure sur l’Inde : un grand arbre à côté duquel se tiennent deux bonhommes dessinés en bâtons, le tout capitalisant les couleurs marron et vert. Cela pourrait venir du fait qu’il s’agisse de couleurs et de motifs qu’elle aime dessiner en ce moment, ce qui impliquerait alors que la musique n’a pas été un facteur d’évocations particulières pour elle. Cela sera à éclaircir lors des conversations avec les enfants lors de la troisième séance. Victor quant à lui a commencé par dessiner deux arbres, un vert aux branches éparses et un ocre plus robuste qui ressemblerait à un baobab. Comme Victor restait la deuxième heure de l’atelier, celui-ci a pu poursuivre son dessin en ajoutant une cabane dans les arbres et ce qui semble être un troisième arbre. Rapidement, lors de cette deuxième heure, Victor m’a expliqué qu’il allait dessiner la guerre sur son dessin aussi car en Afrique en ce moment c’est la guerre : je comprends là qu’il a pu voir récemment ou entendre parler de l’attaque qui a eu lieu dans une université kenyane il y a quelques jours. Il dessine donc un bonhomme tenant un pistolet, des traits orange symbolisant des éclairs de bombe et un bonhomme en rouge étalé sur le sol. Je réalise que Victor n’est alors plus dans le ressenti et les évocations de la musique mais bien dans la réflexion et le recours à des mécanismes cognitifs pour faire le lien entre l’Afrique et les actualités. Je décide donc d’inviter Victor qui a bien rempli sa feuille à terminer son dessin pour passer à une autre activité. Dans l’ensemble, le dispositif semble avoir bien fonctionné, les enfants demandant à repartir avec les « bonjour » qu’ils ont abordés en début d’atelier. Reste à mieux comprendre les dessins réalisés lors des prochaines interventions après les vacances. Reste de la séance : Les enfants sont allés au parc pour se faire prendre en photo par Mehregan et faire eux-mêmes quelques photos à l’aide d’un appareil photo jetable.
Mercredi 8 avril 2015
214
Deuxième intervention didactique avec ce groupe.
Atelier de 17h à 18h. Participants : Arthaud, Rosemay et Adèle ; absents : Maya, Thomas et Rose.
Intervention didactique : la Chine et l’Inde Afin de respecter les contraintes de temps qui me sont données et qui m’empêchent de proposer une troisième séance plus longue que les deux premières, je décide de modifier le déroulement de la deuxième séance pour que la troisième soit dédiée à la discussion sur les dessins et les musiques avec les enfants. Ainsi, les enfants vont aborder deux pays sur une même intervention. Ils auront face à eux les « bonjour » de chacun des deux pays et devront essayer de les faire correspondre aux deux musiques qu’ils vont écouter. Ainsi, en entrant dans l’atelier, nous prendrons le temps de regarder les « bonjour » sous leur forme écrite avant de faire l’écoute d’un premier morceau auquel les enfants devront associer les « bonjour » qui leur semblent correspondre. Lors de cette même première écoute, les enfants procèderont à la même démarche que lors de l’intervention précédente, à savoir fermer les yeux et s’imaginer les lieux, les habitants, etc. qu’ils dessineront ensuite pendant la deuxième écoute. Nous essaierons de voir s’ils trouvent le pays dès la première écoute et prononcerons les « bonjour » correspondants afin qu’ils puissent tous en choisir un et le coller sur leur dessin. Une fois la démarche réalisée pour le premier pays, il s’agira de prononcer les « bonjour » restants et de répéter l’opération écoute/imagination/dessin avec le deuxième pays. Ce type de séance sera répété avec la deuxième intervention avec le groupe du mardi au retour des vacances. Lors de cette séance (mercredi 8 avril), les enfants s’apprêtent à découvrir la Chine et l’Inde. L’Inde est un choix personnel afin d’apporter de nouveaux dessins sur ce pays car le groupe du vendredi était restreint à une seule enfant le jour de l’intervention sur l’Inde. Cela donnera plus de matière qu’un seul dessin pour l’exposition. Les « bonjour » proposés sont :
- Pour la Chine : 你好 (ni hao) et你们好 (ni men hao)
- Pour l’Inde : नमस्ते (namaste) en hindi नमस्कार (namaskar) en bengali
Le dispositif n’a pas entièrement fonctionné selon mes attentes. Tout d’abord, deux des enfants qui s’étaient vraiment montrés intéressés par la Chine lors des entretiens étaient absents, ce qui, en mon sens, nous a fait passer à côté d’une dynamique de groupe qui aurait favorisé la réussite du dispositif. Lors de l’écoute de l’extrait musical sur la Chine, les enfants ont montré les « bonjour » en hindi et bengali comme correspondants à l’extrait, et inversement lors de l’écoute de l’extrait sur l’Inde (ils ont montré les « bonjour » en chinois). Cela ne correspondait pas du tout à mes attentes. Je leur ai donc demandé s’ils savaient dans quels pays Lulu avait voyagé à partir de l’écoute des deux extraits. Après avoir mentionné plusieurs pays (Espagne, Russie, Japon), je leur ai fait réécouter les extraits (fragments) pour les associer aux « bonjour » au milieu du cercle, puis je leur ai demandé de me montrer sur le globe dans quelle région du monde Lulu avait pu aller.
215
J’ai fini par faire le point en leur expliquant qu’elle était partie en Chine et en Inde, leur montrant l’emplacement de ces pays sur le globe et en précisant à quel extrait correspondait chaque pays. Nous avons donc commencé la session d’écoute/dessin avec la Chine, puis fait celle avec l’Inde. Rosemay m’a tout de suite fait part de ses difficultés à savoir quoi dessiner car elle me disait ne rien connaitre de ces pays. J’ai cherché à la rassurer en lui disant que ce n’était pas grave, que le plus important était qu’elle dessine ce que la musique pouvait lui évoquer. Ses deux dessins sortent assez similaires, tous deux réalisés en pastel bleu clair et représentant une jeune fille au milieu d’éléments de paysage. Pour la Chine, on distingue en plus de la jeune fille un pot d’où sortent des branches et des gouttes de pluie dans l’air. Pour l’Inde, la jeune fille a une fleur dans les cheveux, il y a un soleil et d’autres éléments de paysages indistincts. Adèle s’est très peu exprimée pendant l’atelier, elle disait ne rien connaitre de ces pays et a réalisé ses deux dessins en violet et rose, celui sur la Chine représentant une jeune fille en bâtons auprès d’une maison, et celui sur l’Inde présente une sorte de vase d’où sortent de grandes branches et des gouttes de pluie tout autour. Je l’ai vu à plusieurs reprises regarder ce que faisaient Arthaud et Rosemay pendant le temps du dessin, comme si elle cherchait l’inspiration dans les dessins des autres. Cela reflète beaucoup son attitude générale lors des ateliers : timide, elle semble être dans sa bulle et demande à ce qu’on l’aide à réaliser chacune des créations. Elle répète souvent qu’elle ne sait pas faire toute seule et fait ce qu’elle entend tant que personne ne vient l’aider. Arthaud a réalisé des dessins aux tons chauds (rouge, orange, marron, jaune). Celui sur la Chine représente une maison avec un toit rappelant les toits japonais, et celui sur l’Inde comporte une habitation sur plusieurs étages avec trois toits d’influence japonaise et une personne assise sur un éléphant. Rosemay m’a demandé pourquoi Lulu ne parlait pas aujourd’hui, et semblait déçue de cela. Mon choix de ne pas l’intégrer à cette séance de manière en empiéter le moins possible sur le temps d’atelier de Mehregan s’est fait au détriment des enfants qui ont semblé moins investis émotionnellement. Ils étaient concentrés à trouver les pays où Lulu était partie mais ils semblaient plus être dans une démarche de réflexion : l’absence de Lulu était peut-être l’élément manquant de l’activité pour que les enfants se laissent porter par la dimension affective et émotionnelle de l’activité et des musiques et ainsi moins s’inquiéter de ne pas savoir quoi dessiner. Reste de la séance : Les enfants ont poursuivi ou terminé pour certains leur collage sur la mer Méditerranée.
Vendredi 10 avril
Deuxième et dernière intervention didactique avec ce groupe. Atelier de 17h à 18h.
Participants : Marie et Alix ; absente : Agathe.
Cette séance s’est révélée être très particulière car Mehregan s’étant blessée à la main dans la semaine, elle s’était faite opérer la veille et ne pouvait assurer le pedibus avant l’atelier si elle voulait pouvoir l’animer jusqu’à 18h ensuite. J’ai donc assuré le pedibus en allant chercher les enfants et ai appris par message sur le chemin de l’école à l’Atelier que Mehregan ne viendrait pas du tout et que j’allais devoir assurer l’atelier seule.
216
N’ayant pas eu de temps de préparation, je n’ai pu tirer avantage de cette animation d’atelier seule qu’en ne me limitant pas à 10 minutes d’intervention, mais en prenant le temps nécessaire guidé par les enfants eux-mêmes, en fonction de leurs réactions, de leurs demandes. Le dispositif a donc duré près d’1/2 heure. Intervention didactique : la Chine et le Moyen-Orient J’ai pris la décision d’aborder la Chine avec ce groupe car le groupe précédant ayant fait l’activité sur ce même pays était peu nombreux, ce qui me permet d’augmenter le nombre de productions sur ce thème. Le Moyen-Orient était lié à la volonté d’aborder l’arabe comme langue pouvant bénéficier de l’éveil aux langues pour limiter sa minorisation, mais surtout car c’est une langue qu’Agathe, dans son entretien, a mentionnée comme langue qu’elle souhaiterait apprendre. Malheureusement, Agathe était absente. Les « bonjour » étaient les mêmes que précédemment cités pour la Chine, ceux pour le Moyen
Orient étaient السالم et ً مرحبا. J’ai fait animer la séance par Lulu qui a engendré énormément d’intérêt et de tendresse de la part des enfants. Celles-ci demandaient à lui faire des bisous et des câlins, et elles s’adressaient directement à elle lorsqu'elles avaient des questions. Alix, dont je craignais les envies fréquentes de ne pas participer aux activités, s’est montrée vraiment très investie, prenant des initiatives, tout autant que Marie d’ailleurs. Elles ont fait preuve de beaucoup de concentration et d’application dans ce que j’ai pu leur demander.
Nous avons commencé l’atelier par l’arrivée de Lulu qui a dit bonjour individuellement à Marie et Alix. Le fait que la marionnette s’adresse nominativement à chacune des enfants a suscité leur participation de manière quasi immédiate, puisque les deux ont renvoyé ses « bonjour » à Lulu en français, puis en anglais. Nous avons fait le lien avec l’atelier de la semaine précédente où Marie a pu expliquer à Alix qu’elle avait découvert L’Inde avec Lulu et l’a salué d’un « namaste ». Ensuite, on a regardé les « bonjour » des étiquettes posées au centre du cercle. On a pu remarquer que les mots n’utilisaient pas le même alphabet que celui avec lequel les filles écrivent leur prénom. Alors je leur ai demandé si elles savaient d’où venaient ces « bonjour » : Alix a proposé de chercher sur le globe. Afin de réduire la recherche, je leur fait écouter l’extrait musical pour la Chine. Alix propose l’Espagne, Marie le Japon. J’annonce alors que ce n’est pas le Japon mais bien un pays proche que l’on peut trouver sur le globe. Les filles découvrent alors que Lulu est partie en Chine et finissent d’écouter l’extrait. On y associe aussitôt les « bonjour » : je les prononce, et les filles répètent spontanément. Elles choisissent leur « bonjour » et se préparent pour pouvoir aussitôt poursuivre avec le dessin sur la Chine en écoutant l’extrait une deuxième fois. Je les invite à fermer les yeux pour s’imaginer les paysages, les animaux et les habitants que leur évoque la musique, puis elles réalisent leur dessin. Comme nous avons le temps et qu’elles n’ont pas fini leur dessin, je relance l’extrait une dernière fois. Marie dessine un grand arbre en pastels, avec les couleurs jaune, rose et violet. Au pied de l’arbre de tient ce qui semble être un personnage réalisé dans les mêmes couleurs. Alix dessine une petite fille chinoise avec un vêtement rouge. Je demande à chacune des filles d’expliquer à Lulu ce qu’elles ont dessiné. Alix explique la petite fille et ajoute que la forme à côté représente un arbre à l’envers. Marie précise que le personnage au pied de l’arbre est aussi une petite fille.
217
Alix : « La Chine, c’est très important de l’imaginer parce que sinon, si on n’imagine pas, on connait plus où c’est la Chine ! » On entame ensuite la même séquence sur le deuxième pays en écoutant l’extrait musical correspondant au Moyen-Orient. Avant d’écouter l’extrait, je leur demande si elles savent dans quel pays on peut retrouver les « bonjour » qui restent devant elles. En écoutant l’extrait, les filles devinent petit à petit que l’extrait est lié à l’Afrique, et je précise l’Afrique du Nord que nous cherchons ensuite sur le globe. Nous découvrons ensuite les « bonjour ». J’explique qu’il s’agit de « bonjours » en arabe. Marie réagit aussitôt en me disant qu’un garçon de sa classe sait parler arabe, donc je lui demande si elle a déjà entendu comment on pouvait se saluer dans cette langue. Marie ne sait pas, donc nous enchainons avec la prononciation des « bonjour ». Les filles, après avoir choisi chacune leur « bonjour », saluent Lulu en arabe. Elles commencent à être un peu plus dissipées, elles ont des difficultés à se concentrer, et se mettent à parler de jouets qu’elles ont chez elles. Je comprends que mon dispositif commence à trainer en longueur pour elles. Nous réalisons la deuxième écoute de l’extrait et les filles dessinent. Marie réalise un personnage en rouge et vert avec le visage marron. Elle explique que c’est une petite fille qui rentre dans sa maison. Alix a représenté une petite fille en rose, puis en jaune un soleil, un loup et une voiture, et en marron un arbre. Ensuite, j’installe tous les dessins des filles, y compris celui de Marie sur l’Inde de la semaine précédente, de façon à ce qu’on puisse tous les voir d’un seul coup d’œil. Je demande alors pourquoi nous n’avons pas exactement les mêmes dessins pour chaque pays. Alix : « Parce que ils sont pas pareils, parce que ils sont différents. […] Ils ont pas la même ville, ils ont pas la même couleur de ville et pas les mêmes choses qu’ils fabriquent. » Marie : « Parce que j’avais envie de les faire différents. » Nous terminons en revoyant les « bonjour » une dernière fois et en les associant aux pays dans lesquels Lulu a voyagé. Les filles présentent quelques confusions pour tout retrouver, confusion qui semblent être dûes à la fatigue de la journée car avec un peu de temps elles ont fini par associer chaque « bonjour » aux pays correspondants. Le reste de la séance : Nous avons avancé la réalisation de l’installation comprenant un cadre en bois et des fils de laine, réalisation entamée pendant le stage des vacances de février.
Mardi 28 avril Deuxième intervention didactique avec ce groupe.
Atelier de 17h à 18h. Participants : Marie et Lucien ; Victor absent.
Intervention didactique : la Roumanie et le Japon En apercevant l’organisation de la salle pendant le temps du goûter, Marie s’est exclamée d’un ton joyeux « Tiens ! On va voyager aujourd’hui ! », suggérant que mon dispositif est apprécié. Une fois l’intervention commencée, Lulu a d’abord salué les enfants en reprenant les « bonjour » de la Côte d’Ivoire abordés avant les vacances. Les deux enfants ont renvoyé son « bonjour » à Lulu en
218
répétant les mêmes termes. Cela a permis de se rappeler rapidement ce qui avait été fait avant les vacances et dont les enfants gardaient encore le souvenir de l’Afrique. En regardant les « bonjour » sur le tapis au milieu du cercle, Lucien a rapidement demandé si certains étaient en chinois, et les deux ont su remarquer qu’une des langues utilisait les mêmes lettres qu’en français alors que l’autre présentait des signes inconnus pour eux. Nous avons commencé par écouter l’extrait musical sur la Roumanie. Les enfants n’avaient pas d’idée précise du pays ou bien pensaient qu’il s’agissait de la Chine. Je leur ai donc annoncé le nom du pays où était partie Lulu en leur montrant où cela se trouvait sur le globe par rapport à la France. Nous avons ensuite vu les « bonjour » en roumain, à savoir salut et bună. Le premier les a fait rire en réalisant que c’était très proche du français et que la prononciation était pourtant un peu différente avec le T sonore en fin de mot. Marie a choisi bună et Lucien salut parmi les étiquettes à coller sur leur feuille pour le dessin. Avant de commencer le dessin, Marie a fait la remarque qu’ils n’allaient pas savoir quoi dessiner, ce qui n’a pas semblé poser problème plus longtemps lorsque je leur ai dit que ce n’était pas grave et que le plus important était de dessiner ce que la musique pouvait leur évoquer. Marie a dessiné à nouveau ce qui semble être un arbre au milieu de brins d’herbe. L’arbre est réalisé avec un tronc et des branches en noir et marron et le feuillage se devine par de grands tracés bleus en forme de nuages. Il y a un soleil dans le coin supérieur droit. Lucien a dessiné au feutre vert clair quelque chose de ressemblant à un immeuble, ce que nous éclaircirons lors de la prochaine et dernière séance. Ensuite, nous avons écouté l’extrait sur le Japon, et c’est Marie qui, une fois que Lucien avait exclu la Chine comme réponse possible, a trouvé le pays dans lequel avait voyagé Lulu. Lucien m’a alors demandé si le karaté était japonais, ce que j’ai confirmé et il a alors semblé avoir un déclic, disant : « Ah, d’accord, je connais ». Je leur ai demandé s’ils savaient comment on pouvait se saluer en japonais, ce à quoi Marie a répondu « vanakkam », qui ne correspondait pas à mes attentes mais qui montre cependant que ce mot qu’elle avait choisi avant les vacances lors de la toute première séance sur l’Inde était resté dans sa mémoire. En lui rappelant qu’il s’agissait d’un « bonjour » tamil utilisé notamment en Inde, Marie attrape l’une des deux étiquettes en face d’elle et me signale que c’est le « bonjour » japonais qu’elle a choisi, avant même de l’avoir entendu. Je leur fait donc découvrir ce
bonjour qu’est こんにちは (konnishiwa). En reprenant l’exemple du salut en Inde où la gestuelle et la posture tient une place importante, j’introduis donc ce premier « bonjour » avec la posture de salutation qui l’accompagne au Japon. Lucien se lève pour l’effectuer avec moi et me signale que c’est la même posture utilisée pour saluer son adversaire au karaté. Cela semble être un point d’accroche émotionnelle pour lui car il lie ainsi ce que nous faisons à une activité qu’il pratique et apprécie, ce qui pourrait être un facteur positif dans sa découverte du Japon et du japonais, aussi
succincte soit-elle pendant la séance. Nous abordons ensuite le deuxième « bonjour », おはよう
(ohayo). C’est celui que Lucien choisit de mettre sur sa feuille dessin. Nous écoutons donc l’extrait musical sur le Japon à nouveau et les enfants dessinent. Marie reprend un motif d’arbre très similaire au précédent, avec un tronc marron, un feuillage en nuages rose et un trou dans tronc en noir et gris. Quant au dessin de Lucien, nous ne sommes pas en mesure de reconnaitre ce qu’il a voulu dessiner mais il y a un carré marron surplombé d’un rectangle jaune par-dessus lequel sont dessinés quatre triangles de la même couleur. Nous demanderons des détails la semaine prochaine lors de la discussion. Lulu a terminé la séance en expliquant qu’elle apporterait des photos des pays dont elle a parlé la semaine prochaine et a dit au revoir à chacun des enfants. Dans l’ensemble, Marie et Lucien semblait très contents de l’intervention, arborant un sourire quasi constant et montrant une grande attention au moment de dessiner.
219
Reste de la séance : Mehregan a entamé un nouveau projet plastique autour des jardins de Monet. Après leur avoir montré une photo du peintre et expliqué qui il était, elle leur a montré des photos de son jardin et des toiles que Monet avait réalisées de celui-ci. Ensuite, elle a invité les enfants à se déplacer dans la salle en imaginant qu’ils se baladaient dans les jardins de Monet avant de leur faire commencer un projet de peinture sur une feuille pliée à 90 degrés où la partie supérieure présentera le ciel et la partie inférieure, posée au sol, la terre. Ensuite ils ont joué avec les formes de couleur en caoutchouc pendant les 15 minutes restantes avant la fin de l’atelier. Mehregan a beaucoup utilisé le vocabulaire des couleurs, testant par des questions fréquentes la mémoire que les enfants pouvaient avoir de ces termes en anglais et en persan.
Mercredi 29 avril Troisième et dernière intervention didactique avec ce groupe.
Atelier de 17h à 18h. Participants : Arthaud, Rosemay, Maya, Thomas, Adèle et Rose.
Dernière intervention didactique : discussion Pour cette dernière séance avec le groupe du mercredi, tous sont présents. Rose n’étaient pas là avant les vacances et n’a donc pas fait les séances de découverte en musique et dessin, et seuls trois enfants ont pu faire les dessins sur l’Inde et la Chine la semaine avant les vacances, ce qui représente une certaine difficulté pour pouvoir tous les faire participer alors qu’ils n’ont pas tous réalisé l’intégralité du dispositif. Maya s’exclame très vite qu’elle est déçue de ne pas avoir pu faire les autres dessins (Inde et Chine) et qu’elle aimerait les faire tout de suite, ce que malheureusement je suis obligée de refuser par manque de temps. Cela se révèle donc être un gros point faible de mon dispositif : l’évolution sur plusieurs semaines pour arriver à un tout n’était pas le plus adapté si j’avais su anticiper le fait que les enfants peuvent être absents à certaines séances. Il aurait sans doute été moins frustrant pour chacun de faire des séances où le dispositif comprend trois activités complètes par semaine. J’avais accroché les dessins des enfants sur l’un des murs de l’atelier, disposant les dessins sur l’Espagne les uns en dessous des autres, et ceux sur l’Inde et la Chine respectivement dans une deuxième et troisième colonne, faisant en sorte que si l’on regardait l’ensemble par ligne, chaque ligne reprenait les dessins d’un même enfant. En commençant la séance, les enfants demandent pourquoi il n’y a pas de coussins au centre, je leur explique donc que nous allions regarder les dessins réalisés avant les vacances et des photos que Lulu a rapportées de chacun de ses voyages. Les enfants semblent enjoués. Arthaud s’exclame « Génial ! », Rosemay, « super ! ». Lorsque Lulu arrive, elle salue les enfants en reprenant les « bonjour » des trois pays visités puis je lance la musique sur l’Espagne et demande à Rose si elle a une idée de quel pays vient cette musique. Elle ne sait pas mais les autres enfants s’écrient très vite qu’il s’agit de l’Espagne. Je demande donc à chacun d’entre eux de raconter ce qu’ils avaient voulu dessiner. Mis à part les dessins dont j’avais pu deviner le sens, Thomas m’a expliqué qu’il avait dessiné un sous-marin car il avait l’impression d’en avoir entendu un dans la musique. Seule Adèle ne se rappelle plus de ce
220
qu’elle a dessiné, et, toujours aussi timide, n’intervient pas spontanément et n’exprime que quelques mots lorsque j’essaie de la faire s’exprimer. Une fois tous passés, je leur demande s’ils se rappellent des « bonjour » en espagnol. Ensemble, ils retrouvent les 3 « bonjour ». Je demande à Rose de me dire ce qu’elle aurait dessiné pour l’Espagne : elle nomme un cheval avec une petite fille dessus et la maman qui tire le cheval. Nous remarquons alors que le cheval est un élément récurrent. Je décide alors de leur montrer quelques photos d’Espagne sur ma tablette. J’aborde la couleur blanche des maisons pour les préserver de la chaleur, les palais pour lesquels Arthaud ne manque pas de préciser qu’ils ont été construits par les musulmans, puis sortent des photos avec des chevaux sur lesquels les enfants semblent agréablement surpris de les trouver en commun avec leurs dessins. Afin de parler d’actualité, j’ai aussi présenté quelques photos de la feria de Séville pour pouvoir montrer aux enfants les robes flamenca qu’y portent les femmes, et Maya s’écrie dès la première photo : « Waouw ! C’est trop beau ! Moi aussi j’veux m’habiller comme ça ! ». Rosemay raconte qu’elle a déjà eu une robe similaire blanche. Je me rends compte à ce moment-là que je n’ai plus beaucoup de temps, ce qui m’ennuie fortement pour pouvoir aborder les derniers pays. Je lance la musique de l’Inde et nous revoyons rapidement les salutations, mots et posture. Rosemay explique qu’elle avait dessiné une jeune fille qui dansait, Arthaud un temple bouddhiste avec un éléphant. Adèle ne se rappelle plus de ce qu’elle a dessiné et reste muette, je préfère ne pas insister. Je leur montre donc quelques photos reprenant les saris des femmes, le Taj Mahal (pour lequel Arthaud précise qu’il s’agit d’une tombe et pas d’un palais), les épices et la fête de Holi qui s’était déroulée dans les mêmes temps que le premier de l’an perse que les enfants avaient fêté fin mars. Les photos sont aussi évocatrices d’émotions positives, j’entends des « waouw » devant les couleurs des tissus et des épices, des rires devant la célébration d’Holi et les gens tâchés de toutes les couleurs. Maya me redemande pour pouvoir faire un dessin sur l’Inde à ce moment-là, son frère aussi. Je suis presque arrivée au bout des 15 minutes qui m’étaient laissées et je dois donc poursuivre malgré tout, ce qui est très frustrant, tant pour moi que pour les enfants. Je lance donc la musique sur la Chine et nous revoyons également les salutations. Prise par le temps, je privilégie le visionnage des photos au retour sur les dessins, ce qui est préjudiciable pour les enfants ayant fait des dessins sur ce pays mais ce qui dans le fond était aussi une bonne décision pour que tous les enfants se sentent investis car le visionnage des photos était nouveau pour tous. Nous voyons alors la muraille de Chine, les rizières et les chapeaux traditionnels qu’ils définissent vite comme « chapeaux chinois » et quelques images de l’architecture urbaine parmi lesquelles Arthaud reconnait très vite la Cité Interdite. Je finis alors par leur demander : « Pourquoi on n’a pas toujours dessiné la même chose en fonction des pays ? ». Arthaud monopolise vite la parole : « Parce que c’est pas les mêmes pays. Parce que c’est pas les mêmes cultures. ». Les autres enfants restent muets. J’essaie donc de les solliciter en leur demandant s’ils avaient imaginé des éléments similaires à ce qu’ils ont vu sur les photos quand nous écoutions les musiques, ce à quoi ils ont tous répondu « non ». Je demande alors « Pourquoi c’est important de se les imaginer ces pays ? ». Arthaud répond « Bah, parce qu’on travaille dessus ! ». Surprise par sa réponse spontanée, je m’avoue un peu déçue car je ne pensais pas que mon dispositif avait pu donner la sensation de travailler, mais je comprends aussi qu’Arthaud est un enfant avec des connaissances très entendues dans de nombreux domaines et qui aime apprendre, qui aime l’école. Les autres enfants sont restés sans me donner d’autre réponse. J’enchaine donc en expliquant que leurs dessins seront exposés avec les autres créations réalisées
221
avec Mehregan dès le 30 mai, et qu’ils pourront partager cela avec leurs parents. Maya et Thomas me répondent qu’ils en ont déjà parlé aux leurs. Le reste de la séance : Mehregan a commencé avec eux l’activité sur Monet et ils ont tous préparé leur fond de peinture entre ciel et terre.
Mardi 5 mai Troisième et dernière intervention didactique avec ce groupe.
Atelier de 17h à 18h. Participants : Marie, Lucien et Victor.
Dernière intervention didactique : discussion Pour cette dernière intervention, je me retrouve avec les mêmes difficultés que pour le groupe précédent : un enfant était absent (Victor) lors de la deuxième séance, il n’a donc effectué qu’un dessin alors que les autres en ont réalisé trois. Cependant, Victor n’a pas exprimé de regret de ne pas avoir pu faire les autres dessins (contrairement à certains enfants du groupe de mercredi). La deuxième difficulté était de proposer cette séance de discussion comme bilan des deux séances précédentes, ce qui n’était pas adapté car tous les enfants n’ont pas pu être présents à chaque fois, et parce qu’avec le temps entre la réalisation des dessins et la discussion, les enfants sont moins dans une réaction émotionnelle à chaud sur ce qu’ils ont dessiné que sur un retour distancié plutôt réflexif. Cela peut avoir ses avantages, mais cela a parfois donné lieu à des explications de dessin différentes lors de cette séance que lorsque les enfants venaient de les terminer dans les séances précédentes. Après avoir installé les dessins au mur, je demande d’abord aux enfants s’ils reconnaissent quels sont leurs dessins respectifs. Après me l’avoir confirmé, je lance la musique sur la Côte d’Ivoire et demande aux enfants s’ils se rappellent où était le premier voyage : tous les trois sont capables de me nommer spontanément l’Afrique. Victor est le premier à m’expliquer son dessin : il dit avoir imaginé une cabane dans les arbres, un serpent. Marie affirme avoir voulu dessiné un arbre en montrant le dessin qu’elle avait réalisé sur le Japon. Je lui explique donc qu’il ne s’agit pas du dessin qu’elle avait fait pour l’Afrique et lui demande pourquoi elle m’a montré un autre dessin : en lui montrant les dessins qu’elle avait réalisé sur la Chine et l’Inde dans un autre groupe, elle réalise que c’est parce qu’elle a fait des arbres pour chaque pays. Lucien explique à son tour qu’il a voulu présenter un volcan, expliquant les dessins au pastel rouge que je n’avais pas su déchiffrer avant les vacances. Nous regardons ensuite quelques photos de la Côte d’Ivoire : nous abordons les femmes qui portent les charges sur leur tête, l’architecture particulière des églises, les cases, les instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest (djembé, balafon, …), les éléphants et le cacao. Les enfants semblent curieux, leurs réactions installent un échange : Lucien pense que les charges de bois doivent être lourdes à porter sur la tête, et lorsque je préviens qu’ils vont peut-être être surpris en découvrant une église ivoirienne, Victor dit qu’il comprend. Pour les instruments, Victor dit que la photo est comme une chanson, Marie note que les musiciens se déplacent tout en jouant, et Lucien nomme spontanément le tambour. Enfin, ils semblent admiratifs devant les éléphants auxquels ils n’avaient pas pensé et franchement surpris en découvrant les fèves de cacao à l’origine de leur chocolat matinal. Aucune réaction négative n’a été notée pendant l’activité.
222
Je demande à Marie et Lucien d’expliquer à Victor dans quels pays les a emmené Lulu la semaine précédente. Lucien dit la Chine et Marie corrige en disant le Japon. Je lance la musique correspondante en fond. Lucien ne se rappelle plus ce qu’il a voulu dessiner, et Marie explique qu’elle avait aussi dessiné un arbre, ce qui me permet de faire une transition vers les cerisiers qui apparaissent sur les photos que je m’apprête à leur montrer. Marie et Lucien affirment qu’ils ont des cerisiers chez eux ou chez des membres de leur famille, et Victor remarque sur la première photo que l’édifice ressemble à la maison des Ninjago, série animée créée par la maison LEGO où l’intrigue reprend des mythes chinois et japonais. Je réalise à ce moment-là que les enfants sont en train d’associer ce qu’ils voient à des éléments familiers pour eux, ce qui semble faciliter la rencontre visuelle avec ce pays. Nous abordons les cerisiers, les temples, les tenues traditionnelles des femmes en kimono 5dont la mention rappelle à Lucien les kimonos utilisés dans les arts martiaux), les sushis pour lesquels Victor se rappelle d’en avoir mangé et Marie aussi « dans un restaurant chinois à Paris ». Je leur demande si on mange les sushis avec une fourchette, et tous les trois m’affirment vivement que non, ça se mange avec des baguettes ! Enfin, je leur montre la photo de deux personnes qui se saluent dans la posture que nous avons expliquée la semaine précédente. Je demande alors si les enfants savent ce qu’ils sont en train de faire, ce à quoi Lucien répond aussitôt : « se saluer !». Je demande alors s’ils se rappellent quels « bonjour » nous avions découvert : Lucien dit ne pas s’en rappeler mais Marie prononce le mot de konnishiwa tout de suite, ce qui me montre qu’il y a eu un certain degré d’acquisition dans mon dispositif ou en tout cas de renforcement d’acquisition si Marie avait déjà eu l’occasion d’entendre ce mot auparavant par ces parents qui parlent un japonais. Nous terminons par le dernier pays dont Marie et Lucien ne se rappellent pas spontanément. Je lance la musique correspondante et profite de la situation pour demander à Victor s’il a une idée du pays d’où vient la chanson : il ne sait pas. Je commence alors à prononcer la première syllabe du nom du pays et Lucien termine pour moi mon « Rou » en « Roumanie ! ». Je demande alors s’ils se rappellent des « bonjour » en roumain, en commençant par salut que Lucien avait choisi. Lucien et Marie ne se rappelaient pas des termes, Lucien me proposant salam au moment de commencer à prononcer sa_lut. Je précise alors que salam est un bonjour en arabe, me rappelant que nous en avions parlé avec Lucien lors de notre entretien pour établir sa biographie langagière. Je recentre aussitôt l’attention sur le roumain en redonnant les deux « bonjour » abordés la semaine précédente. Tous répètent spontanément les deux mots. Victor me dit qu’il n’aime pas trop la chanson, la trouvant « un peu triste ». Je propose donc de regarder quelques photos afin de découvrir la Roumanie autrement que par la chanson. Nous abordons les couleurs des tenues folkloriques, les châteaux de Transylvanie pour lesquels j’ai fait référence à la légende de Dracula que les enfants ne connaissaient pas. La référence était sans doute un peu trop osée étant donné l’âge des enfants, mais cela pourra fournir une référence plus tard lorsqu’ils en entendront parler à nouveau. On voit également les déplacements en charrettes tirées à cheval et les couleurs variées des maisons en ville. Lulu vient alors saluer les enfants en reprenant les « bonjour » vus au fil des trois pays et demandent aux enfants « Pourquoi on a cherché à imaginer ces pays ? ». Victor : « Parce qu’on voulait voir les pays ». Lulu demande alors si l’imagination les a aidés à voir les pays : Victor : « Moi ça m’a aidé beaucoup ». Je fais alors remarquer que parfois le changement de pays les a fait faire des dessins différents ou, dans le cas de Marie, des dessins similaires, Marie me confirmant qu’elle avait envie de dessiner des arbres. Je valorise donc les deux démarches en affirmant que tout était possible, et que Lulu était
223
contente de faire ce tour du monde avec eux. Terminant l’intervention, j’invite les enfants à retrouver Mehregan pour la suite de l’atelier, ce qu’ils mettent du temps à faire, m’exprimant que maintenant ils avaient envie de faire d’autres voyages. Cela a clos l’intervention et mon dispositif de manière très positive en un signe d’ouverture ou tout du moins d’intérêt et de curiosité pour les voyages à l’étranger à la découverte d’autres langues et cultures. Le reste de la séance : Les enfants ont poursuivi leur projet de création autour des jardins de Monet.
224
Annexe 7 : Grilles d’observation abandonnées
Grille d’observation 1 Date : mardi 3 mars 2015 Heure : 17h-18h Participants : Marie, Lucien et Victor Heure réelle de début d’atelier : 16h57 Activités réalisées / différents temps de l’atelier :
Intitulé de l’activité
Type* Langue(s) utilisée(s)
Durée Supports Notes libres
1. Comptine « Good morning » chantée, mimée et dansée en ronde + Ecoute d’une comptine similaire iranienne
L
Français pour mener l’activité ; Anglais pour la comptine chantée ; Persan par Mehregan pour chanter aux enfants une comptine similaire iranienne
Environ 7 min.
Fichier audio sur l’ordinateur de Mehregan. Comptine iranienne chantée a cappella.
Enfants très agités, excités au début de l’atelier. Mehregan réclame moins de bruit et plus de calme. Mehregan rejoint les enfants au moment de faire la ronde sur « Good morning ». Reste de l’activité dans le coin droit de la pièce**.
2. Comptine « 1, 2, 3, 4, 5, once I caught a fish alive » chantée et mimée. Chantée par-dessus l’enregistrement en groupe ; chantée a cappella individuellement avec Mehregan en ajoutant les mimes ; chantée a cappella et mimée en groupe.
L(l) Français pour mener l’activité; Anglais pour la comptine chantée.
Environ 4 min.
Vidéo-clip de Youtube diffusé sur l’ordinateur de Mehregan.
Enfants plus calmes que lors de l’activité précédente. Début de l’activité dans le coin droit de la pièce** puis tous se mettent debout au milieu de la pièce pour chanter la comptine a cappella et la mimer en groupe.
3. Suite de la réalisation des maisons en boîtes de carton.
Aap Français principalement ; Anglais par des phrases et mots ponctuels ;
Environ 20 min.
Boîtes en carton, papier kraft, pastels.
Enfants concentrés, calmes, assis par terre au milieu de la pièce. Mehregan est assise avec eux.
225
Persan par des mots ponctuels (couleurs)
Fond musical de comptines en anglais diffusé par l’ordinateur de Mehregan (CD audio).
4. Suite de la réalisation des peintures sur le thème du coucher de soleil sur la route de Paris : les enfants doivent dessiner les formes qui se détachent du paysage sur un fond peint, les découper et les coller sur un autre fond de peinture représentant le ciel de fin de journée.
Aap Français principalement ; Anglais par mots et phrases ponctuels.
Environ 30 min.
Ciseaux, crayons à papier, colle, crayons de couleur, feutres.
Seuls Lucien et Victor font cette activité. Marie continue de décorer sa maison en boîte de carton car elle a déjà terminé sa peinture lors d’un atelier précédent. Une fois sa maison terminée elle prend un cahier et dessine librement dessus aux crayons de couleur. Victor termine avant Lucien et dessine librement sur une feuille vierge pendant les 5 minutes restantes de l’atelier. Les enfants sont calmes, concentrés. Ils sont assis au milieu de la pièce et Mehregan aussi.
*Type : A – artistique (Aap – arts plastiques/Am – musique/At – théâtre/ Ad – danse) L(l)/L(c) – liée aux langues et/ou aux cultures M – mixte entre les 2 types précédents **Coin droit de la pièce : occupation de l’espace récurrent lors des ateliers – les enfants sont assis par terre en arc-de-cercle devant la table basse où est posé l’ordinateur de Mehregan ; Mehregan est assise sur un tabouret à côté de la table basse, face aux enfants. Utilisation des langues par les acteurs/Intéractions dans les différentes langues de l’atelier Partie de la grille qui pose problème :
- Les chiffres correspondent au nombre d’occurrence de chaque type d’intervention, le plus souvent correspondant à un nombre de phrases : peu de fiabilité dans les résultats recueillis. Faudrait-il consigner les occurrences et/ou le temps d’utilisation de chacune des langues ?
- Tout n’a pas été consigné en ce qui concerne les interactions en français car elles étaient trop nombreuses pour être toutes prises en compte : il me faut trouver un autre système de recueil de données.
- De la même manière, le recueil de données sur chacun des trois paradigmes d’interaction (de Mehregan aux enfants, des enfants à Mehregan et les enfants entre eux) est difficile à réaliser dans son ensemble. L’enregistrement audio des ateliers peut aider à compléter les données, mais un autre type de recueil de ces données serait peut-être plus approprié.
De Mehregan aux enfants
Narration d’une histoire
Enonce une consigne
Pose une question (à un enfant ciblé/au groupe)
Corrige (enfant/groupe ; prononciation/lexique/grammaire/…)
Traduit Autres
226
En français 9 6 5 0 9 Rappelle à l’ordre (3) ; Répond à une question d’un enfant (3)
En anglais 9 9 11 0 9 Chante (6) ; Répond à une question d’un enfant (1) ; Donne du vocabulaire (11) ; Encourage (2)
En persan 0 Chante (1) ; Donne du vocabulaire (8)
Des enfants à Mehregan
Interventions spontanées
Réponse à une question posée au groupe
Réponse à une question posée à l’enfant
Autocorrection Autres
En français 4 2
En anglais 4 Répétition (4) ; Chant
En persan Répétition (12)
Les enfants entre eux
Questions Réponses Corrections Traduction Autres
En français
En anglais
En persan
Pas suffisamment de temps pour
remplir cette partie de la grille
227
Grille d’observation 2 Date : mercredi 4 mars 2015 Heure : 17h-18h Participants : Arthaud, Rosemay, Maya, Adèle et Sacha (nouvelle) ; Thomas et Rose absents. Heure réelle de début d’atelier : 17h02
Activités réalisées / différents temps de l’atelier :
Intitulé et déroulement de l’activité
Type*
Langue(s) utilisée(s)
Durée Supports Occupation de l’espace
Ambiance générale, attitude des enfants.
Notes libres
1. Comptine « Good morning » mimée et dansée + Comptine iranienne chantée a cappella par Mehregan
L Français pour mener l’activité ; Anglais pour chanter la comptine ; Persan par Mehregan pour chanter la comptine iranienne similaire à « Good morning »
Environ 7 mn.
Ordinateur de Mehregan : fichier audio
Les enfants miment leur réveil le matin au milieu de la pièce. Mehregan est d’abord assise sur un tabouret à côté de l’ordinateur, puis rejoint les enfants au moment de faire la ronde sur « Good morning ». Pour la comptine iranienne, tous les acteurs occupent le carré droit de la pièce**.
Les enfants sont très agités au début de l’atelier : ils courent et sautent un peu partout dans la salle, ils crient.
2. Entame du projet de peinture sur la Mer Méditerranée. Mehregan les fait s’imaginer plonger au fond de la mer pour y observer les
Aap
Français principalement pour mener l’activité ; Passages ponctuels en anglais ; Mots ponctuels en persan.
Environ 42 mn.
Feuilles vierges format A2, peinture, pinceaux, palettes.
Les enfants sont assis par terre au milieu de la pièce pour réaliser leurs œuvres.
Les enfants sont moins dissipés, ils montrent beaucoup de concentration dans la réalisation de leur œuvre.
Avant de faire comme le reste du groupe, Arthaud termine ses découpages et collages sur la création autour du thème du coucher
228
couleurs qu’ils vont peindre ensuite sur une feuille vierge. 2bis. Le temps que tout le monde termine, les enfants ayant achevé leur fond de peinture le plus vite se regroupent avec Mehregan pour dessiner des formes aux feutres à tour de rôle sur une même feuille de papier. Une fois cette œuvre terminée, Mehregan note le nom des enfants en persan à l’arrière de la feuille : les enfants font des commentaires et la questionnent sur l’écriture.
M
Français ponctuellement ; Anglais par phrases ou mots récurrents. Persan par phrases ou mots récurrents et découverte visuelle de l’écriture.
Mehregan est assise par terre avec eux et réalise elle aussi une œuvre.
de soleil sur la route de Paris. A la fin de ces deux activités, Mehregan propose de ranger la pièce et se met à chanter la comptine « Clean up ! Clean up ! Everybody, everywhere. Clean up ! Clean up ! Everybody do your share.» tout en rangeant. Arthaud et Rosemay entonnent rapidement cette comptine avec elle.
3. Comptine iranienne sur les animaux chantée en groupe a cappella avec danse en ronde et imitation du cri des animaux. Mehregan demande d’abord aux enfants de répéter chaque phrase après elle, puis tous chantent en même temps.
L Français pour mener l’activité ; Persan pour la comptine.
Environ 10 mn.
Aucun. Tout le monde est debout en ronde au milieu de la pièce.
Après le calme et la concentration dont les enfants ont fait preuve pendant l’activité précédente, cette danse sur la comptine semble leur redonner beaucoup d’énergie : ils rigolent, cherchent à tourner vite.
*Type : A – artistique (Aap – arts plastiques/Am – musique/At – théâtre/ Ad – danse) L(l)/L(c) – liée aux langues et/ou aux cultures M – mixte entre les 2 types précédents
229
**Coin droit de la pièce : occupation de l’espace récurrent lors des ateliers – les enfants sont assis par terre en arc-de-cercle devant la table basse où est posé l’ordinateur de Mehregan ; Mehregan est assise sur un tabouret à côté de la table basse, face aux enfants. Utilisation des langues par les acteurs/Intéractions dans les différentes langues de l’atelier
- Temps d’utilisation de chaque langue : Français : Anglais : Persan : Autres :
- L’utilisation des différentes langues par Mehregan avec les enfants :
Phrases ponctuelles
Mots ponctuels
Questions (appelant une réponse en/sur la L.E.)
Demande de répétition d’une phrase ou d’un mot en L.E.
Chant (nombre d’occurrences de comptines chantées)
Consigne Correction Encourage-ments, feedback sur l’activité des enfants
Apports sur C.E. et Autres
En français
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Au groupe : 2 A un enfant ciblé : - - - - - -
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
xxxxxxxxxxxxxx Au groupe : 6 11 A un enfant ciblé : -Arthaud : 1 -Rosemay : -Adèle : 1 - - -
xxxxxxxxxxxxxxx
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
Apports sur C.E. : « Ding dong » représente le bruit de l’horloge en persan Autres : Rappels à l’ordre 8 11
En anglais
Seules : 3 Avec traduction successive en français : 11
Seuls : 6 Avec traduction successive en français : 1
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - -
Mehregan seule : Mehregan avec le groupe : 2 Mehregan avec un enfant :
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - -
Prononciation : Lexique : Syntaxe :
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
Apports sur C.E. : Autres : Lorsque Mehregan chante avec le groupe,
230
- - - - - - -
- tous les enfants ne chantent pas.
En persan
Seules : 1 Avec traduction successive en français :
Seuls : 2 Avec traduction successive en français : 1
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
Mehregan seule : 1 Mehregan avec le groupe : Mehregan avec un enfant : - - - - - -
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
Prononciation : Lexique : Syntaxe :
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
Apports sur C.E. : Autres :
Autres langues
Seules : Avec traduction successive en français :
Seuls : Avec traduction successive en français :
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
Mehregan seule : Mehregan avec le groupe : Mehregan avec un enfant :
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - -
Prononciation : Lexique : Syntaxe :
Au groupe : A un enfant ciblé : - - - - - -
Apports sur C.E. : Autres :
- Recours aux langues par les enfants
Des enfants à Mehregan
Réponse à une question posée en une L.E.
Réponse en à une question posée en français sur une L.E.
Répétition après sollicitation de Mehregan
Répétition spontanée
Demande de traduction en français
Demande de vocabulaire en L.E. ou question sur L.C.E.
Interventions spontanées
Autres
En français - - -
- - -
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - - -
- - -
Pas d’autre langue abordée dans l’atelier
231
- - -
- - -
- - -
- - -
En anglais - - - - - -
- - - - - -
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
En persan - - - - - -
- - - - - -
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Autres xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
- Recours aux langues dans les interactions entre les enfants :
Les enfants entre eux
Quels types d’intéraction entre les enfants ?
En français
En anglais
En persan
Pas suffisamment de temps pour remplir cette partie de la grille
232
Grille d’observation 3 (non utilisée)
Date : Heure : Participants :
Heure réelle de début d’atelier :
Activité (grandes lignes du déroulement) + codes artistiques (AP= arts plastiques ; C=chant ; D=danse ; M=musique ; ES= expression scénique)
Elements linguistiques et/ou culturels abordés (vocabulaire, thème, etc.)
Durée Activité impulsée par (imp) … Et animée par (anim) …
Ambiance, atmosphère : ton de Mehregan, impulsions d’émotions aux enfants, …
Encourage-ments et appréciations positives de Mehregan aux enfants
Occupation de l’espace, place du corps dans l’activité
Sollicitation de la créativité chez les enfants (choix, sollicitation de l’imagination, etc.)
Attitudes des enfants
*Code pour langues et cultures: Ang : anglais; Per : persan ; Autres : Esp, All, Ara… **Coin droit de la pièce : occupation de l’espace récurrent lors des ateliers – les enfants sont assis par terre en arc-de-cercle devant la table basse où est posé l’ordinateur de Mehregan ; Mehregan est assise sur un tabouret à côté de la table basse, face aux enfants.
233
Annexe 8 : Grilles d’entretiens Entretien avec Elisa et Xavier, directrice et trésorier de l’association l’Atelier du Coteau
Parcours o Quels ont été vos parcours avant l’Atelier du Coteau ?
o Parlez-vous des langues étrangères ? Lesquelles ? o Où les avez-vous apprises ? o Etes-vous déjà allés à l’étranger ? dans quels pays ?
L’Atelier du Coteau comme association
o Qu’est-ce qui vous a poussé à créer l’Atelier du Coteau ? (causes en amont)
o Comment imaginiez-vous ce projet au départ ?
o Quels sont les buts de l’association ? o Quelles sont ses valeurs ?
o Etes-vous les seuls membres du bureau ? o Combien comptez-vous de membres dans l’association ?
o Quelles sont les sources de financement de l’association ?
Les ateliers artistiques multilingues (A.A.M.): motivations et précisions
o Comment sont nés les A.A.M. à l’Atelier du Coteau ? (besoins ? envies personnelles ? rencontres décisives ?)
o Il y a un A.A.M. musique et un A.A.M. multi-activités. Qu’est-ce que le multi-activités
recouvre ? o Pourquoi proposer un atelier multi-activités plutôt qu’un atelier arts plastiques ou théâtre
multilingue par exemple ?
o Quand les ateliers se définissent comme multilingues, de combien de langues parle-t-on ? o Quelles sont-elles ?
o Pourquoi avoir souhaité ajouter une dimension multilingue à ces ateliers artistiques ? o Comment cela s’intègre dans les buts et valeurs de l’association de l’Atelier du Coteau ?
Profils des animateurs des A.A.M. et instances de travail/réflexion
o Quelles sont les formations et/ou les expériences demandées pour animer les A.A.M. ?
o Y a-t-il une relation particulière entre arts, langues et cultures autour de laquelle vous avez souhaité concevoir les A.A.M. ?
o Des objectifs ou des lignes de travail sont-ils décidés collectivement pour ces ateliers ? o Si oui, quels sont-ils ? o Cela donne-t-il lieu à des bilans (ponctuels ou réguliers) en équipe ?
Bilan et perspectives
o Quel bilan faites-vous à l’heure actuelle des A.A.M. ?
o Quels retours avez-vous des enfants qui y participent ? o Quels retours avez-vous des parents ?
o A l’heure actuelle, quelle est la place des A.A.M. dans l’équilibre financier de l’association ?
o Comment envisagez-vous l’évolution de ces ateliers l’année prochaine ? Et dans trois ans ?
Santé financière de l’Atelier
o Quel est le salaire moyen des intervenants ? o Quelle est l’état de santé financier de l’association ?
234
Entretien avec Mehregan, artiste-animatrice des ateliers multiactivités plurilingues
Formation o Quel a été ton parcours avant d’arriver à l’Atelier du Coteau ? (arts + langues et cultures)
Travail à l’Atelier du Coteau
o Depuis quand travailles-tu à l’Atelier du Coteau ? o Depuis quand t’occupes-tu des A.A.M. multiactivité ?
o Comment résumerais-tu ton travail dans les A.A.M. ?
o As-tu reçu une formation spécifique pour animer ces ateliers ? (formation, observation,
briefing, …)
o Prépares-tu tes A.A.M. seule ou bien travailles-tu en collaboration avec Hélène qui anime les A.A.M. musique ?
o As-tu des réunions avec Elisa et Xavier (la direction) et/ou les autres animateurs de l’Atelier du Coteau pour faire le point sur votre travail ?
Les A.A.M. : pédagogie, objectifs, contenus, supports, évaluation, …
o Tu distingues l’éveil de l’apprentissage : quelles sont les différences entre ces deux notions pour toi ?
o Quels sont tes objectifs avec les enfants qui suivent tes A.A.M. ? (objectifs artistiques + objectifs langues et cultures)
o Comment prépares-tu tes ateliers ?
o Comment associes-tu arts, langues et cultures ?
o Comment sais-tu que tu as atteint tes objectifs avec les enfants ?
o Qu’est-ce qui selon toi fait la particularité de tes ateliers ? (par rapport à l’autre A.A.M., à ce
que font les enfants à l’école, …)
Ressentis sur expérience
o Quels retours as-tu de la part des enfants qui participent à ton atelier ? o Quels retours as-tu de leurs parents ?
o Qu’est-ce que tu aimes dans ton travail ? o Qu’est-ce que tu aimes moins ? o A quelles difficultés es-tu parfois confrontée ?
Biographie langagière
o Quelles langues parles-tu ? o Y a-t-il des langues que tu ne parles pas mais que tu comprends ? o Quelles langues apprends-tu ? o Pourquoi ? o Où et comment as-tu appris / apprends-tu ces langues ? o Comment as-tu vécu/vis-tu ces apprentissages ? o Quelles langues aimerais-tu apprendre ?
o Tu viens d’Iran et tu travailles aujourd’hui en France. Dans quels autres pays as-tu eu
l’occasion de voyager ou séjourner ? o Qu’est-ce que t’ont apporté chacun de ces voyages ? o Etaient-ce des expériences heureuses ? difficiles ?
o Quelles langues utilises-tu avec les enfants dans les A.A.M. ? o Pourquoi ces langues ? Pourquoi pas d’autres ?
235
Guide d’entretien avec les enfants : questions à aborder pour la réalisation de leur
biographie langagière
o Quelles langues parles-tu ?
o Quelle est ta langue maternelle ?
o Est-ce que tu apprends des langues à l’école ? Lesquelles ?
o Quelles langues découvres-tu à l’Atelier du Coteau ?
o Est-ce que tu découvres ou apprends des langues ailleurs qu’à l’école ou à l’Atelier du Coteau ?
o Quelles langues as-tu déjà entendues (même sans forcément les comprendre) ?
o Quelles langues as-tu déjà vu écrites ?
o Ton papa et ta maman parlent-ils d’autres langues que le français ? Et d’autres
membres de ta famille ?
o Et tes amis ? Certains parlent-ils d’autres langues que le français ?
o Quelles langues aimerais-tu apprendre ?
o Es-tu déjà allé(e) en voyage, en vacances ailleurs qu’en France ? Où ?
o Quels pays aimerais-tu visiter ?
236
Annexe 8.1 : Entretien d’Elisa Commeyne et Xavier Fauvelle, directrice
et trésorier-secrétaire de l’Atelier du Coteau Elisa arrive la première à 14h30, l’heure convenue pour l’entretien. Nous installons deux fauteuils et
une chaise autour de la petite table dans le vestiaire contigu à la salle d’atelier. Elisa s’assoie en face
de moi en diagonal de la table, et le fauteuil de Xavier est placé à ma gauche, aligné avec celui où se
trouve Elisa. Celle-ci en profite pour me demander comment se passe le stage en attendant l’arrivée de
Xavier, conversation à partir de laquelle commence l’enregistrement et que nous retranscrivons en
partie ici car elle livre des éléments importants à la compréhension de la suite de l’entretien et, plus
largement, à la compréhension du fonctionnement de l’Atelier du Coteau. L’entretien commence après
l’arrivée de Xavier à 14h45.
Conversation pré-entretien :
Elisa : Pour le projet d’exposition, en effet j’me suis dit que… vraiment dans l’idée que ce
soit relié, que tu puisses le vivre aussi euh… pendant ton stage en fait, cette évolution là
jusqu’à l’exposition, j’crois que c’est important parce que ça relie vraiment en fait aussi c’qui
s’fait dans l’atelier de Mehregan mais aussi c’qui s’passe ici…
Moi : Voilà, c’est pour ça que j’voulais vous voir, pour avoir la vision d’ensemble, enfin
pouvoir faire le zoom en fait entre la vue d’ensemble et ce qui se passe dans les ateliers, …
Elisa : Voilà c’est ça.
Moi : … aller et venir à chaque fois…
Elisa :
Et tu vas t’rendre compte que, de toute façon, euh… nous on est constamment dans cette
réflexion là et on essaie à chaque fois se dire que… que tout soit cohérent dans tout c’qui
s’passe, le plus possible en tout cas. Et euh… et de relier un projet en effet d’enfants amateurs
etc. au projet professionnel de Mehregan aussi qui est artiste et… voilà, et nous de toujours
créer ce lien, ces ponts, c’est euh… c’est essentiel en fait. Pour que même les enfants eux-
mêmes puissent se euh… en fait déjà projeter le côté aussi professionnel finalement, même
petit qu’il soit, euh… sans leur dire bah voilà c’est ça etc. qui s’passe mais qu’ils puissent le
vivre… et d’se dire bah oui c’est possible, ça peut être un métier, c’est aussi… Que ça peut
être qu’un outil d’expression mais qu’ça peut aussi susciter peut-être des futurs euh…
peintres, des futurs euh… musiciens euh… etc. etc.
Moi : Tout à fait.
Elisa : Et euh… J’pense que c’est euh… Plus l’temps passe, plus j’me dis c’est passionnant
c’qu’on fait ! (Rires)
Moi : C’est vrai ! Ce sont des grands challenges.
Elisa : Ce sont des grands… ah ouais, complètement.
Moi : C’est vraiment des grands challenges… Et c’est chouette de voir comment ça s’réalise
aussi, enfin de comprendre le quotidien.
237
Elisa : Oui.
Moi : Ça aide aussi à… je pense à avoir une euh… une perspective encore une fois un peu
plus distancée et se dire : ça demande énormément au quotidien pour apporter quelque chose
euh… derrière qu’on a pensé, imaginé…
Elisa : Si petit, petit soit-il, tout c’qu’on fait est important. On a une place extrêmement
importante. Enfin moi c’est aussi… vraiment une euh… un souci euh… de… de … de…
vouloir euh… faire prendre conscience aussi aux parents etc. que tout c’qu’on fait en dehors
de l’école est tellement aussi important. Et… ça fait vraiment partie de la vie de l’enfant, de sa
construction euh… sociale… euh… Tout c’qu’il ne peut pas trouver forcément à l’école il
faut que nous on travaille là-dessus pour qu’il puisse le trouver à côté. Quand il ne le trouve
pas à l’école…
Moi : Ce n’est pas une petite mission !
Elisa : Non. Non. Mais tu vois, enfin, j’pense que, quand j’y repense c’est encore vraiment
un… un… j’pense que c’est vraiment lié à mon parcours quoi, tout simplement, j’me dis,
personnel. Oh, c’est vraiment ce point de vue que j’ai… qu’il y a tellement à faire pour que
tout le monde… ça parle des intelligences multiples… C’est vraiment ça.
Moi : Les compétences émotionnelles aussi… qui deviennent de plus en plus importantes.
Enfin, c’n’est pas qu’elles deviennent de plus en plus importantes, c’est qu’on commence à
s’dire « ah oui, ce serait bien qu’on les prenne en compte quand même » parce qu’on sait…
Elisa : C’est ça !
Moi : On sait qu’elles sont importantes.
Elisa : C’est ça. Mais qu’on la nomme. Qu’on puisse euh… vraiment euh… voilà, la mettre
aussi en place, voilà qu’on s’en serve de cette, enfin, oui… c’est vraiment quelque chose…
Xavier arrive et s’excuse du retard. Elisa finit de me parler d’une rencontre qu’elle a faite
avec un homme qui fait des interventions dans une école à Couëron sur Doisneau ; elle trouve
qu’ils sont sur la même longueur d’onde concernant le constat global sur l’école,
l’omniprésence de « cours magistraux » qui n’auraient pas changés depuis 60 ans.
Elisa : Il y a des choses encore à faire bouger…
Xavier : Oui !
Elisa : Et j’pense qu’en même temps c’est toute ces actions-là, petites qu’elles soient, mais
faut pas les lâcher en fait. Parce que, à un moment donné j’ose croire que ça va….
Xavier : Ouais, si on l’fait on a un sentiment d’espérance…
Elisa : C’est ça.
238
Moi : Et puis c’est vrai qu’c’est long. Comme on disait ça passe par plein de toutes petites
choses et c’est vrai qu’parfois ça peut être euh… difficile de pas s’décourager, de s’dire ça
avance pas, ou ça avance trop lentement.
Elisa : C’est ça !
Moi : Mais de sentir qu’ça avance quand même !
Elisa : Et d’sentir que tous les acteurs aussi autour de l’Education ne sont pas tous non plus
dans cette même conscience ou dans ces mêmes envies. C’est ça aussi. Et puis au-delà de ça
euh… voilà, là-haut, les budgets etc. c’est énorme. Mais euh… bah en fait j’perds pas espoir.
Xavier : Non. Non.
Elisa : J’me dis euh… qu’il faut continuer. En tout cas c’est notre rôle de se dire à notre porte
c’qu’on peut faire. C’est toujours ça j’pense.
Xavier : Ouais. C’est tout à fait ça. Il y aura p’t-être un jour un déséquilibre entre le reste de la
France entière et notre quartier !
Rires
Moi : Peut-être ! Qui sait ?!
Elisa : En tout cas on essaie de faire quelque chose !
Moi : En tout cas merci beaucoup de pouvoir me donner ce p’tit temps avec vous, c’est
vraiment très très gentil.
Avant d’entamer l’entretien tel que préparé, je m’assure auprès d’Elisa et Xavier du temps que nous
avons devant nous pour assurer une bonne gestion du temps en fonction de leurs disponibilités. Xavier
doit partir vers 16h30. Il est 14h45. Cela nous laisse 1h45 min.
L’entretien commence.
Moi : En fait voilà moi je vous ai demandé juste pour se revoir aujourd’hui, d’une part pour
reparler de certaines choses dont on a déjà parlé quand on s’est vus en décembre, mais tout
simplement pour pouvoir moi le faire entrer dans un entretien et qua ça puisse faire partie de
mon mémoire. Et l’intérêt c’est aussi que je puisse vraiment rendre compte de comment vous
fonctionnez dans l’Atelier, comment ça s’passe, quelles sont les valeurs, les buts, etc… en
respectant justement votre manière de l’exprimer aussi, pour ne pas déformer vos propos
d’une manière ou d’une autre, même si c’est souvent involontaire. Voilà, ça permet de fixer
tout ça. Euh… donc en fait, comme je le mettais dans le mail, mon idée c’est surtout de…
parler avec vous de la motivation, de c’qui vous a poussé à ajouter la dimension multilingue
dans les ateliers. En restant conscients bien évidemment que les arts restent le centre de votre
activité, après moi je prends juste cette perspective là parce que c’est celle qui me correspond,
en lien avec mes études.
Elisa : Oui.
Moi : C’est juste pour faire le lien entre les deux.
239
Elisa : Oui.
Moi : Pour commencer je voulais vous demander si vous pouviez m’expliquer un peu quels
ont été vos parcours avant l’Atelier du Coteau en fait, comment vous êtes arrivés petit à petit à
cette création.
Elisa : Oui. J’commence par euh… par moi.
Moi : Ok.
Elisa : Alors euh… le pourquoi de l’Atelier du Coteau… Non. Même pas commencer par ça.
Donc oui, initialement, moi je suis professeure de danse diplômée en danse contemporaine et
de la méthode Irène Popard depuis 2000 euh... depuis 2000. Euh… j’ai commencé à travailler
sur Nantes après mes études euh… dans l’école de danse dans laquelle en fait j’ai appris la
danse à partir de l’âge de 4 ans…
Moi : D’accord…
Elisa : Et j’ai eu euh… l’opportunité en fait de reprendre une partie de l’école de danse donc
euh… et de m’installer en tant qu’indépendante.
Moi : Ok…
Elisa : Donc j’ai travaillé de 2001… de 2000 jusqu’en 2010… rue Littré, dans le quartier. Et
euh… le bâtiment dans lequel en fait euh… j’dispensais les cours a dû être rasé en fait, vendu
etc. par rapport à l’évolution du quartier, les projets immobiliers, etc. qui pullulent. Et euh… à
c’moment là en fait bah il fallait que je recherche un autre lieu pour travailler, un local. Et là,
avec Xavier en fait on a commencé à regarder ensemble c’qui était possible de faire dans
l’quartier et on a eu cette chance de trouver ce bâtiment. Euh… d’oser le visiter. Voilà. Parce
qu’il fallait oser aussi se dire que…
Xavier : Fallait oser beaucoup de choses.
Elisa : Voilà. Il y a eu beaucoup, beaucoup de… oui. Fallait tout le temps oser en fait à
c’moment là ! Pour plusieurs choses : parce que déjà d’une part en étant dans la danse et puis
en étant profession libérale, peu de gens vous font confiance. Donc il y avait ça et puis Xavier
à l’époque était encore…
Xavier : J’étais encore étudiant.
Elisa : Oui, en études (rires), donc voilà, un profil plutôt d’étudiant et en profession libérale
qui demandons en fait une visite dans un lieu comme ça et puis ensuite qui rentrons dans
l’idée de se dire « ben ce lieu me convient bien pour développer l’école de danse dans un
premier temps », et de louer également les locaux pour d’autres structures, associations
indépendantes dans le bien-être et dans les arts. Euh… cette idée aussi qu’ce soit un lieu plus
ouvert c’était, c’était dans la continuité de l’école de danse, dans ma manière d’approcher
justement l’art et les arts auprès des enfants et autres, de se dire qu’on rassemble toujours les
arts pour, pour éveiller à tout c’qui s’passe, voilà. Et en fait, on a monté le lieu en 2010, ouais,
en septembre 2010. L’association, elle, ne vivait pas encore à ce moment-là, elle n’était pas
240
montée ; on a vraiment ouvert le lieu de l’école de danse. Et ensuite on a eu euh… avec les
rencontres euh…
Xavier : On s’est tout de suite mis à travailler pour l’asso.
Elisa : Pour l’association. En 2012 on a monté l’association en mars 2012, il y a trois ans. Et
avec cette association-là en fait, on… au départ on communiquait sur c’qui s’passait à
l’Atelier du Coteau, la première activité de l’association, on a créé des évènements, déjà des
expositions, des évènements… euh… on a reçu des compagnies de théâtre, on a reçu euh…
plusieurs projets. Et ensuite on a… on a développé le projet avec d’autres rencontres.
Notamment une personne qui était en… qui proposait de l’éveil musical multilingue.
Moi : D’accord.
Elisa : Et euh… on a bien accroché et suite à cette rencontre, c’est là qu’on s’est dit qu’il était
intéressant de se pencher sur ce terme là et… suite à la réforme scolaire. Donc au fur et à
mesure en fait on entendait, moi de la part des parents d’élèves, ce problème de garde le soir
etc. Enfin l’école qui terminerait plus tôt. Que ce serait compliqué pour eux de gérer les
choses, qu’il y aurait donc de l’école le mercredi matin, donc aussi les activités notamment la
mienne en pâtissait aussi le mercredi matin, et de faire vivre le lieu de toute façon, le plus
possible en fait dans la… toujours dans, dans, dans la cohérence avec les arts etc. Et avec
cette idée de langues en plus, parce que bah Elena était d’origine de toute façon italienne…
Xavier : Ça fait partie de la réforme également.
Elisa : Ça fait partie de la réforme. Ça fait partie aussi du projet, enfin, du parcours, de nos
parcours personnels, comment on a vécu les langues etc. et dans la manière aussi moi
d’appréhender tout simplement la danse comme j’le disais, de comprendre que c’est par
l’action qu’on est capables aussi d’éveiller à d’autres, à d’autres matières, à d’autres euh…
voilà. Et dans mon cas c’était d’éveiller à d’autres, aux autres arts en fait, tout en étant dans la
danse. Donc par la peinture, le cinéma, la littérature, la poésie, etc. Ce sont toujours des
thèmes en fait que j’ai utilisé et avec lesquels les enfants se sont intéressés aux autres arts. Et
pour moi du coup c’était le même principe pour la langue. Que en étant en action, on pouvait
appréhender l’apprentissage des langues de manière ludique, de manière euh….
Xavier : Comme le propose certaines méthodes.
Elisa : Voilà, non conventionnelles en fait, moins magistrales.
Moi : Vous pensez à des méthodes en particulier ?
Xavier : Elena Galimberti elle est de la méthode euh…
Elisa : Music Together.
Xavier : Music Together voilà, c’est ça. Et on avait été en lien avec d’autres personnes plus ou
moins dans le réseau par des relations j’pense plutôt faibles, sur le réseau avec des gens qui
pratiquaient d’autres méthodes et aussi d’un point de vue concurrentiel on s’est aperçus un an
après le lancement du projet que, les concurrents sur l’quartier se mettaient à proposer ces
241
méthodes. Au départ du projet le seul concurrent sérieux qu’il y avait sur le secteur c’était
euh… comment ils s’appellent… les enfants… les p’tits anglais, non… les enfants…
Elisa : Euh… Les P’tit Bilingues.
Moi : Oui Les P’tits Bilingues, exactement.
Xavier : Donc voilà en fait, c’était un travail qui s’axait sur leur travail, c’était la première
figure du quartier sur laquelle on s’est fixés pour réfléchir sur le projet.
Moi : D’accord.
Elisa : Oui. Mais en même temps euh… par rapport aussi à ce qu’ils proposaient en fait on…
enfin voilà, on n’était pas non plus dans la même démarche parce qu’on n’avait pas forcément
de méthode etc. d’apprentissage et que justement la différence c’est que le point de vue, de
notre point de vue on partait vraiment du sens d’avoir des professionnels de l’art avant tout en
fait. Donc j’pense que c’est ça aussi qui différait…
Xavier : Complètement.
Elisa : … de tout c’qu’on pouvait avoir en fait autour de nous ou de ce qui se proposait en fait.
Xavier : En fin de compte, au départ du projet, on regardait dans le miroir des P’tits Bilingues,
ça nous permet de voir ce qui nous assimilait et ce qui nous différenciait et euh… donc voilà.
Nous ça nous a permis aussi de nous renforcer voilà, dans c’qu’on défend quoi. Utiliser la
dynamique de projet créatif dans les arts et euh… et amener des éléments créatifs dans une
autre langue. En fin de compte simplement c’est également poser si tu veux une pierre en
avant de quelque chose que l’on souhaite. On a fait aussi ce travail-là dans une dynamique
d’aspiration, au sens physique du terme, parce qu’on s’est dit en plaçant aussi des pièces
devant dans l’idée euh… qu’on ait un réseau d’artistes qu’est pas statique, on est sur leur
chemin de vie, ils peuvent venir une fois, partir revenir, c’est déjà arrivé. Ils peuvent être
Français mais ils peuvent être également étrangers en fin de compte. Et nous ça nous
permettait également de rendre cohérente une approche purement artistique avec des
intervenants plutôt étrangers et de valoriser l’apport culturel qui porte sur eux quand ils
viennent enseigner en France.
Moi : D’accord.
Xavier : C’qui s’passe de manière euh… très simple, très libre sans nous dans une activité
comme les 5 rythmes…
Elisa : Oui.
Xavier : L’intervenant principal c’est euh…
Elisa : … Marc. Sylvestre.
Xavier : Marc Sylvestre, voilà, il travaille avec sa compagne sur la même méthode mais sa
compagne est Anglaise et elle ne parle pas français en fin de compte.
242
Moi : D’accord.
Xavier : Donc il arrive parfois qu’Emma vienne ici, ils ont un correspondant français ici qui
permet de faire la jonction de cours pour traduire un peu les directives d’Emma pendant
l’cours, mais voilà, il y a quand même une dynamique… il y a un enseignement en anglais.
Elisa : Oui.
Moi : D’accord.
Xavier : En fait ça permet aussi de justifier, de rendre cohérent cette position avec les langues.
Moi : Ok. Donc ça va même au-delà finalement des ateliers artistiques multilingues.
Elisa : C’est ça.
Xavier : Oui.
Moi : Il y a… C’est une dynamique beaucoup plus globale finalement.
Elisa et Xavier : Oui.
Xavier : J’pense qu’on essaie d’approcher ça en fait.
Moi : D’accord.
Elisa : De le rendre le plus naturel possible en fait et accessible. Que ce soit quelque chose…
il y a de plus en plus en effet d’intervenants étrangers et que… ça permet, enfin voilà, c’est de
toute façon une évidence que… il y a pas de frontières par rapport à l’enseignement artistique
aussi. Donc euh… c’est de le…
Xavier : C’qui être peut au départ une difficulté, prenons quelqu’un qu’on souhaite soutenir
pour l’année prochaine, un brésilien qui enseigne la capoeira, que j’ai pas encore rencontré
mais que j’ai pu comprendre qu’il était sympathique, et bien tu vois par exemple son niveau
de français est assez euh… c’est pas Mehregan si tu veux. Donc voilà. En même temps
d’abord nous, notre structure elle a cette approche déjà là, ça valorise, ça met pas en difficulté
si tu veux l’artiste quand il vient chez nous, il a pas forcément un complexe à avoir, qu’il
parle pas très bien l’français, on va s’adapter quoi.
Elisa : Oui, et puis d’autant plus que la capoeira étant d’origine brésilienne, il va d’autant plus
inculquer aussi les vrais termes.
Xavier : Et ça replace donc l’art au centre de la culture.
Moi : Tout à fait.
Elisa : Il va utiliser les chants brésiliens, voilà et… finalement les enfants vont s’inscrire pour
la capoeira mais à la fin de l’année ils auront un bagage supplémentaire linguistique.
Moi : Et culturel…
243
Elisa : Et culturel évidemment…
Xavier : Comme dans les arts martiaux euh… coréens, japonais etc. où les enfants apprennent
le vocabulaire du pays.
Elisa : Et voilà, ça existe déjà en fait dans certains cas sans le sa… enfin, sans se dire de toute
façon on y vient pour apprendre ces termes, mais finalement c’est de pouvoir euh… banaliser
en fait cet apprentissage.
Xavier : Ouais. Le démystifier.
Elisa : Exactement. Que ce soit… voilà, quelque chose de naturel en fait.
Moi : Et tous les deux vous parlez des langues étrangères ?
Elisa : Très peu, et c’est pour ça, enfin, moi, c’est ça, je… pour moi c’est un projet en plus de
ça très important parce que c’est tout ce que je n’aurais pas… tout ce que j’n’ai pas pu
aborder ou vivre le plus simplement possible enfant, j’crois. Ça fait partie de…
Xavier : Tous les combats d’l’Atelier du Coteau, si j’peux m’permettre, j’pense sont euh…
chacun individuellement des combats personnels.
Elisa : Oui, oui.
Moi : Donc c’est lié à c’que vous avez pu vivre ou ne pas vivre justement ?
Elisa : Exactement.
Moi : D’accord.
Elisa : Et c’qu’on ne peut pas encore s’offrir par le manque de temps pour nous, mais qu’on
développe en fait pour les autres.
Xavier : Et par exemple ça c’est un moins (rires d’Elisa). Moi par exemple en tant
qu’artificier de bureau, j’ai été beaucoup nourri dans les arts, donc moi ça m’parle de défendre
les arts et c’est aussi quelque chose que j’ai envie d’apporter aux enfants. C’est quelque chose
d’important dans leur développement, évidemment. C’est… après t’as une vision beaucoup
plus panoramique même de tes sens, t’as plus d’approches dans la compréhension du monde
sur n’importe quel domaine, que ce soit des choses assez banales ou des choses assez
pointues.
Elisa : Donc idéalement on devrait nous aussi se former (rires)…
Xavier : Mais on n’a plus l’temps !
Elisa : Mais ça viendra p’t-être ! On trouvera des temps de formation… pour…
Xavier : Pour l’espagnol j’avais pensé à une croisière en Espagne…
244
Rires
Moi : Ça peut être une idée ! (Rires). Il y a tellement de moyens d’apprendre !
Elisa : Exactement ! Donc en fait après, voilà, malgré tout aussi avec les rencontres, on
partage culturellement en fait, par contre on s’nourrit énormément avec tous les intervenants,
mais on prend pas l’temps d’parler, on prend pas l’temps de… enfin voilà, de parler anglais
ou d’échanger en anglais etc. parce qu’on a peu de temps d’échanges donc en fait on vit dans
le vif du sujet et puis de, de…
Xavier : Mais ça s’fait naturellement en fin de compte parce qu’on n’a pas l’temps mais on lie
l’utile à l’agréable, on essaye de s’entourer de personnes, tu vois. De manière informelle par
exemple avec Mehregan ça peut arriver qu’on tripe sur des mots, des fois on peut les faire
passer… parce qu’elle cherche ses mots en français mais elle les trouve en anglais donc elle
les donne en anglais, après on en vient à la signification iranienne, et puis là quelqu’un
balance un sujet donc on part sur la culture iranienne.
Silence.
Elisa : Hmm. La culture perse.
Silence.
Xavier : Ouais… ça lance le débat : perse-iranien… Tout d’suite ça peut lancer un débat !
Rires.
Elisa : Ouais. Exactement ! Elle confirme bien « perse ».
Xavier : Perse… c’est… n’hésite pas à nous r’cadrer hein dans le débat parce qu’on peut
s’égarer !
Rires.
Elisa : Voilà. Après il faut nous axer parce qu’on peut partir…
Xavier : Mais c’est vrai que, tu m’fais penser à ça, mais si j’dis pas de bêtise, que dans
l’Afghanistan, dans le nord de l’Afghanistan qui est collé à l’Iran et qui fait partie de
l’ancienne Perse, et il me semble que c’est dans c’territoire là aussi qu’il y a un peuple qui
s’appelle les Pachtounes, et j’crois qu’les Pachtounes se sentent avant tout Pachtounes depuis
3000 ans avant de se sentir quoi que ce soit d’autre, Afghans ou même musulmans. Donc
c’est intéressant qu’elle se revendique elle Perse, elle s’enracine en fin de compte dans une
histoire plus ancienne que l’Iran.
Elisa : Ouais. Bien sûr.
Moi : C’est vrai.
Xavier : C’est intéressant….
245
Elisa : D’ailleurs elle souhaiterait vraiment développer, j’te coupe excuse-moi, elle
souhaiterait vraiment développer euh… aussi des ateliers supplémentaires sur les contes
perses. De travailler sur euh… notamment là-dessus avec Alexis dans l’idée de théâtre, de lier
les arts etc. en plus, euh… De développer vraiment le dessin, l’art plastique etc. avec en
même temps cette histoire perse en fait.
Silence.
Xavier : Donc ton introduction sur toi était assez longue alors j’vais essayer d’être court…
Euh… pour reprendre mon parcours, moi j’ai fait un bac électronique, après j’ai fait des
études dans le commerce, j’ai fait deux ans de BTS dans le commerce, j’en suis venu à faire
un DUT en gestion orienté sur les ressources humaines et puis j’ai fait une année de finance
dans le cadre d’un diplôme comptable et puis j’ai fini par un semestre pour me détendre
l’esprit en socio et euh… A la fin d’mon premier semestre de socio j’ai décroché la fac et
j’me suis mis à chercher mon avenir, et six mois après j’suis tombé à… démarrer tu vois ce
projet, à faire les premières visites et s’coller dans tous les domaines de lancement de projet,
étude socio-économique etc. Défendre le projet auprès des banques et puis après s’occuper
des murs, développer les murs. Donc à côté on a commencé à partir du moment où on a
construit, où on a mis en place les murs. Le hard.
Elisa : Faire les travaux.
Xavier : Et on a commencé le soft. Donc c’est à partir de 2010 qu’on s’est mis au chantier de
l’association et mes premières fonctions était la communication des locataires d’ici, avoir un
point de visibilité etc. etc. de fil en aiguille comment on en est venu là.
Moi : Donc aujourd’hui vous êtes tous les deux membres du bureau de l’association, est-ce
qu’il y a d’autres gens qui sont membres du bureau aussi ou après on passe aux membres de
l’association en général ?
Elisa : On passe directement aux membres de l’association.
Moi : D’accord.
Elisa : Xavier est secrétaire, trésorier et je suis présidente. Pour l’instant en fait on a… on a
euh… pas le… enfin j’dirais, j’sais pas si c’est l’envie ou autre mais… il nous semble
tellement prégnant ce projet que… on est dans le mouvement, on est vraiment dans l’action.
Par tout ce qui s’passe, par les aléas, par la synergie en fait des ateliers qu’on propose, des
demandes, des besoins du public, des intervenants, etc. etc. que. en fait on n’a pas l’temps et
on n’imagine pas plus de personnes que ça au sein de l’association.
Moi : D’accord.
Xavier : Le centre décisionnel doit être réduit.
Elisa : Réactif. Et moins on est, j’dirais… plus on peut en un sens être… être oui réactifs pour
agir. Après ça ne veut pas dire qu’on est resserrés sur nous, on reste super ouverts justement
sur toutes les rencontres et on se nourrit vraiment, on écoute, on… j’crois qu’on écoute le plus
possible en fait tout c’qui s’passe autour de nous. Mais ensuite en fait on s’engage dans les
choix qu’on a à faire, on reste les seuls décisionnaires pour l’instant. Et j’pense que c’est aussi
246
l’esprit de… de rien, on prend les risques, en fait on prend les risques tous les deux et on n’a
pas envie de les faire porter à quiconque en fait. Il y a un côté comme ça. Enfin c’est vraiment
un…
Xavier : C’est une manière aussi d’se développer, de pouvoir aussi… essayer de retrouver
aucun lien de subordination.
Elisa : C’est ça. C’est… Carrément.
Xavier : C’est… On construit l’Atelier du Coteau que nous parce que l’Atelier du Coteau
aujourd’hui c’est un ensemble de compétences larges, donc c’est au travers de la relation, des
partenariats avec lesquels on construit, et qui travaillent, qui font l’Atelier du Coteau etc.
C’est pas des liens de subordination on est dans la collaboration etc. On défend en fin
d’compte des valeurs très démocratiques de ce point de vue-là, parce que… ça peut
fonctionner que si on est coopérants. On est solidaires dans le projet. Chacun est indépendant
donc si on veut avancer… on peut avancer que comme ça. Et en même temps ça nous amène
une manière de s’éduquer si tu veux entre nous, qu’il y ait des transferts de compétences entre
nous, entre partenaires, entre pairs. Euh… Voilà, ça rend les choses plus fluides comme ça,
c’est… C’est un type de structure…
Elisa : Et qui reste aussi une des valeurs en fait aussi qu’on défend pleinement l’un et l’autre,
c’est de l’ordre de l’autonomie et de la responsabilisation de chacun aussi.
Xavier : Voilà. Ça c’est…
Elisa : Le fait de ne pas être subordonné les uns aux autres euh… j’ai l’impression que des
fois l’engagement est bien plus entier et sincère euh… dans l’engagement de quelqu’un en
fait. Et…
Xavier : On met les choses en place de telles manières qu’elles ne peuvent fonctionner que si
la personne se met en mouvement elle-seule, de sa propre autonomie. Si la personne ne bouge
pas, les choses ne vont pas avancer en fait. Et euh… parfois on peut sentir comme un reproche
mais quand quelqu’un vient et me reproche par exemple de pas subordonner, faut qu’il aille
travailler ailleurs, parce qu’il va pas être déjà…. Il va pas être compétent à mon sens parce
qu’il va pas être autonome. Et d’une certaine manière il correspond pas à la culture
d’entreprise.
Elisa : Il y a un côté euh… justement aussi par rapport à ça, c’est qu’on est... on est formé
aussi, enfin voilà, avant tout moi j’suis… j’ai toujours travaillé seule et en profession libérale
il y a un état d’esprit aussi dans la manière d’aborder d’abord toutes les casquettes en fait et
de… rien attendre de quiconque. On est obligé de se mettre en mouvement tout le temps, de
réfléchir à la manière dont on doit évoluer...
Xavier : C’qui veut dire qu’on est tout le temps en formation de combat.
Elisa : Il y a quelque chose comme ça, tout le temps, tout l’temps, tout l’temps. On peut pas
rester euh…
Xavier : Oisifs.
247
Elisa : Non. Non. Et en fait j’crois que c’est dans l’association, c’qu’on a envie… vraiment
d’immiscer cet état d’esprit, de jumeler en fait ces parts, de ne pas cloisonner en fait les
choses et de rester sur des préjugés, enfin voilà… des idées reçues. L’association bah euh…
tout est subventionné, tout est ceci, tout est cela… On attend beaucoup beaucoup souvent,
enfin j’exagère parce qu’il y a aussi tout un travail aussi souvent de bénévoles,
d’investissement, mais il y a aussi des fois euh… un travail oui, enfin, il y a aussi, une fois
que les gens, que certaines associations sont dans un schéma de subventions, etc. bah on
s’endort, on réfléchit pas forcément. On travaille, c’est pas un jugement mais c’est un constat
qu’il y a quelque chose qui fait que bah voilà, on est dans son ptit train-train, son ptit
« confort » entre guillemets et en fait on réfléchit pas au fond, on remet pas en question les
choses, et puis voilà, les choses tournent, et puis elles passent et puis des fois ça s’effondre
justement et les valeurs en fait… on les oublie. Et le fait d’être dans cette dynamique là on…
bah ça devient plus vraiment constructif et j’crois qu’il y a cet état d’esprit que nous on peut
pas, enfin auquel on n’adhère pas.
Xavier : Ouais, complètement. On est des jardiniers d’un autre type. On va pas par exemple
mettre euh… des engrais, j’vais m’permettre la métaphore, des engrais à fond dans la terre ou
alors contraindre la plante d’une certaine manière pour qu’elle pousse. Nous on est
dépendants des volontés des autres pour notre développement, enfin on va pas chercher le
développement il s’impose à nous. Donc si les gens un moment testent des choses et ne sont
pas autonomes, c’est pas une branche qui va grandir, elle va tomber tout de suite. Alors que
dans l’autre sens tu pourrais très bien t’accrocher, investir, contraindre, enfin contraindre,
j’appelle ça contraindre mais… la subordination c’est une forme de contrainte, puisque c’est
une forme de domination formelle. Tu pourrais contraindre une personne sur le terrain à faire
ça. Déjà, si j’aurais voulu euh… gagner ma vie et contraindre des gens j’aurais fait dans la
technologie pétrolière, ça marche plus ! Donc si aujourd’hui on est dans la culture… là, j’me
permets mais c’est un peu, enfin moi c’est comme ça que j’le ressens, si tu veux faire une
entreprise qui est contraignante, moi j’sais pas, mais c’est pas épanouissant, enfin à mon sens.
Après on parle de choses, on parle de choses aussi p’t-être qu’on connaît pas encore, par
exemple un jour il serait peut-être utile qu’on ait un salarié dans le bureau parce que le lien de
subordination t’apporte notamment une sécurité, notamment en termes d’informations, tu
t’assures que la personne elle connait tes comptes etc., enfin bref, des domaines après qu’on
connaît pas encore tu vois Faut s’laisser aussi la marge de découvrir.
Elisa : Ah bah oui parce que en même temps si on continue de, de, de développer les
projets… euh… il sera forcément certainement utile qu’on s’entoure parce que on pourra pas
prendre, enfin, conserver toutes les casquettes là, actuelles, ça nous demande un
investissement très très important.
Xavier : Ouais c’est ça, c’est… c’est chronophage. Ce projet est chronophage.
Moi : Oui.
Elisa : Bah c’est notre vie, c’est… notre vie. Euh… et puis on le fait bénévolement donc
euh… c’est sûr que… on s’dit qu’on créé du travail, on créé de l’emploi, alors que toi et moi
on n’est pas rémunérés ! (rires).
Xavier : Mais j’regardais une définition intéressante de bénévole, c’est bienveillant.
248
Elisa : Bah voilà, c’est nous. Toute façon j’pense que c’est comme ça qu’on voit les choses de
toute façon. C’est… c’est une manière… c’est nos personnalités aussi je pense.
Xavier : J’suis d’accord.
Elisa : On s’engage voilà, notre vie de… citoyens, c’qu’on peut faire…
Xavier : Citoyens actifs.
Elisa : Voilà. C’est c’qu’on se dit au fur et à mesure parce que nous c’est une question de tous
les jours aussi de se dire euh… comment on vit les choses, enfin dans notre quotidien
finalement, dans notre vie, forcément.
Xavier : Bah à fond. Là par exemple j’viens d’me faire une nuit sur une étude, j’suis à fond tu
vois. J’ai pas dormi beaucoup, enfin voilà c’est des projets, on sait même pas si ça va nous
rapporter de l’argent mais on les fait parce qu’on a envie de les faire.
Elisa : C’est ça. C’est une manière de… On se rend compte qu’on est dans une manière de
vivre différente. C’est pas forcément la norme.
Moi : D’accord. Parce que là, à l’heure actuelle, enfin sans indiscrétion, vous n’êtes pas
obligés de répondre si vous ne voulez pas mais les sources de financements de l’association
elles sont… Quelles sont en fait ces sources de financement ?
Xavier : D’abord nous les fondateurs on a apporté des fonds et euh… aujourd’hui en termes
de développement c’est nos activités qui nous permettent d’assurer le minimum vital, c’est-à-
dire tout ce qu’il faut quand même payer, même si tu payes pas les hommes, tu payes le
matériel, tu payes le site internet, tu payes…
Elisa : Les flyers, les affiches…
Xavier : Le loyer de bureau qu’on occupe, les affiches…
Elisa : Et donc c’est par tout ça en fait, c’est par les inscriptions de tous les ateliers artistiques,
tous les… tous les ateliers dans la manière dont on fonctionne en fait on s’occupe des
inscriptions donc on gère les dossiers d’inscription, la réalisation des dossiers d’inscription,
les appels enfin le rapport aux parents etc. etc... Et ensuite en fait l’association prend un
pourcentage sur les inscriptions et le restant en fait euh c’est l’intervenant qui nous facture et
on lui reverse ce qui lui est imparti. Donc euh…
Moi : D’accord.
Elisa : Donc euh… On est médiateurs en fait, on est juste… en fait c’est de la prestation de
services. Voilà. Et pour beaucoup des intervenants, c’est une euh… On a aussi réfléchis à
cette manière de faire parce que la plupart du temps ce sont soit aussi des indépendants ou soit
des jeunes structures associatives qui n’ont absolument pas … la… le goût et les euh…
qualités pour s’occuper en fait de tout le côté administratif en fait d’une euh… d’une activité,
voilà. Et qui sont uniquement bah, principalement dans le lien de leur activité avec les enfants
etc., le rapport direct aux parents euh… comme tu peux le voir, voilà. Mais ça reste très…
249
Xavier : Ils ont pas le goût pour l’administratif, ils ont pas parfois pas la compétence de la
communication, la visibilité. Et à côté de ces compétences qu’ils ont pas, finalement ils ont
pas de clientèle, très peu, et ils veulent pas prendre le risque de…
Elisa : … de se lancer.
Xavier : … de se lancer. Donc nous on leur apporte euh… ces compétences là et en même
temps on assure le risque de leur développement.
Elisa : On prend le risque avec tout le monde en fait.
Moi : Ok.
Xavier : Un risque, un risque négocié en fait on fait partie des… mais c’est nous au final qui
prenons quand même le risque, si ça s’passe pas, ça s’passe pas.
Moi : Oui. D’accord. Et combien vous comptez d’adhérents à l’heure actuelle, là cette année
par exemple ?
Elisa : Alors entre euh… les ateliers de Mehregan, le chant, le théâtre, le hip hop, j’dirais qu’il
y a … euh… oh ! J’ai même pas compté mais on est à soixante adhérents.
Xavier : Ouais, ouais, oui c’est euh… ça doit être à quelque chose près comme ça.
Elisa : Pour une deuxième année.
Xavier : Soixante adhérents qui ont une activité euh… hebdomadaire et après… on a
également des adhérents euh… qui viennent faire des activités ponctuelles comme le stage hip
hop. Ça doit représenter sur cette saison, on doit en avoir une trentaine supplémentaire.
Elisa : Oui, même un peu plus.
Xavier : Donc on a j’pense à une centaine avec une légère majorité d’adhérents
hebdomadaires.
Moi : D’accord, ok.
Elisa : Oui c’est ça. Donc pour nous c’est… beaucoup pour un début. Même si ça parait peu.
Moi : Vous avez euh… Il y a une évolution par rapport à l’année dernière par exemple ? Au
niveau du nombre d’adhérents ?
Elisa : Ah oui !
Xavier : De moitié je crois.
Elisa : Oui, de moitié. Oui.
Moi : D’accord. Oui donc on peut que garder espoir alors finalement ?
250
Elisa : Oui. Oui, oui, oui.
Moi : C’est vrai qu’c’est plutôt encourageant.
Elisa : Complètement. Oui parce que tout est création. On est parti, bah voilà. Personne
n’avait en plus de ça de… de clientèle ou autre, enfin.
Xavier : Ah oui c’est que de la pure création. Ouais.
Elisa : Donc c’est plutôt encourageant.
Moi : D’accord.
Xavier : Ouais complètement. Ouais, c’est encourageant. On avait porté une étude, on avait
fait des constats, on a mis en place les actions, on a eu les retours escomptés. Donc c’est bien.
Elisa : Oui.
Xavier : Avec des surprises sur le chemin.
Elisa : Sans compter aussi j’pense aussi au stage de Mehregan pendant les vacances, il y avait
aussi des enfants qui ne sont pas dans les ateliers hebdomadaires, euh… Et tout ça aussi avec
des enfants qu’étaient pas inscrits au…
Xavier : C’est pour ça, j’pense que le hip hop ça doit faire une trentaine, plus les enfants… ça
fait ça j’pense.
Moi : D’accord. Si on revient un p’tit peu plus précisément sur les ateliers multilingues et
multi-activités qu’anime Mehregan, j’voulais vous demander en fait pour vous qu’est-ce que
ça recouvre le terme « multi-activités » ? Qu’est-ce que vous entendez par là ?
Elisa : Dans le multi-activités, on… on entend les activités euh… en fait euh… arts plastiques,
expression euh… au sens large, corporelle euh… et aussi euh… j’veux pas mettre forcément
le mot théâtre mais expression scénique, musique, chant, etc… arts visuels, voilà. Tout ce
qu’il y a en fait autour des compétences aussi en fait des intervenants, entre Hélène et
Mehregan.
Moi : Ok. Ça laisse un décloisonnement en fait entre différentes disciplines…
Elisa : Exactement, à savoir que elles sont spécialisées l’une plus musical et l’autre arts
plastiques, mais que je… et qu’elles ne veulent pas se cloisonner non plus qu’à ça.
Moi : D’accord, donc c’est pour ça qu’ils sont présentés comme multi-activités et pas par
exemple atelier multilingue arts plastiques ou…
Elisa : Exactement, exactement.
Moi : D’accord.
251
Xavier : Ça a été tenté en fait, on était parti dans cette direction-là la première année, et on
s’est rendus compte des difficultés sur place à se galvaniser à une seule activité, donc déjà ça
apporte un certain confort dans la pratique de l’intervenant. Euh… et en plus c’est, d’un point
de vue forme de projet, c’est plus compliqué à gérer si tu veux. Avec les parents, « ah, mon
enfant il veut faire chant », « ah, excusez-moi, j’voudrais qu’il fasse théâtre etc. », déjà tu
commences un projet de cette envergure-là et que tu t’attends à avoir un premier noyau, donc
bah l’équipe de sept de football tu vois elle est répartie sur quatre terrains donc euh… tu vas
pas pouvoir faire de match. Ça permet aussi de… de rassembler l’équipe de football.
Moi : D’accord. C’est un moyen de répondre aux attentes des parents en fait finalement ?
Elisa : Aussi.
Moi : Pas uniquement j’imagine, mais euh… en partie quand même.
Elisa : En partie aussi. Avec tout c’qu’on entend de… depuis deux ans. : les attentes, les… et
en effet on a pris ce parti-là, enfin on a fait ce choix, c’est-à-dire de s’dire on…
Xavier : On a tamisé les obstacles, si tu veux, pour qu’ils viennent… C’est une question
d’accessibilité j’pense.
Elisa : Aussi. Oui, oui.
Moi : Et alors si on s’attache au multilingue ? Ça recouvre combien de langues ? Quelles
langues ? Est-ce que c’est quelque chose qui est défini ?
Elisa : Non, qui n’est pas défini parce qu’on est pour l’instant, on est avec la réalité de nos
intervenants qui ont leur propre euh… bagage. Donc Mehregan de toute façon c’est en effet
l’anglais, le perse et tend vraiment à aller vers l’espagnol en se formant aussi parallèlement ;
et puis euh… Hélène elle est plus, elle est anglais, allemand et il y a j’dirais une appréhension
d’aller plus largement elle sur, sans limites. Sans limites sur toutes les langues, par sa
discipline, par sa spécialité le chant aussi, la musique etc. où elle peut aborder peut-être plus
largement en fait ce bagage-là, multilingue.
Moi : D’accord.
Elisa : Voilà. Elle a une appréhension vraiment différente de Mehregan qui, Mehregan n’est
pas contre mais j’pense que c’est déjà euh… bah dans son parcours aussi tout simplement
euh… Hélène aussi a suivi cette, ces études du coup qui sont… qui fait que sa démarche est
plus… à un rapport linguistique euh…
Xavier : Qui ça, Hélène ?
Elisa : Oui.
Xavier : Hélène elle est… elle est formée, c’est ça elle est dans la didactique des langues et de
la formation, donc elle a une approche plus… j’sais pas, différente.
252
Elisa : Elle est vraiment… même si elle a aussi voilà, certainement des choses euh… bien en
place etc. mais j’crois qu’elle a une ouverture de… d’offrir en fait le plus de sons tu vois
possibles en fait aux enfants.
Xavier : Et puis c’qu’est intéressant c’est qu’elle est dans une recherche personnelle aussi,
c’est… elle est sur une recherche personnelle, sur son nouveau métier.
Moi : D’accord.
Xavier : Enfin c’est c’que j’en perçois, et... c’est… j’trouve c’est super intéressant.
Elisa : Oui. Et puis Mehregan j’pense que c’est le temps qui lui manque, et j’ai l’impression
que si elle pouvait développer encore plus euh… de langues, enfin, d’approches culturelles
elle le ferait.
Moi : D’accord.
Elisa : Il y a parallèlement aussi bah sa place d’artiste hein qu’elle euh… qu’elle travaille et
puis euh… bien qu’elle s’engage énormément cette année aussi dans… entre les ateliers à
l’Atelier et les ateliers du midi en fait dans les écoles, du coup l’Atelier aussi intervient depuis
cette année euh… là-dessus et… On est en train aussi de travailler énormément sur ce projet-
là, d’investir une euh… une manière d’aborder aussi les ateliers périscolaires, de… valoriser
le travail en fait des intervenants professionnels dans les écoles.
Moi : Toujours dans le cadre de la réforme aussi j’imagine ?
Elisa : Oui. Oui.
Moi : D’accord.
Elisa : Et l’utilité en fait d’avoir des intervenants professionnels pour aborder les arts.
Moi : D’accord.
Elisa : Donc le multilinguisme euh… on va le proposer à partir de l’année prochaine dans les
écoles. Cette année on était avec Mehregan en tant que plasticienne.
Xavier : Et Hiya en tant que hip hopeuse.
Elisa : Oui. Donc euh… l’année prochaine on aura une… une palette de huit activités, neuf
activités à proposer dans les écoles.
Xavier : Si c’est… ça c’est en cours de validation.
Elisa : Si c’est accordé ! Je dis on a, on aurait, on aurait.
Xavier : On aurait. Faut l’passer au conditionnel si on veut être honnêtes dans notre entretien.
253
Elisa : Avec le multilinguisme, donc en multilinguisme… en arts plastiques purs, euh… en
théâtre, en photographie, euh… en relaxation-sophrologie, pourquoi j’ai dit ? En hip hop, en
théâtre clown et quel est le huitième ? En capoeira.
Moi : D’accord.
Elisa : Et capoeira euh… du coup ce sera aussi relié au multilinguisme. Enfin, au
multilinguisme, oui, tout de même il y a … voilà.
Moi : D’accord. Donc si je reprends ce que vous m’avez dit au départ sur les raisons qui vous
ont fait apporter une dimension multilingue à certains de vos ateliers, donc il y a une histoire
de rencontres avec certains professionnels, des formateurs qui sont, qui ont des cultures
étrangères et qui viennent apporter ça à leurs ateliers et à l’Atelier ; est-ce qu’il y a d’autres
raisons pour lesquelles vous avez voulu apporter cette dimension-là en plus ? Dans l’idée de,
par exemple, pourquoi après l’école, dans le cadre de la réforme, ne pas simplement proposer
–alors quand je dis simplement c’est entre guillemets hein- euh.. des ateliers purement
artistiques mais aller plus loin en disant artistiques et multilingues. Est-ce qu’il y a quelque
chose en plus qui a motivé cela ?
Elisa : Bah par rapport aux petits aussi en fait, c’est la, la, la réflexion de… j’pense que ce
sont les enfants qui sont aussi en… en mesure et en ... en capacité d’aborder le plus
simplement possible en fait les langues, enfin c’est l’idée que, si on pouvait, pour moi,
l’aborder dès la maternelle sous forme ludique ou autre etc. C’est à ce moment-là qu’ils sont
euh… le plus à même d’absorber. Donc certains vont dire que trop c’est… c’est pas
forcément bon etc. parce que déjà ils sont dans l’apprentissage de leur langue maternelle Moi
j’suis pas d’accord. J’pense que de toute façon, ils… enfin c’est comme d’apprendre à
compter, à lire etc., enfin c’est du même ordre. Donc plus on est dans le… dans la période
euh… enfin voilà, qu’on reste dans l’instinct, enfin, utiliser l’instinct plus ce sera bénéfique ;
du coup il y a aussi ce prolongement-là qu’on veut développer ici en fait.
Xavier : C’est aussi leur permettre d’avoir une approche par les loisirs des langues. C’est ça
quand tu parles par instinct ?
Elisa : Oui, les loisirs parce que quand on est en maternelle, on est pas dans… on est pas dans
les cours magistraux etc. et l’enfant il est… En fait ils sont en âge de tout absorber. Plus tôt ça
vient, plus voilà, moins on a de, de, d’aprioris, … de formatage.
Moi : D’accord.
Xavier : J’pense que si euh… J’crois qu’on a indiqué le prétexte de la réforme aussi ?
Moi : Oui.
Xavier : C’est assez caractéristique parce que sur le quartier euh…
Elisa : Après j’pense que c’est un éveil aussi, enfin voilà, moi la manière dont j’évolue dans
mon enseignement déjà, des prises de conscience d’aborder les enfants d’une manière euh…
On en avait parlé lors de nos premières rencontres, enfin, d’être aussi sensibles aux méthodes
Montessori etc. J’pense que, sans les avoir étudiées ou autre, c’est par l’expérience une
manière d’aborder en fait les enfants. Et quand on… et par le fait d’être au contact des enfants
254
et de me rendre compte de mon fonctionnement aussi. De ce que je, quand j’disais ce que je
n’ai pas eu ou autre, c’est aussi comprendre comment je fonctionnais par rapport, quand on
parle d’intelligences multiples ou autres etc., de savoir quelle est moi, ma manière de, de, de,
d’apprendre, d’absorber, enfin voilà. Et du coup c’est aussi sur un travail personnel en fait.
Xavier : Hmm.
Elisa : C’est que ça en fait, quand on enseigne aussi qu’on est dans la recherche, qu’on
évolue, qu’on…
Xavier : C’est par ton engagement que tu te formes en fin de compte. C’est un peu ça. Là ce
qu’elle étudie en ce moment c’est de, d’approcher, de visualiser en fin de compte ce
mouvement. Que c’est quand un enfant est dans son propre engagement, de… de décider
d’avoir fait quelque chose qu’il ne lui a pas été imposé forcément, qu’il ait été encouragé.
C’est lui qui s’autorise, c’est lui qui va prendre la responsabilité de s’exprimer dans le groupe,
etc. Et tout ce chemin-là…
Elisa : … qu’on lui offre différemment.
Xavier : Qui l’amène sur le chemin de l’engagement, et c’est sur ce chemin-là qu’il va…
bah… apprendre le fond et la forme, c’est-à-dire apprendre déjà qu’il peut se former par lui-
même, et apprendre bah… la forme, il prend les informations sur le terrain.
Elisa : Et qu’on l’accompagne, et qu’il soit accompagné à ça. Mais qu’il soit aussi dans la
recherche, qu’il soit acteur aussi dans le fond c’est ça, en fait.
Xavier : Ça te parle, ce qu’on te parle ?
Moi : Oui !
Elisa : C’est cette notion d’être de toute façon de s’dire qu’on apprend à un enfant d’être
acteur tout le temps et que, dans la vie, voilà, si on ne choisit pas, enfin.
Xavier : La première valeur qu’on défend c’est l’imagination. On demande dès le plus jeune
âge et d’ailleurs c’est de plus en plus comme ça que fonctionne Elisa avec les bouts d’papier
« imagine, imagine ! », l’enfant d’abord doit être auteur de soi-même, il doit s’inventer une
histoire etc. Donc voilà, on l’amène dans une dynamique de projet à agir puis en plus quand il
passe dans le corps il agit, quand il manipule il agit, etc. L’agissement, ce phénomène
d’agissement se décompose à plusieurs niveaux du travail.
Elisa : Moi j’parle de plus en plus de géométrie avec les enfants en danse. J’fais le rapport à la
géométrie, aux mathématiques.
Moi : Parce que finalement, plus vous travaillez autour de ces thématiques-là, plus il y a une
relation qui se dégage entre les arts et les apprentissages, que ce soit les langues, les cultures
ou même d’autres…
Elisa : Exactement. C’est de faire le lien, de faire prendre conscience que tout ce qui nous
entoure est utile, mais d’aborder euh… enfin voilà, finalement euh… c’est aussi me dire moi
j’étais bloquée en mathématiques et je me rends compte que de plus en plus dans mon
255
enseignement j’en parle ; et en fait j’utilise une forme de mathématiques constamment. Et en
fait, enfin voilà, j’en suis imprégnée. Et c’est aussi de faire comprendre ça aux enfants d’une
manière euh... là on danse etc. mais en fait on fait ça. Alors au départ ça les fait rire « Oui,
parce que moi j’aime pas les maths ! » bah oui mais j’dis « moi aussi j’aimais pas les
mathématiques », et en fait c’est aussi de, de voilà, cette prise de conscience que tout nous
sert. Peu importe, pas forcément de manière, peut-être que toutes les… c’est pas la formule
exactement qu’il faut retenir, mais en même temps ils euh… ils l’utilisent.
Xavier : Une formule quand tu les apprends en cours, si tu peux la reformer, la déformer,
trouver toutes ses déclinaisons…
Elisa : C’est ce que je veux dire, mais que tu n’en a pas forcément conscience. Et euh… que
tout est comme ça en fait. Et c’est juste ça que j’ai... c’est aussi… que j’ai envie qu’on arrive à
faire passer aux enfants, euh, voilà. Dans n’importe quelle discipline qu’on soit.
Moi : C’est… voilà, les apprentissages comme une expérience physique, réelle, pratique…
Elisa : Exactement.
Xavier : Oui.
Moi : … par les sens aussi…
Elisa : Voilà.
Moi : Ok. Ça me parle vraiment parce qu’en fait, moi, voilà, j’ai fait un travail au premier
semestre sur l’apport des arts dans les apprentissages ; moi j’m’intéresse surtout au prisme des
émotions en fait. Mais euh… en fait, très très vite, dans toutes les recherches, ils précisent
bien que les émotions sont liées aussi à une intégration par le mouvement physique, par le
corps, par un tas de choses et tout ça c’est lié. La question c’est, on sait que c’est là, mais
encore une fois, comme on le disait tout à l’heure, c’est pas reconnu à sa juste valeur. C’est
aussi pour ça que ça m’intéressais de venir faire mon stage ici, pour pouvoir en faire
l’expérience.
Elisa : Bah oui, et quand j’te donne cet exemple-là, là, vraiment mathématiques ou autre, c’est
que, quand j’ai commencé à me rendre compte de ça, de mon fonctionnement, mais bien plus
tard tu vois ! Enfin, voilà, dans mon métier, enfin il y avait une, une, une révélation, une
jouissance tu vois de s’dire mais c’est extraordinaire en fait, je prends conscience que… là ça
ne me parlait pas dans ce cadre-là, mais quand en fait je suis en train de pratiquer et d’utiliser
ce phénomène-là, et euh… mais parce que je suis dans un cadre aussi dans lequel je me plais,
dans lequel je décloisonne et j’ouvre, enfin tu vois, j’ai réussi ; enfin j’me donne la permission
de réfléchir en fait. C’que je veux dire c’est que je ne me sens pas contrainte, je ne me sens
pas… et que, de créer, j’me dis, de réfléchir à créer comme ça plein, plein, de formules
différentes, mais c’est ça qu’est complexe, peut-être utopique, mais de trouver des moments
de vie en reliant les choses beaucoup plus les unes aux autres, on pourrait certainement en fait
encore mieux accompagner les enfants selon leur intelligence. Moi c’est une réflexion qui
me…
Xavier : Plus ils trouveront facilement leur propre méthode…
256
Elisa : Leur propre méthode et leur fonctionnement pour se dire « ah ok, je fonctionne comme
ça. Donc là j’ai besoin de faire interagir telle ou telle ou telle chose pour euh… pour
comprendre ce thème-là ou autre etc. ». Tu vois c’est aussi cette notion, quand j’ai commencé
à rentrer en études de, de, de, danse, que euh… enfin même avant en fait avec les arts
plastiques etc. que je commençais vraiment à m’intéresser à l’Histoire, à prendre conscience
de « ah oui, ok, à telle période il se passait ça, et d’un point de vue socio-économique, etc. ».
Mais en tout cas, parce que moi je suis allée dans ce… enfin, là je m’intéressais à Picasso par
exemple, et bien j’comprenais ce qui se passait autour etc. mais d’un autre point de vue je le
comprenais pas, j’arrivais pas à faire les liens. Donc c’est d’essayer à chaque fois de trouver
pour euh… différentes encore une fois, de susciter en fait l’apprentissage euh… si quelqu’un
va réfléchir par la géographie, et bien qu’est-ce qui va se passer à tel endroit etc. et pourquoi.
Moi : D’accord. et donc, quand… est-ce que par exemple vous organiser des, des réunions,
est-ce que vous vous retrouvez régulièrement avec les intervenants, faire le point avec les
intervenants ?
Elisa : On veut développer ça, on veut développer ça. C’est encore difficile.
Xavier : C’est encore difficile.
Elisa : Et on se laisse aussi euh… là c’est-à-dire c’est une nouvelle équipe qui prend vraiment
place et euh… j’crois que… enfin la manière dont on voit les choses c’est qu’on a envie qu’ils
prennent possession déjà, et qu’on arrive à un moment donné on fera un point, mais peut-être
que vers la fin. On se laisse peut-être aussi, enfin j’ai envie vraiment qu’ils s’expriment aussi.
Xavier : Mais tu veux dire qu’on se réunit dans l’objet, dont l’ordre du jour serait lequel ?
Moi : En fait, tout simplement savoir s’il y a une collaboration entre vous tous par exemple
dans… le jour où vous avez eu l’idée de créer des ateliers artistiques multilingues, voilà, est-
ce que c’est né d’une réflexion collective, est-ce que vous en parlez régulièrement. Par
exemple est-ce que vous voyez Mehregan et Hélène, ensemble ou séparément ? C’est
vraiment au sens large en fait…
Elisa : Moi j’me connecte pas mal avec elles par mail beaucoup. En fait on se suit tout le
temps, notamment sur le projet pédagogique aussi de fin tu vois, au-delà de Mehregan moi je
voulais aussi que Hélène puisse participer autant en fait à l’évènement du 30 mai et également
initialement j’voulais aussi que le chant puisse y participer, donc là avec un public adulte tu
vois, avec Ritz. Et de créer cette évènement voilà, vernissage, etc. mais peut-être avec des
animations autour selon les capacités de chacun, les qualités de chacun, c’est pas
foncièrement la capacité. Mais que, en fait, Hélène se joigne à Ritz avec le chant, avec les
enfants, avec la chorale de Ritz etc. qui pouvait être aussi un moment de représentation, un
moment de mise en ambiance, voilà. Que Alexis, parce que je l’ai exclu du projet parce qu’en
fait il a arrêté avec les enfants, parce qu’il y a un enfant qui a arrêté etc. et donc c’était trop
peu. Mais initialement il faisait aussi partie du projet pour relier l’idée de soit interviewer les
enfants etc. Donc c’est aussi toujours en fait créer une dimension qui fasse qu’ils vont
normalement, les intervenants doivent aussi être indépendants et en même temps autonomes à
se retrouver et à aller chercher un travail en commun. Même s’ils travaillent séparément, qu’il
y ait des liens qui puissent se faire. Ça c’est un souhait quand même réel, c’est une nouvelle
place aussi pour nous et…
257
Xavier : ... de nouvelles compétences à apprendre aussi…
Elisa : … des nouvelles compétences à apprendre à manager, hein, on a aussi un projet
pédagogique où moi j’le fais sur l’école etc. mais que là, des fois entre nos attentes et aussi où
en sont les intervenants dans leur démarche, cette notion aussi moi de restitution j’l’ai
acquise, enfin voilà ça fait partie de mon travail tout le temps. Eux l’ont mais peut-être pas de
la même manière parce qu’Hélène elle est débutante en fait malgré tout dans son domaine,
Mehregan par rapport aux enfants, c’est pareil, le travail de restitution n’était pas forcément
quelque chose qu’elle mettait en avant, donc il y a tout un travail à approfondir. Euh…
l’année prochaine tu vois dans l’idée c’est vrai que c’est d’se dire, idéalement, ce serait de
pouvoir vraiment, vraiment essayer de ficeler le projet pédagogique dès le début de l’année et
de fin d’année aussi et,…
Xavier : Le prendre comme un objectif pédagogique ?
Elisa : Ouais mais pour moi c’est toute la complexité parce que c’est d’abord l’apport du
présent, ou de ne pas s’enfermer non plus, enfin des fois, moi de projeter à neuf mois, dix
mois… ça me bloque aussi. Parce qu’on est... enfin ça fait partie aussi du lieu où on ne sait
pas les rencontres qui vont, enfin voilà, qui vont se faire, et les projets peuvent bouger. Donc
c’est d’abord une lignée, un minimum, mais que au fur et à mesure moi avec l’expérience,
mes termes arrivent de plus en plus tard. Mais ça veut dire qu’il faut aussi avoir, sans
prétention, beaucoup plus de confiance en soi pour pouvoir mener un projet sur un temps plus
court, enfin, dans la préparation, c’est de se laisser, d’avoir au fond son fil rouge, mais dans la
manière de construire sur trois-quatre mois seulement, c’est pas forcément évident pour tout
le monde. C’est pas forcément… voilà. Il y a… enfin j’pense que là il faut de l’expérience
aussi. C’est avec le temps qu’on peut réussir…
Xavier : … à mieux le vivre.
Elisa : A mieux le vivre, euh… mais c’est aussi dans le rapport de, de, d’être le plus…
Xavier : Sensibles.
Elisa : Sensibles et ouverts avec… aux réponses des enfants. C’est dans le sens où on a un fil
rouge, on transmet, l’enseignant il a ses idées, il a sa structure. Mais qu’en même temps il faut
avoir, enfin… il faut être en échange et euh… avancer avec ce que nous donnent aussi les
enfants. Et ça, ça peut bouger en fait énormément entre un enfant qu’est en début d’année et
cinq mois après c’est plus le même, donc on peut pas rester figés. J’sais pas si j’suis…
Xavier : Bah parfaitement, en fait tu… tu donnes deux phases, tu donnes une première phase
de ton année de mise en mouvement sympathique, d’exercices etc…
Elisa : De découverte, enfin, on est tellement, on apprend à se connaitre.
Xavier : Et une fois que les enfants sont en mouvement et que c’est le temps de la création,
par leur engagement ils donnent les informations qui constituent la matière première en fin de
compte de la création. Toi dans ton boulot de directrice artistique…
Elisa : Hmm, et en fait c’est ça maintenant je m’aperçois aussi c’est que j’m’arrête plus qu’à
l’école de danse, mais c’est que j’élargis en fait, et même sans avoir les enfants du coup euh…
258
C’est vrai que j’ai une autre manière d’appréhender les choses où j’dois être en fait tous
azimuts ; j’dois capter en fait ce qui s’passe par les dires de Mehregan, d’Hélène, de sentir,
des parents, parce que je les croise les enfants tu vois, aux intercours ou autre, et puis y’en a
que j’ai aussi dans mon cours pour beaucoup, qui font aussi des deux. Donc euh… je capte
tout ça, plus le déroulement du projet euh… de l’Atelier, enfin voilà. On est dans la
cohérence. C’est-à-dire du coup le spectacle de danse on est dans la visite d’une exposition,
c’est une galerie et les enfants on va travailler sur les, sur les artistes qui ont exposé, et chaque
groupe en fait on va représenter un tableau euh… des artistes et voilà ce sont des tableaux qui
vont prendre vie. Donc les parents d’élèves, voilà, on imagine que le spectacle c’est qu’ils
rentrent dans une galerie et… voilà. Donc Mehregan, on va travailler sur Mehregan, on va
travailler sur Gwenaëlle, on va travailler sur Mr Zion, etc. etc.
Moi : D’accord.
Elisa : Donc euh… les enfants sont imprégnés aussi du lieu, de ce qui s’y passe. Ce sera pas
ça tous les ans mais c’est aussi pour à chaque fois en fait, là j’crois que c’est important pour
moi…
Xavier : Mettre à l’honneur le mouvement d’année, non ?
Elisa : Oui, de travailler en fait ce qui est nous-même à l’honneur dans notre travail et que tout
le monde se rendent compte de ce qui se passe, de cet exercice de travailler les uns avec les
autres, d’une manière ou d’une autre. Et puis ça engage aussi les artistes aussi dans notre
travail amateur. C’est-à-dire que M. Zion il va… voilà il va finalement certainement avoir en
fait un investissement dans le spectacle, par un travail, je sais pas, ce sera peut-être sur
l’affiche, bah voilà. Qu’il y ait toujours, toujours un lien les uns aux autres.
Moi : D’accord. Et quels retours vous avez jusqu’à aujourd’hui des enfants et des parents,
j’pense spécifiquement pour les ateliers artistiques multilingues, mais peut-être de manière
plus large, pour les ateliers pour les enfants, quels retours vous avez ?
Xavier : On sent les parents plus investis. Euh… J’crois que ça c’est une phase assez
nouvelle.
Elisa : Oui, dans le respect aussi de c’qu’on…, de nos métiers.
Xavier : Avant on avait pu percevoir la mise en mouvement des enfants, tu vois que c’était
plus vivant etc. Euh… ouais j’crois qu’c’est ça les gros retours. Après euh… voilà, c’est
l’épanouissement des enfants, c’est difficile à…
Elisa : Bah si, enfin moi j’le vois euh… l’épanouissement des enfants quand même euh… bon
j’ai l’impression qu’ils se sentent,… c’est un peu une deuxième maison, il y a quelque chose
comme ça. J’trouve. Dans le… dans leurs manières de… bah de s’ouvrir justement en fait
aussi… à l’autre.
Xavier : Oui.
Elisa : Du respect, du…
Xavier : …lâcher-prise aussi.
259
Elisa : Oui puis de, enfin de prise de confiance en soi. Je trouve. J’vois Victor euh… que des
fois j’vais chercher aussi euh… au début il était très très très introverti, et euh... enfin voilà,
maintenant il est dans un échange euh… bah entier, enfin. Donc c’est dans le rapport à l’autre
aussi vraiment. Sur la langue je sais pas forcément. Moi j’les vois pas dans ce cadre. Du coup
c’est vrai qu’c’est après aussi avec... c’qui peut être aussi intéressant peut-être c’est aussi de
se confronter aux parents ?
Silence.
Xavier : Après pour avoir des retours.
Elisa : Pour avoir des retours qui seraient peut-être intéressants ?
Moi : Alors moi j’ai préparé, j’ai commencé à préparer un questionnaire de mon côté pour me
permettre d’avoir une vision un peu plus claire en fait des enfants qui viennent dans les
ateliers, qui ils sont et tout ça et il y a une partie effectivement sur leurs attentes et ce… voilà,
quels retours ils ont de leurs enfants et qu’est-ce qu’ils veulent dire aussi sur ce qui se passe
dans les ateliers, est-ce que ça répond à leurs attentes, est-ce qu’ils ont des suggestions etc. Je
l’ai pas encore terminé mais je comptais vous en parler à la fin de l’entretien, en sachant que
je vous l’aurai transmis avant de le diffuser d’une part pour avoir votre accord, et aussi pour
me dire si vous vouliez, soit en profiter pour ajouter des questions qui vous, vous intéressent
aussi, que ce ne soit pas un recueil de données simplement pour moi mais si ça peut vous
servir…
Elisa : Oui. Au contraire, c’est intéressant.
Xavier : C’est intéressant.
Elisa : Oui, tout à fait.
Moi : Oui, au contraire, parce que plutôt que de leur donner deux questionnaires dans l’année,
il y a aussi ce côté-là de regrouper euh…
Elisa : Oui, bien sûr, oui parce qu’en plus de ça nous on s’est souvent posé la question, moi
j’ai jamais osé le faire parce que je trouve ça toujours très délicat et euh…
Xavier : Mais c’est un objet d’étude qui est assez…
Elisa : Mais que, voilà, dans l’objet d’étude, d’autant plus parce que ça aussi ça fait partie de
ce qu’on peut transmettre aux parents, que l’on est aussi dans cette démarche aussi
d’accueillir des personnes en formation et que du coup ça nous permet nous aussi de continuer
notre réflexion etc. etc. et que… voilà, ça fait partie de…
Moi : Tout à fait, d’accord. Et bien écoutez, moi je crois que j’ai fait le tour de mes questions.
Il en reste quelques-unes mais c’est des choses qu’on avait déjà abordées ou vous y avez déjà
répondu d’une autre manière sur d’autres questions ; alors après je ne sais pas si vous avez des
choses à rajouter, s’il y a des choses que vous vouliez me dire…
260
Xavier : P’t-être qu’il y a quelque chose qui pourrait t’intéresser : en ce moment j’suis sur le
projet des temps périscolaires et pour ce faire j’réponds là à l’ordre du jour d’un mail euh… et
dans… euh… les points en fin de compte, c’est un bilan, et dans le bilan j’approche le bilan
sur l’engagement d’une certaine manière.., de deux manières. Et notamment une où je
m’entête à rechercher une… un spectre type des phases de l’engagement entre un apprenti et
un éducateur et de mettre en symétrie euh… notre méthode par rapport à ça. Donc le vecteur
de notre méthode avec comme point de départ nos valeurs euh… qui euh… qui vont vers le
point final : la relation contextuelle et euh… et dont le… et dont la force de notre méthode
seraient nos objectifs pédagogiques, qui seraient euh…pour ce que je.... en tout cas j’ai…
c’est une étude en cours hein… En fin de compte on aurait axés sur nos valeurs ce travail-là,
cet objectif pédagogique. Donc cette recherche aussi m’amène aussi à découvrir si tu veux,
j’vais faire une étude, je pose les questions, ça passe en validation mais euh… ça revient un
peu sur ce qu’on parlait tout à l’heure, c’est-à-dire que la… l’imagination, on peut s’imaginer
être auteur de soi-même, de stimuler un enfant à s’évaluer dans des contextes imaginaires
dans le futur etc. Là quand on le fait, on transmet avant tout des valeurs démocratiques de
respect, de solidarité dans l’apprentissage, etc. Tu vois d’éducabilité de chacun en fait. Quand
on a envie de discuter avec un enfant, comme tu imagines, la manière dont tu t’y prends, il est
conscient que tu es l’éducateur si tu veux, mais il est conscient aussi que tu es intègre ; tu as
des plus, tu as des moins. Ça renvoie un miroir de lui-même où il a le droit d’avoir des plus et
des moins mais que l’idée c’est de… en fait c’est un… sur chaque valeur, de travailler un
objectif pédagogique clair qui puisse en fin de compte, comme une courroie de distribution –
j’sais pas si ça peut être comme ça mais enfin-, chaque valeur avec son objectif
pédagogique… […] puisse travailler chaque phase euh… du euh… c’est du spectre, des
phases de l’engagement entre un apprenti et un éducateur.
Moi : D’accord. Et ces objectifs pédagogiques là après c’est pour être euh… on va dire définis
à l’échelle de l’Atelier du Coteau ou c’est pour quelque chose de plus précis ?
Xavier : En effet ce travail, il sera certainement euh… bah sur le chemin quand tu continues à
avancer tu gardes le blé en trop quoi. Et donc euh… oui, j’pense qu’au final c’est un travail
qui est voué à… devenir interne…
Elisa : Interne et avec… mais dans l’idée c’est un souhait nous de... de le proposer et de le
diffuser.
Xavier : Oui, après c’est l’histoire de le diffuser. C’est une réflexion d’étude qu’on a et on
veut euh… la démontrer qu’elle est valable et la demander à mettre en expérimentation
humaine dans un groupe de travail particulier… dans… les temps périscolaires, avec des
objectifs qu’on veut essayer d’être le plus clairs possibles, d’avoir une visibilité
opérationnelle, cohérente etc. De s’en remettre à ne pas faire, et dans s’en remettre à plus tard
après avoir commencé à le faire, d’essayer de… va falloir trouver des méthodes de sondage,
d’évaluer des… des plus-values si tu veux en fin de compte sur la création de cette méthode
pour la valider, et puis voilà, en passant par des phases classiques tu vois.
Elisa : Parce qu’on est confrontés quand même à…. A des choses euh… par rapport au
périscolaire en fait euh… le cadre n’est absolument pas idéal pour les interventions. Ça se
passe le midi en général les intervenants ont deux, deux groupes sur trois-quarts d’heure, mais
dans ce temps de trois-quarts d’heure en fait, il y a le temps de… rassembler les enfants etc.,
de faire l’activité et de… terminer l’activité etc. Donc ils ne sont des fois entre 25 et 30
261
minutes à peine euh… pour euh… pour agir avec eux. Donc euh… il y a un inconfort
certain…
Xavier : … mais on fait avec l’existant.
Elisa : Voilà.
Xavier : Ça c’est le sens…
Elisa : Donc c’est de dire de toute façon pour l’instant voilà il y a pas de choix, ils
interviennent dans les classes, ils n’ont pas forcément les moyens, le matériel, etc. Enfin il y a
tout plein de contraintes et donc euh… le problème aussi c’est que… ils… ils n’ont pas
forcément les outils aussi pour… comment dire ?
Xavier : … pour faire autrement, ils font dans leur jus du quotidien.
Elisa : Oui voilà, c’est ça !
Xavier : Puisque de toute façon la machine elle va pas…
Elisa : Elle va pas s’changer du jour au lendemain… et du coup nous on réfléchit à ça par
notre expérience, par les retours de Mehregan etc. On étudie aussi… enfin voilà… Par le
retour aussi des référents périscolaires qui ont eux aussi leur mot à dire, qui sont eux aussi
dans leurs contraintes etc. Et bah voilà on s’est mis à réfléchir pour essayer de… pourquoi pas
proposer des solutions ou des réflexions pour faire évoluer les choses. Après on a… on a peut-
être pas encore toutes les clés en main mais en tout cas Xavier euh… travaille énormément
dessus pour essayer de… de rendre les choses en tout cas possibles.
La conversation se poursuit ensuite pendant une petite demi-heure autour du travail de Xavier sur les
problèmes rencontrés dans le cadre des interventions de l’Atelier du Coteau dans les écoles sur le
temps périscolaire. Même si cette conversation s’est révélée très intéressante pour approfondir notre
compréhension des valeurs de l’association et de ses ambitions au sein des écoles, nous arrêtons la
transcription de l’entretien ici car les éléments qui nous semblaient les plus importants et liés au
contexte de notre recherche ont été abordés et transcris dans les pages précédentes.
262
Annexe 8.2 : Entretien de Mehregan Kazemi, artiste plasticienne
animatrice des AMP et tutrice de stage
L’entretien s’est déroulé mercredi 25 mars après l’atelier, c’est-à-dire entre 18h et 19h. Nous nous
sommes installées dans la pièce où se déroulent les AMP, Mehregan assise sur une table basse en tailleur et moi
sur un petit tabouret auprès d’elle.
Moi : Alors... Petit entretien. L'objectif c'est pour moi de mieux comprendre d'où tu viens, tu
vois, ce que tu as fait jusqu'à arriver à aujourd'hui… Et comment tu travailles ici et comment
tu te sens dans ce travail-là. En gros. Et on terminera par … une petite série de questions toute
bêtes, sur les langues et les cultures en générale… Et ta relation avec ces langues et ces
cultures. C'est tout. Donc ça n'a rien d'extraordinaire tu vas voir... S'il y a une question que je
te pose, tu ne la comprends pas ou quoi, surtout tu n'hésites pas à m'arrêter, s'il y a des choses
tu veux pas répondre parce que tu n'es pas à l'aise... Tu peux soit ne pas répondre, soit tu me
dis je veux bien te répondre mais par contre je peux ne pas le mettre dans le mémoire si tu
veux, enfin voilà …
Mehregan : D'accord
Moi : … C'est … tu restes chef de l'entretien. Voilà. Donc, si on commence … Moi je propose
plutôt qu'on commence par ton parcours, jusqu'à ce que tu sois arrivée à l'Atelier du Coteau si
tu peux me dire un peu…
Mehregan rit
Moi : … dans les grandes lignes tu vois ... Dans ta formation, euh … enfin voilà, comment tu
en es arrivée jusqu'à travailler dans les ateliers multilingues de l'Atelier.
Mehregan : Oui. Bon moi euh … Quand j'avais 15 ans, j'ai travaillé en fait j'ai commencé à
travailler avec une NGO... euh … dans laquelle en fait c'était, on était plutôt les uns … on
était tous des jeunes qui étaient là pour apprendre des choses tu vois, et donc à la fin on faisait
des petits, des stages pour mettre euh … En fait c'est, à la base c'était des, des … une
formation, donc c'était en Iran, sur, en fait sur le fait qu'il n'y a pas de différences entre les
femmes et les hommes, les hommes… Et un petit peu sur les choses culturelles, tout ça, et à la
fin on a fait un gros événement, en faisant, en fait, ... euh … en réunissant les enfants de
...moyen famille … on dit famille … de moyenne classe...
Moi : Oui d'accord, des familles de classe moyenne.
Mehregan : …de classe moyenne, donc par exemple des riches ou des pauvres tu vois, on a
fait un gros événement avec ces enfants-là, et on les a fait jouer ensemble par exemple tu
vois ... ça c'était, en fait, je commençais avec cette euh ... formation, plus tard j'ai travaillé
avec encore un autre NGO...
Moi : alors NGO, excuse-moi je te coupe, c'est quoi ?
Mehregan : OGN vous dites, je sais plus …
Moi : Ah, une ONG ! D'accord ok, excuse-moi. Je vois. Donc tu as commencé...
263
Mehregan : une organisation privée plutôt.
Moi : Oui, d'accord, ok.
Mehregan : Euh ...oui, j'ai commencé à 15 ans avec cette formation, en Iran, et puis j'ai … en
même temps, je pense, 16 ans je pense... 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à travailler une autre
organisation qui s'appelait euh … Les Enfants de la Rue...
Moi : D'accord
Mehregan : L'autre c'était les Enfants de la Paix, et celle-là c'était les Enfants de la Rue. Donc
on donnait des cours …euh … Et j'ai travaillé là-bas pendant, je sais pas, depuis mes 15 ans
jusque … 23 ans, un truc comme ça. On donnait des cours aux enfants qui étaient obligés de
travailler dans la rue, parce que soit ils avaient des familles très riches, soit ils avaient des
familles, les parents addicts qui travaillaient pas, qui forçaient leur enfant de travailler, soit
c'étaient des enfants sans papiers, même si ils étaient iraniens ils n'avaient pas de papiers, à
cause de … à force de … euh … à force d'avoir, je sais pas, une famille qui était hyper …
pauvre sur la culture, au niveau de culture machin ; soit des enfants Afghans, qui n'ont pas
droit d'aller à l'école … à l'école en Iran. Ils ont le droit d'aller, mais juste aux écoles privées.
Il faut payer beaucoup d'argent, mais pas les écoles publiques. Donc là, je travaille là-bas, je
donnais des cours euh … arts, et c'était un petit peu art-thérapie pour, surtout pour savoir ce
qu'il se passe dans leur vie, comment ça avance, comment euh .. qu'est ce qu'il font, tu vois. Et
puis, je donnais à un moment des cours de langues aussi ... Et puis je suis venue en France, j'ai
étudié la langue ici direct, je connaissais pas du tout la langue en France … euh c'était 2010
que je suis venue ici. Puis j'ai étudié l'art contemporain et les nouveaux médias à Paris VIII.
Moi : D'accord
Mehregan : Et j'ai passé mon, ... j'ai finis mes études en 2013, on est venu à Nantes, et je
suis ... avec Alexis on a posé notre dossier en fait … parce qu'en fait on a commencé à
travailler bénévoles avec l'Atelier et tout ça, et vu qu'on a une compagnie et tout, euh, moi
j'aimerais beaucoup travailler avec les enfants et tout, et ça … En fait vu que je suis étrangère,
et que je parle par exemple d'autres langues tout ça, j'ai trouvé ça hyper sympa et Elisa aussi
pour que je puisse donner des cours ici.
Moi : D'accord ok. Et tout à l'heure quand tu disais que tu donnais des cours en Iran c'était des
cours de quoi ? Tu faisais des cours de langue ?
Mehregan : De langue oui. Je donnais des cours d'arts, par exemple photo, ou arts, arts
plastiques, et je donnais des cours … Ça c'était plutôt une sorte d'art, d'art …
Moi : D'art thérapie oui ça tu m'as dit, et pour les langues, c'étaient quelles langues en fait ?
Mehregan : Et les langues c'était anglais et perse, parce que eux ils n'avaient même pas ... tu
vois ?
Moi : Oui, ils ne connaissaient pas le, le perse d'accord.
Mehregan : Ils connaissaient mais ils connaissaient pas la littérature, enfin ils ne savaient pas
lire tu vois, c'était ça en fait ils ne pouvaient pas aller à l'école donc cette organisation était
264
sensée être une école pour ces enfants-là, qui ne pouvaient pas aller à l'école.
Moi : D'accord, donc tu leur apprenais à lire le perse, en fait …
Mehregan : Par exemple à lire, et anglais aussi …
Moi : Et l'anglais. D'accord ok, je comprends... Ça marche. Donc tu travailles à l'Atelier du
Coteau depuis quand ?
Mehregan : 2013... Octobre 2013.
Moi : 2013, d'accord. Et tu t'occupes des activités multi-activités multilingues depuis 2013
aussi ?
Mehregan : Oui
Moi : D'accord … ok.
Mehregan : Et je fais des ateliers d'arts plastiques pur aussi.
Moi : Ouais, et tu fais les ateliers d'arts plastiques pur... alors, là du coup je vais peut-être plus
te poser des questions liées aux ateliers multilingues parce que c'est plus ce qui … bah tu vois
par rapport à l'angle de mon travail ça correspond plus … mais c'est pas pour autant que je
mentionne pas le fait, dans mon mémoire que tu travailles aussi en arts plastiques pur tu
vois... Mais ça on pourra revenir dessus un peu après si tu veux... Si tu devais résumer en gros
ce que tu fais dans les ateliers artistiques multilingues, comment tu … le résumerais
justement ?
Mehregan : En fait ces ateliers-là sont destinés pour faire apprendre aux enfants les cultures,
les langues les accents différents du monde. Et le fait que je sois d'un pays étranger, eux ils
voient toujours tous les jours que voilà, il y a un étranger qui parle français, qui peut faire des
fautes, avec un accent mais voilà, c'est pas choquant quoi. Qui parle d'autres langues aussi. Et
là, on travaille, je travaille surtout sur l'art plastique avec eux … euh … En fait le thème c'est,
en fait bon voilà c'est les ateliers multi-activités multilingues, mais je suis plutôt concentrée
sur l'art plastique... Je travaille beaucoup sur les imaginations …euh ... On chante, par
exemple dans l'art, je travaille beaucoup sur les imaginations, au début on a travaillé sur un
petit peu l'histoire d'art, de l'art... et … dans les ateliers multi ... multilingues, on fait des
chansons, par exemple en perses la langue que j'ai, je connais mieux quand même, on fait des
chansons en perse, on fait des chansons en anglais, et … on essaye de faire une performance
avec, bouger avec ces chansons-là. Pas forcément une performance, mais on reste pas assis,
au début on reste assis pour apprendre la chanson mais au fur et à mesure on essaye de … de
danser ou peut-être je ne sais pas de faire … un mouvement avec ces chansons-là.
Moi : D'accord ok
Mehregan : Et … qu'est-ce que …
Moi : Bah c'est ça en fait. L'idée c'était que tu résumes ce que tu fais dans les ateliers, si tu
devais, tu vois, quelqu'un qui connaît pas, ou la manière dont tu résumerais ce que tu fais... Tu
vois autre chose, que tu aimerais ajouter qui te semble important dans un résumé …
265
Mehregan : Attends je réfléchis … C'est sur la culture j'ai dit, sur la langue … euh … sur
l'art … pouvoir s'exprimer, travail sur l'imagination ... toujours par exemple deux langues ou
trois langues différentes, en essayant d'utiliser d'autres langues différentes, les chansons …
euh, les installations … voilà.
Moi : Ok. Et est-ce que, donc, mis à part ce dont tu m'as parlé déjà dans ton parcours jusqu'à
ce que tu arrives ici, et ta formation à Paris VIII, est-ce que tu as eu une formation vraiment
spéciale pour pouvoir animer ces ateliers-là, ou tu as pu commencer comme ça … ?
Mehregan : Non, en fait j'ai passé comme je t'ai dit là… En fait j'ai passé une formation quand
j'avais 15 ans pour pouvoir travailler avec des enfants et tout ça mais c'est des formations dans
lesquelles on étaient bénévoles en fait, on travaille derrière toi, et donc c'était pas une
formation... après laquelle tu peux avoir un diplôme, c'est vraiment des choses, des choses
bénévoles, mais si j'ai travaillé, au niveau d'expérience j'ai beaucoup travaillé avec les enfants,
surtout avec les enfants ... euh… en difficultés… Euh oui … Et j'ai mon diplôme en art… en
art. Mais c'est plutôt l'expérience… c'est par expérience que j'ai beaucoup travaillé avec les
enfants, machin…
Moi : Donc en fait avant toi à l'Atelier du Coteau, y avait personne qui faisait de … en fait
c'est pour savoir si avant ces ateliers là …
Merhegan : Avant moi aussi s’il y avait quelqu'un ?!
Moi : Bah … est ce que quelqu'un faisait du multilingue aussi avant toi ici ?
Merhegan : Oui oui oui, la famille [ ?]. Qui faisait les ateliers plutôt anglais.
Moi : Ouais, mais je veux dire en multi-activités là comme tu fais plus le coté arts plastiques y
avait pas ?
Mehregan : Si si. En fait il y avait moi par exemple je travaillais juste les jours où il y avait
le… multilingue arts plastiques. Arts visuels, on les appelait. Donc je venais juste le vendredi
où il y avait cet atelier là … Je participais en fait avec … et après il y avait deux intervenants,
c'est une famille anglaise francophone...euh ...mais eux ils étaient plutôt concentrés sur
l'anglais …
Moi : Ouais, sur l'anglais, c'était sur le théâtre, c'est ça ?
Mehregan : Non, c'était la musique plutôt.
Moi : Plutôt la musique, ah oui d'accord. Ok.
Mehregan : Et ils essayaient de faire des choses différentes mais …
Moi : Ok. Donc tu n'as pas reçu de … enfin, ou tu n'as pas suivi un truc juste spécial, juste
pour faire ces ateliers-là ?
Mehregan : Ah si, en fait la … l'année dernière, c'était, cette année … c'était un stage que j'ai
passé mon … En fait j'ai commencé ici en forme d'année stage.
266
Moi : D'accord ok, tu as commencé en stage, ok.
Mehregan : J'ai commencé en stage pour apprendre un petit peu les, les enfants … en fait pour
connaitre les enfants, les types des enfants qui viennent ici, et c'était mon année stage
universitaire en même temps mais …
Moi : D'accord ok
Mehregan : J'ai passé deux mois en fait deux mois au début j'avais, j'ai passé... En fait j'avais
un stage de trois mois, mais après deux mois, Elisa elle nous a proposé de travailler avec
eux … donc après, quand mon année stage était finie je suis quand même restée pour pouvoir
améliorer mes connaissance sur les enfants, sur les ateliers...
Moi : Donc ça c'était un stage que tu devais faire pour Paris VIII ?
Mehregan : Oui oui, exactement
Moi : D'accord, ah ouais ok
Mehregan : Mais ... c'était que trois mois mais je suis restée plus …
Moi : Tu es restée après …
Mehregan : … pour … Alexis il venait de temps en temps, pour … pour pouvoir apprendre …
Moi : Et du coup pendant ce stage-là, tu ... observais quoi ?
Mehregan : En fait moi j'étais … en fait c'était à moi de faire les ateliers d'arts plastiques.
Moi : D'accord ok. Donc tu étais directement dans l'action en fait …
Mehregan : Oui, j'étais dans l'action. Par exemple trente minutes au début on travaillait par
exemple, je sais pas moi on chantait on faisait des trucs, et après … c'était un atelier qui durait
une heure, comme normal. Et les premières trente minutes c'était pour faire, je sais pas, des
chansons, des … ouais c'était des chansons et de la musique, et les trente minutes, la
deuxième trente minutes, la …
Moi : Oui si si ça se comprend. La deuxième demi-heure en fait
Mehregan : La deuxième demi-heure, c'était sur l'art, l'art visuel.
Moi : Ok d'accord. C'est bon, je situe. Ok. Et, quand tu … là... donc là, en tant que travailleuse
dans les ateliers multilingues, est ce que …
Mehregan : Si il y a des choses qui ne sont pas clairs, que tu as besoin de moi …
Moi : Oui, je te repose les questions comme on a fait, y a pas de souci. C'est juste pour
continuer un peu à comprendre comment tu travailles. Est-ce que, les ateliers tu les prépares
complètement seule, ou est-ce que ça t’arrive des fois par exemple d'avoir, vous vous voyez
267
avec Hélène, qui anime aussi d'autres ateliers multilingues ? Pour préparer des choses ou …
Mehregan : Ça n’arrive pas souvent, mais par exemple pour la fête du feu on a fait un atelier
ensemble, tu vois. On a fait un atelier ensemble mais … ça n'arrive pas très souvent.
Moi : D'accord. Donc tu prépares plus … là les ateliers que tu fais au jour le jour, c'est plus
toi, chacune de votre côté en fait, plus. A part quelque fois, où vous vous retrouvez pour faire
quelque chose en commun. D'accord, ok. Et est-ce que ça t'arrive des fois par exemple d'avoir
des réunions avec Elisa et Xavier, tu vois un peu sous forme de coordination pour comprendre
ce qu'il se passe, enfin, ce que vous faites dans les ateliers.
Mehregan : Ça ça arrive, et puis, de temps en temps, là depuis que tu es venue Alexis il n'est
pas venu parce qu'il a commencé sa résidence mais de temps en temps on anime des ateliers
ensemble tu vois... Pour changer un petit peu.
Moi : Et dans les réunions avec Elisa et Xavier par exemple vous voyez quoi ensemble ?
Mehregan : Bah … là on fait beaucoup moins, parce que … là ils connaissent ma façon de
travailler, tu vois, mais au début par exemple, avant que les cours commencent on a fait une
réunion pour que moi j'explique ce que je pense et ce que j'aimerais bien de, de faire
progresser dans les ateliers, ateliers multilingues, et puis, quand c'était commencé, j'en parlais,
si ça se passait bien, est ce que, si, tu vois, si j'avance bien sur des projets que j'avais dans la
tête et tout... Mais là on fait plus en fait.
Moi : Ouais, c'était surtout au départ en fait, le temps de te lancer... Ok. Ça marche. Alors, je
voulais rediscuter d'un truc avec toi, mais on en a déjà parlé ensemble, c'était, là je rentre un
peu plus dans le cœur du sujet... On avait parlé de la différence entre éveil et apprentissage, et
tu me disais que toi ce qui était important c'est vraiment l'éveil, tu recherchais pas
spécialement l'apprentissage. Est-ce que tu pourrais … définir ce que c'est pour toi ces deux
choses-là, pour toi en quoi c'est différent, et …
Mehregan : On en a parlé …
Moi : On en avait déjà parlé oui
Mehregan : Donc tu pourrais, en fait ... S’il y a des choses que je dis pas et j'avais dit avant tu
peux les remettre.
Moi : riant Oui oui.
Mehregan : Bon l'apprentissage c'est comme les ateliers ...vivants... De langues vivantes, tu
vois. On est là pour apprendre une langue, on est concentré pour apprendre bien parler une
langue, apprendre la grammaire, le vocabulaire... et voilà, tu vois ? Mais un éveil … c'est
plutôt pour faire réveiller quelque chose … éveiller, éveiller quelque chose tu vois ? Pour …
pour montrer aux enfants que … y a pas que la France, y a pas que cette langue, y a d'autres
langues, y a d'autres cultures, y a d'autres accents, y a les gens qui habitent dans les autres
pays qui ne sont pas forcément de ce pays-là tu vois. L’éveil aux langues c'est un petit peu
mettre l'enfant en face de, d'autres cultures et d'autres langues, pour moi. C'est pas forcément
que, ils ne sont pas obligés quand ils sortent des ateliers, ils ne sont pas obligés de savoir
parler, machin, mais, au moins dans leurs têtes, ils savent que, là, ça existe des choses, de,
268
telles choses ou telles chose ou telles choses dans les autres pays, y a des cultures
différentes ... voilà.
Moi : Est-ce que c'est une sorte d'opposition que tu fais entre les ateliers et l'école par exemple
quand tu dis apprendre une langue c'est plutôt, voilà, être concentré, la grammaire le
vocabulaire tout ça, ou c'est … ou non c'est juste une distinction que tu fais entre les deux
mots, ou est-ce que pour toi ça renvois vraiment à deux … deux milieux différents ? En fait,
tout à l'heure quand tu m'as expliqué les différences entre éveil et apprentissage, au départ tu
as commencé par l'apprentissage, et tu as dit que c'était ...
Mehregan : Apprendre vraiment … apprendre à parler une autre langue.
Moi : Voilà. Mais tu te ref... Quand tu as un … Qu'est-ce que tu as en tête en fait quand tu …
quand tu parles de l'apprentissage, au niveau des lieux, par exemple, est ce que tu penses que
l'Atelier du Coteau ça peut être un lieu d'apprentissage aussi ou c'est plutôt réservé à l'école ?
Mehregan : Si, moi je pense que si… on a envie de créer des ateliers langue vivante comme
ça pour apprendre… pour faire apprendre… vraiment pour des ateliers apprentissage de
langues, c’est autre chose. C’est pas où on est là. Il faut vraiment se concentrer sur ça. Mais là
on fait plein de trucs, on fait plein d’activités. On a une heure et on est là plutôt pour… éveil
aux langues.
Moi : D’accord. Ok. Et donc quand tu…. Quels sont les objectifs que tu as en tête pour les
enfants dans ces ateliers-là ? Qu’est-ce que tu souhaites euh… Est-ce que déjà il y a des
choses que tu souhaites atteindre avec les enfants sur le plan artistique ou sur le plan des
langues et des cultures justement ? C’est quoi tes objectifs ?
Mehregan : En fait euh… sur euh… ça c’est difficile de…
Moi : Sauf si… tu peux ne pas avoir d’objectifs précis ?
Mehregan : J’en ai mais c’est hyper difficile de pouvoir les mettre euh… tu vois ce que je
veux dire ?
Moi : En mots.
Mehregan : En mots. Euh… Silence. En fait euh… c’est vraiment de l’éveil de langues quoi tu
vois. Moi j’aime bien le fait que les enfants à chaque fois, je sais pas si t’as remarqué, quand
ils partent avec des mots, en fait, pas for… tu vois par exemple surtout quand ils parlent par
exemple une autre langue, pas forcément anglais par exemple, parce qu’anglais c’est un petit
peu une pression sur les enfants tu vois. C’est hyper bien s’ils arrivent à parler tu vois. Moi si
j’ai un enfant un jour je veux bien qu’il parle anglais tu vois, ça c’est pas une question… Mais
le fait qu’il… anglais c’est une langue très connue. C’est pas très bizarre pour un enfant
d’entendre ça, tu vois. Mais une langue comme perse, persan, et le fait qu’ils se laissent… être
envisagés… on dit comme ça ? Ils se laissent envisagés ? Non.
Moi : Je vois pas ce que tu veux dire…
Mehregan : Ils se laissent aller avec euh… en fait ils se laissent aller…
269
Moi : Ils se laissent porter ?
Mehregan : Ils se laissent porter par cette langue, tu vois. Ils arrivent à apprendre. Ils
connaissent maintenant les cultures genre... ils connaissent les fêtes en perse, les fêtes
iraniennes, et ils arrivent à tenir tout ça dans la tête. Ça, je pense que c’est un objectif pour
moi, tu vois. Comment je peux te le dire…
Moi : Et sur le plan artistique par exemple ?
Mehregan : Mon but c’est vraiment l’imagination. D’améliorer les imaginations des…
l’imagination des enfants. Vraiment. Et après il y a plein de façons, il y a plein de… c’est, oui,
en art plastique c’est un peu une façon d’apprentissage aussi, mais on est plutôt concentrés sur
l’imagination. C’est ce qu’elle fait aussi par exemple Elisa en danse.
Moi : Oui, d’accord. Et est-ce que pour toi ça a un sens de mélanger… Enfin tu vois, entre tes
objectifs d’éveil aux langues comme tu dis et les… et l’objectif de développer l’imagination,
est-ce que pour toi il y a un lien entre ces deux choses-là ?
Mehregan : Carrément. Je pense qu’il y a un lien, on peut les mêler. Mêler facilement en fait.
Parce que l’imagination, pour apprendre une langue, pour aller… pour aller porter... se laisser
porter par une langue, c’est vraiment, on a besoin d’avoir une imagination qui nous laisse être
portés, tu vois ce que je veux dire ? Moi je trouve aussi ils sont vraiment liés. Il faut vraiment
essayer d’ouvrir l’imagination, d’ouvert vers tout, quoi, tu vois. Il faut pas,… en fait imagine :
quand je demande aux enfants de fermer les yeux, on est dans l’eau, on peut voir des voitures,
on peut voir n’importe quel truc dans l’eau, c’est notre monde à nous, c’est pas le monde qui
existe déjà, tu vois. C’est une porte qu’on essaie d’ouvrir.
Moi : Donc c’est une porte, là vers l’intérieur…
Mehregan : L’intérieur, la culture, la langue et tout ça, c’est une porte aussi. Il faut vraiment
pouvoir… Il faut… Silence. Il doivent vraiment essayer d’ouvrir cette porte-là pour pouvoir
accepter d’autres choses parce que c’est une question d’acceptation, on dit ça ?
Moi : Oui, si, si, d’acceptation.
Mehregan : D’acceptation. En fait pour l’imagination c’est la même chose. Est-ce que l’enfant
accepte de voir d’autres choses qui existent pas pour de vrai dans le ciel, dans le centre, tu
vois. C’est la même chose dans les langues aussi, dans les cultures. Est-ce qu’il se permet, tu
vois. Tu vois son esprit… Et est-ce qu’il se permet d’aller vers une autre langue, d’aller vers
autre chose…
Moi : Donc c’est faire tomber les frontières.
Mehregan : Exactement.
Moi : En soi et ensuite pour mieux aller vers l’autre en fait finalement.
Mehregan : Exactement.
Moi : D’accord, ok, je vois. Et alors comment tu prépares tes ateliers ? Est-ce que tu as ces
270
objectifs-là en tête et à chaque fois tu essaies de voir comment…
Mehregan : En fait si tu veux l’été… en fait on travaille pas beaucoup l’été, on a juste deux
petits stages. Là c’est le moment qu’on réfléchit beaucoup sur les ateliers. Je fais ça. Et donc
même j’ai un cahier à la maison, je dis voilà, cette période-là, je préfère faire ça… Et après,
dans la semaine, quand ça arrive cette date-là, ça m’arrive des fois que je change
complètement, hein. Par exemple, tu te rappelles je voulais travailler sur les portes
mexicaines, je me suis dit là je vais commencer plutôt sur l’imagination, tu vois. Donc là je
change un petit peu mais… Si à chaque fois, c’est normal on travaille un petit peu sur ce
qu’on veut faire le jour avant, mais moi je travaille du coup pendant l’été aussi.
Moi : Donc quand tu y penses, tu y penses par grands thèmes ou tu y penses avec des choses
assez précises, vraiment sur ce que tu as envie de faire faire aux enfants…
Mehregan : En fait je commence par les grands thèmes et après je rentre dans les détails.
Moi : D’accord, et là par exemple, ce que tu avais prévu et ce que tu fais là pour cette année,
tu es dans quels thèmes ? A part l’imagination est-ce que tu as d’autres choses plus précises
qui se sont dessinées ?
Mehregan : Non.
Moi : C’est vraiment l’imagination le gros euh…
Mehregan : Oui ça c’est le gros thème. En fait moi mon but c’est ça. Tu vois c’est vraiment
travailler sur l’imagination après apprentissage c’est important aussi, tu vois par exemple tu
vois comment on utilise la couleur, machin, machin,… Mais là pour euh… Là on est vraiment
concentrés sur l’imagination. En fait je sais pas, en fait c’est le thème un petit peu de l’Atelier
du Coteau aussi.
Moi : Oui, tout à fait, on en avait parlé avec Elisa et Xavier. C’est vrai. D’accord.
Mehregan : C’est pour ça qu’on s’entend bien. Alexis il fait la même chose au théâtre, tu vois.
Il travaille beaucoup sur l’imagination. Donc voilà.
Moi : Et comment tu sais que tu as atteint tes objectifs avec les enfants ? Qu’ils ont pu
développer leur imagination et tout ça ?
Mehregan : En fait avec ce qu’ils ont créé à la fin on peut un petit peu comprendre s’ils ont…
Il y a des enfants qu’on va… bof, ils ont pas vraiment suivis, même s’ils font un bon travail.
Mais il y en a… mais après il y en a tu vois ils ont bien compris tu vois. Mais normalement ils
arrivent bien… Parce qu’ils sont des petits enfants tu vois. En fait c’est l’âge où au niveau de
l’imagination ils ont pas vraiment de gros problèmes. Ils arrivent à se laisser partir tu vois. Tu
vois à cet âge-là ils ont un esprit très ouvert.
Moi : Et quand par exemple tu te rends compte qu’il y a des enfants pour qui c’est plus
difficile de développer l’imagination ? Comment tu réagis par rapport à ça ? Est-ce que tu
essaies de t’adapter ou au contraire est-ce que tu essaies de continuer avec le groupe ?
Mehregan : J’insiste, j’insiste beaucoup. Je dis là par exemple, là, là, « tu fermes tes yeux »,
271
ça peut pas être par exemple, tu vois… « non le ciel est bleu », mais non « mais Mehregan,
c’est pas possible, ferme tes yeux, ferme tes yeux, regarde, c’est pas le ciel qui existe déjà,
c’est le ciel que toi tu es en train de créer », tu vois ? ça peut être avec des couleurs, des fois
ça marche. Des fois, non, « pour moi c’est toujours bleu ». Là j’insiste pas plus que ça, tu
vois.
Moi : Oui, quand tu vois que la deuxième fois c’est la même chose qui revient…
Mehregan : J’insiste pas plus que ça parce qu’après il y a pas qu’un seul enfant tu vois.
Moi : Oui bien sûr. J’imagine que ça fait partie des difficultés à gérer.
Mehregan : Ouais.
Moi : Quels retours tu as pour le moment de la part des enfants ? Est-ce que les enfants te
disent spontanément des fois s’ils aiment, s’ils aiment pas ? S’ils aiment venir ? S’ils
s’ennuient ?
Mehregan : Je te dis plutôt s’il y en a qui sont… Bon c’est pas les ateliers multi-activités mais
il y a Léa qui aime pas l’Atelier du Coteau, qui dit qui aime pas l’Atelier du Coteau, mais à
chaque fois qu’elle sort elle est contente, c’est un peu comme Victor, mais elle le dit. Et tu
vois sa mère elle est hyper contente, elle trouve qu’elle travaille beaucoup mieux, elle utilise
beaucoup son imagination tout ça. C’est la fille qui a fait la mer à droite… à gauche (me
montrant du doigt les peintures des enfants sur le mur). Mais des fois elle veut plus travailler,
tu vois. Elle… Je t’ai dit une fois des fois elle est vraiment compliquée. C’est elle… qui le…
bah après par exemple, je sais que le groupe de mercredi ils adorent euh… l’atelier. Agathe
elle adore, Marie elle adore. Alix elle est très petite des fois elle aime beaucoup, d’autres fois
elle aime pas. Ça dépend des sujets en fait : « Ah non ça j’aime pas trop », tu vois ?
Moi : Mmm, mmm.
Mehregan : Victor euh… Il est compliqué un petit peu, on sait pas. Mais il s’implique très
bien dans le projet donc. S’il aime pas, je sais pas pourquoi. Comme il t’a dit. Mais il
s’implique très bien, tu as vu.
Moi : Donc pour toi le fait que les enfants s’impliquent c’est un signe positif ?
Mehregan : Moi je pense. Parce que s’ils veulent pas ils sont petits. Par exemple Alix des fois
elle se met là et elle dit « j’ai plus envie », tu vois, et moi j’insiste pas trop.
Moi : Et tu vois par exemple quand tu dis que Marie, Agathe, tout ça elles adorent, qu’est-ce
qui te fait dire que elles adorent l’atelier ?
Mehregan : Elles me le disent.
Moi : Elles te le disent, clairement.
Mehregan : Oui. Agathe elle insiste beaucoup à sa mère si elle peut rester encore une autre
euh… une autre... la deuxième heure, tu vois. Marie quand je vais chercher elle est excitée
quoi, beaucoup. Par exemple elle dit à Léa, « mais tu dois pas dire ça, les ateliers sont très
272
sympas, machin ». Lucien il adore aussi parce qu’ils me disent en fait quand je vais les
chercher déjà ils ont un grand sourire comme ça tu vois. Et après je trouve que Lucien il
travaille bien aussi.
Moi : Donc en fait c’est un mélange de… d’émotions que toi tu peux ressentir de leur part dès
le moment où tu vas les chercher à l’école et pendant les ateliers…
Mehregan : Oui et par exemple Maya aujourd’hui elle m’a ramené plein de fleurs et elle m’a
dit « j’aime beaucoup tes ateliers ». Et moi je lui ai dit « ça me fait vraiment plaisir ».
Moi : Donc dans l’ensemble les retours ils sont plutôt positifs en fait. A part quelques
exceptions de temps en temps mais euh…
Mehregan : De temps en temps il s’ennuient peut-être parce qu’ils n’aiment pas le sujet, c’est
normal ça.
Moi : Oui, ça peut arriver.
Mehregan : Bien sûr.
Moi : Et les retours de la part des parents, tu en as beaucoup ? Et ils sont de quelle sorte ?
Mehregan : Par exemple c’est rigolo parce que Léa qui aime pas les ateliers sa mère elle est
hyper contente de ces ateliers-là. Je sais que par exemple Sophie et Jérôme ils sont très
contents. Je pense euh… Maya et Thomas. Parce que sa mère, apparemment ils utilisent
beaucoup de mots qu’on utilise ici à la maison. Surtout Thomas vu qu’il fait pas les ateliers
dehors, sa mère elle est sûre qu’il apprend ici, tu vois ?
Moi : Oui.
Mehregan : Et, bon… après il y a des parents qui aiment pas du tout parler. Par exemple,
Arthaud et Rosemay tous les deux ils s’ennuient pas, ils sont sociables et tout ça mais les
parents en fait quand ils viennent ils disent à peine « bonjour », « au revoir » tout ça, ils filent
vite fait. Je comprends pas trop. Je pense que la mère d’Adèle et son père ils sont contents
aussi. C’est au comportement aussi qu’on peut comprendre, tu vois. Après il y en a qui me
donnent pas leurs idées sur les ateliers.
Moi : Oui, d’accord.
Mehregan : Lucien sa mère elle parle pas du tout donc j’ai aucune idée. Elle dit « bonjour »,
elle dit « au revoir ».
Moi : Et des fois toi tu cherches à savoir ce qu’ils en pensent ou tu préfères les laisser venir à
toi ou…
Mehregan : Non, je cherche pas du tout. C’est pas du tout mon style et je… tu vois. Non, je ne
cherche pas du tout.
Moi : D’accord. Et alors qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ?
273
Mehregan : Euh… j’aime beaucoup travailler avec les enfants et de cet âge parce que, je
répète, imagination. Et moi j’aime bien parce que je pense que ça m’aide beaucoup pour
travailler mon imagination.
Moi : D’accord. En fait tu nourris ta propre imagination de l’imagination des…
Mehregan : …des enfants, oui. Et le fait de… Par exemple si c’est des enfants plus âgés que
ça j’aime pas en fait, ça va pas être un travail que j’aime. Mais là je suis hyper contente parce
que je m’entends bien avec les enfants de cet âge, je me sens comme eux, et le fait de
travailler sur leur imagination ça me plait énormément parce que ça m’aide aussi. Ça me rend
contente d’être avec eux. Je me sens heureuse.
Moi : Et qu’est-ce que tu aimes le moins alors s’il devait avoir quelque chose que tu…
Silence. Mehregan réfléchit.
Mehregan : Oh, là, là, ça je dois réfléchir, attends…
Moi : Bon, c’est bon signe quelque part, si tu dois réfléchir ! Alors peut-être qu’on peut
essayer de voir ça sous un autre angle : par exemple est-ce que euh… à quelles difficultés tu
es confrontée parfois dans ces ateliers-là ? Est-ce qu’il y a des choses que tu trouves difficiles
parfois dans les ateliers ?
Mehregan : Euh… Oui, mais attends… Je me rappelle pas ! Euh…
Moi : Des problèmes auxquels tu aurais été confrontée ou euh…
Mehregan : C’est pas dans les ateliers mais des fois j’aime pas le fait que… quand je veux
communiquer avec les parents, pas avec n’importe quel parent, certains, des fois j’aime pas le
fait que je fais des fautes. Et je suis consciente du fait que je suis en train de faire des fautes et
je les fais quand même. Et il y a des parents je m’en fous parce que je sais qu’ils me
connaissent très bien, ils sont très cools, tu vois. C’est pas des fautes, c’est des fautes de
langue tu vois ? C’est pas des fautes, c’est pas des fautes qui sont pas compréhensibles, ils
sont compréhensibles en fait je fais pas des fautes de dingue tu vois. Mais le fait que je fais
des fautes en grammaire, machin et tout ça, féminin/masculin et tout ça, ça me gêne. Mais
c’est comme ça.
Moi : Et par contre ça te gêne avec les parents mais ça te gêne avec les enfants ?
Mehregan : Pas du tout. C’est le boulot en fait. Dans cet atelier-là ça va. Même avec les
ateliers que je fais dans les écoles qui s’appellent les ateliers de langues euh… j’suis là pour
euh… au moment où j’arrive à les faire comprendre, leur faire comprendre ce qui se passe, ce
qui doivent faire, machin et tout ça, il y a aucun problème tu vois.
Moi : Et qu’est-ce que tu fais dans ces ateliers-là, à l’école ?
Mehregan : A l’école je donne des cours euh… d’arts plastiques mais toujours le thème c’est
l’imagination.
Moi : Et il y a aussi une dimension multilingue ou pas du tout ?
274
Mehregan : Pas du tout. Dans ces ateliers-là, non. Mais peut-être qu’on va proposer l’année
prochaine, ça peut être hyper intéressant. Tu vois moi je pense qu’on peut profiter du fait que
j’ai un accent tu vois. J’ai un accent, même là je parle je fais beaucoup de fautes mais au fur et
à mesure que les années passent je fais moins de fautes mais je vais garder toujours mon
accent. Donc pourquoi pas, on peut en profiter.
Moi : Oui. Donc en fait, finalement à part la relation avec les parents, enfin c’est pas la
relation qui est difficile mais des fois tu te sens… c’est dans ta manière de t’exprimer… c’est
une peur de faire des fautes en fait ?
Mehregan : Oui c’est juste ça
Moi : Enfin des fautes… de faire des erreurs.
Mehregan : Oui, dans la langue.
Moi : D’accord. C’est une peur qui vient d’où d’après toi ?
Mehregan : En fait le moment où je suis en train de parler avec eux, il y a aucun problème,
c’est après je me prends la tête. Je me dis : « Pu.., j’ai dit ça, c’était pas correct le mot que j’ai
utilisé, c’est au féminin, c’est pas au masculin ». Tu vois, c’est après.
Moi : Et pourquoi en fait ça te fait peur ?
Mehregan : Parce que je suis comme ça. Je suis obsédée. Un petit peu. Mais ça va.
Moi : Pour toi c’est important de faire bien ?
Mehregan : C’est pas avec les parents. Moi quand je vais n’importe où, quand je connais pas
les gens assez bien j’ai un stress et donc je fais plus de fautes que d’habitude et je m’exprime
beaucoup… je m’exprime moins bien que… que d’habitude.
Moi : Ok.
Mehregan : Mais ça ça arrive pas avec les enfants, je répète.
Moi : C’est vraiment juste avec les parents.
Mehregan : Avec les parents ou n’importe qui.
Moi : Et avec les enfants tu as jamais été confrontée à aucune difficulté particulière ?
Mehregan : Non. J’arrive à m’exprimer, à …
Moi : Il y a jamais eu un soir où t’es rentrée chez toi et tu t’ai dit : « oh, là, là, ça a été super
dur aujourd’hui » ou…
Mehregan : Par rapport aux langues ?
275
Moi : Non, pas forcément, tu vois, ça peut être vraiment tout et n’importe quoi, c’est dans ton
travail.
Mehregan : Avec Léa des fois je suis épuisée. C’est vrai qu’avec Léa je suis épuisée des fois.
Mais maintenant c’est mieux parce que j’ai une autre élève qui fait son atelier avec moi aussi
donc là ça aide beaucoup mieux parce qu’avant elle était toute seule. Je comprends en même
temps que c’était pas forcément très cool pour elle d’être toute seule, mais là ça avance
beaucoup mieux, mais quand même elle fait des fois des… des choses qui sont pas agréables,
tu vois. Quand il pleut par exemple on est dehors avec Louise et Marie et Léa, Léa elle se met
à pleurer en fait. Elle a un personnage comme ça quoi. Elle a un caractère un petit peu
difficile.
Moi : Donc c’est parfois difficile.
Mehregan : Oui, elle est compliquée quoi. Même à l’école elle est compliquée.
Moi : Et donc plus spécifiquement dans les ateliers multilingues, t’as pas de difficultés
particulières ?
Mehregan : Franchement, non. Quelque chose qui me gêne quand j’arrive à la maison je dis à
Alexis, non. Euh… non. Attends, je réfléchis quand même… Est-ce qu’il y a quelque chose
qui me gêne ? Je sais pas.
Moi : Au pire si jamais tu te rends compte qu’il y a une idée qui te vient, tu m’en reparles une
autre fois, c’est pas grave. Mais bon quelque part si là comme ça de visu tu te rappelles de
rien…
Mehregan : A chaque fois je peux te dire tu vois ça c’est bien. Maintenant à chaque fois qu’on
fait un atelier je peux te dire ce qui me gênait et ce qui m’a pas gêné.
Moi : Ok. Tu pourrais le faire par exemple pour ce soir ?
Mehregan : Ce soir il y a… rien. Tu sais des fois en fait il y a un truc avec le groupe de
mercredi qui est pas vraiment une difficulté mais ils sont nombreux et quand on fait des
collages comme ça, tu vois c’est un petit peu difficile à gérer. C’est que ça en fait.
Moi : Et c’est pas euh... par exemple la différence d’âge qu’il y a notamment dans ce groupe-
là, c’est pas du tout gênant pour toi ?
Mehregan : Thomas de temps en temps peut-être mais… c’est possible.
Moi : Ok. D’accord. Alors maintenant je te propose de passer à la dernière partie de
l’entretien où là on va plus discuter des langues, des pays, des cultures que tu connais, que tu
connais pas ; avec l’objectif de dresser un peu ce qu’on appelle un portrait langagier, une
biographie langagière de toi. Ok ?
Mehregan : Mm, mm.
Moi : Alors la première question c’est quelles langues parles-tu ?
276
Mehregan : Riant. Persan, anglais, français et un petit peu espagnol mais j’ose pas trop.
J’arrive très bien à lire, pas mal comprendre…
Moi : Pourquoi tu oses pas trop l’espagnol ?
Mehregan : Bah, je sais pas. Parce que je sais pas, parce que je suis tout débutante quand
même peut-être. Je dois lancer cet effort de parler espagnol de temps en temps avec les
enfants, des petits mots que j’apprends à chaque fois. En plus ça peut même m’aider.
Moi : Et est-ce qu’il y a des langues que tu… ne parles pas mais que tu comprends ?
Mehregan : Un petit peu portugais parce que quand je travaillais au musée Quai Branly j’avais
plein de collègues qui venaient de pays différends et les Brésiliens en fait, les gens qui
parlaient portugais et espagnol je comprenais un petit peu de quoi ils parlaient, le thème
j’arrivais à comprendre tu vois. Arabe je comprends un petit peu. Le turc un petit peu je
comprends parce qu’il y a des mots en commun donc j’arrive à comprendre de quoi ils
parlent. J’arrive pas à suivre tu vois mais…
Moi : C’est des mots communs avec le persan ou avec l’arabe ?
Mehregan : Le persan, le persan. Persan et arabe donc. Quoi d’autre ? Non c’est tout en fait.
Moi : Et tu les parles pas du tout celles-là c’est juste que tu peux les comprendre un petit peu.
D’accord. Et quelles sont les langues que tu apprends à l’heure actuelle ?
Mehregan : Français et espagnol.
Moi : Français et espagnol, ok. Et pourquoi tu as… alors ça va te paraitre très bête, surtout
pour le français mais pourquoi tu apprends ces langues-là ?
Mehregan : Parce que j’habite en France, parce que j’adore apprendre des langues et donc
j’apprends une autre langue qui est espagnol qui est assez répandue.
Moi : C’est parce que c’est assez répandu que tu as voulu l’apprendre ?
Mehregan : J’aime bien aussi.
Moi : Qu’est-ce qui fait que tu aimes bien cette langue-là ?
Mehregan : Quand je l’entends ça me fait… c’est joli pour moi quand je l’entends.
Moi : Ok. Alors le persan c’est ta langue maternelle donc tu l’as appris dans ta famille, en
grandissant. Le français tu as commencé à l’apprendre en Iran ?
Mehregan : Non en France.
Moi : Juste en France, ok. ET tu l’as appris dans la vie de tous les jours où tu es allée dans tes
cours…
Mehregan : Non j’ai pris des cours de la langue et de la civilisation française à la Sorbonne.
277
Moi : D’accord. Et l’anglais ?
Mehregan : L’anglais je l’ai appris dans des écoles privées en Iran.
Moi : Et alors l’espagnol tu m’as dit c’est…
Mehregan : C’est dans le centre culturel espagnol.
Moi : D’accord, donc on a fait le tour des langues que tu parles. Donc en fait c’est des langues
que tu as apprises dans un contexte plutôt institutionnel, c’est vraiment dans de
l’apprentissage.
Mehregan : Non je les ai pas… Si français peut-être un petit peu parce que j’ai étudié un an,
un an et demi et puis à force de travailler, à force d’aller à la fac… J’ai mon copain il est
Français, je travaille avec des Français, je connais même pas une seule personne ici à Nantes
qui est iranienne, je crois que j’en connais une qui est très récente pour moi. En fait si la
France… Français je l’ai commencé vraiment dans une structure euh… je sais pas, dans une
école quoi, mais après c’est vraiment dans la langue, dans la vie de tous les jours.
Moi : Et comment tu as vécu ces apprentissages-là ? Enfin est-ce que pour chacune de ces
langues-là il y a eu des choses que tu as trouvé difficiles, est-ce que ça a été une expérience où
tout s’est bien passé, où tu n’as pas eu de problème particulier ou est-ce que tu te rappelles de
certaines choses qu’on été vraiment difficile à vivre pour toi ?
Mehregan : Anglais vu que je l’ai commencé depuis mon enfance, je peux pas dire que… Je
me rappelle même pas comment ça s’est passé tu vois. Mais français si je trouve hyper
difficile. J’étais pas là en fait, je voulais jamais venir en France tu vois avant. Je me suis
vraiment retrouvée dans une situation merdique tu vois : « Pu… je dois apprendre une langue
que j’aime pas du tout… euh, j’suis obligée, merde » tu vois . Mais finalement je me suis mise
à apprendre quoi.
Moi : Et c’est quoi ton ressenti aujourd’hui par rapport à cette langue-là ? Tu as toujours le
même ressenti que c’est une langue que tu aimes pas trop ou…
Mehregan : Non, non. Si je l’aime beaucoup mais je trouve que je me sens toujours qu’elle est
hyper difficile. Elle est vraiment difficile quoi. Surtout pour quelqu’un comme moi qui n’a
pas du tout de choses dans les grammaires, de forme féminin, masculin, tout ça machin quoi.
Ça ça me fatigue.
Moi : D’accord, ok. Et est-ce qu’il y a d’autres langues, à part toutes celles qu’on a dites, que
tu aimerais apprendre ?
Mehregan : Après… Portugais.
Moi : Portugais, pourquoi ?
Mehregan : Je sais pas, j’aime beaucoup.
Moi : Et dans… alors le portugais ça fait partie des langues que tu peux comprendre un petit
278
peu…
Mehregan : Un petit peu !
Moi : … mais que tu parles pas, et parmi les autres langues que tu comprends, celles-là tu as
pas forcément envie de les apprendre ?
Mehregan : Il y a italien aussi mais… d’abord je sais pas. Oui je pense que d’abord portugais
je préfère parce que j’aime beaucoup déjà les pays d’Amérique latine et si un jour je veux
apprendre une autre langue, ça va être italien. Mais bon là, je pense qu’espagnol euh… c’est
la fin hein !
Rires.
Moi : Pourquoi ce serait la fin ?!
Mehregan : Parce que j’en ai assez là ! Rires. Non parce que c’est hyper difficile je trouve.
Moi : Oui. C’est fatigant pour toi de naviguer…
Mehregan : J’aime beaucoup, beaucoup apprendre la langue mais il faut que je me mette
encore plus de temps pour français je trouve. Tu vois. J’suis pas assez bien en français donc je
pense qu’à la place d’apprendre une autre langue je pourrais encore m’améliorer sur cette
langue-là.
Moi : Pour toi ce qui est important c’est, quand tu apprends une langue, c’est de réussir à la
parler le mieux possible ou tu préfères parler plusieurs langues même si tu les maitrises pas
toutes au même niveau ?
Mehregan : En fait si j’aimerais bien apprendre plusieurs langues mais le… vu que j’habite en
France avec des Français. Pour vivre en France, pour vivre dans n’importe quel pays on a
besoin de parler bien. Et moi je préfère de m’en sortir mieux que ça tu vois. J’pense pas que je
parle pas bien, je pense que dans mon niveau tout ça, je pense que je parle quand même bien.
Mais je préfère parler encore mieux.
Moi : D’accord… plutôt que de commencer d’autres langues…
Mehregan : … là espagnol ça va, j’ai pas envie d’arrêter. Je dis pas que j’ai envie d’arrêter
espagnol parce que j’aime bien, c’est pas très loin. C’est difficile en même temps, tu sais en
même temps c’est difficile parce que je suis pas hyper douée en français donc euh… il y a des
règles qui se ressemblent beaucoup mais que je connais pas encore très bien en français donc
ça me pose des problèmes en espagnol. Tu vois, il y a des choses comme ça. Et… et moi j’ai
pas… je veux pas d’aller encore prendre des cours pour apprendre le français. Là c’est
vraiment le moment que je dois apprendre dans la vie de tous les jours. Là je lis beaucoup
beaucoup de livres, je comprends mais j’arrive pas… je comprends très bien franchement les
livres français, j’ai presque pas de problèmes tu vois. Il y a des mots mais c’est pas grave
parce que je comprends très bien… le… le…
Moi : Le sens général.
279
Mehregan : Le sens général mais… j’arrive jamais à utiliser ces mots-là dans la vie de tous les
jours, jamais je sais pas un jour peut-être mais j’arrive pas à utiliser ces mots-là dans la vie de
tous les jours, tu vois ?
Moi : D’accord. Oui.
Mehregan : Je perds des fois, et après ça dépend quand je suis fatiguée, je pense que tu as
déjà… eu ça. Quand on est fatigués même dans notre langue maternelle on a du mal des fois.
Moi : Oui, bien sûr.
Mehregan : C’est même pas une question d’être fatiguée en fait, des fois il y a juste quelque
chose qui va pas pour parler.
Moi : Mm, mm. Et donc si on s’intéresse là maintenant plus sur le plan des pays et des
cultures, donc tu viens d’Iran, tu habites en France, tu as fait une exposition aux Pays-Bas ;
est-ce qu’il y a d’autres pays dans lesquels tu es allée ?
Mehregan : Euh oui, en Turquie j’ai habité trois mois. Euh… que je suis allée ? comme un
voyage quoi ?
Moi : Oui, bah après tu peux me dire si c’était un voyage ou si tu es vraiment restée
longtemps.
Mehregan : Alors attends. Euh… Turquie j’ai fait une fois en voyage de deux semaines, bien
dans tout le pays. Après j’ai habité trois mois en 2010. Puis j’ai été en France, j’ai été aux
Pays-Bas euh… j’ai été en Allemagne mais j’ai pas vécu là-bas. J’ai été en Italie, j’ai été au
Danemark, Belgique, Sicile (vu que les Italiens, les Siciliens n’aiment pas être comptés
comme euh…). Alors attends. J’ai été jamais en Espagne… Je sais plus. Euh… attends.
France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne. C’est tout.
Moi : D’accord. Et c’est des pays où tu allée une fois que tu étais arrivée en France où…
Mehregan : Non j’étais allée avant.
Moi : D’accord, ok. Et comment tu as vécu ces voyages ? Qu’est-ce qu’ils t’ont apporté ?
Mehregan : La première fois dans ma vie, quand je suis sortie de l’Iran, j’avais 12 ans, je suis
venue en France et… je suis venue en France avec ma mère et on a voyagé un petit peu : on
est allées aux Pays-Bas, on est allées… en Allemagne et tout ça. Et la première fois, c’était
hyper, hyper… pour moi c’était hyper… au niveau des cultures c’était hyper choquant. Pas
choquant, j’aime pas ce mot. C’était différent quoi tu vois, c’était hyper différent. Moi je
trouvais euh… les enfants du même âge que moi qui portaient pas de voile dans la rue et tout
ça. Et donc moi en fait à cet âge-là quand j’avais 12 ans je mettais pas encore de voile mais je
savais que dans quelques années je devais le mettre, tu vois. Et donc… c’était. Il y avait des
choses comme ça qui étaient un petit peu choquantes pour moi. Mais tu sais, après cet âge-là,
au fur et à mesure, tu commences à connaitre le monde, même si tu es en Iran, je crois que…
comme un Iranien. Tu commences à connaitre mieux le monde, tu regardes des films, tu
regardes… tu vois ? Tu commences à former ton caractère donc… Quand tu es plus grand,
quand tu vas dans un autre pays c’est pas aussi choquant que… tu vois. Parce que 12 ans c’est
280
l’âge que tu es adolescent, tu vois, c’est un petit peu différent. Donc là cette première fois
c’était un petit peu choquant on va dire. Mais la deuxième fois quand j’avais 23 ans, non,
c’était pas du tout choquant, j’étais là pour un petit peu voir qu’est-ce qui se passe tu vois.
C’était un voyage d’un mois, j’ai pas mal bougé. J’ai été aux Pays-Bas, j’ai posé ma
candidature là-bas, j’ai passé un entretien et tout. Ouais. La deuxième fois c’était hyper
sympa, j’ai… j’ai retrouvé des amis, des copains et tu vois, communiquer avec les gens et tout
ça. Ça marchait vraiment, c’était mon goût et j’ai bien réussi. Et… même quand je suis allée
en Turquie avec deux autres copains, c’était comme ça, on a trouvé plein de, plein de… en fait
je fais des genres de voyages où tu es obligée de communiquer avec les gens tu vois. Voilà.
Moi : Et c’est des pays que tu connaissais avant de les visiter ou… tu avais des connaissances
autour de ces pays-là, tu savais un peu comment on y vivait, quelles langues on y parlait, etc.
ou t’as fait des découvertes ?
Mehregan : non, non, je connaissais. Surtout il y avait ma… ma tante qui habite par exemple à
Copenhague il y a 20 ans, on a de la famille ici en France, on de la famille en Allemagne, tu
vois.
Moi : Oui. Donc en fait tu voyageais pour aller voir des membres de ta famille aussi
finalement ?
Mehregan : Pas forcément. Mais je restais chez eux. J’allais pas, par exemple, si j’avais
quelqu’un là-bas, j’allais pas prendre un hôtel.
Moi : Oui, bien sûr. Donc est-ce que tous ces voyages pour toi c’était des expériences
heureuses ou est-ce que tu as eu des moments…
Mehregan : Si bien sûr on a des moments un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, mais
en gros c’était vraiment bien. C’était une expérience… J’ai fait deux voyages avant que je
vienne en France, une fois en Turquie une fois en Europe on va dire, c’était deux voyages
hyper intéressants pour moi, avec beaucoup de bonnes expériences. Et alors après j’ai fait
d’autres voyages aussi, après je suis retournée en Turquie après par exemple. Quand j’étais en
France, je suis retournée en Turquie pour pouvoir voir ma famille on s’est arrangé.
Moi : Vous vous êtes rencontrés à mi-chemin ?
Mehregan : Mm, mm.
Moi : Maintenant qu’on a fait un peu tout ce portrait de toi en termes de langues et de pays,
dans les ateliers ici multilingues tu utilises donc le français pour mener l’atelier en fait,
l’anglais, le persan… Alors, ma question va paraitre bête mais pourquoi parmi les langues
étrangères on va dire pour les enfants, pourquoi juste l’anglais et le persan ? Pourquoi ces
langues-là et pas d’autres ?
Mehregan : Parce que je… connais pas les autres langues. Parce que j’ai… j’ai droit d’utiliser
les mots, parce que je pense que j’ai assez de connaissances dans ces langues-là, sur ces
langues-là. Je me perds moins. Quand je te dis que j’ose pas trop parler en espagnol avec les
enfants parce que je me sens pas assez euh… comment on dit ?
Moi : A l’aise ?
281
Mehregan : Non pas à l’aise. Assez… Je connais pas la langue assez bien pour pouvoir me
permettre… faire apprendre aux enfants.
Moi : D’accord. Donc en fait tu préfères t’attacher aux langues que tu parles couramment
plutôt qu’aux langues que tu apprends ?
Mehregan : Pour l’instant ! Peut-être au fur et à mesure je change d’idée. Peut-être comme tu
dis je vais trouver, faire des recherches, par exemple voilà je peux dire aux enfants « Ah vous
savez en fait je savais pas, on dit ça en arabe, on dit ça comme ça ». Mais pour l’instant je
préfère que ces deux langues-là. Parce que je peux me permettre.
Moi : Tu as l’impression que tu peux pas te permettre pour le moment en espagnol par
exemple ?
Mehregan : Oui par exemple.
Moi : D’accord. Bah écoute euh…
Mehregan : Par exemple c’est ce que Hélène elle fait. Elle sait pas forcément parler par
exemple je sais pas chinois ou turc ou j’sais pas quoi, mais elle utilise, elle connait des
chansons, elle les utilise et tout ça. Mais moi j’y arrive pas.
Moi : Tu arrives pas ?
Mehregan : C’est pas que j’y arrive pas parce que… je peux pas. C’est j’arrive pas parce que
je me permets pas. Parce que je pense qu’une fois… ça c’est façon, je préjuge pas du tout
mais moi je préfère avoir assez de connaissances pour, tu vois, pour pouvoir faire…
Moi : … pour pouvoir te sentir bien en fait dans les ateliers ?
Mehregan : Pour me sentir bien ou pour pouvoir faire apprendre des choses aux enfants, je me
sens mieux comme ça. Ça peut être une idée hein, ça peut m’arriver plus tard, peut-être que je
vais le faire l’année prochaine, je sais pas du tout. Mais là à ce moment-là je préfère utiliser
les langues sur lesquelles j’suis… j’ai la connaissance.
Moi : D’accord. C’est comme ça que tu le ressens maintenant.
Mehregan : oui.
Moi : D’accord. Je pense avoir fait le tour de toutes mes questions… Mais, est-ce que toi il y a
quelque chose d’autre que tu voudrais dire, ajouter ou…
Mehregan : Non, j’pense que c’était… Après tu sais, nous, on peut en parler de temps en
temps. Là pour l’instant j’ai pas quelque chose à ajouter. On t’a envoyé une fois un texte avec
Alexis ?
Moi : Oui. Euh… c’était un texte qui présentait vos activités dans la compagnie, si je me
trompe pas.
282
Mehregan : oui mais je vais te dire s’il y a des choses… A chaque fois si tu as des questions
n’hésite pas.
Moi : Oui. Et est-ce que par exemple, parce que l’éveil aux langues on avait déjà dû en parler,
c’est aussi, enfin ça devient quelque chose d’officiel aussi tu sais, c’est un peu des gens qui y
ont réfléchis, qui ont commencé à mettre des choses en place, est-ce que ça fait partie des
outils que tu aimerais utiliser ou tu préfères euh… le faire voilà à ta manière avec les langues
dans lesquelles tu es à l’aise etc. ?
Mehregan : J’ai pas compris…
Moi : En fait est-ce que… ma question tout bêtement c’est est-ce que tu… aurais envie de…
d’en apprendre plus sur l’éveil aux langues, sur ce que c’est, selon comment c’est défini
aujourd’hui, pour les mettre en place plus tard dans les écoles ou…
Mehregan : … est-ce que tu es en train de me demander si j’ai envie de développer cette
partie-là ?
Moi : Oui, par exemple.
Mehregan : Si, si. Ça m’intéresse beaucoup. Parce que si tu veux la langue c’est un truc que
me… un truc qui m’intéresse énormément aussi tu vois.
Moi : D’accord. Donc au-delà des ateliers multilingues finalement c’est un thème qui
t’intéresse beaucoup personnellement ?
Mehregan : Oui, oui, la langue déjà, ça m’intéresse beaucoup. En fait chaque stage je t’ai pas
dit. A Paris je donnais des cours de langue sur… en fait avec une… une organisation dans les
écoles. Dans… deux écoles.
Moi : D’accord ok. Et tu enseignais quoi à ce moment-là ?
Mehregan : Anglais.
Moi : Anglais surtout. D’accord. Parce que là en fait ce que je voulais te proposer, du coup
j’en profite pour t’expliquer pour la suite. Tu sais que j’ai un dispositif à mettre en place. Moi
en fait ce qui m’intéresse, étant donné que… ton approche à toi et l’approche de l’Atelier du
Coteau en général c’est vraiment une approche au départ purement artistique et après sur
laquelle ont été amenées les langues, ce que j’aurais aimé proposer en fait c’est que… comme
on avait dit au départ, mercredi prochain, pas dès mardi mais mercredi, je prenne juste 15
minutes sur la séance pour faire une activité qui mélange les arts et l’éveil aux langues…
Mehregan : D’accord. Tu sais le problème de mercredi j’ai un petit peu réfléchis. On est
plusieurs, on est beaucoup et on arrive déjà pas bien à avancer sur le projet, tu vois ce que je
veux dire ? On est toujours, je sais pas si tu as remarqué, on est toujours en retard avec les
enfants du mercredi…
Moi : Oui, tu préfèrerais que je prenne moins de temps avec le groupe du mercredi ?
Mehregan : Non, oui. Si tu veux tu peux prendre par exemple, on peut plutôt travailler sur les
283
enfants de vendredi ou mardi, qu’on est moins. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu’on est
plusieurs ce jour-là, on arrive pas déjà bien à avancer sur notre projet à nous et dans un mois
et demi il y a l’expo.
Moi : Oui, je sais. Et moi mon stage il termine avant. Donc euh…
Mehregan : Tu vois ce que je veux dire ?
Moi : Oui, oui, je comprends tout à fait. Qu’est-ce qui te reste encore à faire pour
l’exposition ?
Mehregan : En fait… euh… écoute moi j’aimerais bien qu’on travaille quand même sur deux
ou trois autres projets.
Moi : D’accord. Sachant que moi ce que je comptais te proposer en dispositif c’est une idée
de projet aussi pour l’exposition… Mais si toi tu as des idées précises, ce serait important que
je les connaisse tu vois ?
Mehregan : Oui mais je suis tout à fait d’accord tu vois, mais moi je veux qu’ils avancent
ensemble. Je veux pas que… Parce que j’ai remarqué qu’ils sont pas contents du fait qu’ils
ont pas travaillé sur ça. Ils se sentent pas bien, tu vois ce que je veux dire ? Les enfants le
mercredi ils aiment pas le fait qu’ils ont pas de travail sur ça ou ils ont pas de travail sur
l’installation. Il aiment pas du tout ça. Ils m’ont dit, mais à chaque fois ils me disent et ils ont
raison.
Moi : Oui, oui, mais je comprends tout à fait.
Mehregan : Sinon, on peut faire un truc : on peut à chaque fois on demande aux parents de
rester 10 minutes de plus.
Moi : Oui, par exemple, si toi ça peut t’arranger.
Mehregan : Oui, on fait, on commence l’atelier avec ton activité de 10 minutes et on met,
comme ça j’ai une heure, et s’il y a des parents qui sont pas d’accords ils viennent chercher
leurs enfants.
Moi : D’accord. Moi ça m’irait si on pouvait faire comme ça. Parce que du coup comme j’ai
aussi travaillé sur ces enfants-là ça m’intéresserait de voir comment ça fonctionne avec eux,
mais dans ce cas on réduit à 10 minutes pour ce groupe-là. Si on peut pousser un peu plus
tard. Est-ce que pour les autres groupes tu préfères que ce soit 10 minutes aussi ou ça peut
aller jusqu’à 15 ?
Mehregan : On peut même… tu sais quoi, je vais voir, cette semaine on va essayer de voir si
les parents sont… c’est juste une fois que tu veux faire ou plusieurs fois ?
Moi : L’idée, non ça aurait été de le faire plusieurs fois enfin. Attends, je reprends. Mon idée
de base c’était te proposer là, à partir de mercredi prochain, avec le groupe de mercredi,
ensuite avec le groupe du vendredi et après avec le groupe du mardi, en gros… si tu veux au
lieu de commencer la semaine le mardi je la commencerais le mercredi, c’est juste pour me
laisser plus de temps de la préparer. Euh… l’idée ça aurait été que mercredi notamment je
284
fasse une première intervention avec les enfants. Et en fait moi ce qui m’intéresserait c’est
que après ça, on puisse ravoir un petit peu de temps toutes les deux pour en discuter, tu vois,
pour qu’on puisse échanger entre toi ce que tu as l’habitude de faire, ce que moi j’ai fait, et toi
comment tu l’as ressenti. S’il y a des choses que tu as aimé, que tu n’as pas aimé, … Pour
que, après, en fait mon objectif ce serait que je puisse te reproposer des activités mais
toujours, en fait pour que ce soit des choses qui te conviennent de plus en plus à toi tout en
gardant moi tu vois le côté didactique des langues et des cultures. Pour que moi je travaille sur
ce dispositif-là mais pour que tu puisses aussi te sentir… que tu puisses me donner ton avis en
fait. Que tu te positionnes par rapport à ça, par rapport à ce que tu as l’habitude de faire dans
les ateliers. Euh… et ça pourrait être l’occasion aussi, comme tu me le disais si ça t’intéresse,
que je t’explique moi comment je travaille et notamment par rapport à ce qui est dit dans
l’éveil aux langues en fait. Après tu vois, ça te donne des pistes, tu trouves ça bien, tu as envie
toi après de reprendre ce que j’ai fait et de le faire, il y a aucun souci ; ça te plait pas, tu as pas
envie de le faire, tu le prends pas tu vois. C’est juste, moi étant donné que j’ai un dispositif à
faire, ce qui m’intéresse c’est pas simplement de faire le dispositif avec les enfants, c’est
aussi, bah que ce soit un travail ensemble pour que ce soit vraiment quelque chose d’adapté à
ta manière de travailler et aux valeurs de l’association. Mais juste peut-être avec un point un
peu plus fort sur la didactique des langues et des cultures.
Mehregan : Moi je pense qu’on peut prendre les autres ateliers pour l’instant, parce que là on
a fini déjà ce projet avec les autres, et le vendredi on va finir euh… avec Alix et Marie. Je
pense que je veux pas forcer euh… Agathe, si elle a envie elle le fait mais… parce qu’elle a
fait ça le mardi aussi dans son école. Et puis on va demander aux parents de dire s’ils sont
d’accords pour attendre 10 minutes, 15 minutes.
Moi : D’accord, ok, ça marche. Parce qu’après, il suffit juste que tu me dises, si c’est 10
minutes, je prépare pour que ça tienne en 10 minutes, si tu me dis 15, je prépare en 15…
Mehregan : On va dire 15, on va dire 15.
Moi : D’accord, ok. Moi ce que je peux faire c’est de préparer une première activité qui tient
en maximum 15 minutes pour mercredi prochain…
Mehregan : D’accord. Au début.
Moi : Au début, si ça te convient, si ça te gêne pas. Et après, soit si t’as encre un peu de temps
après l’atelier le mercredi soir ou si tu préfères à un autre moment, on se pose un peu, c’est
pas obligé de durer une heure, hein, mais juste pour faire le point parce que je pense que ce
qui pourrait être intéressant aussi c’est que je te dise ce que j’ai remarqué dans les
observations, dans les entretiens que j’ai fait avec les enfants et tout ça, que tu puisses avoir
un peu un bilan de ce que j’ai vu et du coup pourquoi je propose ça tu vois.
Mehregan : ok.
Moi : Après c’est vraiment comme tu veux aussi, je veux pas t’obliger à faire ça si…
Mehregan : Non, non, non, c’est bon, on fait comme ça. Et le mercredi on va voir ça avec les
parents.
Moi : Oui, ok, ça marche. Super. (L’entretien s’achève sur ces mots).
285
Annexe 8.3 : Entretiens des enfants. Biographies langagières.
Les entretiens suivants sont retranscris dans l’ordre où ils ont été réalisés. Tous ont eu lieu
dans un des petits vestiaires sur le temps des ateliers. L’enfant et moi-même nous asseyions sur un
banc dans un coin de la pièce. Les enfants ont été interviewés individuellement sur le temps des
ateliers car il était difficile de mobiliser de leur temps et de celui de leurs parents en dehors de ces
heures. Aucun n’a présenté de refus pour participer, au contraire, tous se sont montrés très motivés
par l’idée de « m’aider dans mon travail ».
Entretien 1 : Agathe (Durée : 10 m 09 s)
Moi : Alors, Agathe, je connais déjà ton école donc j’ai pas besoin de te le demander… hop
là… On va beaucoup parler toutes les deux des langues. Est-ce que tu sais déjà ce que c’est ta
langue maternelle.
Agathe : Le français.
Moi : Ouais c’est le français. Super. Et est-ce que tu parles d’autres langues que le français.
Agathe : Bah avec ma remplaçante on en faisait mais maintenant on en fait plus.
Moi : Alors qu’est-ce que tu faisais avec ta remplaçante ?
Agathe : On apprenait à compter en anglais, …
Moi : Ouais… donc c’était à l’école ça ?
Agathe : Euh… oui.
Moi : Ok.
Agathe : … à dire quelques mots et euh…
Moi : Et c’est tout ?
Agathe : Oui.
Moi : Est-ce que par exemple tu as des gens dans ta famille ou dans tes copains et copines qui
parlent d’autres langues que le français ?
Agathe : Mmh… Papa il sait parler un peu anglais, maman pas trop. Papa il sait beaucoup
parler.
Moi : Papa il sait beaucoup parler anglais…
Agathe : Maman un p’tit peu.
Moi : D’accord.
Agathe : et euh…
286
Moi : Et est-ce que des fois tu parles anglais avec papa ou avec maman ?
Agathe : Bah… non pas trop. Enfin, non.
Moi : Non… jamais, jamais ?
Agathe : Avant j’le faisais un peu…
Moi : Ouais…
Agathe : Et puis des fois euh… enfin… bah en fait je pourrais en faire mais j’en fais pas.
Moi : Pourquoi tu fais pas ?
Agathe : J’sais pas…
Moi : C’est, est-ce que c’est parce que t’as pas envie ? t’aimes pas ça ?
Agathe : Parce que j’y pense pas.
Moi : Oui, t’y penses pas, tout bêtement. Et puis si papa et maman ils parlent pas forcément
anglais avec toi à la maison t’y penses pas non plus.
Agathe : Bah non.
Moi : Non… ok. Est-ce que tu pourrais me dire quelles langues tu… fais ici à l’Atelier du
Coteau ?
Agathe : Bah… on fait de l’anglais, et puis un peu d’perse.
Moi : Anglais et un peu de perse… Est-ce que tu en fais d’autres ?
Agathe : Non.
Moi : D’accord. Et est-ce que tu apprends des langues ailleurs qu’à l’école ou à l’Atelier du
Coteau ?
Agathe : Euh…
Moi : Par exemple, l’anglais, tu en faisais à l’école tu m’as dit, tu en fais plus maintenant ; tu
en fais un peu ici, est-ce que tu en fais ailleurs ?
Agathe : Mmmh…. Non.
Moi : D’accord. Ça marche. Est-ce que tu connais... alors attention ça va être un peu plus
compliqué ! … des langues que tu as vu écrites mais que tu ne comprends pas ?
Agathe : Langues écrites ?
287
Moi : Ouais… c’est compliqué langues écrites… Tu es en CP c’est ça ?
Agathe : Oui.
Moi : En CP tu apprends à lire et à…
Agathe : …écrire.
Moi : Et à écrire. Alors en français nous on écrit avec les lettres de l’alphabet qui sont… A, B,
C, D, ...
Agathe : …E, F, F, H, I, J, K , L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Moi : C’est ça ! Tu le connais par cœur. Alors est-ce que par exemple t’aurais vu des fois des
choses écrites avec des signes différents ? Ou alors des mots qui utilisent les mêmes lettres
que le français mais c’est pas des mots en français ?
Agathe : Chez papi et mamie des fois, il y a une euh… j’ai vu un ptit reportage et ils font des
lettres en signes.
Moi : D’accord… et tu sais ce que c’était ?
Agathe : Pas trop.
Moi : Pas trop. D’accord. Bon.
Agathe : Et puis à l’école quand par exemple on a vu le son [a] on a appris à faire le son [a] en
langue des signes.
Moi : Ouais, ça tu m’avais dit que vous faites les sons aussi en langue des signes pour vous
aider à retenir les sons en lecture. Ok. Et est-ce que tu as déjà… Est-ce que tu peux me dire
quelles langues tu entends ou tu as déjà entendues ?
Agathe : Euh… Bah j’ai déjà entendu de l’anglais !
Moi : Bah ouais bien sûr ! Où est-ce que tu as entendu de l’anglais déjà ?
Agathe : A l’Atelier du Coteau, à l’école, quand papa il parle des fois un peu anglais, et puis
euh… des fois… quand papa il dit un mot quand on a le temps, il le dit en anglais pour que
j’le devine… Voilà
Moi : Super. Et est-ce que par exemple quand tu écoutes de la musique tu écoutes que des
chansons en français ou des fois tu écoutes des chansons en anglais aussi ?
Agathe : Bah… quelques fois j’écoute La Reine des Neiges en anglais.
Moi : D’accord. Très bien… La Reine des Neiges en anglais… et tu préfères laquelle de
version ? Tu préfères en français ou en anglais ?
Agathe : Euh… anglais.
288
Moi : En anglais ? Pourquoi ?
Agathe : Parce que. J’aime bien… C’est rigolo !
Moi : Oui ! Les sons sont différents, c’est pour ça qu’tu aimes bien ?
Agathe : Un peu…
Moi : Ok. Et est-ce qu’il y a d’autres langues que tu as déjà entendues à part l’anglais et le
français ?
Agathe : Dans Violeta des fois ils chantent des chansons euh... j’sais pas en quelle langue
mais pas en français ni en anglais.
Moi : Dans Violeta ? C’est quoi Violeta ?
Agathe : C’est une fille qu’est… j’sais pas dans quelle classe mais… avec des gars qui
s’bagarrent pour être leur amoureux.
Moi : D’accord… Et ça passe où ça ? ça passe à la TV ? C’est un DVD ?
Agathe : Bah… ça passe sur Gulli et puis moi j’regarde sur Netflix, c’est pas une chaîne mais
c’est que papa il s’est abonné…
Moi : D’accord, donc tu regardes Violeta sur Netflix… Et des fois ils parlent dans d’autres
langues qu’en français ou anglais ?
Agathe : Bah en fait ils… ils chantent jamais des chansons en français ou en anglais.
Moi : D’accord. C’est toujours des chansons dans d’autres langues mais tu sais pas c’que
c’est… Ok. Tu pourras essayer de regarder une prochaine fois puis d’me dire si des fois t’as
trouvé c’que c’est les langues ?
Agathe : Oui.
Moi : Super. C’est gentil ! Alors tu m’as dit les copains, les copines tu en as pas qui parlent en
d’autres langues que le français..
Agathe : Non.
Moi : Ok. Et alors est-ce qu’il y a des langues que tu aimerais apprendre ? Maintenant ou plus
tard…
Agathe : Bah… euh… j’sais pas, un peu l’espagnol…
Moi : Un peu l’espagnol ? Pourquoi tu aimerais apprendre l’espagnol ?
289
Agathe : Parce que. J’pense que ça pourrait être bien. Et puis à l’école des fois… tous les
vendredis soirs ils donnent des cours d’espagnol sauf que c’est après l’école et que bon moi
j’peux pas parce que j’ai l’Atelier du Coteau.
Moi : Parce que tu viens là… D’accord. Ok. Donc tu peux pas y aller…
Agathe : Enfin c’est des cours d’arabe !
Moi : Ah c’est des cours d’arabe ! Et c’est pareil l’espagnol et l’arabe ?
Agathe : Non.
Moi : Et alors est-ce que t’aimerais bien apprendre l’arabe aussi ?
Agathe : Oui.
Moi : Pourquoi t’aimerait bien apprendre l’arabe ?
Agathe : Bah… j’sais pas… Parce que j’ai une copine qui, qui vient d’un pays et puis des
fois… comme elle ne peut pas y aller, bah… elle m’a dit qu’elle pouvait me l’apprendre.
Moi : Super ! Donc en fait tu as une copine qui parle une autre langue que le français alors ?
Agathe : Oui, j’avais oublié !
Moi : Comment elle s’appelle cette copine ?
Agathe : Aya.
Moi : Et est-ce que tu connais son pays ?
Agathe : Euh... non.
Moi : Non ? C’est une copine de ta classe ?
Agathe : Oui.
Moi : Ok. C’est une copine de ta classe… Elle a ton âge du coup aussi. Donc tu aimerais bien
apprendre l’arabe avec elle…
Agathe : Oui.
Moi : Comme ça tu pourrais parler avec elle dans sa langue. Super… Et est-ce que tu as
déjà… Alors déjà, avant de passer à la dernière question que je voulais te demander, est-ce
qu’il y a d’autres langues… Tu m’as dit l’espagnol, l’arabe,… et est-ce qu’il y a d’autres
langues que tu voudrais apprendre ?
Agathe : Euh… non…
290
Moi : Non ? L’espagnol et l’arabe. Tu voudrais continuer l’anglais aussi ou tu aimes moins
l’anglais ?
Agathe : J’voudrais continuer l’anglais.
Moi : Oui, ça te plaît aussi ?
Agathe : Oui.
Moi : Super… Alors ma dernière question : est-ce que tu es déjà allée passer des vacances ou
euh… fais des voyages en dehors de la Espagne ?
Agathe : Euh… Papa et maman ils sont allés euh… à New York euh… Et puis… on a des
amis qui sont allés en Afrique du Sud.
Moi : D’accord. Et est-ce que tu as… toi tu es jamais sortie de Espagne ?
Agathe : J’crois pas. En tout cas j’suis pas allée avec eux.
Moi : D’accord. Et quand papa et maman ils sont rentrés de New York ils t’ont montré des
photos ? T’as pu voir des choses de là-bas ?
Agathe : Euh… J’sais pas…
Moi : Tu te souviens plus ?
Agathe : Mais je sais qu’ils m’ont offert un T-shirt et une casquette.
Moi : Ils t’ont offert un T-shirt et une casquette…
Agathe : Deux T-shirts.
Moi : Et les amis qui sont allés en Afrique du Sud est-ce qu’ils t’en ont parlé aussi ?
Agathe : On a vu des photos et puis sinon… non.
Moi : Ok. D’accord. Est-ce que toi tu voudrais me dire quelque chose en particulier ? Sur les
langues ? Sur les pays ? Est-ce que tu as des pays dans lesquels tu aimerais voyager ?
Agathe : Euh… bah j’voudrais aller avec papa et maman à New-York…
Moi : Oui…
Agathe : Et puis euh… en Espagne…
Moi : Oui…
Agathe : Et puis voilà.
291
Moi : D’accord ! c’est bien ! C’est des belles destinations ! Ok dac… Tu m’as beaucoup
aidée, merci beaucoup Agathe !
Entretien 2 : Alix (Durée : 8 m 30 s)
Alix était malade le jour où l’on a réalisé l’entretien. Elle était fatiguée et même si au départ
elle était très motivée pour répondre à mes questions, l’entretien lui a semblé long. Ses réponses sont
difficiles à interpréter, et je crains d’avoir parfois trop insisté sur certaines questions ce qui n’était
pas du tout adapté à un enfant de son âge et aussi fatigué, de surcroît un vendredi soir après toute la
semaine d’école.
Moi : Alors, Alix, déjà, est-ce que tu sais toi quelle est ta langue maternelle ?
Alix me fait signe que non par un mouvement de tête.
Moi : Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ta langue maternelle ?
Alix : Non.
Moi : non. La langue que tu parles depuis que tu es née.
Alix : Ma langue maternelle que je parle c’est… un peu différent que les autres.
Moi : Ah bon ? Pourquoi c’est un peu différent que les autres ?
Alix : Parce que, avant on parlait en anglais et là on parle en… pas la même sorte de langue.
Quand on parle des fois il y a des gens qui parlent dans notre langue dans notre vie, mais c’est
pas très pareil…
Moi : Ah bon ? Bah alors toi, par exemple, quand t’es à la maison avec papa et maman, quelle
langue vous parlez tous ensemble ?
Alix : Bah… en français.
Moi : En français ? C’est la langue qu’on utilise toutes les deux pour parler ?
Alix hoche la tête.
Moi : C’est ça ? Oui… Et alors, tu m’as dit tout à l’heure que avant vous parliez en anglais,
c’est ça ?
Alix : Oui.
Moi : Est-ce que c’est parce que ton papa ou ta maman sa langue maternelle c’est l’anglais ?
Alix : Oui.
Moi : De qui c’est la langue maternelle ? C’est ta maman qui parle anglais ? Ton papa ? C’est
les deux ?
292
Alix : C’est les deux…
Moi : D’accord. Donc toi tu sais très bien parler anglais ou tu apprends encore ?
Alix : J’apprends encore.
Moi : T’apprends encore. Ok. Donc quand tu étais toute petite à la maison tout le monde
parlait anglais ?
Alix : Non, moi je parlais… euh français.
Moi : D’accord. Et alors quand tu dis que la langue que tu parles, que ta langue maternelle
elle est un peu différente des autres, c’est parce que c’est un français différend ou c’est parce
que c’est un français mélangé avec d’autres langues.
Alix : Un français différend.
Moi : Tu peux me donner des exemples ? Est-ce que c’est par exemple parce que tu utilises
des mots différends ou… ?
Alix : Bah euh… C’est euh… presque pareil mais pas du tout pareil.
Moi : D’accord. Ça marche. Et alors à l’école tu fais déjà… Est-ce que avec la maîtresse vous
parlez en… vous faites de l’anglais par exemple ou d’autres langues à l’école ?
Alix : C’est pas une maîtresse ! C’est que des garçons ; c’est Luc et Jérôme…
Moi : Ah pardon… alors est-ce que…
Alix : … parce que ma maîtresse elle est dans une autre école. Elle s’appelle Lucie et elle est
dans une autre école.
Moi : D’accord. Et alors les professeurs que tu as, les maîtres que tu as est-ce qu’ils vous font
faire de l’anglais ou une autre langue à l‘école ?
Alix : Non.
Moi : Non ? Pas du tout du tout ?
Alix me fait signe que non d’un mouvement de tête.
Moi : Et est-ce que tu connais les langues qu’on fait ici par exemple avec Mehregan ou avec
Hélène ? C’est quoi les langues qu’on fait à l’Atelier du Coteau ?
Alix : Non.
Moi : Non, tu connais pas ?
Alix : Non…
Moi : Par exemple avec Mehregan quelles langues on parle ?
293
Alix : Bah… euh… je sais pas c’est quoi qu’on parle… des langues…
Moi : Par exemple tu sais les comptines qu’on fait, elles sont en quelle langue ? Est-ce que les
comptines elles sont en français ?
Alix : Non.
Moi : Elles sont en quelle langue ? tu sais ?
Alix : En allemand… ?
Moi : En allemand ? Avec Mehregan ? Ou avec Hélène l’allemand ?
L’attention d’Alix est détournée par une jeune fille qui est entrée dans le petit vestiaire où
l’on réalise l’entretien.
Moi : Alix ?
Alix : Euh… Avec Mehre…gan…
Moi : Avec Mehregan. Ok. Et est-ce qu’il y a d’autres langues aussi ?
Alix : Allemand… le français… et l’anglais…
Moi : Allemand, français, anglais avec Mehregan. Et avec Hélène est-ce que tu fais ces
mêmes langues-là ou d’autres ?
Alix : D’autres.
Moi : Alors c’est quoi les autres langues avec Hélène ?
Alix : Avec… allemand… italien…
Moi : Oui… D’autres ?
Alix : Et anglais.
Moi : Et anglais aussi. D’accord.
Alix me regarde noter sa réponse sur mon bloc-note.
Alix : Tu sais écrire anglais ?
Moi : Oui !
Alix : En me montrant ma feuille du doigt – C’est comme ça ?
Moi : Oui, c’est le dernier mot là. Et alors est-ce que tu apprends des langues ailleurs qu’à
l’école ou à l’Atelier du Coteau ?
294
Alix : Ailleurs ? Chez papi et mamie…
Moi : Chez papi et mamie ? Quelle langue tu parles avec papi et mamie ?
Alix : En allemand.
Moi : En allemand avec papi et mamie ?
Alix : C’est trop long…
Moi : C’est quoi ?
Alix : C’est trop long…
Moi : C’est trop long les questions ?
Alix : Oui…
Moi : J’ai presque fini tu veux bien juste terminer vite fait avec moi ?
Alix : Oui.
Moi : Ok. Est-ce que t’as des copains et des copines à l’école qui parlent des langues ?
Alix : Nooon… !!!
Moi : Non, pas du tout ?
Alix : On parle pas des langues on parle des plantes du jardin !!!
Moi : Mais est-ce que, par exemple, t’as des copains et des copines à l’école, ou dans les
voisins qui parlent une autre langue que le français ?
Alix : Swan et Louise et Julien !
Moi : Swan et Louise et Julien, qu’est-ce qu’ils parlent comme…
Alix : Julia !
Moi : Et Julia, pardon. Qu’est-ce quelles parlent comme langue toutes les trois ?
Alix : Bah… en allemand !
Moi : En allemand, toutes ?
Alix : Oui… et aussi Gaspard, il parle en allemand.
Moi : Et donc dans ta famille, papa et maman ils parlent anglais et papi et mamie ils parlent
allemand ?
295
Alix : Un p’tit peu… Je peux y aller ?
Moi : J’ai presque fini, il ne me reste plus que deux p’tites questions… t’es prête ?
Alix hoche la tête et me tend un pétale de fleur qui était sur le banc.
Moi : Waouw, trop ce joli pétale, merci Alix ! Quelles langues tu aimerais apprendre toi plus
tard ? Quelle langue tu aimerais savoir parler ?
Alix : En allemand.
Moi : T’aimerais parler allemand ? Et quoi d’autre ? C’est tout ? Juste l’allemand ou tu
aimerais parler d’autres langues ?
Alix : Anglais.
Moi : Anglais. C’est tout ? On s’arrête là ?
Alix : Oui… !
Moi : Oui, c’est les deux langues que tu veux apprendre ?
Alix : Oui.
Moi : Et alors ma toute toute dernière dernière dernière dernière question, est-ce que tu es déjà
allée dans d’autres pays avec papa et maman par exemple ?
Alix : Oui !!! A la montagne du pôle Nord !!!
Moi : A la montagne du pôle Nord vous êtes déjà allés ?! C’est vrai ça ?
Alix : On a vu un renne. Un renne vrai. On a vu un renne de traineau.
Moi : Waouw !
Alix : Et papa et maman ils ont un truc qu’il faut qu’ils tiennent pour se tenir bien fort parce
qu’à l’avant, pour pas nous laisser tomber, et aussi il y a des étriers pour mettre les pieds. On
est allés comme le vent ! Comme l’éclair. Et le renne il s’appelle… j’te dis qu’il s’appelle…
Non on a pas l’temps parce qu’il va pleuver.
Moi : D’accord. Et est-ce que tu es allée dans d’autres pays avec papa et maman ou avec
d’autres gens ?
Alix : A la campagne.
Moi : Oui. D’autres encore ou c’est tout ? On a fini ?
Alix : C’est tout fini.
296
Moi : C’est tout fini, c’est bon tu peux retourner dans l’atelier ! Merci Alix pour ton aide !
Merci beaucoup !
Entretien 3 : Marie (Durée : 19 m 07 s)
Moi : Alors, je voudrais parler avec toi des langues. Est-ce que tu connais déjà ta langue
maternelle ? Est-ce que tu sais ce que c’est la langue maternelle ?
Marie : Le français.
Moi : C’est le français, oui… et est-ce que tu parles d’autres langues que le français ?
Marie : L’espagnol.
Moi : Tu parles espagnol ? Aussi bien que le français ?
Marie : Tu sais une fois c’que j’ai dit en espagnol ?
Moi : Non…
Marie : Petit jambon.
Moi : T’as dit « petit jambon » ? Comment ça s’dit ça en espagnol ?
Marie : J’me souviens plus comment j’ai dit.
Moi : Alors l’espagnol c’est une langue que tu apprends ou c’est une langue que tu connais
déjà.
Marie : Que j’apprends avec Hélène.
Moi : tu l’apprends avec Hélène. Ok. Est-ce qu’il y a d’autres langues que tu apprends avec
Hélène ?
Marie : Italien, anglais, …
Moi : Autre chose ? Tu m’as dit espagnol, italien, anglais…
Marie : Et euh… et français.
Moi : Et français. C’est une langue que tu apprends ça aussi ou tu la connais déjà ?
Marie : J’la connais déjà le français.
Moi : D’accord. Alors, avec Hélène, espagnol, italien anglais, … Et avec Mehregan alors tu
fais quoi comme langues ?
Marie : Et aussi avec Hélène on apprend le français.
297
Moi : Aussi avec Hélène vous apprenez le français ?
Marie hoche la tête.
Moi : Et avec Mehregan alors ?
Marie : Euh… on apprend le perse.
Moi : On apprend le perse avec Mehregan, c’est vrai. Et quelles autres langues ? Les
comptines par exemple elles sont en quelles langues ?
Marie : Moi j’connais des comptines françaises.
Moi : Tu connais des comptines françaises…. Et avec Mehregan on les fait en quelles langues
les comptines ?
Marie : Euh… En perse.
Moi : En perse, c’est tout ? On voit que du perse et du français avec Mehregan ?
Marie hoche la tête.
Moi : Ok. Et alors à l’école, tu fais des langues aussi Marie ou pas du tout ? Tu fais quoi à
l’école ?
Marie : En fait avant on faisait de l’anglais.
Moi : D’accord. C’était avant ça tu n’en fais plus maintenant ?
Marie : Plus maintenant.
Moi : Pourquoi ?
Marie hausse les épaules.
Moi : Tu sais pas… Avant tu faisais de l’anglais et maintenant il n’y en a plus.
Marie : En fait avant j’en avais pas… avant j’en avais après, et maintenant j’en ai plus.
Moi : D’accord, ok. Très bien. Et est-ce que tu fais d’autres langues à part l’anglais à l’école ?
Tu as fait que de l’anglais jusqu’à aujourd’hui à l’école ?
Marie : jusqu’à lundi ou mardi…
Moi : Ok. Et est-ce que tu connais d’autres langues que tu apprends ni à l’école, ni ici, mais
ailleurs ?
Marie : Euh…
298
Moi : Est-ce qu’il y a d’autres endroits à part l’école et l’Atelier du Coteau où tu parles
d’autres langues que le français ?
Marie : Euh… l’Atelier du Coteau c’est bon… L’école c’est bon… La maison c’est bon…
Moi : A la maison tu parles quoi comme langue par exemple ?
Marie : Aussi euh… quand on était avec ma copine en fait on essaie de parler en anglais mais
on dit n’importe quoi. On dit c’est… c’est pas du tout vrai mais on parle différemment.
Moi : Ok. C’est quelque chose que vous aimez faire toutes les deux ?
Marie : Oui.
Moi : Pourquoi ?
Marie : Des langues drôles !
Moi : C’est pour vous amuser ?
Marie : Oui, on fait des jeux. Mais sauf aujourd’hui parce qu’il y avait l’éclipse.
Moi : D’accord. Et oui. Tu l’as vu l’éclipse aujourd’hui ?
Marie : Non. En fait il y avait une protection. On s’enfermait tous dans les classes. Mais faut
surtout pas regarder parce que… il y a deux toilettes et entre les toilettes avec des vitres qu’on
voit tout flou on peut voir même pas l’éclipse et il y a l’autre toilette entre… la classe de
Valérie et la classe de Jaida. Et il y a pas de rideaux du tout.
Moi : D’accord.
Marie : Pas sur la porte de la fenêtre. Donc il faut pas du tout regarder. Il y en avait deux qui
regardaient l’éclipse. A dix heures.
Moi : D’accord. Ok. Est-ce que tu m’as dit à la maison tu parles une autre langue que le
français avec papa et maman ?
Marie : Je t’ai dit… Une fois, j’ai dit « petit jambon »…
Moi : En espagnol.
Marie : C’est ça…
Moi : Mais est-ce que papa et maman, des fois, ils te parlent à toi dans une autre langue que le
français ?
Marie : Anglais.
Moi : En anglais ? Tous les deux ?
299
Marie hoche la tête.
Moi : Beaucoup ?
Marie : Un ptit peu.
Moi : Un ptit peu. D’accord. Et c’est la seule langue qu’ils parlent ou ils parlent d’autres
langues papa et maman ? Tu sais ça ?
Marie : Euh… aussi… ils parlent euh… en langue de chat !
Moi : En langue de chat ?! C’est quoi la langue de chat ? Apprends-moi.
Marie se met à imiter le miaulement d’un chat.
Moi : Ok !!! D’accord ! Donc c’est les deux langues qu’ils parlent papa et maman.
Marie : Oui. Moi j’parle surtout bien chat.
Moi : Toi tu parles surtout bien chat. Tu parles avec ton chat à la maison ?
Marie : C’est un garçon.
Moi : D’accord. Comment il s’appelle déjà ?
Marie : Dindin.
Moi : Dindin, c’est vrai !
Marie : Et on lui a mis une piqûre pour pas qu’il fasse de bébés sinon on aura plein de bébés
qui renversera tout.
Moi : D’accord… Et alors est-ce que tu as des copains et copines, ou des voisins ou des
voisines, qui parlent d’autres langues que le français ?
Marie : J’ai que des voisines qui parlent français.
Moi : D’accord.
Marie : j’ai une voisine et une copine. Euh… J’raconte n’importe quoi, quatre copines.
Moi : T’as quatre copines. Et elles parlent toutes français. Et à l’école est-ce que t’as des
copains ou des copines qui parlent une autre langue que le français.
Marie : Non. Mais la maitresse elle sait parler beaucoup de langues.
Moi : C’est vrai ? Qu’est-ce qu’elle sait parler comme langues la maitresse ?
Marie : Euh… anglais, italien,… euh… aussi elle sait parler… en langue allemande comme
Hélène. Et aussi… français. Ça j’connais par cœur.
300
Moi : Donc ta maitresse elle parle anglais, italien, allemand, français ?
Marie : Oui.
Moi : ça y est ? Tu as fait le tour ? C’est la quatre langues qu’elle parle. Et donc des fois est-
ce qu’elle vous parle en anglais, en italien ou en allemand la maitresse à l’école.
Marie : En fait, une fois quand on faisait beaucoup beaucoup de bruit, elle parlait anglais.
Moi : D’accord.
Marie : pour que nous on comprendait rien. Moi j’comprendais une chose.
Moi : Qu’est-ce que tu avais compris ?
Marie : En fait j’avais rien compris une chose. C’était : [articulation impossible à transcrire].
Elle a fait ça comme bruit.
Moi : D’accord. Et alors comment tu sais qu’elle parle toutes ces langues-là la maitresse ?
Marie : Parce que. J’l’ai entendue.
Moi : Tu l’as entendue parler ces langues-là ?
Marie : En fait, elle a dit dans la classe tellement on faisait de bruit : « Vous voulez qu’je
parle anglais ? italien ? allemand, ou français ? ». Donc… Moi j’étais la seule à pas faire de
bruit.
Moi : Donc du coup qu’est-ce qu’elle a fait la maitresse ?
Marie : Elle m’a dit rien.
Moi : Alors est-ce qu’il y a des langues que tu entends même si tu les comprends pas, Ets-ce
qu’il y a des langues que tu entends tous les jours ?
Marie : Euh… non.
Moi : L’anglais tu l’entends jamais ?
Marie : Si ! A l’école.
Moi : Où ça autrement ?
Marie : Dans la classe de petite section.
Moi : Ils parlent anglais en petite section ?
Marie : Et en plus il y a une directrice. Elle s’appelle Catherine. Aussi elle a un autre nom.
301
Moi : Comment elle s’appelle autrement ?
Marie : Madame C.......
Moi : Et toi tu l’appelles comment ? Tu l’appelles Catherine ou Madame C…….. ?
Marie : Catherine.
Moi : D’accord. Et par exemple quand tu regardes la TV ou que tu écoutes de la musique, tu
écoutes que des choses en français ou tu écoutes des choses en anglais ou dans d’autres
langues ?
Marie : Français.
Moi : Que en français. D’accord. C’est qui tes chanteurs préférés ?
Marie : euh… aussi on apprend le jardin. Et aussi on a chanté aujourd’hui une musique de
Charles Trénet.
Moi : D’accord. C’est quoi cette musique ?
Marie : En fait, tu veux que j’te la chante ?
Moi : Oui, bien sûr !
Marie : « C'est un jardin extraordinaire:
Il y a des canards qui parlent anglais.
Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière
En me disant "Thank you very much, Monsieur Trenet".
On y voit aussi des statues
Qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on
Mais moi, je sais que, dès la nuit venue,
Elles s'en vont danser sur le gazon.
Papa, c'est un jardin extraordinaire:
Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet.
Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère.
Comme clients ils ont Monsieur le maire et le Sous-Préfet.
Il fallait bien trouver, dans cette grande ville maussade
Où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars,
Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade.
J'avoue que ce samedi-là je suis entré par hasard... ». Et voilà !
Moi : Pas mal !!! Bravo !!! Tu l’as connait très bien dis donc ! Tu chantes bien Marie. C’est
super ! Tu l’aimes bien cette chanson ?
Marie hoche la tête en esquissant un sourire.
Moi : Cool ! Alors si j’essaie de terminer avec ce qu’on disait toutes les deux : est-ce que par
exemple il y a des langues que tu as déjà vues écrites mais que tu ne comprends pas ?
302
Marie : En fait, une fois, avec Hélène, on a écrit des langues euh… italien.
Moi : Vous avez écrit en italien ? Ça utilise les mêmes lettres que le français ?
Marie : Non.
Moi : Non ? Alors t’es sûre que c’est de l’italien ?
Marie : Ouais ! Je m’en souviens. C’était super bizarre !
Moi : Ah oui ? Ça ressemblait à quoi les lettres ? Tu serais capable de m’en dessiner un ptit
bout là ? Tu te rappellerais ?
Marie : Euh… non.
Moi : Non ? Ok. Si tu veux on redemandera à Hélène lundi ce que c’était que tu avais dessiné.
Marie : C’était un lundi euh… un lundi euh… mmh. En mars. Mais le mars d’avant.
Moi : D’accord. Bah c’est pas grave, je pense qu’elle va s’en rappeler Hélène. On lui
demandera lundi, ok ? On lui demandera si c’était bien de l’italien ou si c’était autre chose
que tu avais dessiné.
Marie : Tu sais, quand t’avais euh… Alix, avec toi, et bien j’ai fait un rototo !
Moi : Oh ! Tu as dit pardon ?
Marie hoche la tête vivement.
Moi : Et bien tout va bien alors ! Pour terminer… est-ce que tu pourrais me dire quelles
langues tu aimerais apprendre plus tard ?
Marie : Quelles langues je voudrais apprendre plus tard… ?
Moi : Oui. Réfléchis bien. Quelles langues tu aimerais savoir parler ?
Marie : Allemand !
Moi : Allemand. D’autres langues ?
Marie : Italien !
Moi : Italien…
Marie : Mmmh.. anglais !
Moi : Ok…
Marie : euh… peuh… peuh… peuh… japonais !
303
Moi : Japonais tu voudrais parler ? Waouw ! Tu connais déjà des mots en japonais ?
Marie : Euh… à Paris tu sais c’qu’on a ?
Moi : Non.
Marie : Un restaurant japonais.
Moi : D’accord ! Et tu y manges bien ?
Marie : Oui, c’était super cool ! A part on mangeait avec des baguettes ! Chinoises !
Moi : Ah… ! Tu mangeais dans un restaurant japonais avec des baguettes chinoises ?
Marie : En fait, on est allé en haut, mais c’était des couverts de Nantes. Ils parlaient euh…
français. Sinon on comprendait rien. Sinon moi j’comprendrais plein plein plein de langues !!!
Moi : Donc tu aimerais apprendre le japonais. Et pourquoi tu aimerais apprendre l’allemand
ou l’italien ?
Marie : Parce que j’aime bien parler hein !
Moi : Donc c’est parce que tu aimes bien ces langues-là que tu aimerais les apprendre ?
Marie : Oooouuuuuuiiiiiii !!!!!!!!!!!!!
Moi : Et est-ce qu’il y en a d’autres que tu aimerais apprendre à part celles-là ou tu as fait le
tour ?
Marie : Euh… j’ai fait le tour !
Moi : Ok, très bien ! Alors ma dernière question, attention, est-ce que tu es prête ?
Marie hoche vivement la tête.
Moi : Est-ce que tu es déjà allée dans des pays autres que la France ? Est-ce que tu as déjà fait
des voyages ou tu es partie en vacances ?
Marie : J’suis partie en vacances chez mon papi et ma mamie. C’est à Nantes.
Moi : C’est à Nantes. Et est-ce que tu es déjà allée… tu m’as dit que étais allée à Nantes, à
Paris… Est-ce que tu es déjà allée ailleurs ?
Marie : A Disneyland Paris.
Moi : A Disneyland Paris…
Marie : J’suis allée deux fois.
Moi : D’accord. Et est-ce que tu es allée dans d’autres endroits ?
304
Marie secoue la tête.
Moi : D’accord. Donc tu es toujours restée en France. Ok.
Marie : Disneyland Paris c’est encore en France.
Moi : Oui, c’est encore en France. Tu aimerais aller visiter certains pays plus tard, toi ? Ets-ce
qu’il y a des pays que tu aimerais aller voir en voyage, en vacances ? Est-ce qu’il y a des pays
que tu aimerais visiter ?
Marie : L’Inde.
Moi : Tu aimerais visiter l’Inde ? Pourquoi ?
Marie : Euh… parce que j’aime bien.
Moi : Qu’est-ce qui te plaît ?
Marie : En Inde ?
Moi : Oui.
Marie : J’aime bien les lits douillets !
Moi : Les lits douillets. Ok.
Marie : Tout est douillet !
Moi : Et est-ce qu’il y a d’autres pays où tu aimerais aller ? Où tu aimerais voyager,
Marie : Bah euh…
Moi : ça peut s’arrêter là, je te demande juste au cas où s’il y a d’autres pays où tu aimerais
aller.
Marie : C’est tout !
Moi : C’est tout ! ok ça marche ! Est-ce que toi tu aimerais me dire d’autres choses ?
Marie : Non, c’est bon.
Moi : C’est bon ? Et bien on a fini, merci beaucoup Marie !
Entretien 4 : Lucien (Durée : 6 m 48 s)
Moi : Je vais te poser juste quelques petites questions qui ont rapport avec les langues… C’est
quoi les langues ? Tu sais c’que c’est ?
305
Lucien semble très timide et répond à mes questions en hochant ou secouant la tête.
Moi : Montrant la langue dans ma bouche – Tu crois qu’c’est cette langue-là ?
Lucien secoue la tête.
Moi : Chuchotant – Tu crois qu’c’est quoi ?
Lucien : Anglais.
Moi : Par exemple, oui, tu as raison, l’anglais c’est une langue. Et c’est quoi la langue que tu
parles depuis que tu es né toi ? Ta langue maternelle c’est quoi ?
Lucien : Français.
Moi : C’est le français, tu as raison. Et est-ce que tu parles d’autres langues que le français
toi ?
Lucien secoue la tête.
Moi : Non… Que le français. Ok. ET alors tu m’as déjà dit qu’à l’école tu apprenais…
Lucien : … l’anglais.
Moi : L’anglais. Tu en fais encore maintenant ?
Lucien : Oui.
Moi : Et est-ce que tu apprends d’autres langues que l’anglais à l’école ?
Lucien secoue la tête.
Moi : Non… Juste l’anglais ?
Lucien : Oui.
Moi : Et quand tu viens ici à l’Atelier du Coteau, quelles langues tu apprends ?
Lucien : Anglais.
Moi : Anglais aussi ? Et est-ce qu’il y en a d’autres ?
Lucien : Mmh…
Moi : C’est vrai on fait de l’anglais à l’Atelier du Coteau. Avec Mehregan est-ce que
Mehregan elle vous parle qu’en anglais ?
Lucien secoue la tête.
Moi : En quelle autre langue elle vous parle des fois ?
306
Lucien : Perse.
Moi : En perse, oui, c’est vrai. ET est-ce que ça lui arrive de parler dans d’autres langues ?
Lucien : Non.
Moi : Non ? On a fait l’tour ?
Lucien semble continuer à réfléchir. Il finit par hocher la tête timidement.
Moi : Oui ? Tu as le droit de me dire non hein si t’es pas d’accord et que tu penses qu’il en
manque on les rajoute. Si tu penses que c’est fini tu me dis alors c’est fini…
Lucien esquisse un sourire.
Moi : C’est fini ?
Lucien hoche la tête.
Moi : C’est fini ? Oui ? Alors, on a parlé des langues que tu apprends à l’école, les langues
qu’on apprend à l’Atelier du Coteau, ici. Est-ce que tu apprends des langues ailleurs ?
Lucien : Euh… non.
Moi : Non… D’accord. Est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà entendues mais que tu ne
comprends pas ?
Lucien : Espagnol.
Moi : Espagnol, tu l’as déjà entendu. Quand est-ce que tu as entendu de l’espagnol ?
Lucien : Mmh… dans un dessin animé.
Moi : En regardant un dessin animé. C’était quoi comme dessin animé ?
Lucien : Mmmh… Trois P’tits Cochons mais je sais p…
Moi : C’était en espagnol qu’on t’a raconté l’histoire ?
Lucien hoche la tête.
Moi : D’accord. Et est-ce qu’il y a une autre langue que tu as déjà entendue et que tu
comprends pas ?
Lucien : Mmh… non.
Moi : Non ? Ok. Est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà vu écrites mais que tu comprends
pas ?
Lucien secoue la tête.
307
Moi : Non ? Aucune aucune ?
Lucien secoue la tête à nouveau.
Moi : Non. D’accord. Dans ta famille, est-ce que papa et maman par exemple ils parlent
d’autres langues que le français ?
Lucien secoue la tête.
Moi : Non ? Pas du tout du tout ?
Lucien secoue la tête à nouveau.
Moi : Et euh… tes tontons, tes tatas, les papis et les mamies, les cousins et les cousines ? Non
plus ?
Lucien : Je sais pas.
Moi : Ok. C’est pas grave, ne t’inquiète pas. Et est-ce que par exemple à l’école ou euh… ou
chez les voisins tu as des amis, des copains et des copines qui parlent d’autres langues que le
français.
Lucien : Non.
Moi : Non. Pas du tout. Et est-ce qu’il y a des langues que tu aimerais apprendre ?
Lucien sourit et hoche la tête.
Moi : Lesquelles ?
Lucien : Mmmh… Espagnol.
Moi : Espagnol… Quoi d’autre ?
Lucien : Mmmh… mmmh… Euh… le russe !
Moi : Le russe. Pourquoi tu aimerais apprendre le russe ?
Lucien : Je sais pas.
Moi : Tu sais pas ? T’as envie ?
Lucien : Et aussi marocain ?
Moi : Le marocain tu voudrais apprendre… C’est une langue le marocain ?
Lucien sourit.
Moi : Est-ce que tu sais ?
308
Lucien : J’en connais des… J’connais des… Je connais bonjour.
Moi : Comment on dit « bonjour » en marocain ?
Lucien : « Salaam »
Moi : « Salaam » ! Oui, c’est bien ! C’est aussi de l’arabe en fait. C’est de l’arabe qu’on parle
au Maroc. Donc tu aimerais apprendre l’espagnol, le russe, le marocain. C’est tout ? ou il y a
en a d’autres que tu voudrais apprendre ?
Lucien : C’est tout…
Moi : D’accord. Est-ce que tu es déjà parti en vacances dans d’autres pays qu’en France ?
Lucien hoche la tête.
Moi : Dis-moi où…
Lucien : En Tunisie.
Moi : Waouw, la chance ! C’était chouette ? ça t’a plu ?
Lucien : Avec un grand sourire – Deux fois !
Moi : Deux fois en plus ? C’était pendant les grandes vacances ?
Lucien : Oui mais quand j’étais p’tit.
Moi : D’accord. Tu t’en rappelles bien ou pas du tout ?
Lucien : J’m’en rappelle. Il y avait la mer et il y avait des piscines.
Moi : Oh, super ! Tu t’étais bien amusé ?
Lucien : On n’est pas allé à la mer on est resté à la piscine.
Moi : D’accord. Ok. Est-ce que tu es allé dans d’autres pays à part la Tunisie ?
Lucien secoue la tête.
Moi : Non. D’accord. Est-ce qu’il y a des pays où tu aimerais aller ?
Lucien : Mmmh… dans les langues que j’ai dit.
Moi : Dans les langues que tu as dit ? Alors tu m’as dit espagnol, russe et marocain. Alors
l’espagnol, dans quel pays tu voudrais aller pour parler espagnol ?
Lucien : Je sais pas…
309
Moi : Tu sais pas ? En Espagne, en Argentine, au Pérou ? Au Chili ? Il y a plein de pays où on
parle espagnol ! En Russie tu aimerais aller ?
Lucien hoche la tête.
Moi : Et au Maroc ?
Lucien hoche la tête à nouveau.
Moi : D’accord. Donc dans les pays où tu connaitras les langues. C’est ça ?
Lucien hoche la tête une nouvelle fois. Il sourit.
Moi : D’accord. Je crois qu’on a fini. Merci beaucoup Lucien de m’avoir aidée !
Entretien 5 : Victor (Durée : 8 m 55 s)
Moi : Alors, j’ai quelques petites questions à te poser à propos… attention… des langues !
C’est quoi les langues ? – Montrant la langue dans ma bouche - C’est ça ?
Victor : Oui.
Moi : Oui ? Est-ce qu’il y a d’autres langues que la langue qu’on a dans notre bouche ?
Victor : Non.
Moi : Non, il n’y en a pas d’autres ? L’anglais c’est quoi ?
Victor : Bah si…
Moi : Aah, tu vois !
Victor : Mais j’connais l’anglais parce que toi j’te l’avais dit !
Moi : Ouais, ça je sais mais on est là pour parler de l’anglais et d’autres langues en même
temps.
Victor : Y a l’allemand, y a…
Moi: Alors justement.
Victor: Y a…
Moi: Attends, attends mon grand. Dis-moi déjà quelles langues tu sais parler. Quelles langues
tu parles ?
Victor : J’sais que parler français.
Moi : Tu sais que parler français. Et les langues que tu apprends à l’école ?
310
Victor secoue la tête.
Moi : Pas du tout tu m’as dit. Vous n’apprenez pas de langues à l’école.
Victor : Non.
Moi : Et les langues que tu apprends ici à l’Atelier du Coteau c’est quoi ?
Victor : Bah… plein de sortes.
Moi : Alors vas-y, dis-moi, lesquelles tu peux…
Victor : J’me rappelle plus !
Moi : Oh, j’te crois pas…
Victor : Bah je sais qu’aussi il y a déjà espagnol ou pas ?
Moi : Peut-être. Il y a de l’espagnol ou pas à l’Atelier du Coteau ?
Victor hoche la tête.
Moi : Oui. Quoi d’autre il y a ?
Victor : Allemand…
Moi : Allemand… Tu fais avec qui ça espagnol et allemand ?
Victor : Euh… avec Mehregan,
Moi : Avec Mehregan. D’accord. Alors espagnol, allemand, quoi d’autre ?
Victor : Euh… espagnol et allemand ça c’est plutôt avec Hélène hein.
Moi : Ah, c’est plutôt avec Hélène. Ok. Il y en a d’autres que tu fais avec Hélène ?
Victor : Oui !
Moi : Quoi d’autre ?
Victor : Italien. Euh… anglais.
Moi : Il y en a d’autres ?
Victor : Euh… J’pense pas.
Moi : Ok, donc ça c’est avec Hélène. Et avec Mehregan ?
Victor : Avec Mehregan euh… oui.
311
Moi : Qu’est-ce qu’on fait avec Mehregan comme langues ?
Victor : On parle parfois une autre langue… parfois on parle une langue … pour dire les
choses en anglais.
Moi : Parfois on parle dans une autre langue pour dire des choses en anglais ? C’est ça que tu
veux dire ?
Victor : Oui.
Moi : Donc on parle en anglais un peu dans les ateliers de Mehregan ?
Victor : Oui.
Moi : Et c’est quoi les autres langues ?
Victor : Bah d’autres langues. J’crois pas qu’y en a d’autres…
Moi : Tu crois pas qu’y en a d’autres ? Non ? On fait que de l’anglais avec Mehregan ?
Victor : Non, aussi y a euh… chuchotant – Italien je pense et euh… espagnol… euh…
Moi : Italien, espagnol. Avec Mehregan aussi ou c’est avec Hélène ça ?
Victor : Mehregan.
Moi : Avec Mehregan on fait aussi de l’italien, de l’espagnol…
Victor : … et puis…
Moi : Et puis ?
Victor : Euh… dans toutes les langues en fait !
Moi : Toutes les langues avec Mehregan ? Avec Mehregan on est d’accord ?
Victor : Oui.
Moi : Ok. Ça arche. Et m’as dit que toi, à part l’école et l’Atelier du Coteau tu vas apprendre
l’anglais ailleurs dans une école spéciale, c’est ça ?
Victor : Oui, mais ça tu sais ça !
Moi : Oui ça je sais ça déjà.
Victor : C’est pas une école spéciale en fait.
Moi : C’est quoi, tu te rappelles ?
312
Victor : En fait c’est un cours.
Moi : C’est un cours, d’accord.
Victor : C’est un cours où il faut apprendre à dire des trucs en anglais, on s’amuse à faire des
trucs, …
Moi : Et voilà ?
Victor : Oui.
Moi : Alors là maintenant on a fait le tour des langues que tu apprends. Est-ce qu’il y a des
langues que tu as déjà entendues mais que tu comprends pas forcément ?
Victor : Non.
Moi : Pas du tout du tout du tout du tout ?
Victor : Oui.
Moi : Même à la radio, à la TV,… ?
Victor : Euh… ouais.
Moi : Ouais, t’as jamais entendu autre chose que du français ?
Victor : Non.
Moi : D’accord. Et est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà vues écrites mais que tu
comprends pas forcément ?
Victor : Non.
Moi : Non. Ok. Dans ta famille est-ce qu’il y a des gens qui parlent d’autres langues que le
français ?
Victor : Euh… non.
Moi : Non ? Pas du tout ? Papa et maman ils parlent que français ils parlent pas, ils
connaissent pas d’autres langues ?
Victor : Si ils connaissent d’autres langues mais ils parlent pas anglais.
Moi : Ils parlent pas anglais.
Victor : Si ! Ils parlent anglais mais que à eux. Ils me parlent pas anglais parce que moi
j’connaissais pas l’anglais.
Moi : D’accord. Donc papa et maman ils parlent anglais. Est-ce qu’ils parlent d’autres
langues ?
313
Victor : Non.
Moi : D’accord. Tu les entends des fois parler anglais papa et maman ?
Victor : Non.
Moi : Ils parlent anglais entre eux ?
Victor : Oui.
Moi : Ou c’est pour leur travail ?
Victor : Ils parlent entre eux.
Moi : D’accord. Et est-ce que t’as des copains et des copines à l’école qui parlent d’autres
langues que le français ? A l’école ou au cours où tu vas ?
Victor : Non. J’pense pas.
Moi : Tu penses pas ?
Victor : Non. C’est que des Français.
Moi : Que des Français. Manolo par exemple il parle que français ?
Victor : Oui mais lui c’est un espagnol et euh… j’pense pas qu’il sait parler anglais. Mais y en
a un, Nathanael lui il sait parler dans toutes les langues.
Moi : Nathanael il sait parler dans toutes les langues ? Ah bon ? Tu l’as déjà entendu parler
dans toutes les langues.
Victor : Pas vraiment toutes, mais un p’tit peu.
Moi : D’accord. Tu sais le nom des langues qu’il sait parler Nathanael ?
Victor : Non. J’pense qu’il dit en fait n’importe quoi.
Moi : Ah bon, tu crois ? Peut-être, on ne sait pas. Et donc Manolo par exemple il parle pas
espagnol ?
Victor : Manolo, bah lui, je pense que… En fait l’année dernière, j’pense qu’il sait parler
espagnol.
Moi : Tu penses qu’il sait parler espagnol ? Mais tu l’as jamais entendu parler.
Victor : Non.
Moi : Ok dac. Ça marche. Et quelles sont les langues que tu aimerais apprendre plus tard ?
Est-ce qu’il y en a que tu aimerais apprendre ?
314
Victor : Oui !
Moi : Alors dis-moi.
Victor : J’aimerais bien apprendre le français.
Moi : Tu aimerais apprendre le français ? Mais tu sais déjà parler français ?!
Victor : Bah non ! Là j’parle anglais !
Moi : Tu parles anglais là ?
Victor se met à rigoler.
Moi : Ah bon ?
Victor : Non j’aimerais bien apprendre l’allemand.
Moi : Tu aimerais bien apprendre l’allemand…
Victor : Papa quand il était p’tit j’pense qu’il savait parler allemand.
Moi : D’accord. Donc c’est pour ça que tu aimerais apprendre l’allemand ?
Victor : Là j’suis en train d’apprendre l’anglais, j’sais déjà un peu parler anglais…
Moi : Oui. Et est-ce qu’il y a d’autres langues à part l’anglais et l’allemand que tu aimerais
savoir parler ?
Victor : Oh non ! oh non !
Moi : Oh non surtout pas ? Juste ça ?
Victor : Non… aussi il y a l’espagnol et puis l’allemand et puis euh…
Moi : Et puis quoi d’autre ?
Victor : Africain.
Moi : Africain ? Il y a une seule langue euh… il y a une langue qui s’appelle africain ?
Victor : Non. Non mais moi c’est…
Victor commence à tenir de moins en moins en place, il se met à de déplacer dans la pièce.
Moi : Alors dis-moi, est-ce que tu es déjà allé dans des pays à l’étranger ? Dans d’autres pays
que la France en vacances ?
Victor : Surtout pas ! J’suis juste allé en espagnol.
315
Moi : T’es déjà allé en espagnol ? Ou en Espagne ?
Victor : En Espagne !
Moi : En Espagne. C’était avec papa et maman ?
Victor : Oui. Et j’ai fait du bateau.
Moi : Waouw ! Tu sais où c’était en Espagne ?
Victor : Euh… oui. A Ibiza.
Moi : Waouw, à Ibiza ! J’ai juste une seule question à te poser, c’est la dernière. T’es prêt ?
Victor : Oui.
Moi : Quels pays toi tu aimerais visiter ? Si tu devais choisir de partir en voyage, dans quels
pays tu irais ?
Victor : C’que j’aimerais bien voir ?
Moi : Oui…
Victor : je voudrais voir l’Afrique.
Moi : L’Afrique, d’accord. Et c’est tout ? Ou tu as d’autres endroits où tu aimerais aller ?
Victor : Non, j’ai pas d’autres endroits.
Moi : Ok, et ben écoute c’est bon mon grand, merci beaucoup !
Entretien 6 : Thomas (Durée : 8 m 58 s)
Moi : J’ai des questions à te poser… sur les langues ! Tu sais c’que c’est les langues ?
Thomas : Oui.
Moi : C’est quoi les langues ?
Thomas : Euh… C’est… Euh…
Moi : C’est langue qu’on a dans la bouche ?
Thomas : Oui. Oui.
Moi : C’est ça ? Et est-ce qu’il y en a d’autres des langues que tu connais à part la langue
qu’on a dans la bouche ?
316
Thomas : La… la langue de Mehregan.
Moi : La langue de Mehregan, oui ! C’est quoi la langue de Mehregan ?
Thomas montre sa langue de son doigt.
Moi : Ah oui, la langue dans sa bouche !
Thomas : Elle a… Elle… derrière elle a la peau douce !
Moi : Derrière elle a la peau douce ?
Thomas : Derrière sa langue elle a la peau douce !
Moi : D’accord ! Alors moi en fait je voudrais te parler des langues que l’on parle. Tu sais ?
Par exemple le français ? C’est la langue dans laquelle on parle tous les deux !
Thomas : Ah ouais !
Moi : Et des fois avec Mehregan on chante des chansons dans d’autres langues. En quelles
langues par exemple on chante des chansons avec Mehregan ?
Thomas : On peut chanter « Dodo l’enfant do » hein !
Moi : Oui mais tu sais, avec Mehregan, dans les ateliers des fois on chante des chansons qui
sont pas en français ! Elles sont en quelle langue ?
Thomas : Elles sont euh… en langue … anglaise !
Moi : Oui en anglais par exemple ! C’est ça ! Tu as raison ! Alors, est-ce qu’il y a d’autres
langues qu’on fait dans les ateliers ?
Thomas : Ouais !
Moi : On fait quoi d’autre ?
Thomas : On fait… en français, une en… de chinoise…
Moi : En chinois aussi ? Avec Mehregan on fait du chinois ?
Thomas : Non.
Moi : Non pas avec Mehregan. Alors avec Mehregan qu’est-ce qu’on fait comme langue.
Thomas : On fait du chinois.
Moi : On fait du chinois ? Tu m’as dit non tout de suite. Qu’est-ce qu’on fait comme langues
Thomas avec Mehregan ?
Thomas : On fait une langue chinoise, une langue français et une langue anglais !
317
Moi : On fait du chinois, du français et de l’anglais avec Mehregan. C’est ça ?
Thomas hoche la tête.
Moi : Ok. Et alors, toi la langue que tu parles depuis tout petit c’est quoi ?
Thomas : Euh… la langue français ?!
Moi : Ouais, c’est la langue française, c’est vrai, tu as raison ! Et est-ce que tu apprends
d’autres langues à l’école ?
Thomas : Ouais j’apprends la langue français, langue anglais et langue euh… Et langue euh…
anglais et français.
Moi : Tu fais de l’anglais avec la maîtresse à l’école ?
Thomas : Euh… non, non.
Moi : Non ? Donc à l’école avec la maitresse vous parlez qu’en français ?
Thomas : Oui, qu’en français. Mais, mais ma maîtresse elle s’appelle Maud.
Moi : Oui, elle s’appelle Maud. D’accord.
Thomas : Elle veut toujours euh… qu’j’dessine des trucs.
Moi : Ah bon ? Ok ! Et alors est-ce que par exemple dans ta famille ton papa et ta maman ils
parlent d’autres langues que le français ?
Thomas : Euh… Mon papa il parle en français et ma maman elle parle un peu français et un
peu anglais.
Moi : Ta maman elle parle un peu français et un peu anglais, d’accord.
Thomas : Comme langue des chinoises.
Moi : Et la langue des Chinoises ?
Thomas : Oui.
Moi : Ta maman elle parle chinois ?
Thomas : Elle parle en chinois, en français et en anglais.
Moi : D’accord. Et euh… est-ce que t’as des copains qui parlent d’autres langues que le
français ? Des copains ou des copines ?
Thomas : Euh… tous les enfants parlent en français en fait, dans ma classe.
Moi : D’accord. Il n’y a pas de copain ou de copine qui parle d’autres langues ?
318
Thomas : Bah oui… Il y a une fille qui s’appelle Suki et qui parle anglais.
Moi : Suki elle parle en anglais ?
Thomas : Ouais.
Moi : D’accord. Et est-ce qu’il y a des langues que tu aimerais apprendre toi plus tard ?
Thomas : J’aime la langue français et j’aime la langue euh… anglais et… la langue chinoise.
J’aime bien la langue chinoise et la langue anglais et la langue euh… français.
Moi : Donc ça l’anglais, le français tu l parle déjà. Donc tu aimerais apprendre à parler anglais
et chinois. C’est ça ?
Thomas : Ouais.
Moi : Et tu sais déjà dire des choses en chinois ?
Thomas : Ouais.
Moi : Qu’est-ce que tu sais dire en chinois ?
Thomas : Euh… j’sais dire euh… « voiture » en chinois.
Moi : Comment on dit « voiture » en chinois ?
Thomas : Bah, j’sais pas !
Moi : Ah bon ! Ok.
Thomas : Mais maman elle m’a apprir comment dire en chinois ça.
Moi : D’accord, et tu te rappelles plus du mot en fait ?
Thomas : Bah, non.
Moi : D’accord. Alors j’ai deux p’tites questions pour finir… Est-ce que t’es déjà allé en
vacances dans d’autres pays que la France avec papa et maman ?
Thomas : Ouias ! J’suis allé en France et j’suis allé en avion !
Moi : T’es allé en avion ? ET tu es allé où en avion ?
Thomas : Euh... chez papa ?
Moi : Chez papa. Donc tu es resté en France ou c’était ailleurs ?
Thomas : Euh… non j’suis resté euh… En fait, en fait papa il était à Londres !
Moi : Ah ! Papa il était à Londres ! Et donc tu es allé le voir à Londres ?
319
Thomas : Oui.
Moi : D’accord !
Thomas : Mais il s’appelle euh… il s’appelle euh… Chanteur. Mais Chanteur c’est le nom de
la famille.
Moi : Qu’est-ce que tu as dit mon grand ? Je n’ai pas compris…
Thomas : Il s’appelle Franck ! Il s’appelle Franck mon père.
Moi : D’accord. Ton papa il s’appelle Franck. Et donc ton papa Franck il vivait à Londres
avant ?
Thomas : Hochant la tête – Non, il est toujours… avant il vivait… pas à Londres.
Moi : D’accord. Avant il vivait ailleurs. Il vivait en France ?
Thomas : Oui, il vivait en France.
Moi : Après il est parti à Londres ?
Thomas : Ouais, après on est parti à une maison qu’est toute bleue, et papa il est parti chez
une maison qu’est toute euh… - montrant le néon allumé - comme la lumière…
Moi : Toute blanche ?
Thomas : … oui, elle était toute blanche.
Moi : Ok. Donc ton papa il parle anglais aussi alors ?
Thomas : Ouais, ouais…
Moi : Un p’tit peu ?
Thomas : Un p’tit peu.
Moi : Ok. Et est-ce qu’il y a des pays où tu aimerais aller ? Où tu aimerais voyager plus tard ?
Thomas : Ah bah… [Lita ?] c’est le nom de la famille de nous.
Moi : D’accord, c’est votre nom de famille.
Thomas : Non ! Chanteur c’est notre nom de famille, et Lita c’est le nom de Maita, Maita
l’Amour.
Moi : D’accord. Et est-ce que tu as des pays où tu aimerais aller plus tard mon grand ?
Thomas : Dans des pays qui parlent français que j’aimerais bien aller !
320
Moi : C’est vrai ? Lesquels ?
Thomas : Bah… Ceux qui… ceux avec des gens en français.
Moi : Ceux avec des gens qui parlent en français, c’est ça que tu veux dire ?
Thomas : Ouais, c’est ça que je veux dire.
Moi : Tu as pas envie d’aller dans des pays où il y a des gens qui ne parlent pas forcément
français ? qui parlent anglais par exemple ?
Thomas : Ouais... J’voudrais aller dans des pays qui parlent pas en français, en anglais.
Moi : Des pays où on parle anglais.
Thomas : Ouais, ouais…
Moi : D’accord. Et il y a d’autres pays où tu aimerais aller ?
Thomas reste silencieux.
Moi : Donc tu aimerais aller dans des pays où on parle français ou anglais, c’est ça ? Je me
trompe pas ?
Thomas : Ouais, ouais…
Moi : D’accord.
Thomas : C’est juste que… En fait j’aime aller dans les pays de chinoise.
Moi : Oh, t’aimerais aller en Chine aussi ?
Thomas : Ouais.
Moi : C’est vrai ? Ce serait cool !
Thomas : et ! et ! et ! et ! ma mère elle est… avec un dessin animé qui s’appelle… qui
s’appelle euh… qui s’appelle Mulan ! Et Mulan, elle vit en chinoise !
Moi : C’est vrai, elle vit en Chine Mulan ! Donc c’est une Chinoise, tu as raison. Donc c’est
pour ça que tu aimerais bien aller en Chine ? Tu aimerais voir le pays de Mulan ?
Thomas : Elle parle un peu anglais et elle parle en chinoise aussi.
Moi : C’est vrai. Et bien tu sais quoi mon grand, je crois que tu as répondu à toutes mes
questions ! Merci beaucoup !
Entretien 7 : Arthaud (Durée 12 m 17 s)
321
Moi : Alors, Arthaud, pour mon travail moi je m’intéresse aux langues…
Arthaud : Aux langues ?!
Moi : C’est quoi les langues ?
Arthaud : Euh… bah euh… en fait euh… c’est… comment dire bah… les langues c’est les
différentes façons de parler dans le monde.
Moi : Oui c’est vrai, tu as raison.
Arthaud : Et y en a pas mal ! (rires)
Moi : On peut dire ça comme ça. Et y en a pas mal, oui, c’est vrai ! Alors toi Arthaud quelles
sont les langues que tu parles ?
Arthaud : Euh… le français… et… l’anglais.
Moi : D’accord, tu parles français et anglais…
Arthaud : Oui.
Moi : D’accord. Très bien. Et quelles sont les langues que tu apprends à l’école ?
Arthaud : Euh… l’anglais.
Moi : L’anglais. Et quand tu me dis que tu parles français et anglais, laquelle est ta langue
maternelle ?
Arthaud : Le français.
Moi : Le français, ok. A l’école tu apprends que l’anglais ou tu apprends d’autres langues ?
Arthaud : Euh… que l’anglais.
Moi : Que l’anglais, ok. Et à l’Atelier du Coteau, qu’est-ce que tu apprends comme langue
avec Mehregan ?
Arthaud : Le perse et l’anglais.
Moi : Le perse et l’anglais, ok. D’accord. Et est-ce qu’il y a des langues que tu apprends ni à
l’école, ni à l’Atelier du Coteau mais ailleurs ?
Arthaud : Non.
Moi : non. D’accord. Est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà entendues et que tu ne
comprends pas ?
Arthaud : Euh…
322
Moi : Tu sais par exemple une langue que tu aurais pu entendre par quelqu’un qui parle dans
la rue, ou à la TV, ou à la radio…
Arthaud : Ah bah des fois à la TV c’est pas des langues mais des fois au début des phrases
j’comprends rien. Par exemple y a quelqu’un qui faisait… une fois j’crois qu’il y avait
quelqu’un des Etats-Unis, j’comprenais rien. Et quelqu’un en Afrique...
Moi : D’accord. Quelqu’un aux Etats-Unis et quelqu’un en Afrique.
Arthaud : Enfin, j’suis pas sûr que c’était aux Etats-Unis mais… quelqu’un qui parle euh… de
quelque part dans le monde j’ai entendu quoi.
Moi : D’accord, donc ce serait à la TV. D’accord. Mais tu sais pas ce que c’est ces langues-
là ?
Arthaud : Si j’crois qu’une fois aux infos c’était d’l’anglais.
Moi : D’accord. Et est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà vu écrites mais que tu ne
comprends pas forcément ?
Arthaud : Euh… - Arthaud réfléchit pendant plusieurs secondes en silence. Oui il y a de
l’anglais.
Moi : L’anglais t’as déjà vu écrit. Quoi d’autre ?
Arthaud : Après sur des photos j’ai… Je crois qu’j’ai vu une… l’écriture… enfin j’crois que
c’était du vieux français.
Moi : Du vieux français…
Arthaud : Et aussi, j’crois, j’sais pas si c’est du latin mais… en tout cas j’sais le prononcer :
res ciprium.
Moi : En effet ça ressemble au latin !
Arthaud : Oui.
Moi : Ok. Il y en a d’autres que tu aurais vu écrites ?
Arthaud réfléchit.
Arthaud : Oui, du portugais, sauf que en fait c’est une image du drapeau du Paraguay mais
dessus il y a écrit du portugais.
Moi : Sur un drapeau du Paraguay ?
Arthaud : Oui, bah en fait il y a deux faces, et j’crois que c’est du Paraguay, euh… du
portugais.
323
Moi : C’est bizarre parce qu’au Paraguay on parle pas Portugais normalement, on parle
espagnol…
Arthaud : Ah, j’ai dû m’tromper alors…
Moi : C’est peut-être le drapeau du Brésil auquel tu penses ?
Arthaud : Je crois que j’ai dû me tromper mais en tout cas j’ai déjà vu l’écriture sur le drapeau
du Paraguay.
Moi : D’accord. Ok. Oh tu sais c’est pas grave. C’est pas des questions faciles que je pose,
non ?
Arthaud : En même temps j’pourrais regarder sur un livre parce que il y a marqué la langue.
Moi : Et ben écoute tu me diras alors ?
Arthaud : Oui.
Moi : On fait ça ?
Arthaud : Oui.
Moi : Ok, ça marche. Est-ce qu’il y a d’autres langues que tu as vu écrites ou tu penses que tu
as fait le tour ?
Arthaud : Euh… j’ai fait le tour.
Moi : Ok. Est-ce que dans ta famille il y a des gens qui parlent d’autres langues que le
français ? Par exemple ton papa, ta maman, ou tes oncles et tes tantes ?
Arthaud : Euh… oui papa j’crois qu’il parle un peu euh… En tout cas ma mère c’est sûr elle
parle portugais un peu.
Moi : D’accord.
Arthaud : Mon père peut-être qu’il parle… euh… les deux langues qui sont utilisées en
Belgique.
Moi : Les deux langues qui sont utilisées en Belgique.
Arthaud : Je crois, une des deux en tout cas.
Moi : Il est Belge ton papa ? Il est né en Belgique ?
Arthaud : Non, c’est mamie elle était Belge.
Moi : D’accord. Ta mamie elle était Belge.
Arthaud : Non sa mamie à lui.
324
Moi : Ah, sa mamie à lui, pardon. Donc ta… en fait la mamie de ton papa elle parlait les deux
langues qu’on parle en Belgique ?
Arthaud : Oui.
Moi : Tu connais les deux langues qu’on parle en Belgique ?
Arthaud : non. J’en connais une c’est le français et l’autre… j’sais plus mais en tout cas c’est
un nom un peu bizarre…
Moi : C’est la langue des Wallons.
Arthaud : Ah oui !
Moi : ça te dit quelque chose ?
Arthaud : Oui, peut-être.
Moi : D’accord. Donc en fait c’était ton arrière-grand-mère à ti.
Arthaud : Oui.
Moi : D’accord. Et il y a d’autres gens dans ta famille autrement qui parlent d’autres langues ?
Arthaud : Euh… sinon peut-être hein j’suis pas sûr, j’crois que mes parents aussi ils parlent
entre eux italien. J’suis pas sûr.
Moi : D’accord, t’es pas sûr.
Arthaud : Et aussi anglais.
Moi : Et aussi anglais. Ça t’es sûr ou pas ?
Arthaud : Oui, oui, ça j’suis sûr.
Moi : Et est-ce que t’as des amis à l’école ou chez les voisins qui parlent d’autres langues que
le français aussi?
Arthaud : Euh… que le français oui, j’ai un copain qu’habite pas loin de la maison… j’peux
dire son prénom ?
Moi : Si tu veux.
Arthaud : Il s’appelle Martin et il… comme il est allé en Italie un jour et bah… deux ans
j’crois, et ben il parle italien.
Moi : Martin qui parle italien, d’accord.
Arthaud : Et aussi assez bien italien et aussi assez bien anglais.
325
Moi : D’accord. Et t’as d’autres copains comme ça qui parlent d’autres langues que le
français ? Ou des copines d’ailleurs ?
Arthaud : Bah euh… non, j’crois pas.
Moi : Ok. Et alors dis-moi. Tu m’as dit que pour le moment tu apprends l’anglais, un peu de
perse aussi avec Mehregan, est-ce qu’il y a d’autres langues… alors est-ce… ça c’est des
langues que tu voudrais continuer à apprendre ? Est-ce qu’il y a d’autres langues que tu
aimerais apprendre ?
Arthaud : Bah… Silence.
Moi : T’as le droit de me dire non si t’as pas envie d’apprendre des langues. T’as le droit.
C’est juste pour savoir.
Arthaud : Je réfléchis… non.
Moi : Non ? Tu as pas spécialement envie d’apprendre des langues ?
Arthaud : Non.
Moi : Ok. Et est-ce que tu es déjà allé dans d’autres pays que la France ? En vacances par
exemple ?
Arthaud : Oui.
Moi : Et où ça tu es allé ?
Arthaud : Au Portugal, c’est tout.
Moi : Au Portugal, d’accord. Ta maman elle vient du Portugal ou elle a de la famille au
Portugal ?
Arthaud : Alors elle est née en France mais elle est un peu Portugaise parce que son père il
était Portugais.
Moi : D’accord ! Ok. Donc c’est ton grand-père à toi qui était portugais ?
Arthaud : Oui mais mon grand-père comme ils se sont séparés et ben, en fait euh…
Maintenant il vit avec une autre femme mais une fois on est allés les voir.
Moi : D’accord. Donc c’est à cette occasion-là que tu es allé au Portugal ?
Arthaud : Oui.
Moi : Ok. Et est-ce que tu es allé dans d’autres pays aussi ?
Arthaud : Non.
326
Moi : D’accord. Et est-ce qu’il y a des pays où tu aimerais aller plus tard ?
Arthaud : Ah si ! Un seul pays.
Moi : Ah ! Dis-moi.
Arthaud : L’Allemagne.
Moi : C’est un pays où tu aimerais aller ou où tu es déjà allé dans ce pays ?
Arthaud : Déjà allé.
Moi : D’accord. Tu es déjà allé en Allemagne.
Arthaud : J’étais allé dans un grand parc… oui un grand parc.
Moi : Un grand parc. C’était quoi comme parc ?
Arthaud : Une espèce de fête foraine…
Moi : D’accord.
Arthaud : J’sais pas si tu connais : EuropaPark ?
Moi : Si, j’connais.
Arthaud : C’est ça.
Moi : Donc tu es déjà allé à EuropaPark.
Arthaud : Oui.
Moi : Ok, ça marche. Et alors des pays… Est-ce qu’il y a des pays où tu aimerais aller, que tu
aimerais visiter ? Dans lesquels tu aimerais voyager ?
Arthaud : Oui, y en a beaucoup !
Moi : Alors dis-moi, j’écoute !
Arthaud : Et bien j’aimerais beaucoup aller en Grèce.
Moi : Oui…
Arthaud : En Italie.
Moi : D’accord.
Arthaud : Euh… - Arthaud poursuit sa réflexion en silence pendant plusieurs secondes.
Moi : En Grèce, en Italie…
327
Arthaud : Et euh… Aux Etats-Unis…
Moi : Ok.
Arthaud : Au Canada.
Moi : D’accord…
Arthaud : Euh… - Silence à nouveau. Euh… j’crois qu’c’est tout.
Moi : D’accord. Et pourquoi tu aimerais aller dans ces pays-là ?
Arthaud : Bah par exemple l’Italie il y a des beaux trucs antiques qui… qu’on peut voir… La
Grèce aussi… Et j’aime beaucoup ça.
Moi : ok. Et les Etats-Unis et le Canada ?
Arthaud : Bah e Canada j’aimerais bien voir Toronto, j’aimerais bien la visiter. Québec aussi.
Et Etats-Unis ce serait New-York… Et Monument Valley. C’est pas une ville mais c’est une
grande falaise.
Moi : Oui, je vois c’que tu veux dire. Tu connais des gens qui habitent là-bas ou c’est des
endroits que tu as vus à la TV ou…
Arthaud : C’est que… en fait c’est des villes qui m’intéressent. Par exemple à Toronto il y a
un monument qui m’intéresse beaucoup. Québec j’aimerais bien : peut-être qu’il y a un musée
qui rappelle et qui… qui montre la colonisation française sur cette partie. En plus ils ont fondé
cette ville ! Et donc euh… peut-être qu’il y a un endroit où c’est marqué le fondateur de la
ville. Après New-York parce qu’il y a aussi beaucoup d’autres monuments…
Moi : Tu aimes l’architecture en fait ou c’est l’Histoire plus que tu aimes ?
Arthaud : L’Histoire et l’architecture.
Moi : D’accord.
Arthaud : Et euh… Monument Valley parce que euh… en viture j’aimerais bien admiré les
molosses, les espèces de grosses statues de bloc.
Moi : D’accord, ok. Bon, c’est des supers idées tout ça ! On croise les doigts pour qu’un jour
tu puisses y aller !
Arthaud : Oui, peut-être !
Moi : Oui. Ok, super, merci beaucoup Arthaud. Tu vois, j’ai fini, à part si tu voulais me dire
quelque chose en plus ?
Arthaud : Bah… non.
328
Moi : Non ? ok, merci beaucoup en tout cas !
Entretien 8 : Maya (Durée : 10 m 59 s)
Moi : Aujourd’hui j’ai besoin de te poser des questions sur les langues. C’est quoi les
langues ?
Maya : Euh…
Moi : Tu sais ? Est-ce que je parle de la langue qu’il y a dans la bouche ?
Maya : Euh non.
Moi : Tu penses que j’parle de quoi comme langues ? Essaie de deviner.
Maya : La langue qu’on parle ?!
Moi : Oui, exactement, la langue qu’on parle ! Alors toi tu parles quoi comme langues Maya ?
Maya : Euh…
Moi : La langue que tu parles depuis que tu es née c’est quoi ?
Maya : Euh… euh…
Moi : Tu sais pas ?
Maya : Si euh…
Moi : Tu trouves pas le mot pour le dire ?
Maya : Euh, non.
Moi : Non tu trouves pas le mot ?
Maya : Oui.
Moi : D’accord, c’est pas grave, t’inquiète pas. Papa et maman ils parlent la même langue que
toi ?
Maya : Mm-mm.
Moi : Est-ce que la langue qu’on parle toutes les deux maintenant ?
Maya : Oui !
Moi : Oui. La langue que tu parles depuis toute petite, tu n’arrives pas à te rappeler de ce
nom ? Du nom de cette langue ?
329
Maya : Euh… euh… non.
Moi : Non. C’est le français ?!
Maya : Ah !!!
Moi : Ah, voilà c’est ça ! On est sauvées on a trouvé ! Et est-ce qu’il y a d’autres langues que
tu parles ?
Maya : Euh non.
Moi : Non. Ok, ça marche. Et est-ce qu’il y a des langues que tu apprends à l’école ?
Maya : Euh…
Moi : Est-ce que par exemple des fois avec le maitre ou la maitresse que tu as vous faites
autre chose que du français ?
Maya : Non.
Moi : Non, pas du tout ?
Maya secoue la tête.
Moi : Ok. Pas d’anglais, rien du tout ?
Maya : Rien.
Moi : Et ici dans les ateliers avec Mehregan, quelles langues tu apprends ?
Maya : Euh… Silence. Euh… tsss….
Moi : Tu sais par exemple dans les comptines qu’on chante… Est-ce que tu connais ces
langues-là ?
Maya : Non.
Moi : Non, pas du tout ? Par exemple tu sais dans la chanson « One, two, three, four, five,
once I caught a fish alive…. », tu sais ce que c’est cette langue-là?
Maya : Euh, non.
Moi : Et la langue de Mehregan ? La langue qu’elle parle depuis qu’elle petite tu sais ce que
c’est ?
Maya : Semblant un peu gênée - Euh, non.
330
Moi : D’accord, ok. C’est pas grave, ne t’inquiète pas, c’est juste pour te poser la question.
Alors, on a parlé des langues à l’école, les langues ici et ets-ce que tu apprends des langues
ailleurs qu’à l’école ou à l’Atelier du Coteau.
Maya : Euh, oui.
Moi : Oui ? Qu’est-ce que tu apprends comme langue ?
Maya : Euh… Silence. Maya semble gênée de ne pas répondre. Euh…
Moi : Tu sais pas ?
Maya : Non.
Moi : C’est pas grave tu sais. Ets-ce qu’il y a d’autres endroits où tu vas à part la maison,
l’école et l’Atelier du Coteau ?
Maya : Euh… euh… non.
Moi : Non ? Ok. Donc à part le français que tu parles déjà, tu n’apprends pas d’autres
langues ?
Maya : Euh… non.
Moi : Non. Ok, d’accord. Est-ce que tu peux me citer, enfin me dire des noms de langues que
tu connais, même si tu les parles pas, mais des noms de langues que tu connais ? On a parlé
du français… Quelles autres langues tu connais ?
Maya : Euh… espagnol.
Moi : Oui, l’espagnol tu as raison, c’est une langue. Tu en connais d’autres ?
Maya : Euh… euh… l’anglais ?
Moi : Oui, très bien !
Maya : Euh… le chinois.
Moi : Le chinois… Et bien tu en connais plein des langues alors ! Donc ces langues-là tu ne
les apprends pas en fait c’est juste des langues que tu connais comme ça ?
Maya hoche la tête.
Moi : Ok, d’accord, ça marche. Ets-ce que dans ta famille il y a des gens qui parlent d’autres
langues que le français ?
Maya : Oui…
Moi : Oui ? Alors qui parle quoi ? Dis-moi…
331
Maya : Mon papa parle anglais…
Moi : D’accord… Il parle d’autres langues ?
Maya : Euh, non, l’anglais et le français.
Moi : L’anglais et le français, ok. Il y a d’autres personnes qui parlent d’autres langues que le
français ?
Maya : Je sais pas.
Moi : Tu sais pas. En tout cas ton papa il parle anglais.
Maya : Oui.
Moi : ça t’arrive de parler en anglais avec lui ? Ou lui qui te parle en anglais ?
Maya : Des fois oui.
Moi : D’accord. Ok. Et est-ce que tu as des amis à l’école qui, par exemple, ou tu vois chez
tes voisins ou des copains et des copines à toi qui parlent d’autres langues que le français ?
Maya : Euh… euh… non.
Moi : Non ? Ok. Et est-ce qu’il y a des langues que tu aimerais apprendre plus tard ?
Maya : Oui…
Moi : Oui ? Lesquelles tu aimerais apprendre ?
Silence. Maya semble réfléchir.
Maya : Euh… la langue de Mehregan.
Moi: La langue de Mehregan tu aimerais bien apprendre ? Est-ce que tu sais comment elle
s’appelle la langue de Mehregan ?
Maya : Non…
Moi : C’est le perse, la langue de Mehregan.
Maya : Ah oui.
Moi : Donc tu aimerais bien apprendre cette langue-là. Pourquoi tu aimerais bien
l’apprendre ?
Maya : Euh… Long silence. Maya semble à nouveau gênée.
Moi : T’as le droit de pas avoir de raisons, c’est juste parce que tu as envie tu sais. Je te
demande ça si au cas où tu as des envies particulières.
332
Maya : Euh, non.
Moi : Non. Ok. Et est-ce qu’il y a d’autres langues que tu aimerais bien apprendre ?
Maya : Euh, oui… Non.
Moi : Non, ok. Ça marche. Est-ce que tu es déjà allée dans d’autres pays que la France ?
Maya : Euh… Non.
Moi : Non. Ok. Et est-ce qu’il y a des pays où tu aimerais aller, toi ?
Maya : La Chine…
Moi : La chine, oui. Pourquoi tu aimerais aller en Chine ?
Maya : Euh…
Moi : Qu’est-ce qui t’attire en Chine ?
Maya : Euh… euh… Silence à nouveau.
Moi : Il n’y a pas de mauvaise réponse hein Maya tu sais ma grande. Tu me dis, peut-être que
tu n’as pas de raison particulière ou peut-être c’est parce que tu as vu quelque chose à la TV
qui t’a donné envie d’aller en Chine par exemple ?
Maya : Non.
Moi : Non ? C’est juste que tu as envie comme ça d’aller en Chine.
Maya : Oui.
Moi : D’accord, ok. Et bien écoute je crois qu’on a fait le tour. Je voulais juste te demander si
tu avais des langues que tu avais déjà entendues ou vu écrites mais que tu ne comprends pas
forcément ? Est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà entendues à part le français ?
Maya : Anglais…
Moi : Oui, l’anglais, quoi d’autre ?
Maya : Euh… euh… rien d’autre.
Moi : Ok, l’anglais tu l’as entendu où ?
Maya : A la TV…
Moi : A la TV, oui, par exemple. Et où d’autre ? Que à la TV ?
Maya : Oui. Que à la TV.
333
Moi : D’accord ok, ça marche. Et il y a des langues que tu as déjà vu écrites avec des lettres
ou des signes ?
Maya : Euh, oui.
Moi : Lesquelles tu as déjà vues ?
Silence.
Maya : Euh… euh… celle en chinois.
Moi : En chinois tu as déjà vu du chinois écrit ?
Maya : Oui.
Moi : Est-ce que ça ressemble au français le chinois quand c’est écrit ?
Maya : Pas trop…
Moi : Non, tu as raison, c’est vrai, c’est un peu différent. Est-ce que tu as déjà vu d’autres
langues que le chinois ?
Maya : Euh… l’anglais.
Moi : L’anglais, tu l’as déjà vu écrit, d’accord.
Maya : Euh… et rien d’autre.
Moi : Et rien d’autre ! Le chinois tu l’as vu ? Je te demande par curiosité…
Maya : Euh… je sais plus trop…
Moi : Ton petit frère tout à l’heure il m’a parlé de Mulan.
Maya : C’est un film !
Moi : Oui, c’est un film ! Mais ça se passe où l’histoire de Mulan ?
Maya : En Chine.
Moi : En Chine, oui. C’est pas pour ça que tu as envie d’aller en Chine ?
Maya : Mm-mm.
Moi : Oui, c’est pour ça ? Tu aimes bien Mulan ?
Maya : Oui mais je sais qu’elle existe pas.
334
Moi : Bah non mais c’est pas parce qu’elle existe pas que ça te donne pas forcément envie
d’aller découvrir le pays où son histoire est née ! Non ? Donc ce serait pas dans Mulan que tu
aurais vu du chinois écrit par hasard ?
Maya : Euh, non.
Moi : C’était ailleurs ? Tu te rappelles plus où ?
Maya : Euh, non.
Moi : Ok, ce n’est pas grave. Merci tu m’as beaucoup aidée ! Merci beaucoup Maya !
Entretien 9 : Rosemay (Durée 9 m)
Moi : Alors, j’ai des petites questions à te poser sur les langues… C’est quoi les langues ?
Rosemay : Les langues c’est français… c’est anglais…
Moi : Oui, tout à fait, c’est de ces langues-là dont je parle. Toi c’est quoi la langue que tu
parles depuis que tu es toute petite ?
Rosemay : Le français !
Moi : D’accord, donc c’est ta langue maternelle le français. Eté st-ce que tu parles d’autres
langues que le français ?
Rosemay : En fait j’sais beaucoup de pays parce que papa il est né euh…
Moi : Dis-moi. Il est né où papa ?
Rosemay : Il est né en France aussi mais… il parle beaucoup anglais.
Moi : D’accord. Papa il parle beaucoup anglais. Et avec toi aussi il parle beaucoup anglais ?
Rosemay : Euh… pas souvent mais quand on vient ici il nous fait des petites devinettes en
disant un mot en anglais des fois.
Moi : D’accord, ok. Et est-ce qu’il parle d’autres langues ton papa que l’anglais ?
Rosemay : Non.
Moi : Non. Et ta maman elle parle des langues aussi ?
Rosemay : Oui elle parle des langues.
Moi : Elle parle quoi comme langues ta maman ?
335
Rosemay : Bah… plein de langues mais elle les a… je sais pas comment elle les a apprises
mais elle parle plein de langues quand elle veut, quand elle veut pas qu’on sache ce qu’elle dit
à papa et elle veut le dire à voix haute et elle le dit en anglais ou en autre langue.
Moi : D’accord, et tu sais pas ce que c’est ces autres langues ?
Rosemay : Non.
Moi : D’accord…
Rosemay : Des fois souvent elle parle anglais mais je sais pas…
Moi : D’accord, ok. Et est-ce qu’il y a d’autres membres de ta famille qui parlent des langues
étrangères ?
Rosemay secoue la tête.
Moi : Non ? Juste ton papa et ta maman… Ok, ça marche. Alors, toi tu m’as dit que tu parlais
français. Est-ce que tu apprends des langues à l’école ?
Rosemay : Non.
Moi : Non, pas du tout. Et c’est quoi les langues que tu apprends ici à l’Atelier du Coteau ?
Rosemay : Bah, un peu toutes les langues !
Moi : Un peu toutes les langues ! Alors lesquelles ?
Rosemay : Bah, l’anglais…
Moi : Oui, quoi d’autre ?
Rosemay : Euh… silence.
Moi : A l’Atelier du Coteau qu’est-ce qu’on fait comme langues ?
Rosemay : Je sais ! Il y a, il y a encore deux autres langues qu’on fait mais je sais pas, je sais
pas le mot.
Moi : D’accord, c’est pas grave. Est-ce que tu peux me décrire un peu ? C’est quoi les autres
langues qu’on fait ?
Rosemay : Bah la langue où Mehregan elle est née…
Moi : D’accord. Donc la langue avec laquelle Mehregan est née et l’autre langue, c’est quoi
l’autre langue ?
Rosemay : Je sais plus.
336
Moi : Tu sais plus, c’est pas grave. Hum… La langue de Mehregan tu n’arrives pas à te
rappeler de son nom ? Le nom de la langue de Mehregan tu n’arrives pas à t’en rappeler ?
Rosemay secoue la tête.
Moi : Non. Ça commence par un P. Non, ça ne te dit rien ? Ok, c’est pas grave, ne t’inquiète
pas, on va revenir dessus après. Est-ce qu’il y a d’autres langues que tu apprends ailleurs qu’à
l’école ou à l’Atelier du Coteau ?
Rosemay secoue la tête.
Moi : Non ? ok. Est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà entendues même si tu les
comprends pas forcément ?
Rosemay : Non mais j’ai vu, des fois des gens dans le tramway ou dans la rue qui parlaient
anglais et qui discutaient.
Moi : D’accord, dans le tramway ou dans la rue tu as déjà entendu de l’anglais. D’accord. Ok.
Et à la TV ou la radio par exemple tu as déjà entendu d’autres langues ?
Rosemay secoue la tête.
Moi : Non, ok. Et est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà vu écrites ? A la TV ? Sur des
publicités ?
Rosemay : oui j’ai déjà vu une autre langue qu’est écrite parce qu’on a des ateliers le mercredi
matin et puis on les fait.
Moi : D’accord. Et c’est quoi ces ateliers le mercredi matin ?
Rosemay : Bah ça dépend car de deux semaines et une fois on a fait un travail sur la Chine
pour réaliser un album, et puis une fois la maitresse elle nous a montré un gâteau chinois et
elle nous a donné la recette et elle était en chi… elle était écrite.
Moi : Elle était écrite en chinois ?
Rosemay hoche la tête.
Moi : Donc tu as déjà vu du chinois alors. D’accord ! Ok, c’est intéressant ça ! Et est-ce que
tu as déjà vu d’autres langues écrites ?
Rosemay : Euh… non.
Moi : Non ? Ok. Alors est-ce que tu as des copains et des copines qui parlent d’autres langues
que le français ?
Rosemay : Euh… non.
Moi : Non.
337
Rosemay : J’suis pas allée dans les autres langues.
Moi : Ok. Et est-ce qu’il y a des langues que tu aimerais apprendre ?
Rosemay : L’Allemagne…
Moi : Oui. Alors l’allemand du coup, l’Allemangne c’est le pays.
Rosemay : Oui.
Moi : D’accord, t’aimerais apprendre l’allemand. Et quoi d’autre ?
Rosemay : Et parler euh… En Suisse il y a un côté où on parle français et l’autre où on parle
une autre langue…
Moi : Où ça ?
Rosemay : En Suisse.
Moi : En Suisse. Alors en Suisse on parle français, on parle allemand, mais ça tu l’as déjà dit.
Et la troisième langue qui est en Suisse c’est quoi ?
Rosemay : J’sais plus…
Moi : Un peu d’italien peut-être ? Oui ? C’est ça l’autre langue que tu aimerais apprendre ?
Rosemay hoche la tête.
Moi : Oui ? Donc allemand et italien tu aimerais apprendre ? Est-ce qu’il y a d’autres langues
que tu aimerais apprendre plus tard ?
Rosemay : Non.
Moi : Et pourquoi tu aimerais les apprendre ces langues-là ?
Rosemay : Bah parce que j’pense que… je pourrais comment dire… le dire à l’école euh…
dans la cour avec mes copains et copines un peu jouer et un peu leur apprendre en même
temps les langues…
Moi : D’accord ! Et alors est-ce que tu es déjà allée dans d’autres pays que la France ? En
Vacances ? En voyage avec papa et maman par exemple ?
Rosemay : Non…
Moi : Non, pas du tout ?
Rosemay : Si je crois que j’suis allée à côté de la France dans la petite euh… la petite euh… -
Rosemay se lève et se met à dessiner une carte imaginaire avec ses doigts sur le mur à côté de
moi. Là il y a la France.
338
Moi : Ok, je vois la France.
Rosemay : Et puis là juste à côté c’est une petite euh… c’est une petite île-là…
Moi : Une petite île… Ah, ce serait pas la Corse par hasard ?
Rosemay : Si, j’crois…
Moi : Ah ! Donc tu es déjà allée en Corse.
Rosemay : Oui, pour aller voir ma copine. Mais elle parlait français.
Moi : D’accord. Est-ce que tu es déjà allée dans d’autres endroits en vacances ? A part la
Corse.
Rosemay : Non. J’suis déjà allée au ski, c’est un peu tout près des autres pays mais non.
Moi : D’accord. Ok. Et dans quels pays tu aimerais aller toi ? Est-ce qu’il y a des pays que tu
aimerais visiter plus tard ?
Rosemay : Oui.
Moi : Lesquels ?
Rosemay : Je sais plus comment ils s’appellent mais les pays… j’te donne quelques détails
peut-être que tu peux…
Moi : Oui, vas-y ! Je vais essayer de deviner. Vas-y dis-moi.
Rosemay : Ils portent des jupes…
Moi : Oui…
Rosemay : Avec euh… enfin où il y a des Vahinés…
Moi : Où il y a des Vahinés ? Ce serait pas du côté de Tahiti par exemple ? EN Nouvelle-
Calédonie,
Rosemay : Si, j’crois qu’une fois j’ai dit à papa j’veux aller dans le pays où il y a des Vahinés,
une fois j’ai dit ça à papa et maman. Parce que je me suis déjà déguisée en Vahiné et c’est très
beau.
Moi : D’accord. Donc c’est pour ça que tu aimerais aller dans le pays où il y a des Vahinés. Et
est-ce qu’il y a d’autres pays où tu voudrais aller ?
Rosemay secoue la tête.
Moi : Non ? Ok, ça marche. Bah écoute on a… tout fini ! Super ! Merci Rosemay !
Rosemay : Arthaud il t’a pas dit la même chose que moi !
339
Moi : Et bah parce que c’est pas parce que vous êtes frères et sœurs que vous allez dire la
même chose ! Vous êtes aussi important l’un que l’autre !
Entretien 10 : Adèle (Durée 4 m 19 s)
Moi : Adèle, je vais te poser quelques petites questions et je vais avoir besoin que tu me
répondes bien fort, ça t’ennuies pas ?
Adèle : Non…
Moi : Super ! Alors, les questions que je voulais te poser, c’est sur les langues. Pas la langue
qu’on a dans la bouche, les langues que l’on parle. Toi par exemple est-ce que tu connais la
langue que tu parles depuis que tu es toute petite ? Comment elle s’appelle cette langue ?
Adèle : Français.
Moi : C’est le français, tu as raison. Et est-ce que tu parles d’autres langues que le français ?
Adèle : Oui, un p’tit peu anglais.
Moi : Un p’tit peu anglais, d’accord. Est-ce que tu fais de l’anglais à l’école par exemple ?
Adèle : Hésitante - Non…
Moi : A l’école est-ce que tu fais d’autres langues que le français ?
Adèle secoue la tête.
Moi : Pas du tout. Et à l’Atelier du Coteau qu’est-ce que tu fais comme langues ? Ici avec
Mehregan qu’est-ce que tu fais ?
Adèle : Euh… rien.
Moi : Rien du tout ? On parle toujours qu’en français avec Mehregan ?
Adèle : Non…
Moi : Non ? Quelles autres langues on parle avec Mehregan ?
Adèle : On parle anglais…
Moi : Anglais… Est-ce qu’il y a d’autres langues qu’on parle avec Mehregan ?
Adèle secoue la tête.
Moi : Non ? D’accord. Est-ce que tu apprends des langues ailleurs qu’à l’école ou à l’Atelier
du Coteau ?
340
Adèle secoue la tête.
Moi : Non ? Est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà entendues ? A la TV, ou à la radio ou
dans la rue par exemple avec des gens qui parlent pas en français ?
Adèle hoche la tête.
Moi : Tu as déjà entendu d’autres langues que le français ?
Adèle hoche la tête à nouveau.
Moi : Si ? Est-ce que…
Adèle secoue la tête vivement.
Moi : Non, pas du tout. Ok. Est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà vu écrites ?
Adèle : Euh…
Moi : Sur des magazines, à la TV…
Adèle secoue la tête.
Moi : Pas du tout. Ok. Est-ce que dans ta famille il y a des gens qui parlent d’autres langues
que le français ? Par exemple ton papa et ta maman, qu’est-ce qu’ils parlent comme langues ?
Adèle : Français.
Moi : Français. Et c’est tout ? Ils parlent pas d’autres langues ton papa et ta maman ?
Adèle secoue la tête.
Moi : D’accord. Et les tontons, les tatas, les cousins, les cousines ?
Adèle secoue la tête à nouveau.
Moi : Non ? Et les papis, les mamies ?
Adèle secoue la tête encore une fois.
Moi : Non, tous le français ?
Adèle : Oui.
Moi : Ok, ça marche. Et est-ce que tu as des copains et des copines à l’école ou chez les
voisins par exemple qui parlent d’autres langues que le français ?
Adèle : Non.
341
Moi : Pas du tout, tout le monde parle français. Ok. Est-ce qu’il y a des langues que tu
aimerais apprendre toi plus tard quand tu seras grande ?
Adèle hoche la tête.
Moi : Lesquelles tu voudrais apprendre ?
Adèle : Je sais pas.
Moi : Tu sais pas ? Mais tu aimerais bien apprendre des langues quand même ?
Adèle hoche la tête à nouveau.
Moi : Et pourquoi tu aimerais apprendre des langues ?
Silence.
Moi : Pourquoi tu aimerais apprendre des langues Adèle ?
Adèle : Je sais pas.
Moi : Tu sais pas ? Mais tu as envie quand même ou pas du tout ? Tu as le droit hein tu sais, si
ça t’intéresse pas tu peux me le dire.
Adèle : Non.
Moi : Alors non quoi ? Tu as quand même envie ou tu as pas très envie d’apprendre des
langues ?
Adèle : J’ai pas très envie.
Moi : Tu as pas très envie, tu aimes pas trop ça ?
Adèle secoue la tête.
Moi : D’accord, t’aimes pas trop ça. Est-ce que tu es déjà allée dans d’autres pays que la
France en vacances ou en voyage avec papa et maman ?
Adèle secoue la tête encore une fois.
Moi : Non ? Où est-ce que tu es déjà allée en vacances ?
Adèle : Praz sur Arly.
Moi : Praz sur Arly, je connais pas. C’est en France ça aussi ?
Adèle : Oui.
Moi : Oui ? Et est-ce qu’il y a d’autres endroits où tu es allée en vacances ?
342
Adèle : Bah oui mais je m’en rappelle plus.
Moi : D’accord, c’est pas grave. Est-ce qu’il y a des pays où toi tu aimerais aller plus tard
quand tu seras grande ? Des endroits que tu aimerais visiter ?
Adèle hoche la tête en souriant.
Moi : Lesquels ?! Dis-moi ! Où est-ce que tu aimerais aller ?
Adèle : Je sais pas.
Moi : Tu sais pas… Ok, ça marche. Tu es sûre que tu sais pas ? Il n’y a pas de noms qui te
viennent en tête ?
Adèle secoue la tête.
Moi : Non, pas du tout ? Ok. Et bien écoute ma belle, c’est bon, on a fini, tu as été super
rapide ! Merci Adèle !
Entretien 11 : Rose (Durée 7m 17 s)
Moi : Tu sais quoi, j’ai quelques questions à te poser sur les langues ! Tu sais, pas la langue
que l’on a dans la bouche, mais les langues que l’on parle… ça te dit quelque chose ?
Rose hoche la tête.
Moi : Oui ? Alors je vais te poser des petites questions, c’est pas dur du tout ais il faut juste
que tu répondes bien fort pour que je t’entende bien. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses, c’est juste pour savoir ce que tu connais, ok ?
Rose hoche à nouveau la tête.
Moi : Alors, quelle langue tu parles depuis que tu es née toi, Rose ?
Rose : Euh…
Moi : Ta langue maternelle à ton avis c’est quoi ?
Rose : Gaga !
Moi : C’est quoi ? C’est Gaga ? C’est quoi cette langue ? C’est quoi cette langue-là ?
Rose : Euh…
Moi : C’est quoi la langue que tu parles depuis que tu es née ?
Rose : Euh…
Moi : Tu sais pas comment elle s’appelle ?
343
Rose hoche la tête.
Moi : Si ?
Rose secoue la tête.
Moi : Non, tu sais pas ? Est-ce que c’est la langue que l’on parle toutes les deux là
maintenant ?
Rose : Non.
Moi : Non, c’est une autre langue que tu parles ? Mais tu te rappelles pas du nom ?
Rose : Oui.
Moi : D’accord. Est-ce que tu apprends des langues à l’école ?
Rose : Euh… non.
Moi : Non ? Et à l’Atelier du Coteau on fait quoi comme langues ?
Rose : Euh…
Moi : Là quand on parle toutes les deux c’est quoi cette langue-là qu’on utilise ?
Rose : C’est le français.
Moi : C’est le français, tu as raison. Alors est-ce qu’on fait que du français avec Mehregan ?
Rose : Non…
Moi : Qu’est-ce qu’on fait d’autre comme langues ?
Rose : De l’anglais.
Moi : Oui, on fait de l’anglais. On fait quoi d’autre ?
Rose : Euh…
Moi : Tu sais ?
Rose secoue la tête.
Moi : Non ? Juste on fait que de l’anglais ou est-ce qu’il y a d’autres langues ?
Rose : On fait que de l’anglais…
Moi : Que de l’anglais tu penses ? D’accord. Et est-ce que tu apprends des langues ailleurs
qu’à l’école ou à l’Atelier du Coteau ?
344
Rose : Euh… non.
Moi : Non, d’accord. Est-ce qu’il y a des langues que tu as déjà entendues ? A la radio ? A la
TV ? Dans la rue ? Même si tu ne les comprends pas, est-ce qu’il y en a que tu as déjà
entendues ?
Rose : Euh… non.
Moi : Non, pas du tout ?
Rose : De l’anglais.
Moi : Un petit peu d’anglais ? Oui ? Où ça tu as entendu de l’anglais ?
Rose : Dans la voiture.
Moi : Dans la voiture tu entends de l’anglais. Dans les musique, dans les chansons ?
Rose : Oui.
Moi : Et oui on entend beaucoup de musiques où on chante anglais dedans, c’est vrai, tu as
raison. Ets-ce qu’il y a d’autres langues que tu as déjà entendues à part l’anglais ?
Rose : Euh… oui.
Moi : Oui ? Lesquelles ?
Rose : « Joyeux anniversaire » en anglais.
Moi : « Joyeux anniversaire » en anglais, d’accord. Est-ce que tu as déjà entendu jouer
« Joyeux anniversaire » dans une autre langue que l’anglais ?
Rose secoue la tête.
Moi : Non. D’accord, très bien. Est-ce qu’il y a déjà des langues que tu as vu écrites ?
Rose secoue la tête.
Moi : Non ? Pas du tout ? Sur des publicités ou à la TV par exemple ?
Rose : Non.
Moi : Non, d’accord. Et dans ta famille est-ce qu’il y a des gens qui parlent d’autres langues
que le français ?
Rose : Euh, non.
Moi : Ton papa et ta maman par exemple ils parlent que français ou ils savent parler d’autres
langues ?
345
Rose : Ils parlent que français.
Moi : Que français, d’accord, ça marche. Et est copains et tes copines à l’école ou chez tes
voisins, est-ce que certains d’entre eux parlent d’autres langues que le français ?
Rose : Euh… non.
Moi : Non, ok. Est-ce qu’il y a des langues que tu aimerais apprendre plus tard quand tu seras
grande ?
Rose : Oui.
Moi : Lesquelles tu aimerais apprendre ?
Rose : L’anglais…
Moi : L’anglais… Il y en a d’autres que tu aimerais apprendre ?
Rose secoue la tête.
Moi : Non ? Pas du tout du tout ?
Rose : Oui.
Moi : Juste l’anglais. Et pourquoi tu aimerais apprendre l’anglais ?
Rose : Parce que j’ai envie d’être Anglaise…
Moi : Parce que tu as envie d’être Anglaise ! C’est vrai ça ?
Rose hoche la tête vivement avec un grand sourire.
Moi : Qu’est-ce qui te plaît dans le fait d’être Anglaise ?
Rose : Comme ça les autres il comprendra rien…
Moi : Comme ça les autres ils comprendront rien. D’accord. C’est pour garder des secrets en
fait alors ?!
Rose sourit et hoche la tête.
Moi : Ah ! Je vois ! D’accord. Est-ce que tu es déjà allée dans d’autres pays avec papa et
maman par exemple en vacances ou en voyage ?
Rose : Oui, quand j’étais petite.
Moi : Où est-ce que tu es allée quand tu étais petite ?
Rose : En Espagne j’ai acheté une r…, un déguisement d’Espagnole.
346
Moi : C’est vrai ?! Super !!! T’es déjà allée en Espagne ! Et il est de quelle couleur ton
déguisement d’Espagnole ?
Rose : Noir et rouge !
Moi : Noir et rouge ! Et il a des petits points dessus ?
Rose hoche la tête avec un sourire de plus en plus grand.
Moi : Oui ? C’est une grande robe ?
Rose : Oui, mais maintenant elle est trop petite…
Moi : Ah… dommage…
Rose : C’est quand j’avais trois ans.
Moi : D’accord. Et en Espagne est-ce que tu sais ce qu’on parle comme langue ?
Rose : Euh… non.
Moi : Est-ce qu’on parle français en Espagne ?
Rose : Non.
Moi : Non, on parle espagnol en fait en Espagne. C’est une langue que tu aimerais apprendre
aussi ou pas du tout ?
Rose : J’aimerais l’apprendre !
Moi : T’aimerais bien ? Pourquoi tu aimerais bien ?
Rose : Parce que, parce que j’aimerais bien être une princesse… !
Moi : Oh, et les princesses elles parlent espagnol ?
Rose : Oui.
Moi : C’est parce que tu voudrais être une princesse avec une robe d’espagnol, c’est pour ça ?
Rose : Avec un grand sourire – Oui !
Moi : Waouw ! Moi aussi j’aimerais bien être une princesse avec une robe d’Espagnole !
C’est chouette ! Alors ça on a dit que c’est dans les langues que tu aimerais apprendre.
L’espagnol. Ça c’est super ! Et il y a d’autres pays dans lesquels tu es allés ?
Rose : Euh… non.
Moi : Non ? Que l’Espagne, d’accord. Et est-ce qu’il y a des pays où tu aimerais aller plus
tard ? Que tu aimerais visiter ?
347
Rose : Euh… oui.
Moi : Lesquels ?
Rose : Euh… j’aimerais bien aller en Chine !
Moi : Tu aimerais bien aller en Chine ?! Waouw, c’est un grand voyage ça ! Pourquoi tu
voudrais aller en Chine ?
Rose : Parce que j’aimerais bien avoir les yeux comme ça – Elle tire avec ses index sur
l’extrémité de ses yeux pour les allonger comme des yeux bridés.
Moi : Oh tu voudrais avoir des yeux tout fins comme ça ?! Ah ! Tu trouves ça joli ?
Rose hoche vivement la tête.
Moi : D’accord, donc en fait tu serais une princesse, avec les yeux tout fins comme une
Chinoise, et une robe d’Espagnole ?
Rose : Oui (rires).
Moi : C’est ça ? Waouw ! Super ! Et est-ce qu’il y a d’autres pays où tu aimerais aller ?
Rose : Non.
Moi : Non, ok. Bah super ! On a fini, merci beaucoup ! Tu m’as beaucoup aidée là minette !
348
Annexe 9 : Questionnaire à destination des parents
Questionnaire au sujet des AAM multi-activités Ce questionnaire a pour but d’enrichir mon travail de recherche sur l’apport des pratiques artistiques à l’éveil aux langues et aux cultures. Il me permettra de mieux comprendre les relations qu’entretient votre enfant avec les arts et les langues ainsi que vos attentes envers les ateliers multi-activités multilingues. Il permettra également à l’Atelier du Coteau de faire le point sur ces ateliers à la lumière de vos réponses et suggestions. Les questions marquées « bis » ou « ter » complètent la question précédente. Par exemple, si vous avez répondu « non » à la question 2, vous pouvez passer directement à la question 3, sans répondre à la question 2bis. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter par mail à l’adresse suivante : [email protected]. Je me tiens également à votre disposition à l’Atelier du Coteau lors des ateliers multi-activités multilingues de Mehregan. Merci pour votre participation.
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………… Sa date de naissance : …………………………………………….. Sa classe : ………………………………………. Son école : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Prénoms des parents : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Profession(s) des parents : père ……………………………………………………………..
mère…………………………………………………………….. Quartier d’habitation : ……………………………………………………………………………………………………………………….
1. A quel(s) atelier(s) multi-activités multilingues votre enfant participe-t-il ?
o Mardi 17h-18h o Mardi 18h-19h o Mercredi 17h-18h
o Vendredi 17h-18h o Vendredi 18h-19h
2. Participe-t-il à d’autres ateliers proposés par l’Atelier du Coteau ?
o Oui o Non 2bis. Si oui, au(x)quel(s) ?
o Atelier musique multilingue : o Lundi 17h-18h o Lundi 18h-19h o Jeudi 17h-18h o Jeudi 18h-19h
o Atelier arts plastiques
o Atelier théâtre o Cours de danse o Autre, merci de
préciser :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Depuis quand votre enfant est-il inscrit à ces ateliers ? (merci de préciser pour chaque
atelier le mois et l’année d’inscription) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
349
4. Pour les parents dont les enfants participent aux ateliers des lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l’école, votre enfant est-il inscrit au service de pedibus ? o Oui o Non
5. Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à inscrire votre enfant aux
ateliers artistiques multilingues de l’Atelier du Coteau ? Merci de cocher 4 réponses maximum. o Par commodité pour que votre enfant soit récupéré à l’école et gardé en attendant
votre retour du travail o Parce que c’est un centre de loisirs proche de chez vous o Parce que les tarifs sont accessibles
o Surtout pour qu’il fasse des activités artistiques o Surtout pour qu’il découvre des langues et cultures étrangères o Surtout pour qu’il apprenne des langues étrangères
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures de manière ludique o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures par le biais des arts
o Autre(s), merci de préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Votre enfant parle-t-il couramment une autre langue que le français ?
o Oui, laquelle/lesquelles ? : …………………………………………………………………………………………………………
o Non
7. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) à l’école ?
o Oui, merci de préciser la/les langue(s) concernée(s) : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
o Non 7bis. Si oui, à quelle fréquence ?
30 min 1 heure 1h30 Autre, merci de préciser :
Par semaine
Une semaine sur deux
Par mois Autre, merci de préciser :
350
8. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) en dehors de l’école et de l’Atelier du Coteau ? o Oui, dans un centre de langues o Oui, dans une association de
quartier o Oui, avec un professeur particulier o Oui, avec une nourrice ou un(e)
baby-sitter
o Oui, dans un autre cadre, merci de préciser : …………………………………………………………………………………………………………
o Non
8bis. Quelle(s) langue(s) apprend-il dans ce cadre ? .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8ter. A quelle fréquence ?
30 min 1 heure 1h30 Autre, merci de préciser :
Par semaine
Une semaine sur deux
Par mois
Autre, merci de préciser :
9. Quelle est votre langue maternelle ? Père : ……………………………….…………………… Mère : ……………………………………………………… 10. Avez-vous appris des langues étrangères durant votre vie ? Merci de préciser vos prénoms si vos réponses sont différentes.
o Oui, laquelle/lesquelles : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o Non
10bis. Utilisez-vous ces langues avec votre enfant ? o Oui (merci de préciser la ou les
langues concernées : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….)
o Non
10ter. Si oui, pouvez-vous préciser de quelle manière ? Par exemple, si vous lui parlez exclusivement dans cette/ces langues, si vous utilisez quelques mots de temps en temps… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
351
11. Avez-vous déjà voyagé à l’étranger avec votre enfant ? o Oui, dans le(s) pays suivant(s) :
……………………………………………………………………………………………...
o Non
12. Qu’attendez-vous des ateliers multi-activités multilingues pour votre enfant ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13. Quelles sont vos impressions aujourd’hui sur ces ateliers ? Répondent-ils à vos
attentes ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14. Qu’est-ce que ces ateliers ont apporté à votre enfant jusqu’à aujourd’hui ?
Par exemple, le trouvez-vous plus curieux ? Plus en confiance ? Plus à l’aise au contact des autres ? Lui arrive-t-il de s’exprimer spontanément en langue étrangère lorsqu’il est avec vous ? Semble-t-il s’épanouir ou au contraire s’ennuyer dans les ateliers ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15. Quelles suggestions aimeriez-vous apporter pour enrichir les ateliers ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
352
Annexes 9.1 : Questionnaires reçus
Questionnaire au sujet des AAM multi-activités
Prénom de l’enfant : Adèle Sa date de naissance : 31/01/2010 Sa classe : moyenne section Son école : La contrie Prénoms des parents : Noémie et Gildas Profession(s) des parents : père : Informaticien Mère : Chargée ressources humaines Quartier d’habitation : Contrie
1. A quel(s) atelier(s) multi-activités multilingues votre enfant participe-t-il ?
o Mardi 17h-18h o Mardi 18h-19h
Mercredi 17h-18h
o Vendredi 17h-18h o Vendredi 18h-19h
2. Participe-t-il à d’autres ateliers proposés par l’Atelier du Coteau ?
o Oui Non 3. Depuis quand votre enfant est-ilinscrit à ces ateliers ? (merci de préciser pour chaque
atelier le mois et l’année d’inscription) Depuis cette année 4. Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à inscrire votre enfant aux
ateliers artistiques multilingues de l’Atelier du Coteau ? Merci de cocher 4 réponses maximum. o Par commodité pour que votre enfant soit récupéré à l’école et gardé en attendant
votre retour du travail o Parce que c’est un centre de loisirs proche de chez vous o Parce que les tarifs sont accessibles
Surtout pour qu’il fasse des activités artistiques
Surtout pour qu’il découvre des langues et cultures étrangères o Surtout pour qu’il apprenne des langues étrangères
Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des cultures de manière ludique
Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des cultures par le biais des arts
o Autre(s), merci de préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
353
5. Votre enfant parle-t-il couramment une autre langue que le français ? o Oui, laquelle/lesquelles ? :
…………………………………………………… Non
6. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s)à l’école ?
o Oui, merci de préciser la/les langue(s) concernée(s) : ……………………………………………………
Non
7. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) en dehors de l’école et de l’Atelier du Coteau ? o Oui, dans un centre de langues o Oui, dans une association de
quartier o Oui, avec un professeur particulier o Oui, avec une nourrice ou un(e)
baby-sitter
o Oui, dans un autre cadre, merci de préciser : …………………………………………………………………………………………………………
Non
8. Quelle est votre langue maternelle? Père : français Mère : français 9. Avez-vous appris des langues étrangères durant votre vie ? Merci de préciser vos prénoms si vos réponses sont différentes.
Oui, laquelle/lesquelles : principalement anglais
o Non
9bis. Utilisez-vous ces langues avec votre enfant ?
o Oui (merci de préciser la ou les langues concernées) : ………………………………………………
Non
10. Avez-vous déjà voyagé à l’étranger avec votre enfant ? o Oui, dans le(s) pays suivant(s) :
……………………………………………… Non
11. Qu’attendez-vous des ateliers multi-activités multilingues pour votre enfant ? Divertissement Art plastiques activités linguistiques pluralité des activités proposées 12. Quelles sont vos impressions aujourd’hui sur ces ateliers ? Répondent-ils à vos
attentes ? oui
354
13. Qu’est-ce que ces ateliers ont apporté à votre enfant jusqu’à aujourd’hui ?
Par exemple, le trouvez-vous plus curieux ? Plus en confiance ? Plus à l’aise au contact des autres ? Lui arrive-t-il de s’exprimer spontanément en langue étrangère lorsqu’il est avec vous ? Semble-t-il s’épanouir ou au contraire s’ennuyer dans les ateliers ?
…pas de changement de comportement flagrant …Par contre une envie récurrente de peindre, faire du coloriage, du découpage 14. Quelles suggestions aimeriez-vous apporter pour enrichir les ateliers ?
RAS
355
Questionnaire au sujet des AAM multi-activités
Prénom de l’enfant : AGATHE Sa date de naissance : 05/02/2008 Sa classe : CP Son école : ECOLE DE LA FRATERNITE Prénoms des parents : ESTELLE et ERIC Profession(s) des parents : père INGENIEUR COMMMERCIAL
mère ASSISTANTE COMMERCIALE Quartier d’habitation : NANTES ZOLA
1. A quel(s) atelier(s) multi-activités multilingues votre enfant participe-t-il ?
o Mardi 17h-18h o Mardi 18h-19h o Mercredi 17h-18h
o Vendredi 17h-18h o Vendredi 18h-19h
2. Participe-t-il à d’autres ateliers proposés par l’Atelier du Coteau ?
o Oui o Non 3. Depuis quand votre enfant est-il inscrit à ces ateliers ? (merci de préciser pour chaque
atelier le mois et l’année d’inscription) Depuis Septembre 2013 : Atelier Arts Plastiques De Septembre 2013 à Juin 2014 : Atelier Chant et Musique le lundi de 16h à 18h 4. Pour les parents dont les enfants participent aux ateliers des lundis, mardis, jeudis
et/ou vendredis après l’école, votre enfant est-il inscrit au service de pedibus ? o Oui o Non
5. Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à inscrire votre enfant aux
ateliers artistiques multilingues de l’Atelier du Coteau ? Merci de cocher 4 réponses maximum. o Par commodité pour que votre enfant soit récupéré à l’école et gardé en attendant
votre retour du travail o Parce que c’est un centre de loisirs proche de chez vous o Parce que les tarifs sont accessibles
o Surtout pour qu’il fasse des activités artistiques o Surtout pour qu’il découvre des langues et cultures étrangères o Surtout pour qu’il apprenne des langues étrangères
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures de manière ludique o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures par le biais des arts
356
o Autre(s), merci de préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Votre enfant parle-t-il couramment une autre langue que le français ?
o Oui, laquelle/lesquelles ? : ……………………………………………………
o Non
7. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) à l’école ?
o Oui, merci de préciser la/les langue(s) concernée(s) : ……………………………………………………
o Non
8. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) en dehors de l’école et de l’Atelier du Coteau ? o Oui, dans un centre de langues o Oui, dans une association de
quartier o Oui, avec un professeur particulier o Oui, avec une nourrice ou un(e)
baby-sitter
o Oui, dans un autre cadre, merci de préciser : …………………………………………………………………………………………………………
o Non
9. Quelle est votre langue maternelle ? Père : FRANÇAIS Mère : FRANÇAIS 10. Avez-vous appris des langues étrangères durant votre vie ? Merci de préciser vos prénoms si vos réponses sont différentes.
o Oui, laquelle/lesquelles : ANGLAIS pour les parents ; ALLEMAND pour la maman
o Non
10bis. Utilisez-vous ces langues avec votre enfant ?
o Oui (merci de préciser la ou les langues concernées : mais rarement l’anglais
o Non
10ter. Si oui, pouvez-vous préciser de quelle manière ? Par exemple, si vous lui parlez exclusivement dans cette/ces langues, si vous utilisez quelques mots de temps en temps… mots de temps en temps et jeux 11. Avez-vous déjà voyagé à l’étranger avec votre enfant ?
o Oui, dans le(s) pays suivant(s) : république dominicaine . Projet d’aller à Londres
o Non
357
12. Qu’attendez-vous des ateliers multi-activités multilingues pour votre enfant ? Qu’Agathe fasse une activité artistique en langue étrangère ; pourquoi pas avec plusieurs langues mais l’anglais en priorité. L’an dernier, nous avions apprécié les chansons en langue étrangère qui sont aussi un moyen ludique de s’initier à d’autres langues ; il y en avait dans tous les cours et Agathe appréciait cela. 13. Quelles sont vos impressions aujourd’hui sur ces ateliers ? Répondent-ils à vos
attentes ? Agathe prend beaucoup de plaisir à pratiquer les arts plastiques le vendredi (même si elle semble moins enthousiaste par les photos en extérieur -> c’est peut-être lié à la fatigue du vendredi soir…) L’atelier correspond à nos attentes. Toutefois, Agathe ne nous fait pas de retour sur des mots en langue étrangère et nous ne savons pas si elle pratique un peu. (exemple : les couleurs, les formes … pour les arts plastiques). 14. Qu’est-ce que ces ateliers ont apporté à votre enfant jusqu’à aujourd’hui ?
Par exemple, le trouvez-vous plus curieux ? Plus en confiance ? Plus à l’aise au contact des autres ? Lui arrive-t-il de s’exprimer spontanément en langue étrangère lorsqu’il est avec vous ? Semble-t-il s’épanouir ou au contraire s’ennuyer dans les ateliers ?
Voir réponse 13. 15. Quelles suggestions aimeriez-vous apporter pour enrichir les ateliers ? Continuer à pratiquer l’activité artistique en mettant plus en avant les langues étrangères ; et pourquoi pas une chanson en langue étrangère …
358
Questionnaire au sujet des AAM multi-activités Prénom de l’enfant : Alix Sa date de naissance : 23 juin 2010 Sa classe : Moyenne section de maternelle Son école : Ecole maternelle publique Maisdon Pageot Prénoms des parents : Lily et Franck
Profession(s) des parents : père : Ingénieur informatique mère : Magistrate Quartier d’habitation : Canclaux / Procé
1. A quel(s) atelier(s) multi-activités multilingues votre enfant participe-t-il ?
o Mardi 17h-18h o Mardi 18h-19h o Mercredi 17h-18h
o Vendredi 17h-18h o Vendredi 18h-19h
2. Participe-t-il à d’autres ateliers proposés par l’Atelier du Coteau ?
o Oui o Non 2bis. Si oui, au(x)quel(s) ?
o Atelier musique multilingue : o Lundi 17h-18h o Lundi 18h-19h o Jeudi 17h-18h o Jeudi 18h-19h
o Atelier arts plastiques
o Atelier théâtre o Cours de danse o Autre, merci de
préciser :……………………………………………………………………………………………
3. Depuis quand votre enfant est-il inscrit à ces ateliers ? (merci de préciser pour chaque
atelier le mois et l’année d’inscription) Septembre 2014 4. Pour les parents dont les enfants participent aux ateliers des lundis, mardis, jeudis
et/ou vendredis après l’école, votre enfant est-il inscrit au service de pedibus ? o Oui o Non
5. Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à inscrire votre enfant aux
ateliers artistiques multilingues de l’Atelier du Coteau ? Merci de cocher 4 réponses maximum. o Par commodité pour que votre enfant soit récupéré à l’école et gardé en attendant
votre retour du travail o Parce que c’est un centre de loisirs proche de chez vous o Parce que les tarifs sont accessibles
o Surtout pour qu’il fasse des activités artistiques o Surtout pour qu’il découvre des langues et cultures étrangères
359
o Surtout pour qu’il apprenne des langues étrangères
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des cultures de manière ludique
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des cultures par le biais des arts
o Autre(s), merci de préciser : Alix s'embêtait au périscolaire de son école.
6. Votre enfant parle-t-il couramment une autre langue que le français ?
o Oui, laquelle/lesquelles ? : ……………………………………………………
o Non
7. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) à l’école ?
o Oui, merci de préciser la/les langue(s) concernée(s) : ……………………………………………………
o Non
8. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) en dehors de l’école
et de l’Atelier du Coteau ? o Oui, dans un centre de langues o Oui, dans une association de
quartier o Oui, avec un professeur particulier o Oui, avec une nourrice ou un(e)
baby-sitter
o Oui, dans un autre cadre, merci de préciser : ……………………………………………………
o Non
9. Quelle est votre langue maternelle ? Père : Français Mère : Français 10. Avez-vous appris des langues étrangères durant votre vie ? Merci de préciser vos prénoms si vos réponses sont différentes.
o Oui, laquelle/lesquelles : Lily : Allemand, Anglais ; Franck : Anglais, Espagnol, Chinois
o Non
10bis. Utilisez-vous ces langues avec votre enfant ?
o Oui (merci de préciser la ou les langues concernées : Très légèrement l’anglais.
o Non
10ter. Si oui, pouvez-vous préciser de quelle manière ? Par exemple, si vous lui parlez exclusivement dans cette/ces langues, si vous utilisez quelques mots de temps en temps…
360
Nous lui parlons de temps en temps en anglais pour lui montrer qu'il existe plusieurs langues. 11. Avez-vous déjà voyagé à l’étranger avec votre enfant ?
o Oui, dans le(s) pays suivant(s) : Nous sommes allez à
Edimburgh avec Alix
lorsqu'elle avait 2 ans. o Non
12. Qu’attendez-vous des ateliers multi-activités multilingues pour votre enfant ?
Avant tout qu'elle y trouve du plaisir. Ensuite qu'elle développe son imagination et sa sensibilité artiste. Enfin, qu'elle comprenne qu'on peut utiliser plusieurs langues pour communiquer.
13. Quelles sont vos impressions aujourd’hui sur ces ateliers ? Répondent-ils à vos
attentes ?
Oui, même si on s'attendait à ce que les encadrants soient de langue maternelle non français (notamment anglo saxons)
14. Qu’est-ce que ces ateliers ont apporté à votre enfant jusqu’à aujourd’hui ?
Par exemple, le trouvez-vous plus curieux ? Plus en confiance ? Plus à l’aise au contact des autres ? Lui arrive-t-il de s’exprimer spontanément en langue étrangère lorsqu’il est avec vous ? Semble-t-il s’épanouir ou au contraire s’ennuyer dans les ateliers ?
On la trouve plus épanouie et très contente de participer à ces ateliers. Elle apprécie d'autant plus d'aller au périscolaire de son école. L'alternance des deux parait être un bon choix pour elle. Elle a fait d'énorme progrès en dessin et faire preuve de plus de créativité dans ce domaine. Elle ne s'exprime pas spontanément dans une autre langue mais on ne s'y attendait pas non plus.
15. Quelles suggestions aimeriez-vous apporter pour enrichir les ateliers ?
Nous aurions aimé qu'Alix soit plus baigné dans un environnement totalement multilingue avec une très faible utilisation du français. Cela n'a pas l'air d'être le cas. Néanmoins, nous faisons confiance aux encadrants pour trouver la bonne dose afin de ne pas braquer notre fille ou que ce soit au détriment de l'aspect artistique. La formule actuelle fonctionne et nous sommes très content du déroulement de ces ateliers.
361
Questionnaire au sujet des AAM multi-activités
Prénom de l’enfant : Lucien Sa date de naissance : 17 mars 2009 Sa classe : grande section maternelle Son école : Maisdon Pageot Prénoms des parents : Guillaume et Marie Profession(s) des parents : père : pharmacien Mère : pharmacien Quartier d’habitation : ……………………………………………………………………………………………………………………….
1. A quel(s) atelier(s) multi-activités multilingues votre enfant participe-t-il ?
o Mardi 17h-18h o Mardi 18h-19h o Mercredi 17h-18h
o Vendredi 17h-18h o Vendredi 18h-19h
2. Participe-t-il à d’autres ateliers proposés par l’Atelier du Coteau ?
o Oui o Non 3. Depuis quand votre enfant est-il inscrit à ces ateliers ? (merci de préciser pour chaque
atelier le mois et l’année d’inscription) septembre 2014 4. Pour les parents dont les enfants participent aux ateliers des lundis, mardis, jeudis
et/ou vendredis après l’école, votre enfant est-il inscrit au service de pedibus ? o Oui o Non
5. Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à inscrire votre enfant aux
ateliers artistiques multilingues de l’Atelier du Coteau ? Merci de cocher 4 réponses maximum. o Par commodité pour que votre enfant soit récupéré à l’école et gardé en attendant
votre retour du travail o Parce que c’est un centre de loisirs proche de chez vous o Parce que les tarifs sont accessibles
o Surtout pour qu’il fasse des activités artistiques o Surtout pour qu’il découvre des langues et cultures étrangères o Surtout pour qu’il apprenne des langues étrangères
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures de manière ludique o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures par le biais des arts
362
o Autre(s), merci de préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Votre enfant parle-t-il couramment une autre langue que le français ?
o Oui, laquelle/lesquelles ? : ……………………………………………………
o Non
7. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) à l’école ?
o Oui, merci de préciser la/les langue(s) concernée(s) : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
o Non 8. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) en dehors de l’école
et de l’Atelier du Coteau ? o Oui, dans un centre de langues o Oui, dans une association de
quartier o Oui, avec un professeur particulier o Oui, avec une nourrice ou un(e)
baby-sitter
o Oui, dans un autre cadre, merci de préciser : …………………………………………………………………………………………………………
o Non
9. Quelle est votre langue maternelle ? Père : français Mère : français 10. Avez-vous appris des langues étrangères durant votre vie ? Merci de préciser vos prénoms si vos réponses sont différentes.
o Oui, laquelle/lesquelles : Guillaume : anglais, allemand, latin,
Marie : anglais, allemand, latin, espagnol, italien
10bis. Utilisez-vous ces langues avec votre enfant ?
o Oui (merci de préciser la ou les langues concernées : ………………………………………………
o Non
11. Avez-vous déjà voyagé à l’étranger avec votre enfant ?
o Oui, dans le(s) pays suivant(s) : Tunisie
o Non
12. Qu’attendez-vous des ateliers multi-activités multilingues pour votre enfant ? Une première activité artistique, une ouverture sur les autres langues/cultures. 13. Quelles sont vos impressions aujourd’hui sur ces ateliers ? Répondent-ils à vos
attentes ?
363
Oui, notre fils ne raconte pas ce qu’il y fait mais ça lui plait. 14. Qu’est-ce que ces ateliers ont apporté à votre enfant jusqu’à aujourd’hui ?
Par exemple, le trouvez-vous plus curieux ? Plus en confiance ? Plus à l’aise au contact des autres ? Lui arrive-t-il de s’exprimer spontanément en langue étrangère lorsqu’il est avec vous ? Semble-t-il s’épanouir ou au contraire s’ennuyer dans les ateliers ?
Les ateliers se passent bien, mais pas de changement particulier. 15. Quelles suggestions aimeriez-vous apporter pour enrichir les ateliers ? RAS.
364
Questionnaire au sujet des AAM multi-activités
Prénom de l’enfant : Marie Sa date de naissance : 03/07/09 Sa classe : GS Son école : Maisdon Pajot Prénoms des parents : Sophie & Jérôme Profession(s) des parents : père : chef de projet informatique mère : consultante en intelligence économique Quartier d’habitation : Procé-Zola
1. A quel(s) atelier(s) multi-activités multilingues votre enfant participe-t-il ?
o Mardi 17h-18h o Mardi 18h-19h o Mercredi 17h-18h
o Vendredi 17h-18h o Vendredi 18h-19h
2. Participe-t-il à d’autres ateliers proposés par l’Atelier du Coteau ?
o Oui o Non 2bis. Si oui, au(x)quel(s) ?
o Atelier musique multilingue : o Lundi 17h-18h o Lundi 18h-19h o Jeudi 17h-18h o Jeudi 18h-19h
o Atelier arts plastiques
o Atelier théâtre o Cours de danse o Autre, merci de
préciser :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Depuis quand votre enfant est-ilinscrit à ces ateliers ? (merci de préciser pour chaque
atelier le mois et l’année d’inscription) pour cette année scolaire : depuis le début de l'année l'an dernier : depuis janvier 4. Pour les parents dont les enfants participent aux ateliers des lundis, mardis, jeudis
et/ou vendredis après l’école, votre enfant est-il inscrit au service de pedibus? o Oui o Non
5. Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à inscrire votre enfant aux
ateliers artistiques multilingues de l’Atelier du Coteau ? Merci de cocher 4 réponses maximum. o Par commodité pour que votre enfant soit récupéré à l’école et gardé en attendant
votre retour du travail o Parce que c’est un centre de loisirs proche de chez vous o Parce que les tarifs sont accessibles
o Surtout pour qu’il fasse des activités artistiques
365
o Surtout pour qu’il découvre des langues et cultures étrangères o Surtout pour qu’il apprenne des langues étrangères
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures de manière ludique o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures par le biais des arts
o Autre(s), merci de préciser : le service de pedibus
6. Votre enfant parle-t-il couramment une autre langue que le français ? o Oui, laquelle/lesquelles ? :
…………………………………………………… o Non
7. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s)à l’école ?
o Oui, merci de préciser la/les langue(s) concernée(s) : anglais depuis janvier 2015
o Non
7bis. Si oui,à quelle fréquence ?
30 min 1 heure 1h30 Autre, merci de préciser :
Par semaine OUI Une semaine sur deux
Par mois
Autre, merci de préciser :
8. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) en dehors de l’école et de l’Atelier du Coteau ? o Oui, dans un centre de langues o Oui, dans une association de
quartier o Oui, avec un professeur particulier o Oui, avec une nourrice ou un(e)
baby-sitter
o Oui, dans un autre cadre, merci de préciser : …………………………………………………………………………………………………………
o Non
9. Quelle est votre langue maternelle? Père : français Mère : français 10. Avez-vous appris des langues étrangères durant votre vie ? Merci de préciser vos prénoms si vos réponses sont différentes.
o Oui, laquelle/lesquelles : Sophie : anglais (5,5 ans aux USA), suédois (2,5 ans en
Suède), allemand (scolaire), italien, japonais et arabe en loisir. Jérôme : anglais,
366
allemand, japonais, suédois, roumain et russe.
o Non
10bis. Utilisez-vous ces langues avec votre enfant ?
o Oui (merci de préciser la ou les langues concernées : anglais)
o Non
10ter. Si oui, pouvez-vous préciser de quelle manière ? Par exemple, si vous lui parlez exclusivement dans cette/ces langues, si vous utilisez quelques mots de temps en temps… Quelques mots de temps en temps, quand on joue, on donne les 2 mots en français et en anglais, on nomme les couleurs des voitures, les noms des animaux, on cuisine en anglais... 11. Avez-vous déjà voyagé à l’étranger avec votre enfant ?
o Oui, dans le(s) pays suivant(s) : ………………………………………………
o Non
12. Qu’attendez-vous des ateliers multi-activités multilingues pour votre enfant ? Sur le côté pratique, un mode de garde pour l'enfant jusqu'à 19h, avec le service du pedibus pour qu'on ne s'occupe de rien. Pour le côté éducatif, un apprentissage d'une langue de travail (anglais) et la découverte d'autres langues, l'ouverture à d'autres cultures. Le tout en faisant des jeux, des arts plastiques ou de la musique. 13. Quelles sont vos impressions aujourd’hui sur ces ateliers ? Répondent-ils à vos
attentes ? Tout se passe bien. Ce sont de petits groupes avec des activités de qualité 14. Qu’est-ce que ces ateliers ont apporté à votre enfant jusqu’à aujourd’hui ?
Par exemple, le trouvez-vous plus curieux ? Plus en confiance ? Plus à l’aise au contact des autres ? Lui arrive-t-il de s’exprimer spontanément en langue étrangère lorsqu’il est avec vous ? Semble-t-il s’épanouir ou au contraire s’ennuyer dans les ateliers ?
Notre fille comprend de plus en plus de mots en anglais et découvre d'autres langues comme notamment l'allemand ou le perse. Les langues l'amusent. Elle aimait peu les arts plastiques et aujourd'hui, non seulement elle aime mais elle a beaucoup d'imagination. Elle y trouve beaucoup de plaisir. Le fait qu'elle y reste jusqu'à 19h est certes fatigant et les animateurs savent bien gérer la fatigue de l'enfant. Mais la fatigue ne tient pas à l'atelier mais au rythme de l'enfant qui vit des journées plus longues que celles de ses parents ! 15. Quelles suggestions aimeriez-vous apporter pour enrichir les ateliers ? Les ateliers sont déjà très riches et les animateurs très compétents pour les organiser. Notre
réflexion pour l'année prochaine porte plutôt sur le rythme. Notre fille sera en CP et aura
367
donc des devoirs à faire. Faire ses devoirs après 19h, pour un enfant de 6 ans, c'est difficile.
Aujourd'hui Marie reste aux ateliers tous les jours jusqu'à 19h, sauf période exceptionnelle.
Nous ne savons pas trop comment faire pour l'an prochain à cause des devoirs. L'idéal serait
une baby sitter de 18h à 19h mais les baby sitters ne se déplacent pas pour 1h. Cela signifie
donc moins d'ateliers pour Marie, sauf si on arrive à trouver une bonne âme pour ne la
garder qu'une heure le soir... Les ateliers nous apportent une grande satisfaction mais
comment concilier les horaires avec les devoirs ? cela dépasse en fait le cadre de l'atelier.
368
Questionnaire au sujet des AAM multi-activités
Prénom de l’enfant : Rose Sa date de naissance : 22/12/2009 Sa classe : GS Son école : Notre Dame de Toutes Joies Prénoms des parents : Sophie et Antoine Profession(s) des parents : père : coursier assurance mère : responsable recrutement Quartier d’habitation : Procé
1. A quel(s) atelier(s) multi-activités multilingues votre enfant participe-t-il ?
o Mardi 17h-18h o Mardi 18h-19h o Mercredi 17h-18h
o Vendredi 17h-18h o Vendredi 18h-19h
2. Participe-t-il à d’autres ateliers proposés par l’Atelier du Coteau ?
o Oui o Non 3. Depuis quand votre enfant est-il inscrit à ces ateliers ? (merci de préciser pour chaque
atelier le mois et l’année d’inscription) Septembre 2014 4. Pour les parents dont les enfants participent aux ateliers des lundis, mardis, jeudis
et/ou vendredis après l’école, votre enfant est-il inscrit au service de pedibus ? o Oui o Non
5. Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à inscrire votre enfant aux
ateliers artistiques multilingues de l’Atelier du Coteau ? Merci de cocher 4 réponses maximum. o Par commodité pour que votre enfant soit récupéré à l’école et gardé en attendant
votre retour du travail o Parce que c’est un centre de loisirs proche de chez vous o Parce que les tarifs sont accessibles
o Surtout pour qu’il fasse des activités artistiques o Surtout pour qu’il découvre des langues et cultures étrangères o Surtout pour qu’il apprenne des langues étrangères
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures de manière ludique o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures par le biais des arts
369
o Autre(s), merci de préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Votre enfant parle-t-il couramment une autre langue que le français ?
o Oui, laquelle/lesquelles ? : ……………………………………………………
o Non
7. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) à l’école ?
o Oui, merci de préciser la/les langue(s) concernée(s) : ……………………………………………………
o Non
8. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) en dehors de l’école
et de l’Atelier du Coteau ? o Oui, dans un centre de langues o Oui, dans une association de
quartier o Oui, avec un professeur particulier o Oui, avec une nourrice ou un(e)
baby-sitter
o Oui, dans un autre cadre, merci de préciser : …………………………………………………………………………………………………………
o Non
9. Quelle est votre langue maternelle ? Père : français Mère : français 10. Avez-vous appris des langues étrangères durant votre vie ? Merci de préciser vos prénoms si vos réponses sont différentes.
o Oui, laquelle/lesquelles : anglais, espagnol
o Non
10bis. Utilisez-vous ces langues avec votre enfant ?
o Oui (merci de préciser la ou les langues concernées : ………………………………………………)
o Non
11. Avez-vous déjà voyagé à l’étranger avec votre enfant ?
o Oui, dans le(s) pays suivant(s) : ………………………………………………
o Non
12. Qu’attendez-vous des ateliers multi-activités multilingues pour votre enfant ? Découvrir les arts plastiques tout en se familiarisant avec les langues. 13. Quelles sont vos impressions aujourd’hui sur ces ateliers ? Répondent-ils à vos
attentes ?
370
Positives 14. Qu’est-ce que ces ateliers ont apporté à votre enfant jusqu’à aujourd’hui ?
Par exemple, le trouvez-vous plus curieux ? Plus en confiance ? Plus à l’aise au contact des autres ? Lui arrive-t-il de s’exprimer spontanément en langue étrangère lorsqu’il est avec vous ? Semble-t-il s’épanouir ou au contraire s’ennuyer dans les ateliers ?
Pose souvent des questions sur le vocabulaire en anglais, s’intéresse aux différends pays. 15. Quelles suggestions aimeriez-vous apporter pour enrichir les ateliers ? RAS
371
Questionnaire au sujet des AAM multi-activités
Prénom de l’enfant : Victor Sa date de naissance : 07/11/2010 Sa classe :MS Son école : écoles des réformes Prénoms des parents : marjorie & fabien Profession(s) des parents : père : ingénieur mère : directrice marketing Quartier d’habitation : Chantenay
1. A quel(s) atelier(s) multi-activités multilingues votre enfant participe-t-il ?
o mardi 17h-18h x o Mardi 18h-19h x o Mercredi 17h-18h
o Vendredi 17h-18h o Vendredi 18h-19h
2. Participe-t-il à d’autres ateliers proposés par l’Atelier du Coteau ?
o Oui x o Non 2bis. Si oui, au(x)quel(s) ?
o Atelier musique multilingue : o Lundi 17h-18hx o Lundi 18h-19hx o Jeudi 17h-18h o Jeudi 18h-19h
o Atelier arts plastiques
o Atelier théâtre o Cours de danse o Autre, merci de
préciser :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Depuis quand votre enfant est-il inscrit à ces ateliers ? (merci de préciser pour chaque
atelier le mois et l’année d’inscription) Avril 2014 4. Pour les parents dont les enfants participent aux ateliers des lundis, mardis, jeudis
et/ou vendredis après l’école, votre enfant est-il inscrit au service de pedibus ? o Oui x o Non
5. Quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à inscrire votre enfant aux
ateliers artistiques multilingues de l’Atelier du Coteau ? Merci de cocher 4 réponses maximum. o Par commodité pour que votre enfant soit récupéré à l’école et gardé en attendant
votre retour du travail o Parce que c’est un centre de loisirs proche de chez vous o Parce que les tarifs sont accessibles
o Surtout pour qu’il fasse des activités artistiques o Surtout pour qu’il découvre des langues et cultures étrangères
372
o Surtout pour qu’il apprenne des langues étrangères
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des cultures de manière ludique
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des cultures par le biais des arts
o Autre(s), merci de préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Votre enfant parle-t-il couramment une autre langue que le français ?
o Oui, laquelle/lesquelles ? : ……………………………………………………
o Non
7. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) à l’école ?
o Oui, merci de préciser la/les langue(s) concernée(s) : initiation anglais
o Non
7bis. Si oui, à quelle fréquence ?
30 min 1 heure 1h30 Autre, merci de préciser :
Par semaine 30 min/sem durant un trimestre
Une semaine sur deux
Par mois
Autre, merci de préciser :
8. Votre enfant apprend-il une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) en dehors de l’école et de l’Atelier du Coteau ? o Oui, dans un centre de langues o Oui, dans une association de
quartier o Oui, avec un professeur particulier o Oui, avec une nourrice ou un(e)
baby-sitter
o Oui, dans un autre cadre, merci de préciser : …………………………………………………………………………………………………………
o Non
8bis. Quelle(s) langue(s) apprend-il dans ce cadre ? Anglais avec Maria Pop une heure tous les mercredis depuis septembre 2013 8ter. A quelle fréquence ?
373
30 min 1 heure 1h30 Autre, merci de préciser :
Par semaine x Une semaine sur deux
Par mois
Autre, merci de préciser :
9. Quelle est votre langue maternelle ? Père : FR Mère : FR 10. Avez-vous appris des langues étrangères durant votre vie ? Merci de préciser vos prénoms si vos réponses sont différentes.
o Oui, laquelle/lesquelles : Anglais Allemand
o Non
10bis. Utilisez-vous ces langues avec votre enfant ?
o Oui (merci de préciser la ou les langues concernées : Anglais)
o Non
10ter. Si oui, pouvez-vous préciser de quelle manière ? Par exemple, si vous lui parlez exclusivement dans cette/ces langues, si vous utilisez quelques mots de temps en temps… Explication sur comment se dit tel mot en anglais, écoute de chansons, lectures de livres mais à petites doses 11. Avez-vous déjà voyagé à l’étranger avec votre enfant ?
o Oui, dans le(s) pays suivant(s) : Egypte, Thailande, Espagne, Grece
o Non
12. Qu’attendez-vous des ateliers multi-activités multilingues pour votre enfant ? Se former l’oreille, s’ouvrir à d’autres cultures, un apprentissage plus libre que l’école et donc complémentaire, acquérir un vocabulaire qui même s’il n’est pas encore utilisé oralement s’inscrit dans sa mémoire pour plus tard 13. Quelles sont vos impressions aujourd’hui sur ces ateliers ? Répondent-ils à vos
attentes ? J’y trouve une approche et pédagogie bienveillantes et un temps d’activité dans le calme et l’écoute. C’est une parfaite transition entre l’école et la maison. 14. Qu’est-ce que ces ateliers ont apporté à votre enfant jusqu’à aujourd’hui ?
374
Par exemple, le trouvez-vous plus curieux ? Plus en confiance ? Plus à l’aise au contact des autres ? Lui arrive-t-il de s’exprimer spontanément en langue étrangère lorsqu’il est avec vous ? Semble-t-il s’épanouir ou au contraire s’ennuyer dans les ateliers ?
Victor a beaucoup de plaisir à se rendre à ces ateliers. On note un véritable intérêt pour le graphisme, la peinture, la création. Depuis qq temps, il ressort certaines expressions spontanément en anglais. Je pense qu’il était plus timide au démarrage et qu’il a pris confiance en lui depuis. 15. Quelles suggestions aimeriez-vous apporter pour enrichir les ateliers ? Je trouve la formule parfaite dans son contenu. Pour les horaires, 18h est un peu tôt et 19h un peu trop tard, 18h30 aurait été parfait mais je comprends les contraintes.
375
Annexe 9.2 : Bilan des questionnaires
Bilan des questionnaires au sujet des AAM multi-
activités Participation aux questionnaires :
Nombre de questionnaires distribués : 9 Dont 7 auprès de parents n’ayant qu’un seul enfant inscrit aux AAM multi-activités Et 2 auprès de parents ayant deux enfants inscrits aux AAM multi-activités Nombre de questionnaires retournés au 18/04/2015 : 7 Correspondant aux 7 foyers n’ayant qu’un seul enfant inscrit aux AAM multi-activités Taux de participation au questionnaire de la part des parents : 78% Nombre d’enfants représentés sur le total des enfants participant aux AAM multi-activités : 7 enfants sur 11 inscrits, soit à peine 64% Les chiffres mentionnés dans le reste de ce document seront à considérer en référence aux nombres de personnes ayant répondu au questionnaire.
Profils socio-éducatif des enfants : Répartition par âge :
- 4 ans : 2 - 5 ans : 3 - 6 ans : 1 - 7 ans : 1
Répartition par classe : - Moyenne section : 3 - Grande section : 3 - CP : 1
Répartition par école :
- Maisdon Pageot (quartier Zola) : 3 - Fraternité (quartier Zola) : 1 - Contrie (quartier Contrie) : 1 - Réformes (quartier Chantenay) : 1 - Notre Dame de Toutes Joies (quartier
Procé) : 1
Répartition par quartier d’habitation : - Zola : 1 - Procé : 3 - Contrie : 1 - Chantenay : 1 - Non renseigné : 1
Nombre d’AAM multi-activités suivis à l’Atelier du Coteau :
- 1 atelier : 5 enfants - 2 ateliers : 1 enfant - 4 ateliers : 1 enfant
Nombre d’enfants participant à d’autres ateliers de l’association : 4
- AAM musique : 3 - Danse : 1
Ancienneté dans l’association :
- 2 ans : 1 - 1 an et demi : 2 - 1 an : 4
376
Enfants inscrits au pedibus : 5
Professions des parents Métiers de l’informatique : 3 (chef de projet informatique, informaticien, ingénieur informatique) Commerce et marketing : 3 (ingénieur commercial, assistante commerciale, directrice marketing) Ressources humaines : 2 (chargée de ressources humaines, responsable recrutement) Santé : 2 (pharmaciens) Droit : 1 (magistrate) Ingénierie : 1 (ingénieur) Autres : 2 (consultante en intelligence économique, coursier assurance)
Raisons d’inscription de leur enfant aux AAM Les parents répondant au questionnaire pouvaient sélectionner jusqu’à 4 raisons. 1 couple n’a donné que 2 raisons. 2 couples n’en ont donné que 3. 4 couples en ont donné 4. Les raisons listées ci-dessous sont classées en fonction du total des couples les ayant mentionnés.
o Surtout pour qu’il fasse des activités artistiques : 6
o Pour qu’il découvre/apprenne des langues et des cultures de manière ludique : 6
o Surtout pour qu’il découvre des langues et cultures étrangères : 4
o Pour qu’il découvre/apprenne (rayez si besoin la mention inutile) des langues et des
cultures par le biais des arts : 2
o Par commodité pour que votre enfant soit récupéré à l’école et gardé en attendant
votre retour du travail : 1
o Parce que c’est un centre de loisirs proche de chez vous : 1 o Surtout pour qu’il apprenne des langues étrangères : 1
o Autres : 2
- Pour le pedibus : 1
- Parce que l’enfant s’ennuyait au périscolaire de son école : 1
o Parce que les tarifs sont accessibles : 0
Aucun couple n’invoque de raisons exclusivement utilitaires, artistiques ou linguistiques et culturelles. 5 couples invoquent des raisons à la fois artistiques, linguistiques et culturelles. 1 couple invoque des raisons à la fois utilitaires, linguistiques et culturelles. 1 couple invoque des raisons à la fois utilitaires, artistiques, linguistiques et culturelles : 1
Attentes initiales des parents envers les AAM
Attentes les plus récurrentes (mentionnées par 3/7 couples) : - Prendre du plaisir, s’amuser - Avoir une première expérience artistique, développer sa sensibilité artistique - Découvrir/apprendre de manière ludique, sous formes d’activités variées (reviennent
les disciplines suivantes : chansons, arts plastiques, musique) - Se familiariser avec les langues (sonorités, vocabulaire, différentes manières de
communiquer) - S’ouvrir à d’autres cultures
Attentes mentionnée par 2/7 couples:
- Découvrir voire même apprendre l’anglais en priorité - Faire des activités artistiques en langue étrangère (attente d’une animation-
enseignement en langue étrangère et/ou par des intervenants étrangers, notamment anglophones)
Attentes individuelles (mentionnées une seule fois parmi toutes les réponses reçues) :
- Développer l’imagination - Un apprentissage plus libre mais complémentaire de l’école - Un mode de garde avec le pedibus
→ Si l’on devait résumer ces attentes au regard des ateliers multi-activités multilingues, nous relèverions les 3 points suivants :
- De l’amusement - Un éveil à l’art toutes disciplines confondues ; la dimension « multi-activités » est une
véritable attente de la part des parents - Une familiarisation aux langues et cultures étrangères avec une attention particulière envers
l’anglais
Impressions des parents jusqu’à aujourd’hui sur les ateliers multi-activités multilingues
Impressions positives : - 7/7 couples sont satisfaits des ateliers, ils répondent à leurs attentes. - 3/7 couples affirment que cela plait à leur enfant. - 3/7 couples y voient des activités de qualité, une pédagogie adaptée, des ateliers
riches. - 1/7 couple mentionne l’avantage d’avoir de petits groupes. - 1/7 couple y voit une bonne transition entre l’école et la maison, entre l’agitation et
le calme.
378
- 1/7 couple trouve que les animateurs sont compétents, savent gérer la fatigue des enfants
Impressions plus nuancées reprise par 2/7 couples :
- Les enfants ne parlent pas à leurs parents de ce qu’ils font dans les ateliers. - Ils ne montrent pas non plus qu’ils ont appris ou pratiqué des mots en langue
étrangère.
Evolution de l’enfant depuis sa participation aux AAM
Evolutions positives (mentionnées à chaque fois par 1/7 couple, sauf lorsqu’il est précisé différemment) :
- 3/7 couples affirment que leur enfant a de plus en plus envie de peindre, dessiner, colorier, découper, créer…
- L’enfant a fini par aimer les arts plastiques - L’enfant a fait des progrès en dessin - L’enfant a développé son imagination - L’enfant a développé sa créativité
- Les langues sont sources d’amusement - L’enfant comprend de plus en plus de mots en langues étrangères - L’enfant pose des questions sur le vocabulaire en anglais - L’enfant s’intéresse aux différents pays - L’enfant s’exprime ponctuellement en anglais (à nuancer car l’enfant en question suit
des cours d’anglais hebdomadaires dans une autre structure)
- 2/7 couples affirment que leur enfant est content d’aller aux ateliers - L’enfant a pris confiance en lui - L’enfant est plus épanoui
Absence d’évolution chez l’enfant pour 2/7 couples. Pour 3/7 couples, leur enfant ne s’exprime pas spontanément en langues étrangères avec eux.
Suggestions
3/7 couples n’ont pas donné de suggestion.
- 2/7 couples suggèrent de mettre plus en avant les langues étrangères, que l’animation se fasse plus en langues étrangères qu’en français pour que l’enfant soit vraiment baigné dans un environnement multilingue, sans pour autant que ce soit en détriment de l’éveil artistiques.
- 2/7 couples mentionnent des difficultés liés au rythme et horaires des ateliers : terminer à 19h est assez tard, notamment lorsque l’enfant entre en CP et aura des devoirs à faire le soir. 1 couple propose de terminer plutôt à 18h30.
379
Annexe 10 : Tableau adapté des compétences du CARAP
L’Eveil aux langues et les approches plurielles : sélection du Cadre de Référence pour les Approches Plurielles
Le tableau des compétences
C1
Compétence à gérer la communication
linguistique et culturelle
en contexte d'altérité
C2
Compétence de construction et
d'élargissement d'un répertoire
linguistique et culturel pluriel
C1.1
Compétence de
résolution des
conflits/
obstacles/
malentendus
C1.2
Compétence de
négociation
C2.1
Compétence à tirer
profit de ses
propres
expériences
interculturelles/
interlinguistiques
C2.2
Compétence à
mettre en oeuvre,
en contexte
d'altérité, des
démarches
d'apprentissage
plus
systématiques,
plus contrôlées
C1.3
Compétence de
médiation
C1.4
Compétence
d'adaptation
C3
Compétence de décentration
C4
Compétence à donner du sens à des
éléments linguistiques et/ou culturels
non familiers
C5
Compétence de distanciation
C6
Compétence à analyser de façon critique
la situation et les activités
(communicatives et/ ou d'apprentissage)
dans lesquelles on est engagé
C7
Compétence de reconnaissance de
l'Autre, de l'altérité
380
Objectifs parmi les savoirs
K 1 Connaitre quelques principes de fonctionnement des langues
K 2 Connaitre le rôle de la société dans le fonctionnement des
langues et des langues dans le fonctionnement de la société
K 3 Connaitre quelques principes de fonctionnement de la
communication
K 5 Avoir des connaissances sur la diversité des langues, le
multilinguisme et le plurilinguisme
K 6 Savoir qu’il existe entre les langues (les variétés
linguistiques) des ressemblances et des différences
K 8 Avoir des connaissances à propos de ce que sont les
cultures et de leur fonctionnement
K 10 Connaitre le rôle de la culture dans les relations
interculturelles et la communication interculturelle
K 11 Savoir que les cultures sont en constante évolution
K 12 Connaitre divers phénomènes relatifs à la diversité des
cultures
K 13 Savoir qu’il existe entre les (sous-)cultures des
ressemblances et des différences
K 15 Savoir comment on acquiert ou apprend une culture
Objectifs parmi les savoir-être
A-1 Attention pour les langues, cultures et personnes «
étrangères » ; pour la diversité linguistique, culturelle et
humaine de l’environnement ; pour le langage en général ; pour la
diversité linguistique, culturelle et humaine en général (en tant que
telle)
A-2 Sensibilité à l’existence d’autres langues, cultures et
personnes ; à l’existence de la diversité des langues,
descultures et des personnes
A-3 Curiosité ou intérêt pour des langues, cultures ou personnes
« étrangères » ; pour des contextes pluriculturels ; pour la
diversité linguistique, culturelle et humaine de l’environnement ; pour
la diversité linguistique, culturelle et humaine en général (en tant que
telle)
381
A-4 Acceptation positive de la diversité linguistique ou culturelle
, de l’autre ou du différent
A-5 Ouverture à la diversité des langues, des personnes ou des
cultures du monde ; à la diversité en tant que telle (à la
différence en soi, à l’altérité)
A-6 Respect ou estime des langues, cultures ou personnes,
«étrangères » ou « différentes » ; de la diversité
linguistique, culturelle et humaine de l’environnement ; de la diversité
linguistique, culturelle et humaine en tant que telle (en général)
A-7 Disponibilité ou motivation par rapport à la diversité ou à la
pluralité, linguistiques ou culturelles
A-8 Désir ou volonté de s’engager ou d’agir par rapport à la
diversité ou la pluralité, linguistiques ou culturelles ; dans
un environnement plurilingue ou pluriculturel
A-9 Attitude critique de questionnement ou posture critique, face
au langage et à la culture en général
A-10 Volonté de construire des connaissances ou des
représentations « informées»
A-11 Disponibilité à (ou volonté de) suspendre son jugement, ses
représentations acquises ou ses préjugés
A-12 Disponibilité au déclenchement d’un processus de
décentration ou de relativisation, linguistiques et culturelles
A-17 Sensibilité à l’expérience
A-18 Motivation pour apprendre des langues (p. ex. langue(s) de
l’école, de la famille, langue(s) étrangères, régionales, etc.)
A-19 Attitudes visant à construire des représentations pertinentes
et informées pour l’apprentissage
Objectifs parmi les savoir-faire
S 1 Savoir observer ou analyser des éléments linguistiques ou
des phénomènes culturels dans des langues ou cultures plus
ou moins familières
S 2 Savoir identifier (ou : repérer) des éléments linguistiques et
des phénomènes culturels dans des langues ou cultures plus
ou moins familières
382
S 3 Savoir comparer les phénomènes linguistiques ou culturels
de langues ou cultures différentes (ou : Savoir percevoir ou
établir la proximité et la distance, linguistiques ou culturelles)
S 4 Savoir parler de certains aspects de sa langue, de sa
culture, d’autres langues ou d’autres cultures ; savoir les
expliquer à d’autres
S 5 Savoir utiliser les connaissances et compétences dont on
dispose dans une langue pour des activités de
compréhension ou de production dans une autre langue
S 6 Savoir interagir en situation de contacts de langues ou de
cultures
S 7 Savoir s’approprier (ou : apprendre) des éléments ou
usages linguistiques, des références ou comportements
culturels, qui sont propres à des langues ou cultures plus ou moins
familières
383
Annexes 11 : Evolution du dispositif didactique
Ebauche de proposition de dispositif didactique
Objectif de projet pratique :
- Proposer un dispositif mêlant arts, langues et cultures dans les ateliers multiactivité
multilingues pouvant être valorisé lors de l’exposition des œuvres des enfants en juin.
Objectifs de projet recherche :
- Mettre en lumière le potentiel émotionnel des arts au bénéfice d’un éveil aux langues et aux
cultures
- Faire émerger les représentations autour de langues et cultures étrangères par la musique, la
danse et le dessin (ou la peinture)
- Mettre en lumière l’efficacité d’un apprentissage multisensoriel
Objectifs d’apprentissages :
- Développer la compétence émotionnelle des enfants en stimulant leur sensibilité artistique :
o Prendre conscience des états émotionnels impulsés par la musique
o Mobiliser des stratégies d’expression de ces émotions : par le corps, par le dessin et
par les mots
- Exprimer par le corps, le dessin puis les mots les représentations que l’on peut avoir d‘une
culture
- S’éveiller aux cultures étrangères aux différentes manières de saluer à travers le monde
- Apprendre le mot « bonjour » dans différentes langues
Contraintes :
Dispositif à concevoir en maximum 2 semaines.
A réaliser et évaluer en 3 semaines, à raison de 3 séances par semaine avec 3 groupes différents et
une enfant participant à 2 groupes sur 3. 3 semaines coupées par 2 semaines de vacances (soit 2
semaines d’affilée / 2 semaines de vacances / 1 dernière semaine).
Durée de 15 minutes maximum à respecter par atelier.
Doit être adaptable aisément au rythme des enfants qui ont besoin de se défouler après l’école, sans
savoir à quel moment de l’atelier le dispositif pourra être mis en place (début ? milieu ? fin ?).
Grandes lignes d’ébauche du dispositif (à aménager en fonction des contraintes mentionnées ci-
dessus) :
Faire écouter aux enfants quelques chants traditionnels de pays différents : chant a cappella ?
berceuse ? avec fond instrumental ?
Petit à petit demander aux enfants de bouger dans l’espace au gré de ce qu’ils ressentent en
écoutant le chant.
384
Toujours avec le chant en fond sonore, leur proposer de dessiner (ou peindre) ce que ce chant leur
évoque, que ce soit de manière abstraite ou figurative (couleurs, formes, éléments symboliques, …)
en laissant un espace vierge sur la feuille.
Demander aux enfants de raconter au groupe leur dessin, de chercher à expliquer ce qu’ils ont voulu
représenter et pourquoi.
Cette verbalisation doit aussi donner lieu à l’expression des émotions ressenties.
Leur demander s’ils ont une idée du pays d’où vient le chant et leur demander de le montrer sur un
globe terrestre.
Leur apprendre l’expression qui signifie « bonjour » associée au geste de salutation, puis lancer la
musique une dernière fois pour danser dessus en y intégrant le mot signifiant « bonjour ».
ATTENTION : dispositif trop long tel quel. A repenser.
Ebauche de proposition de dispositif didactique 2
Hypothèses 1 (avant cadre théorique) :
- Les émotions joueraient un rôle clé dans les apprentissages
- les pratiques artistiques seraient un moyen de valoriser les émotions de l’apprenant pour
faciliter ses processus d’apprentissages, notamment de langues et cultures étrangères
Dossier qui interroge les théories travaillant sur ces hypothèses. Théories qui confirment ces
hypothèses.
Hypothèses à vérifier :
- L’association des plans physiques, cognitifs et émotionnels faciliterait les apprentissages
- Le recours aux pratiques artistiques libèrerait l’expression des enfants pour
o Développer leurs compétences émotionnelles
o Développer leur imagination et leur créativité
Mise en place d’une expérimentation qui valide ou invalide ces hypothèses.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Objectif de projet pratique :
- Proposer un dispositif mêlant arts, langues et cultures dans les ateliers multi-activité
multilingues pouvant être valorisé lors de l’exposition des œuvres des enfants en juin.
Objectifs de projet recherche :
- Mettre en place un dispositif d’éveil aux langues et aux cultures répondant d’une pédagogie
de la créativité en s’appuyant sur le potentiel émotionnel des arts sur les enfants. Elements à
prendre en compte pour un dispositif favorisant la créativité :
o Dimension nouvelle tout de même en lien avec ce que font les enfants
habituellement
o Plusieurs tâches menant à un tout final
o Chaque tâche développe des savoirs et savoirs-faire précis
o Cherche à augmenter la SEP des apprenants (dépassement)
385
o Emotion d’arrière-plan renvoyant au calme
o Favorise la construction d’endocepts
o Autonomie suffisante pour que l’apprenant prenne conscience des enjeux cognitifs
et émotionnels)
Objectifs pédagogiques :
- Développer la compétence émotionnelle des enfants en stimulant leur sensibilité artistique :
o Prendre conscience des états émotionnels impulsés par la musique
o Mobiliser des stratégies d’expression de ces émotions : par le corps, par le dessin et
par les mots
- Exprimer par le corps, le dessin puis les mots les représentations que l’on peut avoir d‘une
culture
Objectifs d’apprentissage :
- S’éveiller aux cultures étrangères aux différentes manières de saluer à travers le monde
- Apprendre le mot « bonjour » dans différentes langues
Contraintes :
Dispositif à concevoir en maximum 2 semaines.
A réaliser et évaluer en 3 semaines, à raison de 3 séances par semaine avec 3 groupes différents et
une enfant participant à 2 groupes sur 3. 3 semaines coupées par 2 semaines de vacances (soit 2
semaines d’affilée / 2 semaines de vacances / 1 dernière semaine). Possibilité d’ajouter une
quatrième semaine.
Durée de 15 minutes maximum à respecter par atelier.
Doit être adaptable aisément au rythme des enfants qui ont besoin de se défouler après l’école, sans
savoir à quel moment de l’atelier le dispositif pourra être mis en place (début ? milieu ? fin ?).
Expression par le corps
1) Prendre conscience des états émotionnels impulsés par la musique
Faire écouter aux enfants des extraits musicaux de genres et rythmes variés et leur demander de se
déplacer en occupant tout l’espace. Ils doivent adapter leur manière de se déplacer à chaque extrait
en fonction de ce que la musique leur inspire comme mouvements.
Echange tous ensemble : Pourquoi n’avons-nous pas bougé de la même manière sur chaque extrait ?
2) Prendre conscience de la dimension culturelle de la musique
Voyager par la musique. Faire écouter aux enfants des extraits de musiques et chants du monde.
Possibilité 1 : effectuer la même activité que précédemment. Repérer les changements de
mouvements d’une musique à l’autre et échanger sur ces mouvements.
Possibilité 2 : Ecouter une musique/chant et demander aux enfants de bouger et se déplacer en
fonction de ce que ça leur inspire.
386
Objectif : commencer à déceler les premières représentations.
Possibilité 2 : délimiter l’espace avec un planisphère géant au sol, ou avec des représentations des 5 continents et demander aux élèves d’aller vers la région du monde d’où ils pensent que la musique vient.
Expression picturale
3) Faire émerger par le dessin ce que nous inspirent une musique/chant, une culture Faire écouter aux enfants une musique/chant traditionnels d’un pays en particulier. Laisser à la disposition de chacun une feuille blanche et de quoi dessiner ou peindre en couleurs. Ecouter l’extrait une fois en fermant les yeux. Ecouter l’extrait une deuxième fois tout en dessinant. Le dessin doit s’arrêter en même temps que la musique. Exposer les dessins sur un mur.
Expression verbale Echanger sur ce qui a été dessiné. Pourquoi ? Dans quel pays sommes-nous allés ? Montrer des photos et/ou des oeuvres d’art propres de ce pays pour aider les enfants à trouver. Objectif : poursuivre dans l’expression des émotions et des représentations liées à une culture.
Dispositif didactique 3
Activité 1 : Lulu la Tortue est partie en voyage, et elle a rapporté de la musique
1 mn de musique tsigane/roumaine aux rythmes variés pour se défouler.
Les enfants écoutent la musique et doivent se déplacer dans la pièce en occupant tout l’espace et en
adaptant leurs mouvements et déplacements à ce qu’ils entendent.
Q : Où Lulu est-elle partie en voyage ?
Activité 2 : Lulu la Tortue nous a rapporté des bonjours ! 4 mn : On s’asseoit tous par terre en cercle pour savoir où chacun pense que Lulu est partie. Sans donner de réponse, Lulu présente différente manière de dire bonjour dans le pays où elle est partie en voyage et fait choisir à chacun des enfants une de ces manières. Les bonjours, en plus du mot, peuvent se matérialiser par des petits paquets contenant le mot écrit sur une étiquette que l’enfant pourra ensuite coller sur son dessin. Activité 3 : Une musique, un dessin
387
6 mn : On écoute au calme un morceau choisi en fermant les yeux pour imaginer le pays que Lulu a visité, puis on le dessine le temps d’une nouvelle écoute (chacun des enfants fait un dessin de son côté). Au fur et à mesure que les enfants terminent leur dessin, on les installe de manière à tous les voir d’un coup (accrochés au mur ou étalés sur le sol) Activité 4 : L’album photo de Lulu 4 mn : On discute tous ensemble de ce qui a été dessiné. Lulu déplie sa grande carte du monde pour trouver où elle est allée en voyage. Les enfants cherchent d’abord puis Lulu leur montre. On dit merci à Lulu dans la langue choisie ! ATTENTION : Dispositif qui risque encore de dépasser les 15 min…
Dispositif didactique 4 Temps de réalisation par séance diminué à 10 minutes. Nécessité de revoir le programme ! Organisation générale des deux premières interventions :
- Lulu la Tortue (marionnette) raconte aux enfants qu’elle est partie en voyage, et qu’ils vont
devoir trouver où grâce à plusieurs indices !
- Lulu leur a rapporté des « bonjour » comme premier indice. Elle explique aux enfants qu’il y a
plusieurs expressions pour dire bonjour à quelqu’un dans ce pays. Chaque enfant doit
ensuite dire à Lulu quelle expression il préfère et Lulu lui remet alors un « bonjour » qui
correspond à l’expression choisi. C’est un petit cadeau constitué de l’expression choisie par
l’enfant écrite sur étiquette autocollante et écrite une deuxième fois sur un petit bout de
papier. Le petit bout de papier est pour l’enfant, il peut en faire ce qu’il en veut. L’étiquette
servira à orner le dessin qu’il s’apprête à faire.
o On peut demander une première fois si les enfants ont une idée du pays dans lequel
Lulu est allée.
- Comme deuxième indice, Lulu la Tortue fait écouter aux enfants une musique qui vient du
pays où elle a voyagé. Les enfants vont l’écouter les yeux fermés et ressentir ce que leur
évoque cette musique en termes de couleurs, paysages, personnes, …
o On peut demander à nouveau si les enfants ont une idée plus précise du pays d’où
vient cette musique.
- Enfin, Lulu relance cette même musique une dernière fois pour que chaque enfant puisse
dessiner librement ce que cette musique lui évoque sur une feuille blanche avec, à
disposition, des feutres, des crayons de couleur et des pastels. Lorsque la musique est
terminée, on arrête de dessiner. Au préalable, on aura demandé aux enfants de coller sur
leur feuille l’étiquette de « bonjour » qu’ils ont reçu pour que cela accompagne leur dessin.
- On remercie Lulu de nous avoir fait partager son voyage dans la langue du pays où elle est
allée. L’intervention est terminée (je collecte les dessins pour les rapporter lors de la
troisième séance).
388
Organisation de la troisième séance (15-20 minutes si possible – à négocier avec ma tutrice) :
- D’abord on reprend le schéma des séances précédentes à la découverte d’un troisième pays.
- A la fin de cette troisième découverte, on affiche ensemble tous les dessins réalisés par le
groupe sur les trois pays. Nous discutons alors tous ensemble de ce que nous voyons : les
points communs, les différences, le pourquoi de certains dessins, etc. Les enfants ont la
parole.
- Eventuellement, on peut prévoir pour l’occasion quelques peintures ou représentations
artistiques de ces pays pour comparer les dessins des enfants avec ce que d’autres ont pu
représenter.
Toutes les productions des enfants seront présentées lors de leur exposition, de préférence à
l’entrée de l’espace d’exposition pour accueillir les visiteurs d’un bonjour en plusieurs langues.
Objectifs des interventions :
Objectif de projet en contexte de stage :
Réaliser des interventions d’éveil aux langues et aux cultures par les arts qui puissent apporter de la
matière à l’exposition des créations des enfants dont le vernissage est le 30 mai.
Objectifs liés aux problèmes de terrain rencontrés :
Proposer des interventions où l’éveil aux langues et aux cultures soient plus en fusion avec les arts et
les pratiques artistiques.
Diversifier le recours aux différentes disciplines artistiques pour répondre à l’exigence de multi-
activités (théâtralisation par la marionnette Lulu la Tortue, éveil musical et expression graphique).
Diversifier l’input en termes de langues et cultures à découvrir sans que la non-connaissance des
langues et cultures abordées soit une difficulté pour l’animateur.
Développer l’implication personnelle des enfants dans les ateliers en partant de leur biographie
langagière et en favorisant une approche émotionnelle des langues et des cultures (appropriation
individuelle du vocabulaire proposé en choisissant le « bonjour » que l’on souhaite parmi ceux
proposés, passage d’un input musical vers un output graphique qui invite à l’imagination et à
l’expression spontanée plus qu’à l’analyse cognitive).
Préparer des créations qui valoriseront la dimension d’éveil aux langues et aux cultures des ateliers,
notamment pour les parents qui sont en attente de retours sur ce que font et découvrent leurs
enfants.
Objectifs d’éveil aux langues et aux cultures (selon les descriptifs du CARAP) :
Savoirs :
- K.5 : Avoir des connaissances sur la diversité des langues
o K.5.1 : Savoir qu’il existe une grande pluralité de langues à travers le monde
o K.5.2 : Savoir qu’il existe une grande diversité d’univers sonores
o K.5.3 : Savoir qu’il existe une grande diversité de systèmes d’écriture
- K.12 : Connaitre divers phénomènes relatifs à la diversité des cultures
389
o K.12.1 : Savoir qu’il existe (encore) une grande pluralité de cultures à travers le
monde
Savoir-être :
- A.1-6 : Attention/Sensibilité/Curiosité/Acceptation positive/Ouverture/Respect relatives aux
langues, aux cultures et à la diversité des langues et des cultures
o A.2.2 : Sensibilité aux différences langagières/culturelles
o A.4.3 : Accepter qu’une autre langue/culture peut comporter des éléments différents
de sa propre langue/culture
- A.17 : Sensibilité à l’expérience
o A.17.4 : Confiance en ses propres capacités d’apprentissage linguistique/en ses
capacités à étendre ses compétences linguistiques propres
Savoir-faire :
- S.1 : Savoir observer des éléments linguistiques/des phénomènes culturels dans des
langues/cultures plus ou moins familières
o S.1.2 : Savoir observer les sons (dans des langues peu ou pas connues)
o S.1.3 : Savoir observer les écritures (dans des langues peu ou pas connues)
- S.7 : Savoir s’approprier des éléments ou usages linguistiques/des références ou
comportements culturels propres à des langues/cultures plus ou moins familières
o S.7.1 : Etre capable de mémoriser des éléments non familiers
o S.7.2 : Savoir reproduire des éléments non familiers
__________________________________________________________________________________
Planning des interventions :
Groupe du mercredi :
- Mercredi 1 avril : l’Espagne
- Mercredi 8 avril : la Chine
- Mercredi 29 avril : Tahiti ?
Groupe du vendredi :
- Vendredi 3 avril : l’Inde
- Vendredi 10 avril : le Moyen-Orient
- Problème : vendredis suivants 1er et 8 mai = fériés. Nécessité de ne faire que deux séances
avec ce groupe ?
Groupe du mardi :
- Mardi 7 avril : Afrique
- Mardi 28 avril : la Roumanie
- Mardi 5 mai : Japon
Planning des interventions modifié au 8 avril 2015 :
Groupe du mercredi :
- Mercredi 1 avril : l’Espagne
390
- Mercredi 8 avril : la Chine et l’Inde (afin d’avoir plus de dessins sur ce pays puisqu’un seul
enfant était présent à la séance du 3 avril)
- Mercredi 29 avril : Discussion autour des dessins et ré-écoute des extraits. Au besoin
retouche des dessins par les enfants. Point sur les « bonjours » abordés.
Groupe du vendredi :
- Vendredi 3 avril : l’Inde
- Vendredi 10 avril : la Chine et le Moyen-Orient + discussion autour des dessins
- Problème : vendredis suivants 1er et 8 mai = fériés. Nécessité de ne faire que deux séances
avec ce groupe.
Groupe du mardi :
- Mardi 7 avril : Afrique
- Mardi 28 avril : la Roumanie et le Japon
- Mardi 5 mai : Discussion autour des dessins et ré-écoute des extraits. Au besoin retouche des
dessins par les enfants. Point sur les « bonjours » abordés.
396
Annexe 11.2 : Références des chants et musiques utilisés
Alina. (2014). Loli phabaj. Album Comptines et berceuses tsiganes. Didier Jeunesse : Paris.
Ensemble Tre Fontaine, Ensemble Eduardo Paniagua, & Serghini Mohammed, E. A. (1998). Nuba
ushshak - mizan betayhi. Album Luz de la Meditarrania. De la Occitania a l'Andalucia
medieval. Alba musical : Audrix.
Guire Ramata, S. (2009). So diyara. Album Comptines et berceuses du baobab. Didier Jeunesse :
Paris.
Krishnamurthy, K., Yagnik, A., Kumar, A., & Narayan, U. (2006). Bole Chudiyan. Album Bharati.
Il était une fois l'Inde. Universal Music - Mercury.
Póveda, M. (2012). Triana, puente y aparte (Tangos de Triana). Album Artesano. Universal Music
Spain - Discmedi Blau : Espagne.
Rodière, S. (2007). Antagata doko sa? Album Comptines et berceuses des rizières. Didier
Jeunesse : Paris.
Song, L. (2007). Shi shang zhi you mama hao. Album Comptines et berceuses des rizières. Didier
Jeunesse : Paris.
Pratiques artistiques et enseignement-apprentissage des langues et des cultures à la rencontre des émotions
Expérience de stage à l’Atelier du Coteau, centre de création et de loisirs artistiques
Cherchant à définir les liens étroits entre émotions et apprentissages et leurs implications
pour la didactique des langues et des cultures, ce mémoire relate un travail de recherche à
l’Atelier du Coteau, centre de création et de loisirs artistiques nantais. Au cœur des ateliers
multi-activités plurilingues, une artiste plasticienne iranienne accueille chaque semaine des
enfants de 3 à 8 ans pour un éveil artistique et un éveil aux langues et aux cultures où les
émotions sont au cœur de l’expérience proposée à ces jeunes apprenants. Comment les arts et
les pratiques artistiques peuvent-ils mettre à profit l’action des émotions dans des situations
d’éveil aux langues et aux cultures ? Fil rouge d’une démarche praxéologique, cette question
jalonne la présentation d’un parcours de recherche associé à un travail de terrain qui se
caractérise par une étude du contexte, la définition d’un cadre théorique et une analyse des
nombreuses données recueillies sur trois mois menant à la conception d’un dispositif didactique
original au confluent des arts, des langues, des cultures et des émotions dans la rencontre des
enfants avec l’Autre et l’Ailleurs.
Mots clés : émotions – apprentissages – éveil aux langues et aux cultures – arts – pratiques
artistiques – didactique des langues et des cultures.
Looking for a definition of how emotions underlie learning processes and what it implies
for the teaching of languages and cultures, this Master’s thesis deals with research conducted
at l’Atelier du Coteau, a centre for creation and artistic activities in Nantes. Inside the multi-
activities plurilingual workshop, a female Iranian artist receives every week children aged from
3 to 8 to provide them with a blend of awakening to arts and awakening to languages and
cultures that set emotions in the heart of these young learner’s experience. How can awakening
to languages and cultures activities benefit from the power of emotion thanks to the arts and
artistic practices? Following a praxeological approach, this question works as a thread through
the presentation of a research project associated with fieldwork. The presentation of the learning
context, the research literature and data analysis merge to help design an original teaching
program combining the arts, languages, cultures and emotions to allow children to experience
an enriching encounter with other people and other places.
Key words: emotions – learning – awakening to languages and cultures – arts – artistic practices
– teaching of languages and cultures.