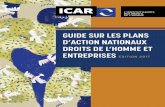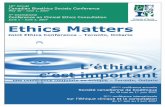Modes d'action collective et construction éthique; les émotions dans l'évaluation
Transcript of Modes d'action collective et construction éthique; les émotions dans l'évaluation
1.
MODES D'ACTION COLLECTIVEMODES D'ACTION COLLECTIVEET CONSTRUCTION ETHIQUEET CONSTRUCTION ETHIQUE
Les émotions dans l'évaluationLes émotions dans l'évaluation
Pierre LIVET et Laurent THEVENOTContribution au colloque
"Limitation de la rationalité et constitution du collectif"Cerisy, 5-12 juin 1993
publié dans: Dupuy, Jean-Pierre et Livet, Pierre (eds.), Les limites de la rationalité, tome 1, Rationalité, éthique et cognition, Paris,
La Découverte, pp.412-439.
INTRODUCTIONL'analyse de l'action collective met en évidence des
régimes de coordination qui sont difficiles à intégrer dans lathéorie de l'action rationnelle, celle doù l'agent cherche àmaximiser son utilité en fonction de ses préférences et descroyances qu'il a sur la situation et sur les autres. La priseen compte des capacités cognitives des acteurs, sous une formeclassique, ne suffit pas à rendre compte des caractèresspécifiques de ces différents régimes de coordination:cohésion interne, résistance à la dissociation, exigenced'engagement de la part des acteurs, hétérogénéité entre cesrégimes. Ces caractères sont en général associés aux notionsde valeur ou de norme sociale.
Par référence au modèle de l'acteur rationnel, cesspécificités sont vues comme autant de biais dans lesjugements et les heuristiques. Ainsi, dans ce que Kahneman etTversky nomment une heuristique de représentativité (Kahneman,
2.
Slovic et Tversky 1974, p.6), la recherche de redondance, decohérence avec un modèle exemplaire, va ainsi à l'encontred'une collecte d'informations indépendantes les unes desautres. Ces spécificités sont souvent rattachées à un modèlealternatif à celui de l'acteur rationnel, modèle qui estdéveloppé en propre en sociologie, celui d'un agent soumis àdes normes sociales. La pression à la conformité serarapportée à des sanctions, éventuellement relayée par uneémotion personnelle (Elster 1989), et cette approchealternative repose sur l'assise d'un collectif qui déterminela diffusion et la mise en pratique des normes et valeurs. Orce niveau collectif est justement celui que nous cherchons àreconstruire, dans une architecture qui repose sur desagissements individuels et qui assigne des niveaux différentsde coordination des actions en fonction des exigences mises enjeu et des limitations rencontrées dans leur suivi et leurajustement (Livet 1987, Thévenot 1990, Livet et Thévenot1991). Nous ne pouvons donc prendre appui, sans plus dequestionnement, sur des entités collectives normalisatrices.Leur insertion dans le cadre de l'action individuelle obliged'ailleurs à utiliser des notions-relais fort problématiques,telles l'intériorisation des normes: appropriées pour rendrecompte d'une reproduction de comportements à l'identique, cesnotions sont impropres à saisir des dynamiques plus complexes.
Plutôt que de traiter les valeurs comme desreprésentations sociales, espèces de croyances collectivesdotées d'un pouvoir contraignant sur l'action, il nous fautleur chercher un soubassement dans les diverses facultés del'acteur et, pour cela, considérer la place des émotions dansla cognition. L'aspect évaluatif des ordres degrandeur (Boltanski et Thévenot 1991) que nous avonsidentifiés comme cadres de justifications, ou plusgénéralement des jugements de valeurs, doit s'appuyer sur des"valences" primaires associées aux émotions. Mais les émotionsdoivent être transformées, réélaborées, dirigées, socialisées,pour s'inscrire dans ces jugements de valeur. Comme lesopérations cognitives individuelles, les mouvements émotifssubjectifs forment la base d'une architecture du collectif.Nous nous intéresserons donc à l'élaboration d'émotions
3.
sociales, ou publiques, qui dépendent d'interactions avec lesautres. Pour autant, nous ne pouvons emprunter les voies d'uneapproche sociale des émotions qui prenne appui sur uneévidence du collectif et de la normalisation sociale qu'ils'agit justement de remettre sur le métier.
Dans une première partie, nous donnerons un aperçu del'expression d'affects dans des ajustements d'actionscollectives qui passent par des justifications, en suggérantquelques articulations entre émotion et visée d'un jugementpublic. La construction de ce type de jugement de valeurincite à s'interroger sur la possibilité d'intégrer émotion etcognition, et à considérer la capacité d'intégration dedifférentes approches théoriques des émotions. La deuxièmepartie propose une approche des émotions publiques à partird'une spécification des émotions et de leurs relations à desopérations proprement cognitives. Un passage est proposé del'affectivité à l'évaluation axiologique qui sert de base ànos jugements éthiques et qui leur donne leur matière et leursémantique. Enfin, dans une troisième partie, nous reviendronssur plusieurs des régimes de coordination collective étudiésantérieurement, en suggérant la façon dont chacun associe àune forme de référent collectif garant du caractère commun dujugement, un traitement des indécidabilités dansl'interprétation des actions, l'appui sur des objetspertinents et des investissements émotionnels.
1. DES ÉMOTIONS CONTENUES DANS DES JUGEMENTS1.1. Affects et justificationsLe sang-froid du jugement valide
Les modes de coordination reposant sur des évaluationscommunes offrent, tout d'abord, des moyens d'apaisementd'émotions agonistiques associées à des affrontements directs.Le recours à des repères communs encadre les disputes dans unedynamique qui n'est pas celle de manoeuvres d'intimidation oud'une épreuve de force engagée dans un corps à corps. Lesémotions liées à l'agression et à la défense d'une intégritéphysique ou d'un territoire sont repoussées au profit demodalités d'ajustement et de révision des croyances et des
4.
repères communs qui passent par une forme de jugement. Lecadre de la justification n'implique pas l'accord mais il estdestiné à écarter la question de l'agression personnelle ou du"conflit de personne" pour orienter les acteurs vers un régimed'évaluation commune arrêtant la remontée de l'enquête sur lesmauvaises intentions. Des émotions manifestant l'"agressivité"du sujet entachent le jugement qui n'est plus de sang-froid etnuisent au détachement du jugement par rapport à l'agent quile supporte. Le détachement est la condition d'accès au niveaucollectif de la justification et à ses aspects cognitifs etobjectivés qui le différencient du niveau des intentionspersonnelles.L'émotion d'une évaluation qui interrompt l'action
Par rapport à un affrontement direct et à la réponseémotionnelle à un danger, le jugement de valeur présente unapaisement. Cependant, situé dans le cours d'une action, lemoment de jugement manifeste également une interruption, unchangement de registre. Le jugement n'est pas en continuitéavec l'action comme le manifeste bien le tout premier indicede cette rupture qu'est la gêne. L'acteur interrompt lecontrôle de repères cognitifs et le mouvement d'ajustementavec l'environnement - et notamment avec d'autres personnesagissant de concert - qui caractérisent le cours de l'action,pour considérer les évaluations possibles des personnesimpliquées et notamment de lui-même. Cette perspective faitvenir une inquiétude qui grippe le moteur de l'action. L'agentqui se voit évalué n'est plus un acteur, pas plus que lesautres agents avec lesquels il était engagé dans une actionconjointe. Le bouleversement du cours de l'action ne seproduit pas sans une émotion que déclenche la perspectived'être jugé.L'inquiétude d'être méjugé et le sentiment d'injustice
On voit clairement cette rupture lorsque le mouvementprécédent se poursuit dans une évaluation publique, un procès,une enquête ou même une discussion s'élevant sur lajustification des conduites. Plus de conduite de l'action, àproprement parler, dès lors qu'on évalue. Et lorsquel'évaluation s'élabore publiquement et se transforme en uneremise en cause, critiques et justifications ne s'affrontent
5.
pas sans une émotion qui sourd aux confins du jugement et quis'exprime notamment dans un "sentiment d'injustice". Cesentiment qui accompagne l'expression d'une injustice n'estplus seulement l'inquiétude d'être jugé mais une indignation.Ainsi l'émotion agressive qui prépare l'acteur àl'affrontement direct n'est pas repoussée sans que soitdéclenchée une émotion publique liée à l'évaluation. Cettetransformation, qui passe par l'évaluation par d'autres,constitue un premier lien à explorer entre jugement de valeurpublic et émotion privée.L'émotion comme garantie de l'engagement authentique
L'analyse des discussions dans lesquelles les personnesmettent en jeu les qualités axiologiques des situations, desobjets ou des personnes, montre que le jugement évaluateurs'inscrit dans un processus plus étendu et s'accompagne d'unemontée en intensité émotionnelle, de la gêne à l'inquiétuded'être jugé, puis à l'indignation devant une injustice. Sansla nécessité de résoudre cette tension émotionnelle, on nevoit pas clairement pourquoi on parviendrait à arrêterl'épreuve du jugement. Le jugement apaise donc ces émotions enfixant ou en révisant des règles ou repères communs. Mais,inversement, l'enquête déclenchée par la remise en cause desqualifications menace d'être infinie et l'investissementémotionnel des repères, qui fait qu'ils ne sont pas purementcognitifs, permet de suspendre cette quête1.Il semblenécessaire, pour que l'enquête du jugement s'arrête, nonseulement que l'on rencontre des indices décidables, mais quepuisse se fixer sur ces indices une intensité émotionnelle.Car ainsi l'intensité de l'indécidabilité se transfère surl'intensité affective d'indices décidables.
Le jugement de valeur ne peut "refroidir" la situationsans prêter au soupçon quant au rapport entre ces conventionset les actions véritables, sans être l'objet d'une critiquesur son caractère "conventionnel" (dans un sens dépréciatifqui correspond à ce soupçon). Les assises cognitives dujugement, qui lui confèrent sa vertu apaisante, ne satisfontjamais complètement les exigences de garantie sur les1 Luc Boltanski a analysé la suspension radicale du jugement dans le pardon etla bifurcation avec un régime d'amour (Boltanski 1990).
6.
intentions. Elles offrent simplement des substituts décidablespour des requêtes qui ne peuvent jamais parvenir àsatisfaction. La convention n'offre que des points de replis àune indécidabilité foncière portant sur les actions desautres. C'est pourquoi l'érection de conventions et leurmaintien suscitent régulièrement des demandes pour aller au-delà des repères conventionnels, pour prouver que les règlesne sont pas seulement suivies à la lettre mais que les acteurs"s'engagent", "sont à leur affaire" et, ainsi, comblentd'action authentique la convention. Les ambiances émotionnelles des différents ordres de justification
La demande d'engagement est satisfaite par l'expressiond'une émotion qui doit être appropriée à la convention envigueur. On voit bien cette tension entre convention etémotion dans les moments de qualification axiologique dessituations. Ces moments peuvent se mettre en ordre dans dessituations réglées qui ouvrent sur un soupçon, le terme de"cérémonie" servant alors à reprocher cette froideur. Pourqu'il n'en soit pas ainsi, il faut une émotion. Cependantcelle-ci n'est pas indifférenciée mais spécifiée selon lerégime de qualification. Les émotions associées à l'engagementdans une épreuve de confiance, dans une transaction marchandeou dans un moment de solidarité collective, diffèrent. Lesrégimes ont tous des implications émotionnelles quis'expriment dans des ambiances émotionnelles différentes.1.2. L'intégration du domaine cognitif dans des théories del'émotion
L'effort pour rendre compte de cette intrication entreaffect et jugement rencontre la difficulté d'une hétérogénéitéradicale entre les émotions et les attitudes (croyances etdésirs) propres au domaine cognitif. Cependant, diversesapproches contemporaines des émotions accordent une placeimportante à des croyances et nous envisagerons les stratégiesqu'elles proposent, en les abordant dans le sens d'unearticulation de plus en plus étroite des deux domaines.La construction sociale des émotions
L'articulation est réduite dans les approches en termesde "construction sociale" ou "socio-culturelle" des émotions.
7.
C'est en effet contre des considérations d'ordres biologique,psychologique ou éthologique, condamnées pour leur"naturalisme" et leur "essentialisme", que se développent destravaux d'anthropologie ou de sociologie attentifs au cadresocial jugé déterminant pour la signification donnée auxémotions, leur identification, voire leur perception par lesindividus socialisés et immergés dans une culture. Le modèledu langage, envisagé comme code, est alors très prégnant (Lutzet Abu-Lughod, 1990); si le programme doit s'étendre d'uneproblématique de la signification à une "pragmatique à grandeéchelle" (Abu-Lughod et Lutz 1990, p.9), cette pragmatiquerepose sur une unité de base de l'action qui est déjà une"pratique sociale" régulée et régulière. Les différencesculturelles (ou historiques2 dans d'autres travaux : Harré etFinlay-Jones, 1986) peuvent servir de levier pour montrer quemême la référence à des états internes, si souvent mise envaleur dans la littérature sur les émotions, n'aurait pas unepertinence universelle. Ainsi, étudiant la pratique de lalouange religieuse et profane dans l'Inde hindouiste, ArjunAppadurai entend montrer que l'émotion associée n'est pasaffaire de communication directe entre des états internes despersonnes concernées mais une expression publique participanten l'occurrence de la construction de la réputation d'unegrande personne : dirigeant, patron, star, saint, divinité(Appadurai 1990, pp.94,98,102). L'auteur généralise cette nonpertinence de l'inquiétude sur l'authenticité, dans la culturequ'il étudie, en considérant le traitement public des humeurs(rasa) au moyen d'un répertoire dramatique de gestes etd'expressions qui les réfléchissent et qui touchent au niveaudes symptômes physiques : épanchement lacrymal, contraction duplexus solaire, dilatation des orbites oculaires. La créationd'une "chaîne de communication des sentiments" au moyen d'unrépertoire met en question, selon l'auteur, le traitement del'émotion comme empathie sans médiation entre des intérioritésémues (p.107). Anthropologue très influent sur ce courant,Clifford Geertz avait déjà montré que, dans la culture
2 L'approche historique de Norbert Elias met en évidence, dans la mise àdistance du privé et l'aménagement d'un espace public, le rôle régulateur del'émotion qu'est le dégoût pour l'intimité de l'autre (Elias 1973).
8.
balinaise marquée par l'hindouisme, l'inquiétude ne porte passur l'authenticité de l'expression mais sur la correction dugeste. Plutôt que la honte ou la culpabilité, l'émotionrégulatrice principale (lek) serait plutôt le "trac",l'inquiétude que "l'acteur demeure visible sous lepersonnage", "faisant fondre l'identité publique" dans un"embarras mutuel" à la suite d'un faux pas (Geertz 1983,p.155). Les travaux antérieurs de Gregory Bateson sur lanotion d'ethos, comme "système culturellement standardiséd'organisation des instincts et des émotions desindividus" (Bateson 1936) et ceux de Margaret Mead,convergeant dans une investigation commune (Bateson et Mead1942), avaient souligné la nécessité pour l'anthropologuecommunicant avec des Balinais de "ne pas compter sur sesémotions réelles" mais d'"apprendre à exagérer et àcaricaturer ses attitudes amicales jusqu'à ce que les Balinaispuissent les tenir sans risque pour théâtrales plutôt queréelles" (Mead 1942, p.32). Sociologue soucieux de rendrecompte de l'origine d'émotions sociales, Erving Goffman acontribué à étendre le modèle du théâtre et de la mise enscène à l'ensemble des interactions sociales, ce qui l'amèneégalement à porter une grande attention au tact, à la gaffe,au faux pas, à l'embarras (Goffman 1974, pp.27-29, 87-100).
Les approches constructivistes précédentes, danslesquelles un individu "interprète sa propre conduite commeémotionnelle à la façon dont un acteur interprète son rôleavec 'du sentiment'" (Averill 1980, p.305) mettent l'accentsur des conventions collectives qui déterminent l'expressiondes émotions et privilégient donc les significations et lescroyances (elles-mêmes considérées d'emblée comme collectives)sur des excitations corporelles. Le niveau collectif serasaisi par des cultures, des systèmes de rôles, ou des cadreschez Goffman, "cadres primaires sociaux" dans lesquelss'effectue "le genre de pilotage de l'action soumettantl'événement à des normes et l'action à une évaluation socialefondée sur les valeurs d'honnêteté, d'efficacité, d'économie,de sûreté, d'élégance, de tact, de bon goût, etc." (Goffman1991, p.31). Les catégories utilisées pour cerner cescontraintes collectives (des normes sociales aux situations-
9.
types en passant par les rôles et les pratiques) ne sont pasindifférentes pour notre propos, certaines étant plus aptesque d'autres à la saisie d'une dynamique de l'interaction,d'un apprentissage, ou à la prise en compte des ébranlementscorporels3.
Dans sa théorie cognitiviste de l'émotion sur laquellenous reviendrons, Ronald de Sousa reconnaît la pertinence decette approche dite "contextualiste" pour aborder des émotionsparticulièrement sociales comme la colère ou la sympathie (deSousa 1987). En outre de Sousa aborde la question du caractèreapproprié de l'émotion en se référant à des "scénariosparadigmatiques" qui contribuent à une sémantique et qui ontun rôle crucial dans la mise en place de répertoiresémotionnels (id, pp.171,235). Les travaux empiriques sur lesantécédents des émotions (Scherer Wallbott et Summerfield1986) pourraient contribuer à repérer ces scénarios.Cependant, de Sousa s'écarte des analyses socio-culturelles enconsidérant que ces scénarios ne sont pas assimilables à descoups dans un jeu, leur origine se trouvant dans des"pratiques" qui sont constituées pour partie de "réponsesnaturelles", même si ces réponses "trouvent une cohésion et unnom dans le contexte d'une situation sociale pertinente" (id.,p.251)4. Les émotions ne sont pas des créations sociales aumême titre que les jeux ou même le langage, et de Sousa endonne pour indice qu'une divergence entre un "scénariosocialement prescrit et un scénario qui suscite les sentimentsd'un individu n'est pas nécessairement réglée en faveur dudialecte public" (id., p.236). Certaines émotions passent,mieux que d'autres, l'épreuve de l'explication, voire de lajustification (id., pp.108,131).
Dans notre propre démarche, nous chercherons à tenircompte des différences et des articulations entre des émotions
3 L'engagement corporel dans les pratiques est ainsi mis en valeur dans lesélaborations proposées par Pierre Bourdieu des catégories de l'ethos et del'hexis. L'émotion peut ainsi être soustraite à l'ordre d'une psychologieindividuelle sans être rabattue sur un code social en étant vue comme lerésultat d'une rencontre d'hexis corporelles. L'accent sera mis surl'installation de dispositions émotionnelles dans des habitus (Bourdieu 1980).4 Pour une analyse, partiellement autocritique, des limites, des catégories derôle et de jeu, dans l'approche des émotions, voir Averill (1980, pp.324-326).
10.
plus primaires, même lorsqu'elles portent déjà la marque d'uneinquiétude sur l'évaluation, et un niveau conventionnelattaché à des exigences de publicité. Ceci nous permettranotamment de situer les places respectives d'un régimecollectif attaché au renom et à l'opinion des autres, et d'unrégime de l'inspiration dans lequel c'est, à l'inverse,l'authenticité qui est mise en valeur.Langage et normalité des émotions
Inversant la démarche qui consiste à rapporter desémotions à des normes sociales, on peut s'interroger sur lestatut de ces normes et la place qu'y tiennent les émotions.
Une stratégie intéressante consiste à rapporter lejugement normatif à une exigence de coordination desconduites. Allan Gibbard adopte cette stratégie dans sonapproche de ce type de jugement qu'il rattache à la nécessitéd'une coordination complexe d'actions et de plans danslaquelle le langage joue un rôle central (Gibbard 1990, p.26).Il distingue de l'internalisation des normes leur"acceptation" qui passe par le détour du langage. Ce détourfait défaut à un ajustement reposant sur un système decontrôle primaire dans lequel l'individu est "sous l'emprise"d'une norme (in its grip) (id., p.61). L'acceptation des normess'élabore dans des conversations quotidiennes qui sontl'occasion de revenir, avec une certaine distance, sur desévénements problématiques et des affrontements personnels,dans l'attente de réactions, et qui font ainsi office derépétitions (p.72)5. Cette démarche reconnaît donc une placeimportante aux exigences du jugement normatif et conduit às'interroger sur la façon dont il "imite" le jugement de fait(p.8) et sur la nature de ses exigences de cohérence, plutôtque de considérer que les émotions contiennent des jugementsproprement cognitifs. Faute d'une définition tranchée d'unjugement cognitif, nous ne pouvons que situer les émotionsdans un espace marqué, à une extrémité, par une arithmétiquementale qui relève clairement d'un jugement cognitif et, àl'autre extrémité, par un sentiment comme celui de lassitude
5 Gibbard situe le commérage (gossip) parmi ces exercices quotidiens decoordination des évaluations (cf. Sabini et Silver 1982).
11.
qui est clairement non cognitif et ne semble pas procéder d'unjugement (id., p.131).Emotion, évaluation et connaissances
Que les émotions contiennent des évaluations, ce queGibbard tient pour une mauvaise question, est une affirmationqui caractérise un courant se réclamant d'une analyse"cognitive-phénoménologique" des émotions (Lazarus Kanner etFolkman 1980) et que rencontre sur certains points l'approched'Averill déjà mentionnée. Dans ce courant, le concept-clé estcelui de "cognitive appraisal". L'attribution d'une faute àl'origine d'un mouvement de colère ou de culpabilité est uneforme de cette appréciation cognitive. Selon ces auteurs, plusque d'une évaluation initiale, elle relève d'une dynamiquesuivie et critique se développant dans l'expérience de cesémotions. Emotion et cognition sont ainsi inséparables,puisque "l'appréciation comprend une part de la réactionémotionnelle" (p.198). Cette dynamique met l'accent sur unesituation de coordination plus large que la coordinationlangagière examinée par Gibbard, que les auteurs désignent entermes de "coping" avec l'environnement et la transaction.
Cette intrication du cognitif et de l'émotif dans unmouvement d'ajustement à l'environnement de l'agent est ainsiplus étroite que dans les approches qui mettent plusgénéralement en avant l'influence des croyances sur latraduction d'excitations physiologiques en émotions. Cesapproches se sont notamment constituées en opposition à laréduction jamesienne de l'émotion à la perception dechangement des états du corps. L'expérience de Schachter etSinger (1962) est classiquement mentionnée à l'appui de cettedémarche, puisqu'elle montrait qu'une injection d'adrénalinequi produit des symptômes déclenchés normalement par uneémotion mais non l'émotion elle-même, qui dépend, elle, de lasituation dans laquelle sont plongés les sujets del'expérience. Selon cette situation et les croyances dessujets, l'émotion ressentie était la colère ou l'euphorie. Cetableau "attributionnel" de l'émotion sert, comme les travauxsur les différences interculturelles dans le lexique desémotions, à mettre en question les démarches qui visent, àl'inverse, à proposer des taxinomies d'émotions élémentaires
12.
se prêtant à des combinaisons diverses, adoptées parPlutchik (1980) ou Tomkins.L'émotion comme soutien des opérations cognitives
Le rapprochement entre émotion et cognition est plusétroit encore lorsqu'est établi un parallèle entre l'attentionaccompagnant la perception et la direction de l'émotion, sa"focalisation" (Gibbard, p.135). Ce parallèle suppose d'êtreattentif aux cas dans lesquels les émotions ont des objetsextérieurs, à la différence des humeurs sans objet et des"émotions projectives" qui devraient être exclues del'intégration dans le cognitif (de Sousa 1987). L'émotion estvue alors comme participant d'une économie cognitive. C'est unmécanisme de "contrôle du facteur de saillance" qui permet delimiter "l'ensemble pléthorique des objets d'attention, desinterprétations, des stratégies d'inférence". Les émotions"imitent temporairement la mise en information de laperception" (id., p.172). Cependant, cette démarche n'impliquepas de rabattre complètement émotion sur cognition si elles'accompagne d'une attention aux degrés d'intentionnalité,depuis des tropismes jusqu'à l'attachement à des personnesparticulières et non seulement à des situations-types, à ceque de Sousa nomme, par analogie avec le droit, des objets"non fongibles", attachement qui diffère du niveaud'adaptation instinctive et qui, selon lui, est une capacitéproprement humaine (id., pp.98-101).
2. ESQUISSE D'UNE THÉORIE DES ÉMOTIONS PUBLIQUESDans une perspective purement cognitive, les émotions
sont déclenchées causalement par des traits ou propriétés desobjets et des situations. Perçus et catégorisés, ces traitsinduisent des croyances ou sont reliés à des croyancesd'arrière-plan et à des désirs (ou préférences) du sujet. Onpeut donc identifier une émotion du point de vue de latroisième personne, à condition d'attribuer des désirs et descroyances à autrui. Cette approche a l'avantage de rendrecompte du fait que notre propre expérience affective enpremière personne peut être déficiente : nous pouvons noustromper sur nos émotions. Nous croyions ressentir un légeragacement, et nous étions en colère ou haineux. Mais elle se
13.
heurte à une objection évidente : il ne suffit pas derassembler les préférences, les désirs, certaines croyancesd'arrière-plan, et les propriétés de telle situation, pour quenous ressentions l'émotion ainsi décrite. Il en est un peucomme de l'action : il ne suffit pas d'avoir l'intentiond'agir (le désir, la croyance qu'en se comportant ainsi onobtiendra telle fin) pour agir effectivement. Par ailleurs ilsemble y avoir des émotions non intentionnelles (comme "avoirle blue"), qui ne sont pas déclenchées par des propriétésparticulières d'une situation, ni par des croyances. Lescroyances cognitives ne sont donc ni suffisantes, ninécessaires pour que nous ayons des émotions.
Les approches comportementales lient les émotions à desmodes de réaction, à des situations. Plus précisément,l'émotion est située dans la chaîne des événements déclenchéspar un stimulus, comme une étape de préparation à uneréaction. Mais il est nécessaire de dépasser les limites dubehaviorisme, et d'admettre des états internes émotionnels,pour expliquer des réactions très différentes à des situationsapparemment semblables. L'émotion semble donc impliquer unétat affectif, une disposition à des réactions, unefocalisation sur certains aspects de la situation.
Par tous ces traits, l'émotion apparaît comme une ébauchede cognition, comme une cognition primaire, dans laquellel'appréhension de l'information et la réaction interne et/ouexterne seraient plus immédiatement reliées que dans uneactivité cognitive plus sophistiquée. Mais il ne semble pasque l'émotion nous permette d'appliquer des catégorisationstrès articulées. Les émotions ne semblent pas organisées à lamanière des genres et des espèces. Avoir peur n'est pas unesous-catégorie des émotions négatives, ayant elle-même commesous-catégorie l'épouvante. Les deux émotions sont directementde valence négative et reliées à des dispositions d'évitement.Elles diffèrent donc selon les dimensions de la valence, del'intensité, de la conduite dispositionnelle. Les émotionssont proches des odeurs, où chaque activation d'un récepteurse rapporte à une dimension d'un vecteur sans qu'on puissehiérarchiser et regrouper en catégories ces dimensions, plus
14.
qu'elles ne sont proches des catégories cognitives ordonnéesdans un réseau d'héritage de propriétés.
Cependant, via son expression, l'émotion n'implique passeulement un état affectif, des dispositions à des réactions,et un mode de sélection de traits de la situation. Elleimplique aussi une relation interactive avec d'autrespersonnes. Les expressions des émotions sont en partie innées,mais elles se raffinent au cours des interactions entre lebébé et son entourage.2.1. L'émotion d'être évalué
Nous n'entrerons pas ici dans une théorie del'apprentissage des émotions par les différences de leursexpressions, mais nous relèverons que nos capacitésd'évaluation, au sens fort de ce terme, ont pour origine cetteinteraction. C'est parce que nous ressentons l'évaluationd'autrui dans l'interaction que nous devenons capablesd'évaluation de nos propres conduites.
Cette thèse peut sembler excessive. Après tout, nousévaluons déjà les situations en fonction de nos intérêtsvitaux et des conduites dans lesquelles nous sommes engagés(nous évaluons telle chose comme appétissante quand noussommes engagés dans une conduite de nutrition, etc.). Onpourrait alors penser que, devenant capables d'assigner auxautres des croyances, des intérêts vitaux et des dispositions,nous pouvons leur attribuer des émotions et des évaluations,en particulier celles qui portent sur nous et nos conduites.Mais on ne voit pas comment une telle activité cognitivepourrait rendre compte de l'intensité émotionnelle qui estliée au sentiment d'avoir été évalué (positivement ounégativement) par les autres. C'est un problème qu'Adam Smithavait en quelque sorte retourné. Il tablait en effet sur unebaisse d'intensité émotionnelle, sur l'impossibilité d'uneimplication totale quand nous attribuons des émotions àautrui et les reconstruisons par notre imagination. Ilescomptait ainsi nous faire peu à peu accéder au point de vuede la troisième personne, celui de l'observateur impartial6.6 A la question du spectacle de la souffrance et de son traitement public, quesoulève également l'analyse de Smith, la recherche actuelle de Luc Boltanski esttout entière consacrée.
15.
Mais cela démontre a fortiori que ressentir une évaluation enpremière personne est une tout autre expérience. Nouspartirons, à l'inverse, d'un sentiment passif, d'uneévaluation qui est faite de soi, non pas d'un soi qui évalue.
Ce n'est en effet pas en reconstruisant cognitivement lescroyances d'autrui et leurs émotions que nous pouvonsressentir le poids de leur évaluation. Comment pourrions-nousdéclencher à nous seuls de telles émotions d'évaluationlorsque nous sommes occupés à poursuivre et orienter nosconduites ? Nos évaluations sont alors dirigées vers lessituations et non vers le Je qui utilise ces évaluations pours'orienter. Même si, dans ces conduites, nous recourons à desreprésentations de nous-mêmes, le Je qui utilise cesreprésentations n'est pas lui-même évalué, et ceci parprincipe.
La difficulté vient de ce que, pour me sentir "gêné" ou"honteux" par exemple, il n'est pas nécessaire de construireune représentation des croyances d'autrui, cet autrui qui mejugerait mal. Plus exactement, il n'est pas nécessaire d'êtrecapable de différencier les croyances d'autrui des siennes. Ilsuffit d'identifier une expression de désapprobation chezautrui, à l'origine assez proche du dégoût. Nous ressentironsl'émotion d'"être désapprouvé", c'est-à-dire d'être évaluénégativement, sans pour autant reconstruire toutes les raisonsde cette désapprobation. De même, nous n'avons pas besoin,pour nous sentir désapprouvés, de construire unereprésentation du Soi qui est désapprouvée. Il nous suffit delier le sentiment d'être désapprouvé à une expression d'autruiet, d'autre part, à un trait de notre conduite.
Cette expression se manifeste dans une "panne" del'interaction : nous ne pouvons plus poursuivre l'interactionengagée sur les bases de nos projets, nous devons les remettreen cause. Cette panne pourrait n'engendrer que la surprise oula déception. Cependant, nous ne ressentons pas seulementl'hétérogénéité de l'expression d'autrui qui ne "cadre" plus,mais aussi l'impuissance à la compenser. S'il s'agissaitsimplement de rectifier notre conduite pour continuer à nouscoordonner avec autrui, seule serait engagée une opérationcognitive. Mais la rupture nous fait ressentir notre
16.
"altérité" : la fausse note, c'est nous. Une simpleinsatisfaction au regard de convenances personnelles devientune véritable gêne avec l'incursion d'une évaluationétrangère. Il faut donc distinguer entre l'appréciation quenous avons de la situation en fonction de nos intérêts et desconduites dans lesquelles nous sommes engagés, appréciationqui peut reposer sur des convenances personnelles, etl'évaluation interactive déclenchée par l'émotion d'êtreévalué dans une de nos conduites. Il n'est pas nécessaire pourautant que nous forgions une représentation du Soi. Il fautseulement que nous cessions d'adhérer à nos conduites et d'enêtre le centre de contrôle inévaluable puisque toujoursappréciateur des situations. Le sentiment d'être désapprouvésuspend pour un temps l'égocentrisme de l'engagement dansl'action, sans impliquer pour autant une identification duSoi. Ce sentiment marque une brusque déconnexion entre lesanticipations propres au contrôle du Je et notre conduitedévaluée par l'expression négative d'autrui. Il nous faut doncdistinguer la simple "appréciation", qui nous fait valuer dessituations en fonction des actions et buts où notre contrôlen'est jamais remis en cause, et l'évaluation, qui prend sonessor avec l'émotion d'être évalué dans une de nos conduites,et qui repose donc sur une interaction avec autrui, même sielle ne se fait pas sous le mode sophistiqué des attributionsd'attitudes.
Cette émotion est à rapprocher de l'indécidabilitérencontrée dans notre quête pour identifier les intentionsd'autrui, dans nos efforts pour attribuer à autrui desattitudes et pour nous représenter les différences possiblesentre nos croyances et celles d'autrui. Ici, l'indécidabiliténe concerne pas l'intention d'autrui mais notre propreactivité de décider, de contrôler notre conduite, qui estbrusquement déconnectée de cette conduite. L'expressiond'autrui indique clairement la désapprobation, mais nous nesavons pas quelle intention de notre part elle vise, et nousne nous posons pas encore explicitement cette question. C'esttoute notre maîtrise dans la décision et l'appréciation qui setrouve suspendue. Et pour découvrir les justifications decette réprobation, nous devrons passer par deux nouvelles
17.
phases. Nous reprendrons le contrôle égocentrique de nos actesdans la mesure où nous aurons pu identifier le trait mis encause et décider de la conduite responsable. Si nous cherchonsà identifier les justifications et intentions d'autrui danscette mise en cause, alors nous rencontrerons le problème del'indécidabilité. Il est en effet indécidable de savoir sic'est bien par l'évaluation que je pense imposée à moi-mêmeque les autres m'évaluent. Leur poserais-je la question :"est-ce bien en visant telle intention mienne que vousm'évaluez ainsi?" que je ne saurais si leur réponse positivevaut confirmation de leur propre intention d'assignation oubien reconsidération de leur précédente assignation pours'aligner sur l'intention qu'ils supposent que je leur proposeà présent. Ces trois étapes (émotion d'être évalué,assignation de la conduite responsable, indécidabilité del'enquête sur les intentions d'assignation d'autrui) noussemblent pouvoir décrire le processus d'apprentissage del'évaluation sociale.
Nous sommes peut-être allés un peu vite au coeur duproblème, et il nous faut maintenant catégoriser la notiontrop générale d'émotion. Nous avons expliqué l'intensité del'émotion liée à l'évaluation par une "panne" du système dedécision et d'appréciation, suspension provoquée par uneexpression d'autrui. Mais, pour que cette mise en questionnous apprenne à nous évaluer, il faut qu'elle ait desrésonances durables. Il faut donc que l'expression d'autruisoit répétée. Dès lors elle ne peut plus simplement provoquerla surprise. Le choc de la suspension, quand il est répété,devrait décroître, sauf si nous nous trouvons chaque foisdésapprouvés sans l'avoir anticipé. Pour que cette habituationà l'émotion d'être évalué ne ruine pas les effets de cetapprentissage axiologique, il faut que ce ne soit pas unesimple émotion passagère qui soit mise en branle mais une"passion". La passion est un mode d'auto-renforcement d'uneémotion. 2.2. Catégorisation du domaine émotionnel
Pour être plus explicite, il nous faut donc esquisser unetypologie du champ émotionnel.
18.
Nous partons d'affects qui sont des modes cognitifsprimaires dans lesquels la perception, en corrélation avec lesfonctions mises en jeu par l'organisme (nutrition,reproduction sexuelle, exploration, etc.), déclencheimmédiatement des états internes fortement résonnants. Dotésd'une certaine rémanence, ils imposent une tonalité au systèmecognitif et sélectionnent certaines dispositions à l'action.
Ces affects sont-ils intentionnels? L'intentionnalitéintroduit (entre autres) l'opacité référentielle, et la nonsubstituabilité. Ici, sans doute, deux mêmes propriétés del'environnement peuvent induire des émotions très différentes.On pourrait donc croire à l'intentionnalité. Mais si noussommes dans le même état interne et que deux choses présententun même trait déclencheur pour notre système perceptif, alorsces deux choses sont substituables; toutes deux déclencherontle même affect. Et deux états internes similairesaffectivement vont posséder la même classe de substituabilitéquant à leurs traits déclencheurs (de plus on peut définir uneévolution de cette classe selon la dynamique de l'affect).Donc l'affect ainsi défini ne présente qu'une pseudo-intentionnalité. On ne peut pas en particulier superposer desaffects de second ou nième degré qui seraient les véritablesappréciateurs des traits déclencheurs, au lieu des affects depremier degré, alors qu'on le peut dans les attitudesintentionnelles (je crois que je crois que). La pseudo-intentionnalité tient simplement à la circularité entre lestraits déclencheurs et les états internes qui lessélectionnent. Mais cette circularité n'est pas vicieuse: ilsuffit de partir de traits donnés, de supposer un métabolismequi les sélectionne, de définir la classe de variation decette sélection et tenant compte de son évolution covarianteavec les variations du métabolisme, etc.
Nous définirons ensuite des sentiments qui procèdentd'une recherche d'identification des aspects supposésresponsables de l'affect, qu'il s'agisse de l'état interne, oubien de propriétés des situations et objets ambiants. Lessentiments sont intentionnels quand ils réussissent àattribuer à des traits de la situation interne ou externe lesqualités des affects. Quand cette attribution ne se fait pas,
19.
ce sont alors des humeurs (le blue, le spleen, etc.) quidiffusent de manière assez indifférenciée.
Les émotions proprement dites naissent de larequalification de l'affect par le sentiment, et durenforcement du sentiment par l'affect qui en résulte. Dans lecas intentionnel, le trait identifié par le sentiment estmaintenant celui qui déclenche l'affect : l'affect nousfocalise sur ce trait de sorte qu'il contribue à coordonnerdes réactions internes (états) et externes (comportements). Sion accepte avec Edelman qu'une telle "recatégorisation" enappelle au conscient, les émotions sont conscientes sans êtrepour autant réflexives. On considère désormais la situationsous un certain aspect focalisé par l'émotion.
C'est par ce pouvoir de focalisation que l'émotion peutêtre intégrée à moindre frais dans un cadre cognitif,puisqu'elle fait saillir des traits et, en concentrantl'attention sur eux, restreint le domaine de traits pertinents(de Sousa 1987). Cependant l'intégration aux opérationscognitives ne doit pas gommer les spécificités de cetengagement émotionnel. L'émotion ne se confond pas avec unediscrimination d'un trait ; elle suppose un mouvement derenforcement du trait. En outre, à la différence d'uneconscience perceptive, elle comprend une disposition àl'action qui n'est pas détachable de l'action. La perceptionpeut se faire sans action alors que l'émotion exerce unpouvoir mandatorial.
Enfin les passions sont des sentiments qui perdurent. Lemouvement de recatégorisation s'étend dans le temps. Il peutnaître de l'anticipation d'un trait déclencheur d'émotion maisil s'étire en une disposition à reparcourir sans arrêt lecycle de recatégorisation dans un auto-renforcement del'émotion. On voit donc que l'évaluation, pour ne pas seréduire à une simple appréciation temporaire, implique laconstitution de passions. L'expression d'autrui déclenche ennous une passion d'évaluation, qui consiste à ressasser lacatégorisation et à la renforcer affectivement.
20.
2.3. La place de l'émotion dans la transformation du jugementde fait en jugement de valeur
Les émotions au sens général du terme sont donc des modesprimaires de cognition-réaction. Le mode cognitif au sensstrict pourrait bien n'être qu'une hypertrophie de l'affectlié à l'exploration, une émanation de l'émotion d'exploration.On voit bien la place de cette excitation dans l'apprentissagedu maniement d'artefacts complexes. En l'absence d'une telleémotion, l'agent manipulateur s'installe dans une habitude, unchemin balisé dans son interaction avec l'artefact, qui éviteles mauvaises surprises mais limite la variété des usages danslesquels l'objet peut être engagé (Thévenot 1993). Pours'écarter de ce chemin balisé, l'agent doit s'aventurer dansune exploration coûteuse en déboires. L'excitationexploratrice est, à l'inverse, à son comble dans le cas où lemanipulateur cherche délibérément à dépasser les fonctionsnormales de la machine pour découvrir de nouvellespossibilités, comme dans le cas des hackers en informatique.Poussée à cette extrême, l'émotion de la découverte peut êtresocialisée dans un régime collectif de l'inspiration surlequel nous reviendrons en troisième partie.
Mise à part l'émotion liée à l'exploration, qui pousse àdécouvrir de nouveaux traits pertinents dans l'interactionavec l'environnement7, les émotions confèrent à l'espèceparticulière de jugement qu'est le jugement de valeur descaractères spécifiques par lesquels il s'écarte d'un jugementde fait ne reposant que sur les processus cognitifs de lacognition classique. Cependant, il en reprend aussi bien destraits, quand il n'est plus simples appréciation, maisélaboration d'un évaluation.Le jugement de valeur est un jugement d'analyse.
L'usage classique des notions de valeur ou de normesociale tend à présupposer que les conduites attachées à cestermes sont similaires, d'un individu à l'autre, dans le tempset dans l'espace, de sorte que la question de leur
7 L'accent mis généralement sur les émotions négatives tend à laisser dansl'ombre le rôle des émotions "positives" comme la joie, ou le "flow", dans lapoursuite à moyen terme des efforts pour venir à bout dedifficultés (coping) (Lazarus Kanner et Folkman 1980).
21.
coordination serait ainsi résolue d'avance. Corollaire decette hypothèse de similitude et de détermination rigoureusedes comportements, le rôle imparti au jugement évaluatif surla situation est réduit à sa plus simple expression, celled'une orientation holiste et idéaliste vers un principe. Dèslors que l'on entreprend une autre démarche et que, partant duniveau d'actions individuelles a priori irréductibles à desrègles, on s'interroge sur les conditions de leur coordinationet sur la spécificité d'un niveau axiologique, la dynamiqued'ajustement cesse d'être triviale et doit reposer sur desexigences de rationalité qui sont à l'oeuvre dans le jugementde fait. L'opération de jugement occupe une place importantedans cet ajustement et il faut prendre au sérieux la façondont le jugement normatif "imite le jugement de fait" (Gibbard1990).
L'étude des jugements émis dans des régimes collectifsd'évaluation, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en cause unêtre qui a failli, montrent que, loin de se réduire à laréaffirmation d'un principe ou d'une norme, ils procèdentd'une analyse de la situation qui n'est pas sans rappelerl'examen qu'impliquent la recherche de causes à un événementobservé, ou la construction d'une anticipation sur lesconséquences de la situation présente. L'orientationaxiologique n'est pas seulement soumise au débat et à lacritique parce que les normes sociales le seraient, comme dansla présentation qu'en fait Habermas (1987), mais parce que lesjugements impliqués par cette orientation se prêtent au débatet à la critique. Cela implique qu'ils ne visent pas seulementles idéaux des acteurs mais qu'ils sont supportés par destraits de la situation, et notamment des objets qui fontpreuve. Ces jugements constituent donc des tableauxdécomposant la situation en éléments de façon à permettre d'enconsidérer les relations.L'exigence de cohérence dans le jugement de valeur et le soubassementémotif
Mais l'enracinement émotionnel du jugement de valeur esttoujours maintenu. Le jugement de valeur se prête à unedynamique de procès et d'attribution d'une défaillance à unêtre, ce qui suppose des règles d'accord entre les éléments
22.
réunis dans le tableau du jugement. C'est dans ces règlesd'accord que nous retrouvons la trace des soubassementsémotifs du jugement de valeur. En effet les règles d'accord nesont pas des règles de non contradiction mais des exigences decohérence. Le moteur des associations qui gouvernent la miseen rapport des éléments pris en compte dans le jugement résidedans la capacité de diffusion de l'émotion. La passion permetune mise en rapport puisque, une fois déclenchée par un traitparticulier d'une situation, elle diffuse sur d'autres traits,se propage, fait tache. La généralisation émotive met enrelation les traits susceptibles d'induire la même passion. Perception et qualification
Au niveau de l'émotion, les traits qui déclenchent etdiffusent sont idiosyncrasiques et on admettra qu'ilsdiffèrent d'un individu à l'autre, ce qui est une différencenotable par rapport à la perception. La coordination desémotions se privera des exigences fortes associées à laperception. Cependant, les évaluations impliquées dans desjugements doivent permettre un certain niveau d'abstractionpar rapport aux traits particuliers de la situation etimpliquer un détachement des subjectivités et de leurshistoires particulières. Les qualifications impliquées dansles justifications qui se rapportent à des ordres de grandeurpermettent une catégorisation de traits évaluatifs et unaccrochage avec un discours argumentatif. Les traits sontenvisagés comme propriétés des objets et la cohérence dans lesmodes de qualification est assurée par la spécification del'ordre de grandeur. Ce sont des traits qui ont une apparentestructure catégorielle mais qui déclenchent la passion.L'enchaînement du jugement et de l'action
Les émotions permettent une coordination plus immédiateque la cognition classique, puisqu'elles enclenchentdirectement des dispositions à l'action, au seul vu decertaines expressions chez autrui. Et si nous nous sommestrompés sur une expression, notre action ou notre propreexpression manifestent rapidement notre erreur. Lacoordination est plus rapide que celle impliquant le détour del'attribution de croyances. Dans des accommodements locauxdans le cours d'actions communes, on tendra à traiter dans
23.
l'affectif ce qui, faute de temps, ne peut donner lieu à unjugement de fait et à une analyse fine des repères cognitifs.Bien entendu, cette coordination est aussi plus limitée encomplexité, et les erreurs peuvent être irrécupérables unefois l'action mise en branle et sa résonance émotionnellelancée sans possibilité d'arrêt immédiat.
3. LES RÉGIMES COLLECTIFS D'ÉVALUATION Nous pouvons maintenant comprendre comment l'émotion liée
aux évaluations permet la constitution de collectifs, et derégimes propres à ces collectifs. Parce que l'identificationdu trait en cause dans l'évaluation n'est pas aisée, tousauront tendance à se fixer sur des saillances trèsparticulières qui vont être l'occasion des expressionsd'évaluation : ce sont des traits tabous ou festifs surlesquels se concentrent les manifestations de la communauté.L'incertitude de l'assignation évaluative exige cettefocalisation sur des traits emblématiques.
Cependant, cette première forme de collectif intégrantdes traits cognitifs et des émotions n'aboutit qu'à unecommunion sur des traits particuliers, dans un rituel. Pourque la communauté puisse faire respecter des évaluations dansdes domaines d'action plus larges, il faut conventionnaliserces traits en en faisant des repères pour des règles plusgénérales. Une convention gouverne un large ensemble d'actionscoordonnées et ne présuppose que quelques repères indiquant latransgression ou le respect de la règle. Pour le reste, ons'en remet au contrôle qu'ont les sujets sur leurs conduiteset à leur intérêt à se coordonner. Les conventions mêlent doncdes traits qui pourraient donner lieu à une émotion évaluativeavec des processus cognitifs classiques (inférences, plans,etc). Ce procédé a l'avantage de "refroidir" les émotions, etd'utiliser les capacités de réélaboration et d'auto-entretiendes passions pour frayer des "habitus" qui réunissentcognition et affect.
Cependant, avec le niveau conventionnel, l'émotiond'évaluation peut être déclenchée non plus seulement par untrait particulier qui fait saillie, mais par une dissonance.On peut repérer, ou plutôt soupçonner dans certains traits des
24.
actions ou des objets une inadéquation des intentions auxrègles : elles seraient au mieux suivies, mais pas appliquées.L'émotion qui en résulte peut être contenue, refoulée, ou biendonner lieu à une demande d'épreuve et de jugement. On revientalors à une socialisation "chaude", après le refroidissementconventionnel. De même le jugement évaluatif et justificateurtentera de "refroidir" à nouveau l'intensité émotionnelle enpassant à un niveau de généralité supérieur.
Notre thèse est la suivante : avant d'en venir à unjugement éthique qui doit en appeler à des arguments d'unegénéralité aussi large que possible, nous commençons à vivrel'évaluation éthique dans des ordres de jugement (les sphèresde justice de Walzer (1983), les ordres de grandeur deBoltanski et Thévenot (1991)). Ces régimes, qui peuvent sesuperposer dans un même domaine d'activité, sont déterminéspar le type de mise en jeu des émotions d'évaluation, avantmême qu'il y ait véritablement jugement de valeur. C'est surces cohérences émotionnelles que s'appuient ensuite lesjustifications du jugement axiologique.
Nous allons esquisser de tels régimes d'évaluationémotionnelle. Souvenons-nous que chacun d'eux propose un modede mise en oeuvre de l'indécidabilité qui est au coeur del'émotion d'évaluation. Régime domestique et généralisation du jugement de confiance
Le régime de coordination par la grandeur domestique dela confiance est celui qui prend le plus directement appui surla familiarité acquise dans des actions en commun. On peut entirer des conclusions sur la genèse de ce régime, sonantériorité par rapport à d'autres. On peut aussi en inférerqu'il est premier dans l'apprentissage de ce qu'est unjugement de valeur. L'interaction rapprochée permet de testerles modes d'évaluation d'autrui. Les premières expériences quiconduisent à ressentir l'émotion d'être évalué surviennentdans un cadre d'apprentissage supposé commun parce qu'il estpermanent et que les situations y sont répétables et répétées.Les expressions de l'évaluation s'y fixent sur des traitsparticuliers, des objets familiers. Dans ce cadre habité pardes personnages familiers, c'est notre propre décidabilité quiest en cause et non celle d'autrui par rapport à qui la
25.
question de l'authenticité n'est pas d'emblée soulevée. Cetteexpérience première de l'évaluation est donc marquée par deuxcaractères que l'on retrouvera dans la généralisation de liensfamiliers à un régime général de coordination "domestique" :a) une tendance à la personnalisation de l'instance dejugement (le "supérieur commun" est une autorité); b) uneasymétrie entre la position du sujet en proie au doute quant àl'évaluation portée sur son compte et, d'autre part, laposition du personnage auquel l'acte d'évaluation est attribuéa priori sans indécidabilité compte tenu de la familiaritéentretenue avec lui. L'asymétrie de position sera aisémenttraduite en une hiérarchie d'autorité et de confiance.
Dans les relations de familiarité, il y a distribution del'émotion sur un large ensemble de choses ou de traitspersonnalisés qui constituent les entours et conduisent à unesorte de fétichisme des objets et des rituels. Leuridentification induit ce qui est décrit comme "chaleur" de larelation et leur absence est ressentie comme un manque.L'intensité affective des traits décidables étant largementrépartie et les repères très nombreux, l'enquête sur lesintentions démarre difficilement.
Le système est très stable lorsqu'il se referme sur uncercle familial ou de familiarité et qu'il se maintient par lareproduction de situations, éventuellement complétée parl'exploration très progressive de variantes toujoursrapportées à des précédents. En revanche, l'insinuation dudoute sur les intentions d'autrui déclenche une crise radicaleet rend très problématique le retour à la stabilitéantérieure. Les repères et les choses familières deviennentbrusquement dissonants par rapport à l'intention soupçonnée :c'est l'enfer, la jalousie ; la retraduction des ajustementsauparavant effectués en confiance en termes de dettes nonpayées.
Pour supporter un régime de coordination général, cettefamiliarité doit être étendue en une grandeur domestique de laconfiance propre à permettre des rapprochements dépassant uneenceinte limitée, et à soutenir des jugements de valeur delarge validité. On le voit bien dans une interrogation sur laconfiance qui peut être accordée à une personne (lors d'un
26.
recrutement par exemple). Il ne peut y être répondu simplementpar la référence à des liens familiaux ou personnels. Il fautpouvoir dépasser le niveau de liens familiaux ou amicaux pourpasser à une estime susceptible d'être transportée et partagéepar une communauté. Cette généralisation pose problème comptetenu d'un ancrage dans des relations personnelles, d'un passécommun et d'objets personnalisés dont la nature dépend de cepassé. La généralisation tendra à s'opérer par l'extension, deproche en proche, à un collectif de "nous autres", sensédétenir la clé de l'évaluation et constituer un gradient avecun autrui plus éloigné. La conventionalisation s'effectuerasur des objets qui gagent la confiance par l'ancrage dans unterritoire et une histoire (maison, seuil, domaine, marquesd'appartenance et de mémoire, coutume). Les traits décidablesdoivent, pour être valides, être investis publiquementd'émotion. La joie est requalifiée en affection, en gratitude,la tristesse en peine et en reproche. Mais l'ambianceémotionnelle des grands moments de la grandeur domestiquesoulève la question de l'authenticité qui était écartée dansune l'intimité ou la familiarité d'un cercle restreint.L'inquiétude quant au caractère "convenu" d'une "cérémonie"(entendue dans un sens dépréciatif) occasionnera dessurenchères dans les civilités et les expressions de confianceet de gratitude.Régime du renom.
Il faut le différencier du régime de l'opinion, et noterqu'il n'est plus guère moderne. Mais il est utile de signalerson existence. Car il permet d'introduire l'idée que nouspourrions être évalués par un groupe, à l'intérieur d'un mêmesystème, par exemple, par nos supérieurs, qui ne sont passimplement une autorité tutélaire, mais une hiérarchie. Enrevanche, nous pouvons alors, en tant qu'appartenant augroupe, nous poser en évaluateurs des autres collectifs, enpensant détenir la clé de cette évaluation. On reste dans cerégime fixé à des rituels, et on a pour repères d'évaluationd'un côté des modèles exemplaires (des individusemblématiques), de l'autre des traits conventionnels dedifférenciation entre groupes. Les traits ou repères
27.
décidables (gestes, objets) doivent être investis par uneémotion exprimée publiquement pour être valides. Régime de l'opinion
Dans le régime de l'opinion, nous conjuronsl'indécidabilité de notre auto-évaluation par une évaluationindirecte via l'opinion des autres en tant que collectif. Nouspartons de traits qui peuvent être particularisés, àl'origine, mais qui doivent pouvoir se reproduire et êtrelargement reconnus, par un autrui anonyme. Leur qualificationrepose sur la reconnaissance par les autres et non sur laspécificité d'une relation familière qui ne joue aucun rôledans cette forme d'évaluation. Les traits pertinents ou leursextensions à des objets sont qualifiés par leur vertu d'êtrereproductibles, communicables. La qualité mise en valeur dansle trait ou l'objet est ce qui fait un signe.
L'émotion est détachée du sujet pour se transformer enpassion de communication collective. Dans le contact avec lesigne de reconnaissance, de la célébrité à la chose griffée enpassant par le lieu commun, l'adhésion est directe avec uneforme de collectif8 et l'émotion qui l'accompagne est uneeffusion. A l'inverse, l'évaluation négative se manifeste,comme nous l'avons vu précédemment dans les travauxanthropologiques ou sociologiques qui éclairent ce régimed'émotion dans l'opinion, par une gêne, un trac, plus qu'unehonte de la confiance perdue.Le régime de la culpabilité et du salut (ou de l'inspirationreligieuse).
Là encore, il s'agit d'un régime qui pourrait êtreconfondu avec le suivant, celui de l'inspiration. Mais il doiten être distingué, parce que son mode de gestion del'indécidabilité est tout à fait original. Ici on ne conjurepas l'indécidabilité, on la vit dans le repentir du pécheur,qui doit justement ne jamais être assuré d'être converti pourpouvoir être sauvé. L'acceptation de l'indécidabilité estconçue comme équivalente à la suspension de contrôle de soipropre à l'émotion d'être évalué, au lieu d'être développéepour elle-même. Le déclenchement émotionnel est privé aussi
8 Weber exclut du social cette forme de collectif (1971, p.20).
28.
bien que public, et il doit se faire sur des traits qui sontrattachables à un système théorique de croyances, système quipermet ce pont entre le privé et le public (on ne satisfaitdonc pas seulement des traits rituels). Régime inspiré et esthétique
A l'inverse du régime précédent, c'est le caractèreradicalement subjectif de l'émotion qui est exploité dans lerégime inspiré, comme réponse aux problèmes del'indécidabilité. L'authenticité de l'inspiration tient à lasuspension du contrôle de soi. On ne s'intéresse pas àidentifier les intentions des autres évaluateurs et l'on seconcentre, non sur l'interprétation d'autrui, mais sur lasuspension du contrôle de son action. Bien qu'il n'y ait pasalignement de conduites collectives, ce régime peut s'étendrecollectivement, chacun ressentant pour lui-même cettesuspension de son propre contrôle. Le supérieur commun n'estdonc ni attaché à une autorité, ni inscrit dans une opinioncollective, mais opère comme une sorte de médium de cettesuspension du contrôle.
Le déclenchement émotionnel est privé, même en public, etles traits déclencheurs sont supposés d'autant plusidiosyncrasiques qu'ils sont liés à une émotion intense. Dansl'élaboration esthétique, ces traits sont en même tempsobjectifs, au sens où ils ne restent pas enfermés dans un étatinterne de l'individu mais s'extériorisent dans une relationentre l'individu et l'objet esthétique. L'émotion doit êtrespécifiquement déclenchée par un objet. Le refroidissementconventionnel se manifeste dans la réification de l'objet oudu geste qui devient reproductible, et la revitalisation de laconvention passe par une rupture de cette conformité et unere-singularisation.Régime civique
On peut approcher le régime civique qui est souventimpliqué par le vocabulaire du "collectif" ou du "social" soitdans une perspective aristotélicienne, comme une mise enémotion puis une reconventionalisation des litiges sur lesconventions (entre différents groupes de la cité), soit dansune perspective rousseauiste, l'évaluateur étant la volonté
29.
générale immanente au groupe lui-même. Dans les deux cas,l'émotion d'évaluation sert à l'élaboration d'une émotionpublique qui tient compte du fait que chacun (ou chaque autregroupe) est aussi un évaluateur.
Le conflit entre des évaluations différentes estdirectement pris en charge par des règles et des repères codésqui constituent les objets pertinents dans ce régime decoordination, et qui contribuent à refroidir les tensionsentre particuliers ou groupes différents. L'émotiond'évaluation mise en branle lors des litiges est une passiondu collectif attachée à l'expression de la Loi commune quinous évalue tous. Les émotions sont d'autant plus intensesqu'elles sont déclenchées par des traits publics et reliéesaux lois : il faut, pour que la conduite soit investie,l'inscrire dans une norme publique.Régime industriel
Le régime industriel de l'efficacité collective doitpermettre de gérer une coordination d'actions en l'absence del'ancrage familier qui soutient le régime domestique, unecoordination avec des acteurs anonymes. Ce régime ne peutcouvrir un très large ensemble d'actions (plus étendu quecelui couvert par le régime de l'opinion, par exemple) queparce qu'il repose sur l'intermédiation d'objets techniques etde méthodes. Par suite, la désapprobation de l'évaluationd'autrui opère par la relation avec l'objet. L'émotion del'évaluation est transférée dans une émotion associée àl'engagement d'objets techniques. L'autrui évaluateur estd'ailleurs, dans ce régime, un expert, c'est-à-dire un êtretrès proche d'un corps de méthodes et d'objets techniques.
Le sentiment de désapprobation est donc le plus souventdéclenché par un échec dans un maniement de tels objets, un"loupé" qui fait sentir que l'on n'est pas à la hauteur et quecela rejaillira sur les autres. Cette émotion est étroitementliée à l'indécidabilité de l'assurance que je fais bien ce queje veux faire. Le repli s'effectue sur des objets qui, parleurs propriétés, font office de garants de la normalité del'action, la technique devant assurer la convergence desévaluations. La garantie du bon jugement des autres setrouverait dans le suivi des articulations de l'objet.
30.
L'émotion du grand moment, dans lequel "ça marche", est unepassion de l'efficacité.Régime marchand
Le régime de coordination marchand permet également decoordonner des actions entre des individus anonymes, enl'absence de familiarité. Pour cela, il prend également appuisur une très large variété d'objets qui serventd'intermédiaires dans l'ajustement des actions. Toutefois, lagamme des actions couvertes est plus étroite que dans lerégime précédent puisqu'elle se limite à l'achat et à la ventede biens. Les actions d'utilisation de ces biens sont laisséesen dehors de la coordination et n'apparaissent que dansl'"utilité" ou le désir de l'acheteur. Ce régime estparticulièrement équipé de conventions destinées à régler leproblème de l'indécidabilité. La monnaie d'échange permet uneévaluation commune par les prix, et les intentions sontclairement de vendre et acheter au meilleur prix.
L'émotion de base, strictement privée et liée au désir etau plaisir d'appropriation, est collectivisée et transforméeen une émotion publique dans la passion de "faire desaffaires" qui dépend d'une évaluation de la transactionparticulière par rapport au prix juste ou normal. L'évaluationdes autres se focalise sur l'alternative "faire une bonneaffaire" / "se faire rouler". L'émotion de l'évaluation peuts'insinuer dans ce régime pourtant encadré par des conventionstrès formalisées en raison de deux types de limitesrencontrées dans la conventionalisation. L'une concerne lesbiens marchands, l'autre la monnaie d'échange.
L'enjeu et les limites de l'identificationconventionnelle des biens marchands tiennent au fait que lesutilisations des biens ne sont laissées en dehors de lacoordination marchande qu'en vertu d'une inscription de cesutilisations potentielles dans une qualité propre à l'objet.La définition et la garantie de propriétés intrinsèques, trèsproblématiques - plus encore lorsque le bien marchand est unservice - sont sources d'une émotion d'évaluation qui démarrepar un doute sur les objets, le soupçon d'un vice dans lamarchandise impliquant la défaillance de l'acheteur qui s'estfait tromper. Ce doute et son indécidabilité se manifestent
31.
dans une circularité entre la qualité et le prix, lorsque cedernier joue le rôle d'indicateur de qualité. Il est suscitépar des asymétries de toutes sortes entre les partenaires dela transaction qui ne sont plus les agents équivalentscouverts par les conventions de l'échange. Et la passion desaffaires relance justement la quête opportuniste de tellesasymétries, ce qui donne une dynamique particulière à cerégime marchand et met à profit l'émotion proprementexploratoire de recherche d'opportunités9.
L'autre convention, qui porte sur la monnaie d'échange,est mise en échec par l'extension de l'horizon temporel deséchanges et la spéculation à laquelle elle peut donner lieu.Les crises de confiance sur la monnaie transforment lacirculation en un crash. Les agents deviennent conscients dufait que leur évaluation leur revient en boomerang au traversdu marché. L'émotion d'être évalué est particulièrementintense dans ces crises.
CONCLUSION:Pour éclairer les fondements et la dynamique de régimes
de coordination collective à partir des catégories de l'actionindividuelle, nous avons cherché dans l'émotion le mouvementinitial qui fait que l'acteur se déprend de l'égocentrismepropre à l'action en s'inquiétant de l'évaluation des autres.Ce mouvement est donc une pièce essentielle dans laconstruction d'un jugement de valeur et dans l'élaboration deformes de collectifs qui sont associées à une notion de biencommun. En concevant les émotions comme des modes cognitifsprimaires, nous avons proposé une différenciation du mouvementde l'émotion par degrés (affects, sentiments, émotionsproprement dites, passions), de façon à suivre précisément laprise en compte des autres dans la construction d'uneévaluation. Nous avons identifié l'émotion d'"être évalué"comme point d'articulation avec la dynamique proprementcognitive de l'indécidabilité dans l'attribution d'intention.Des émotions "publiques" peuvent être générées de différentesfaçons, selon l'élément de l'inquiétude émotionnelle de base
9 On voit bien cette émotion dans la mise sur le marché d'objets de brocante etdans l'expertise qu'elle implique : Bessy et Chateauraynaud 1993.
32.
qui sert de support à une généralisation, et donc au jugement.La recherche de substituts décidables à une enquêteindécidable utilise la fixation émotionnelle et son intensitépour arrêter la quête. Les jugements de valeur contiennent desémotions plus qu'ils ne les excluent dans un pur tableau defaits et dessinent un paysage d'axiologies collectivesdifférenciées.
Nous avons cherché ainsi à échapper aux difficultés d'uneconception purement cognitive des émotions, tout en intégrantleur fonctionnement à une perspective cognitiviste. Si ladiscussion éthique déborde le cadre de ces régimes collectifsmettant en valeur des émotions publiques, l'éthique n'estqu'un moment où l'on échappe à l'appartenance à des régimesaxiologiques en les relativisant. Mais la discussion éthiquen'est qu'un intermède. Le jugement final et son impact sur lapratique ne sont acquis qu'en retrouvant l'un ou l'autre deces régimes (ou en contribuant à l'élaboration d'un nouveau).La généralité des jugements éthiques porte toujours la marquedes spécificités des dynamiques émotives qui individualisentchaque régime. La généralisation que permet la discussionéthique est ainsi toujours ramenée par la pratique à sesimpacts dans des régimes axiologico-pratiques spécifiques quimêlent cognition et émotion selon les modalités que nous avonsesquissées.
RÉFÉRENCESAbu-Lughod, L., Lutz, C.A., 1990, "Introduction: emotion,
discourse, and the politics of everyday life", in Lutz,C.A., Abu-Lughod, L. (eds.), 1990, Language and the politics ofemotion, Cambridge, Cambridge University Press, Paris, Ed.de la Maison des Sciences de l'Homme, pp.1-23.
Appadurai, A., 1990, "Topographies of the self: praise andemotion in Hindu India", in Lutz, C.A., Abu-Lughod, L.(eds.), 1990, Language and the politics of emotion, Cambridge,Cambridge University Press, Paris, Ed. de la Maison desSciences de l'Homme, pp.92-112.
Averill, J.R., 1980, "A constructivist view of emotion", inPlutchik, R., Kellerman, H., (eds.) Emotion. Theory, Research,
33.
and Experience, vol.1, San Diego, Academic Press, pp.305-339.
Bateson, G., 1936, Naven, Cambridge, Cambridge UniversityPress.
Bateson, G., Mead, M., 1942, Balinese character, New York, SpecialPublications of the New York Academy of Science, vol.II.
Bessy, C., Chateauraynaud, F., 1993, "Les ressorts del'expertise des objets", in Conein, B., Dodier, N.,Thévenot, L., (éds.), Les objets dans l'action, série Raisonpratique, Paris, Ed. de l'EHESS (à paraître).
Boltanski, L., 1990, L'amour et la justice comme compétences, Paris,Ed. Métailié.
Boltanski, L., Thévenot, L., 1991, De la justification; les économies dela grandeur, Paris, Gallimard.
Bourdieu, P., 1980, Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit.de Sousa, R., 1987, The rationality of Emotion, Cambridge, MIT Press.Elias, N., 1973, La civilisation des moeurs, Paris, Calmann-Lévy
(traduction du t.I de Uber den Process der Zivilisation, premièreédition, 1939).
Elster, J., 1989, The Cement of Society, Cambridge, CambridgeUniversity Press.
Geertz, C., 1983, "Personne, temps et comportement à Bali" inBali, interprétation d'une culture, Paris, Gallimard (traductionpar D. Paulme, première édition en américain : 1966).
Gibbard, A., 1990, Wise Choices, Apt Feelings, A Theory of NormativeJudgment, Oxford, Clarendon Press.
Goffman, E., 1974, Les rites d'interaction, Paris, Minuit (trad. parA. Kihm).
Goffman, E., 1991, Les cadres de l'interprétation, Paris, Minuit (trad.par I. Joseph avec M. Dartevelle et P. Joseph)
Habermas, J., 1987, Théorie de l'agir communicationnel, Paris, Fayard(traduit par J.-M. Ferry et J.-L. Schlegel, éditionoriginale 1981).
34.
Harré, R., Finlay-Jones, R., 1986, "Emotion talk acrosstimes", in Harré, R. (ed.), The Social Construction of Emotions,Oxford, Basil Blackwell, pp.220-233.
Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (eds.), 1974, Judgementunder Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge, CambridgeUniversity Press.
Lazarus, R.S., Kanner, A.D., Folkman, S., 1980, "Emotions: acognitive-phenomenological analysis", in Plutchik, R.,Kellerman, H., (eds.) Emotion. Theory, Research, and Experience,vol.1, San Diego, Academic Press, pp.189-217.
Livet, P., 1987, "Les limitations de la communication", LesEtudes Philosophiques, n°2-3, pp.255-275.
Livet, P., Thévenot, L., 1991, "L'action collective", colloque"L'économie des conventions", Paris, 27-28 mars {àparaître aux PUF, sous la direction de A. Orléan}.
Lutz, C.A., Abu-Lughod, L. (eds.), 1990, Language and the politics ofemotion, Cambridge, Cambridge University Press, Paris, Ed.de la Maison des Sciences de l'Homme.
Mead, M., 1942, "Balinese character", in Bateson, G., Mead,M., Balinese character, New York, Special Publications of theNew York Academy of Science, vol.II.
Plutchik, R., 1980, Emotion, A Psychoevolutionary Synthesis, New York,Harper & Row.
Plutchik, R., Kellerman, H. (eds.), 1980, Emotion. Theory, Research,and Experience, 3 vol., San Diego, Academic Press.
Sabini, J., Silver, M., 1982, Moralities of Everyday Life, Oxford,Oxford University Press.
Schachter, S., Singer, J.F., 1962, "Cognitive, social andphysiological determinants of emotional state",Psychological Review, 79, pp.379-399.
Scherer, K.R., Wallbott, H.G., Summerfield, A.B. (eds.), 1986,Experiencing emotion. A cross-cultural study, Cambridge, CambridgeUniversity Press, Paris, Ed. de la Maison des Sciences del'Homme.
35.
Thévenot, L., 1990, "L'action qui convient", in Pharo, P.,Quéré, L., (eds.), Les formes de l'action, série Raison Pratique ,Paris, Editions de l'EHESS, pp.39-69.
Thévenot, L., 1993, "Essai sur les objets usuels; propriétéset usages", in Conein, B., Dodier, N., Thévenot, L.,(éds.), Les objets dans l'action, série Raison pratique, Paris, Ed.de l'EHESS (à paraître).
Walzer, M., 1983, Spheres of Justice. A Defence of Pluralism and Equality,Oxford, Basil Blackwell.
Weber, M., 1971, Economie et société, Paris, Plon (traduction sousla direction de J. Chavy et d'E. de Dampierre deséditions en langue allemande de 1956 et 1967). premièreédition 1922.