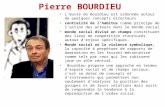“A l’école de Marrou aujourd’hui : un témoignage”, Cahiers Marrou, 2, 2009, p. 75-90.
Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
Volume 25 - n° 98/2012, p. 9-33 DOI: 10.3917/pox.098.0009
Pour une sociologie des problématisations
politiques de l’École
Frédéric Sawicki
Résumé – Cet article se veut un plaidoyer en faveur du décloisonnement des recherches sur les politi-ques scolaires. En plus de présenter les contributions du numéro, il analyse les raisons du long désintérêt de la science politique pour ce domaine, il met en exergue certains des apports majeurs à la sociologie de l’action publique des recherches menées sur les politiques scolaires en France au cours des vingt dernières années, et attire l’attention des spécialistes des politiques scolaires sur la nécessité d’être plus attentifs aux acteurs « centraux » qui concourent à la « problématisation » des questions scolaires.
10 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
Ce numéro de Politix est né d’un triple constat : celui du long désintérêt de la science politique française pour les politiques et les institutions scolaires, si l’on désigne par là les programmes d’actions publiques et
les modes et instruments de gouvernement et d’administration qui concernent l’enseignement primaire et secondaire ; celui de la monopolisation corrélative de ce domaine, d’une part par des experts (statisticiens, hauts fonctionnaires, universitaires ayant occupé d’importantes responsabilités administratives dans l’Éducation nationale…) préoccupés avant tout d’évaluation, d’autre part par des sociologues, des économistes et des spécialistes de sciences de l’éducation qui, en partie par tropisme disciplinaire, tendent à privilégier l’analyse des effets des politiques publiques au détriment de leur élaboration et de leur légitimation ; celui enfin, de l’émergence récente d’une génération de politistes et de sociolo-gues qui a entrepris de compléter les approches centrées sur les établissements et les usagers de l’École par une investigation des acteurs et des instances gouver-nementaux, nationaux et internationaux, qui élaborent et légitiment les grandes orientations et les nouveaux instruments des politiques scolaires et éducatives 1. Sans privilégier cette seule échelle d’analyse et négliger en conséquence les usa-ges que font les acteurs locaux ou intermédiaires des normes et des ressources définies et distribuées nationalement, voire internationalement, ce sont ces tra-vaux récents que Politix entend ici mettre à l’honneur.
Notre objectif est de contribuer à décloisonner le champ des recherches sur les politiques scolaires et d’attirer l’attention sur la nécessité de penser l’ensem-ble des jeux et conflits d’acteurs et des logiques institutionnelles qui, à tous les niveaux, les produisent et les façonnent en mettant entre parenthèses – au moins provisoirement – la question de leurs conséquences en termes de performances scolaires. En plus de présenter les contributions de ce dossier, cette introduction se veut donc être un plaidoyer. Elle s’efforcera pour ce faire de mettre en exergue certains des apports majeurs des recherches menées sur les politiques scolaires à la sociologie de l’action publique, mais aussi d’attirer l’attention des spécialistes des politiques scolaires sur quelques points aveugles liés à leurs façons d’abor-der jusqu’ici la production des politiques scolaires, notamment leur propension à laisser de côté les acteurs « centraux » qui concourent à la « problématisation » des questions scolaires.
1. Parmi cette génération, plusieurs politistes ont également entrepris d’analyser la fabrique des politiques universitaires et de recherche, ici volontairement laissées de côté. Cf. Aust (J.), Permanences et mutations dans la conduite de l’action publique. Le cas des politiques d’implantation universitaire dans l’agglomération lyonnaise (1958-2004), thèse pour le doctorat en science politique, Institut d’études politiques de Lyon, 2004 ; Ravinet (P.), La genèse et l’institutionnalisation du processus de Bologne : entre chemin de traverse et sentier de dépendance, thèse pour le doctorat en science politique, Institut d’études politiques de Paris, 2007 ; Bruno (I.), À vos marques®, prêts… cherchez ! La stratégie européenne de Lisbonne, vers un marché de la recherche, Belle-combe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2008.
Frédéric Sawicki 11
98
Un champ de recherche longtemps délaissé
Plusieurs indices confirment le désintérêt qu’a longtemps eu la science poli-tique française pour les institutions et les politiques scolaires. Les références à ce secteur de l’action et de l’administration publics sont ainsi quasiment absen-tes des principaux ouvrages généraux consacrés au cours de ces deux dernières décennies à l’action publique, qu’il s’agisse de manuels 2 ou de livres à vocation théorique ou problématique 3. Il est par exemple frappant que les trois sommes publiées récemment par les Presses de Sciences Po établissant un bilan des politi-ques publiques sectorielles dans la France contemporaine ne comportent aucun chapitre dédié aux politiques scolaires, alors que deux portent sur l’enseigne-ment supérieur 4. Seul le récent Dictionnaire des politiques territoriales paru chez le même éditeur fait exception 5.
Le même constat peut être établi à partir de l’examen du contenu des revues dites « généralistes » de science politique, comme d’ailleurs de celui des revues de sciences sociales accordant une place à l’action publique. La Revue française de science politique n’a publié aucun article consacré aux politiques scolaires au cours de ces vingt-cinq dernières années. Il faut remonter à 1985 6 pour y trouver un article analysant, assez superficiellement, la mobilisation des historiens contre la réforme de leur programme, et à 1976, pour y dénicher une analyse fouillée de la réforme chaotique de l’enseignement secondaire français 7. Politix fait à peine mieux. Un seul article aborde cette thématique au cours de la décennie 2000 sous l’angle de l’étude d’un dispositif participatif mis en place par le ministère de l’Éducation nationale en 2004 pour contourner les organisations syndicales 8.
2. Cf. principalement : Gaudin (J.-P.), L’action publique. Sociologie et politique, Paris, Presses de Sciences Po- Dalloz, 2004 ; Massardier (G.), Politiques et action publiques, Paris, Armand Colin, 2003 ; Hassenteu-fel (P.), Sociologie politique : l’action publique, Paris, Armand Colin, 2008.3. C’est par exemple le cas dans tous les ouvrages suivants qui constituent les références les plus souvent citées dans le domaine de la sociologie de l’action publique : Dupuy (F.), Thoenig (J.-C.), L’administration en miettes, Paris, Fayard, 1985 ; Commaille (J.), Jobert (B.), dir., Les métamorphoses de la régulation politique, Paris, LGDJ, 1998 ; Balme (R.), Faure (A.), Mabileau (A.), dir., Les nouvelles politiques locales. Dynamiques de l’action publi-que, Paris, Presses de Sciences Po, 1999 ; Duran (P.), Penser l’action publique, Paris, LGDJ, 1999 ; Gaudin (J.-P.), Gouverner par contrat. L’action publique en question, Paris, Presses de Sciences Po, 1999 ; Lascoumes (P.), Le Galès (P.), dir., Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2005. Seuls B. Jobert et P. Muller évoquent très brièvement la politique d’éducation comme « le cas le plus achevé du corporatisme du secteur public » : Jobert (B.), Muller (P.), L’État en action. Politiques publiques et corporatismes, Paris, Presses universi-taires de France, 1987, p. 182-184.4. Borraz (O.), Guiraudon (V.), dir., Politiques publiques, 2 tomes, Paris, Presses de Sciences Po, 2008 et 2010 ; De Maillard (J.), Surel (Y.), dir., Les politiques publiques sous Sarkozy, Paris, Presses de Sciences Po, 2012.5. Morel (S.), « Éducation », in Cole (A.), Guigner (S.), Pasquier (R.), dir., Dictionnaire des politiques terri-toriales, Paris, Presses de Sciences Po, 2011.6. Delannoi (G.), « Qui a gagné la bataille de Marignan ? Peut-on changer l’enseignement ? L’exemple de l’enseignement de l’histoire », Revue française de science politique, 35 (4), 1985.7. Donegani (J.-M.), Sadoun (M.), « La réforme de l’enseignement secondaire en France depuis 1945 : analyse d’une non-décision », Revue française de science politique, 26 (6), 1976.8. Mazeaud (A.), « Le Débat national sur l’avenir de l’École ou des partenaires sociaux à l’épreuve de la démo-cratie participative », Politix, 75, 2006. Cf. également, récemment, Lignier (W.), « La cause de l’intelligence.
12 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
Même si, depuis sa fondation, en 1988, l’éducation a été davantage traitée dans Politix que dans la Revue française de science politique, elle l’a été selon deux biais principaux qui laissent de côté le cœur de l’institution scolaire : la formation des élites politico-administratives et celle des militants. Pas moins de trois arti-cles ont ainsi été consacrés à l’École libre des sciences politiques – plus un à l’ENA – et trois aux écoles du parti communiste. Genèses ou Sociologie du travail s’inscrivent dans cette même tendance. Si cette dernière a publié de nombreux comptes rendus d’ouvrages portant sur les politiques scolaires, aucun article ne leur a été spécifiquement consacré au cours de la décennie écoulée et Genèses n’a quant à elle publié dans le même laps de temps qu’un article sur le sujet 9. Seule la Revue internationale de politique comparée se démarque dans ce paysage pour avoir récemment consacré un dossier aux politiques éducatives comparées 10.
Cette situation est particulièrement étonnante eu égard d’abord au poids, sans cesse croissant, des dépenses d’éducation dans le budget de l’État français, dont elles constituent, depuis 1982, le premier poste, mais aussi, depuis les lois de décentralisation de 1982 et 1983, dans celui des collectivités territoriales 11. Il est surtout surprenant au regard de la place qu’occupe l’École dans la société et dans la politique françaises. Cinquante ans de travaux d’histoire et de sociologie de l’éducation, par-delà leurs différences paradigmatiques et méthodologiques, s’accordent au moins sur ce double constat : la « fonction » centrale de l’École publique dans la construction du régime républicain, de la citoyenneté et du sentiment national 12, et son emprise croissante, à mesure de la démocratisation de l’accès à l’enseignement secondaire puis supérieur, dans la détermination des
Comment la supériorité intellectuelle enfantine est devenue une catégorie de l’action publique d’éducation en France (1971-2005) », Politix, 94, 2011.9. Chapoulie (J.-M.), « Les nouveaux spécialistes des sciences sociales comme “experts” de la politique sco-laire en France 1945-1962 », Genèses, 64, 2006.10. Buisson-Fenet (H.), dir., « Politiques éducatives comparées », Revue internationale de politique comparée, 14 (3), 2007. La même année Pouvoirs dédie un numéro à l’« Éducation nationale » (122, 2007), où la parole est réservée à des acteurs des politiques scolaires (trois inspecteurs généraux, un ancien directeur du minis-tère, une ancienne rectrice, un journaliste expert auprès du Haut Conseil de l’évaluation de l’école, un provi-seur, le créateur de la Direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’Éducation nationale).11. En 2010, les dépenses d’éducation de la nation (État, collectivités territoriales, entreprises, ménages, etc.) sont estimées à 134,8 milliards d’euros soit 7 % du Produit intérieur brut (PIB), dont 38,5 milliards sont consacrés au premier degré et 55,4 milliards au second degré, soit 70 % de l’effort national. L’État assume 59,4 % de cet effort, soit 80 milliards d’euros et les collectivités territoriales 24,6 %, soit 33 milliards (cette part était de 14,3 % en 1980). Les salaires, charges et pensions représentent 73,4 % des dépenses de l’État. Depuis 1980, la dépense moyenne par élève a crû de 76,3 % en prix constants dans le primaire et de 64,6 % dans le secondaire, soit une dépense par élève de 5730 euros dans le primaire et de 9380 euros dans le secondaire en 2009. Le ministère de l’Éducation nationale reste le financeur prépondérant, même si sa part a diminué depuis 1985 en raison de la décentralisation. La part des ménages quant à elle a décru du fait de l’augmentation forte des bourses et de l’extension du champ de la gratuité. Sources : ministère de l’Éducation nationale.12. Cf. notamment Ozouf (M.), L’École, l’Église et la République, 1871-1914, Paris, Armand Colin, 1982, Peneff (J.), Écoles publiques, écoles privées dans l’Ouest, 1880-1950, Paris, L’Harmattan, 1987 et Déloye (Y.) École et citoyenneté. L’individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy : controverses, Paris, Presses de la FNSP, 1994.
Frédéric Sawicki 13
98
destins professionnels et sociaux. Qu’ils dénoncent les leurres ou qu’ils pointent les succès de cette démocratisation, tous les chercheurs reconnaissent que la réussite scolaire ou son corrélatif, l’échec scolaire, sont ainsi devenus une pré-occupation centrale pour une très grande majorité de Français. La combinaison de ces deux traits structuraux fait que l’École, depuis les années 1880, n’a cessé d’occuper une place centrale sur l’agenda politique et plus largement dans le débat public.
Depuis les lendemains de la Première Guerre mondiale, mais plus encore de la Seconde Guerre mondiale, les projets de réforme visant à élargir et démo-cratiser l’accès à l’enseignement post-primaire n’ont cessé de se succéder, et si beaucoup d’entre eux ont tardé à être mis en œuvre ou ont eu des effets contre-intuitifs 13, le résultat est là : l’École d’État a fini par conquérir la France pour reprendre le titre de la somme que Jean-Michel Chapoulie vient de consacrer à l’histoire de la politique scolaire 14. Au cours des soixante dernières années, l’État a en effet assumé l’essentiel de l’augmentation exponentielle des dépen-ses d’éducation, passées de 1,5 % du PIB en 1952, à 2,4 % en 1959, 4 % en 1980 et 7 % à la fin de la décennie 2000, permettant une croissance sans précédent de la scolarisation, tant en amont, avec la généralisation de l’enseignement mater-nel à partir de trois ans, qu’en aval, avec le passage de la scolarité obligatoire à seize ans 15 et l’intégration de l’essentiel des formations professionnelles ini-tiales au sein de l’Éducation nationale dans les centres d’apprentissage créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puis dans les collèges d’ensei-gnement technique (CET), les lycées d’enseignement professionnel (LEP) et enfin dans les lycées professionnels 16. Le pourcentage des jeunes titulaires du baccalauréat est ainsi passé de 12 % en 1960, à 26 % en 1980, 43,5 % en 1990 et 65 % depuis le début des années 2000. Comme le souligne J.-M. Chapoulie, « la durée moyenne passée dans l’institution scolaire pour les générations qui parviennent aujourd’hui à l’âge adulte atteint près de vingt ans, soit environ le quart de la durée moyenne de vie probable de la population 17 ». Ajoutons que l’emprise de l’État concerne également l’enseignement privé, puisque le développement des politiques de contractualisation amorcées par les lois Marie-Barangé de 1951 et Debré de 1959, a conduit à la prise en charge de
13. On en trouvera quelques illustrations dans Prost (A.), « Lecture historique et lecture sociologique des politiques d’éducation », in Éducation, société et politiques. Une histoire de l’enseignement de 1945 à nos jours, Paris, Seuil, 1992.14. Chapoulie (J.-M.), L’École d’État conquiert la France. Deux siècles de politique scolaire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. Cf. le compte rendu de l’ouvrage dans ce numéro.15. En pratique cette obligation est largement dépassée. En 1995, plus de 80 % des jeunes sont encore scolarisés à dix-huit ans, et la moitié à vingt ans, ce qui est dix fois plus qu’au début de la Ve République. Concernant l’enseignement maternel, la tranche d’âge 3-5 ans était scolarisée à 50 % en 1960 contre 100 % en 1999.16. Cf. notamment Pepel (P.), Troger (V.), Histoire de l’enseignement technique, Paris, Hachette, 1993 et Brucy (G.), Histoire des diplômes de l’enseignement technique et professionnel (1880-1965), Paris, Belin, 1998.17. Ibid., p. 15.
14 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
la quasi-totalité de son personnel enseignant et d’une part importante de ses dépenses de fonctionnement par l’État 18.
Il existe donc peu de politiques publiques à l’impact social aussi ample et profond. Pourquoi dès lors un tel désintérêt des politistes français 19 ? Au moins deux pistes d’explication – largement sécantes – peuvent être avancées. La pre-mière réside dans la représentation dominante de l’Éducation nationale comme « institution particulièrement rétive à la réforme », pour reprendre l’expres-sion d’André Legrand, professeur de droit public devenu, à la fin des années 1980, directeur des lycées et collèges, puis de l’enseignement scolaire 20. De fait, en science politique, l’Éducation nationale a traditionnellement servi d’arché-type, soit pour exemplifier le « néo-corporatisme à la française », c’est-à-dire la forte collusion entre administration et syndicat(s) dans le gouvernement de certains secteurs d’action publique 21, soit pour illustrer le poids (et les excès) de la centralisation, les deux perspectives étant souvent conjuguées. C’est donc davantage comme exemple d’institution irréformable et sclérosée que l’Édu-cation nationale a retenu l’attention des politistes, bien plus souvent d’ailleurs anglo-saxons que français 22. Dans l’un des premiers travaux d’ampleur visant
18. Poucet (B.), La liberté sous contrat : une histoire de l’enseignement privé, Paris, Fabert, 2009. Actuellement 98 % des établissements privés sont sous contrat d’association, parmi eux 95 % sont catholiques.19. Comme on va le voir, les politistes américains et européens s’intéressent de leur côté beaucoup au cas français, de même que les historiens français qui, comme le remarque H. Buisson-Fenet, ont largement investi « l’identification des programmes d’action, des mesures gouvernementales et des réformes, l’analyse des changements et des continuités, l’examen de l’articulation entre les “cultures locales de l’école” et les contributions institutionnelles à la production des identités nationales ». Buisson-Fenet (H.), « L’éducation scolaire au prisme de la science politique : vers une sociologie politique comparée de l’action publique édu-cative ? », Revue internationale de politique comparée, 14 (3), p. 388.20. Legrand (A.), « Comment réformer le mammouth », Pouvoirs, 122, 2007, p. 19.21. Cette idée est notamment développée et discutée par Aubert (V.), Bergounioux (A.), Martin (J.-P.), Mouriaux (R.), La forteresse enseignante. La Fédération de l’éducation nationale, Paris, Fayard-Fondation Saint-Simon, 1985 ; Ambler (J. S.), « Neocorporatism and the Politics of French Education », West European Politics, 8, 1985 et Weiler (H. N.), « The Politics of Reform and Nonreform in French Education », Compa-rative Education Review, 32 (3), 1988. Elle est reprise par B. Jobert et P. Muller dans L’État en action, op. cit., mais est en revanche contestée par Frank Baumgartner et Jack Walker qui considèrent que les divisions politiques du syndicalisme enseignant ont contrarié la possibilité d’une régulation néo-corporatiste, tout en favorisant une surenchère oppositionnelle. Baumgartner (F. R.), Walker (J. L.), « Educational Policymaking and the Interest Group Structure in France and the United States », Comparative Politics, 21 (3), 1989.22. La question du conservatisme de l’institution scolaire, en particulier des professeurs et proviseurs de lycées, est également au cœur des travaux de la sociologue Viviane Isambert-Jamati. Si dans Crises de la société, crise de l’enseignement. Sociologie de l’enseignement secondaire français (Paris, Presses universitaires de France, 1970) l’étude approfondie d’un siècle de discours prononcés à l’occasion des distributions de prix des lycées, la conduit à conclure au caractère très fluctuant des définitions et des objectifs de l’institution, dans un article antérieur, elle se montre assez pessimiste sur la capacité des enseignants du secondaire à accepter une remise en cause en profondeur du caractère élitiste des lycées. « Il est possible, écrit-elle, que le caractère très centralisé de l’enseignement français ait été peu favorable à une institutionnalisation du changement, puisque toute réforme ou presque est générale, et puisque chaque enseignant, maître dans sa classe, est cependant soumis à une structure et à un programme décidés au-dessus de lui. Une telle organi-sation est probablement de nature à favoriser un certain misonéisme. Mais l’affrontement actuel n’est pas simple misonéisme. On peut dire, nous semble-t-il, que des résistances dans lesquelles l’idéologie a joué un
Frédéric Sawicki 15
98
à construire une typologie des systèmes d’éducation dans le monde occidental, Margaret Archer se sert ainsi du cas français pour construire l’idéaltype du système centralisé par opposition aux modèles décentralisés bâtis à partir des cas anglais et danois 23. Ce système se caractériserait selon elle par une grande inertie et par des changements nécessairement brutaux (« stop-go pattern ») résultant de conflits immanquablement politisés. Un autre spécialiste de la comparaison des politiques éducatives, Hans N. Weiler, constatant l’échec de toutes les tentatives de réforme en profondeur de l’enseignement secondaire français, se montre pour sa part très sceptique quant à toute possibilité de changement 24.
Après avoir étudié en détail les protestations et tractations qui ont accom-pagné la mise en œuvre de la réforme Haby de 1975 visant à créer le collège unique, Roger Duclaud-William aboutit à la conclusion inverse :
« The picture of change proceeding in France according to a stop-go pattern is inac-curate. Once one looks beyond intention to realization, a more incremental pattern re-emerges, mainly because political obstacles to any comprehensive reform imme-diately present themselves. These obstacles are themselves in part the result of centra-lization ; it is therefore centralization itself which ensures that nothing but piecemeal reform is ever really possible. »
Autrement dit, la centralisation de l’Éducation nationale aurait pour consé-quence que les changements y seraient essentiellement incrémentaux 25. Dans une série d’articles, John S. Ambler, qui s’est attaché à l’échec des réformes entre-prises par Alain Savary entre 1981 et 1984 (réformes du collège et de l’enseigne-ment privé) et au succès de la réforme engagée par Jean-Pierre Chevènement en 1985 d’atteindre l’objectif de 80 % d’une génération au niveau du baccalauréat à l’horizon 2000, tempère cette conclusion. Il souligne que des changements plus brutaux peuvent intervenir lorsque le ministre en charge du dossier parvient,
grand rôle ont été déterminantes il y a quelques années pour maintenir les lycées tels quels, en extension et en compréhension. L’invocation des valeurs a renforcé la rigidité de l’institution. Depuis lors, une politique scolaire souvent faite d’ordres et de contre-ordres, presque toujours méprisante pour les enseignants, a renforcé cette résistance en favorisant le syncrétisme de l’opposition politique et de l’idéologie de la culture. Que le rush vers l’enseignement secondaire aboutisse chez des professeurs si souvent épris de justice à une nostalgie du passé, on peut craindre que cela ne soit le signe d’une sérieuse occasion perdue. » Isambert-Jamati (V.), « La rigidité d’une institution : structure scolaire et systèmes de valeurs », Revue française de sociologie, 7 (3), 1966, p. 324.23. Archer (M. S.), Social Origins of Educational Systems, London, Sage, 1979.24. « There are few places where this resistance to change is more striking than in contemporary France, where, over a period of now almost 30 years, an enormous proliferation of reform proposals has more or less peacefully coexisted with an extremely limited degree of actual change in the educational system. » Weiler (H. N.), « The Politics of Reform… », art. cit., p. 251.25. Duclaud-Williams (R.), « Centralization and Incremental Change in France: The Case of the Haby Edu-cational Reform », British Journal of Political Science, 13, 1982, p. 91 et « Policy Implementation in the French Public Bureaucracy: The Case of Education », West European Politics, 11 (1), 1988.
16 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
comme ce dernier, à mobiliser de très importants soutiens extérieurs au monde éducatif et qu’il bénéficie d’un fort appui politique 26.
Par-delà leurs différences d’appréciation sur les formes du changement, la majorité des politistes qui ont travaillé sur la politique scolaire s’accordent pour reconnaître que si la Fédération de l’Éducation nationale (FEN) et ses syndicats ont fait montre, des années 1950 au début des années 1990, quels que soient le régime et la majorité en place, d’une grande capacité à défendre les droits et les statuts de ses membres et à retarder de nombreuses réformes 27, au premier rang desquelles la mise en place du collège unique, c’est-à-dire la disparition en son sein de filières sélectives et la création d’un corps de professeurs dédié 28, ils n’ont pas été en mesure, en raison de leurs divisions, d’opposer une ligne de front à tout changement 29 et de peser véritablement sur les décisions concernant les orientations pédagogiques.
Ce constat que les choses changent en dépit de la résistance des acteurs sug-gère une deuxième clé d’interprétation du désintérêt des politistes français pour les politiques scolaires : la croyance partagée que l’évolution du « système scolaire » résulte principalement des pressions de la « demande sociale », celle des entreprises pour une main-d’œuvre plus qualifiée et celle des familles sou-cieuses de promotion sociale. Comparant la Grande-Bretagne et la France, c’est d’ailleurs la conclusion à laquelle aboutit J. S. Ambler :
« The obstacles to policy innovation in education are imposing but not insur-mountable, as evidenced by the dramatic postwar expansion of secondary and higher education enrollments and by the spread of comprehensive schools. […] In both countries the transformation from elite to mass education resulted less from government initiative than from a rapid growth in demand for education beyond the elementary level 30. »
26. Ambler (J. S.), « Constraints on Policy Innovation in Education: Thatcher’s Britain and Mitterrand’s France », Comparative Politics, 20 (1), 1987 ; « French Education and the Limits of State », The Western Political Quarterly, 41 (3), 1988 ; et « Why French Education Policy is so often Made in the Streets », French Politics and Society, 12 (2-3), 1994.27. Cf. les travaux d’André D. Robert, notamment sa thèse : Trois syndicats d’enseignants face aux réformes scolaires. Positions idéologiques du SNI, du SNES et du SGEN par rapport au système d’Éducation nationale entre 1968 et 1982, thèse pour le doctorat de sociologie, Université Paris V, 1989 et « Jeux croisés des syndicats d’enseignants face aux réformes et projets de réforme (1944-2000) », in Girault (J.), dir., Les enseignants dans la société française au XXe siècle. Itinéraires, enjeux, engagements, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004.28. Ce point est au cœur de la démonstration de J.-M. Donegani et M. Sadoun, « La réforme de l’enseigne-ment… », art. cit.29. Cette thèse est déjà celle du premier ouvrage consacré à la FEN des années 1950, écrit là encore par un politiste américain : Clark (J. T.), Teachers and Politics in France: A Pressure Group Study of the Fédération de l’Education Nationale, Syracuse, Syracuse University Press, 1967. James T. Clark y analyse notamment l’im-puissance de la FEN à s’être opposée aux lois Marie et Barangé (1951) et Debré (1959) autorisant le finance-ment public de l’enseignement privé.30. Ambler (J. S.), « Constraints on Policy Innovation in Education… », art. cit., p. 102.
Frédéric Sawicki 17
98
Les gouvernements successifs, après avoir été contraints d’ouvrir les vannes de la scolarisation, n’auraient guère eu le choix que de devoir garantir les pla-ces et les établissements d’accueil en nombre suffisant aux niveaux supérieurs : d’abord en collège, puis en lycée, professionnel et général, puis dans l’enseigne-ment supérieur, toutes les tentatives pour ériger de nouvelles barrières ayant échoué. De même, compte tenu de la taille ainsi atteinte par l’Éducation natio-nale, ils ne pouvaient que se résoudre à la décentraliser.
Une telle croyance ne pouvait que conduire à laisser aux sociologues le soin d’étudier les logiques sous-jacentes aux stratégies d’investissement scolaire. C’est peu dire que sur ce terrain ces derniers se trouvaient déjà en position de force. L’école a en effet constitué, des années 1960 aux années 1980, un de leurs terrains d’affrontement politique et paradigmatique privilégié. Entre les démographes de l’INED et les sociologues du Centre de sociologie européenne d’abord, à propos de la réalité statistique de la démocratisation scolaire, puis entre ces derniers et les tenants de l’individualisme méthodologique sur le rôle de l’école dans les mécanismes de reproduction sociale 31. Quel que soit le point de vue adopté, « conflictualiste » ou « externaliste 32 », la première génération des sociologues français de l’éducation a essentiellement mis l’accent sur les logiques qui condui-saient à expliquer pourquoi, malgré les progrès de la scolarisation, le système scolaire demeurait profondément inégal. À leurs yeux, la vérité de l’école réside avant tout dans les fonctions sociales qu’elle remplit (de reproduction sociale 33, d’« appareil idéologique d’État 34 », d’acquisition de connaissances et de diplô-
31. De son côté, au cours de cette période, la sociologie des organisations, curieusement, a beaucoup moins investi l’Éducation nationale que l’enseignement supérieur ; une seule étude s’en inspire directement : Paty (D.), Douze collèges en France. Enquête sur le fonctionnement des collèges publics aujourd’hui, Paris, La Documentation française, 1981. Quant à la sociologie de l’action d’inspiration tourainienne, elle n’investira fortement le terrain de l’école qu’à la fin des années 1980 autour de François Dubet à partir d’une approche centrée sur l’expérience des élèves et la mobilisation des établissements. Cf. notamment Dubet (F.), Les lycéens, Paris, Seuil, 1991 ; Dubet (F.), Cousin (O.), Guillemet (J.-P.), « Mobilisation des collèges et perfor-mances scolaires », Revue française de sociologie, 30 (2), 1989 ; Dubet (F.), Martucelli (D.), À l’école. Sociologie de l’expérience scolaire, Paris, Seuil, 1996.32. On reprend ici le distinguo commode proposé par Jean-Manuel De Queiroz entre, d’une part, ceux qui attribuent à l’école un rôle dans la création d’inégalités en tant qu’elle amplifie, par la sélection qu’elle opère, tout en les légitimant, les inégalités de classe (P. Bourdieu, J.-C. Passeron, C. Grignon) ou en tant qu’elle est le théâtre de la lutte des classes (C. Baudelot, R. Establet) et, d’autre part, ceux qui « rapportent les inégalités à des subcultures de classe et à des systèmes de valeurs contrastés » et/ou aux calculs des individus qui en découlent (R. Boudon, M. Cherkaoui). De Queiroz (J.-M.), L’école et ses sociologies, Paris, Nathan, 1995, p. 21.33. Bourdieu (P.), Passeron (J.-C.), La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Minuit, 1970 ; Grignon (C.), L’ordre des choses. Les fonctions sociales de l’enseignement technique, Paris, Minuit, 1971.34. Baudelot (C.), Establet (R.), L’École capitaliste en France, Paris, Maspero, 1971. Guy Vincent, même s’il ne se réfère pas directement à Althusser mais à Durkheim et à Marx, réinterprète dans le même sens la fonction historique de l’enseignement primaire, « école du peuple créée par la bourgeoisie » dont le programme se doit de rester « limité et pratique » pour éviter toute remise en cause de l’ordre établi. Vincent (G.), « Histoire et structure de l’enseignement scolaire français : l’enseignement primaire », Revue française de sociologie, 13 (1), 1972.
18 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
mes non automatiquement convertibles sur le marché du travail 35, etc.). Dans une telle perspective, les décisions de politique scolaire ne méritent guère qu’on s’y attarde. Tout au plus contraignent-elles les acteurs sociaux – en fait surtout les classes moyennes et supérieures –, à des stratégies d’adaptation et de distinc-tion visant à se prémunir de tout risque de déclassement en investissant dans les filières et les établissements les plus sélectifs, avec la complicité des chefs d’éta-blissement mais aussi des recteurs, des élus et au final des ministres, contraints de plier devant leurs pressions conjuguées pour obtenir force dérogations à la carte scolaire et créations ou maintiens d’enseignements ou de classes élitistes. La plupart des sociologues de l’éducation s’accordent ainsi pour considérer que la politique dite « des 80 % », a débouché sur une « démocratisation ségréga-tive 36 ». Tout change, mais rien en réalité ne change vraiment, telle est finalement la représentation que la sociologie française a longtemps véhiculée de l’école, même après que son regard se fut porté davantage vers les acteurs et les établis-sements : les barrières sont en quelque sorte vouées à se déplacer à mesure que le niveau monte 37.
Constitution d’un sous-champ de recherche hybride
Alors que jusqu’au début des années 1980, les politiques éducatives étaient l’apanage des hauts fonctionnaires en charge du secteur 38, les mutations qui vont affecter le système éducatif après 1981 vont progressivement faire émerger un nouveau sous-champ de recherche prenant pour objet les politiques scolaires.
35. Boudon (R.), L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles, Paris, Armand Colin, 1973 ; Girod (R.), Inégalité, inégalités : analyse de la mobilité sociale, Paris, Presses universitaires de France, 1977 ; Cherkaoui (M.), Les paradoxes de la réussite scolaire. Sociologie comparée des systèmes d’enseignement, Paris, Presses universitaires de France, 1979 et Les changements du système éducatif en France (1950-1980), Paris, Presses universitaires de France, 1982.36. Merle (P.), « Le concept de démocratisation de l’institution scolaire : une typologie et sa mise à l’épreuve », Population, 55 (1), 2000. Cf. également Euriat (M.), Thélot (C.), « Le recrutement social de l’élite scolaire depuis quarante ans », Éducations et formations, 41, 1995 ; Terrail (J.-P.), La scolarisation de la France, Paris, La Dispute, 1997 ; Duru-Bellat (M.), Les inégalités sociales à l’école : genèse et mythes, Paris, Presses universi-taires de France, 2002 et L’inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie, Paris, Seuil, 2006.37. On aura reconnu la référence à Edmond Goblot, dont le livre est redécouvert dans les années 1960. Cf. Goblot (E.), La barrière et le niveau. Étude sociologique sur la bourgeoisie française moderne, Paris, Presses uni-versitaires de France, 1967 (1925). L’idée que la démocratisation scolaire encourage les stratégies de distinction scolaire et dévalue la valeur économique et sociale des diplômes est développée dès les années 1970 par Pierre Bourdieu dans La distinction (Paris, Minuit, 1979) et Françoise Œuvrard (« Démocratisation ou élimination différée ? », Actes de la recherche en sciences sociales, 30, 1979).38. Les ouvrages de synthèse disponibles jusqu’alors sur la question sont rédigés, pour l’un, par un inspec-teur général de l’Éducation nationale, pour l’autre par un conseiller d’État chargé dans les années 1960 de la planification des constructions scolaires : Caplat (G.), L’administration de l’Éducation nationale et la réforme administrative, Paris, Berger-Levrault, 1960 et Fournier (J.), Politique de l’éducation, Paris, Seuil, 1971. Le pre-mier ouvrage rédigé par un sociologue en langue française portant ce titre paraît en 1981. Rédigé par un spé-cialiste de la mobilité sociale, il repose pour l’essentiel sur une synthèse des travaux existants sur les effets de l’augmentation de la scolarisation sur le niveau d’instruction visant à dénoncer les trop grandes illusions qui lui sont attachées. Cf. Girod (R.), Politiques de l’éducation : l’illusoire et le possible, Paris, Presses universitaires de France, 1981.
Frédéric Sawicki 19
98
Ce sous-champ a un caractère hybride : s’y croisent des statisticiens, des mem-bres des corps d’inspection et des hauts fonctionnaires du ministère de l’Éduca-tion nationale, des experts travaillant pour des organismes internationaux, des sociologues, des chercheurs en sciences de l’éducation, des économistes. Cette hétérogénéité se traduit par une diversité des approches : les sociologues et les chercheurs en sciences de l’éducation privilégient l’enquête de terrain au niveau des établissements et accessoirement l’analyse historique, les autres la modélisa-tion et l’analyse statistique. Les échanges et les influences entre ces deux groupes sont cependant nombreux et contribuent à diffuser une posture évaluative dans le monde de la recherche, les uns et les autres accordant une place centrale aux effets des politiques publiques.
Pour comprendre les ressorts de l’émergence de ce sous-champ, il faut com-mencer par brièvement rappeler les principales transformations qui affectent l’Éducation nationale au cours des années 1980. Il s’agit d’abord de la mise en place, en 1981, d’une politique d’éducation prioritaire qui remet officiellement en cause le principe de l’égalité de moyens pour lui substituer celui d’une égalité de résultats 39. Vient ensuite la décentralisation, qui transfère en 1983 aux dépar-tements et aux régions l’entretien et la construction des bâtiments des collèges et lycées sur le modèle de ce qui prévalait depuis un siècle pour les municipa-lités vis-à-vis des écoles primaires et maternelles. Ce transfert a d’importantes conséquences. Il accélère et amplifie la déconcentration administrative amorcée au cours de la décennie précédente : en 1985, les collèges et lycées deviennent ainsi des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) financièrement autonomes, et en 1986 et 1987 les inspections académiques et les rectorats se voient chargés de la responsabilité de l’offre pédagogique et de la gestion de leurs personnels. Les processus de décentralisation et de déconcentration se renfor-cent mutuellement et favorisent la multiplication d’instances locales de décision et de concertation 40, en particulier dans le domaine de l’enseignement profes-sionnel qui nécessite de lourds investissements et dans les quartiers prioritaires au regard de la politique de la ville 41. C’est dans ce contexte que s’inscrit la loi d’orientation sur l’école de 1989, dont Sylvie Aebischer a retracé la genèse dans
39. Cette politique, lancée en juin 1981, est fondée sur la délimitation d’établissements définis comme prio-ritaires sur la base de leurs faibles performances scolaires et de leur recrutement social défavorisé. Elle a été précédée par différentes initiatives visant à promouvoir la pédagogie de soutien dans la foulée de la réforme Haby de 1975 et elle a connu plusieurs interruptions à la suite d’alternances politiques puis de relances et redéfinitions en liaison avec les changements de la politique de la ville (en 1989 et 1997) et à la suite des émeutes dans les banlieues de novembre 2005. Cf. Robert (B.), Les politiques d’éducation prioritaire. Les défis de la réforme, Paris, Presses universitaires de France, 2009.40. Y. Dutercq souligne que « la déconcentration incite les services académiques à construire des relations parfois étroites avec des collectivités qui participent de manière complémentaire à l’organisation territoriale de l’éducation. » Dutercq (Y.), « Les politiques éducatives des collectivités », in Van Zanten (A.), dir., L’École. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2000, p. 122.41. Morel (S.), École, territoires et identités. Les politiques publiques françaises face à l’épreuve de l’ethnicité, Paris, L’Harmattan, 2002.
20 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
sa thèse et dont elle analyse le contenu et les acteurs dans ce numéro 42. Elle rap-pelle que ses promoteurs ont eu pour but principal d’encourager l’autonomie des établissements scolaires en les contraignant à élaborer un projet propre afin de généraliser un « pilotage par objectifs » : « Le but affiché du projet d’établisse-ment est en effet d’amener chaque école, collège, lycée voire université à définir des objectifs à remplir sur une période donnée et de se doter des moyens pour y parvenir » et de fournir au ministère et aux rectorats les moyens d’évaluer les résultats ainsi obtenus. L’autonomie des établissements sera renforcée par la « loi de programmation sur la cohésion sociale » de 2005 dont deux décrets d’appli-cation (2005-114 et 2005-1178) les obligent à signer un « contrat d’objectifs » tout en leur donnant la possibilité de réaliser des expérimentations pédagogi-ques pour une durée de cinq ans maximum. Enfin, last but not least, la politique visant à faire parvenir 80 % d’une génération au niveau du baccalauréat à la fin du siècle lancée en 1985, dont la création des bacs professionnels constitue le principal instrument, fait advenir le collège unique en faisant quasiment dispa-raître l’orientation en CAP en fin de la classe de quatrième, modifie en profon-deur les lycées professionnels qui préparent de moins en moins aux CAP mais aux BEP et aux bacs professionnels, et transforme le public des lycées généraux et, partant, celui de l’enseignement supérieur.
C’est parce que, comme le remarque Antoine Prost, historien auteur de plu-sieurs ouvrages de référence sur l’histoire et la sociologie de l’éducation 43 et d’un rapport sur les lycées ayant inspiré la réforme de 1985, « la transformation des années 1980 est menée sur un rythme beaucoup plus rapide » et qu’« elle est directement assumée par l’Éducation nationale elle-même, […] voulue de l’intérieur de l’institution, […] pas imposée de l’extérieur 44 » qu’elle va autant susciter de recherches, en réponse à « une demande d’expertise croissante liée à la nécessité d’évaluer les effets des dispositifs mis en œuvre 45 ». Franck Pou-peau a montré que cette demande s’est traduite d’une part par la commande de nombreux rapports à des universitaires ou des chercheurs spécialistes du domaine (Renée Ribier, René Girault, André De Peretti, Louis Legrand, Antoine Prost, Laurent Schwartz, Lucie Tanguy, Pierre Bourdieu, etc.), et d’autre part, par une refonte en profondeur des services d’étude et de recherche dépendants du ministère de l’Éducation nationale. Cela concerne au premier chef son service des statistiques qui devient, en février 1987, Direction de l’évaluation et de la
42. Aebischer (S.), « Mettre l’élève et le management au centre du système ». Sociologie d’un moment réfor-mateur : le ministère Jospin (1988-1989), thèse pour le doctorat de science politique, Université Lumière Lyon II, 2010.43. Notamment Prost (A.), L’enseignement en France (1800-1967), Paris, Armand Colin, 1968 et L’enseigne-ment s’est-il démocratisé ? Les élèves des lycées et collèges de l’agglomération d’Orléans de 1945 à 1980, Paris, Presses universitaires de France, 1988.44. Prost (A.), « Pourquoi les lycées ont craqué en 1990 », Le Monde de l’éducation, avril 1991, reproduit dans Prost (A.), Éducation, société et politique…, op. cit., p. 220.45. Poupeau (F.), Une sociologie d’État. L’école et ses experts en France, Paris, Raisons d’agir, 2003, p. 84.
Frédéric Sawicki 21
98
prospective (DEP) 46 et l’Institut national de la recherche pédagogique (INRP). Ces deux institutions, en concurrence et en très forte tension, même si elles sont incitées à collaborer 47, jouent un rôle central dans la structuration de la recher-che sur les politiques d’éducation à partir de 1987. Sont ainsi affectés pour la première fois à l’INRP des personnels de statut universitaire, en même qu’y est créé un nouveau département « Politiques, pratiques et acteurs de l’éducation » regroupant sept unités de recherche 48 et orienté autour de deux axes : apprentis-sages et politiques éducatives. De son côté, la DEP devient le principal financeur de la recherche en éducation. Xavier Pons rappelle que « l’association avec les chercheurs est en effet l’un des axes de développement explicite » de la DEP qui est dotée d’un « budget études », oscillant entre 1,87 et 10,12 millions de francs par an au cours de la période 1987-1997, « spécifiquement consacré à la com-mande de travaux externes auprès de laboratoires universitaires et de cabinets privés 49 ». Se met alors en place un va-et-vient permanent entre les statisticiens de la DEP et le monde de la recherche académique qui permet aux premiers de perfectionner leurs outils d’évaluation et aux seconds de financer leurs recher-ches. Les travaux des économistes de l’IREDU dans un premier temps 50, ceux de sociologues dans un second temps (Louis-André Vallet, Dominique Merllié, etc.) sont largement mobilisés.
Ce changement de statut et d’organisation de la recherche en éducation conduit une partie de ses acteurs à adopter un « rapport plus pratique à l’insti-tution scolaire et à ses agents » et à orienter ses recherches « dans le sens d’une “science de l’administration scolaire” 51 » dépolitisée, en même temps qu’elle prive les sociologues moins soucieux de recherche appliquée des possibilités de réaliser de grosses enquêtes quantitatives, les contraignant à se borner « à faire des observations ethnographiques dans les établissements scolaires », tout particulièrement dans les banlieues populaires. Il est difficile de donner tort à F. Poupeau sur ce dernier point, même s’il faut ajouter que cette orientation trouve aussi son origine dans la routinisation et l’épuisement des méthodes et
46. La montée en puissance de la DEP et sa capacité à absorber et en retour influencer les travaux des cher-cheurs devra beaucoup, entre 1990 et 1997, à son directeur, Claude Thélot, statisticien de l’INSEE, titulaire d’un doctorat de sociologie dont la thèse sur la mobilité sociale fait référence (Tel père, tel fils. Position sociale et origine familiale, Paris, Dunod, 1982).47. Pons (X.), Évaluer l’action éducative. Des professionnels en concurrence, Paris, Presses universitaires de France, 2010.48. Parmi celles-ci, le Groupe d’études sociologiques dirigé par Jean-Louis Derouet, élève de Luc Boltanski, aura un rôle moteur dans l’impulsion des recherches sur la décentralisation du système éducatif et ses effets, une décentralisation et une autonomisation des établissements dont J.-L. Derouet se fera progressivement le chantre. Cf. Derouet (J.-L.), « Une science de l’administration scolaire est-elle possible ? Réflexions autour de la circulation des savoirs entre recherche, politique et administration », Revue française de pédagogie, 130, 2000.49. Ibid., p. 134.50. Institut de recherches sur l’éducation, UMR du CNRS et de l’Université de Bourgogne.51. Ibid., p. 103.
22 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
problématisations dominantes dans la période précédente 52. La multiplica-tion, voire l’hégémonie, des analyses localisées fondées principalement sur des observations et des entretiens est bien un trait distinctif des recherches menées en sociologie de l’éducation des années 1990 à aujourd’hui (comme d’ailleurs d’autres domaines de la sociologie), qu’elles aient pris pour objet les nouvelles formes de « gouvernance » éducative ou qu’elles se soient efforcées d’analyser la « mobilisation » (ou la démobilisation) des enseignants 53 et des parents – notamment d’origine populaire 54 –, et des autres acteurs intervenant dans la vie des établissements 55, ou qu’elles se soient attachées à rendre compte du difficile apprentissage du « métier d’élève 56 » ou d’enseignant 57, des interactions entre acteurs 58 ou des modalités d’élaboration des « compromis locaux 59 ». Ajoutons que même quand elles ont pris appui sur des données quantitatives, beaucoup des recherches sociologiques de ces vingt dernières années ont eu tendance à travailler sur des petits échantillons d’établissements et à déplacer leur attention vers l’influence du contexte local (la classe, le quartier, l’établissement surtout)
52. L’évolution de chercheurs comme J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie est emblématique. Formés par P. Bour-dieu, ils remettent en cause sa problématisation et l’analyse statistique dès les années 1970 à mesure qu’ils étudient l’histoire de la scolarisation. Comme l’écrit J.-M. Chapoulie : « Les recherches menées ensemble sur la scolarisation nous avaient fait en effet douter sérieusement de la pertinence du schéma de La Reproduction de P. Bourdieu et J.-C. Passeron, et plus encore de celui de l’École capitaliste en France de Christian Baude-lot et Roger Establet […]. L’idée d’inculcation, partagée par ces ouvrages et bien d’autres, nous apparaissait inconsistante : l’inculcation des classes populaires était toujours postulée, jamais observée ; l’expérience qui était la nôtre nous faisait aussi fortement douter d’une domination univoque des classes populaires par la culture dominante. L’examen des données statistiques sur les effectifs présents à l’école depuis le début du siècle montrait que des phénomènes essentiels comme la scolarisation et la réussite croissante des filles (que devaient bien plus tard découvrir C. Baudelot et R. Establet) échappaient à ces deux analyses ; il en allait de même du développement de la scolarisation dans les formes diverses d’enseignement non classiques. ». Chapoulie (J.-M.), « Enseigner le travail de terrain et l’observation : témoignage sur une expérience (1970-1985) », Genèses, 39, 2000, p. 144.53. Cf. notamment Dubet (F.), Cousin (O.), Guillemet (J.-P.), « Mobilisation des établissements scolaires. Le cas des collèges », Revue française de sociologie, 30 (3), 1989 ; Duru-Bellat (M.) et al., « Tonalité sociale du contexte et expérience scolaire des élèves au lycée et à l’école primaire », Revue française de sociologie, 45 (3), 2004 ; Jellab (A.), Sociologie du lycée professionnel. L’expérience des élèves et des enseignants dans une institu-tion en mutation, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2009.54. Cf. notamment Sirota (R.), L’école primaire au quotidien, Paris, Presses universitaires de France, 1988 ; Careil (Y.), Instituteurs des cités HLM. Radioscopie et réflexion sur l’instauration progressive de l’école à plu-sieurs vitesses, Paris, Presses universitaires de France, 1994 ; Thin (D.), Quartiers populaires : l’école et les familles, Lyon, Presses universitaires de Lyon.55. Cf. notamment Van Zanten (A.), L’école et l’espace local. Les enjeux des zones d’éducation prioritaire, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1990 et L’école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue, Paris, Presses universitaires de France, 2001.56. Cf. notamment Dubet (F.), Les lycéens, Paris, Seuil, 1991 ; Dubet (F.), Martucelli (D.), À l’école. Sociologie de l’expérience scolaire, Paris, Seuil, 1996 ; Barrère (A.), Travailler à l’école : que font les élèves et les enseignants du secondaire ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003.57. Cf. par exemple Barrère (A.), Enseignants au travail : routines incertaines, Paris, L’Harmattan, 2002 et Deauvieau (J.), Enseigner dans le secondaire. Les nouveaux professeurs face aux difficultés du métier, Paris, La Dispute, 2009.58. Cf. par exemple Masson (P.), Les coulisses d’un lycée ordinaire. Enquête sur les établissements secondaires des années quatre-vingt-dix, Paris, Presses universitaires de France, 1994.59. Derouet (J.-L.), École et justice. De l’égalité des chances aux compromis locaux, Paris, Métailié, 1992.
Frédéric Sawicki 23
98
sur les chances de réussite scolaire 60, contribuant ce faisant largement à la pola-risation sur l’« horizon local des pratiques 61 ».
Convergences avec la sociologie de l’action publique
Le jugement de F. Poupeau concernant « le glissement de la sociologie de l’éducation vers une sociologie au service de l’État 62 » apparaît en revanche excessif. Tous les sociologues qui ont travaillé sur la mise en œuvre des nou-velles orientations des politiques scolaires n’ont ni abdiqué leur sens critique ni renoncé à inscrire leur travail dans une perspective théorique dépassant le cas de l’école. Les recherches menées par Agnès Van Zanten, Lise Demailly, Yves Dutercq, Jean-Luc Derouet, Christian Maroy, Bénédicte Robert, Nathalie Mons, pour citer les principaux chercheurs francophones ayant analysé la production des politiques scolaires en privilégiant souvent le niveau des établissements ou des territoires locaux, se montrent souvent très critiques à l’égard des orienta-tions des décideurs publics, même s’ils ne renoncent pas à adopter une posture prescriptive. Tous empruntent par ailleurs beaucoup de concepts et d’outils à la sociologie politique ou à la sociologie générale et sont soucieux de comparer le secteur scolaire avec d’autres secteurs d’action publique ou d’autres institu-tions 63. Yves Dutercq pose ainsi que « pour mieux comprendre la complexité de l’administration contemporaine de l’éducation, pour en démêler le sens, les concepts auxquels se réfère l’analyse des politiques publiques constituent de pré-cieux outils ». Il invite à abandonner la référence à la sociologie des organisations qui « a été le modèle dominant d’analyse du fonctionnement du système éduca-tif et de ses composantes (rectorats, services académiques et établissements) », pour se tourner du côté « de la sociologie politique et de la science politique [où] l’on peut espérer trouver aujourd’hui des pistes propres à construire une science de l’administration de l’éducation valide 64. »
Pour ces chercheurs, deux arguments plaident en faveur d’un rapprochement avec la sociologie politique : d’une part, s’il conserve une marge d’autonomie, le secteur éducatif est de plus en plus articulé avec d’autres secteurs de l’action publique (politiques de la ville, politiques d’emploi et de formation, politique de sécurité…) ; d’autre part, les transformations qui l’affectent ne sont pas
60. Cousin (O.), L’efficacité des collèges. Sociologie de l’effet établissement, Paris, Presses universitaires de France, 1998.61. Lagroye (J.), « De “l’objet local” à l’horizon local des pratiques », in Mabileau (A.), dir., À la recherche du « local », Paris, L’Harmattan, 1993.62. Poupeau (F.), Une sociologie d’État…, op. cit., p. 56.63. C’est par exemple la comparaison entre les métiers de l’éducation, du soin aux personnes et du travail social qui conduit F. Dubet à conclure au déclin des « programmes institutionnels ». Dubet (F.), Le déclin de l’institution, Paris, Seuil, 2002.64. Dutercq (Y.), « Administration de l’éducation : nouveau contexte, nouvelles perspectives », Revue fran-çaise de pédagogie, 130 (1), 2000, p. 161. Cf. également Van Haecht (A.), « Les politiques éducatives, figure exemplaire des politiques publiques », Éducation et sociétés, 1, 1998.
24 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
séparables de celles qui touchent beaucoup d’autres 65 : la territorialisation de l’action publique, l’introduction du néo-management et du pilotage des admi-nistrations par les résultats, le développement de l’évaluation, et notamment du benchmarking international sont autant de tendances qui caractérisent en effet la plupart des administrations, non seulement en France, mais dans le monde.
La « normalisation du champ de l’éducation qui apparaît comme de moins en moins spécifique par rapport à d’autres domaines de l’action publique 66 », a d’abord été pointée par les chercheurs qui ont analysé le développement de la « déconcentralisation » de l’Éducation nationale. Pour Yves Dutercq et Vin-cent Lang, la « construction de véritables réseaux territoriaux, sous la forme d’alliances entre élus et fonctionnaires locaux » et de « réseaux similaires, hori-zontaux ou latéraux, liant des établissements entre eux, aux collectivités, aux branches professionnelles, à des élus, à des associations, à des entreprises », a bouleversé le rôle des chefs d’établissement, rendu « moins pesant le circuit hiérarchique académique » et conféré aux élus locaux une position de plus en plus cruciale 67. Ils en concluent que « le système scolaire français est passé en quinze ans d’un niveau de régulation national de ce que doivent faire les unités locales (essentiellement les établissements), via la chaîne hiérarchique, à un espace de régulation intermédiaire où les informations, les incitations, les réfé-rences circulent et interagissent. Le contrôle systématique par le sommet est devenu quasi impossible et les chaînons hiérarchiques s’inscrivent eux-mêmes, en définitive, dans cette circulation territoriale. Ils conservent un certain poids, mais qui n’est jamais donné d’avance : l’impact hiérarchique est variable d’un lieu à l’autre et dépend avant tout des rapports de force locaux, si bien qu’il peut évoluer en même temps que changent les personnes 68. »
D’autres chercheurs ont insisté davantage sur la persistance des « régula-tions » nationales et sur les résistances à l’égard de l’autonomisation des établis-sements et de la territorialisation des politiques scolaires. Lise Demailly, tout en reconnaissant que la déconcentration et la décentralisation « modifient la façon dont les acteurs mènent leurs luttes et leurs alliances autour de l’école », insiste ainsi sur le fait que les « bonnes manières d’administrer (diriger, piloter, évaluer, gérer l’argent, gérer les carrières, aider les professionnels de terrain, nouer des partenariats, faire participer les usagers) » sont un enjeu de luttes. Elle récuse l’idée qu’il y aurait un nouveau « référentiel 69 » partagé, mais qu’en fonction
65. Cf. par exemple Demailly (L.), Dembinski (O.), « La réorganisation managériale de l’hôpital », Éducation et sociétés, 6, 2000.66. Dutercq (Y.), « Les politiques éducatives des collectivités territoriales », art. cit., p. 128.67. Dutercq (Y.), Lang (V.), « L’émergence d’un espace de régulation intermédiaire dans le système scolaire français », Éducation et sociétés, 8, 2001, p. 43.68. Ibid., p. 63. Cf. aussi Ben Ayed (C.), Le nouvel ordre éducatif local. Mixité, disparités, luttes locales, Paris, Presses universitaires de France, 2009.69. Au sens de Jobert (B.), Muller (P.), L’État en action, op. cit.
Frédéric Sawicki 25
98
de leur position et des enjeux les différents groupes d’acteurs du système édu-catif défendent des positions « éthicopolitiques » opposées 70. Ces conflits sont observables au quotidien à tous les niveaux de l’administration. Ils se traduisent par de nombreux actes de résistance, à l’instar de la « grève administrative » de sept ans (de 1999 à 2006) menée par les directeurs d’école pour protester contre leur surcharge de travail qui s’est traduit par leur refus de transmettre à l’Inspection académique des « enquêtes de rentrée » ; ils peuvent aussi donner lieu à des mobilisations collectives, à l’instar du mouvement de grève déclenché à la suite de l’annonce par le gouvernement Raffarin en 2004 de transférer aux départements et aux régions des personnels d’entretien des collèges et lycées 71. Cette grève, bien qu’inefficace, a témoigné du fort attachement de la majorité des enseignants à ce que Y. Dutercq et V. Lang appellent une « régulation aca-démique traditionaliste », fondée sur leur autonomie professionnelle, un rôle bureaucratique pour les chefs d’établissement et « une professionnalité acadé-mique pour les corps d’inspection 72 ».
De même, les chercheurs qui se sont focalisés sur l’application des principes du nouveau management public à l’éducation ne se sont pas seulement attachés à décrire leur mise en œuvre – souvent insidieuse et sans adhésion des acteurs – et leurs effets 73, mais ont aussi été attentifs aux controverses et conflits portant notamment sur le contenu et les outils de l’évaluation 74 et sur la place à accorder aux usagers (parents, élèves) 75. Les différences de diagnostic quant à l’ampleur des changements intervenus sont ici particulièrement importantes. Certains considèrent que la concurrence entre les établissements, à travers la liberté crois-sante accordée aux parents de choisir leur école (suppression de la carte scolaire, renforcement des aides à l’enseignement privé) et aux chefs d’établissement de
70. Demailly (L.), « Management et évaluation des établissements », in Van Zanten (A.), dir., L’École : l’état des savoirs, op. cit., p. 137 et s.71. F. Poupeau tend à interpréter de même la mobilisation des enseignants et des parents d’élèves de Seine-Saint-Denis en 1998 comme une révolte contre le désengagement de l’État. Poupeau (F.), Contestations scolaires et ordre social. Les enseignants de Seine-Saint-Denis en grève, Paris, Syllepse, 2004.72. Dutercq (Y.), Lang (V.), « L’émergence d’un espace de régulation intermédiaire dans le système scolaire français », art. cit.73. « C’est aussi à partir de multiples micro-décisions où il est nécessaire d’opérer des catégorisations, de répondre à des demandes précises et parfois pressantes et de trancher dans le vif entre des options concur-rentes que l’on peut repérer la diffusion souterraine de cette orientation à l’échelle locale. Un bon exemple de ceci est la gestion des dérogations dans l’enseignement élémentaire. Même dans de nombreuses muni-cipalités de gauche dont le discours officiel est celui de la défense de l’enseignement public et de l’aide aux élèves les plus défavorisés, on observe que, dès lors qu’il y a des places disponibles dans les établissements, politiques et gestionnaires hésitent de plus en plus à aller à l’encontre des vœux parentaux qui mettent pourtant en péril le fonctionnement des établissements les plus en difficulté. » Ball (S.), Van Zanten (A.) « Logiques de marché et éthiques contextualisées dans les systèmes français et britannique », Éducation et sociétés, 1, 1998, p. 55.74. Demailly (L.), « En Europe : l’évaluation contre la crise des systèmes scolaires, l’évaluation en crise », Éducation et sociétés, 17, 2006.75. Buisson-Fenet (H.), « Un “usager” insaisissable ? Réflexion sur une modernisation mal ajustée du service public d’éducation », Éducation et sociétés, 12, 2004.
26 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
modeler l’offre pédagogique, ajoutée à la dépendance croissante des établisse-ments vis-à-vis des élus locaux et, pour l’enseignement professionnel, du milieu économique local, a abouti à la domination de l’école par une logique de mar-ché. La thèse de l’école libérale, voire capitaliste a connu ainsi une reviviscence, nationale et internationale, non pas à partir de l’examen statistique de la répar-tition des élèves entre filières générales et professionnelles, mais sur la base d’ob-servations locales 76, de l’analyse des nouvelles formes de pédagogie orientées vers la professionnalisation et des discours tenus par les « réformateurs 77 » et de comparaison internationales 78.
Les comparaisons internationales fondées sur des observations systémati-sées établissent cependant que les logiques combinées de marchandisation et de décentralisation de l’école n’ont pas la même ampleur selon les pays, sans que leurs promoteurs s’accordent pour autant sur le degré de convergence des systèmes éducatifs. L’étude dirigée par C. Maroy 79, qui repose sur l’analyse qua-litative des politiques menées dans cinq pays (communauté française de Belgi-que, Grande-Bretagne, France, Hongrie et Portugal) saisies au niveau local et intermédiaire, débouche ainsi sur le constat d’une orientation générale vers un modèle postbureaucratique, même si les pays étudiés n’empruntent pas tous le même sentier (de dépendance) pour y parvenir. Ce modèle se caractériserait par le renforcement des autorités locales, la substitution de l’évaluation au contrôle normatif central, des marges de choix accrues pour les familles, la mise en place de programmes et de dispositifs spéciaux pour les élèves les plus faibles, avec comme conséquence une segmentation accrue des publics et des établissements scolaires, qui contraint les chefs d’établissements à se comporter en entrepre-neur/manager… De son côté, N. Mons 80, à partir d’une analyse en composantes principales des traits organisationnels des systèmes éducatifs de trente-neuf pays ou communautés, met en évidence la persistance de quatre modèles idéaltypi-ques spécifiques d’organisation (« quasi centralisé », « fédéral », « différenciation intégrée », « différenciation désarticulée ») et conclut au maintien de l’ancrage de la France dans le modèle quasi centralisé, lequel repose sur un enseignement
76. Careil (Y.), De l’école publique à l’école libérale. Sociologie d’un changement, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998.77. Broadfoot (P.), « Un nouveau mode de régulation dans un système décentralisé : l’État évaluateur », Revue française de pédagogie, 130, 2000 ; Laval (C.), L’école n’est pas une entreprise. Le néolibéralisme à l’assaut de l’enseignement public, Paris, La Découverte, 2004 ; Laval (C.), Vergne (F.), Clément (P.), Dreux (G.), La nouvelle école capitaliste, Paris, La Découverte, 2011.78. Laval (C.), Weber (L.), dir., Le nouvel ordre éducatif mondial, OMC, Banque mondiale, OCDE, Com-mission européenne, Paris, Syllepse, 2002 ; Jones (K.), L’école en Europe. Politiques néolibérales et résistances collectives, Paris, La Dispute, 2011.79. Maroy (C.), École, régulation et marché : une comparaison de six espaces scolaires locaux en Europe, Paris, Presses universitaires de France, 2006 et « Vers une régulation post-bureaucratique des systèmes d’enseigne-ment en Europe ? », Sociologie et sociétés, 40 (1), 2008.80. Mons (N.), Les nouvelles politiques éducatives. La France fait-elle le bon choix ?, Paris, Presses universitai-res de France, 2007.
Frédéric Sawicki 27
98
privé fortement encadré, des possibilités limitées de dérogation à la carte sco-laire, des examens nationaux, et un système d’évaluation centralisé.
L’étude que H. Buisson-Fenet et X. Pons consacrent dans ce numéro aux vicissitudes de l’évaluation des établissements scolaires en France telle que pro-mue au plan européen et international, tout comme celle de Lorenzo Barrault sur la mise en œuvre de l’assouplissement de la carte scolaire 81 conduisent de même à relativiser la transformation néo-managériale de l’École. En pratique, les évaluations d’établissement se heurtent aux habitudes des corps d’inspec-tion et à la résistance des enseignants et aux craintes des chefs d’établissement, elles sont aussi victimes de la rotation des recteurs et des ministres. De même, la liberté de choix de l’école publique laissée aux parents se heurte aux contrain-tes bureaucratiques et gestionnaires auxquels se plient les conseils généraux en dépit des pressions que peuvent exercer les parents ou malgré l’ambition de certains élus de lutter contre la ségrégation sociale.
Le débat est loin d’être clos. La permanence d’une forte coordination bureau-cratique combinée au maintien d’un haut degré d’autonomie professionnelle des enseignants, en dépit des réformes, conduit toutefois à conclure à la néces-sité d’« articuler l’analyse des évolutions du système éducatif comme secteur institutionnel et aussi comme “politique sectorielle”, en s’attardant à la fois sur les continuités normatives et les dépendances de sentier, et sur les espaces publics d’échanges et de controverses où sont redéfinis les problèmes publics et leurs modes de résolution 82 ». À cet égard, même si ces effets ont été plus modestes qu’es-comptés, on ne peut ignorer, comme le remarquent Agnès Van Zanten et Stuart Ball, que la critique de l’Éducation nationale comme inefficace, bureaucratisée, conservatrice, dominée par des intérêts corporatistes qui a accompagné la mise en place de politiques néo-managériales a été partagée par tous les gouverne-ments depuis au moins 1988 et a largement contribué à définir « les problè-mes du service public d’éducation, comme ceux d’autres services publics […] comme des problèmes de coordination des tâches et des activités, de gestion et d’évaluation en vue d’améliorer le rendement et de revaloriser l’usager face aux professionnels de l’éducation 83 ». Les raisons de ce consensus paradoxal des élites gouvernantes et la genèse de cette nouvelle « problématisation » de l’école (non seulement son contenu mais les acteurs qui la portent) méritent d’être étudiées, non seulement en eux-mêmes, mais au regard d’autres formes de problématisations antérieures et/ou alternatives.
81. Cf. également Barrault (L.), Gouverner par accommodements. La régulation publique de l’accès à l’École et les stratégies des familles, thèse pour le doctorat de science politique, Université Paris 1, 2011.82. Buisson-Fenet (H.), « L’éducation scolaire au prisme de la science politique… », art. cit., p. 389, souligné par nous.83. Ball (S.), Van Zanten (A.) « Logiques de marché… », art. cit., p. 54. Cf. également Van Zanten (A.), « La construction des politiques d’éducation. De la centralisation à la délégation au local », in Culpepper (P. D.), Hall (P. A.), Palier (B.), dir., La France en mutation, 1980-2005, Paris, Presses de Sciences Po, 2006.
28 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
Vers une sociologie des problématisations politiques de l’école…
Si les pratiques de nombreux acteurs du monde de l’éducation manifestent une claire résistance vis-à-vis des normes que tente de prescrire le ministère de l’Éducation nationale et confèrent aux changements intervenus au cours de ces trente dernières années un caractère plus hybride que certains ne le prétendent ou le craignent, la question de la genèse de ces nouvelles normes, de leur dif-fusion et de leurs effets sur la façon de problématiser l’école, au sens de Michel Foucault 84, ou, si l’on préfère, sur la façon dont l’école est construite comme « problème public », au sens de Joseph Gusfield 85, et partant, la question des propriétés sociales des acteurs et des groupes qui sont à la manœuvre, ont été beaucoup moins étudiés par les sociologues et les spécialistes de sciences de l’éducation. Leur tropisme disciplinaire a conduit ces derniers à se concentrer sur les pratiques éducatives et les effets des réformes scolaires sur les enseignants, les élèves, leurs parents et, partant, sur les performances et les inégalités scolai-res. En cela, la sociologie des politiques éducatives fournit incontestablement un modèle pour la sociologie de l’action publique qui laisse trop souvent dans l’ombre les street-level-bureaucrats 86 et les effets des politiques, pour privilégier les processus d’élaboration des programmes et des instruments d’action et leurs acteurs. En contrepartie, elle a tendu à ignorer ou à négliger, tout au moins pour la période contemporaine, les arcanes du gouvernement et notamment du ministère de l’Éducation nationale – mais pas uniquement –, les lieux publics et privés, nationaux et internationaux, de production de l’expertise sur l’école, les partis politiques, le parlement, dans une certaine mesure les syndicats, et de manière générale les débats et controverses publics sur l’école.
Or l’école, à la différence de beaucoup d’autres secteurs de l’action publique, se caractérise par un degré de politisation exceptionnel et quasiment ininter-rompu depuis les débuts de la IIIe République. Cette politisation n’est évidem-ment pas sans lien avec l’ampleur des attentes qui pèsent sur l’école, mais elle contribue aussi rétroactivement à les renforcer et à les définir. De fait, les
84. C’est-à-dire la façon dont, à un moment donné, non seulement « un ensemble d’embarras et de diffi-cultés » est définie comme un problème, mais la façon dont « une certaine pratique institutionnelle et un certain appareil de connaissances » en définissent les contours et y associent diverses solutions pratiques. « Problématisation ne veut pas dire représentation d’un objet préexistant, ni non plus création par le dis-cours d’un objet qui n’existe pas. C’est l’ensemble des pratiques discursives ou non discursives qui fait entrer quelque chose dans le jeu du vrai et du faux et le constitue comme objet pour la pensée (que ce soit sous la forme de la réflexion morale, de la connaissance scientifique, de l’analyse politique, etc.) ». Foucault (M.), Dits et écrits, t. 2 : 1976-1988, Paris Gallimard, 2001, p. 1417 et 1489.85. Gusfield (J.), La culture des problèmes publics : l’alcool au volant, Paris, Economica, 2008 [1re éd. am. 1981].86. Rappelons que dans son étude pionnière sur ce sujet, Michael Lipsky considère ainsi les enseignants. Lipsky (M.), Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York, Russel Sage Foundation, 1980.
Frédéric Sawicki 29
98
questions scolaires occupent une place de choix dans les programmes des partis politiques et constituent un terrain d’affrontement privilégié entre la droite et la gauche, comme l’illustre la focalisation sur la question de la carte scolaire lors de la campagne présidentielle de 2007, point de départ de l’article de L. Barrault. Les questions scolaires nourrissent des controverses et polémiques incessantes, dans lesquelles de nombreux intellectuels, experts et universitaires 87 sont partie prenante, à propos de ses finalités (« éduquer », « instruire », « émanciper », « professionnaliser », « favoriser la mobilité sociale »…), de sa capacité ou non à les remplir et des causes de ses défaillances voire de sa « crise 88 ». Ces controver-ses ont pour propriété d’être presque systématiquement rattachées aux valeurs fondamentales du régime et de l’État : l’égalité, la liberté, la laïcité, la mixité, la cohésion sociale, si bien que tout se passe comme si l’école était condamnée en France à n’être jamais assez « démocratique », « professionnalisante », « appre-nante », « ouverte sur le monde », « émancipatrice », « exigeante », « socialisa-trice »… et nourrissait de ce fait des débats jamais tranchables.
Les instruments d’analyse conventionnels des politiques publiques privilé-giés par les chercheurs en éducation trouvent ici leurs limites 89. Ils apparaissent peu adéquats pour rendre compte de la compétition pour imposer la définition légitime, « vraie » dirait Foucault, des problèmes scolaires et de leurs solutions, ainsi que des acteurs qui y prennent part ; ils permettent également mal d’ap-précier en quoi la forte politisation du secteur, largement héritée, portée par des milieux socio-politiques très structurés 90 mais en pleine recomposition 91, favo-risée par la surreprésentation des enseignants au sein du personnel politique, pèsent sur les stratégies des acteurs politiques, comme tenus en permanence de proposer des réformes qui se démarquent de celles de leurs concurrents, tout en sachant que c’est là un domaine à haut risque. Comment rendre autrement compte de la réforme incessante des programmes et des curricula au cours des vingt-cinq dernières années et des « ruses » employées et des concessions
87. Les sociologues de l’éducation non seulement ne font pas exception mais, comme l’a montré Bernard Ravon, ont joué un rôle essentiel en ruinant « les espérances d’une intégration différentielle » et en ébranlant « les fondements idéologiques contenus dans le Plan Langevin-Wallon ». Ravon (B.), L’« échec scolaire ». Histoire d’un problème public, Paris, In Press, 2000, p. 261.88. Sur ce point, cf. Balland (L.), Une sociologie de la crise de l’école. De la réussite d’un mythe aux pratiques enseignantes, thèse pour le doctorat en science politique, Université Paris X-Nanterre, 2009.89. Pour une critique approfondie de ces instruments, cf. Dubois (V.), « L’action publique », in Cohen (A.), Lacroix (B.), Riutort (P.), dir., Nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2009.90. On pense bien sûr d’une part au milieu laïque qui associe certaines fractions du parti socialiste à cer-tains syndicats enseignants, à la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) au monde mutualiste et coopératif, à la Ligue de l’enseignement, à Force ouvrière et à la franc-maçonnerie et d’autre part au milieu catholique qui agrège les associations de parents de l’enseignement « libre » (UNAPEL).91. On songe notamment à l’éclatement de la FEN en 1992 et à la disparition de la « culture profession-nelle » des instituteurs portée par les Écoles normales et le syndicat national des instituteurs (SNI). Cf. Geay (B.), Profession : instituteurs. Mémoire politique et action syndicale, Paris, Seuil, 1999 et Le syndicalisme enseignant, Paris, La Découverte, 2005.
30 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
consenties pour faire passer certaines réformes 92 ? On peut ici se demander si, pour parvenir à réformer, les ministres ne sont pas structurellement contraints de jouer une partie du milieu professionnel contre une autre, quitte à échouer 93 et d’adopter diverses stratégies de contournement. L’analyse de la création du Conseil national des programmes (CNP) en 1990 que propose dans ce numéro Pierre Clément en fournit une belle illustration. Il montre que pour faire abou-tir ce qui est d’abord « une stratégie de subversion de l’ordre institutionnel antérieur, dans lequel les directions d’administration centrale et surtout l’ins-pection générale tenaient le premier rôle » destinée à « laisser plus d’autonomie et de responsabilités aux échelons locaux », le cabinet de Lionel Jospin a mobi-lisé des universitaires réputés pour les amener à justifier la nécessité de faire évoluer les programmes au nom de leur décalage par rapport aux connaissances scientifiques.
Les problématisations de la question scolaire n’ont bien sûr pas cessé d’évo-luer depuis le début du XXe siècle, à mesure des changements de la société fran-çaise et à mesure de sa saisie par de nouveaux acteurs (syndicats professionnels, hauts fonctionnaires chargés de la planification, chercheurs en sciences sociales, associations de parents d’élèves, experts internationaux, spécialistes en mana-gement public, etc.). Si la légitimité de l’État à contrôler seul l’éducation des enfants au nom du principe d’égalité et la défense du droit des familles de choi-sir leur école au nom du principe de liberté a longtemps été la ligne de clivage centrale qui a divisé le champ politique, l’école a fait l’objet d’au moins deux autres grandes formes de problématisations : en termes d’efficacité économi-que et de justice sociale. Ces problématisations sont plus anciennes qu’on ne le croit parfois 94, même si elles sont devenues de plus en plus prégnantes après
92. C’est ainsi que la loi de programmation de 1989 est avant tout présentée par ses promoteurs comme une loi pédagogique et non avant tout néo-managériale et qu’elle est accompagnée d’une revalorisation des carrières enseignantes (création du corps des professeurs des écoles, révision des barèmes de rémunéra-tion…) et d’un renoncement à créer un corps de professeurs de collège. Cf. Aebischer (S.), « Mettre l’élève et le management au centre du système »…, op. cit.93. Prost (A.), Bon (A.), « Le moment Allègre (1997-2000). De la réforme de l’Éducation nationale au sou-lèvement », Vingtième siècle, 110, 2011.94. C’est la critique qu’on peut adresser à J.-L. Derouet (École et justice…, op. cit.) qui considère que le modèle de l’égalité des chances a été le principe de justice unique et fédérateur qui a guidé les politiques scolaires jusqu’en 1968. Frédéric Mole a récemment montré que « l’organisation de l’enseignement en ordres séparés fait l’objet de critiques répétées » dès le début du XXe siècle et que plusieurs « projets d’unification visant à étendre la détection des aptitudes et à fonder une nouvelle égalité scolaire » surgissent alors, portés par les radicaux-socialistes. Mais les conservateurs comme les révolutionnaires s’accommodent du dualisme scolaire existant, les uns au nom de la préservation de la culture classique, les autres au nom de la priorité à donner à la révolution, mais aussi du rejet de la culture bourgeoise incarnée par le lycée d’alors. Autrement dit, si c’est dès le début du XXe siècle que « l’école unique trouve […] ses premiers fondements argumenta-tifs », ce modèle est loin d’être dominant. Concernant la question de l’efficacité économique ou plus large-ment de l’adéquation de l’école aux besoins de la société et/ou du marché du travail, là encore, certains des termes du débat sont eux aussi déjà posés. Mole (F.), L’école laïque pour une République sociale. Controverses pédagogiques et politiques (1900-1914), Rennes-Paris, Presses universitaires de Rennes-INRP, 2010, p. 261 et p. 265.
Frédéric Sawicki 31
98
la Seconde guerre mondiale. Comme le montre Philippe Bongrand dans sa contribution à ce numéro 95, le rôle des organisations patronales et du syndica-lisme agricole est crucial dans cette évolution, mais si ceux-ci ne parviennent à faire aboutir la réforme de l’enseignement professionnel et de l’enseignement secondaire qu’après avoir trouvé des alliés au sein de l’institution scolaire et du monde politique, lesquels ont transcodé les attentes des milieux économiques en fonction de leur propre système de valeurs méritocratique. Les commissions du Plan, au cours des années 1960, seront le lieu central où s’opérera cette « mise en équivalence » des formations scolaires avec l’emploi non seulement au nom des besoins de l’économie, mais en celui également des chances données à cha-cun de valoriser ses compétences 96. La démarche de P. Bongrand s’inscrit dans les pas de J.-M. Chapoulie tant sur le plan méthodologique qu’empirique. Ce dernier a en effet clairement établi que la formation de la main-d’œuvre n’est en rien, comme le laissent entendre certaines critiques contemporaines, une préoccupation récente des acteurs de la politique scolaire 97, mais qu’elle est au cœur de la politique d’allongement de la scolarisation de l’après-guerre, même si, à partir des années 1970, le souci de la lutte contre le chômage va se subs-tituer à celui de l’ajustement de la main-d’œuvre aux besoins de l’économie. Symétriquement, depuis l’après-guerre, la résistance contre la soumission de l’enseignement aux besoins de l’économie se trouve portée par une coalition d’acteurs politiquement hétérogènes rassemblant défenseurs de la culture clas-sique et syndicalistes du secondaire hostiles à « l’inféodation au capitalisme ».
Les travaux de J.-M. Chapoulie et Jean-Pierre Briand 98 fournissent à ce jour le modèle le plus convaincant d’une sociologie des politiques scolaires qui par-vient à faire tenir ensemble la façon dont à chaque époque sont problématisées différemment les questions scolaires, la sociologie des acteurs qui concourent à cette problématisation (leurs dispositions, leurs croyances, leurs intérêts) et les négociations explicites ou implicites qui président à la mise en œuvre des programmes d’action publique qui en découlent. Dans son dernier livre, contre toute vision rapide et naïve de la demande d’instruction, J.-M. Chapoulie se montre ainsi très attentif à la « dimension symbolique de la politique scolaire » et au déchiffrement des actions du personnel politique et plus largement de tous les acteurs (pédagogues, administrateurs, personnels de direction, syndicats,
95. Contribution issues de sa thèse : Bongrand (P.), La scolarisation des mœurs. Socio-histoire de deux poli-tiques de scolarisation, en France, depuis la Libération, thèse pour le doctorat de science politique, Université de Picardie Jules Verne, 2009.96. Cf. Tanguy (L.), « La mise en équivalence de la formation avec l’emploi dans les IVe et Ve plans (1962-1970) », Revue française de sociologie, 43 (4), 2002.97. Elle est déjà au cœur des préoccupations des édiles municipaux de l’entre-deux-guerres qui subvention-nent des formations professionnelles au sein des écoles primaires supérieures. Cf. Briand (J.-P.), Chapou-lie (J.-M.), Les collèges du peuple. L’enseignement primaire supérieur et le développement de la scolarisation prolongée sous la Troisième République, Paris, INRP-Éditions du CNRS, 1992.98. Briand (J.-P.), Chapoulie (J.-M.), « L’institution scolaire et la scolarisation : une perspective d’ensem-ble », Revue française de sociologie, 34 (1), 1993.
32 Pour une sociologie des problématisations politiques de l’École
associations, spécialistes de sciences sociales, etc.) qui participent à son élabora-tion « selon un code historiquement constitué et propre à chaque période 99 ».
Aucune analyse aussi approfondie n’a à ce jour été menée sur les réformes récentes précédemment évoquées. L’étude par S. Aebischer des propriétés socia-les des membres du cabinet Jospin entre 1988 et 1991 comme celle de P. Clé-ment sur le CNP apportent une contribution importante en éclairant l’énigme du ralliement des gouvernants socialistes aux solutions néo-managériales dans l’Éducation nationale, même si cet aspect ne peut être isolé des réformes qui au même moment sont mises en œuvre dans d’autres secteurs de l’administra-tion 100. Beaucoup reste cependant à faire, notamment sur les politiques menées par les gouvernements de droite entre 1993 et 1997 et de 2002 à 2012.
Peut-on de façon plus générale parler à l’égard de ces politiques d’un nouveau « code » ou d’une nouvelle problématisation contemporaine des politiques sco-laires ? Comme le suggèrent les enquêtes de terrain et les comparaisons interna-tionales citées plus haut, la réalité est encore loin de manifester la domination d’un « référentiel néolibéral » fondé sur l’autonomie des acteurs et l’évalua-tion généralisée. L’école n’est pas qu’une institution, elle doit aussi être analysée comme un champ de luttes où s’affrontent de multiples acteurs, locaux, natio-naux, internationaux, salariés ou non de l’institution, porteurs de différentes conceptions normatives de ce qu’elle doit être et de la manière dont elle doit être organisée, gérée, pilotée, évaluée… sans qu’aucune ne domine réellement. Un des objets que doit dès lors se donner en priorité la sociologie politique de l’école est l’analyse de ces luttes, de ses acteurs, des coalitions et des alliances qu’ils constituent, de leurs stratégies d’action, d’influence et d’enrôlement.
*
Il ne s’est pas agi dans cette introduction, par un jeu de distinction classique qui fait les modes en science comme ailleurs ou qui permet à des disciplines de contester des territoires occupés jusqu’ici par d’autres, de proposer un renver-sement des perspectives existantes, de promouvoir un retour à une conception « top down » de la production des politiques publiques. Une telle orientation serait proprement ridicule. Elle tournerait le dos tant aux résultats des recher-ches menées sur les politiques scolaires qu’aux acquis les plus stimulants de la sociologie de l’action publique 101 qui convergent pour établir que l’action
99. Chapoulie (J.-M.), L’École d’État conquiert la France…, op. cit., p. 325-326.100. Bezès (P.), Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, Presses uni-versitaires de France, 2009.101. « L’espace d’appropriation des acteurs de la mise en œuvre est vaste, souvent peu structuré et laissant libre cours aux jeux de pouvoirs organisationnels internes. […] C’est pourquoi les routines, les enjeux les plus sensibles localement et les façons de faire, ont autant de poids que les injonctions hiérarchiques et la
Frédéric Sawicki 33
98
publique procède à la fois de haut en bas et de bas en haut. Comme le montre ici Claire Lemêtre à propos de la création d’une option « théâtre » au baccalau-réat, l’autonomisation des établissements scolaires, en ouvrant des espaces de liberté à des innovations pédagogiques, a eu pour effet de modifier les cadres réglementaires nationaux. De manière générale, les réappropriations des nor-mes et des ressources par les « street-level bureaucrats » et les « usagers » ou les anticipations par des gouvernants de ce qu’elles pourraient être, modifient en permanence les orientations politiques générales, en particulier dans un sec-teur soumis à la fois à de fortes pressions des usagers/électeurs et à des évalua-tions multiformes 102. Il s’est simplement agi modestement d’attirer l’attention des spécialistes des politiques scolaires sur l’intérêt à élargir la focale vers la construction des questions scolaires comme problèmes publics et politiques et ce faisant de s’intéresser à la fois à la sédimentation historique des définitions concurrentes de ce que doit être l’école et aux milieux et acteurs en compétition qui les promeuvent dans et hors l’institution.
pression supposée des urgences sociales. » Lascoumes (P.), Le Galès (P.), Sociologie de l’action publique, Paris, Armand Colin, 2007, p. 35.102. B. Robert montre que les multiples changements d’orientation de la politique d’éducation prioritaire résultent de la non-adhésion de la majorité des acteurs du monde éducatif au principe d’équité et à ce qu’il impliquerait concrètement (remise en cause de l’unicité des programmes, changement dans les règles de recrutement, de carrière et de rémunération des enseignants). Robert (B.), Les politiques d’éducation prio-ritaire…, op. cit.
Frédéric Sawicki est professeur de science politique à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, chercheur au CESSP (UMR CNRS-Paris I-EHESS 8209). Ses travaux ont porté sur la sociologie des organisa-tions et des mobilisations politiques et sur l’engagement militant. Il vient dans cette perspective d’achever une recherche sur l’engagement des enseignants français. Il travaille actuellement sur les politiques de construction des grands équipements
sportifs. Il a publié récemment « Partis poli-tiques et mouvements sociaux : des inter-dépendances aux interactions et retour… », in Dechezelles (S.), Luck (S.), dir., Partis politiques et mouvements sociaux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011 et, avec J. Lagroye et B. François, Sociologie politique, Paris, Dalloz/Presses de Sciences Po, 2012, 6e éd.
Politique(s)LES ARMES DE L’ÉCRIT
Héloïse HERMANT – Guerres de plumes et contestation politique dans l’Espagne de la fin du XVIIe siècle Benoît AGNÈS – Les normes de la pétition, France et Royaume-Uni, première moitié du XIXe siècle
POLITIQUES DES SUBALTERNES
Vanessa R. CARU – Mouvements de locataires et politisation des subalternes. Bombay, 1920-1940 Benoît TRÉPIED – Des conduites d’eau pour les tribus. Action municipale, colonisation et citoyenneté en Nouvelle-Calédonie
LECTURES
François DUMASY – Les transactions inégales de la dominationFlorence ALAZARD – Une ou des Renaissances ?Étienne ANHEIM – L’historien et la psychanalyste
COMPTES RENDUS
Prix du numéro : 25 � ISSN : 0048-8003
octobre-décembre 2011
B U L L E T I N D ’ A B O N N E M E N T
TARIF 2012 : QUATRE NUMÉROS PAR AN + 1 SUPPLÉMENT
VERSION PAPIERpour 1 an pour 3 ans
FRANCE ÉTRANGER FRANCE ÉTRANGER
Particuliers 68 � 87 �Institutions 97 � 107 � 255 � 286 �
VERSION PAPIER ET NUMÉRIQUE ENSEMBLE*pour 1 an pour 3 ans
FRANCE ÉTRANGER FRANCE ÉTRANGER
Particuliers 78 � 97 �Institutions consulter le portail numérique Cairn
Vous pouvez également commander les numéros sur notre site : www.editions-belin.comou consulter la version numérique sur le portail de revues en ligne : www.cairn.info
* L’abonnement numérique donne accès à tous les numéros de la revue depuis 2000 sur le portail CAIRN : www.cairn.info
58-4