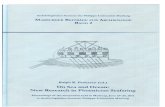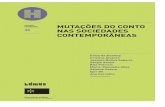“‘Pour clorre nostre conte’: la comptabilité de Montaigne”, Littérature, n° 82 (1991), p....
Transcript of “‘Pour clorre nostre conte’: la comptabilité de Montaigne”, Littérature, n° 82 (1991), p....
Armand Colin is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Littérature.
http://www.jstor.org
Armand Colin
« POUR CLORRE NOSTRE CONTE »: la comptabilité de Montaigne Author(s): Philippe Desan Source: Littérature, No. 82, SCIENCE ET LITTÉRATURE (MAI 1991), pp. 28-42Published by: Armand ColinStable URL: http://www.jstor.org/stable/41713176Accessed: 22-06-2015 07:57 UTC
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Philippe Desan, Université de Chicago
« POUR CLORRE
NOSTRE CONTE » :
la comptabilité
de Montaigne
LA COMPTABILITÉ À PARTIE DOUBLE
L'art de tenir des écritures connaît une véritable révolution à la Renaissance. En effet, c'est durant la seconde moitié du XVIe siècle qu'apparaissent en France deux manières nouvelles de tenir des livres, à savoir la comptabilité à partie double telle qu'elle est appliquée par les marchands de l'époque et l'essai tel que le définit et le pratique Montaigne. Nous voudrions montrer ici l'analogie qui existe entre ces deux formes d'écriture - comptable et littéraire - à la fin de la Renais- sance.
Là où, durant le Moyen Âge et le début de la Renaissance, les livres de comptes tenus par les marchands n'étaient que de
simples mémorandums, ou encore des journaux et mémorials chronologiques ouverts pour chaque foire ou chaque marchand avec qui on faisait commerce, à partir du milieu du XVIe siècle, la complexité croissante des échanges économi- ques entraîna une multiplication rapide de ces carnets et journaux. Témoin cet auteur comptable qui note en 1567 la difficulté de « souder » des comptes et le temps « prolixe et penible » que les marchands passent à « courir un débiteur ou créditeur en dix ou douze carnets » 1. Devant le volume des transactions, le marchand est bientôt incapable de constituer une image précise de sa situation financière à un moment donné. L'idée d'un compte courant est pratiquement incon- nue en France avant 1550. Face au nombre toujours plus
1. Pierre de Savonne, Instruction et maniere de tenir livres de compte par parties doubles, soit en compagnie ou en particulier, Lyon, Jean de Tournes, 1581, p. 16.
28
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Peinture et littérature
grand de journaux, de carnets et de mémorials, et le chevau- chement compliqué des écritures qu'implique un tel système comptable, le marchand se perd souvent dans ses comptes. L'établissement d'un bilan correct est devenu une tâche
impossible, et, s'il veut contrôler ses opérations en vue d'un
profit, le marchand doit alors inévitablement limiter son activité économique à un nombre restreint de foires et d'individus.
Comme on l'imagine, cette spécialisation « forcée » des
opérations commerciales ne répond plus à la nécessité de diversification des marchés et d'accroissement des échanges. Afin de pallier au problème technique de la tenue de ses
comptes, le marchand développe alors un système comptable dit à partie double lui permettant de générer à chaque instant un bilan à jour de sa position monétaire, cela sur une seule et même page. Crédits et débits s'inscrivent désormais sur le même livre selon une forme diptyque : à gauche les débours, à droite les recettes. Mais la comptabilité à partie double
engendre aussi des répercussions d'un ordre différent. En effet, bien plus que l'introduction d'une technique nouvelle, la tenue des livres de comptes à partie double provoque des
implications épistémologiques et idéologiques profondes. La complexité accrue du monde et des rapports humains,
comme la complexité des opérations marchandes, contraint à
repenser la mise en compte des interactions (aussi bien matériel- les que mentales) et modifie à jamais leur écriture. Il s'agit d'interpréter la connaissance, quelle qu'elle soit, à partir d'une
position fixe et à l'aide d'un dénominateur commun. Si les
journaux tenus par les marchands étaient toujours créés par rapport à des lieux ou des comptes individuels (selon un modèle binaire : X à la foire de Y, ou X vendant et achetant au marchand Z), le livre de comptes à partie double possède pour centre le marchand lui-même. Celui qui tient le registre occupe une place privilégiée ; tout échange, toute interaction, se rapporte désormais à lui et modifie son bilan.
C'est peut-être pourquoi, à la Renaissance, le livre de
comptes est synonyme de livre de Raison. Ainsi, le plus ancien livre de comptes italien s'intitule libro delle ragioni (1211). Dans la préface de son Instruction et maniere de tenir livre de compte par parties doubles, publié à Anvers chez Plantin, en 1567, Pierre de Savonne propose une analogie entre livre de comptes et livre de Raison : « tu ne laisseras d'y treuver tout ce qui est
29
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
necessaire pour bien dresser escritures et livres de raison » 2. Le livre de raison est aussi un livre de comptes car l'homme devient le produit de son travail, son activité commerciale et marchande détermine son existence. Ainsi, le livre de comptes, comme le livre de Raison, est souvent l'unique trace écrite d'une vie : « après ton deces tes enfans et héritiers seront grandement soulagés de trouvez tes livres ainsi bien ordonnés, pour les monstrer à tes débiteurs et créditeurs » 3. Un seul livre suffit à regrouper toutes les activités humaines. En ce sens, l'apparition de l'individualisme bourgeois est aussi visible dans la réorganisation comptable qui prend place au XVIe siècle. Le marchand conçoit l'idée d'un « grand livre » ou d'un registre sur lequel il devient possible de reporter toutes ses opérations commerciales, sans exception.
C'est en Italie, et plus précisément à Venise, que la méthode à partie double fut d'abord adoptée et que créances et dettes furent reportées sur la même page. Le moine franciscain Luca Paciolo publie en 1494 le premier traité de comptabilité où est exposé ce système. Benedetto Cotrugli, dans son traité Della mercatura et del mercante perfetto , publié en 1573 mais écrit en 1458, consacre aussi un court chapitre à la méthode à partie double. Cette méthode fut diffusée en France grâce à Jean Ympyn, mercier anverrois, qui publia en 1543 une Nouvelle Instruction et Demonstration de la très excellente Science du Livre de compte, pour compter et mener compte % à la manière ď Italie , et à Pierre de Savonne, également marchand, auteur d'une Instruction et maniere de tenir livre de compte par parties doubles 4. Devant le succès de ce dernier ouvrage, l'imprimeur lyonnais Jean de Tournes donna une nouvelle édition augmentée en 1581.
Dans sa préface de 1581 dédiée à Claude Pigeon, marchand bourgeois de la ville de Lyon, Pierre de Savonne affirme que cette technique est déjà courante parmi les marchands des grandes cités. Il argue que l'échange n'est plus fondé sur des transactions isolées (selon le modèle du troc), mais représente un processus continuel. La valeur d'échange est en train de
2. Ibid., p. 6. 3. Ibid. 4. Pour une histoire de ces traités et de la méthode comptable à partie double, nous
renvoyons à l'étude de Raymond de Roover, « Aux origines d'une technique intellectuelle : la formation et l'expansion de la comptabilité à partie double », Annales d'histoire économique et sociale, vol. 9, 1937, pp. 171-193 ; et vol. 10, 1938, pp. 270-298. Voir aussi Albert Dupont, La Partie double avant Paciolo. Les origines et le développement de la méthode , Paris, 1926.
30
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Peinture et littérature
prendre le dessus sur la valeur d'usage : une révolution nécessaire à l'envolée du capitalisme marchand. Puisque l'échange fait partie intégrante de toute activité humaine et commerciale, Savonne recommande de garder le livre de
comptes ouvert . C'est là un pas important vers ce que nous
appelons aujourd'hui le compte courant. Avant l'apparition de cette technique, un espace était calculé pour « clorre » ou « souder » l'écriture d'une opération marchande. La tenue des livres à partie double et l'apparition du compte courant ne rend
plus nécessaire cette pratique. Les nombreux carnets sont bientôt remplacés par un seul grand livre sur lequel il suffit de
reporter crédits et débits. L'idée de digression - le passage d'une valeur à une autre
ou d'un compte individuel à un autre - tend à disparaître puisque l'on privilégie maintenant la situation comptable du
sujet à qui appartient le grand livre. De plus, la consultation du grand livre devient fondamentalement intertextuelle car le marchand a désormais besoin de se reporter en arrière et de se
déplacer à plusieurs endroits de son registre pour suivre l'évolution d'un compte. La comptabilité à partie double entraîne donc une lecture selon un nouvel ordre, non plus analogique mais comparatif. Comme on l'a dit, le développe- ment de cette technique eut pour effet de « substituer un
système cohérent de comptes aux multiples livres analytiques, et de remplacer par une balance les inventaires et états
récapitulatifs » 5. Cette restructuration de l'écriture comptable débouche sur une appréhension centralisante de la connais- sance et du monde.
Le grand livre dont parlent les auteurs comptables de la Renaissance est un livre qui (1) se rapporte au sujet, (2) regroupe tous les comptes - aussi bien impersonnels (comptes de valeurs) que personnels - de façon systémati- que, (3) enregistre les dépenses et les recettes sur une même
page, (4) préconise la conversion de toute opération en une seule unité monétaire afin de permettre une commune mesure, (5) reste ouvert en permanence. Pierre de Savonne est
explicite sur ce dernier point : « je suis d'advis, et vaut mieux, que les comptes demeurent plustost ouverts dans le grand livre, que non pas de les porter de carnet en carnet, comme dit est, ny de les laisser mourir sur un carnet qui ne peut estre que
5. Raymond de Roo ver, op. cit., p. 193.
31
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
LE GRAND LIVRE DE MONTAIGNE
de quarante ou cinquante feuillets, plus ou moins, qui n'a pas tant d'autorité d'estre creu comme un grand livre » 6.
Quand on étudie les différentes composantes qui forment la base de la comptabilité à partie double, on s'aperçoit que Montaigne conçoit l'écriture de ses Essais de façon semblable. Son activité littéraire est également une activité commerciale. Il n'est plus nécessaire de démontrer comment Montaigne multiplie ses « commerces » en fonction de ses lectures. Le langage économique des Essais est sur ce point révélateur 7.
Chaque nouvelle interaction modifie un compte ouvert. Nous pourrions ainsi lire les différents chapitres des Essais comme de véritables comptes sur lesquels Montaigne revient en fonction de ses nouveaux échanges. Devant le nombre sans cesse croissant de ses commerces, Montaigne a, lui aussi, besoin de développer un système comptable qui répond à la forme complexe de l'essai.
La méthode comptable à partie double ne s'adresse pas seulement au marchand, elle a aussi pour but de diriger la pensée selon une logique quantitative. Parce que les commer- ces de Montaigne ne sont pas limités à un seul échange mais reflètent une succession d'opérations, chaque lecture des anciens entraîne une situation active ou passive qu'il faut ensuite comptabiliser. De plus, contrairement à la tendance qui faisait jadis accepter ou rejeter en bloc l'autorité d'un texte, et grâce à la pesée 8, Montaigne fait d'un même auteur tantôt un créancier, tantôt un débiteur. A partir du distingo comptable inhérent à l'essai, l'auteur des Essais entrevoit le besoin d'une comptabilité à partie double. Alors que dans la méthode comptable à partie simple seules certaines opérations sont comptabilisées, la méthode à partie double a pour but de donner une situation complète. Toute nouvelle opération modifie la position comptable du sujet et doit pour cette raison être indistinctement enregistrée.
6. Pierre de Savonne, op. cit., p. 16. 7. Sur le discours économique dans les Essais, nous renvoyons à nos études :
« L"invention' du discours économique : éléments pour une économie politique des Essais », dans Claude-Gilbert Dubois, ed., L'Invention au XV f siècle, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1987, pp. 153-181 ; « Quand le discours social passe par le discours économique : les Essais de Montaigne », Sociocriticism, vol. 4, n° 1 (1988), pp. 59-86 ; « Le discours économique dans le troisième livre des Essais », Romance Languages Annual, vol. 1 (1989), pp. 244-250 ; « La richesse des mots : mercantilisme linguistique à la Renaissance », Stanford French Review, à paraître.
8. Voir Floyd Gray, La Balance de Montaigne : Exagium fessai, Paris, A. -G. Nizet, 1982.
32
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Peinture et littérature
Raconter et comptabiliser deviennent une seule et même
opération. Il est symptomatique que, dans les Essais, « conte » et « compte » se confondent. Il serait dès lors possible de considérer les Essais comme le grand livre du moi, sujet à toutes sortes d'échanges et sans cesse en commerce, une sorte de compte courant laissé à la postérité afin d'évaluer l'homme. Les chapitres représenteraient dans ce cas une série de carnets relatifs à des opérations commerciales ponctuelles, chaque nouvelle interaction remettant en circulation le chapitre. Ainsi, les carnets-chapitres s'organisent souvent autour d'un lieu commun sur lequel Montaigne revient lors d'un nouvel
échange. Dans « De l'art de conferer », Montaigne résume assez bien
son attitude devant l'échange et le commerce des hommes. Le commerce est pour lui tantôt créditeur, tantôt débiteur, car « n'est pas marchand qui tousjours gaigne » (III, 8, 938 B) 9. Il s'agit pourtant d'accepter ces pertes et de les enregistrer au même titre que les gains. La comptabilité à partie double, comme l'essai, n'est possible qu'à partir du moment où l'on consent à comptabiliser toutes les opérations, sans rature et sans en évacuer aucune. Ainsi, Montaigne accepte les varia- tions comptables que produisent ses commerces ; la balance fluctue en fonction de chaque nouvelle opération et chaque entrée sur le grand livre modifie inéluctablement le bilan du moi qu'il faut toujours calculer de nouveau : « Pour moy, je ne juge la valeur d'autre besongne plus obscurément que de la mienne : et loge les Essais tantost bas, tantost haut, fort inconstamment et doubteusement » (III, 8, 939 B). Il n'y a
plus de transactions isolées, chaque « allongeait » transforme la situation comptable du sujet. Tout chapitre doit alors être lu comme un compte courant où crédits et débits apparaissent sur la même page - sur deux colonnes dans le cas des livres de comptes, de façon entremêlée dans le cas des Essais.
Là où Cotrugli conseillait de tenir trois livres, « le Cayer, le
Journal, et le Memorial » 10, Louis Mayerne, dans son Traicté des negoces et trafiques (1599), propose de regrouper le cahier
(carnet) et le mémorial sur un même « papier journal » : « chacun tienne un simple papier Journal, pour soustenement
9- Nous citons Montaigne dans l'édition Villey-Saulnier, Paris, Presses Universitaires de France, 1965. Nous indiquons dans le texte les numéros de livre, chapitre, page, ainsi que la couche du texte (A : 1580, B : 1588, C : 1595) entre parenthèses.
10. Benedetto Cotrugli, Traicté de la marchandise , et du parfaict marcband, traduit de 1 italien par Jean Boyron, Lyon, François Didier, 1582, p. 71.
33
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
et preuve de toutes autres escritures et comptes » 11 . Mais il s'empresse d'ajouter que « lesdittes parties fussent extraictes, et rapportées dudict Journal au grand livre » 12 . Les papiers journaux sont des notes relatives aux ventes et aux achats. Sorte d'aide-mémoire, l'emploi du « papier journal » est courant parmi les marchands et son usage est recommandé dans tous les livres traitant du commerce et de la comptabilité à cette époque. C'est aussi un terme employé par Montaigne pour désigner une forme courte qui n'est pourtant plus nécessaire grâce au progrès comptable de l'essai. Montaigne nous raconte comment son père tenait un livre de raison en y recopiant des papiers journaux : « En la police œconomique mon pere avoit cet ordre, que je sçay loüer, mais nullement ensuivre. C'est qu'outre le registre des negoces du mesnage où se logent les menus comptes, payements, marchés, qui ne requierent la main du notaire, lequel registre un receveur a en charge, il ordonnoit à celuy de ses gens qui lui servoit à escrire, un papier journal à inserer toutes les souvenances de quelque remarque, et jour par jour les mémoires de l'histoire de sa maison, tres-plaisante à veoir quand le temps commence à en effacer la souvenance » (I, 35, 223-224 C). Montaigne se juge sot d'avoir failli à cette pratique du livre de raison ; pourtant, à plusieurs reprises, il déclare tenir lui aussi un registre de sa vie (II, 12, 467 ; II, 18, 665 ; III, 7, 918), mais un registre où les carnets et papiers journaux ne sont plus nécessaires puisque son grand livre lui permet d'insérer directement les débits et crédits de ses notes de lecture et de ses expériences.
L'essai ne peut rendre compte que d'opérations tangibles dont il reste une trace. Ainsi, si Montaigne ne dit presque rien de son éducation, même de façon négative, c'est bien parce que cette période de sa vie n'a provoqué aucun commerce, « sans aucun fruit que je peusse à present mettre en compte » (I, 26, 175 A). A plusieurs reprises l'auteur des Essais s'in- terroge sur ce qu'il faut enregistrer sur son grand livre : « Mettray-je en compte cette faculté de mon enfance ? » (I, 26, 176 B). La pratique de l'essai est comparable à une mise en compte des lectures et expériences de notre auteur. Il s'agit d'évaluer, grâce au jugement, ces expériences et de les
11. Louis Mayerne, Traicté des negoces et trafiques, Paris, Jaques Chovet, 1599, p. 68. 12. Ibid., p. 69.
34
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
LA MÉMOIRE
Peinture et littérature
reporter sur le grand livre tantôt comme créance, tantôt comme dette.
La fin d'un chapitre tient souvent lieu de bilan provisoire. Ainsi, « De l'institution des enfans » se termine par la clôture du compte : « Pour revenir à mon propos ». Mais puisqu'un compte est toujours courant, même la clôture n'exclut jamais la reprise de ce compte. Nombreux sont les exemples de ce
procédé de la soudure provisoire dans l'œuvre de Montaigne. Les bilans temporaires annoncés par les expressions « retombons à nos coches », « revenons à notre propos », servent unique- ment de repères comptables. Les énoncés de ce genre annon- cent le moment de la balance où il faut « souder » un compte afin d'en extraire un « acquest » ou une « perte ».
Le développement des comptes selon une méthode rigou- reuse sert aussi à se garantir contre les défaillances de la mémoire. Dans un chapitre consacré à « l'ordre de tenir les escritures en fait de Marchandise », Cotrugli aborde les
problèmes liés à une mauvaise mémoire : « Et ne doit le marchant en ses affaires s'arrester en sa memoire » 13. Seules les écritures « conservent et retiennent en memoire les choses traitees » 14. Ainsi, la mémoire du marchand sera son grand livre, la seule trace de son activité, tout comme les Essais seront la mémoire de Montaigne. On connaît à ce sujet les célèbres déclarations de Montaigne où il se plaint de la « trahison de [s] a mémoire » et du fait que, « a faute de memoire naturelle [il] en forge de papier » (III, 13, 1092 C).
Le registre de Montaigne est pourtant différent, il ne se limite pas aux actions mais touche aussi à ce que l'auteur
appelle ses « fantasies » : « Je ne puis tenir registre de ma vie
par mes actions : fortune les met trop bas ; je le tiens par mes fantasies » (III, 9, 945-946 B). Encore plus éphémères dans la mémoire que les actions, les pensées nécessitent une écriture immédiate. Montaigne explique ailleurs la raison qui le pousse à créer un nouveau compte : « Je veux icy enregistrer certains traicts particuliers et rares, sur le faict de ses guerres, qui me sont demeurez en memoire » (II, 34, 736 A). La mémoire est trompeuse, c'est pour cela qu'il faut « enregistrer » les commerces le plus vite possible. On s'expose sinon à compta- biliser plusieurs fois la même opération. Montaigne est tout à
13. Benedetto Cotrugli, op. cit., p. 70. 14. Ibid., p. 70.
35
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
UNE « PAREILLE MESURE »
L'ENREGISTREMENT DES « MESCONTES »
fait conscient de ce risque : « Encores en ces ravasseries icy crains-je la trahison de ma memoire, que par inadvertance elle m'aye faict enregistrer une chose deux fois » (III, 9, 962 B).
Tenir un livre de comptes à partie double implique une nécessité importante : réduire toutes les monnaies d'échange à une commune mesure. Une unité monétaire et une unité de jugement doivent ainsi être mises en place. En effet, les carnets ouverts pour un seul marché ou un seul individu exprimaient soit la monnaie du lieu de l'échange, soit la monnaie d'un marchand qui venait souvent d'une autre région ou d'un autre pays. La diversité des monnaies à la Renaissance engendra rapidement une anarchie monétaire. Les problèmes de conversion d'un carnet à l'autre ne permet- taient pas au marchand de savoir où il en était financièrement. Pourtant, le regroupement des carnets et mémorials en un seul livre força les marchands à convertir leurs opérations en une seule monnaie comptable.
On a déjà démontré l'importance de la balance chez Montaigne et le besoin de tout rapporter à un dénominateur commun, quelle que soit la complexité de l'échange. Comme le note Montaigne, « quelque langue que parlent mes livres, je leur parle en la mienne » (II, 10, 418 A). Dans les Essais, le langage commun sert de monnaie de compte. Si les mots sont bien des pièces de monnaie, Montaigne élabore un système d'équivalence qui lui permet la comparaison entre les diffé- rentes monnaies, les différents textes. Cet effet de nivellement du langage est nécessaire à la création d'un compte courant. Devant la multitude des monnaies qui ont cours, et devant le nombre croissant d'ouvrages en circulation, le sujet se doit de convertir toutes ses opérations - économiques et littéraires - en une monnaie commune. Grâce à cette « pareille mesu- re », le marchand comme l'essayiste est à même d'avoir devant lui une situation complète. Le fait que les opérations compta- bles soient indistinctement enregistrées n'est dès lors plus un problème.
Si la méthode comptable à partie simple ne transcrit que certaines opérations liées à un seul individu ou à une seule marchandise, la méthode à partie double se veut exhaustive. Il n'est plus nécessaire de classer les entrées de façon alphabéti- que. A première vue le lecteur a le sentiment d'une écriture
36
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
« DES NOMS »
Peinture et littérature
digressive, mais cette impression disparaît rapidement si l'on
envisage un système de renvois et de sous-comptes. L'essai fonctionne d'une façon analogue. L'idée même de topos n'est
plus nécessaire, ou du moins elle n'est plus que le prétexte à un premier échange. La latitude offerte au sein d'un compte (chapitre) s'accentue à partir du moment où le sujet conçoit chaque opération comme complémentaire d'un projet plus large. C'est le commerce en tant qu'activité essentielle, et non
pas une série de commerces ponctuels, qui est privilégié dans le grand livre des Essais.
« Ennemy juré de toute falsification » (I, 40, 252 C), Montaigne enregistre de façon systématique aussi bien les avoirs que les passifs. Il regrette par exemple que, de son
temps, « personne ne tient registre de leurs mescontes » (I, 11, 43 C). Il remarque encore comment « le reçeu ne se met plus en compte » (III, 6, 904 B). Les plus petites opérations, comme les plus grandes, doivent faire l'objet d'un libellé dans le grand livre. Cette méthode indiscriminée, Montaigne la réaffirme sans cesse : « Je manie les chartes pour les doubles et tien compte, comme pour les doubles doublons » (I, 23, 110-111 C). La critique comptable de Montaigne s'adresse à ceux qui n'inscrivent que les crédits dans leurs livres : « Les
pilleurs, les emprunteurs mettent en parade leurs bastiments, leurs achapts, non pas ce qu'ils tirent d'autruy. Vous ne voyez pas les espices d'un homme de parlement, vous voyez les alliances qu'il a gaignées et honneurs à ses enfants. Nul ne met en compte publique sa recette : chacun y met son acquest » (I, 26, 152 C). Montaigne ne corrige pas ses écritures, s'il veut obtenir un bilan complet et exact il doit enregistrer aussi bien les « acquests » que les « descharges ».
Le chapitre « Des noms » (I, 46) offre un des meilleurs
exemples de la comptabilité à partie double dans les Essais. Dans cet essai Montaigne recense « divers articles » relatifs à un même compte. D'abord un débit : « Chaque nation a
quelques noms qui se prennent, je ne sçay comment, en mauvaise part : et à nous Jehan, Guillaume, Benoit » (276 A). Vient ensuite une succession d'« Items » qui se placent tantôt dans la colonne des débits, tantôt dans la colonne des crédits.
Remarquons que cette façon de soumettre un nouvel exemple correspond à ce que l'on trouve dans les livres de comptes des marchands de l'époque. Le terme « Item » s'emploie en effet
37
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
principalement pour introduire un article de compte. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si les « articles » qu'annonce Montaigne dès le début de ce chapitre commencent presque tous par un « Item ». Chaque nouvelle entrée se réfère à un individu ou à un compte de valeurs et 1'« Item » marque la continuation d'une série de débits ou de crédits qui se rapportent tous à une première écriture, cela jusqu'à l'ouver- ture d'un autre compte.
Dans cette inscription initiale, Montaigne relève l'aspect négatif des noms. La généalogie des princes démontre par exemple la fatalité associée à certains noms. Il en va ainsi pour les Ptolémée en Egypte, les Henry en Angleterre, les Charles en France. Notons que ce second article, de par la grandeur des dynasties évoquées, crée aussi un avoir qui équilibre le débit précédent. L'écriture suivante raconte une anecdote où Henry, duc de Normandie, prit conscience du nombre extraordinaire de Guillaume à sa Cour lors d'un banquet. Cent dix chevaliers portaient le même nom, ceci « sans mettre en conte les simples gentils-hommes et serviteurs » (276 A). Une telle « ressemblance des noms » porte à confusion et fait alors l'objet d'un débours. La manipulation quantitative de ce compte ne fait que s'affirmer au fur et à mesure de la lecture du chapitre. C'est ici la quantité des opérations, plutôt que la qualité associée aux noms, qui intéresse Montaigne et lui permet de concevoir un ordre comptable.
Dans un ajout B, Montaigne commence un sous-compte qui se rattache à l'idée de banquet qu'il vient de développer. On voit ainsi l'ouverture d'une couche nouvelle afin d'entrer une opération effectuée à un autre moment. La pratique des additions textuelles s'explique parfaitement dans une logique comptable. La distribution des tables en fonction des noms fait l'objet d'une écriture supplémentaire qui, cette fois-ci, ne débute pas par un « Item », précisément parce qu'elle marque le début d'un compte interne. Cette manipulation de 1'« allongeail » nous révèle aussi le fonctionnement et l'avan- tage du compte courant.
Contrairement à l'opinion publique qui veut qu'il « faict bon avoir bon nom » (276 A), Montaigne enregistre quant à lui un débit : « J'ay veu le Roy Henry second ne pouvoir jamais nommer à droit un gentil-homme de ce quartier de Gascongne ; et, à une fille de la Royne, il fut luy mesme d'advis de donner le nom general de la race, parce que celuy
38
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
'Peinture et littérature
de la maison paternelle luy sembla trop revers » (277 A). Il renverse l'idée reçue d'une qualité intrinsèque aux noms et démontre comment ceux-ci peuvent parfois être « revers » et
engendrer un passif. Cette écriture sur la beauté et la sonorité des noms fait à nouveau l'objet d'un ajout dans la couche C : « Et Socrates estime digne de soing paternel de donner un beau nom aux enfans » (277 C). Cette dernière entrée vient contrebalancer le débit instauré par l'exemple précédent et rétablit le compte à une somme zéro.
L'« Item » suivant se divise encore une fois en un passif et un actif. Notre Dame de Poitiers doit sa fondation à un débauché qui logeait chez lui une « garce » du nom de Marie. Il se convertit à la religion chrétienne, chassa cette femme, et s'amenda de son péché durant le reste de sa vie. Devant ce miracle, on bâtit à l'endroit de cette maison l'église qui porte aujourd'hui le nom de cette femme. Ce revirement de situa- tion - le passage d'un doit à un avoir au sein d'une même anecdote - est typique de la façon de procéder de Montai-
gne. A chaque entrée, qu'elle soit positive ou négative, correspond obligatoirement une contrepartie comptable qui permet d'arrêter et de solder un compte dans le grand livre. Un ajout C reprend ce compte courant et fait intervenir un nouveau débit, cette foik c'est Pythagore qui subit le même travail comptable : « estant en compagnie de jeunes hommes, lesquels il sentit complotter, eschauffez de la feste, d'aller violer une maison pudique, commanda à la menestriere de
changer de ton, et, par une musique poisante, severe et
spondaïque, enchanta tout doucement leur ardeur, et l'endor- mit » (277 C). La balance vérifie la rectitude de l'écriture
comptable. Montaigne s'interroge ensuite sur la mode qui, à son
époque, conduit à remplacer les anciens noms de baptême tels que Charles, Louis et François pour peupler le monde de Mathusalem, Ezechiel, Malachie et autres noms « beaucoup mieux sentans de la foy » (277 A). Devant cette dévaluation des anciens noms, Montaigne invoque « un gentil'homme mien voisin, estimant les commoditez du vieux temps au pris du nostre, n'oublioit pas de mettre en conte la fierté et
magnificence des noms de la noblesse de ce temps, Don Grumedan, Quedragan, Agesilan » (277 A). L'entrée initiale débitrice fait ainsi place à un rétablissement créditeur qui permet de balancer le compte.
39
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
LES « ESSAIS » COMME LIVRE DE COMPTES À
PARTIE DOUBLE
Le chapitre progresse par une succession d'« Items » entre- mêlés de sous-comptes relatifs à une valeur ou à un individu. Le chapitre « Des noms » se lit ainsi comme un compte courant, lui-même partie intégrante du grand livre que sont les Essais . Après avoir recensé tous ses commerces sur le
compte des noms, Montaigne dresse un bilan. Le moment est venu de liquider le compte « noms ». Dans ce cas précis la clôture du compte représente une perte : « Pour clorre nostre conte, c'est un vilain usage, et de tresmauvaise consequence en nostre France, d'appeller chacun par le nom de sa terre et Seigneurie, et la chose du monde qui faict plus mesler et mesconnoistre les races » (278 A). Mais le solde de ce compte n'est que provisoire, ce n'est qu'un relevé récapitulatif. Le chapitre se poursuit car l'activité échangiste et marchande du moi n'en permet pas une fermeture définitive. Tant que le commerce du moi se poursuit, le grand livre reçoit imman- quablement de nouvelles écritures. Toute clôture d'un compte n'est qu'un inventaire périodique du moi.
Quel intérêt représente la lecture d'un ouvrage tel que les Essais ? Montaigne se pose la même question : « Ay-je perdu mon temps de m'estre rendu compte de moy si continuellement, si curieusement ? » (II, 18, 665 C). La célèbre consubstantia- lité entre l'auteur et le livre renvoie à l'activité humaine qui est au centre des Essais : les commerces - c'est-à-dire leur trace en tant qu'écriture comptable. C'est en effet l'homme au travail que le lecteur découvre au travers des crédits et débits transcrits dans le grand livre. Considérant la fonction de miroir du livre de comptes, Pierre de Savonne proposait une lecture didactique : « Et à l'adventure pourra il servir de quelque chose à autres que marchands, et ne sera point desaggreable aux doctes et entiers personnages, qui desirent juger grandement des différents et controverses des hommes » 15. Ce passage est remarquable car il s'applique aussi à Montaigne pour qui le jugement est effectivement la qualité essentielle qui permet de se livrer au commerce des hommes, des femmes, et des livres. Le jugement affecte les opérations comptables et forme la pierre angulaire du travail de l'essai.
15. Pierre de Savonne, op. cit., p. 6.
40
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Peinture et littérature
Les opérations marchandes nous apprennent plus sur la société et les interactions humaines qu'un livre de raison ; ainsi, comme le remarque Savonne, « par cette instruction ils
[les doctes] pourront plus entendre des affaires des marchands en une heure, qu'ils ne sçauroyent, par maniere de dire, en dix ans en feuilletant les livres de raison, lesquels ils sçavent faire
foy en jugement » 16 . C'est le jugement au travail qui se dévoile dans le livre de comptes, c'est là que se dévoile l'homme dans son quotidien. Si les historiens ont relevé
l'importance d'un ouvrage tel que le Journal de Gilles de Gouberville, c'est précisément parce qu'il permet de voir vivre au jour le jour un homme pour qui, comme on l'a dit, «l'information 'compte' est l'armature du Journal»17. Ne
pourrait-on pas aussi avancer que l'activité comptable de
Montaigne est devenue partie intégrante de son moi ? Au bout du compte Montaigne se retrouve devant un livre
très différent : « En fin, toute cette fricassée que je barbouille
icy n'est qu'un registre des essais de ma vie » (III, 13, 1079 B). Cette série de comptes, ce registre de commerces, c'est l'homme dans sa condition, une vie réglée d'après des
échanges dont il laisse la trace : « J'ay assez vescu, pour mettre en compte l'usage qui m'a conduict si loing. Pour qui en voudra
gouster, j'en ay faict l'essay, son eschançon » (III, 13, 1080 B). On pourrait certes s'interroger sur l'utilité de ce registre comptable. La lecture d'un livre de comptes n'est en fait
jamais passionnante, à moins que ce livre serve de modèle
pour tenir d'autres livres de comptes. Pierre de Savonne
justifie la publication de son traité en montrant l'utilité
pratique des exemples qu'il propose au marchand. C'est comme exercice pratique que la lecture d'un livre de comptes est profitable. Nul ne saurait en retirer un savoir précis, seulement une méthode, une « forme nouvelle » (II, 12, 574 B) qui « par long usage... est passée en substance » (III, 10, 1011 B). L'auteur des Essais accepte pleinement cette fonction didactique de son grand livre : « qui voudra esplu- cher un peu ingénieusement, en produira infinis Essais » (I, 40, 251 C).
Montaigne enregistre scrupuleusement toutes les activités commerciales du moi et dresse bilan sur bilan. Mais le papier
16. Ibid. 17. Madeleine Foisil, Le Sire de Gouberville : un gentilhomme normand au XVf siècle, Paris,
Flammarion, 1981, p. 17.
41
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
fait bientôt défaut car les comptes n'en finissent pas. Que faire une fois qu'un livre est rempli ? Faut-il ouvrir un autre livre sous un titre différent ? Savonne s'oppose à ce procédé et conseille tout simplement d'agrandir « physiquement » le grand livre en y ajoutant des feuillets : « il n'est besoing de faire livre nouveau, ains ad j ouster du papier à la fin du vieux, et l'aggrandir d'autant, comme aucuns font, qui pour n'avoir ceste peine de souder, l'aggrandissent comme dit est, et le font durer jusques à la fin de la compagnie » 18. Montaigne continue lui aussi le même livre, il l'augmente mais conserve le même titre. Il poursuit sa comptabilité à partie double « autant qu'il y aura d'ancre et de papier au monde » (III, 9, 945 B). La clôture du livre de comptes ne peut intervenir que lorsque l'activité commerciale de l'auteur touche à sa fin. La mort marque le bilan définitif du livre de comptes que représente les Essais . Aux générations futures d'en faire l'inventaire et d'y trouver leur compte.
18. Pierre de Savonne, op. cit., p. 19.
42
This content downloaded from 82.229.188.102 on Mon, 22 Jun 2015 07:57:02 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions