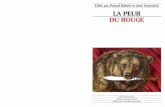Ramadhan et alimentation, le cas des femmes diabétiques d’Oran,
P�dagogie et Rh�torique Ramistes: Le Cas Fouquelin
Transcript of P�dagogie et Rh�torique Ramistes: Le Cas Fouquelin
Pédagogie et Rhétorique Ramistes: Le Cas FouquelinAuthor(s): Kees MeerhoffSource: Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, Vol. 5, No. 4 (Autumn 1987), pp.419-429Published by: University of California Press on behalf of the International Society for theHistory of RhetoricStable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/rh.1987.5.4.419Accessed: 06-08-2017 20:36 UTC
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
http://about.jstor.org/terms
International Society for the History of Rhetoric, University of California Press arecollaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Rhetorica: A Journal ofthe History of Rhetoric
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
KEES JVIEERHOEF
Pedagogie et Rhetorique Ramistes: Le Cas Fouquelin
a dialectique et la rhetorique se presentent comme les deux cles de voiite de I'edffice conceptuel ramiste. Ceci n'est plus a demontrer. Dans I'optique du Ramisme, en
effet, les connaissances doivent etre structurees d'apres les regies fourrues par la dialectique; eUes doivent etre egalement utiles dans la realite concrete, se transformer en arguments brillants et per-suasUs face a des habitudes mentales, a des prejuges souvent secu-lahes: ce sera le role de la rhetorique.
Afin de pouvoh fonctionner de la sorte, les connaissances doivent passer par un 'relais' d'une importance vitale, I'enseignement. C'est la qu'eUes seront mises a I'epreuve, c'est-a-dire soumises au debat, testees en fonction de leur utUite. L'ecole, congue a I'image de I'Academie platonicienne, est le haut lieu de la sagesse et de I'eloquence.' Car le maitre qui enseigne certaines matieres a ses ele-
'L'association de la sagesse et de I'eloquence remonte, bien entendu, a I'An-hquite. EUe a ete affirmee avec force par Ciceron et, a sa suite, par Quintilien. En la prenant a leur compte, les Ramistes se montrent, ici comme aUleurs, les adeptes a peu pr^s inconditionnels de I'authentique doctrine ciceronienne. lis sont particulierement attaches aux dialogues 'ornes' De Oratore, et au texte dru des Partitiones Oratoriae. Voir notamment Cic. Part. Or 23, 78-79, ou dialectique et rhetorique sont appelees 'quasi ministrae comitesque sapientiae', servantes et compagnes
© The International Society for the History of Rhetoric Rhetorica, Volume V, Number 4 (Autumn 1987)
419 This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
420 R H E T O R I C A
ves se trouve, aux yeux des Ramistes, dans une situation comparable a celle du debat deliberatif; a chaque instant, U doit etre capable de prouver que les matieres qu'il enseigne sont vraies et (done) utiles, U doit persuader ses eleves du bien-fonde de son en-seignement. Sans cette procedure exemplaire, comment ceux-ci pourraient-Us combattre a leur tour les prejuges, plaider la cause de la verite devant I'inertie generale, faire resplendir ce \6yo<; platonicien dans lequel raison et discours, sagesse et eloquence coincident, balayant faux savoir et affirmations creuses? L'ecole prelude ainsi aux combats a venir, elle simule en quelque sorte les luttes intellectuelles et oratoires dans lesquelles chaque eleve s'engagera par la suite.^
En bref, pour les Ramistes, I'enseignement est le contraire du 'bourrage de crane'; aussi affirment-ils bien haut avoir en horreur ces eleves 'soumis comme des esclaves a un maitre morose'.^ Leur eleve ideal, c'est un etre a I'esprit independant, disposant de toutes
de la sagesse. Dans le meme passage, Ciceron dit: 'NihU (enim) est aliud eloquentia, nisi copiose loquens sapientia'. Les remarques de I'eminent commentateur hu-maniste, Jacques-Louis d'Estrebay, sur ce passage sont singulierement eclairantes. II souligne le role primordial de la dialectique et de la rhetorique par rapport aux autres sciences: ' . nee unum quid proprium spectant, sed omnium sunt communes artium'. D'Estrebay renvoie ensuite a Cic. De Oral. Ill, 14,55-18,65 et a Quint. Inst. Or. II, cap. 21. Nous citons d'apres M.T. Ciceronis De partitione oratoria dialogus, l.L. Strebaei commentariis, & B. Latomi enarrationibus illustratus, Paris, J. Roigny, 1543, pjgvo j g premiere ed. du commentaire de D'Estrebay date de 1536). Sur ce commentateur, voir notre etude Rhdorique d podique au XVIe siecle en France, Leyde, E. J. BrUl, 1986, pp. 49-64, 349-358.
'Des 1547, Omer Talon ecrit a propos des efforts pedagogiques faits par lui-meme et par son 'frere' La Ramee: '. . . commune utriusque nostrum studium, & institutum fuit, ut veterem in erudienda juventute disciplinam jampridem ob-soletam revocaremus, ut conjunctis eloquentiae & sapientiae studUs, juventus dis-ceret de,rebus propositis non solum subtUiter & acute sentire, sed graviter & ornate dicere, & artium subtUitatem eatenus probare, quoad usus popolaris, & humanae prudentiae ratio postularet.': Academia, dans Talon et Ramus, Colledaneae praefationes, epistolae, orationes, Paris, Denys Duval, 1577 (rdmpr. Geneve, 1971), p. 107.
Voir egalement le plaidoyer de Ramus pour l'ecole publique, contre I'enseignement prive par un precepteur, dans le Ciceronianus, Paris, A. Wechel, 1557, pp. 47-48 ('. . . Nee verb deceat eum, quem in sole & acie versari volumus, in solitudine & tenebris educare . . concertatio etiam & aemulatio, & ipsa . . plurimdm proderit.').
'Talon, ibid. (1577), p. 118. -On songe evidemment a certains passages de Montaigne, qui dit e.a. ceci: '(a) Je ne veux pas (que le gouverneur de I'enfant) invente et parle seul, je veux qu'il escoute son disciple parler a son tour, (c) Socrates et, depuis, ArchesUas faisoient premierement parler leurs disciples, et puis Us par-loient a eux. "Obest plerumque lis qui discere volunt auctoritas eorum qui docent." (Cic. De nat. dear., 1,5)': Essflis, I, 26, ed. Pleiade p. 149.
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
Pedagogie et Rhetorique Ramistes 421
les ressources de la dialectique et de la rhetorique, en emulation genereuse avec un maitre pret a remettre en question son savou.
Cette conception pedagogique aux accents etonnamment modernes s'enracine dans une prise de position phUosophique qu'on retrouve chez les predecesseurs spirituels des Ramistes, chez Laurent Valla et Rodolphe Agricola par exemple. CeUe-ci s'inspire avant tout de Ciceron et, a travers Ciceron, de Platon.
Ciceron, on le salt, a opte pour une demarche phUosophique qui s'accorde a merveiUe avec sa pratique oratohe: le libre debat in utramque partem lui permettant de cerner a propos de chaque question non pas la verite absolue et definitive, mais une verite toujours provisoire. A plusieurs reprises, Ciceron a rapproche la demarche sceptique de la Nouvelle Academic et la procedure de I'orateur ideal (qu'il se flattait d'incarner, ou peu s'en faut). Ainsi, U affirme au debut de V Orator qu'U doit ses capacites oratoires non pas aux rhetoriciens, mais aux philosophes de I'Academie ('non ex rhetorum officinis, sed ex Academiae spatUs').* Inversement, au commencement du traite Defato U pretend se servir de la methode oratoire dans ses recherches philosophiques.^ Bref, c'est tout I'ideal ciceronien d'une union de I'eloquence et de la philosophie -sceptique, en I'occurrence- que nous retrouvons ici, ideal qui a eu une influence decisive sur les grands penseurs de la Renaissance."
De la reflexion ciceronienne, les Ramistes retiennent non seulement la necessite d'unir I'eloquence a la phUosophie', mais egale-
•"Cic. Or. 3,12. Ramus cite et developpe ce passage dans le Ciceronianus. Voir ibid. (1557), p. 69, ou U conclut: 'Quamobrem ad imitationem Ciceronis, eam phi-losophiam Ciceronianus sequatur, unde & animi constantiam, & bene dicendi peritiam consequatur'; p. 67: 'Academicos oratoris germanissimos invenies'. Cf. Ch.B. Schmitt, Cicero Scepticus. A Study of the Influence of the 'Academica' in the Renaissance, La Haye, 1972, pp. 79-81-l-n.8. Ajoutons que Ch. Schmitt cherche a etablir un contraste, selon nous Ulusoire, entre 1'attitude de La Ramee et celle de Talon a regard du scepticisme ciceronien. Voir ibid. (1972), pp. 81,94. Cf. infra, note 12.
'Cic. Defato 3, cite dans I'excellent article de Lisa Jardine, 'Lorenzo Valla: Academic Skepticism and the New Humanist Dialectic', in M. Burnyeat (ed.). The Skeptical Tradition, Berkeley, Los Angeles, Londres, 1983, p. 262.
'Voir, outre L. Jardine (1983) et Ch. B. Schmitt (1972), R. Radouant, 'L'union de I'eloquence et de la phUosophie au temps de Ramus', in Revue d'hist. litt. de la France 31 (1924), pp. 161-192, et H. H. Gray, 'Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence', in Rermissance Essays, eds. P. O. Kristeller et Ph.P. Wiener, New York, Evanston, 1968, pp. 199-216.
'Ramus a prononc^ ^ Paris, en 1546, un discours de studiis philasophiae et eloquentiae coniungendis. Ramus et Talon insistent frequemment sur cette meme id^e dans les prefaces a leurs ouvrages recueUlies dans les Collect. (1577).
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
422 R H E T O R I C A
ment I'idee de la libertas philosophandi qui leur confere la liberie, et meme le devoir, d'approcher chaque auteur ancien ou moderne avec un esprit critique. D'oii leur combat, affirme a maintes reprises, contre les idees regues, contre I'autorite. En 1547, Omer Talon public un ouvrage au litre eloquent, YAcademia. II y prend a son compte les reflexions 'contestataires' de Ciceron, et presente son ami La Ramee comme victime des Aristoteliciens qui se sentent menaces dans leurs certitudes. II va meme plus loin en interpretant le scepticisme ciceronien dans le sens d'un eclectisme resolu qui n'est pas sans rappeler la demarche imitative preconisee par les poetes contemporains, et formulee de fagon exemplaire dans I'image frequemment evoquee des abeilles allant d'une fleur a I'autre pour en tirer le miel:" "S'il y a quelque chose dans les ecrits de Platon qui me convient et m'est utile, je I'accepte; s'U y a quelque chose de bon dans les jardins d'Epicure, je ne le deteste pas; si Aristote vend quelque chose de meUleur, je I'accepte; si les marchandises de Zenon sont plus vendables que celles d'Aristote, je quitte Aristote pour me rendre au magasin de Zenon; si toutes choses qui se vendent dans les boutiques des phUosophes sont vaines et inutUes, je n'y achete rien du tout." ' Ramus, de son cote, met le scepticisme ciceronien en pratique en examinant 'librement' les ouvrages logi-ques d'Aristote, et bientot apres les ouvrages rhetoriques de Ciceron et de Quintihen. Au cours de cette evaluation hyper-critique -et, ajoutons-le, souvent fort malveUlante- de ces 'autorites' anciennes'". Ramus veut tester la consistance de leurs affirmations, par exemple en soumettant celles-ci a I'epreuve du syllogisme. Dans tons les cas, U pretend conserver Tessentiel' de 1'ouvrage, mais 'retrancher les superfluitez', comme U le dira dans sa Remonstrance de 1567. Des 1547 Ramus definit sa demarche dans la preface aux Brutinae Quaestiones: "Men pere fut agriculteur . . . ; U m'ap-prit a m'exercer a herser, a sarcler, a echardonner et a desherber les champs . . J'elimine les chardons et les mauvaises herbes du
"Cf. J. von Stackelberg, 'Das Bienengleichnis; ein Beitrag zur Geschichte der literarischen Imitatio', in Romanische Forschungen 68 (1956), pp. 271-293.
'Talon, Acad., in Colled. (1577), p. 133. Passage cite et traduit par R. Hooykaas, Humanisme, science et Reforme. Pierre de la Ramee, 1515-1572, Leyde 1958, p . 15. Sur I'influence de la pensee ciceronienne sur les Ramistes, voir notre article 'Ramus et Ciceron', dans la Revue des sciences philosophiques et theologiques 70 (1986), pp. 25-35.
'"Ramus, Aristotelicae animadversiones (1543'), Brutinae Quaestiones (1547'), examen critique de I'Orator de Ciceron, Rhetoricae Distinctiones in Quintilianum (1549").
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
Pedagogie et Rhetorique Ramistes 423
champ oratoire de Ciceron, m'appliquant a faire tout ce que mon pere m'a appris . . . Car ainsi qu'un champ bien nettoye produit une moisson plus riche, I'Orateur de Ciceron portera des fruits beaucoup plus soUdes et desirables apres qu'on aura separe le bon grain de I'ivraie."" Et voUa Ciceron victime d'une approche anti-autoritahe qu'U a prechee lui-meme!
Considerant ensemble les deux citations relevees ci-dessus, nous pouvons en distiller trois caracteristiques majeures concer-nant I'attitude des Ramistes a I'egard des grands textes anciens. La premiere, c'est leur demarche resolument eclectique. A propos de chaque probleme scientifique ou phUosophique qui se presente a eux. Us entendent faire un tri dans les temoignages des autorites qui en ont parle. Ils se tourneront tantot vers Platon, tantot vers Aristote, tantot vers quelque autre source de savou. Mais ils n'ac-ceptent pas pour autant les textes selectionnes dans leur integrite; a I'interieur de chacun de ces textes -et c'est la la seconde caracteristique- Us precedent a un nouveau tri, separant 'le bon grain de Tin vraie'. lis soumettent, autrement dit, chaque texte a un processus d' 'emendation', eliminant les parties du texte qu'Us jugent inutUes pour ne retenir que ce qu'Us estiment etre valable.'^ Enfin, et voila la troisieme caracteristique de leur attitude, surs desormais d'avoir decouvert le noyau, la 'substantifique moelle' du texte, ils se I'approprient. Ils se servent de 'residus' de textes anciens dans la construction de leurs propres ouvrages. En etudiant les textes ramistes, on est en effet frappe par le nombre des emprunts lit-
"Ramus, Brutirme Quaestiones, Paris, J. Bogard, 1547, ff. iii™-iv; cf. la Remonstrance au Conseil prive (1567 a.s.): ' ^'este toute mon estude d'oster du chemin des arts liberaux les espines, les caUlous, . . . de faire la voye plaine & droicte . . .', cite par Ch. Waddington, Ramus: sa vie, ses ecrits et ses opinions, Paris, 1855 (rdmpr. Geneve, 1969), p. 344.
"SouUgnons que cette attitude scepHque a I'egard des textes restera constante chez les Ramistes. En 1569, Ramus a a souder ensemble les Brut. Quaest. et les RJket. Dist. pour en faire des scholae rhetoricae ininterrompues, destinees 4 entrer dans les Scholae in liberates artes. Bale, heritiers E. et N. Episcopius, 1569. A cet effet, U omet la preface et les onze premieres lignes des Rhet. Dist., ecrit onze lignes de transition et amorce son attaque contre Quintilien avec quelques phrases a I'allure nettement 'academique': 'Quamobrem, dialectici omnes, adeste, animadvertite, vestram sa-pientiam excitate, repeUite procul a vobis . . amorem, odium, praejudicatam opinionem, levitatem, inconstantiam, temeritatem, & quantum firma ratio convincet, quantum conclusio certa conficiet, quantum denique Veritas ipsa . . obtinebit, tantum animis aequis & libentibus accipite': scholae rhetoricae, in Scholae (1569; rdmpr. HUdesheim/New York 1970), col. 319. Voir supra, note 4.
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
424 R H E T O R I C A
teraux aux Anciens qu'on peut y decouvrir. Des plages entieres des textes ramistes sont constituees par des citations a la file, unies les unes aux autres par quelques mots, ou par un leger changement dans la construction syntaxique. Nous en avons fait 1'experience en analysant dans le detaU quelques chapitres de la derniere version de la Rhdorique ramiste.'^ Bien entendu, ces citations ont ete in-serees dans un ensemble definitionnel des plus rigoureux, perfec-tionne d'une version a I'autre et quelquefois meme d'une reimpres-sion a I'autre. On constate par ailleurs que la contrainte du systeme definitionnel est telle que les Ramistes se voient obliges de temps en temps de changer un ou plusieurs mots dans une citation presentee comme litterale. Mais nous n'allons pas insister sur ce point, si important soit-il dans I'elaboration de la rhetorique ramiste.'*
Les deux precedes d'emondation et d'appropriation que nous venens de decrhe, et qui font suite a une selection d'erdre plus general, correspondent tres exactement a deux principes fondamentaux d'une methode didactique appliquee en classe (au College de Presles et au College Royal) et defendue avec ardeur dans les ecrits des Ramistes. Cette methode, dent I'importance a ete seulig-nee a juste litre par Peter Sharratt'^, se compose de deux meuve-ments cemplementaires appeles I'analyse et la genese. Voici, en effet, comment les Ramistes traitent un texte classique en classe. D'abord, Us examinent les precedes grammaticaux, rhetoriques et dialectiques mis en oeuvre dans le texte. Cet examen n'a rien de passif; car a propos de chaque element considere, le maitre avance un jugement de valeur, louant tel precede mais en critiquant tel autre. En bref, dans ce premier stade on precede a revaluation critique des precedes textuels. Dans le second stade, la genese, c'est aux eleves de jouer: ayant pris connaissance des 'vertus' et des 'vices' du texte-medelle. Us sont invites a rediger un texte simUaire en prelevant les elements juges 'bons' du texte ancien, et en y ajeu-
"II s'agit du texte A. Talaei Rhetorica, P. Rami . praelectionibus illustrata. La premiere ed. date de 1567; nombreuses r^impressions. Voir Meerhoff (1986), p. 289 sqq. et en particulier p. 309 -I- note 44.
'"Pour un echantUlon de cette manipulation textueUe, voir ibid. (1986), pp. 306-308.
"Voir P. Sharratt, 'Peter Ramus and Imitation: Image, Sign and Sacrament', in Yale French Studies 47 (1972), pp. 19-32; id., 'Ramus, phUosophe indigne', in Bulletin de I'association G. Bude (1982), pp. 187-206. Cf. deja W. Ong, 'Ramus educateur . . .', in Pedagogues et furistes, Paris 1963, pp. 214-215.
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
Pedagogie et Rhetorique Ramistes 425
tant d'autres elements qui s'accordent a ceux du texte etudie. Le resultat sera un melange savamment dose d'emprunts au texte-modele et d'elements nouveaux, et a la fin la creation d'un texte independant, bien que forcement limite par les contraintes de 1' imitatio.'" On cenviendra que cette procedure didactique binaire qui oblige I'eleve a 1'emulation critique avec le texte ancien, a I'imita-tien creatrice, ressemble a s'y meprendre a la methode suivie par les Ramistes lors de I'elaberatien de leurs propres textes theoriques, cemme par exemple la Rhetorique Frangoise d'un eleve cem-mun de La Ramee et de Talon, Antoine Fouquelin, originaire de Chauny dans le Vermandois, en Picardie.
En examinant cet ouvrage, ecrit sous la surveillance des deux maitres, U conviendra d'etre particulierement attentif aux aspects mentionnes auparavant: la methode de composition, celle-ci impU-quant comme nous 1'avons vu la selection, puis I'appropriation des textes d'autrui, et I'insertion de ces plages textuelles dans un ensemble definitionnel rigoureux.
Comme on salt, la Rhetorique Frangoise se presente comme une simple traduction de la Rhetorica latine de Talon. Voici comment Fouquelin decrit la procedure qu'il a suivie: "J'ai traduit les preceptes de rhetorique, fidelement amasses des anciens rheteurs grecs et latins, et ranges en singulier ordre de disposition par Omer Talon . . A I'aveu et conseU duquel (Talon), j'ai accommode les preceptes de cet art a notre langue (frangaise), laissant toutefois (de cote) ce a quoi le naturel usage d'icelle (langue) semblait repugner; ajoutant aussi ce qu'elle avail de propre et particulier en soi, outre les Grecs et les Latins."" Autrement dit, Fouquelin a pu garder tels quels la plupart des 'preceptes' de I'original, remplagant les exemples latins par des equivalents frangais. 11 a pu laisser intacte toute la charpente de son modele, construite sur la base de definitions simples, rigoureuses, et de divisions en dichotomie: "(La) rhetorique est un art de bien et elegamment parler . . (La) rhetori-
"Pour une description de cette procedure didactique, voir p. ex. Ramus, Dialectique (1555), ed. M. Dassonville, Geneve 1964, p. 155 n. c (Ajout de I'ed. 1576); scholae dialed., in Scholae (1569), cols. 600-601 (cf. cols. 191-194); et surtout Pro philosophica parisiensis Academiae disciplina oratio, in Collect. (1577), p. 327 sqq.
"Lfl Rhetorique Frangoise d'Antoine Foclin de Chauny en Vermandois, a Tresillustrc Princesse Madame Marie Royne d'Ecosse. Paris, A. Wechel, 1555, preface. W. Ong, Ramus and Talon Inventory , Cambridge (Mass.) 1958, no. 71. -Nous avons modernise I'orthographe.
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
426 R H E T O R I C A
que a deux parties: I'Elocution et la Prononciation. L'elocution n'est autre chose que I'ornement et enrichissement de la parole et oraison (orationis exornatio), laquelle a deux especes: I'une est ap-pelee Trope, I'autre Figure.'"* Suivent, plus loin, la definition et la division de la figure (figures de mots, figures de pensee) ainsi que la definition et la division de la prononciation (voix et gestes)."
Ainsi, Fouquelin tient pour acquise la delimitation des arts du Trivium defendue depuis une dizaine d'annees par Ramus, et enoncee par Talon au commencement de son traite; delimitation qui n'a d'aUleurs rien de revolutionnaire, puisqu'elle avail deja ete formulee par Valla, Agricola, Melanchthon et bien d'autres: "La Rhetorique s'occupera exclusivement a rehausser par les orne-ments de l'elocution et a mettre en relief par la grace de la prononciation ou de Faction les choses trouvees et mises en ordre par la Dialectique, et exprimees dans un langage pur et convenable (puro & proprio sermone) par la Grammaire."^" La dialectique assumera done I'lnvention et la disposition des 'choses'; elle est ars rationis, la oil la grammaire et la rhetorique, en tant qu'artes orationis, vent se charger des 'mots'. La grammaire donnera des regies permettant de parler ou d'ecrire correctement, c'est-a-dhe elle aidera I'eleve a construire un discours 'non marque', 'de degre zero'; alors que la rhetorique s'occupera exclusivement des ecarts linguistiques qui vont pour ainsi dire se greffer sur un discours neutre, transparent, pour lui conferer une opacite qui charme et persuade.
II n'echappera a personne a quel point cette 'division du travaU' est factice; elle est pourtant justifiable -et s'impose par consequent aux yeux des Ramistes, pedagogues avant tout- d'un point de vue didactique: elle evite, en effet, la redondance des preceptes.^'
La 'division du travaiF entre grammaire et rhetorique se retrouve tout naturellement dans la definition du trope de de la figure. 'Le trope', dit Fouquelin, 'est une (espece d') elocution, par
'"Fouquelin, ibid. (1555), p. 1. "Fouquelin, ibid. (1555), pp. 34-35; (112;) 113. '"Talon, Rhetorica, ad Carolum Lotharingum Cardinalem Guisianum. Quarta aeditio
ab authore recognita et aucta, Paris, M. David, 1550 (1548'), p. 6. Ong, Inv. (1958), no. 61. Ce passage manque chez Fouquelin.
"Talon, ibid. (1550), p. 5. -Nous consid^rons ici uniquement le fondement pragmatique -didactique- de la 'loi de justice', pierre angulaire de la methodologie ramiste. Sur les trois lois aristoteliciennes (cf. Arist. Sec. Analyt. I, 4-9), tres souvent evoquees par Ramus, voir N. Bruyere, Mdhode et dialectique dans I'oeuvre de La Ramee, Paris 1984, II, chap. 3: 'Les trois lois de I'ascendance dialectique' ('Ramus a truffe ses textes ant^rieurs de ces formules').
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
Pedagogie et Rhetorique Ramistes 427
laquelle la propre et naturelle signification est changee en une autre'^: ecart semantique par rapport au sens 'naturel', 'pur et convenable'; fourni par la grammaire. La figure, elle, est 'une espece d'elocution, par laquelle le langage est change de la simple et vul-gaire maniere de dire. '" Dans la derniere version de la Rhdorique latine publiee en 1567 La Ramee precisera, a I'instar de Ciceron et de QuintUien, que la figure, a-xf)p.a en grec, est comme une 'posture' ou un 'geste' du discours: habitus et gestus orationis: la encore, ecart par rapport a la normalite grammaticale.^* Le contexte de ce passage nous montre que Ramus se refere ici tout d'abord au neu-vieme livre de Quintihen, oil celui-ci affirme que le cr)(r\pt,a est un ecart podique ou oratoire.^
VoUa qui explique pourquoi La Ramee aussi bien que Talon et Fouquelin se sentent tout a fait justifies a parler de la poesie, et notamment de la prosodie poetique, dans cette section de leurs manuels d'art oratoire. Par aUleurs, et meme en dehors de toute consideration theorique ou terminologique, c'est cette solution qui semblait s'imposer du point de vue pedagogique; en bons Humanistes, les Ramistes n'avaient-Us pas base leur enseignement sur I'etude des orateurs, des historiens et des poetes? Alors, oCi parler de la technique poetique, sinon dans la rhetorique, cette codification de tout ce qui, dans le discours, est deviant?
Des lors, I'endroit le plus approprie a parler de la prosodie est, de toute evidence, la sous-section concernant les figures de mots. Talon n'avail deja pas manque de le faire dans sa Rhdorique latine, mais de fagon succincte, comme en passant; il avait prete le plus clair de son attention non pas au 'nombre poetique', mais bien sur au nombre oratoire, au moyen duquel I'eleve etait initie aux sortileges du style ciceronien.^^ C'est I'inverse qu'on observe dans le cas de Fouquelin. En effet, la prose d'art frangaise n'est soumise a aucune contrainte metrique, alors que celle-ci constitue, aux yeux de Fouquelin, I'essence meme de la poesie, ce grand Ecart.^'
Les exemples fournis par Talon et Fouquelin pour illustrer les
"Fouquelin, Rh. fr. (1555), pp. 1-2. '^Fouquelin, ibid. (1555), p. 34, '"(Ramus), A. Talaei Rhetorica e P. Rami . . . praelectionibus observata; cui praefixa
est epistola (A. Wecheli) . . , Francfort, heritiers A. Wechel, 1582, 1, 14, p. 29. Ong, Inv. (1958), no. 97. Cf. Cic. Or. 25, 83; Quint. II, 13, 9; IX, 1, 11; 13; 14.
"Quint. IX, 1, 13: '(id quod est) poetice vel oratorie mutatum,' sell, 'a simplici atque in promptu posito dicendi modo'.
"•Talon, Rhd. (1550), pp. 58-63. "Fouquelin, Rh. fr. (1555), pp. 35-36.
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
428 R H E T O R I C A
preceptes de cette section illustrent egalement le renversement qui s'est produit d'un livre a I'autre et d'une langue a I'autre. Le nombre d'exemples en prose proposes par Talon est exactement le double de ses exemples poetiques; chez Fouquelin c'est I'inverse, et meme plus: 52 exemples poetiques sur 22 exemples en prose.
VoUa comment Fouquelin a reussi a mclure la poetique frangaise dans sa Rhdorique d'origine grecque et latine. La machine definUionnelle et dichotomique des Ramistes s'est montree d'une grande efficacite!
Qu'en est-U de I'autre aspect mentionne auparavant, la composition du texte qui implique, nous 1'avons vu, I'utihsation des textes d'autrui?
Pour un texte en principe traduit, le probleme de la composition se pose dans la preface, les exemples et les adaptations que Fouquelin se voyait oblige d'effectuer.
Quant a la preface et aux exemples, la recherche moderne a souUgne a juste litre I'apport decisif des textes de la Pleiade. Le jeune Ramiste fera son miel des recueils tout juste parus de Ronsard, Du Bellay, Baif et d'autres encore; le manifeste de la Pleiade, la Deffence et Illustration de la langue frangoyse publiee cinq ans plus tot lui offre non seulement les arguments, passes dans la preface, aptes a defendre 1'entreprise de traduction, mais encore bon nombre d'exemples en prose qu'on retrouvera dans le texte meme.^*
Pour ce qui est des adaptations qui, nous 1'avons vu, prennent place essentiellement dans la section concernant les figures de mots oii est traitee la prosodie frangaise, Fouquelin nous a reserve une belle surprise. Car loin de s'adresser, la encore, aux doctes poetes de la Pleiade, Fouquelin a prefere se tourner vers celui qu'on considerait a I'epoque comme I'ennemi jure de la nouvelle ecole, a savoir Thomas SebiUet, auteur d'un Art Podique Frangois paru un an avant la Deffence (en 1548). Fouquelin a emprunte a SebiUet toute la structure d'exposition de la section; et quand U parle de ces formes poetiques traditionnelles fort prisees par I'auteur de VArt Podique, mais ecartees avec dedain par les poetes de la Pleiade (ballades, virelais, etc.), c'est pour en derober la description, et souvent aussi I'exemple, au meme Thomas SebiUet.
InutUe de faire a present la demonstration detaillee de tous ces
^Cf. Meerhoff (1986), p. 238 n. 11.
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms
Pedagogie et Rhetorique Ramistes 429
larcins et de leur importance quantitative.^' SouUgnons ici plutot le travaU d'appropriation selectif si caracteristique de l'ecole ramiste; et ajoutons qu'en procedant de la sorte, FouqueUn et ses maitres a penser n'ont pas hesite a reurur I'heritage des 'freres ennemis' Du Bellay et SebiUet, restant ainsi fideles aux principes de Ciceron, champion de 1'approche anti-autoritaire.
Dans le Ciceronianus pubUe au meme moment, et chez le meme editeur parisien que la reimpression de la Rhetorique Frangoise (1557), Ramus entonnera de nouveau I'eloge de Ciceron, phUosophe sceptique, defenseur de sa langue maternelle.^ Mais, en bon disciple, U I'a egalement critique ici et la. FouqueUn, eleve de I'eleve, avait deja suivi le modele ciceronien en traduisant en frangais la Rhdorique ramiste; cependant, pour autant qu'on sache, U ne s'est jamais permis d'observations critiques a I'egard de Ramus, son venere maitre.
"Nous nous autorisons a renvoyer le lecteur a notre article 'Antoine Fouquelin et Thomas SebUlet', dans la Nouvelle Revue du Seizieme Siecle 5 (1987), pp. 59-77.
"'Ciceron sceptique: Ramus, Cic. (1557), pp. 67, 69 (voir supra, note 4); Ciceron champion de la langue latine: ibid. (1557), pp. 14-17, 77-78. Cf. aussi notre article 'Ramus et Ciceron' (1986), deja cite.
This content downloaded from 146.50.98.28 on Sun, 06 Aug 2017 20:36:28 UTCAll use subject to http://about.jstor.org/terms