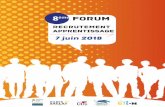Représentation Dynamique de Documents pour une Recherche Documentaire Intelligente
Pas d’impôts sans représentation! La commission budgétaire du Parlement européen et les...
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pas d’impôts sans représentation! La commission budgétaire du Parlement européen et les...
1
«Pas d ’ impôt s sans représen ta t ion !» .
La commiss ion budgé ta i re du Par l ement européen e t
l e s é l ec t i o n s d e j u in 1 9 7 9 .
Valentina VARDABASSO
IN T R O D U C T IO N
L’élection directe du Parlement européen a retenu l’attention des
historiens1, des anthropologues,2des politologues.3 L’espace parlementaire
européen a été ainsi exploré sous plusieurs angles :dans son interaction
avec la société civile et les gouvernements nationaux,4l’attitude des
opinions publiques5, les répercussions et le réflexe des différentes pratiques
1Gérard BOSSUAT« Les partis des socialistes européens dans la bataille des élections », in Gérard BOSSUAT, Adrien CANDIARD, Frédric CEPEDE, Jean Pierre COT, Xavier GARCIA, Pierre MARTIN, Elsa TULMETS, in Les socialistes et les élections européennes, 1979-‐2004, Les notes de la Fondation Jean –Jourès, Histoire et memoire, n°39 juin 2004, p.43-‐68.Voir aussi Mathieu MONOT, Socialistes et démocrates chrétiens et la politisation de l’Europe, Harmattan 2010.
2 Marc ABELES ,La vie quotidienne au Parlement européen,Paris, Hachette, 1992,
443 p. 3Olivier ROZIENBERG « Les élections européennes et le PE entre influence et indifférence », in Politique européenne n°28,2009 ed Harmattan. David BUTLER, David MARQUAND, European elections and british politics, Longman, London, New York, 1981. Karlheinz REIF, Hermann SCHMITT, « Nine second order national elections ? A conceptual framework for the analysis european elections results », in European Journal of political Research n°8, 1980, pp.3-44. 4 Sylvain SCHIRMAN « Syndicats français, et élections européennes » , in Marie Thérèse BITSCH, Wilfried LOTH, Charles BARTHEL, Cultures politiques, opinions publiques, et intégration européenne, Bruxelles, Bruylant, pp.323-336. 5 Anne DULPHY , Christine MANIGAND,L’opinion publique et le PE, in Journal european history integration, vol.17, n°1, 2011, pp.117-130. Anne DULPHY , Christine MANIGAND, La France au risque de l’Europe.Entre audace et repli 1950-2005, ed.Armand Colin, 2006. Christine MANIGAND « Les Français face aux trois premières élections européennes(1979-1989) », in Parlement(s), Revue d’histoire politique, 3, 2007, pp.103-113.
2
électorales,6 sans oublier la contribution des mouvements fédéralistes 7 et
des juristes 8.
L’historiographie semble ignorer toutefois à ce jour le rôle joué par la
commission budgétaire du PE lors les premières élections au suffrage
universel direct en 1979, ainsi que dans la montée en puissance de cette
institution.
Or la réappropriation au niveau communautaire de la fonction du contrôle ,
qui s’exprime dans le droit du PE de rejeter le budget commun, a été le
cheval de bataille de la commission budgétaire. Son action débute avec le
traité sur les ressources propres, signé le 21 avril 1970, qui fait suite à la
décision du Conseil relative au remplacement des contributions financières
des Etats membres par des ressources propres aux Communautés, prise ce
même jour. Cette décision, d’extrême importance, pose la question du
renforcement des pouvoirs de contrôle budgétaire du PE , devant
permettre à celui-ci d’exercer un contrôle démocratique sur un budget
communautaire alimenté par des ressources propres. Ce processus qui
s’étend sur toute la décennie est marqué par le traité instituant, à l’
instigation du PE , la Cour des comptes européenne en 1975. Il s’achève en
1979, avec l’élection du Parlement européen au suffrage universel direct.
Notre propos est d’analyser ce processus sous l’angle de l’action de la
commission budgétaire en tentant de voir en quoi la fonction du contrôle
parlementaire a contribué à la formation de l’espace public européen ainsi
qu’à la perception d‘une identité européenne.
6 Julien NAVARRO, Les députés européens et leur rôle ,ed. Université de Bruxelles, 2009 , p.287.
7 Bertrand VAYSSIERE, Vers une Europe fédérale ?Les espoirs et les actions fédéralistes au sortir de la deuxième guerre mondiale, Peter Lang, 2006, réed.2007, p.461.
8JACOBS, Francis; CORBETT, Richard; SHACKLETON, Michael. The European Parliament. 4th éd. London: John Harper, 2000. 363 p.
3
Dans la plupart des démocraties contemporaines, le suffrage universel
s’accompagne de la réappropriation de la fonction du contrôle budgétaire
par l’Assemblée parlementaire nationale. « Pas d’impôts sans
représentation ! », est beaucoup plus qu’un slogan dans la civilisation
occidentale. C’est la consécration du principe du consentement à l’impôt,
clé de voûte du régime parlementaire , qui représente un tournant dans
l’histoire des nations, crée une identité et une classe politique, marque et
distingue les cultures politiques nationales.
Quel est cependant l’impact de ce même principe, désormais
consubstantiel aux démocraties contemporaines, au niveau
communautaire ? Les Six membres fondateurs de la Communauté
européenne et après les Neuf, reconnaissent-ils partager des traits
communs dans une prérogative désormais acquise et bien enracinée au
niveau national ?De surcroît, comment le contrôle, fonction revendiquée à
mainte reprises par le Parlement européen , s’articule-t-il sur la question de
la représentation politique , centrale dans les débats parlementaires des
années soixante-dix ?Au niveau communautaire, le contrôle parlementaire
est-il une fonction propre, ou un droit transposé du niveau national à celui
européen ?
Cette transposition du contrôle politique , du niveau national au niveau
européen –a-t-elle connu des difficultés ? Quelles ont été les césures et les
décalages dans cette transposition par rapport au contexte national ? S’il
est vrai que par la réappropriation de la fonction du contrôle externe le PE
a obtenu la légitimité consacrée ensuite par les élections directes, cette
même prérogative a –t-elle contribué à la formation d’une classe politique
supranationale ?
Notre hypothèse de travail part de la constatation que l’appropriation de la
fonction du contrôle budgétaire de la part du PE a impliqué une ouverture
progressive des débats a une compétition partisane selon l’axe droit et
gauche, un accroissement des compétences de l’UE, un mécanisme
4
d’identification des différentes cultures politiques nationales et un espace
de decision commun. Or cette politisation9 des enjeux, par laquelle le
budget a pris une dimension politique, mais dans un sens transnational
plutôt que supranational, n’a été pas été suivie par la réappropriation du
politique par les citoyens : le clivage entre les élites et les citoyens reste
malgré tout remarquable.
De surcroît, au niveau national, l’appropriation de certains principes en
matière budgétaire par l’Assemblée parlementaire tel que le consentement
à l’impôt, le contrôle parlementaire, et par là la responsabilité du pouvoir
exécutif devant le Parlement, a esquissé une identité politique, formant en
même temps une classe politique. Or, au niveau communautaire il y a un
décalage ou mieux une rupture , car ces mêmes principes qui dans un
contexte national ont bâti un chemin, indiqué une direction, et ont fait
émerger une culture politique , peinent à s’affirmer dans le contexte
régional européen.10 Tout en créant un espace commun de décision, et la
conscience de partager une culture politique commune, ces principes ne
créent pas une classe politique supranationale, et ne remplissent pas le vide
démocratique. Par ailleurs quelle est la relation entre le contrôle
budgétaire, la représentation parlementaire et l’européanisation ?
Cette posture de recherche se révèle intéressante pour l’historien, car elle
permet de casser la linéarité de l’historiographie européenne par la
réappropriation du passé, notamment de certaines idées et intuitions du
siècle des Lumières, et en même temps dégage l’historiographie des
perspectives et interprétations nationales.11
9 Jacques LAGROYE(dir), La politisation, Paris, Belin, 2003, 564 p. 10 Les limites de l’analyse sur le tropisme parlementaire, voir Paul MAGNETTE , Le régime politique de l’Union européenne, Presse de Sciences Po, 2009, pp241-268. 11Jost DULFFER, « De l’histoire de l’intégration à l’histoire intégrée de l’Europe »,in Gerard BOSSUAT,Eric BUSSIERE, Robert FRANK, Wilfried LOTH , Antonio VARSORI, L’expérience européenne .Des historiens en dialogue, Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J/Paris, Nomos/Verlang/Baden-‐Baden, pp.11-‐35.
5
Défricher le terrain à partir des premières élections du PE et des
démarches de la commission budgétaire implique une réflexion sur le
contrôle parlementaire par rapport à l’espace public et à l’identité
européenne. Ensuite l’attention sera portée sur la politisation du budget et
sur le rôle de Altiero Spinelli, de 1976, date de son arrivée à la commission
budgétaire, jusqu’à juin 1979 .
I-LE POIDS DU PASSE.LE CONSENTEMENT A L’IMPÔT A LA
BASE DE LA PRATIQUE PARLEMENTAIRE
La réflexion sur l’identité européenne dans sa relation avec le contrôle
parlementaire, nécessite de jeter un regard rétrospectif sur la philosophie
politique du XVIII siècle qui a véhiculé certains principes à la base de la
démocratie représentative. Quel est le poids du passé, dans cette volonté
de réinventer le politique par la réappropriation au niveau communautaire
de la fonction du contrôle parlementaire ?
L’histoire de la construction européenne ne débute pas en 1950 avec la
déclaration Schuman, mais bien avant, par l’élaboration d’idées et de
principes qui ont exercé une certaine fascination et influence au XX
siècle.12Or, s’il est vrai qu’il faut atteindre l’institutionnalisation prévue par
le traité CECA pour considérer la Communauté européenne comme un
sujet juridique, l’héritage du passé, les idées reçues, notamment celles du
siècle des Lumières, ont sans doute animé la construction européenne et
scandé les débats. Cette approche est évident le moment où la
Communauté décide d’élire démocratiquement les membres de son
assemblée parlementaire. C’est à cette occasion que l’on voit ressurgir
l’héritage du passé, celui des idées développées au XVIII siècle ,
particulièrement par les grands philosophes politiques :
12Robert FRANK, « Conclusion », in Gérard BOSSUAT,Eric BUSSIERE, Robert FRANK, Wilfried LOTH , Antonio VARSORI, L’expérience européenne .Des historiens en dialogue, Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J/Paris, Nomos/Verlang/Baden-‐Baden, p.471.
6
Montesquieu,13John Locke,14 et Jean-Jacques Rousseau15. Ils avaient déjà
bien dégagé le principe du consentement à l’impôt.
C’est ainsi que les débats passionnants des années soixante-dix,
notamment ceux portant sur la représentation politique, les prérogatives de
contrôle du Parlement européen, et les réserves du Conseil, rappellent les
grands débats de la révolution française entre Robespierre pour lequel tout
pouvoir émane d’une Assemblée élue par le peuple, et Barnave selon
lequel le pouvoir du représentant n’est pas obligatoirement légitimé par
son élection. 16
Dans le même registre, la question très actuelle de la limitation du
pouvoir du Conseil des Etats, prioritaire aujourd’hui dans l’agenda
européenne dans le contexte du déficit démocratique, trouve des échos
dans le débat qui eu lieu sous la Restauration, sur les pouvoirs budgétaires
accordés par la Charte en 1814 .
A l’époque, les ultra royalistes , Chateaubriand en tête ,membre de la
Chambre des Pairs, tout en partageant le principe du consentement à
l’impôt, soutenaient que « gouverner c’est dépenser »17.La confection du
budget était donc une prérogative royale, et la Chambre des députés devait
l’approuver ou la refuser, mais les parlementaires ne déviaient pas faire le
choix budgétaire. Les libéraux, sous la conduite d’Antoine Roy de 1816 à
1820, au contraire assuraient que le droit de voter les impôts implique le
13 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Paris, Libraire Firmin Didot Frères, 1845. 14 LOCKE John, Gouvernement civil,1690, ch.X « On imposera point de taxes sur les biens propres du peuple sans son consentement, donné immédiatement par lui même ou par ses députés », cité par Aurelien BANDU, Contribution à l’étude des pouvoirs budgétaires du Parlement en France, Dalloz, 2010, p.48. 15 ROUSSEAU Jean-Jacques, Discours sur l’économie politique, 1755, p.73. « Les impôts ne peuvent pas être établis légitimement que par le consentement du peuple ou de ses représentants ». 16 Querelle entre Barnave et Robespierre voir Archives parlementaires, séance 10 aôut 1791, t.29, p.31. 17 Querelle entre les ultraroyalistes et les liberaux, v.BANDU, cité, p.69.
7
droit d’en déterminer l’usage, c’est à dire la prérogative de fixer le montant
des dépenses publiques qui pour eux relève de la compétence du
Parlement18.
Une question doit alors être posée : comment ont été reçus au niveau
européen les grands principes hérités de la philosophie politique des
Lumières ?Le consentement à l’impôt, la séparation des pouvoirs, garantie
de la démocratie, et le suffrage universel , condition préalable de cette
dernière, favorisent-ils, l’émergence d’une identité européenne et d’un
espace public ?Autrement dit, le binôme représentation politique-
démocratie contribue-t-il à créer chez les Européens un sentiment de
reconnaissance mutuelle et des solidarités réciproques , ou au contraire ce
pilier traditionnel des démocraties contemporaines s’est-il enlisé dans
l’hémicycle de Strasbourg ? Enfin s’agit –il là d’une simple transposition
au niveau communautaire d’idées bien enracinées sur le plan national, ou
au contraire le Parlement européen a –t-il été capable de se doter au moyen
de ses commissions spécialisées, de caractères qui lui sont propres ?
C’est au Royaume-Uni que se situe par ailleurs le berceau du régime
parlementaire, qui a exercé à toutes les époques une certaine fascination à
l’étranger, à l’exemple de Michel Debré19 à la veille de rédiger la
Constitution de la V eme République.
Les deux grands principes d’origine britannique : celui de la limitation du
pouvoir exécutif par le contrôle de la Chambre des Communes et celui du
parlementarisme représentatif ont été transposés dans la majeure partie
des constitutions européennes et ont marqué un tournant.20 De surcroît, la
limitation du pouvoir exécutif est inscrite dans la Grande Charte depuis
1215.
18 ibid.
19 ROUVILLOIS Frédéric, Se choisir un modèle : Michel Debré et le parlementarisme anglais en 1958, in RFHIP N°12, 2000, pp.347-‐365.
20 Edouard TILLET « Modèle anglais et modèle américain de l’ancien Régime à la Révolution.L’exemple de Jean-‐Nicolas Démeunier », in RFHIP N°12, 2000, pp. 265-‐286.
8
Dès lors, le Roi ne peut lever d’impôt sans le consentement du peuple
(Magna Charta article 12). C’est là le principe à l’origine de la tradition
politique britannique, auquel, sauf quelque moment exceptionnels, les
Britanniques sont demeurés fidèles. Ils l’ont défendu avec détermination
tout au long du XVII siècle, contre la dynastie des Tudors et surtout des
Stuart.Le roi Charles I er en a fait l’amère expérience:en 1628 , poussé
par l’exigences de ressources nouvelles, il a négligé la Petitions of Rights
et privé le Parlement pendant dix ans de toute discussion sur les questions
financières. 21
Le Roi gagne contre Hampden, un citoyen condamné par la justice
anglaise car il refusait d’acquitter la ship money, un impôt au commerce
maritime, mais il est réduit à l’impuissance par la révolution populaire de
1688.Celle-ci ouvre les portes du Royaume anglais à Guillaume d’Orange
et fait triompher des principes proclamés par la nation, tel que le
consentement à l’impôt.22
L’autre idée héritée d’outre Manche concerne la représentation
parlementaire. 23.Avec l’élargissement du droit de suffrage, le rôle et les
compétences de la Chambre des Communes s’accroissent au détriment de
ceux de la Chambre des Lords. Cette institution présente le défaut d’un
certain déficit démocratique, faute de ne pas être élue.
A ce titre, n’étant pas élue, elle se voit progressivement retirer ses
attributions délibérantes et budgétaire par les Parliament Act de 1911 et
1949, pour devenir finalement une chambre modératrice. Comme dans
tout régime parlementaire, la chambre basse dispose du pouvoir
21 François Michel GUIZOT , Histoire de la revolution d’Angleterre depuis l’avènement de Charles I er jusqu’à sa mort, ed.Didier Libraire, 1850, p.464 .
22 Aurelien BANDU, Contribution à l’étude des pouvoirs budgétaires du Parlement en France, Dalloz, 2010, p.81-‐82.
23 Sur l’Angleterre modèle politique pour certains, repoussoir pour les autres, voir Frédéric SAULNIER, Oppurtunisme, positivisme et parlementarisme à l’anglaise au début de la IIIème République, in RFHIP, n°12, pp.307-‐308.
9
budgétaire depuis la Charte de 1215 (Art. 14), renforcée par le Parliament
Act de 1911, au détriment de la Chambre des Lords. Celle-ci n’a pas
l’initiative des lois budgétaires, mais elle peut en débattre et les voter. Par
ailleurs,la Chambre des Communes peut mettre en cause la responsabilité
du gouvernement lorsqu’elle n’a plus confiance en l’équipe
gouvernementale.
Tout en se laissant en partie séduire par la culture politique britannique, la
France a connu une gestion laborieuse de la consécration du principe de
consentement à l’impôt, lequel a triomphé seulement à l’aube du XIX ème
siècle.24 Certes la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen avait
bien affirmé ce dernier principe, mais déjà Napoléon y déroge. S’il est
vrai que, depuis 1815, avec la Restauration, l’affirmation de ce principe
a été systématique, à l’exception de la parenthèse de Vichy, il faut attendre
la Quatrième République et l’article 16 de la Constitution de 1946, pour
que l’Assemblée nationale soit dotée des plus amples prérogatives, y
compris le droit de veto, en matière budgétaire. 25 En résumé le
consentement à l’impôt, et la responsabilité de l’exécutif vis à vis du
Parlement, ont connu un tournant, qui introduit l’âge moderne de la
démocratie en Angleterre au XVIII et en France au libéralisme du XIX
siècle.
Si tel a été l’effet au niveau national, quelle suite a été donnée au niveau
communautaire à ces deux mêmes principes ? S’agit–il d’une
transplantation ou au contraire d’un processus plus long et bien plus
24 Nicolas DELALANDE, Alexis SPIRE, Histoire sociale de l’Impôt, La Découverte, coll.Repère Histoire, 2010.Maurice LEVY LEBOYER , Michel LESCURE , Alain PLESSIS, L’impôt en France, au XIX et XX siècle, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006, p.466.
25 Dossier Fiscalité et societé :les résistances à l’impôt, au XIX et XX siècle,Belin avril –juin 2009, 256 p. Voir aussi :Alexandre GUIGUE , Les origines et l’évolution du vote du budget de l’Etat en France et en Angleterre, thèse dirigée par G.GONDUINsoutenue le 9 décembre 2005, Université de Savoie.
10
complexe ? Observons –nous une ligne droite ou au contraire un chemin
semé de contradictions et césures?
II- LE CONTROLE BUDGETAIRE EUROPEEN DANS UNE
PERSPECTIVE HISTORIQUE
Si dans le cadre des Assemblées nationales, le contrôle parlementaire est
désormais un des acquis des démocraties représentatives, le contrôle
budgétaire étant une prérogative du Parlement, tel n’est pas le cas de
l’Assemblée parlementaire européenne, qui s’est vue attribuer cette
fonction par des compromis, au terme de débats qui opposent les partisans
et les adversaires du fédéralisme.
Il va sans dire que le traité de la CECA comme le traité de Rome
prévoient un contrôle sur les comptes de la Communauté. La CECA se
dote d’un commissaire aux comptes, alors que le traité de Rome prévoit
une commission de contrôle, mais dans un cas comme dans l’autre, il n’y a
aucune distinction entre la responsabilité de la gestion et le contrôle de
cette dernière. Dans la pratique, les membres de la commission de contrôle
sont investis de cette fonction par la Commission qui les recrute parmi ses
fonctionnaires. La Commission est de ce fait en même temps gestionnaire
et inspectrice .Il en va de même pour le commissaire aux comptes de la
CECA.26
Si les raisons exogènes de l’affirmation du contrôle externe résident dans
la tradition démocratique occidentale qui accorde cette prérogative au
Parlement, les circonstances dans lesquelles cette fonction a prévalu au
26 Paul Gaudy, membre de la Cour des Comptes européenne (1977-1987), expliquant les raisons de la création de cette institution, rappelle aussi le mécanisme de contrôle de la CECA. Voir Paul GAUDY « La Cour des Comptes européenne », in L’Europe en formation, juin 1978, PP.3-4.
11
niveau européen pendant les années soixante-dix sont d’abord
endogènes.27
L’incapacité de la commission de contrôle de faire face au premier
élargissement de 1973 a sans doute pesé. 28De surcroît , les fraudes
toujours plus importantes dans le FEOGA, exigeaient une capacité
d’inspection et un pouvoir de vérification qui faisaient défaut à la
commission de contrôle29.
La gestion de la section garantie apparaît en effet dépourvue d’un
véritable contrôle externe, au sens habituel du terme .La commission de
contrôle n’est dès lors pas en mesure d’éclairer valablement les
responsables communautaires sur sa gestion.
La leçon tirée dans l’affaire OTRACO en 1970 sur la gestion des fonds de
développement est double.30 Des contrôleurs mandatés de la Communauté
sont dans l’incapacité de s’acquitter de deux fonctions à la fois, et en
même temps il est absurde que le PE ne puisse pas donner son avis sur la
gestion des fonds européen de développement car ses compétences
l’article 206 du traité de Rome se limitent aux affaires courantes.
La Commission se dote néanmoins de nouveaux instruments
informatiques de contrôle des comptes, et la commission budgétaire du PE
27 Sur l’évolution de la fonction de contrôle ensuite à des difficultés endogènes , voir l’intervention de Wohlfart (groupe socialiste) contre certaines mésures de la Commission européenne visant à paralyser les contrôles sur place de la commission budgétaire du PE à propos de la gestion financière du Fond social européen, in CARDOC, séance 9 mai 1973, débats PE, p.168, Wohlfart écrit : « Le PE ne doit pas donner la décharge si la Commission ne tien pas comptes des autorités budgétaires ».
28 ibid.
29 CARDOC, Débats PE séance 9 mai 1973, p.165, interventions de Pounder : « Si c’est question de l’argent des contribuables, est très important que les representants du peuple puissent vérifier les comptes et interroger les gestionnaires. (........) L’un des faits les plus inquietants qui se degage du rapport d’Aigner est que personne ne semble savoir exactement à combien se montent les irrégularités commises dans lme budget du FEOGA de 1970.D’après mes indications elles pourraient être de l’ordre de 130 millions d’unités de comptes » .
30OTRACO, office transports coloniaux du Congo.
12
propose la création d’une sous commission de contrôle ad hoc pour
contrôler le centre de calcul basé au Luxembourg. Les deux initiatives ne
changent la donnée ni les statistiques :les fraudes se multiplient au sein du
FEOGA.
La conscience de la faiblesse de ce type de contrôle, qui se prétend externe,
mais n’est rien d’autre qu’interne, allant de pair avec le prochain
élargissement prévu dans l’agenda de la Commission européenne en 1973,
persuadent Aigner, Spenale et les autres membres de la commission
budgétaire de la nécessité d’une révision des traités CECA et CEE en
matière de contrôle. 31
Telle est l’impression qui se dégage des débats parlementaires, au
lendemain de la conclusion du traité des ressources propres du 21 avril
1970, réflexions dont la commission budgétaire est l’auteur et qui
embrassent toutes les années soixante-dix.Parmi les fonctions
parlementaires, celle du contrôle budgétaire est certainement la plus liée à
l’évolution de la démocratie moderne. L’évaluation des résultats des
dépenses et le contrôle permanent de l’exécution du budget, sont
indispensables pour l’évaluation de toute politique. Conscient du fait que la
plupart des parlements nationaux ont bâti leur pouvoir et consolidé leur
position en exigeant de contrôler l’utilisation faite par le « souverain » des
deniers des contribuables, le PE s’est très tôt fixé comme objectif de
soumettre les finances communautaires à un contrôle indépendant.
Il va de soi que la possibilité de voter le budget, implique aussi la
possibilité de le refuser. Et concernant le droit de veto des nouvelles
dynamiques, des convergences et des divergences s’affirment à l’intérieur
de l’Assemblée parlementaire.
31Chronologie de l’évolution de la fonction de contrôle :1975 dernière année d’application de la procedure de contrôle amendée du traité de Paris et du traité de Rome. 1976 et 1977 années de transition pendant les quels le commissaire aux comptes de la CECA et la commission de contrôle assurent des rapports dans l’atteinte de l’installation de la Cour des comptes européenne.
13
Si d’un point juridique, le refus des crédits n’a pas de conséquences
pratiques immédiates, sur le plan politique, les conséquences sont
beaucoup plus importantes. Spinelli dans cet esprit en 1978 a fait peser
la menace d’un refus de voter le budget afin de donner du souffle à la
cause des élections directes du PE. Le 19 décembre 1979, le PE réjet le
budget.Ce vote s’inscrit dans une période de tension entre le PE et le
Conseil, qui prefère dépenser pour la PAC. La protestation des députés
n’est pas timide . D’une part par les baies de la procédure budgétaire, le PE
manifeste sa revendication d’un rôle plus important dans le processus
législatif. De l’autre part, le PE se leve contre la decision du Conseil qui
penalise trop à faveur de la PAC les dépenses non obligatoires. Le
Président allemand du groupe PPE affirme sans reserves : « Si nous
approuverions ce budget, nous approuverions la stagnation de la
Communauté ». 32C’est donc le droit ultime derrière lequel s’abrite le
pouvoir législatif pour contraindre le pouvoir exécutif au recul .Or, si au
niveau national le droit de veto rentre dans les pratiques constitutionnelles,
le parcours de cette prérogative est très différente au niveau européen.
III- DU SIMPLE CERTIFICAT DE COMPTABILITE A LA
DECHERGE INSTRUMENT POLITIQUE :LA POLITISATION DU BUDGET33
32 50 ans d’Histoire du groupe du PPE au service de l’Europe unie 1953-‐2003, ed.Service Recherche et documentation du PE, responsable de la publication Pascal Fontaine, 2003, p.102.
33 Sur la politisation des structures européennes voir :Simon HIX, Abdul NOURY, Gérard ROLAND, Democracy in the Européan Parliament, 2005, 322 p. Voir aussi Celine BELOT ,Bruno Cautres(dir.), La vie démocratique de l’UE.Paris, La Documentation française , 2006, 187 p. Elisabeth DU REAU, Christine Manigand, Traian SANDU (dir.), Dynamiques et resistences politiques dans le nouvel espace européen , Paris, Harmattan, 2005, p.207.Robert SOIN,L’Europe politique,Histoire, crises, développements et perspectives du processus d’intégration,Paris, ed.Armand Colin, 2005, 207 p.
14
C’est seulement dans les années soixante-dix que le PE, au terme d’une
longue bataille, se voit reconnaître le pouvoir traditionnel de contrôle, y
compris le droit de veto, sur la gestion financière de la Commission.34 Le
principe fondateur des démocraties contemporaines, selon lequel le
contrôle exercé par le PE sur les recettes et les dépenses de la Communauté
est essentiel afin que le respect du principe de la responsabilité à l’égard
des citoyens soit garanti, n’a pas été transféré de façon automatique au
niveau européen. En fait si la conscience de l’importance de cette
prérogative est bien enracinée dans les cultures politiques nationales des
Six et après des Neuf, le Parlement européen au début des années
soixante-dix manque d’une véritable structure budgétaire. Le financement
de la Communauté révélait encore à cette époque des Etats, dans le sens
que la CECA disposait d’un impôt perçu sur les entreprises ainsi que les
emprunts recueillis sur le marché des capitaux, alors que la CEE et
Euratom étaient financés par les Etats membres.
Les bases juridiques du contrôle budgétaire parlementaire sont inscrites
dans les révisions des traités de Paris et de Rome, réalisées en 1970 et
1975 : dès lors le PE devient le principal responsable de l’exécution du
budget communautaire par la décharge qu’il donne à la Commission. Il
s’agit là de d’un moment clé, sous-évalués par l’historiographie, mais à
l’origine d’un grand élan donné à la cause de l’Europe.35
Dans le spécifique, en 1970, par le traité des ressources propres, la
Communauté accède à l’autonomie financière, alors que le PE se voit
conférer un pouvoir de décision dans le cadre de la procédure budgétaire.
34 En 1975(22 juillet), avec le traité instituant la Cour des comptes européenne.
35 CARDOC, Débats du PE , 7 juillet 1977 p.294 , en occasion de la décharge 1975.Aigner à propos du contrôle parlementaire écrit : « C’est avant tout la responsabilité politique de la Commission, en tant que telle qu’il faut mettre en evidence, et que le rapport de contrôle doit analyser.Ce rapport se fonde sur deux principes. D’abord il s’agit non seulement de juger la regularité des opérations , mais il s’agit de verifier si l’exécution du budget concrétise la volonté politique de l’autorité budgétaire.Ensuite il s’agit de coordonner l’activité de contrôle parlementaire avec les autres institutions et les Etats membres ».
15
En 1975 après avoir mis un place une véritable structure budgétaire le
PE se voit conférer finalement la prérogative du contrôle sur les finances
communautaires par l’attribution de la décharge, c’est à dire le contrôle
final du budget par le PE, compétence reconnue jusqu’alors exclusivement
au Conseil.36
Loin d’être un simple certificat de comptabilité, la décharge est
l’expression la plus importante et la plus vivante de la fonction de contrôle
au niveau parlementaire. Avec cette décision, le PE clôture les opérations
d’exécution du budget annuel par un vote de confiance ou le cas échéant
de défiance, envers la manière dont la Commission a exercé sa
responsabilité.37Ainsi la décharge ne tarde pas à acquérir une signification
politique de mise en jeu de la responsabilité de la Commission sur
l’exécution du budget devant le Parlement européen.38
36 Débat du PE, séance 9 mai 1973, intervention d’Aigner p.157.
37 Cheysson, membre de la Commission : « La décision de décharge semble relever d’une procédure formelle.Il n’es est rien.Elle est la sanction de votre contrôle sur l’exécution du budget communautaire par les institutions.Elle est l’acte final d’un processus qui commence avec l’examen du budget et se termine dans la décharge, votre droit exclusif en application du traité du 22 juillet 1975 », in CARDOC,Débats du PE, séance 14 décembre 1976, p.91
38 CARDOC, Débats PE, séance 9 mai 1973, p.182.Aigner : « Nous pouvons naturellement dire à la Commission : si vous ne nous donnez pas ce droit parlementaire en vertu du principe que les initiatives ne sont pas attribuées mais prises, nous userons notre droit de renverser la Commission.C’est le seul moyen. ».
Avec la prérogative de la décharge, avance parallelement à la responsabilité de la Commission devant le Parlement européen, le sens de la responsabilité des deputés face l’opinion publique. Notenboom écrit « Mon groupe tient à lancerun appel à tous les intéressés de ce monter ouvert au contrôle, et de rénoncer à toute réserve peut –être justifiée dans le passé.Etcelà d’autant plus que nous serons sous peu derectement responsables devant la population européenne en ce qui concerne des sommes budgétaires qui, à juste titre vont sans cesse en augmentant » in CARDOC, Débats PE,séance 14 décembre 1976, p.89.
39 AHUE, FMM(fond Franco Maria Malfatti), dossier 9, Secrètariat de la Commissioneuropéenne,« Relève des différentes positions sur les problèmes institutionnels », Bruxelles, 25 février 1972.
16
C’est le moment pour le Parlement par l’examen des comptes de faire
toute critique , pour formuler toute récomandation. C’est le moment où le
contrôle démocratique s’exprime prèsque totalement.Prèsque, car PE
jusqu’à juin 1979 n’est pas encore elu directement par les citoyens.
Et c’est sur ce tournant politique que le PE se divise tout au long des
années soixante-dix. La fraction la plus avangardiste de l’Assemblée
parlementaire comprend tout de suite que l’exercice de cette prérogative
conduit aux élections directes du PE, contrairement à la fraction la plus
conservatrice de l’Assemblée, gaullistes en tête, qui s’oppose avec
véhémence à toute ouverture en limitant le contrôle parlementaire aux
dépenses administratives, soit à 3.5% environ des dépenses totales des
Communautés.39
Ces débats s’enlisent devant l’attitude très hostile de Georges Pompidou
qui préfère renvoyer sine die la question des élections directes du PE. C’est
à ce moment que la commission budgétaire du PE entre en jeu endossant
un rôle très important dans la réappropriation de la fonction du contrôle
externe par le PE au niveau communautaire. Après avoir sondé les
différentes chancelleries européennes et après avoir constaté la prudence
des gouvernements sur l’élargissement des pouvoirs de contrôle du PE, une
poignée restreinte de députes réunis dans cette commission budgétaire
autour d’Aigner, reprennent un modèle déjà enterré pendant les années
soixante, celui d’une Cour des comptes européenne. Le traité instituant la
Cour des comptes est signé en 1975 et la Cour entre en fonction deux
années plus tard. Par cet organisme, la commission budgétaire parvient à
obtenir la décharge au PE, mais à condition de consulter la Cour des
comptes européenne , dont les membres sont élus par les Etats. 40
40Valentina VARDABASSO, -« La Cendrillon del’Histoire.La Cour des comptes européenne er la démocratisation desinstitutions en Europe », in Journal of european integration history/Revue d’histoire de la construction européenne,décembre 2011,n°34.
17
Une fois assuré un certain regard des gouvernements sur l’activité de
contrôle, l’attribution de la décharge au PE ne rencontre pas des
véritables difficultés auprès des gouvernements et il obtient cette
prérogative.41 Ainsi l’élaboration des décisions de décharge s’est déroulée
au sein des commissions budgétaires du PE.
Devant l’ampleur et l’importance de cette tâche, la commission budgétaire
a constitué d’abord un groupe de travail permanent, puis à partir de 1976,
une sous-commission. Elle a enfin réclamé la création d’une commission à
part entière. Ce fut chose faite lors de la constitution du premier Parlement
élu au suffrage universel direct en 1979. Cette coïncidence entre le
renforcement de la représentativité du PE et l’institutionnalisation du
contrôle budgétaire parlementaire correspond à une orientation politique
évidente: garantir le contrôle de l’utilisation des ressources communautaire
par les représentants des citoyens-contribuable.42
IV-L’INTERACTION ENTRE LE BUDGET ET L’ESPACE
EUROPEEN.
Le budget peut être le levier de la démocratie ou au contraire sa négation
s’il n’est pas soumis à l’approbation du Parlement. Du point de vue
politique, le budget peut caractériser un système confédéral ou fédéral ,
selon s’il est alimenté par des contributions étatiques ou relève d’une
autorité supranationale. Il peut être par ailleurs un facteur de cohésion du
41 CARDOC, Débats parlementaires, séance 7 juillet 1977, p.295.Aigner revient encore sur le contenu du contrôle parlementaire, mettant en garde le Conseil : « Tout contrôle parlementaire ne peut porter ses fruits que si ses résultats se répercutent d’une part au niveau des délibérations budgétaires et, d’autre part au niveau de l’execution du budget.(.....)Il faut que l’exécution du budget traduise la volonté du PE et de Conseil et non plus seulement la volonté du Conseil ».
42 CARDOC, DG Etudes et recherche du PE, Le contrôle parlementaire des finances communautaires, 3ème édition, 1988.
18
système politique comme une cause importante de l’explosion de ce
dernier.
A titre d’exemple, le Zollverein allemand du milieu du XIX siècle, avec
un budget commun et des droits de douane prélevés à l’extérieur des
frontières, préfigure l’unification politique des Etats allemands .De la
même façon beaucoup voient dans la prérogative du Parlement européen
en matière budgétaire un premier pas vers l’unification politique de
l’Europe.43
Elément d’unification, le budget peut aussi être une cause importante de la
dissolution du système politique. Il suffit de rappeler à ce propos la
Fédération yougoslave, dont l’éclatement a pour origine les tensions au
plan budgétaire. Ainsi, qu’il soit un tremplin d’une fédération ou une
cause de sa désintégration, le budget joue de ce fait un rôle essentiel dans
le développement d’une Communauté.
Instrument d’accompagnement de l’intégration des marchés, de
financement des politiques communes et de solidarité financière entre les
États membres de l’Union européenne (UE), le budget est à la fois un
enjeu politique, diplomatique et économique dans le processus
d’intégration européenne. La fonction budgétaire alimente et définit en
effet un espace commun de décision tout en restreignant le pouvoir de
décision aux Etats membres.
Reflet incontournable de la sensibilité des partis politiques par rapport à
l’intégration européenne, l’approbation du budget laisse apparaître un
contraste à l’intérieur de l’Assemblée entre les positions les plus avant-
gardistes - favorables à l’élargissement des compétences de la
Communauté et donc à de nouvelles ressources financières- et celles plus
réservées des conservateurs, qui, sans forcément s’opposer aux
43 Yves BERTONCINI « La révision du budget de l'Union européenne : pour une analyse politique globale », Horizons stratégiques 3/2007 (n° 5), pp. 94-119. En ligne :www.cairn.info/revue-horizons-strategiques-2007-3 page-94.htm.
19
prérogatives de la CEE, refusent l’augmentation de ses ressources et
contribuent à l’amputation des prérogatives de la Communauté au bénéfice
des Etats.44
Il va sans dire que tout en étant en puissance un important élément
fédérateur, le budget européen garde un aspect diplomatique non
négligeable. Au niveau communautaire, il opère comme un instrument de
redistribution entre les Etats membres en vue d’une meilleure justice
sociale. Toutefois, malgré les avancées des prérogatives communautaires,
les principaux arbitrages européens incombent encore aux représentants
des Etats.
L’adoption du budget procédant de considérations économiques et
diplomatiques, il a été parfois utilisé pour compenser les effets des
inégalités.
Ce faisant, les compromis budgétaires ont donné un élan important à la
cause de l’Europe. A cette fin ont été institués le « Fond social de
développement », pour amortir les chocs liés à la mise en place du
Marché Commun, ou encore la politique régionale européenne qui a pris
son essor au lendemain de l’adhésion du Royaume Uni, en retard de
développement par rapport à la moyenne commune.45
Dans l’analyse de l’interaction du budget et de l’espace européen on doit
tenir compte aussi des acteurs bénéficiant du budget et ne pas négliger les
opinions publiques. Comme la PAC est la principale bénéficiaire du budget
européen, les agriculteurs exercent une certaine influence à Bruxelles ainsi
qu’auprès des gouvernements nationaux dans les négociations budgétaires.
Au fur et à mesure qu’augmentent les ressources en faveur de la cohésion
territoriale, les organisations locales et régionales affirment leur légitimité
pour peser sur les décideurs. De ce fait, des stratégies d’influence et des
44 AHUE, fond AS, dossier 345,Intervention de Altiero Spinelli sur les ressources propres de la Communauté, Strasbourg, le 26 mars 1980.
45 Yves BERTONCINI « La révision du budget de l'Union européenne , cit.p.100.
20
rationalités différentes s’affirment dans l’espace public, et le budget
communautaire, longtemps adopté sur une base de compromis entre
gouvernements, est confrontée à des nouveaux acteurs.
Parallèlement avec la mutation de la décharge devenue un instrument
politique, la commission budgétaire du PE a joué un rôle dans le transfert
des prérogatives budgétaires du niveau national à celui européen, mais
également dans l’affirmation au niveau communautaire de certains
principes tel que le contrôle parlementaire et la responsabilité de l’exécutif
européen (la Commission) vis à vis du PE à propos de la gestion
financière.
L’ambition de donner à la Communauté une structure financière
indépendante des Etats, a encouragé un dialogue interinstitutionnel,46
élargi à la société civile, dans la mesure où celle ci se retrouve impliquée
dans les instruments des politiques communautaires tel que le FEOGA, et
les politiques régionales. On a assisté de cette façon aux avancées du droit
communautaire.
L’indépendance financière de la Communauté annonce un autre grand
principe dont il est question à maintes reprises dans les débats, celui de la
transparence budgétaire selon lequel toutes les opérations
communautaires doivent être retracées dans le budget général de la
Communauté. Dans ce but, alors que seulement les comptes d’Euratom
étaient budgétisé à l’époque , les parlementaires européens réussirent à
imposer à la totalité des institutions et organes de la Communauté, la
budgétisation des emprunts et crédits.47
46 CARDOC, Documents de séance , 30 mai 1978, Rapport fait au nom de la commission des budgets sur le dialogue interinstitutionnel relatif à certaines questions budgétaires. Rapporteur Michel Cointat.
47 CARDOC, Documents de séance 14 juin 1976, Rapport fait au nom de la commission des budgets sur le rôle et la fonction du contrôle parlementaire des ressources et des dépenses communautaires, Rapporteur Michel Cointat.
21
Le fait d’avoir le dernier mot sur l’activité de la Commission a valu au
PE la possibilité de participer à la préparation du budget, comme à
l’approfondissement du contrôle, ainsi que celle d’établir dans le domaine
budgétaire des relations avec la Commission du type législatif-exécutif. Il
est clair que par cette voie, sous impulsion de la commission budgétaire du
PE un espace public de discussion et de délibération émerge autour du
budget avec la multiplication des centres de délibération qui ne relèvent
plus seulement des gouvernements, mais impliquent aussi de nouveaux
acteurs.
Ainsi la fonction du contrôle budgétaire appelle un débat transnational,
par l’implication de sujets non étatiques, dépassant les intérêts nationaux ,
ce qui établit un espace de décision et de délibération commun.
De fait il a été tenté dans cette étude de montrer qu’ une entité politique
plus transnationale que supranationale, se construit autour du contrôle
parlementaire et si l’Union européenne ne possède pas encore un espace
public européen central, large et populaire, il existe des espaces publics
européens, sectoriels, sur une durée de temps déterminée, liés à des débats
sur des questions européennes.
Il va sans dire que le contrôle parlementaire du budget renforce les
prérogatives du PE , sans garantir pour autant sa légitimité, cette assemblée
n’étant pas encore élue au suffrage universel direct. Si au cours de la
période 1970 -1975 , l’objectif de la commission budgétaire est
l’élargissement des pouvoirs du PE au moyen du budget, une fois obtenue
la prérogative du contrôle des finances communautaires par le traité du 22
avril 1975, la priorité change. Il s’agit désormais d’assurer une légitimité
au PE par les élections directes de ses membres.
V-QUAND LA REINE FRAPPE A LA PORTE DE
WESTMINSTER……….
22
L’espace public européen ne repose pas seulement sur des normes et des
règles qui mobilisent la rationalité des sujets expliquant leurs choix, mais il
y a aussi une dimension immatérielle, qui fait recours à des imaginaires,
des représentations, des mythes, des fantasmes, bref un socle commun de
valeurs partagés.48 Si les rationalistes refusent l’imagination comme
source de la connaissance, réduisant la réalité à l’expérience, des nouvelles
études et sensibilités admettent que le domaine du politique, est traversé
par des émotions, des discours, des récits jouant un rôle déterminant. De ce
fait l’imaginaire se matérialise dans des actions informées par des
symboles , et des rituels, qui par la pratique deviennent une médiation
entre l’imaginaire et le réel, le monde externe et le monde interne, jusque à
devenir actuels pour comprendre les processus sociaux.49 C’est pour cette
raison que des cérémonies riches en symboles, bien traditionnelles, sont
encore des repères d’identification dans les cultures politiques
occidentales. Parmi ces rituels, le plus important est le discours annuel de
la Couronne en Grande-Brétagne.
En cette seule occasion c’est la Reine qui frappe à la porte de
Westminster, et entre dans ce bâtiment. La voiture arrive à peu de distance
et un héraut de la suite entre dans la salle pour informer que la Reine vient
prononcer son discours. La grande porte du Parlement est alors fermée
sur ordre du speaker.Puis, une fois accompli cet ordre, le chef de garde de
la Reine, annonce que la Souveraine demande à rencontrer les « fidèles
communes d’Angleterre ». C’est à ce moment que le speaker donne l’ordre
48 Robert FRANK , « Espace de référence culturelle , mémorielle et symbolique, espace
public, et démocratie européenne », in Gerard BOSSUAT,Eric BOUSSIERE, Robert
FRANK, Wilfried LOTH , Antonio VARSORI, L’expérience européenne .Des historiens en
dialogue, Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J/Paris, Nomos/Verlang/Baden-‐Baden, pp.211-‐233.
49 Robert FRANK (dir), Images et imaginaire dans les relations internationales depuis
1938, ed.IHTP, juin 1994, 168 p.
23
d’ouvrir la porte et la Reine fait son entrée accompagnée par la garde de
Westminster. Cet ancien rituel qui montre la soumission de l’exécutif au
législatif, remonte au XVIII ème siècle, au moment où, précisément,
Montesquieu écrivait l’Esprit des lois, texte fondateur de l’Etat de droit et
de la séparation des pouvoirs.
Cette séparation, ainsi que la responsabilité du pouvoir exécutif devant le
Parlement, précède la démocratie, et il se réalise également au sein de
monarchies dotées d’amples prérogatives.
Son introduction constitue le fondement indispensable, bien qu’insuffisant
des régimes démocratiques, dont les constitutions sont le couronnement.
S’il est vrai que l’identité européenne se nourrit aussi de représentations,
d’images, de rituels, le discours cérémonial de l’entrée de la reine au
Palais de Westminster exerce encore aujourd’hui une certaine emprise sur
les esprits réunis dans l’hémicycle de Strasbourg.
Les députés anglais, qu’ils soient conservateurs ou travaillistes⎯en dépit
des réserves du gouvernement britannique sur le système électoral
proportionnel⎯ rappellent souvent par ce rituel que si l’Etat de droit
passe par la responsabilité de l’exécutif devant le Parlement, sa
légitimation ne peut pas se fonder que sur le suffrage universel direct. 50
Et c’est sur ce principe, conforté par des images et des cultures politiques
communes, qui s’alignent les différentes forces du PE.
VI- LA COMMISSION BUDGETAIRE SUR LE TERRAIN
Alors que la commission budgétaire engage un véritable bras de fer avec le
Conseil en vue d’une réévaluation du PE par la politisation du budget, la
cause de l’Europe, sur plusieurs plans , y compris celui diplomatique,
gagne des points à son faveur. La décision du Conseil européen de Paris
50 CARDOC, Séance 12 décembre 1978, p.91.Intervention de Lord Bruce of Doningon au nom du groupe socialiste.
24
en 1976, sur les élections européennes est l’épilogue d’une longue
démarche, compliquée surtout par l’opposition du gouvernement
français.51 Il ne faut pas oublier que le Parlement européen élu au suffrage
universel direct , est déjà la préoccupation du Traité de Paris instituant la
CECA en 1951 , qui à l’article 20 prévoit une Assemblée composée par
les représentants des peuples de la Communauté. En 1957, l’article 138 du
Traité de Rome reprend cette disposition. Les années soixante, les années
du Général, enterrent dans le sommeil le Rapport Dehousse et il faut
atteindre le Sommet de La Haye de 1969, pour que ce point soit réinscrit à
l’ordre du jour du Conseil. En décembre 1974, à Paris, les chefs d’Etat et
de gouvernement, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing ,
prennent la décision de principe de procéder à des élections au suffrage
universel direct le plus tôt possible à partir de 1978. De ce fait,
l’élargissement de 1973, impose une révision du Rapport Dehousse , et
c’est un jeune député socialiste, Schelto Patijn qui est chargé de cet affaire.
Ce brillant avocat néerlandais, est chargé par le PE de rédiger un rapport
approuvé en séance plénière le 14 décembre 1975 avec 106 votes
favorables, 2 négatifs , et 17 abstentions, venant des communistes et des
gaullistes.52 Pour ne pas achopper sur la question des différents systèmes
électoraux nationaux, le rapport Patijn renvoie la décision d’adopter une
procédure électorale uniforme aux élections suivantes,et propose pour la
première élection un Parlement élu au suffrage universel pour 5 ans selon
les modalités de scrutins nationaux. Donc pour les élections de juin 1979,
il appartient à chaque Etat membre d’établir la méthode ou le système
pour exercer le droit de vote.
51 Marie Thérèse BITSCH, La construction européenne :enjeux et choix institutionnelles, Peter Lang, 2007, pp.235-239.
52 CARDOC Rapport Patjin fait au nom de la commission politique sur le droit de vote dans les élections directes, 19 avril 1977, doc.43/77
25
Le réalisme, dont ce projet est porteur, lui vaut l’approbation soit des
parlementaires ainsi que des Etats membres qui le retiennent comme base
de négociations au sein du Conseil, pourparlers qui aboutissent à l’Acte
du 20 septembre 1976.
Si cette recherche porte sur la commission budgétaire, il ne faut pas
négliger l’apport des autres commissions parlementaires, avec lesquelles la
commission budgétaire a interagi, en vue de la démocratisation des
institutions européennes. La commission des affaires politiques et des
questions institutionnelles par exemple a fortement interagi avec la
commission budgétaire pour promouvoir l’élection directe des députés
européens au suffrage universel direct. Née en 1958,elle est fréquentée par
Michel Debré, Pierre-Henri Teitghen, Antoine Pinay ou Fernand
Dehousse. De 1958, date de sa création jusqu’à 1969, année du Sommet
de La Haye qui met dans l’agenda du sommet européen le suffrage
universel direct du PE, la commission politique propose l’investiture
directe comme le moyen pour donner au Parlement une « légitimité et une
force desquelles il tirera un pouvoir politique ».53 Les deux rapports
principaux concernant les élections directes du PE, c’est à dire le rapport
Dehousse (1960) et le rapport Patijn (1975), relèvent de la commission
politique.
Son interaction avec la commission budgétaire est évidente le 10 juillet
1975 quand sur initiative conjointe de ce deux commissions, le PE adopte
le rapport Bertrand (B/DC) sur l’Union européenne. La résolution
demande que le futur PE ,ayant désormais les pouvoirs de contrôle,
devienne au moins à titre paritaire le véritable organe législatif de la
Communauté et que un centre de décision européen, avec les fonctions de
53 Selma Nendjaballah « Politisation du PE et commissions parlementaires.Représentativité partisane et normative », in ROZIENBERG, « Les élections européennes et le PE entre influence et indifférence », cit.p.103-107.
26
gouvernement, indépendant des gouvernements nationaux, soit
responsable devant le Parlement .54
VII- 1976 ALTIERO SPINELLI MEMBRE DE LA COMMISSION BUDGETAIRE. LE FEDERALISME FISCAL EUROPEEN
La nécessité d’une investiture populaire du PE devient encore plus
évidente lorsque le PE obtient le contrôle de la décharge en 1978 sur
l’exécution du Fond européen de développement. Cela a encore constitué
un pas en avant dans la démarche communautaire européenne et une
occasion pour la commission budgétaire d’agir. Les députés européens ne
manquent pas de souligner que le PE, selon le traité 1975, doit donner son
appréciation au contenu de la nouvelle Convention de Lomé. 55Ce dernier
doit également participer à la budgétisation du FED, c’est à dire décider
des critères de fixation du montant global des crédits pour la coopération
financière et technique, du volume de la dotation, du régime administratif,
et financier des services de gestion. Or il s’agit d’un domaine de
compétence propre à la Commission , au Conseil , au comité du FED et au
Conseil ACP-CEE : le PE en est encore partiellement exclu. Pourtant,
devant une éventuelle renégociation de la Convention de Lomé et une
redistribution des crédits, une nouvelle légitimation des députés européens
devient de plus en plus nécessaire pour assurer une implication plus forte
du PE, puisque il est appelé à se prononcer sur la budgétisation du FED.56
54 50 ans d’Histoire du groupe du PPE au service de l’Europe unie 1953-‐2003,cit.pp.92-‐95.
55 CARDOC, Rapport fait au nom de la commission budgétaire du PE relatif au contrôle parlementaire sur les opérations financières du fond européen de dévoloppement, 3 juillet 1978, rapporteur Martin Bangemann.
56 ibid.
27
Tel est le climat général au lendemain du traité de 1975 : la commission
budgétaire a été à l’origine de remarquables résultats pour le PE, qui
manque encore de députés reconnus et élus par tous.
Spinelli arrive à la commission budgétaire en 1976, après une parenthèse
de cinq ans à la Commission européenne57. L’atmosphère change, il donne
du brio et de l’enthousiasme à une commission qui, après avoir obtenu le
pouvoir absolu de décharge pour le Parlement ne sait plus quelle nouvelle
stratégie d’action adopter.
L’opportunité de ce moment historique n’échappe pas au député italien, en
même temps membre de la commission budgétaire et de la commission
politique du PE depuis 1976. Il joue sur les deux tableaux, son objectif
étant d’accélérer la mise en pratique des élections directes pour le PE par
l’accroissement des compétences et des ressources de la Communauté.
Cette démarche se situe déjà à un stade avancé, Aigner ayant bien creusé le
sillon les années précédentes.
Sa perspicacité joue en sa faveur ; dans les débats, Spinelli fait preuve d’un
grand optimisme. Il apparaît alors bien éloignés de l’esprit de Santiago, le
pêcheur protagoniste du roman d’Heminguay, auquel il ne manque pas de
se comparer dans ses mémoires après l’échec de son projet pour une
Constitution européenne. Au fur et à mesure que les débats avancent , la
direction que prend l’évolution institutionnelle souhaitée depuis longtemps
par Spinelli et vers laquelle convergent désormais aussi bien les
démocrates chrétiens que les socialistes, se précise dans l’hémicycle
strasbourgeois. L’élection des députés européens devrait permettre une
57 Piero GRAGLIA, Altiero Spinelli, ed.Il Mulino, 2008, p.634.
28
plus grande européanisation du PE par la formation de grandes forces
politiques de dimension non plus nationale mais européenne. De ce fait,
par la légitimation électorale, le PE doit devenir une institution bénéficiant
de plus de pouvoir et de poids dans le processus décisionnel.
Pour le député italien, la méthode communautaire doit être préservée. Il ne
s’oppose pas aux réunions de chefs d’Etat et de gouvernements en marge
des institutions communautaires : il semble nécessaire de chercher une
solution à l’intérieur même des institutions et de la Communauté et non
auprès des gouvernements. 58
Dans les discours de Spinelli il n’y a pas encore les limites de cette
stratégie qui par le suffrage directe du PE n’a pas colmé le deficit
démocratique, tout laissant aux débats politiques une coloration nationale.
Ces réflexions ont un certain intérêt aussi sous le profil fiscal; dans les
débats ressort que, parallèlement aux réflexions sur le suffrage universel
sont reprises des idées déjà avancées par la Commission européenne
quelques années avant, sur le fédéralisme fiscal au niveau européen.Mais
cette fois, à la fin des années soixante-dix, le contexte politique où ces
discussions avancent est bien différent, ce dernier étant marqué à la fois
par les trois événements les plus importants dans l'agenda européenne:
l'élargissement, l' approfondissement, élections directes du PE.L'ouverture
de la Communuaté à trois nouveaux membres(Grèce, Espagne,
Portugal),donc la nécessité de nouvelles ressources,59 la création du
Sistème monétaire européen,dans la perspective d'une monnaie unique,
58 AHUE, fond AS, dossier 345,Strasbourg, 26 mars 1980, Document de travail de Spinelli sur les ressources propres de la Communauté.
59 AHUE, fond AS 345, Note de Spinelli , sans date, adressée au Conseil et au PE sur le parcours à suivre dans les années à venir en matière budgétaire.Il faut prendre en considération des elémets :l’elargissement de la Communauté qui comporte un augmentaion du budget et la budgétisation du Fond social européen.
29
rendent nécessaire et évident le lien entre politique monétaire et politique
budgétaire, car une politique monétaire efficace, élément clé de toute
intégration, demande un transfert de ressources massif des pays riches aux
pays pauvres.A cette date c'est claire désormais que à cause du caractère
évolutif de la CEE, la nature et la fonction du budget doivent faire l'objet
d'un processus continu d'adaptation aux nouvelles réalités politiques de la
Communuté. De ce fait, à la veille des élections de juin 1979, fort de ses
nouvelles prérogatives, les réflexions du PE en matière budgétaire se
dédoublent dans la compatibilité entre fédéralisme supranational et
espace régional, et dans la possibilité de concilier l'Europe des autonomies
et la pluralité des Etats avec une leadership européenne. Si l'idée de fond
qui anime les débats de la commission budgétaire dans la période 1976-
1979 remonte à Musgrave (1959) et à sa théorie sur le fédéralisme
budgétaire , selon laquelle le maximum du bien être résulte de la
centralisation de la fonction allocative et de la décentralisation de la
fonction distributive des finances publiques, il faut atteindre le rapport Mac
Dougall en 1977 pour que cette théorie franchisse le périmètre
communautaire.
C'est envers la fin de l'année 1976, que la Commission européenne confie
à un groupe d'experts une étude sur le rôle des finances publiques dans
l'intégration européenne. Ce rapport, qui est resté longtemps un document
guide dans la matière , voit fortement engagé un économiste écossais,
Mac Dougall,60 qui depuis longtemps réfléchissait autour la comparaison
des budgets des entités fédérales de l'époque, tel que les Etats Unis, la
Suisse , le Canada. Ses conclusions, attirent l'attention sur le fait que une
monnaie fonctionnant de façon harmonieuse suppose un budget
communautaire de 5 à 7% pour avoir des effets de compensation et
redistributions comparables à ceux dont bénéficient certains pays fédéraux
60 Chief economic adviser of confederation of british industry London.
30
comme les Etats Unis.61 Spinelli dans ses interventions au PE montre de
partager pleinement l’analyse de Mac Dougall.62
Un document qui fait surface à la suite des élections de juin 1979, dévoile
le plan et les limites du fédéraliste italien alors à la commission
budgétaire du PE. 63
Il sait bien que, la Communauté européenne peut avoir un poids politique
plus fort, à condition d'un budget commun plus important.Le fédéralisme
budgétaire est la seule voie pour couper la dynamique des egoïsmes
nationaux, qui ont bloqué le budget communautaire à 1%du PIB.
Soustraire la gestion budgétaire aux Etats, au profit d'une autorité
supranationale, implique la fin d'un certain individualisme qui conduit le
Royaume Uni à tout conditionner en fonction d'une diminution de sa
contribution nette, pas différemment des pays de l'Europe du Sud
sensibles seulement à la défense des fonds structurels et de la France, qui,
inquiète pour le juste retour, défend la politique agricole commun en
dépit des autres politiques communes.
Plusieurs fois à Strasbourg comme à Bruxelles, dans sa querelle avec les
représentants du Conseil des Etats, Spinelli a l'occasion d'affirmer sa
position par rapport à la PAC. Il souhaite à maintes reprises réduire le
budget européen de celle-ci qui fait la partie du lion, à faveur d'autres
politiques de la Communauté, considérées de deuxième rang,telle que la
61 Rapport Mac Dougall ou « Report of the study group on the role of public finance in european integration » , Bruxelles, avril 1977, sur le site ec.europa.eu/economy –finance
62 AHUE fond AS dossier 345,PE, procès verbal de la réunion 23 et 24 janvier 1980. Spinelli à propos du rapport entre masses financières communautaires et nationales invite à suivre le rapport Mac Dougall.
63 AHUE fond Spinelli dossier AS 345, ,Strasbourg, 26 mars 1980, Document de travail de Spinelli sur les ressources propres de la Communauté, cit. en note 58.
31
recherche ou les politiques régionales. Son attention pour la politique
régionale s'explique pour son rôle clé dans une éventuelle redistribution
budgétaire. Suivant un point de vue keynésien, le marché ne rejoint pas uns
situation optimale:le budget , utilisé de façon contra cyclique, peut
détourner les inégalités à faveur de la croissance.La redistribution des
revenus est un souci d'équité et de justice, car cette fonction sert à réduire
les desequilibres.
En tant que membre de la commission budgétaire, Spinelli se pose donc
sur la ligne de continuité du rapport Mac Dougall: le fédéralisme
budgétaire lui semble d'abord la solution la plus efficace contre le
repliement des Etats sur des politiques budgétaires nationales. Un
Parlement légitimé par le suffrage universel,est habilité à intervenir dans la
phase de contrôle comme dans l'idéation du budget et par là dans les
politiques redistributives.De ce fait, son action est une tentative de mise
en pratique de certaines idées du fédéralisme fiscal qui avant lui avaient
déjà retenu l'attention de l'hémicycle bruxellois.
Conclusions LA POLITISATION DU BUDGET,
L’EUROPEISATION, LA DEMOCRATISATION
Revenons en conclusion à notre question: est -ce que la politisation du
budget a été suivie par l'européanisation et la démocratisation du
politique?
Autrement dit, le contrôle du PE sur le budget a -t-il favorisé un processus
d'européanisation de la société civile par la synchronisation des objectifs
et des politiques financières comme par la création d'une classe politique
supranationale? Il va sans dire que, cette catégorie de contrôle, a favorisé
la création d'un espace politique de délibération et de circulation des
idées, un phénomène d'identification dans des cultures politiques
communes, et donc par l’ accroissement des competences de l’Union
32
européenne il a été evidemment un outil d’intégration et parfois de
solidarisation .64
La commission budgétaire65 de sa part, tout au long des années
soixante-dix jusqu'aux élections de juin 1979, a été fondamentale dans
l'ouverture des débats sur le budget à une compétition partisane entre
droit et gauche, qui toutefois n’a pas rempli le clivage entre les élites et
les citoyens.
Cette politisation a esquissé donc un espace politique dans un sens plus
transnational que supranational. Et l’intégration sollicitée par le contrôle
budgétaire n’a pas impliquée l’européisation du politique, étant le
domaine financier fortement marqué par l’individualisme des Etats.
Par rapport aux crises financières, les attaques de Spinelli contre le
caractère trop individualiste des Etats auraient été les mêmes dans la
crise des années soixante dix comme dans la crise d’aujourd'hui.
64 CARDOC, documents de séance 12 mars 1979, Rapport fait au nom de la commission des budgets sur les orientations du PE concernant la politique budgétaire pour l’exercice 1980.Rapporteur M.Bangemann.
65 Pour la reconnaissance complète du PE comme coautorité budgétaire
voir :Pascal FONTAINE, Voyage au coeur de l’Europe,1953-2009,
ed.Racine, 2009,pp. 191-199.