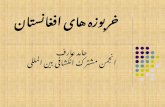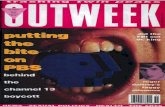Oupouaout-Rê, l'agitateur d'Assiout ? GM 218 (2008), 71-76.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Oupouaout-Rê, l'agitateur d'Assiout ? GM 218 (2008), 71-76.
Oupouaout-Rê, l’agitateur d’Assiout ?
Pierre Meyrat
Cette petite contribution est dédiée au Professeur Michel Valloggia,
à l’occasion de son prochain départ à la retraite, en lui souhaitant ! Dans sa publication de la stèle de P“-T“-wrt (BM 1632)1, un document probablement ramesside originaire d’Assiout, Hellmut Brunner signale trois signes de lecture malaisée, dans le registre inférieur, à la fin de la première colonne du passage consacré à Oupouaout-Rê2 :
fig. 1a 3 fig. 1b
4
Comme l’arme du dieu passe juste en dessous de cette colonne (fig. 2a), l’artiste n’a pas eu beaucoup de place pour en écrire les derniers hiéroglyphes. Les mots p“ ‡d qui précèdent ont jusqu’ici été compris comme « le sauveur » malgré l’absence de déterminatif approprié, et les trois signes en question n’ont, à notre connaissance, jamais été déchiffrés. Une petite recherche lexicographique nous incline à voir dans ces derniers le mot !rw (fig. 2b), écrit avec les signes P 8 (plutôt ramassé et difficilement identifiable)5 et Z 7 (ici inversé comme dans le toponyme S“wt(y) : on attendrait ), suivi par le déterminatif du dieu assis A 40 (on distingue une légère proéminence représentant la tête).
fig. 2a 6 fig. 2b
1 H. Brunner, ‘Eine Dankstele an Upuaut’, MDAIK 16 (1958), pp. 5-19 et pl. III. Voir aussi : A. I. Sadek, Popular Religion in Egypt during the New Kingdom, HÄB 27 (1987), pp. 41-42 ; D. Kessler, ‘Die kultische Bindung der Ba-Konzeption, 2. Teil : Die Ba-Zitate auf den Kultstelen und Ostraka des Neuen Reiches’, SAK 29 (2001), pp. 162-168 ; T. DuQuesne, ‘Exalting the God. Processions of Upwawet at Asyut in the New Kingdom’, DE 57 (2003), pp. 42-45. D’après Terence DuQuesne, spécialiste du dossier, cette stèle provient certainement de la tombe dite « de l’abattoir » ( salakhânat : abattoir), cf. DuQuesne, ‘The Salakhana Stelae. A Unique Trove of Votive Objects from Asyut’, in J.-C. Goyon et C. Cardin (éds), Actes du neuvième congrès international des égyptologues, Grenoble, 6-12 septembre 2004, OLA 150/1 (2007), p. 463. 2 Une forme assez rare d’Oupouaout qui apparaît au Moyen Empire ; il est presque toujours appelé Nb ”bƒw, « seigneur d’Abydos », cf. LGG II, p. 346. Voir aussi les travaux de DuQuesne : DE 57, p. 44 (i), ‘Empowering the Divine Standard. An unusual motif on the Salakhana Stelae’, DE 58 (2004), p. 54 (b) et The Jackal Divinities of Egypt, I : From the Archaic Period to Dynasty X, Darengo, Londres, 2005, p. 395 (§514). 3 D’après Brunner, MDAIK 16, p. 7. 4 D’après M. L. Bierbrier (éd.) with drawings by R. Parkinson, Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae, Part 12, British Museum Press, Londres, 1993, pl. 83 (1. 1632). 5 Cette écriture de P 8 est toutefois comparable à ses autres occurrences dans la stèle (dans la formule m“©-!rw). Je remercie vivement le Dr. Richard Parkinson d’avoir bien voulu examiner à nouveau le document et de m’avoir confirmé la vraisemblance de cette lecture (communication personnelle du 14 mars 2008). 6 D’après Brunner, MDAIK 16, pl. III.
L’ensemble devrait donc être lu : p“ ‡d-!rw « l’agitateur », « le furieux », « celui qui élève la voix »7 (Wb. IV, 566, 6-7). L’épithète divine ‡d-!rw, qui désigne généralement le dieu Seth8, apparaît avec cette écriture dans les Coffin Texts.9 Dans la « confession négative » du chapitre 125 du Livre des Morts, le 23e assesseur, également appelé "d-!rw, est parfois représenté avec une tête de canidé.10 Dans la deuxième colonne du texte, il faut certainement voir, comme le propose Sadek11, une écriture réduite de la conjonction néo-égyptienne µrm « et » (Wb. I, 115, 20), dont l’élément rm est également associé au déterminatif (K 5) pour écrire le mot « poisson ». L’usage de la conjonction (préposition + 1er élément + µrm + 2e élément) est ici similaire au papyrus Chester-Beatty I, E 1-3 : n s‡ X. µrm µmy-r m‡© Y. µrm Z. « au scribe X. et au général Y. et à Z. »12 Ce passage de la stèle devrait donc être translittéré et traduit de la manière suivante :
Wp-w“wt-R© nb µ“w p“ ‡d-!rw S“wt(y) r “d µrm rm nb
Oupouaout-Rê, maître de l’adoration13, l’agitateur d’Assiout, contre l’agressif14 et tout poisson.
Il ne s’agit donc pas de faire appel à la miséricorde de ce dieu chacal, mais à ses tonitruants glapissements de colère15, qu’il peut déchaîner contre ses ennemis squameux.16 En outre,
7 La « voix » de Seth est le tonnerre, cf. N. Shupak, ‘« He hath subdued the water monster/crocodile » : God’s
Battle with the Sea in Egyptian sources’, JEOL 40 (2006-2007), p. 81 n. 24. 8 Cf. LÄ V, 909 et LGG VII, pp. 158-159. Elle désigne aussi le prêtre-ouâb de Seth à Ta-chénet, où le dieu s’est transformé en crocodile, cf. J. Vandier, Le Papyrus Jumilhac, CNRS, Paris, 1961, p. 133 (XXII, 23) et P. Derchain, ‘L’auteur du papyrus Jumilhac’, RdE 41 (1990), p. 19 et p. 22 (q). 9 CT II, 107a, col. B2L (avec G 43 au lieu de Z 7). 10 Cf. R. O. Faulkner, Book of the Dead, British Museum, Londres, 1985, p. 29 (photo) et p. 32 : « O Disturber who came forth from Weryt, I have not been hot-tempered. » 11 Sadek, HÄB 27, p. 42 n. 1. 12 Cf. A. H. Gardiner, The Chester Beatty Papyri, No. I, Oxford University Press, Londres, 1931, p. 44, pl. XXVIII et A. Erman, Neuägyptische Grammatik, 2. völlig umgestaltete Auflage, Geschrieben von W. Erichsen, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1968, p. 87 (§. 196.1). 13 Cf. LGG III, p. 570. Tout en fuyant le crocodile, le personnage semble adresser un geste d’adoration au dieu. 14 Le mot “d (Wb. I, 24) désigne ici le crocodile, cf. P. Wilson, ‘Slaughtering the crocodile at Edfu and Dendera’, in S. Quirke (éd.), The Temple in Ancient Egypt : New Discoveries and Recent Research, British Museum Press, Londres, 1997, p. 193 ; la stèle est aussi mentionnée p. 181. Crocodile et poisson servent de déterminatifs pour les animaux aquatiques dangereux (µmyw-mw, Wb. I, 74, 7), cf. K. C. Seele, ‘Oriental Institute Museum Notes : Horus on the Crocodiles’, JNES 6 (1947), p. 47 n. 45 et p. 48 et Wilson 1997, p. 193. Le crocodile vit de poissons, cf. CT II, 42c et S. Bickel, ‘Un hymne à la vie. Essai d’analyse du Chapitre 80 des Textes des Sarcophages’, in N. Grimal et al. (éds), Hommages à Jean Leclant, BdE 106/1 (1994), p. 87. Pour l’association de ces animaux, voir P. Vernus, Athribis, BdE 74 (1978), p. 387 n. 1. Notons finalement que dans Job 40 : 31, le harponnage du Léviathan, monstre associé ici au crocodile, est comparé à celui d’un poisson : « Cribleras-tu sa peau de dards, le harponneras-tu à la tête comme un poisson ? », La Bible de Jérusalem, traduction française sous la direction de l’École biblique de Jérusalem, nouvelle édition, Desclée de Brouwer, Paris, 2000, p. 918. Voir à ce propos C. Uehlinger, ‘Leviathan’, in K. van der Toorn et al. (éds), Dictionary of deities and demons in the Bible (DDD), 2e éd., Brill, Leyde - Boston - Cologne, 1999, pp. 513-514. 15 Les canidés représentés derrière le dieu semblent confirmer son aspect de ‡d-!rw « qui élève la voix ». Sur leur nombre, voir l’hypothèse de M. Rochholz, Schöpfung, Feindvernichtung, Regeneration : Untersuchung zum Symbolgehalt der machtgeladenen Zahl 7 im alten Ägypten, ÄAT 56 (2002), p. 141. 16 Ce dieu canidé harponnant un crocodile rappelle l’illustration d’un papyrus amulette de Deir el-Médinet, comme l’indique T. DuQuesne, ‘Seth and the Jackals’, in W. Clarysse, A. Schoors, H. Willems (éds), Egyptian religion the last thousand years, Studies Dedicated to the Memory of Jan Quaegebeur, Part I., OLA 84 (1998), p. 617, p. 628 pl. 1.2 et DE 57, p. 45. Le même type de scène apparaît, bien plus tard, au milieu de la face avant de la stèle de Metternich, juste en dessous des pieds de l’enfant-Horus, cf. N. E. Scott, The Metternich Stela, BMMA, New Series Vol. 9 No. 8, New York, avril 1951, p. 206.
l’association de cette épithète au dieu Seth est intéressante, car ce dernier est parfois remplacé par Oupouaout, comme le souligne DuQuesne.17 Pour cet auteur, le crocodile de notre stèle représente le serpent Apophis, ce que semble confirmer notre lecture : Oupouaout-Rê « l’agitateur » serait ici une forme à la fois solaire et typhonienne du dieu d’Assiout. Or, la tâche traditionnelle de Seth est de protéger la barque de Rê contre les attaques d’Apophis.18 Ces jeux de syncrétismes, replacés dans le contexte lycopolitain et aquatique des mésaventures de Pataouret, expliquent peut-être en partie le rôle et l’épithète endossés ici par ce dieu canidé.
fig. 3 19
Concernant le registre inférieur droit de la stèle (fig. 3), consacré à Amon, nous aimerions également proposer les lectures suivantes : a) le grossier déterminatif d’animal qui suit le nom Ómn est certainement le lion debout (E 22), comme l’a démontré Guglielmi20, figurant ici dans l’expression m“µ pÌty « puissant lion », présentée dans le Wörterbuch (I, 540, 13) avec le félin couché rw (E 23).
b) l’oiseau p“ (G 40) placé après le mot ƒ“mw serait-il simplement une abréviation du nom P“-T“-wrt, écrit dans le mauvais sens pour mieux le mettre en valeur ? Dans certains cas, une graphie abrégée ne résulte que de « l’investissement de l’espace par l’inscription. »21 c) µmµ dµ=k : cette forme est vraisemblablement une « extension de l’impératif », suivie d’un subjonctif à la 2e personne.22
17 DuQuesne, OLA 84, pp. 621-622. Seth est parfois représenté comme un canidé, cf. N. Durisch Gauthier, ‘Sur les traces de Thot chien. À propos de Plutarque, De Iside et Osiride, 11, 355 B’, BSÉG 25 (2002-3), p. 52 n. 76. 18 Cf. N. Shupak, JEOL 40, pp. 80-81. 19 D’après Brunner, MDAIK 16, pl. III. 20
Cf. W. Guglielmi, ‘Die Funktion von Tempeleingang und Gegentempel als Gebetsort. Zur Deutung einiger Widder- und Gansstelen des Amun.’, in R. Gundlach et M. Rochholz (éds), Ägyptische Tempel- Struktur, Funktion und Programm (Akten der Ägyptologischen Tempeltagungen in Gosen 1990 und in Mainz 1992), HÄB 37 (1994), pp. 56-57, n. 16-17 (lire BM 1632 et non 1631) et LGG III, p. 209. Pour un autre lion représenté avec la queue retroussée sur le dos, dans la même expression, cf. A. Heissa, ‘Zum Lepidotos-Fisch als eine Erscheinungsform des Osiris’, GM 124 (1991), p. 47 Abb. 1 (JdE 47969, registre inférieur). Pour l’association du lion à Amon, cf. C. de Wit, Le rôle et le sens du lion dans l’Égypte ancienne, 2e éd., Gaber Aly Hussein, Louxor, pp. 215-220. 21 P. Vernus, Le surnom au Moyen Empire, Studia Pohl 13, Biblical Institute Press, Rome, 1986, p. 113.
d) pÌ-s(w) : pour les derniers signes de la colonne, nous y voyons, comme Sadek23, une écriture du verbe pÌ « atteindre », mais pris dans son sens agressif : pÌ-sw « celui qui l’attaque »24, avec le sw écrit d’un simple s (O 34) par manque de place. Ici encore, le mot msÌ (crocodile) est évité pour des raisons magiques : évoquer un être par son vrai nom, c’est accroître son potentiel néfaste.25 Nous proposons de translittérer et traduire ce passage comme suit :
Ómn m“µ pÌty n p“ ƒ“mw P“-(T“-wrt) µmµ dµ=k pÌ-s(w)
Amon, puissant lion pour le jeune homme26 Pa(taouret), puisses-tu immobiliser27 son agresseur.
Un crocodile nommé Maga est également associé à Seth, dont il est le fils28, et une formule du papyrus magique Harris servant à le repousser fait expressément appel au dieu Amon.29 Elle doit être récitée sur une représentation tétracéphale de ce dieu entouré d’une ogdoade en prière, dessiné sur le sol avec un crocodile sous les pieds : ce dernier point, en plus de préfigurer les stèles d’Horus « sur les crocodiles », n’est pas sans rappeler l’illustration de notre document. Le saurien serait donc, cette fois, associé à un animal séthien.
fig. 4 Sur un scarabée daté de la XXVIe dynastie trouvé près de Haïfa (fig. 4)30 figure un dieu couronné de l’atef à cornes , représenté dirigé vers la droite, au-dessus d’un crocodile dont
22 Avec un sens de souhait renforcé : « permets que », « fais que », « puisses-tu », cf. M. Malaise et J. Winand, Grammaire raisonnée de l’égyptien classique, AegLeod 6 (1999), pp. 514-515, §§ 841-842. 23 Sadek, HÄB 27, p. 42 n. 5. 24 Cf. Wb. I, 534, 7 ; D. Meeks, ALex 79 p. 100 (79.1016) ; Y. Koenig, ‘Le contre-envoûtement de Ta-i.di.Imen. Pap. Deir el-Médineh 44’, BIFAO 99 (1999), p. 265 (o). Cette solution avait déjà été proposée par Guglielmi, HÄB 37, p. 57 n. 17. 25 Pour le crocodile, on préfère soit un euphémisme, comme « l’habitant du marais » (Wb. IV, 415, 6-7), cf. J. F. Borghouts, AEMT, p. 83 (122), soit une épithète décrivant son caractère agressif : voir à ce propos les listes établies par Wilson 1997, pp. 193-197 ; C. Leitz, Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, HPBM VII (1999), pp. 4-8 (pBM 9997, Incantation 2) ; N. Shupak, JEOL 40, pp. 79-80 n. 14. 26 Le mot ƒ“mw, normalement écrit comme un collectif, désigne les troupes de conscrits recrutés pour une campagne militaire ou d’intérêt général, à l’âge de 20 ans (âge où s’achève la formation) : on peut en conclure que Pataouret avait 20 ans environ au moment de l’incident. Cf. J. Lopez, ‘L’auteur de l’Enseignement pour Mérikarê’, RdE 25 (1973), p. 182 (a) et E. Feucht, Das Kind im Alten Ägypten : die Stellung des Kindes in Familie und Gesellschaft nach altägyptischen Texten und Darstellungen, Campus Verlag, Frankfurt/Main, 1995, pp. 556-557. 27 Extrapolé du sens « placer » donné à (r)dµ, cf. par exemple Wb. II, 467, 29 : placer (les ennemis) dans un endroit (prison). De l’extrémité de son sceptre, qui vise la tête du crocodile, le dieu semble arrêter celui-ci. 28 Il sera plus tard identifié à Seth, cf. W. Helck, ‘Maga’, in LÄ III, 1133 et Wilson 1997, p. 181 et pp. 193-194. 29 Leitz, HPBM VII, pp. 38-39 (pBM 10042, VI, 4-9). Notons au passage que ‘sous ses pieds’ (ßr rdwy=f) pourrait aussi se traduire par « à ses ordres, en son pouvoir », cf. A. Théodoridès, ‘Mettre des biens sous les pieds de quelqu’un’, RdE 24 (1972), p. 190. 30
Je remercie chaleureusement le Prof. Othmar Keel de m’avoir autorisé à reproduire ici cette illustration, tirée de O. Keel et al., Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel, Band II, OBO 88 (1989), p. 272 (fig. 95).
il harponne la tête ; du haut de son pagne pend une queue de taureau qui descend jusqu’au niveau des pieds et derrière lui, à la verticale, se trouve une forme qui ressemble à un poisson, tête en bas. Isis fait face au dieu dont le visage, peu détaillé, est assez allongé et évoque celui d’un bélier : il s’agit sans doute, ici encore, du dieu Amon.31 La situation de notre stèle évoque également les fameux « charmes d’eau » (Ìsw-mw) censés écarter les crocodiles lors d’un passage à gué de troupeaux, thème bien connu dès l’Ancien Empire, et évoqué au Nouvel Empire dans la poésie amoureuse.32 Par certains gestes (bras tendu et index pointé, gestes d’autorité)33, les bouviers contribuaient à la réussite de la formule : on pourrait comparer à cela la position du sceptre-was brandi par Amon, qui vise la tête du crocodile. Ce sceptre, dont la partie supérieure rappelle la tête de Seth, est peut-être associé à la puissance chaotique de ce dieu, qu’il sert à maîtriser.34 Il est muni d’une terminaison fourchue qui a certainement pour origine la forme en Y du « bâton à serpent » ©bwt (Wb. I, 176, 16), représenté par le signe (O 30 inversé, voir aussi le signe A 20), utilisé dès les époques anciennes pour se débarrasser de ces reptiles : les notions de bien-être et d’autorité associées au was proviennent peut-être de cette fonction pratique, comme le souligne Cherf.35
fig. 5 31
Cf. O. Keel et al., OBO 88, pp. 271-272 (fig. 95). L’Amon de Pnoubs est représenté en criosphinx couronné de l’atef à cornes sur une plaquette de la XXVe dynastie (Chabaka), cf. D. Valbelle, ‘L’Amon de Pnoubs’, RdE 54 (2003), p. 192 fig. 1 et p. 207. Il pourrait toutefois s’agir de Khnoum ou Hérichef, plus habitués qu’Amon au port de la couronne atef, cf. S. Bickel, ‘L’iconographie du dieu Khnoum’, BIFAO 91 (1991), pp. 58-66 et G. Mokhtar, ‘Similarity between the Ram Gods of Ihnasya and Elephantine’, MDAIK 47 (1991), pp. 253-254. 32 Sur ces incantations, cf. Borghouts, AEMT, p. 83 (122) ; R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, SAOC 54 (1993), pp. 225-228 ; Y. Koenig, ‘L’eau et la magie’, in B. Menu (éd.), Les problèmes institutionnels de l’eau en Égypte ancienne et dans l’Antiquité méditerranéenne, BdE 110 (1994), pp. 245-247 ; B. Mathieu, La poésie amoureuse de l’Égypte ancienne, Recherches sur un genre littéraire au Nouvel Empire, BdE 115 (1996), p. 98, p. 106 n. 349 et p. 231 n. 771. 33 Cf. Ritner, SAOC 54, p. 227 n. 1051 ; Y. Koenig, Magie et magiciens dans l’Égypte ancienne, Pygmalion, Paris, 1994, p. 75 et du même auteur, ‘L’eau et la magie’ (2), in A. Amenta et al. (éds), L’acqua nell’Antico Egitto, Proceedings of the First International Conference for Young Egyptologists, Italy, Chianciano Terme, October 15-18, 2003, Egitto Antico 3 (2005), pp. 93-94. 34 Cf. DuQuesne, OLA 84, pp. 622-623 et A. H. Gordon et C. W. Schwabe, ‘The Egyptian w“s-Scepter and its Modern Analogues : Uses as Symbols of Divine Power or Authority’, JARCE 32 (1995), pp. 188-190. 35 W. J. Cherf, ‘The Function of the Egyptian Forked Staff and the Forked Bronze Butt : A Proposal’, ZÄS 109 (1982), pp. 86-89 et p. 97. On peut voir ce sceptre au bras d’un personnage (aveugle ?) travaillant aux champs, dans une tombe de la XVIIIe dynastie (Menna : TT 69), cf. W. Sameh, Alltag im alten Ägypten, Georg D. W. Callwey, Münich, 1963, p. 34 et T. Dothan, ‘Forked Bronze Butts from Palestine and Egypt’, IEJ 26 (1976), p. 32 fig. D. On peut d’ailleurs se demander si le signe (Aa 21), présenté par Gardiner comme un « outil de charpentier » avec un point d’interrogation, ne représente pas plutôt le bâton à serpent muni d’une traverse de bois : ce signe, lu wƒ©, signifie en premier lieu « trancher » (la tête d’un animal, Wb. I, 404, 3), cf. Cherf, ZÄS 109, p. 94 et p. 95 fig. 6. Voir aussi l’hypothèse de J.-P. Corteggiani, ‘La « butte de la Décollation », à Héliopolis’, BIFAO 95 (1995), p. 147 et pp. 149-151, qui y voit un « bloc de bois et la lame de l’herminette qui y est fichée ».
Bien qu’une bonne prise sur le cou d’un crocodile soit difficilement envisageable avec un tel sceptre (!), il peut symboliquement remplir la même fonction et être utilisé contre cet animal : c’est par exemple le cas dans la vignette (fig. 5)36 du chapitre 31 d’un Livre des Morts sur papyrus37, où le défunt, normalement armé d’un harpon, est représenté avec un was.38 Comme on peut le constater, le sceptre-was fait partie de l’attirail magique exploité par les dieux et les hommes pour repousser les manifestations du chaos, qu’elles soient ophidiennes ou crocodiliennes, ces créatures dangereuses étant par nature associées soit à Apophis, soit à Seth, soit aux deux selon les circonstances. Par l’aspect de ses extrémités – tête de Seth et bâton à serpent – il représente sans doute la victoire de Seth sur Apophis, d’où les sens de « domination » ou de « chance » donnés au mot w“s (Wb. I, 260, 6).
* * * C’est donc à la synergie de ces deux divinités, Oupouaout-Rê l’agitateur et Amon le puissant lion, que Pataouret doit d’avoir échappé à un funeste destin dans sa jeunesse39, et sa stèle de grâces (Dankstele), par ses représentations, servait sans doute de protection à qui en récitait les inscriptions ; en d’autres termes, on peut considérer que ce document relève aussi bien de la magie apotropaïque que de la piété personnelle. Genève, mai 2008
36 D’après E. Naville, Das Aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie, I : Text und Vignetten, A. Asher & Co., Berlin, 1886, pl. XLIV (P.c. = papyrus Louvre 3074). 37 « Formule pour repousser le crocodile qui est venu pour enlever à N. sa puissance magique », cf. P. Barguet, Le Livre des Morts des anciens Egyptiens, LAPO, Cerf, Paris, 1967, p. 76. 38 Exemple signalé dans Wilson 1997, p. 181. Voir aussi Keel et al., OBO 88, p. 275 et p. 274 fig. 105. Pour combattre Apophis, le défunt est parfois armé d’une longue perche terminée en fourche, cf. A. M. Roth, ‘The ps‡-kf and the ‘Opening of the Mouth’ Ceremony : a Ritual of Birth and Rebirth’, JEA 78 (1992), p. 139 n. 128. Voir aussi W. J. Cherf, ‘Some Forked Staves in the Tut‘ankhamûn Collection’, ZÄS 115 (1988), pp. 107-110 et J. Berlandini, ‘Le « double-chaouabti gisant » des princes Ramsès et Khâemouaset’, RdE 53 (2002), p. 29. 39 Sur la place occupée par le crocodile dans l’imaginaire égyptien, cf. E. Brunner-Traut, ‘Krokodil’, in LÄ III, 791-801 ; A. Lohwasser, ‘Die Macht des Krokodils’, in M. Fitzenreiter (éd.), IBAES 4 (2003), pp. 131-134 : <http://www2.rz.hu-berlin.de/nilus/net-publications/ibaes4/lohwasser/text.pdf> ; P. Collombert, ‘Un étrange anthroponyme de l’Ancien Empire : « Il/Elle mourra par le crocodile » (?)’, GM 209 (2006), pp. 34-35, où la stèle est également mentionnée.