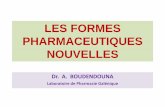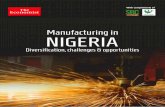Nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges et Villiers-Vineux
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges et Villiers-Vineux
Diœcesis Galliarum. Document De travail n° 9
191
Titre sur 2 lignes ou 3 lignes
Fabien Pilon
1. InTroducTIon
L’officine bourguignonne de Jaulges & Villiers-Vineux (Yonne) (fig. 1) produit, de la fin du IIe s. au milieu du Ve s., une très grande quantité de céramiques fines dont le revêtement argileux est généralement (mais pas exclusive-ment) métallescent. Cette production se situe à la croisée de plusieurs « lignées » de vaisselles de service : celle des sigillées, d’ailleurs produites sur le site même au Haut-Empire, celle de la vaste famille des céramiques à parois fines et, bien entendu, celle de la céramique métallescente dont l’origine est à situer à Lezoux. À Jaulges & Villiers-Vineux, la famille des céramiques à revêtement argileux se compose de deux grands groupes aux frontières à vrai dire peu évidentes : d’une part celui des céramiques métallescentes proprement dites, numériquement le plus important, qui comporte sur-tout des gobelets, mais aussi des pots et quelques cruches, et d’autre part, celui des dérivées-des-sigillées, terme créé pour rassembler la production de formes basses et ouvertes dont l’affiliation avec les sigillées du Haut-Empire est plus ou moins évidente. Une forme émerge très nettement de ce second groupe, la jatte Chenet 323, seule à être véritable-ment produite en masse1.
1 Séguier, Morize, 1996.
2. caracTères de la producTIon
La vaisselle à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux est produite avec une argile non calcaire à texture fine ou légèrement sableuse contenant de très nombreuses inclusions de quartz. Cet aspect, qui donne volontiers une fracture « sableuse », est nettement perceptible sous loupe binoculaire. La pâte est, à quelques exceptions près, très dure. Les vases sont, pour la plupart, cuits en mode A et l’engobe qui a subi un phénomène de grésage partiel, par-fois très poussé, prend volontiers un aspect irisé et métal-lique, d’où l’appellation fréquemment utilisée de céramique « métallescente ». Cette « métallescence » est due à la nature du lait argileux et à son grésage. Une sous-couche blanche est souvent observée sur les vases aux reflets métalliques les plus accusés (notamment ceux de teinte noire, vieux rose ou violacée), dont la nature demeure à expliquer. Il serait vain de tenter de décrire une couleur moyenne de la pâte et de la couverte. Celle de la pâte oscille en effet du blanc au gris, en passant par toute une gamme de beige, orangé pâle, saumon ou rouge clair. Quant à l’enduit, qu’il soit mat ou irisé, il est volontiers plutôt rougeâtre sur les dérivées-des-sigillées et très varié, du beige au noir, parfois mat, parfois irisé, mais il n’atteint jamais la finesse et la qualité de celui des céramiques métallescentes de Lezoux ou de Trèves. Ce n’est d’ailleurs qu’une tendance car il existe de nombreux gobelets orangés, roses, bruns, rouges, violacés, verdâtres,
mots-clés
Jaulges & Villiers-Vineux, centre de production, céramique fine, vases à revêtement argileux, céramique métallescente, dérivées des sigillées, jatte Chenet 323, typologie, chronologie, diffusion.
résumé
L’officine de Jaulges & Villiers-Vineux, située dans le nord-ouest de la Bourgogne, est l’un des grands centres de production de céramique fine du Bas-Empire. Tout au moins, a-t-elle largement diffusé ses produits à partir du IIIe s., notamment en direction de l’ouest et du nord-ouest de la Gaule. Les potiers fabriquent des vases rassemblés dans la famille des vaisselles à revêtement argi-leux. Ces dernières sont d’aspect varié, le caractère métallescent de l’enduit étant plus ou moins accusé. Parmi elles, on distingue un groupe de formes basses et ouvertes (dérivées des sigillées) et un autre de gobelets, pots et cruches (céramique métallescente au sens strict). La typologie réactualisée de compose de 30 formes différentes ou variantes, dont une qui est précisée et neuf nouveaux types. Apparue à la fin du IIe s., la production de vases à revêtement argileux prend son essor au IIIe s. (gobelets tulipiformes, type Niederbieber 33 et jattes Chenet 323b). La fin du IVe s. voit la production recentrée sur deux modèles : le gobelet Chenet 333 et surtout la jatte Chenet 323a, attestée jusque dans la première moitié du Ve s., largement diffusée dans le sud de l’Île-de-France et à considérer comme l’un des marqueurs les plus fiables des périodes valentinienne et théodosienne.
w
nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux
Jean-marc séguier
nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux
192
voire argentés ou dorés... et les vases présentant des teintes variant d’une surface à l’autre semblent être fréquents au vu des récipients complets qu’il nous a été donné d’examiner. Les formes ouvertes sont quant à elles plutôt de teinte claire, rouge à orangé vers la fin de la production, mais il n’est pas rare d’observer des coups de feu de couleur grise à noire, voire des vases entièrement noirs. D’ailleurs, les coupelles de forme 1.01 (cf. infra, p. 00) sont presque toujours grises ou noires avec des reflets plus ou moins mordorés.
À côté de cette production, très majoritaire, on observe, surtout au début de la période de fabrication, des vases à pâte plus fine et plus tendre qu’à l’accoutumée et de teinte volontiers beige, à engobe peu irisé, non grésé et de teinte claire (fin IIe s. et début IIIe s.). Vers la fin de l’activité de l’atelier on va retrouver des vases aux qualités techniques comparables, mais d’aspect franchement grossier, au décor sommairement exécuté, couverts d’un engobe de médiocre qualité et non grésé.
3. la TypologIe : rappels eT nouVelles formes
3.1 TypologieLa typologie proposée en 19962 a été mise à jour ; elle com-porte 30 formes différentes ou variantes et sous-variantes dont neuf nouveaux types. Par ailleurs, la forme de l’un des types identifiés en 1996 a pu être précisée.
2 Ibidem
Formes ouvertes (ou dérivées-des-sigillées) (fig. 2)Forme 1.01 : coupelle hémisphérique comparable à la forme Dragendorff 40.Forme 1.02 : coupelle à marli.Forme 1.03 : coupelle à bandeau (nouvelle forme).Forme 2.01 : assiette à marli profilé apparenté à la forme Curle 15.Forme 2.02 : assiette à paroi convexe de type Dragendorff 31 (série Lezoux 054/056).Forme 3.01 : coupe hémisphérique apparentée à la forme Niederbieber 16.Forme 3.02 : coupe moulée de forme Dragendorff 37.Forme 3.03 : coupe cylindrique apparentée à la forme Dragendorff 30.Forme 4.01 : coupe à collerette médiane dérivée de la forme Dragendorff 38.Forme 4.02 : coupe à collerette haute proche de la forme Curle 21.Forme 5.01 : jatte à bandeau de type Chenet 323a.Forme 5.02 : jatte à bandeau de type Chenet 323b.Forme 5.03 : coupelle à bandeau de type Chenet 323c.Forme 5.04 : mortier à déversoir de type Dragendorff 45. Forme 5.05 : jatte à bandeau de type Chenet 323ab (nou-velle forme).Forme 5.06 : coupelle à bandeau hybride de Chenet 323a et 323c (nouvelle forme).Forme 5.07 : coupelle à bandeau hybride de Chenet 323b et 323c (nouvelle forme).Forme 9.01 : jatte à profil en S (nouvelle forme).
Formes fermées et gobelets métallescents (fig. 3)Forme 6.01 : gobelet tulipiforme à lèvre en baguette.Forme 6.02 : gobelet tulipiforme à lèvre en corniche.Forme 6.03 : gobelet tulipiforme de type Chenet 333.Forme 7.01 : gobelet fusiforme à dépressions de type Nieder-bieber 33.Forme 7.02 : gobelet trapu à dépressions de type Niederbie-ber 33.Forme 7.03 : grand pot ovoïde.Forme 7.04 : grand pot ovoïde de type Déchelette 72.Forme 7.05 : petit pot ovoïde type Déchelette 72.Forme 7.06 : petit pot à panse surbaissée et dépressions.Forme 8.01 : cruche à col haut et poucier (nouvelle forme).Forme 8.02 : cruche à ouverture discoïdale (nouvelle forme).Forme 8.03 : flacon (nouvelle forme).
3.2 les types précisésLe type 3.03 n’était pressenti qu’au travers d’éléments très fragmentaires trouvés à Jaulges & Villiers-Vineux, Chamvres et Grisy-sur-Seine3. La fouille récente d’un dépotoir de l’établissement du Marais du Colombier à Varennes-sur-Seine (fosse 4093)4 a permis de retrouver une grande par-tie d’un vase de ce type (fig. 4, n° 1). Il se confirme qu’il s’agit bien d’une grande et profonde coupe cylindrique à carène basse dont la conception générale s’apparente à celle du Dragendorff 30 (la forme de la base étant toutefois
3 Séguier, Morize, 1996.4 Séguier, Delage, 2009.
Troyes
Sens
Melun
Dijon
La Seine
L'Yonne
L'Aube
La Vanne
Le Loing
L'Armançon
Le Serein
La Cure
La Loire
Jaulges & Villiers-Vineux
LINGONES
HAEDUI
CIVITAS
SENONUM
La Seine
TRICASSES
0 40 kmN
Figure 1. Localisation de l’atelier de Jaulges-et-Villiers-Vineux (infographie : P. Pihuit, inrap).
Jean-marc séguier
193
9.01
5.05
5.06
5.07
1.01
1.02
2.01
2.02
2.03
3.01
3.02
3.03
4.01
4.02
5.01
5.02
5.03
5.04
1.03
0 5 cm
Figure 2. Typologie des formes ouvertes (infographie : P. Pihuit, inrap).
nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux
194
méconnue). Le décor, identique à celui de bien des gobelets tulipiformes 6.02, est composé de motifs excisés (métopes ornées de croix de Saint-André à séparations foliées) limi-tés par deux bandeaux guillochés. Le contexte est daté par un riche matériel de la première moitié du IIIe s., au sein duquel figure de la sigillée de Gaule centrale caractéristique de cette période (vases d’officines de la fin du IIe s. et groupe CALETVS5).
5 Ibidem
Il convient également de mentionner une grande coupe de forme Dragendorff 37 de l’établissement de Soignolles-Coubert6 qui apporte la preuve qu’il existe des variantes rares dans l’ornementation de la forme 3.02 / Dragendorff 37 (fig. 4, n° 2). Ce vase à reflets métallescents porte un médiocre décor de chasse libre au sein duquel sont dispersées quelques oves et une rosette. Les motifs sont empâtés et dis-posés en dehors de toute composition cohérente, alors que la
6 Adrian, 1998.
8.01
8.02
7.04
7.06
7.05
7.03
6.01 6.02
6.03
7.01
7.02
8.03
0 5 cm
Figure 3. Typologie des formes fermées (infographie : P. Pihuit, inrap).
Jean-marc séguier
195
frise d’oves est remplacée par une bande lisse que surmonte un large bandeau guilloché dont le style est caractéristique des productions de Jaulges & Villiers-Vineux. Le contexte, richement documenté, est daté de la première moitié du IIIe s.
Ces deux vases présentent l’intérêt de bien illustrer le continuum qui relie, à Jaulges & Villiers-Vineux, la produc-tion de sigillée et l’émergence du groupe des dérivées-de-sigillées. Ils montrent bien comment les décors guillochés et excisés, d’exécution plus simple, se substituent progressive-ment au décor moulé, substitution qui se déroule sans doute entre la fin du IIe s. et le milieu du IIIe s. Ils confirment également l’ambiguïté de la dichotomie opérée entre déri-vées-des-sigillées et gobelets métallescents puisqu’un décor caractéristique des seconds est apposé sur une forme ouverte
stylistiquement plutôt précoce sur laquelle on aurait pu s’attendre à observer un décor moulé (vase de type 3.03)7.
3.3 nouvelles formes (fig. 5)Forme 1.03 : coupelle à bandeau guilloché. Ce type a pu être individualisé grâce à deux fragments dont la pâte et l’enduit sont caractéristiques des productions de Jaulges & Villiers-Vineux, au sein du mobilier provenant de la fouille
7 Le musée d’Escolives-Sainte-Camille (Yonne) conserve en outre quelques fragments de Dragendorff 37 métallescents portant des rehauts de barbotine blanche sur le bandeau lisse (inédit), ce qui confirme largement, outre la précocité de ce type d’ornementation secondaire, la diversité conceptuelle du décor de cette forme, beaucoup plus libre que dans les autres ateliers contemporains (Gaule du Centre et Gaule de l’Est).
1
2 0 5 cm
Figure 4. Forme 3.03 de Varennes-sur-Seine (1) et bol Dragendorff 37 de Coubert (2, d’après Adrian, 1988) (infographie : P. Pihuit, inrap)
nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux
196
5.065.07
8.02
8.01
1.03 - a1.03 - b
1.03 - c
9.01 - a9.01 - b
8.03
0 5 cm
Figure 5. Nouvelles formes du répertoire de Jaulges & Villiers-Vineux (cf. texte) (infographie : P. Pihuit, inrap).
Jean-marc séguier
197
du 14 avenue Thiers à Melun8. Le bandeau vertical, court, est guilloché (fig. 5, 1.03 – a) et concave sur l’un des deux exemplaires (fig. 5, 1.03 – b). Il est vraisemblable que la cou-pelle caliciforme à épaulement dotée d’un revêtement métal-lescent, trouvée à Villiers-le-Sec dans le Val-d’Oise (structure 1448)9 (fig. 5, 1.03 – c), appartient à la même forme : tout au moins, la lèvre est-elle identique à celle de l’un des deux vases de Melun. Ceci permet de poser l’hypothèse d’une pro-duction, sans doute fort discrète, de coupelles caliciformes à Jaulges & Villiers-Vineux. Le deuxième vase de Melun (fig. 5, 1.03 – b) semble un peu différent en raison de la hauteur du col, relativement développée et de sa forme peu évasée, mais aussi du fait du détail de la forme de la lèvre. Néanmoins, devant le caractère fragmentaire de ces éléments, il n’est pas possible de savoir si l’on est en présence de deux variantes d’une même forme ou de deux types distincts. Dans l’état actuel des informations, nous privilégierons provisoirement la première hypothèse. Ce type de coupelle caliciforme, apparemment rare, ne semble connaître aucun équivalent parmi les céramiques métallescentes de Gaule du Centre, de l’Est ou de Rhénanie. La coupelle de Villiers-le-Sec a été rap-prochée par Didier Vermeersch du type Gose 44610, forme dotée d’un pied assez haut. Cette dernière forme, identifiée au type Niederbieber 82a, est produite en céramique à pâte blanchâtre et est intégrée par Erich Gose dans son groupe des brûle-parfums11, hypothèse qui doit être considérée avec beaucoup de circonspection tant la morphologie de ce vase est différente de celle des véritables brûle-parfums. Les récipients de type 1.03 en céramique métallescente n’ont peut-être jamais connu une telle fonction. La coupelle de Villiers-le-Sec est datée de la première moitié du IIIe s.12 ; elle est donc antérieure à la datation admise pour l’horizon Niederbieber. Le contexte des deux coupelles de Melun est incertain car il associe des éléments allant du Ier s. au IIIe s., mais s’accorde bien avec une attribution du type à la pre-mière moitié ou vers le milieu du IIIe s.13
Forme 5.05 : jatte à bandeau guilloché dont la lèvre est marquée par une très légère inflexion et dont le décor est matérialisé par trois bandes guillochées séparées par une plage lisse. Le profil lourd et empâté rapproche cette forme du Chenet 323a, alors que l’inflexion de la lèvre est proche des caractères du Chenet 323b. L’organisation du décor, d’exécution bien plus sommaire que sur le Chenet 323b, est intermédiaire entre les deux types (deux bandes contre une sur le Chenet 323a et trois sur le Chenet 323b). Nous pro-posons de voir dans cette forme rare un hybride ou plutôt une forme de transition entre les variantes Chenet 323 A et B : on proposera de nommer ce type Chenet 323ab. Le seul
8 Observation effectuée lors de l’étude des contextes précoces de ce site (matériel mis obligeamment à notre disposition par Jean-Claude Le Blay, Groupe de Recherches Archéologiques de Melun).
9 Gentili, Vermeersch, 2001, p. 227 et fig. 12.10 Ibidem11 Gose, 1950, p. 38.12 Gentili, Vermeersch, 2001, p. 227.13 Ce site, où la céramique métallescente est assez abondante, en particulier les
gobelets de type 6.02, semble être abandonné au plus tard vers le milieu du IIIe s.
vase complet identifié à ce jour provient de la fosse F.15 de la Terre aux Moines à Montereau-Fault-Yonne14 et est daté de la première moitié du IIIe s. (fig. 6).
Forme 5.06 : coupelle à bandeau de petit module dont le profil est semblable à celui du Chenet 323c, mais portant, à la base du bandeau, un guillochis fin matérialisé par deux passages de roulette comme sur le Chenet 323ab. Nous pro-posons donc d’y voir une forme hybride du Chenet 323c et du Chenet 323ab. Cette forme, rare, n’est à ce jour réperto-riée que dans la fosse 49 du Bois de Roselle à Balloy où elle est datée de la fin du IIIe s.15.
Forme 5.07 : coupelle à bandeau (?) de petit module dont la lèvre est soulignée par une gorge, le bandeau étant orné de guillochis. En raison de l’étroitesse du diamètre qui rappelle le Chenet 323c et de la ressemblance de conception avec la jatte Chenet 323b (profil), nous proposons d’y voir, à titre d’hypothèse, une forme rare, hybride du Chenet 323c et du Chenet 323b (forme Chenet 323bc). Cette forme n’est à ce jour répertoriée que dans la fosse 49 du Bois de Roselle à Balloy où elle est datée de la fin du IIIe s.16.
Forme 9.01 : jatte à profil en S, col souligné par un épau-lement et pied bas légèrement oblique. Il semble exister deux variantes : sur l’une, l’épaulement est marqué par un simple ressaut, alors que sur l’autre, il l’est par des cannelures (fig. 5). Ce type n’a pas d’équivalent dans le répertoire des céramiques communes régionales, pas plus que dans celui des sigillées gauloises. Un bol à épaulement d’Alésia, classé dans son groupe 22 par Robin Symonds17, est conçu de façon comparable mais son profil demeure différent de la forme 9.01. En revanche, le rapprochement avec la forme
14 Séguier, 2006b.15 Séguier, 2006a.16 Séguier, 2006a.17 Symonds, 1992, 110 et fig. 17, n°351.
Figure 6. Forme 5.05 de l’agglomération de la Terre aux moines à Montereau-Fault-Yonne (cliché : J.-M. Séguier, inrap).
nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux
198
Desbat 8, produite en sigillée claire B rhodanienne18, est plus convaincant, mais sans doute fortuit car l’éloignement des ateliers rend peu probable un quelconque rapport. La forme 9.01, rare, n’est à ce jour répertoriée que dans les fosses 49 et 128 du Bois de Roselle à Balloy où elle est datée de la fin du IIIe s.19.
Forme 8.01 : cruche à ouverture circulaire, lèvre en bandeau et poucier trilobé reposant sur une anse à section ronde ; la panse ovoïde présente un épaulement. Cette forme est sans doute imitée d’un prototype métallique. Les rares contextes de découverte situent plutôt ce type dans la seconde moi-tié du IIIe s. La forme n’est connue à l’heure actuelle qu’à Châteaubleau dans le puits F.1 des Grands Jardins20 et dans le puits F.3 de la zone 121.
Forme 8.02 : cruche à ouverture discoïdale large. Les cruches comparables semblent rares à l’époque romaine. Seul le type Lezoux 10522 se rapproche de cette forme en raison de la forme de l’embouchure, quoique cette dernière y soit plus massive et légèrement moulurée. En revanche, une cruche en céramique à pâte claire et engobe orangé du puits AB 206/207 de l’agglomération de Montereau-Fault-Yonne, présente une ouverture exactement identique, alors que la panse est globulaire et que la base repose sur un petit pied23. On retrouve une embouchure identique sur une cruche à pâte brun-orangé et engobe blanc conservée au Musée des Beaux-Arts de Chartres24. L’objet de référence, connu à ce jour en un unique exemplaire, provient de l’agglomération de Montereau-Fault-Yonne, la Terre aux Moines et se trouve dépourvu de contexte fiable, alors que la cruche du puits de Montereau-Fault-Yonne est datée du milieu du IVe s. et que le contexte de celle de Chartres est inconnu.
Forme 8.03 : flacon à panse piriforme, fond creux, lèvre mince évasée et anse ronde à un sillon. L’allure générale de la panse est comparable à celle des gobelets tulipiformes 6.02. Cette forme ne semble pas connue des répertoires de céramique fine gallo-romaine. Il s’agit peut-être d’une créa-tion originale, connue, à ce jour, à un seul exemplaire issu du puits F.25 de Châteaubleau25, contexte daté du deuxième quart du IVe s.
4. problèmes chronologIques
La mise en évidence de la longévité de la production des céramiques à revêtement argileux, du IIe s. au Ve s. est un acquis relativement récent, à laquelle les trouvailles
18 Desbat, 1988.19 Elle serait cependant connue dans l’Yonne (information Michel Kasprzyk).20 Pilon, Bertin, Poilane, Van Ossel, 2006.21 Harlay, 1996.22 Bet, Fenet, Montineri, 1989.23 Voir dans ce volume notre contribution consacrée à la céramique du secteur
Seine – Yonne.24 Sellès, 2001, p. 208/209 (type 3424).25 Pilon, Bertin, Poilane, Van Ossel, 2006.
franciliennes ont apporté une contribution essentielle26. Dans leurs grandes lignes, les propositions établies alors se sont vues largement confirmées. Quelques points méritent néanmoins des précisions, notamment à la lumière des nou-velles découvertes réalisées principalement dans le secteur Seine – Yonne, particulièrement riche en céramiques à revê-tement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux.
4.1 les productions de première génération Il a été montré que c’est dans la seconde moitié du IIe s. et sans doute plus précisément autour du dernier tiers ou du dernier quart du siècle, que cette céramique apparaît, en connexion avec des sigillées techniquement attribuables à la phase 7 de Lezoux et avec des coupes moulées de la seconde moitié ou de la fin du IIe s. (groupes DOECCVS, PATERNVS et ALBVCIVS notamment). Cette phase de la production a été dénommée « première génération » des céramiques à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux27. Deux contextes du confluent Seine – Yonne, le cellier 3654 des Vallées à Villiers-sur-Seine et la cave 2 du Chemin de Sens à Marolles-sur-Seine, apportent un éclairage indiscutable sur ce point. Sur le premier site, le cortège se limite à des gobelets de type 6.02. À Marolles-sur-Seine, contexte très riche28, neuf gobelets de type 6.02 (fig. 7, n° 3-6, 11-12) sont accompagnés de deux gobelets 6.01 (fig. 7, n° 7), d’un prototype du gobelet 7.02 à dépressions, portant un décor « végétalisant » exécuté à l’aide de rehaut à la barbotine blanche (fig. 7, n° 2 ; fig. 9), d’un pot 7.03 (fig. 7, n° 1), ainsi que par une coupelle 1.01 et par deux bols de forme 3.01 (fig. 7, n° 9-10). Il apparaît donc que la production de gobelets, déjà relativement diversifiée, est au cœur du processus qui voit l’émergence des céramiques à revêtement argileux à Jaulges & Villiers-Vineux, la part des dérivées-des-sigillées paraissant alors être minime. Ce dernier point est intéressant car il coïncide avec le caractère tout à fait confidentiel de la production et de la diffusion de la sigillée stricto sensu du centre de Jaulges & Villiers-Vineux aux IIe et IIIe s., pourtant reconnue dans le sud de l’Île-de-France dans les agglomérations de Montereau-Fault-Yonne par un poinçon tout à fait typique (fig. 8) et de Bernay-Vilbert29, ainsi que dans les établissements ruraux de Balloy, Bois de Roselle et de Varennes-sur-Seine, La Justice. Cette phase de la production des céramiques à revêtement argileux se prolonge au début du IIIe s. et voit se multiplier les types de dérivées-des-sigillées avec l’apparition, mais toujours en nombre très modeste en contexte de consommation, des formes 2.03, 3.01, 3.02 (peut-être), 4.01 et 4.02.
4.2 les productions du IIIe s.Tous les éléments convergent désormais pour affirmer que le IIIe s. (et le premier quart du IVe s., qui en est indisso-ciable) constituent la période d’apogée de la production des gobelets. Tous les contextes de cette période connus dans
26 Séguier, Morize, 1996.27 Séguier, Morize, 1996, p. 168 et sq.28 Séguier, Morize, 1996, p. 168-169 et fig. 13.29 Prospections Hervé Jand’heur, identification de l’auteur.
Jean-marc séguier
199
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11 1213
0 5 cm
Figure 7. L’association des formes de la première génération dans la cave 2 du chemin de sens à Marolles-sur-Seine (infographie : P. Pihuit, inrap).
0 3 cm
Figure 8. Montereau-Fault-Yonne, la Terre aux moines : fragment de Dragendorff 37 en sigillée de Jaulges &
Villiers-Vineux (infographie : P. Pihuit, inrap).
nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux
200
le secteur Seine – Yonne en sont très largement pourvus et, cela ne saurait être une coïncidence, nombre de ceux du nord de l’Île-de-France, traditionnellement plus chiches en la matière, fournissent régulièrement quelques gobelets et jattes Chenet 323b de Jaulges & Villiers-Vineux. D’ailleurs, il convient de remarquer que les trois quarts de la vaisselle exportée par Jaulges & Villiers-Vineux vers les campagnes de l’ouest de la cité de Sens correspondent à des gobelets, ce qui reflète sans doute largement l’orientation, sinon la spécialisation, des potiers de ce centre. Il convient de dis-tinguer deux étapes dans cette phase de la production des gobelets. En effet, les contextes datés de la première moitié et des alentours du milieu du IIIe s. sont submergés par les gobelets tulipiformes 6.02 (fig. 9), néanmoins accompagnés de quelques gobelets 7.02 (ou Niederbieber 33)30, alors que les ensembles datés de la fin du IIIe s. voient les proportions s’inverser, le type 7.02 devenant prédominant (fig. 10) 31. Il s’agit-là, tout au moins pour les secteurs les mieux achalan-dés en gobelets de Jaulges & Villiers-Vineux, en particulier ceux de la cité de Sens, d’un critère très fiable pour affiner la chronologie des contextes du IIIe s.32. On ne doit pas oublier que cette phase voit également apparaître, en même temps qu’en Gaule centrale du reste, le pot Déchelette 72 (formes 7.04 et 7.05), ainsi que le gobelet 7.01 et la cruche 8.01.
Le répertoire des dérivées-des-sigillées voit son corpus s’étoffer des formes 1.03, 2.01, 2.02, 2.03, 3.02, 4.01, 4.02, 5.02, 5.03, 5.04 et 9.01. Même si ces vases figurent en quan-tité généralement négligeable, on assiste à un phénomène d’innovation au sein d’un répertoire précédemment des plus limités, ce qui confirme bien la très grande vitalité de l’officine à cette époque. L’une des formes, la jatte à bandeau Chenet 323b sera même appelée à un certain succès, on y reviendra plus loin. Plusieurs contextes, comme le cellier 3 de Marolles-sur-Seine, le Chemin de Sens, datée vers le milieu du IIIe s., montrent des cortèges d’association de dérivées-des-sigillées caractéristiques de cette période : formes 1.01, 2.01, 4.02, 5.02. Il n’est peut-être pas inutile de préciser que, dans le secteur Seine – Yonne, les dérivées-des-sigillées à revê-tement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux occupent une place importante dans la vaisselle fine du IIIe s., puisqu’elle fait au moins jeu égal avec les sigillées dans quasiment tous les contextes33. La coupelle arrondie 1.01 et surtout la jatte Chenet 323b dominent les assemblages : réunies, elles repré-sentent l’essentiel des effectifs. En revanche, dans la même région, la coupelle Chenet 323c est absente des contextes analysés, mais il est vrai qu’il s’agit d’une forme rare. Plus étonnante est l’absence du mortier Dragendorff 45, qui est pourtant sensé figurer au répertoire de Jaulges & Villiers-Vineux dès le IIIe s.34, mais il est vrai que les contextes analy-
30 Voir par exemple deux contextes datés du milieu du IIIe s. comme le cellier 3 de Marolles-sur-Seine, avec douze formes 6.02 contre six formes 7.02 (Séguier et al., 2006) et la fosse F.15 de Montereau-Fault-Yonne avec seize gobelets 6.02 pour un gobelet 7.02 (Séguier, 2006b).
31 Par exemple dans l’ensemble de Balloy, Bois de Roselle, on compte treize gobelets 7.02 contre trois de forme 6.02 (Séguier, 2006a).
32 Séguier, Delage, 2009.33 Séguier, Delage, 2009.34 Le contexte des exemplaires du puits F.25 de Châteaubleau (Pilon, Bertin,
Poilane, Van Ossel, 2006), attribué à un horizon fin IIIe – début IVe s., est
sés en Bassée livrent, pour cette période, très peu de mortiers en céramique fine, toutes provenances confondues.
4.3 les productions des IVe et Ve s.La situation au IVe s. est diversement appréciée : encore un peu confuse pour les deux premiers tiers du siècle, elle est mieux documentée à partir de la période valentinienne. Force est en effet de constater que les contextes d’époque constantinienne sont à la fois peu nombreux ou assez peu fournis, de sorte que la perception que l’on a de la pro-duction et de la diffusion des céramiques à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux demeure incomplète. Néanmoins, l’étude des ensembles de Varennes-sur-Seine et de Montereau-Fault-Yonne contribue à éclairer un peu l’état des connaissances.
La production des gobelets semble connaître un change-ment radical que traduit le renouvellement du répertoire : les tulipiformes 6.01, 6.02 et 6.04 semblent avoir totalement disparu, alors que la forme 7.02 semble se maintenir, mais dans des proportions qu’il est difficile d’évaluer (sans doute
probablement à placer plutôt dans la partie basse de la fourchette envisagée, en raison du cortège de formes associées.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
gobelet 6.02 gobelet 7.02
Montereau, fosse F15
gobelet 6.02 gobelet 7.02
Balloy, fosses 47-48
0
2
4
6
8
10
12
14
0
2
4
6
8
10
12
14
16
gobelet 6.02 gobelet 7.02
Montereau, fosse F15
gobelet 6.02 gobelet 7.02
Balloy, fosses 47-48
0
2
4
6
8
10
12
14
Figure 9. Proportions des gobelets tulipiformes et des gobelets Niederbieber 33 à Montereau-Fault-Yonne, la Terre aux moines, fosse F15 (première moitié du IIIe s.).
Figure 10. Proportions des gobelets tulipiformes et des gobelets Niederbieber 33 à Balloy, bois de
roselle (fin du IIIe s.).
Jean-marc séguier
201
faibles). La forme 7.01, variante fuselée du Niederbieber 33, timidement apparue à la fin du IIIe s., devient relativement fréquente. Une nouvelle forme fait son apparition dans le courant de la première moitié du IVe s. (sans doute pas avant le second quart) : le Chenet 333 (forme 6.03), qui perdure au moins jusqu’à l’époque valentinienne. L’association de ces deux formes semble être surtout caractéristique du milieu du IVe s. (fig. 11). Il importe néanmoins de noter que, si l’on se fie aux ensembles du secteur Seine – Yonne, la production des gobelets diminue considérablement à partir du IVe s. : tout au moins constate-t-on que les gobelets sont bien moins nombreux dans les contextes constantiniens, valentiniens et théodosiens que dans les ensembles du IIIe s. Il est possible que ce déclin soit en partie à mettre au compte de la concur-rence qu’exercent les ateliers locaux produisant des gobelets en céramique commune de mode B aux surfaces polies35. La production de l’atelier de Jaulges & Villiers-Vineux se distin-gue ainsi notablement de celle de Trèves où les gobelets sont largement produits et diffusés à l’époque constantinienne. On doit d’ailleurs observer que si quelques gobelets trévires sont connus dans l’ouest et le nord de l’Île-de-France36, on ne dispose que d’assez peu de gobelets 6.03 et 7.01 dans ces mêmes secteurs37. Au-delà de l’Île-de-France, la diffusion de Jaulges & Villiers-Vineux est des plus modestes.
La production des dérivées-des-sigillées se restreint quant à elle considérablement puisque en dehors de la classe des formes à bandeau (jattes et mortiers), il ne semble plus subsister aucune autre forme en dehors de rares coupelles 1.01 et d’assiettes 2.01 et 2.02. C’est le type Chenet 323 qui domine largement cette période qui correspond à l’apogée de la production des différentes variantes de cette forme (cf. infra, p. 00), tandis que le mortier Dragendorff 45 est assez modestement diffusé38, tout au moins dans les campagnes du sud de l’Île-de-France. La durée de vie de cette dernière
35 Séguier, Delage, 2009.36 Mithraeum de Septeuil par exemple (Gaidon-Bunuel, Barat, Van Ossel, 2006)37 On note cependant plusieurs gobelets Chenet 333 dans la nécropole de Maule
(Barat, Sirat, 1993).38 Rarement plus d’un vase par contexte, contrairement au Chenet 323.
forme apparaît comme assez longue puisqu’elle est mention-née jusqu’au milieu du Ve s. à Rouen39.
D’une manière plus générale, les contextes franciliens suggèrent que la diffusion des produits de l’officine bour-guignonne connait à l’époque constantinienne un léger fléchissement40, pour rebondir à la période valentinienne. Cette observation traduit-elle une crise dans l’atelier ou dans les circuits commerciaux ? Rien n’autorise à priori une telle lecture des faits. Il faut en revanche se demander si l’intro-duction massive des sigillées d’Argonne n’a pas, un temps, constitué un frein à la diffusion des produits de Jaulges & Villiers-Vineux, phénomène qui ne sera contrecarré qu’à l’époque valentinienne par le succès du type Chenet 323a.
4.4 les jattes chenet 323La jatte Chenet 323, très abondante à l’emplacement des ateliers et largement diffusée, en particulier dans le secteur Seine – Yonne 41, constitue un matériau de choix pour abor-der les problèmes chronologiques. Néanmoins un certain nombre de questions se posent, notamment en raison de l’existence de plusieurs variantes et d’apparentes disparités à l’échelon local.
C’est la forme Chenet 323b (ou 5.02) (fig. 12-13) qui inaugure la production. Cette forme se caractérise générale-ment par une pâte très cuite de teinte beige, rouge ou grise, et un enduit vitrifié et métallescent à reflets plus ou moins métallescents (fig. 13), quoique l’on connaisse des exem-plaires à pâte tendre et enduit non grésé42. Sans qu’une ana-lyse métrologique ait été entreprise, il est évident qu’il existe plusieurs modules, probablement standardisés (fig. 12). Il faut, par ailleurs, noter l’existence de deux variantes de décor : la plus fréquente est constituée par trois étroites bandes guillochées équidistantes (fig. 12, n° 1-5), mais sur certains exemplaires, c’est toute la surface du bandeau
39 US 4687 de la Cour des Maçons (Adrian, 2006).40 C’est ce que montrent les ensembles de Montereau-Fault-Yonne et de
Varennes-sur-Seine (Séguier, Auxiette, Pilon, Van Ossel, 2006).41 À titre d’exemple, on a identifié au moins 86 vases de ce type dans
l’établissement du Chemin de Sens à Marolles-sur-Seine et 153 dans l’agglomération de Montereau-Fault-Yonne (Séguier, Morize, 1996, p. 168).
42 Varennes-sur-Seine : Séguier, Auxiette, Pilon, Van Ossel, 2006, fig. 7, n° 2.
1
2
3
4 0 5 cmFigure 11. Exemple d’association de gobelets sur le site de Varennes-
sur-Seine, le marais du colombier vers le milieu du IVe s. (infographie : P. Pihuit, inrap).
nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux
202
1
2
3
4
5 7
6
9 8 0 5 cm
Figure 12. Variabilité de la forme, du module et du décor des jattes Chenet 323b : 1-2 : Marolles-sur-Seine, le chemin de sens ; 3, 8-9 : Varennes-sur-Seine, le marais du colombier ; 4 : Varennes-sur-Seine, la Justice ; 5 : Combs-la-Ville, écopole sénart ; 6 : Montereau-Fault-Yonne, la Terre aux moines ; 7 : Bazoches-lès-Bray,
le Tureau à l’oseille (infographie : P. Pihuit, inrap).
Figure 13. Jatte Chenet 323b de l’établissement rural du chemin de sens à Marolles-sur-Seine
(cliché : J.-M. Séguier, inrap).
Figure 14. Vue de détail du décor guilloché d’une jatte Chenet 323b de l’établissement rural du chemin de sens
à Marolles-sur-Seine (cliché : J.-M. Séguier, inrap).
Jean-marc séguier
203
qui est uniformément guillochée (fig. 12, n° 6-7-8). Une variante rare du premier décor ne porte que deux bandes guillochées (fig. 12, n° 9). Cette ornementation, obtenue soit à l’aide d’une roulette, soit, plutôt, à la lame vibrante, est généralement assez profondément marqué (fig. 14). Il convient d’insister sur un point : on ne connaît encore aucune jatte Chenet 323b non décorée43. Initialement fixée vers le milieu du IIIe s. sur la foi de l’ensemble du cellier 3 du Chemin de Sens à Marolles-sur-Seine44, l’apparition pour-rait être plus ancienne. La forme est en effet présente dans des ensembles datés de la première moitié du IIIe s. comme le dépotoir 4093 du Marais du Colombier ou l’horizon 6 de la Justice à Varennes-sur-Seine45, ainsi que dans d’autres contextes (Saint-Sauveur-lès-Bray, le Port aux Pierres), sans qu’il soit possible de préciser dans quelle étape de ce demi-siècle ces vases se situent. Il est donc théoriquement tout à fait possible que cette forme soit apparue dès le début du IIIe s.46. On doit donc aujourd’hui retenir cette fourchette chronologique certes large, mais irréductible, des années 200-250 pour l’apparition de la variante la plus ancienne. Le Chenet 323b se retrouve, généralement, en quantités assez modestes, dans presque tous les ensembles de la seconde moitié du IIIe s. et de la première décennie du IVe s. : cela se vérifie au confluent Seine – Yonne comme à Châteaubleau. La forme se retrouve inchangée dans plusieurs assemblages datés de la première moitié du IVe s.47, par exemple dans l’agglomération de Montereau-Fault-Yonne. Les tessons trouvés dans des ensembles postérieurs ont, en revanche, toutes chances d’être résiduels.
Le Chenet 323a (fig. 15) présente habituellement l’as-pect caractéristique des productions les plus tardives. En effet, si l’on connaît quelques très rares exemplaires à enduit sombre métallescent, la très grande majorité de ces jattes, aux parois habituellement épaisses, montre une pâte beige à rose orangé, sableuse et très dure et un enduit d’aspect grésé variant du beige au rouge ou violacé, à reflets très légèrement irisés. Le profil est simplifié par rapport à celui du Chenet 323b par la disparition de l’inflexion à hauteur de la lèvre et le décor est quasi systématiquement constitué d’une seule bande de guillochis située au milieu ou vers la base du bandeau. Cette bande guillochée est parfois scindée
43 Ce qui, dans certains cas éventuellement litigieux, constitue, outre l’absence de râpe interne, un indice absolument fiable pour distinguer la jatte Chenet 323b (et Chenet 323a d’ailleurs) du mortier Dragendorff 45 et de toutes les autres jattes à bandeau produites dans d’autres centres, notamment à Lezoux et à Gueugnon.
44 Séguier, Morize, 1996, p. 169 ; Séguier et al., 2006.45 Séguier, Delage, 2009.46 On ne dispose d’aucun ensemble de la fin du IIe s. dans lequel figure cette
forme, mais, d’une part, il est vrai que les contextes fiables de cette période sont peu nombreux et que, d’autre part, la jatte Chenet 323b est habituellement considérée comme témoignant d’une date tardive, postérieure au IIe s. Nous considérons ce problème comme impossible à résoudre actuellement ; seule la multiplication des études de contextes riches associant de grandes quantités de sigillée (l’étude stylistique des décors étant absolument incontournable) et des monnaies est à même de faire progresser cette question.
47 Contra : Kasprzyk, 2003, mais avec des arguments difficilement recevables puisque ne prenant pas en considération les découvertes franciliennes, ces dernières étant difficilement contestables.
en deux lignes presque jointives48. Une analyse métrologique de cette forme reste à entreprendre sur le lieu de production pour savoir si les variations de diamètre (fig. 15) sont liées à l’existence de plusieurs modules, mais il semble d’ores et déjà acquis que la majorité des jattes Chenet 323a trou-vées en contexte de consommation sont le plus souvent de grande taille (fig. 15, n° 1 et 5-7), les vases de petit diamètre étant plus rares (fig. 15, n° 2-3). Le passage de la forme Chenet 323b à la forme Chenet 323a résulte d’un proces-sus de simplification des gestes techniques à mettre sans doute en relation avec une rationalisation de la production, traduisant une standardisation en vue d’une production de masse. La forme apparaîtrait dès la fin du IIIe s. selon Didier Perrugot49, mais cette assertion demeure, en l’état actuel du dossier, tout à fait contestable50. En réalité cette variante a toutes chances de ne pas faire son entrée sur la scène avant le IVe s., l’attestation la plus ancienne étant incontestablement celle de la cave de la rue Minot à Dourdan51. Le Chenet 323a existe pendant tout le IVe s. mais demeure en général peu abondant, tout au moins sur les sites franciliens52, pour, soudain, devenir très fréquent à l’époque valentinienne et jusqu’au début du Ve s.53. Les meilleurs ensembles de réfé-rence pour cette forme restent ceux du Chemin de Sens à Marolles-sur-Seine où, à elle-seule, elle surclasse les sigillées d’Argonne, pourtant elles-mêmes assez bien diffusées sur le site. À cet égard, on doit noter que l’atelier bourguignon a repris le dessus, dès la fin du IVe s., tout au moins dans le secteur Seine – Yonne, après une période de récession rela-tive. Il semble donc évident que, de la fin du IVe s. au milieu du Ve s., le Chenet 323a est la principale forme produite dans l’officine. En outre, cette dernière semble fabriquée à grande échelle, mais comme l’on ne sait rien de l’organisa-tion de l’atelier à cette époque, il est impossible de dire si cette production est l’affaire d’une ou plusieurs officines spécialisées installée dans ce vaste centre producteur54. On doit également noter que si ce type morphologique est très standardisé à l’époque valentinienne et théodosienne, les productions les plus tardives, précédant de peu le milieu du Ve s. à Marolles-sur-Seine, montrent un profil encore plus simplifié caractérisé par un bandeau vertical, un décor guilloché à peine perceptible, une pâte tendre et un enduit non grésé. Il s’agit sans doute là des dernières productions de Jaulges & Villiers-Vineux, qui voit ses derniers fours s’éteindre avant le milieu du Ve s. 55.
48 Type dénommé par Michel Kasprzyk (2003, p. 180) « Chenet 323a, variante précoce », expression ambigüe recouvrant une possible confusion entre les types Chenet 323a et 323b.
49 Perrugot, 1995, p. 112.50 Séguier, Morize, 1996, p. 171.51 Ibidem52 Un seul exemplaire sur le site du Marais du Colombier à Varennes-sur-Seine par
exemple, au milieu du IVe s.53 Séguier, Morize, 1996, p. 171-172.54 Ce point, très intéressant pour la compréhension de l’évolution de l’atelier,
de son organisation et de son statut au Bas-Empire, mériterait, à n’en pas douter, une analyse précise que seule une fouille sur le site même permettrait de développer.
55 L’absence de toute production de l’officine bourguignonne sur le site du Merdat à Châtenay-sur-Seine, déjà mise en avant, conserve tout son intérêt chronologique dans la mesure où ce site est occupé au troisième quart du Ve s. (Séguier, Morize, 1996, p. 172). Le site de la Médiathèque de Melun
nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux
204
Le problème le plus complexe que posent les jattes Chenet 323 tient au fait que, dans le secteur Seine – Yonne,
confirme pleinement cette observation, de même que la stratigraphie de la Cour des Maçons à Rouen : le Chenet 323a est présent du deuxième quart du IVe s. (US 4771) à la première moitié du Ve s. (US 4691) ; on peut s’interroger sur la présence de produits de Jaulges & Villiers-Vineux dans les séquences les plus tardives datées du milieu du Ve s. : un Chenet 323a dans l’US 4696, deux Dragendorff 45 dans l’US 4687 et un Chenet 323c dans l’US 5877 : mobilier résiduel, vases conservés longtemps ou ultimes exportations du milieu du Ve s. ?
sensé être très représentatif de la diffusion des produits de Jaulges & Villiers-Vineux, il semble qu’en dépit d’un effectif assez réduit, le Chenet 323b soit plus fréquent que le Chenet 323a au cours des deuxième et troisième quarts du IVe s.56 Or, l’agglomération des Ouches du Bourg à Pithiviers-le-Viel semble présenter une situation inverse à
56 Un seul Chenet 323a (Varennes-sur-Seine) contre plusieurs Chenet 323b (Marolles-sur-Seine, Montereau-Fault-Yonne).
1
2
3
4
5
6
7 0 5 cm
Figure 15. Variation de module des jattes Chenet 323a de Marolles-sur-Seine, le chemin de sens à la fin du IVe s. et au début du Ve s. (infographie : P. Pihuit, inrap).
Jean-marc séguier
205
la même époque57. Ces données contradictoires, alors que Pithiviers-le-Vieil, est situé chez les Carnutes, mais peu éloigné de la confluence Seine – Yonne, ne trouvent pas, pour l’heure, d’explication satisfaisante. On sait toutefois désormais qu’existe dès la première moitié du IIIe s. une variante intermédiaire entre les formes Chenet 323b et 323a (Chenet 323ab : voir supra, p. 00). Il est possible que cette variante, a priori rare, soit plus développée que prévu dans la première moitié du IVe s. et que, sur un mobilier fragmenté, elle soit difficile à déceler, ce qui pourrait en partie expliquer ces contradictions. Ce point devra faire l’objet d’une analyse détaillée dans le futur car les jattes Chenet 323 dans leur ensemble constituent, dans certains cas, un précieux auxi-liaire de discrimination chronologique.
Enfin, les coupelles Chenet 323c constituent une variante très marginale. La forme ne semble pas évoluer entre son apparition, à situer au cours du IIIe s. (seconde moitié ?), et son extinction, pendant la première moitié du Ve s., en dehors d’un alourdissement du profil à la fin de la produc-tion. Cette forme reste globalement assez rare58 ; néanmoins, elle est sujette à hybridation avec d’autres variantes de la jatte à bandeau guilloché (cf. les formes 5.06 et 5.07). Du reste, la pertinence du classement de cette coupelle dans le type général Chenet 323 reste à démontrer.
57 Information Christian Cribellier, Service régional de l’archéologie Centre.58 De l’ordre d’un individu par ensemble lorsqu’elle est présente.
5. ImpacT sur les producTIons locales eT dIffusIon
Les recherches récentes confirment l’importance de la pro-duction des céramiques fines à Jaulges & Villiers-Vineux et le poids particulièrement important de ces dernières dans les assemblages de vaisselle de la fin du IIe s. au début du Ve s., en territoire sénon notamment. Une conséquence inattendue du rayonnement de ce centre de production réside dans la mise en évidence, dans le secteur Seine – Yonne, d’imitations, certes encore rares, de formes et de décors caractéristiques de l’atelier bourguignon. Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, ces imitations ne sont pas produites en céramique de mode A engobée, mais en céramique commune de mode B lustrée, ce qui en fait, de toute évidence, des composantes de la vaisselle de service. On note deux imitations de la jatte Chenet 323b guillochée59 : l’une dans la cave CH2 de La Terre aux Moines à Montereau-Fault-Yonne (fig. 16, n° 3), datée de la charnière des IIIe et IVe s., l’autre dans le cellier 75 du Chemin de Sens à Marolles-sur-Seine (fig. 16, n° 4), daté du milieu du IVe s. D’autres imitations de cette forme sont reconnues dans des contextes du IVe s. : plus simples, elles présentent un bandeau non guilloché, mais lisse60 ou mouluré61. Sont également identifiés un gobelet à bord en corniche imitant le tulipiforme 6.02 dans le cellier 3 du
59 Forme 514 de la typologie des céramiques communes locales (Séguier, Delage, 2009).
60 Varennes-sur-Seine, le Marais du Colombier (Séguier, Auxiette, Pilon, Van Ossel, 2006, fig. 13, n° 10).
61 Châteaubleau (Pilon, Bertin, Poilane, Van Ossel, 2006, fig. 12, n° 27).
1
2
3 40 5 cm
Figure 16. Exemples d’imitations de productions de Jaulges & Villiers-Vineux en céramique commune de mode B trouvées dans le secteur Seine – Yonne : 1 : Balloy, bois de roselle ; 2, 4 : Marolles-sur-Seine,
le chemin de sens ; 3 : Montereau-Fault-Yonne, la Terre aux moines (infographie : P. Pihuit, inrap).
nouvelles données sur les productions à revêtement argileux de Jaulges & Villiers-Vineux
206
Chemin de Sens à Marolles-sur-Seine (fig. 16, n° 2) et un très grand gobelet62 à col droit dont le décor excisé repro-duit celui des mêmes gobelets 6.02 (fleurons séparés par une ligne foliée, encadrés par deux bandeaux guillochés) à Balloy, Bois de Roselle (fig. 16, n° 1) à la fin du IIIe s.
En dehors du territoire sénon, et pour rester en Île-de-France, de telle imitations sont pour l’instant inconnues, ce qui n’est guère surprenant dans la mesure où la diffusion des produits de Jaulges & Villiers-Vineux est nettement moins importante : les arrivages semblent beaucoup plus limités chez les Meldes, les Parisii, les Carnutes ou les Véliocasses et concernent, en premier lieu, les gobelets63, même si ces derniers se heurtent ici, en particulier vers l’est, à la diffusion des gobelets d’Argonne à enduit noir et à celle des gobelets gris métallescents d’origine encore inconnue.
Néanmoins, dans une région comme la plaine de France, entité que se partagent Meldes et Parisii, la distribution
62 On ose à peine le terme devant les dimensions d’un tel récipient... ; peut-on parler de bouteille, voire de cratère destiné au mélange des liquides ?
63 C’est le cas à Meaux au IIIe s. (information Patrice Bertin).
des gobelets et celle des jattes Chenet 323 (lato sensu) fait apparaître un semis régulier qui suggère que les arrivages sont peut-être peu importants sur le plan quantitatif, mais qu’ils sont soutenus et constants64. Ce point mérite, à n’en pas douter, une analyse détaillée sur la base de comptages et de cartes de répartition fondées sur de nouvelles données. La situation dans la seconde moitié du IVe s. et au début du Ve s. est, dans ces mêmes régions, encore en grande partie mécon-nue. On signale certes çà et là quelques jattes Chenet 323a, mais toujours, ou presque, à l’unité. Là encore, on ne peut qu’appeler de nos vœux la réalisation d’une analyse sur des bases fiables, quantifiées et cartographiées renouvelant les données disponibles65, pour mesurer l’impact des produc-tions de Jaulges & Villiers-Vineux en dehors de la cité de Sens et, plus généralement, dans l’ensemble du nord de la Gaule.
64 Information inédite de Patrice Bertin.65 Séguier, Morize, 1996.