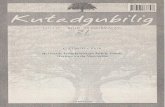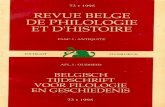Notes trophoniaques, II: La dixième épigramme de Callimaque, dans Hermes. Zeitschrift für...
-
Upload
uppsalauniversitet -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Notes trophoniaques, II: La dixième épigramme de Callimaque, dans Hermes. Zeitschrift für...
Franz Steiner Verlag is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Hermes.
http://www.jstor.org
Notes trophoniaques, II: La dixième épigramme de Callimaque Author(s): Pierre Bonnechere Source: Hermes, 136. Jahrg., H. 2 (2008), pp. 153-166Published by: Franz Steiner VerlagStable URL: http://www.jstor.org/stable/40379162Accessed: 20-08-2014 14:22 UTC
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of contentin a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship.For more information about JSTOR, please contact [email protected].
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
NOTES TROPHONIAQUES, II : LA DIXIEME ĒPIGRAMME DE CALLIMAQUE.
Timarque de Chēronēe (Plutarque, De genio Socratis, 589f-592f) et les croyances sur 1' Hades ?
La dixieme ēpigramme de Callimaque (Pfeiffer = Anthologie Palatine, 7, 520) concerne un Timarque ā l'identitē incertaine. Le texte, riche, vaut qu'on s'y arrete ānouveau:1
"Hv Si^Tļ TiļLiap%ov ev "Ai'8o<;, 6cļ)pa TtvGiļai Tļ ii Tiepi \ļfi>%fļ<; iļ nak\ 7tco<; eaeai, Si^eaOai tyvXr\q ITrotelnaiScx; mea naipoq ria\)aavio\)* Sf|£i<; 8' auxov ev evaepecov.2
«Si tu cherches Timarque dans l'Hades, desireux d'en apprendre soit au sujet de Tame soit sur «comment» tu revivras,3
1 J'ai trēs briēvement traitē ce point dans mon ouvrage Trophonios de Lebadee. Cultes et mythes d'une cite beotienne au miroirde la mentalite antique, Leyde-Boston, 2003, p. 182 (RGRW, 150). Pour d'autres precisions sur Trophonios, voir Notes trophoniaques, I: Triptoleme, Rhadamanthe, Musee, Eumolpos et Trophonios (P. Corn. 55), dans ZPE, 158, 2006, p. 83-87. Je remercie mon
collēgue et ami Vayos Liapis, du Centre d'ētudes classiques, pour ses nombreuses remarques constructives et bien des intuitions. De mēme Vincent Rosivach, de Fairfield University, a bien voulu m'ēclairer sur certains points. Ma gratitude va aussi aux participants de la table ronde, organisēe ā Montreal par TUniversite de Montreal et McGill University en octobre 2006, qui fit suite ā la
presentation orale de cette recherche. En dernier lieu, je mentionne les remarques de A. Kohnken sur certains points du texte, notamment sur l'anaphore 8i£ti - 8i£ea0ai et ses consequences.
2 ēv £i)oepea)v [par ex. : xcapw] : voir IG, 12 (3), suppl., 1190, 1. 5-6 (egQXol 8ē vai© 8(6uxxTa
Oepaecļjovai; x^P^ ^v evoepeov) ; 12 (5), 304, 1. 3, avec reconstitution (cf. /. Notion, 19, 6). Ex-
pression reprise par Grēgoire de Nazianze, apudAP, 8, 66. Voir aussi Lycurgue, Contre Leocrate, 96 ; [Platon], Axiochos, 371c, etc.
3 Au second vers, l'expression Tļ naXi neq eaeai peut ētre traduite de deux manieres, tout en gardant le mēme sens, selon que naXi se rapporte a ēoeai ou ā Tļ. A.S.F. Gow & D.L. Page, The Greek Anthology. The Hellenistic Epigrams, Cambridge, 1965, p. 191 ont adoptē la premiere solution, qu'ils qualifiaient de «more probable», et ont donnē la traduction: «soit sur comment tu revivras»; ā leur suite : C. Meillier, Callimaque et son temps. Recherches sur la carriere et la condition d'un ecrivain ā Vepoque des premiers Lagides, Lille, 1979, p. 198 ; E. Livrea, Tre epi- grammi funerari callimachei, dans Hermes, 118, 1990, p. 316, n. 8. G.B. Walsh (Callimachean Passages : The Rhetoric of Epitaph in Epigram, dans Arethusa, 24, 1991, p. 89) traduit: «to learn a bit of. . . eschatology », ce qui relēve dēja d'une interpretation. Mais naXi pourrait tout aussi bien se rapporter ā iļ, l'expression signifiant alors : «ou encore comment tu sēras [aprēs la mort / dans
l'Hades] ». Le tcgk;, quant ā lui, est marque d'une rēelle ambiguītē, peut-ētre voulue par le poēte :
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1 54 Pierre Bonnechere
cherche, de la tribu Ptolemai's, le fils qui a pour pere Pausanias : tu le trou veras au sejour des justes ».
Les commentateurs ont souvent tentē de prēciser, autant que faire se peut, les realia du texte. Ainsi la tribu Ptolemai's serait soit celle d'Alexandrie,4 soit celle d'Athēnes, bien que de graves flottements chronologiques grēvent cette derniēre interpretation.5 Au regard des allusions «philosophiques», dans le premier disti- que, ā la mort et la survie de Tāme, voire ā l'allusion voilēe ā un ouvrage intitule ITepi \ļ/\)%fļ(;, Timarque a toujours ētē identifiē ā un philosophe. Et parmi les trois Timarque philosophes et contemporains de Callimaque, celui d'Alexandrie sur- tout, le cynique, a retenu l'attention:6 son nom est citē par Diogēne Laērce, qui le dit ēlēve de Clēomēne, disciple de Mētroclēs de Maronēe, lui-mēme ēlēve de Thēophraste puis de Crates le Cynique (6, 95).7
faut-il le traduire par « de quelle maniēre/sous quelle forme » ou « par quelle faĢon/par quel moyen » tu sēras ā nouveau? «Comment», en fran9ais, rend parfaitement cette ambiguitē.
4 P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, I, Oxford, 1972, p. 38-60 et n. 8 (qui renvoie ā cette epigramme et ā la Vie d'Apollonios de Rhodes, p. 1, Wendel [Scholia in Apollonium Rhodium vetera, Berlin, 1935]). P.J. Parsons, Callimachus and the Hellenistic Epigram, dans Callimaque, Vandoeuvres-Genēve, 2002, p. 107 (Entretiens Hardt, 48) : «(probably) an Alexandrian tribe». F. Nisetich (trad, et comm., The Poems of Callimachus, Oxford, 2001, p. 306) parle lui d'un dēme Ptolemai's.
5 La creation de cette tribu, en remerciement des bienfaits de Ptolēmēe III, est habituellement datēe des alentours de 224-223 avant J.-C, mēme si certains remontent cette creation d'une dizaine d'annēes (bonne discussion chez Ē. Will, Histoire politique du monde hellenistique, 1, Nancy, 19792, p. 363-364). Or un accord entre speciālistes fixe la date de la mort de Callimaque aux alentours de 240-235 avant J.-C. II s'agit cependant d'une pure approximation, ā partir de quelques elements datables dans sa poēsie, des testimonia ainsi que de deux notices de la Souda, s.v. KaAMļLia/ot; (ou une olympiade est manifestement corrompue) & 'Apiaio(j>dvT|<; Bi)£dvxio<;. La naissance du poēte n'est pas davantage fixee, 310 avant J.-C. ētant de mēme une estimation. Voir A. Cameron, Callimachus and his Critics, Princeton, 1995, p. xiv et 3 ; L. Lehnus, Riflessioni cronologiche sulV ultimo Callimaco, dans ZPE, 105, 1995, p. 6-12. Rien ne dit, ēvidemment, que le dēcēs du poēte n'ait pu advenir aprēs 235, mais il n'est pas assure que Callimaque ait pu connaitre la fondation de cette tribu d'Athēnes. A.S.F. Gow & D.L. Page (The Greek Anthology [citē n. 3], p. 190-191) hēsitaient entre les deux possibilitēs. C. Meillier (Callimaque et son temps [citē n. 3], p. 198) opte pour la tribu alexandrine. Notons qu'une tribu de ce nom pourrait avoir existe dans d'autres vilies, hypothese qui rend tous ces raisonnements plus fragiles encore.
6 E. Livrea (Tre epigrammi funerari [citē n. 3], p. 317, n. 17-318) note que Ies parēchēses telles 8i£Tļ - 8i£ea0ai sont frequentes dans la littērature cynique, et que l'expression ev cuoePeov, dans le second distique, pourrait renvoyer ā un apophtegme d'Antisthēne le cynique: «ceux qui dēsirent ētre immortels doivent mener leur vie ei>aep©<; mi Sncaiox;».
7 Par exemple : Ē. Cahen, Callimaque, Paris, 1922, p. 1 16, n. 1 (CUF); A.W. Mair, Callimachus. Hymns and Epigrams, Cambridge (Mass.)-Londres, 19552, p. 145, note c (LCL, 129); F. Nisetich, The Poems (citē n. 4), p. 306. Contra P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, 3 (citē n. 4), p. 696 (qui renvoie ā U. von Wilamowitz-Moellendorff, Hellenistische Dichtung in der Zeit des Callimachos, 1, Berlin, 1924, p. 176). Les autres Timarque sont: un proche d'Aristote citē dans le testament du maītre (Diogēne Laērce, 5, 12), et un personnage invite par Mētrodore ā rallier les rangs de
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Notes trophoniaques, II : La dixieme ēpigramme de Callimaque 155
Plusieurs incertitudes sont manifestēs. La personne visēe par le poēte pourrait ētre un autre Timarque dont l'histoire ne nous a pas conserve le nom. Les motifs invoques pour en faire un philosophe sont assez faibles, plausibles tout au plus. Quant aux patronymes de ces trois Timarque, ils sont inconnus. Une derniēre faiblesse a ētē incidemment relevēe par Claude Meillier, dans son commentaire ēclairē de Tēpigramme :8 si Ton opte pour le cynique, qui serait mort entre 280 et 240 avant J.-C, on se trouve dans l'impasse pour expliquer les allusions sur l'au-delā. Cērtes les cyniques, dans le cadre d'une littērature de consolation, ont ā l'occasion ēcrit sur Tame et l'Hades.9 Mais ils ētaient agnostiques et jugeaient ēvidemment superflues les considerations sur la survie de l'ame que Timarque, dans le premier distique, est justement censē dēfendre, ou avoir dēfendues (« si tu cherches Timarque . . . pour savoir comment tu revivras »). Sans avoir la prētention de m'attaquer ā toutes Ies difficultēs qui hērissent ce magnifique texte, je voudrais proposer quelques nouvelles pistes, qui pourraient prēciser certaines donnēes et ouvrir peut-ētre ā d'autres perspectives.
La Xe ēpigramme ne rēvēle que par ētapes l'identitē de la personne qui, rēelle ou fictive, est inhumēe sous la pierre gravēe. Le premier vers, « si tu cherches Timarque dans l'Hades », est beaucoup trop vague pour orienter le passant, ou le lecteur, vers une personne en particulier. C'est une structure trēs similaire ā celle de la XIIIe ēpigramme, ou le passant demande, au vers 1 : «Est-ce Charidas qui repose sous toi, la pierre?» II existe bien des Charidae, ā n'en pas douter, et le
poēte, qui ā dessein laisse dans le flou l'identitē de la personne inhumēe, n'apporte la rēponse qu'au vers 2, quand la pierre tombale rēpond: «si tu veux parler du fils d'Arimmas de Cyrene, oui, je recouvre son repos». De tels commencements enigmatiques ne sont pas rares dans Ies ēpigrammes de Callimaque10 et, dans le cas de la Xe, le Timarque en question ne devient une personne dēterminēe qu'aux vers 3 et 4, quand sont citēs le nom de sa tribu, Ptolemais, puis celui de son pēre,
1'ēpicurisme (Plutarque, Contre Cōlōtēs, 17, p. 1117b). Voir A.S.F. Gow & D.L. Page, The Greek Anthology (citē n. 3), p. 190-191; E. Livrea, Tre epigrammi funerari (citē n. 3), p. 314-317; C. Meillier, Callimaque et son temps (citē n. 3), p. 197-199. L. Coco ([ēd., trad. & comm.], Calli- maco. Epigrammi, Manduria-Bari-Rome, 1988, p. 82) ajoute la possibilitē, d'aprēs le v. 2, que ce philosophe soit pythagoricien, sans autre explication ; G.B. Walsh (Callimachean Passages [citē n. 3], p. 90) considēre Timarque comme un philosophe «who claimed some knowledge of the soul's immortal nature and its condition after death (or its chances of surviving death)», sans relier ce Timarque au philosophe alexandrin.
8 Callimaque et son temps (citē n. 3), p. 199. 9 Comme le rappelle E. Livrea, Tre epigrammi funerari (citē n. 3), p. 316-317. 10 Ēpigrammes, 2: Hēraclite (v. 1), poēte d'Halicarnasse (v. 4-5); 7: Thēētēte (v. 1), poēte
non prime mais promis ā la gloire ēternelle (v. 2-A) ; 15 : Timonoē, mais laquelle? (v. 1), fille de Timothēos, de Methymna, et ēpouse d'Euthymenes (v. 2-4). Mēme 34 : Archinos, mais lequel (v. 2), le Crētois (v. 3). Dans la IIP ēpigramme, l'ēnigme n'est pas rēsolue (Timon le misanthrope), et laisse le lecteur seul responsable de son succēs.
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
156 Pierre Bonnechere
Pausanias, dans un enjambement, si toutefois celui-ci est significatif, une question qu'on laissera en suspens pour le moment.
Cette enigrne et ce flou initiaux, ā mon avis intentionnels, sont destines ā lancer le lecteur, le temps d'un moment, ā la recherche d'identifications possibles au Ti- marque qui repose soi-disant sous la pierre : 8i£eo0oa en quelque sorte. Mais ā la difference de l'epigramme XIII, qui ne donne aucun indice pour 1' identification de Charidas, le premier distique de la Xe ēpigramme dans son ensemble s'apparente ā une piste toute tracēe grace ā 1' accumulation de details convergents : Timarque, Hadēs, connaissances sur Tāme et une re-naissance, qu'il s'agisse de la vie dans l'outre-tombe ou d'une reincarnation.11 C'est cette sequence d'indices qui, loin d'etre anodine, nous retiendra dans un premier temps. Par la suite, nous cherche- rons ā savoir si le Timarque de la tribu Ptolemais, et peut-ētre le second distique au complet, plutot que d'etre la resolution terre ā terre de l'ēnigme initiale, ne sont pas eux-memes autre chose qu'un sourire ironique, de par le nom parlant du pēre, Pausanias.
1. La piste metaphysique du premier distique
De nombreux Timarque pouvaient venir ā l'esprit du passant, mais les preoccu- pations «philosophiques» sur l'au-dela semblent aiguiller en tous points vers un Timarque originaire de Chēronēe et qui, des siēcles plus tard, allait ētre au centre du De genio Socratis de Plutarque. Voyons la chose en detail.
Les protagonistes de ce dialogue sont des patriotes thēbains, en fait les conjures sur le point de massacrer la garnison spartiate sur la Cadmēe en 379 avant J.-C, mais ils sont aussi des philosophes, discourant, en dēpit d'un contexte pour le moins angoissant, de la nature des daimones. L'un d'eux tente alors d'unifier leurs multiples discussions par le biais d'un mythe philosophique, qualifie de hieros lo- gos : ā la fin du Ve siēcle avant J.-C, l'oracle de Trophonios, ā Lebadēe de Bēotie, aurait dispense au jeune Timarque une vision apocalyptique, dans une experience privilēgiēe de contact avec le divin ā laquelle le consultant, proche d'ailleurs de Socrate, ne survecut que deux mois.12
Quelle est cette experience ? Le jeune homme desire percer la nature du de- mon de Socrate, et la voie oraculaire lui semble tout indiquee. II decide done de consulter Trophonios, une divinite que Ton ne rencontre qu'au prix d'un voyage
11 La protase de 1'epigramme evoque allusivement le monde des tablettes « orphiques » : Timarque est ev evaepeav, 1'initie va sieger eg evayeav (II A 1 &2, Pugliese Carratelli). Voir aussi le terme ndXiv chez pindare (fr. 133).
12 Plutarque, De genio Socratis, 21-24, p. 589f-593a. Sur ce dialogue, son originalitē et sa grande coherence interne, voir D. Babut, Le dialogue de Plutarque «Sur le demon de Socrate». Essai d' interpretation, dans BAGB, 1984, p. 51-76.
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Notes trophoniaques, II : La dixieme ēpigramme de Callimaque 157
aux enfers nomme catabase dēs Ies plus anciens tēmoignages.13 La, descendu dans Yadyton, ii perd connaissance selon Ies modalitēs de la revelation locale:14 son āme, dit Plutarque, s'ēchappe du corps, s'ēlēve et se fond ā l'air ambiant, pour soudain recevoir la revelation au cceur d'un Hades celeste.15 La divinitē, dans une majestueuse vision, lui explique la destinēe de toutes Ies āmes et comment, une fois dēgagēes des liens du corps par la mort, beaucoup d'entre elles retombent dans le cycle des naissances pour ne pas s'ētre suffisamment purifiēes durant leur vie terrestre. Certaines, qui appartiennent ā des ētres d'exception, -comme Socrate,- parviennent ā atteindre la lune et y deviennent des dēmons dēsincarnēs, favorables aux hommes et en lesquels Plutarque, dans la droite ligne d'Hēsiode, voit Ies garants de la justice, les responsables des grands oracles et mysteres, et enfin la cause des actes de salvation.16
Les elements de cette description, et leur ordre dans le rēcit de Plutarque, se coulent ā la perfection dans le moule dēfini par Callimaque : Timarque, dans 1' Ha- des, acquiert un savoir sur Tame et sur la reincarnation. Mēme la question posēe ā Timarque par l'oracle de Trophonios, « xi rcoOeic; 7n)6ea9ca ; », pourrait renvoyer ā la fin du premier vērs de l'ēpigramme, « 6cļ)pa TruGiļca ».17
Ce rapprochement, autant que je sache, n'a jamais ētē propose. La plupart des speciālistes, ii est vrai, considērent Timarque de Chēronēe et son illumination comme une pure invention littēraire de Plutarque. Mais ils le font sans aucune raison argu- mentēe : 18 comme Timarque est un Chēronēen, on a cru dēceler dans cette figure une touche de chauvinisme, une trace pythagoricienne, voire mēme, ā cause du suffixe de son nom, un simple demarquage de celui de Plutarque.19 L'historicitē de Timarque
13 Hērodote, 8, 1 34 ; Dicearque, fr. 1 lac ; 79-8 1 , Mirhady ; /G, 7, 3055 (ca 350 avant J.-C.) et de nombreuses sources plus tardives.
14 P. Bonnechere, Trophonios de Lebadee (cite n. 1), p. 129-202, part. 129-164. 15 L'endroit ox\ se trouve Tame de Timarque est assez clair : la quatrieme partie de l'univers, sous
le pouvoir de Persephone, dēlimitēe par le Styx, et appelēe « route de l'Hades ». La consultation de l'oracle impliquait la descente dans une chambre souterraine d'ou le consultant aurait ētē « aspire »
vers l'Hades (Pausanias, 9, 39, 11 : sur la signification exacte de ce passage, voir P. Bonnechere,
Trophonios de Lebadee [citē n. 1], p. 157-164). 16 Sur ce point: Sur le visage qui apparait dans la lune, 30, p. 944ce. Hēsiode, Travaux,
121-126. 17 La formulē semble automatique en contexte eschatologique (voir P. Bonnechere, Trophonios
de Lebadee [citē n. 1], p. 193-202. Dēja Parmēnide, fr.l : xpe© Se <*e 7cdvxa 7t\)6ea0ai), mēme si, ēvidemment, on pourrait allēguer qu'il n'y avait guēre moyen de s'exprimer autrement.
18 Par exemple J. Sirinelli, Plutarque de Chēronēe, Paris, 2000, p. 251. 19 Ainsi J. Hani (dont l'ēdition et le commentaire sont par ailleurs excellents), Notice a Plutar-
que, Le demon de Socrate, Paris, 1980, p. 47 (CUF), qui suit PH. de Lacy et B. Einarson, Plutarch, Moralia, 7, Cambridge (Mass.)-Londres, 1959, p. 365, n. a. Un anachronisme enfin entacherait le
tēmoignage : Timarque fut enterrē ā proximite de Lamproclēs, le fils de Socrate, mort quelques jours avant lui, par les soins de Socrate lui-mēme. Or Lamproclēs aurait encore ētē en vie ā la mort de son pēre : Platon, Apologie, 34d ; Phēdon, 1 16b ; Xenophon, Mēmorables, 2, 2, sect. 1 . Quand bien mēme Plutarque (ou sa source), qui avait assidument frequente les milieux de 1' Acadēmie, aurait-
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
158 Pierre Bonnechere
de Chēronēe n'est pas une donnee accessible au regard de nos documents. Au reste, elle importē peu, au contraire de la date ā laquelle son aventure aurait ētē rapportēe pour la premiere fois. A cet ēgard, l'argument du silence a ētē systematiquement applique : le mythe et le personnage n'apparaissant nulle part avant Plutarque, Plu- tarque de facto en est devenu Tinventeur. Ce raisonnement simpliste est irrecevable. Et il ne suffit pas non plus de dire que Plutarque avait plagiē le mythe d'Er de Platon pour ēvacuer la question : loin d'ailleurs d'etre dēnuē d'originalitē comme on le rē- pēte trop souvent, il puise cērtes ā des sources platoniciennes, mais aussi ā quantite d'autres courants.
Or, il suffit d'un regard aux contributions philosophiques du IVe siēcle avant J.-C. pour entrevoir, dans Ies misērables fragments qui nous en sont parvenus, toute une recherche sur Tame qui faisait grand cas des experiences psychiques extracor- porelles, assorties parfois de visions eschatologiques. Platon y avait recouru,20 mais l'ēcole du Lycee y tenait aussi, depuis Aristote lui-meme et sans doute Thēophraste, dont Ies traitēs relatifs ā Tāme, aujourd'hui perdus, ētaient nombreux.21 Deux frag- ments explicites de Clearque de Soloi, et conserves un peu miraculeusement par Proclos, nous renvoient ā la mentalitē de la fin du IVe siēcle avant J.-C. : on y lit que Tame d'un certain Cleonyme, dans un beau cas de lipopsychia, s'ētait ēlevēe dans les airs, avait vu et entendu bien des choses, avant de rēintēgrer le corps.22 Le nom de Timarque dans la tradition philosophique, d'ailleurs, pourrait ne pas ētre fortuit; parmi les hommes de l'antiquite dont, disait-on, Tāme s'ēchappait hors du corps, deux contiennent le radical -tim- : Hermotimos de Clazomenes et Empedotimos, le premier evoque longuement par Apollonios, le second par un proche de Platon et d'Aristote, Hēraclide du Pont.23
Ceci nous amēne ā un autre pēripatēticien de la mēme epoque, Dicearque de Messine, qui s'ētait ēgalement intēressē ā ces phēnomēnes d'ēchappēe psychique. Et le plus intēressant, dans son cas, est qu'il semble en avoir discouru, entre autres, dans un volume intitule Eiq TpocļKDvioi) Kamfiācic,, prēcisēment le manteion oū
il commis une erreur chronologique, ceļa ne permet pas de rejeter sans discernement l'histoire de Timarque dans son ensemble.
20 Et le tardif dialogue apocryphe, Axiochos, montre que le theme demeurait vivace dans les milieux academiques.
21 Aristote, Sur la philosophie (Eudeme), fr. 1 1 (Ross); Theophraste, nos 345-347b (en general 266-275a, 328, 342-344, 719a-725, Fortenbaugh et al). Voir aussi Hēraclide du Pont (ami de Platon vieillissant), fr. 73-75 (Abaris: histoire de voyage d'ame); fr. 68-70 (Zoroastre); fr. 76-89 (Sur V absence de respiration : histoire de voyage d'ame [?]); fr. 90-1 17 (Sur Vāme), Wehrli.
22 Sur le sommeil, fr. 7-8, Wehrli. 23 Apollonius, Mirabilia, 3 (voir J.N. Bremmer, The Early Greek Concept of the Soul, Princeton,
1983, p. 38-43. Ce personnage est dēja evoque dans laMetaphysique d'Aristote, 984b) ; Hēraclide, fr. 90-107, Wehrli, part. fr. 93. Les sources tardives feront d'ailleurs d'Empēdotime un Lēbadēen (Cosmas Hierosolymitanos in Grēgoire de Nazianze, Chants, 64, 286-287 [= PG, 38, col. 512-513] et Nonnos Abbas, Scholia mythologica in Grēgoire de Nazianze, Oratio, 4 [Contre Julien, 1], His- toria 1, Nimmo Smith), ce qui le rapprochait de l'orbite de Trophonios. Hermotime de Clazomenes est citē en exemple par Trophonios ā Timarque chez Plutarque, De genio Socratis, 22, 592c.
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Notes trophoniaques, II : La dixieme ēpigramme de Callimaque 159
Plutarque fait descendre Timarque.24 Dans Ies misērables fragments de cette ceu- vre aujourd'hui perdue, il n'existe aucun indice de ce que Timarque avait ētē citē. Nēanmoins, face ā l'idēe, assez gratuite il faut le dire, d'une pure invention de Plutarque, il me semble beaucoup plus probant de conclure que Timarque avait pu ētre citē ou inventē dans le giron d'une ēcole philosophique du IVe ou Ille siēcle avant J.-C. (voire avant), pour ētre remis ā l'honneur par Plutarque.25
L' ēpigramme de Callimaque apporte, je crois, un element dēcisif en ce sens, car elle se caique trop bien sur l'experience et l'eschatologie rapportēes par Plutarque des siēcles plus tard, ā propos de Timarque de Chēronēe. On pourrait objecter que ce Timarque aux relents metaphysiques aurait ētē trop peu connu pour exciter aussitot Timagination du public lettrē de Callimaque. Ce serait ignorer, je pense, les hasards de la transmission des textes antiques : combien compte-t-on, chez les Alexandrins, d'ēpisodes enigmatiques ā n'avoir laissē de trace dans aucune source antērieure? Dicearque par ailleurs, qui s'ētait intēressē de prēs au Trophonion, serait un maillon ideal entre la Grēce du Lycee et le Musēe d' Alexandrie : loin d'etre alors le personnage obscur qu'il est pour nous, il faisait partie des ēlēves directs d'Aristote, interlocuteur de Thēophraste, d'Aristoxene ou d'Hēraclide du Pont. II avait animē les grands dēbats contemporains26 et, parmi les membres du
24 Fr. 13-22, Wehrli. La nouvelle edition de D. Mirhady {Dicaearchus of Messana. Text, Translation, and Discussion, ēds W.W. Fortenbaugh & E. SchOtrumpf, New Brunswick [USA] - Londres, 200 1 , p. 1-142) a remaniē le classement de F. Wehrli (Die Schule des Aristoteles, 1 , Bale, 1944). Celui-ci avait place les fragments reliant Tāme et la divination dans l'ouvrage sur la descente chez Trophonios; ces fragments ont ētē replaces par Mirhady dans le traitē sur Tame (30a-31c), qui inclut par contre les fragments sur l'oracle de Trophonios (79-81) dans les oeuvres concernant l'histoire culturelle de la Grēce. Les deux attributions sont, je crois, parfaitement dēfendables. Cependant, quand on sait l'importance de l'ēchappēe de Tame dans le processus de revelation au Trophonion (voir supra, n. 15), il serait surprenant que Dicearque, dans un traitē sur cet oracle en particulier, n'y ait traitē que de points secondaires comme les fragments conserves sembleraient Tindiquer. Je rappelle, par exemple, que l'oeuvre d'Hērodote serait ridicule et mēconnaissable si Ton se fiait uniquement aux citations qui nous en sont parvenues, notamment celles d'Aristote et de Thucydide (D. Lenfant, Peut-on sefier aux «fragments d'historiens »? : V exemple des citations d'Hērodote, dans Ktēma, 24, 1999, p. 103-121).
25 Ce dernier avait d' ailleurs compose un traitē, ēgalement perdu mais dont le titre ētait presque identique ā celui de Dicearque, riepi xf\q eiq Tpo^coviov Kaxapdoeax;: Catalogue de Lamprias, n°181.
26 Voir par exemple Cicēron, Definibus, 4, 79 ; Plutarque, Contre Colotēs, 14, p. 1 1 15a; Suda, s.v. AiKaiap%o<;. En politique, il dēfendait la primautē de la vie active sur la vie contemplative (fr. 33-52, Mirhady), ainsi que Ies mērites de la fameuse «constitution mixte», dont Polybe allait s'inspirer (fr. 86-88, Mirhady ; voir G.J.D. Aalders, Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum, Amsterdam, 1968, p. 72-81 ; F.W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, t. 1, Oxford, 1957, p. 639-641) ; en ethique, par le biais de biographies, il avait discouru sur le libre arbitre dont seul bēnēficiait, pour son bonheur et son malheur, l'etre humain ; en gēographie, il avait applique de nouvelles mēthodes mathematiques, etc. En dernier lieu J.-P. Schneider, art. Dicearque de Messine, dans Dictionnaire des philosophes antiques, ss dir. R. Goulet, t. 2, Paris, 1994, p. 760-764, et la collection d' articles dans Dicaearchus of Messana (citē n. 24).
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1 60 Pierre Bonnechere
Musēe, on voit qu'Eratosthene le tenait en haute estime.27 Ses commentaires sur Homēre28 et sur Alcēe, sur les tragedies, son livre d'hypotheseis, ainsi que ses ēcrits sur Ies concours littēraires (fr. 89-111, Mirhady) n'avaient pu passer inaper^us des philologues alexandrins.29
En matiere de psychologie, Dicearque s'opposait aux autres pēripatēticiens quant ā rimmortalitē de Tame. Pour lui l'esprit mourait avec le corps (fr. 27-29, Mirhady). « 'ApiaxoxeXriq Kal AiKaiap%o<; xovq oveipoax; eiadyovai, dOdvaxov |iev xflv \\rvxr\v o\) vofii^ovxeq, Geiov 8e xivoq ļiex8%eiv», soit: «Aristote et Di- cearque croient aux rēves (le fr. 30b ajoute «et ā l'enthousiasme») : ils ne croient pas que 1'ame soit immortelle, mais bien qu'elle partage quelque chose de divin» (fr. 30a; aussi 30b-31c, Mirhady). Une experience extatique comme celle de Ti- marque aurait done naturellement trouvē place dans ses recherches, mēme si les conclusions qu'il en aurait tirēes auraient ētē assez diffērentes de celles d'un aca- dēmicien eclectique comme Plutarque : qu'a cela ne tienne, ce qui retient ici notre attention est l'histoire du mythe de Timarque, non 1' interpretation philosophique qui ne dut pas manquer de diviser Ies ēcoles. On manquait d'une trace antērieure ā Plutarque pour ce mythe, et je crois que Callimaque nous la fournit.
2. Le Timarque de Callimaque est-il unpersonnage reel?
L' allusion aux questions metaphysiques et ā l'au-delā, dans le premier distique, est ainsi replacee dans un cadre plus large, sans qu'il soit nēcessaire de Ies rattacher ā Timarque le cynique en particulier, ce qui posait problēme, nous l'avons dit. Qui est dēs lors ce Timarque vise par l'ēpigramme depuis le debut, ce fils de Pausanias, de la tribu Ptolemais, et pourquoi Callimaque avait-il provoque sa mise en relation avec le consultant oraculaire et voyageur dans l'au-dela?
II pourrait s'agir d'un homonyme en chair et en os. La conclusion du poete, «tu le trouveras au sejour des £\)aePel<;», serait ā comprendre soit dans son sens
27 Ēratosthēne -et aprēs lui Straton- avait trouvē ā Alexandrie les ēcrits de Dicearque concernant la mesure de la cireonfērence terrestre, la mesure de la latitude et celle de la hauteur des monta- gnes (fr. 116-127, Mirhady), datēs de Textreme fin du IV6 siēcle et peut-ētre sous le patronage de Ptolēmēe (?), et s'en ētait inspirē: RT. Keyser, The Geographical Work ofDikaiarchos, dans Dicaearchus ofMessana (citē n. 24), p. 353-372 ; voir aussi P. Pēdech, La geographie des Grecs, Paris, 1976, p. 196-200.
28 Les fragments 93 & 94-95 (Mirhady) semblent mēme impliquer qu'il se soit intēressē au dialecte et aux variantes homeriques.
29 D'autant que le Musēe avait ētē fondē sous le conseil de Dēmētrios de Phalēre, ēlēve de Thēophraste, trēs au fait des dēveloppements scientifiques et dont Cicēron (Des lois, 3, 14) fait l'hēritier « en thēorie et en pratique » de ses prēdēcesseurs en pensēe politique : Aristote, Thēophraste et Dicearque (sou vent citēs ensemble d'ailleurs dans les autres fragments). Phlēgon (Livre des merveilles, 4 & 5) cite comme ses sources pour Tirēsias et pour les Lapithes : Hēsiode, Dicearque, Clitarque, Callimaque (et quelques autres).
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Notes trophoniaques, II : La dixieme ēpigramme de Callimaque 161
eschatologique strict, soit simplement comme une allusion poetique aux morts.30 C. Meillier a propose de voir dans le plēonasme « le fils qui a pour pere Pausanias » une trace de la bureaucratie ptolemai'que, et a paraphrase plus librement : « Cherche dans la liste de la tribu Ptolemai's, dans la colonne mentionnant les fils, le Timarchos dont le nom du pēre est Pausanias», une formulation qui, selon E. Livrea, serait mēme celle d'un reģistrē fiinēraire.31
A cette idēe trēs reāliste peut s'opposer celle d'un simple jeu d'esprit. Rien n'oblige ā faire du bēnēficiaire de Tepigramme un personnage reel : le thēme, cērtes lie ā la mort et l'au-dela, n'est pas funēraire au sens strict, avec mention de la tombe par exemple.32 II apparait ludique autant que funēbre, et en fait critique les mythes qui racontaient le sort de Tāme aprēs la mort. On n'a pas manque d'ailleurs de si- gnaler combien le poeme est ā cet ēgard dēvastateur : comment interroger quelqu'un dans Ies enfers, mēme sur la survie, sans ētre mort soi-meme ? En d'autres termes, fondēe sur l'antithese mort - survie, Tepigramme ridiculiserait, sinon la croyance elle-mēme, au moins ceux qui prētendaient expliquer l'au-dela et ses secrets.33 La signification de l'ēpigramme demeure nēanmoins incertaine, car il reste difficile, pour un dēfunt qui cherche Timarque dans l'Hades, de consulter encore un reģistrē officiel ā Alexandrie.34
Si, dans un tel contexte, 1' interpretation est privēe de bases solides, on peut tenter, tout en sachant Ies limitēs subjectives de la mēthode, de dissequer le second distique au niveau des jeux de mots et de possibles ambiguitēs semantiques.35
Un premier indice vient du nom de la tribu : au vers 3, ITcoXeli-caSoq est l'exact correspondant du ev "Ai'8o<; du premier vers.36 Face ā l'Hades visitē par Timarque de Chēronēe, axe sur la survie de l'ame et la reincarnation ou la renaissance, le nom de la tribu, avec son suffixe -ai8o<;, renverrait ā la rēalitē directe de la mort, qu'elle soit inaccessible ā l'entendement ou, plus simplement, sans possibilitē de retour.
30 C. Meillier, Callimaque et son temps (cite n. 3), p. 199. 31 C. Meillier, Callimaque et son temps (citē n. 3), p. 198 ; E. Livrea, Tre epigrammifunerari
(citē n. 3), p. 318. 32 Epigrammes, 9; 11-12; 15-20, etc. Le ton ressemble plutot aux 4, 13, ou 23, davantage
satiriques. E. Livrea, Tre epigrammifunerari (citē n. 3), p. 314; C. Meillier, Callimaque et son
temps (citē n. 3), p. 197. 33 Voir par exemple E. Livrea, Tre epigrammifunerari (citē n. 3), p. 318; aussi C. Meiller,
Callimaque et son temps (citē n. 3), p. 198-199 ; G.B. Walsh, Callimachean Passages (citē n. 3), p. 90-91. Bonne comparaison en Epigrammes, 13.
34 A moins d'imaginer que les enfers sont, en mode plaisant, imagines comme le caique du monde ptolemai'que, avec sa bureaucratie tatillonne.
35 Peut-ētre le nom de la tribu Ptolemai's, dont nous ignorons tout, ajoutait-il encore un peu de
piquant, un lieu par exemple ou on ne se serait pas attendu ā trouver un juste, mais ce sont la de
simples suppositions fondēes sur cette tension, qui traverse toute rēpigramme, vers une rēponse que Callimaque retarde au maximum, puisqu'on n'a la certitude de la mort de Timarque qu'a la fin du dernier vers.
36 C. Meillier, Callimaque et son temps (citē n. 3), p. 199 ; E. Livrea, Tre epigrammifunerari (citēn. 3), p. 318.
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1 62 Pierre Bonnechere
Un second indice vient du patronyme, Pausanias, que les anciens rapprochaient etymologiquement de Teat)©, rccrueoOca, «cesser», «faire cesser», comme Platon dans le Banquet (185c),37 ou mēme «faire cesser par la mort». Pausanias signifie en fait « celui qui fait cesser les maux » (nav® et ctvia), une idee que Callimaque aurait appliquee ā des fins funēraires, ā la suite d'une longue tradition dans la pensēe grecque.38 L' argument n'est pas saugrenu, et surtout dans ce contexte de revelation sur l'au-dela.
II est en effet un Pausanias, et de reputation panhellenique, le regent de Sparte vainqueur des Pērses ā Platēes, ā propos duquel couraient deux anecdotes conver- gentes qui valent un dētour un peu plus long. Alors qu'au faite de sa gloire, il s'egarait sur la mauvaise voie, menant ā la tyrannie sur tous les Grecs, Pausanias aurait d'abord, par inadvertance, tuē une jeune Byzantine qu'il voulait violer, Clēonice, et dont le fantome le menaĢa, rēve aprēs rēve, d'un juste chātiment en rēpētant toujours le mēme vērs epique (non localise) :
«crcei%£ [ou Paive] 8ikt1<; aaaov \iāXa xoi koikōv dvSpdaiv iippu;».
« Marche ā ton chātiment : la dēmesure est un grand mal pour les hommes ».
Alors que, cherchant ā se racheter, il evoquait Tāme de Clēonice ā l'oracle des morts (psychopompeiori) d'Hēraclēe du Pont, celle-ci lui annonĢa que tout mal cesserait (nombreuses formes de rccnieaGai) dēs qu'il rentrerait ā Sparte oū, naturellement, il mourut peu aprēs.39 Cette version diffēre fortement du rēcit de Thucydide, qui montre Pausanias se rendre au sanctuaire du Tēnare pour y interroger, non Tāme de Clēonice, mais un de ses sbires rēfugiē en suppliant. Les ēphores, voulant le prendre sur le fait, y ēcoutent la conversation ā travers une tente ā double cloison et, sur ces entrefaites, dēcident de le faire arrēter. Le rēgent s'enfuit et meurt de faim au sanctuaire d'Athēna Chalkioikos sur l'acropole de Sparte.40
De toute evidence, entre Thucydide41 et Plutarque, l'histoire avait ētē rēēla- borēe, non sans logique d'ailleurs, puisque le sanctuaire du Tēnare ētait aussi un psychopompeiori. Le nom de Pausanias y est dēsormais parlant, etymologiquement liē ā TtcnieoOca et ā la mort imminente du rēgent, thēme au demeurant banal lors des consultations oraculaires lēgendaires. L' absence de l'ēpisode de la jeune fille chez Thucydide n'autorise pas ā y voir une adjonction tardive. L'historien, pour cette affaire, a pu filtrer ses sources et les expurger de ce qu'il considērait comme
37 riavaavicu 8e Ttcruaaļj.evo'u -8i8daKO'uai yap lie loa A-eyeiv o\rca>ci oi oo<f>oi-. 38 Dēja Homēre, Odyssee, 20, 273-274 : Antinoos ā Telemaque. Sophocle, ā propos d'CEdipe
vainqueur de la Sphinge, utilise l'expression «encruad viv», qui fait penser immēdiatement au nom de Pausanias {(Edipe-Roi, 397).
39 Plutarque, Cimon, 6, 4-7 (icaiKjeoOai) ; Des delais de la justice divine, 10, p. 555c (rcauaexai, naDOļievoi)).
40 Oū ses concitoyens seraient, par la suite, obliges par l'oracle de Delphes de lui dresser deux statues. Thucydide, 1, 128-134.
41 Et mēme peut-ētre les sources de Thucydide.
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Notes trophoniaques, II : La dixieme ēpigramme de Callimaque 1 63
trop hērodotēen.42 Outre son «nom parlant», ce Pausanias off re avec la dixieme ēpigramme de Callimaque un autre parallēle flagrant: il interroge Tame d'une morte, ā la bouche des enfers, avant de mourir lui-mēme faute d' avoir ēlucidē la revelation ambiguē.
Uhybris de Pausanias, stigmatisee par l'āme de Clēonice dans le vers epique, nous amēne ā la seconde anecdote : face ā la dēmesure du regent, le poēte Simo- nide lui aurait rappelē «qu'il n'ētait qu'un homme».43 Cette dichotomie mortel / immortel semble avoir, dēs l'antiquite, impregnē toute la reputation de Pausanias, y compris dans le nom de la jeune fille qu'il tue, Cleo-nikē. La victoire de Platēes, qui garantissait ā Pausanias le kA£O<; acķGitov, immortel, est ainsi traitēe en miroir, car la «gloire (immortelle) de la victoire» est aussi la cause de sa mort.44
Tout ceci nous autorise, au minimum, ā penser que le nom « Pausanias » ētait naturellement riche de sens pour les intellectuels, et en accord avec l'antithēse de l'ēpigramme, la fameuse opposition vie - survie. L'enjambement realise sur IlaDoavio'u serait en ce cas parfaitement intentionnel. Une autre piste, mais tellement semblable sur la symbolique du nom, mēne au disciple d'Empedocle, Pausanias, auquel le maitre enseigne Ies remēdes « contre les maux » : dominer les vents et la pluie, et, plus important pour nous, ramener des enfers Ies āmes des dēfunts...45
Enfin un troisieme indice provient d'une anaphore, la double utilisation du verbe 8i£ea0ca chez un poēte pour qui les repetitions sont significatives.46 Ai£ea0ca n'est pas, ēvidemment, utilise exclusivement en contexte infernal ou funēraire, au contraire,47 mais il possēde ā l'occasion de nettes accointances avec l'au-dela. Dans
42 Pausanias (3, 17, 7-9), ignorant la tradition de Foracle des morts ā Hēraclēe, montre le regent de Sparte recourir aux psychagogues arcadiens : structuralement, les elements de fond demeurent identiques. Dans la version d'Aristodeme (Fr.Gr.Hist., 104 F 8 [1]), Pausanias a eu recours ā des sacrifices expiatoires, sans autre detail. Cet article ētait sous presse quand j'ai eu connaissance du beau livre de P. Ellinger, La fin des maux. D'un Pausanias ā V autre, Paris, 2005, qui a dēveloppē ces themes jusqu'au moindre detail : j'y renvoie pour toute indication supplemental.
43 Apud Ēlien, Histoires variees, 9, 41; mais 1' anecdote est bien connue dēja par Plutarque, Consolation ā Apollonios, 6, 105a; cf. aussi Platon, Lettres, 2, 311a.
44 Selon Elien {Histoires variees, 9, 41), juste avant de mourir, Pausanias clame trois fois qu'il comprend maintenant le sens des paroles de Simonide, en echo evident au Crēsus d'Hērodote : il est difficile de savoir ā quand remontē cette portion du rēcit.
45 31 B 1 (D.-K. = fr. 3, Bollack): je dois ce rapprochement ā P. Ellinger, La fin des maux (citē n. 42), p. 163-166.
46 C. Meillier, Callimaque et son temps (citē n. 3), p. 199. Repetitions dans Ies ēpigrammes : 1, 12etl6;3, let 2; 22, I,2et4;25, 1 et3; 29, 3; 30, 1 ;45, 3 et4; 63, 1 et 3, 2et4. Jeremercie A. Kohnken pour ces precisions.
47 Par exemple chez Bacchylide, Dithyrambes, 4, 60 ; Hērodote, 1, 67 ; 2, 66 ; 3, 53 ; 4, 142 ; 15 1 ; 5, 92 8; 7, 167. . . ; Hēsiode, Travaux, 602-603, etc. Ce sens profane se trouve bien ēvidemment aussi chez les Alexandrins : Apollonios de Rhodes, 1, 1208 ; Callimaque, Hymne ā Zeus, 16. Sur 5i£oum - SiĶnjiai dans le sens de «chercher», voir E. Livrea (ēd.), Colluto: il ratto di Elena, Bologne, 1968, p. 105-106.
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
164 Pierre Bonnechere
YOdyssee dēja, Ulysse aux enfers cherchait (5i£nai) auprēs de Tirēsias « un retour agrēable»,48 soit une faĢon de revenir du monde des morts, qui est aussi celui de ses errances, ā Ithaque. A ce theme allait se rēfērer ēgalement un autre Alexandrin, Lycophron, qui utilise le mot quand Ulysse recherche Tiresias dans la plaine des morts: «veicpop-avTiv KE[ineXov 8i£naeTca» (Alexandra, 682 [681-687]). Le terme VEKpoliavxiq y est en accord avec le Tēnare chez Thucydide, avec 1' oracle des morts d'Hēraclēe du Pont chez Plutarque.49
Une attention toute particuliēre enfin doit revenir au terme 8i£r|ci<;, utilise ā quatre reprises par Parmēnide, une fois pour specifier 1' alternative de la bonne ou de la mauvaise direction de recherche, et trois autres fois pour specifier le mau- vais chemin, celui qu'il faut ēviter ā tout prix.50 Parmēnide, on le sait, reĢoit une revelation par Ies soins d'une dēesse aux relents mysteriques et done anonyme, Thea, dans un enfer ouranien clairement evoque51 et que Callimaque congoit pro- bablement ainsi. Le fr. 7 de Parmēnide, deux fois citē par Platon dans le Sophiste (237a et 258d), s'ēnonce en ces termes :
« O\) yap jLiTļ 7COT8 tomo Saļifļ, eivca \ii\ eovxa, aXka ci) xflaS' cm))' 68o\) 8iCnoioc; elpye voTļjna».
« Non jamais tu ne pourras forcer ā ētre ce qui n'est pas, mais de cette route de recherche, ēcarte ta pensēe».
II faut avouer que Callimaque, en ce contexte d'outre-tombe, pourrait s'ētre inspirē de faĢon trēs humoristique de 1' opposition ētre / non-ētre: au lecteur qui, dans l'Hadēs, serait tentē de chercher Timarque, qui n'est plus, pour en apprendre la vēritē sur le fait « d'etre ā nouveau », ce qui reviendrait ā « forcer ā ētre ce qui n'est pas », -la mauvaise voie de recherche,- il propose d'accepter soit la fatalitē de la mort, soit l'impossibilitē pour l'esprit humain d'en percer le secret.52
48 11, 100: voaxov Si^ai ļieXiTļ5ea, (j>ai5iļi' '08\)aaei), en echo ā Odyssee, 23, 251-253 : ©<; yap ļiioi \ļn>xfi ļj.avxe\)aaTO Teipeaiao fļ^iati xē, 6x£ 8fi KaxepTlv 56|iov "Ai5o<; eiao, voaxov exaipoiaiv 5i^fmevo<; r\& eļnoi a\>x©.
Dans YHymne homerique ā Hermes, on retrouve le mēme verbe dans la bouche d' Apollon qui cherche ses vaches, un episode dont les allures chthoniennes ont ētē souvent relevēes (190-193, 215-216, 261-262, 370-372).
49 Et avec les psychagogues arcadiens chez le Pēriēgēte (voir supra, n. 42). 50 Frs 2, 8 ; 6, 3 et 10 ; 7, 3; cfr aussi 5i£f|aeai en 8, 6. 51 Voyage en char, passage des portes ēthēriennes dont le seuil est chthonien, revelation to-
tale. 52 Reste une derniēre piste: le 5f|ei<; du dernier vers, forme relativement rare, n'est pas sans
rappeler Dēmēter sous sa forme hypocoristique At|<6, attestēe dēs YHymne homerique ā Demeter (47-48; 492), Sophocle {Antigone, 1119-1121), etc., et bien connue de Callimaque (Hecalē, fr. 285, 1 ; Hymne ā Demeter, 132-133) et des Alexandras (Apollonios de Rhodes, 4, 988 ; Nicandre, Alexipharmaca, 1 27-13 1). Or s'il est une divinitē impliquee dans une quete infernale, e'est bien la mere de Core. Peut-ētre peut-on, pour revenir encore sur un jeu de mots infernal, allēguer la proxi-
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Notes trophoniaques, II : La dixieme ēpigramme de Callimaque 1 65
Selon cette interpretation, le theme de la visite aux enfers apparait trois fois dans les quatre vērs de l'ēpigramme. II y a d'abord le lecteur, qui cherche Timarque dans l'Hades pour en obtenir une revelation sur la devolution de Tame aprēs la mort. Cette quete renvoie ā celle d'un autre Timarque, qui avait appris la mēme chose, dans l'Hades et de la bouche de Trophonios en personne. Et, dans ce contexte, le patronyme du Timarque de l'inscription, Pausanias, rappelle aussitot 1'evocation necromantique par le regent de Sparte, ā nouveau aux marges des enfers.
Qui plus est, deux de ces consultations dēbouchent sur la mort des visiteurs infernaux. Timarque de Chēronēe, deux mois aprēs avoir ētē informē des secrets de la vie aprēs la mort, meurt comme Trophonios le lui avait annoncē ā demi-mot.53 Pausanias le regent interroge Tame d'une morte54 qui lui annonce, sous couvert d'une metaphore, sa mort imminente. Son nom parlant renvoie au patronyme du dēfunt Timarque honorē par 1 'ēpigramme qui, siēgeant parmi les justes, sera capable, dit l'ēpigramme, de rēpondre ā l'enqueteur. Tous trois se sont done vu prēdire la « fin de leurs maux »55 et tous trois, bien que morts, sont dēsormais en possession de ces vēritēs eschatologiques. Le paradoxe est assez plaisant : il y a effectivement moyen de connaitre les secrets relatifs ā l'āme aprēs la mort, mais cette revelation dēbouche elle-mēme sur la mort de ceux qui en prennent connaissance.
Que dire alors du lecteur, que Callimaque imagine en train de chercher Timar-
que, justement pour en apprendre ce qu'il adviendra de son āme aprēs la mort ? Le texte, en fait, n'implique pas que ce lecteur doive ētre mort pour s'entretenir aux enfers avec l'āme de Timarque. Le poēte peut mettre en scene une nekyia sur les traces d'Ulysse, renforĢant l'impression de peine perdue, voire une consultation necromantique dans un oracle appropriē, un psychopompeion. Mais ā mes yeux, Callimaque procēde par mise en abime, en ironisant sur le danger qu'il y a a vou- loir connaitre la fin derniēre des choses, si cette connaissance est synonyme d'un aller simple pour l'Hades.56
mitē de 8Tļ'io©, tuer, ravager, selon l'etymologie d'ailleurs dont les Anciens usaient pour expliquer At|<6, et ce au moins depuis le papyrus de Derveni (col. 22, 1. 12-13, Janko).
53 De genio Socratis, 22-23, 592df. 54 Ou, selon Pausanias, les psychagogues arcadiens, ce qui revient au mēme. 55 Au demeurant, T oracle qui prēdit la mort des consultants est un lieu commun de la litterature
oraculaire en Grēce. 56 Un fragment de Dicearque (32, Mirhady) dit ceci: «Mais (les stoiciens disent) qu'il est
important pour nous de savoir les choses ā venir. Selon un gros livre de Dicearque, mieux vaut ne pas avoir connaissance de ces choses plutot que de Ies connaitre». Ētant donnē la briēvetē du fragment et son absence de contexte, je prefere m'en tenir ā le citer en note, non sans trouver cet avis de Dicearque bien ā propos pour la comprehension de l'epigramme!
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
166 Pierre Bonnechere
3. Conclusions
Dans la Xe ēpigramme, Tidentitē exacte du Timarque dēcēdē demeure un mystere jusqu'au troisiēme vers, une situation qui permet ā Callimaque de pousser son lecteur ā tenter de dēcouvrir par lui-mēme de quel personnage il pouvait s'agir. Pour ce faire, il multiplie certains indices metaphysiques qui, au rang des candidats potentiels, semblent designer Timarque de Chēronēe mēme si, en derniēre analyse, la solution s'avēre bien plus simple. Nēanmoins, cette allusion fine offre dēsormais la premiere attestation d'un mythe philosophique qu'on croyait n'ētre qu'une in- vention tardive de Plutarque dans le De genio Socratis, et dont la Quellenforschung se trouve radicalement modifiēe. Cette analyse confirme aussi l'importance de l'ēpisode de Timarque dans les traditions de l'oracle de Trophonios, entre Tecole pēripatēticienne et le mēdioplatonisme.
Ētant donnē ces premisses, il y a tout lieu de croire que si le poēme lui-mēme pourrait avoir ētē destine ā un Timarque historique, dont l'identite nous echapperait, il peut aussi faire allusion ā une figure de fantaisie qui permettait, grace au nom parlant de Pausanias « celui qui libēre des maux », quantite de jeux d'esprit sur la mort,57 sur la quete aux enfers et sur l'ineptie de tenter de percer, s'ils existent, les mysteres de la vie dans l'au-dela.58 A ce stade, nēanmoins, faut-il exclure le philosophe cynique Timarque d'Alexandrie?59 Pas nēcessairement. Aprēs tout, quoi de plus ironique que d'aiguiller un consultant fictif vers un philosophe qui, hostile durant sa vie ā toute tentative de dēcrire l'au-dela, se verrait designer, une fois mort, comme le dēpositaire de cette fatale vēritē ?
Centre d'ētudes classiques, Universitē de Montreal Pierre Bonnechere
57 Une derniēre idēe, iconoclaste sans aucun doute, vaut au moins la peine d'etre ēnoncēe en note : dans quelle mesure le poēte de cour Callimaque, dans cette ēpigramme qui tourne autour de l'antithese mortel - immortel, n'a-t-il pas, par la mention de la tribu Ptolemais, lance un clin d'ceil ironique aux Ptolēmēe et ā leur habitude de divinisation (cfr le fr. 228), dans une attitude comparable ā celle de Simonide face ā Pausanias ?
58 Une ēpitaphe fictive (AP, 7, 370), par Diodore (Ier siēcle avant et aprēs J.-C), est visible- ment inspirēe de la forme de repigramme de Callimaque. Elle oppose deux Mēnandre, Tun qui est mort et repose sous la pierre, l'autre, «tu le trouveras dans la maison de Zeus, ou au pays des bienheureux ». Mais elle est dans une ligne de pensēe plus traditionnelle, puisque la survie de Tame du poēte est hors de doute.
59 En tous les cas, la mise en evidence de Timarque de Chēronēe dans le premier distique rēsout la difficultē des allusions eschatologiques, qu'on ne pouvait allouer ā un cynique.
This content downloaded from 132.204.38.173 on Wed, 20 Aug 2014 14:22:28 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions