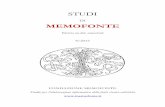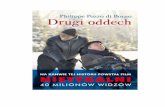MUSSI M. 2010-2011. Grotta di Pozzo (AQ, Italie centrale), une grotte ornée « au féminin ». In :...
Transcript of MUSSI M. 2010-2011. Grotta di Pozzo (AQ, Italie centrale), une grotte ornée « au féminin ». In :...
CLOTTES J. (dir.) 2012. — L’art pléistocène dans le monde / Pleistocene art of the world / Arte pleistoceno en el mundo Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010 – Symposium « Signes, sympoles, mythes et idéologie… »
Grotta di Pozzo (AQ, Italie centrale), une grotte ornée « au féminin »
Margherita MUSSI*
Grotta Romanelli, dans le sud des Pouilles, est la première grotte ornée découverte en Italie : reconnue comme telle par Stasi et Regalia dès 1905, elle ne manque pas d’être âprement contestée avant que la réalité de l’art pléistocène ne s’impose, en Italie comme ailleurs (Orlando 2003; Stasi & Regalia 1905). Un demi-siècle plus tard, en 1956, Graziosi ne connaît encore que trois autres grottes avec art pariétal, toutes en Sicile, alors que Leroi-Gourhan en 1964 n’ajoute à cette bien petite liste que Grotta del Romito en Calabre, qu’il mentionne très brièvement. En 1973, une nouvelle monographie de Graziosi porte l’effectif total à 19, dont Grotta Paglicci qui, pour la première fois, comporte des peintures. Plusieurs, toutefois, ne présentent que de simples incisions linéaires dont la datation n’est pas établie avec certitude et, dans son inventaire de 1987, Zampetti fait état de 15 sites seulement avec représentations zoomorphes. Les localités sont toujours les mêmes : Grotta del Caviglione aux Balzi Rossi en Ligurie, Grotta Paglicci et Grotta Romanelli dans les Pouilles, Grotta del Romito en Calabre, et 8 grottes en Sicile. Ces dernières correspondent en bonne partie aux découvertes faites dans les alentours de Palerme, surtout par C. Mannino, actif dans les années 1960-1970.
Quelques années plus tard, des traces de peinture rouge en larges bandes sont remarquées à Riparo di Villabruna en Vénétie (Broglio 1992). Plus récemment, de nouvelles grottes avec incisions pariétales, ainsi que de nouveaux motifs dans des sites déjà connus ont été repérés, et certains sont publiés : Grotta delle Arene Candide en Ligurie et, à nouveau, Grotta Romanelli (Mussi et al. 2006 ; Mussi & De Marco 2008). Ces recherches indiquent bien que les cavernes ornées d’Italie, certes moins nombreuses que celles de France ou d’Espagne, sont à ce jour tout de même largement méconnues et sous-estimées. Les manifestations d’art pariétal de Grotta di Pozzo, décrites ci-dessous et encore inédites, en sont un exemple.
Grotta di Pozzo (AQ) Grotta di Pozzo, dans la province de L’Aquila, s’ouvre à 700 m d’altitude sur le
versant sud du bassin de l’ancien lac Fucino, aujourd’hui asséché. Elle se trouve dans les massifs calcaires de l’Apennin central, à 42°N et au centre de la péninsule italienne (fig. 1). Il s’agit d’un abri d’une amplitude de 12 m sur 4 m de profondeur, qui se prolonge par une grotte encore presque entièrement comblée de sédiment, dont la voûte est plus basse (fig. 2). Les fouilles ont mis au jour une séquence
* Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università di Roma La Sapienza, Italia – [email protected]
Symposium Signes, symboles, mythes et idéologie…
CD-1784
stratigraphique qui commence lors du Maximum Glaciaire, avec des dépôts fluvio-lacustres, et se poursuit avec des niveaux archéologiques dont les dates s’étagent entre 23 000 et 14 000 cal BP (Mussi et al. 2000, 2004, 2008 ; Mussi, données inédites). L’industrie lithique est celle de l’Épigravettien ancien à pièces à cran dans la partie inférieure de la séquence (Unità III), puis de l’Épigravettien final dans la partie supérieure de cette dernière (Unità IV). Ce changement dans la technologie et typologie, qui correspond à une interruption dans les sédimentation, suivie d’une phase d’érosion, n’est pas encore directement daté, mais il a probablement eu lieu vers 16 000-15 500 cal BP. Le Dryas récent est représenté par un niveau remanié et pauvre en matériel archéologique ; on trouve ensuite une escargotière à industrie sauveterrienne, avec des dates entre 10 500 et 9 000 cal BP, et enfin quelques traces remaniées de Néolithique. Dans le talus, les niveaux en cours de fouille ont livré de l’industrie de l’Épigravettien ancien à crans, avec des dates 14C jusqu’à 20 000 cal BP.
Fig. 1. Localisation de Grotta di Pozzo, au centre de la péninsule italienne.
Les calcaires microgranulaires du Jurassique dans lesquels s’ouvre la grotte s’intercalent avec des strates dolomitiques sub-horizontales et sont plus ou moins résistants à l’érosion. L’abri, qui a une forme en hémicycle régulier, se termine par une petite paroi verticale, de moins d’un mètre de hauteur, qui correspond justement à un de ces niveaux plus compacts (fig. 2).
MUSSI M., Grotta di Pozzo (AQ, Italie centrale), une grotte ornée « au féminin »
CD-1785
Fig. 2. Grotta di Pozzo : vue d’ensemble. Les éléments d’art pariétal ont été découverts sur la paroi verticale du fond, au-dessous de laquelle on entrevoit le début de la voûte de l’arrière-grotte, comblée de sédiments.
(Élaboration graphique Filiberto Scarpelli.) (Cliché Carlos de la Fuente.)
En dessous commence la voûte de l’arrière-grotte encore comblée. C’est sur cette surface verticale que se trouvent les éléments sculptés décrits ci-dessous, à une distance régulière de 2-3 m l’un de l’autre et à hauteur constante, donnant l’impression d’une organisation voulue. De gauche à droite en regardant l’ouverture de la grotte : 1) incision horizontale (fig. 3), longue 47 mm, large et profonde de 5 mm. Elle se
trouve juste à côté d’une partie mal conservée de la paroi, où devaient se trouver des éléments complémentaires, aujourd’hui perdus ;
2) vulve verticale n° 1, en bas-relief (fig. 4), haute de 90 mm, dont le relief varie de 15 à 35 mm. Elle est symétrique, en triangle allongé autour d’un trou central, d’origine naturelle, qui se trouve dans le registre supérieur. La surface est polie, mais des trace de façonnage sont visibles sur la paroi tout autour ;
Fig. 3 (ci-dessus). Grotta di Pozzo : incision horizontale. (Cliché Carlos de la Fuente.)
Fig. 4 (ci-contre). Grotta di Pozzo : vulve verticale n° 1, en bas-relief.
(Cliché Carlos de la Fuente.)
Symposium Signes, symboles, mythes et idéologie…
CD-1786
3) vulve verticale n° 2 (fig. 5), haute de 50 mm, large jusqu’à 20 mm, obtenue à partir d’une fissure naturelle, sur une partie de la paroi rocheuse qui crée relief. La surface est polie, mais on voit encore les profonds sillons parallèles effectuées latéralement pour en accentuer le relief ;
4) silhouette féminine de type Gönnersdorf-Lalinde (fig. 6), de 75 mm de hauteur, façonnée sur une arête verticale de la paroi modifiée par percussion et abrasion. La partie antérieure de la silhouette est partiellement délimitée par un sillon vertical, large et peu profond.
Fig. 5. Grotta di Pozzo : vulve verticale n° 2. (Cliché Carlos de la Fuente.)
Fig. 6. Grotta di Pozzo : silhouette féminine de type Gönnersdorf-Lalinde.) (Cliché Carlos de la Fuente.)
Le premier élément décrit évoque un peu un anneau, tels qu’ils sont connus, notamment, au Roc-aux-Sorciers (Iakovleva & Pinçon 1997), mais il a été obtenu par une technique différente, car il s’agit d’un profond et bref sillon parfaitement horizontal. Il n’est que partiellement conservé et le manque de comparaisons ponctuelles ne permet pas d’arriver à une conclusion à cet égard. Les vulves verticales 1 et 2 peuvent être comparées à des représentations du même genre connues à Gouy et Bédeilhac (Clottes 2008 ; Martin 2007). En Italie, certaines gravures à l’entrée de Grotta Romanelli peuvent être évoquées, celles que G.-A. Blanc (1930) se limite à décrire comme “ovoïdes”, “fusiformes” ou éventuellement “pisciformes”. Le triangle pubien, gravé sur une paroi de Grotta del Caviglione aux Balzi Rossi, peut également être mentionné ici (Vicino & Mussi 2010 et ce CD). Mais aucune représentation paléolithique en relief n’est connue à ce jour dans la péninsule ou en Sicile. Quant au profil de type Gönnersdorf-Lalinde, c’est un thème documenté dans toute l’Europe centre-occidentale ; il est présent également en Italie sur un panneau à l’intérieur de Grotta Romanelli (Bosinski 1991 ; Bosinski et al. 2001 ; Delporte 1993 ; Mussi & De Marco 2008).
MUSSI M., Grotta di Pozzo (AQ, Italie centrale), une grotte ornée « au féminin »
CD-1787
L’âge de ces éléments peut être précisé. Aucune comparaison ne peut être établie avec des manifestations symboliques du Mésolithique, du Néolithique ou de périodes suivantes, ce qui porte à exclure l’Holocène ancien et récent. Les rappels thématiques aux sites du Magdalénien français, et l’âge des figures de type Gönnersdorf-Lalinde du Magdalénien supérieur et de l’Azilien, datées entre 15 500 et 13 000 cal BP (Bosinski 2009, com. pers.), suggèrent que ces manifestations d’art pariétal appartiennent à la fin du Tardiglaciaire. Le Dryas récent, mal documenté, pourrait correspondre à une phase d’abandon à Grotta di Pozzo. Par contre, les éléments repérés se trouvent à hauteur d’homme par rapport aux niveaux à industrie de l’Épigravettien final (Unità IV) datés entre 16 000 et 14 000 cal BP. Leur position est plus élevée, et serait plus difficile à atteindre, s’ils étaient en rapport avec les niveaux à industrie de l’Épigravettien ancien (Unità III). Une attribution à l’activité humaine dont témoignent les niveaux supérieurs (Unità IV) est donc à retenir, et les dates obtenues pour ces derniers correspondent, de plus, à celles des figures de style Gönnersdorf-Lalinde ailleurs en Europe.
Enfin, la disposition à hauteur constante et la cohérence thématique m’incitent à croire que l’ensemble de ces quatre éléments puisse appartenir à une phase de réalisation unique, ou pour le moins à des moments rapprochés dans le temps.
À la recherche d’une interprétation Des fouilles en extension dans la grotte permettent une bonne compréhension des
activités et de l’utilisation de l’espace lors de la formation des niveaux datés de 16 000 à 14 000 cal BP.
Industrie lithique nb % Outils retouchés nb % Nucléus 16 0,41 Grattoirs 32 8,70 Éclats >20mm 154 3,93 Grattoirs-perçoirs 1 0,27 Éclats ≤20mm 2196 56,09 Becs/Perçoirs 5 1,36 Lames 85 2,17 Burins 20 5,43 Lamelles 770 19,67 Troncatures 23 6,25 Lames à crête 20 0,51 Coches/Denticulés 23 6,25 Ravivages 89 2,27 Éclats retouchés 55 14,95 Coups de burin 40 1,02 Lames/lamelles retouchées 49 13,32 Microburins 9 0,23 Racloirs 4 1,09 Fragments 168 4,29 Gravettes/microgravettes 34 9,24 Outils retouchés 368 9,40 Lamelles à dos 106 28,80 Dos tronqués 12 3,26 Couteaux à dos 2 0,54 Crans 1 0,27 Pièces écaillées 1 0,27
Total 3 915 100 Total 368 100
Tabl. 1. Grotta di Pozzo : Décompte de l’industrie lithique de l’Épigravettien final (Unità IV), fouilles 1993-2007.
L’industrie de l’Épigravettien final comporte approximativement 60 % de grattoirs,
burins, éclats retouchés et autre outillage de fond commun, et 40 % de microgra-vettes et autres armatures que l’on peut associer à l’activité cynégétique (tabl. 1), souvent endommagées. La subsistance est assurée par la capture de mammifères
Symposium Signes, symboles, mythes et idéologie…
CD-1788
de taille moyenne, chamois et cerf principalement, mais des espèces plus petites ont souvent été recherchées (Mussi et al. 2004, 2008) : marmottes, gros galliformes (Tetrao tetrix ou Tétras lyre), et surtout truites, rapportées en grande quantité. L’étude de ces dernières indique une sur-représentation des éléments du squelette crânien et une sous-représentation des vertèbres, qui pourtant se conservent généralement mieux. L’hypothèse a été émise que ces truites, de grandes dimensions, aient été capturées pendant le rassemblement qui précède la fraie, puis qu’à plusieurs occasions une partie des poissons, nettoyés et privés de la tête, ait été exportée du site.
Un certain nombre de structures sont connues, dans la partie interne de la grotte : une cuvette oblongue, peu profonde, de moins de 2 m de diamètre, au pied même de la paroi décorée, a été comblée de dépôts cendreux, pierres chauffées et autres matériaux pendant des phases répétées d’emploi, qui se terminent par une vidange de foyer remarquablement conservée (fig. 7). Des restes de branches carbonisées sont parfaitement visibles. Des activités de type domestique sont également suggérées par trois proches structures en creux, de 25-50 cm de diamètre, répétées sur deux différents niveaux (fig. 8). Elles ont des parois abruptes et un fond plat, et contiennent peu de matériel.
Fig. 7. Grotta di Pozzo : vidange de foyer au fond de la grotte, entre les deux vulves. (Cliché Mauro Benedetti.)
Fig. 8. Grotta di Pozzo : structure en creux au fond de la grotte, proche de la vulve n° 1.
MUSSI M., Grotta di Pozzo (AQ, Italie centrale), une grotte ornée « au féminin »
CD-1789
Enfin, Grotta di Pozzo n’est qu’une de plusieurs grottes du versant méridional du bassin du Fucino ayant livré de l’Épigravettien final, même si, à ce jour, c’est la seule où de l’art pariétal a été découvert. Dans les environs immédiats, on trouve Riparo di Venere, puis la toute proche Grotta di Ortucchio, suivie de Grotta La Punta, Grotta San Nicola, Grotta Maritza et enfin Grotta Continenza (Grifoni Cremonesi 2003 ; Radmilli 1977). Plusieurs ont également fourni des restes humains et des sépultures. L’unique encore en cours de fouilles, à part Grotta di Pozzo, est Grotta Continenza. Pour presque toutes les autres, il faut avoir recours à des publications trop anciennes pour donner les précisions requises. Avec les précautions qui s’imposent, on peut établir quelques comparaisons avec Grotta di Ortucchio, Maritza et Continenza, bien que pour les deux premières il soit difficile d’évaluer l’intensité de l’occupation en fonction des différents niveaux, et que la dernière ait des datations plus récentes, centrées sur le Dryas récent. Grotta di Pozzo se trouve à l’ouverture d’une petite vallée, alors que les autres s’ouvrent dans des falaises bordant le bassin même du Fucino. Elle est nettement plus petite que Grotta Continenza, mais probablement assez semblable, comme espace utilisable, à Grotta di Ortucchio et à Grotta Maritza. Ses 30 à 40 m2 couverts correspondent à l’espace requis par un groupe humain petit à moyen.
En d’autres termes, Grotta di Pozzo n’offre pas les caractéristiques d’un lieu d’agrégation, mais bien celles d’un endroit apte à des séjours plus ou moins prolongés, par un groupe humain limité, dont les membres (hommes, femmes, enfants) seraient occupés à un nombre variable d’activités, compatibles avec différentes classes d’âge.
Les traces laissées par des activités domestiques réitérées caractérisent principalement l’espace interne, à proximité des éléments d’art pariétal - ces derniers ayant une connotation féminine très explicite. Quelles sont donc les clefs d’interprétation possibles – érotisme/pornographie, croyances communes, fonction des grottes, utilisation symbolique de l’espace, autre chose encore ?
La première interprétation, soutenue principalement par Guthrie (2006), a joui d’un regain d’attention après la découverte de la statuette féminine aurignacienne de Hohle Fels (Mellars 2009). Une explication en quelque sorte naturaliste, étroitement liée à la sexualité, et en particulier aux pulsions masculines ayant la femme pour simple objet, ne paraît pas en accord avec le nombre et la répétitivité des activités domestiques en ces lieux. La chasse, que l’on peut vouloir considérer comme étroitement liée au monde des hommes, du moins en ce qui concerne les espèces de taille moyenne ou grande (Murdock & Provost 1973), n’est certainement pas l’aspect de la vie quotidienne qui émerge ici avec le plus d’évidence. Le soin des foyers, la cuisson de la nourriture et la préparation de réserves alimentaires ne peuvent être, il est vrai, attribuées a priori à une composante plutôt qu’à une autre du groupe humain ; toutefois, il est généralement reconnu que, parmi les chasseurs-cueilleurs et autres sociétés modernes, ceci ressort plutôt du domaine des femmes. Il est difficile de croire que, dans un abri aussi fréquenté au cours d’activités quotidiennes, des vulves aient été façonnées par des adolescents ou autres en proie à des fantaisies sexuelles. L’éventuelle valeur érotique de la silhouette féminine schématique serait encore plus difficile à appréhender.
La position au sein d’un habitat qui reçoit la lumière du jour, face à un porche amplement ouvert, ne plaide pas non plus en faveur d’un sanctuaire, tel qu’il a été défini par Leroi-Gourhan (1965), ou d’une interprétation qui fasse appel au paléo-chamanisme (Clottes & Lewis-Williams 1996). Les silhouettes et figurines de type
Symposium Signes, symboles, mythes et idéologie…
CD-1790
Gönnersdorf-Lalinde peuvent par contre être rapportées à un fonds commun de mythes et croyances religieuses, en accord avec leur vaste distribution géogra-phique, de l’Espagne cantabrique à la Pologne. Une telle amplitude et un tel nombre de manifestations, dans des milieux très différents les uns des autres, et en utilisant techniques, supports et matières premières diversifiées, ne peut être le fruit de convergences accidentelles. Ceci reflète plutôt des valeurs et des codes symboliques communs qui comportent, au niveau expressif qui nous est parvenu, une ou de multiple créatures de sexe féminin. Par ailleurs, ces images sont très souvent tout à fait schématiques. Elles n’ont été progressivement reconnues qu’après des découvertes, comme celles du site éponyme de Gönnersdorf, qui ont permis d’établir un vaste corpus de variantes, et donc d’identifier les représentations isolées et peu détaillées. À Grotta di Pozzo, c’est justement une de ces silhouettes réduites à l’essentiel qui côtoie des représentations sexuelles non seulement très explicites, mais aussi limitées à un seul détail anatomique, celui de la vulve. Donc, en admettant que les différents éléments soient en rapport réciproque, le rappel à des croyances ou mythes répandus chez tous, ou du moins chez de nombreux groupes humains de la fin du Tardiglaciaire, ne fait pas entièrement le tour d’une question : celle-ci fait aussi appel à des aspects très concrets du monde féminin.
Les deux vulves ont été obtenues en façonnant des accidents naturels de la paroi, ce qui est un aspect bien connu de l’art paléolithique, mais qui indique aussi que ce sont les lieux en eux-mêmes qui ont une valeur précise. La fonction de la grotte, ou de cette partie de la grotte, doit donc entrer en ligne de compte. Aucun élément connu à ce jour dans ce site, ou dans ceux qui lui sont proches, ne porte à croire qu’il s’agisse ici d’une localité dédiée à des activités très spécifiques, qui ne concerne-raient que les femmes, telles que les rites au moment de la puberté. Si nous rete-nons plutôt l’hypothèse d’un groupe humain au complet, la paroi ornée, à signature féminine évidente, peut alors correspondre à une division de l’espace quotidien selon le sexe des occupants, comme on la connaît dans de nombreuses sociétés pré-industrielles (Faegre 1979 ; Le Moine 2003) : le fond, à proximité des foyers et autres structures domestiques, serait alors qualifié comme relevant du monde de la femme. Une éventuelle autre caractérisation du reste de l’espace, celui plus proche de l’ouverture, si elle a jamais existé, n’a pas laissé de traces archéologiques.
Éléments pour une réflexion finale Grotta di Pozzo est une grotte peu profonde qui présente des œuvres d’art pariétal
à la lumière du jour, proches de traces variées d’activités domestiques et quotidiennes. L’accent est mis sur les représentations relevant du monde féminin, qui trouvent des comparaisons ponctuelles dans des sites de la fin du Tardiglaciaire hors d’Italie. Elles indiquent un fonds commun de croyances, et la circulation et l’échange d’informations basées sur un code symbolique bien compris au travers de l’Europe. Un deuxième aspect à prendre en compte est celui de cette caractérisation très précise de la paroi qui occupe le fond de l’habitat. La division symbolique de l’espace a été évoquées pour des sites paléolithiques tels que Kostenki I en ce qui concerne le Gravettien (Iakovleva 2009) et Caverna delle Arene Candide pour l’Épigravettien final (Mussi et al. 1989), tant en rapport avec la distribution des objets artistiques, que du fait de la disposition des sépultures. L’interprétation ici proposée pour Grotta di Pozzo est du même ordre, et considère que nous avons là des représentations symboliques en rapport avec l’organisation sociale des chasseurs-cueilleurs de la fin du Paléolithique, telle qu’elle se reflète dans l’organisation de l’espace d’habitat.
MUSSI M., Grotta di Pozzo (AQ, Italie centrale), une grotte ornée « au féminin »
CD-1791
RemerciementsLes recherches à Grotta di Pozzo sont financées par des fonds MIUR « Ricerca
Scientifica » en dotation à l’Università di Roma Sapienza, et par une collaboration avec le Department Archaeological, Geographical and Environmental Sciences de la University of Bradford, sur des fonds alloués par le Leverhulme Trust.
Je remercie Carlos de la Fuente pour les photos des figures 2 à 5, Mauro Benedetti pour la photo de la figure 7 et Filiberto Scarpelli pour l’élaboration graphique des figures. La commune de Gioia dei Marsi a aimablement mis à disposition des locaux lors des campagnes 2009 et 2010.
Bibliographie BLANC G.A. 1930. — Grotta Romanelli. II. Dati ecologici e paletnologici. Atti della I° Riunione dell'Istituto Italiano di
Paleontologia Umana: 365-518.
BOSINSKI G. 1991. — The representation of Female Figures in the Rhineland Magdalenian. Proceedings of the Prehistoric Society 57: 51-64.
BOSINSKI G., D’ERRICO F., SCHILLER P. 2001. — Die Gravierten Frauendarstellungen von Gönnersdorf. Stuttgart 2001.
BROGLIO A. 1992. — Le pietre dipinte dell'Epigravettiano recente del Riparo Villabruna-A (Dolomiti Venete). Atti della XXVIII° Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria: 223-237.
CLOTTES J. 2008. — L’art des cavernes préhistoriques. Paris : Phaidon.
CLOTTES J. & LEWIS-WILLIAMS D. 1996. — Les chamanes de la préhistoire : Transe et magie dans les grottes ornées. Paris : Éditions du Seuil. (Coll. « Arts rupestres »).
DELPORTE H. 1993. — L’image de la femme dans l’art paléolithique. Paris : Picard.
FAEGRE T. 1979. — Tents. Architecture of the Nomads. New York : Anchor Press/Doubleday.
GRAZIOSI P. 1956. — L'arte dell'antica età della pietra. Firenze : Sansoni.
GRAZIOSI P. 1973. — L'arte preistorica in Italia. Firenze : Sansoni.
GRIFONI CREMONESI R. 2003. — La Grotta Continenza di Trasacco: note sui livelli epigravettiani. In : Atti della XXXVI Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Preistoria e Protostoria dell’Abruzzo, Chieti - Celano, 27-30 settembre 2001, p. 81-89. Firenze : Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.
GUTHRIE R.D. 2006. The Nature of Paleolithic ArtArt . Chicago : University of Chicago Press.
IAKOVLEVA L. 2009. — De l’art mobilier au système socio-symbolique dans le Paléolithique supérieur ancien et moyen d’Europe Orientale. In : DJINDJIAN F. & OOSTERBEEK L. (eds.), Symbolic Spaces in Prehistoric Art Territories, travels and site locations, Proceedings of the XV World Congress UISPP (Lisbon, 4-9 September 2006), Session C28., vol. 40, p. 21-32. Oxford : Archaeopress. (BAR International Series ; 1999).
IAKOVLEVA L. & PINÇON G. 1997. — La frise sculptée du Roc-aux-Sorciers. Paris : Éditions Comité des Travaux historiques et scientifiques et de la Réunion des Musées Nationaux.
LE MOIGNE G. 2003. — Woman of the House: Gender, Architecture, and Ideology in Dorset Prehistory. Arctic Anthropology, 40, p. 121–138.
LEROI-GOURHAN A. 1965. — Préhistoire de l'art occidental. Paris : Éditions Mazenod.
MARTIN Y. 2007. — The Engravings of Gouy: France’s Northernmost Decorated Cave. In : PETTITT P., BAHN P., RIPOLL S. (eds.), Palaeolithic Cave Art at Creswell Crags in European Context, p. 140-193. Oxford : Oxford University Press.
MELLARS P. 2009. Origins of the female image. Nature, 459, p. 176-177.
MURDOCK G.P. & PROVOST C. 1973. — Factors in the division of labor by sex : a cross-cultural analysis. Ethnology, 12, p. 203.225
MUSSI M., BAHN P., MAGGI R. 2008. — Parietal art discovered at Arene Candide Cave (Liguria, Italy). Antiquity, 82, p. 265-270.
MUSSI M., COCCA E., D’ANGELO E., FIORE I., MELIS R.T., RUSS H. 2008. — Tempi e modi del ripopolamento dell’Appennino centrale nel Tardiglaciale: nuove evidenze da Grotta di Pozzo (AQ). In : MUSSI M. (ed.), Il Tardiglaciale in Italia – Lavori in corso, p. 111-132. Oxford : Archaeopress. (BAR International Series ; 1859).
Symposium Signes, symboles, mythes et idéologie…
CD-1792
MUSSI M., COUBRAY S., GIRAUDI C., MAZZELLA G., TONIUTTI P., WILKENS B., ZAMPETTI D. 2000. — L'exploitation des territoires de montagne dans les Abruzzes (Italie centrale) entre le Tardiglaciaire et l'Holocène ancien. In : CROTTI P. (ed.), Méso 97, Actes de la Table Ronde « Épipaléolithique et Mésolithique », Lausanne, 21-23 novembre 1997, p. 277-284. Lausanne. (Cahiers d'Archéologie Romande ; 81).
MUSSI M., D’ANGELO E., FIORE I. 2004. — Escargots et autres « petites » ressources alimentaires : le cas de la Grotta di Pozzo (Abruzzes, Italie centrale). In : BRUGAL J.-Ph. & DESSE J. (dir.), Petits animaux et sociétés humaines : Du complément alimentaire aux ressources utilitaires, XXIVe rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, 23-24-25 oct. 2003, p. 99-110. Antibes : Éditions APDCA.
MUSSI M. & DE MARCO A. 2008. — A Gönnersdorf–style engraving in the parietal art of Grotta Romanelli (Apulia, southern Italy). Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte, 17, p. 97-104.
MUSSI M., FRAYER D.W., MACCHIARELLI R. 1989. — Les vivants et les morts. Les sépultures du Paléolithique supérieur en Italie et leur interprétation. In : HERSHKOVITZ I. (ed.), People and Culture in Change, p. 435-458. Oxford : Archaeopress. (BAR International Series ; 508(I) ).
ORLANDO M.A. 2003. — Grotta Romanelli e il Museo civico di paleontologia e Paletnologia di Maglie. In : FABBRI P.F., INGRAVALLO E., MANGIA A. (eds.), Grotta Romanelli nel centenario della sua scoperta (1900-2000), Atti del Convegno Castro, 6-7 ottobre 2000, p. 17-25. Galatina : Congedo Editore.
RADMILLI A.M. 1977. — Storia dell'Abruzzo dalle origini all'età del Bronzo. Pisa : Giardini Editori.
STASI P.E. & REGALIA E. 1905. — Grotta Romanelli (Castro, Terra d’Otranto). Seconda nota. Due risposte a una critica. Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia, 2, p. 113-172
VICINO G. & MUSSI M. 2010. — Grotticella Blanc-Cardini aux Balzi Rossi (Vintimille, Italie). In : L’art pléistocène dans le monde, Congrès de l’Ifrao, sept. 2010. Symposium « Art pléistocène en Europe ». (Pré-Actes).
ZAMPETTI D. 1987. — L'arte zoomorfa del Paleolitico superiore in Italia. Scienze dell'Antichità, 1, p. 9-35.
Citer cet article MUSSI M. 2012. — Grotta di Pozzo (AQ, Italie centrale), une grotte ornée « au féminin ». In : CLOTTES J. (dir.), L’art
pléistocène dans le monde / Pleistocene art of the world / Arte pleistoceno en el mundo, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010, Symposium « Signes, symboles, mythes et idéologie… ». N° spécial de Préhistoire, Art et Sociétés, Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, LXV-LXVI, 2010-2011, CD : p. 1783-1792.