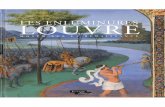Sur la datation des monuments funéraires de Haute Macédoine : Critères et difficultés
Maitre de Pembroke, E. (2013). « Identifier et analyser le rôle des émotions dans les...
Transcript of Maitre de Pembroke, E. (2013). « Identifier et analyser le rôle des émotions dans les...
Pour citer cet article : Maitre de Pembroke, E. (2013). Activités de production orale et
émotions : gérer la complexité dans l’instant de l’échange. Langage et émotions. Revue de
Linguistique et Didactique des Langues, n°48.
Emmanuelle Maitre de Pembroke – [email protected]
Laboratoire REV – CIRCEFT (EA 4384) Université Paris Est Créteil.
L’acte de production orale mobilise une multiplicité de procédures dans un système
complexe. Les travaux récents de la psychologie cognitive soulignent l’importance des
émotions dans la mise en œuvre des procédures cognitivo-langagières. Des recherches
soulignent le rôle prégnant de la prosodie dans la réception du contenu émotionnel du
message. Les approches anthropologiques abordent l’incorporation du ressenti lié aux
émotions selon les cultures d’appartenance et le rôle de l’identité dans la mise en œuvre des
capacités langagières. Enfin, la linguistique pragmatique souligne la difficulté de la co-
construction du sens dans l’instant de l’échange. Les travaux présentés sont des études de cas
à partir d’entretiens visant à identifier avec les apprenants où se trouvaient leurs difficultés de
prise de parole. Ces entretiens ont été menés auprès de deux catégories de personnes : des
adultes en situation d’expatriation et des élèves locuteurs d’une autre langue première que le
français, fréquentant des établissements scolaires français. La place des émotions est forte, les
difficultés se situent à différents niveaux dans la perception et dans la production.
The oral production mobilizes a multiplicity of procedures in a complex system. The recent
works of the cognitive psychology underline the importance of the emotions in the
implementation of the cognitivo-linguistic procedures. Researches underline the important
role of the prosody in the reception of the emotional contents of the message. The
anthropological approaches show the incorporation of felt connected to the emotions
according to the cultures and the role of the identity in the implementation of the linguistic
capacities. Finally, the pragmatic linguistics underlines the difficulty of the co-construction of
the meaning in the moment of the exchange. The presented works are case studies from
interviews to identify with the learners where were their difficulties. They were led with two
categories of persons : adults in situation of expatriation and pupils speakers of another first
language than French frequenting French schools. The role of the emotions is strong and the
difficulties are situated at different levels of the perception and the production.
La prise de parole en classe et l’entrée dans les échanges posent des difficultés à bon nombre
d’apprenants. Vue la complexité de l’acte de production orale, le repérage de la nature des
difficultés est difficile. Il est cependant nécessaire pour la mise en place d’aides appropriées.
Or, la prise en compte du rôle des émotions dans les travaux de recherche est récente. Ceux-
ci mettent l’accent sur l’importance des émotions à tous les niveaux de l’élaboration de la
parole. Afin d’éclairer cette question, le croisement de plusieurs cadres épistémologiques
semble requis. D’une part, celui de la psychologie cognitive permet d’analyser la complexité
des procédures de production orale. Les travaux récents montrent l’impact des émotions, tant
sur les processus de compréhension/production que sur la mémoire requise pour gérer cette
complexité. Cette approche définit aussi l’émotion comme une évaluation de l’environnement
passant par le ressenti corporel qui prépare le corps à réagir de façon adaptative (Audibert &
al. 2005). Le processus qui permet d’évaluer le caractère plaisant ou déplaisant d’une
perception est inconscient, direct, non réflexif. Il est influencé par des facteurs culturels,
sociaux et contextuels. Enfin, ces travaux soulignent l’impact fort de l’émotion sur la
production orale. Les travaux anthropologiques soulignent justement l’importance des
cultures d’appartenance, des systèmes de valeurs et de croyances dans la mise en œuvre des
capacités langagières. Dans ce cadre, l’ajustement émotionnel avec autrui est relatif aux
représentations de la relation. Ici, est mise en jeu l’image de soi et prendre la parole est un
risque fort. Enfin, la linguistique pragmatique permet d’aborder la production orale dans sa
dimension communicative et interactive.
Les travaux présentés sont des études de cas à partir d’entretiens visant à identifier avec les
apprenants où se trouvaient leurs difficultés de prise de parole. Ces entretiens ont été menés
auprès de deux catégories de personnes : des adultes en situation d’expatriation et des élèves
locuteurs d’une autre langue première que le français fréquentant des établissements scolaires
français. Dans les deux cas, l’apprentissage du français est un enjeu fort pour leur intégration.
Certaines difficultés relèvent de la charge due à la gestion des émotions simultanément au
traitement cognitif de la parole. Beaucoup d’entretiens soulignent la difficulté à comprendre la
courbe mélodique, source d’émotions spontanées fortes et donc de conflits. Enfin, d’autres
relèvent davantage de difficultés d’interprétation liées aux positionnements et aux valeurs
attribuées à la relation et au contexte de l’échange.
L’oral : une complexité de procédures à gérer
Les travaux de psycholinguistique recensent la diversité des processus cognitifs mobilisés lors
d’échanges oraux. Ils montrent à quel point la charge attentionnelle est élevée du fait de la
multiplicité des procédures menées simultanément. Deux modèles permettent de décrire
l’activité relative à la compréhension (Gremmo, Holec, 1990). Le premier, de type ascendant,
va de la perception de la chaine phonique à la construction du sens. Selon ce modèle, le
locuteur doit dans le même temps percevoir et isoler des unités phoniques, les associer aux
contenus de sa mémoire sémantique (sens de chaque mot). Parallèlement, dans le flux du
discours, il doit retenir l’essentiel de l’information comprise et construire la cohérence locale
puis globale de l’ensemble du propos (Kintsch, 1998). Cela lui permet d’élaborer un « modèle
de situation » qui rassemble les informations du discours et ses connaissances. Le second
modèle de type descendant décrit l’activité du compreneur à partir des connaissances qu’il
mobilise dans sa mémoire pour construire le sens. Ces connaissances relèvent de nombreux
niveaux (Gremmo et Holec, 1990) : sociolinguistiques sur la situation de communication,
socio-psychologiques sur le producteur du message et les circonstances de l’échange,
discursives sur le type de discours concerné, linguistiques sur le code utilisé, référentielles sur
la thématique invoquée, culturelles sur la communauté à laquelle appartient le producteur du
message. A partir de ces connaissances, des hypothèses de sens sont élaborées et doivent être
constamment vérifiées par des prises d’indices portant sur chacun des niveaux. Les travaux
actuels parlent dorénavant de modèle interactif (Fayol, 1997). Ainsi, le compreneur mobilise
tout à la fois des procédures de bas et de haut niveau. Il privilégie l’une ou l’autre selon son
profil cognitif, son degré d’expertise du sujet et de connaissance du contexte.
Dans une interaction, répondre est quasiment concomitant à la compréhension. Pour cela, le
locuteur doit sélectionner le vocabulaire approprié, le positionner de façon correcte dans une
syntaxe, tout en créant les variations nécessaires (conjugaisons, liaisons…) et produire la
forme compréhensible en articulant les phonèmes adéquats, tout en étant attentif à la courbe
mélodique (Levelt, 1989). Selon cet auteur, une boucle de production permet au locuteur
d’entendre son propre discours et de le réguler en temps réel pour l’ajuster au contenu de sa
pensée. Il est clair que la prise d’indices ne s’arrête pas là. Des connaissances pragmatiques
portant sur la relation et des saisies d’informations sur la communication non verbale sont
mobilisées dans le même temps (Mondillon & Tcherkassof, 2009).
Les travaux récents insistent sur la complexité et la simultanéité. Ils révèlent une activité
conjointe des aires cérébrales de compréhension et de production (Mesulam, 1985). D’autre
part, comprendre et produire seraient des activités qui ne relèveraient pas seulement de ces
deux zones. En particulier, l’information serait transmise au système émotionnel en
interaction avec l’ensemble des procédures. Ces apports de la psycholinguistique démontrent
la charge attentionnelle de l’acte de production orale (Gaonac’h 1987). Mais surtout, ils
soulignent le rôle prédominant des émotions dans les activités langagières. Selon Damasio
(2010), émotions et cognition sont fortement liées. D’autre part, les émotions sont perçues
dans l’échange à travers le ressenti corporel, lequel est interprété de manière si rapide qu’il
échappe au contrôle. Enfin, Audibert (2005) relève que la prosodie joue un essentiel dans la
perception du message et dans l’activation des émotions.
Approche anthropologique de l’échange
Les approches anthropologiques apportent un éclairage sur les échanges langagiers. Tout
d’abord parce que l’anthropologie se penche sur les activités quotidiennes. Celles-ci sont
tellement intégrées qu’elles ne sont plus conscientes et font partie du savoir-faire relationnel.
Ce n’est que lors d’échecs de la relation que la personne prend conscience de manières de
communiquer différentes des siennes. Levi-Strauss (1958) a souligné la nécessité de
rencontrer d’autres systèmes sémiologiques pour prendre conscience du sens de ses
comportements acquis dans ses milieux d’appartenance. Il souligne aussi le lien entre les
comportements (signifiants) et les représentations et valeurs. L’ethnométhodologie vise à
transformer le regard de façon à percevoir les éléments qui nous semblent en apparence les
plus anodins : les gestes, les expressions corporelles, les tonalités, les silences (Laplantine,
2005 ; de Luze, 1997). Or, ces éléments minimes sont des vecteurs importants de l’identité
culturelle. De plus, la démarche compréhensive vise à suspendre son jugement immédiat dans
l’accueil de la manière de communiquer de l’autre, qu’elle soit surprenante, inattendue,
contraire à nos grilles de lecture.
Un autre apport de l’anthropologie est de prendre en compte les dimensions corporelles. Le
terme d’« incorporation » souligne comment l’individu intègre socialement ses perceptions
(Laplantine, 2005). De nombreux anthropologues ont décrit la manière dont les sujets
assimilent dans leur corps ce rapport à l’environnement. Wulf (2003) nomme cette
compétence de l’enfant sous le terme de « mimesis » : intégration dans le ressenti des modèles
comportementaux et systèmes de significations. L’incompréhension entre deux interlocuteurs
de ces menus détails déclenche des réactions émotionnelles fortes. Ces éléments sont souvent
des vecteurs de ce qu’une communauté considère être la politesse (Picard, 1998). Selon le
cadre de l’échange, il existe une manière de dire, laquelle est tellement incorporée qu’elle
n’est guère explicitée. L’incompréhension de ces éléments qui relèvent essentiellement de la
gestuelle, du paraverbal et de la prosodie (de Salins, 1992) touche les acteurs de l’échange
dans leur fondement et provoque des blessures identitaires. Les travaux insistent sur la place
du rituel dans le cadre des échanges langagiers. Ceux-ci soulignent la sacralité de la personne
dont parle Durkeim (1973). S’engager dans l’échange et prendre la parole est un risque
important pour celui qui parle car elle le dévoile dans des aspects profonds de son identité.
Les rituels évitent les blessures identitaires et relationnelles en préservant la « face » de la
personne (Goffman, 1967). La difficulté réside dans le fait que les rituels diffèrent dès lors
qu’on change de groupe. Les personnes qui entrent dans un nouveau cadre ne les connaissent
pas et se trouvent en difficulté.
Une co-construction du sens dans l’instant
Formuler un discours correct du point de vue linguistique n’est pas la seule finalité du
locuteur. Bien d’autres aspects d’ordre contextuel et relationnel entrent en jeu. De nombreux
indices permettant de produire un discours approprié et pertinent sont liés au contexte de
l’échange qu’il faut savoir analyser (cadre de l’échange, identification des composantes de
l’interaction, positionnement et lecture des indices identitaires, prise en compte de données
culturelles). Hymes (1972) parle de contexte interlocutif dans lequel le sens s’ajuste en
fonction de l’autre. Dans un cadre communicatif qui lui est familier, la personne sait analyser
les positions, rôles, relations des personnes impliquées. Elle sait aussi prendre en compte les
paramètres de la situation d’énonciation (lieu, moment).
Selon les pragmaticiens du langage, parler revient avant tout à accomplir un acte social à
destination d’autrui. Tout échange conversationnel présuppose l’adhésion au principe de
coopération (Grice, 1979) et exerce une action sur autrui (Searle, 1972). A la fonction
propositionnelle (le contenu des mots), s’ajoutent une fonction illocutoire qui instaure un lien
entre deux personnes et une fonction perlocutoire qui représente l’effet des mots sur
l’interlocuteur (Austin, 1962).
Selon Kerbrat Orecchioni (1990 ; 2008) les partenaires de l’échange exercent les uns sur les
autres un réseau d’influences mutuelles. Brassac (2001) parle de logique interlocutoire selon
laquelle le sens ne préexiste pas à l’interaction. Il est construit dans une dynamique dont
chacun des locuteurs est responsable. Dans cette construction conjointe du sens, Vernant
(1997) souligne que chaque interlocuteur se construit une image de soi et une image de l'autre
de manière à pouvoir interpréter correctement ses énoncés. Celles-ci sont réévaluées au
moment de l’échange. L’ensemble de ces travaux insistent sur le fait que chaque échange est
impliquant émotionnellement car il met en jeu l’identité (Trognon&Brassac, 1992).
Résultats
Cet article présente des études de cas à partir d’entretiens semi-directifs visant à identifier
avec les apprenants où se trouvaient leurs difficultés de prise de parole et quelle était alors la
place du ressenti émotionnel. Ces entretiens ont été menés auprès de deux catégories de
personnes :
1. Vingt-quatre adultes en situation d’expatriation, confrontés à l’apprentissage du FLE
en immersion dans un contexte culturel différent du leur. Cette situation nécessite
l’apprentissage du français comme outil de communication mais est source de
nombreuses émotions qui favorisent ou freinent les acquisitions.
2. Un prolongement auprès de douze élèves en difficultés scolaires, locuteurs d’une autre
langue première que le français.
Ne souhaitant pas catégoriser les personnes selon leur culture nationale, c’est le
concept d’identité mosaïque que nous retenons (Porcher,1998) : chaque individu est
composé de multiples subcultures et ici ce sont les modalités de changements de
groupe et de positionnements qui nous intéressent.
L’analyse de ce corpus permet de distinguer différents niveaux de difficultés.
Certaines relèvent de la charge due à la gestion des émotions simultanément au
traitement cognitif de la parole. D’autres relèvent de difficultés à interpréter
correctement le contenu émotionnel véhiculé par des dimensions non verbales telles
que la forme prosodique. Enfin, le positionnement permettant d’adopter les formes
d’expression correctes envers autrui est très difficile pour des natifs d’une autre
langue. Ces obstacles mettent en jeu l’identité de la personne et provoquent des
réactions fortes. Des difficultés particulières ont été relevées dans des actes de langage
tels que le remerciement, la négation et l’argumentation.
Difficultés dues à la charge attentionnelle
De l’ensemble des entretiens ressort la difficulté à traiter de façon simultanée la construction
du sens des propos et la correction linguistique. Selon les individus, l’attention est portée sur
un des niveaux : phonétique, lexical, syntaxique, pragmatique. Par exemple, de nombreux
ressortissants de langue japonaise ou chinoise expriment la difficulté de se concentrer sur les
aspects articulatoires et de conserver le contenu de sens, ainsi que le fil de leur pensée
(cohérence globale). Pour beaucoup des personnes interrogées, la recherche du mot correct en
mémoire lexicale provoque la perte des autres niveaux. La charge cognitive requise pour la
prise de parole est si forte que des émotions émergent dans le même temps : découragement,
perte de confiance. De façon récurrente apparait le terme de « perte d’identité », dans la
mesure où la pensée ne trouve plus le mode d’expression auquel elle est habituée dans sa
langue d’origine. Chez les adultes, surgit aussi le sentiment de régression dans la mesure où le
bagage lexical de la langue étrangère en cours d’apprentissage correspond à celui d’un enfant.
Un sentiment de perte d’estime et de capacité d’expression de son identité sociale provoque
frustration et colère.
Deux dimensions du temps opèrent ici. Tout d’abord, celle de simultanéité des procédures
cognitives. Les personnes se sentent rassurées lorsque la simultanéité et la complexité des
procédures sont expliquées. Il semble bon de pouvoir centrer son attention tantôt sur un
niveau, tantôt sur un autre dans des activités d’entrainement. D’autre part, en langue
étrangère, la charge attentionnelle est si forte que les personnes ont besoin de plus de temps
pour prendre la parole. Les enseignants qui gèrent les tours de parole en tenant compte de ce
besoin de temps et en acceptant les silences sont rassurants. Selon le point de vue des
personnes, les échanges verbaux français sont très rapides et fonctionnent sur un mode
polyphonique : plusieurs locuteurs en même temps (de Pembroke, 1998). Revenir à un mode
monophonique (chacun son tour) et laisser un temps de concentration au locuteur semble un
facteur rassurant pour les personnes. Les enfants fréquentant l’école française soulignent que
ce temps n’est pas donné en classe car les temps de silence ne sont pas acceptés et
l’enseignant passe très vite à un autre enfant si la parole ne vient pas. Des stratégies
différentes apparaissent dans la gestion des frustrations lesquelles relèvent de différences
culturelles. Les ressortissants de cultures latines sont à l’aise avec la gestion polyphonique et
la rapidité des échanges car elles se lancent dans la parole même si leur niveau de correction
linguistique n’est pas parfait. Les cultures asiatiques, marquées par la lenteur et la
monophonie, s’arrangent de la difficulté à entrer dans les échanges car ces personnes ne
souffrent pas de rester dans le silence. Elles expliquent leur capacité à gérer la frustration par
le fait qu’elles sont d’une culture de la patience et du silence. Pour elles, leur responsabilité
est d’écouter et de se concentrer pour assimiler intérieurement.
Difficultés liées à la courbe mélodique
En conformité avec les travaux de Banziger (2001), les éléments prosodiques sont ressortis très
clairement dans les difficultés à interpréter le contenu émotionnel d’un message en français. Cela
provoque en retour des réactions émotionnelles fortes que les personnes apprennent à gérer au fur et
à mesure que leur temps de séjour en France s’allonge. Les personnes remarquent une courbe
mélodique particulièrement accentuée lors des actes de politesse : salutations, remerciements. La
voix prend alors une tonalité chantante et la hauteur change pour se situer dans des tons plus élevés.
Les femmes adoptent volontiers ces courbes mélodiques qu’elles assimilent à de la bienveillance.
En revanche, beaucoup d’hommes avouent adopter difficilement ces tonalités qu’ils jugent
d’emblée trop féminines. Acquérir ces modulations de voix entre en contradiction avec l’image de
leur identité.
Mais la plus grosse difficulté réside dans l’interprétation exacte des intentions de
communication portées par la courbe mélodique. De nombreux malentendus et conflits ont été
évoqués. Eclats de voix, intonations soudainement accentuées : les témoignages évoquent
l’émotion forte ressentie face à une courbe mélodique qu’ils ne comprenaient pas. « J’ai eu
l’impression que mon patron était en colère et j’ai paniqué. J’ai compris après qu’il était juste
enthousiaste. » « Pour les japonais, le ton de voix des Français est perçu comme agressif et
surtout trop émotionnel. Cela provoque chez nous un certain mépris pour l’orateur qui ne sait
contrôler ses émotions et s’exprimer posément. Surtout, nous avons la sensation d’être
agressés.». Même si le contenu du message n’est pas entièrement décrypté, l’intention de
communication est immédiatement traitée selon une grille de lecture relevant de la culture
d’origine. Les personnes évoquent d’une part une difficulté à prendre conscience de ces
paramètres non explicités (Banziger et Scherer, 2005). D’autre part, même si la personne
conçoit ces décalages d’interprétation, il est difficile de se distancier du contenu émotionnel.
L’interprétation semble être de l’ordre de l’immédiateté et les émotions surgissent dans le
même temps : peur, fuite, colère. La récurrence de ces remarques souligne l’importance de la
prosodie et de la courbe mélodique dans l’impact émotionnel. Deux aspects semblent
fondamentaux à travailler en formation. D’une part, apprendre à se distancier de ces impacts,
en analysant les variations phonétiques d’ordre culturel, est nécessaire. En cours de langue,
les activités sur ces variables mélodiques sont fondamentales comme le souligne Guimbretière
(2001). D’autre part, seule la personne destinataire est en mesure de dire si la courbe
mélodique est agressive en fonction de ses grilles de lecture propres. En d’autres termes,
certains entendent de l’agressivité là où d’autres ne la perçoivent pas. Il est essentiel de
favoriser les échanges d’interprétation afin que :
les interlocuteurs prennent conscience de ce qu’ils reçoivent de l’autre et de ce qu’ils
adressent à autrui ;
qu’ils se distancient de leur grille spontanée pour conserver leur capacité d’écouter ;
qu’ils sachent reporter leur jugement spontané ;
qu’ils puissent s’appuyer sur d’autres prises d’indices (non verbaux, par exemple) ;
qu’ils apprennent à moduler leur discours en fonction d’autrui.
Difficultés aux positionnements
Dans le cadre des échanges oraux, les marqueurs de positionnement jouent fortement sur le
ressenti émotionnel. La conviction d’avoir ou non droit à la parole va marquer l’implication
émotionnelle. Les marqueurs sociologiques sont pertinents pour analyser les positionnements
des interlocuteurs : âge, sexe, statut. Ainsi, dans certaines cultures, les femmes ne peuvent
prendre la parole à la suite d’un homme. Même au sein d’une classe, certaines filles ne
peuvent entrer dans l’échange en présence des garçons. Autre difficulté : un enfant ne peut
interagir librement avec un adulte. L’asymétrie de l’âge est renforcée par le statut du
professeur. « Une fois, j’ai levé la main et la maitresse ne m’a pas interrogée. Je ne lève plus
la main car je crois que je n’ai pas le droit ». Dans certaines cultures, le maitre est dans une
position si haute que l’échange verbal est difficile ou est réglé selon des règles
conventionnelles fortes. « Pour moi, le professeur est tout en haut et je suis tout en bas. Ce
n’est pas correct de prendre la parole. » De nombreux témoignages évoquent ces difficultés de
prise de parole. Ce qui est notable, c’est que ces croyances font surgir des émotions fortes
lorsqu’il faut se lancer dans l’échange en classe : perte de repères, stress, tremblements,
accélération de la respiration. D’autre part, plus les modalités de prise de parole diffèrent des
représentations que l’on se fait, plus les émotions sont difficiles à gérer dans le même temps
que la parole. En d’autres termes, gérer l’émotion interfère avec la gestion de la complexité
des procédures cognitives. D’où ce qui est souvent évoqué : le blanc total, la perte du contenu.
Pour certaines personnes, l’anticipation de ces émotions les amène d’emblée à renoncer à
toute intervention.
Ces marqueurs de positionnement identitaire sont corrélés avec des valeurs différentes
attribuées à la parole et au silence. Dans les cultures où le silence est fortement valorisé, faire
le choix de se taire en classe est cohérent avec le système de valeurs selon lequel le silence est
une vertu. En revanche, pour d’autres personnes, ne pas réussir à identifier les marqueurs et
donc ne pas pouvoir se positionner correctement pour prendre la parole est très frustrant. Des
différences fortes marquent aussi la valeur accordée au langage par rapport à l’action.
Agacement, impatience, désintérêt accompagnent les temps d’échange trop longs pour les
personnes qui se disent d’une culture de l’action (souvent évoquée par les anglosaxons). Dans
certaines cultures, l’expression orale est conçue comme une action importante de lien avec
autrui et la fonction phatique telle que la définit Jakobson (établissement de la relation) joue
un rôle prédominant. Pour d’autres, parler est une perte de temps par rapport à l’agir. Enfin,
dernière difficulté émotionnelle évoquée : celle d’être confronté à l’impossibilité de trouver
les mots véhiculant l’émotion que l’on veut témoigner. Exprimer sa gratitude, son désaccord,
ses condoléances : autant de situations dans lesquelles les personnes ont souffert de ne pas
connaitre les codes langagiers permettant de communiquer leurs états internes. Ces difficultés
sont liées à l’insuffisance des niveaux lexical et pragmatique. Mais elles entrent directement
en jeu dans les positionnements face à autrui. Plus grave, le sentiment de perte de cohérence
entre le ressenti profond que l’on souhaite exprimer et ce qu’on exprime réellement à l’autre.
Cette faille entre pensée intime et langage provoque chagrin, déception et/ou sentiment de
solitude.
Difficultés liées à certains actes de parole
Dans l’ensemble des entretiens, certains actes de parole ont été relevés comme fortement
marqués par l’émotion. Remercier, par exemple, ne consiste pas seulement à énoncer une
formule toute faite. En effet, dans certaines langues, le remerciement est conçu comme
condescendant. Choc émotionnel fort pour les personnes qui, en référence à leur système,
n’usent pas de ce procédé et se voient qualifiées d’impolies. Difficultés également pour
trouver le bon vecteur de sa gratitude lorsque sa culture ne la manifeste que par du langage
gestuel. Plus impliquant encore est le fait de nier. Dans certains systèmes linguistiques, des
procédés permettent d’éviter l’expression verbale de cette négation : soit par des phrases
détournées, soit par un ton de voix très bas (un oui très peu prononcé) soit par une gestuelle
fine (une expression de visage). Les moments de classe où la personne doit nier ou contredire
sont relevés comme éprouvants. Argumenter fait donc partie d’un registre très difficile dans la
mesure où il faut non seulement contredire mais aussi exprimer son opinion. Dans les cultures
où une des valeurs essentielles est celle d’harmonie, les oppositions d’opinion sont vécues
comme des ruptures à la relation. Dans ces contextes, écouter chacun et trouver un consensus
commun avant même l’échange en grand groupe est une manière de gérer les relations qui
vise à préserver l’harmonie du groupe.
Conclusion
Ces travaux soulignent l’importance de la prise en compte des émotions dans les activités
orales. Aider à les expliciter, apprendre à s’en distancier, donner des outils de gestion du
stress et de mobilisation de ressources semblent aussi importants et complémentaires que de
donner des outils linguistiques. Ces recherches s’inscrivent dans le paradigme de la
complexité dans la mesure où sont impliqués tout à la fois la gestion de procédures multiples
simultanées, mais aussi le ressenti profond, l’expression de soi, l’appartenance et l’identité.
Les difficultés soulevées sont valables pour toute entrée dans une communauté nouvelle où
les rituels de préservation de la face diffèrent des siens.
Prendre conscience de ces mécanismes fait partie de la compétence relationnelle et de
l’intelligence émotionnelle. Savoir gérer, exprimer ses émotions, écouter et percevoir les
celles d’autrui, suspendre le jugement immédiat pour accueillir de nouvelles formes : ces
compétences sont fondamentales dans un monde d’échanges et de changements. La prosodie
est si souvent source de conflits que connaitre ces mécanismes est essentiel dans la médiation.
Une formation particulière doit être apportée aux enseignants pour qui il est essentiel de
développer tout à la fois qualité d’écoute et stabilité sereine dans le ressenti. La suspension du
jugement et la qualité de présence dans le moment de l’échange inscrivent ces réflexions dans
le cadre du paradigme de l’émergence (Varela, 1988).
Audibert, N. Aubergé, V. Rilliard, A. (2005). The Prosodic Dimensions of Emotion in
Speech. The Relative Weights of Parameters. 9è European Conference on Speech
Communication and Technology, Lisbonne, Portugal, pp 525-528.
Austin, J.L. (1962, 2002) : Quand dire, c’est faire. Paris, Le Seuil.
Banziger, T., Grandjean, D., Bernard J.P., Klasmeyer, G. & Sherer, K. (2001) : Prosodie de
l’émotion. Cahiers de Linguistique Française, 23, 11-37.
Bänziger, T. and Scherer, K. (2005) : The role of intonation in emotional expressions. Speech
Communication, 46, 252-267.
Brassac C. (2001) : L’interaction communicative, entre intersubjectivité et interagentivité,
Langages, 144, 39-57.
Bruner,J. (1987) : Comment les enfants apprennent à parler, Paris, Retz.
Damasio, A. (2010). L'autre moi-même - Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et
des émotions. Paris, Odile Jacob.
De Luze H. (1997) : L’éthnométhodologie, Paris, Anthropos.
De Salins, G.D. (1992) : Une introduction à l’éthnographie de la communication, Paris,
Didier.
Durkheim E. (1973) : Sociologie et philosophie, Paris, PUF.
Fayol, M. (1997) : Des idées au texte. Psychologie cognitive de la production verbale orale et
écrite, Paris, PUF.
Gaonach, D (1987) : Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, Paris,
Hatier.
Gauvain, M. (1995) : Thinking in niches : Sociocultural Influences on Cognitive
Development, Human Development, 38, 25-45.
Guimbretière, E. (2001) : La prosodie : un passage obligé pour la compréhension orale, Le
français dans le monde. Recherches et applications, Paris, Hachette.
Goffman E.,(1967) : Les rites d’interaction, Paris, Minuit.
Gremmo M.J. et Holec H., (1990) : La compréhension orale : un processus et un
comportement, Le Français dans le monde. Recherches et applications. Hachette.
Grice, H.P., (1979) : Logique et conversation, Communications, 30, 57-79.
Hymes Dell H., (1972) : “Models of the Interaction of Language and Social Life », in J.
Gumperz & Dell Hymes (Eds), 35-71.
Kerbrat-Orecchioni, C. (1990) : Les interactions verbales, Paris, A.Colin.
Kerbrat-Orecchioni, C. (2008) : Les actes de langage dans le discours, Paris, A.Colin.
Kintsch, W. (1998) : Comprehension : A paradigm for cognition, New York, Cambridge
University Press.
Laplantine F., (2005) : La description ethnographique, Paris, A. Colin.
Levelt, W., (1989) : Speaking, from intention to articulation, Cambridge, M.I.T Press.
Levi Strauss C., (1958) : Anthropologie structurale, Paris, Plon.
de Pembroke E. (1998) : L’hétérogénéité des représentations du temps dans un cours de
langue, Travaux de didactique, 39, 57-66.
Mesulam, MM. (1986) : “Patterns in behavioral neuroanatomy”. In: M.M. Mesulam( ed.),
Principles of Behavioral Neurology, Philadelphia, F.A. Davies, 1–70.
Mondillon, L., & Tcherkassof, A. (2009). La communication émotionnelle : quand les
expressions faciales s’en mêlent…Revue électronique de Psychologie Sociale, 4, 25-31.
Nelson G. (1997) : How cultural differences affect written and oral communication, The case
of peer response groups, New directions for teaching and learning, 70, 77-84.
Picard, D. (1998) : Les rituels du savoir vivre, Paris, Le Seuil.
Porcher L.& Abdallah Pretceille, M., (1998) : Ethique de la diversité et éducation, Paris :
PUF.
Rogoff, B. (1981). “Schooling and the development of cognitive skills”, in H.C. Triandis &
A. Heron, Handbook of Cross-Cultural Psychology, Boston, Allyn & Bacon.
Searle, J. (1972) : Les actes de langage, Paris, Hermann.
Trognon A. & Brassac C. (1992) : L'enchaînement conversationnel, Cahiers de Linguistique
Française, 13:76-107.
Varela F., (1988). Invitation aux sciences cognitives, Paris, Le Seuil.
Vygotsky L., (1934-trad 1997) : Pensée et langage, Paris, La Dispute.
Vernant, D. (1997) : Du discours à l'action, Paris, PUF.
Wulf C., (2003) : Anthropologie de l’éducation et de la formation, Spirale n° 31.