Liaison et formation des mots en français : un scénario développemental
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Liaison et formation des mots en français : un scénario développemental
Jean-Pierre ChevrotCéline DuguaM. Michel Fayol
Liaison et formation des mots français: un scénariodéveloppementalIn: Langages, 39e année, n°158, 2005. pp. 38-52.
Abstractlexical status of the liaison consonant are proposed to account for this later stage characterized by the formation of more abstractconstructions including liaison.
Citer ce document / Cite this document :
Chevrot Jean-Pierre, Dugua Céline, Fayol Michel. Liaison et formation des mots français: un scénario développemental. In:Langages, 39e année, n°158, 2005. pp. 38-52.
doi : 10.3406/lgge.2005.2661
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_2005_num_39_158_2661
Jean-Pierre Chevrot 1 LIDILEM, Université Stendhal, France Céline Dugua LIDILEM, Université Stendhal, France Michel Fayol LAPSCO, Université Blaise Pascal-CNRS, Clermont-Ferrand, France
Liaison et formation des mots en français :
un scénario développemental
INTRODUCTION
La façon dont le petit homme parvient à maîtriser une langue suscite depuis toujours de vives interrogations. La réponse bien connue de Chomsky, développée et diffusée par Pinker (1999), est de postuler que l'enfant est épaulé dans cette tâche par une connaissance innée des structures linguistiques abstraites communes aux langues du monde. Face à cette conception innéiste, des alternatives ont été proposées, notamment dans le domaine du développement syntaxique. Les données présentées par Tomasello (2000) suggèrent que la compétence linguistique précoce est fondée sur des items mémorisés. Les énoncés du jeune enfant ne seraient pas organisés en catégories et en structures abstraites, mais agencés concrètement autour de séquences et de mots particuliers. Dans le modèle d'acquisition qui en découle, les changements développementaux sont guidés par l'usage. Par imitation, les enfants mémoriseraient des séquences spécifiques au contact de la langue environnante. Par la suite, des schémas et des catégories syntaxiques plus abstraites émergeraient de ces acquis initiaux concrets, puis seraient combinées de façon créative. Le moteur de cette structuration serait la mise en œuvre d'habiletés générales, relevant des domaines cognitif ou sociocognitif.
Même si la liaison n'est généralement pas considérée comme un phénomène syntaxique, mais comme une alternance phonologique qui engage d'autres niveaux structuraux (lexique, morphologie et syntaxe) ainsi que des dimensions non linguistiques (influences stylistiques et sociales sur les liaisons facultatives), les résultats dont nous disposons confortent un scénario d'acquisition en accord avec cette conception du développement syntaxique basée sur l'usage.
Les étapes de ce scénario sont fondées sur les propositions de Morin (2003 [1998]). Notre contribution a consisté à les préciser et à discuter la forme d'une
1. Contact : [email protected]. Les recherches présentées ont été soutenues par l'ACI Cogni- tique et le programme Émergence d e la Région Rhône- Alpes.
38
Liaison et formation des mots en français : un scénario développemental
troisième étape. Nous avons également étayé ces propositions par des données développementales fiables sur le plan statistique.
Lors de la première étape, la disjonction entre frontière lexicale et frontière de syllabe CV créée par la liaison conduirait le jeune enfant à segmenter et mémoriser précocement plusieurs traces lexicales de chaque mot qui suit ordinairement une consonne de liaison (dorénavant, mot2). Alors que l'adulte n'est censé posséder qu'une seule représentation du mot habit, un jeune enfant disposerait de plusieurs variantes distinctes : /nabi/, /zabi/, /tabi/, /abi/. Cette série est plus concrète que la représentation unique /abi/ au sens où chaque variante porte la trace des séquences motl-mot2 où elle a été récupérée, la variante /nabi/ ayant été récupérée lors de la réception d'une séquence comprenant une liaison /n/ (un habit), /zabi/ lors de la réception d'une séquence avec /z/ (des habits), etc.
Deuxièmement, ce jeu de variantes lexicales étant établi, la suite du processus d'acquisition consisterait à mémoriser les liens standard entre chaque mot 1 et la variante adéquate du mot2. L'enfant apprendrait que /nurs/ suit le mot un, que /zurs/ suit le mot des, etc. Nous défendons l'idée que le ressort de cet apprentissage est l'exposition aux séquences motl-mot2 bien formées rencontrées dans l'environnement langagier. C'est donc l'usage du langage en réception qui contribuerait principalement à structurer ce réseau d'associations.
Troisièmement, après la formation des variantes des mots2, après le renforcement des connexions motl-mot2 sous l'effet de l'usage, une troisième étape serait caractérisée par l'émergence d'une structure plus abstraite résultant de la réanalyse des représentations de l'étape 2.
Le premier objectif du présent article est de présenter les données qui ont fondé chaque étape de ce scénario et de nouveaux résultats qui conduisent à en reconsidérer certains aspects. Ce faisant, nous cernerons les zones de flou, notamment les hypothèses concernant la troisième étape, qui a donné lieu à plusieurs conceptions : évolution de la consonne de liaison (dorénavant : CL) vers l'indépendance lexicale, rattachement progressif à la finale du motl, maintien à l'initiale du mot2 jusqu'à l'âge adulte. Le second objectif est de répondre aux objections adressées par Wauquier-Gravelines (2002 ; 2003) à l'encontre d'une conception fondée sur la mémorisation d'items et l'apprentissage statistique. Cette auteure adopte un point de vue plus abstrait, selon lequel l'acquisition des liaisons obligatoires serait contrainte précocement par un principe phonologique général, le principe du « maximal onset », puis évoluerait ultérieurement sous l'impact de la morphologie.
1. ETAPE 1 - SEGMENTATION CV ET FORMATION D'EXEMPLAIRES
La structure syllabique CV est majoritaire dans les lexiques des langues (Vallée, Rousset & Boë, 2001) et pourrait servir d'attracteur à la segmentation précoce de mots nouveaux (Peters, 1985). Dans le cas des séquences motl-CL- mot2, la présence d'une liaison introduit une première difficulté. Du fait de l'enchaînement syllabique, cette CL forme une syllabe CV avec la voyelle initiale du mot2. Une segmentation favorisant la structure CV induit le placement d'une frontière de mots avant la CL, qui, de ce fait, sera rattachée à l'initiale du mot2.
Lan a es 158 39
La liaison : de la phonologie à la cognition
Une autre caractéristique de la liaison introduit une seconde difficulté. En effet, la nature phonétique de la CL (/n/, /z/ ou /t/ dans 99,7 % des cas, Boë & Tubach, 1992) est déterminée par le motl, « comme si elle lui appartenait » (Tranel, 2000). Ainsi, l'enfant entend le mot habit précédé de la CL /n/ dans un habit, précédé de /z/ dans deux habits, de /t/ dans petit habit. Si on admet que la formation d'un mot est ajustée au fur et à mesure des rencontres avec ce mot, le maintien d'une segmentation CV dans chacun de ces contextes aboutit à la mémorisation de plusieurs variantes du mot2 : /nabi/, /zabi/, /tabi/. Cette conception est fondée sur la théorie des exemplaires (Pierrehumbert, 2002), qui défend l'idée de traces mnésiques laissées par les différentes rencontres avec les sons qui composent un mot.
Nous allons présenter des données qui attestent de cette tendance à privilégier les segmentations CV dans les séquences motl-CL-mot2, puis des résultats qui confortent l'existence d'exemplaires en variation dans le lexique enfantin.
1.1. Tendance à la segmentation CV dans les contextes de liaison
Afin de simuler la rencontre avec un nom nouveau dans le contexte détermi- nant-CL-nom, Dugua (2002) a utilisé quatre pseudo-mots représentant des animaux imaginaires. L'expérimentateur montrait à l'enfant une image représentant un animal et disait : c'est un-n-ivak. Il lui montrait ensuite le même animal dessiné en double et l'enfant devait dénommer ce qu'il voyait. S'il disait deux nivaks, en gardant le /n/, on admettait qu'il avait segmenté la séquence entendue en privilégiant CV initial : un / nivak. S'il produisait deux-z-ivak en substituant /z/ au /n/ entendu, on en déduisait qu'il avait segmenté la séquence entendue en interprétant le /n/ de un-n-ivak comme une CL. Cette tâche a été proposée à 200 enfants répartis dans quatre tranches d'âge entre 2 ans 4 mois et 6 ans 1 mois. Les résultats montrent que, dans la tranche 2-3 ans et la tranche 3-4 ans, la segmentation CV (moyennes : 2,6 et 2,7 pour un maximum de 4) prévaut de manière significative2 sur la segmentation inverse (moyennes : 0,6 et 0,7). La tranche 4-5 ans est une période transitoire où les deux types de segmentation s'équilibrent (différences entre 2 et 1,7 non significative). Finalement, à 5-6 ans, la segmentation CV (1,4) cède le pas devant la segmentation inverse (4,2). En bref, jusqu'à 4 ans, l'enfant tendrait à segmenter les séquences motl-CL-mot2 en traitant la CL entendue comme l'initiale du mot2.
1.2. Mémorisation d'exemplaires avec CL initiale
La segmentation de type CV aboutit à la formation de mots2 dont la représentation lexicale comporte un /n/, un /z/ ou un /t/ à l'initiale. Des faits confortant cette hypothèse ont été trouvés dans l'analyse des erreurs produites par Sophie entre 2 ans 1 mois et 3 ans 6 mois (Chevrot & Fayol, 2001). Parmi 665 erreurs de substitution ou d'ajout des consonnes /n/, /z/, /t/ ou /l/ notées lors d'interactions quotidiennes, 41 surviennent à l'initiale d'un énoncé (par exemple, la fillette dit « nâne ! » pour appeler un âne).
2. Lorsque les tests statistiques sont disponibles dans les publications citées, nous ne donnons pas leur détail mais seulement leur résultat (significatif ou non significatif). Pour les tests calculés dans l'optique de cet article, nous détaillons.
40
Liaison et formation des mots en français : un scénario développemental
Dugua (2002) a provoqué expérimentalement la production de mots2 à l'initiale d'énoncés grâce à une tâche d'apostrophe. Elle proposait aux 200 enfants de son échantillon d'appeler huit figurines d'animaux pour les faire avancer. Parmi ces figurines, quatre renvoyaient à des noms commençant par une voyelle chez l'adulte : âne, écureuil, éléphant, ours. Chaque figurine étant appelée deux fois, l'enfant était en situation de produire 8 apostrophes de type : Ours, viens ici ! Les productions avec /n/, /z/ ou /t/ à l'initiale (Nours !) représentent globalement 15,5 % des productions. Elles diminuent progressivement avec l'âge, les pourcentages moyens étant toujours significativement différents entre deux tranches d'âge consécutives : 35,4 % à 2-3 ans, 19 % à 3-4 ans, 8 % à 4-5 ans et 2,8 % à 5-6 ans. Un second résultat montre que les enfants sont capables de produire précocement les variantes à initiale vocalique. Les apostrophes telles que Ane ! ou Ours ! représentent 40,6 % des productions à 2-3 ans et une proportion statistiquement identique à 3-4 ans. Elles augmentent ensuite massivement (et significativement) pour atteindre 83,3 % à 4-5 ans et se stabilisent autour de cette valeur à 5-6 ans.
Le système lexical précoce comporte donc des variantes à initiale vocalique à côté de variantes à initiale consonantique. La question est de savoir si les variantes vocaliques ont été déduites par réanalyse des variantes consonantiques ou prélevées directement dans les énoncés entendus. Dans le cas de liaisons non réalisées (gros ours prononcé [grouRs]), après certains adjectifs au singulier (joli ours), en cas d'usage autonyme ou d'apostrophe, l'enfant peut rencontrer des contextes où les mots2 ne sont pas précédés d'une CL. Brent & Siskind (2001) ont montré que l'audition de mots isolés faisait partie de l'expérience langagière d'enfants anglophones de 9-15 mois. La fréquence avec laquelle leur mère prononce un mot isolément prédit d'ailleurs la capacité ultérieure de l'enfant à le produire.
Les erreurs sur les mots produits isolément sont un bon indice de l'attachement lexical des CL au mot2, mais elles n'en constituent pas une preuve. La consonne observée peut en effet résulter de l'adjonction « en ligne » à une représentation lexicale à initiale vocalique. C'est dans le but de rechercher cette preuve que Chevrot, Dugua & Fayol (en préparation) utilisent une expérimentation d'induction d'erreurs par amorçage auprès de 30 enfants francophones monolingues âgés de 37 mois à 54 mois.
Grâce à une tâche de dénomination d'images, ces sujets étaient amenés à produire une séquence déterminant-nom contenant une CL (la cible) aussitôt après avoir entendu une autre séquence déterminant-nom (l'amorce). Pour illustrer les trois conditions d'amorçage, nous prendrons le cas où les sujets devaient prononcer la séquence un ours, la CL cible étant alors la CL /n/ et l'erreur attendue un zours. Dans la condition expérimentale de contrôle, la production de un ours survenait après l'audition d'une amorce qui ne contenait aucune liaison, telle que un cochon. Dans la condition dite lexico-phonologique, la séquence un ours était produite après audition de deux ours, qui contient une autre CL (/z/) et un nom identique (ours). Dans la condition dite phonologique, la production de un ours arrivait après l'audition de deux arbres, qui contient une autre CL (/z/) et un nom différent (arbre).
On peut établir des prédictions qui différencient les trois modèles de rattachement lexical. Plus précisément, seul le rattachement lexical de la CL à l'initiale du mot2 prédit que les erreurs doivent augmenter dans la condition
Lan a es 158 41
La liaison : de la phonologie à la cognition
lexico-phonologique et dans celle-ci seulement. En effet, si la CL est attachée au mot2, l'unité intrusive qui provoque l'erreur un zours est zours et cette unité n'est présente que dans l'amorce de la condition lexico-phonologique {deux ours). Inversement, si la CL est indépendante et épenthétique, l'unité intrusive qui provoque l'erreur un-z-ours est /z/. Or, l'unité /z/ étant présente aussi bien dans l'amorce de la condition lexico-phonologique {deux ours) que dans celle de la condition phonologique {deux arbres), les erreurs devraient être plus fréquentes dans ces deux conditions que dans la condition contrôle. Enfin, si la CL est attachée à la finale du motl, l'unité intrusive qui provoque l'erreur est un-z. Cette unité n'étant présente dans aucune des conditions, l'amorçage auditif ne devrait pas modifier la fréquence des erreurs. Plus intuitivement, si nous observons que la présence de la séquence phonique /zuRs/ - et pas seulement celle de /z/ - est requise pour favoriser l'erreur un zours, alors nous en déduirons que cette séquence forme une unité lexicale .
Les résultats montrent que les moyennes des scores d'erreurs sont plus importantes dans la condition lexico-phonologique (3,34 pour un maximum de 16) que dans la condition contrôle (2.0). En revanche, aucune différence significative n'existe entre cette condition contrôle et la condition phonologique (2.1). Ce patron de résultats est précisément celui qui est prédit par l'attachement lexical au mot2.
En revanche, ce résultat ne s'accorde pas avec la conception abstraite défendue par Wauquier-Gra vélines (2002 ; 2003). Selon cette conception, les enfants, mus par des principes généraux privilégiant les syllabes non marquées, garniraient l'initiale des représentations lexicales des mots2 d'une structure consonantique abstraite, qu'ils rempliraient « en ligne » à l'aide d'un contenu phonétique récupéré dans leur propre parole (par harmonie : un léléphant) ou dans celle d'autrui. Si tel était le cas, le contenu phonétique [z] de la CL proposée à l'audition des enfants dans la condition d'amorçage dite phonologique {deux arbres — > un ours) devrait être utilisé pour remplir cette position C abstraite à l'initiale de ours. Or, cette condition n'induit aucune augmentation des erreurs par rapport à la condition contrôle.
2. ÉTAPE 2 - RENFORCEMENT DES CONNEXIONS STANDARD M0T1-M0T2
Vers 3-4 ans, l'enfant disposerait donc d'un jeu d'exemplaires lexicaux pour chaque mot à initiale vocalique. Nous pensons que l'étape suivante est l'apprentissage des connexions entre certains motsl et certaines variantes du mot2. Plus précisément, apprendre à faire la liaison reviendrait à apprendre dans un premier temps que la variante nours du mot2 ours suit les motsl un ou aucun, que la variante zours suit les motsl trois, des ou gros, que la variante tours suit les motsl petit ou grand, etc. Notre hypothèse est que la mémorisation de ces associations procède par exposition aux séquences motl-mot2 bien formées rencontrées dans l'environnement. Plus souvent un enfant rencontrera ces séquences bien formées, plus rapidement il apprendra à produire des liaisons correctes.
La conception avancée par Wauquier-Gravelines (2002 ; 2003) est différente. La diminution des erreurs ne résulterait pas d'un apprentissage statistique associatif mais de l'impact de la morphologie. Découvrant que certains déterminants ou
42
Liaison et formation des mots en français : un scénario développemental
adjectifs révèlent une consonne lors d'opérations d'inflexion ou de dérivation (un : une, petit : petitesse), l'enfant encoderait une consonne flottante dans leur représentation lexicale. Dans ce cas, ce n'est plus la fréquence des séquences bien formées motl-mot2 dans l'environnement langagier qui prédit la vitesse d'acquisition des liaisons, mais le nombre et la fréquence des dérivés ou des formes fléchies du motl.
Nous allons exposer des faits qui suggèrent que la maîtrise précoce de la liaison est déterminée par un apprentissage statistique fondé sur la perception des séquences bien formées motl-mot2. Nous finirons en avançant un résultat peu compatible avec l'éventualité d'un impact initial de la morphologie.
2.1. Fréquence, liaisons optionnelles et obligatoires, milieu social
L'observation de corpus de parole adulte (Booij & de Jong, 1987) révèle que les liaisons ne sont réalisées à 100 % que dans quatre contextes : après déterminant, après pronom pré-verbal, entre verbe et pronom (prenez-en !), dans certaines expressions figées (tout à l'heure). Dans les séquences motl-mot2 où la liaison est obligatoire, l'enfant perçoit systématiquement le motl suivi de l'exemplaire du mot2 commençant par une CL. Ce n'est pas le cas dans les séquences motl-mot2 avec liaison facultative, où il perçoit une alternance entre la variante du mot2 avec CL initiale et la variante à voyelle initiale. Plus concrètement, l'enfant entend toujours la séquence des ours sous la forme [de] + [zurs], alors qu'il peut percevoir la séquence gros ours sous deux formes : [gro] + [zurs] ou [gro] + [urs]. En outre, un retraitement des données d' Ahmad (1993) montre que, dans 20 heures de parole adulte, les contextes obligatoires sont plus fréquents que les contextes facultatifs (fréquences respectives : 3 843 et 3 318). Cette systématicité et cette fréquence plus élevée des liaisons obligatoires prédisent que leur maîtrise sera plus rapide.
À l'aide d'une tâche de dénomination d'images, Dugua (2002) a incité les 200 enfants de son échantillon à produire des liaisons après les déterminants un et deux d'une part, et après les adjectifs petit et gros d'autre part. La liaison après déterminant est réalisée à 100 % chez l'adulte et peut être considérée comme obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la liaison qui suit l'adjectif. Dugua observe que l'acquisition est plus rapide pour les liaisons qui suivent un déterminant, liaisons obligatoires et plus fréquentes. La moyenne des pourcentages de liaisons justes après déterminant évolue significativement entre 2-3 ans (36 %) et 3-4 ans (54 %), ainsi qu'entre 3-4 ans et 4-5 ans (80 %) puis elle marque un plateau entre cette dernière tranche d'âge et 5-6 ans (83 %). Pour les liaisons facultatives, l'augmentation des moyennes est nulle entre 2-3 ans (12 %) et 3-4 ans (14 %) puis tendancielle entre 3-4 ans et 4-5 ans (22 %) et enfin significative entre 4-5 ans et 5-6 ans (33 %). Les liaisons obligatoires progressent donc entre 2 et 5 ans, alors que l'évolution des facultatives débute à 3-4 ans et se poursuit jusqu'à 6 ans.
Une deuxième façon de mettre en évidence la sensibilité du processus d'acquisition à la fréquence des séquences motl-mot2 rencontrées dans l'environnement est d'observer son conditionnement social. En effet, l'observation des interactions précoces entre mère et enfant suggère que les enfants de parents à statut social élevé entendent davantage de paroles (Hoff, 2002). Davantage de paroles, c'est davantage d'occasions de rencontrer les séquences motl-mot2 bien formées. Cette
Lan a es 158 43
La liaison : de la phonologie à la cognition
supposition prédit que les enfants de familles à statut social élevé apprendront les liaisons obligatoires avant les autres, même si aucune différence sociolinguistique n'oppose les adultes quant à l'usage de ce type de liaisons. Nardy (2003) a vérifié cette conjecture à l'aide d'une tâche de dénomination d'images destinée à faire produire des liaisons en contexte déterminant + nom à 189 enfants de 2 à 6 ans de milieux sociaux contrastés. La moitié environ avaient grandi dans un milieu catégorisé « ouvrier » et les autres dans un milieu défini comme « cadre ». Dans toutes les tranches d'âge, les pourcentages moyens de liaisons justes sont significative- ment plus élevés pour les « cadres » que pour les « ouvriers » : respectivement 67 % et 25 % à 2-3 ans, 74 % et 60 % à 3-4 ans, 83 % et 65 % à 4-5 ans, 96 % et 86 % à 5-6 ans. Chabanal (2003) retrouve une différence similaire dans deux études de cas comparant l'usage des liaisons obligatoires chez deux enfants enregistrés en situation d'interaction.
Ainsi, lorsque les séquences correctes motl-mot2 sont plus souvent entendues dans l'environnement langagier, les liaisons sont apprises plus vite.
2.2. Jugement et production chez des enfants dysphasiques et tout venant
Dans notre hypothèse, la connaissance des liens standard entre motl et variantes du mot2 s'établit par la perception. Cette proposition est compatible avec l'idée que cette connaissance peut être disponible pour une tâche de jugement d'acceptabilité avant même d'être utilisée pour la production. Une autre hypothèse est que cette connaissance se construit sur la base de la production dans les situations d'imitation immédiate, par exemple quand un enfant reprend dans une réponse une séquence déterminant + nom contenue dans la question qu'un adulte vient de lui poser. Cette seconde hypothèse n'est pas compatible avec une avance des jugements d'acceptabilité sur la production effective.
Chevrot, Dugua & Fayol (en préparation) ont testé cette alternative en comparant jugement et production de liaisons obligatoires chez 15 enfants dysphasiques de type phonologique-syntaxique, appariés à 15 enfants tout venant en fonction du sexe et de l'âge de développement langagier mesuré par le Test de Closure Grammaticale (Deltour, 1991). Les deux groupes sont donc identiques quant à leur âge de développement langagier (56 mois) même si l'âge civil des dysphasiques est le double de celui des tous venants (respectivement 116 mois et 58 mois). Les résultats montrent premièrement que les dysphasiques avec un âge développe- mental inférieur à 60 mois disposent, comme tous les enfants, d'un jeu de variantes de mots2. Deuxièmement, le pourcentage moyen de jugements justes des dysphasiques n'est pas différent de celui des tous venants (67 % pour les deux groupes) alors que leur pourcentage de productions justes est significativement inférieur à celui des tous venants (dysphasiques : 60 %, tous venants : 88 %). À la mesure de leur âge développemental, les jugements des dysphasiques sont donc en avance sur leur production.
Du fait de leur âge, les enfants dysphasiques ont été exposés suffisamment longtemps aux séquences bien formées motl-mot2 pour les reconnaître lors d'une tâche de jugement. Leur difficulté à produire ces mêmes séquences montre qu'ils en ont pris connaissance sans le recours à la pratique productive.
44
Liaison et formation des mots en français : un scénario développemental
2.3. La question du rôle de la morphologie
La constitution d'un réseau de connexions lexicales entre motsl et variantes de mot2 est - pensons-nous - le principal moteur de l'acquisition précoce de la liaison. Toutefois, aucune des données présentées jusqu'ici n'infirme l'hypothèse de Wauquier-Gra vélines (2002 ; 2003) qui impute les progrès dans l'acquisition au rôle de la morphologie. Nous allons maintenant présenter un nouveau résultat qui joue en défaveur de cette intervention précoce de la morphologie.
Parmi les motsl utilisés dans la tâche de dénomination d'images conçue par Dugua (2002), deux et petit s'opposent selon deux dimensions. Deux est plus souvent suivi d'une liaison que petit . Inversement, les dérivés de deux sont rares alors que les formes fléchies de petit sont fréquentes. À défaut d'enregistrements extensifs de l'environnement langagier enfantin, nous disposons du dictionnaire de Boë et Tubach (1992) qui liste les fréquences d'occurrence des mots rencontrés dans 20 heures de parole adulte. Sa consultation nous apprend que deux apparaît 65 fois suivi de la liaison /z/ réalisée, alors que petit n'apparaît que 8 fois devant la liaison /t/ réalisée. Les dérivés de deux rencontrés dans la parole adulte sont deuxième et deuxièmement et l'addition de leur fréquence aboutit à 22 occurrences. Nous ne trouvons aucun dérivé de petit mais 59 occurrences de la forme fléchie du féminin petite. Si les progrès dépendent de la rencontre avec les formes fléchies ou dérivées, l'acquisition de la liaison après petit devrait s'effectuer plus vite que celle de la liaison après deux. Si, au contraire, c'est la rencontre avec les séquences motl-mot2 incluant une CL réalisée qui est déterminante, nous devrions observer l'ordre d'acquisition inverse. Dans la figure 1, les taux de liaisons réalisées justes sont représentés pour les quatre tranches d'âge selon lesquelles sont répartis les 200 enfants observés par Dugua (2002).
2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans 5-6 ans
Figure 1 - Petit et deux : pourcentages de liaisons réalisées justes par deux cents sujets (à partir des données de Dugua, 2002)
L'acquisition est plus précoce pour la liaison suivant deux, qui progresse signi- ficativement entre 2-3 ans et 3-4 ans (Mann-Whitney, p <.0001), entre 3-4 ans et 4-5 ans (p=.OO63) mais pas entre 4-5 ans et 5-6 ans. A l'inverse, les progrès sur la liaison suivant petit ne sont pas significatifs entre 2-3 ans et 3-4 ans, mais le deviennent entre 3-4 ans et 4-5 ans (p=.0002) et entre 4-5 ans et 5-6 ans (p=.O254). Il s'ensuit que les liaisons justes sont plus fréquentes pour deux que pour petit, tendanciellement à 2-3 ans (p=.O94), significativement plus tard (p<.0001).
Lan a es ISS 45
La liaison : de la phonologie à la cognition
Si les jeunes enfants maîtrisent la liaison /z/ de deux plus précocement que la liaison /t/ de petit, c'est parce qu'ils rencontrent souvent deux suivi d'une CL dans des séquences motl-mot2. Cet effet s'exerce malgré la faible fréquence des dérivés du déterminant et en dépit de la tendance reconnue à réussir généralement l'articulation du /t/ avant celle de /z/ (Vinter, 2001). Ces résultats sont peu compatibles avec l'intervention précoce de la morphologie proposée par Wauquier- Gra vélines (2002, 2003). Ce qui ne signifie pas que nous excluions la morphologie des facteurs dynamiques caractérisant l'étape 3 de notre scénario.
3. ETAPE 3 - GENERALISATIONS
Les études d'enregistrements familiaux montrent que la réalisation des liaisons obligatoires (après déterminant, après clitique, entre verbe et clitique, dans des séquences figées) atteint au plus tard vers 6 ans le score de 100 % observé chez l'adulte. Dans cinq études de cas transversales (Chevrot, 2002), les pourcentages individuels de liaisons justes sont de 84 % vers 3 ans 6 mois, de 98 % vers 5 ans 9 mois, de 99 % vers 6 ans 11 mois. Outre cette disparition progressive des erreurs, des modifications tardives de leur composition suggèrent que certaines restructurations des connaissances opèrent jusqu'à 5-6 ans au moins.
3.1. Les modifications tardives des profils d'erreur
Premièrement, la part que représentent les omissions de CL (des ours produit [deurs] sans CL /z/) augmente parmi les erreurs affectant les liaisons obligatoires. Dugua (2002) établit que la proportion d'omissions parmi les erreurs passe de 28 % à 2-3 ans à 85 % à 5-6 ans, avec un saut quantitatif significatif entre 3-4 ans (35 %) et 4-5 ans (66 %).
Deuxièmement, Chevrot (2001) et Wauquier-Gravelines (2003) notent l'apparition d'erreurs sur les consonnes initiales. Soit il s'agit de l'omission de /n/, /z/ ou /\/ à l'initiale de mots dans des séquences déterminant + nom (le nombril produit le ombril [Ia5bril]). Soit il s'agit du remplacement de /n/, /z/ ou /!/ à l'initiale par un /l/ ou une autre consonne pouvant fonctionner comme CL : les nuages ou mon petit zèbre produits les zuages [Iezua3] ou mon petit tèbre [mSptitebr]). Dugua (2002) a généralisé ces observations par une tâche de dénomination des mots lavabo, nombril, nuage et zèbre après les déterminants un et deux. Un retraitement de ses données met en évidence deux types de substitutions. Dans le type 1, la CL remplaçant l'initiale est celle qu'induit le motl : un zèbre produit un nèbre avec un /n/, CL qui suit régulièrement un ; dans le type 2, la CL diffère de celle qu'induit le motl : les zèbres produit les nèbres avec /n/ après les. Dans la figure 2 sont notés les nombres globaux d'erreurs d'omission et de substitution de consonnes initiales et les moyennes des pourcentages individuels d'occurrence3.
3. Ces pourcentages sont rapportés au nombre de réponses effectives. Les cas où les enfants n'ont rien produit ou produit un déterminant ou un nom inattendus (un cheval à la place de un zèbre) sont exclus du dénominateur.
46
Liaison et formation des mots en français : un scénario développemental
La consultation du tableau montre que seules les substitutions type 1 ont une incidence notable. Sans différencier les tranches d'âge, leur pourcentage d'occurrence est supérieur à celui des trois autres types (Wilcoxon, p < 0.009), qui ne diffèrent pas entre eux. Par ailleurs, seules les substitutions type 1 évoluent avec l'âge (Kruskal-Wallis, p < 0.0001) et manifestent un patron « en cloche » typique des surgénéralisations. Plus précisément, l'augmentation entre 3-4 ans (2 %) et 4-5 ans (11 %) et la diminution entre 4-5 ans et 5-6 ans (5 %) sont significatives (Mann-Whitney, p < 0.0025). En bref, vers 4-5 ans, âge auquel les liaisons obligatoires justes franchissent le seuil des 80 %, l'enfant remplace les consonnes initiales de zèbre ou nombril par des CL compatibles avec le motl qui précède (nèbre si zèbre suit un, zombril si nombril suit deux, etc.). Ce patron de surgénéralisation n'avait jamais été observé à ce jour. Nous estimons qu'il doit jouer un rôle central dans les tentatives d'explication des étapes tardives du scénario développemental.
Substitution type 1 : remplacement de la C initiale par une CL compatible avec le motl : un nèbre Substitution type 2 : remplacement de la C initiale par une CL non compatible avec le motl : les nèbres Omission de la C initiale : les zèbres produit sans /z/ Substitution où /l/ remplace la C initiale : les lèbres
2-3 ans
5 5%
2 3%
2 1% 4
3%
3-4 ans
6 2%
1 0.3%
6 3% 4
2%
4-5 ans
40 11%
2 0.5 %
9 4% 0
0%
5-6 ans
15 5%
1 0.4 %
9 4% 2
0.7%
âges con
fondus
66 6%
6 1%
26 3% 10 1%
Figure 2 - Erreurs sur les initiales consonantiques : nombre et moyenne des pourcentages individuels (à partir de Dugua, 2002)
3.2. Trois hypothèses en concurrence
Trois hypothèses ont été avancées pour décrire cette étape tardive du lien entre acquisition de la liaison et formation des mots. Nous allons les confronter aux données « classiques » concernant les modifications tardives ainsi qu'à ce patron de surgénéralisation.
Hypothèse 1 (Morel, 1994) - Selon la première hypothèse, les exemplaires de mot2 tels que /nurs/, /zurs/, /turs/ fusionnent et se réduisent à leur structure sonore commune /urs/. Cette restructuration lexicale serait motivée par la proximité de leur sonorité et l'identité de leur sens dans le lexique enfantin. Par ailleurs, du fait de la co-occurrence régulière entre certains motsl et certaines liaisons (/z/ suit gros, /n/ suit un, etc.), les CL finiraient par s'attacher à la finale des motsl. En bref, l'étape 3 serait caractérisée par la fusion et la resegmentation des exemplaires de l'étape 2. Finalement, chez l'adulte, la CL serait classiquement encodée à la finale du motl, comme dans la majorité des modèles phonologiques.
Cette hypothèse pourrait expliquer la progression des erreurs d'omission par un état intermédiaire dans lequel la CL n'est plus à l'initiale du mot2 et pas encore
Lan a es 47
La liaison : de la phonologie à la cognition
à la finale du motl (Côté, ce volume). Les erreurs sur les consonnes initiales résulteraient de fausses segmentations. La consonne initiale d'éléments lexicaux tels que zèbre serait abusivement détachée et la séquence /ebr/ serait employée régulièrement après des motsl porteurs de CL. Toutefois, l'hypothèse 1 entre en contradiction avec d'autres faits. Comme le note Côté (ce volume), le rattachement progressif des CL à la finale du motl devrait entraîner deux autres types d'erreurs par surgénéralisation : soit le traitement d'une consonne finale stable comme une CL {honnête prononcé [Dne] devant consonne), soit la production de CL devant consonne. Les erreurs du premier type n'ont jamais été rapportées. Quant au second type, nos observations en éliminent l'éventualité. Dans les tâches de dénomination d'images de Dugua (2002) et Nardy (2003), les distracteurs étaient des séquences où le motl implique une CL {un, deux, petit, gros) et le mot2 commence par une consonne. Or, parmi 7 800 séquences prononcées par 389 enfants de 2 à 6 ans, jamais une production de CL devant un mot à initiale consonantique n'a été observée. Un deuxième argument à l'encontre de l'hypothèse 1 est la disponibilité des variantes à initiale vocalique dès 2-3 ans (Dugua, 2002 et supra 1.2). Celles-ci sont précoces et ne sont pas déduites tardivement de la confrontation des variantes à initiale consonantique.
Hypothèse 2 (Chevrot, 2001, Dugua, 2002) - Selon la seconde hypothèse, l'élimination progressive des erreurs est imputée à la poursuite de l'apprentissage des relations standard motl-mot2. L'enfant mémoriserait de mieux en mieux les séquences rencontrées dans l'input et serait de plus en plus capable de les mobiliser en production. La compétence adulte reposerait alors sur un réseau de connexions entre les motsl et les exemplaires de mots2.
Dans cette conception, la progression de la part des omissions parmi les erreurs résulterait de l'inhibition des séquences motl-mot2 dans lesquelles la variante du mot2 commence par une initiale consonantique non conforme {un zours). Les enfants percevraient ces séquences dans leurs propres énoncés et apprendraient progressivement à bloquer leur production. Cette inhibition laisserait émerger les séquences composées d'un motl et de la variante du mot2 à initiale vocalique, moins contrôlées parce que moins audibles. Enfin, les erreurs sur les consonnes initiales résulteraient de créations analogiques. Le mot zèbre serait assimilé aux noms de type ours, qui disposent de plusieurs variantes (Côté, communication personnelle). La série /ebr/, /nebr/, /zebr/ serait alors créée par analogie à /urs/, /nurs/, /zurs/.
Aux critiques qu'adresse Côté (ce volume) à cette conception de l'étape tardive, Wauquier-Gravelines & Braud (ce volume) en ajoutent deux, plus générales. C'est en effet le principe même de l'hypothèse 2 qui fait problème. Admettre que l'enfant doit mémoriser exhaustivement toutes les séquences motl-mot2 possibles ne rend pas justice à ses capacités de généralisation, pourtant attestées par les erreurs sur les initiales consonantiques. Par ailleurs, l'hypothèse 2 manque de réalisme : peut-on penser qu'un enfant rencontre avant 5 ans toutes les combinaisons possibles entre les motsl déclencheurs de liaison et les mots2 ?
Hypothèse 3 (Côté, ce volume ; Côté & Chevrot, 2003) - Dans la troisième hypothèse, l'étape tardive serait caractérisée par la resegmentation du mot2. Contrairement à l'hypothèse 1, la majorité des CL détachées du mot2 resteraient
48
Liaison et formation des mots en français : un scénario développemental
lexicalement indépendantes et seraient insérées « en ligne » par un processus d'épenthèse. L'économie lexicale motiverait cette restructuration. Lorsque l'enfant sait activer les exemplaires du mot2 à partir du contexte lexical (motl) ou morphologique (pluriel, personne 3), la CL à l'initiale des variantes du mot2 devient prédictible en fonction du contexte. Elle est donc exclue du lexique et fait l'objet d'un traitement plus général. Chez l'adulte, le cas général serait donc l'indépendance lexicale des CL.
Dans cette hypothèse, la disparition des erreurs résulterait de la maîtrise du processus d'épenthèse. Les erreurs par omission découleraient de la non-application ponctuelle de ce processus d'épenthèse devant un mot2 resegmenté. Le nombre de resegmentations croissant avec les progrès, la probabilité de non-application de l'épenthèse devant des mots2 resegmentés augmenterait et les omissions prendraient une part croissante parmi les erreurs. Enfin, les omissions de consonnes initiales résulteraient de la surgénéralisation du processus de resegmentation à des mots tels que zèbre et les substitutions de consonnes initiales seraient provoquées par l'application de l'épenthèse à ces représentations lexicales abusivement resegmentées : après avoir détaché par erreur le /z/ à l'initiale de zèbre, les enfants inséreraient un /n/ dans cette position.
Cette interprétation est cohérente, à un détail près. On sait que les variantes à initiale vocalique sont disponibles dès 2-3 ans. Comment justifier alors la resegmentation tardive des variantes à initiale consonantique, puisque l'objet phonologique auquel cette opération aboutit existe déjà dans le lexique enfantin ?
3.3. Environnement langagier et capacité de généralisation
L'examen des trois hypothèses souligne trois critères empiriques auxquels doivent se conforter les tentatives d'explication : ne pas prédire d'erreurs jamais attestées, prendre acte de l'existence précoce de variantes à initiale vocalique, rendre compte du patron de surgénéralisation. À ces trois critères s'ajoutent deux principes généraux : ne pas sous-estimer les capacités enfantines de généralisation et ne pas surestimer l'exhaustivité des informations fournies par l'environnement langagier. Les points fondamentaux de l'étape 1 et de l'étape 2 et les hypothèses sur l'étape 3 doivent être reconsidérés à la lumière de ces contraintes.
Premièrement, même si nous maintenons que l'enfant segmente les séquences motl-CL-mot2 en récupérant des exemplaires du mot2 commençant par des CL différentes, il nous faut admettre que l'environnement ne lui permet pas la rencontre avec toutes les combinaisons possibles CL-mot2. En conséquence, pour certains mots2 effectivement rencontrés derrière /n/, /z/ et /t/, l'enfant récupérera le paradigme complet des variantes : /zurs/, /nurs/, /turs/. Pour d'autres mots2, rencontrés avec une ou deux des trois CL, le paradigme des variantes sera incomplet. Deuxièmement, bien que nous maintenions que l'enfant apprend les liens entre motsl et exemplaires du mot2 par exposition aux séquences bien formées, nous précisons maintenant qu'il ne mémorise pas de cette façon toutes les séquences motl-mot2. D'une part, il n'est pas certain qu'il les rencontre toutes. D'autre part, comme le propose Morin (2003 [1998]), sur la base des connexions apprises dans l'environnement, il forme des généralisations concernant les relations entre un motl particulier et une classe particulière de variantes des mots2 (entre un et les variantes commençant par /n/) ou entre un contexte morphologique et une
Lan a es 158 49
La liaison : de la phonologie à la cognition
classe de variantes (« pluriel » et les variantes en /z/). L'application de cette généralisation à des paradigmes incomplets est l'origine des erreurs de surgénéralisation sur les consonnes initiales.
Une fois établi le lien entre un motl et une classe de variantes, la sélection lexicale du motl active la production d'un élément de la classe correspondante. Par exemple, si le lien entre des et /z/ est généralisé, la sélection lexicale de des active un exemplaire du mot2 commençant par /z/. Si cet exemplaire a été rencontré et segmenté, il est disponible dans le lexique enfantin. Il peut alors être mobilisé et produit. Si cet exemplaire n'a pas été rencontré et segmenté, il est absent du lexique et doit alors être créé « en temps réel ». Les erreurs de type 1 sur les consonnes initiales sont la trace de cette création. Prenons le cas d'un enfant qui doit produire un zèbre, qui a généralisé le lien entre un et les variantes à /n/ initial et qui dispose de la forme /zsbr/ dans son lexique. Pour satisfaire à la généralisation du lien entre un et les variantes à /n/ initiale, il créera /nebr/ et produira un nèbre. Notons que le processus est exactement le même s'il doit produire un âne et ne dispose pas de /nan/ dans son lexique.
La question maintenant cruciale est de savoir comment sont réalisées ces créations. Une première solution est de penser qu'elles procèdent par adjonction d'une CL, éventuellement après resegmentation des exemplaires existants. Prenons le cas où l'enfant doit produire des ânes alors qu'il a mémorisé /an/ et /nan/, mais pas /zan/. Il dispose de deux moyens pour créer cette dernière forme : soit insérer /z/ devant /an/, soit resegmenter /nan/ en lui ôtant le /z/ puis insérer /z/. Selon les variantes disponibles dans son lexique, l'enfant peut utiliser l'un ou l'autre des deux procédés pour générer les variantes compatibles avec le motl. À force de faire l'objet de segmentations ou d'ajouts « en ligne », les CL à l'initiale des représentations lexicales finiraient par s'en détacher et deviendraient indépendantes. Soulignons que cette première solution est une spécification de l'hypothèse 3, dont elle partage l'explication donnée pour les erreurs par omission (section 3.1).
La seconde conception pour envisager la création de nouvelles variantes est fidèle à l'hypothèse 2 et l'explication de la part croissante des erreurs d'omission parmi les erreurs est alors le processus d'inhibition défendu dans le cadre de cette hypothèse (section 3.1). Dans ce cas, la création de formes compatibles avec le motl ne procède pas par des opérations de resegmentation et d'épenthèse portant sur les unités phonologiques mais par analogie avec les éléments lexicaux disponibles et activés par le motl. Dans le cas où la séquence cible est des ânes, la sélection de des active tous les exemplaires des mots2 commençant par /z/. Si la variante /zan/ n'est pas disponible dans le lexique, elle est créée par analogie à toutes les variantes en /z/ préactivées. L'évolution des erreurs de type 1 et 2 sur les consonnes initiales (figure 2) indique clairement que des créations analogiques existent dès 2-3 ans mais que leur nombre augmente à 4-5 ans, lorsque se généralise le lien standard entre motl et classes de mots2.
En bref, l'hypothèse 1, qui défend classiquement un attachement progressif des CL à la finale du motl est éliminée parce qu'elle prédit des erreurs jamais observées. Les contraintes théoriques et empiriques issues de la confrontation des conceptions sont compatibles avec l'évolution de la CL vers l'indépendance lexicale (hypothèse 2) autant qu'avec son maintien à l'initiale du mot2 (hypothèse 3). Les travaux à venir devront trancher entre épenthèse et analogie.
50
Liaison et formation des mots en français : un scénario développemental
4. CONCLUSION
Comme le notent Wauquier-Gravelines & Braud (ce volume), ce sont les principes explicatifs qui différencient le scénario proposé dans ces lignes de celui qu'elles défendent. Elles estiment que l'enfant est mû précocement par le principe du « maximal onset » et qu'il « sait qu'il faut une consonne [à l'initiale du mot2] mais ne sait pas laquelle ». Nous pensons au contraire que l'enfant connaît le contenu phonétique situé à l'initiale des exemplaires du mot2 récupérés dans l'environnement avant même de le catégoriser comme consonne. Une seconde divergence explicative concerne le rôle de la morphologie : facteur précoce et crucial pour fixer la CL pour Wauquier-Gravelines & Braud, élément tardif émergeant des reformulations phonologiques dans notre conception. Enfin, Wauquier- Gravelines & Braud envisagent une étape très précoce où le substantif et le déterminant constitueraient une seule unité non segmentée. Nous devrons prendre en considération cet état initial.
Les principales oppositions dépendent donc du rôle accordé aux catégories abstraites, aux principes généraux, à des niveaux de représentation plus élaborés. Soit on conçoit l'accès précoce à ces niveaux de représentation comme un facteur dynamique du développement ultérieur, sans d'ailleurs postuler nécessairement que cet accès est induit par un programme génétique. Soit on met l'accent sur la genèse des représentations abstraites à partir de séquences mémorisées précocement, à l'intérieur desquelles l'enfant aménage progressivement des emplacements libres où peuvent s'insérer des éléments nouveaux (Lieven, Behrens, Speares & Tomasello, 2003). Ce second point de vue est celui que nous adoptons et que défendent les modèles basés sur l'usage. Rien n'empêche toutefois d'envisager - comme nous l'avons fait - que l'enfant utilise ces représentations induites de l'usage pour générer des séquences qu'il n'a jamais rencontrées dans les énoncés environnants.
Références bibliographiques
Ahmad, M. (1993). Vingt heures de français parlé : aspects phonétiques de la liaison, Doctorat, Institut de la Communication Parlée, Grenoble 3 (non publié).
Boe, L.-J. & Tubach, J.-P. (1992). De A à Zut, dictionnaire phonétique du français parlé, Ellug. Boou, G. & De Jong, D. (1987). The domain of liaison: theories and data, Linguistics 25,
1005-1025. Brent, M.R. & Siskind, J.M. (2001). The role of exposure to isolated words in early
vocabulary development, Cognition, 81, B33-44. Chabanal, D. (2003). Un aspect de l'acquisition du français oral : la variation
sociophonétique chez l'enfant francophone, Doctorat, Université Montpellier 3. Chevrot, J.-P. (2002). Rapport final du projet La liaison : Acquisition, Théorie Phonologique,
Traitement Automatique, ACI Cogmtique. Chevrot, J.-P. & Fayol, M. (2001). Acquisition of French liaison and related child errors. In
M. Almgren, A. Barrena, M.J. Ezeizabarrena, I. Idiazabal, and B. MacWhinney (eds), Research on Child Language Acquisition, volume 2, Cascadilla Press, 760-774.
Chevrot, J.-P. (2001). Variation phonétique, développement, orthographe, Habilitation à diriger des recherches, Université Grenoble 3.
Chevrot, J.-P., Dugua, C. & Fayol, M. (en préparation). Word segmentation and formation: what can we learn from the French liaison?.
Lan a es 158 51
La liaison : de la phonologie à la cognition
Côté, M.-H. & Chevrot, J.-P. (2003). The Acquisition of French Liaison, 28th Boston University Conference on Language Development, 31 Octobre-2 Novembre, Boston, U.S.A.
Dugua, C. (2002). Liaison et segmentation du lexique en français : vers un scénario développemental, Diplôme d'Études Approfondies, Université Grenoble 3.
Dugua C, Chevrot J.-P., Côté M. -H. (2003). Liaison et formation des mots : scénario développemental et conséquences pour le traitement phonologique, 5e Journées Internationales du GDR CNRS Phonologies, 2-4 juin 2003, Université Paul Valéry, Montpellier.
Dugua, C, Chevrot, J.-P. & Fayol, M. (2003). Segmentation du lexique et formation des mots en français : le cas de la liaison chez des enfants tout venant et dysphasiques, Colloque International Le Langage Oral de l'Enfant Scolarisé : Acquisition, Enseignement, Remédiation, 23-25 Octobre, Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Grenoble.
Hoff, E. (2002). Causes and consequences of SES-related differences in parent-to-child speech. In M. H. Bornstein & R. H. Bradley (eds.), Socioeconomic status, parenting, and child development, Lawrence Erlbaum Associates, 147-160.
Lieven, E., Behrens, H., Speares, J. & Tomasello, M. (2003). Early syntactic creativity: a usage-based approach, Journal of Child Language, 30, 333-370.
Morel, E. (1994). Le traitement de la liaison chez l'enfant : études expérimentales, Tranel, 21, 85-95.
Morin, Y. C. (2003) [1998]. Remarks on prenominal liaison consonants in French. Living on the Edge, 28 Papers in Honour of Jonathan Kaye, Stefan Ploch (éd.), Mouton de Gruyter.
Nardy, A. (2003). Production et jugement d'acceptabilité entre 2 et 6 ans : aspects psycholinguistiques et sociolinguistiques de l'acquisition des liaisons, Diplôme d'Études Approfondies, Université Grenoble 3.
Peters, A. (1985). Language Segmentation: Operating Principles for the Perception and Analysis of Language. In Dan Slobin (éd.), The Crosslinguistic Study of Language Acquisition, 2, Erlbaum.
Pierrehumbert, J. (2002). Word-specific phonetics. In C. Gussenhoven and N. Warner (eds), Laboratory Phonology VII, Mouton de Gruyter, 101-140.
Pinker, S. (1999). L'instinct du langage, Éditions Odile Jacob. Tomasello, M. (2000). The item-based nature of early syntactic development, Trends in
Cognitive Science, 4 (4), 156-163. Tranel, B. (2000). Aspects de la phonologie du français et la théorie de l'optimalité, Langue
française 126 : 39-72. Vallée N., Rousset I. & Boë L.J. (2001). Des lexiques aux syllabes des langues du monde.
Typologies, tendances et organisations structurelles, Linx, 45, 37-50. Vinter, S. (2001). Les habiletés phonologiques chez l'enfant de deux ans, Glossa, 77, 4-19. Wauquier-Gravelines, S. (2002). Segmentation de la chaîne parlée et détermination des
frontières gauches dans l'acquisition du lexique précoce, Rencontres Internationales du GDR Phonologies, Grenoble, 6-8 juin 2002.
Wauquier-Gravelines, S. (2003). Du réalisme des formalisations phonologiques contemporaines : que nous apprennent les données d'acquisition ? In Angoujard, J.P. & Wauquier-Gravelines S. (eds), Phonologie : champ et perspective, Presses de l'École Normale Supérieure de Fontenay-St Cloud.
52
















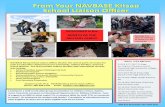







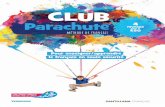










![World Health Organization [WHO] - Liaison File - Volume 01](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633a9f0d351bffb3ec0d8c05/world-health-organization-who-liaison-file-volume-01.jpg)

