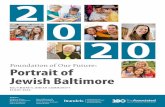Le « mythe » du Barbare. Déchéance d’un concept : époque contemporaine et Antiquité.
L’habitus d’un 'itinérant' : portrait du chasseur malinké
Transcript of L’habitus d’un 'itinérant' : portrait du chasseur malinké
Colloques de la Maison René-Ginouvès C o l l e c t i o n dirigée par Pierre R o u i l l a r d
La chasse Pratiques sociales et symboliques
Sous la direction de Isabelle SIDÉRA,
avec la collaboration de Emmanuelle VILA et de Philippe ERIKSON
D e B o c c a r d
1 1 , rue de Médic is 7 5 0 0 6 Paris
2 0 0 6
ilHABITUS D'UN « ITINÉRANT » .
PORTRAIT D'UN CHASSEUR MALINKÉ (CÔTE D'IVOIRE ET MALI )
Agnès KEDZIERSKA*
Résumé
Après une brève descr ipt ion de leur statut social et
du cadre général de leur prat ique, ce texte explore
habitus cynégétique des membres de la confrérie
2es chasseurs malinké. Les techniques d u corps,
3 ;nsi que les schémas moteurs et perceptifs mob i l i
ses à l'occasion des sorties en brousse sont décrits,
= nsi que l'état d'esprit (préparation, concent rat ion
et ascèse mentale) de ceux q u e la littérature orale
désigne fréquemment c o m m e « les itinérants ».
Mots-clés: habitus, motricité, percept ion , c o g n i -
: on, malinké, imaginaire.
Abstract
After a short description oftheir social status and the
gênerai framework oftheir practice, this paper explo
res the hunting habits (habitus) of members of the
Malinké hunters brotherhood. Body techniques, as well
as driving and perceptual diagrams employed during
outings in the bush are described, as well as thestate of
mind (préparation, concentration and mental asceti-
cism) ofthose frequently designated as "the itinérants"
in oral literature.
Key words: habitus, motivity, perception, cognition,
malinké, imaginary.
N ous nous proposons i c i d 'explorer l 'habi tus cynégétique mal inké 1 , à par t i r de nos
recherches sur le t e r ra in , menées depuis 1995 dans le nord-ouest i v o i r i e n et le sud-
ouest d u M a l i . N o u s percevons encore la chasse c o m m e u n fait social total, selon les
termes de M a r c e l Mauss , q u i englobe une technique psychosomatique et u n système de
représentations.
E n premier l i e u , nous analyserons les schémas moteurs des chasseurs, puis leurs sché
mas perceptifs p o u r t e r m i n e r par les composantes mentales de leur activité. E n raison de
la brièveté de notre exposé, nous nous l i m i t e r o n s à m e n t i o n n e r les p o i n t s essentiels de
i habitus cynégétique sans i l lustrer nos constatations par des exemples concrets. L'analyse
de l 'habitus sera précédée par une brève descr ipt ion d u rôle d u chasseur dans sa société et
d u cadre général de sa pra t ique . À travers l'analyse de l 'habi tus , nous souhaitons présenter
les relations entre la praxis et l ' imaginaire cynégétiques dans la c o m m u n a u t é étudiée.
Chez les M a l i n k é , l 'activité cynégétique a tou jours formé une ressource a l imentaire
i m p o r t a n t e sans const i tuer une activité de base de l ' économie . M ê m e si elle représente
ia pr inc ipale source de protéines animales 2 , elle co-existe depuis longtemps avec d'autres
modes de subsistances, d o n t l ' agr icul ture .
• Doctorante INALCO/Llacan CNRS, UMR 8135. ' . " 'er re Bourdieu définit ïhabitus c o m m e l 'ensemble des schémas moteurs, perceptifs et c o g n i r t ca' ï r te-
• sant un g roupe socioprofessionnel dans une société donnée (1980, pp . 88-96). 2. -élevage, c o n n u sur ce terrain, est considéré davantage c o m m e une source de p r o d u i s ='Te3 2 - e
; e viande. Cette s ituation évolue, néanmoins, depuis plusieurs décennies déjà, à c - c > . " te 3eï r c r e ; ..rbaines.
46 Habitus du chasseur, le cas malinké
À cause de sa dépendance au cycle agraire, l 'activité cynégétique se l i m i t e pendant cer
taines périodes à une sortie hebdomadaire . A v a n t les fêtes annuelles des chasseurs d u r a n t
la saison sèche, elle p e u t s'étendre à des semaines entières. Elle se déroule le j o u r o u la
n u i t , s u r t o u t i n d i v i d u e l l e m e n t et, a u j o u r d ' h u i , avec une arme à feu. La chasse fai t l 'ob jet
d ' u n apprentissage, q u i consiste en une longue pra t ique solitaire, doublée d ' u n enseigne
m e n t dispensé par u n maître chasseur. La transmission de la t echnique corporel le cynégé
t ique , q u i répond à de nécessaires adaptations au terra in où se déroule la chasse, n'est pas
verbale, mais passe par l ' i m i t a t i o n 3 .
Le chasseur r e m p l i t des fonc t ions sociales variées : i l apporte la n o u r r i t u r e indispen
sable à la c o m m u n a u t é et vei l le également à la sécurité et au m a i n t i e n d ' u n équilibre
s y m b o l i q u e . I l occupe une p o s i t i o n capitale dans la société, q u i l u i accorde, p o u r des
raisons m y t h i q u e s et historiques, u n p o u v o i r de d i v i n a t i o n , de guérison et de médiat ion
et social, dans la f o n d a t i o n des villages et la p r o t e c t i o n . I l peut être avant t o u t caractérisé
par son appartenance à la confrérie des chasseurs, donsoton, une organisat ion p o l i t i q u e
et religieuse d o n t les origines r e m o n t e n t au début de notre ère. L'intégrer nécessite une
i n i t i a t i o n r i tue l le régie par certains principes é th iques 4 . Aussi , l ' i m p o r t a n c e de la figure
d u chasseur dans l ' imaginaire co l l ec t i f mal inké ne pourra i t -e l le n u l l e m e n t se réduire à la
satisfaction des besoins al imentaires.
M O U V E M E N T E N ÉQUILIBRE
D a n s les chants et les récits de chasse, le chasseur est souvent s u r n o m m é jula, ce que l ' o n p o u r r a i t t raduire , selon l 'étymologie popula i re , par « i t inérant ». E n effet, l 'activité cynégétique reste la mise en m o u v e m e n t de celui q u i recherche une pro ie . Lors d 'une seule part ie de chasse, le chasseur p a r c o u r t d 'ord ina i re entre d i x et quarante ki lomètres. La savane claire de la région étudiée f o r m e u n ter ra in d i f f i c i l e à escalader, val lonné, c a i l l o u teux et rocheux, parsemé d'obstacles divers. Tous ces facteurs c o m p l i q u e n t la progression en brousse, et plus part icul ièrement la chasse n o c t u r n e . I l paraît d o n c évident que, sa grande résistance à la fatigue mise à par t , la toute première qualité d u chasseur consiste en une technique de marche spécifique.
La sortie en brousse débute d 'ordina i re par une marche très rapide q u i permet de s'éloigner de la zone habitée et d 'a t te indre la zone choisie. Là, le chasseur recherche le gibier. Cette phase nécessite une technique corporel le particulière, c u l m i n a n t dans la phase d 'approche d u gibier. Le re tour de la chasse s'apparente davantage à l 'étape préliminaire.
La recherche et l 'approche d u gibier méri tent part icul ièrement notre a t t e n t i o n , en t a n t que réalisations idéales de Vhabitus cynégétique. Cette phase présente une marche très p r u dente et légère, appelée en mal inké jWyWi , que l ' o n p o u r r a i t transcrire par « marcher à petits pas, approcher » 5 . El le possède u n n o m b r e de paramètres techniques propres, p a r m i lesquels nous soulignerons le travai l des pieds et de la co lonne vertébrale, l ' emplacement d u centre de gravité et les p o i n t s d ' a p p u i au sol, la c o o r d i n a t i o n générale et la vitesse des m o u v e m e n t s , ainsi q u ' u n m a i n t i e n par t icul ier de l 'équilibre. Décr ivons br ièvement tous ces paramètres.
O n p o u r r a i t d i re , paraphrasant la célèbre f o r m u l a t i o n de M a r c e l Mauss 6 , que le p i e d est le premier des i n s t r u m e n t s d u chasseur. C o n s é q u e n c e des caractéristiques physiques
3. Plus exactement mimesis, un te rme qu i renvoie aux études de JOUSSE ( 1 9 7 4 ) et deTAUssiG ( 1 9 9 3 ) . 4 . Û S S É 1 9 9 4 .
5. BAILLEUL 2000, p. 493.
6. MAUSS 1 9 5 0 , p. 1 1 .
Agnès KEDZIERSKA 4
mite pendant cer-
• chasseurs d u r a n t
Dule le j o u r o u la
chasse fa i t l 'ob jet
riée d ' u n enseigne-
corporelle cynégé-
: si chasse, n'est pas
Bixmture i n d i s p e n -
en d ' u n équilibre
seconde, p o u r des
BC et de médiat ion
it t o u t caractérisé
l i sa t ion p o l i t i q u e
er nécessite une
nce de la figure
i t se réduire à la
ucnmé jula, ce que
En effet, l 'activité
: r r o i e . Lors d 'une
zze ki lomètres. La
vallonné, c a i l l o u -
i t la progression
évident que, sa
: consiste en
L permet de s'éloi-
berche le gibier.
; la phase d 'ap-
c préliminaire.
: E t e n t i o n , en tant
; marche très p r u -
marcher à petits
s. p a r m i lesquels
ement d u centre
r ies m o u v e m e n t s ,
• ces paramètres.
* 6 , que le p i e d
iques physiques
1993).
d u terra in , i l f aut y v o i r aussi le résultat des exigences inhérentes à t o u t e activité cynégétique : une progression rapide, silencieuse, d o n t le r y t h m e d o i t p o u v o i r être modif ié à t o u t instant . A i n s i , le chasseur peut être a m e n é à s ' immobi l i ser sur une seule j ambe , en équil ibre sur une pierre instable. U n e surface très l imitée de son p i e d , d 'ord ina i re la plante , d o i t supporter son poids ainsi que celui de son équipement : fus i l et gibecière. I l est d o n c naturel que son p i e d reste flexible, ex t rêmement sensible, c o m m e s'il s 'agrippait au sol.
Puisque le chasseur risque de heurte * les ca i l loux et les branches q u i parsèment le sol, i l progresse en préservant une grande a m p l i t u d e verticale des pas. E n revanche, leur a m p l i t u d e hor izonta le paraît réduite au m i n i m u m . E n effet, l 'éventuel c h e m i n , s'il existe, n est qu 'une piste étroite. La tai l le d ' u n pas, elle, peut être assez i m p o r t a n t e , p e r m e t t a n t d avancer plus rap idement . A u cours de l 'approche, le chasseur peut aussi s'accroupir, s'agenouiller o u ramper, c o m m e décri t 7 dans la littérature orale 8 .
M ê m e si dans cette phase, le chasseur peut parfois c o u r i r en p o u r s u i v a n t une pro ie , aénéralement, sa progression d o n n e une impress ion de ra lent i , conséquence , entre autres, de la fréquence re lat ivement faible des pas, de leur grande a m p l i t u d e verticale, ainsi que de la légèreté des appuis au sol. Le poids d u corps ne d o i t jamais être lâché brusquem e n t n i au hasard, i l reste tou jours soigneusement contrôlé , re tenu avant d'être déposé. Cette technique nécessite des qualités de maîtrise et de c o o r d i n a t i o n (complémentar i té des direct ions des m o u v e m e n t s et des posi t ions de toutes les parties d u corps, q u i , ainsi , se contrebalancent) . C o m m e n t le chasseur p a r v i e n t - i l à ce résultat?
Cette quest ion nous renvoie au rôle de la co lonne vertébrale, f o n d a m e n t a l d u p o i n t de vue des M a l i n k é . « Pour les Bambara et les M a l i n k é , la co lonne vertébrale, à laquelle se f ixent et autour de laquelle gravi tent les autres composants d u corps, est le s u p p o r t et l'axe à la fois b i o l o g i q u e et o n t o l o g i q u e de la personne. Lorsque la co lonne vertébrale est affectée, c'est t o u t l'être q u i est touché au plus p r o f o n d de lu i -même, et à t o u t e déviation de la colonne vertébrale correspond une déviation psychologique et sexuelle » 9 . Le maître-chasseur d o i t , par définit ion, être celui d o n t l'axe existentiel f o n c t i o n n e par fa i tement b i e n . Laissant de côté la d i m e n s i o n s y m b o l i q u e de la c i t a t i o n précédente, o n d o i t c o n f i r m e r sur le p l a n p u r e m e n t physique la prédominance d u rôle de la co lonne vertébrale. El le sert de base à toute i m p u l s i o n m o t r i c e . Lors de la progression en brousse, les muscles a b d o m i naux d u chasseur travai l lent , mais la plus for te tension s'établit dans le dos en dessous de la tai l le . Le m i l i e u de la co lonne vertébrale p e u t être d r o i t o u courbé , pro longeant ainsi la l igne d u bas. Par ailleurs, la p o s i t i o n souvent légèrement courbée, devient très naturel le à p a r t i r d u m o m e n t où le fus i l est intégré.
I l reste à préciser quelle part ie de la co lonne vertébrale j o u e u n rôle essentiel dans la technique cynégétique. Selon les spécialistes des techniques d u corps, la n o t i o n f o n d a mentale d'équilibre renvoie i m m é d i a t e m e n t à une autre, t o u t aussi capitale : le centre de gravité, d o n t la p o s i t i o n assure la balance d u corps en contrôlant le poids . Le chasseur semble ainsi retenir précieusement son poids à l ' intérieur de son corps. A i n s i , la tens ion s'établissant dans la part ie l o m b a i r e d u dos (charnière sacro-lombaire) i n d i q u e l 'emplacem e n t exact de son centre de gravité et de son p o i n t d'équilibre.
7. De manière esthétisée mais plus exacte que l'on pourrait le supposer. 8. « Le chasseur"se recroquevi l le et s'allonge c o m m e un" [ . . . ] , " s 'accroup i t c o m m e un crapaud dans la d o u -
chière", "il lève la tête c o m m e un crocodi le dans l'eau", [...] il vise "en faisant de son œil crépuscule'* (DÉRIVE, DUMESTRE, éds, 1999, p. 44).
9 . CISSÉ 1973, p. 153.
Habitus du chasseur, le cas malinké
I l semble intéressant de noter que la n o t i o n de centre de gravité renvoie, en mal inké , aux n o t i o n s d'équilibre et d'énergie, indissociables selon les considérations locales. E n fa i t , le m o t « équilibre », correspond à ba sigi q u i signifie « asseoir o u poser l 'énergie » o u hakili sigi, l i t téralement « asseoir o u poser la conscience » 1 0 . L'équilibre phys ique est plus exactement évoqué par l 'expression hakili ma sigi: « asseoir l'aspect physique de la personne » tandis que hakili ba sigi se réfère davantage à l 'équilibre m e n t a l , à la concentra t ion psychique de l ' i n d i v i d u . Selon les chasseurs, avoir « la conscience et l 'énergie posées » const i tue la c o n d i t i o n sine qua non de la réussite de l 'activité cynégétique. A i n s i , l 'équilibre corpore l est considéré n o n seulement c o m m e issu d ' u n l o n g entra înement mais avant t o u t c o m m e le résultat de la c o n c e n t r a t i o n psychique. La technique corporel le semble i c i parallèle à u n état m e n t a l donné , q u i est a t te int au m o m e n t d u départ.
L a d i s t i n c t i o n entre l 'équilibre physique et m e n t a l ne paraît d o n c pas décisive aux yeux des Mal inké , q u i considèrent q u ' i l s'agit plutôt des deux facettes d ' u n m ê m e p h é n o m è n e : l 'équilibre cosmique de l 'univers . L a gestion de cet équilibre s'appuie sur une « théorie énergétique » c o m m e l 'appelle Jean-Paul C o l l e y n " , q u i f o n d e la cosmogonie et la pensée religieuse m a n d e . D e ce fa i t , la maîtrise de soi et le m a i n t i e n de l 'équilibre i n d i v i d u e l , social et universel , très i m p o r t a n t s p o u r la pra t ique et la t r a d i t i o n de chasse, incarnent aussi des valeurs fondamentales p o u r l 'ensemble de la cu l ture mal inké .
V I S I O N
La maîtrise d 'une technique de marche particulière, demeure à la fois nécessaire et n o n suffisante p o u r garantir , seule, l 'efficacité de la chasse. Elle f o r m e u n préliminaire q u i d o i t être complété par une technique spécifique in tervenant au niveau d u regard, m ê m e si la percept ion d u chasseur ne se réduit pas à la v i s i o n . C o m p t e t e n u des aspects de mobi l i té permanente et d ' a t t e n t i o n focalisée déjà évoqués, o n peut admettre que les schémas perceptifs en j e u m o b i l i s e n t autant la v i s i o n que l 'ouïe, ainsi que le sens p r o p r i o c e p t i f et k iné-sique. Si l ' o n peut reconnaître, preuves pratiques à l ' a p p u i , l ' i m p o r t a n c e d 'une percept ion organique indépendante de la vue, ce sens demeure capital p o u r le chasseur mal inké . I l convient d o n c d'analyser l 'activité spécifique de la tête et des yeux, ainsi que la reconnaissance des formes sous lesquelles apparaissent les a n i m a u x .
L a tête d u chasseur demeure a u t o n o m e par r a p p o r t au reste d u corps, en effectuant des m o u v e m e n t s latéraux de grande a m p l i t u d e , mais aussi en osci l lant sur u n axe vert ical si nécessaire. L a fréquence des m o u v e m e n t s reste élevée tant qu 'aucune proie n'est perçue, puis la tête s ' immobi l i se .
Les yeux d u chasseur adoptent généralement la m ê m e d i r e c t i o n que sa tête. Dans le cas de la chasse n o c t u r n e contempora ine , le chasseur guette la f o r m e animale dans le faisceau d 'une lumière électrique. I l s'agit d 'une torche légère en a l u m i n i u m o u en plastique, chargée avec trois piles et retenue par des élastiques et des cordelettes sur le b o n n e t d u chasseur 1 2 . Les m o u v e m e n t s de la tête et des yeux co ïnc ident de manière naturel le avec les déplacements de cette lumière.
1 0 . Le m o t hakili possède de nombreuses significations. Selon le dict ionnai re de Bailleul, il renvoie à a not ion d'esprit, de mémoire, d' intel l igence et de sagesse. Selon un usage courant , il peut aussi indiqiyef une compétence techn ique, la conscience et la compréhension.
1 1 . COLEEYN2004.
12 . Dans le passé, avant la popular isat ion sur le terrain des torches électriques, le chasseur fabr iquait une lampe à huile.
Agnès KEDZIERSKA 49
. en mal inké, , locales. E n
: i énergie » o u sique est plus
«eue de la per-i o ) n c e n t r a t i o n
;ie posées » A i n s i , l 'équili-
nt mais avant lie semble ic i
sive aux yeux : phénomène : une « théorie ' : et la pensée
i n d i v i d u e l , incarnent
saire et n o n i re q u i d o i t m ê m e si la
, de mobi l i té i schémas per-
ept i f et k iné-: zme percept ion
malinké. I l : la reconnais-
effectuant des
i axe vert ical si
• n'est perçue,
a tête. Dans le Lie dans le fais-
t J U en plastique, le b o n n e t d u j re l le avec les
a i e , il renvoie à la t r e - t aussi indiquer
i . ' fabr iquait une
N é a n m o i n s , i l serait p r o b a b l e m e n t plus exact d 'admettre que le chasseur scrute a t tent ivement et r a p i d e m e n t t o u t l'espace accessible à sa vue , procédant par de peti ts coups d oeil ex t rêmement f u r t i f s et épars. A i n s i , les yeux exercent u n n o m b r e très i m p o r t a n t de minuscules m o u v e m e n t s q u i ne dessinent n i des lignes, n i des courbes assimilables à une organisat ion spatiale géométr ique, et semblent très adaptés aux exigences cynégétiques. Le b u t d u chasseur reste de c o u v r i r d u regard une large zone. A p a r t i r d u m o m e n t où le gibier est détecté, i l ne le q u i t t e plus des yeux. L' image, au début incertaine et floue, se précise avec la réduction de la distance entre le chasseur et sa pro ie .
Les qualités perceptives d u chasseur sont d 'autant plus impératives q u ' i l ne perçoit que rarement, en brousse, u n a n i m a l entier et i m m o b i l e . I l l u i est possible d'apercevoir u n f ragment de fourrure peu dissociable de la texture végétale l ' e n v i r o n n a n t , une part ie d u corps, u n m o u v e m e n t fugace et s u b t i l d u gibier. La difficulté augmente lors de la chasse nocturne , où la torche f ronta le ne p e u t laisser percevoir que des formes partielles, déformées et d i f f i c i l e m e n t associables à l ' image mentale stéréotypée d ' u n a n i m a l . C o m m e n t le chasseur p e u t - i l alors reconnaître que l 'ob jet perçu n'est n i une pierre n i une plante mais ie gibier recherché ?
E n fa i t , la percept ion débute par la détect ion d ' u n signal à l ' intérieur d u c h a m p visuel . Sa f o r m e , sa couleur et sa tail le sont identifiées, p e r m e t t a n t ainsi sa déterminat ion soit en « cible » d igne d ' a t t e n t i o n soit en « leurre » devant rester ignoré. V i e n t ensuite l ' i n t e r prétation consciente et sémantique de l 'ob jet . Le chasseur, t o u t au l o n g de sa pra t ique , mémorise et stocke les souvenirs perceptifs p e r m e t t a n t l 'élaboration d ' u n « fichier » correspondant aux a n i m a u x . I l rattache ainsi la f o r m e perçue à la représentation cogni t ive l u i correspondant. M ê m e en disposant de représentations extrêmement élaborées, i l n'est pas toujours apte à i d e n t i f i e r ins tantanément l 'espèce.
Dans la littérature orale, o n retrouve la difficulté de cet acte de reconnaissance à travers 'JL métaphore de la métamorphose . Selon la t r a d i t i o n , le gibier, p o u r t r o m p e r le chasseur, peut se t ransformer en revêtant épisodiquement une f o r m e di f férente 1 3 . La m ê m e faculté de t r a n s f o r m a t i o n reste également l'apanage des grands maîtres chasseurs q u i , lors de '. approche o u d u c o m b a t avec l ' a n i m a l , peuvent se rendre invisibles. I l semble, en l 'occurrence, q u ' i l fail le considérer des métamorphoses de différents types et n o n u n p h é n o m è n e u n i q u e et hétérogène. E n brousse, dans la phase d 'approche o u d ' o p p o s i t i o n , tantôt le gibier, tantôt le chasseur, o u les deux à la fois, m o d i f i e n t leur apparence af in de désorienter o u de t r o m p e r l'adversaire. La métamorphose au m o m e n t d u c o m b a t semble s'opérer, d'après les données ethnographiques d u ter ra in , à l 'aide d ' u n fétiche dibilan « obscurité, ténèbres » q u i , c o m m e son n o m l ' i n d i q u e , fa i t s'élever u n r ideau imaginaire d i s s i m u l a n t son uti l isateur. A i n s i , son détenteur remplace son apparence habi tuel le par le v i d e , le no i r , ie non-être q u i peut t o u t de m ê m e être figuré dans certains récits. Cela suggère que la technique de la métamorphose ne consisterait pas tant en une m o d i f i c a t i o n véritable d u corps qu 'en une sorte d'altération de la percept ion de celui q u i regarde.
Le p r i n c i p e des subst i tut ions d'images semble c o n n u et f o n d a m e n t a l p o u r toute ac t ion magique. M i c h a e l Tauss ig 1 4 le considère m ê m e c o m m e le mécanisme p r o f o n d de l 'effica-ciré s y m b o l i q u e dans le sens où la création et l ' ac t ion effectuées sur une image, considérée c o m m e une copie et d o n c u n d o u b l e , p e r m e t t e n t d 'entrer en contact et d ' inf luencer
"3. ^es exemples sont extrêmement nombreux , parmi les plus célèbres, la métamorphose de la fe^ buff le dans lépopée de Soundiata. Voir également : BRAQUESSAC 1 9 9 8 ; CAMARA 1981,1982: K:_ 1 9 9 4 .
14. TJUSSIG 1 9 9 3 .
50 Habitus du chasseur, le cas malinké
l ' o r i g i n a l de l ' image. A i n s i , m ê m e si dans sa qualité d'artefact, elle demeure différente,
l ' image-copie devient opérante . Dans cette o p t i q u e , i l semble hasardeux d'opposer repré
sentat ion fictive et représentation réelle. L a seule d i s t i n c t i o n possible se résume à celle q u i
différencie plusieurs images que l ' o n p e u t juxtaposer o u substi tuer les unes aux autres.
Dans not re cas précis, t o u t se passe c o m m e si l ' image p r o d u i t e par le gibier se subst i tuai t
dans la percept ion d u chasseur à l ' image physique d u gibier.
L a métamorphose peut être interprétée c o m m e une faute de reconnaissance, u n rat
tachement erroné de l ' image perçue à u n modèle q u i ne l u i correspond pas, une erreur
d ' i d e n t i f i c a t i o n , en quelque sorte. Pour u n chasseur, cette erreur peut être lourde de consé
quences (échec de la chasse, mise en danger d u chasseur. . .) et i l demeure d o n c essentiel
de l'éviter. C o m m e le résume C a r o l i n e Braquessac 1 5 , le chasseur « d o i t faire preuve de
clairvoyance c'est-à-dire v o i r ce q u i se cache derrière les apparences d ' u n corps p o u r diffé
rencier l'être h u m a i n de l ' a n i m a l , dans u n univers M a n d e n k a où t o u t est sujet à la méta
m o r p h o s e ». I l d o i t d o n c avoir une v i s i o n juste des choses, ce q u i représente u n enjeu v i t a l
et relève aussi d ' u n postulat d 'ordre p h i l o s o p h i q u e .
Lors de la chasse, la quest ion ne se l i m i t e pas, en effet, à la s imple i d e n t i f i c a t i o n des
formes . C o m m e le suggèrent les leçons de K o m o 1 6 , cette nécessité relève d 'une v i s i o n
d u m o n d e considéré c o m m e une i l l u s i o n : « L'univers [la vie] est u n leurre de s o i - m ê m e
et u n leurre de nous-mêmes [et par n o u s - m ê m e s ; u n leurre co l l ec t i f ] ». T o u t se passe
d o n c c o m m e si, dans la c o n c e p t i o n de l 'univers mal inké, en brousse, mais également au
q u o t i d i e n , les apparences étaient souvent trompeuses, d'où la difficulté à reconnaître la
vérité. Seule la c o n t e m p l a t i o n de la v i s i o n p e u t permet t re alors au chasseur de dis t inguer
la vérité de l 'apparence. C o m m e le résume Sory C a m a r a 1 7 : « C o n t e m p l e r la v i s i o n s i g n i
fie n o n la percept ion , s ignif ie avoir la lumière q u i révèle au-delà des choses, c o m m e par
transparence, l'essence des choses ». Cette c o n t e m p l a t i o n s'exerce lors des festivités de la
confrérie. A i n s i la danse, la parole chantée et la mus ique f o n d e n t et c o n d i t i o n n e n t les
schémas cogni t i f s perceptifs et assurent en per fec t ionnant la v i s i o n d u chasseur, la réussite
de l 'entreprise cynégétique.
ASCÈSE
Pour aborder les schémas cogni t i f s cynégétiques, i l nous semble indispensable de situer
le c o m p o r t e m e n t d u chasseur en brousse dans le contexte plus large de la gestion générale
de son organisme. Les récits de chasse et le discours popula i re le présentent c o m m e apte
à des efforts presque surhumains , p o u v a n t assumer une fat igue i m p o r t a n t e , une p r i v a t i o n
prolongée d'eau, d 'a l iments et de s o m m e i l . Puisqu ' i l accepte de q u i t t e r le c o n f o r t d u foyer
p o u r la so l i tude de la brousse, o n l u i a t t r ibue également la v e r t u de sacrifier ses plaisirs
personnels aux exigences de la chasse. A i n s i , son a t t i tude générale, au m o i n s dans l'idéal,
p o u r r a i t être qualifiée d 'ascét ique 1 8 . E x a m i n o n s de plus près les différents types de p r i v a
t ions corporelles d o n t i l est c o u t u m i e r .
La première consiste en une déshydratation régulière. G é n é r a l e m e n t , le chasseur
absorbe une i m p o r t a n t e quant i té d'eau juste avant et i m m é d i a t e m e n t après son expédi
t i o n . M a i s en brousse, i l ne dispose d 'aucune réserve et endure la so i f p e n d a n t de longues
15 . BRAQUESSAC 1 9 9 8 , p. 1 4 .
16. DIETERLEN, CISSÉ 1 9 7 2 , p. 2 6 4 .
17. CAMARA 2 0 0 1 , p. 7 7 .
18. TRAORÉ 2 0 0 0 , p. 9 4 .
Agnès KEDZIERSKA 51
re différente, i opposer repré-
ae à celle q u i aux autres.
• se subst i tuai t
rice, u n ratissas, une erreur
l e de consé-: donc essentiel
lŒue preuve de ; p o u r diffé-
et à la méta -: an enjeu v i t a l
Scation des d'une v i s i o n
: de so i -même Tout se passe
i p a i e m e n t au î reconnaître la r i e dis t inguer
L vision s i g n i -. c o m m e par
•virés de la aonnent les
, la réussite
: p r i v a t i o n
: d u foyer
ses plaisirs
l i a n s l'idéal,
; de pr iva -
£ chasseur
i am expédi-
: de longues
rsrures de marche. Parfois, en saison sèche, lorsque les températures at te ignent souvent puarante degrés à l ' o m b r e , i l se m u n i t d 'une pet i te gourde d'eau. N é a n m o i n s , i l semble rsrdent que cette m i n u s c u l e quanti té n'est n u l l e m e n t suffisante p o u r désaltérer u n orga--isanr l o n g u e m e n t et in tensément sollicité.
La p r i v a t i o n existe aussi p o u r la n o u r r i t u r e , car le chasseur n 'empor te aucune col la-r o n . quelle que soit la durée présumée de son expédit ion. S ' i l par t à la chasse à l 'aube, le r œ t - d é j e u n e r est c o n s o m m é avant son départ. A v a n t une chasse n o c t u r n e , i l par t i c ipe i a c o l l a t i o n d u soir, au crépuscule. E n brousse, i l peut éventuel lement c o n s o m m e r des r u i t s sauvages o u , après avoir tué u n gibier i m p o r t a n t , gr i l ler u n foie et le c o n s o m m e r sur r - .K~f. C o m p t e t e n u de fortes dépenses énergétiques, ces médiocres apports ne peuvent pue nuancer l 'état de jeûne q u i demeure une conséquence des circonstances pratiques 3 : la chasse et de la vie au vil lage mais aussi des schémas cogni t i f s nécessaires à l 'entreprise cynégétique. L'idée de prêter a t t e n t i o n aux besoins immédiats et al imentaires sem-T L C inconci l iable avec l 'état de c o n c e n t r a t i o n hakili ba sigi, déjà m e n t i o n n é , q u i d o i t être — l i n r e n n p o u r assurer l 'efficacité de la chasse.
L ne autre p r i v a t i o n concerne le temps de s o m m e i l . Elle reste part icul ièrement s i g n i f i -cznve au m o m e n t des travaux agraires où la chasse n o c t u r n e t e n d à supplanter les expédit ions diurnes . Le chasseur passe la n u i t en brousse, retrouve le vil lage à l 'aube et s'y res-ripire rap idement avant de regagner les champs. Le temps de repos est alors p u r e m e n t et spnplement supprimé. M ê m e s'il peut l i m i t e r son expédition à quelques heures en début :>p en fin de n u i t , le r y t h m e b i o l o g i q u e d u chasseur se t rouve désormais altéré par r a p p o r t
i celui des villageois. O n p e u t supposer que la m o d i f i c a t i o n d u b i o r y t h m e (circadien, pprïadien et u l t radien) a des conséquences sur l 'équilibre n e u r o b i o l o g i q u e cérébral et d o n c spr la c o g n i t i o n d u chasseur.
La réduction de la durée de s o m m e i l d u chasseur d o i t également inf luencer les p r o priétés de son repos. M a n q u a n t de s o m m e i l , le chasseur p e u t s ' endormir n ' i m p o r t e où, - i m p o r t e q u a n d et n ' i m p o r t e c o m m e n t . I l effectue des cycles de s o m m e i l très brefs, et . on peut évoquer u n s o m m e i l d i s c o n t i n u , faisant alterner r a p i d e m e n t veil le et endormissement. Ce r y t h m e permet , paraît-il , une mei l leure connaissance des rêves puisque la m u l t i p l i c a t i o n des réveils faci l i te leur mémorisat ion progressive. É tant d o n n é l 'extrême _ppportance accordée aux rêves chez les Mal inké , i l ne serait guère surprenant que les g r o u pes supposés les maîtriser (chasseurs, féticheurs, devins, tous possédant le statut l i m i n a i r e ) pra t iquent u n certain type de s o m m e i l p e r m e t t a n t de m i e u x les mémoriser .
U n autre é lément de l'ascèse cynégétique est d 'ordre sexuel. L'adultère incarne l 'une P S plus graves fautes q u ' u n m e m b r e de la confrérie des chasseurs puisse c o m m e t t r e 1 9 . Mais la cont ingence sexuelle ne se l i m i t e pas à l ' i n t e r d i c t i o n des liaisons socialement désapprouvées et s'entend également à la réduction et à la gestion stricte des rapports que J Î chasseur entret ient avec ses épouses légitimes. O n p o u r r a i t d o n c rappeler i c i la f o r m u l e PJÎ Sory C a m a r a 2 0 , selon laquelle le chasseur « sacrifie son épanouissement sexuel à son arcomplissement cynégétique ».
D ' u n e manière générale l'acte sexuel se t rouve chez les M a l i n k é prohibé dans toutes les circonstances liées à la ritualité, dans les périodes que l ' o n peut qual i f ier de l imina i res . Par es dernier terme, défini par V i c t o r T u r n e r 1 , o n e n t e n d u n m o m e n t (une phase, u n l i eu , prie personne, une activité) intermédiaire et passager, relevant à la fois d 'univers (brousse/
-9. -!=awœ 2 0 0 1 ; CISSÉ 1 9 9 4 .
2a C-MARA 1 9 8 2 , p. 2 0 7 .
21. "-SNER 1 9 9 0 .
Habitus du chasseur, le cas malinké
village ; mythique/réel) et de statuts sociaux différents (adulte/enfant) . I c i , les pratiques de
vénération des fétiches, de thérapie herboriste t r a d i t i o n n e l l e o u de préparation des objets
rituels semblent b ien correspondre aux critères de la « l iminarité ». Joseph H e l l w e g 2 2 juge
aussi la p o s i t i o n et l 'activité des chasseurs c o m m e l imina i res . T o u t semble i n d i q u e r que
cette sphère entraîne o b l i g a t o i r e m e n t la r u p t u r e avec les obl igat ions et les plaisirs de la
vie courante .
M a i s i l semble i m p o r t a n t d 'a jouter que la gest ion stricte de la sexualité reste i n t i m e
m e n t liée à la c o n c e p t i o n énergétique de l 'univers mal inké : en dehors des appréciations
sociales et morales de la re la t ion entre h o m m e s et femmes t o u t acte sexuel semble a f fa ib l i r
l ' h o m m e et réduire ses forces v i ta les 2 3 . O n évoque là une perte d'énergie, u n anéantis
sement des forces propres à l ' h o m m e o u acquises par la magie. Ce gaspillage, c o m m e
une c o n c e n t r a t i o n insuffisante due à des pensées n o n maîtrisées ( a l i m e n t a t i o n , vie v i l l a
geoise . . . ) , semble, selon les chasseurs, causer une d i m i n u t i o n des ressources et n u i r e au
niveau d ' a t t e n t i o n d u chasseur en brousse.
* * *
A i n s i , la maîtrise et l 'équilibre corporels sont perçus par les M a l i n k é c o m m e la conséquence directe de la c o n c e n t r a t i o n mentale . L'apprentissage de la chasse ne se l i m i t e d o n c jamais à u n s imple entra înement physique et semble reposer davantage sur l ' acquis i t ion d 'une a t t i tude mentale . Caractérisée c o m m e une condensat ion de l 'énergie mentale {hakili ha sigi), cette dernière consisterait en une sorte d'ascèse mentale , m e t t a n t t e m p o r a i r e m e n t de côté toutes les préoccupations quot id iennes p o u r parvenir à l'état de « l 'esprit v i d e », p e r m e t t a n t au corps d'agir efficacement en dessous d u seuil de l'analyse intel lectuel le . C o m m e le remarque avec une grande justesse Sory C a m a r a 2 4 : « l 'activité cynégétique i m p l i q u e une ascèse en ce sens q u ' i l faut n o n seulement q u i t t e r le vil lage, mais q u ' i l faut essayer d'extraire de sa pensée t o u t ce q u i se passe au vil lage. [ . . . ] C'est faire le v ide de toutes les préoccupations villageoises [ . . . ] p o u r se concentrer u n i q u e m e n t sur le gibier. M a i s le gibier sur lequel i l se concentre c'est, en fa i t , une absence d u gibier en ce sens q u ' i l n ' imagine a u c u n gibier nul le part , et c'est b i e n p o u r cela, sans q u ' i l fasse a t t e n t i o n , que q u a n d surgi t le gibier, i l le v o i t . [ . . . ] C'est dire que la c o n c e n t r a t i o n i m p l i q u e q u ' o n ne pense m ê m e pas à la c o n c e n t r a t i o n ; q u ' o n fasse le v ide absolu ».
T o u t converge d o n c p o u r admettre que les pr ivat ions et le b i o r y t h m e altéré d u chasseur, t o u t c o m m e sa préparation mentale vo lonta i re , le m e t t e n t dans u n état m e n t a l part icul ier , métaphor iquement appelé « le v ide m e n t a l », nécessaire à l'exercice de la chasse. A u t r e m e n t d i t , l ' i n h i b i t i o n des schémas corporels ordinaires , le recours à des techniques corporelles spécifiques, l 'élaboration de schémas perceptifs spécialisés et une gestion de l 'organisme déficitaire, associés à une f o r m e d'ascèse mentale , cons t i tuent d o n c les facteurs q u i p e r m e t t e n t en définitive au chasseur de préserver le m a x i m u m de vigi lance et de capacités physiques, q u i rendent possible son a p p l i c a t i o n pra t ique . Cec i c o n f i r m e nos hypothèses a d m e t t a n t une for te corrélation entre les schémas moteurs , perceptifs et cogni t i f s et la spécificité intrinsèque de l 'habi tus cynégétique.
22. HELLWEG 2 0 0 1 .
23. DUMESTRE, TOURÉ 1 9 9 8 ; BRETT-SMITH 1 9 9 4 .
24. CAMARA 2 0 0 1 , pp . 1 1 9 - 1 2 0 .
Agnès KEDZIERSKA 53
be/enfant) . I c i , les pratiques de
le o u de préparation des objets
narité ». Joseph H e l l w e g 2 2 juge
tes. T o u t semble i n d i q u e r que
«bligations et les plaisirs de la
: de la sexualité reste i n t i m e -
: en dehors des appréciations
u t acte sexuel semble af fa ib l i r
\e d'énergie, u n anéantis-
gie. C e gaspillage, c o m m e
ées ( a l i m e n t a t i o n , vie v i l l a -
on des ressources et n u i r e au
. Mal inké c o m m e la consé-
: la chasse ne se l i m i t e d o n c
: davantage sur l ' acquis i t ion
[ de l 'énergie mentale {hakili
e. m e t t a n t t e m p o r a i r e m e n t
: a l'état de « l 'esprit v ide »,
de l'analyse intel lectuel le .
r + : « l 'activité cynégétique
• le vil lage, mais q u ' i l faut
C'est faire le v ide de
; u n i q u e m e n t sur le gibier.
: d u gibier en ce sens q u ' i l
i qu ' i l fasse a t t e n t i o n , que
ation i m p l i q u e q u ' o n ne
l ïsîorythme altéré d u chas-
[ dans u n état m e n t a l par-
; à l'exercice de la chasse.
: recours à des techniques
lises et une gestion de
^constituent d o n c les fac-
: m a x i m u m de vigi lance
[prat ique. Cec i c o n f i r m e
moteurs , perceptifs et
N é a n m o i n s , i l semble i m p o r t a n t d 'a jouter une précision concernant le véritable
; . : a r e n u de « l 'esprit v ide » d u chasseur. Sans contredire la descr ipt ion ci-dessus, nos expé-
-.erices d u terra in suggèrent de concevoir le chasseur m o i n s c o m m e q u e l q u ' u n q u i ne
zvnse à r ien que c o m m e q u e l q u ' u n q u i s'efforce de se concentrer. E n effet, selon les p r o -
r o î des chasseurs, au m o m e n t où la proie est détectée, l 'esprit d u chasseur est to ta lement
perniné par le seul o b j e c t i f de tuer le gibier. La p u l s i o n de prédation, plus for te que t o u t
LPtre affect o u é m o t i o n , semblerait occuper t o u t son espace m e n t a l . La prédation, p u l s i o n
agressive canalisant socialement la violence, reste selon nous, sur le p l a n émot ionne l , m û
r i e m e n t liée à la sensation de jouissance, d 'enthousiasme et d'effervescence.
Bibliographie
r>-rU-£UL C. (2000), Dictionnaire bambara-français, Bamako, Éditions Donniya. r>; VUDIEU P. (1980), Le Sens pratique, Paris, Les éditions de M i n u i t . p « J I Q L E S S A C C. (1998), Le chasseur et le berger : essai sur le rapport entre l'homme et le milieu naturel
dans la littérature orale Mandenka, DEA, Bordeaux. P4ZTT-SMITH S. C. (1994), The making Bamana sculpture: Creativity and Gender, Cambridge,
Cambridge University Press.
_»_MARA S. (1981), Paroles de nuit ou: L'univers imaginaire des relations familiales chez les Mandenka, Thèse de Doctorat de l'Université de Lille.
_'_WARA S. (1982), Paroles très anciennes ou le Mythe de l'accomplissement de l'homme, Grenoble, Pensée Sauvage.
_».MARA S. (2001), « Cynégétique et traversée de l'existence », i n La Chasse traditionnelle en Afrique s* l'Ouest d'hier à aujourd'hui, Actes d u Colloque Internationa] de Bamako, 26-27-28 janvier 2001, Bamako, Ministère de la Culture du M a l i , pp. 75-124.
_PSSÉ Y. T. (1973), « Signes graphiques, représentations, concepts et tests relatifs à la personne chez .es Malinké et Bambara d u M a l i », i n La Notion de personne en Afrique Noire, Paris, Éditions du C N R S .
_S5É Y. T . (1994), La Confrérie des chasseurs malinké et bambara: mythes, rites et récits initiatiques, îvry-sur-Seine, Nouvelle Editions du Sud, Paris, A C C T .
I . r u j t Y N J.-P. (2004), « L'alliance, le dieu, l'objet », L'Homme, 170.
-TTTERLEN G. , CissÉ Y. T . (1972), Les Fondements de la société d'initiation du Komo, La Haye-Paris, Mouton & Co et EPHE.
_>/MESTRE G. , TOURÉ S. (1998), Chroniques amoureuses au Mali, Paris, Karthala.
- - ; i \ T E G J . (2001), The Mande Hunters' Movement of Côte d'Ivoire: Ritual, Ethics, and Performance :i the Transformation of Civil Society, 1990-1997, P H . D . Dissertation, University o f Virginia.
CCSSE M . (1974), L'Anthropologie du geste, Paris, Gallimard.
-•Lr-iTATE A. , ARBERSOLD D . , KEÏTA D . (1994), Manden Bori Fasa: Récits de chasse recueillis auprès de ?ert Kolon Kulibali, séréwa de Baro, Conacry, Bibliothèque franco-guinéenne.
>s M . (1950), Sociologie et anthropologie, Paris, PUE
_C"SSIG M . (1993), Mimesis and Alterity: A Particular History ofthe Sensés, Routlege, New York/ Londres, Chapman and H i l l .
.iMDRÉ K. (2000), Le Jeu et le sérieux: essai d'anthropologie littéraire sur la poésie épique des chasseurs •izi Mandé (Afrique de l'Ouest), Cologne, Riidiger Kôppe Verlag.
--TtNER V. (1990), Le Phénomène rituel : structure et contre-structure, Paris, PUE