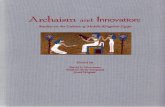Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais du XVIe siècle
Transcript of Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais du XVIe siècle
Collectanea Islamica
ISBN 978-88-548-5668-4 – DOI 10.4399/97888548566844
pp. 45-70 (novembre 2012)
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais du XVI
e siècle
Rémi Dewière
(CEMAf, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Introduction
Les royaumes musulmans d’Afrique subsaharienne ont très tôt partici-
pé à la culture du manuscrit et du livre en écriture arabe. Dès le XIIIe
siècle, des indices laissent entrevoir un usage de l’écrit développé en
Afrique de l’Ouest mais également dans le bassin du lac Tchad, no-
tamment au Nord de l’actuel Nigeria. À l’Ouest du lac Tchad la ville
de Birni Ngazargamu, capitale du sultanat du Borno, rayonne particu-
lièrement sous la dynastie Kanuri des Sefuwa (IIe-XIII
e/XI
e-XIX
e
siècles). Elle est un centre de production de l’écrit important.1 Mal-
heureusement, les traces matérielles de cette culture sont rares, voire
quasi inexistantes jusqu’au XIXe siècle.
L’expédition britannique de 1849-1854, menée initialement par
James Richardson, permet à Heinrich Barth de recueillir plusieurs
textes soudanais sur l’histoire moderne de l’Afrique de l’Ouest,
comme la chronique du XVIIIe siècle le Tārīḫ al-Sūdān d’al-Sa‘adī.
1 A ce sujet, voir Dmitry Bondarev, “Multiglossia in West African manuscripts: The case of
Borno, Nigeria,” in Jorg B. Quenzer et al. (eds.), Manuscript Cultures: Mapping the Field, De
Gruyter, Berlin – New York (in press); voir aussi Adrian D. H. Bivar – Mervyn Hiskett, “The
Arabic literature of Nigeria to 1804: a provisional account,” Bulletin of the School of Oriental
and African Studies, 25, 1, 1962, pp. 104-148; Constant Hamès, “Les manuscrits arabo-
africains: des particularités?” in Geneviève Humbert (éd.), La tradition manuscrite en écriture
arabe, numèro monographique du Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 99-
100, 2002, pp. 168-182. En ligne, <http://remmm.revues.org-/index1182.html>, consulté le 16
mars 2011.
46 Rémi Dewière
Au Borno, il découvre, demande et obtient la copie de deux textes arabes
d’un ‘ālim de la cour des sultans Sefuwa du XVIe siècle, Aḥmad b. Furṭū,
généralement appelé Ibn Furṭū: le Kitāb Ġazawāt Barnū, ou “Livre des
Conquêtes du Borno” (K/B), et le Kitāb Ġazawāt Kānim, ou “Livre des
Conquêtes du Kanem” (K/K),2 qui fut l’ancien siège du pouvoir Sefuwa
situé à l’Est du lac Tchad, perdu deux siècles plus tôt.
Les deux manuscrits “mettent en histoire”3 les douze premières an-
nées de règne d’Idrīs b. ‘Alī b. Idrīs, appelé également Idrīs Alawmā
(m. 1005/1596), du nom du village où il fut tué. Ils ont été écrits du-
rant ce que nous considérons être l’apogée de la longue histoire de la
dynastie des Sefuwa, qui régna au Kanem puis au Borno. Nous
sommes redevables des écrits d’Ibn Furṭū pour l’histoire de cette pé-
riode. La connaissance de leur auteur est dès lors nécessaire pour
comprendre les liens avec le pouvoir, ainsi que les raisons de la rédac-
tion de tels ouvrages, à cette période précise du règne d’Idrīs Alawmā.
L’objectif de cet article est de présenter la construction de la figure
d’Ibn Furṭū en tant que ‘ālim bornuan depuis la découverte de son
œuvre. A partir des enjeux dégagés par l’historiographie, nous propo-
serons une étude des références littéraires utilisées par Ibn Furṭū. A la
lumière de ces références, nous discuterons des possibles connections
entre le savant bornuan et le soufisme, notamment à travers la diffu-
sion des textes šāḏilī du Nord au Sud du Sahara.
2 Les deux manuscrits se sont vus attribués plusieurs titres en fonction de leurs différentes
éditions et traductions. Voir Herbert R. Palmer, History of the First Twelve Years of the Reign
of Mai Idris Alooma of Bornu (1571-1533) by his Imam Ahmed ibn Fartua; together with the
“Diwan of the sultans of Bornu” and “Girgam” of the Magumi, translated from the Arabic
with introduction and notes, Government Printer, Lagos, 1926. Dierk Lange les nomme
d’abord Kitāb sha’n balad al-Bornū et Kitab sha’n balad al-Kānem dans sa thèse en 1977,
avant de finalement utiliser les titres de Kitāb Ghazawāt Barnū et de Kitāb Ghazawāt Kānim
(Dierk Lange, A Sudanic Chronicle: The Bornu Expeditions of Idris Alauma [1564-1576]:
According to the Account of Aḥmad b. Furṭū, Steiner, Wiesbaden – Stuttgart, 1987). 3 Expression empruntée à Eric Vallet, L’Arabie Marchande, Etat et commerce sous les Sultans
Rasūlides du Yémen (626-858/1229-1454), Publications de la Sorbonne, Paris, 2010, p. 38.
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 47
1. Ibn Furṭū et son œuvre, vers l’étude d’une entreprise politico-
religieuse.
La prise en compte d’Ibn Furṭū en tant qu’acteur politico-religieux
dans la rédaction des Kitābs fut progressive. Le premier intérêt des
historiens repose sur le texte et son contenu. C’est cet intérêt qui per-
met à Barth, historien et géographe de formation, de saisir le caractère
unique de la source dès que son existence est évoquée lors d’entretiens
avec al-Bašīr, le vizir qui accueillait le voyageur à Kukawa, nouvelle
capitale du sultanat depuis 1814. Plusieurs épisodes relatent
l’événement dans son récit de voyage Travels and Discoveries in
North and Central Africa:4
It was in consequence of these conversations that he [al-Bašīr] began to take
an interest in the former history of the country, and that the historical records
of Edris Alawoma [Idrīs Alawmā] came to light; but he would not allow me
to take them into my hands, and I could only read over his shoulders.5
Ce sont les dirigeants du Borno qui lui montrent les Kitābs d’Ibn
Furṭū. Ce geste ainsi que le don qui suit sont d’autant plus étonnants
qu’al-Bašīr était le vizir de la dynastie des Kānimī, qui venait de ren-
verser le dernier représentant des Sefuwa, à une époque où toutes les
traces écrites de l’ancienne dynastie sont détruites.6 Barth en demande
alors deux copies qui lui seront faites en avril et juin 1853, selon les
colophons des manuscrits.7 Le lien entre le pouvoir et ces sources est
4 Nous utilisons la version anglaise de Heinrich Barth, Reisen und Entdeckungen in Nord- und
Central-Afrika, Justus Perthes, Gotha, 1857, qui fut traduite par l’auteur même et éditée aux
Etats Unis: Idem, Travels and Discoveries in North and Central Africa, Harpers & Brothers,
New York, 1857-1859. Quelques différences entre les différentes éditions ont été relevées par
la suite. Cependant, celles-ci ne concernent pas notre propos. L’ouvrage dirigé par Paulo de
Moraes Farias se penche sur les problèmes de différences entre éditions de plusieurs langues
dans une étude comparative entre l’édition allemande et française: Alain Ricard – Gerd
Spittler, “Sur l’édition française de Barth,” in Paulo Fernando de Moraes Farias et al. (dir.),
Heinrich Barth et l’Afrique, Rüdiger Köppe, Köln, 2006, pp. 71-90. 5 Heinrich Barth, Travels and Discoveries, v. 2, p. 44. 6 Ibidem, v. 2, p. 61. 7 Les colophons sont inscrits dans les manuscrits conservés au Royal Asiatic Society sous la
même cote (Arabic MS 29, 115ff.). Voir Lange, A Sudanic Chronicle, p. 106; Royal Asiatic
Society, Arabic MS 29, f. 45r.; Herbert R. Palmer, Sudanese Memoirs, Frank Cass, London,
48 Rémi Dewière
confirmé par l’épisode du don des copies:
I took leave of the sheikh on the 19
th of November, in a private audience,
none but the vizier being present. […] I concluded my leave-taking by re-
questing my kind hosts, once more, to send a copy of the history of Edris
Alawoma, the most celebrated Bornu king, to the British government, as I
was sure that, in their desire to elucidate the history and geography of these
regions, this would be an acceptable present.8
Une des deux copies est envoyée à Londres au British Foreign Of-
fice, avant d’être donnée à la Royal Asiatic Society de Londres.9 La
seconde est envoyée à Tombouctou pour Barth, puis est entreposée en
Allemagne où elle disparaît pendant la seconde guerre mondiale. Une
copie de ce manuscrit, datée de 1921, nous est parvenue et est actuel-
lement conservée à la School of Oriental and African Studies, à
Londres également.10
De retour en Europe, la principale occupation de
Barth est de contrôler la véracité des informations données par Ibn
Furṭū, notamment pour les périodes le précédant et dont ses sources
sont uniquement des informations orales.11
Pour cela, Barth compare
les listes dynastiques des deux sources trouvées à la cour du Borno:
une liste dynastique des Sefuwa, le Dīwān al-salāṭīn Barnū12
et les ré-
cits des campagnes militaires d’Idrīs Alawmā, écrits par notre auteur.
Leur proximité, malgré quelques variantes, confirme tout particuliè-
rement l’authenticité de la source:
and in this respect the chronicle No. 1 is entirely confirmed and borne out by
Imam Ahmed [Ibn Furṭū], who, in the introduction to his History, gives the pedi-
gree of his master Edris Alawoma up to his first royal ancestor, while the differ-
ence in the form of the names, and one slight variance in the order of succession,
1967, v. 1, p. 71; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 113v. 8 Heinrich Barth, Travels and Discoveries, v. 3, p. 19. 9 Voir note 7. C’est la version du manuscrit la plus ancienne en notre possession et dont nous
nous sommes servis pour cet article. 10 School of Oriental and African Studies, Arabic MS 41384, 148 ff. 11 Barth, Travels and Discoveries, v. 2, p. 17. 12 Tawārīḫ Salāṭīn Barnu, Deutsche Morgenlandische Gesellschaft, Bibliothèque de Halle,
ms. arabe 53 (voir Dierk Lange, Le Diwan des Sultans du [Kanem-] Bornu: Chronologie et
histoire d’un Royaume Africain, Franz Steiner, Wiesbaden – Stuttgart, 1977).
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 49
as given by these two documents, is a plain proof that they have not been bor-
rowed from each other, but have been based on independent authorities. 13
A propos d’Ibn Furṭū, Barth est très lapidaire: “L’imām Ahmed
[est] un homme savant et intelligent de haut rang, et en connexion
constante avec la cour.”14
Par la suite, peu de chercheurs s’attardent
sur l’étude de l’auteur. Tout au plus, Yves Urvoy note-t-il l’intérêt des
“remarques incidentes” reportées par le savant.15
En 1977, dans un ar-
ticle dressant la synthèse des études sur Idrīs Alawmā, Jean-Louis
Triaud pousse plus loin l’analyse sur Ibn Furṭū:
Ces manuscrits en arabe ont été rédigés par l’un des plus hauts dignitaires de
la cour, le grand imam Aḥmad b. Fartua (ou Furtu), dans les années 1576-
1578. […] [L]e ton hagiographique et les intentions pieuses de l’auteur con-
fèrent en effet à ces œuvres une partialité évidente, mais les nombreux détails
vivants dont elles fourmillent fournissent indirectement une documentation
précieuse sur la politique et les méthodes d’Idris, et sur la situation du Bornu
à la fin du XVIe siècle.
16
Dans l’article de Triaud, nous passons d’erreurs dues à la nature des
sources utilisées par Ibn Furṭū à une partialité volontaire dans son récit en
faveur du Sultan Idrīs: quand Barth pense que les différences entre Dīwān
et Kitāb sont liées à la qualité des informateurs de l’auteur, Triaud confère
un rôle plus actif à Ibn Furṭū, non plus simple compilateur mais acteur d’un
document à caractère plus politique.
Jean-Claude Zeltner, spécialiste des tribus arabes du Tchad, est le
premier auteur à proposer une étude détaillée sur Ibn Furṭū, dans son
ouvrage sur l’histoire du Kanem, Pages d’histoire du Kanem, pays
Tchadien, en 1980.17
Il date avec précision la rédaction des deux
textes, à partir des dates qu’Ibn Furṭū donne: “Les dates principales
sont notées. Certes, l’auteur ne donne jamais l’année de l’hégire,
13 Barth, Travels and Discoveries, v. 2, p. 17. 14 “[T]he Imam Ahmed, a learned and clever man in a high position, and in constant con-
nection with the court.” (Ibidem, v. 2, p.18). 15 Yves Urvoy, Histoire de l’empire du Bornou, Larose, Paris, 1949, p. 75. 16 Jean-Louis Triaud, “Idris Alaoma,” in Charles-André Julien (dir.), Les Africains, Jeune
Afrique, Paris, 1977, T. III, p. 47. 17 Jean-Claude Zeltner, Pages d’histoire du Kanem, pays Tchadien, L’Harmattan, Paris, 1980.
50 Rémi Dewière
mais il précise le jour de la semaine et le quantième du mois. Les tables de
correspondance permettent de savoir en quelle année tel jour de la semaine
tombait tel quantième du mois.”18
C’est ainsi qu’il date la rédaction du ré-
cit des campagnes du Borno au 21 octobre 157619
et de celui des cam-
pagnes du Kanem à la fin 1578, corrigeant ainsi la première estimation de
Barth.20
Zeltner insiste sur plusieurs points pour décrire Ibn Furṭū: c’est un
“homme pieux, courageux, soucieux de l’équité, ardent promoteur des ré-
formes inspirées du Coran et de la sunna”21
et un homme cultivé dont la
“spécialité est le droit.”22
De même, Zeltner montre l’influence de l’auteur
de la Risāla, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Abī Zayd al-Qayrāwānī (m.
386/996), sur la pensée d’Ibn Furṭū.23
Celui-ci, à la lecture de son manus-
crit, apparaît être pour Zeltner un “témoin lucide [qui] fait preuve de dis-
cernement dans l’usage des traditions.”24
S’inscrivant en porte à faux avec
ses prédécesseurs, Zeltner voit dans les deux récits de campagne des do-
cuments historiques et interroge peu les motivations d’Ibn Furṭū à entre-
prendre un tel projet littéraire, ni la relation entre savoir et pouvoir.
Ces questions sont largement reprises par Dierk Lange dans
l’introduction de la très bonne édition critique du kitābs sur le Bor-
no,25
où l’auteur fait une synthèse détaillée sur le manuscrit, sa décou-
verte, les traductions et l’auteur. Soulignant l’importance de la famille
d’Ibn Furṭū dans l’histoire du royaume Sefuwa, Lange touche du doigt
les liens importants entre le lettré soudanais et le pouvoir.26
Ainsi,
pour Lange, Ibn Furṭū a écrit le K/B pour
describe and properly emphasize the “outstanding virtues” of the Caliph and
the particular “sagacious stratagems” he had employed in order to achieve
18 Ibidem, p. 135. 19 Ibidem, p. 136. 20 Jean-Claude Zeltner, “Le may Idris Alaoma et le Kotoko,” Revue camerounaise d’histoire,
1, 1971, p. 36. 21 Zeltner, Pages d’histoire du Kanem, p. 16. 22 Ibidem. 23 Ibidem, pp. 124-125. 24 Ibidem, p. 17. 25 Lange, A Sudanic Chronicle, pp. 18-25. 26 “Descending from Muḫammad b. Mani, he belonged to a widespread and famous family. It
would appear that during the period covered by his writings he held the important office of
Grand Imam, in which capacity he led the Friday prayers” (Lange, A Sudanic Chronicle, p. 19).
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 51
great and memorable victories. He is therefore very much preoccupied with
the necessity of expressing himself in a style appropriate for the eulogy of his
Sultan and much less concerned with the establishing of clear facts.27
Cependant, c’est sur la description de l’homme de lettres qu’il
s’attarde. Si Ibn Furṭū a participé à certaines expéditions guerrières, il
ne fait aucun doute que ses principales activités étaient les prières, le
sermon du vendredi, et les lectures pieuses. Il est décrit comme un sa-
vant ayant eu une éducation classique, mais ayant de surcroît développé
une certaine “sophistication intellectuelle.”28
Lange démontre cette so-
phistication intellectuelle en réalisant un très bon travail d’identification
des citations utilisées par Ibn Furṭū dans le K/B. Les principales conclu-
sions de Lange concernent la construction linguistique et littéraire de
son récit: de langue Kanuri, n’ayant jamais quitté le bassin du lac
Tchad, Aḥmad b. Furṭū maîtrise malgré tout remarquablement bien la
langue arabe écrite.29
Ainsi, notre auteur décrit les actions militaires et
la culture matérielle avec une grande précision technique. Lange ajoute
que des parties du K/B se rapprochent du sermon:
It is obvious that he conceived his written text on lines similar to those of a
spoken Friday sermon (khutba). It therefore would appear that the very pecu-
liar style of the K. ghazāwāt Barnu could conveniently be described as the
style of a religious sermon or khutba. It is this’ unity of style, particulary ap-
parent in the introduction and the conclusion, which conveys the impression
that the text is more coherent than it really is. The apparent coherence of the
book may, on the other hand, also be understood to be the result of the initial
conception of the text as an oral discourse.30
Finalement, la démarche de Lange reste confinée à l’étude du K/B.
Il est question ici d’étudier l’auteur pour pouvoir tirer les informations
de son récit: “l’apport d’Ibn Furṭū devrait ainsi être valorisé non seu-
lement en tant que narration historique, mais aussi comme une base
sûre pour la reconstruction historique.”31
27 Ibidem, p. 20. 28 Ibidem, p. 19. 29 Ibidem, p. 23. 30 Ibidem, p. 22. 31 Ibidem, p. 24 (la traduction de l’anglais est la mienne).
52 Rémi Dewière
Cette analyse, sévèrement qualifiée d’ “orientaliste” par Augustin
Holl,32
fait la part belle à l’étude philologique, sans chercher à com-
prendre le milieu culturel en puisant dans les autres sources et les
autres disciplines. Holl propose les clefs d’une telle analyse et sou-
ligne la nécessité d’approfondir notre connaissance sur la construction
idéologique du récit pour comprendre la période de formation du sul-
tanat du Borno à l’Ouest du lac Tchad:
Theoretically, it may be considered that the Sayfawa engaged in warfare
against the pagan tribes during the formative period of the Kanuri kingdom in
the sixteenth century, may have considered themselves as genuine heirs of
the Yemenite Himyarite hero. It is therefore the ideological aspects of this
amazing connection which is relevant in this context and not narrow histori-
cal accuracy in the academic sense of the word.33
Un tel approfondissement passe par une relecture de l’ensemble des
sources nous apportant des informations sur l’auteur des Kitābs, à
commencer par sa production littéraire. L’analyse des références litté-
raires présentes dans les textes est une première clef pour tenter de
mieux cerner Ibn Furṭū, ainsi que sa place à la cour des Sefuwa et
dans la société du Borno au XVIe siècle.
2. Les références littéraires d’Ibn Furṭū.
La question des sources utilisées par Ibn Furṭū a déjà été largement
discutée, notamment pour s’assurer de leur validité.34
D’une manière
plus large, les historiens ont dressé un premier portrait de l’homme de
lettres. Ibn Furṭū est de toute évidence un homme cultivé. D’après
Lange, il ne fait aucun doute que sa langue maternelle est le Kanuri.35
Cette affirmation repose sur les origines ancestrales invoquées par Ibn
Furṭū, faisant remonter sa famille aux origines de la présence musul-
32 Augustin Holl, The Diwan Revisited, Kegan Paul International, London, 2000, p. 42. 33 Ibidem, p. 41. 34 Barth, Travels and Discoveries, v. 2, pp. 17-18; Zeltner, Pages d’histoire du Kanem, p. 16;
Lange, A Sudanic Chronicle, p. 24. 35 Lange, A Sudanic Chronicle, p. 19.
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 53
mane dans la région. Cependant rien n’indique que sa famille ne se soit
pas arabisée et il est sûr qu’Ibn Furṭū maîtrise les deux langues: il utilise
un vocabulaire littéraire et des vers poétiques tout le long de son récit,
confirmant un haut niveau intellectuel.36
L’étude philologique de Lange
montre bien qu’Ibn Furṭū ne maîtrise pas toutes les subtilités du voca-
bulaire arabe, notamment technique,37
lui faisant dire que l’arabe n’est
pas sa langue mater nelle; mais cette remarque reste anecdotique pour
mieux comprendre l’auteur des Kitābs. Ibn Furṭū est né et éduqué au
Borno, compte tenu de la position dont il bénéficie à la cour Sefuwa. Il
n’aurait quitté le pays que pour le Kanem, lors des expéditions du Sul-
tan Idrīs Alawmā contre les Bulala. N’ayant pas fait le ḥāğğ, le pèleri-
nage à la Mecque, il est peu probable qu’Ibn Furṭū soit allé dans le
monde arabe avant la rédaction de ses ouvrages. Cependant, nous avons
vu que le style narratif de ses textes est en arabe classique. Ce style
d’écriture nous montre que c’est un auteur classique et religieux. Cette
maîtrise de la langue arabe est assurée par une longue tradition au Sou-
dan de lettrés formés aux modèles dérivés de la tradition historiogra-
phique et littéraire arabe. Il est difficile cependant d’avoir une idée pré-
cise sur la formation intellectuelle d’Ibn Furṭū. Nous ne possédons pas,
contrairement à d’autres savants soudanais, de biographie d’Ibn Furṭū,
et un document comme le Fatḥ al-Šakūr fī ma‘rifāt a‘yān ‘ulamā’ al-
Takrūr, qui présente la biographie la plus riche d’Aḥmad Bābā de
Tombouctou,38
manque cruellement pour Ibn Furṭū. Quelques pistes
d’étude peuvent être exploitées cependant à partir des citations trouvées
dans les Kitābs. Les textes d’Ibn Furṭū regorgent d’expressions cora-
niques,39
ainsi que de la mention d’un ḥadīṯ de Mu‘aḏ b. Ğabal40
. Un
36 Ibidem. 37 Par exemple, l’usage du mot arabe šawkiyyāt (“fortifications”) peut dans la plume d’Ibn
Furṭū avoir plusieurs sens, comme lors de la description du pays de Kano dans le chapitre IV
du K/B (Lange, A Sudanic Chronicle, K/B, IV §2, note 1). 38 John O. Hunwick, “A new source for the biography of Aḫmad Bābā al-Tinbuktī (1556-
1627),” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 27, 3, 1964, pp. 568-593;
Chouki El Hamel, La vie intellectuelle islamique dans le Sahel Ouest-Africain (XVIe-XIXe
siècle). Une étude sociale de l'enseignement islamique en Mauritanie et au Nord du Mali
(XVIe-XIXe siècles) et traduction annotée de Fath ash-shakūr d’al-Bartilī al-Walātī (mort en
1805), Harmattan, Paris, 2002. 39 Voir par exemple le début du K/B, qui comporte douze références différentes au Coran,
Lange, A Sudanic Chronicle, pp. 32- 34; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, ff. 2v-3r.
54 Rémi Dewière
autre ḥadīṯ est utilisé par le savant en introduction au K/B:
The excellence of equity is well known, its practice by a king for one day is
equal to sixty years of worship; its mentioners are many.41
Ce ḥadīṯ, rapporté par Ibn ‘Abbās (m. 68/687) et recueilli par Mu-
slim b. al-Ḥağāğ (m. 261/875), a notamment été mis en avant par le sy-
rien Ibn Taymiyya42
(m. 728/1328) pour défendre la pensée politique de
al-siyāsā al-šari‘ā, la politique de la Loi,43
positions desquelles Ibn
Furṭū semble assez proche lorsqu’il décrit l’action d’un sultan ou encore
l’action politique d’Idrīs b. ‘Alī (m. 972-1005/1564-1596):
The first principle of leadership (imāma) is pure equity; thus it is correct that
all men follow their imām; he precedes them and they follow him. He guides
them to paradise by their reins after they have given their register into their
right hands and are rejoicing at their salvation and their faith, having stood
for judegment to be passed and having learnt their requital for good or ill.
[…] The abode in which there is an unjust Sultan is better than that which is
void of one.44
[…] Among the most noble of his characteristic actions was his
bringing all the people to accept legal judgements.45
40 Palmer, Sudanese Memoirs, v. 1, p. 36. Cette partie du texte, entre crochets, ne se trouve
pas dans les manuscrits Royal Asiatic Society, Arabic MS 29 et School of Oriental and African
Studies, Arabic MS 41384. Il est probable qu’elle se trouve dans un manuscrit conservé à
Ibadan, ayant appartenu au dernier Maina Gumsumi, le doyen représentant la dynastie Sefuwa
et jouant un rôle de gardien de la dynastie. Cependant Herbert Richmond Palmer nous dit que
le manuscrit est incomplet à partir de la page 53 et qu’il manque ainsi 70 pages (Palmer,
Sudanese Memoirs, v. 1, p. 13). Un prochain terrain permettra de confirmer cette hypothèse.
Compagnon du prophète et compilateur du Coran, Mu‘aḏ b. Ğabal est acteur dans de
nombreux ḥadīṯ (voir Gautier H. A. Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadith, Brill,
Leiden, 2007, pp. 22, 40, 93, 114, 134, 163, 224, 265, 272, 346, 428, 479, 487, 528, 545,
664). Il aurait fait parti des six appelés Kuttāb al-Waḥī, qui ont compilé le Coran sous
l’autorité du Prophète. 41 Lange, A Sudanic Chronicle, p. 35; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 4r. 42 Yadh Ben Achour, “Le Livre, la Balance et le Glaive. La symbolique du droit et de la
politique dans le Coran,” Les droits fondamentaux. Inventaire et théorie générale, Université
Saint-Joseph – Cedroma – Société de législation comparée, Bruylant, 2005, p. 270. 43 A propos de la pensée politique d’Ibn Taymiya, voir Antony Black, The History of the
Islamic Political Thought, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2001 [2005], pp. 154-159. 44 Lange, A Sudanic Chronicle, p. 35; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, ff. 3v-4r. 45 Lange, A Sudanic Chronicle, p. 38; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 6r.
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 55
En plus du Coran et des ḥadīṯ qui sont la base de l’éducation d’un
homme religieux,46
Ibn Furṭū cite de nombreux auteurs classiques tout
au long de ses deux textes. La diffusion des manuscrits dans le monde
arabe demeure mal connue, plus encore à travers le Sahara.47
Cepend-
ant, les recherches récentes commencent à étudier ce phénomène:
Books could be ordered from trans-Saharan traders, purchased from itinerant
booksellers, and copied or purchased directly in specialized markets. Mus-
lims on their return from pilgrimage typically carried large quantities of
books acquired not only in Mecca, but also in Cairo, and elsewhere. On his
way back from the Hiğāz in the early nineteenth century, al-Ṭālib Aḥmad
carried “400 books from the sacred city of the Prophet.” His pilgrimage trav-
elogue is replete with comments about caring for his books, and he lists and
thanks all those who gave him manuscripts.48
Au Soudan central, cette connaissance littéraire suit trois voies de
diffusion: celles des ‘ulamā’ venant au Borno, les pèlerinages à la
Mecque et la diffusion de livres via les routes transsahariennes. Les
traces de cette diffusion des savoirs se retrouvent dans de nombreux
témoignages: ainsi, lors d’un pèlerinage à la Mecque, le souverain Se-
fuwa ‘Alī Gaji (m. 902/1497) s’arrête-t-il au Caire pour consulter al-
Suyūṭī, qui rapporte qu’ “ils étudièrent avec moi un certain nombre de
mes œuvres, plus de vingt, […] et d’autres ouvrages.”49
La traversée
du Sahara par des savants du Maghreb vers le Borno est attestée par
Lorenzo d’Anania en 1576.50
Cette circulation des savants est égale-
46 Dierk Lange mentionne également le fiqh, la jurisprudence islamique. Nous en reparlerons. 47 A ce propos, lire François Déroche, Le livre manuscrit arabe, préludes à une histoire,
BNF, Paris, 2004, pp. 57-60; Dominique Urvoy, “Modes de présence de la pensée arabo-
islamique,” p. 125. 48 Ghislaine Lydon, On Trans-Saharan Trails, Islamic law, Trade Networks, and Cross-
cultural Exchange in Nineteenth-Century Western Africa, Cambridge University Press,
Cambridge, 2008, p. 100. Pour une étude plus approfondie, consulter Ghislaine Lydon –
Graziano Krätli (eds.), The Trans-Saharan Book Trade, Manuscript Culture, Arabic Literacy
and Intellectual History in Muslim Africa, Brill, Leiden, 2011. 49 Joseph Cuoq, Histoire de l’islamisation de l’Afrique de l’Ouest, Geuthner, Paris, 1984, pp.
254-5; Elizabeth Sartain, “Jamal ad-Din al-Suyuti’s relations with the peoples of Takrur,”
Journal of Semitic Studies, 16, 2, 1971, p. 195. 50 “[D]ove arrivano hoggidì molti Turchi, che van cercando lor ventura, et anco molti Mori di
Barbaria, che son lor Dottori” (Gian Lorenzo D’Anania, L’universale fabrica del mondo
overo cosmografia, Aniello San Vito di Napoli, Venezia, 1576, p. 296. Il faut également
56 Rémi Dewière
ment attestée dans le territoire sahélien: ainsi Joseph Cuoq cite un pas-
sage de la chronique de Kano où “entre 1452 et 1463, des shaykh
peuls, venant du pays hausa […] arrivèrent au Bornou, apportant avec
eux des livres de théologie et de grammaire.”51
Nous retrouvons ces trois voies de diffusion dans les Kitāb. Aḥmad
b. Furṭū a certainement eu l'occasion d'étudier différents textes
d’auteurs arabes. Il a sans doute également mémorisé de nombreux
ouvrages, au même titre que le Coran. En regardant les références uti-
lisées dans les Kitāb, nous pouvons avancer qu’Aḥmad b. Furṭū a dé-
veloppé un large savoir à propos de la philologie et de la grammaire
arabes, dont on peut retracer une partie de la chaine de transmission
des enseignements, jusqu’au septième siècle. Nous pouvons en effet
regrouper cinq auteurs cités dans le K/K et le K/B. Le plus récent est
Mağd al-Dīn al-Fīrūzābādī (m. 817/1415),52
dont le nom et l’ouvrage
utilisés sont cités à la fin du K/K. ‘Ālim d’origine iranienne, il est
l’auteur de Qāmūs, un dictionnaire qu’Ibn Furṭū mentionne. Proche
des malikites, s’il ne l’est pas lui-même, al-Fīrūzābādī construit une petite
école malikite à la Mekke lors de son deuxième pèlerinage, en 1400. Il
est spécialiste de la lexicographie, mais aussi d’histoire, de tafsīr et de
ḥadīṯ. Son dictionnaire est le plus connu et répandu en Afrique, et il n’est
pas étonnant de le trouver comme référence chez Ibn Furṭū53
. Autour de
cet auteur classique gravitent de nombreuses autres références classiques
présentes dans les Kitābs. Ainsi, nous retrouvons Imru’ al-Qays b. Huğr
(m. 550 ap. J.-C.),54
poète préislamique faisant partie d’une liste de
poètes, nommés entre autres par al-Suyūṭī et al-Fīrūzābādī. Ibn Furṭū cite
rappeler que les marchands étaient également des savants, dont le commerce permettait de
vivre et de dégager du temps pour la connaissance religieuse (voir Murray Last, “The book
and the nature of knwoledge in muslim Northern Nigeria, 1457-2007,” in Lydon – Krätli
(eds.), The Trans-Saharan Book Trade, p. 182.). 51 Cuoq, Histoire de l’islamisation, p. 251. 52 Palmer, Sudanese Memoirs, v. 1, p. 70; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 113r. Sur ce
poète, consulter Henry Fleisch, s.v. “Fīrūzābādī,” in Clifford E. Bosworth et al. (eds.), The
Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, Brill, Leiden, 1960-2005 (hereafter EI2). 53 Bruce S. Hall – Charles C. Stewart, “The historic ‘Core Curriculum’ and the book market in
Islamic West Africa,” in Lydon – Krätli (eds.), The Trans-Saharan Book Trade, p. 120. 54 Lange, A Sudanic Chronicle, p. 105; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 44r. Sur ce
personnage, consulter également Said Boustany, s.v. “Imru’ al-Ḳays,” in EI2.
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 57
également Ibn Fāris,55
philologue du Xe siècle (m. 395/1004), dont il a lu
des passages du Kitāb al-‘Afrād. La connexion entre Ibn Fāris et al-
Fīrūzābādī se retrouve dans le texte, où Ibn Furṭū écrit:
I have seen in the book Afrad, written by Ibn Faris that every Sakina brought
tranquility except that in the story of Talut which was like the head of a cat
with two wings. This I have seen in the Book of God – The Kamus.56
Cette connexion est confirmée par la biographie d’al-Fīrūzābādī,
qui a fait une étude critique des travaux d’Ibn Fāris, et a repris des
éléments de ses ouvrages. L’autorité intellectuelle d’Ibn Fāris, Abu
Bakr Muḥammad b. Durayd (m. 321/933),57
est également citée par
Ibn Furṭū à deux reprises dans le K/B. Ce lexicographe et philologue
irakien, également poète, a pour maître un certain Hišām b.
Muḥammad b. al-Sā’ib al-Kalbī Abū al-Munḏir, appelé Ibn al-Kalbī
(m. 206/821)58
dont la présence est probable dans la version
d’Ibadan du K/K:
Also in the Commentaries on the Kura’an Al-Kalbiyin says that “Tranquility
from your Lord” means the “Ark of the Covenant.” Kalbiyin says that when
the Ark was present it tranquillised their hearts.59
Il est possible qu’Ibn Furṭū n’ait lu que l’ouvrage Qāmūs d’al-
Fīrūzābādī, compte tenu des liens plus ou moins forts que tous les
autres auteurs anciens ont avec ses travaux. Cette hypothèse n’enlève
55 Palmer, Sudanese Memoirs, v. 1, p. 70; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 113r. Sur ce
savant, voir Henry Fleisch, s.v. “Ibn Fāris,” in EI2. 56 Palmer, Sudanese Memoirs, v. 1, p. 72. 57 Lange, A Sudanic Chronicle, v. 1, pp. 43 et 106; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, ff. 8v,
44v. Sur ce personnage, consulter Johan W. Fück, s.v. “Ibn Durayd,” in EI2. Les poèmes d’Ibn
Durayd sont également largement diffusés en Afrique sub-saharienne (Hall – Stewart, “The
historic ‘Core Curriculum’ ,” p. 121). 58 Voir Wahib Atallah, s.v. “al-Kalbī. II. Hisham b. Muḥammad b. al-Sā’ib al-Kalbī,” in EI2. 59 Palmer, Sudanese Memoirs, v. 1, p. 72; L’auteur pourrait être confondu avec un autre auteur
cité par Ahmad b. Furṭū, maghrébin celui-ci: Ibn Juzzay, de son nom complet Abū cAbd Allāh
Muḥammad b. Muḥammad b. Aḥmad b. Juzayy al-Kalbī. Cependant, l’utilisation d’une
citation évoquant l’arche d’Alliance laisse penser qu’il s’agit de l’auteur Hisham b.
Muḫammad b. al-Sā’ib al-Kalbī Abū al-Munḏir, appelé Ibn al-Kalbī. En effet, celui-ci est
l’auteur d’une histoire universelle, et il “citait des spécialistes qui avaient accès aux sources
bibliques et de Palmyre” (Atallah, s.v. “al-Kalbī”).
58 Rémi Dewière
rien à l’importance de la philologie et de la grammaire pour notre au-
teur. Il s’inscrit bien dans une tradition littéraire arabe classique qui
remonte aux origines de la littérature arabe avec Imru’ al-Qays b.
Huğr. Toutes ces références, venues du Mašriq et tout particulière-
ment d’Iraq, attestent d’une diffusion de la culture arabe via le pèleri-
nage des élites bornuanes et plus généralement soudanaises. Elles pro-
fitent de leurs passages au Caire pour acheter de nombreux biens, dont
très probablement des livres, comme le laissent suggérer le récit d’al-
Suyūṭī, ou encore une lettre du consul de Venise au Caire le 25 sep-
tembre 1565, à propos du pèlerinage du fils d’un souverain noir, iden-
tifié par John E. Lavers comme Idrīs Alawmā:
un figliuolo del Rè de’ Negri, ritornato di pellegrinaggio dalla Mecha,
[...] ha speso in diversi robbi, che fanno per il suo paesi, da ducati tre-
centomila.60
La connaissance d’autres ouvrages ou références a sans doute éga-
lement emprunté cette voie. Dans l’introduction du K/K, Ibn Furṭū
mentionne le Futūh al-Šām61
sans mentionner l’auteur, tout comme un
kitāb Ifrīqīyā,62
non identifié.
D’autres références confirment les liens étroits entre l’Afrique
de l’Ouest et le Maghreb, via le commerce transsaharien. De nom-
breux auteurs ont déjà mis l’accent sur la diffusion du Mālikisme
en Afrique à travers l’œuvre d’Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Abī
Zayd al-Qayrāwānī, que l’on retrouve dans le K/K.63
L’auteur de la
Risāla, basé à Kairouan, est extrêmement important pour les lettrés
60 Archivio di Stato di Venezia, Venise, Senato Dispaci Consoli Egitto 1565, 25 sett. 1565, d.
49, f. 122 (cit. in John O. Lavers, “Adventures in the Chronology,” in Daniel Barreteau –
Charlotte von Graffenried (eds.), Datation et chronologie dans le bassin du lac Tchad,
ORSTOM, Paris, 1993, p. 258. 61 Palmer, Sudanese Memoirs, v. 1, p. 16; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 48r;
plusieurs auteurs classiques ont écrit un futūḥ al-Šām (la conquête de la Syrie): al-Wāqidī (m.
207/822), Abū Ismā‘īl al-Azdī (m. 200/816), ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. Rabī‘a al-Qudāmī
(v. II/VIIIe siécle). La plus connue aujourd’hui est celle d’al-Wāqidī. 62 Palmer, Sudanese Memoirs, v. 1, p. 16. 63 Ibidem, p. 36. Voir Hady Roger Idris, s.v. “Ibn Abī Zayd al-Ḳayrāwanī,” in EI2. A ce propos,
Jean-Claude Zeltner écrit: “Il [Aḥmad] se contente de noter: ‘aucun ne fut sauvé par l’amân’.
L’allusion au texte de la risâlat est évident” (Zeltner, Pages d’histoire du Kanem, p. 124).
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 59
malikites: l’étude de cet ouvrage fait partie de la formation initiale
d’Aḥmad Bābā,64
et sa lecture par le premier souverain des Sefuwa
au Kanem scellait sa conversion au malikisme, sous les auspices de
Muḥammad b. Mānī, ancêtre revendiqué d’Ibn Furṭū.65
Zeltner
avait déjà mis en exergue les influences d’al-Qayrāwānī dans les
Kitābs. Cette influence n’est pas surprenante compte tenu de sa très
large diffusion en Afrique Sub-Saharienne.66
Ibn Furṭū cite également deux autres auteurs venant du Maghreb,
confirmant les attaches intellectuelles de la région du lac Tchad avec
cette partie du monde arabe. Ibn Manẓūr (m. 712/1312),67
connu sous
le nom de Ibn Mukarram au Mašriq, est connecté avec la ville de Tri-
poli, principal partenaire commercial du Borno: en effet, il revendique
être de la descendance de Ruwayfi‘ b. Ṯābit, gouverneur de Tripoli
après 668. Ibn Manẓūr est le qāḍī de Tripoli employé dans le dīwān
al-inšā‘ de la ville.68
Il est probablement une des sources d’al-
Qalqašandī (m. 821/1418). Son nom n’est pas marqué dans le K/B,
mais il est l’auteur du Lisān al-‘Arab, un dictionnaire, dont Ibn Furṭū
cite un passage pour éclairer un point de grammaire. Enfin, l’auteur
des Kitābs cite Ibn Ğuzzayy (m. 741/1340),69
poète et faqīh de Gre-
nade, dont l’un des fils, Muḥammad, se rend à Fez où il est chargé de
64 Hunwick, “A new source,” p. 582. 65 Herbert R. Palmer, The Bornu Sahara and Sudan, John Murray, London, 1936, p. 14. 66 “Le personnage principal de ce premier islam est représenté par l’homme du droit
musulman, le faqīh, qui constitue l’élite d’une classe cléricale présente surtout dans les petites
agglomérations urbaines du Sahara de l’Ouest (Wadân, Walâta, Tombouctou etc). C’est l’âge
d’or du pouvoir socio-religieux des fuqahâ’, sous le règne des Almoravides du Sud, des
souverains du Mali et du Songhaï, entre les XIe et XVIIe siècles, approximativement. Les
textes juridiques qui règnent en maître sont tous basés sur le Muwatta’ de l’imâm Malik b.
Anas, à savoir la Risâla d’Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî (Xe s.), le Muḫtaṣar de Sîdî Khalîl
(XIVe s.) et la Tuḥfa d’Ibn ‘Asim (XIVe-XVe s.), avec leurs innombrables commentaires et
explications de commentaires” (Constant Hamès, “La Shâdhiliyya ou l’origine des confréries
islamiques en Mauritanie,” Cahiers de recherche du Centre Jacques Berque, 3, 2005, pp. 7-
19). Je tiens à remercier M. Jean-Louis Triaud qui a attiré mon attention sur cet article.
L’exemplaire consulté ne nous permet pas de donner les pages de l’article. 67 Lange, A Sudanic Chronicle, p. 35; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 4r. sur ce
personnage, consulter également J.W. Fück, s.v. “Ibn Manẓūr,” in EI2. 68 Cabinet chargé entre autres de la correspondance, de la copie et de l’archivage (Hans L.
Gottschalk, s.v. “Dīwān,” in EI2). 69 Lange, A Sudanic Chronicle, p. 103; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 42v. Sur ce
savant, consulter André Miquel, s.v. “Ibn Djuzayy”in EI2.
60 Rémi Dewière
rédiger le texte de la Riḥla d’Ibn Baṭṭūṭa. Cet auteur est largement
connu en Afrique de l’Ouest pour ses ouvrages de révélations cora-
niques, mais pas pour l’ouvrage cité par Ibn Furṭū, le Maṣāric al-
uššāq70
. Les ouvrages de ces auteurs ont pu emprunter des voies de
diffusions différentes, depuis Tunis, le Maroc ou encore les états Hau-
sa comme nous l’avons vu. Cependant, la plus probable reste la route
caravanière reliant Birni Ngazargamu à Tripoli, attestée pour le com-
merce de papier dès 1637 par le Chirurgien-Esclave, auteur de
L’histoire chronologique du royaume de Tripoly de Barbarie: “Pour
cet effet il écrivit au prince du Fissan et à Mhai Hamour Roy du Borno
qui avoient été couronné en 1634 après la mort du Roy Idris son père,
offrant de leur fournir abondamment du cuivre en lame du papier des
fausses perles de Venisse et du drap.”71
Ces trois auteurs ont la parti-
cularité, contrairement à la première catégorie d’auteurs, d’être des ju-
ristes, qu’ils soient qāḍī, faqīh ou théoriciens du malikisme. Pouvons-
nous en déduire qu’un des enseignements d’Ibn Furṭū est le fiqh,
comme Lange le suppose?72
A aucun moment, Ibn Furṭū ne s’appelle
faqīh, titre qu’il donne à son sultan ainsi qu’à un auteur bornuan du
XVe siècle, Masbarma ‘Umar b.
‘Uthmān. En tant qu’imām al-kabīr,
Ibn Furṭū possède sans doute des connaissances en droit, et les auteurs
cités le montrent. Mais les Kitābs, de par leur nature, ne nous permet-
tent pas de savoir si la connaissance juridique d’Ibn Furṭū était déve-
loppée au point d’avoir reçu un enseignement spécifique comme pour
la philologie.
Une dernière catégorie d’auteurs cités par Ibn Furṭū sort un peu
des domaines évoqués précédemment, à savoir la philologie, la
grammaire ou le droit malikite. Les deux premiers auteurs sont des
poètes, respectivement du VIIIe siècle et du XI
e siècle, Ṣāliḥ b.
‘Abd al-Quddūs al-‘Azdī (m. 167/783)
73 et Abū Muḥammad Ğa‘far
70 Hall – Stewart, “The historic ‘Core Curriculum’ ,” p. 119. 71 [Chirurgien-esclave], L’histoire chronologique du royaume de Tripoly de Barbarie, BNF,
Paris, 1685, Ms. 12219, T. 1, f. 198r. 72 Lange, A Sudanic Chronicle, p. 19. 73 Lange, A Sudanic Chronicle, p. 95; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 38v; sur ce
personnage, consulter Mohsen Zakeri, s.v. “Ṣāliḥ b. cAbd al-Ḳuddūs,” in EI2.
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 61
al-Sarrāğ al-Baġdādī (m. 500/1106).74
Ṣāliḥ b. ‘Abd al-Quddūs al-
‘Azdī est un poète irakien. Il fut crucifié à Bagdad, où il fut accusé
de véhiculer des idées de la religion non orthodoxe. Moraliste, il
diffusait ses idées sur la religion comme des enseignements mo-
raux, non pas comme un système rationnel ou juridique. Quant à
Abū Muḥammad Ğa‘far al-Sarrāğ al-Baġdādī, dont l’ouvrage est ci-
té par Ibn Furṭū,75
c’était un traditionaliste ḥanbalī de Baghdad,
connu pour sa poésie. Ses Maṣāri‘ al-‘uššāk (Les amants qui furent
tués) sont des petites narrations qui circulaient dans le monde
arabe, parmi les étudiants. Elles inspirèrent également, dans une
moindre mesure, les enseignements soufis. Ces deux auteurs, ira-
kiens également, dépassent le cadre du simple droit traditionaliste
musulman et malikite.
Cette connaissance par Ibn Furṭū de tels auteurs, et surtout, leur
utilisation dans les Kitābs ouvre de nouvelles pistes sur les in-
fluences intellectuelles d’Ibn Furṭū. Une dernière référence viendrait
confirmer l’influence spirituelle de l’auteur des Kitābs: il s’agit de
Šarāf al-Dīn Muḥammad b. Sa‘īd al-Būṣīrī al-Sanḥāği, connu sous le
nom d’al-Būṣīrī76
(m. 696/1295) dont Ibn Furṭū cite deux fois
l’ouvrage Qaṣidāt al-Burda, ou “le poème du manteau.” Ce poète
égyptien du XIIIe siècle, d’origine berbère, fait partie des plus impor-
tants disciples de la confrérie soufi de la Šāḏiliyyā. Il fut l’élève
d’Abu al-‘Abbās Aḥmad al-Mursī (m. 686/1286) au même titre
qu’Ibn ‘Atā’ Allāh (m. 709/1309),
77 autre penseur soufi absent des
textes d’Ibn Furṭū mais qui se trouve diffusé plus à l’Ouest, de la
Mauritanie actuelle à Tombouctou:
Une des toute premières indications de l’apparition d’idées mystiques dans
l’Ouest saharo-africain se trouve dans la liste des auteurs et des ouvrages en-
seignés à Aḥmad Bābā (de Tombouctou) par son maître Baghayogho (m.
74 Lange, A Sudanic Chronicle, p. 103; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 42v; lire
également Stefan Leder, s.v. “al-Sarrādj, Abū Muḥammad,” in EI2. 75 Il semble cependant, d’après Dierk Lange, qu’Ibn Furṭū le cite par erreur (Lange, A Sudanic
Chronicle, p. 103, n. 24). 76 Lange, A Sudanic Chronicle, pp. 53, 102; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 14v, 42v.
Sur ce savant, voir Ed., s.v. “al-Būṣīrī,” in EI2. 77 Voir George Makdisi, s.v. “Ibn ‘Aṭā’ Allāh,” in EI2.
62 Rémi Dewière
1594). En effet, parmi une majorité d’ouvrages de droit, d’exégèse et de
langue arabe, figure la mention des Hikam de b. cAtâ’Allāh, avec le commen-
taire établi par Aḥmad al-Zarrûq.78
Ibn Furṭū écrit à la même période que celle pendant laquelle
Baghayogho a enseigné à Tombouctou, peut être même lui est-il
antérieur. Aussi, la référence littéraire de l’auteur des Kitābs à un
des premiers organisateurs de la confrérie šāḏilī, appuyée par les ci-
tations d’auteurs comme ‘Abd al-Qaddūs al-‘Azdī et al-Sarrāğ al-
Baġdādī, complexifient la vision que nous avons de lui. Elle ap-
porte la preuve que les ouvrages ou des extraits d’ouvrages
d’intellectuels soufis ont traversé le Sahara pour atteindre la région
du lac Tchad. Cette diffusion des idées et peut être même des en-
seignements mystiques par les livres dans le monde arabe a été sou-
lignée par Constant Hamès:
Le livre, dans ce milieu, joue un rôle non négligeable et se substitue fac i-
lement au maître et guide qui constitue l’autorité suprême dans les grou-
pements sûfî habituels. On sait qu’à cette période, et probablement à
cause du courant shâdhilî naissant, est posée dans les milieux lettrés la
question de la nécessité de suivre un maître en matière mystique ou de
l’éventualité de pouvoir le remplacer par des livres. C’est à cette occasion
qu’Ibn Khaldûn – foncièrement juriste, sur le plan religieux – participe au
débat, pendant son séjour à Fès en 1373-74 et reconnaît la possibilité du
guide livresque uniquement dans les étapes les plus élémentaires du che-
minement spirituel, notamment dans l’observance de la piété (taqwa) et
de la législation islamique.79
La question des voies de diffusion du soufisme vers l’Afrique sub-
saharienne se pose. Mervyn Hiskett, dans un article sur al-Maġīlī (m.
909/1504), un juriste réformiste d’origine berbère ayant séjourné à la
cour des Askia et à Kano, avance que les confréries soufi entrent au
Soudan à travers une diffusion de la culture nord africaine et anda-
louse vers Tombouctou.80
A propos du même auteur, Dominique Ur-
78 Hamès, “La Shâdhiliyya ou l’origine des confréries.” 79 Ibidem, pp. 9-10. 80 Mervyn Hiskett, “An islamic tradition of reform in the Western Sudan from the Sixteenth to
the Eighteenth Century," in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 25, 1, 3,
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 63
voy remarque également que “son opuscule ‘Amal al-yawm wa-l-
layla81
contient des citations d’al-Šāḏilī (m. 656/1258) et de Ibn ‘Aṭā’
Allāh (m. 709/1309), qui pourraient faire penser à une sympathie de sa
part pour la tarīqa des Šāḏiliyya.”82
Urvoy ne manque pas de confir-
mer par ailleurs l’affirmation de Hiskett à propos de l’origine maghré-
bine d’une telle diffusion. Ainsi, dès le XVe siècle, des ‘ulamā’ appor-
tant avec eux une connaissance mystique sont attestés traversant le
Sahara via Tombouctou. Les premiers auteurs de cette région à citer
les ouvrages des théoriciens de la Šāḏiliyyā – Ibn ‘Atā’ Allāh et
Aḥmad al-Zarrūq (m. 899/1493)83
– sont connus au courant des XVIe-
XVIIe siècles. Ibn Furṭū s’ajoute à la liste. Cela signifie-t-il que la dif-
fusion a suivi les mêmes canaux?
Le Sultanat du Borno est situé à mi-chemin entre l’Afrique de
l’Ouest et l’Afrique de l’Est. Il bénéficie d’une ouverture plus aisée
sur le Moyen Orient que ses voisins situés plus à l’Ouest. Il est dès
lors possible d’imaginer que les références littéraires d’Ibn Furṭū sur
le soufisme proviennent directement d’Egypte. Cette hypothèse est
d’autant crédible que la place d’al-Suyūtī, membre déclaré de la
Šāḏiliyyā,84
est attesté par les sources dans la diffusion des savoirs
vers la région du lac Tchad. La rencontre entre le Sultan cAlī Gaji, en
chemin pour le pèlerinage à la Mecque, et al-Suyūtī confirme
l’importance du pèlerinage dans la diffusion des idées mystiques et
tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle l’arrivée des écrits soufi
au Borno ne passe pas par le Maroc et suit un autre chemin que pour
l’Afrique de l’Ouest.
3. Les indices d’une appartenance au soufisme
Dans quelles mesures cette référence à al-Būṣīrī permet-elle de rap-
1962, p. 583. 81 Bibliothèque nationale de France, Paris, ms. Ar. 5673, ff. 257-259. 82 Daniel Urvoy, “Modes de présence de la pensée arabo-islamique dans l’Afrique de
l’Ouest,” p. 134. 83 Scott A. Kugle, Rebel Between Spirit and Law: Ahmad Zarruq, Sainthood, and Authority in
Islam, Indiana University, Bloomington, 2006. 84 Voir Eric Geoffroy, s.v. “al-Suyūtī,” in EI2.
64 Rémi Dewière
procher Ibn Furṭū, imām al-kabīr d’Idrīs Alawmā, d’une forme de
mysticisme propre aux élites urbaines musulmanes qui lui sont con-
temporaines? Quelles ont pu être les influences du soufisme sur notre
auteur? La seule référence à al-Būṣīrī ne suffit pas à faire d’Ibn Furṭū
un mystique lui-même, et encore moins quelqu’un faisant partie d’une
confrérie comme la Šāḏiliyya, d’autant que le Qaṣidāt al-Burda fut le
poème dévotionnel en l’honneur du Prophète Muḥammad le plus po-
pulaire et le plus diffusé dans le monde musulman85
. Aussi, les histo-
riens ne datent l’arrivée du soufisme au Borno qu’au plus tôt à la fin
du XVIIe siècle, soit un siècle plus tard, et sous la forme de la Qādi-
riyya: John Lavers, après avoir écrit “les confréries soufies ne sem-
blent pas avoir été puissantes au Borno, ou n’ont pas eu de grande in-
fluence avant le dix-neuvième siècle, mais de nombreux savants
étaient soufis et les quelques indices à notre disposition suggèrent que
seules les infuences Qādirī étaient présentes,”86
décrit la biographie
d’un šayḫ soufi bornuan mort vers les années 1680:
It was during his reign that several famous religious communities
flourished, enabling us to at least begin dating the development of
such communities. Among the more famous was the great Sufi scholar
Shaykh Abdullahi b. Muḥammad Abd al-Jalil al-Barnawi al-Himyari.
The Shaykh lived at Kalumbaru, just north of Birni Gazargamu, he
was visited by students from Sinnar in the Nile valley to the east and
from Morocco in the west.87
Le formidable essor de la Qādiriyya au XVIIIe siècle a très proba-
blement pu effacer des traces plus anciennes d’une autre forme de
soufisme, comme le laisse suggérer Hamès.88
A titre d’exemple, la
Šāḏiliyyā est encore présente au Borno, de manière très résiduelle.89
85 Hall – Stewart, “The historic ‘Core Curriculum’,” p. 126. 86 John E. Lavers, “Islam in the Bornu Caliphate: A survey,” in Odu, 5, 1971, p. 33 (la
traduction de l’anglais est la mienne). 87 John E. Lavers, “Adventures in the chronology of the states of the Chad basin, ” in
Barreteau – Von Graffenried, Datation et chronologie, p. 260. 88 Hamès, “La Shâdhiliyya,” 89 Voir Charles E. J. Whitting, s.v. “Bornū,” in EI2; rien ne dit qu’elle se soit implantée
plus tardivement, mais le personage d’Ibn Furṭū laisserait penser qu’elle était là bien
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 65
L’étude des Kitābs ainsi que des Maḥram,90
ces actes juridiques éta-
blis par la cour Sefuwa au Borno pour garantir des avantages à des ‘ulamā’, nous fournissent d’autres indices qui laissent penser qu’Ibn
Furṭū connaisse le soufisme et soit influencé par certaines de ses
idées et de ses pratiques. En effet, à la lumière des références litté-
raires d’Ibn Furṭū, son profil a des similitudes avec celui des adeptes
du soufisme aux XIV-XVIe siècles en Afrique du Nord. Il corres-
pond à un “soufisme des villes de caractère plus intellectuel pratiqué
par des croyants qui semblent n’être affiliés à aucun groupement dé-
terminé.”91
Ces hommes “occupent des charges dans la communauté
musulmane et sont par profession des hommes de science. Aucune
ṭarīqa ou vie commune ne les réunissait, aucun d’eux n’est dit affilié
à une ṭarīqa ou à une confrérie.”92
Pour l’Afrique sub-saharienne, Louis Brenner identifie trois
formes de soufisme à l’époque moderne, dont la première correspond
parfaitement à cette définition du mystique maghrébin. Il s’agit d’un
“soufisme dévotionnel hautement individualisé, dont les adhérents ne
perçoivent ou n’emploient pas la ṭarīqa comme base pour une action
ou organisation sociale ou politique.”93
Pourtant, à cette définition
Paul Nwyia ajoute que “on peut cependant se demander si toutes ces
personnes ne pratiquaient pas la ṭarīqa shadhilite.”94
Dès sa fonda-
tion au XIIIe siècle, la Šāḏiliyyā séduit de nombreux ‘ulamā’ en tant
que voie fondée notamment sur la conformité à la šarī‘a.
95 Cette pra-
avant la Qādiriyya. 90 Voir à leur sujet l’article de Hamidu Bobboyi, “Relations of the Borno ‘Ulamā’ with the
Sayfawa rulers: The role of the Mahrams,” Sudanic Africa, 4, 1993, pp. 175-204. 91 Paul Nwya, Un mystique prédicateur à la Qarawiyin de Fès. Ibn ‘Abbâd de Ronda
(1332-1390), Impr. Cathol., Beyrouth, 1961, p. XXX; voir aussi Mercedes Garcia-Arenal,
“Sainteté et pouvoir dynastique au Maroc: la résistance de Fès au pouvoir Sa’dien,”
Annales, 45, 4, 1990, p. 1033. 92 Nwya, Un mystique prédicateur, p. XXX. 93 Voir l’article de Louis Brenner, “Sufism in Africa in the seventeenth and the eighteenth
centuries,” Islam et sociétés au Sud du Sahara, 2, 1988, p. 81 (la traduction de l’anglais est
la mienne). 94 Nwya, Un mystique prédicateur, p. XXX; Garcia-Arenal, “Sainteté et pouvoir dynastique
au Maroc,” p. 1033. 95 Kenneth Honerkamp, “Ibn ‘Abbâd, modèle de la Shâdhiliyya” in Eric Geoffroy (dir.), La
Shâdhiliyya – Une voie soufie dans le monde, Maisonneuve & Larose, Paris, 2004. En ligne
<http://hnrkmp.myweb.uga.edu/IbnAbbad.pdf>, consulté le 25 avril 2011.
66 Rémi Dewière
tique légaliste et très individualisée du soufisme est caractérisée par
la pratique même d’al-Šāḏili: “il appartient, avec les autres sûfî de sa
tendance, à une élite lettrée, le plus souvent urbaine, exerçant norma-
lement différentes fonctions religieuses ou sociales dans la cité.”96
Ce profil est celui que nous rencontrons chez Ibn Furṭū, dont la di-
mension citadine et lettrée, confirmée par son office d’imām al-kabīr
à Birni Ngazargamu, la capitale du Borno, est évidente. La conformi-
té à la šarī‘a d’Ibn Furṭū est quant à elle mise en avant par Zeltner,
qui affirme qu’il “se situe dans la ligne du plus pur ash’arisme.”97
En
effet, la toute puissance de Dieu dans les actions humaines et le rejet
de la logique et du raisonnement, tout comme le rejet de la révolte
contre le Sultan98
sont présents dans les Kitābs, notamment dans la
définition de l’imāmat vue précédemment et l’intervention divine
dans les victoires d’Idrīs Alawmā.
Une action d’Ibn Furṭū, décrite dans les Kitābs, appuierait une
identité soufie de notre auteur. Lors de la première campagne militaire
d’Idrīs Alawmā contre le sultanat du Kanem, l’imām profite d’une
halte en pays Kanem pour visiter une mosquée:
On the Saturday morning the big drum was beaten and the Sultan moved
south to Balagi. But the Imām al-Kabīr Aḥmad ibn Sofia, the writer of this
book, went off before the Sultan left, to the west of the stockade of Aghafi
accompanied by the Imam al-Saghir Muḥammad ibn Ayesha and their people
wishing to make a pilgrimage to the musjid (mosque) of Armi. They reached
the mosque and looked at it, and meditated on it knowing it to be indeed the
mosque of Armi.99
Durant ses recherches de terrain au Tchad, Zeltner a retrouvé les
ruines d’un bâtiment correspondant à la mosqué d’Armi, qu’il nomme
Erī, 100
validant ainsi son existence. Le mot traduit par Palmer comme
96 Hamès, “La Shâdhiliyya.” 97 Zeltner, Pages d’histoire du Kanem, p. 16; ce trait d’Ibn Furṭū n’est pas étonnant, compte tenu
de son appartenance au malīkisme: “Indeed the Shāficite Subkī (d. 771/1370) describes the
Mālikīs as the Ashcarites par excellence (akhaṣṣ al-nās bi’l-Ashcarī), explaining that he had
never heard of a non-Ashcarite Mālikī” (Michael Cook, Commanding Right and Forbidding
Wrong in Islamic Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 357). 98 Black, History of the Islamic Political Thought, pp. 83-4. 99 Palmer, Sudanese Memoirs, p. 29; Royal Asiatic Society, Arabic MS 29, f. 63v. 100 Zeltner, Pages d’histoire du Kanem, p. 151.
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 67
pilgrimage est ziyārā dans le texte d’Ibn Furṭū. Ce terme signifie vi-
site dévotionnelle, et renvoie aux pratiques soufies de visite des lieux
saints attestée sur des sites souvent identifiés comme étant les tombes
de walī, personnage charismatique soufi, ou un autel lui étant affilié.
Ces lieux étaient marqués par des monuments architecturaux dis-
tincts.101
Ici, le lieu de la visite effectuée par Ibn Furṭū est une mos-
quée, et aucune mention n’est faite d’une tombe de saint ni d’autel.
Cependant, le mot utilisé par l’auteur, ainsi que la description du dé-
roulement de cette visite, s’approchent de la pratique soufie. Une telle
pratique aurait été référencée plus tardivement sur la tombe de certains
souverains bornuans, comme ‘Alī b.
‘Umar (m. 1088/1677), qui serait
mort à l’Est du Caire à son retour de la Mekke, et dont la tombe a été
décrite comme le lieu d’un pèlerinage local du aux miracles qui
avaient eu lieu ici.102
Le dernier élément appuyant cette hypothèse
tient dans un maḥram, ces chartes de privilèges évoquées précédem-
ment. Hamidu Bobboyi identifie notre auteur dans la liste généalo-
gique des bénéficiaires du Maḥram of Humme Jilmi, traduit par Pal-
mer.103
Le bénéficiaire est ainsi “Aḥmad b. Muḥammad b. Walii b.
Farto b. Bitku b. Kukuli b. Farto b. Othman.”104
Dans cette liste, le
nom Aḥmad est remplacé par “Walii,” autrement dit walī, “ami [de
Dieu].” Les modèles patrilinéaires d’attribution du nom, du grand père
au fils,105
nous permettent aisément de remplacer le nom Walii par
Aḥmad (son petit fils s’appelant Aḥmad), donnant ainsi Aḥmad b.
Muḥammad b. Aḥmad b. Furṭū b. Bitku. Le surnom donné à Ibn Furṭū
à postériori est chargé de sens. En effet, le terme walī est utilisé par les
soufi pour qualifier un saint.106
101 John Renard, Historical Dictionary of Sufism, Scarecrow, Lanham, 2005, p. 248. 102 Lavers, “Adventures in the Chronology of the states of the Chad basin,” p. 260; Camillo
Beccari (ed.), “Rerum aethiopicarum scriptores occidentales,” Relation et Epitolae variorum,
v. 15, pars II, Liber I. Cette information est contredite par le lieu de mort du même souverain
donné dans le Dīwān, la liste royale des souverains Sefuwa: d’après cette dernière, il serait
mort dans la capitale du Borno, Birni Ngazargamu (Lange, Le Diwan, p. 81). 103 Herbert R. Palmer, The Bornu Sahara and Sudan. 104 Ibidem, p. 14. 105 A ce titre, l’exemple du nom d’Idrīs Alaoma est significatif: son nom est Idrīs b. ‘Alī b.
Idrīs b. ‘Alī. 106 Renard, Historical Dictionary of Sufism, pp. 90-1.
68 Rémi Dewière
Tous ces indices sont-ils suffisants pour affirmer qu’Ibn Furṭū est
soufi et de manière plus hypothétique un membre de la Šāḏiliyyā? Il est
difficile, avec les sources à notre disposition, d’en apporter d’avantage.
Ce qui est sûr, c’est qu’Ibn Furṭū n’ignore pas l’existence de penseurs
soufis et semble avoir adopté certaines pratiques mystiques, au point
d’être considéré comme walī à une période plus tardive. Les pratiques
soufies d’Ibn Furṭū pourraient se rapprocher de la pratique très person-
nelle des mystiques inspirés par les enseignements d’al-Šāḏilī, caracté-
risée par une intériorisation de celle-ci et un respect profond de la šarī‘a
– al-Šāḏilī ne pensait-il pas que les saints étaient, à l’image des pro-
phètes, chargés de commenter et prescrire les lois religieuses à la com-
munauté?107
Cette pratique, bien souvent très éloignée des confréries
organisées et hiérarchisées, limite les manifestations mystiques dans les
sources et ne nous permettent pas de confirmer cette affiliation. Cepen-
dant, l’hypothèse d’une présence des idées mystiques à travers la cul-
ture de l’écrit au XVIe siècle nous permet d’intégrer le Borno à un es-
pace sahélien plus large, de la Mauritanie à Tombouctou, où le sou-
fisme s’est manifesté de manière précoce, notamment via la pensée
šāḏilī, bien avant la ṭarīqa Qadiriyya. Cette intégration pourrait dès lors
être une conséquence du grand dynamisme de la Šāḏiliyyā au sein des
élites du monde arabe, de l’Egypte au Maroc, dès le XIVe siècle. Ce
dynamisme ne pouvait ne pas avoir atteint le Sud du Sahara, et con-
firme la circulation des idées et des livres via les routes du pèlerinage et
le commerce transsaharien dès le XVIe siècle.
Pour ce qui est du Borno, l’étude des références littéraires d’Ibn
Furṭū confirme la double influence des égyptiens et des maghrébins à
la cour des Sefuwa.108
L’auteur des Kitābs, fort d’une formation pous-
sée en grammaire et philologie, nous a livré un témoignage unique
d’une grande qualité. Si certaines de ses références sont largement dif-
107 Richard J. A. McGregor, Sanctity and Mysticism in Medieval Egypt, The Wafā’ Sufi Order
and the Legacy of Ibn ‘Arabī, State University of New York Press, New York, 2004, p. 43. 108 Cette influence égyptienne est soulignée à une époque plus ancienne par Dominique Urvoy,
sur la foi d’un témoignage d’al-‘Umarī (m. 749/1349): “Or ce même auteur […] affirme que le
souverain du Kanem est chafiite. […] S’il ne s’agit pas là d’une simple erreur, cela signifie qu’à
côté du rite dominant, des docteurs influencés par l’Egypte avaient droit de cité jusqu’à la cour”
(Urvoy, “Modes de présence de la pensée arabo-islamique,” pp. 130-131).
Aḥmad b. Furṭū, portrait d’un ‘ālim soudanais 69
fusées dans les bibliothèques africaines aujourd’hui, à l’image de al-
Qāmūs al-muḥīt d’al-Fīrūzābādī ou du Qaṣidāt al-Burda d’al-Būṣīrī,
d’autres semblent inédites.
Dans un article publié récemment dans l’ouvrage collectif The
Trans-saharan Book Trade, Manuscript Culture, Arabic Literacy and
Intellectual History in Muslim Africa, Bruce C. Hall et Charles C.
Stewart ont tenté de dresser la liste des ouvrages de référence étudiés
par les étudiants et savants musulmans d’Afrique de l’Ouest109
. Cette
liste, construite à partir d’un référencement des manuscrits les plus
diffusés au Sahel dans les bibliothèques actuelles et des annotations
bibliographiques de quatre savants ouest africains ( Abd al-Raḥmān
al-Sa dī [m. 1065/1655-6], al-Ṭālib Muḥammad al-Bartilī [m.
1221/1805], ‘Abd Allāh b. Fūdī [m. 1244/1829] et al-ḥāğğ Umar Tall
[m. 1281/1864]), constitue un tronc commun « sahélien » des sciences
islamiques. L’étude des références littéraires présentes dans les Kitābs
montre qu’Aḥmad b. Furṭū puise dans de larges parties de ce savoir,
sans se limiter à celui-ci puisque sur douze références relevées dans
les Kitābs, six ne font pas partie des auteurs recensés par Bruce C.
Hall et Charles C. Stewart. Par ailleurs, l’ancienneté d’Aḥmad b. Furṭū
par rapport aux savants sahéliens sélectionnés lui confère une grande
importance: elle vient confirmer que la littérature des sciences isla-
miques a déjà largement pénétré le Sahel durant le XVIe siècle, et qu’il
existe une certaine continuité entre notre auteur et les auteurs suivants,
même s’il semble qu’Aḥmad b. Furṭū puise dans un catalogue de réfé-
rences qui lui est propre.
Enfin, les influences soufies dont semble être empreint Ibn Furṭū
nous amènent à revoir notre connaissance du développement de
l’islam au Borno. En effet, les écrits soufis et certaines de ses pra-
tiques semblent avoir précédé la fin du XVIIe siècle et l’arrivée de la
Qādiriyya d’au moins un siècle. Ibn Furṭū n’est probablement pas le
seul ‘ālim du Borno à être influencé par le mysticisme à cette période,
comme le laisse suggérer la foule qui l’accompagne lors de son pèle-
rinage mineur. Nous ne pouvons donc pas nous passer d’une telle in-
formation pour comprendre les raisons de la rédaction des Kitābs ainsi
109 Hall – Stewart, “The historic “Core Curriculum’ ,” pp. 109-174.
70 Rémi Dewière
que son alliance avec le sultan Idrīs Alawmā, d’autant que son règne
est particulièrement important dans l’histoire du Borno et implique de
nombreux changements sociaux-religieux, ainsi qu’un développement
des relations internationales avec deux états musulmans, l’empire Ot-
toman et le Maroc. Les traces évoquant l’appartenance soufie du pre-
mier personnage religieux du sultanat de Borno dans les années 1570
ont sans aucun doute des conséquences importantes dans les relations
entre religion et pouvoir110
et s’inscrivent dans un contexte islamique
plus large, à une période où les équilibres politico-religieux changent
radicalement du Nord au Sud du Sahara. Cette question apparaît être
un point non négligeable de l’étude du Borno à l’époque moderne.
110 Black, History of the Islamic Political Thought, pp. 128-129.