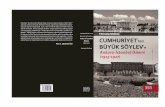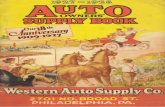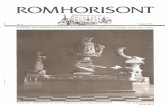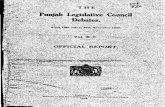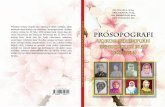L'espace comme Ma : notes sur une scène d'un film de Teshigahara (1927-2001)
Transcript of L'espace comme Ma : notes sur une scène d'un film de Teshigahara (1927-2001)
Pratiques de la transgressiondans la littérature et les arts visuels
Actes du colloque intemational«Les transgressions verbi-voco-visuelles»
Faculté des Lettres, Langues et Sciences humainesUniversité d'Orléans21 et 22 juin 2007
sous la direction deHéliane Ventura
etPhilippe Mottet
••
Einftant même
L'espace comme Ma:notes sur une scène d'un tUm de Teshigahara
(1927-2001)
Yasuko Ôno-DescombesUniversité d'Orléans
Introduction
McLuhan a sotiligné la différence entre la conception occidentalede l'espace et celle de la culture extrême-orientale. D'après lui, lapremière est avant tout visuelle et statique, alors que la secondeest plutôt celle d'un agencement dynamique. Il écrit: «The Westspeaks of"space": the East speaks of"spacing".» À cette occasion,ilparle du Ma des Japonais. Par exemple, « the "Ma" of architectureis defined [ ... ] as the spacing between pillars » (McLuhan, 1971)~Enfait, le mot Ma japonais s' appliqu.e aussi bien aux relations spatialesqu'aux relations chronologiques.l.}jntervalle appelé Ma a toujoursété compris aussi bien comme urt espace séparant deux objets quecomme le temps qui s' écoule entre deux actions.
Le dictionnaire des lexiques japonais Kôjien, qui est unéquivalent du Littré en japonais, relève huit significations du motMa: a) l'intervalle entre deux choses,. b) une certaine unité demesure traditionnelle,. c) la pièce dans une maison,. d) un certaintype d'intervalle, dans la musique et la danse traditionnelles,. e) untemps de silence dans la diction;.f) le « temps de », au sens où il estopportun ou inopportun; g) lafaçon bonne ou mauvaise dont «ça se
103
Pratiques de la transgression dans la littérature et les arts visuels
présente », dont on se sent; h) le mouillage (l'abri côtier ) (traductiond'Augustin Berque, Berque et Sauzet, 2004 : 29). Malheureusement,comme Berque l'a déjà constaté, «cela n'aide guère à saisir unsens général» (~bid), c'est pourquoi il a entrepris de nous rendrela sémantique du Ma tout au long de son ouvrage. Quant à moi,j'aimerais tout simplement souligner une dimension qui me sembleincontournable lorsque nous voulons transposer culturellement cemot: ils'agit de l'expérience du corps propre, et plus précisémentl'expérience des mouvements du corps propre, une expérience quiest indissolublement celle d'un espace à franchir et d'un temps del'action. C'est ce que l'anthropologu~ américain (et théoricien dela «proxémique») Edward T. Hall (1971) a appelé «l'expériencekinesthésique». Le mot «kinesthésique» est un terme provenant dela neuroscience qui désigne les sensations internes provoquées parles mouvements du corps [du grec kinein, «bouger» et aisthesis,« sensation» J. Ainsi, la sémantique du Ma est différente de la notionoccidentale de l'espace. Dans le Japon d'aujourd'hui, pour traduirela conception occidentale de l'espace et du temps, on dispose determes qui sont des néologismes· apparus lors de la modernisationdu Japon durant la deuxième moitié du 19" siècle!. En revanche,le mot Ma est une expression qui existe depuis les temps les plusreculés et qui est ancrée dans la vision traditionnelle du Japon2
•
Bien évidemment, le problème d'expliquer le sens du Ma dépasselargement la simple question de traduction d'un mot. Il s'agit decomparer des visions culturelles.
Par ailleurs, nous sommes au 21e siècle, et depuis plus d'unsiècle le Japon a adopté officiellement la vision moderniste qui estcelle de l'Occident. En adoptant un point de vue comparatiste surla question de la synthèse entre modernité et tradition au sein dela culture japonaise, je vais examiner la manière de traiter l'espace
1. Pour désigner l'espace, on emploie le terme /cû-kancomposé des idéogrammes/cû (vide) et ma (espace), et pour le temps, celui dejikan composé deji (temps)et ma (espacement). Le mot Ma est ici collé à un autre idéogramme et saprononciation devient <~kan».
2. Bien que le Japon soit redevable à bien des égards à la Chine pour ce qui estde sa culture, le mot Ma est une expression employée uniquement au Japon,non en Chine.
104
L'espace comme Ma
chez un artiste japonais contemporain dont les œuvres accomplissentquelque chose comme une fusion créatrice de la modernité et dela tradition.
Cet artiste japonais est Hiroshi Teshigahara (1927-200U. Onpeut çonsidérer le travail de Teshigahara comme une tentative detrouver une expression moderne en prenant appui sur un élémenttraditionnel. Il est l'un de ces artistes japonais qui ont cherché uneexpression artistique moderne tout en tenant compte de la puissancede la tradition. Pour présenter sa vision, nous nous arrêterons surune petite séquence de son œuvre cinématographique. Nous verronscomment cette séquence constitue une réappropriation filmique dela notion traditionnelle de Ma.
Teshigahara
Le cinéaste Teshigahara s'est fait connaître sur le planinternational tout d'abord par son film intitulé La Femme des sablesréalisé en 19643 d'après le roman du même nom écrit par Kôbo Abe(1924-19934
). Ce film, qui est une sorte de parabole singulière, estconsidéré comme appartenant au genre de la «nouvelle vague»japonaise.
Le film dont est tirée la séquence qui nous intéresse aujourd'huiest un drame historique qui raconte la vie d'un maître de thé. Cefilm historique est adapté d'un roman de Yaeko Nogami (1885-1985) intitulé Hideyoshi et Rikyû (19645
). Il a été t~urné en 1989. Ilraconte la vie hors du commun d'un maître de la cérémonie du thé du16e siècle nommé Rikyû6 et sop.rapport avec le plus puissant seigneur
3. Le film a obtenu le prix spécial du jury à Cannes en .1964.4. À l'époque, le cinéaste ne traitait aucun sujet touchant à la tradition esthétique
japonaise. Sa préoccupation était plutôt de créer un univers mélangé deréalisme et de fantaisie. Et cela, pour soulever la question de l'identitéindividuelle, voire la question de la perte d'identité dans le Japon moderne,ou plus précisément dans le Japon de l'après-guerre.
5. Son titre original est Hideyoshi to Rikyû.6. Son nom complet est Sen no Rikyû (Sen est son patronyme).
105
Pratiques de la transgression dans la littérature et les arts visuels
de guerre de l'époque, le dénommé Hideyoshf. La cérémonie du thé,qu'on appelle en japonais Cha no yu (littéralement «l'eau chaudede thé») est une pratique typiquement japonaise qui consiste en unrituel de préparâtion et de consommation du thé. Cette pratique a étéétablie définitivement dans la forme qu'on lui connaît aujourd'huipar le maître Rikyû, le héros du film.
Fils d'un maître de l'art pes bouquets de fleurs, le cinéasteTeshigahara ne pouvait ignoter la puissance d'une longue traditionesthétique au Japon. Mais au ·lieu de se consacrer uniquement àla création florale, il a également cherché à développer sa propreforme d'expression artistique dans le cinéma. Par ailleurs, il a étéaussi artiste plasticien et a réalisé plusieurs installations avec desvégétaux (des bambous).
Vu le milieu où Teshigahara a grandi, l'on peut imaginer facile-ment que ce thème de la créativité artistique dans le Japon traditionnell'a intrigué depuis toujours. Il faut souligner que le maître de thé Rikyûa concrétisé un goût qualifié de typiquementjaponais, goût tourné versla beauté sobre émanant de 1'harmonie avec la nature environnante.Cegoût est aujourd'hui connu sous le terme de wiibi: une notion àla fois esthétique et morale.·Le mot wabi désigne en effet «le goûtpour la simplicité, le dépouillement, voire l'austérité des formes, descouleurs et des matières, à travers lesquelles s'exprime la beauté etmême un idéal moral8» (Berque, 1994: 512).
Cette pratique perdure jusqu'à aujourd'hui, quoique depuislongtemps déjà le contexte historique et social ne soit plus èelui del'époque des fondateurs. Mais l'esthétique de la cérémonie du théwabi a été cultivée sous les auspices des amateurs de thé durantles cinq derniers siècles. Elle peut être tenue pour caractéristiquede la sensibilité propre aux Japonais. Et cela d;autant plus qu'elleintègre la conception de l'espace et du temps des Japonais: l'espaceclos/délimité et le temps cyclique, tous deux étroitement liés àl'expérience sensible de l'homme.
7. Son nom complet est Toyotomi Hideyoshi (Toyotomi est son patronyme).8. C'est pourquoi la cérémonie du thé de Rikyû est aussi appelée le w,abi cha,
« la cérémonie du thé dépouillée)}.
106
L'espace comme Ma
Ceci veut dire que l'espace et le temps tels qu'ils sont comprisdans la cérémonie du thé contiennent l'élément archaïque de laculture traditionnelle. Mais, depuis la deuxième moitié du 19c siècle,avec le basculement de la culture vers le monde occidental, lesJaponais ont adopté désormais les conceptions du temps et del'espace de l'Occident moderne. La question que l'on va poser iciest de savoir comment, dans cette coexistence des deux visions- d'un côté la traditionnelle et d'un autre l'occidentale - au seind'une même culture, l'artiste Teshigahara a façonné sa synthèse.Alors même qu'il avait recours aux ressources du cinéma (inventionoccidentale), il a cherché à figurer une interaction des personnagesdans un espace conçu à la manière traditionnelle, en l'occurrence,ici, par référence à la cérémonie du thé.
Une séquence du film: l'empreinte personnelle deTeshigahara
Teshigahara a entr,epris de raconter avec les moyens ducinéma la vie de Rikyû qui a été une lutte perpétuelle pour menerà bien sa conviction esthétique. Dans ce drame, il y a une séquencesur laquelle je voudrais m'arrêter. Les protagonistes de l'histoiresont Rikyû et Hideyoshi, l'homme fort de l'époque. Ce dernier adésigné Rikyû comme son maître de thé. La chose étonnante, c'estque Rikyû joua auprès de Hideyoshi non seulement le rôle d'unmaître de thé, mais aussi celui d'un conseiller, c'est-à-dired'un homme d'influence. Le hasard du temps a fait de Rikyû le pluspuissant maître de thé que le Japon ait jamais connu. Mais le goûtdu &eigneurn'était pas forcément le Plême que celui de son maîtrede thé. Entre ces deux hommes, le conflit était sans doute inévitable,et leur relation n'a cessé de s'envenimer: l'histoire se termine parla condamnation à mort de Rikyû par Hideyoshi.
En plein milieu du récit de cette histoire, il y a une scèneparticulière qui nous arrête par la qualité de sa construction visuelle.La séquence montre le couple de Rikyû et sa femme se trouvantdans une sorte d'enclos, situé à l'intérieur d'une pièce de lamaIson.
107
Pratiques de la transgression dans la littérature et les arts visuels
Cette séquence enchâme les scènes suivantes. D'abord, nous. voyons le couple dans une pièce à tatami. Rikyû fait savoir à safemme qu'il accepterait d'être condamné par Hideyoshi plutôt quede lui demander sa grâce pour un crime qu'il n'a pas commis. Lascène suivante montre Hideyoshi et sa femme déçus de constaterque la lettre envoyée par la femme de Rikyû ne demande pas lepardon de Hideyoshi. Enfin nous 'voyons une scène qui changebrutalement de registre. Cette scène ne dure que vingt secondes.Pour des raisons que je vais maintenant expliquer, je l'appelleniila scène de l'écran.'
Cette scène montre une installation faite de panneaux de formesirrégulières, une sorte d'écran en papier soutenu par des châssis enbois. C'est une espèce de shôji (porte coulissante traditionnelle entreillis tendu de papier), légèrement déformé. Cet objet envahitla pièce de la maison. Au premier coup d'œil, cette installationest tout à fait incompréhensible. Malgré tout, on peut tenter dedonner une interprétation de cette scène en se disant que Rikyû etsa femme sont en train de retapisser des shôji, ce qui est un travail
" annuel qui marque l'arrivée du printemps (Nouvel An) dans leJapon traditionnel. En fait, Rikyû est mort au mois de février 159i,donc avant le temps des travaux marquant la nouvelle année selonle calendrier traditionnel. C'est le privilège du cinéaste de pouvoirinventer cette scène pour les besoins de sa création.
Néanmoins, il reste. à' expliquer pourquoi ces shôji (cespanneaux) sont déformés, et aussi pourquoi ils sè trouvent àl'intérieur d'une pièce au lieu d'être au seuil de cette dernière commeil conviendrait. Dans cet espace - qui fait l'effet d'une sorte d'écranà moitié transparent - on voit les deux silhouettes, celle de Rikyû etde sa femme, éclairées par la lumière venant de l'intérieur. Cela nousfait bien entendu penser à un jeu d'ombres chinoises. Cela nous faitaussi penser à une énorme lanterne tournante telle qu'on la connaîtdans la tradition extrême-orientale9
• Mais ce qui nous intéressesurtout, c'est le fait que cette scène, construite uniquement SUI des
9. On peut retrouver la tradition de la lanterne tournante jusqu'à l'originebouddhique du Tibet (associée à l'idée de réincarnation).
108
L'espace comme Ma
effets visuels et sonores, peut être interprétée comme une mise entreparenthèses du monde extérieur, une façon de placer le couple dansun espace à la fois irréel et hors du temps. Cette impression est aussisoutenue par l'effet d'une bande sonore (réalisée par Takemitsu)avec une acoustique particulière.
Cette scène nous intrigue d'abord par le. côté hybride desmoyens qu'elle implique. Pourtant, graduellement, elle finit parnous convaincre: elle nous apparaît comme la mise en scène del'intimité du couple. Apparemment, la voix de la femme de Rik:yûest gaie, apaisée. Quant à Rikyû, on entend dans sa voix quelquechose comme un signe d'acquiescement. Leur conversation résonnecomme s'ils étaient dans un espace clos, voire daris une capsulecomplètement isolée du monde extérieur, loin du monde trivial.Et nous, les spectateurs, comprenons alors que le couple partageun moment de bonheur d'autant plus précieux qu'il est éphémère.
Paradoxalement, cette scène elliptique est riche d'informations:le bonheur éphémère du couple est décrit par le jeu de l'ombre etde la blancheur des panneaux en papier, ce qui crée la sensationd'un espace clos mais fragile, une impression que renforce la bandesonore qui résonne.
Dans cette scène de l'écran, nous sommes face à un espacesymbolique façonné par la construction d'un ordre qui appartientaux territoires des arts plastiques. L'idée que je défends ici est qu'untel espace nous aide à concevoir la sémantique du mot japonais Ma,dont la notion comprend l'espace, le temps et l'expérience (ou laprésence) physique des hommes.
Ce que signifie la scène de l'écran•
Ainsi, dans cet écran, Teshigahara présente la notion del'espace Ma d'une manière exagérément épurée. En résumé, voiciles trois aspects du Ma que je découvre en me référant à la scène.
D'abord, un Ma compris comme un espace: ilest littéralementun espace dans la pièce de la maison. Au Japon, l'architecturetraditionnelle est soutenue par des piliers. L'espace entre un pilieret un autre peut être appelé un Ma. Un Ma dans le sens d'un espace
109
Pratiques de la transgression dans la littérature et les arts visuels
délimité peut être créé par des portes coulissantes (jusuma ou shôji).Une pièce, dans une maison japonaise, est un espace ouvert à peinecloisonné par des panneaux coulissants en bois et en papier. Quandon le compare avec celui de la maison occidentale bâtie avec desmurs fixes, il y a un 'contraste bien net entre les deux. L'espaceque l'on voit dans cette séquence ne peut être autre chose qu'uneinterprétation exagérément symbolique de la notion japonaise de
l
l'espace. 'Ensuite, un Ma compris comme un temps: c'est le moment
mis entre parenthèses du temps de la vie du couple dans la scènedu film. Par ailleurs, c'est aussi une suggestion du cycle de la viecar le travail de retapisser les shôji évoque la saison du printemps,il dénote donc le cycie cosmique. En effet, dans la perspectivejaponaise, le temps décrit une boucle. Sur ce point, si l'on tentede faire la comparaison iconologique du traitement de la notiondu temps entre celui du Japon et celui de l'Occident moderne,dans la culture occidentale, voire dans son iconographie, on peutmentionner les œuvres picturales dans lesquelles, comme Panofskyl'a jadis suggéré (1967: 105-135), le temps est représenté sous lestraits d'un vieillard. Souvent dans la symbolisation, la traditionoccidentale s'appuie sur une conception linéaire du temps, alorsque les Japonais attachent une importance parfois un peu exagéréeaux rites annuels et autres cérémonies périodiques qui soulignentla nature cyclique du temps (Takashina, 1997: 60).
Enfin, dernier élément indispensable pour la conceptiondu Ma, l'expérience de se mouvoir: la notion autochtone de~
. l'espace est étroitement liée aux gestes des occupants, à leursmouvements dans ce lieu et pendant cet intervalle de temps. Dansle cas de la cérémonie du thé, le Ma signifie à la fois la maîtrisedu territoire de la pièce à thé et les gestes de chaque participant.Malheureusement, je n'ai pas trouvé de scènes appropriées dansce film pour illustrer cet aspect. Mais dans la séquence que j'aidécrite, on voit le couple s'affairer à tapisser un écran en papier.C'est une dimension inhérente au Ma. Hall a mentionné cet aspectà propos des anciens architectes japonais. Il notait « [qu'ils] avaientmanifestement entrevu la connexion de l'expérience kinesthésiqueet de l'expérience visuelle de l'espace» (1971: 73). Il l'expliquait
110
L'espace comme Ma
amsI: « Leurs jardins ne sont pas conçus pour être appréhendésseulement par la vue: un nombre peu commun de sensationsmusculaires participe a la saisie d'un jardin japonais au cours d'unepromenade» (ibid.). Cela veut dire que la notion autochtone du Maconçoit l'espace et le temps en passant par une autre dimension quiest le principe de la configuration sémantique du Ma. Et cette autredimension est celle de l'expérience sensible du corps se mouvant,ou ce que Hall appelle « l'expérience kinesthésique ». La scène enquestion exprime tacitement cette vision. Le sens de cette brèvescène est ainsi de représenter ou de traduire un élément de la culturetraditionnelle dans le langage des formes du modernisme.
Le problème que nous pose cette notion du Ma est avant tout,comme j'ai essayé de le montrer, un problème de traduction. Direqu'il s'agit de l'espace ou de l'espace-temps n'est pas suffisant.Pour aller plus loin, j'ai cherché dans les formes des arts plastiquesl'équivalent d'un travail de traduction philologique et j'ai commentéune scène d'un film de Teshigahara, scène traditionnelle par lethème, moderne par le traitement de ce dernier. l'espère avoir par làéclairé le sens du Ma grâce au travail de ce cinéaste profondémentancré dans la configuration culturelle japonaise de tradition et demodernité.
Références
BERQUE, Augustin, 1982, Vivre l'espace au Japon, Paris, Pressesuniversitaires de France.
---, 1986, Le sauvage et 1~artifice. Les Japonais devant la nature,Paris, Gallimard. !'
--- (dir.), 1994, Dictionnaire de la civilisationjaponaise, Paris, Hazan.
BERQUE,Augustin et Maurice SAUZET,2004, Le sens de l'espace au Japon.Vivre, penser, bâtir, Paris, Éditions Arguments.
GERNET,Jacques, 1974, «Petits écarts et grands écarts», dans Jean-Pierre, VERNANT(dir.), Divination et rationalité, Paris, Seuil.
HALL, Edward T., 1971, La dimension cachée, Paris, Seuil.
111
Pratiques de la transgression dans la littérature et les arts visuels
McLUHAN, Marshall et Wilfred WATSON,1971,From Cliché to Archetype,New York, Pocket Book.
NOGAMI,Yaeko, 1964, Hideyoshi to Rikyû, Tokyo, Chûôkôron-sha.
PANOFSKY,Etwin, 1967,Essais d'iconologie. Les thèmes humanistes dansl'art de la Renaissance, Paris, Gallimard.
SHINMURA,lzuru (Ed.), 1974, Kôjien, Tokyo, Iwanami-shoten.
TAKASHINA,Shûji, 1997, «Le patri,m6ine de la mémoire», Cahiers duJapon, n° 72, été: 56-64. .
TESIDGAHARA,Hiroshi (réalisation), 1989,Rikyû, G. Akasegawa (scénario),T. Takemitsu (musique), Japon, Shochiku, 135 min. <www.sogetsu.or.jp/teshigaharahiroshi. corn>.