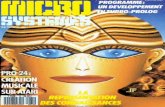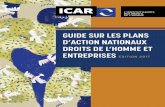Les Systèmes Nationaux d'Innovation entre Territorialisation et Développement local
-
Upload
univ-lille1 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Les Systèmes Nationaux d'Innovation entre Territorialisation et Développement local
1
LLEESS SSYYSSTTEEMMEESS NNAATTIIOONNAAUUXX DD’’IINNNNOOVVAATTIIOONN ((SSNNII)):: EENNTTRREE
TTEERRRRIITTOORRIIAALLIISSAATTIIOONN EETT GGLLOOBBAALLIISSAATTIIOONN..
DJEFLAT, A. “Les Systèmes Nationaux d’Innovation: entre globalisation et territorialisation » in Michel Rautenberg (dir.) Dynamiques locales et Mondialisation, N°Spécial, Revue CLES, l’Harmattan, Octobre 2003, pp. 131-153
Résumé :
Le système national d’innovation (SNI) dont la première approche intégrée nous
vient de Lundvall (1985) met en relation trois sphères : la sphère productive (le
contexte économique et la structure industrielle), la sphère de la formation (la
formation et la qualité des ressources humaines) et la sphère de la recherche (la
coopération entre les entreprises et les institutions publiques de recherche). Sa
caractéristique majeure, notamment dans sa forme initiale, est son enracinement
dans un espace national. L’aspect national est central dans la mesure où le
développement technologique et les flux entre firmes apparaissent plus
fréquemment dans les frontières nationales que par rapport à l’extérieur.
Cette notion qui a connu un grand succès pour expliquer les performances
remarquables des pays avancés en matière d’innovation a attiré un nombre
conséquent d’analystes pour expliquer les faibles performances des pays en
développement en la matière. Depuis quelques années, elle commence à être
sérieusement remise en cause. Elle rencontre d’énormes difficultés à intégrer, dans
sa forme actuelle les nouveaux cycles de la recherche résultant de la globalisation.
Par ailleurs, l’émergence des dynamiques locales (districts, milieux innovateurs etc.)
disqualifie le niveau national comme seul espace pertinent dans les processus
d’innovation.
2
Notre contribution tentera de montrer les dimensions de cette double pression que
subit le SNI et à en tirer brièvement quelques conséquences pour les PED.
Mots clés :
Système national d’innovation, recherche et développement, globalisation,
territorialisation, système local de production, système local d’innovation, PED,
3
Le système national d’innovation (SNI) a bénéficié d’un intérêt soutenu qui se
reflète à travers notamment une littérature abondante. Le schéma classique du SNI
met en relation trois sphères : la sphère productive (le contexte économique et la
structure industrielle), la sphère de la formation (la formation et la qualité des
ressources humaines) et la sphère de la recherche (la coopération entre les
entreprises et les institutions publiques de recherche). Toutefois pour les
concepteurs du SNI, l’aspect national est central dans la mesure où le
développement technologique et les flux entre firmes apparaissent plus
fréquemment dans les frontières nationales que par rapport à l’extérieur.
Cette notion, qui a connu un grand succès auprès des analystes pour expliquer à la
fois le blocage de l’accumulation technologique endogène des pays en
développement et le succès des pays avancés, commence à être sérieusement remise
en cause par un double phénomène celui de la globalisation d’une part et celui de la
territorialisation de l’autre. Les concepteurs eux-mêmes reconnaissent la vision
étroite qui a prévalu à sa production. Conçue essentiellement pour expliquer les
dynamiques nationales d’innovation, elle ne peut intégrer dans sa forme actuelle ni
un certain nombre de phénomènes mondiaux dont elle ne peut être dissociée
surtout si l’on résonne en termes de filières, ni les nouveaux cycles de la recherche
au plan mondial. Dans ces relations, l’aspect international ne peut être négligé, en
particulier pour ce qui concerne le rôle joué par les pays les plus industrialisés pour
influencer et orienter recherche et développement (R&D) d’une manière
significative. Par ailleurs, l’émergence des dynamiques locales (districts, milieux
innovateurs etc.) disqualifie le niveau national comme seul espace pertinent dans les
processus d’innovation. Après une brève présentation du SNI dans sa forme
classique, nous montrerons dans une seconde partie les défis que pose l’émergence
des dynamiques locales d’innovation et les remises en causes qu’elles impliquent.
Une troisième partie examinera le phénomène de globalisation de la recherche et
développement et de l’innovation, qui est un des piliers essentiels de son activité, et
l’éclatement de sa base nationale qui constitue l'un des fondements même de son
existence. Nous conclurons sur les conséquences de ces transformations sur les
pays en voie de développement.
4
LE FONDEMENT NATIONAL DU SNI
Le SNI a bénéficié d’une littérature assez vaste et variée ces dernières années. Différents aspects ont été examinés : le rôle des départements de R&D dans les entreprises, l’importance des réseaux scientifiques, le concept de système technique, le rôle de la science, le rôle de l’Etat dans la promotion de l’innovation, l’importance des alliances techniques etc. (Freeman : 1972, Von Hippel : 1976, Gilles : 1978, Mowery and Rosenberg : 1979, Nelson : 1982 and 1993, Niosi and Faucher : 1991). La première approche intégrée du SNI nous vient toutefois de Lundvall (1985) revue et améliorée les années 90 pour les PVD.
Le schéma classique du SNI met en relation trois sphères (schéma 1). La sphère
productive qui se compose essentiellement du système productif; la sphère de la
formation et la qualité des ressources humaines constituée essentiellement du
système éducatif et de formation, et la sphère de la recherche qui implique les
institutions de recherche quel que soit leur statut (centres de recherche, universités
ou départements de recherche en entreprise).
S p h è re sc ie n t i f iq u e e t F o rm a tio n ts c ie n t i f iqsc ie n t i f ictra in in g te c h n ic ph e re
S p h è re in d u s tr ie l lein d u s tr i ie e l le e l le
(x ) ( )
S p h è re e se a rc h a n d R e c h e rc h e é v e lo p p e m e n t d é v e lo pp e m e n t
(z )
S Y S T E M E N A T IO N A L D ’ IN N O VA R A T IO N
S c h é m a 1 : S y s tè m e N a t io n a l d ’ I n n o v a t io n E x té r ie u r
(a )
( I )
(1 )
(2 ) (3 ) ( I I ) (c ) (b ) ( I I )
Source : A. Alcouffe (1994)
5
Dans ces relations, l’aspect international semble être négligé. Pour les concepteurs
du SNI, “l’aspect national est central dans la mesure où le développement
technologique et les flux entre firmes apparaissent plus fréquemment dans les
frontières nationales que par rapport à l’extérieur » (Lundvall cité par BELLON et
al. 1991)1. Initié à partir des théories systémiques et évolutionnistes, ce concept est
basé sur l’idée que les éléments systémiques dans les économies nationales sont
plus importants que les éléments d'interaction entre les économies de différents
pays. Les interactions se font essentiellement entre producteurs - utilisateurs
d’innovations (Lundvall) (BELLON et al., 1991), doublés de liens particuliers entre
institutions sociales et politiques (Freeman), et soutenues par des politiques
nationales de coordination et financement de la R&D (pour Nelson). Le SNI
regroupe ainsi à la fois un système technologique et des politiques publiques de la
recherche scientifique et technique (c’est-à-dire les structures formelles), des
réseaux d’interaction entre utilisateurs et producteurs et les relations inter
institutionnelles en formation, financement, diffusion de l’innovation et structures
productives (LUNDVALL, 1992). Trois logiques se combinent harmonieusement :
une logique technique, une logique productive et une logique institutionnelle
(CARRE, 2001).
Le contenu du système technologique désigne un groupe d'artefacts caractérisé par
une cohérence technique entre ses composantes. Le support du système
technologique désigne l'ensemble des institutions qui canalisent le développement
des techniques dans l'économie et la société. Dans le cadre du capitalisme
industriel, le développement des technologies est impulsé principalement par les
firmes. Mais, ces firmes "baignent" dans un contexte spécifique marqué par
l'existence d'un ensemble d'institutions (laboratoires de recherche publics,
universités, ministère des armées, etc.) qui constituent le support du système
technologique.
Chaque institution génère ses propres langages et connaissances de sorte que les
mécanismes d'accumulation du savoir sont multiples, spécifiques et orientés. Le
marché ne peut à lui seul assurer la coordination de ces différentes sources
1 B. BELLON, M. CROW, G. NIOSI, P. SAVIOTTI, “ Les systèmes nationaux d'innovation : unité et diversité ”, Problèmes Economiques, n° 2.311, 3-02-91.
6
d'opportunités technologiques et le paradigme traduit l'existence de mécanismes de
coordination entre les institutions elles-mêmes et entre les institutions et le marché.
I. LES DEFIS DES DYNAMIQUES LOCALES D’INNOVATION
De nouvelles approches en termes d’innovation localisée attirent de plus en plus
l’attention et prennent le devant de la scène. Elles remettent sérieusement en cause
la dimension nationale du système d’innovation et lui substituent parfois la notion
de dynamiques locales d’innovation ou même système local d’innovation. Pour bien
comprendre les remises émanant, il est important d’examiner brièvement la
structuration et les fondements de la polarisation locale ou territoriale de
l’innovation d’une part et les modes de coordination et d’apprentissage de l’autre.
Les approches en termes d’innovation localisée reposent souvent sur les approches
plus globales des dynamiques localisées de développement et en constituent
également l’un des principaux arguments. Les externalités, qui fondent les
mécanismes de polarisation des activités économiques, et les formes très
spécifiques d'organisation dont elles émanent permettent une coordination
harmonieuse et une plus grande efficacité productive et innovante.
Polarisation spatiale de la production et de l'activité innovante
Les modes particuliers d’interaction entre firmes et espace peuvent donner lieu à
des externalités qui contribuent à des performances économiques et innovatrices
relativement exceptionnelles. A l’intérieur d’un territoire, certaines formes,
spatialement délimitées, d'organisation des activités économiques révèlent des
performances innovatrices remarquables. Ces dynamiques locales, axées autour des
externalités, résultent de la proximité géographique, notion qui est au cœur de ces
analyses. L’externalité positive a pour origine l’activité économique d’un agent
(consommateur ou producteur) sans qu’il en reçoive une récompense par
l’intermédiaire du marché. Plusieurs types d’externalités positives expliquent la
concentration spatiale des entreprises (PERRAT, 1993) : les externalités
pécuniaires, les externalités technologiques (MOHNEN, 1991), les externalités de
réseau ainsi que d’autres formes d’externalités qu’il est inutile de lister ici. Chaque
firme concernée va chercher à se positionner avantageusement par rapport à ces
externalités, qu’elles soient révélées ou latentes. Les entreprises vont ainsi mettre en
œuvre diverses stratégies qui peuvent aller de la prédation de ressources localisées à
7
une participation à leur mise en culture. Ces stratégies déterminent le degré et la
forme de l’organisation des activités économiques et innovantes sur un espace
donné (CARRE, 2001). L’étude de ces situations par la science économique révèle
plusieurs formes d’organisation localisée des activités. On peut les classer en deux
catégories principales : la première est caractérisée par une relative fermeture et une
forte endogénéisation du système mis en place alors que la seconde fonde la
création de ressources spécifiques et d’externalités positives grâce à une multiplicité
de liens extérieurs et notamment avec les acteurs mondiaux.
1. Les systèmes relativement fermés se composent d’abord des ‘districts industriels
de Marshall’ (MARSHALL, 1891) et des districts italiens. Les premiers sont basés
sur des externalités ayant une composante territoriale explicite: les producteurs
participant à une activité industrielle dominante dans un espace donné se
spécialisent dans une étape du processus productif. Les seconds (BECCANTINI,
1989) sont composés de petites entreprises d’une branche industrielle, spécialisées
et travaillant en interaction, avec un marché local du travail spécialisé. Ils sont
performants à l'exportation (BECCANTINI, 1989). Il faut souligner que la capacité
d’innovation diffuse est un élément central de l’autorégulation du district. En
second lieu, nous avons les ‘milieux innovateurs’ dont la dynamique industrielle,
fondée essentiellement sur l'innovation, se différencie des districts industriels en ce
sens qu’ils sont fortement marqués par une problématique d’économie régionale.
Le milieu “ apparaît comme un espace géographique restreint, défini a priori ”
(LECOQ, 1995) dans lequel se développe quasi-spontanément un ensemble
d’interdépendances fonctionnelles entre acteurs, basées sur leur appartenance à une
même entité territoriale et se caractérisant par l’utilisation des potentiels locaux et
par “ une combinaison de relations d’interdépendance entre des organisations
territoriales et un ensemble de réseaux ”, reliant des “ acteurs et des savoir-faire
diversifiés (production, services, recherche) ” (JOIGNAUX et THOMAS, 1991).
Ici, la notion de réseau d’innovation est au coeur de l’analyse des conditions de
territorialisation des firmes, et du fonctionnement de l’environnement de
l’innovation (LECOQ, 1995). On peut également y adjoindre les ‘technopoles’ qui
sont également des processus territorialisés d'innovation technologique qui
articulent de façon complexe les systèmes productifs, l'appareil de recherche et les
agents institutionnels locaux (GILLY, 1987) au niveau d’un territoire.
8
2. Les systèmes relativement ouverts sur l’international. On peut y inclure les districts
technologiques (PECQUEUR et ROUSIER, 1992) qui sont une réactualisation des
districts industriels, mais présentant en plus une articulation originale entre les
stratégies des grandes firmes multinationales (FMN) et un système productif local
innovant, générant des externalités technologiques. Chaque composante du district
technologique est intégrée dans un réseau international (PECQUEUR et
ROUSIER, 1992). Le district ne se renouvelle que s’il fait l’objet d’une régulation
locale assurée souvent par deux types d’institutions : les organismes de formation et
les collectivités locales qui apportent le savoir-faire et le sentiment d’appartenance à
une collectivité. Les collectivités locales ont un rôle de financement et de
représentation du territoire, et aident à la gestion du rapport entre le district
technologique et l’ensemble de la société. D’une manière indirecte, ils donnent lieu
à une disqualification de facto de la coordination centrale assurée généralement par
les institutions centrales de l’Etat. Pour les organes déconcentrés de l’Etat, la
délégation de pouvoir des formes négociées de coordination locale des activités du
territoire constituent un mode de coordination par proxi des pouvoirs centraux de
l’Etat. Exemple : les contrats de plan Etat Régions en France. Les institutions
décentralisées par contre, bénéficient de facto de cette adjudication du pouvoir de
coordination des activités locales sur le territoire. Le mode de coordination
principale du SNI est ainsi récupéré au niveau local. Mais c’est la quatrième
caractéristique qui nous interpelle le plus dans notre problématique : les districts
technologiques ont en effet, la capacité d’entretenir une relation complémentaire entre le
local et l’international. C’est un système ouvert, dont chacune des composantes est
intégrée dans un réseau international propre. Si la base sociale des districts
technologiques est une communauté professionnelle, territorialisée, c’est son
ouverture sur l’extérieur qui en fait parallèlement la force et la capacité à se
renouveler, à suivre l’évolution de la recherche technologique, (universités, écoles
d’ingénieurs etc.)
Ces diverses formes d'organisation du territoire, où les entreprises collaborent et
gèrent les ressources externes dans le sens de l'intérêt collectif, se distinguent par
une bonne coordination des firmes autour des externalités, par des interactions
marchandes ou non marchandes entre les différentes unités concernées par
l'activité productive et innovatrice (BELLON & PLUNKET, 1998). La plupart des
9
systèmes interagissent avec l'environnement, mais ces liens sont moins forts que
ceux existant entre les éléments du système. Ainsi, le système garde cohérence et
persistance dans le temps contribuant à la mise en place d’un système localisé
d’innovation (TORRE, 1993) . Des ‘rendements croissants de localisation’
apparaissent alors : les entreprises choisissent une localisation non plus uniquement
selon les avantages intrinsèques de l’emplacement considéré, mais en fonction du
nombre d’entreprises déjà implantées sur le site, dont elles savent qu’elles pourront
bénéficier quasi-automatiquement d’une partie du savoir. L’apprentissage collectif
est un véritable processus de conception, qui crée des ressources (compétences,
équipements) spécifiques donc adaptées et intégrées au contexte de production.
La rencontre productive (GAFFARD, 1993) peut correspondre à l’activation de
ressources génériques, par la spécification d’actifs, dans le cas d’une stratégie d’innovation
de la part de la firme, par la construction d’un territoire. Toutes les formes d’interaction
peuvent ici intervenir et se renforcer, externalités pécuniaires et technologiques se
combinant de façon dynamique, pour créer de nouvelles connaissances : c’est
l’aspect ‘construction de ressources’ qui prime, avec un effet en retour important
sur les possibilités de développement du territoire. L’apprentissage collectif devient
le mode de fonctionnement du territoire (COLLETIS, 1997).
L’endogénéisation peut provenir de procédures privées de caractère volontaire
(groupement des agents concernés par l’externalité, intégration du bien à l’origine
de l’effet), ou de procédures publiques mises en oeuvre par une collectivité ou son
autorité (CATIN, 1985). La coordination et la création d’un mécanisme de
représentation des divers intérêts deviennent indispensables : l'efficacité innovatrice
des différentes interactions, au sein d'un système localisé de production, suppose
un mode de coordination permissif des effets d’apprentissage inhérents à tout
processus de création technologique.
Coordination et apprentissage dans un système localisé de production et
d’innovation
Le concept de système d’innovation territorialisé, ou système localisé de production
et d’innovation (SLI)2 est la forme générique des différentes configurations
2 Nous ne retiendrons ici que l’appellation ‘système localisé d’innovation’, dans un souci de cohérence terminologique.
10
présentées précédemment. La notion, de proximité y joue un rôle primordial et
peut prendre des formes diverses : la proximité spatiale qui joue comme support
des relations marchandes et non marchandes qui permet la proximité physique des
acteurs concernés (BES, 1993). La proximité sociale, résultant de la “ mémoire
commune ” et qui est renforcé par le partage de ressources communes
(infrastructures, équipements), est source de débats mettant en relation les acteurs
(GILLY et GROSSETTI, 1993). La proximité géographique est cruciale pour les
innovations qui requièrent une forte interaction entre utilisateurs et producteurs,
celles qui émergent ou encore pour celles qui concernent un secteur fortement basé
sur les connaissances issues de la recherche scientifique. Dans ce dernier cas,
l’innovation n’est pas nécessairement le résultat d’une organisation territoriale
délibérée (proximité systémique). Il peut également s’agir d’une proximité
ascendante : un agent fortement localisé est à l'origine de l'innovation et la construit
par extension locale (par exemple l'université dans les biotechnologies ou les
industries pharmaceutiques). Elle peut enfin être descendante, quand l’innovation
résulte d'une stratégie de délocalisation des firmes, visant à mobiliser les ressources
locales en R&D ou en savoir-faire (dans ce cas, la nécessité d'une proximité
géographique n'est pas absolue, elle dépend de l'étape de l'innovation).
Dans un SLI, le cadre institutionnel doit être un vecteur de processus cognitifs et
sociaux, générant un apprentissage non en termes d’allocation des ressources
(l’apprentissage au sens orthodoxe, où la connaissance préexiste à son échange)
mais en termes de création de ressources (par la mise en place de modes particuliers
de résolution de problèmes) : les proximités spatiale et technologique sont
organisées institutionnellement pour former un SLI.
Pour ce faire, deux types d’institutions se supportent mutuellement dans un SLI :
les institutions pragmatiques, produits d’une conception, d’actions délibérées et
intentionnelles, et les institutions organiques, résultat inattendu et inintentionnel de
la poursuite des intérêts individuels dans le cadre d’une évolution organique. Elles
interagissent dans le SLI : si des institutions pragmatiques sont créées pour gérer de
plus en plus d’activités, l’évolution des institutions organiques, revêtant souvent un
aspect plus informel, sous-tend ce processus plus qu’elle ne l’efface (KIRAT, 1993).
La construction d’un territoire se fait grâce à des stratégies organisationnelles et des
modes de relation établis par la firme innovatrice lors de la construction d’une
11
capacité productive qui permettent l’apprentissage collectif (LECOQ, 1995),
“ l'imaginaire du territoire ”, qui fixe un cadre commun de représentations pour les
agents membres du SLI. L’acteur est sécurisé par ces bornes, qui évoluent avec les
actions économiques. Le cadre historique et spatial de la coordination permet la
construction d'un “ ordre local ” qui assure la coopération, “ construit politique spécifique
à extension limitée et fluctuante qui, tout en s'appuyant sur la structuration initiale du contexte
d'action, modifie celle-ci à son tour et produit ses propres effets ” (FRIEDBERG, 1993). On
observe ainsi d’une part une certaine continuité dans les structures de coordination,
assurant une réduction de l’incertitude sur l’information, et d’autre part une
évolution de celles-ci en fonction d’un environnement changeant.
II. LA CIRCULATION DE LA TECHNOLOGIE AU PLAN MONDIAL ET
LA GLOBALISATION DE LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT.
La globalisation actuelle tend à relativiser les atouts traditionnellement reconnus de
la proximité aussi bien celle qui est permise par les limites d’un territoire national
que celle qui se matérialise sur un territoire local. La contrainte de distance peut être
dépassée par les possibilités de plus en plus grandes de mobilité conjointe des
hommes et des informations. Les communautés professionnelles développent des
relations personnalisées et informelles. Par ailleurs, la proximité n’a pas le même
rôle en fonction de l'innovation concernée. Rallet établit une typologie des
innovations en fonction des différents rapports à la proximité géographique qu'elles
nécessitent. Le cadre actuel des processus d'innovation technologique (RALLET,
1996) tend à se calquer de plus en plus au phénomène de globalisation Dans le
contexte d’échanges commerciaux et industriels accrus entre les pays, la
compétitivité se joue au niveau international, et toute innovation a pour cadre de
référence l'espace concurrentiel mondial.
Les grandes mutations du marché mondial de la technologie.
Les concentrations technologiques et la polarisation seront les deux caractéristiques
majeures des développements des années 90, les taux de croissance tendant à
s’égaliser selon le principe de la convergence entre les pays de la triade. Les
irréversibilités se développent dans le sens de plus en plus d’intégration des
nouvelles technologies avec l’avènement des technologies génériques qui marque la
grande rupture des années quatre vingt et quatre vingt dix : informatique,
12
électronique, sciences des matériaux, biotechnologies, génétiques. Le
rapprochement vertigineux de la sphère de la Recherche fondamentale et de la
sphère du développement, permis par ces technologies, réduit la perspective de
mimétisme pratiquée par les pays asiatiques et qui a relativement bien réussi
notamment pour le Japon et certains dragons. Le gap temporel qui existait n’est
plus praticable. Le phénomène de déverticalisation montre que les intégrations
permises par le passé ne sont plus nécessaires par les technologies immatérielles.
Dans les nouvelles dynamiques de la concurrence au plan mondial, l’économie de la
connaissance et la prépondérance de la dématérialisation priment. L’information est
reconnue comme un élément central dans le fonctionnement de l’économie depuis
les apports d’Arrow.
La compétitivité (définie respectivement comme la capacité d’une nation ou d’une
entreprise d’accroître ou de maintenir sa part de marché national et international
sur une moyenne ou longue période) sera de plus en plus fondée sur la capacité
locale à produire selon des standards mondiaux (par exemple suivant les normes
ISO 9000), d’adapter continuellement ses produits et ses proces, et d’innover au
sein de normes communes.
La délocalisation/décentralisation des processus de R&D et les nouvelles
tendances de sa restructuration au niveau mondial.
On peut aisément constater une tendance générale à une internationalisation accrue
des activités de R&D, même si la plupart des activités technologiques des firmes
multinationales restent encore fortement localisées dans leur pays d'origine. La
localisation de la R&D à l'étranger correspond le plus souvent à des innovations
d'adaptation au marché ou à une acquisition ou à une fusion avec une entreprise
locale. Quoique inégalement partagée, la délocalisation/décentralisation des
activités de production de nouvelles technologies se fait au sein des entreprises
globales (OCDE, 1997).
Les entreprises mettent en place des réseaux internationaux d’alliances stratégiques
à contenu technologique (HAGEDOORN et SCHAKENRAAD, 1993). Dans
douze pays de l’OCDE qui cumulent 95% de la R&D industrielle de la zone, la
R&D effectuée par des filiales de sociétés étrangères représentait plus de 11% des
dépenses totales de R&D industrielle en 1994 (OCDE, 1997). Ce type de calcul
13
permet d’envisager l’importance de la R&D délocalisée relativement aux pays
d’implantation. Cette proportion moyenne de 11% recouvre une grande variété de
situations.
Tableau n°1 : Part de la R&D des filiales étrangères dans une sélection de pays.
Pays Part de La R&D des filiales étrangères
En Irlande, 68%
Canada, Australie et Espagne entre 30% et 50%
Finlande (1995) 7,85%
Japon (1991) 1,36%
Source : OCDE 1997
L’importance relative de la R&D des filiales dépend d’abord du niveau de présence
des implantations étrangères. Celles-ci sont particulièrement importantes en Irlande
puisque dans l’industrie manufacturière elles sont responsables de 70% de la valeur
ajoutée.
D’une manière générale, on peut constater un certain parallélisme entre la
participation des filiales à la R&D et leur participation aux ventes de l’industrie
manufacturière : les classements des pays en fonction des deux variables sont
proches, bien que les valeurs des variables divergent.
14
Tableau n°2 : La R&D des filiales d'entreprises multinationales dans les pays
d'implantation
Part de la R&D Secteur
manufacturier (%)
Part du CA Secteur
manufacturier (%)
Intensité de la R&D
R&D/CA (%) Filiales
Intensité de la R&D
R&D/CA (%) Entreprises nationales
ETATS-UNIS (1994)
13,41 15,53 2,47 2,50
Canada (1993) 37,36 54,92 0,85 1,73 Japon (1991) 1,36 2,80 1,18 2,53
Australie (1989) 46,41 29,0 1,27 0,66 France (1992) 14,91 20,99 1,78 (2) 2,70 (2) Finlande (1995) 7,85 7,59 2,60 (1) 2,51 (1) Allemagne (1993) 16,45 28,14 3,17 6,31 Pays-Bas (1995) 17,42 42,40 (1) 0,80 (1) 2,66 (1) Suède (1994) 12,61 18,74 2,39 3,82 Royaume-Uni
(1989) 18,50 22,30 1,49 1,88
CA : chiffre d’affaires (1) 1993 (2) 1991
Source : OCDE (1997).
En ce qui concerne les filiales implantées aux Etats-Unis, l’intensité moyenne de
leur effort de recherche résulte à la fois de leur concentration dans des activités
relativement intensives en recherche et de l’importance de leur engagement. Ainsi
60% des dépenses de R&D des filiales sont effectuées dans trois secteurs :
pharmacie, chimie de base et équipement électrique et électronique. En outre, dans
les deux premiers, les filiales étrangères sont particulièrement actives en R&D,
puisqu’elles réalisent 47% de la R&D de la pharmacie (filiales suisses et
britanniques) et 93% de la R&D de la chimie de base (filiales allemandes et
canadiennes. Les dépenses de R&D des filiales, montrent qu’il existe une tendance
régulière et marquée à la progression. Ainsi aux Etats-Unis, entre 1980 et 1993 ces
dépenses ont crû au rythme de 16,5% aux prix courants et de 12% en termes réels.
En France, la part de la R&D industrielle imputable aux filiales (y compris les
15
filiales avec participation étrangère de 20 à 50%) représentait 18% en 1994 contre
11% en 1985. (MADEUF 2000)
Bien que très incomplètes, les données l’étude de l’OCDE confirment ce que
d’autres enquêtes et recherches permettaient d’affirmer : il existe depuis quelques
années une tendance certaine à la délocalisation de la R&D industrielle3. D’autre
part, au niveau sectoriel on constate de grands divergences entre activités. Ainsi
dans le cas des Etats-Unis, la R&D internationalisée du secteur automobile
représente 22% de la R&D sur le territoire américain, suivie par l’industrie
pharmaceutique (20%) et les ordinateurs (13%).
De manière plus générale, sur la base de données relatives à un large groupe
d’entreprises multinationales, l’internationalisation de la R&D paraît plus avancée
dans les activités suivantes : produits alimentaires, pharmacie, matériaux de
construction, produits d’extraction et pétrole (PATEL, 1995).
Du point de vue de la localisation géographique, on constate que pour les
entreprises d’origine américaine, les laboratoires à l’étranger sont principalement
situés en Europe (plus de 70% de la R&D hors des Etats-Unis), particulièrement en
Allemagne (28%, voir par exemple : General Motors a confié à Opel le
développement des nouveaux véhicules pour l’ensemble des activités
internationales du groupe) suivie par le Royaume-Uni (15%) et la France (11%). Les
entreprises européennes détiennent des centres de R&D au sein de l’Europe
comme aux Etats-Unis ; le partage entre les deux zones semble varier selon la
nationalité et le secteur d’activité des entreprises. Enfin les centres de recherche à
l’étranger détenus par les entreprises japonaises se trouvent essentiellement aux
Etats-Unis. L’implantation à l’étranger des centres de R&D eux-mêmes démontre
l’existence de choix géographiques privilégiés. (MADEUF , 1997)
3 pour une revue de la littérature voir Madeuf, B., Lefebvre, G., Savoy, A, De l'internationalisation à la globalisation de la RD industrielle : l'exemple de la France, Innovations, n° 5,1997, pp. 55-92.
16
La globalisation de la technologie
La combinaison des données qualitatives sur les fonctions des laboratoires à
l’étranger avec la tendance à la croissance de la R&D « délocalisée », rappelée plus
haut, confirme le mouvement de globalisation de la technologie, non seulement à
l’étape de la diffusion, mais ce qui paraît plus fondamental, au moment de sa
conception ou de sa production. Si on adopte la taxonomie proposée par D.
Archibugi et J. Michie (1995) la globalisation de la technologie peut s’entendre de
trois façons:
1/ elle peut d’abord recouvrir les mécanismes de diffusion et d’exploitation
internationales des technologies par ls entreprises.
2/ elle peut désigner la montée des collaborations internationales pour la mise au
point de nouvelles technologies ( ce que plus haut nous avons qualifié de réseau
externe).
3/elle peut enfin concerner le passage à la production globale des technologies.
Selon B. Madeuf (1997), les modalités les plus significatives de la globalisation de la
technologie correspondent à la seconde et à la troisième des formes. Les enquêtes
réalisées au cours des années récentes (PEARCE et SINGH, 1992 ; BARTLETT et
GHOSHAL, 1990) laissent penser que se sont surtout multipliés les laboratoires du
troisième et du quatrième type.
Pour prendre l’un des exemples les plus récents, les résultats de l’enquête conduite
sur environ 200 centres de R&D établis aux Etats-Unis et sous contrôle
d’entreprises étrangères montrent que leurs fonctions principales incluent la
production de nouveaux concepts, l’information sur les avancées scientifiques et
technologiques réalisées aux Etats-Unis et l’accès à des personnels scientifiques de
grande qualité (FLORIDA, 1997). La dialectique du local et du global est
transversale aux activités d'innovations : pour se rapprocher de la réalité observable,
il n'est nullement besoin de présupposer l'existence d'un espace national, c'est-à-
dire d'un système organisé au sein d’un Etat-nation.
Commentaire [z1] : Ne figure pas dans la bibliographie.
17
La globalisation de la R&D remet en cause d’une manière irréfutable et souvent
irréversible le fondement national du SNI. En conséquence, elle remet en cause
aussi bien les éléments qui en constituent la structure traditionnelle que les modes
d’interaction entre ces éléments. Ce phénomène résulte non seulement de la
globalisation de la R&D, mais se trouve également accentué par la globalisation des
modes d’acquisition des connaissances par l’introduction massive des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC). Enfin la mobilité
des capitaux et des hommes, éléments essentiels dans le phénomène de la
globalisation, fait éclater d’une manière irréversible les systèmes productifs
nationaux qui constituent une des bases essentielles du SNI.
III. LES CONSEQUENCES POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT.
Le SNI, aussi bien comme concept que comme mode opératoire, a intéressé un
grand nombre de pays en développement. Sa relative simplicité en a fait un outil
privilégié pour la mise en place de politiques et de programmes de structuration de
la recherche et du développement dans les pays où la tendance au centralisme et à
la prédominance des institutions centrales de l’Etat (Ministères, secrétariats d’Etat
etc.) dans les décisions majeures concernant le développement économique. Son
importance, et surtout sa nouveauté, le classe souvent aux yeux des décideurs
centraux parmi les domaines stratégiques, comme il l’est d’ailleurs dans un certain
nombre de pays avancés. Ce sont toutes ces caractéristiques qui rendent sa remise
en cause par le double phénomène de territorialisation et de globalisation de la
recherche plus délicat.
Les enjeux technologiques auxquels doivent actuellement faire face les PED, sont
cruciaux : le contexte international crée des limites juridiques aux possibilités
d’imitation, des contraintes économiques avec une délocalisation de moins en
moins importante des activités de production des grandes firmes européennes vers
les pays les moins avancés, et des barrières protectionnistes par le biais de
politiques technologiques très pointues et axées sur le soutien au développement à
l’échelon mondial des grandes firmes nationales. La mutation des formes de
concurrence et la prépondérance de l’innovation comme instrument fondamental
de la compétition sont à la base des revendications des pays avancés et notamment
des USA pour élever les barrières de protection.
18
La prépondérance et la reconnaissance du caractère tacite de la technologie et aussi
implicitement la reconnaissance d’une masse de savoir-faire non codifié et non
codifiable parfois et dont la transmission est relativement difficile, voire impossible
dans certains cas, rend l’accès à la technologie de plus en plus en plus difficile. Les
avantages comparatifs traditionnels, coût salariaux et prix des matières premières,
sont progressivement dévalorisés, ce qui réduit les possibilités d’insertion dans le
marché mondial.
Par ailleurs, les restrictions de la circulation de l’innovation ont limité l’innovation à
des centres qui ont accumulé effectivement pour pouvoir innover. L’innovation
spontanée à partir des technologies importées sans que les conditions ne soient
fournies n’est pas concevable. Des difficultés de remontées de filières importantes
se manifestent et laissent un pan entier de secteur bloqué au niveau de la
consommation passive de la technologie. Si paradoxalement la vision standard néo-
classique du changement technique avait ouvert l’espoir de rattrapage dans les
esprits des PVD, la vision évolutionniste semble boucher toutes perspectives de
rattrapage. Les irréversibilités étant ce qu’elles sont, il est difficile de s’installer dans
une division internationale du travail avantageuse si les capacités locales ne
permettent pas de fournir les ingrédients nécessaires de l’innovation.
Le rapprochement de la sphère de la Recherche fondamentale de la sphère du
développement réduit les perspectives de mimétisme pratiquées par les pays
asiatiques et qui ont réussi à développer en un temps record des capacités
technologiques conséquentes. Le gap temporel qui existait n’est plus praticable.
C’est le cas dans les technologies avancées et les technologies génériques. Coûts
salariaux versus productivité des facteurs.
La progression de la contrefaçon et du mimétisme, celui de la part des pays
asiatiques en l’occurrence, et la chute progressive de la R&D privée industrielle ont
conduit à concevoir des barrières protectionnistes plus élevées. Les nouvelles
restrictions concernant l’accès à la technologie et les hautes barrières imposées par
les accords de l’OMC de Marrakech (1995), assoient de nouvelles règles du jeu pour
la protection de la propriété intellectuelle.
L’impact de ces accords est perçu différemment par les analystes : les arguments en
leur faveur, défendus bien entendu par les FMN et les pays avancés, voient dans
19
ces accords le moyen de relancer la recherche privée en déclin et de fouetter
l’innovation dont les effets seront bénéfique pour toute l’humanité ex : une
découverte sur la protection de l’environnement, le traitement du paludisme ou
celui du SIDA par exemple. Les barrières élevées de protection sont une garantie
supplémentaire et un moyen d’attirer l’investissement étranger. Les conditions de
protection des brevets et inventions sont des éléments fondamentaux pour attirer
l’investissement étranger, parfois seule source d’accès à de nouvelles technologies
dans certaines filières. L’indice de protection de la propriété intellectuelle (IPRI)
avancé par Maskus & Penubarti (1995) indique dans quelle mesure la propriété
intellectuelle bénéficie de suffisamment de protection (Bouayiour et al., 1998).
L’IPRI prend une importance cruciale pour certains secteurs où une concurrence
très ardue existe (électronique, espace et NTIC) surtout pour le commerce mondial
de la technologie et la conférence de Marrakech de 1995 à travers les accords
TRIP(Trade Related Intellectual Property) l’a conforté 4. L’avènement des NTIC, et
notamment le réseau Internet, ont été salués comme des évènements majeurs
permettant un accès plus facile au savoir-faire et à la recherche mondiale
notamment par les PED.
Les opposants au niveau système de protection, mis en place par ces accords, dont
une bonne partie des PED, y voient un moyen d’exclusion supplémentaire des
entreprises et des Etats à système d’innovation non constitué ou peu efficace. On
constate, en effet, depuis une décennie environ l’apparition de nouvelles tendances
lourdes au plan mondial. La nouvelle restructuration de la R&D au plan mondial et
les logiques de déploiement du capital international vont dans le sens d’une
‘éviction’ grandissante des PED d’une manière générale (MADEUF, 2000). Ceci
incite à rechercher des voies alternatives à la R&D conventionnelle pour pouvoir
initier des dynamiques de changement technique propres, susceptibles de
développer la créativité et la construction d’avantages compétitifs sur des créneaux
relativement bien maîtrisés. Lorsque l’on prend en considération cette situation au
plan mondial et les performances de la R&D dans les PED d’une manière générale,
à l’heure actuelle, il semble que les voies possibles de participation restent
relativement limitées.
4Il a constitué 10% de toute la masse de documents produits pour la conférence
20
Avec les efforts faits dans le domaine des codes d’investissement et les systèmes
juridiques nationaux, cette position s’est améliorée. Toutefois, les pays d’Europe de
l’Est et notamment la Russie ont aussi bénéficié de la réorientation de
l’investissement direct, ainsi que l’Asie, avant la crise financière de la fin des années
90. Ce détournement de l’investissement entraîne une éviction croissante de
certaines régions, voire de certains pays, de la sphère de la technologie et
notamment des nouvelles technologies.
Dans ce contexte, les approches en termes de développement local, en tant que
renouvellement des analyses du développement économique, revêtent une
importance particulière pour analyser la situation des pays en voie de
développement vis-à-vis des contraintes internationales. Elles auront pour objectif
de déterminer de quelle marge de manœuvre disposent ces nations pour instaurer
des modes d’organisation des activités productives et innovantes qui soient
créateurs de richesses supplémentaires, de ressources spécifiques.
Les dynamiques territorialisées d’innovation sont confrontées à des difficultés
majeures de création d’externalités de différentes sortes. Les entreprises locales sont
la plupart du temps confrontées à des obstacles institutionnels que les organes
déconcentrés et parfois faussement décentralisés ne permettent pas de surmonter.
Les ressources sont déviées vers la résolution de problèmes que les modes de
coordination locaux sont censés prendre en charge. Les opportunités
d’apprentissage collectif sont ainsi ratées. Les freins au développement sont
exacerbés par l’incertitude de l’information et l’instabilité des règles et des normes
de fonctionnement. Il conviendrait de la part des acteurs locaux qu’ils mobilisent
leurs actifs non pas pour créer des ressources spécifiques et pour valoriser celles qui
existent potentiellement, mais pour tenter de maîtriser ces niveaux d’incertitudes et
en limiter l’impact négatif.
BIBLIOGRAPHIE :
ARCHIBUGI, D., MICHIE, J., The Globalisation of Technology. A New Taxonomy, Cambridge Journal of Economics, 1995, n°19, pp. 121-140.
BARTLETT, C. & GHOSHAL, S. Managing Innovation in the Transnational Corporation, in BARTLETT, C. et al. (ed.) Managing the Global Firm, Routledge, London 1990
21
BECCATINI, G., “ Les districts industriels en Italie ”, in MARUANI M., REYNAUD E., ROMANI C. (eds), La flexibilité en Italie, Syros Alternatives, 1989
BELLON, B., CROW, M., NIOSI, G., SAVIOTTI, P., “ Les systèmes nationaux d'innovation : unité et diversité ”, Problèmes Economiques, n° 2.311, 3-02-91.
BELLON, B., PLUNKET, A. « Organisation de la recherche par les entreprises multinationales : quelle place pour les PVD » in A. DJEFLAT, R. ZGHAL et M. ABBOU « L’Innovation au Maghreb : enjeux et perspectives » Ed. Ibn Khaldoun , 1998
BES, M.P., “ Du partage des informations au sein des systèmes locaux d’innovation ”, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 3, 1993, pp. 565-577. BOUOIYOUR et al. (1998), “ Les inputs outputs de l’innovation sur le pourtour de la Méditerranée”, journées EMMA Maison des Sciences de l’Hommes, Paris, Avril.
CARRE, H., « Capacité technologique et développement dans les PED : cas des industries agro-alimentaires au Sénéngal » thèse de Doctorat, USTL, 2001.
CATIN, M., Effets externes, marché et système de décision collective, Cujas, Paris, 1985.
COLLETIS, G., GILLY, J.P., PECQUEUR, B., PERRAT, J., ZIMMERMANN, B., « Firmes et territoires : entre nomadisme et ancrage » Premières journées de la proximité, Lyon, Mai 1997.
DJEFLAT, A., ZGHAL et M. ABBOU “ L’Innovation au Maghreb : Enjeux et Perspectives pour le 21ème siècle ” Série Maghtech, Editions Ibn Khaldoun, Oran 2000, 406 pages.
FLORIDA, R., The Globalisation of R & D : Results of a Survey of Foreign-affiliated R & D Laboratories in the USA, Research Policy, vol. 26, n° 1, 1997, pp. 85-104.
FRIEDBERG, E., Le pouvoir et la règle, dynamiques de l'action organisée, Paris, Le Seuil, 1993, p. 289.
FREEMAN, Ch. "The economics of industrial innovation", London, Penguin Books, 1982
GAFFARD, J.L. Economie Industrielle et de l’Innovation, Dalloz, Paris, 1990, pp. 431-445.
GILLES, B. "Histoire des techniques », Paris, La Pléiade, 1978.
22
GILLY, J.P., “ Innovation et territoire : pour une approche méso-économique des technopoles ”, Revue d'Economie Régionale et Urbaine, n° 5, 1987, pp. 785-799.
GILLY, J.P. & GROSSETTI, M., “ Organisations, individus et territoires. Le cas des systèmes locaux d’innovation ”, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 3, 1993, pp. 449-468.
HAGEDOORN, J., SCHAKENRAAD, J. Strategic Technology Partnering and International Corporate Strategies, in Hughes, K. (ed.), European Competitiveness, Cambridge University Press, 1993, Cambridge, pp. 60-87.
JOIGNAUX, G., THOMAS, B., “ Polarisation et milieux innovateur au service d’une approche des régions de tradition industrielle ”, 2èmes Journées de l’IFRESI, 24 & 25-01-1991, Lille, pp. 164-174.
KIRAT, T., “ Innovation technologique et apprentissage organisationnel : institutions et proximité dans la dynamique des systèmes d’innovation territorialisés ”, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n° 3, 1993, pp. 547-563.
LECOQ, B., “ Des formes locales d’organisation productive aux dynamiques industrielles localisées : bilan et perspectives ”, in A. RALLET & A. TORRE (eds.), Economie industrielle et économie spatiale, Economica, Paris, 1995.
LUNDVALL, B.A., National Systems of Innovations, Pinters Publishers, 1992.
MADEUF, B., LEFEBVRE, G., SAVOY, A., De l'internationalisation à la globalisation de la RD industrielle : l'exemple de la France, Innovations, n° 5, 1997, pp. 55-92.
MADEUF, B. « Organisation de la recherche industrielle par les entreprises multinationales : qu’elle place pour les pays en développement ? » A. DJEFLAT, A., ZGHAL et M. ABBOU “ L’Innovation au Maghreb : Enjeux et Perspectives pour le 21ème siècle ” Série Maghtech, Editions Ibn Khaldoun, Oran 2000, 406 pages.
MARSHALL, A., “Principles of Economics” MacMilan , London 1891
MASKUS, K.E. & PENUBARTI, M., “ How trade-related are intellectual property rights ” Journal of International Economics, 39, 1995, pp. 227-248
MOHNEN, P., “ Survol de la littérature sur les externalités technologiques ”, in J. DE BANDT & D. FORAY (eds.), L’évaluation économique de la recherche et du changement technique, Editions du CNRS, Paris, 1991, pp. 97-115.
MOWERY, D. & ROSENBERG, N. “Paths of Innovation: Technological Change in 20th-Century America”, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1998.
23
NELSON, R. & WINTER, S., (1993) “An Evolutionary Theory of Economic Change”, Cambridge, Massachusetts, Havard University Press, 1982. et Nelson, Richard. (ed.) National Innovation Systems. A Comparative Analysis, Oxford University Press, 1993.
NIOSI J. AND FAUCHER, P (1991), "The State and International Trade: Technology and Competitiveness" in J. Niosi (ed.): Technology and National Competitiveness, Montreal, McGill-Queen's University Press, pp. 119-141.
OCDE, L'internationalisation de la RD industrielle : structure et tendances, 23-24 octobre 1997
PATEL, P. Localised Production of Technology for Global Markets, Cambridge Journal of Economics,n°19, 1995, pp. 141-153.
PEARCE, R., SINGH, S. (1992), Globalizing Research and Development, Mac Millan, London. ; BARTLETT, C., GHOSHAL, S. (1990), Managing Innovation in the Transnational Corporation, in Bartlett, C. et al. (ed.), Managing the Global Firm, Routledge, London, pp. 215-255.
PECQUEUR, B., et ROUSIER, N., “ Les districts technologiques, un nouveau concept pour l’étude des relations technologies - territoires ”, Revue Canadienne des Sciences Régionales, Vol. XV, n° 3, Automne 1992, pp. 437-455.
PERRAT, J., “ Innovation, territoire et nouvelles formes de régulation : de la proximité à l'externalité ”, Revue d'Economie Régionale et Urbaine, n° 3, 1993, pp. 509-525.
RALLET, A., « Ressources spécifiques et ressources génériques : une problématique pour le développement local ; L’exemple d’une région tunisienne » in ABDELMALKI, L. et COURLET, C. (eds.) Les nouvelles logiques du développement, l’Hartmattan, 1996, pp. 119-132
RALLET, A., et TORRE, A., "Economie industrielle et économie spatiale : un état des lieux", in A. RALLET & A. TORRE (eds), op. cit..
TORRE, A., “ Proximité géographique et dynamiques industrielles ”, Revue d'Economie Régionale et Urbaine, n° 3, 1993, pp. 431-448.
VON HIPPEL, E. (1976) "The Dominant Role of Users in the Scientific
Instrument Innovation Process," Research Policy 5, no. 3 (July):212-39.