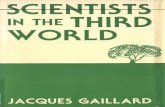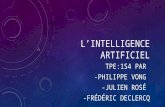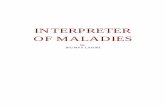Les maladies de passage - Horizon IRD
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les maladies de passage - Horizon IRD
Sous la d irection de
Doris Bonnet et Yannick Jaffré
Les maladiesde passageTransmissions, préventions et hygiènesen Afrique de l'Ouest
MËDEClNE5 DU MONDE
I<ARTHALA
KARTHALA sur Internet: http://www.karthala.comPaiement sécurisé
© Éditions KARTHALA, 2003ISBN: 2-84586-372-1
Sous la dlrectlon de Doris Bonnet et Yannick Jaffré
Les maladiesde passage
Transmissions, prévent'ions et hygiènesen Afrique de l'Ouest
Éditions KARTHALA22-24, boulevard Arago
75013 PARIS
Ouvrage publié avec le concours d'Amadeshttp://www.amades.net
Les recherches composant cet ouvrage ont été menées dansle cadre du programme de l'Union européenne « Interactionsentre les systèmes de santé publique et les conceptions et pratiques populaires relatives à la maladie (Mrique de l'Ouest) Financement Union européenne - INCO ».
Nous remercions Evelyne Féraud pour son indispensableassistance à la préparation du texte et de la bibliographie.
Ce livre est dédié à la mémoire de notre collègue et amiSidiki Tinta.
Introduction
Transmissions, préventionset hygiènes en Afrique de l'ouest,une question anthropologique
Doris Bonnet
Cet ouvrage rassemble les contributions de dix-septsocio-anthropologues et construit, autour d'un large corpus,une réflexion sur le thème de la transmission des maladies etdes pratiques d'hygiène dans les sociétés ouest-africaines duSénégal au Niger. L'originalité de cet ouvrage repose sur lefait qu'il constitue un véritable travail collectif, de l'élaboration du thème et des méthodes de travail à la confrontationcomparative des résultats au terme des enquêtes-.
En effet, contrairement à de nombreux ouvrages collectifs où la décision de forger une réflexion commune sur unsujet s'effectue à partir de terrains et de trajectoires individuels, celui-ci s'est construit à partir d'une grille de lecturecommune élaborée préalablement aux enquêtes: inventairedes champs lexicaux et sémantiques dans les langues vernaculaires sur les thèmes retenus, observation des pratiques depropreté corporelles et domestiques, etc.
1 La constitution de cette équipe date de 1995. Un projet de rechercheintitulé « Interactions entre les systèmes de Santé Publique et lesconceptions et pratiques populaires relatives à la maladie (Afrique del'Ouest) » a bénéficié d'un financement de l'Union Européenne en 1998pour une durée de quatre ans. Un premier ouvrage sur les sémiologiespopulaires, les logiques de nomination et le rôle du contexte dansl'interprétation de la maladie a été édité aux PUF en 1999 sous ladirection de Yannick Jaffré et de Jean-Pierre Olivier de Sardan.
6
Transmissions
Les maladies de passage
L'idée de prendre pour objet d'étude le thème de la contamination a, très vite, posé un problème de traduction. A l'occasion d'un séminaire qui regroupait l'ensemble des auteurs, chacun a fait valoir l'inadéquation du terme entre le français(contamination ou contagion) et les différentes langues vernaculaires africaines. Le terme de contagion ne semblait pas leplus approprié pour exprimer ce que les personnes interrogées conceptualisaient par rapport aux questions relatives àla transmission des maladies entre les hommes, d'autant quel'objectif primordial de ce travail n'était pas de répertorier laconnaissance des villageois sur les maladies contagieuses denotre système biomédical mais plutôt d'explorer l'idée decontamination d'une manière plus générale.
Aujourd'hui, en français, les termes de contaminationou de contagion signifient que la maladie se transmet uniquement d'un sujet malade à un sujet sain. Or, ce type detransmission ne correspond pas à l'ensemble des conceptionslocales de la contamination recueillies au cours de ce travail.Qu'il s'agisse d'une transmission de substances entre unhomme et une femme ou entre une mère et son enfant (par lesang, le lait ou le sperme) ou bien même d'un rapportd'influence (par la parole ou le regard) le « donneur» n'estpas nécessairement malade. Il peut s'agir d'un contact entredeux personnes en bonne santé mais jugées impures d'unpoint de vue social (par exemple, des individus en contactavec la mort). En fait, dans un certain nombre de cas, ce nesont pas les sujets qui sont malades mais le contact qui estmorbide ou mortifère, ce qui ne veut pas dire pour autantque celui qui contamine n'est jamais malade.
A partir de ce constat, et en considérant l'étude deschamps sémantiques des différents termes vernaculairesétudiés, il a été décidé d'emprunter le terme le plus proched'une traduction littérale, et c'est celui de « transmission »
qui a fait le consensus2.
2 Ce même choix a été fait par Caprara (2000).
Introduction 7
Après ce critère ethnolinguistique, un élément de traduction médicale a retenu notre attention. En effet, les discours recueillis faisaient état de maladies considérées commeétant contagieuses par les personnes interrogées selon lesconceptions locales alors qu'elles ne le sont pas d'un point devue scientifique. D'autre part, une maladie considéréecomme étant contagieuse dans le système biomédical ne l'estpas nécessairement dans les sociétés africaines ; ou bien unemaladie transmissible n'est pas obligatoirement jugée contagieuse. Prenons quelques exemples pour faire comprendreces écarts de jugement: l'épilepsie est considérée dans laplupart des groupes sociaux d'Afrique subsaharienne, enzone urbaine comme en zone rurale, comme étant contagieuse et se transmettant notamment par la salive du maladealors que dans le système biomédical, cette maladie n'est enrien ni transmissible ni contagieuse. Prenons un autreexemple. Pour les médecins, le sida est une maladie transmissible non contagieuse alors que pour de nombreuses personnes interrogées, elle est jugée contagieuse. En ce quiconcerne les maladies sexuellement transmissibles, certainsvillageois les jugent transmissibles uniquement par lesfemmes. Enfin, d'autres personnes considèrent que les maladies infantiles sont, en partie, attribuables à une contamination maternelle in-utero ou par l'allaitement. Dans ce cas,c'est le principe qui est retenu sans être associé à une pathologie spécifique; aussi l'interprétation d'une maladie infantile peut s'orienter vers ce type d'explication sans qu'elle corrobore une maladie infectieuse spécifique.
Le mot « contagion » a donc été écarté par la plupartdes auteurs car il risquait d'introduire trop de confusiondans nos échanges avec le milieu médical, en particulier avecles médecins de santé publique; car même si nous revendiquions un travail strictement ethnologique notre but étaitqu'il soit utilisable par le personnel de santé.
L'ensemble de ces réflexions nous a amené à choisir unterme « neutre» et « démédicalisé », d'un point de vue linguistique et historique, et à retenir celui de « transmission»au détriment de celui de contagion. La poursuite de notrerecherche nous a ensuite montré qu'il n'existait pas véritablement de mot sans histoire - même si l'on pouvait s'en dou-
8 Les maladies de passage
ter - car l'usage de ce terme, comme on va le voir ci-dessousa aussi une traversée médicale dans notre histoire occidentale de la contagion. Cette précision étant apportée, les termesde contagion ou de contamination sont quelquefois utilisésau cours de cet ouvrage quand ils ne prêtent pas à confusiond'un point de vue médical.
L'idée de transmission permet surtout de décliner différentes conceptions en usage, de la plus religieuse à la plusmédicale, sans induire de faux couplages entre différentsregistres. Elle se rapproche, comme on vient de le dire, destermes vernaculaires des enquêtes des auteurs de l'ouvragequi évoquent très souvent l'idée de passage. Le thème du passage est, en effet, récurrent d'un point de vue linguistique etdiscursif. Les métaphores utilisées sont toujours en référenceà l'espace: elles sont celles de l'enjambement d'un corps (acteconsidéré d'ailleurs comme « contagieux» au sens du contactmortifère) ou de la traversée d'une rivière. L'idée métaphorique de passer d'un lieu à un autre révèle la dimension physique et spatiale du processus de contamination, tel qu'il estdécrit par les personnes interrogées. La légitimation desespaces est souvent soulignée; et l'effraction d'un espace intime ou d'un espace interdit, dangereux ou impur (domestiqueou public) contamine le transgresseur ou même celui qui s'yaventure par hasard. Pour donner quelques exemples: l'espace de la douche est un lieu potentiellement dangereux car s'yversent les humeurs du corps (salive, sueur, urine, etc) ;l'espace du marché est un lieu de tensions sociales où peuventse transmettre de nombreuses maladies; l'espace d'un carrefour est un lieu d'offrandes aux esprits qui peuvent communiquer certains troubles ; l'espace fréquenté par une femme quia vécu un avortement est porteur de risques car son impuretépeut mettre en danger celle qui est enceinte, etc. Il s'agit doncd'un espace à la fois physique et social, intime et public.
L'idée de transmission se rencontre aussi dans l'histoire de la médecine occidentale ( Grmek, 1980 ; Bourdelais,1998) à l'époque où le religieux et le médical ne constituaientpas deux champs distincts du traitement des maux.Plutarque durant l'Antiquité fait référence à une transmission par influence, communément appelée encore aujourd'huile« mauvais œil ». Cette idée de transmission d'homme à homme
Introduction 9
et de pays à pays daterait en Occident, selon M. D. Gnnek, duVe siècle avant Jésus-Christ (1980). Elle sera contredite parla théorie des miasmes qui nie le passage direct entre lesindividus et par la théorie aériste d'Hippocrate qui attribue àl'air et à l'eau l'origine des principales maladies. La médecine savante, jusqu'aux XIVe et XVe siècles, mettait en doute lathéorie du contact contaminant qui était, en fait, plus populaire que scientifique (Gmerk, 1980). Selon les historiens, laconstatation au XIVe siècle d'une épidémie de peste parcontact avec les vêtements des pestiférés, ne va pas infléchirla médecine officielle. Celle-ci considérait toujours que cetteépidémie était due à l'action des miasmes et des pestilences.
Contrairement à l'histoire de la médecine occidentaleoù une théorie en contredit souvent une autre (théoriesaériste, contagionniste, infectionniste, hygiéniste, etc), dansles sociétés ouest-africaines aucune ne souffre de la contradiction. C'est bien là une des spécificités des pages qui suivent. On pourrait justifier cette pensée plurielle en arguantdu fait qu'il s'agit davantage de croyances populaires que dethéories. Pourtant, à la lecture des articles de cet ouvrage, sedévoile un croisement de savoirs qui sont le fruit de l'histoirede l'Afrique et de l'influence de divers courants de pensée(islam, théorie pasteurienne, etc). Et si, à l'instar deBourdieu, on pense qu'il n'existe pas de pratiques pures sansthéories, on se rendra compte qu'elles véhiculent unensemble de discours à visée extrêmement morale et nonnative en ce qui concerne les relations humaines et sociales,qu'il s'agisse des conduites sexuelles, de la promiscuité descontacts physiques, des règles en matière de rapportssociaux, ou celles relatives aux interdits d'alliance ou, enfin,en ce qui concerne la gestion de l'environnement.
Préventions
Les corpus présentés ici témoignent des nombreusesmanières de faire pour se prémunir de la maladie: la toilettecorporelle, les règles de commensalité, le triage des déchetsdomestiques, les multiples mesures de protection vis à visdes relations interpersonnelles et sociales, et aussi de nom-
10 Les maladies de passage
breuses attitudes d'évitement par rapport aux malades etaux cadavres, ou vis à vis de personnes ou de lieux jugéssales et / ou impurs.
La toilette n'est pas un acte banal et uniquement instrumental même si elle est classée par Marcel Mauss dans lacatégorie des « techniques corporelles» (1950). Elle est aussi,par l'immersion ou l'aspersion, un moyen de purification quiefface l'histoire passée: par exemple, la vie intra-utérinedans le cas de la première toilette du nouveau-né, ou unrisque de traumatisme psychologique dans le cas du fossoyeur dont on dira qu'il faut lui « laver » les yeux afin qu'ilefface de sa mémoire la vision du cadavre. La toilette estdonc à la fois une gestion de l'intime et un acte purificateur.Elle doit être un sujet d'étude non seulement dans le cadredomestique mais aussi à l'hôpital où la famille fait la toilettecorporelle des malades. Le manque de personnel soignant enest la cause essentielle; mais la façon d'y approcher l'intimerévèle aussi une distance sociale maintenue par le corpsmédical à l'égard des patients. L'évocation de la honte ou dela nécessaire pudeur révèle la nécessité pour chacun de rester à sa place et témoigne d'une distance sociale entre soignants et soignés. D'ailleurs, les médecins africains touchentpeu le corps de leurs malades durant l'examen clinique, etlaissent même à leurs étudiants le soin de le faire.
Au moment du repas, les règles de commensalité sontorganisées en fonction du genre, du rapport aîné / cadet, del'organisation familiale et du niveau socio-économique desménages. En zone rurale, où l'usage des couverts reste peuutilisé, il est interdit de puiser dans le plat collectif avec lamain gauche, associée à l'impureté et utilisée pour la toilettede l'anus et des organes génitaux. Ce principe d'hygiène debase3 s'accompagne de la recommandation de ne pas partager le repas avec un malade. Ainsi, les épileptiques, considérés comme contagieux, sont souvent écartés du repas familialpour que leur salive ne contamine pas le plat collectif. Mêmesi cette exhortation n'est pas toujours effective et dépend de
3 L'apprentIssage de l'usage différencié des mains (la droite pour mangeret serrer la main de l'interlocuteur, la gauche pour se laver les partiesintimes) s'effectue dès les premiers âges de l'enfant.
Introduction 11
l'histoire et de la dynamique relationnelle des familles, elleest la marque d'une norme sociale en la matière.
Au sein de l'unité domestique, en zone rurale, le nettoyage des habitations s'effectue essentiellement par lebalayage des poussières et des divers détritus à l'intérieurdes maisons et dans la cour avoisinante, ainsi que par le trides déchets et des résidus de cuisine et l'élimination desodeurs4. La pratique du tri est, on le verra au cours de cetouvrage, extrêmement importante et élaborée. La propretés'associe, là encore, à l'ordre et à la réorganisation quotidienne de l'espace domestique et limitrophe. Les déchets sontjetés dans une poubelle (souvent un bidon métallique) ou surun tas d'ordures et dans des lieux différents selon leur typede décomposition. Les eaux usées, les selles des enfants etles déchets de pacage des animaux sont jetés dans un puisard, ou au pied d'un arbre ou encore dans les latrines. Enville, l'enlèvement des ordures à domicile représente unsigne extérieur de richesseS.
L'idée selon laquelle les populations villageoisesn'auraient aucune pratique de prévention se réfère donc aucadre sanitaire des pays du Nord car les travaux anthropologiques n'ont de cesse d'examiner et de décrire la façon dontles individus non seulement gèrent leur corps et leursespaces privés et publics mais aussi anticipent le malheur(pratiques divinatoires) et tentent de se prémunir contre touttype d'infortune (pratiques de protection, port d'objetsfétiches, offrandes et sacrifices aux esprits de l'au-delà, etc).
La notion de transmission a mis à jour une théoriesociale des contacts (humains, environnementaux et sociaux)où les relations humaines et sociales sont perçues commedangereuses voire violentes, nécessitant un ensemble d'interdits et de pratiques d'évitement qui visent à une maîtrise desliens humains et des espaces sociaux et à une inévitable distance relationnelle et sociale vis à vis des autres. Elle a fait
4 La pratique du brûlage d'encens purifie l'espace et vise aussi à chasserles esprits nuisibles.
5 Le confort sanitaire du domicile (eau courante, W-C, etc) comme l'usagedu papier hygiénique ou celui du mouchoir sont des marques de distinction sociale.
12 Les maladies de passage
valoir la façon dont ces sociétés envisagent la question del'altérité par la nécessaire séparation des mondes (animal ethumain) et des individus (purs/impurs, alliés /non alliés,consanguins /non consanguins, etc), même si des événementsinattendus d'ordre politique, historique ou sanitaire doiventgénérer de nouvelles mises en ordre sociales.
L'évolution des contextes sanitaires, notamment l'arrivée de l'épidémie de sida, en a témoigné ces dernièresannées. Le sida a exacerbé, dans certains contextes, cetterelation à un Autre mortifère (peur, rejet, méfiance, effondrement des solidarités, etc), et s'est appuyé sur des mécanismes de stigmatisation déjà existants (attribution d'un rôleprépondérant à la femme dans la transmission des maladies). Ici, le système de santé publique n'est pas parvenu àune nouvelle mise en ordre de la société. Les malades se sontsocialement défendus par des attitudes relativement individualistes, marquées d'ostracisme, malgré l'émergence demouvements associatifs. L'idée récurrente, au cours de cesétudes, selon laquelle il faut se prémunir de l'Autre, conduità s'interroger sur les raisons pour lesquelles, dans le cas dusida, le port du préservatif n'a pas été mieux accepté.Plusieurs explications non exclusives les unes des autrespeuvent être avançées : le fait de ne pas procréer au coursd'un rapport sexuel n'est pas encore communément admis,en particulier dans les campagnes où l'accès à la planification familiale n'est pas encore bien organisé par les États ;par ailleurs, le sperme est encore perçu par de nombreux villageois comme une nourriture nécessaire à l'évolution favorable du fœtus jusqu'au cinquième ou sixième mois de lagrossesse ; enfin, le port du préservatif témoigne, pour lepartenaire, d'une sexualité adultérine ou volage6. TI est encoredavantage perçu comme une marque de trahison plutôtqu'une mesure de prévention. Le rejet du préservatif correspond donc à l'état des relations entre les genres (rapportsamoureux et conjugaux), au statut de la femme dans ces sociétés et à la difficile organisation de la planification familiale.
6 Les partenaires opposent une relation de confiance sans protection àune relation de méfiance induite par le port du préservatif. Consultersur ce sujet un article de C. Fay sur la situation de la prévention dusida au Mali (1999) ainsi que les travaux de Barbara Browning (1998).
Introduction 13
Ces événements révèlent que ces théories du contact(et de la nécessaire mise à distance relationnelle) sont enperpétuelle évolution « inclusive ", tant dans les pratiquesque dans les marges que les populations s'accordent par rapport à la morale, aux normes et à leurs renouvellements.
Les questions relatives à la traduction des termes vernaculaires ont aussi fait état d'une représentation du risquedu contact, au point que celui-ci peut être morbide ou mortifère sans qu'il concerne l'état de santé initial des individus. Ona vu aussi que certaines personnes considèrent tout contactcomme potentiellement dangereux même si la vie quotidiennepeut être conciliante. Les représentations de la contaminationcomme la notion d'impureté /saleté (qui est une des causesprincipales de la transmission selon les personnes interrogées) se cristallisent donc autour du risque du contact.
Le corps des personnes humaines est le premier objet às'offrir au péril. Il s'expose au risque par les lieux d'entrée dumal ou du danger, soit ses orifices, en particulier la bouche,le nez, les yeux7, les oreilles, la fontanelle (pour l'enfant), lesorganes génitaux, et les pores de la peau. Les produits corporels sont, de fait, des vecteurs du contact: on peut ainsitransmettre à l'Autre une maladie par ses substances corporelles (en particulier le sang), ses excrétions ou déchets (enparticulier le lait, le sperme, la salive, l'urine, les leucorrhées, les crachats, la morve), par son odeur (haleine, sueur,gaz intestinaux). Dans le même ordre d'idées, les traces depieds et les empreintes corporelles (humaines et animales)sont aussi susceptibles de communiquer une maladie8 . Ellessont imprégnées de la chaleur corporelle de l'animal ou de lapersonne impure ou malade qui en a marqué la terre.
7 Les yeux ne sont pas appréhendés uniquement comme un organe de lavue mais aussi par l'action de regarder. Par exemple, une femme enceintequi « voit» un accouplement d'animaux peut être contaminée par unemaladie et la communiquer à son fœtus. Ce principe causal s'intègre dansun ensemble de maladies dont les symptômes sont en relation métaphorique avec l'apparence d'un animal. A. Zempleni (1985 : 30) qualifie ceprocessus de « couplage» toujours associé, écrit-il, à la transgression d'uninterdit de la femme enceinte. Dans le cas de l'accouplement d'animaux,l'accent est davantage mis sur le regard de la femme que sur la rencontreentre elle et l'animal. La femme a vu ce qu'elle ne devait pas voir.
8 Il s'agit, dans ce cas, de contacts indirects.
14 Les maladies de passage
La crainte d'être exposé au danger, à l'impureté, à lasaleté et / ou à la maladie engendre un certain nombre depratiques de précaution au niveau de la gestion de l'intimitécorporelle.
D'une part, la nécessité de garder un corps frais, celuici étant le signe d'un bon état de santé. Ainsi, il est recommandé aux adultes de se laver après un rapport sexuel pour" rafraichir » les corps. La théorie du risque de l'excès, enparticulier du corps trop chaud susceptible de provoquer desmaladies après un rapport sexuel, dont le système symbolique a été étudié par Françoise Héritier (1994), se rencontrefréquemment dans les discours des personnes interrogées enmilieu rural. Un corps trop chaud se rend vulnérable ets'expose au risque de la contamination. La notion de chaleurcorporelle n'est pas, ici, systématiquement associée à unechaleur thermique. Elle s'inscrit aussi dans un système symbolique décrit ailleurs (Bonnet, 1985).
D'autre part, il est recommandé d'éviter de mélangerdes liquides corporels en particulier le lait maternel, le sangmenstruel et le sperme. Les liquides corporels sont soumis àune transformation « alchimique» intracorporelle où la trilogie sperme-sang menstruel-lait maternel se situe dans unrapport de substitution et d'incompatibilités (Héritier, 1985 ;Bonnet, 1988 ; Vincke, 1991). Ce discours justifie notammentles interdits sexuels de l'allaitement du postpartum. Leurtransgression peut être considérée à l'origine de certainesmaladies ou la cause d'infécondités secondaires.
La logique de ce raisonnement se fonde sur la nécessité d'éviter les mélanges, source de désordre. Ce système dereprésentations du corps et de son fonctionnement internelégitime aussi une morale sociale qui exige une maîtrise despulsions physiques, sexuelles et émotionnelles. Par exemple,il n'est pas de bon ton d'exprimer bruyamment sa souffrancephysique à l'accouchement ou son empressement à une reprise des rapports sexuels après cet événement. Bien sûr, lamorale est souvent enfreinte selon le contexte et les individus, comme dans toutes les sociétés du monde!
Enfin, il est aussi recommandé de ne pas mélangerl'eau de toilette et les produits de nettoyage comme le savon.
Introduction 15
Des exemples peuvent illustrer ces recommandations d'évitement des mélanges. Au moment de la toilette, il est formellement déconseillé de mettre les pieds dans l'eau du seau ou dese laver les mains dans une bassine afin de ne pas introduirede savon dans l'eau. La technique de l'ablution ou du versement de l'eau à l'extérieur du récipient est recommandée.Elle permet, de plus, une économie d'eau dans des régions oùles puits sont quelquefois très éloignés. Dans le même étatd'esprit, le nouveau-né n'est pas lavé dans une baignoire oùil tremperait dans l'eau savonneuse ; il est allongé sur lesjambes tendues de sa mère (ou de sa grand-mère) qui placeune cuvette au-dessous d'elle pour recevoir l'eau de rinçage.
Même si la culture islamique de la propreté - avec sonindispensable usage de l'eau - joue un rôle essentiel, les pratiques individuelles de prévention s'appuient largement surdes théories substantivistes : ce sont les humeurs corporellesdes personnes impures, des malades ou des cadavres qui sontcontaminantes et qui suscitent des attitudes d'évitement oudes marques de séparation.
Les notions de prévention et de transmission ont aussicertainement été influençées par le discours hygiéniste dupersonnel médical africain (Hado, 1997) formé, dès le débutdes années 1900, par les médecins militaires européens del'Assistance Médicale Indigène (AMI). En témoigne la notionde microbe ou de germe fréquemment évoquée, et souvent enfrançais, par les personnes interrogées.
L'ethnologue américain, E. Green (1999), dans uneétude sur les « théories indigènes de la contagion ') enAfrique, a cherché à montrer que les conceptions locales de lamaladie et de sa transmission s'associaient aujourd'hui auxnormes biomédicales occidentales. Si l'on s'accorde avecE. Green sur ces idées, on doit aussi faire valoir que cesthéories indigènes de la contagion se sont elles-mêmes enrichies d'un perpétuel apport de normes pré-coloniales en fonction de l'évolution sociale de ces sociétés9 . Ce « stock» actuel
-------- ~------------
9 Cette précision est importante car de nombreuses études tendent àécraser les périodes historiques qui précèdent l'époque coloniale et, defait, en viennent à proposer" l'idée d'une pureté originaire» de ce conti·nent (Amselle, 2001 : 23).
16 Les maladies de passage
de théories indigènes ne doit donc pas être lu et entenducomme un acquis atemporel auquel se seraient uniquementajoutées les nouvelles informations véhiculées par la médecine hygiéniste du XXe siècle. L'histoire de l'Mrique fait valoir,au contraire, les divers réseaux de diffusion des idées qui ontparticipé à l'émergence d'aires culturelles particulières. Onobserve, en effet, à la lecture des travaux historiques surl'Mrique, que l'idée d'une certaine unité culturelle soudanosahélienne est due à l'expansion de l'islam et même à sontriomphe au XIVe siècle - avec sa culture de la propreté -,ainsi qu'au développement d'un commerce transsaharien auxXVe et XVIe siècles qui favorisait de multiples contacts avecle monde arabo-berbère. Il faut aussi avoir en mémoire lesnombreux déplacements des populations pour cause deguerres civiles et de famines dès le XIIe siècle, ainsi que lesnombreux raids guerriers qui s'accompagnaient de la capturede prisonniers. Enfin, les différents contacts que les populations urbaines entretenaient avec les négociants navigateursde la Côte, en particulier avec les Portugais dès le XVe siècle,ont certainement engendré divers autres types d'échangesentre ces groupes. On imagine bien que ces siècles de communications, de circulations, de relations et d'échangesn'étaient pas uniquement marchands, et qu'ils véhiculaientaussi des manières de faire (corporelles et domestiques) etdes façons de penser la maladie et de la traiter.
Paradoxalement, la situation politique pré-coloniale del'Mrique, avec la création de plusieurs royaumes et empiresà vocation expansionniste mais au pouvoir centralisé, a certainement renforcé ou même durci des dispositifs de représentations et des pratiques d'évitement qui visaient à se prémunir de l'étranger, du marchand, du guerrier, de l'esclave,du captif, etc.
Du Sénégal au Niger, en passant par la Côte d'Ivoire,les auteurs de cette recherche ont identifié une relative communauté de représentations et de faits sociaux10 : notamment, la persistance actuelle en zone rurale de notions étudiées par l'anthropologie classique (par exemple, celles de
10 Ce constat a été fait par les chercheurs de la même équipe à l'occasiond'un travml précédent (Jaffré & Olivier de Sardan, 1999).
Introduction 17
force vitale et d'impureté), la nécessaire séparation desgenres et des espèces qui témoigne de la persistance d'uneproximité sociale avec le milieu naturelll (désert, savane,forêt) et de la rigidité des normes par rapport aux comportements sexuels d'une manière générale et en particulierl'inceste, la place particulière des personnes vulnérablesdans les théories du risque (enfants en bas âge, femmesenceintes, parturientes, etc), la nécessité d'une maîtrise desrelations sexuelles après l'accouchement, ainsi qu'une grande diversité d'interdits et de pratiques d'évitement afin de seprotéger de tout danger au niveau des relations humaines etsociales.
Hygiènes
L'idée que les sociétés africaines aient des principeshygiéniques a longtemps paru inconcevable aux administrateurs coloniaux et aujourd'hui encore à certains intervenantsde projets de développement social et sanitaire. Certes, ceuxci se réfèrent à une vision pasteurienne de l'hygiènisme,débarrassée des conceptions populaires de la contagion. Defait, ils perpétuent un hiatus entre « politique d'hygiène» et« pratique de propreté »12.
En 1990, Arlette Poloni, lors d'études menées auBurkina Faso sur l'hygiène faisait état d'« incompréhensionspréjudiciables» entre les médecins, les urbanistes et la population de Ouagadougou. Les uns parlaient d'hygiène, lesautres de propreté, deux notions qui ne se confondaient pas,écrivait l'auteur. Pour les premiers, il s'agissait de mesuresprophylaxiques associées à la santé, pour les seconds « d'éliminer ce qui dérange et d'opérer des sélections » dans lesregistres du domestique et du social. Ces réflexions s'ajou-
Il Le rôle prépondérant des animaux de la brousse dans l'interprétationde la maladie en témoigne (notamment en ce qui concerne les accidentsde la reproduction et les maladies infantiles).
12 Mary Douglas, dans son ouvrage intitulé De la souillure, (981) faitréférence à cette thèse qu'elle illustre d'une manière critique en cestermes : « nous tuons des germes, ils écartent des esprits » (page 52)." Nos coutumes sont solidement ancrées dans l'hygiène, les leurs sontsymboliques", ajoute-t-elle pour persifler cette thèse.
18 Les maladies de passage
taient à celles d'autres ethnologues ayant travaillé sur desterrains différents, notamment aux Antilles françaises etayant fait le même constat (Peeters, 1982) : « il s'agit denotions appartenant à des ordres différents et qui ne sont pasnécessairement associées ni dans le passé, ni dans la plupartdes sociétés" (page 23). Si l'on consulte les travaux des historiens de la médecine et de l'hygiène (Mirko Gmerk ou JeanPierre Goubert), on constate qu'en Europe l'hygiène est, dèssa naissance, une idée éminemment politique. A la fin duXVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle ceux qui étaient chargés de faire respecter les mesures d'hygiène appartenaient dureste à la « police de la santé ". Celle-ci était responsable du« contrôle des étals et des bouchers, (de) la surveillance desvoyageurs suspectés d'apporter une contagion, puis (de) l'isolement des infectés en cas de contamination avérée» (Bercé,1984 : 76). Dans ce cas, la notion d'hygiène est étroitementassociée aux comportements de lutte contre la contagion parles « prévôts de la santé" et à la capacité de l'État à faire faceaux épidémies. Les mesures d'hygiène se sont donc mises enplace par des procédés dirigistes, et par la médiation desmédecins hygiènistes et des médecins de famille.
En Afrique, c'est par la médecine coloniale que le discours hygiéniste fait son entrée. Il est relayé, aujourd'hui,par les services d'éducation sanitaire qui ont leurs proprescodes de propreté. L'hygiène est donc liée à une idéologie del'ordre où le sanitaire (domestique et public) est une préoccupation des politiques de l'État.
Les travaux de cet ouvrage révèlent, en fait, que cetteidéologie représentée par les choix sanitaires des États etpar celle des organismes internationaux n'a pas les moyensde ses recommandations et a des difficultés à adapter sondiscours non seulement aux conceptions populaires de lamaladie mais aussi aux réalités socio-économiques desfamilles. On sait que les progrès en termes d'habitat etd'urbanisme, dans l'Europe du XIXe siècle, ont davantagecontribué à une meilleure hygiène que les recommandationsquelquefois autoritaires des médecins hygiènistes en matièrede comportements individuels et collectifs. Aujourd'hui, enFrance, les études relatives au saturnisme chez l'enfantmigrant s'accordent toutes sur la nécessité de modifier
Introduction 19
l'habitat du patient. Il est parfois curieux que ces évidencesn'apparaissent pas comme telles en Mrique : à quoi sert dedemander aux mères d'apprendre à leurs enfants à se laverles mains au savon avant chaque repas, lorsqu'elles doiventparcourir cinq kilomètres pour atteindre le point d'eau leplus proche? Quel sens doit-on donner à l'éducation sanitaire lorsqu'il s'agit d'éduquer sans changer les conditions devie? Alors que la Santé Publique a pour principale vocationde mettre en relation les conditions de vie et les facteurs decause de maladies pour instaurer des mesures de prévention,en Mrique, elle n'intervient que sur les changements de comportements, faute de pouvoir modifier les conditions de vie.Or, les comportements sont tributaires des conditions de vie!Cette lapalissade sociologique semble pourtant n'être pasperçue en ces termes par nombre d'éducateurs sanitaires quiattribuent l'échec de certains projets de développements auxmentalités « traditionnelles» réfractaires au changementsocial. Mais de quel changement social s'agit-il? Lesrecherches menées par certains auteurs de cet ouvrage montrent, par ailleurs, que de nombreux malentendus perdurententre éducateurs sanitaires et populations-cibles faute d'uneinformation contextualisée.
L'hypothèse selon laquelle les populations, en particulier rurales, n'ont pas de notions d'hygiène pose donc mal leproblème. C'est encore une façon d'attribuer aux individusune responsabilité qui incombe à l'État. C'est à l'État d'instaurer des mesures d'hygiène ; et le couple propreté/santédoit s'associer à des conditions de vie décentes. Le problèmen'est pas uniquement cognitif ou culturel mais aussi économique et politique (gestion de l'environnement, mise en placede latrines, création de points d'eau, etc).
Dans une perspective de santé publique, Edward C.Green souhaite que soient intégrés au système de santé biomédical, certains modèles de pensée indigènes. Si son intention est louable, il n'est pas sûr que le raisonnement soit pertinentI3. Vouloir intégrer un modèle à un autre, c'est déjà ne
13 Il faut distinguer la théorie qui revendique l'intégration par l'Etat dusystème traditionnel au système biomédical, de la prise en compte par lepersonnel de santé du contexte socio-culturel du patient que l'auteur de
20 Les maladies de passage
pas se rendre compte que les individus manient les différentssystèmes depuis un certain temps. Au final, c'est conduirel'État à reprocher au citoyen de ne pas savoir se soigner. Ilest, au contraire, essentiel, que l'État assume ses responsabilités en matière de santé publique sans chercher d'unemanière artificielle et volontariste à « rendre les croyancesreligieuses compatibles avec la santé publique ». Ce renversement de perspective conduit E. C. Green, comme le fontcertains organismes internationaux, à laisser aux anthropologues les réflexions sur la sorcellerie et à vouloir intégrer ausystème biomédical les « compréhensions naturalistiques desmaladies contagieuses l4 » (page 270).
C'est pour éviter ce piège que nous avons volontairement écarté la notion de « contagion mystique »utilisée parcertains auteurs (Murdock, 1980) pour qualifier l'impureté I5.
La séparation de la maladie en deux catégories causales l'une naturelle ou mécanique, l'autre surnaturelle ou mystique- équivaut à penser séparemment le prosaïque et le symbolique. Or dans chaque catégorie - naturelle et supranaturelle- il y a du prosaique et du symbolique. Il ne nous paraît doncpas nécessaire de chercher, à l'instar de Edward Green dansun objectif de santé publique, à naturaliser l'impureté pour larendre compatible avec la médecine occidentale, ou à l'inverse,selon une certaine tradition ethnographique, de ne lui trouverqu'une seule essence religieuse. De plus, cette manière de faireinduit une vision évolutionniste des sociétés humaines régies àl'origine par des symboles, et incite à penser que le rejet del'impureté y serait une forme primitive d'hygiène (EmileDurckheim, 1961). Or, on a bien vu que la notion d'hygiène estéminemment politique. Pour rester fidèle à notre approche parle langage, nous prendrons un exemple provenant de la langue
ces lignes encourage. Regrouper une variété de pratiques pour adaptercertaines d'entre elles aux modèles de prévention de la médecine biomédicale est un exercice de légitimation de la médecine traditionnelle parrapport au modèle biomédIcal (Fassin, 2000 : 85). Par contre, évaluer etprendre en compte le milieu socio-culturel et l'environnement économique des patients est une démarche qui doit faire partie de la cure.
14 Traduit par nous.
15 Pour George P. Murdock, le contact avec le sang menstruel et avec lescadavres entre dans la catégorie de la « contagion mystique» et s'associe à une causalité « supra naturelle» (1980 : 17).
Introduction 21
moore qui illustrera brièvement notre propos. De nombreuseslangues africaines usent d'un même terme pour évoquer lesale et l'impur. Si l'on prend l'exemple du proverbe qui énonce:« L'impureté de ma mère ne me soulève pas le cœur ", le choixdu terme « impureté» révèle l'état marginal de la femmedurant la période des menstrues ; mais le terme utilisé enmoore (regdo) peut aussi se traduire par « saleté ». Si l'on traduit « La saleté de ma mère ne doit pas me soulever le cœur »,le locuteur peut vouloir signifier que l'écoulement et l'odeur desmenstrues des femmes ne doit pas détourner les enfants deleur mère. Celle-ci est à la fois imprègnée d'une odeur et entâchée d'impureté. La notion d'impureté s'inscrit donc dans unematérialité corporelle et dans un espace de relations humainesqui ne permettent pas de dissocier le réel du symbolique.
Notre position rejoint plutôt celle de Mary Douglas quidéfinit l'impureté par les notions conjointes de danger et depouvoir (1971 : 111). Les menstrues de la femme représententun pouvoir de procréation qui n'est pas donné aux hommes.Perçue à la fois comme vulnérable (car « à la merci des espritset des sorciers ») et dangereuse, la femme dogon était autrefois contrainte à s'écarter du groupe familial et à résider dansune maison « spécialisée » durant les quelques jours où coulait son sang menstruel. L'impureté marginalise et se définit,à l'instar de Mary Douglas, par la locution « c'est quelquechose qui n'est pas à sa place» (ibid. : 55), lecture qui s'assortit d'une analyse par le biais de l'ordre, et qui nous permet dene pas différencier les sociétés qu'elles soient rurales ouurbaines. Prenons un dernier exemple qui illustre la modernité des termes et des usages. Durant la période révolutionnaire de Thomas Sankara, au Burkina Faso, les Ouagalais ontconnu une vague de propreté révolutionnaire durant laquelletous les édifices administratifs étaient peints en blanc à lachaux. Les banderoles dispersées dans la ville affichaient :« faire blanc, faire propre ». Le blanc pur devait chasser lesidées anti-révolutionnaires à l'idéologie polluante16.
16 D'autre part, certaines personnes prétendaient que l'assainissementurbain risquait de chasser les esprits des rues et des lieux publics etque de nombreux « démons" seraient contraints de se réfugier dans leshabitations et provoqueraient, de fait, de nombreuses maladies.
22 Les maladies de passage
L'ensemble des données de cet ouvrage fait donc apparaître que l'exploration de l'idée de transmission des maladies révèle une morale sociale fondée sur la nécessité d'unemise en ordre rigoureuse de l'espace domestique et public,relationnel et social. Chaque individu doit être à sa placedans la société et tout marginal est susceptible de la mettreen danger. En certaines circonstances, la société s'octroie ledroit de marginaliser quelques uns de ses membres, à l'occasion de rituels où les sujets obtiennent un droit ou un pouvoir afin de symboliser et de réparer un état de désordre.Ainsi, dans quelques sociétés sahéliennes (Dogon, Mossi),l'homme dont toutes les épouses mouraient à l'accouchementou en suite de couches était, autrefois, amené à violer unefemme en brousse pour transférer son malheur sur cette victime qui risquait, selon l'imaginaire social, d'encourir lamort. Transmettre le mal pour guérir est une idée qui perdure dans le monde contemporain. Elle s'assortit de pratiquesnocives du point de vue de la santé publique. Avoir un rapport sexuel, de préférence avec une marginale (par exemple,une malade mentale qui erre en ville), doit permettre àl'homme de se débarrasser de sa malédiction. Cette attitude,qui s'appuie sur des rituels anciens et sur une représentationde la maladie en termes de malédiction17, valide, encore unefois, la capacité qu'on accorde à la femme d'être un vecteurde transmission de maladies et même de malédictions. Cen'est pas le rituel qu'il faut en particulier incriminer danscette pratique pernicieuse, mais plutôt la place attribuée à lafemme dans ces sociétés.
Plus que la mise à plat d'un système causal aux multiples schèmes, l'examen des théories de la contaminationfait valoir l'influence des contextes et des conditions de viedes individus. Pour cette raison, nous nous sommes gardésde regrouper, d'une manière formelle, des causes en catégories comme certains auteurs l'ont fait (Caprara, 1991 ;Green, 1999), même si leurs intitulés ont tous été cités danscette introduction et dans les articles de cet ouvrage. Par
17 D'une manière plus prOSaIque, on entend aussi dire qu'il faut" vendre»la maladie pour s'en débarrasser. Ainsi, un guérisseur moose m'avait,un jour, confié que « l'épilepsIe ne se vend pas au marché ", autrementdit il faut la transmettre par contact pour en être délivré.
Introduction 23
exemple, Andrea Caprara répertorie quatre types de causes decontamination: l'infraction relative aux conduites sexuelles,celle établie sur la base de l'expérience empirique, la contagionpar la parole et le regard, et enfin celle qui provient des excrétions corporelles (ibid. : 191). Quant à E. C. Green, il enretient principalement trois : la théorie des germes, celle del'impureté, et la contagion provenant des dangers environnementaux (ibid. :78). La mise en catégories est peu satisfaisante car elle donne toujours l'impression au chercheur quecertains éléments ne parviennent pas à y figurer. L'analysedes situations contextuelles paraît plus appropriée à ce typede réflexion. Elle fait davantage valoir la dimension morale18
et normative du sujet ou la façon dont les individus reformulent de nouveaux codes moraux et sociaux.
L'idée de contamination est bien l'expression de l'altérité et de ses différentes figures imaginaires et sociales, deses risques morbides (notamment, par le contact des substances) mais aussi de ses pouvoirs thérapeutiques (par letransfert du mal). Elle met en lumière les frontières spatiales, culturelles et sociales à ne pas franchir au risqued'être souillé et/ou malade. Son étude révèle une certainefaçon de penser les liens sociaux.
Bibliographie
Amselle J.-L.2001 Branchements. Anthropologie de l'universalité des
cultures, Paris, Flammarion.
Bado J.-P.1996 Médecine coloniale et grandes endémies en Afrique, Paris,
Karthala.
Bonnet D.1985 « Notes de recherche sur la notion de "corps chaud" chez
les Mosse du Burkina ", in Sciences Sociales et Santé,vol. 111,3-4, novembre: 183-187.
18 Nous ne faisons pas allusion, ici, à une morale religieuse spécifique(chrétienne ou musulmane) mais à une morale sociale.
24 Les maladies de passage
Bonnet D.1988 Corps biologique, corps social: La procréation et l'interpré
tation de la maladie de l'enfant chez les Moose duBurkina, Paris, IRD.
Browning B.1998 Infectious Rhythm. Metaphors of contagion and the spread
ofafrican culture, NewYork and London, Routledge.
Bourdelais P.1998 « La construction de la notion de contagion: entre médeci
ne et société ", La contagion, Communications, (numérospécial dirigé par J. Cheyronnaud, P. Roussin etG. VigarelloJ, Paris, Seuil, nO 66 : 21-39.
Caprara A.1991 « La contagion. Conceptions et pratiques dans la société
alla di an de Côte d'Ivoire ", L'univers du sida,Anthropologie et sociétés, vol. 15, nO 2-3 : 189-203.
Caprara A.2000 Transmettre la maladie. Représentations de la contagion
chez les Alladian de la Côte-d'Ivoire, Karthala, coll.Médecines du Monde, Paris, 220 pages.
Cheyronnaud J.1998 « Romines pestilentes ", La contagion, Communications,
(numéro spécial dirigé par J. Cheyronnaud, P. Roussin etG. VigarelloJ, Paris, Seuil, nO 66 : 41-64.
Douglas M.1981 De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de
tabou, Paris, Maspéro, coll. FM/Fondations, (éditionanglaise 1967, Purity and Danger, London, Routledge andKegan Paul LtdJ.
Durkheim E.1969 Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF,
(lre édition, 1912, Paris).
Fassin D.2000 Les enjeux politiques de la santé. Etudes sénégalaises,
équatoriennes et françaises, Paris, Karthala.
Introduction 25
Fainzang S.1998 « La marque de l'autre. Réflexions anthropologiques sur la
notion de contagion à propos d'une maladie non contagieuse ",La contagion, Communications, (numéro spécial dirigé parJ. Cheyronnaud, P. Roussin et G. Vigarello), Paris, Seuil,n° 66: 109-119.
FayC.1999 « Du "culturel ", de "l'universel" ou du "social" ? Penser le
sida et la prévention au Mali ", Vivre et penser le sida enAfrique, (édité par C. Becker, J.-P. Dozon, C. Obbo, etM. Touré), Paris, CodesrialKarthalalIRD : 277-298.
Green E.C.1999 lndigenous Theories of Contagious Disease, Altamira
Press, Walnut Creek, London, New Delhi.
GrmekM.D.1980 « Le concept d'infection dans l'Antiquité et au Moyen Age.
Les anciennes mesures sociales contre les maladies contagieuses et la fondation de la première quarantaine àDubrovnik (1377) ", in Rad. Jug. Akad., vol. 383, Zagreb:9-55.
Héritier-Augé F.1985 « Le sperme et le sang. De quelques théories anciennes sur
leur genèse et leurs rapports ", in L'humeur et son changement, Nouvelle revue de Psychanalyse, n° 32 : 111-122.
Héritier F.1994 Les deux sœurs et leur mère, Paris, Odile Jacob.
Jaffré Y., Olivier de Sardan J.-P. (sous la direction de)1999 La construction sociale des maladies. Les entités nosolo
giques populaires en Afrique de l'ouest, Paris, PUF.
Mauss M.1950 Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, Coll. Sociologie
d'aujourd'hui.
Murdock G.P.1980 Theories of illness. A world survey, London, University of
Pittsburgh Press.
26 Les maladies de passage
Peeters A.1982 " L'hygiène et les traditions de propreté. L'exemple des
Antilles françaises ", Bulletin d'Ethnomédecine, Paris,CNRS, n° 11 : 23-30.
Vincke E.1991 " Liquides sexuels féminins et rapports sociaux en Mrique
centrale ", L'univers du sida, Anthropologie et sociétés,vol. 15, n° 2-3 : 167-188.
Zempleni A.1985 " La "maladie" et ses "causes" ", Introduction à Causes,
origines et agents de la maladie chez les peuples sans écriture, L'Ethnographie, Paris, Société d'Ethnographie(numéro 96/97) : 13-44.
Chapitre l
Transmissions, prudenceset préventions en pays mande
Yannick Jaffré
L'ensemble des représentations populaires de la transmission de la maladie résulte de la rencontre de plusieursséries de matérialités et de contraintes: celle du corps et desaffections morbides prévalentes en une région, celle desmots, des catégories conceptuelles et des savoirs dont disposeune langue et une population à un certain moment de leurhistoire, celles des anticipations des risques ressentis où lesdiverses préventions et prudences trouvent leurs origines.
Mais il ne s'agit pas ici d'un catalogue de « variables ",puisque ces séries de « déterminants" ne sont pas simplement juxtaposées, mais dessinent plutôt des configurationschangeantes, selon les aspects qui à un moment, ou en unlieu, sont privilégiés : vivacité des interrogations face à ladouleur, inquiétudes vagues mais constantes lorsqu'il s'agitpar exemple des enfants, interrogations suivies face à despathologies endémiques, etc.
En ce domaine, toujours à venir, des craintes et des précautions, rien ne peut donc se résumer en une liste figée de termesaux contenus invariants. Les populations1 s'interrogent, de nouveaux savoirs s'introduisent, d'autres pathologies apparaissent.
1 L'ensemble des données que nous présentons ici résulte d'enquêtesmenées dans une région située au sud-ouest de Bamako, correspondantadministrativement aux arrondissements de Siby et Bankoumana.Nous remercions M. Ajou Dembele pour son aide dans leur réalisation.
30 Les maladies de passage
Plus qu'à un ensemble notionnel stable et homogène,nous avons donc affaire à de multiples altérations et modulations des discours selon l'axe de questionnement qui sera privilégié par l'entretien, le lieu ou le moment de la rencontre,voire la position spécifique du locuteur. En fait, sur le soclerésistant des pathologies et des lexiques, ces diverses sériesde variables s'entrecroisent, et dessinent, plus qu'une imagefixe, les paysages contextualisés et changeants des interprétations du passage des maladies des uns aux autres, desrisques ressentis, et des prudences profanes.
Parler des catégories émiques de la transmission et desprécautions oblige de ce fait, à respecter deux étapes. Il estindispensable, dans un premier temps, de caractériser àgrands traits les principaux types d'affections que les populations rencontrent et redoutent, et de dresser une liste destermes qui localement nomment les éventuels « transferts »
des maux, d'une personne à une autre. Faire ainsi un brefinventaire ethnolinguistique des notions correspondant à« l'outillage mental » (Febvre 1992) des populations. Dans unsecond temps, de manière plus dynamique, il importe desituer ces conceptions populaires dans divers contextesconcrets comme les pathologies ressenties, les prudences liéesaux pratiques d'hygiène, ou les normes de conduite requisesenvers l'autre, et de tenter d'ordonner l'enchevêtrement desgestes et des conceptions liant les notions de transmission, lesrisques ressentis et les prudences les plus courantes.
Les caractéfis1jques des affections et le lexique de la transmission
Avant de décrire les conceptions locales de la transmission, il n'est pas inutile de préciser leur soubassement, laréalité qu'elles s'efforcent de nommer, et trois caractéristiques affleurent alors qui nous semblent essentielles pourcomprendre la structuration de ce domaine sémantique.
Tout d'abord, au Sahel2, plus qu'elles ne relèvent d'undestin individuel, la plupart des affections - paludisme, rou-
2 Au Sahel plus encore, mais il s'agit là des constantes" ruses» du pathologique ...
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 31
geole, infections respiratoires, diarrhées, conjonctivites,SIDA, lèpre, etc, -, sont des pathologies du grand nombre.« Connaître" la maladie revient donc souvent à « reconnaître »
sur son propre corps, ce que l'on a observé, comme symptômeset évolutions, sur le corps d'un autre. Deuxièmement, cettefréquence épidémiologique se manifeste selon d'apparentesrégularités phénoménologiques. Les affections morbidesoffrent en effet au regard, une certaine récurrence des signes,et une dispersion des troubles selon des lignes de visibilité,pouvant se présenter comme apparemment homogènes etunivoques (maladies affectant uniquement les femmes ou lesenfants), réversibles (des femmes aux hommes et réciproquement), corrélées aux âges, liées aux sites ou aux saisons ...C'est ainsi souligner que la matérialité morbide n'est pasinforme et que les expressions pathologiques constituent desindices complexes et souvent trompeurs, notammentlorsqu'ils doivent être interprétés dans un lexique populairene disposant pas de l'ouverture d'intelligibilité que fournissent des concepts comme ceux d'incubation, de vecteur oud'agent pathogène (virus, bactérie, etc.).
Enfin, d'un point de vue profane, ces indices sont interprétés selon ce qui en est le plus immédiatement visible: lepassage d'une affection d'un malade à une personne apparemment saine. Il en découle, que s'appliquant à des maladies « en acte ", ce lexique populaire de la transmission est,pour une grande part, constitué par un ensemble de verbesdésignant la spécificité de ces échanges pathogènes. Cespoints dégagés, il reste maintenant à comprendre comment,le fil des interprétations populaires brode avec ses proprestermes les plis de ces caractéristiques « lourdes ".
Ainsi, en langue bambara, au plus « large" et au pluspassif, ka kunbèn désigne la « rencontre» avec la maladie.D'autres lexèmes permettent ensuite de qualifier les modalités d'un tel transfert morbide. Ainsi ka jènsèn évoque l'idéed'une propagation. Lorsque ce terme s'applique à unensemble humain, il correspond à une notion de dispersionrapide de la maladie, « affectant tous d'un seul coup ,,3. De
3 De semblables conceptions et expressions se retrouvent dans d'autrescontextes, voir, par exemple, pour les populations andines Œernand, 1983).
32 Les maladies de passage
mamere individuelle, ce mot désigne l'impression d'un« envahissement» de l'intérieur d'un corps. Le nombre et lacélérité sont donc les traits majeurs de ce terme qui se prête,par exemple, à caractériser des épidémies de méningites(kanjabana, lit. cou sec maladie), ou de rougeole (nyànin, lit.mil petit).
Un autre terme, ka yéléma, inclut, outre l'idée detransfert d'un individu à un autre, celle d'une possible transformation de l'affection. Une maladie peut « passer » de l'unà l'autre, mais peut aussi se modifier, commençant parexemple par ce que l'on nomme couramment un « paludisme )'(sumaya, lit. fraîcheur), avant de devenir un « ictère» (sayi).
Un autre mot, ka bila (ka bila màgà la, lit. laisser surquelqu'un), exprime, quant à lui, l'idée d'une transmissionqui peut être volontaire. Son sens est proche de celui duverbe « envoyer », et sous-entend souvent une volonté denuire de la part de « mauvaises personnes» (màgàjuguw).
Dans ce même registre, et plus explicitement encore, ci(envoyer), s'applique à un acte volontaire de transmissiond'une maladie: ne ye korote ci a la (je lui ai envoyé du poison).
Par contre, lase correspond à une notion de « transportde la maladie vers quelqu'un », mais souvent de manièreinvolontaire. C'est pourquoi ce terme s'applique parfois àqualifier le rôle d'un « vecteur» animal.
Dans un autre champ notionnel, le terme cèn (ou ciyèn,lit. héritage), est utilisé pour désigner les maladies qui setransmettent des parents aux enfants (cènbanaw), et dont onhérite (juruya bana, lit. maladie de la dette).
Enfin deux verbes, plus qu'apporter une nuance supplémentaire, concernent la position des locuteurs, et s'appliquent à désigner ceux qui passivement sont atteints par lamaladie: ils la « trouvent» (ka sàrà) , elle les attrape (kaminè)4.
4 Soulignons que l'on ne peut déduire de ces termes aucune interprétation quant à une passivité du malade (. attrapé ", auquel serait opposéeune vitalité de la maladie. Dans un contexte français, le fait .. d'être"enrhumé ou .. d'avoir" la rougeole, n'implique pas que la maladie seconfonde avec le sujet dans un cas, et ne soit qu'une transitoire acquisition dans l'autre.
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 33
On peut raisonnablement supposer que ce lexiquetémoigne de certaines conceptions, autant qu'il oriente lesréflexions du plus grand nombre. Cependant, il ne borne passtrictement le champ des observations et des supputationspopulaires5, pas plus qu'il ne fixe toutes les situations d'interlocution. D'autres maladies apparaissent, d'autres informations circulent et la grammaire est suffisamment plastiquepour les accueillir; permettant, par exemple, des variationsde sens selon que le terme est utilisé sous une forme verbaleou nominale. C'est, par exemple, le cas du verbe yèlèma quis'applique préférentiellement à une transmission univoqued'un malade à une personne saine, alors que le sens du groupe nominal bana yèlèmataw Oit. maladie transmissible) estproche de celui de finyé bana (lit. maladie du vent), quidésigne généralement une transmission épidémique6. Bref,une grille de lecture n'est pas celle d'une prison et comprendre la notion de transmission oblige à décliner les variations de ses nuances sémantiques selon le prisme de diverscontextes. C'est pourquoi, nous nous attacherons maintenantà déchiffrer quelque unes des multiples irisations du sens deces conceptions, selon divers « éclairages» : ceux des maladies, des préventions, des espaces et des conduites d'hygiène,des normes religieuses et de préventions médicales.
La transmission et les maladies
Commençons par caractériser quelques grandsgroupes d'affections ressenties. Tout d'abord, « toutes lesmaladies ne se transmettent pas» (banaw bèè tè yèlèma).Celles qui se transmettent constituent donc un sous-
5 Ces conceptions" homogénéisées" par une approche ethnolinguistique,purement lexicale, sont bien évidemment l'objet de débats. Ainsi certains interlocuteurs, à propos du terme yèlèma déclarent" qu'on utilisele même terme pour dire ce qui passe et ce qui change mais ce n'est pasla même chose ((en kèlèn tè) ", posant ainsi le rapport entre l'analyse ducontenu d'un terme et les multiples variations interprétatives liées auxcompétences de nos interlocuteurs et aux contextes de l'énonciation.
6 De semblables difficultés se retrouvent en langue française puisqu'eneffet si l'on distingue - non sans difficultés - des maladies contagieuseset des maladies transmissibles, par contre sous une forme verbale desmaladies contagieuses" se transmettent ».
34 Les maladies de passage
ensemble, dont nombre d'affections courantes comme kàdimi(douleurs du dos) sont, par exemple, exclues.
Celles qui se transmettent ne constituent pas cependant un groupe homogène. Ces maladies diffèrent toutd'abord physiquement ou matériellement, par ce qu'ellesoffrent à voir, leurs signes certainement, mais aussi par ceque nous nommerons leurs régimes de fonctionnement,incluant notamment leurs modes manifestes de dissémination ; mais aussi les diversités de leur part obscure: cequ'elles obligent à comprendre, imaginer et supposer commeraison et origine. De là, diverses supputations et « regroupements » instables, dont nous allons maintenant tenter de cerner la cohérence « représentationnelle ».
- Un premier large ensemble d'affections, regroupe lesmaladies qui se transmettent sans que nul ne le veuille,« pour rien » (tèmeto gwansan), transmises « comme cela »
(yèlèma ten), « certaines facilement et d'autres difficilement »
(dàw yèlèma ka teli, dàw yèlèma man teli).
Celles-ci, peuvent résulter d'un contact voulu, ou d'uneproximité acceptée (doroko : se serrer, se mêler), ou tout aumoins qui n'est pas évitée, voire d'une inévitable « promiscuité » (gèrèn nyàgàn na bana, lit. maladie du regroupement). Àce titre, toute relation peut être grosse d'une menace, mêmesi les risques perçus restent cependant plus particulièrementliés à certains types de contacts (dorokoli).
Plus spécifiquement, panni ces « contacts », les relationssexuelles (kajè, lit. se rassembler) sont supposées être à l'Oligine d'un ensemble de maladies dont les symptômes se manifestent sur le sexe de la personne, et sont, de ce fait, nommées cèni musoya bana Oit. maladie entre l'homme et la femme7). Lalocalisation génitale et la rapidité d'apparition des signes
7 On ne peut confondre ces maladies qui s'attrapent" entre homme etfemme ", avec celles qui sont spécifiques à un sexe pour de simples raisons anatomiques: maladie d'homme (cèya bana) comme par exemple unhydrocèle scrotal, ou maladie de femme (musoya bana) comme des règlesdouloureuses. Par contre, et bien évidemment dans une classification,avant tout construite autour des expressions symptomatiques, certainesmaladIes sexuellement transmises peuvent être interprétées comme spéCIfiquement masculines ou fémmines, si elles semblent, dans leurs manifestations visibles, n'affecter qu'un seul sexe. Il en est ainsi, par exemplede damaJalan (blennoragie pour les hommes). C'est dire aussi qu'on ne peut
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 35
pathologiques sont les traits principaux de ce groupe de maladies qui, selon les représentations locales, se transmettent instantanément. Et c'est ainsi, pour ne prendre qu'un exemple,selon l'un de nos interlocuteurs, que la « chaude pisse » attrapeles gens « sur place» (sopisi bè yèlèma màgà fè « sur place»).
Mais la contiguïté n'est pas indispensable pour que setransmette la maladie. Le regard ou la voix le peuvent aussi,ainsi que tout contact indirect avec « une trace» (nà) , commelors du partage de la nourriture, de vêtements, ou lorsquel'usage de certains lieux, consacrés notamment aux toilettes ouau lavage des vêtements, expose à entrer en contact avec deslinges ou éponges qui appartinrent à une personne malade:
La femme qui a le kànàdimi (maux de ventre), la pierre où elle s'assoit, celui qui viendra s'asseoir sur cettepierre, et se laver avec la même éponge, le konodimil'attrappera (kànàdimi b'a minè).
Ces préoccupations, concernant la circulation dessouillures pathogènes, englobent aussi l'action de certainsinsectes comme les mouches, ou l'enjambement involontairedes traces de tout cadavre animal supposé porteur d'uneforce vitale négative (nyama) , ou encore des déjectionscomme les urines d'âne et de chien (fali ni wulu sugunè nà).
Si ton pied touche la trace de l'urine d'un âne, cela tedonne la « chaude-pisse» (n'i sen sera fali sugunè ma, 0 bèdamajalan bila i la).
Crainte des contiguïtés hasardeuses, des différencesanimales, des insectes, dont le libre vol laisse imaginer letransport de déjections dangereuses; selon ces propos, toutserait inquiétude, et les protections adéquates consisteraientà isoler chacun, et notamment les enfants (ka denmisenmabà tàw la, lit. séparer les enfants des autres), trier entreles malades et les biens portants, sélectionner ses commensaux8, conserver par-devers soi l'ensemble de ses ustensiles,
surtout pas déduire de cette complexité médicale et terminologique unequelconque" théorie» locale stable liant genre et maladie et moins encoreune" volonté discriminatoire» envers le sexe féminin.
S A contrarw, il est dit aussi que se laver les mains avant le repas, avecl'eau souillée par les mains de ses convives porte chance : tègè ko jinogolèn de ka nyz, barka b'a la.
36 Les maladies de passage
surveiller ses pas et ses déplacements, contrôler ses regards,etc.
À l'évidence, ces diverses préventions ne peuventconcrètement être mises en pratique. Elles s'opposeraient, deplus, aux règles de sociabilité les plus courantes. Elless'adaptent donc, selon les statuts des malades, les craintesressenties; et ne sont réellement parfois mises en œuvre queparcimonieusement face aux périls d'une épidémie.
Deux caractéristiques régissent donc ce premierdomaine des notions populaires de la transmission « involontaire » et des préventions idoines. La première est une inflation des discours portant sur les risques et les craintes: toutsemble potentiellement dangereux. La seconde consiste enun « décrochage » entre ces discours prônant la vigilance et lasuspicion, et le peu de pratiques préventives effectivementmises en œuvre. Qui songerait, dans un village, à refuser decroiser un âne ou un chien, qui n'échange des regards, et quichasserait ses parents malades?
Un deuxième ensemble de pathologies qui se transmettent, concerne les « maladies d'héritage », (juruya bana oucèn bana ou ciyènJ. A l'inverse des précédentes, elles ne circulent ni ne s'échangent largement. Distinctes de celles quise contentent d'être courantes dans une famille - sorte de« point faible » familial -, et qui sont nommées naamu Oit.règle, loi, coutume, usage9), elles « restent dans la famille »
où elles se transmettent de manière interne, précisémentcomme un héritage (cènJ. D'autres étymologies sont parfoisproposées pour expliquer ce terme. Mais, à la manière d'untest projectif, elles renseignent tout autant sur les interprétations profanes, qu'elles n'attestent une véritable originelinguistique.
C'est ainsi que selon certains, le mot cèn aurait commeracine un terme homophone (cèn, lit. être gâté). Cette proximité signifierait que ce qui est transmis est abîmé, altéré parla succession des générations. Un autre terme, employé pourdécrire ce type de maladies,juru, ferait quant à lui, référence
9 Comme on dit en Français : " Dans la famille, on est sujet aux rhumes", sans que cette expression implique une notion de transmission d'uneréelle caractéristique pathogène.
Transmissions. prudences et préventions en pays mande 37
à une corde (juru) , un lien solide, passant des parents auxenfants. Mais quelle que soit l'étymologie, tous s'accordentpour circonscrire un ensemble de maladies « venant desparents ».
Et c'est ainsi, très simplement, qu'une maladie d'héritage est une maladie qui, attestée chez les parents, apparaîtensuite chez les enfants. Mais si l'observation quotidiennepermet de repérer, au sein de certaines familles, la transmission régulière ou discontinue de certaines maladies; rendrecompte de tels phénomènes confronte à plus d'incertitude.Autrement dit, si la sémiologie est une lecture permettant dedécrire une régularité de signes, comprendre « l'étiopathogénie» s'apparente à une interrogation sur les obscures et complexes raisons du mal. De ce fait, plus qu'à des conceptionsstables, les interprétations populaires se présentent en cedomaine comme un champ d'hypothèses.
C'est ainsi que certaines maladies, comme l'albinisme(yefuge) , sont supposées se transmettre tant du côté du pèreque de la mère. Il en serait de même pour banaba Oit. grandemaladie, lèpre) : « La lèpre vient soit du côté de la mère (basira fè), soit du côté du père ou d'un parent (fa ou balimayasira fè). Cette maladie attrapera (minè) aussi les enfants desenfants ». D'autres, supposent que « l'enfant prend la maladie dans le ventre» (den bè bana yèrè de ta konona), et quecette prédisposition est ensuite « activée par le lait maternel»(sinji b'a jiidi, lit. le lait maternel l'accroît, l'active). D'autresentités, comme sàgàsàgàninjè Oit. petite toux séche), termedésignant souvent la tuberculose, se transmettraient plusrapidement et facilement (teli) par la mère. La folie (fa)serait aussi maladie d'héritage ... D'autres maux encore setransmettent spécifiquement selon le sexe (Cf. note supra),et les spécificités induites par leurs différences anatomiques.Sous la forme d'une lapalissade, il en va ainsi, des mères àleurs filles - par exemple « kànàdimi Oit. mal de ventre, et icieuphémisme pour désigner des règles douloureuses), ce sontuniquement ses filles qui ont ça » - ; ou des pères aux filspour les hernies scrotales (kaliya).
Enfin, un dernier ensemble regroupe des maladies« causées», maladies des sortilèges (dabali bana, lit. sortilège maladie), que ces derniers soient d'origine humaine ou
38 Les maladies de passage
surnaturelle. Elles ne « s'attrapent » donc ni gratuitement,« ni sans raison» (oluw t'i baga k'i minè). Elles sont souventtransmises dans la volonté de nuire, et résultent globalementde l'action directe ou indirecte, de « personnes du secret »
(gundo màgà) , de « sorciers » (subaga), ou plus largement demauvaises personnes (màgàjugu). Mais plus que de la violence, ces maladies, sont celles de la volition. En effet, si certains « font exprès» (ka da bà a kama ou ka tugu) de transmettrent une maladie - et il est fréquemment supposé, parexemple, que des malades tentent de contaminer les personnes saines lO - ; d'autres personnes, par contre, semblentêtre agies par leurs pulsions, plus que maîtresses de leurvouloir. Elles sont ainsi jouées par leur regard, lorsque leurs« yeux jaloux » (nyè kèlèyatà) fixent une personne malade, etqu'ils en deviennent malades à leur tour, simples relais,avant de transmettre à d'autres l'affectionll. D'autres encorene peuvent contrôler leur parole et leur envie notammentface à des « enfants trop beaux » (den saraman), qu'ils complimentent alors de manière mortifère12 ...
En fait, ces interprétations reposent sur une conception plus globale de la société, où l'homme étant considérécomme peccable, la transmission se trouve liée à diversesformes d'intentionnalité, allant d'une réelle volonté de nuire,à une insuffisante maîtrise de soi dans ses rapports à l'autre,jusqu'au regret de n'avoir pu faire autrement. Pour le diredifféremment, « être sorcier (subaga), c'est être plus ou moinsresponsable, et pas forcément coupable », voire parfois êtresimplement victime d'un « mauvais destin qui s'impose à soi »
(tèrèjugu). Il en résulte que tout acte quotidien et tout rap-
10 Cette contammation peut être involontaire, par crachat par exemple.Elle peut aussi être voulue, lorsque ces malades « mettent cette maladiesur leur femme" (cè dàw bè fura kè u musa la), afin que ceux qui lescourtisent soient pris par la maladie.
Il Ce transfert de maladie par le regard est bien évidemment lié aux relations de rivalité les plus courantes. C'est ainsi que cette caractéristiquedes « yeux jaloux ", peut aussi parfois être nommée maladie des yeux decoépouses (sinamusow nyèdimi).
12 Cette conception des « enfants trop beaux» est proche de celle décritepar Zempléni (1985), en pays Wolof et Lebou à propos des enfants NaKu Bon. Elle est aussI présente dans les diverses interprétations du« mauvaIs œil ".
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 39
port d'altérité, jusqu'aux plus ténus, se révèlent alors potentiellement dangereux. Tout peut éventuellement engloberune « transmission" : la nourriture, l'air respiré (finyè fè), leslieux, les conduites habituelles comme nettoyer, se laver, serrer la main, ou même dire son nom.
Ces affections ont une cause spécifique. Mais leurssymptomatologies, tout au moins à leurs débuts, prennentun aspect semblable à celui de toute autre pathologie. Le sortilège emprunte au plus banal et se dissimule sous les apparences des troubles les plus ordinaires. La maladie dabalipeut ainsi être toute sorte de maladie. Elle peut entrer dansle corps par une autre affection, et « s'enraciner avec cettedernière » (a b'i di li don a fè) ; pour « ensuite tendre versd'autres » (ka tila k'i lasama do wèrèw nofè) , et « s'étendresur tout ton corps » (k'i fari bè LaM).
C'est pour cela, qu'en fait, l'imputation d'un sort est leplus souvent un acte « rétroactif ». On comprend toujourstrop tard « qu'il y a la main d'une personne derrière » (mogobolo b'a la). Le vouloir trouble ou l'intentionnalité malveillante ne se découvrent « qu'après coup », incriminés faceà un ensemble de signes allant d'un début subit et inattendude la maladie laissant imaginer « une attaque ", à des symptômes visibles et spectaculaires comme des ulcérations, semblables « à des blessures de flèches », ou lorsque la maladiedevient chronique ou conduit à la mort. Plus qu'une pathologie spécifique, c'est l'inhabituel qui est objet de suspicion.
Ce qui fait peur, c'est que quelqu'un jette (bon) undabali dans ton ventre et que cela trouve ton intestin.Dans ce cas, tu peux parcourir le monde, tu ne pourrastrouver de remède pour ça. Pour finir ça te tue (a Laban, ab'i faga). Toutes les maladies que tu vois, dabali peuttransmettre tout cela à la personne.
Maladies d'origine obscure, cet ensemble de pathologies ressenties, loin d'être gommé par les nouvelles pratiquesmédicales, trouve plutôt maintenant à se loger dans seséchecs. Confrontés aux savoirs biomédicaux, dabali bana seprésente alors comme ce qui résiste, ne répond pas au pouvoir des médecins, et correspondrait de ce fait à d'autrescauses, et impliquerait d'autres connaissances.
40 Les maladies de passage
Par exemple, si c'est une rougeole provenant de dabali,les injections ou le vaccin ne peuvent rien contre cettemaladie C.. ) la maladie tue la personne. Dabali bana nepeut pas être guérie par les médecins parce qu'ils neconnaissent pas l'origine de cette maladie. Il n'y a pasd'appareil qui peut voir ça. Si tu vois qu'on peut traiterune maladie, c'est qu'on sait d'où elle vient. Mais le jouroù l'on sait que c'est dabali bana, c'est le jour de ta mort.
Ces descriptions populaires par les causes, recouvrentlargement une distinction entre les maladies de Dieu - globalement toutes les maladies que l'on interprète commeétant d'origine « naturelle» ou transmises dans la filiation -,et les maladies entraînées par un « travail» humain.
Ces dernières sont toujours « envoyées» à dessein denuire. Les « maladies du Dieu de l'Islam» (Ala banaw)s'accordent, quant à elles, globalement avec un capital de viedisponible, une sorte d'espérance de vie « prédéterminée ».Selon les personnes la « force vitale» (ni, lit. souille) est plusou moins forte ou faible (ni ka Mn & ni ka fègèn, lit. souillelourd ou léger). Mais « tant qu'il reste des jours », « tant qu'ilsne sont pas finis» (n'i si ma ban, lit. si ton âge n'est pas fini),toute maladie peut - tout au moins en théorie - être soignée.Lorsqu'elles relèvent d'une telle conception, quasi existentielle, les affections rencontrées s'inscrivent donc dans un destinnormal, une régulière « traversée du monde » (diyèn latigè) ,que seule une violence humaine peut contrarier.
On l'aura compris, ces faisceaux d'explications causales ne constituent aucunement une nosographie populairestable, et plus que des certitudes permettant des prédictionset des prescriptions rigoureuses, ils s'apparentent plutôt àdes interrogations face à diverses énigmes morbides.Brièvement, nous pouvons caractériser ces questions en lesrapportant au réel qu'elles affrontent.
Une première difficulté provient de ce que ces regroupements, selon des modes de transmission de la maladie,sont liés aux expressions phénoménologiques de complexitésvariables des maladies.
Ainsi, au plus simple, il est évident qu'une rougeole,dont l'incubation est ignorée, mais qui est facilement identi-
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 41
fiable par ses signes pathognomoniques, semble « sauter » (abè pan) d'un enfant à l'autre. Mais il est moins aisé de comprendre « l'échange » d'une gonococcie se manifestant rapidement et visiblement par un écoulement chez l'homme, alorsqu'elle ne progresse qu'à bas bruit chez la partenaire féminine. Plus difficile encore lorsque, dissimulée sous le couvertdes relations amoureuses et matrimoniales, la génétiquealterne des porteurs hétéro ou homozygotes, et le hasard destraits dominants ou récessifs, faisant ainsi apparaître ou disparaître la maladie au sein d'une même famille ; ou encorequand le mal sommeille durant de longues périodes d'incubation comme pour certaines pathologies hépatiques ou leSIDA.
Dans ces ruptures du visible, se logent les failles dessavoirs populaires, et dans ces incertitudes des observationsempiriques face aux diverses complexités du mal, s'immiscent - en usant des ressources des concepts locaux, desnotions médicales souvent nouvellement acquises, et descatégories symboliques disponibles - une réflexion sur lescauses de la maladie et les raisons de leurs passages des unsaux autres. En ce domaine, constitué d'hypothèses instableset faibles, « on tente sa chance explicative », et, dans les discours quotidiens, ou plus encore, lors d'un épisode de maladie, les catégories qui semblaient strictement caractériserdiverses identités de maladies se révèlent fluctuantes etlabiles.
En effet, les paradigmes explicatifs précédemmentcités, qui ont plutôt l'apparence de vastes hyperonymes servant à orienter le raisonnement, s'avèrent perméables, régispar une sorte de casuistique fluide, permettant d'envisager,pour une seule maladie, plusieurs types de causalités, et surtout d'utiliser divers recours et propositions thérapeutiques.C'est ainsi que des notions comme celles « d'épidémie» (finyèbana), de « maladies transmissibles» (bana yèlèmata), et« d'héritage» (juruya bana), loin d'être exclusives les unesdes autres peuvent, au contraire, être cumulées dans un seulraisonnement. Pour ne prendre que quelques exemples,mara (entité souvent traduite sous le terme d'onchocercose),peut être décrite comme étant une maladie héréditaire(juruya) , mais supposée aussi, être causée par une petite
42 Les maladies de passage
mouche (limàgà / lèn), ou, éventuellement, être attrapée parle contact avec l'éponge végétale servant à la toilette (fu} ...La lèpre peut résulter d'un contact ou d'un sortilège (dabali).La tuberculose se transmettre par héritage et sortilège...
L'inquiétude, et la recherche du remède, déterminentces supputations complexes, et, en ce domaine, l'appartenance d'une maladie à plusieurs systèmes interprétatifs, est toutautant la trace d'une incertitude, qu'elle n'est caractéristiqued'une luxuriance et d'une précision des imputations causales.Ce qui fût soigné était donc naturel, mais un décès étonnant,pourrait bien provenir d'une obscure raison ... Dans bien descas, les discours profanes sur la transmission de la maladiese présentent comme des explications « après coup ", despathologies en cours. C'est ainsi, qu'à défaut de permettreune maîtrise de la maladie, ces conceptions évitent que cettedernière apparaisse comme « absurde », non motivée, préservant de ce fait - à défaut des personnes -, tout au moins uneraison au mal et à la mort.
La transmission, les prudences et les préventions
Bien que difficile à mettre en œuvre, la préventionn'en est pas moins une réelle préoccupation, englobant plusieurs champs notionnels correspondant à diverses dimensions de la vie sociale que nous allons maintenant parcourir.
Elle s'applique tout d'abord aux deux grandsensembles de causalités et de pathologies précédemmentdécrits. Mais, « maladies de Dieu" ou « maladie des sortilèges ", il s'agit plus de se prémunir contre une incertaineorigine du mal, que d'envisager des conduites prophylactiques correspondant à des pathologies spécifiques.
C'est ainsi qu'au plus prosaïque, et au plus « laïque ",se protéger est, avant tout, simplement affaire d'attention(ka koloci). Plus spécifiquement, un autre terme, kajanto (seprotéger) est utilisé, lorsqu'à ce « contrôle », s'ajoute unevolontaire vigilance, que cette dernière s'exerce pour soimême ou soit conseillée à un autre.
Le terme, ka lakana (lit. défendre et élever) et ses harmoniques de crainte et de protection, s'attache préférentielle-
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 43
ment à certaines personnes, et notamment aux jeunesenfants qui ne doivent pas être « exposés » à un quelconquedanger, que ce dernier soit connu ou simplement supposé.
Enfin, deux autres termes ouvrent à des univers magico-religieux. Ka tanga est une protection contre la maladie,ou contre l'action d'autres supposés dangereux: sorte de barrière symbolique que l'on tente de dresser contre un mal provenant d'une toujours possible malveillance.
Proche mais distinct, ka kisi recouvre quant à lui,l'idée de se mettre sous une protection divine. Là où le premier terme souligne la nécessité de se méfier de l'autre, lesecond incite à se placer sous la protection d'un Autre.Légère différence sémantique certes, mais qui dénote larégulière oscillation du monde mandingue, entre un pôlepaïen et un pôle musulman13 : « le talisman te protège, maisseul Dieu te garde» (bagan b'i tanga, Ala de bè mogo kisi).
Plus spécifiquement, il ne peut y avoir de réelle protection contre des maladies de sortilège (dabali bana), dont lamort est fréquemment l'issue, et dont elle signe l'attestationtoujours trop tardivement comprise. Mais puisque ces affections trouvent leur origine dans une volonté de faire du mal(ka lajuguya), d'offenser (ka lanogo), de détruire la personne(i ta ka tinyè, lit. gâter ce qui est à toi) - autant de jalousies,convoitises, et envies qui émaillent toute vie sociale -, unecertaine prudence (farati) 14, peut cependant s'exercer pourne pas risquer, de l'autre, le courroux. C'est pourquoi, unensemble de précautions « primaires », désigne les principales règles de comportement que l'on doit s'efforcer d'appliquer dans ses rapports aux autres.
En ce domaine, l'auto-surveillance est tout d'abord larègle, et les notions de prévention précédemment évoquées
13 Nous retrouvons ici ce que Dumestre (1996), souligne pour le domainede l'alimentation: " Le deuxième couple qui structure le champ de l'alimentation est celui qui oppose le pôle mari au pôle bàmanan, termesqu'on peut traduire respectivement par "croyant" et "palen" ". C'est,selon nous, l'un des axes cruciaux pour la compréhension des conduitessociales et des valeurs culturelles au Mali.
14 En bambara, le même terme, faratl signifie le danger, et permet deconstruire l'expression exprimant la prudence: farati b'a la (il y a dudanger) & n bè faratl (je suis prudent).
44 Les maladies de passage
s'y conjuguent à la forme réfléchie. Ainsi, une premlerenorme de conduite apparaît sous l'expression k'i yèrè kolosi(lit. se surveiller soi-même). Elle souligne l'importance deréfléchir à ses actes dans diverses situations - comme parexemple de ne pas s'approcher d'une personne malade - maisinsiste aussi de manière beaucoup plus générale, sur lanécessité de respecter un ensemble de « prescriptionssociales » fondamentales, dont la maîtrise de sa parole lorsqu'elle s'adresse notamment - puisque la performativité desmalédictions est liée aux statuts sociaux - à des aînés ou desparents. Cette méfiance, de et pour soi (ka jantà yéréla , lit.se méfier pour soi-même), est donc avant tout, affaire decontrôle de soi. En ce premier domaine, pour être protégé etrespecté, il ne faut pas être « une personne sans valeur»(màgà gwansan). Il faut prouver que l'on est capable de sedominer (an ka se an yèrèla, lit. on se peut), et parfois alors,même les féticheurs (soma) ou les possesseurs de médicaments (fura tigi) « peuvent avoir pitié de toi » (u bè hinè i la).
Ce premier ensemble, constitué autour des prudencesdans les rapports avec autrui, est donc caractérisé par delarges contours, englobant les normes de conduites socialesles plus quotidiennes15. Deux notions fondamentales peuventcependant ici les borner: l'obligation du respect (bonya) , etd'une certaine honte/pudeur (maloya) envers ceux dont ondépend (aînés, parents, beaux parents plus âgés que safemme, etc.).
Ces deux notions, parfois présentées comme interdépendantes - « la honte c'est vraiment le respect » (maloya yeyèrè bonya de ye) - ne sont pas que de discours. Elles doiventcorrespondre à une maîtrise de soi, notamment dans lesdiverses formes d'interaction avec l'autre que sont le faire(kèta) , le dire (fàta) et le voir (yéta). Domaine redondant oucirculaire donc, puisqu'en ces gestes, paroles et regards, se
15 De semblables remarques sont faites par Benoist (1993) au sujet de laRéunion : " Les conduites prophylactiques sont particulièrement nombreuses dans ce contexte. Par une ritualisation obsessive des comportements, l'individu vise à se rendre peu vulnérable : obéIr aux interdits,se méfier des inconnus, ne pas se présenter à six heures ou à minuitdans des carrefours fréquentés par les esprits, ne pas se tenir sous certains arbres, etc. " (p. 66).
Transmissions. prudences et préventions en pays mande 45
retrouvent aussi, les principales « portes d'entrées " de latransmission de la maladie. Bref, pour ces affections de sortilèges, qui finalement sont les pathologies des liens humains,les prudences sont nécessaires ... , autant qu'impossibles,puisque aucune vie sociale n'échappe aux excès, pas plus quele sujet à ses pulsions.
Un autre domaine est construit autour de « préventions secondaires ». Différemment des précédentes, plus qued'empêcher l'autre de songer à commettre un acte maléfique,elles ont pour fonction d'empêcher l'action du sortilège. Outrela dissimulation (dogoli) de toute « personne à risque ", cetensemble, avant tout constitué d'objets (tangali fura outanga fenw, lit. choses de protection), emprunte de manièresyncrétique aux divers domaines religieux, des sortes de« boucliers" symboliques, composés « d'antidotes" (lakari),de talismans et d'amulettes (baganw), de ficelles à nœuds(tafo) sur lesquelles sont prononcées des formules propitiatoires (ka kilisi kè tafo la k'o siri i farila), ou d'eau bénite pardes versets coraniques (nasi).
Il est impossible de prévoir l'ensemble des réactions detous les autres, pas plus qu'on ne peut parer aux rivalités.C'est pourquoi, cette seconde modalité de la préventions'apparente à l'art de la guerre. Puisqu'on ne peut les éviter,il faut - et le terme en français local est on ne peut plusexplicite - « se blinder ", afin que les conflits qui ne pourrontmanquer de surgir tournent à son avantage.
Un troisième ensemble, englobe divers « produits auxiliaires " de la santé (kénéya fura, lit. médicament de santé),ayant comme fonction de permettre à chacun de « seconstruire» (k'i yèrè dilan) ou de se « réparer» (k'i yèrèlabèn). Ces « médicaments» (fura, lit. feuille) sont le plussouvent spécifiques à des âges et à des situations. Ils correspondent à autant de circonstances considérées comme comportant des risques. « Ils sont nombreux" (fura suguya kaca). Certains sont supposés protéger la femme enceinte etl'enfant à naître, contre de mauvaises personnes (mogojugufura). D'autres, après la naissance peuvent donner de la forceà l'enfant (kologèlèya fura, lit. médicament pour durcir lesos) et l'aider à marcher (tagama ou taama fura), ou aumoment de la puberté favoriser la fécondité des jeunes filles
46 Les maladies de passage
(iajoli fura : médicament de fécondité). Ces protections sedéclinent sous divers objets d'apparence et significationsdiverses: banbuna sen naani (pagne à quatre attaches qui aservi à porter l'enfant), solima fini (vêtement de circoncisionde l'enfant) ... Enfin un ensemble d'autres produits a plutôtune fonction « généraliste» de favoriser la chance (garijègèfura : produit pour la chance).
Ces prudences et ces préventions se répartissent doncde manière souple, en fonction des deux pôles ou valencesque constituent les maladies de Dieu et les maladies du sort.Lorsque l'aspect « naturel» du risque est privilégié, les préventions se distribuent selon des étapes physiologiques dudéveloppement de la personne, lorsque le danger est envisagé selon des caractéristiques magico-religieuses, la mise enœuvre de diverses prudences dans les relations sociales estavant tout valorisée.
Ces préventions engagent aussi deux modes. L'un estsingulier, de l'ordre du secret et de l'intimité, l'autre concerne des pratiques collectives, notamment lorsqu'il s'agitd'empêcher des enfants de se rendre dans un village ou uneépidémie est déclarée.
Enfin, soulignons que dans ces systèmes, les populations oscillent globalement entre une méfiance et une prudence qui s'appliquent avant tout aux relations sociales, etdes préventions qui ne se mettent en place que lors d'un épisode de maladie. Représentations et conduites qui se trouvent donc en décalage avec les discours médicaux préventifs,puisque l'on se prémunit avant tout des relations sociales,alors que l'on n'anticipe aucunement sur des maladies « àvenir » selon diverses adaptations comportementales correspondant à des risques sanitaires identifiés.
La transmission et les espaces
Dans la vie quotidienne, ces notions de transmission,et les diverses représentations et pratiques de prévention quiles accompagnent, correspondent aussi à une « topographiedes risques ressentis ». Globalement, les lieux dangereux(faratima yàorà) sont des lieux d'échanges divers : lieux de
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 47
réunion où l'on se rassemble (jamalajè yàrà), lieux de passage du vent (finyè tèmèto yàrà), embranchements de cheminsoù se déposent, et donc peuvent être foulés, des « médicaments » déposés en offrande (siraba kan fura).
D'autres lieux s'accordent avec une mémoire du terroir. Ainsi les « terres chaudes », souvent de vieux champsabandonnés et repris par la brousse, sont proscrites commerecelant fréquemment une force néfaste (nyama yààrOJ.Enfin, au plus quotidien, les cimetières (kaburudo), les lieuxde lavage du linge (finikoyoro) , les toilettes (nyègèn), et lesdépotoirs (nyamaton), suscitent aussi une certaine crainte.
Ces lieux à des périodes se conjuguent, selon une temporalité du risque. Les moments les plus dangereux sontceux, qui juste après le crépuscule (fitiri tèmènen dàànin),aux instants les plus chauds (tilegan fè), ou au mitan de lanuit (dugutila) , sont supposés propices aux sorciers ou auxméchantes gens pour transmettre des maladies (subagayabana, màgàjuguya bana) qui mettent notamment la personne« hors de sa raison» (u bè màgà bà u sabula la).
Mais une nouvelle fois les rapports entre ces discourset les pratiques les plus usuelles ne vont pas sans poser problème, puisqu'en ces lieux dangereux, pourtant, chacun circule. Cependant si une inquiétude vague est plutôt le sentiment qui connote ces pratiques ordinaires de déplacement etde rassemblement, d'autres conduites, concernant notamment les hygiènes de l'environnement et du corps, sontl'objet d'une attention plus soutenue, et cela, particulièrement en certains lieux
Du point de vue de l'hygiène et de la transmission desmaladies ressenties, un village n'est en effet pas uniforme. Ilcorrespond à un formidable emboîtement, chevauchement etsuperposition de « micro-territoires », correspondant à desnormes de conduites spécifiques et à des activités différentes.
C'est ainsi qu'au Mande, le plus souvent, le principalespace religieux est constitué par la mosquée et ses entours.Distinctement de l'espace domestique, les activités de nettoyage y sont principalement à la charge d'enfants, defemmes ménopausées voire parfois du muezzin; indice qu'ences lieux, dont sont exclues les femmes jeunes, l'hygiène est
48 Les maladies de passage
avant tout affaire de purification. Le fidèle y fait ses ablutions et la saleté est repoussée, afin de ne pas « gâter» l'eaulustrale (nogo bè seZiji tiyèn, lit.la saleté gâte l'eau des ablutions).
Plus prosaïquement, la concession (du), bien qu'apparemment homogène dans son enceinte de banco, contientaussi divers espaces. La maison (so), la véranda (gwakoroZa),la cuisine (gwa), le puit (koZon), l'endroit où laver la vaisselle(minanko yoro) ou pour piler le mil (nyosusu yoro), les toilettes (nyègèn), et le dépotoirl6 (nyama bOn yoro), constituentdes aires l ? où se déroulent des activités spécifiques, diversement réparties selon les sexes et les âges.
Certains de ces lieux, comme la véranda destinée àl'accueil des hôtes, sont fréquemment balayés. La cuisineaussi est objet de préoccupation, puisque son état témoignedes qualités de la femme et de la propreté de la nourriturequ'elle y prépare. D'autres lieux sont intermédiaires entre laconcession et l'extérieur, et entre deux types d'activités ou depréoccupations. Il en est ainsi du dépotoir où défèquent lespetits enfants, et où l'on jette des déchets pour les utiliserplus tard comme engrais; cette chaîne opératoire expliquantpourquoi, en milieu rural, ce qui est considéré comme étantune nuisance du point de vue de la propreté (saniya, jèZenya)- et l'odeur nauséabonde (kasa goman) est souvent objet deplainte - est tolérée pour son futur usage agricole l8.
Certains de ces petits territoires sont à usage commun.D'autres, comme les chambres, sont privatifs selon les âgeset les sexes. Enfin des lieux, comme les douchières l9, occupent une place spécifique et sont l'objet de bien des suspicions. Leurs murs ont en effet, pour fonction de ménager la
-------- ---------
16 Nous n'avons pas retrouvé en ces lieux les" rites des ordures» signaléspar G. Dieterlen (1951,201)
17 Cf. Poloni (1990)
18 Le même terme nàgà est utilisé pour désigner à la fois les ordures etl'engrais.
19 En langue bambara, deux termes désignent ces lieux. Le premier nyègèn signifie aussi urine. L'autre sutura ou satura provient du termearabe satara qui SIgnifie dissimuler, voiler. Ces changements lexicauxne peuvent être plus explicites d'un changement de rapport au corps etde normes de conduite.
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 49
pudeur et de la honte de leurs utilisateurs, certes parce queles corps s'y dévoilent. Mais cette discrétion s'impose aussiparce que se laver n'est pas uniquement affaire de nettoyage.
Les façons de se laver sont, en effet, spécifiques auxâges, aux sexes et aux états du corps. Au premier âge, on ditsouvent que la toilette du nouveau-né engage son destin ultérieur: mal faite, le corps de l'enfant risquerait de dégager toutesa vie une mauvaise odeur (a bè kasa lase a ma). C'est pourcela qu'une femme propre et « pure » de tout rapport sexuel estchoisie pour laver le nourrisson. Mais cette vigilance n'est pasque symbolique. De manière pragmatique, on sait aussi quedes maladies du nouveau-né peuvent être liées au fait que lamère n'observe pas certaines pratiques de soin comme laverl'enfant à l'abri du vent, ne pas bien pratiquer certains massages, ou mal utiliser diverses décoctions vivifiantes.
Plus tard, en fonction de l'apparition des caractèressexuels et de l'acquisition d'une certaine autonomie, lesenfants, garçons et filles, se lavent seuls, tout d'abord dansla cour, au vu de tous, puis à l'intérieur des douchières. Dèslors, le lavage du corps distinguera entre les genres et entreles domaines souvent mêlés de l'hygiène et des conduitesreligieuses et protectrices. Mais ici encore, décrivons pourtenter de comprendre.
Au plus ordinaire, le verbe « se laver» (ka ko), s'utilisetant pour désigner une simple conduite d'hygiène que pourindiquer l'usage de « médicaments de protection » (fura) :outre se nettoyer, il s'agit aussi de protéger son corps. C'estpourquoi, si l'homme peut se doucher à tout moment (cè waatibèè la) - même si l'on dit que se laver à certaines heures20
comme au crépuscule ou la nuit et pire encore en son mitan,diminue la chance (a bè garijègè siri) -, il ne doit cependantpas toujours se laver avec du savon, puisque cela diminue la« force de ses divers « médicaments» de force et/ou de protection» (a bè i farila fura lakari) : « Le savon anéantit l'effet desmédicaments» (safune bè fura fanga ban).
20 On dit aussi que la toilette qui oblige à dévoiler le corps, le laisse ainsi" ouvert ", nudité offerte à l'action des génies particulièrement actifs aucrépuscule et la nuit.
50 Les maladies de passage
Mais, au dire de tous, l'hygiène c'est surtout « l'affairedes femmes» (saniya ye musa ta ye), dont la toilette est ditecomplexe (musa saniya ka gèlèn ou ka misèn), tout d'abordpour des raisons anatomiques, le corps de la femme offrantun sexe, comme un lieu caché (yàrà dagalèn) , mais aussi depotelés replis comme les fesses et les aisselles. De plus, etmême surtout, les toilettes des femmes se caractérisent parle souci accordé au corps et à ses états physiologiques :règles, grossesse, suite de couches, trois moments particuliers liant une certaine conception de la souillure du corpsféminin21 , à la fréquence et aux modalités du lavage.
Un premier moment correspond à la période desrègles22 où les femmes doivent se laver précautionneusement(laada waati saniya ka misènJ, afin d'éviter que l'odeur netrahisse leur état.
Durant cette période, même la nuit tu te laves, parceque le sang qui sort est sale et sent mauvais. C'est l'écoulement de sang qui nous amène à nous laver plusieursfois (basi min bè ta ka bà, lit. le sang qui n'arrête pas desortir), si tu n'observe pas l'hygiène, tu vas sentir, et levagin et la cuisse pourront être irrités.
Une deuxième période correspond à la grossesse, ou lecorps de la femme enceinte est supposé être « sale» (musafarila nàgà ka ca) et « chaud ", à cause de la présence del'enfant à naître dans le ventre. De ce fait « la femme enceintedoit faire mousser le savon et ne pas se contenter de se verserde l'eau sur le corps ». Il en est de même pour la femme quivient d'accoucher, qui doit aussi se laver précautionneusement afin de faire partir l'odeur. Enfin une troisième période
21 Cette nuance a été signalée par Monteil (924) : " Rien de très précisn'est dit sur ce qui précède et détermine la venue en ce monde. Il y a làun secret qui ne laisse pas le Bambara indifférent: cela se voit à ce quela femme - par qui nous accédons à la vie - est tenue au moins poursuspecte, tant pas suite du flux menstruel, qui la rend impure, que parl'impénétrable travail qui s'accomplit en elle lorsqu'elle enfante. " (22)
22 Les menstrues entrent aussi dans la confection de " médicaments ".C'est ainsi que pour certains enfants nés vivants malgré un " placentamangé" (tonso nYlmlJ, un des remèdes consiste à laver chaque moisl'enfant avec l'eau de rinçage des serviettes hygiènique de sa mère (finikolon sanankoliJl J. Sur cette questIOn du linge, mais dans un contextefrançais, nous renvoyons à Corbin (991).
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 51
correspond à l'allaitement: « Une femme qui accouche a lesein qui contient beaucoup de lait qui dégage de l'odeur ... »
Disons le tout d'abord simplement, si le vêtement peutmasquer certains états et certaines négligences, l'odeur, toujours susceptible de repousser l'autre, de le dégoûter (degun),est ce que l'on ne peut dissimuler, elle trahit l'intimité etl'état du corps.
Mais si le plus prosaïque n'est pas absent de ces conceptions, il est néanmoins nécessaire, de prolonger ces quelquesobservations immédiates par d'autres remarques puisque loinde ne se rapporter qu'à des normes d'hygiène, ces rapports aucorps et à soi soulignent aussi l'imbrication de normes esthétiques avec celles des convenances sociales et religieuses.
Les unes proviennent de conceptions locales où lesmenstrues sont considérées comme du sang « pourri" (nàgàcèlèn) composé par les résidus de sécrétions vaginales et desperme provenant des rapports sexuels entretenus pendantl'ensemble du cycle et n'ayant pas conduit à une grossesse.Sorte de liquide d'une non-naissance, ce sang est qualifié dedangereux, tant parce que mélangé à de la nourriture il estsupposé pouvoir causer la mort, que parce qu'il peut être utilisé comme un charme contre la femme qui n'aurait pas su ledissimuler23.
Ces conceptions se conjuguent à d'autres, provenantnotamment de l'Islam, tel, tout au moins, qu'il est comprisdans les villages24. C'est en effet, tout un « savoir vivre ,,25 quiest transmis, certes par les prêches des imams locaux, mais
23 Les femmes cachent les chiffons qu'elles utilisent durant cette périodeou les brûlent, afin qu'on ne puisse pas faire de « travail" (baara) dessus. Ces pratiques font partie « des secrets des femmes, plus grands queceux des hommes" (0 gundo ka bàn ka tèmè cè kan).
24 Autant qu'à des croyances autochtones, la référence la plus constanteest celle des normes de l'Islam présent en cette région depuis plusieurssiècles. Comme le soulignait Monteil (1980) :« il n'est pas facile de démêler ce qui, en Afrique, a précédé l'Islam, et ce que celui-ci a apporté : lesubstrat et l'emprunt ".
25 Cf. sur ce point les remarques de Vigarello (1985) : « Encore faut-ilaUSSI bouleverser la hiérarchie des catégories de référence : ce ne sontpas les hygiènistes, par exemple, qui dictent les critères de propreté auXVIIe siècle, mais les auteurs de livres de bienséance ; les praticiensdes mœurs et non les savants. "
52 Les maladies de passage
aussi par une importante littérature de colportage, oralementcommentée, ayant « pour fonction même de s'annuler commediscours et de produire, à l'état pratique, les conduites et comportements tenus comme légitimes par les normes sociales oureligieuse» (Chartier 1987). Prenons quelques exemples, dece syncrétisme en acte, où se mêlent inséparablement ce quiressortit à des soins corporels, et ce qui revient à des pratiques de purification (janabo ka, lit. l'impureté laver)requises avant les prières et lors des soins mortuaires notamment, mais aussi en diverses circonstances plus banales.
Au quotidien, cette liaison peut être observée dansquelques modestes et discrets habitus. Ainsi, puisque êtresale correspond aussi à un certain état de souillure, il est préférable d'entrer dans la douche du pied gauche (sen dangalen,lit. pied maudit)26, dont on sortira par contre du pied droit« .Mais, outre ces habitudes, dévoilant de vagues connotationsmorales d'actes hygiéniques, il s'agit aussi, dans d'autres circonstances, de préceptes plus rigoureux, s'appuyant notamment sur l'interprétation de certaines sourates du Coran27, etprescrivant des conduites diverses selon les sexes.
Globalement quelques situations sont considéréescomme impures, et nécessitent de ce fait de se purifier. Ellessont ainsi soulignées dans quelques textes (Samb 1992 ;Abdelmajid 1994 ; Abderrahman non daté), propos reprislors des prêches du vendredi, commentés après traduction, etconstituant ainsi une sorte de rumeur d'autant plus prégnante que diffuse.
Les causes qui entraînent l'obligation du lavage et lesactes qui sont interdits au fidèle en état de souillure majeure(janabaJ :
• par la sortie du sperme avec jouissance, soit en étatde veille, soit pendant le sommeil, qu'il s'agisse de l'hommeou de la femme ...
26 A l'inverse, on entre dans la maison du pied droit (sen barkaman,lit.pied "béni »). Dans un autre contexte, voir aussi Vincent (1978)
27 L'essai de traduction de la Sourate II (222), par Berque (1990) est :" ilst'interrogent sur les menstrues. Dis : "C'est une affection". Isolez lesfemmes en cours de menstruation. N'approchez d'elles qu'une fOlS purifiées ».
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 53
• après la cessation de l'écoulement du sang des menstrues, c'est-à-dire aussitôt après l'écoulement du liquideblanchâtre dont l'apparition marque la fin des menstrues;
• si l'écoulement sanguin persiste, la femme attendraquinze jours, après quoi, elle considérera qu'elle est atteintede perte et procèdera à la purification par lavage. Elle pourra alors prier, jeûner et avoir des relations sexuelles avec sonmari ;
• après la cessation de l'écoulement des lochies, c'est àdire dès la cessation de l'écoulement du sang de l'accouchement ... (Abdelmajid, ibid.).
Certes, ces textes « prescrivent un devoir être, dont onne sait jamais dans quelle mesure il est accepté, obéi, intériorisé par les hommes» (Furet 1982). Ils constituent néanmoins une des normes de conduite les plus prégnantes en cemilieu, et sans aucun doute l'une des composantes majeuresde l'outillage mental des populations malinkées pour penserle sale, l'impur et les risques liés à ces qualités.
Mais puisqu'il faut bien se « laver/purifier» quelquepart, les représentations avec le plus concret se conjoignentpour délimiter un espace particulier de risques, les toilettes,qui pour être des lieux du quotidien le plus banal, n'en correspondent pas moins à une configuration spécifique.
En effet, dans des villages où nul n'est pratiquementjamais seul, cet endroit est l'un des rares où l'on puisse, entoute intimité, se préoccuper des maladies ou des états, quel'on cache (dàgàli banaw). Ce lieu conjugue ainsi la discrétion des actes qui s'y déroulent avec la succession des utilisateurs. Comment dès lors ne pas le considérer comme comportant des risques28 ? En témoigne fort banalement, le faitque, outre pour des raisons de confort, on y conserve sessandales afin de se protéger d'éventuelles « traces» laisséespar les autres ; et cela d'autant plus que l'intérieur de ladouchière étant souvent humide, il ne peut, et n'est de fait,
28 Les mêmes dispositifs produisant souvent les mêmes contenus discursifs, de semblables conceptions sont courantes en France, où si l'on nouspermet cette expression, les cuvettes des toilettes ont souvent « bon dos»pour expliquer comment furent attrapées certaines pathologies ...
54 Les maladies de passage
que très rarement balayé. Alors, fort logiquement,puisqu'elles sont maladies de la honte et de la dissimulation, la transmission des pathologies sexuelles y est particulièrement incriminée: « Si une femme urine à l'endroitoù une malade à elle même uriné, elle peut attraper damajalan qui se manifeste par une brûlure à l'intérieur duvagin » •••
La conjugaison de ces trois traits - prégnance du corpset d'interprétations religieuses de sa physiologie, dissimulation des personnes, succession des utilisateurs - expliqueque les « douchières » soient considérées comme l'un desprincipaux lieux de risque ressenti.
La transmission et les préventions biomédicales
Si les normes de conduites païennes et musulmaness'interpénètrent au sein d'une sorte de syncrétisme des pratiques d'hygiène corporelle, les rapports entre les conceptionslocales et médicales de la prévention se présentent plutôtsous la forme d'une juxtaposition.
Globalement, en effet, la relation entre ces deux paradigmes préventifs de la maladie peut être qualifiée commeune « articulation par défaut ».
Tout d'abord, ainsi que nous le soulignions précédemment, tout échec du traitement médical peut être interprétécomme la marque d'une différence de nature, ou la preuved'une extériorité de la maladie « africaine » par rapport auxpouvoirs et aux savoirs médicaux.
De plus, concernant plus spécifiquement des actionspréventives, même si globalement, depuis que sont entreprises les campagnes de masse29 , on s'accorde à reconnaîtrel'efficacité des vaccinations, cela ne dément aucunement lareconnaissance d'un pouvoir des traitements locaux.
29 Il est important de remarquer que cette démonstration de l'efficacitépar le nombre, n'est que récente. En effet, auparavant, l'inscriptionpour les vaccinations était utilisée pour recenser la population pour lepaiement d'impôts per capita ; ce qui bien évidemment entraînait denombreuses dissimulations d'enfants.
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 55
Simplement, « les médicaments africains (farafin furaw)réussissent pour certains, alors que la vaccination agit pourtous ... ". La vaccination arrête la maladie d'un seul coup (kakun dan 0 yàrànin kèlèn), alors que les produits locaux ladiminuent (a bè dàgàmanin kun da).
Enfin, d'un point de vue profane, l'immunisations'applique bien évidemment à des pathologies ressenties. Dece fait, si l'éviction de la rougeole est visible il n'en est pas demême pour des maladies plus « discrètes" comme la rubéole,ou lorsqu'une affection comme la poliomyélite peut pourquelques uns, être confondue avec des affections iatrogènesprovenant d'injections lésant le nerf sciatique.
Une forte adhésion à l'acte vaccinal ne pourrait êtrefondée que sur une réelle compréhension de ce mode de prévention, Mais les personnels de santé sont bien peu pédagogues, et les populations, dans bien des cas, ignorent si ellessont, ou non, vaccinées. Bien souvent, elles confondent aussiune simple injection avec une immunisation. Enfin, fréquemment, la diversité des « messages de préventions" entraînede multiples confusions, comme, par exemple, lorsque desfemmes enceintes, à qui l'on a confusément expliqué l'importance de la prise préventive de chloroquine pour éviter unaccès palustre, pensent être vaccinées contre ce même paludisme lorsqu'elles viennent au dispensaire déclarer leurgrossesse.
En résumé, dans bien des cas, ces techniques préventives, pourtant souhaitées par les populations, restent incomprises parce que non expliquées, Et si, les collectivités, strictosensu, « s'y prêtent » volontiers, c'est à la fois sans pouvoirinfluer sur une mise en œuvre qui dépend avant tout del'efficacité des équipes sanitaires, et selon un gradient deconviction qui varie selon la perception visible des effetsobtenus.
Des conduites locales aux programmes sanitaires
A l'issue de cette présentation il est possible de préciser quelques caractéristiques de l'ensemble notionnel de latransmission et de la contagion.
56 Les maladies de passage
Il est tout d'abord vaste et ses contours sontincertains3o. En effet, de multiples expressions et pratiqueslaissent envisager une certaine continuité entre diversdomaines de la vie sociale offrant ainsi aux acteurs la possibilité d'ouvrir plus ou moins le domaine des interprétationscausales selon ce qu'imposent les circonstances.
Ensuite, il existe un constant décrochage entre la prolixité des discours concernant les divers risques et lesconduites. Ce champ sémantique ne peut donc aucunement seprésenter comme une sorte de matrice cognitive directementexplicative des conduites des acteurs. Il n'y a pas de correspondance univoque entre les représentations et les comportements, ceux-ci s'expliquant, au contraire, par une sorte de discrète et constante négociation entre la prégnance de certainstermes orientant la réflexion, les connotations des lieux lesplus usuels, et les aléas des rencontres avec des personnes destatuts divers, des circonstances, et des variations etc. Bref, cedomaine n'est pas paradigmatique, mais connectif; pas hiérarchique, mais vicinal. Et c'est ainsi, par exemple, que s'il estpossible de mettre à part une vieille personne tuberculeusepour des raisons de prévention, la prudence implique cependant de ne pas risquer sa violence, et donc de ne pas trop marquer de précautions à son encontre. De ce fait, les conduites deprévention ne sont pas des constantes mais de simples variations correspondant à des adaptations et négociations entreplusieurs types de contraintes, et entre plusieurs formes devoisinages territoriaux. Ce qui varie, ce ne sont pas les conceptions, mais leur distribution dans un ensemble de contextes.
Il y a pas de coïncidence entre les définitions populaires etmédicales, tout au moins pour une partie des pratiques.Premièrement parce que le domaine populaire est plus constituépar de multiples conceptions des processus de contamination, detransmission que véritablement par une notion précise de conta-
30 Soulignons sur ce point que cette extension du champ sémantique de lanotion de transmIssion impose au chercheur une grande vigilance méthodologique. En e/Tet, pour ne prendre qu'un seul exemple, il seraIt aISé detirer du fait que lors d'un décès on ne raccompagne pas celui qui est venuprésenter ses condoléances de peur d'attacher ainsi la mort à ses pas,l'argument que la mort est transmissible, voire contagieuse ... En cedomaine, il importe de partir de la conscience qu'ont les locuteurs d'utiliser sous un signifiant semblable de mêmes ou de dissemblables signifiés.
Transmissions, prudences et préventions en pays mande 57
gion. Deuxièmement, parce que pour la santé publique - à supposer que cette préoccupation sanitaire soit un domaine homogène les programmes de prévention obéissent à une mise en œuvred'actions, dont les objectifs correspondent à des données statistiques, et la réalisation à une suite d'actions hiérarchisées etordonnées. C'est dire qu'elles correspondent à une stratégie, quisuppose une anticipation des risques, un contrôle des moyenspour les combattre, impliquant de ce fait une maîtrise tant deslieux que sur des personnes : une souveraineté. Par contre, lespréventions populaires se présentent avant tout comme desactions de sauvegarde qui se mettent en place au moment del'apparition de la maladie, plus que pour en anticiper le risque.Mais plus encore, ce domaine populaire est principalement constitué par un ensemble qui se présente sous la forme d'une gestionde problèmes résultant de séries ouvertes d'éléments difficilement maîtrisables : déplacements de vecteurs, de populationsdans des lieux inconnus et adverses, de la venue d'étranger,d'évènements qui se produisent. 11 s'agit donc d'une série ouverted'éléments suspectés auxquels il faut faire face au « coup par coup». Les prudences et préventions populaires, vont entraîner desconduites et aménager un milieu en fonction d'évènements possibles dans un cadre multivariable, et aléatoire. En résumé, auxstratégies sanitaires, correspondent les tactiques populaires.
Enfin, l'anticipation du risque correspond avant tout àun ensemble de prudences sociales liées principalement aurespect des diverses formes de la hiérarchie sociale, touteincartade pouvant entraîner la « réponse d'un autre ». Dansce contexte, la maladie et les prudences qui y sont liéesdébordent très largement du domaine de la santé tel qu'il estlimité par les sciences médicales, pour s'ouvrir à des procédures de pouvoir, qui maintiennent certaines relations.Maladies et prudences correspondent à une sorte de dispositif de sécurité, fonctionnant selon un couplage binaire, interdit/punition, dans lequel toute erreur entraîne un châtiment,ou plus précisément comme le signalait Zempléni (1985)31,
31 «Le diagnostic étiologique se présente comme une démarche judiciaireinversée : elle consiste à partir de la maladie-sanction pour identifierles conduites sociales prohibées ou indésirables - le "délit" - qui motIvent cette sanction au lieu de partir d'un délit établi pour déterminer lasanction appropriée qu'il appelle ".
58 Les maladies de passage
où rétroactivement, la maladie atteste qu'un manquement aété commis. La prévention et le risque ressentis sont liés auxdiverses figures de l'altérité: personnes, territoires, religions, voire les territoires des génies.
C'est dire qu'on ne peut comprendre les rapports entreces divers points de vue comme étant uniquement des affrontements entre des options vraies ou fausses. Même si le pragmatisme et les constatations empiriques permettent souventaux populations de trancher et de choisir, il s'agit aussi despositionnements réciproques de discours plus ou moins légitimés et variant historiquement. Reste à savoir si la technique modifiera les rapports sociaux en limitant le préventifau prédictif?
Bibliographie
Abdelmajid B. A.1994 La purificatwn, Casablanca, Dar Errachad el Haditha.
Abderrahman M. S.Non datéAk-Akhadri Fi Al-îadat, d'après le rite malikite, Beyrouth,
Ed. Mricaines.
Benoist J.1993 Anthropologie médicale en société créole, Paris, PUF.
Bernand C.1983 « Idées de contagion dans les représentations et les pra
tiques andines ", Bulletin d'ethnomédecine n° 20, Paris,SELAF-CNRS.
Berque J.1990 Le Coran, essai de traduction, Paris, Sindbad.
Chartier R.1987 Lectures et lecteurs dans la France d'Ancien Régime, Paris,
Seuil.
Corbin A.1991 Le grand siècle du linge, dans Le temps, le désir et l'hor
reur. Essais sur le X/Xe Siècle, Paris, Flammarion: 23-52.
Transmissions. prudences et préventions en pays mande
Dieterlen G.1951 Essai sur la religion bambara, Paris, PUF.
59
Dumestre G.1996 « De l'alimentation au Mali », Cahiers d'Etudes Africaines,
144, XXXVI - 4 : 689-702.
Febvre L.1992 (recueil de textes rédigés de 1892 à 1933), Combats pour
l'Histoire, Paris, Armand Colin.
Furet F.1982 « De l'histoire-récit à l'histoire-problème », dans L'Atelier
de l'histoire, Paris, Flammarion :73-90.
Monteil C.1924 Les Bambara du Ségou et du Kaarta, Paris, Larose.
Monteil V.1980 L'Islam noir. Une religion à la conquête de l'Afrique, Paris,
Ed. du Seuil.
Poloni A.1990 « Sociologie et Hygiène. Des pratiques de propreté dans
les secteurs périphèriques de Ouagadougou », dansSociétés, développement et santé, Fassin D. & Jaffré Y.(éds), Paris, Ellipses: 273-285.
SambA. M.1992 De la purification extérieure et intérieure dans l'Islam,
Dakar, Ed. Saint Paul.
Vigarello G.1985 Le propre et le sale. L'hygiène du corps depuis le Moyen
Age, Paris, Ed. du Seuil.
Vincent J-F.1978 « Main gauche, main de l'homme. Essai sur le symbolisme
de la gauche et de la droite chez les Mofu, Cameroun duNord ", dans Système de signes, textes réunis en hommageà Germaine Dieterlen, Paris, Hermann: 485-509.
Zempleni A.1985 « L'enfant Nit Ku Bon. Un tableau psychopathologique
60 Les maladies de passage
chez les Wolof et les Lebou du Sénégal ", Nouvelle Revued'Ethnopsychiatrie, n° 4: 9-41.
Zempleni A.1985 « La "maladie" et ses "causes" », L'ethnographie, Causes,
origines et agents de la maladie chez les peuples sans écriture, n° spécial 96-97, tome LXXXI, Paris, Sociétéd'Ethnographie :13-44.
Chapitre 2
Maladies héréditaires et maladiesdu contact en milieu hausa (Niger)
Aboubacar Souley
Lorsque des locuteurs de la langue hausa1 parlent dela notion de transmission de maladies d'une personne à uneautre, ils distinguent deux groupes de maladies : les maladies héréditaires et les maladies contractées en dehors ducercle familial. Il existe, par conséquent, deux mécanismesde transfert: la transmission par hérédité et la transmissionextérieure à la famille. Localement on parle donc, de ciwo nagado (maladie héréditaire) et de ciwo wanda aka dauka(maladie « que l'on prend ailleurs »). Nous allons décrire cesdeux catégories avant de tirer quelques conclusions2•
La transmission par héritage
Héritage se dit gado en hausa. « J'ai hérité de tellemaladie» (na gadi ciwo kaza), signifie que cette affection m'a
1 La langue hausa totalise près de 55 % de locuteurs natifs au Niger (données du recensement général de la population de 1988). Les populations« hausaphones » habitent, principalement le centre et l'Est du Niger.
2 Les données de cet article sont issus d'entretiens réalisés en 1995 et 1996dans les cantons de Bouza, Mayayi et Shadakori et d'une enquête menéeen 1997 à Niamey (dans les quartiers Talladjé, Dar-es-salam, FulanKwara et Boukoki) et à Balleyara. L'ensemble couvre les régions deMaradi et Tahoua ainsi que le nord-est de la région de Tillabéry. Toutesles personnes interrogées sont des locuteurs natifs de la langue hausa.
62 Les maladies de passage
été transmise par l'un de mes parents biologiques (père oumère) ou par tout autre ascendant (oncles, tantes, grandparents). La maladie est alors qualifiée de ciwon gado, oumaladie héritée. On suppose, par exemple, qu'un enfant peut« hériter» d'une maladie, non seulement de son propre père,mais également de son grand-père maternel ou de sa tantepaternelle. Autrement dit, selon cette conception, le rôle dugéniteur, au sens biologique strict, n'est pas déterminant.L'héritage peut être reçu sans médiateur corporel direct.
En fait, cette représentation de la transmission de lamaladie est construite sur le même modèle que celui quiconcerne la transmission des traits physiques ou de caractère d'un individu. Ainsi, une jeune fille peut bénéficier de lamême beauté que sa mère (cawo kamar uwarta) et tenir sestendances psychologiques de la sœur cadette de son père.Ainsi, on dit volontiers: bakin jini kamar kaunar uban, quisignifie « être asocial comme la sœur cadette de son père ».
On dira, de même, d'un enfant qu'il a le caractère (hali) deson oncle paternel alors qu'il ressemble physiquement aupère de sa mère ... Cette notion de caractère (hali) désigne unensemble d'attitudes communes: mêmes réactions, même airmodeste ou hautain ou bien encore une même tendance à lacharité ... Quant aux traits physiques, ils comprennent nonseulement des ressemblances corporelles (yeux, visages,mains, etc.), mais aussi une éventuelle similarité des postures (allure, démarche, etc.).
Dans le domaine pathologique, l'exemple de maladiehéritée le plus fréquemment cité est la « lèpre» (kuturta ouzahin jiki3 ). Le long témoignage qui suit résume l'opiniongénérale, mais témoigne aussi de la complexité d'une conception populaire cumulant des notions de transmission et d'activation. Mais avant de poursuivre écoutons donc ce propos.
La lèpre peut être héritée. Par exemple moi, si je suisune fille de lépreux, je peux ne pas avoir cette maladietoute ma vie. Imaginez un peu qu'un de mes enfants déve-
3 Zahin jikz s'entend le plus souvent près des frontières entre le Nigeriaet le Niger. Il convient de distinguer cette expression du terme zahz,entité nosologlque populaire proche du weyno songhay-zarma, dugamma dogon ou encore du sumaya bambara (cf. Jaffré et OlIvier deSardan : 1999).
Maladies héréditaires et maladies du contact en milieu hausa 63
loppe la maladie! Les gens s'en étonneront: «tiens, un tel,on a vu son père et sa mère, ils n'ont jamais eu la lèpre;comment se fait-il que lui soit lépreux? » Et bien, c'est quedès le départ, il y avait la lèpre dans la famille. Parailleurs, toute personne qui mange le mil (tout humain)est un porteur de la lèpre. En effet, la lèpre est mélangéeaux jiyaji (ligaments, muscles) pour concevoir (kerawa)une personne. Si on ne la mélange pas aux jiyaji, il estimpossible de concevoir (kira, fabrication) une personne.La lèpre apparaît, se manifeste quand elle veut trahir unepersonne. Voilà ce qui se passe: quand une femme ne voitplus ses règles, tu sais qu'elle est enceinte. Il y a deshommes têtus qui ne laissent leur femme tranquille qu'aubout de sept mois de grossesse. Alors, si le maniyi (sperme) touche le fœtus et le lave, c'est ce contact qui amène lalèpre. Pour celui que Dieu ne veut pas trahir, la lèpre nese manifestera pas. Par contre, si Dieu veut le trahir, surson corps apparaissent de petites tâches, ou bien la lèpresort sur les doigts et les arrache, ou bien encore sur levisage ou au dos. Mais, dans tous les cas, toute personneest un lépreux potentiel, tout mangeur de mil est unlépreux. Si tu vas dans les champs maintenant, tu peuxvoir des pieds de mil lépreux. Donc tout mangeur de milest un lépreux. Mais si elle ne veut pas trahir une personne, elle ne se manifestera pas. La lèpre qui est héritée dupère (ta walki, lit. celle de la culotte) est difficile à soigner.Celle qui est héritée de la mère (ta nana, lit. celle du sein)est plus facile à guérir. Le maniyi du père se couche(s'intègre) dans les jiyaji, le maniyi de la mère se couchedans la chair (nama, lit. viande). C'est pourquoi la lèprequi est héritée du père est difficile à soigner car ce sont lesjiyaji qui sont atteints. (Z)
Ce récit souligne l'idée qu'un être humain peut être, parconstitution, porteur de la maladie: la lèpre est conçue commeune sorte d'affaire de famille, une maladie héréditaire (gada).Cependant, la manifestation de la maladie, son extériorisation, provient du fait que Dieu veuille trahir un couple ayantmaintenu des rapports sexuels après sept mois de grossesse,autant dire et plus explicitement, ayant dérogé aux règlessociales. Dès lors que la maladie est potentiellement dans
64 Les maladies de passage
cette famille, et même si elle ne se manifeste pas chez le pèreou la mère, elle peut éventuellement se révéler chez l'un deleurs enfants ou leurs petits-enfants. Elle est dans l'histoire decette famille, et est susceptible de s'y inscrire différemmentselon qu'elle est transmise par le père ou la mère. Dans le premier cas, elle sera difficile, voire impossible à traiter car elleest mélangée aux jiyoji (ligaments et muscles). Par contre,héritée en ligne maternelle, étant donné que ses germes setrouvent dans la chair, il y aura un espoir pour la guérir.
Ciwon kashi (on dit aussi sanyin kashi, fraîcheur desos, ou tamnan kashi, action de broyer des os), autant desymptômes évoquant médicalement la drépanocytose, est unautre exemple d'une maladie héréditaire. Elle est caractérisée comme une affection chronique, douloureusement ressentie dans les os (kashi) et présentant de nombreux épisodesaigus surtout à un âge avancé4.
C'est héréditaire, ça se transmet aux descendants. Sice n'est pas soigné, que tu sois un homme ou une femme,tu peux prendre ce mal. Niché quelque part dans l'organisme, il se lève (tashi) et il affecte (gamewa) tout lecorps, dès qu'il fait froid. Quelques instants après, il seregroupe {dunkulewa} à nouveau et se niche quelque partdans le corps (Zainabu, op. cit.).
Moi j'ai hérité ça de ma mère. Tous mes frères et sœurs,sauf un, ont fait ça. Mais ça se calme, ce n'est pas définitivement guérissable, ça vient de temps en temps. (S)
D'autres maladies héréditaires ont été évoquées.Citons simplement: mageduwa (sorte de démangeaison quifait tomber les ongles), ciwon haure (maladie de la dent),huka (sorte de crise d'asthme), kaikai (maladie du lait quiaffecte le nourrisson), ou encore gira qui désigne souvent letrachome. Il serait fastidieux d'évoquer précisément tous cesexemples, mais on peut par contre, en souligner des caractéristiques communes:
- Premièrement, la transmission par héritage (gado)implique l'idée d'une succession consanguine ou utérine. Elle
4 Il y a sans doute bien des cas de confusion entre la drépanocytose etcertains rhumatismes ...
Maladies héréditaires et maladies du contact en milieu hausa 65
n'est cependant pas nécessairement, « biologiquement directe ».
Elle peut provenir d'un ancêtre lointain ou de tout ascendantqu'il soit de la lignée paternelle ou de la lignée maternelle.C'est un héritage au sens où il s'agit d'un trait virtuel considéré comme une propriété ou une caractéristique d'unefamille donnée.
- Deuxièmement, lorsque la maladie est dite directement héritée du père, on suppose qu'elle a été transmise parle sang de ce dernier. Le sang du père participe à la fécondation et conséquemment à la conception de l'enfant par lebiais des rapports sexuels. Quant à l'héritage par la mère, ilse fait à travers l'allaitement. La mère transmet un traitidentitaire à son enfant par son sein. Même si on parle demaniyi de la femme, on ne conçoit pas qu'elle transmette unepropriété à l'enfant du fait des relations sexuelles.
- Enfin, troisièmement, la transmission par héritage netouche pas obligatoirement tous les membres de la famille.Certains développent les mêmes maladies que leurs ascendants, d'autres sont, par contre, insensibles à ce type d'héritage. De même qu'on conçoit que des enfants de même pèreet de même mère n'aient pas tous des caractères identiquesou ne se ressemblent pas, de même on conçoit parfaitementune discrimination dans la transmission d'une maladie héréditaire.
La transmission hors de la famille
On dira « une maladie qu'on prend» (ciwo wanda akadauka) pour évoquer ce second ensemble. Nous utilisonsl'adjectif « prenable» pour désigner cette catégorie. Il noussemble qu'il rend bien compte du sens du mot hausa, dauka,duquel dérive le verbe daukawa (prendre, saisir, attraper).« Prenable ", contrairement au précédent domaine des« pathologies d'héritage ", signifie donc que la maladie n'estpas une propriété ou une caractéristique de la famille. Onpeut certes attraper une maladie de ce type par un ascendant, mais cette affection ne sera cependant pas qualifiéed'héréditaire puisqu'elle ne fait pas partie des « affaires"(kaya) de la famille. Pour le dire plus précisément, il n'y a
66 Les maladies de passage
pas transmission d'héritage, mais acquisition d'une propriétéexterne qui existe dans la nature ou la société.
Cette catégorie regroupe, donc, des maladies acquisesde deux manières: le contact physique direct et la transmission indirecte par des « vecteurs ».
La transmission par contact physique direct
Elle concerne des circonstances où les corps - ou desparties des corps de divers partenaires - se touchent. Quatrecas de figure sont répertoriés: les contacts cutanés, les maladies sexuellement transmissibles, l'allaitement et la vieintra-utérine.
A l'évidence, le premier rapport entre deux individusest in utero. Diverses maladies sont supposées provenir decette période. Il en est ainsi des maladies nommées shawaraet sanyin kashi ou sanyin mara (sanyi du ventre) transmisespendant la grossesse, de la mère au fœtus, lorsque celle-cisouffre de ces maladies. On dit alors que l'enfant est né avec.
Les symptômes de shawara sont divers, mais le plusfréquemment, shawara, rawaya ou ja masasara Oit. fièvrerouge) désignent des « jaunisses ». Cette maladie est généralement liée à deux autres: zahi et sanyi. Shawara fait toujours intervenir le sang. On dit : « qu'elle travaille avec lesang» (da jini shika aiki,J. C'est une maladie qui « diminuele sang» et qui, selon nos interlocuteurs, ne doit absolumentpas être traitée dans des centres de santé modernes, car onsuppose qu'en cas d'injection, on meurt inévitablement.
Lorsqu'on fait référence à une maladie, sanyi, - fraisou froid en français -, recouvre deux entités distinctes. Toutd'abord, et c'est ce qui nous intéresse ici, sanyi peut désignerune maladie qui aurait son centre de gravité dans le basventre. Elle se manifesterait par des douleurs articulaires.On parle alors de sanyin raba (sanyi de la rosée), ou sanyinkasa (sanyi des os, au singulier : kashi), ou sanyin kunkuru(sanyi du bassin) ou encore sanyin lokaci (sanyi du temps).Ensuite, il y aurait aussi un ensemble de maladies sexuellesCciwon mata, maladie de femme) regroupées sous la dénomination de sanyi (cf. infra).
Maladies héréditaires et maladies du contact en milieu hausa 67
Un second type de contact concerne ceux de la mère etdu bébé, lors de l'allaitement. Par exemple, une femme qui ale kaikai5 (lit. démangeaison), interprétée comme étant unemaladie « héréditaire" qui se trouve notamment dans sonsein, risque, par son lait, de transmettre à son bébé diversesmaladies. La femme allaitant ne ressent pas sa propre maladie et n'est donc pas « coupable ". Cependant son lait est susceptible de provoquer diverses maladies chez l'enfant. Noussommes donc en présence d'un type particulier de transmission de maladie puisque les affections transmises ne sont pasforcément développées par la mère; et qu'ensuite, ce n'estpas la maladie du lait qui se transmet au bébé, mais ce liquide en est le « vecteur ".
En clair, le lait d'une mère peut être infecté par deuxtypes de maladie nommée kaikaï : le farin kaikai (kaïkaiblanc) et le kaikai na dawaki (kaikai des chevaux). Cependantce passage de la maladie de la mère à l'enfant est complexe.En effet, si le bébé de cette mère tète le sein, il n'attrapera nile kaïkai blanc ni le kaikai des chevaux. Par contre, si le laitde la mère est atteint du kaïkaï blanc et contient les germes decertaines maladies telles que tamowa, sanyi et samiya, cesmaladies seront transmises au bébé. Si le lait de la mère estatteint du kaikai des chevaux, le bébé mourra immédiatementaprès avoir avalé ses premières gouttes de lait. C'est pour cetteraison qu'il existe des « tests ,,6 permettant de vérifier si unenouvelle accouchée est porteuse de ce risque. Lorsque cetteinvestigation préventive s'avère positive, le plus fréquemment,on administre une décoction à la femme, et on proscrit le seinau nouveau-né durant 3 à 4 jours.
Pour en revenir aux maladies transmises du fait dukaikai blanc, soulignons que tamowa, plus qu'une maladie,évoque chez les personnes enquêtées des troubles de crois-
5 Kaikai peut désigner aussi une maladie de peau.
6 On a relevé deux procédés. L'un consiste à recueillir quelques gouttesdu lait de la femme dans un bol ; on introduit ensuite des insectes(casu) dans le lait. Si les insectes s'en délectent et restent vivants, c'estle signe que la femme n'est pas atteinte de kaikai ; si par contre lesinsectes meurent, on décrète que le lait est mauvais. L'autre test consisteà verser le lait recueilli dans un bol sur une lame de couteau chauffé aurouge. Si le lait colle à la lame, il est infecté de kaikai. Sinon, il n'y apas d'inquiétude.
68 Les maladies de passage
sance chez l'enfant de 0 à 3 ans. On parle de tamukewa(rétrécissement), karewa (dissolution), jayewa (retrait), shanyewa (assèchement), bushewa (dessèchement), etc. Danscette optique, l'entité nosologique populaire tamowa apparaît, non comme une maladie spécifique, mais plutôt commeune notion reflétant un ensemble de signes visibles sur lecorps, dont les plus manifestes sont l'amaigrissement et uninterminable état maladif. En somme, comme le dit un guérisseur, dès lors qu'on n'arrive pas à soigner définitivementune maladie - quelle qu'elle soit - qui « bloque» la croissanced'un enfant, et le maintient presque constamment malade fiévreux, impassible, pâle, mélancolique, etc. -, on parle detamowa ...
Tamowa est une maladie de l'enfant; il demeure dansun état indéfinissable. C'est cela le statut de tamowa(Abdoulkadri, barbier circonciseur à Bouza).
Quant à samiya, c'est une maladie de peau dont lesprincipales victimes sont généralement les parturientes etleurs enfants. Elle se manifeste, chez le nouveau-né, par dela diarrhée (gudun dawa), les vomissements (ammai ouharassuwa) de la fièvre et un état d'amaigrissementconstant.
Les maladies sexuellement transmissibles sont, quantà elles, englobées dans la catégorie des ciwon mata (les maladies de femmes) ou sanyi (le froid). Le terme sanyi est le pluscouramment utilisé. Populairement, on considère que ce sontles hommes, réputés insatiables et infidèles, ainsi que lesprostituées qui les propagent. Plusieurs termes et expressions, parfois lourds de connotations sociales, précisent lesdivers maux que regroupe cette vaste entité: dan birni (lecitadin), tunjere, yankan gashi (coupure de poils), dan gari(l'autochtone), mawashi, duka-auki (accroupis-toi et prends).Ces dénominations sont plutôt familières.
Une classification, plus soutenue, voire savante, utilisedes distinctions chromatiques, et sépare les maladies sexuellement transmissibles en des formes rouges Uan sanyi),blanches ({arin sanyi) et noires (bakin sanyi).
La première forme de sanyi, la blanche, est bénigne,moins grave et moins douloureuse que les deux autres. Elle
Maladies héréditaires et maladies du contact en milieu hausa 69
se manifeste par l'écoulement d'un liquide blanchâtre (ou grisâtre) et visqueux qui salit tout vêtement.
Ce liquide s'écoule comme du lait, comme de labouillie, il s'écoule pareillement. (AB)
Par contre, le jan sanyi se manifeste par des urinesrougeâtres et on le suppose plus grave que tarin sanyi.Lorsque l'on est atteint par cette forme de la maladie, urinerdevient douloureux car c'est comme du sang qui « sort ", etcontrairement au liquide blanchâtre qui caractérisait le tarinsanyi, celui-ci ne s'écoule pas : «jan sanyi se durcit, on nepeut même pas uriner ", nous dit l'un de nos interlocuteurs.
Pour bakin sanyi, qui correspond à la troisième formede cette maladie, on ne parle plus d'écoulement car l'urètresemble « bouché ". Par conséquent, même si on l'appellebakin sanyi (le noir), il n y a pas d'urines noires parce que,tout simplement, il n'y a pas, ou presque pas, d'urine. Certes,on ressent l'envie mictionnelle de manière très pressante,mais l'acte d'uriner est encore plus douloureux parcequ'impossible.
Bakin sanyi fait une chose comme une graine de sorgho dans la gorge du sexe de la personne, il se durcit, si tuveux uriner tu te mettras à hurler. (Altiné Auta, op. cit.)
Les deux principaux exemples de maladies provenantde contacts cutanés7 sont kazuwa, une maladie de peau avecéruption de boutons et sécrétion de pus, et tarin sanyi, lamaladie sexuellement transmissible que nous venons dedécrire.
Kazuwa se manifeste par une abondante éruptioncutanée sur tout le corps:
Ce sont des boutons qui sortent partout sur le corpsavec des sécrétions liquides. (AM)
Ces boutons démangent tellement que le malade peutse servir d'une lame de couteau pour se gratter. Il est alorsfortement recommandé de ne pas s'approcher d'une personneatteinte, car le contact avec la moindre gouttelette de pus oudu sang est supposé contaminant.
7 Il faut bien noter qu'il s'agit de contact de peau à peau. Ce qui n'est pasla même chose que toucher un objet contaminé.
70 Les maladies de passage
Les mêmes craintes se retrouvent face à la maladienommée farin sanyi. En effet, si le principal mode de transmission est par voie sexuelle, le contact avec le liquide visqueux qui s'écoule du sexe de la personne malade entraîneautomatiquement la contamination.
La transmission indirecte
Le contact physique strict n'est pas toujours absolumentnécessaire pour la transmission d'une maladie. Elle peut eneffet, se faire aussi lorsque la personne atteinte et celle quirisque de l'être, partagent un espace commun. Si entretenirdes relations sexuelles avec une personne atteinte est unrisque de contamination, s'asseoir sur le siège sur lequel elles'est assise, manger avec elle dans le même plat, enjamber sesurines, porter le même habit, sont aussi des conduites quiexposent une personne non atteinte. Ce type de transmissionnécessite un vecteur. On peut en trouver de quatre sortes: larespiration, le regard, le toucher et l'enjambement.
Le premier vecteur de transmission indirecte est larespiration (sheda). C'est par elle que se transmet, parexemple, la toux (tari) et l'asthme (huka). Le malade a unsouffie saccadé, et son « cœur» semble « comprimé » commesi on l'avait « attaché » (kamar an darme zuciya,). La personne tousse fort et crache beaucoup, entraînant cette contamination par la respiration.
Si vous êtes dans un même lieu, alors vous respirez lemême air. C'est comme ça que tu as la maladie. Quand iltousse, tu respires ce qu'il expire. (D)
Se regarder dans les yeux (gama ido, lit. mélanger lesyeux), est un autre vecteur. Par simple croisement desregards, une personne atteinte d'une maladie oculaire (ciwonido) peut transmettre sa maladie à la personne qui la regarde (Jaffré, 1999). Il faut, pour cela, selon certains enquêtés,réunir diverses conditions. Les principales concernent lesrapports entre des personnes de sexes différents ou les relations de parenté, par exemple:
Si tu es le petit frère direct d'une femme, si une femmea ciwon ido, dès que vous mélangez (gamawa) les yeux, tu
Maladies héréditaires et maladies du contact en milieu hausa 71
prends cette maladie. Mais si c'est un homme, tu neprends pas la maladie. (NG)
Un troisième vecteur est le fait de toucher un objetappartenant à la personne atteinte d'une maladie. II en estainsi des maladies sexuellement transmissibles qui peuventêtre, comme nous l'avons précédemment évoqué, contractéespar voie sexuelle, mais aussi par le biais d'un habit partagéavec le malade, un siège sur lequel il s'est assis ou encore pardes urines enjambées. Les maladies de peaux participent dumême principe, et notamment celles qui se manifestent pardes éruptions avec sécrétion de pus (kuraje) et des démangeaisons. La maladie précédemment évoquée, kazuwa, peutaussi correspondre à une telle origine.
Une maladie oculaire appartient aussi à ce groupe demaladies transmises par vecteur. C'est gira (lit. sourci1), quicommence par une sensation de présence d'un corps étrangerdans l'œil. Cette sensation est très désagréable et conduit lemalade à se frotter inlassablement les yeux.
Quand ça a commencé, moi je sentais comme la présence de sable dans mon œil. Je suis allée voir ceux quiregardent les yeux. Quand ils m'ont examinée, ils ont dit quec'est gira. (Z)
Apparaissent ensuite des signes interprétés commemarquant une aggravation : le larmoiement (hawaye) et lesdémangeaisons (kaikai). Alors, l'œil atteint commence à serefermer (ruhewa). Le malade a un sommeil difficile et auréveil son œil est entouré d'une substance blanchâtre etquelque peu collante (komzo). Face à cette maladie, les préceptes populaires sont constants et précis. Pour éviter d'êtrecontaminé, il ne faut partager ni la même bouilloire servantpour les ablutions que la personne atteinte ni la mêmepoudre noire dont se servent les femmes et les jeunes fillespour se maquiller (kolli).
Le dernier vecteur de transmission est « l'enjambement » (ketara). En effet, dans les conceptions locales les pluscommunes, on considère qu'enjamber un espace, toujourspotentiellement marqué par les traces d'un autre, comportecomme risque de se voir transmettre une maladie. Ainsi enest-il du fait d'enjamber les urines d'une personne atteinte
72 Les maladies de passage
d'un sanyi, ou, autre exemple, d'enjamber le lieu où un épileptique vient de faire sa crise. Dans ces deux cas, on risqued'attraper respectivement, un sanyi (le blanc, le rouge ou lenoir) ou borin jaki (lit. transe de l'âne) qui désigne la criseépileptique de type grand mal.
On admet généralement que cette maladie est causéepar un mauvais génie nommé lalan aljani ou lalan iska.Lorsque ce génie, symbolisé par un buffie (san daji), vient àeffieurer une personne, cette dernière devient son « cheval»(doki) et manifeste épisodiquement la maladie. La personneatteinte est appelée mai borin jaki, celui qui a le borin jaki,ou dokin borin jaki, cheval de borin jaki. L'endroit où ledokin borin jaki a fait sa crise est alors considéré comme unespace à risque. En l'enjambant, on attrape la maladie mêmesi on n'est pas effieuré par le lalan iska. De même, lorsquel'on enjambe l'endroit où le malade a reçu une toilette curative ou encore l'endroit où certains animaux (l'âne en particulier) font leur « bain» de sable, on risque de contracter cettepathologie.
Par ailleurs, ketara a une dimension magico-religieuse.Mais ce serait alors sortir du cadre de la transmission,disons « naturelle ", des maladies et entrer dans le domainedes sammu (sortilèges) et celui des iskoki (génies)8.
Conclusion
La typologie qui précède n'a aucune prétention exhaustive. Cependant dans leurs recherches thérapeutiques, lespopulations mobilisent généralement la distinction entre cequi est transmis par héritage et ce qui provient de l'extérieurde la famille. Mais nous avons limité notre sujet car vouloircomprendre toutes ces conceptions autour de la maladie doitfaire intervenir d'autres termes et notamment une relationstructurante entre trois notions: saukin kurwa (ombre fragile9 ), jini (le sang) et nono (le lait). Ces termes vernaculaires,
------------
8 Voir sur ce sujet le travail effectué dans les régions de Tahoua et deFilingué par Nicole Echard.
9 Nous empruntons cette expressIOn à Laurent Vidal. (1990).
Maladies héréditaires et maladies du contact en milieu hausa 73
sans cesse évoqués pendant les entretiens, constituent unesorte de toile de fond sur laquelle est basée toute descriptionrelative à toute sorte d'agression contre l'être humain.
L'ombre fragile
La maladie - ciwo (le même mot désigne aussi la douleur), cuta (maladie) ou rishin lahiya (manque de santé)-peut attraper quelqu'un ou s'attraper (kamawa), prendre oubien se prendre (dokawa), être transmise (sawa, izawa, turawa). Cette transmission apparaît liée à une agression potentielle et ses effets correspondent globalement à une certainevulnérabilité de l'homme. La victime de la maladie est ainsisouvent dite une personne à « l'âme faible» (mai saukinkurwa, littéralement sauki - le n étant possessif - veut direléger, faible, fragile et kurwa veut dire ombre). Que ce soitdans le langage savant des guérisseurs ou dans le langagepopulaire commun, on dit toujours que la maladie, quellequ'elle soit, n'attrape jamais que celui qui a une âme faible:
Quelque soit ton gris-gris, si tu as une ombre faible,tout ce qui t'attaque parvient à t'attraper. (G)
Selon cette conception, la vulnérabilité d'un êtrehumain, (dan adam, fils d'Adam) face à une maladie ou àtoute autre forme d'agression extérieure, dépendrait donc dela force de son âme qui est une des trois composantes de lapersonne, avec le corps (jikiJ et la vie (rai). C'est ainsiqu'avant d'attaquer l'organisme humain dans son intégritéphysique, toute agression s'en prend d'abord à l'âme de lapersonne. Ame, qui comme dans l'ensemble de l'Mrique del'Ouest, est aussi le double de la personne et son ombre. Onretrouve, ainsi, cette même typologie chez d'autres peuplesde l'espace nigérien: les Songhay-Zarma (Olivier de Sardan,1982) et les Peuls (Vidal, op.cit.). Cette conception, particulièrement répandue dans le monde des guérisseurs(ma'gorai, au singulier ma'gori), des prêtres de génies(bokaye, au singulier boka) et des marabouts (malammai, ausingulier malami), mais aussi largement partagée par toutela population, conduit à mettre en avant dans toute « atteinte à l'intégrité » physique ou spirituelle d'une personne ladéficience de son âme. Qu'on ait un talisman ou pas, que
74 Les maladies de passage
celui-ci soit efficace ou pas, on doit toujours craindre uneagression dès lors qu'on a une ombre fragile. Le premier« bouclier» du corps humain est donc son ombre.
Le sang et le lait
Ce sont deux éléments qui interviennent dans la transmission des maladies des parents biologiques à leursenfants. On suppose en effet couramment que les maladiesdu père sont transmises par le biais du sang (jini), tandisque la mère transmet une maladie à son enfant par le sein(hantsa) et donc à travers le lait (nana).
La maladie du père, tu l'attrapes par le sang du père;la maladie de la mère quant à elle, tu la trouves dans sonsein. CT)
Selon ces conceptions, c'est le sang qui « pétrit » lecorps. Il lui donne notamment son aspect physique (kama).Par contre, le lait le nourrit et le fait grandir. On utilisel'expression jini guda (littéralement même sang) pour parlerde la descendance patrilinéaire. Ainsi, l'expression: « ils sontdu même père, de la même descendance» se traduit métaphoriquement par: « ils ont le même sang» (jininsu guda ne)lO.Par contre, nana guda sunka sha (littéralement ils ont bu lemême lait) veut dire « ils sont de la même mère ». On jure parle lait de la mère (na rantse da nanan da na sha : « je le juresur le sein que j'ai tété») ; la mère maudit (tsinewa) en vertudu lait qu'elle a donné. Le lait, comme symbole, apparaît ainsicomme lié à des notions touchant à la destinée.
Il n'y a pas de rapport « hiérarchique» entre le lait etle sang. Néanmoins, le pouvoir de « damnation» mais ausside protection, est associé à la mère en vertu du sein : la forcedu lait, étant plus redoutée que toutes les vertus viriles dusang. Par ailleurs, des pouvoirs redoutables ou des « infortunes» parmi les plus invalidantes sont supposés être transmis par le lait maternel: lèpre, sorcellerie, possession.
10 Soulignons que ces notions semblent proches. de celles des Lobi, populations vivant au sud du Burkina-Faso, à l'extrême nord-est de la Côted'Ivoire et à l'extrême nord-ouest du Ghana (Cros, 1990: 20).
Maladies héréditaires et maladies du contact en milieu hausa 75
Ainsi donc, trois notions, l'âme, le sang et le lait sontimportantes quand on aborde cette sorte de « transfert d'unepersonne à une autre des propriétés de la première"(Paillard, 1998) qu'est le sens que recouvre la notion detransmission des maladies en général. Globalement, et pournous résumer, l'âme faible « prédispose" le corps physiqueou spirituel à succomber facilement à l'agression extérieure.Elle rend la personne vulnérable, et ce n'est pas un gris-gris,même puissant, qui peut palier cette faiblesse. Quant ausang masculin et au lait féminin, ils indiquent la source,l'origine d'une propriété identitaire reçue. Les différentstermes vernaculaires recouvrant les sens du terme de« transmission" de la maladie se rattachent donc à certainescomposantes de la personne.
Bibliographie
Bureau central du recensement1992 Recensement général de la population 1988. Résultats défi
nitifs. Série 4 : Caractéristiques socio-eulturelles. Donnéesbrutes. Ensemble du Niger, Niamey, Ministère del'Economie et des Finances.
Cros M.1990 Anthropologie du sang en Afrique. Essai d'hématologie
symbolique chez les Lobi du Burkina Faso et de Côted'Ivoire, Paris, L'Harmattan.
Echard N.1989 Bori ; Aspects d'un culte de possession Hausa dans l'Ader
et le Kurfey (Niger), Document de travail 10, Paris, Centred'études africaines, EHESS.
Jaffré Y.1999 « La visibilité des maladies des yeux ", in La construction
sociale des maladies. Les entités nosologiques populairesen Afrique de l'Ouest, Jaffré Y., Olivier de Sardan J.P.,(sous la dir. de), Paris, PUF : 337-357.
Jaffré Y., Olivier de Sardan J.-P., 1999, La construction sociale desmaladies. Les entités nosologiques populaires en Afriquede l'Ouest, Paris, PUF.
76 Les maladies de passage
Olivier de Sardan J.-P.1982 Concepts et conceptions songhay-zarma. Histoire, culture,
société, Paris, Nubia.
Paillard B.1998 « Petit historique de la contagion ", Communications,
Paris, Seuil, 66 : 9-19.
Vidal L.1990 « L'ombre fragile. Maladie et rituel de possession au Niger
(exemple peul) ", Sciences Sociales et Santé, vol. VIII (1) :
21-46.
Chapitre 3
Les concepUons de la 'transmission,de la contagion et de la préventionde la maladie en milieu dogon (Mali) l
Sidiki Tinta
En milieu dogon, on conçoit différents modes de transmission de la maladie qui peuvent être regroupés en deuxgrandes catégories. La première regroupe les maladies de latransmission « involontaire ", où on reconnaît au mal la qualité de passer d'un individu à l'autre sans préjuger de la volonté de l'un et de l'autre à donner ou à recevoir ce qui est transmis. Dans cette catégorie, on retrouve en majorité les maladies prosaïques2 : maladies contagieuses, héréditaires etmaladies qui se transmettent dans les relations mère-enfant.La seconde catégorie regroupe les maladies de la transmission « volontaire ", où, plus que la propension de la maladie àse transmettre, c'est l'auteur de la transmission qui estrecherché : par qui ou par quoi une maladie, voire une propriété a été transmise à un individu. Cette catégorie regroupeessentiellement les maladies d'ordre magico-religieux : sorcellerie, génies, force vitale [yanwan] d'animaux et de plantes,etc. Dans cet article nous ne traiterons que de la transmission« involontaire" et des pratiques qui tendent à sa prévention.
1 Les données de ce texte sont, en partie, issues de ma thèse de doctorat(cf. Tinta, 1998).
2 Olivier de Sardan (1999 : 24) désigne ainsi des" maladies que l'on pourrait qualifier de "naturelles", par opposition aux maladies à étiologiemagico-religieuse...
78
Les notions relatives à /0 transmission
Les maladies de passage
Quatre notions sont les plus utilisées par les Dogonspour parler de transmission de la maladie : tagna et tagnako, ainsi que sinle in et tooke. Elles sont à la base des conceptions de la contamination et reposent sur quelques critèreshomogènes.
Tagna 3 : Ce mot est une forme verbale et pourrait êtretraduit en français par « contagionner » si ce néologisme existait. Mais le verbe « contagionner» qui serait entré dans lalangue française vers 18454 est très peu usité et n'est plusmentionné que dans quelques rares documents. Tagna peutaussi signifier « enjamber, traverser, franchir, passer del'autre côté, faire le pas [ko tagna] ». Il serait alors relativement synonyme de notions telles que daaruyan 5 en songhayzarma, gandige en moore ou yabba en Peul.
Cette idée d'enjambement revêt une signification symbolique forte. Elle indique pour l'individu la limite à ne pasfranchir au risque d'un péril. Elle implique aussi l'idée d'unerelation entre deux individus, et le transfert d'une propriétéde « l'enjambeur » vers l'enjambé ou vice versa. Par exemple,il est interdit de se faire enjamber, ou de laisser un objetqu'on a sur soi être enjambé par un chien. Il pourrait enrésulter une contamination s'exprimant par un mal deventre chronique supposé affecter tous les chiens. De lamême manière beaucoup de rites de purification comportentl'enjambement de l'objet sur lequel on transfere son mal.Une semblable conception existerait chez les Mossi où il estinterdit d'enjamber un mort, pour éviter la contagion desmaladies <Delobsom, 1934).
Mais, cette référence au pas évoque aussi une autreconception. Le pas, c'est aussi la marche et la mobilité. Celleci est censée être l'un des vecteurs les plus importants dans
3 Le même mot est utilisé dans la plupart des dialectes dogon. Il serait lesynonyme, dans les langues de populations voisines, de lomba en peul,longe en moore, yelema en bambara, disa en songhay-zarma.
4 cf Larousse, DictIOnnaire étymologique et historique du français, 1997.
5 Les notions songhay-zarma dont les sources ne sont pas citées m'ont étépersonnellement communiquées par Jean-Pierre Olivier de Sardan.
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 79
la diffusion de la contagion et est, d'ailleurs, toujours suspecte. Les gens n'ont jamais une bonne opinion d'une personnetrès mobile.
Il y a quelque chose que les Dogons disent pour direque c'est contagieux. Il y a la maladie lulo dans un village. Un homme quitte son village et séjourne dans le village atteint. Il a mangé et bu avec les gens de ce village.Après il retourne dans son propre village. Il tombe malade et d'autres personnes gagnent la maladie à sa suite.On constate que c'est la même maladie que celle du village où il a séjourné. On dira qu'il a amené la maladie dansle village. C'est ça la maladie contagieuse. (DY)
Dans une autre acception encore, tagna peut signifierprendre feu. On peut dire par exemple que « Sam nuwontagna dei nuwongu be ga un koi : lorsque la brousse prendfeu c'est un feu de brousse ».
Tagna peut aussi désigner une quote-part dans le partage d'une chose entre plusieurs bénéficiaires. Dans ce cas,on l'utilise comme synonyme d'un autre terme dine (do, to)6qui signifie revenir (à), échoir, c'est-à-dire recevoir sa part, cequi échoît au passage. Le terme connote ici l'idée d'une transmission légale ou légitime.
Tagna peut encore connoter une idée de succession,une transmission de fonctions et de statuts. Ainsi, pour parler de succession, on dira, en utilisant ce même terme, que« le bonnet vous est échu» [kunko u tagnaaJ. Étant donnéque le chef de famille est souvent appelé par métaphore« celui du bonnet », On admet que le bonnet revient à celuiqui doit assumer cette fonction.
Dans certains cas, tagna signifie entrer (chez un maripour une femme), se transformer, se métamorphoser, devenir. Par exemple, « aga uro tagna » (lit. : elle est entrée chezson mari), signifie qu'une femme est devenue épouse et vadésormais habiter avec son mari. Cela connote une idée detransfert d'un endroit à un autre, le franchissement d'unelimite. La chose, ou la personne objet du transfert, change
6 Dans le texte, les dialectes sont représentés par des symboles: do pourdonna, ta pour taro, di pour diamsay, te pour tegnu et tm pour tamma.
80 Les maladies de passage
d'espace, d'inscription sociale et/ou d'emplacement géographique. Un syntagme, ige tagna (passage chez le mari)désigne d'ailleurs un des rites de célébration du mariagechez les Dogon.
Une autre expression, « enen tagna » (lit. « elle estdevenue une personne ») signifie qu'un enfant a grandi, etmarque cette idée de transformation ou de métamorphose.
Enfin, dans certains cas, le terme tagna désigne lesactions de teindre ou de déteindre7 : Lorsqu'on imbibe untissu dans l'indigo, c'est par sa couleur que l'on saura s'il estteint [gara tagna]. Il y a des tissus qui déteignent [to =vomir]. Si tu les laves en même temps que d'autres habits, ilspeuvent déteindre [tagnaJ sur ces derniers. C'est commequelqu'un qui s'assoit avec un habit blanc sur un espacepoussiéreux. Son habit sera déteint [tagna].
Dans le champ de la maladie, pour dire « c'est contagieux », on utilise le syntagme tagna ko, formé du verbetagna auquel on adjoint un mot désignant un état: ko.
Sinle in : Littéralement cette expression qui signifie,« l'enfant, le fruit ou la graine de la maladie »8, désigne cequi pourrait s'identifier à un agent pathogène dont la pénétration dans l'organisme entraîne des manifestations morbides. Il s'agit, en quelque sorte, du « germe» de la maladie,de « sa graine» [in]. Cette appellation « graine de la maladie»[sinle in] englobe l'idée de quelque chose en devenir: ce quigerme, pousse, se développe et prolifere.
Lorsqu'on parle de soins, c'est qu'on cherche un médicament qui tue la graine de la maladie ou la fait sortir ducorps. Sinon la graine va germer et s'étendre9 . C'estcomme une plante qui germe sur une autre plante. Au fur
7 Cette même comparaison est utilisée par des Peuls de la République deGuinée qui tentent d'expliquer l'atteinte morbide et physique du corpset, par extension, la transmission d'une propriété d'un objet à un autre.La notion de nanga exprime l'idée de « prendre, saisir, attraper ".(Bouvier, 1998 : 47)
8 On dit l'enfant d'une personne [enen ma ln], la graine du mil [nyu in], lefruit de l'arbre (tlwln ln J.
9 Le terme traduit est wanran. Il décrit surtout la croissance des plantesrampantes et peut donc s'entendre ici dans le sens de « se développer enrampant« .
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 81
et à mesure qu'elle s'étend la plante meurt jusqu'à cequ'elle reste seule. (AG)
La maladie serait donc comme une graine qui pénètredans le corps, germe et croît aux dépens de l'organismehumain tant qu'elle n'est pas neutralisée ou extirpée du corpsmalade. Au passage, soulignons que ces conceptions ne sontpas sans rappeler les thèses développées par certains « contagionnistes ", notamment Bretonneau et Hildebrand pour quiles maladies se sèment à partir de graines (Delaporte, 1990).
Tooke [tooge en do, to] : Ce terme a été emprunté à lalangue peule. Dans cette langue, il signifie venin, dard, fiel,poison, haine ou méchanceté, et, pour l'essentiel, ces diverssens ont été conservés dans la langue dogon. Ainsi, dit-on,par exemple du serpent cobra que son crachat est venimeux[gaba gaba donji togon]. De même, on utilise ce mot pourdire d'une personne qu'« elle est trop méchante ", que « saparole a du venin" [so wo mon togo yese] ou dans le cas d'unerechute d'un épisode de folie Wo tooke ugnunran (lit. : sonvenin s'est levé). Mais ce terme s'utilise aussi spécifiquementdans le domaine de la maladie pour désigner quelque chosed'assez proche de la notion d'agent pathogène.
Certaines maladies tu les soignes, au moment où tupenses que le malade est guéri, la maladie rechute. Celaveut dire que le venin toko de la maladie n'est pas mort.Si le venin a pu être tué, la maladie ne rechutera plusjamais chez cette même personne. (AG)
On s'accorde donc sur le fait que tooke correspond àune « chose nuisible" [sige monsu] susceptible de se trouveren tout objet du monde : dans la maladie, dans une morsurede serpent, chez une personne nerveuse, dans tout ce qui estsorcellerie, notamment en cas d'envoi de la « flèche nocturne »
[yagna cem], où la notion de dard coïncide parfaitement à latraduction du terme de tooke.
Les modalités de la contagion
Chacun peut, bien évidemment constater qu'un mal quiaffectait initialement un individu arrive à se propager àd'autres. Mais il reste à préciser les modalités de ce « passage ".
82 Les maladies de passage
Deux principales observations ont été soulignées par nosinterlocuteurs. Elles concernent des phénomènes de simultanéité ou de succession, déjà observés chez les SonghayZarma (Jaffre, Moumouni, 1996).
Que la maladie attrape plusieurs personnes à la fois ouqu'elle les attrape l'une après l'autre, c'est la même contagion. Chacun a sa façon de dire les choses, sinon c'est lamême chose que nous disons. Une maladie que tu n'avaispas auparavant si quelqu'un arrive avec pour te contaminer c'est ce qu'on dit contagieux non. (AT)
Le contact - direct ou indirect - est toujours au centredu principe de contamination. Ainsi, les modes de contactspathogènes englobent toutes les voies de communicationinterhumaines : toucher, partager, voir ou regarder, enjamber, respirer, écouter, etc.
Une personne et toi, vous mangez ensemble, vousbuvez ensemble, vous déféquez au même endroit, vousurinez au même endroit, tout ce qu'il fera, comme mal oumaladie, se transmettra [tagnade] en toi aussi. (VK)
D'autres personnes interrogées mettent l'accent sur lapromiscuité. Vivre avec un malade, boire, manger avec lui,ou le toucher engendrent un risque de contagiosité.
Chez nous lorsque quelqu'un tombe malade, on met unparent à son chevet pour le garder. Que Dieu nous épargnecela, mais si le malade meurt, ou bien qu'il reste vivant ;quelque temps après, il donne sa maladie à celui qui l'a gardé.Et ainsi de suite plusieurs personnes attrapent la même maladie. On dit que cette maladie est contagieuse. (AT)
Les modalités de cette contamination - qui mêlent demanière étroite des observations sur les formes de transmission et des hypothèses causales - peuvent varier. Pour lesuns, la succession de maladies constitue la contagion. Fortsimplement, si une même maladie « attaque » successivement plusieurs personnes, c'est qu'elle est contagieuse.
Dans la tradition, chacun est avec sa classe d'âge.Dans certaines familles, on voit quelqu'un malade. Aumoment où celui-ci se lève, un autre se couche de la mêmemaladie, ainsi de suite. On dit alors que c'est contagieux[tagna ka]. C'est une vieille chose [. .. ]. (VK)
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 83
Pour d'autres, le critère de contagiosité correspondavant tout à la simultanéité de la transmission. La maladiecontagieuse est celle qui atteint en même temps un grandnombre d'individus. Par ce critère, on semble plus proched'une définition de l'épidémie que d'un simple phénomène detransmission individuelle, et c'est d'ailleurs la notion d'épidémie [jabuPo qui apparaît fréquemment dans ce type d'allégations.
Après ces réflexions sur les notions et les critères decontagion et de prévention, je vais tenter de les rapporter àquelques contextes précis de maladies.
Contagion et prévention dans le contexte de quelquesmaladies
Les maladies les plus craintes et les plus citées commeétant transmissibles sont dumbu, kiru kiru et degele. Cesentités nosologiques populaires sont assez proches de cequ'en français populaire on nommerait la « lèpre », « l'épilepsie »,« la rougeole ». Ces termes ne correspondent qu'approximativement à des termes médicaux. Par exemple, la lèpreest avant tout identifiée par ses lésions cutanées, l'épilepsiepar ses crises, la rougeole par l'exanthème. Les recouvrements de sens ne se font que par défaut ou par excès, autantde discordances que nous signalons par l'usage de guillemets.
10 Le nomJabu se dit d'une chose qui" s'étend ". Il a fini par désigner unecatégorie de génies ou d'esprits malfaisants qui envoient des maladiesaux hommes. Les maladies envoyées par ces mauvais esprits prennentl'aspect d'une vengeance des âmes exclues de la société. Elles peuvents'étendre à toute la société parce qu'elles ne sont pas envoyées à unindividu particulier. Pour cette raison, et par extension, le terme deJabu désigne non seulement les maladies envoyées par ces mauvaisesprits mais aussi toute forme de maladie qui peut s'attaquer à unecommunauté de façon massive. C'est pourquoi il peut être employécomme synonyme d'épidémie.
84
La « lèpre "
Les maladies de passage
Une conception, courante en milieu populaire, attribueau gecko (dumpene) l'atteinte originelle de la « lèpre », parcontact soit direct, soit indirect comme boire l'eau dans laquelle cette sorte de salamandre a trempé. L'« histoire » de lamaladie révèle qu'après une première infection, la maladie seserait transmise à l'homme puis d'individu à individu, soit parcontact direct en touchant le malade, soit par contact indirecten touchant ses excrétions corporelles, des objets souillés luiappartenant, voire en respirant le même air que lui. Troiscourts extraits d'entretiens peuvent illustrer nos propos:
La lèpre est contagieuse. La contagion se fait lorsquela sueur du lépreux te touche. Tous les lépreux transpirent beaucoupll. Elle peut se faire aussi lorsque tu portesles habits du lépreux. Si tu te couches là où il a l'habitudede se coucher, tu es contaminé. Si vos corps se touchent, ilpeut te contaminer. C'est possible d'attraper la maladieen mangeant dans le même plat que le malade ou en partageant le même pot à boire que lui. (AT)
Lorsque tu es en voyage et que tu loges chez unlépreux, je parle de la maladie qui coupe les doigts, à supposer qu'il n'y ait qu'une seule maison chez ton logeur, sile lépreux se couche vers la porte, couche-toi au fond de lapièce. S'il se couche au fond de la maison, sors te coucherau-dehors. Sinon, s'il se couche au fond et que tu tecouches à la porte, tu peux être contaminé [tagnade]. C'estainsi que les Dogons disent car la « graine de la maladie»[lula ï] qu'il a est dans l'air qu'il expire 12 et elle sort par laporte. Si ce courant d'air souillé par la respiration dumalade te traverse tu seras contaminé [tagnade]. (DY)
La lèpre que nous appelons la grande maladie estcontagieuse. La contagion peut se faire en enjambant sonurine ou en vivant avec lui dans la même maison. (AY)
11 Selon un aphorisme local, de quelqu'un qui transpIre beaucoup, on ditqu'il sue comme un lépreux.
12 Cette idée du souille de la respiration comme vecteur de la contamination a été observé par plusieurs chercheurs de l'équipe, notamment chezles Any! à propos de la « tuberculose" [tango fufuol, « toux blanche»<Duchesne, 1998: 77).
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 85
"L'épilepsie"
« L'épilepsie ", autre maladie considèrée comme contagieuse [tagna ko], est appelée tibu sugo par les Donno ; tiwepar les Toro ; et kiri kiru dans les autres dialectes. Les étiologies proposées sont diverses. Une première attribue, d'unemanière générale, cette pathologie à Dieu. D'autres évoquentles génies Uinaju], ou les « gens de la brousse » [ogulubeleme]. D'autres encore, un « mauvais travail" [dabile] del'homme. Enfin, plus prosaïquement, on incrimine la consommation de viande crue ou l'ingestion régulière d'alimentsdont le couvercle est maintenu par une pierre.
La contagion inter-humaine, quant à elle, se ferait deplusieurs manières . Toutes les personnes interrogées évoquent une contamination de proximité: vivre avec le malade,le toucher, avoir des contacts avec ses humeurs corporelles etsurtout celles qui sont sécrétées pendant la crise (bave, urine,selles). De même, la contagion pourrait intervenir en enjambant le lieu où le malade est tombé pendant la crise ou par lefait de manger ou de boire avec lui dans les mêmes récipients.
Si tu touches l'épileptique Uibu sugu bagna] ou sa bave[buro] au moment de ses crises [bagu], tu peux avoir[bere] sa maladie. C'est la même chose si tu t'assoies aumême endroit que lui. (SO)
Si tu as l'épilepsie et que moi je boive dans la même jarreou avec le même gobelet que toi, j'aurais ta maladie. (KA)
Certains guérisseurs dissuadent leurs malades de serendre dans des services de santé car le personnel médical neles hospitalise jamais, disent-ils, par crainte de contamination.
Les dogotoro disent que ce n'est pas contagieux.Pourquoi on garde tous les malades à l'hôpital sauf lesépileptiques? Pourquoi quand les malades font des crises,les médecins ne sont jamais là pour toucher à la bave ?Sinon on serait sûr que ce n'est pas contagieux. On noustrompe. (MK)
Les personnes interrogées considèrent que « l'épilepsie"atteint en priorité les enfants et les personnes vulnérables.
C'est une maladie qui attrape très vite ceux qui ont « lesang léger" [ite wei] et épargne ceux qui ont « le sang
86 Les maladies de passage
lourd " [iZe dogodo] , c'est-à-dire que les personnes d'unecertaine maturité [iZe] sont immunisées alors que les personnes non encore « mûres» ou dont la tête est « légère»[ku wei] sont vite contaminées. (DT)
Par ailleurs, la transmission au sein d'une familles'effectue, en priorité, d'aîné à puîné, ainsi que l'illustre cetteobservation. En effet, arrivant dans un village, j'ai découvertune femme victime d'exclusion parce qu'elle était épileptique,alors que dans le même village un enfant ayant le mêmemal, restait dans sa famille paternelle. Lorsque j'ai voulucomprendre cette différence de traitement, mes interlocuteurs me firent savoir que la femme avait encore des cadetsdans sa famille alors que l'enfant était le dernier né. Il avaitdonc moins de risques de transmettre la maladie que lafemme plus âgée. Étendant ma zone d'enquête pour vérifiercette information, j'ai fini par entendre les mêmes versionsdans d'autres villages.
L'épilepsie [tibu] est contagieuse Uagnade]. Mais lacontagion se fait d'aîné à cadet. Un cadet ne peut pascontaminer [tanga] son aîné. Cet enfant c'est le plus petit[dayi na dayi] de sa famille. Ce n'est pas le cas de lafemme L..]. (AD)
La peur de la maladie est liée à l'absence d'un traitement médical curatif ou préventif totalement efficace (avecune idée de guérison) et disponible localement. De fait, lamise en œuvre de programmes de prise en charge des épileptiques n'a pas complètement changé la perception des populations. Comme le dit un guérisseur:
Depuis que le programme a commencé, je n'ai pasentendu que quelqu'un soit guéri totalement. Certes, pourbeaucoup, il y a du mieux. D'une chute par semaine, ilssont parvenus à une par trimestre ou par année. Mais iln'y a pas de guérison totale.
La prévention de la " lèpre »et de " l'épilepsie»
Ces maladies ont en commun d'être considérées commeétant à la fois contagieuses, incurables, et socialement dépréciatives pour l'individu atteint. Les mesures préventives pré-
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 87
conisées consistent dans la mise à l'écart des malades: discrimination physique d'abord du vivant du malade, puissymbolique à sa mort. La première exclusion tend à se prémunir de la transmission et de la contagion; la seconde permet d'éviter à la fois la contamination après la mort et latransmission héréditaire.
L'épilepsie quand elle atteint une personne tagnade,elle la couvre de honte, la « gâte» yambalade, c'est pourquoi les Dogons disent que c'est une mauvaise maladielula pade. (DY)
On dit que la lèpre est une mauvaise maladie parcequ'elle gâte les mains et les pieds. La victime devient unepersonne de derrière [c'est-à-dire dépendante]. C'est pourcela qu'on dit que c'est une mauvaise maladie sinle mnyu.(YA)
La lèpre est une mauvaise maladie. Une maladie quifait que tout le monde t'évite, est-ce qu'il y a pire mal quecelle-là? Si tu attrapes cette maladie, même tes enfantset ta femme sont aussi évités. On évitera toute ta descendance. Désormais personne ne viendra nouer une alliancematrimoniale avec ta lignée. (Sa)
Travaillant dans un village, sur un thème qui ne portait pas spécifiquement sur les maladies transmissibles, j'aiété frappé par la situation sociale d'une jeune mère qui portait un garçon au dos et qui s'était installée dans un espacequi se confondait symboliquement avec la brousse. Elle étaitentre la case des femmes menstruées et le village. Le tempsqu'elle y passait s'éternisant et n'ayant observé en elle aucune attitude de maladie mentale, j'ai demandé la raison de saprésence à cet endroit. Elle était native du village et s'étaitmariée dans un autre village. Lorsque son épilepsie a étéidentifiée, son mari l'a répudiée avec l'enfant qu'elle portaitau dos. Elle est retournée dans son village natal, mais sespropres parents lui ont refusé l'hospitalité. Elle était donccondamnée à cette sorte « d'extériorité dans le village », et, àson propos, un vieil homme me rappelait l'anecdote de lachauve-souris en difficulté qui finit par en périr parcequ'aucune autre espèce ne l'a reconnue comme sienne. Mivolatile, mi animal, les premiers alléguaient que leur espèce
88 Les maladies de passage
n'a pas de dentition; les seconds la repoussaient à cause deses ailes. Autrement dit, personne ne veut se reconnaîtresocialement proche d'un épileptique, et notamment parcequ'il s'agit d'une maladie humiliante.
Une maladie qui te fait tomber partout, même là où tune voudrais pas; une maladie qui te fait faire des sellesdans ton pantalon ou ton pagne; qui te fait uriner aussi;tout le monde vient te regarder. Est-ce qu'il y a pire maladie que ça ? (ST)
La peur de cette honte sociale conduit parfois à deshomicides. Ainsi, BK est mort le 11 février 1996 de sa maladie, dit-on. Mais dans le village, la rumeur fait état d'unhomicide volontaire commis pour épargner à sa famille unequotidienne humiliation. En fait, « l'épileptique» est celuidont l'identité « s'altère » (Bonnet, 1995), se corrompt. Cettealtération accompagnée de honte fait que « les liens aveccelui qui est atteint de tibu sugo se coupent automatiquement lorsque la maladie se manifeste. Une femme quittera...(son époux) le jour où il se révélera épileptique» (Beneduce& al., 1990). Réciproquement la femme sera répudiée.
Cette rupture du lien conjugal pour cause de maladie aaussi été constatée dans le cas de la lèpre. Dans le village deD., lorsque la lèpre du jeune frère du chef de canton a étérévélée, sa femme l'a quitté, emmenant avec elle leur deuxenfants. Il est mort sans avoir pu se remarier, bien que lesamputations et les plaies se soient cicatrisées.
La discrimination qui s'applique aux lépreux et auxépileptiques est donc la règle dominante dans les pratiquespréventives. Si elle est très sévère pour ces deux maladies,elle se rencontre aussi dans d'autres maladies considéréescomme étant contagieuses.
En milieu dogon, lorsqu'on constate que quelqu'un estmalade d'une maladie contagieuse, on l'isole. On le mettaithors du village dans les cases faites pour les hameaux de culture. Mais si plusieurs cas sont repérés dans le village, on leramène parce qu'on dit que tout le village étant atteint, lamesure devient à la fois discriminatoire et inefficace. (DY)
La lèpre, dont le nom est évocateur puisqu'elle estnommée ninwin, c'est-à-dire « saleté », interdit toute sociabi-
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 89
lité: le malade comme tout ce qui est ou a été à son contactest considéré comme souillé. On fuit les lépreux comme onévite leur nourriture, leur boisson, leurs effets et les lieux oùils séjournent. De la même manière, pour éviter la contagion,on interdira aux lépreux les espaces publics. Mais bien souvent certains malades vexés par cette interdiction refusentde s'y plier. Face à ces réactions, on exerce des mesures decoercition:
Dans un village, pour éloigner les lépreux des placespubliques afin d'éviter la contamination, on y répand dufonio. Ainsi lorsque le lépreux y pénètre sa maladies'aggrave. Il ne pourra plus quitter chez lui à plus forteraison se rendre dans les lieux publics. (DY)
L'usage du fonio trouve son explication dans la conception générale que les Dogons ont de cette céréale qui symbolise une limite ou une barrière. Un mythe raconte que le fonioa été cultivé un « jour interdit » [ni dama], le cinquième etdernier jour de la semaine dogon, considéré comme jour derepos et où toute activité agricole est interdite. Céréale de latransgression, il est interdit à tout homme qui accédait auxfonctions d'Ogon - prêtre totémique - de la consommer.
On peut aussi se prémunir de la lèpre, comme de l'épilepsie, par d'autres méthodes. Ainsi, selon un guérisseur, onpeut recourir à une « fixation )' sur un support réservé [timetangu] :
On peut prévenir la lèpre par la méthode de la fixation.On cherche des morceaux de fer rouges et blancs en formede boucliers avec une sorte de pointe au centre et on procède par incantation en faveur du candidat à la protection.Puis par la partie en forme de pointe on fixe l'ensemble surle tronc duprossopis africana (kire na). (AT)
On peut aussi utiliser des plantes protectrices sousforme décoction avec laquelle le malade effectuera unbain corporel.
Dans le cas spécifique de l'épilepsie, des pratiquespurificatrices selon une logique de type « immunitaire» sonteffectuées : puisque le gecko est considéré comme l'animalqui donne la maladie à l'homme, c'est après tout contact aveclui qu'on peut prévenir la maladie.
90 Les maladies de passage
Lorsque le gecko agene se colle sur ton corps, il fautmettre la poudre de feuilles de baobab adansonia digitatadans l'eau et se laver avec. Tu seras protégé contre l'épilepsie. Même lorsque le malade boit la même eau que toi, c'està-dire s'il met sa salive dans ton eau, il faut toujours ymettre les feuilles de baobab avant de boire. Ainsi tu éviterasd'être atteint par l'épilepsie. (BA)
La transmission de ces maladies se prolonge après lamort car le cadavre reste contagieux. Pour éviter la contamination, deux précautions sont particulièrement observées.Tout d'abord le corps d'un malade décédé n'est jamais enterré ; son cadavre est généralement enfoui dans des creuxd'arbre (par exemple, le baobab) ou dans des grottes:
Quand un lépreux mourait, on ne l'enterrait pas àterre13. On pensait que le corps du lépreux pouvait contaminer [tagna] les plantes qui poussaient en terre. Par lasuite une contamination [tangu] humaine aurait été possible par l'intermédiaire des plantes alimentaires : mil,arbres fruitiers. C'est pourquoi on mettait ces morts dansles creux d'arbres. (DY)
Le cadavre du lépreux n'est pas non plus transportédans une civière. Il est déposé sur une claie [kikaw] fabriquée avec des tiges de mil. Ce brancard de fortune, qui est engénéral celui sur lequel couchait le défunt, est ensuite brûléou jeté sur une fourmilière afin de prévenir toute contamination. Ceux qui ont participé à la sépulture d'un lépreux oud'un épileptique doivent, au retour de l'enterrement, se soumettre à un rite de toilette purificatrice.
On prépare une décoction de feuilles de satele [bauhinia rufescens 1, de caïlcédrat peru [khaya senegalensis],des tiges d'une herbe appelée pise et yaga-yaga [stylosanthes viscosa] dans un canari neuf. Chacun prendra un
13 Ce traitement à part réservé au cadavre d'un lépreux afin d'évIter toutecontamination aussi bien vers les plantes que vers les hommes est aussiréalisé chez les AnYI (Duchesne, 1998: 81). Selon l'auteur. le corps dulépreux est mIS dans un trou creusé dans une termitière. Ceux qui participent à l'inhumation brûlent les alentours de la sépulture avant dequitter les lieux. Enfin, en rentrant de l'enterrement. ils ne marchentpas en file indienne et n'empruntent pas le chemin le plus court, cecipour dérouter la lèpre.
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 91
peu de cette décoction qu'il allongera d'un peu d'eau, puiss'en aspergera. (KA)
Un rite particulier, si l'enterrement a été différé et quele corps a amorcé sa décomposition, sera effectué:
Ceux qui ont dû toucher un corps de lèpreux ou d'épileptique qui commençait à se putréfier doivent dès leurretour, avant tout contact avec les autres, se frotter lesmains avec du mil écrasé. Cette farine est ensuite jetéedans une rivière. (BA)
Le fait de se frotter les mains avec du mil écrasé permet de transférer la souillure sur un support réservé. Celui-ciest ensuite jeté dans la rivière. Selon l'interprétation locale, lemort est assimilé à un voyageur et le mil écrasé symbolise laprovision qu'il emporte durant son voyage vers l'au-delà. C'estpourquoi, après chaque décès, on prépare du mil écrasé quiest jeté soit dans une rivière soit sur la route qui mêne à latombe pour servir de provision au défunt. Mais dans le cas dumort « contagieux» il revêt une signification particulière : lemal venant du mort, après l'opération de transfert de lasouillure, il s'agit de lui renvoyer son malheur pour qu'ilépargne les vivants. Cette provision lui étant destinée, il larecevra avec la charge de souillure qui y a été transférée.Après sa mort, la résidence du lépreux fera aussi l'objetd'attentions particulières pour éviter toute contagion. Ainsi:
Dans une famille lorsqu'un lépreux apparaît, on luifait une hutte à part. Après sa mort, on entoure la huttede l'épineux baru [acacia nilotica]. Quelque temps après ledécès, la hutte et les épineux sont brûlés avec quelquesaffaires du défunt comme ses habits et ses nattes. Cequ'on ne peut pas brûler, comme les canaris, on le jettedans l'eau qui coule. (FB)
L'usage de l'acacia nilotica comme substance antiputride, d'après Zahan (1969), s'explique par la qualité de sontanin, qui est censé retarder le pourrissement de la peau.Elle permet aux parents de voir pour la dernière fois le visage de leur proche et ainsi d'assister à son enterrement en« amoindrissant» les risques de contamination. Lorsque lemalade habitait une maison en banco, d'autres pratiquesétaient mises en œuvre pour la désinfecter.
92 Les maladies de passage
Si un lépreux mourait à l'intérieur d'une maison, parcrainte de contamination, personne n'y entrait. On entourait l'habitation de cendres et on aspergeait tout l'intérieur de potasse; on brûlait certains recoins de la maison,mais on attendait toujours qu'elle s'écroule d'elle-même,sinon lorsqu'on y habite, même si soi-même on n'attrapepas la maladie, on dit qu'elle fera un retour dans la parenté. Mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace ou de maisons, après la cendre et la potasse, ils réutilisent la maison. Dans le temps c'est ainsi qu'on faisait. (BA).
Dans les conceptions locales la cendre joue le rôle de barrière alors que la potasse sert à désactiver et à désacraliser.
La potasse sert à gâter; elle gâte la sorcellerie maléfique comme elle gâte celle qui est bénéfique. (AD)
Cette fonction de neutralisation que possède la potasses'étend à tous les domaines. Ainsi, si elle est mise au contactd'un autel ou d'un fétiche, il se corrompt, sa puissances'annule. De même, si un endroit est soupçonné avoir été« travaillé» par les sorciers, on l'asperge de potasse et soneffet s'annule. Si des semences (de mil, d'arachide, de fonioetc.) sont mises au contact de la potasse ou conservées dansun récipient qui en aurait contenu, elles seront considéréescomme avariées [nuwon], « mortes» et ne seront plus seméesparce que ne pouvant plus germer. Pour éviter le contact dela potasse avec les médicaments, notamment pendant la préparation des décoctions et des bains thérapeutiques, beaucoup de guérisseurs recommandent l'usage de jarres neuves.N'ayant pas encore servi, elles présentent la garantie de nepas anéantir les substances « actives Il du médicament.
Aujourd'hui, nombre de ces conceptions sont évoquéescomme se référant à « l'ancien temps ». Néanmoins, les discriminations physiques qui leur étaient associées continuentd'être pratiquées.
Les mauvaises morts, on les évitait avant. Maintenantle monde a changé, les connaissances aussi ont changé.Certains pratiquent l'islam, d'autres sont catholiques, il yen a qui sont protestants et nous autres jusqu'à présentnous n'avons pas abandonné l'ancienne religion. A chacunsa voie. (Sm
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 93
La " rougeole"
La « rougeole " [degele] est une maladie que les Dogonsconsidèrent aussi comme contagieuse. Elle est aussi appeléeungni «< mince ,,) car ses boutons sont petits. L'agent de lamaladie se trouverait dans l'air et dans tout ce qui est liquide(frais ou humide) ainsi que dans les humeurs corporelles desmalades. C'est une maladie considérée comme transmissibleessentiellement dans les contacts humains.
La rougeole [degele] est dans l'air. La maladie passed'un village à un autre par l'air qui se promène. (YN)
Celui qui a la rougeole, il ne faut pas boire le reste deson eau. Il ne faut pas manger le reste de ses repas. Il nefaut pas regarder ou marcher sur ses selles et ses vomissures. Ce sont ses « saletés» [logo] qui contiennent l'agent[sinle in]. La rougeole te prend si tu approches le maladeou si tu le touches [towo]. Il y a d'autres voies aussi, parexemple si tu t'assembles [monron] avec les femmes quiallaitent. La contagion entre la mère et l'enfant, c'est obligatoire. C'est elle qui le porte sur le dos; c'est elle qui lefait téter: ils sont toujours ensemble. (FK)
Ce rôle de vecteur reconnu aux humeurs est commun àde nombreuses sociétés ouest-africaines. Dans la zoned'enquète dogon, il s'explique en partie par la représentationde la « graine » de la maladie, précédemment évoquée, pénètrant le corps et y « végètant ». Ainsi, les excrétions corporelles (selles, vomissures, sueur), par leur coloration, leurfréquence, ou leur absence, témoignent de la présence ou nonde la « graine de la maladie » dans le corps. Ces excrétionssont donc perçues comme des symptômes, mais aussi commeles moyens et le signe de l'élimination de tout ou partie dugerme. C'est pourquoi, lorsqu'elles surviennent à certainesphases du traitement de la maladie, les guérisseurs les interprètent comme le signe de la réussite de leur médication.
La rougeole, bien que contagieuse, n'est pas stigmatisante. Pourtant, lorsque des cas se déclarent dans un villageles victimes sont isolées. Des mesures sont prises pour contrôler les mouvements de personnes proches des enfants, commeles mères allaitantes, assimilées à des «groupes à risque ».
94 Les maladies de passage
Lorsqu'un cas de rougeole se déclare, la personne est« mise à l'écart » [tomo gondodi] du village. Mais si aprèscette « mise à l'écart» [toma bedo] d'autres personnes sontcontaminées (tagni yo) dans le village, on fait revenir lepremier malade qui a été écarté. À ce moment, ce sont lespersonnes qui n'ont jamais été atteintes par la rougeolequi doivent éviter (bagiledin) le contact avec les malades.Ils doivent les fuir. (BK)
La prévention concerne surtout ceux qui n'ont jamaisété atteints car on considère que la rougeole ne s'attrapequ'une seule fois dans une vie. Elle n'attaquerait pas nonplus ceux qui ont été déjà atteints par d'autres pathologiesprovoquant des éruptions dont la « varicelle» parce que diton « la rougeole refuse de racler l'assiette de son cadet »14.Parallèlement à ces mesures pratiques d'évitement, on invoquera les différentes divinités du panthéon local, espérantainsi pouvoir écarter la maladie du village, ou atténuer toutau moins ses effets.
Lorsque la rougeole entre dans le village, les gens de lafamille où elle s'est déclarée ne la cacheront pas. Ils vontavertir les vieux du village. Ceux-ci vont, au nom du village, avoir recours à l'autel du pegu. Ils imploreront cetautel d'être en accord avec le Dieu invisible pour écarterla maladie du village. Ayant parlé ainsi au pegu en faveurdu village, ils vont égorger des poulets en guise de sacrifice. Grâce à ces pratiques il arrive que pendant des annéesla maladie n'attaque pas le villag. (AT)
Globalement, face à la maladie, il s'agit de faire ensorte que ceux qui ne sont pas encore atteints soient épargnés et que les autres « s'en sortent bien ». La réprobationpopulaire à l'égard de celui qui est supposé avoir introduit lamaladie au village est parfois si forte qu'on en vient, biensouvent, à ne pas déclarer un malade. Cependant, lorsque
14 Cette Idée de « racler l'assiette" [bagna kogno l est la réciproque dudrOIt d'aînesse qu'exerce l'ainé sur son cadet. Selon cette règle l'ainédoît laisser son cadet tenniner le plat. Sî par gourmandise îl termîne leplat en même temps que son cadet on considère qu'il ne peut pas exigerde son cadet le respect des obligations liées au droit d'aînesse, parcequ'îl a failli à l'un de ses devoirs fondamentaux.
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 95
dans un village, on apprend que l'épidémie est déclarée chezdes voisins, certaines précautions sont prises.
Si la rougeole entre dans un village, les autres villagesde la contrée feront attention. Toutes les femmes allaitantes ne pourront plus voyager dans ce village. Demême, celles du village atteint ne pourront plus fréquenter les autres villages. Aucun aliment frais ne doit quitterce village pour les autres. (AK)
La surveillance de ces mesures est confiée aux yayerem 15 . Ces femmes venues d'ailleurs pour se marier dans levillage, sont, à travers cette institution, dans une relation deplaisanterie avec les autochtones. Cette relation qu'on appelle gara, « passer ", ou mangu [de manga : « faire attention à,respecter, accueillir »], « considérer », crée une obligationréciproque. Ce type d'institution est généralement assortid'interdits, notamment ne pas obéir à la requête de l'une desparties auprès de l'autre. L'institution des ya yerem va doncexiger le respect de chacun vis à vis des mesures conservatoires prises pour prévenir la rougeole. Ce groupe de femmesva ainsi pouvoir interdire aux femmes allaitantes natives duvillage mais mariées ailleurs, de rendre visite à leursfamilles d'origine tant que la maladie n'est pas éradiquée. Demême, il interdira aux femmes étrangères de même statut,en provenance des régions infectées, de traverser le village.Il contrôlera le marché du village pour que des aliments etautres produits frais en provenance des villages atteints n'ysoient pas vendus, allant jusqu'à confisquer, détruire oujeter, ce qui leur semble suspect. Les ya yerem jouent doncun rôle très important dans la prévention des risques quimenacent le village, notamment en cas d'épidémie. Ainsi, parexemple, à N. les ya yerem contribuent à prévenir une épidémie en simulant une fuite organisée. Lorsqu'une épidémieentre dans le village et commence à tuer beaucoup de personnes, les ya yerem sortent. Elles fuient le village. Maiscelles qui portent des garçons au dos ne participent pas à lafuite. Le matin elles se retrouvent toutes en un endroit en
15 Lit." celles qui sont venues hIer ". Il s'agit d'une association de femmesmariées dans un village d'où elles ne sont pas originaIres (cf Tinta,1999).
96 Les maladies de passage
dehors du village. Une d'entre elles sera désignée pour fairedes éloges aux autels de fondation des différentes maisonsmères en chantant leurs devises. Puis, elles s'enfuiront ets'arrêteront à un endroit appelé Kibo qui est la limite du territoire villageois. Le sacrificateur de l'autel du lebe vient lesrejoindre avec un poulet blanc et les supplie de retourner auvillage. En sa présence, les femmes répéteront la devise desdifférents lignages puis adresseront les salutations matinales en disant « nous vous donnons le salut du matin, noussommes sorties pour vous fuir ce matin parce que nousétions venues [dans votre village] pour trouver la vie maisc'est la mort que nous y avons trouvée ". Toutes les filless'uniront au mouvement car dans un village tout le mondeest parent de ya yerem. Cette fuite collective est censéevaincre l'épidémie. On appelle cela la fuite des ya yerem. Lespuissances tutélaires invoquées sont obligées, par la règle dumangu, de satisfaire la requête des ya yerem sinon leur fuitemenacerait encore plus gravement l'ordre social que l'épidémie elle-même. En effet, les ya yerem symbolisent le systèmed'alliance matrimonial sans lequel la société ne peut sereproduire. En tant qu'alliées matrimoniales, politiques etrituelles (par la relation à plaisanterie), les ya yerem constituent une double autorité exerçant leur pouvoir sur leshommes et sur leur système religieux.
Outre ces recours sociaux, on use aussi de médecinespréventives et du support symbolique de certaines plantes.
Il y a une plante qu'on appelle jiyal goto16. Qui n'estpas facile de trouver dans la brousse. Mais on l'utilisedans la prévention comme dans le traitement. (BK)
C'est ainsi qu'un fruit unique resté sur un arbredevient le signe de la persévérance, et peut aider à échapperà un fléau collectif. Cette qualité est transférée à ceux quiboivent la décoction faite à partir de ce fruit pour qu'ilséchappent à l'épidémie de rougeole.
---~--~-----------
16 Ce nom emprunté au peul signIfie « une seule] épine» parce que surchacune de ses branchettes cet arbre ne porterait qu'une seule épine.
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 97
Conclusion
Les notions dogons de contagion sont transversales àd'autres secteurs de la vie sociale, et ne concernent pas uniquement celui de la maladie et de la santé. Globalement,elles servent à décrire tous les actes de la vie qui évoquentl'idée de mobilité, de transformation, de métamorphose, etc.Appliquées au domaine de la maladie et de la santé, ellesarticulent une conception de la transmission sur le thème dutransfert et une réflexion basée sur une démarche empirique.Dans certains cas, c'est de la similitude entre des propriétéspathologiques présentes chez des individus différents que lesDogons semblent déduire qu'elles sont transmissibles. Dansd'autres cas, c'est par l'observation empirique de phénomènes simultanés ou récurrents que les populations déduisent leurs idées de transmission. Dans cette conception de latransmission, les notions de médiation étiologique et decontact sont centrales. Les pratiques populaires qui peuventavoir un contenu rituel et symbolique etJou prosaïque s'inscrivent dans une logique d'action soit large et a priori soitspécifique et à propos. Mais aujourd'hui ces pratiques traditionnelles ont en face d'elles l'offre émanant des services desanté moderne. Ceux-ci proposent une prévention de typebiologique ou basée sur les messages de santé. Concrètementon est dans le cadre d'une confrontation dynamique, quiconstitue la modernité sanitaire dogon.
Bibliographie
Bado J.-P.1996 Médecine coloniale et grandes endémies en Afrique, Paris,
Karthala.
Barges A.1993 « Environnement urbain africain et maladie: ségrégation
antilépreuse et comportements adaptatifs à Bamako(Mali) " in Ecologie Humaine, n° 2, vol. XII, Juin: 7-20.
Beneduce R, Salamata O., Barbara F.1990 « L'épilepsie en pays dogon. Une perspective anthropolo
gique et médicale ", in Coppo & Keita (éds) : Médecine tra-
98 Les maladies de passage
ditionnelle. Acteurs, itinéraires thérapeutiques, Trieste,éds : 193-243.
Bonnet D.1995 « Identité et appartenance : interrogations et réponses
moose à propos du cas singulier de l'épileptique ", inCahiers des Sciences Humaines: identités et appartenancesdans les sociétés Sahéliennes, Claude Fay (éd.), Paris,ORSTOM,2 : 501-522.
Bouvier S.1998 « Variations autour du thème de la contagion et de la
contamination (Timba, Fouta-Djalon, Haute-Guinée) ", inProgramme de recherche: « Interactions entre les systèmes de santé publique et les conceptions et pratiquespopulaires relatives à la maladie (Afrique de l'Ouest) ",vol. VII, Février.
Delobsom D.1934 Les secrets des sorciers noirs, Coll. Science et Magie n° 5,
Paris, Librairie E. Nourry.
Delaporte F.1990 Le savoir de la maladie. Essai sur le choléra de 1832 à
Paris, Paris, PUF, Bibliothèque d'histoire des Sciences, 49.
Diakite D.1993 « Quelques maladies chez les Bamanan in Brunet-Jailly (éd.) ",
Se soigner au Mali, Paris, Karthala-ORSTOM : 25-48.
Dieterlen G.1941 Les âmes des Dogon, Paris, Travaux de l'Institut
d'Ethnologie.
Duchesne V.1998 « Représentations de la contagion dans une société africai
ne (les Anyi de Côte d'Ivoire) ", in Programme derecherche : « Interactions entre les systèmes de santépublique et les conceptions et pratiques populairs relatives à la maladie (Mrique de l'Ouest) ", vol. VII, Février.
Herzlich C., Pierret J.1984 Malades d'hier, malades d'aujourd'hui. De la mort collecti
ve au devoir de guérison, Paris, Payot.
Les conceptions de la transmission de la maladie en milieu dogon 99
Jaffré Y, Moumouni A.1994 « L'importance des données socio-culturelles pour l'accès
aux soins et l'observance des traitements dans la lèpre.L'exemple du pays Zarma au Niger ", in Bulletin de lasociété de pathologie exotique, 87 : 283-288.
Jaffré Y, Olivier de Sardan J.-P.1996 « Tijiri: la naissance sociale d'une maladie ", in Cahiers
des Sciences Humaines, 31, 4, ORSTOM, 773-795.
Mbodj A.1996 « Représentations de la bilharziose intestinale chez les
Wolof et les Haalpular du Sénégal (étiologie, nomination,recours et itinéraires thérapeutiques) ", Programme derecherche: « Interactions entre les systèmes de santépublique et les conceptions et pratiques populairs relatives à la maladie (Afrique de l'Ouest) " vol. v.
Olivier de Sardan J.-P.1994 « La logique de la nomination. Les représentations fluides
et prosaïques de deux maladies au Niger ", in SciencesSociales et Santé, 12 (3) : 15-45.
Tinta S.1999 Les conceptions autour de la transmission de la maladie
et les pratiques préventives chez les Dogon du Mali, Thèsede doctorat d'anthropologie sociale et ethnologie,Marseille, EHESS.
Yaogo M.1996 « Paparlo ", in Programme de recherche : Interactions
entre les systèmes de santé publique et les conceptions etpratiques populaires relatives à la maladie (Afrique del'Ouest), vol. V.
Zahan D.1969 La viande et la graine. Mythologie dogon, Paris, Editions
Présence Africaine.
Chapitre 4
Conceptions populaires sosode la 'transmission des maladieset protlques de préventionen Guinée Maritime
Yveline Diallo
Pour des raisons de santé publique et d'améliorationdes connaissances, nous présentons dans ce texte les conceptions des Soso ou Susu- de Guinée concernant la transmission des pathologies, qu'ils soient ou non guériseeurs-. Nousavons dégagé les principales conceptions sans ignorerqu'elles sont plus ou moins partagées et que les personnes yadhèrent diversement; d'autre part, ces représentations,recueillies en milieu rural, ne sont pas figées. Elles entrenten concurrence avec d'autres opinions et se transformentcontinuellement avec la scolarisation et la diffusion de mes-
------_._----
1 Les 8U8U ou 8080 de la république de Guinée constituent la population laplus nombreuse de Guinée Maritime et leur langue, le 8080, est la principale langue de communication de cette région côtière. Le nombre de locuteurs peut être estimé à au moins 1 million cinq cent mille personnes.
2 Les matériaux ayant servi à la rédaction de ce texte ont été réunis lorsde deux enquêtes en décembre 1997 et mars 1998, dans l'île de Kaback,à 100 km au sud-est de Conakry et dans le village de Khanbaya, dans lapréfecture de Boffa, à 140 km au nord-ouest de la capitale. Mr AlkalyFofana, linguiste à l'I.R.L.A (Institut de Recherche LinguistiqueAppliquée de Conakry), et moi-même, avons rencontré pour des entretiens semi-directifs 108 personnes dont 79 guérisseurs. La premièreenquête a été financée par l'IRD, (Institut de Recherche pour leDéveloppement) et la seconde par l'Union Européenne.
102 Les maladies de passage
sages d'éducation sanitaire plus ou moins assimilés. Derrièrela diversité des conceptions de la propagation des maux,nous nous efforcerons de saisir la logique qui les sous-tend.
De ces représentations découlent des choix populairesde prévention qui sont plus ou moins suivis d'effet et quin'engendrent pas automatiquement des pratiques de prévention populaire ou de prudence car les personnes sont soumises à diverses contraintes et normes sociales. ArlettePoloni (1990 : 275) rappelle que « toute pratique est enchâssée dans un réseau de contraintes économiques, technologiques, écologiques à partir duquel les acteurs sociaux composent et donnent sens à leurs activités. » C'est à travers unegrille de conceptions de la transmission des maladies, derecommandations et de pratiques populaires préventives etdes contraintes sociales et économiques que le message desanté publique sera perçu, interprété, ignoré ou appliqué.
Il n'existe pas de termes spécifiques en langue soso pourexprimer les notions de contagion, de contamination. La transmission de la maladie se dit radangi qui signifie faire passer,transmettre. On dit également la maladie « atteint» li, « vient»fa, « entre» sa, « gagne» soto, « descend» gara, « part» siga,« déménage» tunun, « se disperse» rayensen ... Elle est représentée comme une entité qui « attrape », suxu, la personne.
Les Susu pensent que certaines maladies sont congénitales. Ainsi tout le monde naît avec des pathologies digestivestelle suma, qui se manifesteront diversement au cours de lavie selon les individus et leur mode de vie. Les maladies considérées comme les plus contagieuses, que l'on attrape au coursde l'existence, sont celles dont les manifestations ou les symptômes sont très observables comme les éruptions cutanées, lesaffections inflammatoires localisées et celles qui s'extériorisentpar la toux ou des selles et des urines jugées anormales.
Les représentations de la transmission des maladies secristallisent autour de la notion essentielle de contact. Ellessont développées au cours des paragraphes suivants:
• la proximité et le toucher des corps malades sontdangereux;
• le contact avec les liquides physiologiques est particulièrement contaminant;
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 103
• l'alimentation est le principal vecteur de contamination car elle met en relation l'intérieur du corps humain etson environnement;
• les remèdes populaires à base de plantes médicinalespeuvent être des vecteurs de contagion;
• les agents atmosphériques (vent et chaleur) sont desdiffuseurs de maladies.
Le sixième et dernier paragraphe est consacré auxrecommandations populaires et aux comportements de prévention ou de prudence partiellement induits par les conceptions de la transmission des pathologies.
Toutes ces conceptions et pratiques renvoient à desreprésentations de l'environnement, de la personne, du corpset de la maladie qui sont présentées en filigrane de notresujet principal.
La proximité et le toucher des corps malades sont dangereux
La proximité d'un malade est considérée comme potentiellement dangereuse. Ainsi l'air exhalé par une personneenrhumée envoie le rhume mage à celle qui le respire. Lesmaux d'yeux se transmettent en se regardant.
Un certain nombre de maladies seraient transmissibles par contact direct, en touchant le corps du malade, enserrant sa main: la gale kasi, la lèpre kunè3, les pathologiesinflammatoires, foye 4 , bindibandè5 , lenge6, xuntunyi7 , la
3 Différents mots nomment la lèpre selon l'état du malade: dèè est leterme le plus usuel, kirLmase Ichose sur la peau! fait allusion aux tachescutanées, kunè met l'accent sur la lèpre des extrémités des membres etmabolonyil qui coupel insiste sur la phase mutilante.
4 Foyelvent/renvoie à des oedèmes localisés ou généralisés.
5 Bindibandè, inflammation d'une partie du corps ou de la tête (oreille,cou, dent, œil) désigne aussi parfois des douleurs ostéo-articulairesgénéralisées
6 lenge, littéralement calebasse, ou lengedilpetite calebassel se manifestent par la formation d'un kyste, d'un œdème dans différentes partiesdu corps: cou, nez, sein, anus, testicule.
7 xuntunYl, de xuntun bosse, indique la formation d'une tumeur, d'unkyste, d'une inflammation brusque sur une partie du corps notammentaux membres.
104 Les maladies de passage
tuberculose toxun {ure /maladie de la toux!. En fait, la contagion s'effectue soit par la transmission de la chaleur corporelle, soit par le déplacement de saletés noxè. Les effets de lachaleur et des déchets lors de la contagion se cumulent ous'exercent séparément.
Cette représentation est à la fois empirique et magicoreligieuse. La contamination est fortuite ou intentionnelle.Elle est fortuite dans les cas de contagion où une pathologiese transmet d'un malade à une personne saine. Elle estintentionnelle, lorsque, par exemple, le sorcier koè mixi!l'homme de la nuit/ provoque le dépérissement de sa victimeen la touchant masuxu, en lui mettant une empreinte sur lecorps.
Une contamination accidentelle peut se produire enmarchant sur une ombre corporelle.
La contagion se produit par la chaleur corporelle
Le mot {ura en soso signifie à la fois être chaud et êtremalade.
Le mal se propage par la chaleur wuyenga que diffuse lecorps souffrant. La chaleur qui émane de la bouche du maladepeut transmettre selon les cas, la toux, la lèpre. Si on partagele lit d'un individu atteint de dannawali, la jaunisse, la chaleurse dégageant du corps fiévreux communique cette affection.
La contagion par la chaleur résiduelle intervient lorsqu'on s'asseoit à l'endroit où une personne souffrante s'estassise. Porter la chemise d'un malade communique, par lachaleur, diverses inflammations. Manger avec un malade,boire dans son verre, utiliser ses couverts, transmet, par lachaleur (et/ou la salive) divers maux: les plaies buccales dèxonè /douleur de la bouche/, sègèti8 , latègè 9 , sosoè 10 , les
---------------
8 sègètl /petit balai! se réfère à une étiologie de la maladie plus ou momsoubliée. Le balai de paille serait à l'origine de lésions gingivales chezl'enfant et l'adulte.
9 latègè /malheur/désigne une lésion dermatologique pour certains guénsseurs et pour d'autres une angine.
10 sos6è seraIt une mflammation douloureuse de la joue qui se fistule enlaissant écouler du pus.
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 105
inflammations de la bouche bindibandè, xuntunyi, mopia l1 ,
konkoè 12 , {oye, les maux de gorge koromi, konsuxui, la tuberculose, la lèpre, l'asthme siisa, la rougeole tèntènyi, la jaunisse dannawali, l'épilepsie bira {ure 13, le choléra kolera 14, lesida sida15 selon l'atteinte de l'individu.
La femme enceinte donne au fœtus les pathologiesdont elle est porteuse par contiguïté car la chaleur de lamaladie se propage à l'utérus. Elle transmet ainsi xuntunyiune inflammation localisée, dannawali la jaunisse, na{arides troubles digestifs.
Lors des relations sexuelles, les maladies noxe16 , suxukuye, korosila, SOpis 17 passeraient d'un partenaire à l'autrepar la chaleur.
La contamination s'effectue par les saletés et impuretés corporelles
La notion de saletés noxè est essentielle pour penser lamaladie chez les Susu. Cette notion est très générale; elle
11 miJpw mdique une tuméfaction localisée.
12 k6nkoe est une inflammation douloureuse de la mâchoire.
13 L'épilepsie est évoquée avec un certain euphémisme par blra fure !lamaladie qui fait tomber/ mais aussi par xunma girigiri qui signifie latête qui tourne.
14 Il n'existe pas de terme spécifique en soso pour désigner le choléra; onparle de diarrhée furi gere !la guerre du ventre/. La connaissance dumot choléra est liée à l'épidémie de choléra survenue en 1995 àConakry. La diffusIOn de la maladie à l'intérieur du pays, dont àKaback, serait hée, d'après les médias, aux funérailles d'habitants deConakry enterrés dans leur village d'origine.
15 En milieu rural les guérisseurs et les populations disent ne pas savoirce qu'est le sida, ceux qui pensent le connaître l'assimilent à la maladielannè qui se manifeste par des ulcérations rongeant les organessexuels.
16 niJxè qui, nous l'avons vu, signifie saletés, désigne aussi une maladie setraduisant par une lourdeur du corps, de la fatigue, une somnolence,une malchance. Le patient est lavé avec un décocté de plantes et la« saleté" du mal, évacuée avec les eaux usées, serait visible.
17 Les infections suxukuye et korosila sont considérées comme identiques ;kiJroslla est plus fréquemment utilisé pour les hommes et suxukuyepour les femmes. Ils recouvrent toutes les infections uro-génitales àforme purulente ou hématurique et sont des synonymes de sopis,« chaude-pisse".
106 Les maladies de passage
recouvre aussi bien les saletés de l'environnement telles lesordures ménagères, que la matérialisation des attaquesmagiques, mauvais sorts, empoisonnement intentionnel. Elledésigne aussi les déchets évacués par le corps humain etceux supposés stagnés dans l'organisme qui seraient à l'origine de nombreuses pathologies courantes.
Se laver avec l'éponge de toilette fuuti d'un maladeatteint de gale kasi ou de noxè propage le mal par transmission directe des saletés corporelles, crasse, sueur.
Les excrétions, selles, vomissures, sont des vecteurs decontamination lorsqu'elles sont piétinées. Cet exemple et lessuivants illustrent la perméabilité du corps humain particulièrement par les plantes de pieds: marcher sur des déchetsanimaux fait enfler la jambe, piétiner les détritus ménagerssuuti donne la gale kasi.
Les dabari ou mauvais sorts composés de déchets animaux ou humains, poils, plumes et soumis à une manipulation magique sont enfouis au seuil de la maison, à un carrefour ou encore sur le trajet de la personne visée. Lorsque lavictime les foule, son pied enfle, une plaie incurable seformelS. Il est important de souligner que ce phénomène peuts'étendre à des « principes » plus subtiles comme l'ombre etl'âme ou l'énergie vitale de l'individu. Comme dans de nombreuses cultures ouest-africaines, on peut contracter ou transmettre une maladie en marchant sur l'ombre d'une personne.
Le seuil, comme le carrefour, est la matérialisationd'une limite, là où un contact potentiellement dangereuxpeut se produire. Des rituels thérapeutiques ont lieu au seuilde la maison. Pierre Bourdieu (1980 : 57) parle du seuilcomme « limite entre deux espaces où les principes antagonistes s'affrontent et où le monde se renverse. » Le carrefourest une limite symbolique entre le village et la brousse, làd'où rayonnent et aboutissent toutes les voies vers le villageet vers l'extérieur.
La femme enceinte qui piétine l'endroit où un oiseaumaléfique s'est posé, risque un avortement; si celui-ci est
18 Les dabari agiraient aussI à distance en étant placés dans un endroitpeu accessIble: zone marécageuse ou dans un marigot sous un galet.
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 107
évité, l'enfant à la naissance souffrira de crises convulsives.La mère est considérée comme un relais dans la contamination de l'enfant. Ces manifestations diverses et graves sontregroupées sous l'appellation xoni loiseaul19.
Les déchets de l'environnement sont une source de contamination. Une femme qui urine dans un endroit sale risque decontracter la maladie bori, représentée comme un parasite quiprovoque des douleurs abdominales et une aménorrhée.
Les liquides corporels sont une source importante de contamination
Les guensseurs comme les malades observent lesliquides corporels qui sortent du corps et qui sont l'expression visible de la maladie. Une analogie est établie entrel'eau du corps et l'eau de l'environnement. Le mot ye, eau, estun terme générique qui entre dans la nomination des différents liquides physiologiques2o. Les personnes accordent uneimportance à l'eau de l'organisme21, ce qui pourrait expliquerle succès des perfusions dans les traitements modernes descabinets privés à Conakry.
Les humeurs sont des vecteurs de contagion
Les infections urogénitales korosila et suxukuye sonttransmises par le liquide séminal ou les sécrétions vaginalesmaniye lors des rapports sexuels. Les guérisseurs parlent demauvaise eau ye naxi, d'eau chaude ye {ure, d'eau blanche ye
19 xonz/Olseau! désigne à la fois la maladie et son étiologie. Cet oiseaumaléfique est appelé darata ou yamba xumbe ce qui correspondrait àl'engoulevent.
20 dè ye/eau de la bouche/ salive, ya ye/eau de l'œil! les larmes, ye fixè /eaublanche/ les leucorrhées, ye rafili/verser de l'eau! terme respectueuxpour uriner, manzye, sperme.
21 Une malade rencontrée au centre de santé de Tahouya le 28/02/95demande au médeCln si elle a de l'eau dans le corps tout en pinçant lapeau de son avant-bras. Fatoumata, 30 ans de Khanbaya, déclare :" quand je n'ai pas d'eau dans mon corps, je deviens légère, j'ai des vertiges" ; elle boit alors une solution des sels préconisés pour la réhydratation orale des bébés.
108 Les maladies de passage
fixè, de substance visqueuse lingi, gluante salaxunyi. Le liquide séminal se transforme lui-même en « mauvaise eau» oubien n'est que le véhicule de la maladie et pousse les saletésnoxè dans le ventre de la femme. Les saletés sont d'originesdiverses: rétention de sperme par suite d'abstinence, stagnation d'aliment comme l'huile, eau sale, malpropreté yuxa.L'homme et la femme, lors des relations sexuelles, ne sontconsidérés parfois que comme des intermédiaires matériels,des conducteurs, dans la transmission des maux d'un hommeà un autre ou d'une femme à une autre. Ainsi une femmepeut transmettre une maladie spécifique des hommes, d'unpartenaire à l'autre, telle la hernie xèèxè ou xoriye. Un hommefait passer aussi une infection gynécologique d'une femme àune autre sans être toujours considéré lui-même commemalade. Lorsque le trouble est représenté comme une accumulation de liquide au bas-ventre, cet excès d'eau s'évacuechez le partenaire lors des relations sexuelles. L'affection secommunique au futur enfant au cours de la conception parsuite de l'altération du liquide séminal du père ou des sécrétions de la mère; la mauvaise eau de la maladie se mélangerait à l'eau considérée comme étant à l'origine du foetus.
Si une femme enceinte est atteinte de suxukuye, leliquide chaud dans son ventre brûle le foetus qui naîtra desquamé ou mort-né.
L'infection uro-génitale se transmet par l'urine xoli. Lemalade observe une modification de la sécrétion naturelle, deson aspect, de sa consistance et de sa couleur. Lorsque l'urinede l'homme contient du pus fuxi, il donne la sopis « chaudepisse » au cours des relations sexuelles. Un homme attrapekorosila en piétinant l'urine d'un chien porteur de cette maladie. L'insecte est représenté comme un vecteur de mise encontact, ainsi dans le scénario suivant: une mouche boitl'urine d'un homme malade et dépose sa salive sur un aliment,une personne saine consomme cet aliment et est infectée.
Le pou, le moustique, transmettent la gale ou la rougeole tèntènyi, de l'animal à l'homme, par la rencontre dusang de l'animal et du sang humain wuli22 .
22 Des notions différentes se greffent sur le sang humam. Le sang, supportde la force physique, symbolise non seulement la parenté mais aussi la
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 109
Les pathologies, représentées comme des entités qui sedéplacent dans le sang de la mère suxukuye, dannawali,xaliyanyi23 , attaquent le foetus en passant du sang maternelà celui de l'enfant.
La sueur kuyefure, excrétion naturelle accrue par lafièvre, manifestation liquide de la chaleur corporelle, estconsidérée comme un vecteur de contagion. Ainsi, une affection est transmise par la sueur, en se couchant avec une personne souffrante ou en portant sa chemise, son boubou, seschaussures.
La maladie modifie l'aspect de la salive24, sa consistance, son abondance. Boire dans le même gobelet qu'un malade, manger avec lui, se servir de ses couverts, de sa brosse àdent transmettent diverses pathologies: rhume, toux, tuberculose, asthme, inflammation de la bouche, angine, lèpre,choléra. Piétiner les crachats d'un malade, respirer la poussière transportant des crachats séchés donnent la toux.L'épilepsie se transmet en foulant la salive laissée à terrepar le malade après sa crise.
Le rhume mage s'attrape par contact avec la morve.
Une conjonctive provoquant un larmoiement excessifse communique par les larmes.
Diverses maladies de la nourrice gâtent le lait maternel et sont données à l'enfant par le lait: bindibandè, palu,
chance, l'estime publique. Amsi : a wult mafan/son sang plaît! signifie ila de la chance. Une importance est accordée au sang en ce qui concernel'inégalité dans la transmissIOn de la maladie. Une personne de sangclair wuli tinse ne serait jamais souffrante alors que quelqu'un dont lesang est xlxi/endormi, caillé, coagulé/tomberait facilement malade.Lorsque deux personnes ont un sang semblable wuli keren/sang uni, cequi ne signifie pas qu'elles soient de même parenté, la maladie se transmettrait plus facilement de l'une à l'autre. Cette notion citée par deuxguérisseurs est dérivée, semble-t-il, de celle de groupe sanguin.
23 XaliyanYI se déclare chez la femme enceinte et provoque des douleurs,une hémorragie gravidique ou un avortement. Cette maladie est représentée sous la forme d'un être vivant se déplaçant dans tout l'abdomenet qui attaquerait le fœtus. Cette représentation se retrouve aussi dansd'autres maladies abdominales digestives.
24 Il eXIste plusieurs mots en soso pour désigner les crachats: dè ye/eau dela bouche/ est l'expression générale pour la salive et les crachats, dèlmgl est une salive visqueuse, lanxi renvoie aux mucosités qui sortentde la gorge, dèxunfe mdique une salive mousseuse.
110 Les maladies de passage
nafario maladie digestive, seso la folie. Si la nourrice marchesous un chaud soleil, son lait devient très clair et se décantexinè xunma doxo ; le nourrisson qui boit ce lait très clairsouffrira de vomissement et de diarrhée.
L'exsudat qui suinte des pustules est pathogène.Toucher ce liquide corrompu boro/pourri/, communiquemakuru (éruption cutanée bulleuse de l'enfant), la varicellebOnbOrosi25 ou la lèpre selon les cas.
La rétention des humeurs est pathogène
Seraient nocifs, nous l'avons déjà mentionné, lesliquides physiologiques qui stagnent dans l'organisme ets'accumulent au lieu d'être évacués.
La nourrice qui retarde pour allaiter son enfant verrason lait se dégrader. L'abstinence sexuelle de l'homme gâtele liquide séminal.
Certains guérisseurs expriment l'idée que tout liquidephysiologique (menstrues, lait maternel, urine, sperme) quine s'évacue pas complètement engendre la maladie; car nonseulement il stagne, mais aussi il peut suivre un circuitanormal dans le corps qui perturbe le cycle naturel desautres humeurs.
La rencontre de deux humeurs est source de morbidité
La rencontre de deux liquides organiques qui normalement ne doivent pas être en contact serait pathogène. Il s'agitdans certains cas de deux humeurs d'une même personne.
Ainsi une nourrice qui après l'accouchement n'allaitepas son enfant voit le mélange dans le sein du lait et dusang non évacué de l'accouchement. Chez un jeune homme,des rapports sexuels précoces ou trop fréquents produisentun mélange de sang et de sperme ce qui cause une infection chez sa partenaire et parfois entraîne sa propre
25 Bonborosi désigne diverses éruptions cutanées sous forme de pustulesdont la varicelle et la vanole. Pour la varicelle existe aussI l'appellatIOnfundenYllfonio.
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 111
mort26. Lors des infections uro-génitales l'urine mélangée àdu sang est considérée comme une source de contamination.
S'il s'agit du contact de liquides organiques de deuxpersonnes différentes la maladie naît de la rencontre de cesdeux humeurs semblables même si chaque individu est sain.Tel est le cas du contact entre le sperme et le sang menstruel. Des rapports sexuels avant la fin des menstrues bloquent leur évacuation et génèrent l'infection chez l'homme etchez la femme. Un enfant conçu dans ces conditions seraitlépreux. Le liquide séminal est assimilé au sang de l'homme,il s'agit d'un sang clair alors que le sang menstruel est noiret assimilé à la saleté noxè. Les relations sexuelles d'unefemme enceinte avec un autre homme que le père de sonenfant provoquent un avortement par le mélange desliquides séminaux de deux hommes dans le même utérus caril y a incompatibilité entre deux sangs d'origine différente.
Lors des relations sexuelles de la nourrice, le spermeatteint le sein qui grossit. Il se produit une accumulation etun mélange anormal de liquides qui rendent l'enfant malade(diarrhée, amaigrissement)27.
Selon Françoise Héritier (1979, 1984) la rencontre desfluides vitaux (sang, lait, sperme) serait pathogène car elleprovoquerait un excès de chaleur: l'homme, dans les sociétésafricaines, est représenté comme un être naturellementchaud par opposition à la femme dont la nature est d'êtrefroide car elle perd périodiquement son sang. La femmeconnaît des périodes d'intense chaleur quand elle n'est pas
26 Le guérisseur Mamadou Gbessia Camara de Sikhourou qui développecette représentation se réfère à une conception Islamique selon laquellele sperme viendrait de la moelle osseuse sora qui, elle-même, viendraItdu sang. Le mouvement excessif des os du bassin gungl mettrait le sangen contact avec le hquide séminal car la moelle chez l'homme jeunen'est pas" mûne " kooxo, elle n'est pas achevée kamali.
27 L'expression utilisée à Kaback mais aussi dans d'autres secteurs sosoest dl ma kana, l'enfant est gâté, gaspillé. A Khanbaya on utilise avechumour l'expression dl ma dangi l'enfant est dépassé. Le bébé, habituellement couché devant sa mère, est placé dans son dos le tempsqu'elle ait un rapport sexuel avec son mari. La solution préconisée estde s'abstenir jusqu'au sevrage de l'enfant. Certains guérisseurs donnentdes remèdes pour que les parents puissent reprendre des relationssexuelles sans que la qualité du lait en soit affectée, ce qui révèle peutêtre une persistance des conceptions et un changement des pratiques.
112 Les maladies de passage
menstruée et que le corps féminin est représenté commeretenant le sang des menstrues: impuberté, grossesse, allaitement, ménopause. Les rapports sexuels pendant cespériodes doivent être interdits ou réglementés parce qu'ilsont pour effet de produire des accumulations de chaleur quiassèchent les flux vitaux.
L'alimentation est un vecteur de contamination
La représentation de l'alimentation comme vecteur decontamination est liée à celle d'un corps humain dont leventre est considéré comme un centre vital. Le mot {uridésigne le ventre et tous les organes qui s'y trouvent maisaussi l'état de grossesse. D'après les déclarations des guérisseurs, tous les organes de l'abdomen semblent communiquer.En rapport avec cette primauté accordée au ventre seremarque l'importance de la bouche et de l'ingestion. Lesmaladies sont parfois représentées comme des entitésvivantes qui se nourrissent dans notre ventre.
La nourriture en elle-même véhicule la maladie
Le paludisme et diverses autres maladies passeraientde la mère au fœtus par la nourriture et la boisson suivant laconception que l'enfant dans l'utérus se nourrit directementde l'alimentation maternelle.
En mangeant la viande d'un animal (mouton, chèvre,poule), malade ou mort de maladie, on attrape les symptômes ou la pathologie dont il fut porteur, telle la diarrhée, latoux, l'épilepsie, les hémorroïdes, l'hépatite. Cette conceptionde la transmission est liée à celle selon laquelle les mêmesmaladies affectent l'homme et l'animal.
Les aliments, dont l'aspect après mastication ressembleaux humeurs corporelles, sont en eux-mêmes pathogènes
Les aliments végétaux qui, mastiqués, sont trop semblables aux sécrétions du corps humain comme le riz blanc etcru, le manioc cru ou la cola blanche sont déconseillés au
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 113
cours de l'allaitement car ils gâtent le lait maternel. Leurconsommation est interdite lors des infections urogénitalesde suxukuye ou korosila car elle alimenterait les écoulements blanchâtres provoqués par la maladie qui ne tariraient plus.
Les aliments et la boisson transmettent des saletés etdes parasites
Si les récipients, les aliments sont sales ou non recouverts, des saletés de natures diverses sont avalées en mêmetemps que la nourriture et la boisson. Cela risque d'occasionner des maux de ventre, le tétanos, la diarrhée, le choléra oules hémorroïdes manga faxè.
Par la nourriture ou la boisson, on peut ingérer desanimalcules nimase : kuli chenille, sundi ver intestinal,nyali ténia, bari, bae escargot, sori petit poisson, wandiwandi larves, invisibles ou peu visibles à l'œil nu mais qui grossissent dans le ventre et se nourrissent des aliments qui s'ytrouvent. Bari, parasite logé dans l'utérus, cause une stérilité en buvant le sang qui serait à l'origine de la formation del'enfant; ou bien il provoque un avortement en « mordant »,en « mangeant» le fœtus.
Fure na mixi naxan masotoma min yee ra, fa i nu arasansè, bae luuma a xunma nè. l nu na min, a findimafure nan na i furi kui. Bae xungba i furi kui, a nu i furixono, a nu a nèrè, fa e i apere.
La personne attrape la maladie en buvant l'eau, sauf situ la filtres, l'escargot se dépose. Si tu bois, il se trouveque la maladie est dans ton ventre. L'escargot grossitdans ton ventre, il te fait mal au ventre, il marche, excepté si on t'opère. (SC)
Les animaux domestiques (chien, chat, volailles) ouceux de l'environnement proche (souris, oiseau, margouillat,crapaud) souillent l'alimentation en la goûtant, par la saliveou en y déposant des déchets. L'animal transmet ainsi lesmaladies dont il est porteur, en particulier la toux, la tuberculose, l'asthme appelé siisa par analogie entre le ronronnement du chat et le siffiement de l'asthmatique, ou encore de
114 Les maladies de passage
violents troubles psychiques évoquant ceux que provoque larage. Si l'animal n'est pas malade, il contamine la personneen déposant dans la nourriture des saletés susceptibles decauser des pathologies fort diverses comme yanxi empoisonnement alimentaire, des troubles du foie, les hémorroïdes,une maladie des poumons, le tétanos, le paludisme, la maladie pédiatrique makuru (voir note 34).
Les insectes (cancrelat, mouche, araignée, fourmi,moustique) polluent la nourriture et la boisson en se posantdessus, en y goûtant, en y déposant leurs déchets. Ils occasionnent ainsi des maux de ventre, la diarrhée, la toux, lepaludisme. Les insectes sont des agents de contamination enparticulier en déposant un fragment des selles d'un hommemalade dans le plat d'un homme sain.
L'empoisonnement intentionnel est placé dans l'alimentation
Un empoisonnement volontaire se fi/chose donnée/placé dans la nourriture est responsable de ballonnements,de troubles digestifs pouvant entraîner la mort. La contamination est alors sélective et intentionnelle.
La chair humaine que des sorciers introduiraient dansla nourriture provoquerait des pathologies graves chez l'individu qui la consomme. Des présumés sorciers seraient parfois malades de leur propre sorcellerie, notamment lorsqu'ils« mangeraient» trop de chair humaine.
Le remède local est un des principaux vecteurs de contagion
Piétiner le macéré ou le décocté avec lequel le guérisseur a traité un malade ; toucher les feuilles d'un remède oumanger un riz médicamenteux sont des facteurs de transmission des affections. Le médicament traditionnel à base deplantes médicinales est contagieux comme si la maladie passait du soigné aux végétaux, puis de ceux-ci, à la personnesaine. Le remède capte la chaleur du malade et l'eau médicamenteuse est assimilée aux humeurs corporelles. Cette
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 115
conception se retrouve dans certaines cures28 , ainsi desdécoctions de couleur rouge assimilées au sang sont prescrites dans le traitement de l'aménorrhée (kike wali/lune/travail!) et de l'anémie (wuli nonyi rate /sang/fin/corps/ou wuli (ixè/sang/blanc/), des plantes à la sève laiteuse sontutilisées pour soigner les troubles de l'allaitement.
La représentation de la transmission de la maladie parle remède végétal est celle qui est la plus partagée par lespersonnes enquêtées29 . Il semble à travers les discours despraticiens et des populations que, grâce à Dieu, le maladedoit trouver « son » médicament30 à travers une relation personnalisée avec « son» guérisseur qui lui-même a obtenu larecette de « son» maître31 .
Foorè seri nun {oote seri keren mu ara, {oote seri, mixi{irin noma a tongode, wo birin yalan, fdorè seri tan a nuyayilan naxan xili a na na yalan ma.
Le médicament des Blancs et le médicament des Noirsne sont pas les mêmes; le médicament des Blancs, deuxpersonnes peuvent le prendre, elles guériront toutes, lemédicament des Noirs ne soigne que celui pour lequel ilest destiné. (AC)
La conception de la contamination par le remède nes'applique pas aux médicaments pharmaceutiques.
28 La guérisseuse Binta Sompare prescrit le décocté des feuilles de sirienou un macéré des feuilles de kode aux nourrices dont le lait n'est pasbon car la sève de ces plantes a un aspect laiteux. Elle administre ledécocté des fibres des écorces de xari pour lutter contre certains casd'anémie. Une entaille dans l'écorce du tronc laisse perler des gouttelettes rouges qui rappellent le sang.
29 Le remède comme vecteur de contagion est cité spontanément par46 guérisseurs sur 79 pour les maladies qu'ils traitent, ce mode decontagion est reconnu par les trois-quarts de la population des non guérisseurs (22 sur 29 personnes).
30 Seri désigne aussi bien le remède à base de plantes médicinales que lemédicament industrialisé, dans le premier cas on pourra parler de fOorèseri/médIcament des Noirs/ et dans le second de {oote senile médicament des Blancs/.
31 Cette conception concerne le médicament délivré par le guérisseur surlequel les incantatIons ont été prononcées et non pas les remèdes de lamédecine familiale utilisés sans incantation.
116 Les maladies de passage
L'enfant malade est lavé dans la cour de la concessionavec un décocté ou un macéré de plantes médicinales. Il esttrès difficile d'empêcher qu'un autre enfant ou que la mèred'un autre enfant de la même concession ne marche sur l'eaudu remède. Le piétinement inévitable du remède utiliséexpliquerait la prévalence et la contagion des maladiesinfantiles buri32 , takoe33 , makuru34 , xoroxo {ure/maladie quirend dur/tétanos, xoni/oiseau/kuye35 .
La contagion se manifeste d'un enfant malade à unenfant sain qui piétine l'eau du remède déjà utilisé mais ellepeut aussi transiter par la mère, lors de la grossesse ou aucours de l'allaitement. Par exemple, si une décoction ou unemacération de végétaux qui a servi à laver un enfant maladeest foulée par une nourrice, cette eau monte dans les seins decette dernière qui gonflent, le lait change de couleur, devientbleu et de goût amer et provoque vomissements et diarrhéeschez le nourrisson. Il semble y avoir osmose à travers lecorps de la mère, mélange et accumulation de liquides.
La transmission de certaines pathologies des adultescomme la jaunisse dannawali, les affections inflammatoiresprécédemment citées, divers troubles digestifs, des infectionsgynécologiques comme suxukuye, est également expliquée parle contact avec le remède ayant servi à traiter un autre malade.
32 Buri, maladie infantIle, se manifesteraIt par de la diarrhée verte, desvomIssements, un ballonnement abdominal, des œdèmes au vIsage etaux membres, de la pâleur, de la somnolence. (Dr Gbanacé et Dr KOlta1998:6-7)
33 Takoe est une maladie infantile caractérisée par des lésions buccales,déterminant par la suite de la diarrhée et des vomissements, le nonbattement de la fontanelle antérieure et une faiblesse du tonus du cou.(Dr Gbanace et Dr KOlta 1998:8)
34 La maladie infantile, makuru, se signale par des lésions bulleuses surla peau accompagnées ou non de diarrhée.
35 kuye/fétiche/ se manifeste par des crises convulsives, une projection dela tète en arrière avec une révulsion des yeux, une salive mousseuse, untrismus. Il existe plusieurs noms de maladies en 8080 pour expnmer lescrises convulsives du nourrisson. Il n'y a pas de différences nosologiques précises entre les différents termes: kuye, XMl!, lintanydsebalancer, rôder, tourner/(désigne par euphémisme l'oiseau responsablede la maladie XOnl), kule singe, naralaxunyi/attraper les choses de lanature/(cette expression évoque de manière allusive le singe). La diversité de ces expreSSIOns serait à mettre en relation avec la prévalence etla gravité de différentes crises convulsives chez le nourrisson.
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 117
Les plantes médicinales préparées en kuye ou grigri,par la volonté de certaines personnes contamineraientintentionnellement les voleurs. Le kuye est réalisé avec lesmêmes végétaux et les incantations qui servent à confectionner le remède. Il est placé par le cultivateur dans sonchamp de riz, de patates, de manioc ou dans sa plantation.Si un voleur piétine le remède, il attrape la maladie correspondante. Ces affections sont de nature à perturber le travail d'un cultivateur: xori xonè douleurs osseuses, berafèdouleur articulaire à l'épaule, lengedi inflammation localisée.
Les agents atmosphériques, le vent, la chaleur, sont des diffuseurs de maladies
Les agents atmosphériques aident à penser les picssaisonniers de morbidité et la propagation des épidémies.
Les Susu ont remarqué qu'au début de l'hivernage survient une recrudescence de paludisme. D'autre part, lesmaladies infantiles comme la varicelle, la rougeole frappentun grand nombre d'enfants à certains moments de l'année.Ils expliquent cela par le vent et la chaleur. Il y a souventconjonction du vent et de la chaleur comme véhicules decontamination.
Le vent est un véhicule de maladies
Les maladies telles que fula kooka le paludisme, dannawali la jaunisse, fundenyi la varicelle ou tèntènyi la rougeole seraient transportées par le vent. Une certaine ambiguïté subsiste sur l'origine même de la maladie sauf dans lecas du vent froid où celui-ci pénètre dans les narines et causele refroidissement xinbeli, le rhume, la toux.
Foye naxan kelima sogetide biri na nan fama bOnbOrosianun tèntènyi ra ,. na foye minima tunèbaganyi. Nu foyemini, tun doktorue minima e bOètii.
Le vent qui se lève de l'est fait venir la varicelle et larougeole; ce vent sort à la saison des pluies. Quand le
118 Les maladies de passage
vent sort, alors seulement les docteurs sortent pour vacciner36. (FB)
Wuganyi, Ala (oye nan na. Foye nan (aama (ure radannawali.
L'épidémie, c'est le vent de Dieu. Le vent fait venir lamaladie dannawali. (YB)
Dans la nosologie 8080, la maladie nommée (oye/ventJse manifeste par des œdèmes localisés ou généralisés. Pourcertains guérisseurs, son origine serait liée au vent.
Une pratique thérapeutique très répandue à Kabackconsiste à masser le patient pour concentrer le mal en unendroit du corps; la maladie passerait ensuite dans lesmains du masseur qui souffle sur ses paumes dans le sensdu vent pour l'évacuer. Si une personne se trouve dans ladirection du vent elle pourrait attraper cette affection. Despathologies diverses peuvent se diffuser ainsi.
Nous n'avons pas réellement trouvé de conceptionolfactive de la contamination. Néanmoins la guérisseuseFatoumata Soumah précise que l'aire de préparation culinaire ne doit pas être proche de l'endroit où l'on jette les ordurespour éviter de respirer le gaz malodorant qui s'en dégage etqui ferait mal au cœur 80ndonyi 8uxuma/qui saisit le coeur/.Moussa Sylla, 38 ans, cultivateur, attribue l'épidémie de larougeole à l'odeur de l'amande de palmiste grillée éparpilléepar le vent.
Les personnes rencontrées mettent l'accent sur la prévalence et non sur la contagiosité des maladies épidémiques37 •
Les mauvais sorts kortè seraient envoyés par le vent.Des petits grains comparables à ceux du riz s'introduisentdans le corps de l'individu causant des troubles graves quivarient selon leur localisation: paralysie, cécité. La « saleté »
du sorcier korè noxè, jetée dans le vent, donne des derma-
36 Facinet Bangoura a été la seule personne rencontrée lors de cesenquêtes à mentionner les campagnes de vaccination; peut-être est-ce àcause de sa responsabilité de secrétaire du district.
37 Les termes génériques utilisés pour désigner les maladies qui attrapentun grand nombre de personnes à la fois sont wuganYI à Kaback et (lbaà Xanbaya.
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 119
toses, telle la gale kasi. La maladie naxè peut aussi êtretransmise par le vent. Les génies ninè se déplaceraient dansun vent chaud, parfois dans un tourbillon xirixiriZinyi. Larencontre avec ce mauvais vent foye naxi provoquerait desparalysies partielles ou totales, des troubles mentaux dus àla peur, ou l'épilepsie.
La chaleur diffuse les maladies
Le paludisme denbadimi qui entraîne de fortes fièvresserait causé par la chaleur qui se dégage de la terre à lasuite des premières pluies, au début de l'hivernage. La chaleur à la fin de la saison sèche apporterait la rougeole, lavaricelle, le rhume.
La chaleur est un thème dominant chez les sosa pourpenser la transmission des pathologies qu'il s'agisse de lachaleur corporelle wuyenga émanant des corps fiévreux ou dela chaleur atmosphérique saisonnière wuyenyi.
La chaleur de proximité diffusée par un rassemblement de sorciers est citée comme dangereuse. Nos interlocuteurs parlent dans ce contexte de wuyenyi, chaleur environnementale et non de wuyenga, chaleur corporelle.
Na karamixie wuyenyi maninèxinè aZa e nu tèè saa nawuyenyi tèè makinaxè. Xa i gbe gaZi, nan ra i faxamanè.Xa i gere mu ara, i xunti mixi fanyie ra a dandan. Na yirenana aZa kiraxunyi anu yire gbètèe naxan nu a rafan ama.
Cette chaleur des sorciers ressemble à celle d'ungrand feu de bois. Si c'est pour toi, tu mourras. Si ce n'estpas pour toi, tu te diriges chez les bonnes personnes (lesguérisseurs) elles te soigneront. C'est à un carrefour oudans n'importe quel autre lieu qui leur plaît. (ME)
La victime a peur, elle parle n'importe comment, soncorps devient lourd, elle souffre de maux de tête, de troublesde l'esprit; l'attaque peut être fatale.
Les menaces du monde invisible dessinent une géographie de la contagiosité assez vague : carrefours, marigots, basfonds, bosquets en relation avec certaines heures de la journée,crépuscule ou milieu de la journée, qui accroîtraient le risque.
120
Les comportements de prévention
Les maladies de passage
Il semblerait que, face à la multiplicité des risquesdécrits, la transmission des maladies soit très peu maîtrisable par l'homme qui s'en remet à Dieu, cause en premièreet en dernière instance de la santé et de la maladie. Dieu,dans la société susu islamisée, est l'explication de toutes lesinfortunes : épidémies, inégalité devant la maladie, originede la maladie ou seulement maillon inconnu d'une chaînecausale. Il est aussi la prévention infaillible. Les personnesévoquent sa Puissance Ala Mangaya, son Travail Ala Wali,sa Volonté Ala xa Maragiri, sa Protection Ala kantè. Dieuassure la fonction centrale de décideur et de régulateur.
La prévention populaire et le comportement social
La prévention n'est pas orientée exclusivement versl'entretien du corps. Elle concerne en premier lieu le comportement social. La conduite valorisée qu'il s'agisse du travail,de la sexualité, de l'alimentation est basée sur la mesure. Unmauvais comportement son naxi est un comportement excessif son ma dangixi/un comportement qui dépasse/injure, vol,faux témoignage, séduction de la femme d'autrui, qui exposeaux représailles humaines ou divines.
Dans le domaine des maladies sexuellement transmissibles, l'attitude de prévention préconisée est la maîtrise desoi i yètè suxu/tu attrapes toi-même/, il faut éviter les relations avec un partenaire que l'on sait malade.
Xa i bara a kolon (ure na a ma i makuya ra xan ayalan.
Si tu sais qu'il est malade tu t'éloignes jusqu'à ce qu'ilguérisse. (PS)
Pour les autres maladies, dont on admet la contagiosité par contact ou proximité nous avons observé certains évitements38 mais il faut admettre que les normes des relations
38 Dans un village frontalier, un ressortissant de Guinée Bissau, doncétranger au village, voit soudain son corps enfler. Lorsqu'il se lève pourpartir, les personnes présentes refusent de s'asseoir à la même place.
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 121
familiales et sociales vont à l'encontre d'une mise à l'écart39 :
repas dans le même plat, soins aux malades de la famille,visites aux malades de la parentèle et plus les symptômessemblent graves, plus les visites sont nombreuses. Les personnes interrogées insistent sur la nécessité d'approchermakorèra les malades, de s'occuper d'eux, de les soigner.Malgré un contact potentiel dangereux, il y a peu d'évitement des corps souffrants. Les relations sociales priment lesrisques de contamination. Outre les normes sociales, lessituations de pauvreté, le sous-équipement médical, lemanque de prise en charge des malades par la collectivitérendent indispensable la solidarité familiale.
La prévention populaire et le champ des pratiquesquotidiennes
Une attention est apportée dans la vie courante à l'origine du repas que l'on consomme afin d'éviter une contamination intentionnelle4o. Lorsque l'on veut honorer une personne, on lui envoie un plat cuisiné. Le mets peut ne pas êtreconsommé par le destinataire s'il n'a pas confiance dans lapersonne qui le lui a préparé.
Afin d'éviter l'apport de saletés par les insectes, lesplats et les jarres d'eau sont recouverts. Pour lutter contre lacontamination par l'eau, les populations insistent sur lanécessité de boire de l'eau claire tinse et de laisser décanterl'eau prélevée au marigot ou dans les puits traditionnelsavant de la verser dans le canari et de la consommer. L'idéeest qu'une eau claire est une eau potable. Cette décantationest effectivement pratiquée.
39 Le fils de Mbalia a deux ans. Il vit dans la concession avec un oncle âgé,soupçonné d'être atteint de tuberculose, qui ne prend aucun traitement.Le repas de l'oncle est servi à part. Malgré les interdictions de la famille, le garçonnet persiste à partager le repas du vieillard. Devant l'msistance de l'enfant, la famille a cédé.
40 Salif, 28 ans, rencontré le 10/12/94 chez un guérisseur à Conakry,souffre, d'après le médecin de l'hôpital, d'une sévère gastrite. Il déclarequ'il ne peut pas SUIvre de régime, sauf si le guérisseur lui donne untraitement préventif contre l'empoisonnement, car il est plus faciled'être empoisonné si l'on prend un repas particulier que si le repas estcollectif.
122 Les maladies de passage
Les risques de contamination à la douche semblentpris en compte par le port de chaussures en plastique etl'évacuation des eaux usées. Certains traitements par lavagecorporel se déroulent en dehors de l'enclos de toilette, àl'écart de la concession, en veillant à l'infiltration des eauxpar creusement d'un trou dans le sol afin d'éviter la contagion par le foulage du remède.
Pour éviter les risques de récidive ou de contagion liésau remède le patient - ou un membre de sa famille - aprèsguérison est censé rapporter le reste du produit au guérisseur avec une ou plusieurs colas, un poulet, le prix de la cures'il n'a pas été donné. Lorsqu'il n'y a pas règlement du traitement, la maladie retournerait sur le patient, sur une personne saine de l'entourage ou sur le guérisseur.
Na kola non {indima barasira wonun (ure fagi.
La cola est une barrière entre vous et la maladie. (BC)
Cet acte de retourner le remède après usage au soi-gnant a une expression spécifique en soso : seri malisan/asperger, arroser/. Le mot malisan est surtout utilisé àKaback, il est connu à Boffa mais les gens se servent plusvolontiers de l'expression seri fi, raccompagner le médicament. Le thérapeute accomplit un rituel destiné à éviter lapropagation de la maladie41. Au cas où le patient ne tiendraitpas ses engagements vis-à-vis du guérisseur, certains signalent la possibilité que ce dernier brûle intentionnellementune partie des végétaux du remède, qu'il aurait mis de côté,pour que le mal retourne sur son client ingrat.
Ces croyances et ces pratiques sont un moyen de pression du guérisseur sur le malade et sa famille pour assurersa rémunération. La coutume de rapporter le reste du remède au soignant se perd. Le règlement de la cure a lieu de plusen plus fréquemment avant la délivrance du remède et si le
41 Voici le rituel tel que nous l'a décrit la guérisseuse Yaliyah Soumah deKaback. La guénsseuse plonge trois ou quatre pétioles de feuilles demanioc dans le reste du remède rapporté par le malade guéri. Lesfeuilles de mamoc neutralIseraient raxatl le remède, elles en seraientl'interdIt yele. Lorsque son client tourne le dos au moment du départ,elle l'asperge de l'eau du remède en invoquant son maitre dans uneincantation klnsl, pUIS elle va enfouir le résidu au bord d'un marigot,au pIed d'un kolatier, palmIer ou bananier.
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 123
paiement ne se fait pas, tout un jeu de négociations se meten place dans le cadre de relations de proximité.
Peu de gens affirment « raccompagner le médicament »
chez le guérisseur: soit ils ne croient pas au risque présupposé, soit le remède est d'accès facile. Le malade, ou unmembre de sa famille, déclare se débarrasser lui-même durésidu de végétaux dans un endroit peu accessible, au bordd'un marigot, au pied d'un arbre, généralement dans un lieufrais pour que, par analogie, le corps guéri reste frais et quela maladie ne retourne pas sur le malade. Cette pratiquetémoigne que la croyance dans la contamination par le remède utilisé reste néanmoins vivace.
1 saa na seri saama wuri ka xure dè nè alako nan xinbeli xa nu teera, i nu a saa yire sogetiima a ma yire naxè,(ure gbilenma i xa dii f6xora, abadan a xa (ate ganyi.
Tu dois envoyer le médicament au pied d'un arbre ou àun marigot pour faire monter la fraîcheur, si tu mets ausoleil, la maladie va se retourner sur ton enfant, son corpssera toujours chaud. (FS)
La prévention populaire et l'entretien du corps
L'entretien du corps est préconisé. Il faut prendre soinde soi mèèni. La propreté fèntènyi ou sèniyènyi du corps, deshabits, du lit, de la concession, de la nourriture éloigne lamaladie. A l'opposé, la malpropreté yuxa rend le corps lourd,abattu, somnolent et toujours malade. Ces normes de propreté semblent très diversement suivies dans la réalité.
Les risques multiples de la transmission de la maladierenvoient à des soins préventifs populaires très répandus.Les guérisseurs, mais aussi les non-guérisseurs, pensentqu'on doit se préparer i yètè yayilan contre la maladie.Chaque fois qu'une maladie sévit dans l'entourage, que lapersonne craint d'être malade, qu'elle « doute» de soncorps42, elle prend des plantes médicinales.
42 Deux verbes sont utilisés sogi : apercevoir, veiller, douter et sikè quiSIgnifie hésIter, balancer.
124 Les maladies de passage
Alan mixi xa i dandan sanun i xa {ure, nahi i mu nèèmu ma seri {e a ma. Xa {ure seri li mixi rate hui, a mu irayèrèbi ma.
n faut se soigner avant de tomber malade, pour cela tun'oublies pas l'affaire de médicament. Si la maladie trouve le médicament dans le corps, elle ne te fera pas souffrir. (MT)
l seri doxoè moli birin nan baama {ure mu nu i li tèmuinaxè tèmunde, i banma seri ma naxan i ratangama {urema.
Tu cherches toutes sortes de médicaments car tu nesais pas la maladie que tu rencontres, tu enlèves le médicament qui te préservera de la maladie. (KS)
Il ne s'agit pas là seulement d'une recommandationmais de pratiques réelles observées dans les concessionsfamiliales : automédication, potions familiales, remèdes desguérisseurs utilisés, pour les autres, mais aussi pour euxmêmes43•
La femme, par le sang menstruel, par celui des lochies,par le lait, est une source potentielle de contamination.Aussi, au cours de la grossesse et après l'accouchement, estelle soumise à de multiples mesures préventives : macérés,décoctions, talismans. Le nouveau-né boit des remèdes végétaux, porte des grigris dès la naissance, est lavé avec un lasimaami, eau du lavage des versets coraniques écrits sur uneplanchette en bois.
Les remèdes préventifs, comme les remèdes curatifs,basent leur effet sur la « porosité» du corps. Les patients selavent avec des macérations, des décoetés de végétaux, deslasimaami.
43 La guérisseuse Binta Sompare bOIt réguhèrement au petIt déjeuner unedécoction de plantes médicinales qu'elle considère comme fortifiante, quiprévient diverses maladies et empêche celles qui « sommeillent» dans leventre de « se réveiller» telles {oye et sumo. Elle partage ce « thé» avecles visiteurs apparemment bien portants. Les feuilles qui entrent dansla composition de ce petit-déjeuner sont par exemple: hmde xelmyi, dundaxè Nauclea latifolia, {utètè Allophyllus africanus, kobera {ixèTerminalia alblda, limbl Combretum gnalense, mèklO Crossopteryxfebrifuga, mènè Lophira alata, mèxèmèxènyi Craterispermum laurinum,tolmYl Bndeha micrantha, /l'obe smè Acacia albida ...
Conceptions populaires 5050 de la transmission des maladies 125
l yètè yailanxi {ure mu i suxuma. l rate ninxi. l maxalasimaami ra anun wuri.
Tu te prépares pour que la maladie ne t'attrape pas.Tu « cuis » ton corps. Tu te laves avec des lasimaami etdes plantes. (TB)
L'expression mixi xonè/personne/amère/ désigne unindividu qui s'est ainsi protégé, « cuirassé » contre les mauvais sorts. Les cordelettes tafOè, nouées au cou, aux reins, lestalismans écrits sèbè et insérés dans un étui en cuir agissentpréventivement par contact direct avec le corps. Le portd'une chemise sans manche en tissu traditionnel kasi donmaque l'on met sous le vêtement, sèrèxè donma/ chemise sacrifice/ chargée d'assurer la protection et le succès du porteurparticipe aussi de cette prophylaxie par le contact.
L'importance accordée au ventre et à l'ingestion seretrouve dans les remèdes préventifs qui sont essentiellement ingérés. La personne consomme un riz cuit dans unedécoction d'écorce, de racine et/ou boit un décocté ou macéréde feuilles. L'eau lustrale du lasimaami est souvent bue,telle quelle ou ajoutée aux décoctions. Les traitements préventifs et curatifs sont très souvent laxatifs et diurétiquespour « nettoyer » le ventre des saletés qui y stagnent. Aprèsla délivrance, la parturiente kuuye nettoie son ventre par desrepas médicamenteux et purifie son lait en buvant des décoctions44. Il s'agit de remèdes préventifs familiaux préparéspar les femmes les plus expérimentées de la concession : coépouse, belle-sœur, belle-mère.
44 Dans la concession où nous étions hébergée à Kaback, Adama venaitd'accoucher. Le premier jour elle a bu une décoction de feuilles de mokè,DIalium guineensls pour purifier le lait. Quatre jours après l'accouchement elle a commencé à consommer du riz et une sauce préparée avecle décocté de l'herbe kale Rottbelha exaltata qui enlèverait le sang deslochies, nettoierait les saletés du ventre par les selles et cela pendanthuit jours. Ces repas médicamenteux se poursuivront pendant quarantejours en alternant kale, solonyi Imperata cylindrica et éventuellementd'autres plantes pour contrôler l'effet laxatif des remèdes.
126
Conclusion
Les maladies de passage
Dans le tableau que nous avons dressé des conceptionsde la transmission des maladies deux notions sont récurrentes, celle de chaleur fura et celle de saletés noxè. Ellessont mobilisées alternativement ou conjointement. On lesretrouve aussi bien lors de la transmission d'une pathologied'un malade à une personne saine, que lors d'une contamination par l'environnement, aussi bien dans les cas de contagion qui atteignent indifféremment tout le monde que dansceux de contamination intentionnelle.
La mise en contact est dangereuse à cause de la similitude entre l'homme et l'environnement. L'analogie de l'eaudes remèdes et des humeurs corporelles peut provoquer dansle corps humain une accumulation et un mélange de liquidesincompatibles. L'animal est porteur des mêmes maladies quel'homme. La consommation de certains aliments notammentle manioc ou la cola blanche est proscrite dans des casd'infection uro-génitale car leur mastication donne un liquidesemblable aux sécrétions pathogènes. Les victimes privilégiées des sorciers et des génies sont celles qui, ayant des pouvoirs occultes45 , seront plus exposées aux attaques du mondeinvisible par leur appartenance aux deux univers. C'est àcause de leur similitude que le contact symbolique du sperme, du lait, du sang est pathogène.
Les insectes contaminent la nourriture en mettant encontact ce qui relève de l'ingestion et ce qui relève de l'excrétion. La polarisation de la main gauche et de la main droiteque Marguerite Dupire évoque chez les Sereer ndut (1994 :59), et que nous retrouvons dans les sociétés africaines islamisées, permet d'éviter le contact entre l'ingestion et l'excrétion.
La représentation du corps dominante qui sous-tendles conceptions de la contamination et les pratiques préventives populaires est celle d'un corps humain poreux.
Il est nécessaire d'installer des limites en compartimentant les espaces et en renforçant la protection de la peau parles remèdes, les talismans, pour qu'elle soit moins perméable.
45 L'expression utilisée pour désigner les individus ayant un don dedouble vue est ya kanYlile proprIétaire de l'œil!.
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 127
« Un bon équilibre des contraires est nécessaire à l'harmonie du monde, de l'individu, de l'ordre social» CF.Héritier1979: 233).
La santé chez les Susu passe par un équilibre entrenoxè la saleté et fèntènyi, sèniyenyi la propreté ou tinse lapureté d'un liquide, entre binya être lourd et yelebu46 êtreléger, entre tura/avoir chaud! et xinbeli/être humide, êtrefrais/47 .
En ce qui concerne la prévention biomédicale, certaines conceptions populaires de la transmission de la maladie ne lui laissent aucune place et semblent même la contrarier. D'autres, au contraire, pourraient favoriser certainespratiques de santé publique. Ainsi la conception qui attribueà la chaleur se dégageant de la terre lors des premièrespluies la propagation du paludisme risque de ne pas favoriser le recours à la moustiquaire. A l'inverse, la représentation populaire de la transmission de la gale kasi par contactdirect ou par le linge favorise la compréhension par les populations des messages sanitaires diffusés par les personnelsde santé.
Opinions traditionnelles et nouvelles se côtoient ets'éprouvent au contact des réalités. Ainsi les habitants desvillages de Kaback et Khanbaya puisent l'eau des puits traditionnels ou du marigot qu'ils décantent et ils délaissent lesforages récents. La plupart des opinions formulées concordent avec la tradition. L'eau de boisson est source de contamination, mais du moment qu'elle est claire, elle est bonne.L'eau du puits a meilleur goût que celle du forage, sa qualitéest donc meilleure, et d'ailleurs nous avons grandi en buvantcette eau. Quelques habitants ont adopté une opinion nouvelle sous l'influence des messages sanitaires : l'eau du forageest meilleure pour la santé. Parmi eux, certains vont effectivement pomper l'eau du forage, les autres font valoir lescontraintes qui les font continuer à boire l'eau des puits tra-
46 La sensation de maladie est souvent associée à la lourdeur binya maisd'un autre côté une personne trop légère est vulnérable à la maladie.Une maladie passe d'autant plus facIlement d'un malade à une personne saine que cette dernière est nègi mayelefu mixi !personne à la respIration légère!.
47 Xinbeli évoque la fraîcheur et la santé mais aussi le refrOidissement.
128 Les maladies de passage
ditionnels ou du marigot: la pompe du forage est souvent enpanne, nous n'avons pas d'argent pour la faire réparer, leforage est trop éloigné du village.
Le contexte sanitaire, les épidémies, la réponse médicale apportée, les campagnes d'éducation sanitaire influent,semble-t-il, plus sur les pratiques préventives que sur lesreprésentations de la maladie. Kaback a connu une épidémiede choléra en 1995. Aussi, certains habitants de l'île ne secontentent-ils pas de laisser décanter les saletés de l'eau puisée dans les puits traditionnels mais ils la filtrent avec unlinge et versent de l'alcool de menthe dans le canari sanspourtant connaître le mode de contagion du choléra. Ils ontadapté le message sanitaire à leurs possibilités car il n'y aplus de distribution de produits pour désinfecter l'eau commeau moment de l'épidémie.
L'attitude préventive vis-à-vis des remèdes populairesse retrouve en médecine moderne.
1 sigama labitani sali i yalanxi. 1 mu i mato, i noma akolonde nè {ure naxan a xunsaxi i ma. Dokturu na seri sooi yira. Na lèèri i bara {ure yaa rasa.
Tu dois partir au centre de santé même si tu es bienportant. Tu vas faire une visite, tu peux connaître lamaladie qui vient sur toi. Le docteur fera entrer le médicament en toi. Le moment venu tu ignoreras la maladie.(FS)
Cette disposition peut favoriser, dans une certainemesure, une pratique biomédicale comme la fréquentationdes consultations pré et post-natales organisées dans lescentres de santé car il n'est pas incompatible pour les populations de cumuler pratiques préventives traditionnelles etbiomédicales.
Conceptions populaires soso de la transmission des maladies 129
Bibliographie
Bourdieu P.1980 Le sens pratique, Paris, Les Editions de Minuit.
Dupiré M.1994 " Contagion, contamination, atavisme ", in Sagesse sereer
Essais sur la pensée sereer ndut, Paris, Karthala.
Gbanace P., Koïta Y.1998 Lexique soussou des principales maladies en médecine
traditionnelle, Conakry, Ministère de la Santé Publique,Division de la Médecine traditionnelle.
Héritier F.1979 « Symbolique de l'inceste et de sa prohibition », in
M.Izard, P.Smith (éd.), La fonction symbolique, Paris,Gallimard.
Héritier F.1984 « Stérilité, aridité, sécheresse: quelques invariants de la
pensée symbolique ", in Le sens du mal sous la directionde M. Augé et C. Herzlich, Paris, Edition des Archivescontemporaines: 123-154.
Poloni A.1990 " Des pratiques de propreté dans les secteurs périphé
riques de Ouagadougou >', in D. Fassin & Y. Jaffré (éds.),Sociétés, développement et santé, Paris, Ellipses.
Chapitre 5
Modes de transmission de la maladieen milieu songhay-zarma (Niger)
Adamou Moumouni
Pour décrire la transmission d'une maladie, le parlerpopulaire utilise différentes expressions qui emploient desverbes d'action dont le sens révèle le rapport de l'individu àla maladie: di yan (attraper), sambuyan (prendre), tan yan(lâcher), et dan yan (mettre). Si en français l'expression « J'aiattrapé une maladie» est d'un usage courant, par contre enlangue zarma c'est la maladie qui est active et qui attrape.L'individu en devient par conséquent la victime. Un chef devillage déclare avec humour: « dans notre façon de parler,nous disons par exemple: le rhume (hungum) m'a attrapé ».
Ce n'est pas la personne qui attrape la maladie, mais c'est lamaladie qui l'attrape, et non le contraire. Si chacun avait lapossibilité d'attraper une maladie, personne ne souhaiteraitle faire. Une maladie n'est pas un objet d'amusement ».
D'autres expressions sont d'usage courant en languezarma. « J'ai pris la maladie d'untel» (ay na filaana doorosambu) , « il m'a mis sa maladie» (a na nga dooro dan ay ga)sont généralement utilisées dans les interactions sociales poursignifier le passage d'une maladie d'une personne à une autre.
Le fait de dire que « K m'a mis sa maladie» n'est passynonyme d'une action volontaire et malveillante de sa part.Fort simplement, et sans qu'on puisse en déduire une interprétation persécutive, c'est signifier que la maladie est arrivée par son intermédiaire. Cela n'exclut pas que dans des cas
132 Les maladies de passage
bien précis, et souvent dans des contextes familiaux ou deproximité sociale, cette notion récurrente de maladie « prise»chez quelqu'un puisse parfois s'orienter vers une suspicion desorcellerie. Par ailleurs, sans qu'il s'agisse directementd'accusation de sorcellerie, des chefs de village nous ont relaté qu'autrefois des individus, repérés pour avoir introduitune maladie dans le village, étaient violemment molestés oudevenaient le sujet de chants de réprobation. Ces formes deviolences sociales peuvent, en grande partie, s'expliquer parle manque de moyens matériels permettant à ces sociétés defaire face aux effets dévastateurs des épidémies cycliques.
Celles-ci étaient autrefois fréquentes. Dans son ouvrage consacré aux épidémies pendant la période coloniale, Bado(1996) en donne plusieurs exemples dont la mémoire collective garde aujourd'hui encore les traces. Nos propres enquêtes,en pays zarma (région du Boboy), attestent de la crainte queces épidémies représentaient. L'épidémie de variole dénommée karanti, a désigné, par la suite la méningite. Selondiverses personnes interrogées, l'origine du mot proviendraitde la déformation du mot français « quarantaine » caractérisant une pratique préventive mise en vigueur par les médecins coloniaux. Ainsi, nous a-t-on expliqué:
Aux temps où c'étaient les blancs qui commandaient,quand une épidémie se déclarait, le chef de village ou decanton était tenu d'en informer immédiatement le cercle.Le corps médical était généralement constitué de médecins (looktoroJ blancs accompagnés parfois de quelquesnoirs. Les missions se faisaient à dos de cheval. Quand ilsarrivaient dans un village où sévissait la maladie, ilsétaient logés dans une maison construite à leur intentionpar le chef de village. Mais les consultations avaient lieusur une grande place. Tout le village était vacciné, et lesmalades étaient gardés dans un camp séparé du village.Interdiction était faite aux personnes saines d'aller leurrendre visite. Les « accompagnants » n'avaient pas nonplus le droit de quitter le camp pour éviter de contaminerles autres. On leur déposait au sol la nourriture qu'ilsvenaient prendre de l'autre côté de la route. Tout étaitorganisé de sorte que la maladie ne se propage pas. C'estcette méthode qu'on appelait karanti.
Modes de transmission de la maladie en milieu songhay-zarma 133
Le mot est donc né à cette époque. Et chaque fois qu'ily avait une maladie nouvelle qui exigeait la même organisation, les gens disaient « karanti ". La maladie contagieuseprit ensuite elle même ce nom comme l'atteste la récente épidémie de méningite, déclarée en avril 1995 au Boboy et dansbeaucoup d'autres régions du Niger. Quelques personnesinterrogées réservent cependant ce mot à la variole quiimpressionnait par sa virulence et les stigmates qu'elle laissait sur le visage.
Selon les marabouts, le terme de karanti doit se comprendre en fonction de la notion arabe de tahun. Ainsi, touteépidémie répondrait à cette nomination. L'un d'entre euxnous explique que « le Coran nous enseigne qu'il y a desmaladies en provenance du Sahara qui se propagent dans lespays sous la pression du vent. Ces maladies sont des tahun,et des karanti pour les zarma ».
Transmission par les liquides corporels
Du point de vue du sens commun, il y a convergenced'opinions sur les conditions de transmission des maladies.En général, on retient le sang comme principal « vecteur ".La notion d'une transmission par le sang se fonde sur l'idéeque tel ou tel sang peut « appeler " telle ou telle maladie.Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut nécessairement unedeuxième condition: que la personne soit prédestinée à cettemaladie : « Si tu es victime d'une maladie contagieuse, lesgens disent que c'est ton sang qui lui a fait appel - a heen ase (lit. le sang pleure pour elle) - ou que c'est son destin ",déclare un herboriste. Une mère de famille, à son tour,explique: « quand l'épidémie de rougeole s'est déclarée dansnotre village, j'avais très peur pour mes enfants, et je leur aifait des charmes protecteurs. Néanmoins la maladie s'estdéclarée chez le dernier-né dont le sang a fait appel et c'est ledestin. Ce sont les deux choses que nous disons à proposd'une maladie contagieuse» .
Soulignons que ces deux principes explicatifs sont loind'exclure une idée de prévention. En effet, on pourrait croireque le fait que la transmission d'une maladie contagieuse
134 Les maladies de passage
soit déterminée par le sang et le destin, écarte en quelquesorte, toute idée d'un possible évitement et provoque un comportement fataliste. Tel n'est pas le cas, et les populationspratiquent bel et bien des mesures préventives devant unrisque de contagion.
Ces pratiques prophylactiques sont diverses. Commel'atteste un ancien du village de Banizoubou, « en cas demaladies épidémiques, il y a des pratiques préventives collectives et individuelles qui sont faites. Certaines personnesvont voir des marabouts, d'autres des zimas (responsable desgénies). Chacun s'organise comme il l'entend. Mais le maln'attrape que les gens dont le sang a fait appel ".
Dès lors, quelle relation établir entre cette idéed'« appel du sang » et la notion de vulnérabilité puisque cesexpressions sont presque synonymes? En fait, ces conceptions sous-entendent l'incapacité du sang à empêcher unemanifestation morbide, et se fondent sur des notions distinguant un « sang fort" d'un « sang faible ". Selon son caractère, le sang protège ou expose l'être humain à la maladie. Ence sens, tomber malade entraîne à s'interroger sur la qualitédu sang. « Les êtres humains se distinguent selon la qualitéde leur sang. Ceux qui ont un sang fort tombent rarementmalades contrairement à ceux qui ont le sang faible. Quandquelqu'un est malade, on dit parfois que son sang est faible ".
Dans les conceptions locales, le sang est défini commela substance qui maintient le fonctionnement de la vie dansle corps. C'est également lui qui alimente le corps grâce auxvaisseaux (kaaji). Sa composition et sa texture sont des indicateurs de morbidité ou de bonne santé.
Ces représentations sont fréquentes en Afrique del'Ouest. Elles ne varient que sur quelques points. Ainsi, là oùles Lobi dénombraient trois catégories de sang en fonction dela couleur (Cros, 1990), les songhay-zarma parient plutôt dedeux types de sang: le sang noir (kuri bi) et le sang rouge(kuri cirey). Le sang noir (kuri bi) est considéré comme étantde mauvaise qualité (a si bori), il est chaud (a ga dungu) etentraîne une mauvaise circulation à l'intérieur du corps (a siwindi gahamo ra). C'est un signe de maladie qu'il faut extirper du corps par la technique de la saignée ou des ventouses
Modes de transmission de la maladie en milieu songhay-zarma 135
(hilli). Cet excès de sang dans le corps, souvent évoqué pourcaractériser certains états de mal-être, ferait que le sang se« lèverait » (tun yan) ou pourrait « s'éclater" (bogu yan).Cette idée est largement répandue dans la pensée populaire,comme l'atteste cet interlocuteur: « Parfois tu sens des douleurs de partout, tu es fatigué, tu as toujours envie de dormir, ta tête te fait mal, tu as des céphalées. Quand tu enparles aux gens, ils disent que c'est le sang levé (kuri tunyan), et qu'il faut voir un barbier-inciseur qui va t'extirperune partie du sang ". Dans le même état d'esprit, les saignements doivent être pratiqués chez les individus disposantd'une quantité de sang supérieure à la normale.
A la question de savoir ce qui détermine la qualité dusang, les avis divergent. Ainsi un imam déclare que c'est« inné, parce qu'on ne choisit pas son sang, et qu'on naîtavec. C'est un élément du destin, et il est indépendant de lamorphologie physique. En ce sens il y a des gens maigres quiont du sang fort et en quantité, tout comme on trouve desgens gros avec un sang faible et insuffisant. C'est Dieu quiest à la base de tout. Tout se passe pendant la conception,l'être humain n'a donc aucune prise sur ce fait".
En revanche d'autres réfutent cet argument. Pour euxla qualité du sang est déterminée par la qualité de la nourriture consommée. A une mauvaise alimentation correspondun état de mal être régulier exposant le corps à tous lesrisques pathogènes. A contrario, une bonne alimentation estle gage d'une bonne santé. Dans le même ordre d'idées, oninsiste sur le caractère nourrissant, calorique et énergétiquede certains aliments. En particulier la viande. On lui confèrela capacité de produire et de purifier le liquide sanguin touten l'augmentant. Ne dit-on pas d'ailleurs que certainsmalaises (saignements réguliers du nez) sont consécutifs àun manque d'alimentation à base de viande? De même, dansles conceptions locales, l'image du bon chef de famille est trèslargement construite autour de la notion d'une personne quiremplit non seulement toutes les obligations envers sa famille, mais également qui l'alimente en viande.
Au-delà de son aspect diététique, la consommation deviande constitue, à bien des égards, une valeur socialementpositive. Comme l'affirme une jeune femme : « nous disons
136 Les maladies de passage
que le mari qui achète souvent de la viande pour accompagner la sauce de sa femme a de la valeur chez nous. C'estvraiment l'image du bon mari, il sait entretenir une famille ».
Pour en revenir au sang, celui-ci métaphorise aussi laparenté sociale. Il symbolise ainsi la relation agnatique queles gens appellent (kuri fa) par opposition à wa fa (lait commun) relatif à la parenté utérine.
Lorsqu'ils sont évoqués dans le contexte de la maladie,le lait et le sang conservent cette valence et sont alors considérés comme des vecteurs matériels de maladies véhiculéesen ligne maternelle par le biais du lait, et en ligne paternelleà travers le sang. Intervenant sur ce thème, un maraboutconfirme ainsi, bien qu'en complexifiant un peu ces notions,que la transmission des maladies héritées emprunte desvoies différentes. Il postule en effet que « si le père contamine ses enfants par le sang kuri, la mère, quant à elle, le faitpar le lait wa ». Dans le premier cas, tout le processus contaminant se passerait pendant l'accouplement entre le mari etsa femme, c'est-à-dire lorsque « leurs sangs se mélangent »1.
De nombreux traits de personnalité seraient ainsi transmispar le sang du père. Par contre, la sorcellerie anthropophagique se transmettrait par le lait.
Sans s'y limiter, les mécanismes de la transmissiondes maladies se focalisent aussi autour d'autres humeurscorporelles, et principalement le sperme et la sueur.
La contagion par le liquide séminal (manni) concernebien évidemment le large registre des maladies à transmission sexuelle, dénommées localement weybara daari signifiant littéralement: maladies de femmes. Cette dénomination qui paraît à priori stigmatisante, puisqu'elle sembledésigner uniquement la femme comme agent contaminantdans la relation sexuelle avec son partenaire, doit être interprétée avec prudence. En effet, les populations savent que latransmission peut se faire dans les deux sens: « c'est unemaladie que la femme peut transmettre à l'homme, et viceversa » précise, par exemple, un groupe de paysans.
1 Une difficulté d'interprétatlOn supplémentaire provient du fait quedans ce contexte, le terme de sang équivaut souvent au sperme mannz(mot provenant de la langue arabe).
Modes de transmission de la maladie en milieu songhay-zarma 137
Néanmoins, les discours construits autour des notions quirendent compte de la contamination par voie sexuelle tendent à désigner les femmes comme agents « contaminants "et les hommes comme sujets contaminés. Il en est ainsi, parexemple, de certaines maladies sexuelles, comme masar(éruption cutanée dans la sphère génitale féminine), qui sontimputées à la femme infidèle.
Ces notions populaires peuvent-elles être réappropriées dans le cadre de l'information et de l'éducation sanitaire, notamment en matière de lutte contre l'épidémie deSida? Il s'agirait, pourtant, de leur donner un nouveaucontenu, tendant à montrer la responsabilité de l'homme etde la femme en tant qu'agents co-responsables et tous deuxpotentiellement « contaminants ". Le lexique des éducateurssanitaires souligne, du reste, cette modification des conceptions, puisque l'expression « maladies de femmes ", évoquéedans le langage local pour globalement désigner les MST, estabandonnée au profit de « maladies que l'homme et la femmese transmettent ". Cette modification n'altère cependant enrien l'image négative projetée sur ces maladies qu'on pense,d'une manière générale, être la conséquence d'une inconduitesociale (adultère, multipartenariat). Pour cette raison, etsurtout dans les milieux villageois, les traitements relèventtoujours de la confidentialité . « Les gens viennent me voirpour des cas de maladies de femmes parce qu'ils savent queje suis discret" confie ainsi un guérisseur.
Un autre « liquide corporel ", la sueur (sungay) , estaussi fréquemment désigné comme pouvant transmettre desmaladies. Conçue comme provenant de la respiration ducorps (gaham fulanzam), la sueur est considérée comme unpuissant vecteur de contagion. Dans certains cas, la contamination peut être directe; dans d'autres cas, elle est indirecte,par exemple, par l'échange d'habits, ou par le fait de dormirdans le lit d'un malade. C'est la raison pour laquelle, on procède à la destruction par le feu des habits ou des draps d'unmort, en particulier lorsqu'il s'agit d'un tuberculeux ou d'unlépreux.
138 Les maladies de passage
Quelques autres modes de transmissions
A côté de ces formes de transmission par humeurs corporelles, il en existe d'autres qui procèdent de relations interpersonnelles quotidiennes notamment à l'occasion d'un enjambement (daaru yan) ou du croisement de regard (guna yan).
Le fait d'enjamber une personne ou un espace à risqueest susceptible de conséquences pathogènes. En effet, lesreprésentations en matière d'espace distinguent dans l'environnement social et géographique différentes catégoriesd'espaces, certains étant vécus comme dangereux. A cetégard, les personnes interrogées déclarent que l'épilepsie (ouce qui est considéré comme l'épilepsie) peut être causée parun enjambement là où un malade a fait sa crise. Interrogésur la question de savoir comment la contamination s'opère,un guérisseur spécialisé sur cette épilepsie précise: « l'épilepsie est une maladie de génie transmissible, qu'on peutattraper au contact du lieu de la crise. Lorsque la maladie sedéclenche, le malade tombe, il est dans un état d'inconscience, il ne sait plus ce qu'il fait, il se débat de tous les côtés, ilbave, son regard est fixe comme s'il apercevait quelquechose. En réalité oui, c'est le génie qu'il regarde. La crise setermine par des selles ou des urines contenant les germes dela contamination ». Pour un autre spécialiste encore, lesmanifestations de la crise diffèrent mais le potentiel contaminant demeure le même. Aussi pour prévenir le risque detransmission, on brûle le lieu où la crise s'est produite, afin,dit-on, de neutraliser les éléments déposés par le malade.
Le fait d'enjamber une tombe comporte aussi desrisques de maladies, notamment pour les femmes enceintesqui prennent le risque de faire une fausse-couche.
Concernant le regard, le sentiment le plus commun estqu'il est un médiateur dans la transmission de certainespathologies, et particulièrement pour ce qui concerne lesrisques liés à la grossesse et aux conjonctivites (Jaffré etMoumouni, 1993 ; Jaffré, 1999). Globalement dans ces cas, lacontamination s'opère par une sorte de rapport d'analogie:« si la femme regarde des êtres laids ou physiquement déficients, il y a des risques que ces anomalies se transmettent àla grossesse. On parle alors de gunde ga diksa (le ventre est
Modes de transmission de la maladie en milieu songhay-zarma 139
contaminé) ". L'enfant né dans ses conditions se nommedisaw qui signifie en quelque sorte « contaminé »2.
Les autres maladies transmises par le regard concernent surtout les troubles oculaires et notamment les conjonctivites. En effet, pour certaines personnes, une conjonctiviteemprunte parfois le canal du regard pour passer d'une personne à une autre. Mais ce type de contamination se feraitmoins entre individus de même sexe que de sexe opposé.
L'unanimité n'existe pas autour de ces conceptions,puisque pour d'autres, ces croyances sont anciennes et sontde moins en moins évoquées. Elles relèveraient de quelquesdiscours, non de la réalité. En tout cas elles ne déterminentpas les conduites générales des populations vis-à-vis desmaladies oculaires contagieuses.
Transmission par héritage
La notion de maladie héritée s'applique spécifiquement aux descendants directs. Elle ne doit pas être confondue avec celle de maladie « congénitale» appelée doori kanboro hay nda, signifiant littéralement: une maladie aveclaquelle on naît. Une maladie héritée est nommée en faisantallusion à son lieu d'origine. Elle est dite alors « maladie dela maison» (ru ra doori), voire « maladie familiale» car ru,maison, sous-entend implicitement la famille. Comme telle,cette maladie a la spécificité de se fixer dans une famille, sonorigine remontant parfois même à plusieurs générations. Despathologies comme la « lèpre» (jiraytaray) et la « tuberculose »3(kotto beero) sont des exemples souvent proposés pour illustrer ces cas. Ces maladies ont la réputation de se « fixer unefois pour toutes » dans une famille. Elles sont donc particu-
2 Cette appellation peut aussi s'appliquer à des enfants que l'on supposeavoir été échangés par les génies : " parfois la parturiente sort de lacase pour un besoin quelconque et laisse le nouveau-né tout seul. Il estpossible qu'un génie féminin, elle aussi nouvelle mère, vienne précipitamment échanger son enfant contre celui de la femme. C'est parfois lecas de certains enfants malformés ou trop laids, que vous rencontrez ".
3 Les termes zarma ne correspondent pas à une stricte identificationmédicale de la lèpre et de la tuberculose.
140 Les maladies de passage
lièrement redoutées. Selon un marabout du village où unepartie de l'enquête s'est déroulée: « il y a des gens, auZarmataray, qui sont porteurs de maladies dont plusieurs deleurs grands-parents ont déjà souffert. Ce sont ces maladiesque nous zarma, appelons ru ra doori, des maladies familiales. Elles constituent un héritage (tubu) ». D'après un paysan: « dans beaucoup de cas une personne lépreuse tient samaladie d'un ascendant proche ou lointain ». Un lettré musulman de la région du Boboy précise: « quarante générationsaprès, la lèpre peut se déclarer au sein d'une lignée. C'est unemaladie dangereuse comme la tuberculose. Pour cette dernière,on fait tout pour isoler le malade afin qu'il ne contamine pasles autres membres de la famille. Pour cela on lui met sesplats et sa jarre d'eau à part. C'est ce que nous faisons et c'estce qui est recommandé par le Coran. Si le malade cache samaladie à son entourage de peur d'être isolé, il commet unpêché en contaminant les autres, car si cette maladie pénètredans une famille, c'est pour la détruire entièrement. QueDieu nous garde de la tuberculose dont l'incubation se fait surune longue période. Un nourrisson qui est contaminé par samère tuberculeuse déclarera la maladie à l'âge adulte.Durant toute son enfance, la maladie est présente dans soncorps, elle se blottit, dort en attendant qu'il devienne grand ».
Certaines personnes affirment que ces maladies ne sonttransmissibles qu'entre parents de premier degré et descendants. D'autres, au contraire, récusent cette affirmation endéclarant qu'elles peuvent tout aussi bien provenir de la lignedirecte que des grands-parents ou des aïeux. Cette positionsemble largement dominante chez les populations. Commel'indique une vieille accoucheuse : « une maladie familialen'est pas simplement celle que vous prenez avec vos parents,c'est aussi celle des grands-parents morts ou vivants ».
De plus, pour ces familles, ces maladies sont considérées comme des marqueurs sociaux, et peuvent même devenir un obstacle au mariage : « dans un village voisin, il y aune famille dont la principale maladie est yeyni4• Presque
4 Sorte de maladie provoquant notamment des douleurs articulaires.Consulter à propos de cette maladie l'article de J.-P. Olivier de Sardan(1994 : 15-45>.
Modes de transmission de la maladie en milieu songhay-zarma 141
tous les membres en souffrent, pire, pendant la saison descultures, ils sont tous - hommes, femmes et enfants - alités;ni les hommes ni les femmes ne peuvent travailler. Pour celails sont toujours en déficit alimentaire. Parfois les autreshabitants du village organisent à leur profit des travaux collectifs pour le labour des champs. A cause de cette maladie,beaucoup de filles de cette famille n'ont pu trouver de mari.La moindre information concernant leur état de santé faitfuir les prétendants. Il semble selon nos vieux du village queleur maladie remonte à plusieurs générations. Leurs arrièregrands-parents en sont morts pour la plupart» .
Transmission par agression magico-re/igieuse
La maladie peut aussi être un instrument de lutte utilisé dans des conflits inter-individuels : « si quelqu'un estjaloux ou t'en veut, il peut te lâcher une maladie. Il y a différentes manières de le faire. Certains enfouissent un charmesous la terre (fijiri), et si tu passes dessus ou que tul'enjambes, l'effet est le même. La victime est ensorcelée (i nakotte ou i na sawci) " .
Outre l'ensorcellement d'un tiers par la maladie, certaines personnes sont supposées avoir le pouvoir de « lâcher"une maladie sur un village. Ainsi le soutiennent des jeunes:« les marabouts de l'autre village ont dévié sur le nôtre l'épidémie de rougeole dont ils étaient menacés ".
Tout comme les humains, les génies (ganjey) sont, euxaussi, censés avoir leur part de responsabilité dans la causede certaines maladies. Certaines irritations de la peaucomme humburbugay sont particulièrement imputées à larencontre malheureuse d'un génie. Une femme témoigne:« humburbugay est une maladie causée par un génie que tucroises sur ton passage. Le génie te voit mais toi non, il enprofite pour t'envoyer cette maladie. Rapidement, tu as uneforte fièvre, puis des démangeaisons partout et enfin desboutons qui surgissent sur tout le corps. On traite cettepathologie en couvrant le malade avec la cendre d'une natteusée (tangara zeeno) ". Dans le même registre interprétatiffigure un autre agent surnaturel, un génie connu sous le
142 Les maladies de passage
nom de kaaji-kaaji et dont la maladie porte le même nom :« kaaji-kaaji est une forme de démangeaison provoquée parun génie nommé kaaji-kaaji. Quand tu as cette maladie, tupasses tout ton temps à te gratter le corps » •
Le terme de « lâcher » une maladie est assez proche dela signification de « flécher » (hay yan) qui désigne une formed'ensorcellement que l'on dit être causée par une flèche:« Elle consiste à tirer une flèche sur le double de la personne(bora biya) qu'on attire magiquement dans une calebasse(gaasu) remplie d'eau. Aussitôt la calebasse se remplit desang. C'est la preuve que la victime est atteinte et qu'ellerisque la mort » énonce un spécialiste.
Mais il n'y a pas que les êtres humains qui ont cettepossibilité d'attaquer. On dit même que c'est la spécialité d'uncertain génie ayant comme principale activité la chasse, etétant pour cela nommé Gawo (lit. chasseur). Ce terme dontl'équivalent hausa est Ciwon dazi (maladie de brousse)désigne à la fois l'agresseur et la maladie, son origine étantsimplement la rencontre malheureuse entre le chasseur et savictime. Les guérisseurs identifient la maladie par unensemble de signes caractéristiques. A ce propos un de cesguérisseurs nous dit: « quand c'est gawo, tu as un bouton quiapparaît et commence à s'enfler jusqu'à te donner de la fièvre.La zone du bouton chauffe comme du feu, tu ne peux mêmepas la toucher. Au début tu penses que c'est banal et que çava passer, mais plus les jours avancent et plus tu t'aperçoisque ce n'est pas de l'amusement "~. L'irruption de l'abcèsdépend de la forme de gawo. On parle ainsi de deux formes degawo : celui qui se manifeste un mois après l'attaque, et celuiqui s'annonce deux à trois mois plus tard. Enfin une dernièrenotation concerne le mode de traitement. On s'accorde globalement à penser que si la maladie n'est pas soignée traditionnellement le malade peut mourir: « c'est la facilité aveclaquelle le malade meurt en cas d'incision qui me laisse croireque ce n'est pas une maladie de Blancs. Cette maladien'accepte ni incision ni cautérisation (kakatuyan) , seuls lesremèdes des spécialistes sont efficaces ". Enfin, même si cettemaladie est transmise, on lui dénie tout caractère contagieux :« gawo n'est pas une maladie contagieuse. Même si tu es encontact permanent avec le malade tu ne risques rien ".
Modes de transmission de la maladie en milieu songhay-zarma 143
Transmission par un animal
Un autre ensemble de maladies sont « envoyées» individuellement par divers agents. Il s'agit notamment desmaladies convulsives, comme la maladie de l'oiseau (cura),pathologie largement évoquée et commentée par d'autresauteurs auprès de différentes populations sahéliennes(Jacob, 1987, Bonnet, 1999). Dans notre zone d'enquête, cetteaffection serait imputable à l'action maléfique du héron(koysa) et concernerait particulièrement les femmesenceintes et les nouveau-nés (hay taji). Un guérisseurexplique ainsi la manière de la contracter: « c'est au momentoù la femme enceinte est en train de dormir la nuit en pleinair, le ventre exposé, que l'oiseau en profite pour répandre(say yan) sur son ventre du sable pris dans les cimetières.C'est ce qui va donner à l'enfant qui naîtra la maladie ». Plusau sud, dans la région dendi, la forme de la maladie est lamême, mais le mode de transmission est décrit différemment. Comme le narre un autre spécialiste: « C'est le cri del'oiseau volant la nuit qui provoque la frayeur (humburkumey) du nouveau né ». Ces variations mineures ne correspondent pas strictement à des groupes sociaux spécifiques.Soulignons simplement qu'elles conservent comme traitscommuns de concerner au premier chef l'enfant et de semanifester par des convulsions.
Conceptions locales et conseils sanitaires
Les discours et les pratiques populaires en matière detransmission sont souvent en contradiction avec les exigences et les propositions de la santé publique. Certaines difficultés que rencontrent les agents de santé dans la mise enœuvre des messages d'éducation pour la santé à l'endroit despopulations proviennent sans doute de ces différences deconceptions. Il s'agit tout d'abord d'harmoniser des termesdont on a vu à propos du Sida qu'ils pouvaient accueillir des« messages modernes et scientifiques ». Mais il s'agit aussi decomprendre et de modifier des pratiques. En effet, pour nouslimiter à un seul exemple, si pour les populations le recoursà des « barbiers-inciseurs » s'explique par une certaine phy-
144 Les maladies de passage
siologie populaire (Jaffré & Moumouni, 1994), cette pratiquen'est pas sans risque dans une situation caractérisée par laprévalence de l'infection à VIH. Dans ces conditions, ilconvient de s'interroger sur les stratégies d'approche qu'ilfaut préconiser, non seulement pour aider les populations àla compréhension des nouveaux discours médicaux, maisaussi pour obtenir leur adhésion à des programmes préventifs.
Bibliographie
Bado J.-P.1996 Médecine coloniale et grandes endémies en Afrique, Paris,
Karthala.
Bonnet D.1999 « Les différents registres interprétatifs de la maladie de
l'oiseau ", in La construction sociale des maladies: lesentités nosologiques populaires en Afrique de l'Ouest, sousla direction de Y. Jaffré & J.-P. Olivier de Sardan (éds.),Paris, PUF : 305-320.
Cros M.1990 Anthropologie du sang en Afrique: essai d'hématologie
symbolique chez les Lobi du Burkina Faso et de Côted'Ivoire, Paris, L'Harmattan.
Jacob J.-P.1987 « Interprétation de la maladie chez les Winye, Burkina
Faso ", Genève-Afrique, vol. XXV, n° 1, IUED Genève,SSEAJSAG Berne: 59-88.
Jaffré Y.« La visibilité des maladies des yeux ", in La constructionsociale des maladies : les entités nosologiques populairesen Afrique de l'Ouest, sous la direction de Y. Jaffré & J.-P.Olivier de Sardan (éds.), Paris, PUF : 337-357.
Jaffré Y., Moumoubi A,.1993 « Etre aveugle. La cécité, entre définition épidémiologique
et sociale ", Bulletin de la Société de Pathologie exotique,86 (4) : 295-299.
Modes de transmission de la maladie en milieu songhay-zarma 145
1994 « L'importance des données socioculturelles pour l'accèsaux soins et l'observance des traitements dans la lèpre ",Bulletin de la Société de Pathologie exotique, 87 : 283-288.
Olivier de Sardan J.-P.1994 « Logique de nomination. Les représentations fluides et
prosaïques de deux maladies au Niger ", in La construction sociale des maladies : les entités nosologiques populaires en Afrique de l'Ouest, sous la direction de Y. JaiTré& J.-P. Olivier de Sardan (éds.), Paris, PUF : 249-272
Chapitre 6
Les maladies transmissibleschez les Senufo du Mali
Yaouaga Félix Koné
Au Mali, pour les Senufo de la région de Sikasso, aussibien que pour la majorité des BambaralJula, la compréhension de la maladie procède du principe fondamental quetoutes les maladies - actives ou non - existent en soi, toutesdéjà créées par dieu, une fois pour toutes. Elles nous sont, enquelque sorte, prédestinées. Ce sont les conditions - naturelles, sociales, magico-religieuses - d'existence qui favorisent ou activent l'émergence de telle ou telle maladie.
Tout individu est donc susceptible de contracter unemaladie: il en attrape certaines, d'autres « l'attaquent » ouencore des mauvaises gens, des sorciers ou des génies lui en« jettent)). La vulnérabilité dépend, de plus, d'une multitudede facteurs d'ordres divers: les composantes de la personne,les antécédents généalogiques, les remèdes de protection(ordinaires etJou magiques) dont l'individu a bénéficié. Bref,un environnement de dangers et de risques de maladiesemble omniprésent et tout individu est constamment invitéà contrôler son langage et ses actes pour se protéger.
Dans un tel contexte, une même affection peut êtrefavorisée, activée et transmise de plusieurs manières et parplusieurs acteurs: dieu, les hommes, les mauvais génies, lesancêtres et les animaux. Certes, dieu (kilè) a créé toutes lesmaladies. Celles qui sont activées pour des raisons non« complexes)) (ordinaires) sont curables, une fois que les gué-
148 Les maladies de passage
risseurs (cinpilé faiseurs de médicaments) lui trouvent leremède convenable. Lorsque des hommes ou d'autres instances, comme les génies, sorciers et ancêtres, « entrent dansla maladie », les règles des actes de guérison changent. Eneffet, quelques personnes (les méchants, les sorciers), et plusieurs instances (génies et ancêtres) ont le pouvoir de récupérer ou de favoriser l'activité de certaines maladies. Il leur estmême prêté le pouvoir de les « fabriquer, de les construire, deles créer ». Dès lors, toutes les maladies deviennent a prioripotentiellement transmissibles. Elles le sont notammentparce qu'elles sont objets de manipulations. Par contre, toutemaladie n'est pas forcément contagieuse. Toutefois, il est difficile d'opérer une classification tranchée et stable selon unedichotomie contagieux / non-contagieux, parce qu'un seulsyndrome peut se retrouver sur plusieurs registres de causalité et de transmission (Bonnet, 1999).
Ces « configurations fluides »(Olivier de Sardan,1994) rendent difficilement réalisable toute taxinomie rigoureuse même si la classification la plus répandue distingue les« maladies de dieu », des « maladies de l'homme » et des« maladies de génies ».
Les maladies de dieu (kilè yama) sont celles dont unindividu peut être victime lorsque son double (nyil) est fragile.Ce sont des maladies considérées comme naturelles par opposition à des maladies « cultivées ». Parmi les maladies de dieu,figurent les maladies du vent (kafèlègè yama) et les maladieshéréditaires (tulugo yama). Les pathologies de cette catégorieont la spécificité de réunir « les conditions pathologiques auxquelles ni le sens commun ni la divination n'ont pu assigner decause hypothétique» Œindzingre & Zempléni, 1981).
Les « maladies de l'homme » (shen kiyè : une mainhumaine) sont des maladies du sort, sortilèges qui sont desœuvres humaines, et plus précisément de sorciers. Elles procèdent de la magie, sont les plus virulentes et les plus mortelles. La plupart des maladies sexuelles, en l'occurrence lesceciimè (sortilèges de femme), sont perçues comme provenantd'une « œuvre humaine ».
Les maladies de génies (tugubé yama) recouvrent laplupart des troubles psychologiques. Le nyamu est à la fois
Les maladies transmissibles chez les Senufo du Mali 149
une maladie et une composante de la personne humaine.Dans sa phase active, il se manifeste sous forme de chaleuragressive qui poursuit toute personne coupable d'un homicide comme tout individu qui pénètre dans un lieu souillé parla mort.
Les maladies de la première catégorie, c'est-à-dire « lesmaladies de dieu » sont curables par les seules recettes de lathérapie commune ordinaire. Celles du deuxième groupe nesont curables qu'avec des antidotes à forte colorationmagique. Quant aux maladies de la troisième catégorie, ellesnécessitent notamment des rituels et sont, pour certainesd'entre elles, jugées incurables.
Il y a donc plusieurs modalités de la transmission desmaladies.
Les modes de transmission des maladies contagieuses
De nombreuses maladies sont perçues comme étantvéhiculées par le vent. Parmi celles-ci, la rougeole (sapianiou nabesuli), la variole (zogi) et les maux d'yeux (nyentanhage)1, sont particulièrement cités. C'est pourquoi elles sontregroupées sous le nom générique de maladies du vent (kafèlègè yama). Les grandes périodes de rougeole et surtout devariole coïncident effectivement avec des périodes de grandsvents qui souffient toute la journée et entrent dans toutes lesconcessions. Aucune famille, aucun ménage n'est épargné :« Voilà pourquoi nous disons que ça vient par le vent, lesdevins (sadob'lo) vous le disent également. Lorsque les doctora (agents de santé) venaient pour soigner les malades, ils lesfaisaient isoler à l'ouest du village parce que le vent qui estavec ces maladies souffie toujours d'est en ouest ».
Ces maladies sont jugées contagieuses parce qu'ellessont dans l'air que nous respirons. Pour se propager, ellesn'ont aucun besoin d'autres supports et/ou relais. Elles doivent leur contagiosité à la corrosion de l'air « gâté» . Cetteexplication fait singulièrement écho à l'ancienne théorie hippocratique de « l'air vicié» selon laquelle « les maladies
1 Sorte de conjonctivite.
150 Les maladies de passage
contagieuses seraient liées à des exhalations mauvaises»(Cheyrennaud & Vigarello, 1998). Cette notion d'altérationdu milieu ambiant - espace géographique devenant un espace nuisible - s'associe à la notion de personne souillée (personne gâtée devenant dangereuse). Le contact des uns et desautres permet d'expliquer les processus de contamination.Cette perception laisse, néanmoins, la place à d'éventuellescausalités magico-religieuses lorsque s'introduit, da,ns lerécit du malade, une dimension conflictuelle. Elles révèlentun ensemble de rapports de force entre des instances invisibles, énoncés en termes d'agression et de résistance de lapersonne à la maladie grâce à certaines de ses composantesindividuelles.
Ces maladies du vent sont perçues, aussi et le plussouvent d'ailleurs, comme le fait des hommes. Les savants(katiemnè : ceux qui connaissent quelque chose) et les sorciers (siganfèlè) créent ou récupèrent ces maladies. En effet,celles-ci « peuvent naître dans un village quelconque pourune raison ou une autre. Si les sorciers n'entrent pas dans lamaladie, elle se limitera au niveau de ce village. Par contre,s'ils entrent dans la maladie, ils la jettent (waa) dans le vent.Dès lors, tous les villages situés à l'ouest, connaîtront cettemaladie. Les sorciers peuvent aussi fabriquer ces maladies.Ils ont les recettes pour le faire. Après il ne reste plus qu'àles lâcher (yaha) dans le vent ».
Les maladies du vent sont par excellence celles dont lamaîtrise échappe le plus aux Senufo. Aussi, ne pouvant lescontrôler, ils s'en remettent aux puissances tutélaires duterroir. « Nous faisons des offrandes aux génies, pour qu'ilsnous protègent. Nous croyons que les génies ont le pouvoird'arrêter ou du moins de freiner le vent. On fait manger dumiel2 aux enfants dès qu'on est informé de la présence de lamaladie dans les villages environnants. Au village de N., leconseil des sages se réunissait et décidait, après avis desdevins, de confier la santé des populations aux génies en leurfaisant des offrandes par des vœux accompagnésd'engagements spéciaux ».
2 Pour les qualités curatives que les Senufo attribuent à ce produit.
Les maladies transmissibles chez les Senufo du Mali
Les maladies du contact
151
Les maladies éminemment transmissibles « par proximité« et qui reviennent fréquemment dans les discours, sontla maladie du sommeil (yagunongi) , l'épilepsie (sisani), latuberculose (kagolfinè) , les maladies sexuelles (nyuhonyama), les sortilèges de femmes (ceciimi). Ce sont là les principales maladies qui font l'unanimité quant à leur caractèretransmissible. Elles se communiquent par des agents ou dessubstances relais : individus, animaux, objets, fluides ethumeurs corporelles. En dehors de ces maladies, des interlocuteurs ont aussi évoqué les hémorroïdes (kooko) et le sida(sidaw).
Leur processus de transmission est expliqué en cestermes par quelques guérisseurs:
Nous pensons que lorsque le malade tousse et que tues toujours à ses côtés, tu peux attraper le Kagolfini Oit.toux blanche). En mangeant avec un tuberculeux, dèsqu'une goutte de sa salive passe dans ton estomac, lamaladie y étant, tu l'attrapes ».
On m'a également dit que lorsqu'une mouche se posesur un malade du sommeil puis sur une personne saine,celle-ci peut attraper la maladie du sommeil (yagunongi) ».
Quand on mange dans le même plat qu'un épileptiqueet qu'on absorbe une partie de sa salive, cela peut donnerla maladie (SisaaniJ3.
Cette notion d'altération et de « de souillure » de l'airévoquée ici « va de pair avec une vision globale de la contagion qui dépasse largement le cadre de la maladie pourconcerner toutes sortes de contacts avec autrui, ses substances ou ses objets. Elle postule que des effiuves se dégagent des corps et peuvent agir à distance » cPaicheler, 1998).La notion d'une contagion par proximité est, en effet, trèsrépandue dans l'aire culturelle senufo ; mais peut-être faut-ilaussi entendre, dans ces explications, les échos affaiblis deséances d'information d'agents de santé villageois.
3 On dit que l'épilepsie (sisaani) provient d'un liquide qui s'échappe dubec d'une espèce particulière de tourterelle. Lorsqu'on abat ce type detourterelle, il faut éviter de toucher ce liquide, vecteur de l'épilepsie.
152 Les maladies de passage
Cette proximité est aussi parfois synonyme de malveillance. Ainsi, le terme waa (jeter sur) exprime, plus quetout autre, la notion de transmission. Il contient une idéed'agression. Il est utilisé dans les cas de conjonctivite, censésse transmettre d'une personne malade à une personne saineà travers le regard (Jaffré 1999). Il est aussi évoqué à proposdes oreillons (ginkorogo) qui « se transfèrent » sur celui quise moque de toute personne qui souffre de cette maladie.Nous avons donc là deux types de contamination: l'un par leregard, l'autre par le rire.
Soulignons enfin que transmettre sa maladie à unindividu peut permettre la guérison. Cette situation est illustrée par l'expression courante de « vendre sa maladie ". Cettestratégie de transfert a été constatée chez les Senufo de Côted'Ivoire, où pour guérir de la maladie du « front qui pend »4,il faut faire des grimaces qui vont transférer l'affection àcelui qui rira (Sindzingre & Zempléni ibid.).
Les maladies de la consanguinité (tulugo yama)
Dans ce registre, il existe des maladies qu'on pourraitqualifier « de genre» : ce sont les maladies que le père transmet à ses fils et celles que la mère transmet à ses filles. Lesmaux de ventre des parturientes (seedangi) comme les règlesdouloureuses (lagbeleyi) se transmettent toujours en lignéematernelle (mère et/ou grand-mère). Un homme peut aussitransmettre des maladies à ses fils. Par exemple, l'hydrocèle(jobulo). Lorsqu'un homme a cette maladie et qu'il continuede faire des enfants, il peut la transmettre à ses enfants desexe masculin.
D'autres maladies peuvent se transmettre indifféremment, comme, par exemple, des symptômes de tremblement(jelewJ qui laissent parfois évoquer la maladie de Parkinson.La transmission se fait dans les deux lignées, celles du pèreet de la mère. La maladie passe directement du parent malade à l'enfant par le sang si les deux sangs sont « compatibles »
(pi tiim ka je). De même, les maladies mentales (yakiri yamaJ
4 Type de migraine persistante.
Les maladies transmissibles chez les Senufo du Mali 153
sont des maladies que le père aussi bien que la mère peuventtransmettre à leurs enfants : « On nous a appris que le pèretransmet des maladies à ses enfants à travers le sperme. Dèsla conception, la maladie siège (tin) dans l'enfant et se développe (liègi) avec lui. De ces maladies, on dira « qu'elles n'ontpas poussé dans l'herbe» (ku vi nyan ni mè), autrement ditqu'elles s'inscrivent dans la « pathohistoire » des groupes deparenté d'appartenance du malade. Le parent transmetteurpeut ne pas développer lui-même la maladie. Dans ce cas, iljoue un simple rôle de relais ou de « porteur sain ». La survenue de la maladie n'est donc pas systématique; elle reste « unpouvoir pathogène imprimé dans la substance de mon lignage»(Zempléni, 1985). Dans le processus de contamination, laconstitution de la personne est importante. L'individu estdéfini par les caractéristiques du lieu où il est né, par la terreavec laquelle il a été « fabriqué », par la force (fanha) de sondouble (nyil), et par son esprit tutélaire (yilifolo)5 :
Dans tous les cas, « la constitution de l'organismeréglemente la manière de la transmission. Elle la favorise oune la favorise pas» (Desclaux 1997). Dans ce processus detransmission, c'est la constitution individuelle, qui importe.
Les maladies des effluves: le nyamu6
Le nyamu est une instance qui, pour les populations,se présente sous la forme d'une « chaleur» plus ou moinspuissante, agressive, et qui est propre à tout être vivant. Elledevient particulièrement virulente après la mort car elle sedégage de la dépouille lors de sa décomposition. Dès lors ellepeut s'attaquer à toute personne. Lorsque la mort tient de lasorcellerie, le nyamu s'en prend préférentiellement à celuiqui a donné la mort et/ou à sa descendance. Selon cettelogique de pensée, toute personne poursuivie (chasseurs,assassins, guerriers et leurs descendants) par le nyamud'une victime sera rattrapée, et surtout si son double (nyil)est fragile. Alors seront évoquées les notions d'envahisse-
5 Esprit et objet de culte qui veille sur le souille vital de la personne.
6 Instance identique au nyama des Bambara (Cf. le texte de Jaffré sur latransmission dans ce même ouvrage).
154 Les maladies de passage
ment (nyamu lugo wu kurugo, lit. le nyamu est monté surlui) et de pénétration (nyamu je wu na, lit. le nyamu estentré en lui). La charge du nyamu des animaux « sacrés» ettotémiques semble être la plus forte.
Les personnes les plus exposées au nyamu sont leschasseurs parce qu'ils font l'objet d'agression du nyamu desanimaux qu'ils abattent. Le chasseur peut être victime luimême d'une maladie de nyamu que développera ensuite saprogéniture. Prenons le cas suivant:
Un chasseur est poursuivi par le nyamu d'une victime.Il développe des maladies de nyama, stérilité et maladie depeau. Il est aussi soumis à une perte de ses performancescynégétiques. S'il se soigne avec les recettes appropriées, lenyamu de l'animal sera anéanti.
Aux dires de l'un de nos interlocuteurs, « le nyamu leplus fréquent chez les chasseurs est celui du boa. Celui qui estatteint par le nyamu d'un boa développe une transpirationexcessive. Cette sueur contient une matière grasse comparableà la graisse du boa. Elle salit les vêtements du porteur ".
Citons un autre exemple: un chasseur provoque unnyamu en tuant un gibier au nyamu particulièrement dangereux. Le nyamu ne l'attrape pas, parce qu'il est protégé.Toutefois, le nyamu reste « collé » à lui. Alors, le chasseur estsusceptible de le transmettre à ses enfants. Pour se débarrasser du nyamu, le chasseur doit le « laver" Uee). Cela correspond à une purification qui permet l'extinction de la chaleur, elle-même moyen d'action du nyamu.
Les endroits où sont morts un lion, une panthère ou unboa sont contaminés ou « gâtés " par le nyamu de ces animaux. Toutes les personnes qui traverseront ce champ contaminé seront systématiquement agressées. Si leur double(nyil) est fragile, elles développeront un syndrome de nyamu.
Les maladies des sortilèges
Nous classons ici comme sortilèges toutes les maladiesqui sont perçues comme étant l'œuvre d'individus malveillants (shenpele) ou de sorciers (siganfèlè). Si plusieurs
Les maladies transmissibles chez les Senufo du Mali 155
noms servent à désigner cette catégorie de maladies, cesdénominations sont toujours liées au mode de transmissionévoqué et à la causalité imputée. Dans ce cadre, on incriminera tour à tour le sort envoyé (korti), le maléfice de femme(ceciimè), les choses ramassées avec les pieds (yatanhalioro).
Ces maladies ont la particularité d'être « fabriquées»(sennègè) par des hommes avec une intention de nuire, defaire souffrir. Elles ont, le plus souvent, besoin d'un relaismatériel nécessaire à la transmission. Un agent contaminé objet, personne humaine, air, reptile, insecte, autre animal servent généralement de support.
Les devins déterminent en général le responsable dumal avant d'entreprendre de soigner ces maladies.Généralement les victimes (individus ou groupe d'individus)sont bien « ciblées ». Communément, on dit que untel « a jetéla maladie sur» ou qu'il « l'a envoyée sur ».
Les exemples de pathologies les plus souvent citéessont la stérilité, l'impuissance et les maladies sexuelles.
Globalement, les maladies sexuelles sont désignées parle nom pudique de maladie du bas (nyuhon yama). Ce sontles seules maladies dont les Senufo parlent comme étant toujours transmissibles.
La plus nommée se nomme Ceciimè. Elle est imputéeaux hommes trompés qui veulent châtier l'amant de leur épouse.D'une manière générale, la contamination se déroule de lafaçon suivante: « le produit (ciimè) qui va causer la maladie estdéposé furtivement par le mari trompé sur le pubis ou dans lesexe de sa femme. Il peut aussi par ailleurs contaminer sonépouse en lui faisant enjamber - toujours à son insu - unbâtonnet chargé du produit (ciimé). L'enjambement suffit à lacontaminer. On dira alors qu'on a mis un sortilège de femmesur elle. Le mari s'abstiendra d'avoir une pénétration sexuelleavec son épouse s'il n'a pas l'antidote. Si la femme a des rapports sexuels avec son amant, ce dernier reçoit toute la « chargecontaminante » déposée sur elle et devient impuissant. Lafemme ne développera pas la maladie si son mari possèdel'antidote dont lui-même se sert pour maintenir des relationssexuelles avec elle sans courir le risque de contracter une maladie sexuelle. Il y a là indiscutablement un aspect de transfert
156 Les maladies de passage
intégral. Par contre, si la femme, détentrice du produit maléfique, n'a pas de rapport sexuel durant un certain temps, elledéveloppe elle-même la maladie et peut en mourir par absenced'antidote. Les hommes qui déposent ces sortilèges sur leurfemme peuvent ne pas avoir, eux-mêmes, d'antidote, surtoutlorsque la maladie a été « achetée" à une personne différentede celle qui l'a« fabriquée ". Tout homme qui aura une relationsexuelle avec cette femme sera contaminé et atteint par lamaladie. On dira que« le sortilège de femme l'a pris ".
Globalement donc, derrière cette notion de ceciimè seprofile l'idée d'une normalisation des relations sexuelles avecla condamnation de l'adultère féminin.
D'autres pathologies de ce type peuvent frapper leshommes qui se compromettent avec une femme mariée ouvivant en concubinage. Il s'agit principalement du katong(lit., l'escargot) qui se manifeste par « un rétrécissement dusexe de l'homme ", à l'image de l'escargot qui entre dans sacoquille. Le sortilège se prépare à partir d'un escargotnommé katogbogi de la façon suivante: « lorsque celui-ci estlargement sorti de sa coquille, on coupe la partie extérieure àl'aide d'un outil tranchant. Puis, on la carbonise en y associant d'autres plantes. La poudre obtenue à partir du gastéropode est mélangée à du beurre de karité et mise dans unsabot de vache. Le mari jaloux applique ce produit sur lepubis de sa femme pour que tout homme qui a des relationssexuelles avec elle, voit son pénis, tel un escargot, se repliersur lui-même et ne plus jamais pouvoir se mettre en érection.Pour guérir, il lui faudra absolument enduire son sexe avecune poudre provenant du morceau de ce même escargot restédans la coquille (le côté de la tête) ".
Enfin, un ensemble de symptômes difficilement identifiables sont classés par les guérisseurs dans la catégorie des« maladies dont on ne connaît pas la cause " (banasidonbaliw). Ces maladies sont cependant souvent associés aux relations sexuelles. Certains guérisseurs refusent de les classerdans la catégorie des sortilèges de femme (ceciimè) qui, eux,s'en prennent aux organes génitaux (contrairement au sida).Il s'agit donc de maladies sexuelles qui s'attrapent par« affaire de femme » mais qui ne se manifestent pas sur lesexe. Elles peuvent parfois évoquer le sida.
Les maladies transmissibles chez les Senufo du Mali 157
L'univers de la réception des messages sanitaires: sortilèges,M5r, et sida
C'est dans ce paysage déjà fort complexe de compréhension et d'explication de la maladie que l'annonce du Sidaest intervenue. Les populations ont été informées de l'existence du Sida par des voies d'informations anonymes (messages sanitaires radiophoniques, banderoles de rues, etc). Cefait a considérablement influencé le processus de construction du sida, en particulier par la réinterprétation des messages des services de prévention selon des grilles de lecturepersonnelles et selon l'expérience que les individus avaientdes maladies sexuellement transmissibles.
De nombreuses personnes déclarent avoir ignoré le sidajusqu'à une période récente. Toutefois, elles ont appris le nomd'une maladie appelée sidaw dont l'existence, disent-elles, a étéannoncée avant sa survenue concrète. Un guérisseur déclare:« J'ai vu des gens revenir de Côte d'Ivoire qu'on disait atteintsdu sida. Cette maladie, nous ne savons rien d'elle. Selon ce quel'on nous raconte, elle n'est pas une maladie qui se développesuite à un empoisonnement, on l'attrape à travers les relationssexuelles et elle se transmet par le sang. La différence entre lesida et les autres maladies qu'on attrape avec les femmes esténorme. On ne guérit pas du sida alors que nous soignons lesautres maladies de femmes connues jusqu'alors ".
Le sida est aussi pensé en termes de chaleur (kafugo),de rapport entre des instances fortes et faibles, puisqu'« ilparaît que des gens peuvent avoir des rapports sexuels avecdes sidéens sans être malade du sida".
Si les jeunes gens connaissent les voies de transmission du sida, ils ne raisonnent que sur le modèle explicatif dela transmission sexuelle. Ce faisant, ils établissent leurspropres groupes à risque qui sont les prostituées, les étrangers, les migrants, les voyageurs. Ils affirment que « jamaisune victime du sida n'a eu le mal au village. Ils reviennentmourir ici avec cette maladie de la Côte d'Ivoire, mais le sidane s'attrape pas ici ». Il y a, de toute évidence, l'idée quel'espace villageois est un espace rassurant qui constitue, enfait, l'épicentre d'une « enveloppe sociale » où sont maîtrisésou exclus les groupes à risque.
158
Conclusion
Les maladies de passage
A l'opposé des entités locales recouvrant les M8T, lesida se transmet par voie sexuelle mais ne se manifeste passur les organes génitaux. Cette perfidie du mal, trouble etdérange les logiques d'imputation et d'interprétation desmaladies sexuellement transmissibles connues. Le sida obligeà reconstruire des interprétations pour une maladie nouvelle.
Les notions de contagion, de transmission et de contamination sont des catégories complexes qui s'appuient surdes « dynamiques autonomes» (par exemple, le vent). Deplus, ces notions varient en fonction de situations concrètes.Ainsi, bien que la voie privilégiée de la contamination partransmission soit la proximité ou la gestion des humeurs corporelles, il arrive qu'on soit présent aux côtés d'une victimed'une maladie contagieuse sans être « attrapé » par la maladie. Une explication donnée s'apparente à celle évoquée parHéritier comme la théorie des sangs compatibles (1996) : lesmaladies sont transmissibles par le sang lorsque les tiim(sève, sang) sont identiques (compatibles). Cette conceptionse retrouve également à l'œuvre pour les maladies héréditaires : si le sang d'un enfant est identique à celui d'un de sesparents ce dernier lui transmettra ses maladies.
Ces quelques exemples confirment la plasticité du système de causalité senufo tel qu'il a été défini par d'autresauteurs (8indzingre & Zempleni, 1981).
Cette adaptabilité constitue l'univers de la réception desinnovations sanitaires en milieu senufo. En effet, la modernitésanitaire, oblige à lutter contre de nouvelles maladies, maiselle s'ouvre aussi à des messages d'information et use demédias autrefois inconnus comme les ondes radiophoniques.Ces nouveaux équilibres entre risques et nouvelles connaissances construisent au quotidien la santé des populations.
Les maladies transmissibles chez les Senufo du Mali
Bibliographie
159
Bonnet D.1999 « La taxinomie des maladies en anthropologie: aperçu histo
rique et critique ", Sciences Sociales et Santé, vol. 17, n° 2 : 5-21.
Cheyvronnaud J., Vigarello G.1998 La contagion, Paris, Seuil.
DesclauxA.2000 L'épidémie invisible. Anthropologie d'un système de santé à
l'épreuve du sida chez l'enfant à Bobo Dioulasso, BurkinaFaso, Lille, Presses Universitaires du Septentrion.
Héritier F.1996 Masculin 1 Féminin. La pensée de la différence, Paris,
Odile Jacob.
Jafré Y.1999 « La visibilité des maladies des yeux ", in La construction
sociale des maladies, Jaffré & Olivier de Sardan (éds.),Paris, PUF : 337-357.
Paicheler G.1998, « Modèles pour l'analyse de la gestion des risques liés au
VIH : liens entre connaissances et actions ", in SciencesSociales et Santé, vol. 15, n° 4 : 39-71.
Olivier de Sardan J.-P.1994 « La logique de la nomination: les représentations fluides
et prosaiques de deux maladies au Niger ", in SciencesSociales et Santé, vol. XII, n° 3 : 15-45.
Sindzingré N., Zempleni A.1981 Modèles et pragmatique, activation et répétition:
réflexion sur la causalité de la maladie chez les senoufo deCôte d'Ivoire, Soc. Sei. Med., Vol. 15B : 279-293.
Zempleni A.1985 « La « maladie" et ses « causes" L'ethnographie, Causes,
origines et agents chez les peuples sans écriture, n° spécial,96-97, T. LXXXI, Paris, Société d'Ethnographie: 13-44.
Chapitre 7
Connaissances populaireset pra'tiques de préventiondes infections respiratoires aiguës (IRA)infantiles en population bobo(Burkina Faso)
Chiara Alfieri
Lorsqu'un enfant du « Sud» est affecté par une pathologie respiratoire grave, telle qu'une pneumonie ou une bronchite, ses probabilités de survie sont infimes. Cependant, raressont les programmes sanitaires qui prennent en charge globalement - formation des agents de santé, des mères, éducationà la santé et à l'hygiène, etc. - ces pathologies respiratoires.
Elles sont pourtant à l'origine de nombreuses disparitions d'enfants en bas âge. Ainsi, 99 % des décès par pneumonie ont lieu dans les pays en voie de développement, alorsque ce fait est très rare dans les pays du Nord (OMS, 1999).Plus précisément, les IRA (Infections Respiratoires Aiguës)représentent une des causes majeures de la mortalité desenfants entre 0 et 5 ans. Par exemple, l'UNICEF dans sonrapport (Le Progrès des Nations, 2000) estime que chaqueannée 2 millions d'enfants meurent dans les pays du Sudsuite à des affections respiratoires. Elles sont la deuxièmecause de mortalité infantile au Burkina Faso!, après le palu-
1 Le Burkina Faso comprend 11.300.000 habitants. Le revenu moyen par
164 Les maladies de passage
disme. Dans la province du Houet où a été menée notreétude, la direction de la santé souligne qu'en 1999 sur unepopulation totale de 828 554 personnes, il y a eu 38 956 casd'IRA correspondant à une prévalence de 4,70 % (Pland'action des districts sanitaires, 1999).
Mais décrivons, plus précisément encore, les caractéristiques de notre lieu d'enquête. Comptant 383 722 habitants (Anonyme, 1990)2, la principale ville du sud du pays,Bobo-Dioulasso, abrite le centre Hospitalier National SouroSanou (CHNSS), qui est le second hôpital national.Globalement, « 45 % de la population dépend de cet hôpital»(TaU & Nacro, 1994).
Dans le service de pédiatrie de cet hopital, les IRA correspondent le plus fréquemment à quelques pathologiescomme les broncopneumopathie virales et bactériologiques,les pneumonies lobaires aiguës, les staphilococcies pulmonaires, et la tuberculose. En outre, les hospitalisations pourd'autres pathologies pédiatriques comptent des diagnostics« secondaires» qui concernent des formes plus légères d'IRA,dues souvent et notamment chez les enfants de 0 à 3 ans, àdes complications de la rougeole (Nacro, corn. pers.).
Une enquête démographique et sanitaire (EDS) del'UNICEF (Le Progrés des Nations, 2000 : 17) a mis en évidence que les parents des enfants qui souffrent de pathologies respiratoires aiguës s'adressent très rarement aux structures sanitaires. Ces maladies respiratoires seraient occultées, peu reconnues, ou considérées comme peu graves.
---------------
habitant est d'environ 240 $, 61 % de la population vit avec moins d'undollar par jour L'indicateur de pauvreté humaine rIPH) introduit parl'OMS sert à mesurer les différents aspects que peut prendre la pauvreté. Au Burkina, l'IPH dépasse 50 %, ce qui signifie que la moitié de lapopulatIOn vit en dessous du seuil de pauvreté « consenti ". Amat-Roze(2000 : 33) explIque que: « Loo) la pauvreté entraine dans son sillagetoutes les maladies associées à la misère: maladies liées à l'eau, au périlfécal, à l'absence d'hygiène. à la promiscuité, à l'ignorance. D'originesvirales ou bacténennes, elles sont le plus souvent à transmission directe et rencontrent dans l'envIronnement socio-économique des conditionsqui leur sont très favorables. Ces maladies sont l'expression du sousdéveloppement ".
2 Pour plus de détails au sujet de la ville de Bobo-Dioulasso et de sesstructures samtmres, (cf. Myriam Roger-PetitJean, 1999, Alice Desclaux,2000).
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 165
Divers travaux confirment ces données. Ainsi deux études,l'une menée en structure hospitalière (Tall & Nacro, 1994),et l'autre dans un village bobo (Lang & Lafaix, 1986)3, soulignent la difficulté des mères à reconnaître des IRA se présentant sous la forme d'une multiplicité de symptômes (toux,fièvre, vomissements, manque d'appétit). Ce phénoménal dela maladie4 associé à des difficultés pécuniaires conduiraitles mères à utiliser des remèdes « traditionnels ». C'est àmieux comprendre ces conduites que nous avons consacrénotre étude5.
Elle a été menée en population Bobo6, groupe le plusanciennement établi dans cette zone (Guy Le Moal, 1980) etqui constitue 11 % de la population de la ville de BoboDioulasso. Elle se propose d'explorer les perceptions et lesreprésentations relatives aux pathologies respiratoires infan-
3 Sur cette questIOn, voir aussi, Sanou, Koueta et ali 1994 ; Sawadogo,Koueta et ali 1996 ; Koueta, Ouedraogo et ali 1996 ; Sawadogo, Sanouet ali 1997.
4 Nous renvoyons sur cette question à Yannick Jaffré (2000).
5 Une partie de l'enquête à été menée dans deux" quartiers-villages"bobo de la ville de Bobo-Dioulasso et dans 3 villages environnants,auprès de 28 personnes de tous statuts. La plupart étaient mères defamille. Nous avons aussi interrogé 8 guérisseurs (hommes et femmes).Une enquête à été également menée à la Division du Service dePediatrie du Centre Hospitalier National Souro Sanou auprès de trentemères (tous groupes ethniques confondus) dont les enfants,(de 0 à5 ans), étaient hospitalisés pour une pathologie respiratoire. Certainsde ces entretiens supplémentaires ont été poursuivis à domicile. Lesentretiens ont été fait en langue bobo, dioula et français, pour les premières à l'aide d'une interprète. Je tiens à remercier, tout particulièrement, le docteur Boubacar Nacro, responsable du service de pédiatrie,qui m'a permis de mener librement mon enquête auprès des mères desenfants hospitalIsés, et pour ses précieuses clarifications.
6 Les Bobo constituent une population d'agriculteurs d'environ 350 000personnes. Leur majorité vit au Burkina Faso et petite minoritée ausud du Mali. Il s'agit d'une société lignagère où les rôles socio-religieuxsont repartis entre le kireuo, chef de village (autorité villageoise crééeau temps de la colOnIsation), le sogouo, chef de la brousse, le douo (responsable du culte du Do, entité religieuse de reference), le yéléuo responsable de l'education de jeunes, des classes d'âges, des initiations etaussi des masques lors des sorties rituelles. La gestion des" affaires duvIllage" est également assurée par un groupe de notables, charge àlaquelle on accède par ancienneté. La religion animiste detient encoreun poids très considérable parmi cette population, en milieu rural etmême parmi les habitants de la ville.
166 Les maladies de passage
tiles, ainsi que les différentes interprétations de leur transmission. Nous décrirons aussi les stratégies de préventionque les mères utilisent pour leurs enfants, et comment cespratiques sont intégrées et influencées par les messages de« sensibilisation» et « d'éducation à la santé ». Enfin, nousnous interrogerons sur la façon dont cette « préventionmoderne ", et notamment les vaccinations, s'insére dans lacomplexité des systèmes de pensée ruraux et « traditionnels ».
Les causes des IRA dans le discours commun
Très largement, en population bobo, on établit une relation étroite entre les différentes IRA et les conditions climatiques. Elles varieraient de la saison sèche fraîche et froide(de novembre à décembre) à la saison sèche et venteuse (dejanvier à février) ; et de la saison sèche et chaude (de mars àmai) à la saison pluvieuse (de la mi-mai à mi-septembre).
Durant la saison sèche et venteuse, soufflel'harmattan? Ce vent de sable, à cause de la poussière qu'ilsoulève et transporte, est supposé propice à la transmissiondes maladies liées à la respiration. Globalement on pensequ'il favorise aussi la « transmission/contagion» des maladies comme la méningite ou la rougeole (mà{ugapùrùru) , ouencore qu'il provoque des irritations de l'œil.
On distingue dans cette saison sèche, celle qui estfraîche (lia) et celle qui est chaude (siminà). La premièrepériode serait porteuse de pathologies respiratoires liées aurefroidissement du corps exposé à l'amplitude de l'écart thermique entre le soir et le matin. On dit que c'est la période des« maladies du froid ». Si l'on ne se couvre pas, on peut attraper la toux sèche ou la pneumonie: « l'air froid rentre et faitgonfler les poumons ». Durant la seconde période, sèche etchaude, le danger d'attraper un rhume ou une toux proviendrait d'une transpiration nocturne à cause des variations de
7 L'harmattan est appelé wogoyaga en bobo, terme qui est employé aussidans la langue courante pour décrire un état chmatique connoté par unmauvais temps. On emploie aussi le terme panga yaga (panga : vent;yaga : mauvais, litt: « le mauvais vent,,) pour souligner le caractèrenégatif de ce type de vent porteur de maladies.
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 167
température entre l'intérieur et l'extérieur des habitations.Lors des entrées et des sorties, le corps subirait un refroidissement dû à la transpiration qui sèche sur le corps et qui créeune couche d'humidité. En outre, les mères se plaignent dufait que les enfants se découvrent pendant le sommeil ou qu'ilsne soient pas suffisamment couverts lorsqu'ils dormentdehors. Par ailleurs, elles pensent que la transpiration « nonlavée » ou qui reste trop longtemps sur la peau ou sur les vêtements de l'enfant produit une sorte de pellicule qui bouche lespores de la peau et empêche, par là même, à une autre transpiration de sortir. Cette dernière serait à la base du refroidissement : Elle colle au corps, le refroidit et créé ainsi une sortede « membrane» cutanée qui est pathogène. C'est pourquoi lesmères lavent plusieurs fois leurs enfants durant la journée,pour empêcher que la transpiration sèche et reste sur la peau.
Mais la saison des pluies n'est pas plus clémente. Eneffet, on dit que l'organisme est aussi affecté par le refroidissement du climat et par l'humidité: « on dirait que tu es dans lesconditions pour prendre la maladie qui est déjà dans ton corps.Le fait que la fraîcheurS arrive ne fait que la déclencher ».
L'humidité que le corps accumule est nommée kan ti,(kan: fraîcheurlhumidité ; ti être là, exister ; lit. « la fraîcheur est là/existe »). Durant cette période, cette humidité neréussit pas à être éliminée ou absorbée « à la longue, l'humidité enrhume », affirment les gens. Mais il s'agit aussi d'uneconstatation. En effet, durant le mois d'août - que l'ondésigne d'ailleurs par le terme bii le mois des pluies9 - il Y a
8 La notion de " fraîcheur» est très utilisée par les gens lorsqu'on parled'affections respiratoires ou de pathologies fiévreuses. Elle est aussiconsidérée comme l'une des étiologies locales possibles à la base d'unecrise paludéenne. Le dictIonnaire bobo - français traduit le mot paludIsme ainsi que fraîcheur par le même mo t: kan.Roger-Petitjean M., dans son étude (1992, 31 : 55) relative à certainespathologies infantiles au Mali (qui comprend aussi des notions localesqui s'attachent au paludisme), mentionne les éléments climatiques etnotamment la fraîcheur humide de l'hivernage, les soudaines altérations de température, ou le passage du chaud au frais, comme faitconstant, indiqué par les mères, à la base du déclenchement de certainsétats morbides en latence, ou comme facteurs de maladie.
9 Le terme bun est employé aussi pour désigner l'état non mûr, non cuit,ou frais, d'une subsance, d'un aliment, d'une boisson ou aussi d'uneplante, cf. aussi Le Bris, Prost, 1981 : 129.
168 Les maladies de passage
peu de soleil, et il est fréquent que les enfants s'enrhumentet toussent. Les vêtements mouillés sèchent à même la peauet ceux qui jouent et ne se protègent pas sont les plus touchés. Ainsi la vie quotidienne est souvent bien éloignée desmessages sanitaires qui recommandent de protéger lesenfants des pathologies respiratoires en les préservant del'eau, du vent et du froid et en leur mettant des habits, descaleçons, des chaussettes, des bonnets ou des chapeaux1o...
Mais d'autres causes sont aussi évoquées. Ainsi, différents aliments sont considérés comme étant à la base de certaines toux, angines, maux de gorge (kalamala)l1 ou rhumes.En général on évoque les céréales « nouvelles » et les aliments non mûrs. « Une partie de l'aliment se colle à la gorgeet provoque la toux ", disent alors les mères. On incrimineparticulièrement les mangues ou les arachides fraîches queles enfants mangent avec gourmandise. Il s'agit, toutefois, detypes de toux temporaires.
Le mil à peine récolté génèrerait aussi la toux, lerhume ou la diarrhée, soit à cause de la poussière qui serépand dans l'air lorsque la plante est vannée pour séparerles graines des épis, soit parce qu'il s'agit d'un aliment considéré comme récemment cultivé dans l'agriculture régionale.Cette dernière interprétation peut aussi concerner le maïs,les haricots et le fonio. Ainsi l'explique un guérisseur : « c'estun type de récolte nouvelle, l'organisme se rebelle. Le corpshumain n'est pas préparé pour ces aliments, l'organisme nousdit qu'il y a quelque chose de nouveau et il réagit ,,12.
10 Soulignons que la protection des enfants petits de l'eau, était cependantune pratique largement diffusée dans les villages. Il y a quelques décennies, il existait un équipement qui protégeait l'enfant en cas de pluie :«En cas de pluie il y a tout un harnachement qui recouvre l'enfant. Unehotte, en peau graissée au karité mêlée de terre de ferrugineux appelékaba ", couvre et retient l'enfant à cheval sur le dos de sa mère, unesorte de chapeau pointu en fibres de rânier graissées et enduites deterre de ferrugineux recouvre sa tête; des lacets de cuir fixent ce chapeau au corps de la mère (Montjoye, 1952 : 27).
11 Autrefois, dans les vIllages, pour soigner le mal de gorge quand il estpersIstant, on utilisait des amulettes en peau en guise de protection.
12 Entre novembre et décembre, lorsque les récoltes sont terminées etavant de consommer le nouveau mil, une cérémonie d'offrandes de prémices aux ancêtres, appelée fogoziokie, se déroule pendant la nuit danstous les villages et quartiers-villages bobo. Autrefois il était interdit de
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 169
Les noms donnés aux" rhumes" et aux IRA
Les affections respiratoires, interprétées comme étantdes maladies naturelles, sont souvent nommées à partir determes empruntés à un langage médical simple: rhume13,
toux normale ou toux « compliquée ».
En langue bobo, un autre terme, sun, désigne la touxet le rhume. Les personnes âgées affirment que les originesde cette pathologie sont peu connues. On pense que c'est surtout la poussière qui la provoque, même s'il y a des enfantsqui naîssent déjà enrhumés. Dans ce cas, on pense que lamaladie a été transmise pendant la grossesse si la mère ensouffrait durant cette période.
Le plus fréquemment, les mères distinguent plusieurstypes de toux en utilisant une nosographie populaire auxcontours flous même si, certaines d'entre elles, peuvent fournir des détails supplémentaires selon les signes et les symptômes qui se présentent. La diffusion souvent confuse desmessages biomédicaux dans la population induit aussi uncertain arbitraire sémantique dans les terminologies utilisées et pousse les gens à exprimer une symptomatologie ensupposant une correspondance univoque entre leurs catégories et celles de la médecine moderne.
Le rhume et les toux
Selon nos interlocuteurs, le rhume se localise dans lapartie haute du visage et touche le nez, les oreilles, les yeuxet la tête (won: tête, y compris le cerveau). L'origine ducatarrhe serait dans la tête et s'étendrait ensuite dans toutle corps, descendant jusqu'à la poitrine. On distingue deuxtypes de rhumes: bin zio (bin : nez & zio : eau ; lit. : « eau
consommer le " nouveau mil» avant cette cérémonie, mais maintenantil arrive que les familles qui ont déjà épuisé leurs stocks y ont recourségalement, tout en faisant, préalablement, un petit rituel offertoire àl'échelle du lignage.
13 Il s'agit en fait d'une sorte de syndrome associant éventuellement desmaux de tête, de la fièvre, une rhinorhée: un " rhume» au sens populaire français ...
170 Les maladies de passage
du nez») ou, plus généralement, duma 14 : la saleté. Quand lerhume se manifeste, les mucosités transparentes et peu visqueuses sont considérées « comme de l'eau du corps» quicoule. Si l'affection persiste, et qu'elles deviennent jaunâtresou vertes, c'est souvent à ce stade que les mères commencentà s'en préoccuper, même si rien n'est réellement fait pourtenter d'enrayer la maladie.
Il arrive fréquemment que cette affection s'accompagne de toux. On dit alors que les saletés descendent et sedécomposent: « duma ma yaga tangan bè wora » (duma : lasaleté ; ma yaga : mauvaise ; tangan : est assise ; bè wora :sur ton cœur; lit. « les saletés sont assises sur ton cœur ,,).« Maintenant que les saletés sont assises sur ton cœur, tu asla toux ", dit-on.
Les mères distinguent les toux en deux grandsensembles qu'elles appellent la « toux normale ", wogo sun(wogo : tousser; sun : rhume/toux) qui dure quelques jours,et la « toux « compliquée " (sun ba ; sun: toux, ba :difficile/dur, litt : « toux difficile/compliquée ,,). Elles tiennent compte de deux caractéristiques essentielles pour diagnostiquer une « toux compliquée» : la durée hors norme supérieure à dix jours - et le fait qu'une fois que la touxsemble guérie à l'aide des médicaments, elle se représenteseule ou souvent accompagnée par d'autres signes. En fait, lacomplexité des affections respiratoires rend assez difficile la
14 Outre à traduire saleté, le terme du ma sert à exprimer une idée demaladie, d'irrégularité, quelque chose qu'on ne doit pas accepter parceque c'est contraire à l'équilibre. Le contraire de duma est kini, qui veutdire propre, recommandable. La notion de " saleté ", est très utilisée parles Bobo. Certains comparent les microbes à la saleté, en affirmantqu'elle serait: " Comme quelque chose qui se promène dans le corps. Ilfaut faire sortir les saletés, ce n'est pas seulement ce qui est visible quiest mauvais et qui peut rendre malade. Les microbes sont comme lessaletés, quelque chose qu'on ne voit pas et qui à un certain momentrend la personne malade ". La saleté recouvre aussi une significationtrès ample dans le domaine magico-religieux et éthique. Par exemple, lefait de faire une promesse à un « fétiche" et de ne pas la respecter estconsidéré une saleté. Il s'agit également de saleté lorsqu'on se présentedevant un « fétiche" pour une consultation, sans avoir rempli toutes lesconditions physiques et mentales que celui-ci demande. Ainsi de quelqu'un qui a volé en brousse, on dit qu'il est duma, sale. Sur ces rapportsentre souillure et contamination dans la sphère profane et dans celle dureligieux, nous renvoyons à Douglas (1981).
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 171
reconnaissance de leur gravité et des différents stades de lamaladie. Mais, pour préciser notre propos, voici quelquesexemples de nomination de « toux compliquées ".
Pour certaines d'entre elles, l'appellation traditionnellecoïncide en grande partie avec la catégorisation biomédicale.Il s'agit, par exemple, de la coqueluche ou de la « toux detrois mois », kulukulu en bobo. Elle touche les enfants et sices derniers ne sont pas soignés rapidement ils peuvent enmourir: « ça commence avec la toux normale, ensuitel'enfant a le corps chaud15 , et parfois pendant la crise[convulsive] il tourne les yeux ». Cette connaissance se manifeste surtout parmi les mères qui ont plusieurs enfants etqui, de plus, ont parfois recouru aux services de l'hôpital oudu dispensaire. Cette expérience leur permet de formuler undiagnostic correct lors d'un autre épisode pathologique pourun autre enfant.
Sunfuru (sun : toux, rhume & furu : blanc ; lit. « touxblanche ») décrit la tuberculose qui est considérée commeétant une « maladie de famille »16. Elle est appelée touxblanche non pas pour la couleur du crachat mais pour le teintpâle qu'ont ceux qui en sont affectés17 . Sunfuru commencecomme une toux normale mais incurable. Le catarrhe estconsidéré contagieux et les enfants et les adultes qui en souffrent sont alimentés séparément du reste de la famille. Leurshabits et les ustensiles de leur repas sont lavés à part18.
Les mères parlent aussi de « toux compliquée », de« mauvaise toux » sun yo' (sun : toux; yo : mauvaise; lit.« mauvaise toux ») ou de « maladie de la poitrine " dun ba
15 La notion émique de " corps chaud» à été développée à propos du paludisme par D. Bonnet (1990, 241-258). « Corps chaud en bobo: "kantaga"» (kan: corps; taga : feu; litt. "feu du corps, fièvre »).
16 Par" maladie de famille » on désigne des maladies qui sont présentesau sein du lignage, même si tous les membres n'en sont pas forcémenttouchés. C'est le cas aussi de la drépanocytose très fréquente dans lazone d'enquête.
17 M. Dacher (1992 : 114) donne la même information au sujet de la tuberculose dans la société gouin.
18 Soulignons qu'il faut considérer spécifiquement la tuberculose. En effet,bien que sa couverture vaccinale ait atteint 63,34 en 1999, son lien avecla pandémie du VIH fait qu'elle représente actuellement une des principales causes d'hospitalisation pédiatrique.
172 Les maladies de passage
(dun : poitrine; ba : mal), ou de « maladie du froid », laganduru lu (laganduru : maladie ; lu : froid) en se référant àchaque fois à un type de toux persistante, très débilitante,qui tend à s'aggraver au point que l'enfant ou l'adulte qui enest touché ne réussit même plus à tousser. Niunu bana fa(niunu : respirer; bana : fatigue; fa : chose; lit. « la chose quifait respirer avec fatigue ») selon certains désignerait fréquemment de l'asthme. Cette affection est considérée parcertains comme une maladie contagieuse alors que pourd'autres, elle est simplement provoquée par le froid etl'humidité. Par la locution yanaon ba, « maladie du flanc »
(yanaon : flanc ; ba : mal ; lit. « maladie du flanc ») certainesmères nomment la pneumonie19. Yanaon ba est aussi considérée une maladie non contagieuse, provoquée par le froid.Anatomiquement elle correspondrait à une maladie du« foie2o ».
Le kpégélège
Le kpégélège est une maladie naturelle jugée très difficile à soigner. Cette affection, dont les personnes interrogéesne connaîssent pas l'origine, fait partie des « entités nosologiques populaires internes » bobo21 , et ne trouve pas de correspondance dans le domaine biomédical. De fait, lorsquel'enfant en est atteint, les mères n'ont pas recours à l'hôpital,et se tournent vers les guérisseurs bobo. Selon elles, il s'agitd'une maladie de la poitrine qui provoque de la toux et de lafièvre et qui touche uniquement les enfants âgés de quelques
19 A propos de la pneumonie, j'ai retrouvé la même expression, " maladiedu flanc ", dans l'enquête menée en pays bobo par le R.P. de Montjoye(1952 : 9).
20 Selon l'anatomIe bobo, sous le terme" foie" sont indiqués un ensembled'organes internes, considérés comme" plats ", et " collés" aux côtescomme les poumons. Au centre de ces organes résiderait le cœur, quiest décrit comme une gourde, donc" rond ". Le cœur réguleraIt toute lacirculation sanguine dans le corps. Wora tutulu (wora : foie, poumons,cœur; tutulu : gourde,) exprime à la fois un complexe anatomique detype respIratoire et dIgestif, mais aussi l'organe anatomique lui-même,le myocarde. Au sujet des perceptions populaires relatives à l'anatomienous renvoyons à Durif-Bruckert (1994).
21 Au sujet des entités nosologiques populaires en Mrique de l'Ouest, voirJaffré & Olivier de Sardan (2000).
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 173
mois à 3 ou 4 ans. L'enfant a d'énormes difficultés à respirer,il a de la fièvre, il a froid et pleure continûment. Il refuse detéter ou de manger et il devient « grognon ". On dit alors quele kpégélège empêche la respiration des bébés au niveau de lapoitrine ».
Les guérisseurs bobo ou les femmes âgées qui connaissent cette pathologie palpent la poitrine de l'enfant poursavoir s'il s'agit ou non de kpégélège. Si le diagnostic est positif, on fait une série de petites scarifications, généralementau nombre de seize, sur la poitrine et sur le dos à la hauteurdes omoplates. Certains guérisseurs insèrent aussi des« poudres noires ,,22 à l'intérieur des scarifications. Ensuite,on lave l'enfant à l'eau froide pour arrêter le saignement eton le frictionne avec du beurre de karité. Les mères affirment que ces incisions permettent au corps de « mieux respirer ». Parallèlement à cette intervention, on donne à l'enfantune tisane avec laquelle on le lave pendant plusieurs jours.Soulignons que les entretiens faits à l'hôpital ont montré quetous les enfants qui avaient été soignés pour cette maladiedu kpégélège, ont été diagnostiqués comme souffrant d'unepneumonie.
Reste enfin un vaste ensemble de toux liées à la saisondes récoltes. Elles sont qualifiées par leur origine: tugusun23 , toux de mil; sun fen 24 toux de fonia ; demen sun25 ,
toux de haricot; bàmakâ sun26 , toux de maïs ...
22 Il s'agit de racines, brulées et réduites en poudre.
23 Dugo: petit mil.
24 Fen: ronio Wigttana exilis).
25 Demen: haricot locale (Vtgna unguiculata).
26 En ville, les gens commencent à mentionner aussi la <, toux de cigarette ",ou la toux due à la pollution provoquée par les cyclomoteurs et les voitures. On parle aussi de « toux de cola" (wolo : cola; sun: toux) et de« toux de chien ", dans ce deuxième cas pour décrire une toux ancienne,rare et qu'on ne peut guérir, qui provoque des diarrhées sanglantes etpermanentes.
174 Les maladies de passage
Ethnophysiopathologie bobo de la formation du " rhume"et des toux.
La poussière que l'on inspire est censée atteindre latête par les narines. Les personnes interrogées pensent que lasubstance visqueuse qui constitue la morve se forme dans latête par une interaction entre la poussière et le « cerveau »27.
Première étape, le nez joue donc un rôle dans la répartition de l'air respiré. Sa base est censée communiquer avecla gorge et la nuque. Derrière la nuque, où se trouveraientaussi les terminaisons des yeux, il y aurait une sorte de tubequi communique avec le cerveau. En ce même lieu anatomique, il y aurait aussi une sorte de « poubelle » où se déposeraient la poussière et les saletés. Quand on dort, les yeuxse retournent libérant l'ouverture de ces tubes. La saleté yentre et peut communiquer avec le cerveau, ou rester derrière les yeux et dans la nuque. Quand la saleté ne réussit pas àsortir, on suppose qu'elle couvre la vue et peut entraîner lacécité. Quand les enfants ne réussissent pas à ouvrir lesyeux, ils sont lavés avec de l'eau et on leur applique un traitement.
C'est cette poussière qui monte à la tête à travers lesnarines et qui, au contact avec le cerveau, forme les mucosités. Voilà pourquoi les sécrétions nasales sont perçuescomme duma, littéralement une « saleté » expulsée par lesnarines.
Dans les représentations populaires, le cerveau estdonc assimilé à un filtre, épurant l'air et faisant converger lasaleté présente dans la poussière vers un réceptacle, sorte depoubelle, située au niveau du cervelet. On pense qu'un semblable espace se trouve aussi entre les oreilles et le cerveauet que, toujours à travers les narines, s'y dépose la saleté quiavec le temps se décompose et « pourrit ». Et c'est ainsiqu'arrivent les maux de tête wàn tulu ba (wàn : tête; tùlù :
27 Dans les entretiens qui ont lieu en langue française, les gens emplOlentle terme cerveau pour se référer soit au crâne soit au cerveau. Enlangue bobo, la distinction est, par contre, très nette. On appelle la tête,au sens de crâne won tulu (won: crâne; tulu : gourdeJ et le cerveau wonloro won: tête; loro : dans; litt: « dans la tête" J.
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 175
gourde; ba : ma!), la fièvre et l'occlusion du nez. A ce stadede la maladie, des inhalations ou le fait d'aspirer du tabacpeuvent arrêter le processus de décomposition. On dit alorsque « la médecine a fait pourrir définitivement les saletés quiressortent ». On dit aussi que « le médicament attrape lanuque par derrière» et que cela provoque les éternuements.
La saleté inspirée et sa décomposition agissent de lamême manière en ce qui concerne les yeux et les oreilles. Etc'est pourquoi, durant la saison sèche, lorsque l'harmattansouffie, on voit souvent des gens qui protègent leurs oreillesavec du coton. En outre, un surplus de vent reste dans lecorps et en sort par les éternuements « au moment où lamaladie explose ». « Quand tu éternues, tu sens qu'il y a duvent qui sort, quand tu te mouches tu sens qu'il y a du dumaou du bin zio qui sort, c'est la saleté qui s'en va ».
Autre ouverture, la bouche ne communique pas avec lecerveau car elle est au service du ventre. Il peut cependant yentrer une poussière chargée de saletés. Mais, ne pouvantmonter à la tête, elle descend sur la poitrine : « Si dans l'airil y a trop de poussière, ça descend pour se poser sur les poumons et les abîmer et aussi les contaminer ». On prescritalors un régime alimentaire particulier où tout ce qui a de lamousse est adéquat (bière, boissons pétillantes, etc.).
Enfin, l'air entrerait aussi dans le corps par lesespaces intercostaux où il y aurait des « filtres » ou des« trous» qui communiqueraient avec l'extérieur. Si l'air froidy pénètre, il fait gonfler les poumons, le sang ne circule plus,et les poumons n'ayant plus d'espace ne réussissent plus àfonctionner.
La transmission des IRA
La transmission d'une maladie est le plus fréquemment exprimée en langue bobo par le terme kpirèbè, signifiant « passer d'un côté à l'autre ». On peut aussi dire :laganduru kpire (laganduru : laga signifie équilibre physiqueou santé et duru signifie absence, manque, pauvreté). Enfinon emploie aussi l'expression : wi kpire : passer, (lit. « lamaladie est passée du malade au sain »). Le concept de
176 Les maladies de passage
transmission rassemble donc deux idées, celle d'une transmission et celle d'un passage de l'équilibre à l'instabilité.
Cette idée de la contamination est strictement liée auxnotions d'hygiène et de propreté du corps interne et externe.Soulignons que ce sens recoupe aussi la notion d'hygiène« importée ». En effet, on pense que certaines maladiess'attrapent par manque d'hygiène. On évoque toujours lerhume, la toux, la méningite, la rougeole comme étant desmaladies pour lesquelles les « microbes » seraient transportés par le vent et la poussière chargés de saletés.
Cette notion de saleté, qui, comme nous l'avons déjàsouligné, est importante en pays bobo, est différenciée endeux grands ensembles. L'un correspond à la poussière etautres scories qui se posent sur le corps et le pénètrent.Résultant de ce processus, la transpiration (fogoro :sueur/transpiration; de fogo : poudre) est considérée commede la saleté que le corps expulse. Et c'est pourquoi laverl'enfant chaque jour est important. Il s'agit ainsi d'éliminerles saletés qui obstruent les pores, et empêchent la peau de« respirer » normalement. Bref, « dans la poussière on trouve de tout, et quand la maladie attaque quelqu'un, elle setransmet ensuite aux autres. Et par exemple, si les gens crachent par terre, le vent transporte cette saleté sèche dansl'air et elle contamine les autres facilement ».
L'autre ensemble correspond à plusieurs facteurs maissurtout à la nourriture. On considère, en effet, que chaquealiment est porteur d'une petite quantité de « venin ", etdonc, que certains régimes alimentaires favorisent la formation et l'accumulation de la saleté dans l'organisme humain.
Les types de contamination évoqués à propos des IRA
Les différents types de contamination sont nombreuxet nous nous bornerons ici à les citer et à les qualifier trèsbrièvement. La maladie peut se transmettre par contact, et,par exemple, il suffit de donner la main à une personneaprès s'être mouché le nez pour éventuellement être contaminé. C'est notamment le cas durant l'allaitement, si la mèrese mouche le nez avec les mains et ensuite donne le sein à
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 177
l'enfant, ce dernier peut tomber malade28. Réciproquement,elle peut elle-même l'attrapper puisque les mères bobo ontl'habitude d'aspirer la mucosité du nouveau-né avec labouche pour lui libérer le nez et l'aider à mieux respirer lorsqu'il est enrhumé. L'air aussi, lorsqu'on partage le mêmeespace avec quelqu'un qui éternue ou tousse, peut devenirdangereux. Ce mode de contagion est le plus évoqué, puisquel'air et la poussière, transportés par le vent sont décritscomme étant hautement pathogènes. Outre les IRA, le ventest aussi supposé à l'origine des pathologies de l'œil et del'ouie. L'air et la poussière transportés par le vent sont doncglobalement perçus comme une substance pathogène trèscontagieuse. Un autre discours, bien que moins fréquent, estrelatif à la pollution atmosphérique et à celle des eaux. Onimpute les maladies dans le premier cas à l'utilisation massive d'engrais pour les cultures, nasara kuru, le fumier desBlancs et, dans le second aux déchets des usines qui polluentles eaux du fleuve qui traverse la ville de Bobo, et les rivièresde certains villages proches de la ville29. Cette transmissionest souvent attribuée à un changement dans les conduites.On dit ainsi que « le rhume existait depuis toujours, maisqu'il n'avait pas les effets inquiétants d'aujourd'hui ". Etencore : « les gens se mouchent et crachent n'importe où, etc'est avec la poussière que les maladies viennent".
Les aliments, lorsqu'on partage un repas ou qu'on termine celui d'un malade sont aussi des vecteurs de contamination. A ce propos, les mères parlent de la contagion par lesmangues que les enfants souvent se partagent. Il en va demême des ustensiles de cuisine si, par exemple, on fait circuler un même gobelet.
28 Au sujet de la transmission mère-enfant, nous renvoyons à Alfieri etTaverne (2000).
29 Dans le cas de la pollution des eaux, les gens racontent qu'à certainsendroits de la ville, l'eau, qui est recueillie par les femmes, est de couleur rougeâtre et, avant de l'utiliser pour la cuisine, la boisson et lebain, il faut attendre qu'elle décante au fond du canaris. Un autreaspect de la pollution, assez récent, est lié à la mort par empoisonnement des silures, poissons sacrés pour les Bobo, qui étaient présents enville à certains endrOits du fleuve et dont la disparition entraîne aussila déstabilisatIon de certaines pratiques religieuses intrinsèques à laculture bobo.
178 Les maladies de passage
Il en va de même des habits et des pagnes dans lesquels sont enveloppés les enfants : « la transpiration quiimpreigne les habits peut véhiculer certaines maladiescomme la rougeole. Quand un enfant est enveloppé dans unpagne contaminé, il peut l'attraper ,,30.
Tous s'accordent sur une même interprétation, lorsquela maladie est « installée dans le corps ", la personne atteintedevient elle-même un vecteur : « Quand ça attrape une seulepersonne après c'est tout le monde ".
Les recours thérapeutiques
A ses débuts, le rhume ne préoccupe pas les mèrespuisque la morve (bin zia) n'est, après tout, que « l'eau dunez ". C'est seulement quand ce liquide change de consistance et de couleur, qu'il devient jaune, a une mauvaise odeur etqu'apparaissent d'autres symptômes - pleurs, fièvre et touxpersistante - que les mères commencent à s'inquièter. « Tantque l'enfant ne fait pas de fièvre, on se dit que ça peut passer. Dès que la fièvre arrive, on s'inquiète »31.
Le diagnostic est le plus souvent effectué par lesfemmes et les grand-mères en fonction de la gravité de la toux,de la manière de tousser et selon le mouvement de la respiration. Parfois elles réussissent à déceler s'il s'agit de toux sèche,de toux normale ou de toux grave ou « compliquée".
Mais, le plus souvent, ce n'est qu'après avoir appliquéles traitements traditionnels, sans obtenir de résultats satisfaisants, que les familles ont recours à l'hôpital. En effet,« pour qu'il y ait maladie, il faut qu'il y ait durée du symptôme " (Bonnet 1988 : 77). La seconde étape de soins est fréquemment le dispensaire qui orientera vers l'hôpital si lasituation est critique. De fait, une enquête, faite en 1998auprès de la Division Pédiatrique de l'hôpital de BoboDioulasso, souligne que, dans la majorité des cas, les enfants
30 A propos de la rougeole, voir les études de Jaffré (1991), Fassin (1994),Nichter (1995).
31 En 1995, à l'hôpital de Bobo-Dioulasso, la fièvre constituait 60% desconsultations pédiatriques (corn. pers. du docteur Nacro)
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 179
arrivent à l'hôpital dans des conditions dramatiques. LesIRA se sont aggravées à cause d'un manque de soins qu'onpeut notamment attribuer à un système de santé organisépar « palliers successifs» - ce qui augmente le temps d'accèsau bon diagnostic et donc au bon traitement - et non pas spécifiquement à la réaction tardive des mères comme le personnel soignant a trop tendance à le dire d'une manière exclusive. Ceci explique, malheureusement, le pourcentage élevédes décès suite à l'hospitalisation. Certes, il ressort de cesentretiens que les enfants atteints de pathologies respiratoires souffrent aussi de kolon (candidoses buccales) et dekotigè32 (fissures anales), affections qui focalisent l'attentiondes mères et ne les conduisent pas à se rendre directementau dispensaire. Dans ce cas, les mères massent l'anus del'enfant avec du beurre de karité ou d'autres produits pharmaceutiques comme le Mentolatum® ou le Végébaum®, poursoigner les pathologies anales que cette affection provoque,mais aussi dans l'espoir d'accélérer la guérison de la toux:33.
Il ne s'agit donc pas d'analyser ces conduites en fonction de ce qui relèverait uniquement de « résistances culturelles ». Les gens savent que la médecine moderne soigne lespathologies respiratoires graves, mais que l'accès au traitement dépend aussi des possibilités économiques34 et sociales.
32 Ces deux entités nosologiques populaires exprimées par les mères enlangue dioula, ont fait aussi l'objet d'étude, dans la ville de BoboDioulasso, par Roger-Petitjean (1999) et Desclaux (2000). Comme il estsouligné dans les travaux ci-dessus, le kàtigè ne serait pas seulementun effet de la toux, mais il serait dû aussi au fait de rester assis à desendroits sales ou humides, ou de garder les mêmes caleçons, parfoismouillés d'urine pendant longtemps, en créant ainsi une irritation de lazone anale. Une alimentation trop riche en sucre est aussi considéréecomme étant à la base de cette affection
33 Les mères soutiennent que si l'enfant tousse cela concerne aussi l'anus.A ce propos, voilà ce que dit un guérisseur bobo renommé: « Quand lesadultes toussent, l'anus est ouvert et ses muscles détendus, lorsqu'ils seraffermissent la toux s'en va. Quand on tousse, c'est tout le corps quitousse et l'anus est le lieu où démarre la santé de tout le corps. La touxpeut amener le kàtlgè , car c'est tout le corps qui est secoué ".
34 Une étude menée en 1992 à l'hôpital de Bobo-Dioulasso (TaU, Nacro,1992) informe qu'un stock réduit de médicaments indispensables etessentiels est vendu à l'unité par la pharmacie de l'hôpital, et à des prixnettement inférieurs aux pharmacies privées, mais aussi que, dans lecas de patients indigents, leur prise en charge au niveau des médicaments est gratuite.
180 Les maladies de passage
A cela il faut encore ajouter une mauvaise qualité des rapports entre les familles et le personnel médical et paramédical. De nos entretiens, il ressort que les mères et les famillesqui réussissent à arriver à l'hôpital y sont souvent malreçues. On les accuse notamment d'avoir amené l'enfant troptard. D'autres se plaignent qu'après quelques jours d'hospitalisation et plusieurs examens et soins, on ne leur ait communiqué ni le diagnostic ni la thérapie entreprise. Lorsqueles familles ne parlent ni français, ni dioula35 , elles disentêtre l'objet de discriminations dans les soins et les traitements et être aussi victimes d'actes d'escroqueries de la partdu personne136. Tout ceci démontre la difficulté de l'utilisation des recours disponibles et la nécessité d'une analyse deleurs dysfonctionnements.
Imbrications, liens et conflits, entre les systèmes populaireet médical de traitement et de prévention des IRA
Pour soigner les affections respiratoires et les pathologies infantiles, les mères ont recours à diverses thérapies. Ilpeut s'agir de connaissances enseignées dans la famille, desoins conseillés par le voisinage, de savoirs plus spécialisésde guérisseurs ou d'autres « spécialistes » des maladiesinfantiles et, actuellement, d'informations reçues au dispensaire ou à la SMI (Santé Maternelle et Infantile).
En ville, pour accéder aux soins médicaux, les mèrescherchent, souvent par le réseau familial, une personne travaillant dans une structure médicale pour avoir un conseilou une aide, soit pour franchir plus vite les « palliers » dusystème soit à des fins économiques. En effet, le prix desmédicaments pratiqué par le dispensaire ou la pharmacierend leur achat très souvent impossible. C'est pourquoi ons'adresse facilement à une « médecine» locale distribuée pardes herboristes ou des marchands ambulants qui, le plus
35 Le dioula est une langue véhiculaire d'origine mandingue qui compte denombreux locuteurs dans la région.
36 A propos de J'interaction entre patients et personnel de santé, nous renvoyons à Jaffré (1994 & 1999) ; Jaffré et Prual (1994) ; Desclaux (2000) ;DiaIJo (2000) ; Ouattara (2000).
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 181
souvent, ne possèdent aucune connaissance sur les produitsqu'ils offrent. Au Burkina comme à Bamako « il ne s'agitaucunement de spécialisation ou de « filières locales de formation ", et, s'il y a naissance d'une nouvelle professionurbaine du « secteur informel », elle concerne plutôt l'acquisition d'aptitudes commerciales - connaître notamment lesréseaux pour se procurer les produits - que la maîtrise et lavolonté de progresser dans les domaines du diagnostic et dela thérapeutique» Jaffré (1999 : 65). Ce réseau informeldonne l'illusion de prix plus abordables parce qu'il est possible d'acheter des produits à l'unité. Mais ceux-ci sont d'origines diverses, souvent du Nigéria, et douteuses37 . Ce sontsouvent des contrefaçons de produits conventionnels, dont lecontenu est inconnu (Chillio 1996). En outre, un réseau devente « à domicile» - oscillant entre le semi-traditionnel et lesemi-biomédical - se développe. Toujours dans ce secteur« néo traditionnel », dans certains quartiers urbains, on rencontre des personnes - infirmiers à la retraite ou religieuxafricains - qui proposent leurs traitements et préparentleurs propres médicaments pour « soigner» la toux et lerhume mais aussi d'autres pathologies. Il s'agit, le plus souvent, de flacons de sirops à base de plantes ou de grainesvégétales mélangées au beurre de karité qui, selon les mères,sont efficaces s'ils sont pris dès les premiers symptômes.
Parmi ces produits, une place particulière doit être faiteà ce que l'on désigne du nom de Mentolatum® et qui regroupeun produit mais aussi un ensemble de baumes que les mèresutilisent dans le traitement des IRA. Il s'agit de produits à basede méthylacrylique, camphre, menthe et eucalyptus qui sontutilisés à la fois par voie orale ou par friction sur la peau pourcalmer et soigner les « maladies de refroidissement ». Même siles indications portées sur les notices spécifient qu'il s'agit de
37 Dans le bulletin de février 2001, l'OMS souligne comment la contrefaçon de médicaments expose les populations des pays pauvres, et surtoutles enfants, à des handIcaps permanents ou à des risques mortels: parexemple, le cas de l'éthylène glycol, produit antigel, qui est encoreaujourd'hui utilisé par des laboratoires pharmaceutiques clandestinspour la composition de sirops pour la toux. L'utilisation de cette substance provoqua la mort de 236 enfants en 1990 au Bangladesh, d'environ 100 enfants en 1991 au Nigeria. Les « rescapés" eurent des affections permanentes aux reins.
182 Les maladies de passage
produits uniquement à usage externe, les habitudes courantesdans l'utilisation et le faible pourcentage de gens alphabétisésfont que ces indications ne sont pas toujours prises en compte.Qui plus est, dans le cas du Robb® de production nigériane oudu Menthol Balm® de production chinoise les instructions sonten langues étrangères. On pense que ces produits sont efficacesà cause de leurs caractéristiques « piquantes » : leur actioncréerait une forte transpiration qui libèrerait le corps de sesimpuretés38. On distingue encore le mentolatum blanc et lerouge. Ce dernier étant considéré plus puissant, il est utilisédans les cas les plus graves. Il existe aussi un mentolatum, très« piquant» vendu par les femmes yoruba sous forme de« petites boules jaunes »au prix de 25,50 FCFA.
Les mères affirment prendre beaucoup de précautionsdans l'utilisation de ces baumes, et surtout durant la saisonsèche. L'enfant enrhumé est lavé et massé avec le baume, onlui enduit abondamment la poitrine, ensuite il faut bien lecouvrir et le protéger du vent et de la poussière qui, sanscette protection, lui collerait au corps et le contaminerait.
Avec le mentolatum on masse la poitrine, et on enapplique sur les lèvres, dans les narines et aussi sur l'anus etceci même si l'enfant est simplement enrhumé afin d'éviterl'affection nommée kàtigè39 . Pour la toux, on boit du mentolatum dilué dans de l'eau chaude, mais généralement on ne ladonne pas aux enfants de moins de 4 ou 5 ans. On utiliseaussi des infusions à inhaler.
Ces différents types de mentolatum constituent lavariante urbaine du beurre de karité qui reste cependanttrès utilisé. C'est précisément dans ces modalités d'utilisation traditionnelle du beurre de karité que le mentolatum a
38 La présence dans ces produits du méthylsalicylate, antiphlogistique etanalgésique pour une utilIsation topique est évidemment fortementtoxique et peut provoquer, même en petites quantités, des nausées, desvomissements, des œdèmes pulmonaires, des convulsIOns jusqu'à lamort. Le camphre, qui est conseillé seulement pour un usage externe,peut provoquer des troubles gastriques (cf. Casiglia et Gava, 1998: 275).
39 Le massage anal, très pratiqué dans cette zone pour le traitement dukotigè est aussi mentionné en pays songhai-zarma au Niger. Il est pratiqué par des « spécialistes de famille " pour le soin du weyno dans samanifestation sous forme d'hémorroides, cf. Olivier de Sardan, 1999:256.
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 183
pris place : pratique « d'indigénisation " des produits pharmaceutiques largement répandue en Afrique Occidentale oùles populations utilisent les baumes de la même manière queleurs produits traditionnels. Cette pratique est fort répandueen Afrique de l'Ouest. Ainsi dans le Sud-Est du Nigeria, lesmères utilisent des pommades qui réchauffent le corps pourlutter contre le froid auquel l'enfant a été exposé (Etkin,Ross, & al. 1990). Elles ont aussi recours au mentolatumRobb®, en frottant les paupières de l'enfant ou en lui massant la poitrine « pour la réchauffer ", ou encore en l'administrant par voie orale avec de l'eau chaude.
Dans les enquêtes menées en région bobo, l'action deces produits est considérée utile, car productrice de chaleuret favorisant la transpiration, et par la même, l'éliminationde la saleté (celle qui empêche le corps de respirer).
Les discours et les pratiques concernant l'évitement de lamaladie
Nombre de discours concernant l'évitement et la transmission des maladies sont stéréotypés. De plus, la plupart dutemps, les conduites observées ne suivent pas ces propos.Cependant, certaines règles d'hygiène semblent être respectées, comme celle de ne pas cracher à côté ou à l'intérieur dela cuisine, ainsi que dans les endroits où les aliments sontmanipulés et transformés. Il est dit aussi, que les rats de lamaison « sont gourmands" de catarrhe et de mucosités, c'estpourquoi il est rare que les gens mangent les rats attrapés àl'intérieur ou aux alentours de la maison. Ceux qui le font,les lavent soigneusement, et les laissent tremper longtempsdans de la potasse avant de les cuisiner. La viande de rat quin'est pas suffisamment désinfectée est susceptible de transmettre la toux, le rhume et la tuberculose.
La manière de se moucher avec les doigts, et l'apprentissage de ce geste par les enfants, vise à éviter certainscontacts. Il faut apprendre, en pressant sur les narines, àprojeter la morve loin de soi et ainsi à pas se salir les mainset les vêtements avec les mucosités. L'utilisation de mouchoirs est très rare.
184 Les maladies de passage
Soulignons cependant que si les gens tiennent un discours assez codifié quant aux différentes formes d'évitementde la contagion, en pratique, ils ne font, ou ne peuvent pasfaire attention aux types « classiques" de recommandations.Par exemple, éviter d'enjamber des traces d'urine,d'employer des médicaments périmés ou des éponges végétales « communautaires ", utilisées parfois aussi bien pour lebain des personnes malades que pour les autres. En ville, ledanger est considéré comme majeur, car certaines règlesd'évitement de la transmission sont en contradiction avecdes espaces plus restreints qu'en zone rural. Des familles,qui ne sont pas nécessairement apparentées, doivent cohabiter dans la même unité domestique.
Les soins quotidiens et les" préventions populaires" des IRAchez l'enfant
Différents types de conduites guident les mères ou lesfemmes qui s'occupent des enfants en bas âge. Il s'agit deconduites préventives qui relèvent à la fois des savoirs etconseils traditionnels et des actions de sensibilisation« importées" menées auprès des mères par les sagesfemmes lors des consultations aux SMI (Santé Maternelle etInfantile) ou à travers des « causeries éducatives" dans desCentres de Récupération et d'Éducation Nutritionnelle(CREN). Les femmes citent aussi, des émissions médicalesradiophoniques, faites dans la langue locale, le dioula, pardes spécialistes qui donnent des conseils selon les saisons etles maladies susceptibles d'être contractées. Les journaux etles hebdomadaires4o publient encore des rubriques et desservices à caractère médico-préventif.
Les échanges d'informations entre femmes d'un mêmeréseau de voisinage sont également un facteur de diffusion et
40 Le mensuel" Votre Santé» du mois de février 1999 a été en grande partie consacré aux maladies respiratoires infantiles et aux bienfaits desvaccinations. Malheureusement, ces publications ne sont lues que parune petite minorité de la population, ceci s'explique par une doublecause: le coût des journaux et le faible taux d'alphabétisation, 19 % (Lasituation des enfants dans le monde 2001: 78).
Prévention des infections respiratoires aigués en population bobo 185
de comparaison entre les différentes « stratégies de prévention et de soins » des IRA infantiles et, plus généralement, detoutes les pathologies infantiles.
Enfin, on constate que les femmes préviennent lespathologies de leurs enfants à travers des pratiques, que l'onpourrait nommer de « bon sens », et au sein de la famille,véritable lieu« dispensateur des soins » (Cook &Dommergues 1993 : 45). Par exemple, durant les mois oùsouffie l'harmattan les très jeunes enfants doivent être gardés à la maison, bien couverts, et surtout au niveau de la poitrine et des côtes, là où le froid et l'humidité pénètreraientplus facilement. Globalement, ce « travail domestique desanté » (Cresson 1995) est essentiellement féminin, et correspond tant à des comportements « traditionnels » de bon sensqu'à des pratiques plus récentes.
En fait, ces conduites correspondent à un syncrétismeet à une adaptation du mode de vie aux conditions du milieu.La pauvreté extrême d'une grande partie de la population(aggravée par la dévaluation de la monnaie) rend cette population souvent dépourvue de vêtements pour se protéger dufroid. Si l'on ajoute le manque de puits, de fontaines et derobinets, on comprend bien la difficulté de mettre en œuvreles conseils pour appliquer les mesures biomédicales d'hygiène les plus élémentaires41 . C'est pourquoi, les conseilsconcernant le fait de couvrir les enfants durant la saison froide et humide sont parfois suivis, quelquefois peu respectés,car la majorité de la population n'a pas la possibilité de lesappliquer. Un discours « néo traditionnaliste » où l'on ditqu'autrefois le corps« apprenait» à se défendre tout seul dufroid et que les enfants tombaient malades moins souventqu'aujourd'hui, donne, paradoxalement, un sens «hygiéniste »à l'explication des maladies infantiles42• Par exemple, un instituteur de Bobo-Dioulasso affirme : « Maintenant il y a le
41 Une étude de 1991 soulignait que dans la ville de Bobo-Dioulasso, seulement 43 % de la population avait un robinet dans la concession (Planquinquennal de développement sanitaire du Houet).
42 Jusqu'aux environs des années 1950 les Bobo utilisaient peu de vêtements. Une famille pouvait posséder un seul habit ou un chapeau, quicirculait parmi ceux qui devaient voyager hors du village. Cet habillement est donc récent, a fortwri celui des enfants.
186 Les maladies de passage
problème aigu des maladies respiratoires. Les embarras respiratoires se situent au niveau des viscères et c'est pour çaqu'on conseille de bien s'habiller. L'air doit rentrer dequelque part pour se retrouver dans les viscères. Dans letemps, il y avait une immunisation générale: tu te protégeais en ne protégeant pas. On ne veut pas que tu t'exposes,alors que tu es exposé. On ne peut pas recommander des protections que les gens ne peuvent pas se permettre. La protection d'une manière générale, c'est un problème d'hygiène ».
C'est ainsi que les conseils que donnent les SMI sontpartiellement acceptés en ville, lorsqu'ils sont simples : parexemple, couvrir légèrement les enfants lorsqu'il fait chaudau lieu de les déshabiller complètement, les laver aux heureschaudes et avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont enrhumés, Dansla mesure du possible les mères cherchent aussi à ne paslaisser jouer leurs enfants avec l'eau trop longtemps, toutcomme elles cherchent à éviter aux nourissons de resterassis longtemps par terre au contact de l'humidité et de lasaleté. Elles essaient aussi de contrôler l'éventuelle ingestiondes restes de repas, qui pourraient être souillés par lesmouches, les rats ou les chiens de la concession. Durant lapériode de l'harmattan, une bonne partie des femmes, cellesqui ont un puit dans la cour, ont soin d'asperger le sol de laconcession après l'avoir balayée, pour empêcher la poussièrede circuler, puisque, comme nous l'avons dit précédemment,ces situations favoriseraient l'arrivée d'un rhume et de latoux.
Ces conduites sont préconisées et observées parl'entourage. En cas de maladies infantiles certains parentspeuvent évoquer la « négligence de la mère» (Bonnet 1996 ;Desclaux, 1996). Pour certaines femmes, le mauvais « entretien» de l'enfant, y compris dans un sens « hygiéniste biomédical » (Desclaux, ibid.), serait à la base de toutes manifestations morbides chez l'enfant. C'est ainsi qu'une mère nousdécrit l'évolution de la pathologie respiratoire : « Si la mèrenéglige son enfant, il peut attraper beaucoup de maladies,.Après la toux, si on ne le soigne pas, c'est la bronchite. Il y ades mères qui ne soignent pas tout de suite. Elles disent queça ne va pas durer, mais si ça dure ça peut amener l'enfant àl'hôpital. A force de rester dans les poumons, la toux se
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 187
transforme en bronchite. L'entretien de l'enfant dépend desmères, en brousse et en ville aussi. Il y en a qui disentqu'elles n'ont pas les moyens pour soigner, d'autres quidisent que c'est passager et si la maladie s'aggrave, en général elles se tournent vers la médecine traditionnelle ».
La notion de prévention et de vigilance des mères necorrespond pas à une notion strictement biomédicale. Lessoins pour la propreté (décoctions de feuilles ou de racines,beurre de karité parfois mélangé à de la poudre de charbon)ont pour fonction de renforcer la peau et l'organisme del'enfant et le savon est quelquefois considéré comme un élément qui enlève de la force à l'enfant. Il éliminerait les effetsdes bains phytothérapeutiques. « Toute la force du médicament s'en va avec le savon» déclarent certaines mères, ouencore, « le savon ce n'est pas bien, puisqu'il affaiblit la peau ».Dans ce contexte, les normes de propreté modernes, sontnommées par l'expression locale :« l'hygiène au savon ».
La toilette de l'enfant est l'occasion d'administrer àl'enfant divers médicaments sous forme de tisanes et par l'eaudu bain. Il s'agit de feuilles spéciales, préalablementbouillies43 , que l'enfant prend oralement, mais aussi à traversla peau puisqu'on suppose que le bain a la vertu de faire pénétrer le médicament à l'intérieur du corps, à travers les poresqui s'ouvriraient au contact de l'eau chaude rendant ainsi plusefficace le traitement44• Jusqu'à deux ans, le nouveau-né estlavé au moins trois fois par jour. S'il pleure, on poursuit la toilette car les mères pensent qu'il sent encore des saletés surson corps. Il peut aussi ressentir une certaine sécheresse corporelle avec la perte des larmes. Après le bain on essuie soigneusement l'enfant et on enduit son corps de beurre de karité. On lui souffie dans les narines pour en expulser le résidud'eau qui pourrait provoquer un rhume. Enfin, la bouche et lesgencives sont également lavées et massées pour calmer la douleur d'une éventuelle dentition en cours45. Si l'enfant est mala-
43 A propos des pratiques de puériculture bobo voir Alfieri (2000).
44 A propos des pratiques hygiénistes ou de propreté voir Vigarello (1985)
45 Dans les causes Imputées aux IRA, les mères mentionnent souvent ladentition comme facteur favorisant le rhume, la toux et la diarrhée.Durant cette période, une corde avec un morceau d'os ou de bois est liéeau poignet de l'enfant pour qu'il puisse la mastiquer.
188 Les maladies de passage
de, on maintient une toilette quotidienne et en insistant surtout sur le nettoyage du nez lorsqu'il est sec. On lui frictionnerégulièrement la poitrine au beurre de karité et la nuit onintroduit aussi du produit dans les narines.
Malgré ces nombreuses pratiques domestiques, uneétude concernant les comportements et les pratiques d'hygiène en rapport avec les diarrhées (Kanki & Curtis 1993) amontré que, lorsqu'il s'agit d'un petit enfant, les règlesd'hygiéne les plus élémentaires ne sont pas pratiquées. Parexemple, la conception populaire que l'on a du nourrisson faitque ses déchets ne sont pas perçus comme de véritables« saletés ». En effet, la salive, le cathare et les excrémentsdu jeune enfant sont considérés comme étant moins salesque ceux de l'adulte. Cette croyance se base sur la différenceentre les aliments consommés: l'enfant se nourrit du laitmaternel, et de ce fait est considéré comme faisant partied'un cycle alimentaire mère-enfant. Quand l'enfant tète lesein de la mère, il mange ce qui a été produit pour lui par lecorps de la mère. Ses excrétions seraient donc moins malsaines que celles d'un enfant déjà sevré. Et c'est pour celaqu'elles ne font pas l'objet d'un nettoyage méticuleux,lorsque, par exemple, l'enfant fait ses selles. Ce n'estqu'après le sevrage, et le passage aux aliments solides, traités et cuisinés, que les liquides organiques et surtout lesselles de l'enfant sont jugés sales. C'est d'ailleurs vers l'âgede deux ans que les mères enseignent à leurs enfants à faireleurs besoins seuls, à l'extérieur de la maison, et à se moucher le nez conformément aux usages locaux.
Face à la complexité de ces conduites un lien de compréhension semble manquer, dans les informations dites de« sensibilisation », pour permettre de transférer aux mèresle passage essentiel entre hygiène et maladie. En fait, « lesquelques pathologies principalement responsables de la morbidité et de la mortalité sont en grand partie déterminéespar des conduites sociales (manger, boire, déféquer), et sontsusceptibles d'être prévenues par quelques actions simples,allant de la vaccination à une modification des conduitesd'hygiène» (Jaffré 2000: 261).
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 189
Les pratiques populaires" d'immunisation" et de protection
Les pratiques populaires de protection sont d'originereligieuse ou profane. En zone urbaine, les pratiques religieuses ont tendance à disparaître. On raconte fréquemmentqu'il n'y a pas si longtemps, il existait encore des prières etdes formules pour conjurer l'arrivée des maladies transmisespar le vent, comme la toux et le rhume mais aussi la méningite et la rougeole. En milieu rural, et en particulier dans lesvillages vore46 , divers rituels sont encore fréquemmentaccomplis. C'est ainsi qu'en décembre, avant que ne souffiel'harmattan, une cérémonie appelée sun yé (sun : toux,rhume; yé : accompagner; lit. « accompagner la toux et lerhume hors du village ») est organisée. Il s'agit d'un rituelspécifiquement féminin où, à travers des prières et desoffrandes aux ancêtres et aux divinités bobo, les femmesdemandent que le vent qui transporte la toux et le rhume« passe à côté» de leur village et que ses habitants, maissurtout les enfants, en soient épargnés. Le port d'amulettesest aussi largement pratiqué. Celles-ci contiennent un morceau de tissu sur lequel a été versé le sang d'une poule oud'un poussin sacrifié à l'occasion d'une cérémonie où l'enfanta été confié à une divinité bobo (Duba, Do, Wietongon) ou àun génie (wyagaJ. Même les plumes de la pintade, animalappartenant aux mythes de fondation de la société bobo, peuvent être accrochées à une petite corde autour du cou pourprotéger l'enfant de la rougeole.
En ce qui concerne les remèdes profanes des IRA, surtout dans les cas de toux sèches, on pend au cou de l'enfantune valve du fruit du caïcédrat (Kaya senegalensis) avec unpeu de coton sauvage. On peut aussi mâcher et avaler le jusde l'écorce blanche et souple du tigelepin (Sterculia setigeraou tomentosa). L'eau des pluies qui reste dans les troncs desarbres aurait aussi la vertu de calmer la toux. Récupérercette eau et l'administrer comme traitement implique laconnaissance de pratiques codifiées : il faut la récupérer aulever du soleil et la donner trois à quatre fois par jour à
46 La zone dite vore, comprend une quinzaine de villages bobo très actifsdans les pratiques rituelles, désormais résiduelles dans d'autres zones.
190 Les maladies de passage
l'enfant malade selon le sexe. La rosée aurait les mêmes propriétés curatives.
Une autre pratique préventive, qui n'existe plus désormais qu'en milieu rural, est celle de mettre le corps del'enfant en contact avec de l'eau ou des aliments considéréscomme sales, dans le but de le fortifier. On pense que faireboire à l'enfant de l'eau où toute la famille s'est lavée lesmains avant le repas « l'immunise ,,47. Ces épreuves constituent en fait, surtout selon les hommes bobo, une sorte« d'initiation sanitaire" ou même une « vaccination traditionnelle " en mesure de renforcer les éléments sains et dansle but d'identifier ceux qui sont faibles ou malades. Ce querappelle Jaffré dans son étude de 1991 : « La culture bobodéfinit le risque comme étant nécessaire au déploiement réelde la vie".
C'est dans cet univers complexe que prennent place lesdémarches de sensibilisation entreprises au sujet des vaccinations. Il est dommage qu'elles n'utilisent pas les catégorieslocales de l'immunisation et de la protection, même si cellesci sont déjà syncrétiques, afin que le message provenant d'ununivers « importé" soit mieux accepté48.
Le manque d'informations et de communication entreles agents de santé et les mères, la rapidité des consultations(lecture succinte du livret sanitaire, paiement des seringueset des injections), l'attitude des agents de santé jugée souvent arrogante, relèguent les femmes à un rôle passif, et lesrendent souvent réticentes face à la vaccination de leurs
--------- ---- ---
47 M. Dacher (1992: 169) cite le point de vue de certaines personnes âgéesGouin, qui penspnt qu'utiliser les couverts pour manger plutôt que lesmains amène à un affaiblissement de l'orgamsme, qui, au contraire, serenforcerait contre les maladies à travers l'mgestIOn de la saleté déposée sous les ongles grâce à une sorte de vaccination naturelle.
48 L'idée de vaccination n'est pas une conceptIOn absente dans la sociétébobo, Ii eXIste au moms deux types de « vaccinations afncames " que lesgens mentionnent : l'une concerne la protection contre les morsures deserpents, elle consiste en diverses petites incisions au niveau des mollets où sont insérées des poudres protectrices ; l'autre, uti1Jsée pour lesnouveau-nés, préviendrait la « maladie de l'oiseau ", le Yalo (Alfien2000 : 118) Le médicament pour le YaZD préviendrait et soignerait aussIle tétanos. Cette interprétatIOn, qui n'a pas été rencontrée dans notrezone d'enquête m'a été relatée par Mahir Saul (corn pers) en ce qUIconcerne les villages situés à l'est de Bobo -Dioulasso.
Prévention des infections respiratoires aigués en population bobo 191
enfants. Cela peut expliquer le fait que les services de santésoient utilisés seulement à 30 % de leur capacité (BrunetJailly, 2000 : 195).
En fait, si en ville la vaccination semble avoir trouvéson espace parmi les pratiques de prévention et est généralement perçue comme un fait positif, à la campagne la situation est bien différente à cause de l'éloignement des CSPS etaussi parce que la « sensibilisation» est négligée49 . Lesfemmes se plaignent de ne pas recevoir d'informations etd'explications suffisantes, ou que les équipes médicales ne seprésentent pas aux jours convenus, les obligeant ainsi à parcourir avec l'enfant des distances considérables. Voici ce quedit une femme du village de N. : « Un beau jour tu les voistomber dans un coin pour la vaccination et tu ne sais mêmepas pourquoi. Ils tombent comme ça et ils te demandentd'amener l'enfant. Maintenant il faut que chaque mère comprenne pourquoi il faut amener son enfant. Comme ce n'estpas obligatoire, on ne veut pas aller acheter une maladie ".
De leur côté, les équipes sanitaires se plaignent du faitque les populations ne se présentent pas aux jours établis oubien font seulement quelques vaccinations mais ne continuent pas cette prévention. Une infirmière d'un centre desanté rural explique ainsi la situation : « ce n'est pas vraique les gens refusent de vacciner leurs enfants mais ilsdisent qu'ils n'ont pas d'argent. S'ils ont plus d'un enfant ilsdoivent multiplier par deux ou trois les 200 FCFA de laseringue. Puis les femmes se plaignent aussi du fait qu'aprèsla vaccination, les enfants font la fièvre et/ou la diarrhée, cequi influence négativement les autres femmes. D'autresencore refusent la vaccination sans donner d'explications ».
Globalement, il règne une grande confusion sur l'utilité de la vaccination et notamment sur les différents types devaccins. De nombreuses mères pensent que la vaccination estimportante pour la santé de l'enfant, qu'elle le protège dansl'ensemble et qu'elle aide son organisme à lutter contre les
49 Le PEV (Programme Elargie de Vaccination) présent au Burkina, comprend la lutte pour la réduction et la prévention de sept maladies(tuberculose, diphtérie, tétanos, coqueluche, fièvre jaune, rougeole,poliomyélite).
192 Les maladies de passage
maladies. En revanche, d'autres mères admettent n'avoirjamais vacciné leurs enfants, ne rien connaître à ce sujet, etnombreuses sont celles qui pensent qu'une seule vaccinationsuffit à protéger l'enfant. D'autres s'inquiètent des effetssecondaires du vaccin (fièvre, diarrhée),
Cependant, au-delà des difficultés économiques et dumanque d'information, on a pu constater une progressiondans la couverture vaccinale de la province du Houet. En1999, les taux de vaccination sont meilleurs que ceux obtenus en 19885°. Le vaccin BCG est passé de 58 % à 63,34 %,celui contre la rougeole de 25 % à 51 %, la DTC/Polio III de24 % à 48,86 % et le vaccin contre la fièvre jaune de 26 % à50,42 % de couverture vaccinale. Ceci a heureusemententraîné une réduction considérable de la mortalité infantile.Mais il est toutefois utile de rappeler que la moyenne mondiale se situe aux alentours de 77 % d'enfants vaccinés, etque dans les Pays du Nord elle atteint 90 % et parfois plus.Globalement, elle n'est en Mrique subsaharienne qu'à 50 %seulement (Le Progrés des Nations 2000: 22).
Conclusion
Les IRA représentent un grave problème de santépublique. Le résoudre impliquerait d'engager des actions etdes formations qui aillent au-delà des simples messagesd'éducation à la santé. Les conseils concernant la protectiondes enfants du froid, de l'eau, d'une mauvaise l'hygiène etc.,bien qu'utiles, n'affrontent pas le problème central : savoirtransmettre aux mères des connaissances pratiques surl'identification des signes, des symptômes et d'un seuil degravité lorsque se présente l'affection respiratoire. Une étudesur les IRA, faite en 1994 à l'hôpital de Bobo-Dioulasso, préconisait déjà une formation médicale dirigée vers les mères,car ce sont elles les dispensatrices de soins sanitaires « profanes ", afin de les mettre en mesure de dépister une IRA àun stade qui ne soit pas trop avancé (Tall, Nacro & ali 1994).Mais, en amont, il faudrait aussi que les personnels sachent
50 Les données de 1988 sont issues de l'étude de Y. Jaffré (1991: 2490).
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 193
mettre en œuvre une thérapie adéquate et aussi déciderd'une hospitalisation rapide lorsqu'elle est nécessaire!
Cette formation du personnel médical devrait aborderles connaissances « profanes » relatives aux IRA, pour quel'interaction mères-personnel médical puisse servir à réduireles décalages sémantiques et culturels des définitions de laprévention et de la cure.
Bibliographie
Alfieri C.2000 « Allaitement et parenté en pays bobo-madare ", Desclaux
A. et Taverne B. (éds), Allaitement et VIH en Afrique del'Ouest: de l'anthropologie à la santé publique. Paris,Karthala : 111-133.
Alfieri C., Taverne B.2000 « Perceptions de la transmission des maladies par l'allaite
ment maternel au Burkina Faso ". A. Desclaux etB. Taverne (éds), Allaitement et VIH en Afrique de l'Ouest:de l'anthropologie à la santé publique. Paris, Karthala : 219237.
Amat-Roze J.M.2000 « Santé et tropicalité en Afrique subsaharienne : un système
multirisque ", in Gruénais M.E.,Pourtier R., (éds), La santéen Afrique. Anciens et nouveaux défis, AfriqueContemporaine. La Documentation Française, n° 195 : 24-35.
Anonyme1990 Schéma de développement et d'aménagement urbain de
Bobo-Dioulasso. Ministère de l'Equipement, Coopérationfrançaise.
Bonnet D.1988 Corps biologique, corps social. Procréation et maladies de
l'enfant en pays mossi, Burkina Faso, Paris, üRSTüM.1990 « Anthropologie et santé publique. Une approche du palu
disme au Burkina Faso ", D. Fassin et Y. Jaffré (éds),Sociétés, Développement et Santé, Paris, Ellipses/Aupelf :242-258.
1996 « La notion de négligence sociale à propos de la malnutri-
194 Les maladies de passage
tion de l'enfant '>, Présentation du numéro spécial, Lamalnutrition de l'enfant: fait culturel, effet de la pauvretéou du changement social, Sciences Sociales et Santé, Paris,vo1.14, n° 1 : 5-16.
Brunet-Jailly J.2000 « La politique publique en matière de santé dans les faits
en Afrique de l'Ouest francophone », in Gruénais M.E.,Pourtier R., (éds), La santé en Afrique. Anciens et nouveaux défis. Afrique contemporaine, La DocumentationFrançaise, n0195 : 191-203.
Bulletin of the World Health Organisation, 2001, 79 (2).1998 Intéractions entre les systèmes de santé publique et les concep
tions et pratiques populaires relatives à la maladie (Afriquede l'Ouest), Bulletin du programme de recherche, vol. VIII.
Casiglia C., Gava E. (a cura di)1998 Annuarw dei Farmaci, Genova, Piccin.
Chillio L.1996 « La vente informelle de produits de laboratoires au Niger:
une réponse aux problèmes d'accès aux médicaments »,
Marseille SHADYC, IRD, Programme de recherche:Concepts et conceptions populazres relatifs à la santé, à lasouffrance et à la maladie (Afrique de l'Ouest), bull. n° V93-108.
Cook J., Dommergues J.-P.1993 L'enfant malade et le monde méd[cal: dialogue entre
familles et soignants, Paris> Syros.
Cresson G.1995 Le travail domestique de santé. Analyse sociologique,
Paris, l'Harmattan.
Dacher M.1992 Prix des épouses, valeur des soeurs. Suivis de : Les repré
sentations de la maladie. Deux études sur la société gouin(Burkina Faso), Paris, L'Harmattan.
Desclaux A.1996 « De la mère responsable et coupable de la maladie de son
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 195
enfant », J. Benoist (éd.), Soigner au Pluriel, Essais sur lepluralisme médical, Paris, Karthala : 251-279.
2000 L'épidémie invisible. Anthropologie d'un système de santéà l'épreuve du sida chez l'enfant à Bobo-Dioulasso,Burkina Faso, Lille, Presses Universitaires duSeptentrion.
Desclaux A, Taverne B.2000 Allaitement et VIH en Afrique de l'Ouest. De l'anthropolo
gie à la santé publique. Paris, Karthala.
Diallo Y.2000 « Les consultations prénatales à Conakry. Les intéractions
soignantes-soignées ", Réseau Anthropologie de la Santéen Afrique, bull. n 0 1, Marseille, SHADYC : 75-82.
Douglas M.1975 Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contamina
zione e tabù. Bologna, Il Mulino.
Direction provinciale de la santé du Houet, Ministère de la santé,Plan quinquennal de développement sanitaire du Houet,de l'Action Sociale et de la Famille du Burkina faso., BoboDioulasso, DPS Houet.
Dubois M.C.1990 Etude des facteurs de risque de malnutrition en milieu
urbain. Bobo-Dioulasso, Ministère de la santé et desaffaires sociales, Direction provinciale de la santé du Houet.
Durif-Bruckert C.1994 Une fabuleuse machine. Anthropologie des savoirs ordi
naires sur les fonctions physiologiques, Paris, EditionsMétaillié.
Etkin N.L., Ross P.J., Muazzamu 1.1990 « The Indigenisation of Pharmaceuticals : Therapeutic
Transitions in Rural Hausaland », Social Sciences andMedecine, vol. 30, na 8 : 919-928.
Fassin D.1986 « La bonne mère: pratiques rurales et urbaines de la rou
geole chez les femmes haalpulaaren du Sénégal », SocialScience and Medecine, vol. 23, nOll : ll21-ll29.
196 Les maladies de passage
Ferraro F.2001 Les infections chez l'enfant, Paris, PUF.
Gruenais M.-E., Pourtier R.2000 La santé en Afrique. Anciens et nouveaux défis, Paris,
Afrique Contemporaine, numéro spécial, La DocumentationFrançaise, n° 195.
Jaffré Y.1999
1991a
1991b
« Pharmacies des villes, pharmacies « par terre» », APAD,bull. n° 17 : 63-70.« Education pour la santé et conceptions populaires de laprévention. A propos d'un programme d'amélioration de lacouverture vaccinale au Burkina Faso », La revue duPraticien-Médecine Générale, t. 5, n° 154 : 2489-2494.« Anthropologie de la santé et éducation pour la santé »,Cahiers Santé, Paris, vol. 1, n° 1 : 406-414.
Jaffré Y., Dicko F.2000 « La conjugaison des difficultés : école et santé à Bamako
(Mali) », in Gruénais M.E.,Pourtier R., (éds), La santé enAfrique. Anciens et nouveaux défis. Afrique contemporaine,La Documentation Française, n° 195 : 259-266.
J affré Y., Prual A.1993 « Le "corps des sages-femmes" entre identités profession
nelles et sociales », Sciences Sociales et Santé, Paris, JohnLibbey, vol. 9, n.o 2 : 63-80.
Kanki B., Curtis V., Mertens T., Traore E. et coll.1994 « Des croyances aux comportements: diarrhées et pra
tiques d'hygiène au Burkina Faso », Cahiers Santé, 4359-366.
Lang T., Lafaix C., Fassin D. et al.« Acute Respiratory Infections: A Longitudinal Study of151 children in Burkina-Faso, International Journal ofEpidémiology, vol. 15, n° 4: 553-559.
Le Bris P., Prost A.1981 Dictionnaire Bobo-Français. Paris, SELAF.
Le Moal G.1980 Nature et fonction des masques bobo. Paris, ORSTOM.
Prévention des infections respiratoires aiguës en population bobo 197
Ministère de la Santé, Direction Régional de Bobo-Dioulasso1999 Plans d'actions des districts sanitaires.
Montjoye E. (R.P.)1952 Réponses au questionnaire sur la société bobo-fing, 2e fasc.,
Cyclostilé.1955 Réponses au questionnaire sur la société bobo-fing, 4e fasc.
Cyclostilé.
Nichter M., Nichter M.1994 « Acute Respiratory Illness : Popular Health Culture and
Mother's Knowledge in the Philippines », MedicalAnthropology, vol. 15: 353-375.
Olivier de Sardan J.-P.1999 « Les représentations fluides et prosaïques de weyno et
yeyni », Jaffré Y., Olivier de Sardan J. -P., (éds). Laconstruction sociale des maladies. Les entités nosologiquespopulaires en Afrique de l'Ouest, Paris, PUF.
Ouattara F.2000 « Interactions entre populations et personnels de santé
lors des consultations prénatales dans une maternitérurale (Burkina Faso) ». Réseau Anthropologie de la Santéen Afrique, bull. n° 1, Marseille, SHADYC : 111-124.
Roger-Petitjean M.1992 Maladies d'enfants dans la région de Sikasso (Mali).
Evolution des représentations des mères au contact des services de santé: à propos de quatre pathologies. InstitutUniversitaire d'Etudes du Développement, Genève.
1996 « Représentations populaires de la malnutrition auBurkina Faso », Sciences Sociales et Santé, numéro spécialsur la malnutrition, sous la direction de Doris Bonnet,Paris, John Libbey, vol. 14, n° 1 : 17-38.
1999 Soins et nutrition des enfants en milieu urbain africain.Paroles de mères, Paris, l'Harmattan.
Sanou 1., Koueta F., Kam KL., Dao L., Sawadogo A.,1995 « L'asthme de l'enfant: aspects épidémiologiques et évolu
tifs en milieu hospitalier pédiatrique de Ouagadougou(Burkina Faso) », Recherche Médicale: publications pédiatriques: 1-3.
198 Les maladies de passage
Sawadogo S.A, Sanou L, Kam K.L., Reinhardt M.C., KOUETA F.,et ali
1997 Pédiatrie dans le monde, Société d'Editions del'Association de l'Enseignement Médical des Hôpitaux deParis: 493-499.
TaU F., Valian A, Curtis V., Traoré A, Nacro B. et al.1994 « Les infections respiratoires aigues en milieu hospitalier
pédiatrique de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) ", Arch.Pédiatr., 1, 249-254.
TaU F., de Roedenbecke E., Nacro B., Zaongo u., Traore A, SicardJ.M.
1992 « Expérience de recouvrement des coûts médicamenteux auCHNSS, Burkina Faso ", Cahiers Santé, vol. 2 : 161-165.
UNICEF2000 Le progrès des nations, New York, UNICEF.
VigareUo G.1985 Le propre et le sale. L'hygiène du corps depuis le Moyen
Age, Paris, Editions du Seuil.
Votre Santé1999 Magazine Mensuel de santé, n° 0032, Ouagadougou, Le
Pays, Editions.
Chapi"tre 8
Fluides, transmission et filiation.Les cc maladies des femmes» dansune société matrilinéaire ivoirienne
« Infirmier 0, faut venir o.Les gol [filles] de mon quartier,elles m'ont contaminé »2
Véronique Duchesne3
L'expression « maladies des femmes» est utilisée dansdifférentes langues de l'Mrique de l'Ouest pour désigner desmaladies qui seraient contractées auprès des femmes, sousentendu à l'occasion des relations sexuelles. Certains chercheurs (Le Palec, 1997), dans le cadre de leurs recherchessur le sida, dénoncent « le redoutable effet de stigmatisationque cette expression sexiste véhicule » et l'interprètent entermes de rapports sociaux et de relations de genre, voyantdans le pouvoir contaminant attribué aux femmes par les
1 Mot en nouchi, l'argot ivoirien.
2 Chanson populaIre du groupe ivoinen Les Poussins Choc, 1997.
3 Anthropologue, membre de <> Systèmes de pensée en Afrique noire >.
mPRES-A 8048 de l'EPHE et du CNRS). Mes premIères enquêtes deterrain sur la contagion ont été réalIsées lors de deux missions en Côted'Ivoire: en 1996 grâce à une bourse post-doctorale de la FondationFyssen - j'adresse mes remerciements les plus sincères au professeur R.Frankenberg de BruneI Umversity of West London -, puis en 1997 dansle cadre d'un projet collectif de l'UMR 116 du CNRS.
200 Les maladies de passage
hommes une violence symbolique exercée contre les femmes.Cette interprétation fortement teintée de militantisme a seslimites.
De mes enquêtes ethnographiques menées auprès delocuteurs anyi dans la préfecture de Bongouanou4 , au sud-estde la Côte d'Ivoire, il ressort le rôle important accordé auxfluides dans la transmission des maladies entrant dans lacatégorie des « maladies des femmes ». Il est question deliquides souillés (eau de la toilette, eau des lavementsinternes) ou des fluides corporels que sont l'urine et lesfluides sexuels (le sperme et les sécrétions vaginales). Enrevanche, le sang n'est jamais mentionné. Ceci m'amène àaborder le problème des relations entre la symbolique ducorps et le domaine de la parenté: alors que dans la sociétéanyi la filiation suit les liens du sang en ligne maternelle, lesang n'est-il pas considéré comme différent des autres fluidescorporels (urine, sperme et sécrétions vaginales) et ne participe-t-il pas d'un autre registre de la transmission?
Avant de développer l'articulation entre fluides, transmission et filiation, je décrirai les sept maladies entrant dansla catégorie nosographique locale des «maladies des femmes»puis j'exposerai les représentations relatives à la sexualitéféminine et masculine.
Les" maladies des femmes" dans la nosologie locale
Commençons par une brève présentation des représentations locales concernant les maladies. Au niveau sémantique, awonnyale, « maladie », est composé de ya, « la souffrance » ; « je suis malade »se dit « moi-même me fait mal »(me won yô me ya). Différents groupes de maladies5 sont distingués en fonction de la localisation du mal. On a : les mala-
4 Mes enquêtes ont été menées en milieu péri-urbain auprès de locuteursanyi de Kangandissou (4 400 habitants), village devenu l'un des quartIers de Bongouanou (24 000 habitants), préfecture située à environ 200kilomètres d'Abidjan. Les termes anyi sont transcrits dans l'alphabetorthographique utilisé pour les langues ivoirIennes, qui ne reproduitpas les tons.
5 Une kyrielle de maladies ne rentre pas dans les groupes cItés icI.
Fluides, transmission et filiation. Les « maladies des femmes )) 201
dies liées aux yeux6, les maladies situées dans la cage thoracique (désignée par afian, « le milieu»), les maladies situéesdans l'abdomen (kunu, « le ventre»), les maladies « qui sortent sur la peau », les maladies localisées dans « l'utérus»(boboduman) associées aux menstrues et à la fécondité, et les« maladies des femmes «, un euphémisme pour dire lesmaladies du sexe qu'elles atteignent les hommes ou lesfemmes, Dans un même groupe de maladies, une maladieconsidérée comme bénigne peut prendre une forme plus sévère7 si elle est mal soignée, et porter alors un autre nom: ondit qu'elle « s'est transformée» (wô kaki). Le degré de gravitéest considéré comme une caractéristique importante desmaladies. En général, un tradithérapeute8 est compétentpour traiter l'ensemble des maladies d'un même groupe.
Concernant la transmission morbide, on dit habituellement que la maladie « attrape » quelqu'un (wô ce), ou bienqu'elle« se répand » (wô gua) sur plusieurs personnes, voiresur un village. Le verbe bê sa est plus spécifique, il supposeune transmission par contact avec une diffusion possible àun grand nombre de personnes, il est couramment traduitpar « contaminer» (c'est un verbe transitif, wô sa, « celacontamine»). Il est utilisé à propos des « maladies desfemmes » ainsi que pour des maladies de la peau et desmaladies respiratoires.
Parmi les sept« maladies des femmes » recensées, leslocuteurs anyi établisseht des regroupements : par quatre(les maladies nommées : nzonzonzliê, akô miewa, miewa,
6 Cette catégorie inclut les maladies associées aux vertiges.
7 Pour certaines maladies, on utilise l'euphémisme" nom de maladie féminin» (par exemple awuno bla, "awuno féminin ») pour désigner laforme bénigne et " nom de maladie - masculin» (awuno biesua," awuno masculin ») pour la forme grave, le masculin indique une puissance supérieure. Cela n'est pas utilisé pour les maladies étudiées Ici.
8 J'utilise le terme" tradithérapeutes » (que je préfère à celui de " guérisseurs ») pour désigner les thérapeutes locaux qui, en milieu rural, sontdes personnes reconnues par la collectivité pour leur connaissance de lapharmacopée et leur compétence de praticien pour un certain nombrede maladies. J'adresse mes remerciements tout particulièrement à :Atoukora Ngoran, Brou Nganza, Atta Yah, Aka Sôh, Brou Ahou,Anzera Akouman (à Kangandissou). Je remercie également pour sa collaboration Ehui Kpla Roger, neveu d'un tradithérapeute et stagiaire enqualité d'agent de développement sanitaire à Abidjan.
202 Les maladies de passage
babasô) et par deux (tuôle et aklolo), la maladie nzomu est àpart. Les maladies m'ont été décrites en anyi par les tradithérapeutes et par ceux qui les consultent, et aucun lien n'aété établi d'emblée entre termes vernaculaires et noms demaladie en français. Ceux, parmi les plus jeunes, qui parlentle français et qui utilisent des noms empruntés au systèmede représentation biomédical (par exemple « gono » ou « hernie »), continuent de faire référence à la sémiologie et à l'étiologie locales.
• Le premier regroupement: nzonzonzliê, akô miewa,miewa, babasô.
En anyi, le terme nzônzônzliê désigne un arbre quilaisse couler de l'eau goutte à goutte9 ; par analogie, ce nomdésigne la maladie qui fait uriner goutte à goutte10.
Akô miewa, littéralement « miewa du poulet »ll, estconsidérée comme une maladie bénigne, elle rend l'urinerouge et son écoulement est douloureux12.
Miewa est une maladie plus grave. La personne qui enest atteinte ressent des douleurs dans les organes sexuels,urine du sang ou présente un écoulement purulent. Lesjeunes traduisent en français par «gono», abréviation de«gonocoque» qui fait référence à la blennorragie. Selon lareprésentation locale, miewa mal soigné se transforme enbabasô.
Babasô est une maladie longue et mortelle dont lessignes cliniques sont : l'amaigrissement, des démangeaisons(boutons ou furoncles), la chute des cheveux, des difficultés àuriner pour les hommes et des douleurs dans le bas du dospour les femmes 13. Babasô connaît trois ou sept stades cliniques différents, selon le tradithérapeute. Chaque stadeporte un nom en relation avec la représentation de la mala-
9 Mikania cordata. Par aIlleurs, les Anyi disent que si un enfant reçOIt lesgouttes de cet arbre sur la tête, il ne pourra plus grandir.
10 Il pourrait s'agir de l'incontinence urinaire ou d'une M.S.T.
11 Par analogie avec l'écoulement de l'urine chez le poulet.
12 Il s'agit très probablement de la bilharziose.
13 Il s'agit probablement de la syphilis. H. E. Fink (1990.261) qUI a travaillé dans une population akan du Ghana (les Dormaa) associe lesmaladies « du groupe babaso " aux maladies vénénennes.
Fluides, transmission et filiation. Les « maladies des femmes )) 203
die et les symptômes qu'elle présente. Certains stades portent le nom d'un insecte ou d'un ver: on donne le nomnvrôlô, « termites », lorsque les testicules sont comme percés par des termites ; le nom tété (ver non identifié) pour unautre stade de la maladie; le nom akanyi (ver non identifié),lorsque les testicules sont «pourris par l'action des vers».D'autres stades portent un nom qui, comme celui desinsectes et vers déjà énoncés, renvoie d'une manière généralepour les locuteurs anyi à l'idée de saleté ou de pourriture :etan,« vents », et kla,« qui gratte ". Le sida dont tous mesinterlocuteurs, quel que soit leur âge, ont entendu parler estle plus souvent assimilé à babasô. Pour la majorité d'entreeux, c'est une maladie ancienne et que l'on savait soignertraditionnellement14 . Les tradithérapeutes qui soignentbabasô font, eux, une distinction entre les deux termes: [le]sida correspond à la phase la plus grave de babasô. Ils expriment ainsi la continuité entre babasô et sida, selon l'échellede gravité concernant les maladies : le sida est considérécomme la phase ultime de la maladie et difficilement guérissable.
• Le second regroupement: tuôle et aklolo.
Tuôle, maladie masculine avec hypertrophie des testicules, est considérée comme une maladie bénigne dont on semoque publiquement, elle n'est pas mortelle15.
Par contre, aklolo concerne indifféremment leshommes et les femmes et est considérée comme grave et mortelle. Le terme est traduit en français par « hernie ,,16. Dansles discours, il est question d'une boule qui circule17 .
14 Parmi les discours récurrents: « Un vieux connaissait le médicament,constitué de cent feuilles dIfférentes qui étalent plIées ».
15 Il pourrait s'agir de l'hydrocèle (collection de liquide séreux ayantl'aspect d'une tumeur).
16 Notons que dans le roman de l'écrivain congolais Sony Labou Tansi,L'Etat honteux (1981), la toute puissance et la tyrannie de l'abominablecolonel Lopez sont symbolisées par sa " hernie ».
17 Chez l'homme, " lorsque ahlolo est descendue dans les testicules, il estrecommandé de serrer ses cuisses pour que cela ne grimpe pas dans leventre ; car si ahlolo est dans le ventre, cela perce la vésicule biliaire(boiman) et l'homme meurt ". Chez la femme, ahlolo est" une boule surle flanc qui peut aller vers le boboduman (utérus) et entraîner des douleurs ».
204 Les maladies de passage
• Enfin, nzomu désigne une maladie grave quiempêche d'enfanter. Il existe deux sortes de nzomu. Dans lepremier cas, la femme avorte avant la fin de la grossesse18.
Dans le second cas, la femme accouche mais les yeux du nouveau-né sont jaunes (symptômes de ewongo, l'ictère) puis soncorps devient noir, et peu de temps après, il meurt.
Représentations relatives aux normes sexuelles
D'emblée une précision: parler de sexualité et plusencore des maladies sexuelles n'est pas une chose aisée et courante pour les interlocuteurs anyi. Pour eux la sexualité relèvedu domaine de l'intimité et les maladies qui lui sont associéessont considérées comme particulièrement honteuses (le sentiment de honte est proche de celui de gêne). Il arrive que l'onparle en public des organes sexuels masculins (le pénis, tuwa,et les testicules, ndôman), voire même qu'on les prennentcomme objet d'insulte, que le locuteur soit un homme ou unefemme; par contre, l'organe sexuel de la femme (appelé kô)n'est jamais nommé, on utilise pour en parler la forme allusivebla nika, « l'endroit de la femme » - on parle en revancheassez librement du lieu de la conception, appelé boboduman,traduit en français par « utérus ». Un homme ne prendrajamais le sexe de la femme comme objet d'insulte. Et unefemme qui maudirait un homme, en nommant son appareilgénital, le condamnerait quasiment à une mort prochaine.
Si tous s'accordent pour dire que les maladies nzonzonzliô, miewa et babasô sont plus généralement transmisesde la femme à l'homme, en revanche tuôle et aklolo sontconsidérées comme plutôt transmises de l'homme à lafemme. Quant à la maladie nzomu, elle serait transmiseindifféremment par l'homme ou par la femme. En fait, les« maladies des femmes» semblent frapper plus souvent leshommes, ce qui pourrait expliquer la déclinaison au fémininde cette expression qui désigne, par euphémisme, les maladies associées à la sexualité.
18 La fausse couche est expliquée ainsi :« Pendant la grossesse, l'eau quiest dans le ventre devient chaude, l'enfant ne se forme pas, il devientdu sang et tombe "
Fluides, transmission et filiation. Les « maladies des femmes" 205
Les représentations relatives à ces maladies et à leurtransmission sont sans aucun doute révélatrices des normessociales en matière de sexualité. Nous examinons séparément les modèles féminin et masculin.
Un corps féminin socialement construit pour engendrer
Contrairement au garçon, à la puberté, le corps fémininconnaît une construction sociale spécifique19. En fait, ilconviendrait de parler plutôt au passé, le rituel qui m'a étérapporté et que je décris20 n'ayant plus lieu depuis une trentaine d'années, Il est toutefois important d'y faire référence ici.
La jeune fille était censée garder sa virginité et nepouvoir se marier avant la publication rituelle de ses premières règles21 . On raconte qu'une jeune fille bien élevée nedevait pas révéler à sa famille qu'elle a ses premières règles,cela aurait été manifester implicitement son désir de la cérémonie, et donc d'avoir des rapports sexuels. La cérémonieétait effectuée par les femmes du lignage après la premièremenstruation (parfois trois). Durant le rituel, on aspergeaitla jeune fille d'une eau lustrale puis non loin du village, on lapoussait à trois reprises dans l'eau de la rivière; les chantsdes femmes vantaient le pouvoir de fécondité du boson22 dela rivière. Le corps de la jeune fille était mis en contact directavec une puissance aquatique (appelée boson) associée à lafécondité. Ce traitement rituel du premier écoulement du
19 Les Anyi ne pratiquent pas l'excision et la circoncision n'est pas unepratique ancrée dans la tradition (jusqu'à ces dernières années un roine pouvaIt être circoncis), mais de nos jours, la majorité des garçonssont circoncis peu de temps après la naissance.
20 Pour une description détaillée du rite de publication des règles, cf.Duchesne (1996:64-66).
21 Les premières règles sont appelées « les règles de l'au-delà ", ebôlômanza (ebôlô, lieu d'avant la naissance et d'après la mort). Ceci renvOieà la conception anyi du monde en miroir: le corps a déjà une existencedans l'au-delà et le premier écoulement corporel sur terre correspondau dernier dans l'au-delà. De la même façon, les premières selles dubébé sont appelées « selles de l'au-delà ", ebôlô bie.
22 Les boson sont des puissances anthropomorphes qui habitent l'environnement naturel (aquatique ou terrestre) et auprès desquelles les personnes peuvent adresser leur souhait d'avoir un enfant.
206 Les maladies de passage
sang menstruel correspondait à une nouvelle naissance pourla jeune fille qui allait pouvoir accéder sans crainte23 à la viesexuelle, au mariage, et à la procréation.
Si le passage de la jeune fille vierge au statut de futureépouse et future mère, lors de ses premières règles, n'est plusritualisé, la vie génésique de la femme reste l'objet d'attention de la part du groupe social. L'écoulement de sang (lorsdes menstrues ou après l'accouchement) est associé à l'idéede « souillure» (efian)24 et par le biais d'interdits, on sait, ausein de l'unité domestique, quand une femme a ses règles etpar déduction quand elle est enceinte. Une femme est censéepouvoir s'abstenir de relations sexuelles pendant de trèslongues périodes: le veuvage pour la femme peut durer plusieurs années. Les femmes ménopausées aiment à direqu'elles n'ont plus eu de relations sexuelles avec leur maridepuis la conception de leur dernier enfant. La femme neprend pas l'initiative dans les relations sexuelles, on dit quec'est l'homme qui dérange sa femme. Une femme qui changefréquemment de partenaire est considérée comme unedéviante par rapport à la norme sociale en matière de sexualité féminine. Jusqu'à aujourd'hui, la femme ayant conçu dixenfants avec le même mari25 est citée comme un exemple.
Sexualité et procréation au masculin
Contrairement à celle de la femme, la sexualité prémaritale de l'homme ne connaît aucune consigne particulière.Le contrôle social de la sexualité masculine s'exerce essentiellement en rapport avec la situation de mariage.
23 Il y a une quarantaine d'années, on faisait périr tout enfant premier-néd'une jeune fille qui n'avait pas été publiquement déclarée nubile (cf.F.J. Amon d'Aby, 1960:77).
24 Les locuteurs anYl tradUlsent le terme efian par " saleté » mais je luipréfère celui de " souillure» qui, comme le terme anyi, renvoie à l'idéed'interdits et de purification. Par ailleurs, un autre terme, ewula,désigne la saleté matérielle, sous forme organique ou de poussière (bêpiym ewula, ,, balayer la saleté »l.
25 Dans un article, je montre la relation qu'ont la mère de dix enfants et lamère de jumeaux avec la souveraineté dans les populations anyi(V. Duchesne, 1998:137-155).
Fluides, transmission et filiation. Les (( maladies des femmes" 207
Un homme qui a eu des relations sexuelles avec unefemme mariée doit payer une amende appelée bla halé, littéralement « dette de la femme » et traduit localement par« amende d'adultère »26. Cette expression, qui suppose unlocuteur masculin, ne signifie pas que l'adultère est considéré comme une affaire essentiellement masculine, l'adultèrede l'épouse comme celui de l'époux peut être invoqué pourdemander le divorce. Ceci confirme l'asymétrie, soulignéeprécédemment: l'homme est censé avoir l'initiative dans ledomaine des relations sexuelles. Le divorce peut égalementêtre demandé par la femme si son mari devient impuissant.En effet, même si la grossesse est conçue comme liée àl'intervention d'une puissance du terroir (boson) ou d'unancêtre du matrilignage, le rapport sexuel est considérécomme indispensable : le sperme de l'homme doit s'écoulerdans boboduman «< utérus ») et « travailler » le sang maternel qui donnera finalement chair à l'enfant. Par ailleurs, onemploie le verbe «mettre au monde» (bé wule) au pluriel:« ils [le père et la mère] ont mis un enfant au monde ». Lesgéniteurs, mère et père, sont bien distingués d'éventuelsmères ou pères sociaux. Pour le père, comme pour la mère,l'expression kunu ba, littéralement« les enfants du ventre »,ou « enfants de mes entrailles », désigne les enfants biologiques. Pour l'homme comme pour la femme, le ventre(kunu) est associé à la procréation, et non pas les organessexuels.
Lorsqu'une femme non mariée est enceinte, on luidemande avec quels hommes elle a eu des relations sexuelleset ils sont convoqués. Le lignage de la femme se préoccupe desavoir qui est le géniteur de l'enfant, même s'il ne devientpas son père social en épousant la femme. Alors que la mèredonne à ses enfants leur identité généalogique, historique etsociale (de son matrilignage), le père transmet à ses enfantsson nom et ses interdits27 . Le géniteur est d'une manière
26 Parfois, le payement de l'amende d'adultère incombe au père de lafemme, à charge par lui de se faIre rembourser par le ou les coupables(P.J. Amon d'Aby, 1960:152).
27 Certains de ces interdits sont liés au culte de« l'eau du père ", un culteprotecteur de l'unité domestique, fondé à l'initiative du père CV.Duchesne, 1996: 144-152).
208 Les maladies de passage
générale indispensable aux opérations rituelles de protectiondu capital de vie de ses enfants: il est censé les protéger desmalveillants qui agressent à l'intérieur du matrilignage (lesbayefuô, traduit couramment par « sorciers»).
Les modèles féminin et masculin en matière de sexualité s'exercent donc en rapport avec le mariage mais demanière différente: jusqu'à ces dernières années pas desexualité pré - maritale pour la femme, et pour l'homme, pasde relations adultérines. Nous allons voir comment cesmodèles sont encore prégnants dans les représentations de latransmission des maladies associées à la sexualité.
Transmissions et fluides
Dans le registre étiologique, les maladies de la catégorie « maladies des femmes » renvoient à une double causalité:l'une fait référence à un contact direct avec certains liquidestandis que l'autre est de nature sociale. Commençons parexaminer la première.
D'une manière générale, les fluides corporels comme lasueur (muifile), le crachat (nuan nzuo « eau de la bouche »),la morve (bo nzuo « eau du nez »), l'urine (mie), le sperme(tuwa nzuo « eau du pénis ») et les sécrétions vaginales (kônzuo « eau du sexe de la femme» que je traduis par« eaudu vagin ») sont considérés comme sales (efian). Sont citésdans la transmission des« maladies des femmes » : le sperme, les sécrétions vaginales et l'urine (de l'homme ou de lafemme). Lors des rapports sexuels, les deux partenaires ontune contribution fluide «< l'eau du pénis» et « l'eau duvagin », encore appelées bê won nzuo, « l'eau de leur corps»).Les rapports sexuels sont considérés comme salissant lesdeux partenaires, et la femme 28 plus que l'homme; lafemme doit impérativement se laver matin et soir, même s'ilexiste une attitude positive à l'égard des sécrétions vagi-
28 Par exemple: une femme qui ne s'est pas lavée après avoIr eu des rapports sexuels et prend un enfant dans ses bras, peut être à l'origined'une maladie de l'enfant appelée efian, " saleté» (c'est une maladieinfantile dont les symptômes sont la perte d'appétit et J'amaigrissement, et que je rapprocherais du marasme).
Fluides, transmission et filiation. Les" maladies des femmes )) 209
nales29 (elles sont censées jouer un rôle en facilitant le rapport sexuel). Traditionnellement, hommes et femmes n'urinent pas n'importe où, il est impératif d'utiliser la douchière(dont le sol reçoit aussi l'eau sale de la toilette quotidienne).Cette conduite a un caractère préventif: éviter de marcherdans l'urine d'une personne contaminée3o.
L'autre causalité est de nature sociale. Elle est évoquée par les locuteurs anyi comme étant de l'ordre « surnaturel ». Et elle est souvent donnée lorsqu'une personne neguérit pas malgré son traitement. Nous nous situons ici dansle registre des « médicaments »31 (ayile) achetés pour transmettre une maladie. Le « médicament » est tantôt décritcomme un fil tantôt comme une poudre noire, mais il resteinvisible aux yeux du commun des mortels (seuls les « clairvoyants » auprès desquels on achète ce genre de « médicament » peuvent le voir). Le « médicament » est placé sur lesexe de la femme mariée par son mari, et si celle-ci a desrelations sexuelles adultérines, elle contamine son amant. Le« médicament » peut encore être placé sur le mur de sa maison par le propriétaire, et lorsqu'un homme urine sur ce mur,il est aussitôt contaminé32 . Autre exemple fréquemmentdonné, le « médicament » cette fois est placé sur le pot devin de palme par celui qui l'extrait, et lorsqu'un homme le
29 Les femmes anyi ne pratiquent pas, comme les femmes d'Mrique centrale, l'assèchement du vagin (cf. Vincke, 1991). On reconnaît parailleurs aux deux époux le droit au plaisir sexuel, il serait même nécessaire pour la conception.
30 L'exemple d'un malade du sida dans un hôpital ghanéen et de la question de son urine est significatif: « The presence of an AIDS patient,however, caused concern and fear, especially among the nurses: 'Themother of the HIV patient became angry when the nurses directed herto go and throw the urine ofher son in the toilet about 200m away fromthe ward'" (Sjaak van der Geest & S. Sarkodie, 1998:1377).
31 Le terme «médicament" utilisé en français local (et commun aux sociétés d'Mrique de l'Ouest) désigne une substance ambivalente pouvantêtre utilisée comme remède ou comme poison. Le mot nya, «feuille», quidésigne en anyi des substances végétales, est souvent utilisé commesynonyme de « médicament ".
32 On retrouve cette idée dans la société lobi : « Les hommes Ici, semble-til, feraient davantage usage de leur urine contaminée pour empoisonner autrui" (M. Cros, 1997:100)
210 Les maladies de passage
vole, ce dernier est contaminé33 . Dans ces différents cas, les «
maladies des femmes » viennent punir l'adultère, le faitd'uriner contre le mur d'une maison et le vol de vin de palme.Elles sanctionnent des conduites sociales réprouvées qui onten commun d'être associées à l'écoulement de liquides (selonle cas les fluides sexuels, l'urine ou le vin de palme).
Pour la maladie nzomu, utiliser la poire de lavements(il s'agit de lavements par voie anale) ou le seau pour selaver d'une personne atteinte suffit à transmettre la maladie. Dans ce cas, le contact avec l'eau de lavement ou l'eau dela toilette est contaminant. Une causalité d'un autre ordreest aussi évoquée : le changement brusque du flux de l'eaucourante dans laquelle se trouve une femme enceinte, lorsqu'elle va chercher de l'eau. On explique que «l'eau rentrepar ses pieds, atteint son ventre», ce qui provoque la faussecouche34. Cette dernière causalité est plutôt de nature analogique : le flux du courant d'eau naturelle renvoie à celui del'eau amniotique dans le ventre de la femme enceinte.
Quelle que soit la causalité mise en jeu, transmissionet fluides (ou liquides35) sont toujours associés. Toutefois ilne s'agit pas de n'importe quel fluide. Ainsi le sang n'est-ilpas évoqué dans la transmission des « maladies des femmes ",maladies liées à la sexualité.
Sang, transmission et filiation
Le sang est un fluide fortement chargé symboliquement dans les populations anyi. Rappelons qu'en vertu deleur conception de la personne, le sang (moja) est transmis à
33 Cette étiologie concerne principalement la maladie fuôle. Celle-ci estconsidérée par mes interlocuteurs anyi comme très fréquente chez leursvoisins baoulé, lesquels sont justement renommés pour leur usage des« médicaments".
34 La conduite préventive pour une femme enceinte dans une telle sItuation consiste à prendre de l'eau du lieu et de s'en passer sur le visage etsur le ventre.
35 «Liquids are especially privileged vehicles of this symbolism, becausethey possess the capacity to flow, and thus to mediate between distinctrealms ofbeing L.. ! liquids pass between the partners to the interaction"(C Taylor, 1988:1344).
Fluides, transmission et filiation. Les" maladies des femmes )) 211
l'individu par sa mère ; c'est lui qui circule à travers lesâges, et qui rattache Ego à ses ancêtres. C'est le sang qui,cheminant de femme en femme, assure la continuité desgénérations. Il faut comprendre cette continuité au sens leplus matériel, le plus physique du terme - c'est le mêmesang qui gonfle les veines de la mère et celles de l'enfant. Achaque matrilignage correspond donc« un seul et même filetde sang, qui s'écoule depuis le commencement des temps, etdont les individus ne sont que des réceptacles provisoires ,,36.
Les expressions anyi « le lignage est un seul sang » ou « lelignage est une seule personne » renvoient à la conceptiondu lignage comme étant une personne37 irriguée par un seulet même sang. Par ailleurs, l'effusion de sang n'est pas uneaffaire privée, elle est soumise à un contrôle et est l'affairedu pouvoir. On l'a vu précédemment avec le traitement ritueldu premier écoulement du sang menstruel. Le sang n'est pasconsidéré comme un fluide corporel individuel, il est partagépar l'ensemble des membres du matrilignage. Il circule enquelque sorte en circuit fermé et se distingue, de cette façon,des autres fluides corporels (évoqués précédemment) qui,eux, peuvent circuler entre des individus. De plus, le sangest l'élixir de vie, il n'est pas assimilé à un fluide sale (sauflors des menstrues, mais le terme utilisé est manzan, et nonpas moja)38.
Il existe cependant deux formes de « transmission»morbide par le sang. L'une se situe au niveau symboliquedans une problématique du semblable (entendez « mêmesang») et nous entraîne vers la sorcellerie et la malédiction.L'autre renvoie aux « maladies du ventre» et pose le problème de la transmission maternelle in utero.
36 Cf. E. Terray, 1994:557.
37 Notons les métaphores suivantes: le chef de lignage est appelé « latête "du lignage tandis que les segments du lignage sont « ses bras ".
38 Dans une autre société matrilinéaire, celle des Lobi (du Burkina Fasoet de la Côte d'Ivoire), tomin désigne « ce qui s'écoule du corps ", il s'agitdu sang rouge des veines, des sangs blancs que constituent les sécrétions sexuées de l'homme et de la femme, et du sang noir des menstrues, M. Cros parle" d'humeurs sanguines ". Ceci diffère totalementde nos matériaux anyi.
212 Les maladies de passage
La « sorcellerie » (baye) attaque à l'intérieur du corpssocial qu'est le matrilignage, en suivant les liens du sangmaternel. On dit que les « sorciers» (bayefuô) « mangent lachair» et « boivent le sang» de leurs victimes ou encorequ'ils les « mangent de l'intérieur ». Les « sorciers» ne peuvent s'attaquer qu'aux membres de leur matrilignage, c'està-dire à ceux qui partagent le même sang et la même chairqu'eux. Les attaques en « sorcellerie» concernent le registredes conflits au sein du matrilignage et non celui des relationsentre alliés ou des relations inter-individuelles qui sont duressort des « maladies des femmes ».
La malédiction (bê wo amwan, traduit localement par« maudire») consiste à demander oralement la mort de quelqu'un à une puissance. Un comportement réprouvé socialement (vol, injure, querelle, etc.) peut être à l'origine d'uneparole de malédiction. La malédiction vise ensuite non seulement la personne nommée (supposée avoir effectué le méfait)mais l'ensemble de son matrilignage. Pour arrêter la transmission du mal à l'ensemble des membres du lignage, il estnécessaire d'effectuer à l'attention de la puissance invoquéeun sacrifice et des prestations. Tous les membres du matrilignage doivent participer financièrement au rituel, puisqu'ilssont tous concernés. Tant que le sacrifice n'est pas effectué,la malédiction pèse sur l'ensemble du matrilignage de la personne visée au départ. Le processus opère sur le long terme.Dans la malédiction, l'intégrité morale du lignage est en jeu.
Dans les registres de la sorcellerie et de la malédiction,l'intégrité du matrilignage est mise en danger par le comportement de l'un de ses membres qui est contraire à l'ordresocial. Un rituel (qui opère au niveau symbolique et social)doit être effectué, en présence du chef de lignage, pour arrêter la diffusion du mal à l'intérieur du matrilignage par lesliens du sang.
39 Après aVOIr tracé plusieurs petites incisions cutanées à l'aide d'unelame à l'endroit douloureux, le thérapeute appuie fortement et fait finalement sortir un objet (le plus souvent une pointe, un Call1ou pointu, uncadenas, une dent ou un petit crabe, objets qui constituent de véritablesmétaphores pour l'action de percer ou d'attacher). Une poudre nOIre estensuite frottée sur les incisions et un breuvage thérapeutique est donnéau malade.
Fluides, transmission et filiation. Les" maladies des femmes il 213
Une autre pratique malveillante consiste à « lancer unmédicament» (bê tô ayiie), traduit localement par « empoisonner ". L'extraction du corps étranger, le « médicament ",est pratiquée par certains spécialistes exerçant les fonctionsde devin ou de guérisseur39. Lorsque le « médicament» n'estpas extrait à temps, il « passe dans le sang », les deux semélangent et on ne peut alors plus rien faire pour sauver lapersonne.
Pour les locuteurs anyi interrogés, les « maladies desfemmes " étudiées ici ne sont pas « dans le sang " alors quec'est le cas des maladies localisées dans le ventre et « qui sortent sur la peau ", telles que la varicelle, la variole ou lalèpre. On dit indifféremment par exemple que la lèpre est« dans le sang », ou bien « dans le matrilignage », et dans cecas la transmission de la maladie de la mère à au moins l'unde ses enfants est considérée comme possible. Dans lecontexte anyi où la mère et l'enfant partagent le même sang,il convient d'examiner les représentations de la transmissionmaternelle in utero pour les maladies sexuelles, dites« maladies des femmes ».
La contamination in utero
J'ai d'abord posé de façon systématique la question dela transmission mère/enfant sous la forme : « Si une femmeenceinte a la maladie X, est-ce que l'enfant qu'elle va mettreau monde aura cette maladie? ». Les réponses sont unanimes : une femme enceinte atteinte d'une maladie de lacatégorie des « maladies des femmes» ne la transmet jamaisà son enfant car « la maladie est dans le sexe de la mère, etl'enfant, lui, se trouve dans son ventre ». La localisation de lamaladie, dans le sexe ou dans le ventre, apparaît commeessentielle pour la question de la transmission mère/enfant.Pour la catégorie des « maladies du ventre »40, la transmis-
40 Parmi les" maladies du ventre ", on compte deux maladies de formehépatite: - nyanguman fufuô (traduction littérale" paludisme blanc ",pourrait correspondre à la fièvre jaune) qui est une maladie mortelle;la phase ultIme : on vomit du sang, les yeux sont blancs, ainsi que lapaume de la main, les orteils et les ongles, parfois un gonflement despieds; pour les enfants, leurs cheveux deviennent épais, ils ne mangent
214 Les maladies de passage
sion de la mère à l'enfant est cette fois considérée commesystématique car les maladies situées dans le ventre « touchent [automatiquement] l'enfant» qui est lui-même dans leventre. On utilise le verbe bé kan, « toucher » (la maladie« touche l'enfant ») ou le verbe bé sa, « contaminer ». Lapossibilité d'une transmission morbide de la mère à l'enfantpendant la grossesse existe bien mais pas pour les maladiesde la catégorie étudiée.
Dans l'éventualité qu'une femme enceinte aie des relations sexuelles avec un homme qui a babasô, le foetus seraitcontaminé et la femme avorterait. Pour la maladie sexuelleaklolo, plutôt transmise de l'homme à la femme, elle seraitensuite transmise à l'enfant. Dans ces deux cas, une transmission père/enfant est reconnue possible, par l'intermédiaire de la mère.
Ajoutons que la transmission d'une maladie de la mèreà l'enfant pendant l'allaitement n'a jamais été évoquée. Desrecherches seront menées ultérieurement sur les représentations du lait maternel41, ainsi que sur les pratiques d'allaitement.
pas; un traitement traditionnel existe par lavage interne et externe; ewongo dont la forme sévère est amalebon, est une maladIe mortelle;l'mtérieur de la bouche rougit, l'urine devient épaisse. Deux autresmaladies de cette catégorie n'ont pas été Identifiées: - mviele : letableau clinique de cette maladie mortelle est très large " Cela rentredans le bas du dos puis cela descend dans les testicules et celles-ci gonflent ,ce peut être aUSSI le bras ou le pied; la maladie marche dans lecorps et l'endroit où elle arrive gonfle" ; s'agit-il de tumeur (?); il existeun traitement traditionnel par lavements internes et massages desparties gonflées; une mesure préventive est observée par le thérapeute :il ne frotte pas le remède sur la partie gonflée avec la main maIS avecune plume de poulet sinon il est contaminé; - ngekale, certains dessymptômes décrIts feraient penser à la drépanocytose (?).
41 Le lait maternellnyonman nzuo,« eau du sem ,,) semble être un liquide corporel associé à la saleté : on dit que le lait sent mauvaIS. Raressont les adultes qui boivent du lait d'animal.
Fluides, transmission et filiation. Les « maladies des femmes" 215
Pratiques thérapeutiques et risques de contamination pourle thérapeute
En général, un même tradithérapeute sait soigner lesmaladies qui appartiennent à un même sous-groupe: lesquatre maladies (nzonzonzliê, akô miewa, miewa, babasôJ, oubien les deux (tuZe et akZoZo), ou bien la maladie nzomu. Ilessaie toujours de soigner les deux partenaires - sauf pour lamaladie tuoZe (gonflement des testicules) où seul l'homme esttraité42. Les traitements prescrits comportent des lavementsinternes (par voie anale), des bains et des breuvages. Lessoins consistent à faire sortir la maladie du corps43 parl'intermédiaire de liquides.
Le traitement de nzomu est spécifique et prend lafonne d'un rite thérapeutique effectué sur une journée seulement par la femme. De l'eau contenant de nombreux ingrédients (végétaux et animaux) est préparée et la femme, àsept reprises, en boit trois gorgées puis s'en lave tout lecorps. A la fin, les yeux fermés, elle saisit les mains de deuxenfants parmi ceux qui l'entourent (les deux enfants élussymbolisent ses propres enfants à venir) puis elle partageavec eux un poulet préparé avec des feuilles médicinales.Cette dernière phase rappelle celle qui était effectuée par lajeune fille pubère lors de la publication rituelle de ses premières règles. Dans ce cas, une reconstruction symbolique ducorps de la femme est effectuée afin qu'elle puisse à nouveauengendrer. Le traitement s'accompagne d'interdits alimentaires et de lavements internes pour la femme ainsi que pourson mari.
Traitements thérapeutiques et pratiques préventivessont souvent associés. Dans le cas de nzomu des soins àcaractère préventif sont donnés au bébé dont la mère a été
42 Il existait un traitement ancien qui n'est plus pratiqué: "l'homme étaitassis sur une chaIse comportant un trou, il plaçait ses testiculesdedans, et une fois les deux boules montées dans le ventre, on tirait aufusil à plomb dans le scrotum]. Le pus coulait dans un trou et ensuiteon soignait les plaies". Aujourd'hui, la plupart ont recours à l'opérationchirurgicale ou bien vivent avec le handicap.
43 Par exemple, pour miewa et babasô, les selles gluantes sont le signe quela maladie s'en va.
216 Les maladies de passage
traitée lorsqu'elle était enceinte : le tradithérapeute incise lapeau du bébé et enduit les scarifications de la même poudreque celle qu'il a utilisée pour soigner sa mère.
Le tradithérapeute prend également des précautionspour ne pas contracter la maladie qu'il soigne. Par exemplepour babasô : l'eau où les feuilles médicinales ont macéré estversée avec un filtre afin de ne pas la toucher avec les mains.Le caractère ambivalent du liquide qui à la fois peut soignerla maladie et la transmettre dans certaines circonstances està souligner. Dans le cas d'une personne qui était supposéemorte du sida, les proches ont veillé à ne pas toucher à l'eaude la toilette afin d'éviter le contact avec l'eau qui a étésouillée.
Le tradithérapeute utilise également pour lui-même, àtitre préventif, le remède qu'il prépare pour le malade. Et àla fin du traitement il est capable de prouver que le maladen'est plus contagieux en s'exposant lui-même physiquement.La notion de risque pour le tradithérapeute existe, pourpreuve l'un d'eux dit avoir eu des relations sexuelles avecune femme qu'il avait soignée pour babasô afin de lui démontrer qu'elle n'était plus contaminante. L'affirmation de sonpouvoir thérapeutique et de l'efficacité de son traitement serévèle donc aussi dans sa capacité à surmonter le risque decontamination. Notons que le personnel soignant des dispensaires ou hôpitaux a lui aussi le soucis de se protéger desmalades considérés comme « contagieux ».
La santé est une préoccupation majeure et desremèdes sont employés à titre préventif dans la vie quotidienne : ce sont surtout des lavements par voie anale et/oudes bains. Le naturel et le « méta-naturel » sont souventimbriqués. Des bains d'eau froide contenant divers élémentssont pris, durant plusieurs jours, pour renforcer l'immunitépersonnelle physique et «méta-physique». Des scarificationssont effectuées pour rendre« dure», c'est-à-dire moins vulnérable, une personne exposée, de par sa fonction (de responsable de culte ou de responsable politique), à toutes sortesd'agressions (physiques ou non). La notion de vaccin44 n'est
44 Selon Fink, il existait une vaccination traditionnelle pour la variole chezles Dormaa (populatIOn akan du Ghana) :" Smallpox vaccinations were
Fluides, transmission et filiation. Les « maladies des femmes" 217
pas étrangère au système de pensée local: une « protection »
peut durer de quelques mois à quelques années et doit êtreréactivée pour garder son efficacité. Est-ce pour cette raisonque les campagnes de vaccinations sont si bien acceptées parla population? Alors à quand la découverte d'un vaccincontre le sida? Dans la région d'enquête, des guérisseursambulants ont déjà commencé à réaliser des scarificationsavec application d'une poudre, au niveau du bas du dos, pourprotéger contre le sida45 .
Conclusion
En Mrique de l'Ouest les messages de prévention assimilent en général les « maladies des femmes » aux maladiessexuellement transmissibles et englobent le sida. L'expression « maladies des femmes» utilisée par différentes populations locales sous-entend une transmission par les femmespour de locuteurs masculins. Mais une interprétation entermes de rapport sociaux et de relations de genre apparaîtinsuffisante. Mes enquêtes menées dans le sud-est de la Côted'Ivoire auprès des locuteurs anyi montrent que les maladiesde cette catégorie ont en commun au niveau nosologique undysfonctionnement de l'écoulement de fluides (masculins ouféminins), qui peut aboutir dans certains cas à un gonflement localisé dans le sexe. Lorsque la causalité évoquée estd'ordre naturel, la transmission a lieu par contact direct avecun fluide: il s'agit d'un liquide souillé contaminé (eau de latoilette, eau des lavements internes) ou d'un fluide corporel
part of the preventive medical measures of the Dormaa healers longbefore the arrivaI of the Europeans. It is not possible to trace back thesmallpox prophylaxis in Africa to its beginning, but probably it wasknown as early as in the 18th century. During the course of colonization, variolation ?] was prohibited and replaced by colonial vaccinationcampaigns. However, these often failes for technical reasons, so thatfurther smallpox epidemics occurred and as a result the traditionalmethod of vaccination was still practised. Not before the introduction ofa temperature-resistant vaccine at the beginning of this century wasthe traditlOnal type of vaccination replaced for good »(H.E. Fink, 1990 :225).
45 Les personnes étaient en majorité des jeunes hommes âgés de 20 à 30ans.
218 Les maladies de passage
contaminé (l'urine, le sperme ou les sécrétions vaginales).Lorsque l'origine est non naturelle, les «maladies desfemmes» viennent sanctionner des conduites sociales réprouvées et toujours associées à l'écoulement de liquides (les relations adultérines associées aux fluides sexuels, le versementde l'urine hors des endroits prescrits ou le vol de vin depalme sur le lieu de la récolte).
Le sang n'est pas considéré comme un fluide contaminant pour cette catégorie de maladies. Les fluides en question entrent dans une logique de transmission entre deuxpersonnes individualisées, ils interviennent dans les relations inter-individuelles. En revanche le sang entre dans uneautre logique, celle de la circulation à l'intérieur d'une même«personne» (le matrilignage dans la population étudiée), ilintervient dans des relations intra-personnelles. Le sang quiest conçu comme le support de la filiation en ligne maternelle, n'est donc pas semblable aux autres fluides corporels etne participe pas au même registre de transmission.
Nous avons vu que le sida est considéré comme unemaladie ancienne que les tradithérapeutes savaient soigner.Il est intégré à la catégorie des « maladies des femmes », et,comme elles, est considéré comme honteux et contagieux.Comme elles aussi, il entre dans le registre de la transmission attachée aux relations inter-individuelles, principalement les relations adultérines ou les relations avec des«femmes faciles» (femmes ayant plusieurs partenaires maispas forcément assimilées à des prostituées) ; lorsque la causalité est naturelle, la transmission a lieu par contact directavec un liquide souillé contaminé (eau de la toilette) ou avecun fluide corporel contaminé (l'urine, le sperme ou les sécrétions vaginales). La transmission du sida par le sang n'estpas envisagée, de même que la transmission de la mère àl'enfant. Promouvoir une communication efficace avec lespopulations africaines impliquerait de connaître et de tenircompte de ces définitions locales de la transmission.
Fluides, transmission et filiation. Les « maladies des femmes"
Bibliographie
219
Aaby P., Bukh J., Lisse LM., Smits A.J.1983 Les hommes sont-ils plus faibles ou leurs soeurs parlent
elles trop ? Essai sur la transmission des maladies infectieuses, Anthropologie et Sociétés, VII, 2:47-59.
Amon D'aby, F.J.1960 Croyances religieuses et coutumes juridiques des Agni de
la Côte d'Ivoire, Paris, Larose.
CapraraA.1991 La contagion. Conceptions et pratiques dans la société
alladian de Côte d'Ivoire, Anthropologie et Sociétés, XV, 23:189-203.
Cros, M.1990 Anthropologie du sang en Afrique. Essai d'hématologie
symbolique chez les Lobi du Burkina Faso et de Côted'Ivoire, Paris, L'Harmattan.
1997 Un semblant de mithridatisation au féminin, Journal desanthropologues, 68-69 : 93-101.
Duchesne, V.1996 Le cercle de kaolin. Boson et initiés en Côte d'Ivoire, Paris,
Institut d'ethnologie, 371 p.1998 Gémellité, fécondité et souveraineté chez les Anyi de Côte
d'Ivoire, L'Vomo, 1998, 1:137-155.
Fink, H.E.1990 Religion, Disease and Healing in Ghana. A Case Study of
Traditional Dorma Medicine, München, TricksterWissenschaft .
Fosu G.B.1981 Disease Classification in Rural Ghana : Framework and
Implications for Health Behaviour, Social SCIence andMedicine, XXVB : 471-482.
Héritier, F.1985 Le sperme et le sang, Nouvelle revue de psychanalyse, 32
111-122.1995 Masculm / Féminin. La pensée de la différence, Paris, éd.
Odile Jacob.
220 Les maladies de passage
Le Palec A.1997 Un virus au cœur des rapports sociaux de sexe, Journal
des Anthropologues, 68-69:111-127.
Taylor, C.C.1988 The concept of flow in Rwandan popular medicine, Social
Sciences and Medicine, XXVII, 12 : 1343-1348.
Terray, E.1994 Le pouvoir, le sang et la mort dans le royaume asante au
XIXe siècle, Cahiers d'Etudes africaines, XXXIV (4), 136549-561.
Van Der Geest, S. et S. Sarkodié1998 The fake patient : a research experiment in a Ghanaian
hospital, Social Sciences and Medicine, XXXXVIl, 9:13731381.
Chapitre 9
La transmission sexuelle des maladieschez les Mossi. Rencontre descatégories nosologiques populaireset biomédicalesdans le champde la santé publique (Burkina Faso)
Marc Egrot, Bernard Taverne
Dans toutes les sociétés, et bien avant la diffusion desinformations biomédicales, il existe des savoirs plus oumoins élaborés sur les maladies transmises à l'occasion desrelations sexuelles. Ces savoirs guident en partie l'identification de ces pathologies et définissent les recours thérapeutiques jugés les mieux adaptés.
La forte prévalence des maladies sexuellement transmissibles (MST) dans les pays d'Afrique au sud du Saharaest depuis longtemps un sujet de préoccupation pour les responsables des politiques de santé. A la fin des années 80, lamise en évidence du rôle des MST dans la propagation del'infection à vih (OMS, 1989) a entraîné un regain d'attentionenvers la prévention et le traitement de ces maladies. Maisactuellement, un même constat est fait dans la plupart despays africains: « la majorité des personnes souffrant de MSTne se présentent pas dans les services de santé, elles sontsoignées par les guérisseurs, (. .. ) patients et guérisseurs sontconvaincus que les traitements "traditionnels" sont plus efficaces que les traitements "modernes" »1 (Green, 1992). Sur la
1 Traduit de l'anglais par les auteurs.
222 Les maladies de passage
base de ce constat, d'innombrables < campagnes de sensibilisation » sont mises en œuvre dans tous les pays afin de diffuser le plus largement possible des informations sur les MSTet le sida. Le Burkina Faso ne fait pas exception à cette règle;les institutions publiques et privées, nationales ou internationales, multiplient les interventions à l'intention de lapopulation générale et de différents « groupes cibles ".
Ces interventions sont fondées sur le principe del'acquisition de savoirs par des personnes a priori ignorantes, et elles font exclusivement référence à la nosologiebiomédicale. Les énoncés interfèrent avec les savoirs populaires préexistants qui sont le plus souvent méconnus desprofessionnels de santé et des concepteurs des messagesd'information sanitaire.
Comment sont pensées et classées les maladies transmises à l'occasion des relations sexuelles? Quelles sont lesreprésentations de la transmission de ces maladies? Quellesconduites préventives et prophylactiques sont liées à cesreprésentations? Quelles sont les interactions entre lesconceptions et pratiques populaires relatives à la maladie etle système de santé biomédical.
Le texte suivant apporte des réponses à ces questions àpartir des résultats de deux enquêtes ethnographiques menéesdans la région centrale du pays Mossi au Burkina Faso-.
Les pug-bonse
Les Mossi regroupent les maladies transmises lorsd'un rapport sexuel dans une catégorie nosographique qu'ilsnomment pug-banse. Ce terme est constitué par le radicalpug (paga) qui désigne la femme, et le nom commun banse
2 Les informations ont été obtenues par des entretiens serni-structurés etdes observations directes effectués à l'occasion de séjours de longuedurée (plus de 12 mois) dans les provinces du Bazega entre 1994 et1996 par M. Egrot, et de l'Oubritenga entre 199:1 et 1999 parB. Taverne. Ces recherches ont été réalisées en milieu rural, dans desvillages distants de 25 à 50 km de la capitale. La majorité des entretiens a été réalisée en rnoré, la langue des Mossi, à l'aide d'un interprète, auprès d'hommes et de femmes de la population générale, de guérisseurs et de professionnels de la santé.
La transmission sexuelle des maiadies chez les Mossi 223
qui signifie maladies (sing. baaga). L'expression pug-bansesignifie littéralement « femme-maladies ", autrement dit« maladies de femme ». Il s'agit des maladies que l'oncontracte auprès des femmes, sous-entendu à l'occasion desrelations sexuelles. Le terme pug-banse est d'un usage habituel tant dans la population générale que chez les guérisseurs. Une dizaine de maladies entrent dans cette catégorie.
La comparaison de ces dix maladies entre elles, sur labase de leurs mécanismes, de leurs étiologies et de leursexpressions sémiologiques, révèle que la définition de la catégorie nosographique des pug-banse n'est pas univoque:
- de prime abord, le premier principe classificatoiresemble être la référence à l'acte sexuel. Les pug-banse onttoutes en commun le fait d'être acquises lors d'un rapportsexuel (même s'il est aussi admis que certaines peuvent setransmettre selon d'autres modalités). Mais il existe desmaladies survenant secondairement à des relations sexuellessans pour autant être incluses dans la catégorie des pugbanse. C'est notamment le cas de celle qui apparaît lorsqu'unindividu (masculin ou féminin) a un rapport sexuel - réel ouonirique - avec un partenaire qui n'est en fait qu'une forcevitale (siiga) ayant provisoirement revêtu une apparencehumaine; cette maladie nommée tiiga n'est pas classéeparmi les pug-banse. De même, la relation néfaste qui liedeux hommes ayant eu des relations sexuelles, même éloignées dans le temps, avec une même femme, n'est pas inscrite dans le domaine des pug-banse, alors qu'elle suppose pourtant la création d'un lien mortifère entre ces hommes, acquislors de la relation sexuelle avec la femme. Le coït, en tantque causalité instrumentale3, apparaît donc comme un critère nécessaire mais non suffisant.
3 Pour reprendre la terminologie et la classification proposées parA. Zempleni (1985) : le diagnostic de maladie, en plus de sa reconnaissance et de sa nomination, comporte au plus les 3 questions suivantes:11 la description du moyen ou du mécanisme (comment est-elle survenue ?) qui définit la cause instrumentale ; 21 l'identification de l'agentqui en est responsable (qui ou quoi l'a produite?) qui définit la cause efficiente ; 31 la reconstitution de son origine (pourquoi est-elle survenueen ce moment, sous cette forme et chez cet individu ?) permettant dedéfimr la cause ultime ou finale.
224 Les maladies de passage
- l'imputation de l'apparition et de la transmission despug-banse est globalement orientée vers les femmes ainsiqu'en témoigne la dénomination de la catégorie nosographique. Ceci n'est cependant pas spécifique à cette catégoriede maladies, et là encore, le rôle attribué aux femmes dans latransmission ne constitue pas un critère distinctif suffisant.
- dans le registre étiologique, à partir d'interprétationsse référant au niveau des causes efficientes des maladies, lesMossi distinguent deux grandes catégories d'affections : les« maladies de Dieu » (wend-banse) qui sont conçues commeétant de cause « naturelle », conformes à l'ordre du monde telqu'il est instauré par Dieu (WendeJ ; et les maladies dues auxancêtres, aux génies, aux humains, etc. Si la plupart des pugbanse sont considérées comme « maladies de Dieu », certainessont attribuées aux ancêtres ou à des actes de sorcellerie instrumentale. Ainsi, cet ensemble de maladies ne forme pas ungroupe homogène du point de vue des causes efficientes.
- la sémiologie populaire décrite pour chacune despug-banse révèle la diversité des expressions cliniques et deslocalisations anatomiques des affections. Certaines se traduisent par des lésions sur les organes génitaux, d'autres sontdes affections générales (syndromes complexes associant dessignes relevant de plusieurs appareils), d'autres encore sontseulement respiratoires, psychiques, etc. Les pug-banse puisent dans des registres sémiologiques qui dépassent largement la sphère génitale. La catégorie des pug-banse n'estdonc pas définie sur la base de la ressemblance entre lessignes et les symptômes de chaque maladie, ce que Vinéis(1992: 27) nomme un critère phénoménologique.
- enfin, la « légitimité» de l'inscription de certainesaffections dans la catégorie pug-banse est variable. Elle nefait aucun doute pour certaines maladies (ex. sopisi, tuma,pug-kosgo, sida). Celles-ci constituent en quelque sorte le «
noyau dur» du champ nosographique : les personnes rencontrées reconnaissent de manière unanime et sans la moindrehésitation cette appartenance. Pour d'autres affections (ex.ku-pogdo, pug-poaaga), les avis sont plus partagés, d'autantque certaines de ces pathologies appartiennent aussi àd'autres ensembles nosographiques. Aussi la catégorie despug-banse semble floue à sa périphérie : le champ nosogra-
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 225
phique n'est pas exclusif; certaines affections relèvent aussides catégories de la « folie » (pug-ruubo), d'autres des « maladies de famille » (tuma), des « maladies des ancêtres » (kupogdo), etc.
En conclusion, il apparaît que l'on est face à une classification de type polythétique : le seul élément commun entretoutes ces maladies est leur transmission possible par le coït;ce critère est nécessaire mais non suffisant, et aucune desautres propriétés n'est suffisante ni nécessaire pour appartenir au groupe (Vinéis ibid. : 30). Ceci est souvent le cas pourdes nosographies populaires; cette absence de propriété commune se retrouve en particulier dans le domaine des modesde transmission.
Brève description des 10 pug-banse
• Le sopisi se manifeste dans les jours qui suivent unerelation sexuelle avec une personne malade ou une exposition dans un espace pollué. Elle s'exprime sous la formed'une blennorragie, c'est-à-dire par l'écoulement spontanéde sérosités purulentes et par une dysurie.
• Le pug-poaaga est une appellation à laquelle peuventcorrespondre divers syndromes très différents ; seul l'und'entre eux est classé dans la catégorie des pug-banse4 .
« Le poaaga contracté pendant l'acte sexuel» atteint lespersonnes des deux sexes et se traduit par des urinespurulentes. Il peut s'accompagner d'un gonflement des testicules qui deviennent douloureux, de douleurs hypogastriques (pende : bas ventre), et aussi d'une gène mictionnelle mais moindre que celle occasionnée par le sopisi.
• Le kiiga (( maladie du rat palmiste ») se manifestepar la présence d'ulcérations sur les organes génitaux.Chez l'homme, ces ulcérations débutent autour du méaturétral, chez la femme sur la vulve, où elles auraient tendance à s'étendre jusqu'à recouvrir l'ensemble de la vulvepuis atteindre l'intérieur du vagin, entraînant alors une
4 Il existe une autre forme du pug-poaaga qui affecte uniquement lesfemmes et n'est pas une pug-banse.
226 Les maladies de passage
gène majeure avec un écoulement de sang spontanémentou lors des mictions5.
• Le pug-bendgo (pug/femme et bendgo/piège ;« femmepiège » ou « femme-piègée ») est une maladie qui affecte leshommes à la suite d'un rapport sexuel avec une femme quia été l'objet, par son époux et à son insu, de pratiquesmagiques destinées à rendre malades ses éventuelsamants. Les effets et l'intensité du piège sont variables.Les moins dangereux se limitent à provoquer une anérection transitoire. Dans quelques cas, la maladie commencerait dans les jours suivant le rapport sexuel par des boutons (yuuga) sur le sexe qui augmenterait de volume. Maisl'élément caractéristique est lié à la présence de termites(kinkierba) « qui rongent le sexe et que l'on ne peut enlever »,accompagnées de pus. Certains pièges, réalisés par desmaris très jaloux et amers (toogo), sont particulièrementredoutables. Au moyen d'une « reine des termites », ils peuvent entraîner un éclatement de la vessie ou un décèsconsécutif à un délabrement majeur de la verge.
• Le sabga est une entité nosologique complexe, caractérisée par un contenu juxtaposant de nombreux tableauxsémiologiques et des limites imprécises. Il est questiontantôt d'une diarrhée, tantôt de vertiges avec « maux dereins» (lombalgies). Parfois cette maladie est présentéepar un tableau associant des douleurs « dans tout le corps»et une asthénie intense, lorsque d'autres fois il est question d'un « gonflement du ventre » avec « arrêt des gaz »,d'une difficulté pour uriner, ou enfin, chez l'homme, d'uneimpuissance par anéjaculation. A cette multiplicité desyndromes pouvant évoquer un sabga, s'ajoute une perméabilité de la frontière avec une autre maladie abdominale que les Mossi nomme le kuiiga. Des guérisseursassocient le sabga avec le kuiiga : « si une femme a lesabga et si un homme a un rapport sexuel avec elle, lekuiiga va attaquer l'homme ». Plus loin, le même guérisseur précise : « et si le kuiiga devient gros et qu'il fautl'opérer, c'est ça que l'on appelle le sabga ».
5 Il est communément admis que cette maladie affecte également les anImaux (chèvres, chiens, etc.).
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 227
• Le pug-kosgo (pug/femme et kosgo/toux = « femmetoux" ; « la toux contractée pendant le rapport sexuel »)est aussi parfois nommée le song-kosgo (songo : natte enpaille servant de lit), terme où la natte apparaît commeune métaphore de la relation sexuelle. Le pug-kosgo semanifeste dans un délai variant de quelques mois jusqu'à3 ans. Lors de cette période silencieuse, la maladie« bouffe »,« aspire »,« suce» le sang. Elle se manifeste par une touxchronique accompagnée d'expectorations blanchâtres comparées au sperme, et par la suite d'hémoptysies. Le malade maigrit, ses yeux deviennent rouges, son teint s'éclaircit puis généralement la mort survient après deux à troisans d'évolution.
• Le pug-ruubo (pug/femme et ruubo/morsure =« femme-morsure» ; « la morsure pendant l'acte sexuel »).
La maladie s'exprime après une phase de latence silencieuse pouvant varier de 1 à 4 ans. La personne atteintedu pug-ruubo devient « folle ». Ce trouble psychique peutsurvenir brutalement: « la personne se déshabille etentre dans la brousse » selon un guérisseur. Il peut aussidébuter de manière plus progressive : « ça peut commencer par des maux de tête, puis des douleurs dans tout lecorps, la personne va se caresser la tête sans cesse, etpuis quelque temps plus tard, ça va devenir grave. Elle vase lever un jour en voulant tout casser, en voulant tuer lesgens avec n'importe quel outil qu'elle trouve. Là il fautl'attraper et l'enchaîner, elle peut être vraiment dangereuse » selon un autre guérisseur.
• Le tuma est évoqué par les guérisseurs et les individus âgés. Ils en parlent comme d'une « maladie de l'ancientemps » qui aurait pratiquement disparu de nos jours parl'action du « traitement des Blancs ". Les descriptions lesplus souvent énoncées sont imprécises et mentionnent desulcérations génitales mais aussi des lésions cutanées« rouges» autour de la bouche, dans la gorge, qui pourraient empêcher de manger et de boire. D'autres fois, untableau associant une desquamation des régions génitale,périnéale et de la face interne des cuisses, accompagnéede prurit, est également évoqué. Ces signes cutanés peuvent s'étendre sur tout le corps rendant alors la position
228 Les maladies de passage
allongée difficile. La maladie peut également « couper lesdoigts », enlever les lèvres et provoquer une chute desdents.
• Le ku-pogdo (kure/funérailles et pogdo/femme =« femme de funérailles ») affecte tout homme qui auraiteu un rapport sexuel avec une veuve, avant que celle-ci neréalise le rituel de levée de deuil. Elle se manifeste pardes œdèmes au niveau des pieds, des mains et des yeux.En l'absence de traitement la maladie s'aggrave et l'évolution vers une lèpre (waoodoJ est alors évoquée.
• Le sida est aujourd'hui connu de tous, et a été intégré dans la catégorie des pug-banse. Cela ne s'accompagne pas pour autant de connaissances médicalementconformes, et celles que les guérisseurs ont sur le sidasont peu différentes de celles de la population villageoisedont ils sont issus. Tous évoquent le diagnostic sur l'association des éléments suivants: diarrhées chroniques,amaigrissement majeur, lésions dermatologiquesdiverses, appétit insatiable de viande. La « débauchesexuelle» ou un séjour en Côte-d'Ivoire sont encore régulièrement associés à l'affection. Le diagnostic de sidaconcerne toujours les personnes en phase de maladie, austade terminal.
La Transmission des pug-banse
Chez les Mossi, la notion d'acquisition d'une maladieest exprimée par plusieurs termes. Un individu ne dit pas« je suis malade» ou « j'ai attrapé une maladie» mais « lamaladie m'a pris, la maladie m'a attrapé », par exemple: « larougeole a attrapé X » (bi nioka X). D'autres verbes d'actiontel « gagner» et « suivre» sont aussi employés: « la maladiea gagné X » (paame), « la maladie suit X » (tuudameJ. Latransmission est évoquée de la manière suivante : « la rougeole contamine les gens» (bi longda nebaJ, longda signifieaussi passer, traverser, enjamber, passer d'un lieu à unautre; une maladie peut aussi se répandre (benegeJ, ce verbeest également utilisé pour signifier « étaler », par exemple unonguent sur une plaie.
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 229
Les pug-banse font partie des maladies qui « attrapent»les gens ; elles sont transmissibles. Cependant elles sontacquises par des mécanismes de transmission qui ne sontpas identiques pour chacune de ces maladies. Leur description permet de distinguer deux catégories : celles qui sontcontagieuses, et celles qui ne le sont pas.
La transmission des pug-banse par contagion
Un individu porteur de la maladie peut la transmettre,par contact direct ou indirect, à une personne saine, laquelleà son tour pourra la transmettre à d'autres. Elle peut advenir dans plusieurs circonstances: lors du coït; par contactdirect et indirect avec des liquides corporels d'une personneatteinte; à distance, par l'effet d'une émanation issue de cesliquides.
• lors du coït :
La transmission est due à l'intensité et à l'intimité ducontact physique, ainsi qu'à l'échange des humeurs corporelles qui lui est associé.
Les représentations de la transmission des maladieslors du coït sont liées à celles de la procréation au sein desquelles deux niveaux d'interprétations coexistent. Le premier est d'ordre symbolique: « pour les Mossi, la procréationest le résultat de la pénétration d'un esprit appelé kinkirga(pl. kinkirse) dans le ventre de la femme au moment où celleci a un rapport sexuel avec son mari» (Bonnet 1988:21). Leprocessus reproductif est dépendant de l'entente entre leshumains, les génies et les divinités, les vivants et lesancêtres. Mais parallèlement, la fécondation est aussi décriteen des termes qui relèvent de représentations populaires dela physiologie humaine: « pendant le « mélange» (coït), la« bouche du sexe » de l'homme s'ouvre, elle aspire « l'eau»(koomJ produite par la femme qui « verse» la première. Dansle corps de l'homme, « l'eau de la femme» se mélange avec« l'eau de l'homme », puis l'homme « verse» [éjacule] lemélange [des deux eaux] dans le corps de la femme, et c'estça qui va faire l'enfant» selon un guérisseur. Dans ceregistre interprétatif, « l'eau» de l'homme et celle de la
230 Les maladies de passage
femme sont décrites comme étant élaborées à partir du« sang» selon des modalités assez complexes faisant appel àdivers organes et tissus (reins, tendons, testicules, utérus, os,moelle). Ces deux registres interprétatifs coexistent en permanence, en particulier dans l'ensemble des pratiques destinées à favoriser la fécondation. Ils ne sont pas exclusifs et ilpeut y être fait référence alternativement ou simultanémentpar les mêmes personnes.
La circulation et l'échange des humeurs génitalesexpliquent la transmission de certaines maladies. Il est eneffet admis que lorsque l'homme « verse» le mélange deshumeurs dans le corps de la femme, une partie demeure enlui: « il y a une partie de l'eau de la femme qui est entrée,mais en versant, l'homme ne remet pas tout, aussi, si lafemme a le sopisi, l'homme l'aura aussi» précise le mêmeguérisseur. La contamination d'une femme par un hommerelève du même mécanisme : « si la maladie se trouve avecl'homme, et si au moment où il « verse », le lieu où est couchél'enfant est ouvert, ça va entrer là-bas, et puis ça va se fermer lorsqu'il aura fini, et la maladie sera chez la femme ».
Le coït provoque l'entrée d'éléments féminins dans lecorps masculin, cette pénétration est évidemment redoutéepar les hommes. Au premier rang des substances fémininesnocives se situe le sang menstruel : « le sang de la femme varemonter le sperme, il entre et il se tait, et c'est ça qui tue lesexe ; un jour tu vas aller chercher une femme et le sexereste mou; il [le sang menstruel] entre par le sexe, puis il vadans le ventre et rentre dans tous les os du corps, il suit lestendons et va au niveau des cuisses et c'est la maladie seulement; le sang de la femme est mauvais », précise un autreguérisseur. Son entrée dans le corps de l'homme peut entraîner chez celui-ci une impuissance, ou la maladie nomméesabga, et plus largement encore une malchance généralisée.Les hommes, jeunes et vieux, sont rarement à court d'idéespour détailler les méfaits du sang menstruel: « ton sexe peutmourir », « toutes tes affaires vont se gâter, tu vas perdre tonargent, tes bœufs, toute ta richesse », « ça va annuler le pouvoir de tes protections », etc.
Pourtant, les menstruations sont créditées d'un rôlebénéfique pour le corps de la femme, et « salvateur» pour son
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 231
partenaire sexuel. En effet, le liquide menstruel permet l'élimination régulière des impuretés (regdo, lit. saletés) quis'accumulent dans le corps féminin. Le sperme est l'une deces impuretés. Les accouchements ont la même propriété :« une femme qui continue d'accoucher n'a jamais le sabga "précise un guérisseur, elle ne peut donc pas le transmettre àson partenaire. À l'inverse, une femme en aménorrhée, parcequ'elle ne « bénéficie » plus du nettoyage régulier de soncorps est susceptible de transmettre facilement le sabga etde souffrir elle-même de pug-poaaga.
Ainsi, c'est le mélange intime des liquides sexuels quiest jugé à l'origine de la transmission des cinq pug-banse suivantes: sopisi, tuma, kiiga, sida et sabga. Mais ce mode detransmission n'est pas le seul possible car le pouvoir contagieux de certains liquides corporels peut s'exprimer aussi àl'extérieur des corps.
• par contact direct et indirect avec des liquides corporels:
Les urines, les sécrétions génitales, le sang et sesautres dérivés, issus d'un individu malade sont susceptiblesde transmettre les pug-banse indépendamment de l'actesexuel, par contact direct ou indirect.
Ainsi le sida est supposé pouvoir se transmettre parcontact avec un objet souillé de sang (lame, ciseau, rasoir, ... ),mais également par simple contact cutané avec le malade oudes habits qu'il a portés. La salive, les aliments et les platsemployés par un malade du sida sont également jugés contaminants par de nombreuses personnes.
Le rôle du contact indirect, par l'intermédiaire d'unobjet souillé se retrouve aussi pour la maladie nomméetuma, qui est décrite comme étant extrêmement contagieuseen dehors du coït : « si une personne atteinte par le tumas'assoit sur ce banc et puis s'en va, celui qui va venirs'asseoir à sa place va être atteint ", affirme un vieil homme.Un guérisseur précise encore que « la maladie peut contaminer par les habits et les aliments, on ne doit pas manger desaliments chauds avec un malade du tuma ".
L'essentiel du risque de contagion indirecte est lié àune émanation de la maladie. Certaines pug-banse peuventêtre contractées en urinant sur un lieu où un malade a précé-
232 Les maladies de passage
demment uriné: « un homme ou une femme peuvent attraper ça en allant pisser dans un endroit où quelqu'un demalade avait pissé, si il y a du sopisi ou du pug-poaagadedans, si tu t'accroupis pour ajouter ton urine, tu vas attraper la maladie » met en garde un guérisseur.
L'élément contaminant est nommé le walgo : « c'est lewalgo de la maladie qui est là sur le sol, si tu pars pisser, lewalgo se soulève et remonte ton urine pour entrer dans toncorps » selon un guérisseur. Ce terme est communément traduit par « gaz » ou « vapeur ». Il s'agit d'un principe immatériel porteur de la maladie, qui émane du malade lui-même,de ses humeurs, de ses excréta, des objets qu'il touche, maisaussi des cadavres (humains et animaux). Il est souvent comparé au gaz, car il est comme lui invisible, mais tout aussiprésent, puisque le gaz peut s'enflammer et le walgo transmettre une maladie.
Le pouvoir de contamination du walgo est variabledans le temps. Certaines personnes considèrent que lorsquel'urine du malade est totalement sèche, le walgo a disparu,d'autres affirment qu'il persiste après la disparition de latrace d'humidité sur le sol : « même si l'urine a séché, lewalgo peut te prendre Loo) c'est comme de l'essence, si on laverse à terre, ça devient vite sec, mais si tu pisses dessusc'est comme si elle était encore là ; tu pisses et tu as attrapé[le mal] » selon un guérisseur. Il est également parfois affirmé que le walgo qui semble avoir disparu peut être « réactivé»par des urines fraîches.
Enfin, le pouvoir de contamination du walgo est aussilié à la susceptibilité individuelle aux maladies de celui quiest exposé à ses effets. Cette susceptibilité dépend essentiellement de l'âge et de l'état du « sang ». Les personnes jeuneset celles qui ont le « sang chaud » (zi-tulga), ce qui est lié,sont plus facilement contaminées que les individus âgés ouceux qui ont un « sang frais » (zi-masga).
Les pug-banse qui peuvent « attraper » les gens parl'effet du walgo sont: sopisi, pug-poaaga, kiiga, tuma et sida.
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi
La transmission des pug-banse non contagieuses
233
La particularité des pug-banse non contagieuses tientau fait qu'aucun des deux partenaires n'est malade aumoment où se déroule l'événement qui va provoquer l'émergence de la maladie chez l'un des deux. Cet événement esttoujours bien identifié. De plus, la maladie une fois acquisen'est pas considérée comme transmissible: elle ne peut pascontaminer un tiers, ni par contact direct ou indirect, ni parl'effet du walgo.
Quatre événements conduisent à la transmission de cesmaladies: la toux et la morsure pendant le coït, des relationssexuelles avec une femme « piégée », et le non respect del'interdit sexuel prescrit aux femmes pendant leur veuvage.
• La toux pendant le coït« Lorsque l'homme et la femme se « mélangent », si
l'un tousse, l'autre va prendre la maladie, ça attrape les genspendant le rapport ; si la femme tousse, l'homme sera malade, si l'homme tousse, c'est la femme qui sera malade » précise un jeune homme. Cette affection est nommée le pugkosgo6.
Les explications sur le mécanisme d'apparition de lamaladie font référence à une anomalie de la localisation dusperme. Le trajet normal du sperme dans le corps serait perturbé chez celui qui « reçoit» la toux. La toux de la femmeentraînerait un reflux du sperme dans le corps de l'homme àtravers son sexe, tandis que la toux de l'homme provoqueraitune pénétration trop importante du sperme dans le corps dela femme. Dans les deux cas, il en résulterait une situationanormale du liquide séminal responsable de l'apparition dela maladie qui se traduit par des expectorations dont la substance est comparée explicitement au sperme?
Les Mossi insistent sur le caractère non contagieux dupug-kosgo : « une personne qui a le pug-kosgo ne peut pas en
6 une maladie similaire, le khélé kontm, existe chez les Lobi du BurkinaFaso (Cros, 1990 : 144)
7 Cette maladie vient s'ajouter aux diverses autres affections liées auxanomalies du trajet ou de la présence de sperme dans le corps del'homme, de la femme, et de l'enfant (à travers le lait maternel).
234 Les maladies de passage
contaminer rtongreJ une autre, ça ne contamine ni par les aliments ni par le contact physique » précise un premier guérisseur, tandis qu'un autre affirme encore: « ça ne prend (niokJpas les gens simplement, la salive ne donne pas la maladie, cen'est pas contagieux, si un homme a le pug-kosgo et il a un rapport sexuel avec une femme, ça ne va pas donner la maladie àla femme C.. ) c'est seulement si l'homme ou la femme tousse ».
• La morsure pendant le coït
La morsure pendant une relation sexuelle entraînel'apparition du pug-ruubo. L'agent causal à l'origine de lamaladie n'est pas clairement précisé. Il s'agirait d'une substance inoculée lors de la morsure, mais « ce n'est ni la salive, ni un fragment de dent; de même qu'une plaie avec unmorceau de fer donne le tétanos, et il faut aller au dispensaire pour se faire vacciner, les dents de l'homme ont leur poison » assure un guérisseur. Un autre homme affirme également: « c'est le venin de la dent, il teint (yunigi) le sang ». Leterme teindre signifie ici que la substance est à ce pointentrée dans le corps qu'elle s'est fondue dans l'organisme,qu'elle modifie la nature du sang, mais sans agir réellementsur sa couleur.
Une distinction est clairement affirmée entre l'effetd'une morsure pendant le coït et celles qui peuvent survenirà l'occasion d'altercations en d'autres circonstances: « lesmaladies ne sont pas les mêmes » est-il affirmé.
• Les femmes « piégées»
Le piège (bendgo) est réalisé par un guérisseur à lademande du mari. Il s'agit d'une préparation que l'hommedonne à son épouse sans qu'elle en soit informée. La substancepeut agir à partir de différents modes d'administration : ellepeut être ingérée en la mélangeant dans un plat ou une boisson; elle peut être enduite sur un filou répandue sur le seuild'une porte que la femme franchit (enjambe). A cette substance s'associe parfois un objet magique conservé par le mari.
La femme piégée n'est pas malade, et son mari peutavoir des relations sexuelles avec elle sans dommage car ilpossède un antidote (yindu). Par contre, tout homme ayantune relation sexuelle avec cette femme sera malade parl'effet du piège.
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 235
• Le rapport sexuel avec une veuve
Tout homme qui aurait un rapport sexuel avec uneveuve (pug-koore), avant la fin de la période de deuil de celleci, peut être victime du ku-pogdo. Les veuves sont soumises àun interdit sexuel qui s'étend du décès du mari jusqu'à lacérémonie de levée de deuil qui survient plusieurs moisaprès l'enterrement, parfois plus d'une année.
Les explications sur les mécanismes de cette maladieévoquent un contact avec les « souillures " (regdo) du maridéfunt présentes dans le corps de son épouse, notammentson sperme. La maladie résulterait de la rencontre néfasteentre le sperme du défunt, qui n'a pas été totalement éliminédu corps de la femme, et celui du nouveau partenaire.
Prévention et prophylaxie des pug-banse
A chacune des pug-banse, et en rapport avec les différents modes et circonstances de transmission évoqués, correspond un ensemble de recommandations et de mises engarde ayant pour but de se protéger contre leur survenue.
Ces recommandations sont couramment rappelées parles guérisseurs lors de leurs activités thérapeutiques, maiselles sont surtout évoquées entre pairs, dans des petitsgroupes de discussion. C'est en particulier le cas lorsque dejeunes hommes se rassemblent par affinité, avant d'aller« chercher les filles » d'un village voisin. Parmi eux, les plusâgés, qui ont déjà eu quelques expériences sexuelles, se plaisent à conseiller les plus jeunes, impatients de « connaître ».
Ces conseils se répartissent en trois groupes:
- un ensemble d'avis qui relèvent de mesures d'hygiènepopulaire permettant de se protéger contre la transmission dela plupart des maladies, et pas seulement des pug-banse ;
- des avis à propos du choix du partenaire sexuel;
- des conseils liés au déroulement du coït.
• Les conseils d'hygiène :
Ils se réfèrent pour la plupart au risque de transmission par le walgo des maladies. Le pouvoir pathogène du
236 Les maladies de passage
walgo diminuant avec la distance, il s'agit donc avant tout dese tenir le plus loin possible des sources potentielles decontamination. Il est donc conseillé de contourner les espacessouillés comme les aires mictionnelles et défécatoires, de nepas les enjamber et de ne pas uriner dans ces lieux, ou, àdéfaut, de ne pas le faire accroupi car la trop faible distanceentre le sol et le corps augmenterait le risque de transmission. Ainsi, certains guérisseurs affirment que « si tu pissesaccroupi, la maladie t'attrape, mais si tu pisses debout, ça nepeut pas remonter jusqu'à toi ».
Cette mise à distance s'applique aussi aux individusqui sont considérés malades, et aux objets par eux utilisés. Ilest ainsi recommandé de se tenir à distance des malades dusida, de ne pas s'asseoir sur un siège qui a été utilisé par unmalade du tuma, etc. Ces conseils s'appliquent aussi àl'égard de certains animaux: ainsi il est recommandé de nepas enjamber une chèvre ou une brebis atteinte par le kiiga.
• Les recommandations liées au choix du partenaire:
Même dans le cas d'une rencontre éphémère, quin'engage pas les individus dans une relation à long terme,divers critères s'appliquent au choix du partenaire sexuel.
Dès le début d'une rencontre, alors que les individusen sont encore aux jeux de séduction, ils doivent vérifier sileurs origines généalogiques et leur réseau d'affinité ne leurinterdit pas toute relation sexuelle. En effet, deux principesdoivent être scrupuleusement respectés:
- le premier est l'expression de la règle d'exogamie etde prohibition de l'inceste. Elle définit les partenairessexuels autorisés et interdits par rapport aux lignages d'origine des deux individus. Si les partenaires sont généalogiquement trop proches8 , il est dit qu'ils sont « frère et soeur ».
Les relations sexuelles n'entraînent pas de maladie, maiselles sont interdites et condamnées9.
8 Chez les MOSSI, la règle d'exogamie étend la prohibition de l'allianceaux hgnages des quatre grands-parents (Izard, 1985:6)
9 Dans le passé, les individus étaient bannis du village dès qu'une tellerelation était découverte.
La transmission sexuelle des maiadies chez les Mossi 237
- le deuxième principe recommande à tout homme den'avoir aucune relation sexuelle avec une femme qui en auraiteu précédemment avec l'un de ses amis. Si cela survient, ilapparaît un lien néfaste entre les deux hommes qui peut entraîner la mort de l'un d'eux dans des conditions particulières. Cetterègle s'applique quelle que soit la durée qui sépare ces deuxrelations. Pour éviter une telle situation, dès le début d'une rencontre, les partenaires passent en revue lO leur réseau de relation à la recherche de leurs amis communs. Si l'homme suspecteque l'un d'entre eux a eu des relations sexuelles avec la femmequ'il convoite, il va immédiatement lui signifier que leurs jeuxde séduction ne peuvent conduire à une relation sexuelle.
Ces questions « préalables " étant résolues, viennentalors des conseils plus directement liés à la prévention despug-banse. Le premier est une mise en garde contre les« pièges " dont peuvent être porteuses, malgré elles, lesfemmes mariées. Il est conseillé aux jeunes qui n'ont pasencore assez de « force " de s'abstenir de séduire les épousesdes autres, et aux téméraires de se prémunir à l'aide de protections magiques. Il existerait en effet des amulettes permettant de révéler si une femme convoitée est « piégée " : unbracelet pourrait serrer le bras de l'homme qui le porte lorsqu'il est en présence d'une « femme piégée "... Certaines préparations permettraient d'annuler totalement les effets dupiège préparé par un mari jaloux.
Enfin, la dernière recommandation relative au choixdu partenaire concerne les veuves. Il est interdit d'avoir desrelations sexuelles avec elles avant les cérémonies de levéede deuil, sous peine d'être frappé de ku-pogdo. Un rituel particulier de ces cérémonies, désigné par le terme guuri, a pourbut de « nettoyer» totalement les dernières traces dudéfuntll . Le lavage du corps et les ablutions permettent l'élimination totale de toutes les « souillures» transmises par ledéfunt à son entourage avant sa mort.
10 De manière discrète mais efficace.
11 Le terme guun désigne une espèce de fourmis bien déterminée [MessorgaZla (Mayr), MyrmicinaeJ. De la terre prélevée sur les fourmilières dumême nom est utilisée pour la préparation du foyer qui sert à fairechauffer l'eau destinée au lavage des veuves et des fils du défunt (pourune description détaillée du rituel, cf. Egrot, 1999:408-409).
238 Les maladies de passage
Plus récemment, sont apparues quelques recommandations liées à la crainte de transmission du sida. Lesfemmes dont les époux sont suspectés d'être décédés du sidasont en effet considérées comme porteuses de « la maladie ».
Parfois nommées « femmes-sida », il est conseillé de les éviter, il leur est de plus en plus souvent refusé le droit au lévirat. Les migrants de retour de Côte d'Ivoire sont égalementsoupçonnés d'être contaminants et des périodes d'observationplus ou moins longues leur sont parfois imposées avant qu'ilspuissent espérer trouver un partenaire sexuel.
• les recommandations qui s'appliquent au coït:
L'un des tout premiers conseils que s'échangent lesjeunes a trait à la toux et aux morsures. Il est vivementrecommandé de ne jamais tousser ni de mordre son partenaire pendant le coït afin de ne pas transmettre le pug-kosgo oule pug-ruubo. Ce qui pourrait passer pour une attention àl'égard du partenaire se double en fait du conseil de « rendre,de remettre » la toux ou la morsure éventuelle. Il s'agit, si lepartenaire tousse, de tousser en retour (une autre solutionconsiste pour celui « qui a reçu la toux » à frapper du piedcontre le mur de la chambre), et de le mordre s'il a mordu.Ainsi, le risque de transmission de ces deux maladies setrouverait annulé. Au cas où cette pratique préventive neserait pas effectuée, et si rien n'est fait le lendemain, alorscelui qui a « reçu » la toux ou la morsure, serait irrémédiablement porteur de la maladie, réputée fort difficile à guérir.
Face au pug-kosgo, il existe tout un arsenal préventifet curatif. À titre préventif, certains guérisseurs réalisentune protection médico-magique sous la forme d'une poudrequi doit être absorbée, mélangée dans la pâte de mil. Cetteprotection serait définitive, mais peu de personnes yauraient recours. Aussi, la principale prévention consiste àne pas tousser pendant le rapport sexuel, quitte à l'interrompre si la toux est imminente.
Si ces premières procédures d'annulation sont impossibles, on entre alors dans le domaine des traitements prophylactiques qui doivent être effectués le lendemain matin.Diverses variantes plus ou moins compliquées de ce traitement sont énoncées.
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 239
Cinq traitements prophylactiques contre le pug-kosgo
- il faut verser de l'eau sur la natte [sur laquelle étaitétendu le couple] récupérer cette eau, et la boire chacun àson tour,
- l'homme et la femme se lavent puis vont jeter l'eau deleur toilette sur un zi-peelga (zone de terre aride surlaquelle sont censés habiter des génies [kinkirsi]),
- on verse de l'eau sur la natte, puis on la récupère dansune calebasse, ensuite, on sort de la case, on verse cetteeau sur le toit, [elle va glisser sur la paille] et on la récupère dans une autre calebasse au bord du toit, et on boit.
- il faut sortir de la case avec la natte [sur laquelle étaitétendu le couple], la rouler, prendre une calebasse pleined'eau et jeter cette eau sur le toit de la case, l'eau va coulersur le toit, puis atteindre le bord du toit, là il faut mettre lanatte afin que l'eau passe dedans [comme dans un tuyau],avant de la recueillir dans une autre calebasse dans laquelle a été mis un fer de houe (wak-kienrga). Ensuite, onprend cette eau, on la fait bouillir et chacun boit,
- ils se lèvent et versent sur la natte où ils ont dormi desgraines de petit mil, puis ils ramassent ces graines, enfont de la farine et préparent une bouillie ou de la pâtequ'ils mangent ensemble devant la porte.
Enfin, si aucune de ces mesures n'a été prise, la maladie se déclarera inexorablement. Le diagnostic et le traitement relèvent alors de la seule compétence des guérisseurs 12 .
Le deuxième conseil que se transmettent les hommes estcelui de ne pas avoir de relations sexuelles lors des menstruations. Il est impératif de se prémunir d'un contact avec le sangféminin dont le pouvoir néfaste a été précédemment évoqué.
12 Pour le pug-ruubo comme pour le pug-kosgo l'incident initial peutremonter à plusieurs mois ou années. Il est le plus souvent totalementoublié, et c'est à partir de l'interprétation des signes cliniques et del'histoire de la maladie, dans laquelle on retrouve souvent l'échec desthérapeutiques biomédicales, que les guérisseurs vont établir leur diagnostic.
240 Les maladies de passage
Enfin, une fois le rapport sexuel réalisé, afin d'éviterles effets néfastes du mélange des humeurs sexuelles dans lecorps de l'homme, il lui est recommandé « de se mettre sur lecôté, ou sur le ventre, mais de ne pas rester allongé sur ledos ". Ainsi, « le sexe pend, et le walgo des maladies peut s'enaller» explique un guérisseur.
Ces multiples conseils révèlent l'importance accordéepar la population aux notions de prévention. Ces recommandations sont énoncées en référence aux représentations desmodes de transmission des pug-banse, en particulier: à lapénétration des humeurs sexuelles féminines dans le corpsde l'homme; aux risques inhérents aux mélanges desspermes dans le corps de la femme lorsqu'elle a eu plusieurspartenaires ; à la propriété des humeurs corporelles de setransformer en souillures dès lors qu'elles sont hors deslimites qui leur sont assignées.
Rencontre entre pug-banse et MST dans le champ de lasanté publique
La description de la classe nosographique des pugbanse montre qu'elle n'est pas superposable à celle des MSTdéfinie par la médecine et utilisée dans le champ de la santépublique. Néanmoins, ces deux catégories coexistent au seinde l'espace social. L'usage de la première prédomine dans lesecteur populaire et celui des médecines traditionnelles, laseconde chez les professionnels de santé et les « agents dedéveloppement ».
Ces classes nosographiques se rencontrent de manièrerépétée en diverses circonstances, notamment dans les deuxprincipales situations gérées par les professionnels de santé:lors des demandes de soins adressées au secteur biomédical,et dans les actions d'éducation sanitaire. À travers l'observation des modalités de ces rencontres, et du contenu des informations échangées à ces occasions, peuvent être au mieuxappréciés les enjeux et la dynamique des affrontementsqu'elles provoquent.
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi
Les circonstances et les modalités de la rencontre
241
Les circonstances de rencontre influencent directementla confrontation des savoirs, il est important d'en tenir compte autant que des informations véhiculées.
Dans les actions d'éducation sanitaire, le choix deslieux repose sur la volonté des professionnels de santé de« communiquer» avec le plus grand nombre possible d'indi-
- vidus. Cela conduit à l'organisation de « campagnes d'informations » réalisées par des équipes plus ou moins spécialisées, qui interviennent dans des lieux publics (marchés, parking, gares routières, etc.). Les informations sont diffuséespar voie d'affiches, par des haut-parleurs, des films, parfoisassociées à la diffusion de messages radiophoniques ou télévisuels. Parfois même, sous forme de jeux où l'individu quidonne les « bonnes réponses » (celles médicalement justes)est récompensé de tee-shirt, préservatifs, et autres gadgets.Ces interventions sont dirigées vers la population générale,sans considération du sexe, de l'âge ou du statut social desindividus qui les reçoivent. Il s'agit de situations souventfamilières aux populations, même en milieu rural, habituéesà ces « sensibilisations » régulièrement pratiquées depuisquelques dizaines d'années pour diverses affections (paludisme, dracunculose, malnutrition, etc.). La particularité decelles sur les MST tient au fait qu'elles abordent la sexualitéde manière explicite et précise, bien plus que ce n'était le caslors des campagnes de « planification familiale ».
Or, les Mossi répugnent à s'exprimer en public sur toutce qui a trait, de près ou de loin, à la sexualité, hormis sur lemode de la plaisanterie grivoise qui n'est autorisée que dansquelques contextes sociaux bien définis. Un très fort sentiment de pudeur, la « honte », conduit à l'emploi de différentes formes langagières (euphémisme, métaphore, etc.)pour désigner sans les nommer directement les organes, lesliquides corporels, les pratiques ou les maladies liés à lasexualité.
Traiter de la sexualité dans des espaces publics estune atteinte majeure à l'ordre traditionnel. Ce n'est pas sansréticence que les « vieux » et les dignitaires religieux acceptent cela. Ces interventions sont considérées comme un des
242 Les maladies de passage
avatars « du temps moderne où l'on ne respecte plus rien ".Ils n'ont pas le pouvoir de les interdire13 mais les désapprouvent le plus souvent car ils les jugent comme des incitationsà une permissivité sexuelle irrespectueuse des règles coutumières.
La stratégie qui consiste à s'adresser à des groupes depersonnes plus homogènes (âge, sexe), dans des espaces clos(maison d'association, maternité, école .. .) résout en partie leproblème des règles de bienséances. Elle soulève par contrecelui de la stigmatisation des personnes faisant partie d'ungroupe. A cet égard, les efforts particulièrement soutenusenvers les femmes, sans qu'aucune action équivalente ne soitfaite en direction des hommes, confortent l'idée largementrépandue en société traditionnelle, de la responsabilité desfemmes dans la transmission des maladies liées à la sexualité.
Les centres de santé ne sont pas des lieux dans lesquels il est aisé d'évoquer une pug-banse. Les barrièrescréées par la « honte" existent également et sont d'autantplus difficiles à dépasser que souvent les professionnels desanté ne sont pas du même sexe que le consultant. De plus,le cadre habituel des consultations et des actes médicauxdans les centres de santé ne favorise pas la mise en confiancedes consultants. Le manque d'intimité et de confidentialitéest courant (mauvaise insonorisation des locaux, présence detémoins, d'interprètes, etc.). Enfin, l'autoritarisme dont fontpreuve un grand nombre d'agents de santé est particulièrement redouté lorsqu'il prend la forme d'une injonction à fairevenir le ou les partenaires à la consultation. Ces situationsparaissent d'autant plus paradoxales et inacceptables qu'àl'inverse les consultations chez les guérisseurs répondenttoujours aux principes de discrétion et de confidentialité.
Les contenus de la rencontre
Les messages d'information sanitaire sur les MSTabordent habituellement : les contextes et modes de trans-
13 l'acceptation de ces manifestations entre aussi dans des stratégiesvisant à attirer sur le territoire des agents de développement susceptibles d'intervenir dans d'autres secteurs (cf. Laurent, 1998).
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 243
mission des maladies; les expressions sémiologiques; l'incitation aux traitements biomédicaux; et l'adoption deconduites préventives.
• Les contextes et les modes de transmission des maladies sont évoqués à travers:
- les « groupes et comportements à risque» en désignant les prostituées, les « filles de bar », les « femmes libres »,les migrants, les routiers, le « vagabondage sexuel », le lévirat.
- le non respect des valeurs sociales telle la fidélitéconjugale; mais aussi, de manière plus insidieuse, la mise encause du caractère honnête, sérieux et travailleur de l'individu, et son insouciance à l'égard des intérêts de sa famille.
La transmission des MST est souvent évoquée dans leregistre de l'altérité tant géographique que sociale: on secontamine à l'étranger ou avec un étranger (en fait uneétrangère). Les prostituées figurent l'archétype de cetteconception en concentrant toutes les altérités possibles(Desc1aux, 1995).
Le rappel des valeurs morales dans les messagesd'information est à ce point récurent qu'il finit par apparaître plus important que ce qu'il est dans le droit coutumier.Ce dernier interdit les relations extramatrimoniales pour lesfemmes, et délimite la manière dont les hommes peuvent enuser (Taverne, 1999). Mais en aucun cas les maladiesacquises dans ces occasions ne sont considérées comme laconséquence de manquements à la morale.
Enfin, une très nette asymétrie entre hommes etfemmes est exprimée dans les messages sanitaires: lesfemmes sont plus fréquemment désignées comme vectrices,et les hommes plus souvent comme malades. Cette situationentre en résonance avec l'asymétrie sexuelle de l'imputationdes maladies en direction des femmes qui est fortementancrée dans la pensée populaire, en particulier dans ledomaine des pug-banse (Egrot, 1999 : 470).
• Les expressions sémiologiques
Quels ques soient les supports d'information(dépliants, « boite à images », vidéo, etc.) et les circonstancesd'énonciation (séance publique ou consultation médicale), les
244 Les maladies de passage
messages d'information sont bâtis sur les mêmes éléments.Ils rappellent qu'une MST doit être soupçonnée dès la présence de signes cliniques mineurs, tel un prurit, qu'unefemme peut être atteinte de MST sans même s'en rendrecompte, et qu'en l'absence de traitement cela peut avoir desconséquences graves et conduire à la mort. Certaines illustrations montrent, en gros plan, des sexes masculins et féminins suintants ou ulcérés; d'autres présentent des images dedélabrements génitaux majeurs ou d'individus cachectiquesmoribonds.
Outre le fait que ces images sont parfaitement repoussantes pour toute personne qui n'est pas au fait de la sémiologie des MST, elles heurtent la pudeur en mettant au grandjour des régions du corps qu'il est socialement convenu demasquer. L'expression de la gêne que cela entraîne est directement visible dans l'attitude des personnes à qui ces imagessont imposées : les hommes restent impassibles ou laissentfuser quelques rires, des femmes se détournent, mettent unemain devant leurs yeux, ou poussent des cris pour marquerleur gêne. Ce type de réaction se retrouve notamment lorsdes démonstrations d'utilisation des préservatifs sur despénis en bois14.
Au delà de ces aspects, l'information sémiologique délivrée (et celle qui est échangée lors des consultations) peutsembler particulièrement fruste au regard de la diversité desregistres sémiologique des pug-banse. Cette relative pauvreté sémiologique des MST correspond à la réalité clinique quela médecine reconnaît, puisque en dehors des écoulementsurétraux ou vaginaux, tous les autres signes en particuliercutanéo-muqueux ne sont pas aisément descriptibles.
• L'incitation aux traitements biomédicaux:
Les moins élaborés des messages se limitent à faireréférence aux délabrements anatomiques et à la mort.D'autres évoquent des conséquences apparemment moins
14 Les démonstrations de pose d'un préservatif sur les pénis en bois queles femmes sont lllvitées à réaliser en public, apparaissent d'autantplus choquantes qu'une femme mossi ne doit en principe jamais regarder directement, et encore moins toucher, le sexe d'un homme ; ni surtout faire preuve d'habileté dans le registre sexuel.
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 245
vitales mais bien plus importantes socialement: le risque destérilité secondaire, et la perte de la force de travail. Cesdeux derniers arguments tentent de toucher les individus àtravers deux valeurs essentielles de la société: la féconditéet le labeur.
Chez les Mossi, comme dans bien d'autres sociétés, lastérilité est la pire des calamités dont puissent être victimesles femmes, qui bien souvent portent seules cette responsabilité. Pour les hommes, la menace de ne pouvoir assurer lasurvie de leur famille à travers leur labeur est une remise encause directe de leur statut social. C'est une des causes fréquentes de suicide en milieu rural.
L'objectif des messages évoquant la mort (physique ousociale à travers la stérilité ou l'incapacité à travailler) esttoujours le même: faire peur. Il ne s'agit pas d'apporter uneinformation mais de susciter un état émotionnel. Or il estétabli depuis les années cinquante « qu'il n'existe pas de lienlinéaire entre l'intensité de la peur et le changement de comportement (. ..) si la peur est trop intense, elle produit un blocage et l'adoption d'un comportement adapté devient impossible " (Paicheler 1997). En fait, selon ce même auteur (ibid. :47), « c'est la présence ou l'absence de moyens efficaces defaire face à la situation de peur qui déterminent les réactionsà la peur ». Or, pour faire face à la peur ainsi suscitée, il estproposé de recourir aux centres de santé dont on sait justement le peu de confiance que leur accorde la population.Dans ces conditions, on peut douter de la capacité de persuasion de tels messages.
L'incitation aux traitements prescrits dans les centresde santé est aussi comparée aux traitements « traditionnels"et à l'automédication à l'aide des produits pharmaceutiquesde contrebande vendus sur les marchés. Ces deux possibilitéssont systématiquement condamnées et accusées de ne pasêtre efficaces. Or, en contestant toute capacité thérapeutiqueà la médecine traditionnelle dans ce domaine, les messagesd'information invalident de fait l'ensemble des référents surlesquels s'appuie la catégorie des pug-banse. Il s'agit d'unemanière détournée d'en contester la validité.
246 Les maladies de passage
• L'adoption de conduites préventives:
Les messages d'information sanitaire évoquent l'abstinence, la fidélité, la limitation du nombre de partenaires etenfin l'utilisation du préservatif. Or ces différentes stratégiespréventives n'ont pas toujours d'écho dans la pensée « traditionnelle« :
- seules les femmes en fin de grossesse puis allaitantesdoivent être sexuellement abstinentes; il n'existe pas d'autresituation nécessitant pareille mesure; pour les hommes, celaest jugé impensable et impossible, contraire à la nature.
- dans cette société polygame, la fidélité sexuelle estobligatoire pour les femmes, cependant un ensemble demécanismes sociaux leur permet de s'en affranchir sansconséquence notable ; pour les hommes qui souhaitent obtenir de nouvelles épouses, la notion de fidélité et la limitationdu nombre de partenaires n'ont aucun sens (Taverne, 1999).
- Enfin le préservatif, en partie parce qu'il est depuisplus de dix ans présenté comme l'alternative à la fidélité, estchargé d'une valeur morale fortement négative. Cela parasite les propositions d'usage avec un nouveau partenaire.L'utiliser dans une relation de couple ancienne soulèvediverses difficultés en référence avec le pouvoir de négociation des individus. La « capture" du sperme qu'il provoquesuscite également des inquiétudes liées au fait qu'il est alorssusceptible de provoquer certaines maladies telle l'impuissance par obstruction de la « bouche du sperme ".
Les professionnels de santé considèrent que lesconseils qu'ils délivrent sont fondés uniquement sur desarguments scientifiques. Pourtant, leurs propos ont uncaractère fortement moralisateur. En fait, ils véhiculent lesvaleurs morales et les représentations du risque qui sontpropres à leur groupe social.
Une rencontre manquée?
Dans les messages d'information ou durant les consultations, les professionnels de santé ne prennent jamais l'initiatived'un rapprochement (et d'une confrontation) entre pug-banse etMST. Tout au plus, se limitent-ils à contester quelques modes de
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 247
transmission et les mesures préventives associées (tel l'enjambement, mais ils ne s'aventurent jamais vers les pièges, les ruptures d'interdit, etc.), ou plus directement ils nient l'originesexuelle de certaines affections (telle pug-kosgo [toux-sexuelle]).
Leur attitude, comme le contenu des messages qu'ilsdiffusent, se fonde sur un double parti-pris: la présomptiond'ignorance de l'ensemble de la population, et le déni de compétence des guérisseurs dans ce domaine. D'une part, ilsconsidèrent que la population ne sait rien des maladiestransmises lors d'un rapport sexuel; aussi, il est jugé nécessaire de tout lui apprendre, y compris les évidences comme lecaractère anormal d'un prurit ou des brûlures mictionnelles.D'autre part, les guérisseurs, et tous ceux qui prescrivent etconseillent des traitements autres que ceux proposés dansles centres de santé, sont considérés incompétents, voire dangereux. Pourtant il est bien connu que la plupart des guérisseurs proposent des thérapies et affirment traiter les pugbanse avec plus de succès que les professionnels ne savent lefaire avec les M8T15.
Les professionnels de santé évitent plus ou moinsconsciemment la confrontation entre M8T et pug-banse parcequ'ils connaissent mal, ou pas du tout, ces dernières. Ils nesavent pas comment en parler et ne veulent surtout pas êtreentraînés sur la pente des étiologies autres que biomédicales.Mais leur gêne est aussi liée aux relations ambivalentesqu'ils entretiennent avec la médecine traditionnelle. Cesrelations oscillent entre le mépris et la fascination: le méprisdes « intellectuels » (ainsi qu'ils se définissent) par rapportaux « illettrés» que sont la plupart des guérisseurs ; et lafascination à l'égard des connaissances ancestrales et despouvoirs magiques que ces derniers sont censés maîtriser16.
Les stratégies de communication se limitent alors à larépétition d'informations biomédicales simplifiées, comme si
15 Et l'absence de toute prise en charge médicale des malades du sidadans les centres de santé en milieu rural confirme bien aux yeux de lapopulation les limites des compétences et des pouvoirs des professionnels de santé.
16 Cette ambivalence se manifeste jusqu'au plus haut niveau des décisions de politique de santé du pays, dans les récurrentes déclarationsd'intention de collaboration avec la médecine traditionnelle.
248 Les maladies de passage
la seule vertu de cette répétition devait suffire à convaincreles auditeurs de leur justesse. Les savoirs populaires sontconsidérés comme des « fausses croyances» et la rationalitédes comportements des personnes par rapport à ces savoirsest évacuée.
Mais ainsi, en refusant d'organiser et de gérer laconfrontation entre les savoirs populaire et médical, les professionnels de santé abandonnent toute maîtrise dansl'orientation du processus de rencontre. Et l'on peut sedemander si pour eux la rencontre entre pug-banse et MST,faute d'être organisée, n'est pas tout simplement manquée.
Conclusion
De manière bien plus sensible que pour toutes les autresmaladies, la rencontre entre la catégorie nosologique des pugbanse et celles des MST s'avère source de tensions. Celles-ci nesont pas seulement liées à la non concordance des champsnosographiques, ni même au fait que ces catégories sont définies à partir de manières différentes de penser la maladie. Celaest couramment décrit pour de nombreuses autres affections,et plusieurs articles de cet ouvrage en témoignent.
La particularité de la rencontre pug-banselMST tientau fait que l'évocation de ces maladies fait référence à lasexualité. Or, la sexualité est, au-delà de la jouissance desindividus et de la reproduction biologique, une affaire dereproduction sociale. à travers la sexualité, « ce que leshommes s'efforcent de reproduire, ce n'est pas leur espèce( ... ), c'est le groupe social auquel ils appartiennent»(Godelier 1995 : 119). Ces maladies, tout comme les grossesses, constituent des manifestations visibles de l'activitésexuelle des individus, qui sont autant d'occasions d'exercerune forme de contrôle social sur celle-ci.
Dès lors, guérisseurs et professionnels de santé ne sontpas les seuls à prendre la parole car il s'agit de parler moinsdes maladies sexuellement transmises que de la sexualitédans la société, et au-delà de l'état et du devenir de celle-ci.
Ainsi, le discours biomédical sur les MST est confrontéaux discours promus par les différents groupes sociaux qui
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 249
revendiquent une influence sur la conduite de la société«< traditionalistes », « modernistes ", féministes, religieux,etc.), et qui s'affrontent sur le thème de la sexualité. Le discours médico-technique se prétend indépendant de touteinfluence doctrinale. Cependant, précisément parce qu'il nese fonde pas explicitement sur les valeurs morales défenduespar les courants idéologiques existant dans la société, est-ilconsidéré comme étant amoral par ceux-là. L'informationbiologique est perçue comme niant les valeurs auxquelleselle ne se réfère pas. L'absence de ces références s'interprètecomme une contestation, ou une promotion de valeurs exogènes (valeurs occidentales accusées de permissivité et delicence sexuelle).
En ce sens, tout discours d'information sur la prévention des M8T et sur la sexualité peut être entendu commeune forme de discours politique. Les messages d'informationconcernent autant le domaine des savoirs populaires quecelui des rapports sociaux institués au sein de la collectivité.Et c'est assurément à ce niveau que les tensions et les enjeuxliés à l'acceptation des messages de prévention des M8T,sont les plus forts.
Bibliographie
Bonnet D.1988 Corps biologique, corps social. Procréation et maladies de
l'enfant en pays mossi, Burkina Faso. Ed. de l'üRSTüM,coll. mémoires, nO 110, Paris, 138 p.
Cros M.1990 Anthropologie du sang en Afrique. Essai d'hématologie
symbolique chez les Lobi du Burkina Faso et de Côted'Ivoire. L'Harmattan, Paris: 298 p.
Desclaux A.1995 « L'État contre la santé publique? La désignation d'un
groupe social dans le discours public sur le sida auBurkina Faso ", Sociologie Santé, n° 13, pp. 84-91.
Egrot M.1999 La maladie et ses accords. Le sexe social, mode de déclinai-
250 Les maladies de passage
son et espace de raisonance de la maladie chez les Moosedu Burkina Faso. Thèse pour le doctorat en anthropologie,Université de Droit, d'économie et des sciences d'aix-marseille, faculté de droit et de science politique, laboratoired'écologie humaine et d'anthropologie, 627 p.
Godelier M.'1995 « Sexualité et société. Propos d'un anthropologue ", in
Bajos N., Bozon M., Giami A. et al. Sexualité et sida.Recherches en sciences sociales, Paris, ANRS, pp. 117121.
Green E. C.1992 « Sexually Transmitted Disease, Ethnomedecine and
Health Policy in Africa ", Social Science and Medecine,Vol. 35, n° 2, pp. 121-130.
Izard M.1985 Gens du pouvoir, gens de la terre. Les institutions poli
üques de l'ancien royaume du Yatenga (Bassin de la VoltaBlanche). Cambridge University Press, Ed. de la Maisondes Sciences de l'Homme, Paris, 594 p.
Laurent P.-J.1998 Une association de développement en pays mossi. Le don
comme ruse. Karthala, Paris, 291 p.
OMS1989 « Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et mala
dies sexuellement transmissibles. Déclaration par consensus à l'issue de la Consultation sur les maladies sexuellement transmissibles comme facteur de risque pour latransmission du VIH ", Wkly Epidem. Rec. - Relevé ép['dém. hebd., Vol. 64, n° 7, pp. 45-48.
Paicheler G.1997 « Modèles pour l'analyse de la gestion des risques liés au
VIH : liens entre connaissances et actions ", SciencesSociales et Santé, Vol. 15, n° 4, pp. 39-70.
Taverne B.1999 « Valeurs morales et messages de prévention: la « fidélité"
contre le sida au Burkina Faso ", in Becker C., Dozon J.P., Obbo C. et Touré M. (éds), Vwre et penser le sida en
La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi 251
Afrique / Experiencing and understanding AIDS in Africa,Paris, (Codesria, IRD, Karthala), pp. 509-525.
Vineis P.1992 « La causalité en médecine: modèles théoriques et pro
blèmes pratiques », Sciences Sociales et Santé, Vol. 10,nO 3, pp. 5-32.
Zempleni A.1985 « La maladie et ses causes ", L'Ethnographie, nO 2, pp. 13
44.
Chapitre 10
La transmission de kirikirimasienen milieu bambara au Mali .une variation des savoirs et despratiques autour de cc l'épilepsie»
Sophie Arborio
L'épilepsie l est une maladie chronique et invalidante.Les données épidémiologiques fournies par l'OMS rapportentune prévalence globale de 40 millions de personnes atteintesde cette maladie dans le monde, chiffre qui augmente chaqueannée de deux millions de nouveaux cas. Sur cette population, 80 à 85 % des cas vivent dans les pays « en voie de développement ", et son incidence est, au minimum, deux foisplus élevée que dans les pays industrialisés2. Enfin, plus pré-
1 Dans notre article, le tenne épilepsie renvoie à deux définitions. Il se réfère à sa définition médicale, mais aussi à ce que le français " populaire"nomme épilepsie et qui correspond globalement au " grand mal ". Cesdeux acceptions ne se recouvrent qu'en partie et c'est pourquoi nous utiliserons les guillemets pour désigner ce qui concerne la nomination profane de cette maladie.
2 Dans les pays en voie de développement Jallon et Dumas (1998) soulignentque" les données rapportant les enquêtes de prévalence montrent aussides chiffres élevés, se situant autour et au-dessous de 10 pour 1000, maisdes taux beaucoup plus élevés, 3 à 5 fois ceux reconnus dans les paysindustrialisés, ont été rapportés dans certains pays et dans certaines populations, en particulier les populations rurales. » Nous renvoyons aussi àKarlo et al. (1993) qui soulignent" qu'il existe 4 à 5 fois plus d'épilepsiedans les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés.Cette situation s'explique par la plus grande fréquence des encéphalopathies infantiles, des traumatismes cranio-encéphaliques, des maladiesparasitaires et nutritIOnnelles qui affectent le systême nerveux »
254 Lesmaladies de passage
cisément au Mali, cette prévalence s'élève à 13,3 pour milleen milieu rural-.
Les inforrnationss que nous avons recueillies s'attachent principalement à comprendre la dynamique d'exclusionliée à l'épilepsie, dans une société rurale bambara, au Mali.
La notion de transmission constitue un point de tension entre le pôle des données nosographiques et celui de ladimension sociale, dans l'interprétation de l'épilepsie. Eneffet, tandis que les connaissances biomédicales ne reconnaissent à cette maladie aucune qualité de transmission, lecontexte populaire bambara la considère comme une maladiecontagieuse. D'une part, cette conception s'appuie sur l'observation profane des crises, d'autre part, les pratiques qui endécoulent renvoient directement à la dimension socioculturelle de la maladie. Dès lors, la notion de contagion est liée àun processus d'exclusion qui est modulé, comme on le verra,selon les différents espaces d'appartenance sociale du malade, ainsi qu'en fonction de la qualité du lien familial.
Comprendre la notion de transmission dans le cadred'une maladie signifie donc, dans le contexte de la sociétérurale bambara, s'intéresser aux entités nosographiquespopulaires qu'elle sous-tend et en observer les prolongementssocioculturels. Comme les deux faces d'une réalité commune,ces deux dimensions de l'épilepsie donnent alors un aperçude l'ensemble du vécu du malade.
Pour cela, j'étudierai d'une part, les agents, les modeset les conditions de la transmission de l'épilepsie, et d'autrepart, les significations socioculturelles que véhicule la notion.Je montrerai, également, dans quelle mesure ces constatations peuvent expliquer d'apparents paradoxes entre leniveau des représentations et celui des pratiques.
3 Farnarier (1998)
4 Cette recherche s'inscrit dans le cadre d'un travail de doctorat enanthropologie à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, sous ladirection de J.P Dozon et le tutorat de D. Bonnet. Elle s'intègre, parailleurs, au " Projet Epilepsie-Onchocercose au Mali» mené sous la responsabilité du Pr.O.Doumbo (Faculté de médecine et de pharmacie deBamako) et du Dr. G. Farnaner (Hôpital Nord, Marseille). Par ailleurs,y. JafTré (Faculté de médecine et de pharmacie de Bamako) était le responsable de notre travail au Mali.
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali 255
Les sens des termes kirikirimasien, épilepsie et transmission
D'un point de vue biomédical, selon le « Dictionnairede l'épilepsie » (Gastaut, 1973), cette pathologie est une« affection chronique, d'étiologies diverses, caractérisée parla répétition de crises résultant d'une décharge excessive deneurones cérébraux, quels que soient les symptômes cliniques ou paracliniques éventuellement associés. "
En bambara, les crises épileptiques généralisées, sontcommunément appelées « kirikirimasien ". L'emploi de « kirikiri- " sert à exprimer le vertige, tandis que « -masien "semble plus proche d'une onomatopée. Mais cette maladiepeut également apparaître sous forme d'autres dénominations, employées pour éviter la prononciation de « kirikirimasien ", dont la connotation est, comme je le montrerai, socialement négative.
Ces deux termes - épilepsie et kirikirimasien - appartiennent à des univers de représentations différents. On peutnéanmoins se demander quels sont les signes communs entreles deux entités nosographiques, et quels sont ceux qui lesdifférencient?
Ces deux systèmes d'interprétation partagent, bien évidemment, une partie de leur symptomatologie descriptive : laperte de conscience, l'amnésie, l'activité convulsive, la chute brutale, l'émission de bave, ainsi que le relâchement des sphincters.
Par contre, dans le contexte bambara, l'attention portée à certains signes pathologiques chez ces malades telsl'accroissement de l'activité onirique ou les fugues, révèleune perception magico-religieuse de la maladie alors quedans le cas de l'épilepsie, telle qu'elle est interprétée médicalement, le terme « terreurs nocturnes épileptiques" est présenté comme « impropreS ", et ces terreurs sont distinguées
5 Gastaut H. : " Terreurs nocturnes épileptiques. Terme impropre car,par définition, les terreurs nocturnes ne sont jamais épileptiques. Il estbien évident que, très exceptionnellement, un épileptique peut faire unecrise nocturne (habituellement du lobe temporal) caractérisée par desautomatismes mimiques ou gestuels exprimant la terreur, mais il fautalors parler de " crise épileptique affective survenant au cours du sommeil" et ne Jamais utiliser le terme "terreurs nocturnes épileptiques".Syn : Pavor nocturnus épilepticus. " (79)
256 Les maladies de passage
de l'épilepsie. Ainsi, on constate, à travers cet exemple, undécalage entre l'entité populaire kirikirimasien et le conceptscientifique d'épilepsie.
En milieu rural bambara, « l'épilepsie" est considéréecomme une maladie transmissible et héréditaire6. L'expression « bana bè yèlèma anw fè » se traduit littéralement par« la maladie change par nous ». « Ka yèlèma ". Cette expression signifie, dans un sens général, changer de direction, derécipient, convertir, ou traduire. Elle est synonyme de mouvement, voire de métamorphose, lorsqu'elle est utilisée pourexprimer la transformation d'un sorcier en animal. Unemaladie transmissible, telle que l'épilepsie, se dira: « banayèlèmalila " et la transmission « yèlèmali ". On se servira parailleurs du terme « sinti » qui signifie « ascendant» ou de« jurula " (( emprunt »), pour évoquer une transmissionhéréditaire7 .
Sans préciser, pour le moment, la signification de lanotion de transmission dans ce contexte, on peut tout simplement constater la présence d'expressions linguistiques spécifiques, liées à l'idée de passage d'une personne à une autre,par contact direct ou indirect.
Une traduction littérale des termes ne semble toutefoispas suffisante si l'on veut saisir l'amplitude des significationsde la notion de transmission. Certes, l'expression « ka yéléma »servira à exprimer l'idée d'une transmission, mais encorefaut-il connaître les significations de cette notion dans soncontexte d'appartenance; en déterminer les agents et les vecteurs. Plus que de manière abstraite, nous situerons cesnotions dans le contexte des représentations sémiologiques,étiologiques et thérapeutiques de l'épilepsie.
Quelle est donc cette entité kirikirimasien, question quiouvre à une description de sa sémiologie et de son étiologie.
6 Karfo.K et al :La peur de la transmission de l'épilepsie existe égalementdans d'autres pays africains, notamment le Sénégal, où 47.3 o/r del'échantillon de l'étude relie leur peur de l'épilepsie au risque de contagIOn, p 141.Egalement l'article de Awaritefe A. fait référence à la notion de contagion dans les représentations nigérianes de l'épilepsie.
7 Pour une définition de ces termes voir dans ce même ouvrage l'articlede Jaffré sur la transmission dans le Mande.
La transmission de klrikirimasien en milieu bambara au Mali
L'entité populaire kirikirimasien
257
Kirikirimasien est décrite à travers l'énumération dedifférents signes, répartis selon trois registres principaux.
Le premier, purement physique, définit la maladie parune perte brutale de connaissance, souvent accompagnée demouvements incontrôlés. La bave «< daji kagan » : « salivemoussante ») est présentée comme un signe souvent constaté, alors que les pertes d'urine, pudiquement, sont rarementsignalées.
Le second registre décrit des manifestations psychiques de la maladie, avec des sensations de frayeur ou depeur «< siran»), provoquées par un accroissement de l'activité onirique et imaginaire.
Enfin, la troisième approche fait intervenir unensemble de troubles psychologiques chez le malade, quivont de l'angoisse «< ijà be tigè » : « ton âme est coupée ») auxsentiments d'isolement «< i be kè kelen na mogo ye » : « tu esrendu seul par les gens ») et de « perte d'humanité» «< adamaden tiyèn »).
Dans le milieu rural bambara où nous avons travaillé,les principales causes de kirikirimasien recouvrent différentsdomaines, tels les diables, Dieu, la transmission par unesouillure, les sorciers, le lien de lignée, ou la transgressiond'un interdit.
Mais, aux questions « d'où vient la maladie? » et« qu'est ce qui fait que cette maladie t'attrape? », ne furentdonnées que des réponses basées sur le récit des circonstances dans lesquelles les premières crises se sont déroulées.
A travers ces formes narratives qui constituent unmode d'appréhension de la maladie, l'analyse étiologiquetend à inclure des données contextuelles. Elle ne repose doncpas uniquement sur une description objective de signes isolésde toute expérience personnelle, mais au contraire, résultede la combinaison de différents facteurs: le moment, le lieu,les personnes... bref, l'ensemble du contexte dans lequel s'estinscrite la maladie d'une personne particulière.
On pourrait donc parler ici de circonstances causalesdans le mode d'appréhension de l'épilepsie. Ce type d'étiolo-
258 Les maladies de passage
gie englobe un ensemble diversifié d'éléments de compréhension et se réfère à un contexte; il ne suppose pas une relation de cause à effet, établie à priori, telle qu'une interprétation strictement médicale de l'épilepsie l'impliquerait.
Détermination de kirikirimasienen milieu rural bambara
~-~
1
1
1
Détermination de
J..fnJ../rmll1\len
:::; démmche dIte étlOlol!lOue
Symptômes HI<;lOlre personnelle
du malade
- chute
- fréquentation Je heux occupés par génies
- convu[~lons
- relatIOns socIales conflictuelle...
- JalousIe de J'entourage
etc ,etc.
RéCit de", cm:on'it•.mce<;
qUI ont marqué le début dc~ cn...e ...
La détermination de la maladie renvoie à une existence singulière, et non pas à des signes cliniques détachés detoute réalité humaine.
C'est au cœur de ce type de démarche, que l'idée detransmission se construit, comme une représentation globalede la situation pathologique. Elle ne peut donc pas être uniquement décrite selon une énumération classique des formesde transmission (modes, agent et conditions) ni être appréhendée comme une entité abstraite et anonyme, mais doitêtre construite selon un contexte général de circonstances,que l'on détermine progressivement, en fonction de données
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali 259
individuelles. Elle est ainsi, moins subsumée par un élémentisolé de son contexte (tel que le virus ou le microbe), que progressivement rendue significative, par rapport à l'ensembledu contexte lui-même.
C'est ainsi que bien que la notion « scientifique ", demicrobe ait été traduite par le terme bambara « bana kisè ,,8,cette notion n'apparaît jamais dans les représentationsrurales relatives à la notion populaire de transmission. Selonun parent d'un malade:
Le mot bana kisè est une appellation française, à monavis. Quant à moi, je connais seulement la cause de latransmission ... Ce qui peut transmettre la maladie, parexemple si vous buvez dans le même pot qu'un malade ousi vous marchez dans la bave d'un épileptique. Je neconnais pas le microbe.
Cette remarque souligne qu'un ou plusieurs modes detransmission peuvent être évoqués par les conceptions populaires de l'épilepsie. Toutefois, la notion de microbe, entendue dans le sens d'un agent pathogène organique, ne s'ytrouve pas exprimée. Le processus de transmission renvoieplutôt à l'analyse d'un contexte global, qui a favorisé l'apparition de la maladie.
Les modalités de la transmission de kirikirimasien
Les modes, les agents et les conditions de la contamination représentent trois registres populaires interprétatifsdifférents, qui peuvent apparaître conjointement.
Les modes de contamination
Deux grands groupes notionnels constituent les modesde transmission de l'épilepsie. Il s'agit des" maladies quiattrapent la personne ", d'une part, des « maladies transmises par lien de lignée ", d'autre part.
8 La traduction littérale de " bana kisé » est l'association de " bana »;
" maladie" à " k!sé " qui représente une unité. Le microbe est donc présenté comme une" unité de maladie ".
260 Les maladies de passage
Dans le cas d'une transmission héréditaire, la personne est « fabriquée » avec la maladie, c'est-à-dire que l'affection est inhérente à la constitution même de l'individu,comme une partie intégrante de la personne.
A l'inverse, dans le cas où la maladie surviendrait tardivement, on suppose que la maladie « attrape» la personne,comme un élément extérieur à l'individu qui viendrait sesurajouter à son existence.
La « maladie qui attrape»
On dira d'une maladie9 telle que kirikirimasien qu'ellepeut
• « attraper» la personne :« bana bè mogo minè » (lit.,la maladie attrape la personne)
• « trouver» la personne: « bana bè mogo sàrà » (lit., lamaladie trouve la personne)
• « se lever» chez la personne: « bana bè wuli mogo la »(lit., la maladie se lève chez la personne). Cette dernièreexpression est particulièrement employée lorsque l'on faitréférence à des crises répétitives
Par ailleurs, elle est considérée, soit comme une maladie qui est en permanence dans le corps de la personne (tête,poitrine, ventre), soit comme une entité extérieure et elle estalors attribuée à la présence de diables, qui viennent ponctuellement perturber le malade.
La « maladie qui attrape» se décline à partir d'unensemble de pratiques, liées au contact avec le malade:
Par contact direct (le toucher), notamment au momentd'une crise, ou par simple voisinage, la maladie peut« s'attraper ». La salive (daji) , en particulier, représente unvecteur essentiel avec lequel il faudra éviter d'être encontact, particulièrement lorsqu'elle se présente sous laforme de mousse ou de bave (daji kagan : « salive moussante»)pendant les crises.
9 Ce vocabulaire n'est pas spécifique à « l'épilepsIe ", mais il est employépour toutes les maladies.
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali 261
Par contact indirect, tout objet ayant servi à l'alimentation du malade est susceptible de transmettre l'épilepsielorsqu'il est réutilisé sans avoir été préalablement lavé. Lepartage de la nourriture ou de l'eau représente également unrisque important de contamination. Enfin, l'enjambementdes espaces souillés par l'urine ou la salive d'un épileptiqueen crise, constitue une autre possibilité de transmission.
Par ailleurs, un registre intermédiaire, entre le contactdirect et le contact indirect, englobe les actions néfastes desmauvaises personnes (mogo juguw) ou des sorciers (subagaw). Le « bolonon » «< trace des mains ») peut illustrer latransmission de la maladie, par l'intermédiaire d'une personne qui envoie un mauvais sort à une autre personne.
La « maladie transmise par la lignée»
La notion de transmission héréditaire représente unmode de contamination indépendant des deux classificationsci-dessus. Le lien de sang (joli fè), c'est-à-dire l'appartenanceà une même lignée, est considéré comme un mode possible detransmission de « l'épilepsie ». Divers récits évoquent cetteorigine héréditaire. Ils constatent la présence de plusieursmembres atteints de kirikirimasien dans une même lignée.
En particulier, lorsque la maladie apparaît chez unenfant en bas âge, l'interprétation penchera en faveur d'unetransmission héréditaire. La simple appartenance à un groupe de filiation dans lequel ont vécu d'autres personnes épileptiques constitue donc une première forme d'explication dela transmission par « lien de lignée» (jurula ou sinti). Dansce cadre interprétatif, il s'agit du mélange de sang, qui, aucours de la grossesse, conditionne cette transmission.
Tu as trouvé alors que la mère avait la maladie, toimême, ta personne est fabriquée avec la maladie. Le sangest mélangé avec la maladie. Depuis que tu es petit,depuis que tu es du sang (fécondation), la maladie tu l'as.
De surcroît, il découle de cette représentation uneconception singulière de la guérison de « l'épilepsie ». Eneffet, il semble plus difficile de guérir cette maladielorsqu'elle est transmise de manière héréditaire que lorsque
262 Les maladies de passage
la maladie survient à l'âge adulte, sans antécédents familiaux.
Le fait que l'enfant naisse avec « l'épilepsie » rendindissociable maladie et personne, représentation à partir delaquelle une guérison est rendue peu probable.
Par ailleurs, une notion de durée semble égalemententrer en ligne de compte dans la gravité de « l'épilepsie ",qui se renforce au fur et à mesure que la personne granditavec la maladie. Le caractère récurrent des crises sur unelongue période signe la maladie et influence les conceptionsde la guérison. La notion de chronicité constitue donc un élément essentiel dans les représentations de « l'épilepsie" enmilieu bambara.
Néanmoins, si de ces deux représentations de la maladie émergent des conceptions différentes de la guérison, cesdernières s'accordent, en définitive, sur la dimension religieuse de la maladie ; une dimension qui les réunit sousl'ultime volonté divine, quant à leur évolution possible.
Fréquemment, la transmission par la lignée impliqueplus la relation maternelle que paternelle. En effet, on trouve parmi les causes de l'épilepsie la transgression de certaines recommandations sociales, qui s'adressent en particulier aux femmes enceintes. Ainsi, se coucher dehors un soirde pleine lune ou se laver après le coucher du soleil, représentent des dangers que la femme enceinte se devra d'éviter,sous peine de voir son futur enfant atteint « d'épilepsie ». Sil'imprudence apparaît être ici la principale explication del'apparition de la maladie, on l'associe fréquemment à l'idéed'une transmission maternelle.
Mais le lien paternel est aussi évoqué et explique notamment les difficultés matrimoniales que rencontrent les hommes« épileptiques ". On pourrait rappeler à ce propos le caractèrepatrilinéaire inhérent à la filiation dans cette société.
On remarquera enfin, globalement, que la conceptionhéréditaire de la maladie ne peut être ni exclusive ni préconçue, puisque l'observation empirique et les énigmes qu'elle posereprésentent un des modes de compréhension de la maladie.
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali
Les agents de la contamination
263
Le malade est le principal protagoniste de la transmission. Mais comme nous le laisse entrevoir l'énumération desmodes de contamination, le sorcier, mais également lesparents, et en particulier la mère, sont à considérer commedes agents possibles de contamination.
Deux remarques, au sujet de ces derniers, permettrontégalement de préciser la nature de leur implication respective.
La première rappelle que l'agent de la contamination dans tous les cas une personne qui transmet la maladie àune autre personne - n'est pas nécessairement lui-mêmecontaminé. C'est le cas des sorciers.
La seconde remarque porte sur la nature de la transmission qui peut être ou non, considérée comme intentionnelle, selon qu'il s'agisse d'une transmission par le « bolonon» (acte de sorcellerie), par la décision divine ou par le malade.Ce dernier notamment, n'est jamais tenu pour entièrementresponsable, puisque l'on considèrera, avant tout, la décisiondivine dans l'attribution de la maladie. Ceci a pour conséquence de justifier l'attitude de nombreux parents, qui partagent leur repas avec le malade, estimant que la maladie dechacun dépend, non pas de précautions humaines, mais enpremier lieu, d'une « élection» par choix divin.
Les conditions de la contamination
La crise représente la situation la plus propice à unecontamination éventuelle. Lorsque la maladie « se lève »10, lacrainte de la contamination apparaît simultanément. Puis'( la maladie laisse la personne » (( bana bè mogo bila »), ledanger disparaît alors ... et les relations sociales retrouvent,en général, un cours normal. On peut immédiatement manger avec le malade et s'amuser avec lui, dès lors que la criseest terminée. C'est le cas cité d'un enfant de neuf ans, rejetépar ses camarades au moment de la crise, et qui redevientleur partenaire de lutte corporelle dès la fin de celle-ci.
10 Sur l'ensemble de ce vocabulaire et de cette physiologie populaire, nousrenvoyons à Jaffré (1999).
264 Les maladies de passage
Par ailleurs, les données contextuelles ont une importance significative dans la détermination étiologique. Aussicelle-ci peut-elle être imputée à la fréquentation de lieuxréputés dangereux, tels le marigot ou la brousse. C'est, parexemple, le cas d'un jeune homme parti pêcher au marigotpendant la nuit et qui attribue à cet épisode l'origine de samaladie. Les conditions de la transmission - la nuit et le faitde pêcher au marigot - sont clairement définies comme lescauses de sa maladie.
De la même manière, toute transgression d'un interditqui place un sujet dans une situation dangereuse et incertaine le rend vulnérable aux forces qui favorisent la transmission, soit par l'action des mauvaises personnes, soit parcontact avec des éléments maléfiques.
Prévention de kirikirimasien
La dimension sociale des « pratiques de prudence»
Plutôt que de parler de prévention, nous préféreronsl'expression « pratiques de prudence », afin d'illustrer lescomportements qui visent à éviter de contracter l'épilepsie.Quelles sont-elles, et quelles représentations de la maladie yprésident?
Parmi les modalités d'une transmission de l'épilepsieréside la transgression d'un interdit. Par exemple, unefemme enceinte ne doit pas se laver à une heure tardive, nise coucher à l'extérieur de la maison. Cette transgressionpourrait être à l'origine, pour son enfant, de la « maladie del'oiseau» (kànà). Cette pathologie caractérisée par desconvulsions, en s'aggravant, pourrait aboutir à l'épilepsie.
Dans ce cas, il s'agira de respecter certains interditsd'ordre social, afin d'éviter de contracter la maladie. Unautre exemple du même type permet de saisir l'importancede la dimension socioculturelle des pratiques de prudence.En effet, le père d'un jeune homme malade nous confie quel'origine de la maladie de son fils est un acte de vol que cedernier avait commis aux dépens d'un pêcheur bozo. Le vol
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali 265
des poissons est reconnu comme une transgression sociale,dont les conséquences sont directement liées à l'apparitionde la maladie. La transmission de l'épilepsie apparaît dansce cas comme une vengeance de la victime du vol, voire unacte de punition sociale.
Cependant, la maladie ne représente pas non plus, systématiquement, une punition sociale. Elle peut également êtreinduite par ressentiment à l'égard de quelqu'un et résulter d'unacte de sorcellerie. Ainsi, le malade n'aura commis aucunetransgression particulière, mais il sera au centre de tensionssociales. Tel est l'exemple proposé par un jeune homme malade, qui situe l'origine de son « épilepsie" dans la jalousie d'unecoépouse de sa mère. Dans ce cas, diverses amulettes peuventêtre employées pour se défendre des mauvaises personnes engénéral, mais elles ne protègent pas spécialement de l'épilepsie.
Ces exemples illustrent que l'interprétation de la transmission se rattache à un ensemble de relations sociales, quisont analysées, a posteriori, dans l'explication de la maladied'un individu. Le non respect des recommandations socialespeut provoquer « l'épilepsie ". Le mauvais sort, qui illustre parlui-même un désordre social, représente également une interprétation de la maladie, dont l'origine est alors une punition,une jalousie, voire une vengeance. L'idée de transgressiondans l'ordre des relations sociales comme cause de l'épilepsie aaussi été développée notamment par Bibeau et al. (1993).
Mais dans tous les cas, le moyen d'éviter l'épilepsiesemble généralement être la conservation de « bonnes » relations sociales. Il s'agit là d'une forme de prévention de lamaladie qui est avant tout d'ordre social, liée à des comportements socio-relationnels localement préconisés. Les pratiques de prudence mises en œuvre dans la prévention del'épilepsie concernent donc essentiellement le comportementsocial de l'individu.
La répulsion envers le corps
Après nous être intéressés à ce versant social des pratiques de prudence, nous reviendrons à une modalité de prévention qui concerne le contact direct ou indirect avec le
266 Les maladies de passage
malade, en particulier au moment des crises. Ainsi, lorsquela personne bave, il est communément admis que marchersur son crachat, ou être touché par ce dernier, voire l'ingérerpar inadvertance, représentent des comportements qu'il fautéviter à tout prix. Au moment de la crise, les personnes présentes auront donc tendance à s'en écarter et en dehors descrises, beaucoup n'accepteront ni de partager un repas, ni ungobelet, ni même une couche commune, afin de ne pas risquer de respirer les flatulences du malade.
Mais ces comportements d'évitement doivent également être appréciés selon les significations socioculturelleslocales. L'appréhension de la crise comporte en effet unensemble d'éléments qui sont associés à l'idée de saleté(nàgà). Le malade inspire un sentiment de crainte, lié à l'idéede transmission, mais il provoque également un sentimentde dégoût.
Sentiments de crainte et de dégoût se mêlent alors,entraînant une intolérance à l'égard de la personne en crise.En effet, l'émission de bave moussante, voire d'urine, renvoieà un manque de contrôle de la personne sur ces matièresconsidérées sales. Symboles de désordre et de souillure, lecontact avec le malade est alors imprégné d'un rejet pour cetaspect dégradant pour la personne.
Quant à lui on l'écarte, en réalité, parce qu'il va avec lasaleté. Quand il tombe, le crachat moussant sort, et puisil y en a certains qui urinent même. C'est pour cela quebeaucoup d'hommes l'évitent, c'est par rapport à ça.
Certains disent que si ça arrive dans ton ventre, çapeut être la cause pour que la maladie t'attrape. C'est àcause de ça qu'on se méfie de lui (du malade). Que ce soitson eau à boire, que ce soit les choses là. On met tout àpart. Parce que tout ça c'est par rapport au problème deméfiance que j'ai dit. A cause de ce fait. (Grand Frère d'unhomme malade J.
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali 267
Processus d'intolérance à l'égard de la personne dite« épileptique»
Emission de bave, vOire d'urine; et manque de contrôle corporel
senliment de
crainte
Intolérance
à l'égard du malade
sentiment de
dégoût
Les idées de dégoût, de saleté et de désordre physiqueliées à la crise confèrent, là encore, à la notion de transmissionun caractère socioculturel évident. La transmission est connotée comme impure et les comportements d'évitements qui endérivent ont valeur de répulsion physique et symbolique,
La notion de transmission englobe ainsi des réactionsde méfiance (( an bè an tang'a ma » : nous nous protégeonsde lui), de dégoût (nyugun), de honte (maloya), voire de rejet(a b'a kàn ka bà tàw la) de la part l'entourage.
On peut donc distinguer à travers les discours, lacrainte de la transmission, et le dégoût engendré par l'aspectdégradant de la maladie. Néanmoins tous deux suscitent unemise à l'écart de « l'épileptique », L'idée de transmission de lamaladie représente donc un mélange de sentiments qui nerelèvent pas uniquement d'une conception organique, maisqui font appel à un sens figuré d'une contamination, procheparfois de la notion de souillure. Cette conception de latransmission semble profondément enracinée dans unereprésentation sociale et magico-religieuse de « l'épilepsie »,
268 Les maladies de passage
Enfin, ces différents comportements d'évitement apparaissent néanmoins beaucoup plus prégnants au niveau desreprésentations de « l'épilepsie ", qu'ils ne sont effectifs auniveau des pratiques. L'analyse contextuelle fait apparaîtreun ensemble de contradictions dans l'appréhension de lamaladie, entre différents niveaux de savoir d'une part, entreces savoirs et leurs pratiques d'autre part. Ainsi, l'idée communément reçue selon laquelle la personne malade estl'objet d'une mise à l'écart, doit être nuancée, selon lessphères relationnelles d'appartenance de cette personne.
Le jeu des discours et des pratiques liés à la transmission
Nous avons pu constater que le discours sur la transmission de kirikirimasien pouvait varier, selon les circonstances dans lesquelles il était émis. Son enracinement dansla réalité collective éclaire ainsi, un jeu de réorganisation desespaces sociaux, en termes de comportements spécifiques,qui sont répartis selon des sphères : familiale, villageoise, ouextra-villageoise.
Les différents discours sur la transmission
Les représentations de l'épilepsie sont, en général,axées sur une conception contagieuse et héréditaire de cettemaladie. On observe initialement un premier niveau de discours, issu du savoir commun populaire, qui met en évidencela contagiosité de l'épilepsie.
Mais la plupart du temps, ce discours sera remaniédans l'intimité, où prévaut une analyse subjective, basée surune observation empirique de la maladie. Le cadre familialconstitue en effet une sphère spécifique qui répercute sesvaleurs dans l'appréhension de la contamination. Dans cecontexte, le discours sur la contamination est caractérisé pardes écarts entre les règles édictées socialement - mettre àl'écart - et les choix individuels. Le savoir commun peutdonc, dans un premier temps, être remis en question parl'observation empirique, démarche d'observation qui conduit,par la suite, à infirmer l'idée d'une contagiosité de l'épilepsie.
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali 269
Ainsi, lorsque la famille d'un malade refuse toute mise àl'écart de ce dernier et partage pendant plusieurs années sonrepas, chacun constate que la maladie ne s'est pas transmisependant ce laps de temps. Peu à peu, le doute fait alors placeà une connaissance empirique plus précise de la maladie, etpar là même, de la transmission, conception alors d'autantmieux acceptée qu'elle se concilie avec l'intégration du malade.
Le décalage des discours et des pratiques
De plus, on constate un aménagement entre ces représentations rattachées au savoir commun et bien des comportements qui leur sont contradictoires. Ainsi, une famille peutcroire à la contagiosité de la maladie, mais refuser parallèlement toute mise à l'écart de la personne malade. Cette attitude est justifiée dans le discours par une règle socialed'unité familiale qui, dès lors, prévaut sur la crainte d'unecontamination. Tel est le sens d'un proverbe très populaire :« Si tu as un enfant, même si celui-ci devient un serpent, tudois le ceindre autour de tes reins ».
Ceci tend à replacer l'étude de la contamination dansune perspective dynamique, où correspondent, mais aussi seheurtent le niveau des représentations et celui des pratiques.
Ce décalage apparaît d'autant plus important que l'onse rapproche de la sphère des relations familiales. Parcontre, les sentiments de crainte liés à la transmission del'épilepsie se transforment en attitudes de rejet vis-à-vis dumalade, au fur et à mesure que se distendent les relationsd'intimité avec la personne.
Dans le cadre des relations conjugales - y comprisentre coépouses -, ainsi que dans celui des relations parentales, la crainte de la transmission est systématiquementdépassée par la cohésion familiale. Dès lors, le malade nesubit plus aucun comportement de rejet. L'empathie est unsentiment souvent exprimé dans les discours de l'entouragefamilial, et la notion de devoir prévaut dans les pratiquesd'intégration du malade. Ce dernier mange, boit, dort et travaille au sein du groupe familial, même s'il est exclu par lespersonnes qui en sont étrangères. La coépouse d'une malade
270 Les maladies de passage
avait ainsi pris sous sa bienveillance sa « rivale ", malade« épileptique », sous couvert de leur relation de « parenté ».
Même si un tel cas représente une forme d'exception, il n'enreste pas moins que le lien familial constitue un facteurd'intégration essentiel et prépondérant.
Dans le cadre des relations intergénérationnelles, onobserve généralement une adéquation entre le savoir commun et les pratiques d'évitement, mais uniquement aumoment des crises. Les relations sociales reprennent ainsiun cours normal avec le malade, dès la disparition des signesde la crise. Par exemple, au sein d'un « grin » (associationd'amis souvent d'une même classe d'âge), le malade épileptique retrouve une place à part entière dès lors que sa criseest passée, et certains de ses amis oseront même le mettre àl'abri en cas de chute. Le partage du thé, forme majeure deconvivialité, ne fait pas exception dans les pratiques d'intégration du jeune épileptique au sein du « grin ».
Dans le cadre des relations extérieures à sa famille, età son village, les sentiments de crainte priment sur ceux dela solidarité; hors des sphères d'intimité relationnelle, lespratiques d'isolement sont alors plus généralisées. Onconstate alors, dans le discours, une modification significative qui tend à une abstraction de la maladie, une dépersonnalisation à travers laquelle s'exprime une conception très péjorative de « l'épilepsie ». On ne se réfère plus à une personne,mais à une maladie, perçue comme « détestée ", « rejetée »,
« pas aimée ", ou « indésirable ", formes linguistiques fortes,mais le plus souvent impersonnelles.
En fait, le degré de connaissance entretenu avec lemalade semble un facteur déterminant des comportementsde mise à l'écart. A l'intérieur de son village, le malade peutêtre toléré, tandis qu'il peut être aussi chassé et victime desévices, dans un autre village éloigné de dix kilomètres. Telest notamment le cas d'un jeune homme, contraint de resterdans un cercle familier, afin d'éviter toute situation gênante.Telle est aussi l'histoire d'une jeune fille lynchée dans un village proche du sien, où elle s'était rendue lors d'une fugueliée à un état comitial. Ses parents la retrouvèrent unesemaine plus tard et elle fut soignée plusieurs mois avant deretrouver ses capacités.
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali 271
Synonyme de danger, ou simplement de honte pour lemalade, la crainte d'une survenue d'une crise dans un environnement étranger peut contraindre l'individu à demeurerparmi ses proches.
Enfin, dans le rapport particulier de la relation soignant/soigné, la crainte d'une transmission peut être à l'origine du refus de certains guérisseurs de prendre en chargeles personnes épileptiques. Mais il s'agit dans ce cas d'unetransmission par l'intermédiaire des diables qui « attaqueraient" un membre de la famille du guérisseur. Une limite,fixée à neuf personnes « épileptiques » soignées, est reconnuepar certains guérisseurs, afin ne pas être atteint par cettemaladie dans leur famille.
Par ailleurs, les soins du corps d'une personne décédéede « l'épilepsie" peuvent également être l'objet de crainte dela part des personnes préposées à ce rôle. Ainsi, une vieillematrone disait s'être lavée sept fois, après avoir préparé pourl'enterrement une jeune « épileptique " vraisemblablementdécédée d'un état de malH . Toucher le corps du mort représente un risque pour la personne que la maladie peut ainsi« attraper ". Il s'agirait là plutôt d'une contamination symbolique, puisque la pratique de prudence qui lui est appliquée est celle d'une purification symbolique, par l'intermédiaire des sept lavements qui sont effectués par la matrone.
Les pratiques d'exclusion liées à la transmission doivent donc être abordées en fonction des différentes sphèresd'appartenance relationnelle du malade (Jaffré, 1999). Elless'y trouvent en effet modulées selon le degré d'intimité que lemalade entretient avec les personnes qui les composent. Ceversant relationnel doit donc être pris en considération, afinde saisir les véritables enjeux de l'exclusion du malade. Entémoigne également l'article de D. Bonnet (1995), qui met enexergue l'importance de la qualité du lien relationnel (facteurs individuels et psychologiques) dans les différentessituations d'exclusion de l'épileptique.
11 H. Gastaut : " Etat de mal: Etat caractérisé par une crise épileptique quipersiste suffisamment prolongée ou se répète avec des intervalles suffisamment brefs pour créer une condition épileptique fixe et durable ".Dictionnaire de l'épilepsie, Partie 1 : Définitions, ed.OMS, Genève,1993, p. 64.
272 Les maladies de passage
La notion de transmission apparaît donc variable, nonseulement par les conceptions qui la composent, mais également par les pratiques qu'elle engage. Cette complexitéconfère à la prise en charge du malade un caractère dynamique, évolutif et diversifié, caractère que l'on retrouve illustré à travers la question de l'offre de soins.
Aperçus sur la question des soins liée à celle de la transmission
La question de l'offre des soins apparaît en lien directavec les modalités de l'exclusion de la personne épileptique12.
Nous avons vu que cette exclusion était, en partie, associéeaux sentiments de crainte et de dégoût liés à la transmissionet qu'elle était d'autant plus importante, que l'on s'éloignaitdes sphères d'intimité relationnelle du malade.
Ce constat pourrait avoir une incidence non négligeable sur l'application des programmes de soins. En effet,on a pu constater que la compliance au traitement anti-épileptique s'avère plus forte lorsque l'approvisionnement estbasé dans le village du malade. Et ce, dans la mesure où cedernier y est reconnu en tant que tel, dans un entourage quilui est familier. D'où la possibilité de se procurer des médicaments, sans les contraintes de dissimulation qu'un environnement étranger pourrait imposer. En fait, il faudra distinguer trois situations dans l'offre des soins:
• Le village d'origine du malade, où se rend un médecin qui apporte à domicile le traitement.
• Un village proche de celui du malade où se trouve undispensaire, ou une pharmacie et où il est possible de se procurer les anti-épileptiques.
• Une ville éloignée où le malade se rend à la pharmacie ou à l'hôpital pour obtenir les médicaments.
Il semblerait que la fréquentation d'un lieu totalementanonyme, tel un hôpital en ville, soit préférée à celle d'un dispensaire basé dans un village proche, dans lequel le malade ne profite ni de la familiarité de son village, ni de l'anonymat de la ville.
12 Le problème de la prise en charge médicale de l'épilepsie à été traitépar Gaudart-Humbert (1997).
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali 273
La transmission s'avère, par ailleurs, un objet dereprésentation remanié au fur et à mesure que s'approfonditl'observation empirique de la maladie sur une personnemalade déterminée. D'où l'importance de conserver cetterelation spécifique entre le malade et son entourage, et parconséquent, de faciliter un accès aux soins dans le villaged'origine du malade.
Par ailleurs, les recours multiples aux différents typesde traitements (guérisseurs traditionnels, marabouts, infirmiers) représentent également un aspect particulier de laquestion des soins. En effet, leur utilisation diversifiée n'estpas sans conséquence sur la notion de transmission. Dans cecadre variable de recherches thérapeutiques, cette notionapparaît là encore très controversée. Les informations quisont en effet diffusées à son sujet sont contradictoires. Ainsi,on trouve dans les discours un espace de confusion autour dela transmission définie qui par un infirmier, qui par un guérisseur ayant infirmé l'information ... Ecoutons, dans le discours de malades, ce qui résulte de cette confrontation:
Les dogotorow (médecins) ont dit que ça se transmettait vite. Que c'est une maladie qui se transmet vite, quesi vous mangez ensemble, le microbe se transmet vitechez l'homme, c'est pourquoi nous l'avons mis à côté, ilboit son eau tout seul, il a sa jarre, il a sa louche, il a sonrécipient de repas, bon voilà, on lui donne tout ça là-bas.Mais nous-mêmes nous ne sommes pas sûrs car certainesmalades faisaient elles-mêmes leur cuisine et il n'y avaitrien. On ne sait pas comment ça se transmet. Mais lesdocteurs, ils disent certaines choses...
Ceux dont leur mère et leur père croquent la kola etchiquent le tabac... parait-il que la maladie peut te trouver grâce à ça. Il y a des docteurs qui nous ont dit ça.
Mais d'autres disent que quand tu vis avec le malade,si jamais le crachat sort et que ça arrive dans ton ventre,ça se transmet chez toi, ça nous été dit de cette manière.Nous, nous n'avons pas étudié jusqu'à ce niveau élevé.
Oui, on décide de la mettre à l'écart, même si on necomprend pas. Parce que c'est une chose qui est assezmélangée. On a peur d'elle, en réalité, même. On a peuL_
274 Les maladies de passage
d'elle quoi. Il y a de ces cheminements qui sont les mêmesque les vôtres. Mais il y a des cheminements où il y amême une grande différence entre nous. Quant à ce problème en réalité, nous on n'a pas pu trouver d'information. (Grand frère d'un homme malade)
Si les conceptions populaires semblent plutôt axées surla transmissibilité de « l'épilepsie », on ne retrouve pas, defaçon aussi systématique, cette représentation contagieusedans le discours des guérisseurs eux-mêmes. La transmission héréditaire y est représentée, ainsi qu'une forme detransmission par les diables, mais aucune pratique de prudence particulière n'est employée par le guérisseur pour seprotéger de la contamination au cours des soins. Qui plusest, lorsque le guérisseur est lui-même un ancien « épileptique ", il se considère comme « immunisé" contre cettemaladie. Enfin, le thème de la transmission est rarementabordé par le guérisseur dans sa relation avec l'entourage,car une telle question ne semble circonscrite qu'aux rapportspersonnels de la famille avec son malade. Le guérisseur neconsidère pas son rôle comme celui d'un éducateur. Il secontente d'un rôle de soignant.
Ainsi, dans les discours des infirmiers rapportés parles malades, dans ceux des guérisseurs, ou encore des personnes sans lien direct avec la maladie, la notion de transmission est imprégnée d'incertitudes et de contradictionsdiverses. Le recours thérapeutique ne semble pas considérécomme un pôle de référence, en matière d'information ausujet de la transmission. Cette notion est, en définitive, plutôt laissée à l'appréciation de chacun. Tant des guérisseursque des infirmiers, l'entourage sollicite avant tout une résolution de la maladie, sans chercher d'information précisequant à la transmission.
Néanmoins, l'efficacité d'un traitement semble indirectement contribuer à la diminution des craintes de contamination, qui sont principalement situées au cours de l'épisodede crise. L'aspect désordonné des mouvements du malade,l'émission de bave, voire d'urine, constituent en effet les éléments primordiaux sur lesquels se tisse une crainte de transmission. Leur disparition représente donc un facteur d'intégration essentiel pour le malade, au-delà de toute informa-
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali 275
tion précise sur la transmission. Ainsi, même si le malade neguérit pas définitivement, mais que le traitement permet ladisparition des crises, la question de la transmission seraplacée au second plan et le malade réintégré dans la majeurepartie des cas.
C'est pourquoi, afin de mieux adapter la mise en placed'un traitement au long-cours, il semble nécessaire deconnaître, non seulement les facteurs qui risquent de freinerune bonne compliance, mais également ceux, qui pourront lafavoriser.
Conclusion
Dans le contexte rural bambara, la notion de transmission s'inscrit au cœur d'une représentation globale de lasituation pathologique. En outre, les éléments nosographiques, étiologiques, et thérapeutiques que l'on distingue neprennent un sens que dans leur association à la dimensionsociale des évènements. Ainsi, le récit narratif - où l'onretrouve non seulement la description des symptômes, maiségalement l'histoire personnelle du malade - constitue unmode à part entière d'appréhension de la maladie.
Dans l'ensemble, on retiendra, à propos des pratiquesde prudence, qu'il est essentiel de conserver de « bonnes »
relations sociales, afin d'éviter la transmission de la maladie.Dans la même perspective d'unité sociale, les pratiquesd'exclusion à l'égard de « l'épileptique» sont modulées selonles différentes sphères d'appartenance sociale (familiale, villageoise, extra-villageoise). Le lien familial constitue un facteur d'intégration essentiel, dans la mesure où le degréd'intimité implique un malade et une autre personne ensituation d'échange, tandis que dans un environnementétranger, la dépersonnalisation de la maladie tend à favoriser les pratiques de mise à l'écart.
Ainsi, la transmission et les pratiques qui en découlentapparaissent nuancées par le contexte qui les supporte, d'oùl'intérêt d'une approche globale des faits étudiés, rôle poursuivi par l'analyse anthropologique.
276
Bibliographie
Les maladies de passage
Amani N., Durand G., Delafosse R.C.J.1995 " Incidence des données culturelles dans la prise en char
ge des épileptiques en Mrique Noire ", in Nervure, tomeVIII, n° 2, 47-51
Awaritéfé. A.1989 " Epilepsy : the myth of a contagious disease ", in Culture,
Medicine and Psychiatry, vol. 13, n° 4.
Bibeau G., Uchoa E., Corin E., Koumaré B.1993 « Représentations culturelles et disqualification sociale ",
in Psycho. Afr., XXV, 1,33-57.
Bonnet D.1995 « Identité et appartenance : interrogations et réponses
moose à propos du ca singulier de l'épileptique ", in Cah.Sci. Hum, 31 (2), 501-522.
Caprara A.1991 « La contagion - Conceptions et pratiques dans la société
Alladian de Côte-d'Ivoire - ", in Anthropologie et Sociétés,vol. 15, n° 2-3 : 189-203.
Farnarier G.1996 « Epilepsie dans les pays tropicaux en voie de développe
ment: étude de quelques indicateurs de santé ", inEpilepsie, n° 8.
1998 30 Novembre-2 Décembre, 3e Congrès de NeurologieTropicale, Fort de France-Martinique.
Gastaut H.1973 « Dictionnaire de l'épilepsie ", Partie 1 : Définitions-OMS
Genève.
Gaudart-Humbert A.Approche socio-anthropologique et prise en charge de l'épilepsie à Bamako, Mali, Thèse, Marseille, Faculté de médecine.
Jaffré Y.(a) 1999 " Conclusion ", in La construction sociale des maladies,
Jaffré Y. & Olivier de Sardan J.-P. (éds.), Paris, PUF :359-369.
La transmission de kirikirimasien en milieu bambara au Mali 277
(b) 1999 La maladie et ses dispositifs in La construction sociale desmaladies, Jaffré Y. & Olivier de Sardan J.-P. (éds.), Paris,PUF: 41-68.
Jallon P., Dumas M.1998 « L'épilepsie dans les pays en voie de développement ", in
Epilepsies, 10: 101-103.
Karfo K. et al.1993 « Aspects socio-culturels de l'épilepsie Grand Mal en
milieu Dakarois : enquête sur les connaissances, attitudeset pratiques ", in Dakar Médical, Sénégal, 38, 2 : 139-144.
Chapitre 11
Les conceptions populaires moosede la méningite (Burkina Faso)
André Soubeiga
La méningite, et plus précisément la méningite cérébro-spinale causée par le méningocoque, est une maladieendémo-épidémique très répandue en Mrique de l'Ouest etparticulièrement au Burkina Faso. Chaque année, lors de sapériode de recrudescence, de janvier à mai, durant la périodede l'harmattan, elle fait de nombreuses victimesl, largementissues des populations les plus défavorisées.
Peu de travaux d'anthropologie médicale sont consacrés à cette pathologie. Cette rareté ethnographique associéeà cette importance épidémiologique ont orienté nos investigations vers ce sujet. Nous nous proposons donc d'apporter iciun éclairage sur les représentations populaires de la méningite chez les Moose (singulier: moaga) du Burkina Faso2.
1 Par exemple, en 1996, les statistiques officielles dénombraient 4072décès sur 40509 cas déclarés.
2 Nous avons retenu pour notre enquête, la région de Ouagadougou, pourplusieurs raisons. Elle est une zone à très forte prévalence de mémngite. Elle connaît une forte implantation de guérisseurs qui apparaissentcomme des recours possibles pour des malades souffrant de cette maladie. Enfm, elle est proche du Centre Hospitalier National YalgadoOuédraogo qui reçoit, lors des épidémies de méningite, un nombre élevéde malades en provenance de diverses provinces du pays. Au total, cetteenquête est bâtie autour de plusieurs entretiens qualitatifs parfoisrepris deux ou trois fOls avec le même interlocuteur. Nous avons complété ces mformations provenant des populations et des guérisseurs,par les propos de quelques malades admis à l'hôpital, de leurs accompagnants ainsi que ceux de soignants.
280
De la dénomination de la maladie
Les maladies de passage
La plupart des interlocuteurs de notre enquête identifient et désignent la méningite par l'utilisation déformée duterme français: mininzit. S'il existe certains termes moorequi y font songer, la quasi totalité de la population ne les utilise pas. Néanmoins, à travers les propos de certains guérisseurs, donc de spécialistes, on a pu identifier au moins deuxtermes moore servant surtout à désigner les symptômes decette maladie :
Nak yubla Oit. cou raide) :
Ce terme se justifie par le constat que toute personneatteinte de cette maladie voit son cou se raidir. Cette dénomination descriptive3 se fonde sur l'un des symptômes lesplus caractéristiques de la méningite: la raideur de lanuque. Une variante proche de cette appellation correspondà l'expression kwi naake (lit. cou raidi et sec).
- Zu zabr' kasenga (lit. grand mal de tête; zugu = tête;zabre = faire mal; kasenga = grand, majeur):
Là encore, la logique qui préside à la nomination estune référence au symptôme. Les maux de tête, réputés violents et très douloureux (de siège tantôt frontal, tantôt occipitall, apparaissent aussi pour de nombreux tradithérapeutes moose comme des indicateurs. L'adjectif kasenga(grave) apposé à zu-zabre (céphalées, maux de tête) permetde bien distinguer la méningite d'un simple mal de tête.
Ces dénominations font donc référence à la partie ducorps affectée par la maladie.
Perceptions et discours sur les symptômes
Les signes cliniques pouvant aider à l'identification decette maladie vont donc, fort logiquement, être la douleur, lafièvre et la raideur du cou. En dehors de ces caractéristiques,pour diagnostiquer la méningite, les guérisseurs sont extrêmement attentifs et s'intéressent à tout signe « suspect ",
3 Nous empruntons cette expression à Fainzang (1986).
Les conceptions populaires moose de la méningite 281
arguant que certaines manifestations de la maladie peuventêtre trompeuses. En effet, les malades interrogés au CentreHospitalier National (CHN) de Ouagadougou, déclarent souvent avoir ressenti au début de leur maladie des symptômesfort éloignés de ceux que l'on associe ordinairement à laméningite. Ainsi, pour certains patients, la maladie s'estannoncée par de simples douleurs au dos ou aux reins, ouencore à la gorge. Pour d'autres, la première alerte s'estmanifestée par des douleurs abdominales: « ma fille s'estmise à pleurer en disant que son ventre lui faisait mal; ellemarchait en se tordant le dos » (mère d'une fillette de quatreans souffrant de la méningite).
Ces témoignages attestent de la diversité et de la complexité des signes précurseurs tels qu'ils sont perçus par lapopulation et par la suite, de la difficulté à établir un diagnostic fiable. Ces premiers symptômes qui affectent desorganes comme le dos, la gorge, l'abdomen, ou le cou vontêtre la cause fréquente de diagnostics populaires erronés. Ilssont assimilables à ceux d'un paludisme, d'un torticolis, d'unproblème musculaire, ou de douleurs de la colonne vertébrale. Seul, le raidissement de la nuque, lorsqu'il survient, apparaît aux yeux de tous, spécialistes ou pas, comme le signeévident et manifeste de la méningite. De l'aveu d'un guérisseur, c'est là, l'élément fondamental, quasiment infaillible,lui permettant d'établir son diagnostic:
C'est assez simple! par exemple, je commence par bienobserver le malade; s'il se met à regarder le ciel etdevient sec comme un bois, ce n'est rien d'autre que laméningite. Une fois que tu l'as, ton cou devient raide et tune peux que regarder le ciel; tu ne peux plus te plier ou tecourber. Chez l'enfant, la mère peut penser à une entorsedu cou, alors qu'il ne s'agit pas de cela. Moi, j'essaye de luifaire adopter une certaine position et s'il n'y arrive pas, jepense automatiquement à la méningite. (RO)
Cette complexité du diagnostic n'est pas sans conséquences pratiques. En effet, les premiers soins ont souventlieu au sein des familles, surtout lorsqu'elles sont peu fortunées. Par automédication, avec des remèdes obtenus à partirde feuilles et de racines, on cherche à faire disparaître lespremiers symptômes qui semblent bénins. « Certains com-
282 Les maladies de passage
mencent le traitement traditionnel jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'est la méningite. Mais c'est souvent c'est troptard! » (accompagnant d'un enfant de six ans, atteint deméningite).
Alors que Nak yubla est réputée être une maladie dontl'évolution est rapide et fulgurante, les recommandations desguérisseurs ne sont pas homogènes. Pour certains, il fautune intervention médicale dès le raidissement de la nuque sil'on veut préserver la vie du malade. D'autres, considèrentque le pronostic vital dépend des individus. La maladie peutdevenir rapidement critique chez certaines personnes, alorsque chez d'autres, elle commence et gagne petit à petit duterrain. Autrement dit, elle peut provoquer la mort enquelques heures tout comme elle peut durer plusieurs joursavant d'être fatale. Cela s'expliquerait par le fait que « lesgens n'ont pas le même sang ». Ces divergences d'interprétations mêlent ce qui relève d'une difficulté à établir une identification précise et précoce de la maladie aux diverses interprétations concernant la singularité de l'identité physique.
Les étiologies populaires de la maladie
Les discours populaires sur les facteurs susceptiblesd'expliquer l'apparition de nak yubla ne sont pas constantset stables. Ils intègrent un ensemble de faits, d'éléments etd'événements qui peuvent varier considérablement d'uninformateur à un autre. Cependant, deux éléments sont particulièrement pris en compte dans l'interprétation de la causalité de cette maladie : la coïncidence entre sa période derecrudescence et celle de l'harmattan (période des vents et dela chaleur) et le fait que la maladie sévit au moment oùapparaissent les mangues vertes. Pour ces raisons, liées àl'observation, deux grandes catégories d'agents pathogènescomposent l'étiologie moaga de la méningite.
Il s'agit tout d'abord des facteurs climatiques. En effet,une étroite relation est établie entre la chaleur, le corps, lesang et l'apparition de nak yubla. S'agissant de la chaleur,on incrimine avant tout le soleil dont les rayons provoqueraient un excès thermique susceptible de rendre nocif les
Les conceptions populaires moose de la méningite 283
vents secs et déjà chauds de l'harmattan. Cette fournaiseactiverait les « germes de la maladie » (ban-biisi), déclenchant ainsi les premiers symptômes. Pour cette raison, lespériodes chaudes sont réputées dangereuses. Selon cettemême logique de pensée, le germe de la méningite, qui« aime» la chaleur, est particulièrement dangereux pour lespersonnes qui sont censées avoir le sang « chaud» notamment les enfants.
Une forme de danger est donc associée au soleil dont lachaleur est potentiellement source de fièvre4 . On éviterapour cela, une longue exposition au soleil, en particulierquand celui-ci est au zénith. En revanche, durant la périodefraîche, le germe reste inoffensif: « je pense que le germepeut être dans le corps, mais si c'est pendant la saison pluvieuse ou pendant le froid, et si tu as un corps frais, il n'a pasd'effet sur l'organisme» ( l A, guérisseur, Ouaga). Ici encorela base de ces conceptions est empirique puisque les premières pluies (mai et juin) ont pour effet de stopper les épidémies de méningite.
Le vent, parce qu'il est souvent chaud et ignore lesfrontières qu'il franchit pour aller d'un pays à un autre etd'un village à un autre, est perçu comme un puissant facteurde transmission. Liés à cette conception, les comportementsde prévention vont dans le sens d'une réduction des contactsphysiques et sociaux en période d'épidémie. Il s'agit d'éviterà la fois les voyages, les marchés, les lieux de rencontre et derassemblement car « la maladie est fréquente là où il y abeaucoup de monde ».
Outre les facteurs climatiques, la méningite subitaussi l'influence des comportements alimentaires. On a vuplus haut que Nak yubla est parfois appelée « maladie desmangues vertes ». Cette pathologie serait, en effet, provoquéepar la consommation de mangues qui ne sont pas arrivées àmaturité. Et, une fois de plus, les enfants sont les plusconcernés par cette forme de transmission, puisqu'ils sont lesprincipaux consommateurs de mangues précoces. Si l'unanimité semble faite sur cet agent causal, les versions diflèrent
4 La même conception est à l'œuvre dans l'explication du paludisme chezles moose, ainsI que l'attestent les travaux de Bonnet (1990).
284 Les maladies de passage
quant aux mécanismes de la contamination. Selon une première explication, c'est la sève contenue dans le fruit qui estresponsable de la maladie: « quand vous grattez unemangue verte, il s'écoule un liquide; lorsque vous répandezce liquide sur votre peau, il se forme une plaie au bout dequelques heures. Donc, ce liquide acide une fois introduitdans l'organisme, peut être nocif, sous l'effet du soleil» (MmeS P, guérisseuse). Une autre justification incrimine la poussière qui se dépose sur les fruits à la faveur de l'harmattan.Cette poussière, porteuse de germes, pénètrerait par ingestion dans le corps, offrant ainsi l'occasion aux germes de lamaladie de s'introduire dans l'organisme. Outre lesmangues, on cite également d'autres fruits comme le karitévert (butyrospermum parkii), ou certaines variétés d'aubergines vertes appelées coumba. Par ailleurs, des alimentsgras ou huileux sont également associés à l'idée de risque:
Il y a au marché des aliments qui sont huileux (beignets, gâteaux) et qui ont une odeur. Si vous avez lesmains sales et que vous les saisissez, les germes peuventse coller à l'huile qui se trouve sur vos mains, et vous pouvez attraper la maladie en les mangeant. (OA)
Le même thérapeute précisera par la suite que les aliments secs comme les arachides sont, par contre, à conseillercar ne présentant aucun danger pour le consommateur. Danscertains cas, l'alimentation n'est pas jugée directement responsable de la maladie, mais apparaît simplement comme unfacteur la favorisant. Par exemple, un thérapeute traditionnel déclare que les germes de la méningite, du paludisme oude la jaunisse peuvent se retrouver dans l'organisme de toutindividu, mais qu'en s'adonnant à la consommation de« nourritures vertes », le sujet peut favoriser le déclenchement de l'une d'entre elles. Cette nuance, apportée par ceguérisseur, introduit la notion de « porteur sain » ou de« maladie latente » déjà signalée par D. Bonnet à l'occasionde l'épilepsie (1995 : 512). Il est difficile de penser avec certitude qu'il s'agirait d'une construction effectuée à partir desmessages de sensibilisation proposés par le personnel desanté sur diverses maladies tropicales. Ce savoir syncrétiqueintégre, sans doute, une certaine vision médicale à desconnaissances et pratiques thérapeutiques profanes.
Les conceptions populaires moose de la méningite 285
Qu'il s'agisse de la jaunisse, du paludisme, ou de laméningite, les facteurs climatiques (chaleur, humidité, fraîcheur) et alimentaires apparaissent donc comme les éléments clés de ces schémas étiologiques. De même, c'est toujours en référence à ces causes qu'est justifiée la plus grandevulnérabilité des enfants et des jeunes: ils aiment s'amuserau soleil, dans la poussière et sont de très grands consommateurs de mangues vertes ...
Les mécanismes de transmission et de contamination
La méningite est perçue comme une maladie trèscontagieuse: ban longdem. (lit. baanga = maladie; longdem =contagieuse). Mais, plus précisément, cette contaminationqui, comme nous venons de le décrire, se fait par voiesaériennes (vent, humidité) et alimentaires peut être soitdirecte, soit indirecte.
Lorsque la contamination se fait par contact physiquedirect, elle survient dans les cas suivants:
- par frottement avec des personnes malades lors desgrands rassemblements de population, comme les marchés,puisque le nombre élevé de personnes dans la foule augmente la probabilité de rencontrer des malades;
- par contact avec la sueur d'un malade qui contientles germes de la méningite ;
- par l'air expiré par un malade qui véhicule lesgermes de la maladie ;
- par un gaz qui peut s'échapper inopunément ducorps et se disséminer dans l'atmosphère.
La contamination indirecte peut se faire:
- par l'intermédiaire d'objets ayant appartenu ouayant servi à une personne malade;
- par la consommation d'aliments non protégés;
- par l'intermédiaire du vent et de la poussière.
Pour récapituler, les principaux « vecteurs »incriminéssont l'eau de boisson souillée par le vent ou la poussière, lesvents et les poussières, les aliments huileux et gras (comme
286 Les maladies de passage
les beignets, le beurre de karité, etc.), tous facteurs de transmission qui permettent aux: germes de se fixer sur les objetsou les mains souillées, les vêtements sales ou ceux d'unmalade, les aliments verts acides qui, sous l'effet du soleil,peuvent déclencher la maladie.
Par ailleurs, l'idée que le vent soit responsable de latransmission des maladies et en particulier de la méningitepeut s'illustrer à travers d'autres exemples recueillis auprèsde nos principaux: informateurs. En effet, la nocivité du ventne se manifeste pas uniquement à travers la respiration desparticules (ou des germes) en suspension; à la faveur de lanuit, les «germes de maladie » aiment à se promener, aidés encela par le vent. Voyageant ainsi au gré du vent, ils se collentet se fixent à tout ce qu'ils rencontrent. Ils sont en particulierattirés par l'humidité, raison pour laquelle il est déconseillé delaisser sécher des vêtements à l'extérieur, durant la nuit.
Si tu étales un habit la nuit dehors, et que le lendemain tu le portes avant même que les rayons du soleil nele frappent, tu peux attraper des maladies. (GA)
Séché dans de telles conditions, tout vêtement devientun vecteur potentiel de maladie, et de nak yubla en particulier, parce que susceptible d'avoir « hébergé » des germespathogènes. Cependant, précise notre interlocuteur, toutdanger disparaît dès lors que la chaleur du soleil atteintl'habit: « Si les rayons du soleil frappent cet habit, certainsde ces germes qui ne peuvent pas tenir longtemps sous lachaleur, meurent; en ce moment, il n'y a plus rien àcraindre ». L'on perçoit à travers cette « théorie de la contamination » que le vent reste un vecteur important de latransmission des maladies (Meulenbroek, 1990), soit directement par la respiration, soit indirectement par l'intermédiaire des vêtements. Si, comme nous l'avons vu, l'humidité permet aux ban biisi de se fixer sur les vêtements restés audehors, la couleur blanche (des vêtements) exerce, semble-til, une certaine attraction sur ces mêmes ban biisi.Autrement dit, si l'agent pathogène responsable de nakyubla passe par le vent et l'humidité pour se fixer sur lesvêtements, il affectionne aussi leur blancheur, car le blanc,outre son éclat, se caractérise à la fois par son aspect« attractif» et par sa « visibilité ».
Les conceptions populaires moose de la méningite 287
Au total, l'idée qui apparaît dans l'expression « maladie du vent » suggère d'emblée un type de contamination quise ferait par voie aérienne, rejoignant en cela une certaineconception biomédicale de la contagion5 . Mais l'explicationmoaga s'accompagne, comme on l'a vu plus haut, d'unereprésentation individuelle de la personne métaphorisée parla « qualité » de son sang: celui-ci doit « convenir » à la maladie. Les sujets ayant le sang chaud (ziim tulga) sont censésêtre davantage exposés à cette maladie. A la proximité d'unepersonne atteinte de méninzit, il se produit un phénomèned'attraction directe et donc de contamination; le sang chaudayant la faculté d'" attirer » la maladie (autrement dit lechaud attire le chaud). Cette forme de contamination symbolique, par" attraction » des similitudes, s'applique essentiellement aux sujets jeunes, au « sang chaud ». Ils sont ensituation d'une plus grande vulnérabilité face à nak yubla dufait de la « chaleur » de leur sang6. A l'opposé, les personnesâgées qui ont le « sang frais » (ziim maasga) sont moinssujets à cette maladie; non seulement ils l'attrapent plus difficilement, mais surtout elle est rarement mortelle dans leurcas7 (K. M. guérisseur, Koupèla). Le sang apparaît alorscomme l'élément fondamental de la transmission ou de larésistance à la méningite, une fois que le sujet sain est encontact avec les germes de la maladie.
5 Pour celle-ci, le méningocoque, agent causal de la méningite contenudans l'aIr que l'on respire peut pénétrer par effraction dans l'organismeà la faveur d'une lésion des muqueuses nasales généralement provoquée par un vent chaud et sec.
6 Cela, dit un guérisseur, est également observable chez certams animaux. Il soutient que la méningite c'est aussi une "maladie des poules":dans un poulailler, les vieux gallinacés peuvent souffrir de cette maladie, mais n'en meurent pas souvent. A l'inverse, les jeunes pouletsayant le sang chaud sont vite décimés car ils sont gras et en forme ; orla maladie "déteste tout ce qui est gras".
7 Ceci paraît en contradiction avec la vision biomédicale selon laquelle, laméningite du vieillard (tout comme celle de l'enfant), en raison du défiCIt immunitaIre provoqué par l'âge, est grave et rapidement mortelle.
288
Evolution et traitement de la méningite.
Les maladies de passage
Il n'existe aucun traitement traditionnel reconnucomme efficace contre le nak yubla en pays moaga. Ce sentiment semble unanimement admis par les thérapeutes rencontrés ainsi que par les malades (ou anciens malades) etleurs familles. N'ayant pas les moyens diagnostiques nécessaires pour procéder à l'examen du liquide lombaire, les« médecins traditionnels » se bornent à proposer un traitement symptomatique pour soulager le malade de la fièvreet/ou des céphalées. Ils apparaissent alors comme un recoursde « premiers soins ». Le malade est ensuite invité à serendre dans le centre de santé le plus proche.
L'avantage de la médecine moderne, c'est la possibilitéde faire des analyses, des examens, et dans le cas de laméningite, la ponction lombaire. Si la médecine africainen'arrive pas à soigner la méningite, c'est parce qu'on n'apas les moyens de faire ces examens. (SP)
Les guérisseurs moose ont une bonne connaissance del'existence du liquide céphalo-rachidien, appelé po-raogokoom8 en moore.
Toute la gravité de la maladie nak yubla se résume àcela, car faute d'un traitement rapide et approprié, celiquide peut se « disperser et attaquer la moelle épinièreet la détruire; dans ce cas, le malade est foutu ». (Rü)
Une fois que ce liquide est « gaté» (c'est-à-dire devenutrouble) les thérapeutes traditionnels se trouvent désarméset avouent leur impuissance. Lorsque le po-raogo-koomdevient trouble9, la maladie progresse très rapidement, affaiblit le sujet et lui est souvent fatale. Ce point de vue est celuid'une grande partie des guérisseurs interrogés qui admettentet reconnaissent les performances de la médecine savante,du fait qu'elle soit plus outillée.
8 Traduction littérale : dos/grand/eau ; traduction lIttéraire : l'eau de lacolonne vertébrale. Le terme koom s'utilise, comme dans de nombreuseslangues africaines, pour désigner différents liquides corporels ; ils'adjoint du nom d'un organe pour spécifier la nomination (par exemple,l'eau du sexe désigne le sperme).
9 Dans le dIscours médical, on dit que ce liquide présente un aspect semblable à l'eau de lavage du riz.
Les conceptions populaires moose de la méningite 289
Certains d'entre eux, préconisent des remèdes à basede plantes soit d'une manière préventive pour conférer unesorte d'immunité (d'environ un an) aux individus, soit pour« ralentir" l'évolution de la maladie lorsqu'elle s'est déjà installée. Mme S. P. propose soit une décoction de plantes (dontles noms n'ont pas été révélés), soit un produit sous forme depoudre. L'administration de ces remèdes se fait par voieorale et en purge, pendant au moins une semaine, et n'estsoumise à aucun interdit alimentaire ou social. Même si ceremède est surtout indiqué pour un traitement préventif dela méningite, la praticienne avoue l'utiliser égalementcomme « calmant » une fois que la maladie est déclarée.Quant à M. 1. A, il se dit détenteur de remèdes ayant à la foisdes vertus préventives et curatives. Là encore, il s'agit dumême traitement utilisé pour prévenir et pour soigner lemal. Il se présente sous diverses formes: infusions ou décoctions préparées à partir d'un mélange de feuilles de ouilinwiga (Guiera senegalensis) et d'écorces de caga (Detariummicrocarpum)lO, mais le plus souvent sous forme de poudreque l'on peut sucer ou mélanger à l'eau de boisson, ou encoreà la bouillie des enfants, etc. Ces plantes, soutient-il, « aidentà combattre la méningite; même si elle ne peuvent pas tuerle germe, elles peuvent au moins ralentir sa progression etcela tout le monde le sait ". Deux autres guérisseurs affirment ne rien détenir comme remède susceptible de prévenirou de guérir nak yubla ; ils se disent toutefois aptes à la diagnostiquer, et se contentent le cas échéant, de diriger lesmalades vers une structure médicale ou hospitalière.
Si dans le domaine curatif les guérisseurs moose semblent désemparés, leurs compétences en matière de traitements préventifs sont revendiquées; ainsi deux d'entre eux ontdéclaré avoir mis au point des produits préventifs, disponiblessous forme de poudre ou de sirop, capables de protéger pendantune année. Ils assimilent ces produits à des « vaccins ".
10 D'un point de vue médical. il est reconnu que le Deterium microcarpumest un excellent préventif contre la méningite, en raison de sa forteteneur en vItammes C.
290
Conclusion
Les maladies de passage
La méningite, dans la conception populaire moaga relève de la catégorie des maladies qualifiées de Wennam yirbaanse (litt. maladies de la cour de Dieu) ; elles sont également désignées sous le vocable ban zaalse (litt. : maladiessimples). L'expression Wennam yir baanse renvoit à toutes lesmaladies provoquées par l'action d'un agent pathogène conçucomme naturel, ou à des maladies consécutives à des causesnaturelles et susceptibles d'être traitées par la pharmacopéetraditionnelle localell . Selon certains guérisseurs moose, lesWennam yir baanse renvoient ordinairement aux affectionsdont les manifestations cliniques ont pour siège la tête et leventre. Une telle conception postule que l'être humain « nedispose que de deux centres vitaux, qui ne sont autres que latête et le ventre, le reste ne représentant que des ramifications. Que le mal soit ressenti aux oreilles, aux dents ou auxyeux, c'est toujours de la tête qu'on souffre. De même, pour leventre, que le mal soit ressenti au foie ou à l'estomac, c'esttoujours du ventre qu'on souffre ». (Ouedraogo., 1998)
Ce faisant, si pour les thérapeutes traditionnels laméningite est une maladie naturelle qui n'a pas de liendirect avec la sorcellerie12 , le sens commun, établit, quant àlui, un rapport étroit entre la maladie et la sorcellerie durantles périodes d'épidémie. Elle est aussi pensée, par l'entourage du malade, sous un mode persécutif lorsque celui-ci décède brutalement : « Si tu t'amuses avec le traitement traditionnel, tu es foutu car dès que le liquide du dos n'est pasévacué, il n'y a pas de guérison. Or, les tradipraticiens nepeuvent le faire. Si ce liquide est enlevé, le malade peut viteguérir; mais si malgré cela il meurt, c'est que ce sont dessorciers qui sont responsables de la mort ,,13.
11 Elles s'opposent alors aux ban mand'm ou ban {abd'm (maladies provoquées) dont l'étiologie est le plus souvent associée à l'élément magicoreligieux.
12 Même si l'on consIdère que les sorciers profitent toujours de la maladIe,et quelle qu'elle soit, pour nuire à leurs victimes, puisqu'ils attaquent,en particulier, les personnes vulnérables.
13 EntretIen avec un accompagnant de malade, Centre HospitalierNational, Ouagadougou.
Les conceptions populaires moose de la méningite 291
Les propos des guérisseurs rapportés ci-dessus témoignent de leur constante évolution et de leur incorporation decertains aspects du discours médical. Cette tendance estobservable plus particulièrement chez ceux qui exerçentdans les grandes villes comme Ouagadougou ou qui sontregroupés dans des associations, sous l'impulsion duMinistère de la Santé. Au sein de ce cadre associatif, ils peuvent bénéficier de séances de sensibilisation et/ou de formation (sur les MST, le Sida... ).
Les données recueillies ci-dessus attestent aussi d'unetrès grande diversité dans les pratiques des guérisseurs traditionnels. Comme l'a souligné Didier Fassin (1992), cette hétérogénéité renvoie elle même à une diversité des modalitésd'acquisition de leurs savoirs ainsi que de leurs expériencesrespectives dans l'exercice des arts de guérison. Les divergences et les différences constatées çà et là dans les proposdes guérisseurs de même que leurs contradictions, témoignent de ce que ce même auteur a appelé la « nosographieinstable » ; en effet, à les écouter, chacun de ces thérapeutessemble avoir sa propre nosographie. S'agissant de la méningite, l'on a pu constater des différences (si mineures soientelles) dans leurs discours, qu'il s'agisse de ses causes ou deses manifestations ou encore de ses modes de transmission.Quant au traitement traditionnel, si son efficacité ne peutêtre avérée, certains thérapeutes disposent de « calmants» oude remèdes à caractère préventif, tandis que d'autres avouentleur impuissance à prévenir ou à traiter cette maladie.
En somme, les connaissances accumulées par lesMoose au sujet de la méningite se caractérisent à la fois parleur unité et par leur diversité, par leur adaptation et leurinadéquation (risques de retard dans les recommandationsdans l'accès aux soins). Si la méningite semble connue delongue date en pays moaga, les discours, les attitudes et lespratiques thérapeutiques évoluent selon les conditions, lesmodalités et les contextes familiaux et sociaux dans lesquelsles guérisseurs sont appelés à exercer. De plus, la « rencontre»avec la ville et partant, la médecine savante, constitue unautre facteur qui va progressivement accélérer la transformation de la médecine traditionnelle. D'ores et dèjà, certaines associations sont invitées à opérer une « épuration»
292 Les maladies de passage
en leur sein en refusant l'adhésion de devins et autres « charlatans » soupçonnés soit de s'adonner à des pratiques mystiques et « irrationnelles ", soit d'« escroquer" leur clientèle(Soubeiga, 1996). Seuls ceux qui guérissent en s'appuyantexclusivement sur les vertus thérapeutiques des plantessemblent bénéficier de la grâce du pouvoir médical et desautorités sanitaires. Cependant, la réalité sur le terrainmontre à bien des égards que ces critères manichéens ne suffisent pas à garantir l'efficacité thérapeutique ou l'honnêtetédu guérisseur. De plus, dans de nombreux cas l'adhésion àl'association semble se jouer en priorité sur des enjeux politiques (accession à une position de pouvoir à l'échelle duquartier) et sociaux (quête de reconnaissance et de légitimité) [Gruénais et Malaya, 1989]. Signe des temps, les guérisseurs intégrés désormais au sein de cadres associatifs, refusent de reconnaître ouvertement le recours aux pratiquesmagico-religieuses. Comme les autres, ils se montrent deplus en plus perméables aux schémas de causalité véhiculéspar le savoir médical (cas de la méningite, et de bien d'autresmaladies comme le sida actuellement) qu'ils adoptent maisré-interprètent à leurs manières. Pour eux, la force de la« médecine des Blancs » réside dans sa capacité à utiliserdes « machines" pour voir l'intérieur du corps ainsi que lesgermes des maladies qu'on ne peut voir à l'œil nu ; celasemble suffisant pour justifier la supériorité de cette biomédecine dans le domaine du diagnostic et du traitement. Nepouvant contester cette « supériorité ", ils se voient obligésd'utiliser ces précieuses informations qu'ils réadaptent ententant de les mettre en adéquation avec leurs propres systèmes de représentation. On est alors en présence de « syncrétismes étiologiques ", qui s'avèrent être de puissants facteurs d'évolution de la médecine traditionnelle.
Bibliographie
Badini A.1978 La représentation de la vie et de la mort chez les Moose tra
ditionnels de Haute Volta, thèse de Doctorat de 3e cycle dePhilosophie, Univ. de Lille.
Les conceptions populaires moose de la méningite 293
Bonnet D.1988 Corps biologique, corps social: procréation et maladies de
l'enfant en pays mossi, Paris, Ed. de l'ORSTOM , coll.Mémoires nO 110.
1990 « Anthropologie et santé publique ", in Fassin D et JaffréY, Sociétés, développement et santé, Paris, Ellipses: 243258.
Fassin D.1992 Pouvoir et maladie en Afrique, Paris, PUF.
Fainzang S.1986 « L'intérieur des choses " : Maladies, divination et repro
duction sociale chez les Bisa du Burkina, Paris,L'Harmattan.
Gruenais M-E., Mayala D.1989a « Comment de débarrasser de 1'« efficacité symbolique» de
la médecine traditionnelle? ", in Politique Africaine, nO 31.
Meulenbroek A.1990 La conception des maladies chez les Mossi dans la région
de Basma, Burkina Faso, Min. de la Santé Kaya.
Olivier de Sardan J.-P.1994 « La logique de la nomination: les représentations fluides
et prosalques de deux maladies au Niger ", in Sciencessociales et santé, vol. XlI, nO 3.
Ouedraogo P.A.1998 Contribution à l'étude des représentations sociales du
« tiim " dans le milieu traditionnel moaga (Région deOuagadougou), Mémoire Maîtrise de Sociologie, Univ. deOuagadougou.
Soubeiga A.1996 La médecine traditionnelle à l'épreuve du changement
social: problèmes et perspectives, doc. multigr.
Chapitre 12
La gestion locale des épidemiesdans la vallée du fleuve Niger
Abdoua Elhadj Dagobi
Au Niger, les actions de santé publique qui ont pourobjectif de réduire la morbidité due aux maladies épidémiques ne tiennent pas compte des représentations localesdes épidémies. Ces actions regroupent notamment dans unmême ensemble des pathologies différemment ordonnées parles populations. Par exemple, la rougeole et la variole(aujourd'hui disparue), sont perçues, en milieux hausa etzarma, comme des « maladies anciennes ». A l'inverse, laméningite et le choléra sont interprétées comme des pathologies récentes l . Les traitements locaux sont supposés peu efficaces, et la prise en charge de ces pathologies est fortementassociée à la médecine. Quant à la poliomyélite, elle resteencore mal connue, en dépit des campagnes de lutte dont ellea fait l'objet ces dernières années. On voit donc, à partir deces quelques distinctions, que la catégorie d' « épidémie » estloin d'être homogène tant à cause de l'histoire de leur priseen charge par le système de santé que du contenu des représentations des populations. C'est pour pallier ces lacunes quece travail se propose de préciser les conceptions locales de ces
1 Les données sont variables pour la méningite : pour certains informateurs, cette maladie sévissait avant la période coloniale alors que pourd'autres, elle reste quasiment inconnue à cette même période. Enrevanche, l'apparition du choléra est datée avec précision: la premièreépIdémie connue remonte à 1970.
296 Les maladies de passage
pathologies et de décrire les formes de prévention locale utilisées face à diverses « épidémies ,,2. Cette question sera traitée à partir de matériaux d'enquête collectés en milieu ruralZarma-Songhay3.
Mais, avant de présenter les caractéristiques généralesde ces conduites préventives, il importe de cerner les propriétés des maladies épidémiques telles qu'elles sont interprétéespar les populations.
Les caractéristiques des maladies épidémiques
Qu'elles soient supposées anciennes ou nouvelles, lesmaladies épidémiques partagent quelques caractéristiquescommunes.
En premier lieu, et fort banalement, elles sont contagieuses (l ga diisa), c'est-à-dire transmissibles d'un malade àune personne saine :
Si la maladie entre dans une concession, elle peutattraper deux à quatre personnes. Elle attrape celui-ci,puis elle saute à celui-là... jusqu'à ce qu'elle se répande(say) dans le village. (AS)
2 Je remercie sincèrement J.-P. Olivier de Sardan, Y. Jaffré, D. Bonnet,A. Moumouni et A. Souley qui ont accepté de lire les versions successives de ce travaIl.
3 Le milieu zarma-songhay est un ensemble ethnolmguistIque situé depart et d'autre de la vallée du fleuve Niger. Cette région est majoritaIrement peuplée de Kado, de Kourtey, de Wogo qui sont les principauxsous groupes de l'ensemble zarma-songhay (Olivier de Sardan 1984)..On y trouve également d'autres populations d'installation plus oumoins récente comme les Hausa, les Peuls et les Bella. De manièregénérale, toutes ces populations pratiquent les mêmes activités économiques (agriculture, élevage, riziculture pêche, commerce), avec unepréférence marquée pour le commerce chez les Hausa et pour l'élevagechez les Peuls et les Bella.Les données ici présentées ont été recueillies entre décembre 1997 etfévrier 1998 à Sarando Ganda (rive droite du fleuve) et à Diamballa(rive gauche) à partir d'entretiens semi-directifs effectués sur le thèmedes « maladies locales ". Ces données ont ensuite été complétées enoctobre 2000 à Diomana et Famalé, sur la rive gauche. Les différentsentretiens ont été effectués en zarma (la langue la plus parlée de laréglOn) et ont été systématiquement enregistrés sur bande magnétiqueavant d'être transcnts et traduits en françaIS.
La gestion locale des épidémies dans la vallée du fleuve Niger 297
En second lieu, les maladies épidémiques qui sontprincipalement des « maladies de l'enfance »4, sont dites« immunisantes» car:
Celui qui en a souffert est pratiquement épargné pourle reste de sa vie. Mais le risque de développer la maladiereste entier pour celui qui n'en a pas encore souffert,même s'il parvient à l'âge adulte5 . (MHF)
On observe aussi que la sévérité de ces maladies augmente avec l'âge, particulièrement dans le cas de la rougeolepour laquelle:
L'adulte a moins de chance de guérir qu'un enfant.(AMN)
Il s'agit là d'un constat empirique. En troisième lieu,ces maladies ont un caractère mortifère. Ainsi:
Lorsque la rougeole vient, elle attrape tous lesenfants... Sur 20 malades, environ 2 seulement s'en sortent.(AS)
Des propos et souvenirs similaires concernent laméningite. « L'épidémie survenue en 1995 à Sarando Gandaa été très meurtrière. Quand le piroguier prend le large pourévacuer un malade au lazaret de Boubon, on lui dit: attends,il en vient un autre! Quand vous finissez d'enterrer un mortet que vous reprenez le chemin du village, on vous dit: nepartez pas, il y a une nouvelle dépouille ».
Enfin, les maladies épidémiques ont un caractèrecyclique: « Il y a longtemps, la rougeole survennait tous les2, 3 ou même 10 ans ... La méningite met également dutemps pour venir, mais quand elle vient, elle tue presquetous les enfants qui sont nés après la dernière épidémie» (A,Sawani). Ce caractère cyclique met en évidence l'omniprésence des maladies épidémiques et des souffrances dont ellessont porteuses. Par leur récurrence et le nombre élevé de vic-
4 La rougeole par exemple est appelée « zankay hayya » car « elles'attaque surtout aux enfants» ; cette maladie est encore appelée« dobu dobu ». Mais le choléra ne relève pas de la catégorie des« maladies de l'enfance» car il touche aussi bien les enfants que les adultes.
5 On retrouve la même observation chez les Haalpulaaren du Sénégal(Fassin : 1986 : 1124).
298 Les maladies de passage
times qu'elles provoquent, ces maladies sont perçues commeétant de véritables fléaux (bala'u ou annoba). Des événements malheureux sur lesquels les hommes n'ont pas deprise. A ce titre, elles relèvent du même registre que lessécheresses, les famines, les guerres ou les incendies.
La transmission des maladies épidémiques
Quatre modes de transmission sont évoqués pourexpliquer la propagation de la maladie.
En premier lieu, les déplacements : « quand quelqu'unvoyage, il rapporte la maladie. Après, elle attrape celui dontle corps lui plaît ». Le déplacement est particulièrement citécomme étant un facteur important dans la transmission desmaladies épidémiques et explique la mise en œuvre desmesures quarantenaires.
En second lieu, on évoque le vent (haw). « La maladie,c'est le vent qui l'amène au village. Dès que le vent change dedirection, elle vient dans le village. Elle attrape celui dont ellepeut dominer le sang ». Ce mode de transmission s'appliqueplus particulièrement à la méningite et à la rougeole. Cesmaladies, qui atteignent généralement leur pic épidémique ensaison sèche, sont associées au souille de l'harmattan. Ellesne régressent qu'avec les premières pluies censées « laver » laterre et la débarrasser des maladies. Cette conceptionconjugue sans doute des souvenirs de messages d'éducationsanitaire consacrés à l'hygiène et à la protection des alimentset certaines représentations émiques dans lesquelles le ventest le symbole de tout ce qui est l'extérieur au village. Parexemple - ce qui semble confirmer cette hypothèse - le terme« haw » s'applique notamment aux génies6.
En troisième lieu, les contacts favoriseraient unetransmission qui peut être directe lorsqu'elle s'opère entredeux sujets, sans intermédiaire, comme c'est le cas lors deséchanges respiratoires? On dit ainsi que:
6 Communication personnelle de Jean-Pierre Olivier de Sardan.
7 C'est aussi le cas des relations sexuelles, de la manipulation d'un malade ou du lavage d'un cadavre.
La gestion locale des épidémies dans la vallée du fleuve Niger 299
Lorsque tu restes près de quelqu'un, ton haleine(heway) pénètre dans le corps (gaham) de l'autre, dansson être profond (hundi). Dès que ton souffie entre dansson corps, tu lui transmets ta maladie. (MHF)
La rougeole et la lèpre (jirey) sont souvent citéescomme correspondant à ce mode de transmission. Mais cettetransmission peut être indirecte, comme lorsque l'on manipule des objets souillés par le malade comme des vêtementsou des instruments de cuisine, louches ou gobelets ... Cetteconception, fréquemment évoquée à propos du choléra, estcertes régulièrement mentionnée lors des campagnes éducatives. Mais elle est aussi confirmée par l'expérience vécue dela quarantaine et de ses risques. Ces propos en témoignent:
Je suis restée avec ma sœur et mon fils, tous deux hospitalisés à Ayorou, en 1994. Je lavais leur linge et lesustensiles dans lesquels ils mangeaient. Au bout du troisième jour, j'étais moi aussi atteinte de choléra. (HF)
Globalement, les déplacements, le vent et les contactssont les principales voies de transmission des maladies épidémiques. Il faut, ici, faire une remarque particulière à propos de la contamination hydrique, fréquemment évoquée lorsdes campagnes de lutte contre le choléra, mais aussi contrela bilharziose urinaire. Cette thèse de la transmissionhydrique est apparemment admise, mais il ne s'agit le plussouvent que d'une reprise des messages de santé8. Nosenquêtes révèlent que la majeure partie de la population,bien que tenant ces propos, ne peut accepter ce « message»qui semble contredire - ou empêcherait - les plus habituellesdes conduites quotidiennes. Un simple exemple suffit ici:
Nous ne connaissons pas les maladies liées à l'eau, c'estvous, les intellectuels, qui les connaissez et c'est à vous denous en préserver. Nous, nous allons au fleuve, nous nousy lavons et nous y faisons notre vaisselle. (ASG)9.
8 Les expressions assez souvent rencontrées sont du genre : « les agentsde santé disent que le choléra est dans l'eau ", « l'eau sale peut donnerla diarrhée ", etc.
9 Dans le même ordre d'idées :« nos grands parents n'avaient pas connude forage, c'est l'eau du fleuve qu'ils ont toujours consommée et ils sesont pourtant bien porté" (M. A., Diomana).
300 Les maladies de passage
Dans ces conditions, la prévention des maladieshydriques apparaît d'emblée comme problématique, et c'estpourquoi, la connaissance des conduites locales de prévention est indispensable.
Les conduites locales de prévention
Le dispositif local de prévention peut être décritcomme un ensemble formé de pratiques d'origines diverses.Il y a tout d'abord la « quarantaine ", revendiquée commeétant une pratique « typiquement locale " par les populations, et qui aurait été simplement formalisée sous la formede police sanitaire par l'administration coloniale puis parl'Etat post-colonial. Viennent ensuite les rites préislamiquesdu terroir, puis les pratiques maraboutiques issues de la tradition islamique. Enfin, l'inoculation antivarioliqueaujourd'hui disparue, mais dont le souvenir est encore vivacedans les représentations sanitaires des populations. Ce sontces diverses pratiques que nous allons décrire en détail.
La quarantaine
Historiquement, le terme de quarantaine est apparudans le contexte des poussées épidémiques du choléra aucours du XIXe siècle en Europe. Il désigne la période deréclusion de quarante jours imposée aux équipages desnavires marchands provenant des contrées lointaines avantd'accoster dans les villes portuaires en Europe. Ce terme,passé dans le vocabulaire des médecins et administrateurscoloniaux, a été repris par les populations pour lesquelles laquarantaine est devenue « karanti ". Si l'on s'en tient à l'histoire du concept, la pratique de la quarantaine proviendraitdonc de l'époque coloniale lO.
Mais, cette pratique est revendiquée par les populations pour lesquelles elle était déjà mise en œuvre avant lacolonisation:
10 Pour un aperçu de la mise en œuvre de la quarantaine sous la colonisation, voir Salifou (1977 : 984 )
La gestion locale des épidémies dans la vallée du fleuve Niger 301
Bien avant l'arrivée des Blancs, les Kado ne se fréquentaient pas en cas d'épidémie (l ga ce gayiJ. (TF)
Dans les représentations locales, la pratique médicalement fondée de la quarantaine vient se confondre avec desconduites locales d'évitement.
Mais, outre ces discussions sur l'origine d'une pratique, le plus important nous semble être la manière dontelle est vécue par les populations. De la part des services desanté, il s'agissait d'une pratique autoritaire. Ainsi, lors de lapremière épidémie de choléra en 1970 à Famalé :
Les agents de santé sont venus avec des militairespour mettre la quarantaine (l dan karanti ir game). Ilsnous ont interdit d'aller à Famalé car il y a une terriblemaladie qui tue en peu de temps. Ils ont fait la mêmechose pour le village de Dessa. (S., Imam de G)
Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, cet élément autoritaire n'est pas perçu comme anormal par lespopulations car elles en perçoivent le bénéfice. Cet « accordautour de la quarantaine» est d'autant plus aisé à obtenirque, comme nous l'écrivions précédemment, les déplacements et les contacts sont perçus comme des modes de transmission des épidémies.
De manière générale, le bilan de la lutte contre les épidémies est perçu comme positif et les pratiques d'isolementdans les lazarets (appelés tanda ll ) sont entrées dans leshabitudes locales, mais surtout ont ouvert la voie à d'autrespratiques médicales. Il suffit ici de citer ces quelques témoignages:
Lorsque nous avons su que les agents de santé soignaient la méningite, nous sommes allés les trouver àBoubon. Lorsqu'on fait des injections aux malades; celuiqui a une longue vie (alhomarJ survit, mais celui dont lavie est à son terme meurt. (ASG)
11 Ce terme signifie" hanga» ; cette appellation vient du fait que les lazarets sont généralement des hangars qu'on dresse derrière le villagepour accueillir les malades et leurs accompagnants. Après l'épidémie,ces hangars sont destinés à être brûlés.
302 Les maladies de passage
Concernant maintenant la rougeole:
Les agents de santé nous ont conseillé de laver lesmalades car ceci est sans danger. (AS)
Mais, au delà de l'hygiène, la médecine est aussi perçue comme ayant apporté le « bon remède ». Dès lors, lestraitements traditionnels sont perçus comme des « médications du passé» (don borey safara) :
Ce sont les agents de santé qui ont amené le remède.Nous faisions nos soins traditionnels, faute de mieux. (AD)
Soulignons que ce rapport globalement positif avec lamédecine a été à l'origine de la construction de centres desanté à la seule initiative des populationsl2 .
Les rites préislamiques
Ces rites ont un caractère propitiatoire. Ils visent à prévenir les fléaux dont les épidémies ne constituent qu'un aspect.On citera plus particulièrement le yeynandi 13 et le fu kali.
Le yeynandi est une cérémonie annuelle organisée parles zima 14 (prêtres des halle ou génies) au début de chaquesaison de pluies pour « rafraîchir» la terre à l'intention desgénies du panthéon zarma et, plus spécialement de Dongo, legénie de la foudre. En « rafraîchissant» la terre, les zima« distraient» les génies et demandent, en retour, une issuefavorable pour la nouvelle saison, et la protection contre lafoudre et les calamités diverses, telles les inondations ou lesépidémies (Olivier de Sardan, 1982). Mais, au-delà de cettetâche occasionnelle d'organisation du yeynandi, les zimajouent une fonction de vigile pour le village ou la région.C'est ainsi:
12 C'est le cas notamment de Diamballa et de Namari Goungou, dans ledépartement de TIilabén.
13 Le culte hausa homologue au yeynandi est le « budin daJl ,,(lit. ouverture de la brousse) qui inaugure l'ouverture de la chasse chez les Azna,qui constituent l'un des rares bastions animistes au Niger. Quant au"ru kalL ", il a pour correspondant le culte de " aljanin gida ,,) (littéralement, le génie de la maison). Nous ne reviendrons pas sur les culteshausa en raIson de leur grande similitude avec les cultes zarma.
14 Ce sont les prêtres des holley ou génies, spécialistes des cultes de posseSSlOn.
La gestion locale des épidémies dans la vallée du fleuve Niger 303
Qu'à l'époque du règne de feu le chef de canton deDessa, un sohance 15 de l'Anzuru a fait un kotte 16 afin quela pluie ne tombe plus. Il voulait que la famine s'installedans la région. Les marabouts ont fait des invocations,mais la pluie n'est pas tombée. C'est alors que les autorités locales saisirent les zima de Famalé, de Gaygoru et deTomare qui se rencontrèrent à Dessa. Ils invoquèrent leshawka 17 pour que la pluie tombe et que le sohance soitchâtié. Ce jour-là, une pluie abondante tomba sur toute larégion, et trois jours plus tard, le sohance trouva la morto., zima de Famalé )
Un tel récit met en évidence la puissance - tout aumoins supposée - des hawka. Mais il a aussi comme but demontrer la force des zima qui ont réussi là où les maraboutsont échoué. En mettant en échec le sohance, les zima revendiquent ainsi un statut de sauveur de la région.
Quant au culte du « ru kali ", il s'apparente aux culteslignagers destinés à protéger les familles contre les agressions magiques et à assurer la fertilité des champs et destroupeaux. Cette protection des familles est souvent la spécialité des atakurma ou génies nains. Mais on peut aussichercher la protection d'un génie d'un culte de possession(holle) :
Pour sceller une alliance avec un atakurma, on placedes graines de sésame (lamti) et des feuilles d'oignonséchées (gabu) au pied d'un arbre afin de l'appâter. Aprèsquelques séances, l'homme et le génie sympathisent, puisils définissent les termes du contrat. L'homme promet dessacrifices à un rythme convenu avec le génie qui, enretour, l'assure de sa protection, pour lui-même et pour safamille. (ABD).
Cependant, ainsi que le souligne ce même interlocuteur, « de nos jours, les gens n'entretiennent plus les mêmesrapports avec les génies à cause de la religion ". Autour de
15 Le Sohance est un personnage redouté en raison de ses pouvoirs surnaturels.
16 Le kotte est le recours aux pouvOIrs magiques à des fins de nuisance.
17 C'est une famille particulière de génies apparus dans les panthéonshausa et zarma pendant la colonisation.
304 Les maladies de passage
ces pratiques de protection, c'est donc tout un ensemble derapports entre des cultes du terroir et un islam, théologiquement et socialement exigeant, qui apparaît.
Les pratiques maraboutiques
Le champ d'application des pratiques maraboutiquess'étend à des domaines aussi divers que, par exemple, laréussite économique ou sociale, la quête d'un emploi ou larésolution des problèmes conjugaux. Mais, plus spécifiquement, deux types de pratiques sont mobilisées dans la luttecontre les épidémies.
La première consiste à confectionner des amulettesque l'on suspend au cou des enfants:
Lorsqu'une épidémie de coqueluche se déclare, lemarabout écrit des versets sur des feuilles de hohorbevi etconfectionne des amulettes que l'on suspend au cou desenfants. Ces amulettes ne les empêchent pas d'êtreatteints par la maladie, mais elles en atténuent les effets.(GD)
La seconde pratique est un rite annuel, organisé, selonle calendrier zarma, le dernier mercredi du dernier moislunaire de l'année (daddaba hayrui), Cette pratique se fondesur une tradition islamique alliant une temporalité et desmodes alimentaires. Selon celle-ci:
Il existe, chaque année, une nuit au cours de laquelleDieu fait descendre diverses maladies sous forme de poussière sur la terre. Si cette poussière entre en contact avecun aliment non protégé, la consommation de ce dernierdevient source de maladie. C'est pour cette raison qu'ondemande aux gens de protéger leurs aliments. (HYD)
Ce rituel est toujours strictement organisé. Ainsi, pourne prendre qu'un exemple dans un village, un imam déclare:
L'année dernière, les femmes ont envoyé quelqu'unpour me demander d'organiser ce rituel. Je leur ai répondu que cela se fait à une date précise et que cette daten'était pas encore arrivée. Cette année, lorsque la date
18 Nom local d'une plante (non identifiée).
La gestion locale des épidémies dans la vallée du fleuve Niger 305
arriva, j'ai informé les gens et nous avons organisé lerituel. Les marabouts se sont rassemblés à la mosquéepour transcrire certains versets coraniques sur destablettes en bois; ces tablettes ont ensuite été lavées etl'eau du lavage (hantum hari) a été recueillie dans descanaris, puis distribuée à chaque famille pour êtreconsommée. (HYD)
Implicitement, cette pratique souligne que Dieu est lacause première de tous les phénomènes. C'est donc vers luiqu'il convient de se tourner afin d'obtenir un remède ou unmoyen de prévention.
L'inoculation antivariolique
Le terme utilisé pour désigner cette pratique est cansaqui signifie scarification. Elle repose sur l'idée qu'une immunité peut être acquise grâce à l'introduction du pus d'unmalade dans l'organisme d'une personne saine. Cette inoculation volontaire provoquerait une forme bénigne de la maladie qui préserverait, ensuite, d'une attaque sévère.
Cette opération se déroule de la manière suivante:
Celui qui n'a pas encore été atteint par la maladie, onlui fait des scarifications sur le bras. On casse une pustulevariolique (bida gna, (lit. mère de la variole) sur le corpsd'un malade, on en prélève le pus, puis on l'applique surles scarifications faites sur une personne saine. Ce receveur fait alors une petite fièvre, mais ça s'arrête là. (MD)
Lorsque le pus inoculé provoque une petite pustule, ondit que « ça a aimé ton corps » ; et cette pustule finitd'ailleurs par se cicatriser. Mais, lorsque la pustule se transforme en plaie, on dit que « ça ne l'a pas aimé ».
Les détails apportés à cette description de l'inoculationlaissent supposer que cette technique était très répanduedans la vallée du fleuve. Par ailleurs, nous avons pu remarquer, au cours de l'enquête, que plusieurs personnes âgéesd'une quarantaine d'années en portent encore les traces. Onpeut en déduire, que, dans cette région, cette pratique a du seperpétuer jusqu'à la veille de l'indépendance. Dans certaineslocalités du département de Zinder, à l'Est du Niger, cette
306 Les maladies de passage
inoculation faisait même l'objet de « transactions » entre ledonneur et le receveur. Pour se faire inoculer le pus prélevéchez un malade, le receveur était tenu de « payer sa variole»au donneur, en lui offrant quelques grains de haricotl9 .
Faut-il en déduire que cette pratique est d'origine locale?Sans doute pas puisque son caractère exogène peut être attestéà partir de sources historiques2o• Mais l'important nous sembleêtre que cette pratique d'inoculation est maintenant revendiquée comme une pratique endogène. Elle se présente, dès lors,comme une conduite syncrétique, très largement appropriée parles populations en fonction de leurs propres représentations.
Mais, il ne s'agit pas ici que d'une réflexion théorique.Ces considérations et discours locaux ne sont pas sansimportance puisqu'ils peuvent, tout au moins en partie,expliquer quelques conduites de soins. En effet, le mêmeterme cansa est utilisé pour désigner la vaccination apparueavec les premières implantations biomédicales et l'inoculation, dont la pratique est plus ancienne dans la vallée dufleuve. Cette homonymie peut s'expliquer par le caractèreintradermique des deux pratiques, mais également, par lesréactions secondaires qui les accompagnent: comme l'inoculation, la vaccination se pratique sous la peau et s'accompagne de manifestations fébriles. Dans les discours populaires, on en déduit qu'un vrai vaccin doit être intradermiqueet donner lieu à des réactions secondaires. A l'opposé, le vaccin antipoliomyélite étant oral et ne donnant lieu à aucuneréaction secondaire, n'est donc pas cansa 21 .
19 Peut être faudrait il VOIr, dans cette transactIOn, une applicatIOn d'unerègle des soins traditionnels selon laquelle un médicament ne peut êtredonné gratuitement et le bénéficiaire doit faire un geste, au moins symbolique envers le donneur.
20 Pour une histoire de l'introductIOn de l'inoculation antivariolique enEurope, voir Vigarello (1999) ; pour un bref aperçu de cette histoire enMrique, voir M'Bokolo (1984 : 184 J.
21 En décembre 1998, une équipe de supervision des Journées Nationalesde Vaccination contre la poliomyélite s'est rendue dans un village del'arrondissement de Kollo et a demandé les nouvelles de l'éqUIpe de vaccination aux villageois. Ces derniers répondirent qu'ils n'ont pas vul'équipe en questIOn, mais plutôt des gens qui mettaient des gouttesd'eau dans la bouche des enfants. De leur point de vue, ceci n'était pasune vaccination.
La gestion locale des épidémies dans la vallée du fleuve Niger 307
Cette valorisation de la voie intradennique s'appliqueaussi à l'injection (pikir), qui est nettement préférée aux traitements utilisant des comprimés (kiniJ22. Autrement dit, lecomprimé est à l'injection ce que le vaccin antipoliomyéliteoral est à la vaccination intradennique. La valorisation de lavoie intradermique s'explique par l'efficacité supposée plusgrande de ce « qui entre dans le corps ». Il faut, en effet, quela maladie censée se camoufler dans le corps, soit « atteinte })par le médicament. Or, pour que le comprimé puisse produire l'effet recherché, il faut qu'il se dissolve, se diffuse dans lecorps, puis localise la maladie et agisse sur elle. Un tel processus semble lent et compliqué. Dans le meilleur des cas,cet effet pourrait être retardé; dans le pire des cas, le comprimé absorbé pourrait être évacué par les selles avantmême d'avoir « attaqué" la maladie. Bref, si, aux yeux despopulations, le comprimé ne présente pas de garantie solide,en revanche, l'injection assure « l'acheminement}) direct duremède dans l'organisme. Dans le cas des produits antipaludéens comme le quinimax, l'intense douleur qui accompagnel'injection, apporte encore plus de crédit au traitement.Comme la vaccination, l'injection serait donc, tout au moinsen partie23, décodée à travers les caractéristiques généralesde l'inoculation antivariolique, modèle d'efficacité en matièrede soins de santé.
Conclusion
Cette brève présentation des conceptions et du dispositif local de lutte contre les épidémies appelle quelquesremarques.
Tout d'abord, le dispositif local de prévention est« souple}) et pragmatique. En effet, il intègre divers éléments exogènes (pratiques maraboutiques, inoculation antivariolique, quarantaine) dès lors que ces pratiques apparais-
22 Cette appellatIOn vient du français « quinine ". On voit, ici encore, quela quinine, qui est probablement le premier comprimé connu, sert derepère pour la dénomination de tout autre comprimé.
23 En partie puisque cette préférence pour l'injection se retrouve aussidans d'autres contextes.
308 Les maladies de passage
sent comme bénéfiques. Il élimine aussi, ou sélectionne partiellement, des éléments endogènes comme, par exemple, leru kali afin de « ménager » un islam supposé porteur de nouveaux types de prévention. Dans les deux cas, l'opération estrégie par une volonté d'efficacité. Dans le premier, l'introduction d'éléments exogènes renforce les chances objectives desurvie. Dans le second, la disparition partielle des ru kali estnécessaire à l'introduction de pratiques maraboutiques dontle « pouvoir protecteur ", supérieur ou identique, semble, entous cas, plus « moderne ",
Ensuite, ces représentations n'engagent pas obligatoirement des pratiques qui leur seraient associées. En effet,bien que ses bienfaits soient reconnus24, on note une fortedéperdition de la population pour les antigènes qui nécessitent un rappel, qu'il s'agisse des femmes adultes ou desenfants. Ainsi, par exemple, sur 257 femmes ayant reçu lapremière dose du vaccin antitétanique (VAT1) au dispensaire de Karma (arrondissement de Kollo) en 1991, 103 n'ontpas reçu la seconde dose, soit un taux de déperdition de 40 %(ABC: 1994). Cette déperdition s'explique sans doute fortbanalement par les obligations du quotidien. Et les proposdes mères sont d'ailleurs explicites: « j'avais voyagé ",« j'étais occupée ", « j'étais au champ ". Ces réponsesrecueillies auprès des femmes résidant dans un rayon de 0 à5 kilomètres des centres de santé25 • montrent que les préoccupations domestiques et sociales prennent souvent le passur la vaccination.
Une autre remarque concerne l'extension de la notionde transmission. Elle est certes à l'origine de nombreusesdémarches de préventions prosaïques (inoculation antivariolique et quarantaine). Mais ces connaissances restent secon-
24 Ainsi, dans certains groupes d'éleveurs nomades de Korohane, dansJ'arrondissement de Dakoro (centre du Niger), la vaccination humame aété comprise et acceptée en référence aux bienfaits constatés à la suitedes campagnes répétées de vaccination bovine (Lovel : 1998 : 24) : «
Jes vétérinaires ont vacciné notre bétail bien avant qu'on vaccine leshommes, et nous savons bien que les effets sont bénéfiques ", commente un éleveur.
25 DirectIOn Nationale du Programme EJargi de VaccinatIOn. Enquête dela couverture vaccinale et connaissances, attitudes et pratiques auNiger, 1993 (rapport de présentation J, page 8.
La gestion locale des épidémies dans la vallée du fleuve Niger 309
daires pour ce qui concerne les préventions magico-religieuses (rites préislamiques et pratiques maraboutiques) oùla transmission inclut d'autres notions et modalités commeun « héritage pathogène ", des attaques de génies ou del'agression en sorcellerie26. Globalement, la transmission ausens médical correspond plutôt à une logique de la nomination qui vise à « identifier des symptômes en tant que maladie ", donc à leur donner un nom de maladie, un nom commun, celui d'une entité nosologique populaire 27 . Enrevanche, les préventions magico-religieuses, correspondentplutôt à une logique de l'imputation qui se préoccupe, avanttout, d'identifier les agents humains ou surnaturels responsables de la maladie. Soulignons cependant que face à unemaladie ce sont les deux systèmes d'interprétation qui sontle plus souvent convoqués, l'un parce qu'il apparaît efficace,l'autre parce qu'il fournit une explication et un sens, nonseulement à la maladie mais aussi à tout autre événementsocial.
Ce dispositif, caractérisé par « l'hégémonie » des entités magico-religieuses, n'exclut donc pas pour autant lesstructures de santé. D'une certaine manière, on peut mêmeaffirmer que la lutte contre les épidémies est l'un des lieuxoù le rapport des populations à la médecine paraît globalement positif. Mais, outre les données culturelles que nousvenons d'évoquer, d'autres paramètres sont à prendre encompte. Il s'agit principalement des attitudes du personnelde santé. C'est de ces conduites - modalités d'accueil, explications fournies aux patients, etc. - que dépend en grandepartie l'accès des populations aux services de santé en général et à la vaccination en particulier. C'est pourquoi, une descontributions des sciences sociales à l'amélioration de la couverture vaccinale consiste à étudier les interactions entre lesagents de santé et les populations à l'occasion des prestations de soins, qu'il s'agisse des soins curatifs ou des soinspréventifs.
26 Nous renvoyons ici à toute la première partie de l'ouvrage sur la description de ces notions.
27 Jean-Pierre Olivier de Sardan (1994 : 39).
310
Bibliographie
Les maladies de passage
ABC (Association pour le Bien-être Collectif et l'Ecologie)1994 Monographie de Boubon-Karma, vol. II, rapport final.
DNPEV (Direction Nationale du Programme Elargi de Vaccination)1993 Enquête de la couverture vaccinale et connaissances, atti
tudes et pratiques au Niger.
Fassin D.1986 " "La bonne mère" : pratiques urbaines et rurales de la
rougeole chez les femmes Haalpulaaren du Sénégal ", inSocial Science and Medecine, vol 23, nO 11 : 1121-1129.
Lovel N.1998 Evaluation du programme élargi de vaccination, Niamey,
rapport de mission UNECIA, Sheffiel, Royaume Uni.
M'bokolo E.1984 " Histoire et maladie ", in Le sens du mal: anthropologie,
histoire et sociologie de la maladie, sous la dir. Herzlich C.et Auge M., Paris, Editions des archives contemporaines:155-186.
Olivier de Sardan J.-P.1982 Concepts et conceptions Songhay-Zarma: culture, histoire,
société, Paris, Nubia.1984 Les sociétés songhay-zarma {Niger-Mali} : chefs, guerriers,
esclaves, paysans, Paris, Karthala .1994 « La logique de la nomination: représentations prosaiques
de deux maladies au Niger ", in Sciences Sociales et santé,vol. XII, N°3, Paris, John Libbey :15-45.
Salifou A.1977 Colonisation et populations indigènes au Niger, Thèse de
Doctorat d'État, Université de Paris-Panthéon.
Vigarello G.1998 « Inoculer pour protéger ", in Communications n° 66, sous
la dir. de Cheyronnaud J., Roussin P. et Vigarello G.,Paris, Seuil: 65-73.
Chapitre 13
Prévention et contagion desmaladies animales en milieu peul
Frédéric Le Marcis
Situé au Mali, au nord de Mopti, le Delta intérieur duNiger est une vaste plaine qui subit pendant près de six moisla crue spectaculaire du fleuve du même nom. Pendantl'hivernage, l'eau empêche tout transport terrestre et noie lespâturages. Si l'inondation est bénéfique à la productionhalieutique, elle favorise également le développement denombreux moustiques 1. Quand la saison sèche revient, l'eause retire découvrant de riches pâturages.
Cet environnement particulier a permis le développement de trois activités principales, la pêche, l'élevage etl'agriculture.
Les Peuls, dont la notion de contagion nous intéresseici, ont développé dans cet écosystème un modèle particulierd'exploitation des ressources: l'élevage transhumant. Ilconsiste à mener les animaux hors du Delta intérieur duNiger en saison des pluies et à revenir après la décrue2.
Ainsi les jeunes bergers, parfois avec leurs femmes, accompagnent les troupeaux pendant ce déplacement qui dure envi-
1 Le pullulement des moustiques a une incidence sur la production decertains discours étiologiques en milieu peul.
2 Pour plus d'informations sur le système de transhumance, nous renvoyons à Gallais (1967) et Legrosse (1997) ; sur la production halieutique dans le Delta et ses différentes populations voir Gallais (op. cit.)et Fay (1993 et 1995).
312 Les maladies de passage
ron six mois. Les autres villageois attendent sur place leretour des troupeaux, avec quelques vaches laitières auprèsd'eux afin d'assurer une production minimale de lait.
En abordant la notion de contagion dans ce milieu,nous souhaitons illustrer comment diverses interprétationset conduites prennent place dans une société inscrite dansune écologie particulière3 . De nombreuses modalités decontagion sont connues, ainsi que diverses formes de prévention. Souvent elles sont communes à d'autres populationsouest-africaines (comme le fait de vacciner contre la varioleou de recouvrir un enfant atteint de rougeole avec une couverture pour éviter que la maladie ne se propage avec levent). Nous nous intéresserons plus particulièrement à unemaladie spécifique du milieu pastoral: ka dow ka Oit. : ce quiest dessus) assimilée à la « maladie du charbon» par certainsauteurs comme on le verra plus loin. A partir de cette maladie contagieuse du bétail, transmissible aux hommes, nousverrons le rôle que joue le rapport à la production pastoraledans la répartition des connaissances de la contagion. Lestechniques de prévention subiront le même examen.
En nous intéressant à une maladie simple, ou « prosaïque » (Olivier de Sardan 1994) telle que ka dow ka nousdéfendons l'idée que du point de vue de l'anthropologie de lamaladie, les pratiques quotidiennes en disent aussi long surla société qu'un processus thérapeutique lourd. En analysantnos données sur ka dow ka, on verra qu'elles relèvent nonseulement du champ d'étude de la santé mais aussi del'anthropologie sociale au sens large dans la mesure où ellessont emblématiques de catégories identitaires. Ainsi pour lasociété peule, le troupeau et ses dérivés (lait, viande) jouentun rôle particulier dans la production de ces catégories, cartous les membres de cette société n'entretiennent pas avecces produits un même rapport de contiguïté.
3 Les données présentées ici ont été recueillies lors d'enquêtes menées auMali au nord de Mopti de septembre 1995 à juillet 1997. Financées parl'IRD, ces enquêtes n'auraient pu avoir lieu sans le soutien de DorisBonnet (IRD), Yanmck Jaffré (université de médecine de Bamako),Thiambal Simbé (avec qui j'ai travaillé sur le terrain) et sans l'accueildes populations visitées. Que tous soient ici remerciés.
Prévention et contagion des maiadies animales en milieu peul 313
Après avoir exploré le lexique de la contagion en fulfulde, on prendra quelques exemples issus de données de terrain pour tenter de cerner certaines de ces conduites « auquotidien» et leurs conséquences en termes de catégoriesidentitaires.
Mise au point lexicologique
La maladie en fulfulde
En fulfulde, parler peul du Maasina 4 , deux termesexpriment de manière générique la notion de maladie: fiaw a(pluriel fiawji IÛ) et naawalla a (plu: naawallaaji IÛ). Si leterme fiaw a a le sens général de maladie, le terme naawallaa introduit l'idée de douleur (par le radical naaw). Parfois leterme « maladie» est suivi d'un qualificatif, donnant uneidée de la gravité de la maladie en question: « fiaw saata »(maladie mortelle) terme notamment utilisé à propos dusida. Ce terme peut aussi être suivi d'une localisation corporelle, indiquant l'endroit du corps où le mal se déclare. Ainsi,« fiaw duhal » (maladie de la ceinture) désigne pudiquementles affections vénériennes. Le terme « maladie » peut aussiêtre qualifié en fonction de sa cause. On rencontre parexemple l'expression « fiaw jinne » qui désigne toute maladiedont l'origine est attribuée aux génies.
Il arrive aussi que la maladie soit plus précisémentidentifiée et nommée. Elle occupe alors la fonction de sujetde l'action comme dans l'expression: « le rhume m'a pris»(durma nanngi kamJ. Un autre mode de désignation utilisela métaphore. Ainsi le sida est-il parfois désigné par le termeliccal ngal : le grand chiffon sans valeur, terme qui rappellel'état physique du malade (voir aussi infra ka daw ka).
L'identification du mal passe par sa nomination.Cependant la reconnaissance de l'affection ne garantit pas saguérison. L'échec d'une thérapie (aussi bien celle de la biomédecine que celle des guérisseurs, toutes traditions confon-
4 Le terme Maasma désigne, au sens large, le Delta intérieur du Niger.
314 Les maladies de passage
dues), suivie de la mort du malade est parfois acceptée avecrésignation sur le mode de «jate makko wari » qui signifie« l'heure de son compte est venue » (le moment de son jugement). Aussi certains estiment qu'il est vain de lutter contreune maladie si Dieu a décidé de la mort du malade. L'idéeselon laquelle la décision ultime de la survie ou du décès dumalade appartient à Dieu joue un rôle non négligeable dansl'appréciation de l'importance de la contagion. On verra, eneffet, que la connaissance d'un mécanisme de contagionn'empêche pas la prise de risque. La décision d'ignorer lerisque et de passer outre la possibilité d'être contaminé provient d'une « triangulation » entre le risque su, le plaisir queprocure l'action risquée, et la conscience de son rapport avecDieu (proximité ou non du jour du jugement) ou plus simplement de la confiance en son ndeenaagu (sécurité, protection).Ainsi, comprendre « la contagion» implique d'en définir lestermes mais aussi de l'analyser à travers des conduites complexes.
La contagion en fulfulde
Le terme désignant la contagion-contamination présent dans notre corpus est raafJu ngu. Osborn & al. (1993)donnent pour la région du Maasina : raafJo ngo, ndaafJungungu. On rencontre également le verbe raafJude ou raafJoyde(cf. explication infra) : contaminer. Osborn et al. (1993)signalent aussi raafJondirde ou raafJondirgol : se contaminermutuellement. Les verbes « prendre» ou « avoir» sont également usités, selon la même logique qu'en français. On dit parexemple: la maladie a pris untel, ou bien: untel a eu lamaladie avec tel autre.
A propos des maladies vénériennes ou du sida, on ditque la maladie s'obtient chez quelqu'un d'autre qui, dès lors,est stigmatisé. On relève ainsi, concernant le sida, des occurrences telle que: « il l'a eu avec une femme» (propos d'unmarabout à propos d'un homme revenu malade de Côted'Ivoire).
Parlant d'une maladie vénérienne, fieeru, un vendeurde préservatifs explique qu'un homme peut attraper unemaladie avec une femme puis la transmettre à une autre
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 315
femme. Il dit : « gorko oodu raafJan debbo gO/lo » (l'hommeaussi contaminera une autre femme). Dans ces deux cas, lacontagion passe par le contact sexuel entre deux individus:un donneur, un receveur. Le donneur n'est pas forcémentconscient de donner une maladie à son partenaire. Ce qui eststigmatisé chez lui ce n'est pas son inconscience mais sesmauvaises mœurs. On l'a vu, l'homme comme la femme peuvent contaminer quelqu'un. Il faut néanmoins noter que lesfemmes sont plus couramment accusées de transmettre desmaladies vénériennes, au point que l'on désigne parfois cesmaladies comme des « maladies de femmes» (naw rewfJe).
Pour d'autres types de maladie, c'est le mal lui-mêmequi est incriminé. On dit qu'il s'échange, qu'il prend les gens.Ces maladies ne se contractent pas par contact physiquedirect mais plus insidieusement par la proximité d'un malade avec une personne saine. C'est le cas de suna, maladieaussi appelée tekko et généralement traduite en français par« coqueluche ". Un vieil éleveur Baaja5 de statut noble (dimo)rencontré dans son campement en brousse explique à proposde suna :
Cela s'échange [ana wattaJ pour prendre l'êtrehumain, pour prendre l'enfant. Cela contamine [anaraafJaJ. Cette maladie, elle est vraiment contagieuse.
Sa fille, présente lors de l'entretien, complète:
Si l'enfant tousse et qu'il crache, si un autre enfantpasse par-dessus, il sera contaminé. S'il boit les restes del'enfant, il sera aussi contaminé.
On constate à travers ces exemples que le radical raafJrenvoie autant à l'idée de contagion, qu'à celle de contamination. Une maladie est dite « contaminatrice » ou contagieuse,lorsqu'elle se transmet d'un individu à un autre par l'intermédiaire de ses crachats, de son odeur ou de sa sueur. Ellel'est aussi lorsqu'elle se transmet par contact direct, lors derapports sexuels par exemple.
'5 Le terme BaaJa est une forme raccourcie du nom Baajankoojo (plu'BaajankoofJe), Il désigne de manière général les groupes peuls originaIres des terres sèches qui bordent le Maasina mais qui y pénètrentavec leurs troupeaux pendant la décrue (Cf. Legrosse 1999 : 241),
316 Les maladies de passage
Ces conceptions de la contagion ainsi que quelques pratiques de prévention ont été décrites pour l'ensemble dumonde peul (Mc Corkle & Mathias-Mundy 1992). Cet article, àla bibliographie fournie, recense à partir de la littérature existante, les pratiques vétérinaires « traditionnelles» en Mriqueou « ethnoveterinary medicine ». Les auteurs rendent comptede notions similaires de contagion dans plusieurs sociétés pastorales africaines (ibid. : 60) rapportées par Bonfiglioli & al.(1988) à propos des Peul au Sénégal, et par A. B. Maliki (1981)pour les exemples provenant du Niger (Wodaaf3e).
Le même terme raaf3- est employé pour d'autres formesde contagion. On parle de contagion dans le cadre de maladietransmise par le lait d'une vache à un individu ou d'une mèreà son enfant (cf. infra meegaasi et mulla). L'homme peut doncêtre contaminé par l'animal (l'inverse n'a pas été observé).
Afin de ne pas uniquement nous limiter à une définition des termes, nous prendrons exemple sur une nosologieprécise: ko dow ko. Nous en décrirons la sémiologie et lesétiologies locales, mais surtout tenterons de montrer comment cette pathologie renvoie aux préoccupations les plusquotidiennes de cette population: la gestion du troupeau.
L'exemple de ko dow ko
Littéralement, l'expression ko dow ko signifie « ce quiest dessus ». Il s'agit d'une maladie6 répandue dans leMaasina. Elle se manifeste autant chez les animaux que
6 Ka dow ka, généralement traduit en français par charbon (ou anthrax),est une maladie d'abord vétérinaire, mais qui peut se transmettre àl'homme Le bétail la contracte en mangeant de l'herbe infestée par laspore du charbon. Celle-ci pénètre dans le sang de l'animal à la faveurd'une lésion buccale et s'y développe. Il peut décimer tout un troupeauen quelques Jours Les hommes sont contaminés par contact avec ladépouille des animaux ou par ingestion de leur viande. C'est une maladie dont l'issue n'est pas forcément mortelle pour l'être humain. Elle setraduit dans un premier temps par la formation d'une pustule sur lalésion par laquelle la spore est entrée. Chez les animaux, la mort estrapide et inévitable (sauf par la vaccination). Le charbon se développedans le sang et le noircit. Un œdème sanguinolent du pharynx se développe. Le charbon résIste longtemps après la mort de l'animal. Il infestele sol du pâturage comme les restes de l'animal...
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 317
chez les hommes et est réputée pour sa contagiosité. Lagrande quantité de termes d'évitement la désignanttémoigne aussi bien de sa fréquence que de la crainte qu'elleinspire. Dans notre corpus, on l'appelle aussi « ko sowa ko »,
littéralement « ce dont on parle par métaphore ». Un groupede Peuls originaires de l'est du Delta central du Niger(BaajankoofJeJ connaît cette maladie sous le nom de dUJ-lJ-le.D'après Osborn et al. (1993), ce terme désigne parfois lecharbon, parfois la péripneumonie. Il s'agit probablement devariantes dialectales de parlers du Delta central. Osborn etal. (1993) donnent d'autres termes que je cite pour information. Ces termes sont traduits mais pas explicités par lesauteurs. Il s'agit de fJoolol, pettu, cowaaJ-le, koyngel et pittel.Ils traduisent tous ces termes par anthrax, charbon.Précisons cependant que cowaaJ-le et sowa partagent le mêmeradical sow- qui désigne le fait de parler au figuré, par métaphore (standard de la politesse en milieu peul, et pratiquecourante qui consiste à éviter de nommer directement unmal qui est craint). Le sens littéral de koyngel est « la petitepatte ». Il s'agit du diminutif du nom koyngal ngal : la patte.Retenons que la patte est un des endroits du corps de l'animal où se manifeste la maladie.
L'origine de la maladie
Si la maladie est bien nommée, son origine ne semblepas connue de tous. Seuls quelques éleveurs avec qui le sujeta été abordé ont pu donner une explication quant à la causepremière du mal. Par contre le savoir à propos de la contagion ou des soins est largement partagé, et l'ensemble desinformateurs est prolixe sur ce sujet.
Trois explications différentes ont été recueillies à propos de l'origine de la maladie, dont deux par la même personne, lors du même entretien. Ces trois versions, si ellesvarient, reposent sur le même mode d'appréciation de la réalité écologique. A une situation écologique donnée correspondent des pathologies spécifiques. Ce lien entre réalité écologique et pathologie dépasse le simple cadre de l'élevage etconstitue un modèle récurrent d'interprétation du mal enmilieu peul.
318 Les maladies de passage
La première version émane d'un Peul dimo (de statutnoble), ancien berger et riche propriétaire de bovin à la réputation de grande connaissance des maladies. On peut la résumer ainsi: au moment de la saison sèche, après la pluiequand il fait très chaud, les animaux mangent les feuillesd'un arbre qu'on appelle pattuki (acacia senegal). Si les animaux mangent ces feuilles en grande quantité, de la graisse(fJellere nde) se forme dans leur ventre. Alors la maladie lesprend. S'ils meurent, toute personne qui cuit la viande et lamange, tombe malade. La nature morbide de cette viande estexprimée par la qualité qu'on lui reconnaît: on dit d'ellequ'elle est « chaude ».
La deuxième version, qui émane du même interlocuteur, peut se résumer ainsi: lorsque vient yawnde (saison dela chaleur après la saison des pluies), les moustiques sontnombreux et les habitants du Delta sont beaucoup piqués. Cesont ces nombreuses piqûres qui provoquent la maladie.
Cette interprétation de la cause de la maladie reposesur l'idée, assez répandue dans le Maasina, que les moustiques quand ils piquent donnent du sang plutôt qu'ils n'enprennent, ce qui explique les boutons. Ce sang « déposé» estdu sang mort qui empêche le bon sang de circuler dans lecorps. La bonne circulation du sang dans le corps est un critère de bonne santé et sa stagnation est crainte. Bon nombrede saignées pratiquées ont pour objectif d'évacuer le sang« mort» qui ne circule plus et obstrue le passage du sang.Les foulures, et les coups provoquant des enflures, sont doncsoignés par des saignées suivies d'incantations « crachées»sur la plaie. L'observation des caillots formés par le sang coagulé confirme a posteriori la nécessité de la saignée.
La troisième version nous vient d'un interlocuteur différent qui, comme le précédent, est éleveur. Cependant il viten brousse et n'est pas crédité d'une réputation spécifique deguérisseur, son savoir est celui d'un berger. Il explique que lamaladie prend les animaux surtout lorsqu'ils paissent l'herbenouvelle pendant le korsol (courte période des premièrespluies entre la saison sèche: ceeflu et la véritable saison despluies: ndunngu) ou lorsque pendant la même saison, lesanimaux boivent de l'eau de mauvaise qualité dans desmares nouvellement apparues.
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 319
Ko dow ko est liée, dans l'interprétation qu'en font leséleveurs, à l'appréciation d'une réalité climatologique donnée. Dans un cas, avec les premières pluies, le sol serecouvre de nouvelles pousses que consomment les animauxet qui les rendent malades. On retrouve ce principe d'appréciation du climat (au sens large) en fonction de ses conséquences pathogènes notamment chez les migrants de retourde Côte d'Ivoire. Ils incriminent souvent la fraîcheur de la« forêt » et le changement d'alimentation comme source deleur mauvais état de santé pendant leur migration. L'originede la méningite (joorngal ngal : lit. la grande sèche) est également associée dans le Maasina aux conditions climatiques.Elle apparaît pendant la saison sèche, période où les ventsde poussière sont fréquents, vents de poussière qui sontreconnus comme les vecteurs de la méningite.
Dans l'autre cas, l'inondation du Delta est en cause.Elle provoque l'infestation de la zone par les moustiques.Cette inondation provoque un changement radical dans legenre de vie, aussi bien dans l'alimentation (on consommemoins de lait car les animaux sont remontés vers le nord,dans le Mema), que dans la vie sociale (les visites sont raresà cause d'une communication difficile7). Le soir des nuées demoustiques investissent les campements et les villages aupoint que dans certaines régions, les bovins sont abrités lanuit dans des huttes enfumées afin de leur éviter de tropnombreuses piqûres.
A n'en pas douter, le discours assez original mettanten scène le moustique comme vecteur d'une maladie doit êtreentendu comme l'écho de messages de vulgarisation à proposdu paludisme. Ce type « d'interférence» de représentationsest courant (Jaffré 1990) et nous l'avons aussi observé. On
7 La visite à sa parentèle joue un rôle important dans l'affermissementdes liens Iignagers. Elle permet l'échange de nouvelles (naissances,décès. état des pâturages) mais favorise également la préparationd'alliances matrimoniales ou pohtiques... Il existe un terme en fulfuldepour désigner ces visites: sonude. Osborn (1993) propose la traductionsuivante: « serrer les hens de parenté par des visites fréquentes. " Onretrouve la même idée en milieu peul de Guinée !Fuuta Jaloo), on y diten effet que la parenté repose dans les talons (talons qUI permettent derendre visite à ses parents). La période d'inondation, en rendant lesvoyages difficiles, ralentit donc pour un temps ces visites.
320 Les maladies de passage
peut parler d'interférences car il n'y a pas « table rase " faitede représentations anciennes. Les deux coexistent, animéespar la même logique: dans le cas de l'alimentation, la graissequi se forme entrave la bonne circulation du sang. Le sangmort stagne et provoque la maladie. Dans le cas des moustiques, le sang mort déposé par le moustique joue le mêmerôle que la graisse ... Bref, les contenus changent alors queles modalités interprétatives à partir de la notion de sangmort restent stables.
Cette représentation d'une action pathogène de lagraisse ou du mauvais sang est partagée par les Touareg, demême que l'explication du charbon (Bernus 1969; 130) : « Lecharbon est contagieux C.. ). Les Touaregs pensent qu'ovinset caprins en sont atteints lorsqu'ils se sont couchés sur dusable humide, ou lorsqu'ils ont mangé en grande quantité lefruit du tamat (acacia flaua) ou du tiggart (acacia arabica).On fait des scarifications au bout de la queue, du nez et desoreilles, pour faire couler le sang ".
Ce discours sur l'origine de ko dow ko relevé auprèsd'éleveurs atteste d'une spécialisation professionnelle qui participe explicitement à la constitution d'un savoir particulier.Les activités quotidiennes, liées aux rôles culturellementattribués aux individus ou à leurs expériences, participent àl'émergence de « savoirs impliqués ". Ces savoirs en effet seconstituent en rapport avec les activités ou les intérêts quotidiens des individus: mère veillant sur son enfant, berger surson troupeau, personne infectée se soignant ... Lire les discours sur la maladie à la manière de Byron J. Good (1994 ;172), c'est-à-dire y rechercher ses multiples voies, ses dialogues internes (heteroglossia), permet de comprendre larépartition des rôles dans la société. On découvre ainsi à partir de l'étude conjointe du discours et de son contexte d'énonciation les rapports inégalitaires structurant la société.
Découvrir un sens dépassant la simple sphère de lasanté à travers le discours sur des maladies courantes comporte un intérêt qui concerne la construction même de l'objet« maladie " en anthropologie : cela le déplace. En effet, lesétudes sur la sorcellerie et la transe, telles que Augé (1975) etZempleni (1962) les ont respectivement menées (pour l'anthropologie francophone) ont permis le dévoilement de tensions
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 321
sociales dépassant le champ de la santé, et constituent unexemple saisissant de la démarche anthropologique appliquéeà la maladie. Cependant l'anthropologue s'intéressant principalement à ces manifestations risque de « sur-construire » leréel et d'en donner une image par trop accentuée. Ainsi, préférer la sphère plus quotidienne de la maladie à ses manifestations les plus éclatantes, c'est donner une vision peut-être plusfade mais plus juste de la réalité d'une société.
Dans le cas de la société peule du Maasina, Ko dow kopermet d'expérimenter cette démarche. A travers le discourssur l'origine de la maladie, on a vu d'une part que les Peulproduisent un discours écologiquement centré, une lectureparticulière de leur environnement. D'autre part, on aconstaté des disparités dans la profondeur et l'étendue dusavoir, ces variations jouent autant sur les causes connuesque sur les mécanismes de contagion, les soins et la prévention (cf. infra). C'est un truisme de dire que l'appartenance àune société ne suppose pas forcément une connaissance partagée par tous de manière équivalente. Mais cela mérited'être répété pour la société peule. Aussi l'appartenance àune société à vocation essentiellement (mais parfois surtoutidéologiquement) pastorale ne fait pas pour autant de tousles Peul des spécialistes des questions relatives à la conduited'un troupeau. Le discours plus développé des hommes surles causes de la maladie témoigne d'un partage des tâchesquotidiennes par genre. Dans le Delta intérieur du Niger, leshommes dominent largement l'élevage. Ils s'occupent demener les bêtes aux pâturages et de les traire. Ils prennentaussi en charge les animaux de leurs femmes, parfois deleurs sœurs. Ils ne peuvent vendre leurs animaux sans leuraccord, mais peuvent refuser de les vendre, alors qu'elles ledemandent. La maîtrise des femmes sur leurs animauxdépend pour partie de leur place dans le lignage8.
8 On a pu observer par exemple le cas d'une vieille femme malade, divorcée, sans fils et dont les deux gendres étaient en transhumance qui s'estvu refuser par ses frères la vente de ses animaux alors qu'elle déSIraitfinancer un séjour à l'hôpltal. .. Elle n'avait pas de garçons pour défendreses intérêts et ses frères en refusant de s'exécuter protégeaient un capital dont ils pouvaient espérer hériter un jour. Pour plus d'informationssur ce sujet dans le monde peul,nous renvoyons à Dupire (1970 l.
322 Les maladies de passage
Dans ces conditions, le contact des femmes avec letroupeau passe essentiellement par la transformation ou lavente du lait qu'elles reçoivent une fois que le partage duproduit de la traite est effectué par les hommes. Ainsi, lecontact exclusif des hommes avec les animaux favorise chezeux une connaissance plus approfondie de l'origine de lamaladie dans le troupeau que chez les femmes. Par contre,les mécanismes de contagion font l'objet de savoirs étenduschez les femmes quand ils concernent leur sphère d'activitéquotidienne: la vie de la famille dans la concession, l'entretien de la maison, les soins des enfants, l'alimentation...
Ces différents savoirs ont cependant une armaturecommune. Jean-Pierre Olivier de Sardan (1994 ; 32) définissant ce qu'il appelle une entité nosologique populaire parled'une « configuration de représentations fluides ». Dans le casde ka dow ka on est aussi en présence d'une configuration dereprésentations fluides. L'étude des variations de ces représentations, du fluide, nous informe sur la position du locuteurdans le rapport de production pastorale et plus généralementsur son statut social. Les informations reproduites ici émanent majoritairement d'hommes et de femmes rimfJe (nobles)dont l'activité de référence est l'élevage9 mais pas exclusivement puisque des femmes de statut casté ou d'origine servileont été interrogées. Cette répartition particulière du savoir deka dow ka dans la société, en fonction des genres et des statuts rappelle une division statutaire des tâches dans laquellel'élevage est l'activité de référence des nobles et l'agriculturecelle des descendants de captifs. Ce résultat est bien une production du terrain et pas une « surconstruction » ethnologiquea posteriori. On pourrait objecter au vu de tels résultats qu'ilsuffit à l'ethnographe de n'interroger que des nobles pour présenter un savoir qui serait spécifique aux nobles. Retenir unetelle objection serait oublier l'importance de la légitimité dansl'acte de parole et particulièrement dans la production desavoir: le savoir pour s'énoncer doit être légitime.
9 Nous ne pouvons développer ici les questions d'identité des pôles rim(3e(nobles) et rWla.v(3e (descendants de captifsl. On se contente d'indiquerune activité de référence, qUI souvent relève plus de l'idéologie que de laréalité. Nombre de nm(3e cultivent la terre, comme les nmay(3e élèventdes bœufs.
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 323
Ainsi l'enfant ou l'élève d'un guérisseur, même initié,ne pratique ni n'énonce son savoir si son maître est encorevivant et est en mesure de répondre ou d'agir par lui-même.De la même façon, un individu descendant de captifs, dontl'identité repose sur une idéologie le rattachant à deux activités de références que sont l'agriculture et la pêche collective,ne détient en général pas la légitimité l'autorisant à produireun discours « savant" sur un sujet ayant trait à l'élevage(même si éventuellement le savoir en question ne lui est pasétranger). Cela se vérifie également pour les classes supérieures de la société au sujet d'autres savoirs, tels que lachasse ou certaines pratiques thérapeutiques. Il est vraicependant qu'il s'agit souvent de savoirs qui ne sont passocialement valorisés.
La sémiologie de la maladie chez l'homme et l'animal
Chez l'homme, la maladie se développe à partir d'uneconcentration de chair ou de graisse (le bouton « tire » lachair). Le sang se concentre à cet endroit et devient du pus.Le bouton qui apparaît provoque une démangeaison. Sil'individu se gratte, le bouton enfle. Sur le bétail, la maladiese déclare d'abord sous la forme d'un abcès (uure ndeJ. Lecorps chauffe à l'endroit de la plaie. Certains animaux survivent, d'autres non. Cela peut prendre l'animal subitementdurant la nuit. Le berger le retrouve mort au petit matin, lecorps enflé, alors que la veille il semblait en bonne santé.
Certains animaux sur le point de mourir sont égorgésafin de permettre la consommation de la viande. Dans biendes cas, la viande d'un animal malade n'est pas vendue maisconsommée par la famille étendue. Sauf si personne n'a euvent de la maladie, ce qui est rare ... La maladie de l'animaloffre un prétexte pour ne pas acheter de viande au propriétaire malchanceux mais n'interdit pas sa consommation euégard au nombre de personnes venant lui en quémander. Onpeut, en résumé, citer un extrait d'entretien mené avec unéleveur sur la cause de la maladie:
Certains s'ils sont pris le soir, ils ne passent pas la nuitcar la plaie est très mauvaise. D'autres s'ils sont pris, unecloque se forme, que nous appelons « ka daw ka ". Cette
324 Les maladies de passage
cloque ne les fatigue pas du tout. D'autres encore, le boutonenfle, mais ils survivent. Pourtant nous en avons très peur.
Selon nos interlocuteurs, les caractéristiques cardinales de ka daw ka sont donc au nombre de cinq. La premièrecaractéristique de cette maladie est sa réputation d'extrêmecontagiosité. La deuxième concerne sa distribution, elle sedéveloppe aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Sonissue est parfois mortelle et on dit que si un malade survittrois jours, il ne mourra pas. C'est là sa troisième caractéristique. La quatrième concerne le développement le plus fréquent de la maladie, un unique bouton très douloureux seforme sur le pied, le ventre ou dans le cou. Et enfin, le dernier point caractérisant cette maladie consiste en une craintede faire éclater un bouton identifié comme étant ka daw kaen le mettant en contact avec de l'eau.
Cette brève description d'une maladie nous permet depréciser les modes de contagion identifiés par la population.On peut distinguer trois types de contagion de ka daw ka :entre les animaux, de l'animal à l'homme, entre les hommes.
La contagion de l'animal à l'animal
Il existe deux principaux modes de contagion entre lesanimaux. Le premier mode de contagion c'est le contact avecun animal malade : frottements et inhalation de son odeur.Le second mode de contagion repose sur le contact avec lecadavre d'un animal infecté, le lèchement de ses os ou de sapeau. Une jeune femme dima explique:
Il faut qu'il hume! Son odeur entre en lui, cela « prend»rapidement.
Un éleveur dima donne une théorie plus complète:
Si ka daw ka prend une vache et qu'elle meurt surplace. Si d'autres vaches passent près d'elle, cela lesprend ! Ça prend les vaches, ça prend les ânes. Ça prendles moutons, ça prend les chèvres.
Les vaches ne valent rien, elles ne sont pas intelligentes. Si un animal meurt et que restent ses os, lesvaches les lèchent. Elles lèchent les os. La peau aussielles la lèchent, ça les contamine.
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 325
L'éleveur cité ici fait allusion à un comportement quel'on observe lors de la mort d'un animal dans un troupeau:souvent les bovins se rassemblent autour du cadavre, éventuellement à l'endroit du dépeçage et hument le lieu en beuglant d'une façon particulière.
Dans ce dernier extrait d'entretien, l'interlocuteuremploie une forme verbale particulière pour exprimer l'idéede contagion qui mérite d'être explicitée.
A propos de la peau et des os qui sont léchés, il dit« ana raaf30ya » (ça contamine). Cette forme verbale sedécompose ainsi: « ana / raaf3- / -oy- / -a ».
Ana exprime le duratif. L'action dont il est questiondans le radical verbal est en cours de réalisation. (Il s'agit icide la contagion). Raaf3- est un radical qui exprime l'idée decontagion. -oy- est un dérivatif verbal exprimant l'idée quel'action est faite à une certaine distance de l'endroit où setrouve l'agent (cf. Labatut 1994 ; 125). Associé au radicalraaf3-, l'ensemble exprime une idée de contagion à distance.
-a est la marque de l'inaccompli progressif. Dansl'énoncé de notre interlocuteur, la contagion n'est pas encoreacquise, mais elle est en train de se réaliser.
Notre interlocuteur insiste sur le déplacementpuisqu'il n'était pas obligé, d'un point de vue grammatical,d'utiliser le dérivatif -oy-. Il aurait pu dire « ana raaf3a » (çacontamine). D'ailleurs cette construction avec le dérivatifverbal -oy- est loin d'être systématique dans notre corpus. Enl'employant, il insiste sur le déplacement de la maladie ducadavre à l'animal sain.
La décomposition de cette forme verbale permet demieux cerner ce mode de contagion en milieu peul: le passage à distance, le déplacement de la maladie d'un individu àun autre. La traduction en français ne permet pas de traduire le sens de ce dérivatif, à moins d'alourdir le texte (onaurait pu traduire: « cela s'en va le contaminer»).
326
La contagion de l'animal à l'homme
Les maladies de passage
Quand on suppose qu'il y a eu contagion, ce qui n'estpas toujours le casIO, on en distingue deux modes entre lesanimaux et les hommes: l'ingestion de la viande de l'animalatteint et le contact avec son sang.
Après ingestion de la viande contaminée, soit la personne meurt dans la nuit soit elle survit mais souffre d'unecloque, d'une inflammation qui finit par disparaître.
La contamination peut aussi passer par le contact dusang de l'animal avec la peau de l'individu. Cette modalitéapparaît une fois dans notre corpus (entretien avec un éleveurspécialisé) comme étant une action contaminante. Pour enêtre victime, il suffit de porter sur la tête la peau de l'animalégorgé. Un éleveur dimo définit en ces termes la contagion:
Et bien, cela se passe quand les gens mangent.Certains individus sont pris car ils ont mangé la viandede l'animal malade. C.. ) Pour qu'un homme soit contaminé, il faut qu'il mange la viande ou qu'en égorgeant l'animal, son sang se colle sur lui, ou bien encore qu'il transporte sur sa tête la peau de l'animal. Mis à part ces troiscas, elle n'est pas contagieuse.
Un autre éleveur dimo explique:
Il faut manger la viande pour être pris. Dans ce casc'est plus rapide [la contagion]. Certains ne prennent pasdu tout de viande mais sont pris quand même.
A propos du contact avec le sang, un éleveur dimonous précise qu'il faut que le « sang chaud » de l'animal entreen contact avec une plaie du berger pour le contaminer. Unsecond complète:
Là où tu le dépèces, si tu te coupes et si son sang prendton sang, tu meurs en un moment.
Le lait n'a pas été évoqué comme contage de ko dow koentre les animaux et les hommes, alors qu'il l'est dans d'autresmaladies. Dans le cas d'une affection nommée « mulla » ettouchant principalement les femmes allaitantes, le lait mater-
10 La maladie peut apparaître sans qu'I! y ait eu contaglOn. Elle se déclaresImplement sans qu'une autre explication soit recherchée.
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 327
nel est ainsi accusé de rendre malade le bébé. Cette maladie setraduit chez la mère par une dépigmentation des lèvres, unedémangeaison de la poitrine ainsi qu'une altération de la qualité de son lait (il devient de l'eau). La maladie se prolongechez l'enfant encore au sein, par une diarrhée.
Le lait de vache peut jouer un rôle similaire. La maladie nommée « meegaasi » en donne un bon exemple. Il s'agitd'une maladie contagieuse dont l'issue n'est pas fatale. Elleprovoque une forte toux et se manifeste par la présence deboutons sur les poumons de l'animal.
On reconnaît à la viande et à la graisse de l'animalmalade la capacité de transmettre cette maladie à l'homme s'illes consomme. On dit aussi que le lait véhicule la maladie,même s'il est mélangé avec du lait provenant d'une vachesaine. Dans un autre contexte, E. Bernus (1969 ; 116-117)atteste, pour la société touareg, de maladies dues à un laitrendu toxique par de l'herbe trop fraîche, ou au fait que lavache était restée trop longtemps au pâturage sans être traite.
Le lait cependant ne transmet pas que les maladies, iltransmet aussi les qualités des aliments ingérés. Ainsi le laitde chèvre, généralement déprécié à cause de son amertume,et de son goût très prononcé lorsqu'il est caillé, est néanmoins apprécié pour ses qualités médicamenteuses ll (iltransmet les vertus des plantes consommées par les chèvreset maintient donc en bonne santé). Une vieille femme bella12
rencontrée sur notre terrain conseille aux mères dont lesbébés ont la diarrhée de leur faire téter au pis de la chèvre lelait de fin de traite pour les guérir. Un autre moyen d'interrompre la diarrhée de son enfant est donné par une femmejaawanllo13 d'âge moyen. Elle décrit ce qu'on appelle « nona-
11 L'amertume du lait de chèvre est une preuve de ses qualités médicamenteuses: il porte en lui l'amertume des plantes, médicaments parexcellence.
12 Les Bella sont les descendants des captifs des Touareg. Si certainsvivent encore à proximité de leurs anciens maîtres, d'autres s'en sontséparés et vivent en communauté indépendante.
13 LesJaawamf3e (sg. :JaawanJlO 0) appartiennent à la classe des hommeslibres. Ils sont néanmoins d'un statut inférieur aux Peul nobles (rimf3ef3e ; sg. : dlmo 0). Ils Jouent souvent auprès d'eux le rôle de conseillers etde courtiers.
328 Les maladies de passage
gol suka » (faire le fiofiagol à l'enfant). Cela se pratique sil'enfant a la diarrhée et que l'on retrouve dans ses selles despetits brins verts. La mère de l'enfant malade va en brousse,elle cueille des feuilles de sept arbres différents (njammi :tamarinier, njaami : jujubier, gigile : Boscia senegalensis,nammaadi : Bauhinia rufescens, mbarkewi : Piliostigma reticulatum, furduko : non identifiée, kooli : Mitragyna inermis)et les mâche afin d'en exprimer le jus. Elle avale ce jus etrecrache ce qui reste des feuilles. Elle rentre chez elle ensilence, sans répondre aux salutations et va faire téter sonenfant. Le lendemain, l'enfant est guéri14. Dans ce cas, le laittransmet les qualités du médicament ingéré.
Une jeune femme, de statut casté (cordonnier: sakkeejo 0) et soignant le mulla (affection du sein provoquant unedépigmentation de la peau et une altération de la qualité dulait) résume d'une phrase la propriété du lait:
L'enfant qui tète, tout ce qui est dans le sein de sa mèresortira en lui. Si tu manges de la terre, (pratique courantedes femmes enceintes dans la région), si l'enfant a tété, iltétera la terre. S'il vomit aussi, il vomira de la terre.
Constance M. Mc Corkle & Evelyn Mathias-Mundyrappellent aussi la qualité de vecteur du lait à propos detechniques de vaccination des animaux chez les Nuer, lesPeul, les Masaï et les Maures (1992 ; 63). Ceux-ci vaccinentprincipalement par l'inoculation d'une maladie à un animalsain. Dans le cas de la peste bovine (contamination des animaux à partir d'un point d'eau infecté par un animal malade), les éleveurs procèdent par incision de la peau du bovinet insèrent dans la plaie un morceau de poumon infecté.L'urine, les excréments, le lait d'un animal infecté, lesmatières fécales, sont utilisés comme des vaccins contre lapeste bovine.
Alors pourquoi le ko dow ko ne se transmettrait-il paspar le lait? Il semble en fait que la soudaineté de la mort del'animal en cas de ko dow ko ne permette pas la contamination animal-homme par le lait. La bête infectée meurt avant
14 Il existe une autre verSIOn à ce som: la mère va boire dans le village àsept canaris (récipient où l'on conserve l'eau) différents sans parler etretourne fmre téter son enfant.
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 329
qu'elle ne soit traite. C'est ainsi qu'il est possible d'expliquerl'absence de la contagion par le lait dans nos énoncés sur kodow ko.
Les hommes ne sont pas contaminés par l'odeur del'animal mort. Il semble que l'odeur n'est contaminante quepour un être possédant une odeur de même nature. Ainsi lavache saine est contaminée si elle respire l'odeur d'une autrevache. Marguerite Dupire (1985) explique que chez les SereerNdut, le killi (l'odeur) d'un individu malade peut contaminerune personne saine. Dans le monde peul, « l'odeur» d'unmalade atteint de tuberculose est aussi considérée commecontaminante. Celle du linge sale aussi. Ainsi un migrantrevenant malade de Côte d'Ivoire expliquait que son mauvaisétat de santé était dû à l'odeur du linge très sale qu'il lavaità Abidjan pour gagner sa vie.
La contagion de l'homme à l'homme
Concernant le ko dow ko, la notion de contagion quel'on a avec les hommes diffère de celle développée avec lesanimaux. La connaissance d'une contagion possible entre leshommes n'est pas aussi précise et homogène que celle de lacontagion entre animaux ou entre hommes et animaux. Lesavis diffèrent entre une contagion par simple rapprochementd'une personne saine et d'une personne malade (commes'asseoir l'un près de l'autre) et la non-contagion. Le caractère secondaire d'une contagion possible de ko dow ko entre leshommes est confirmé par le fait qu'aucune pratique de prévention n'a été observée pour parer à une telle contamination. Alors que pour les animaux, elles foisonnent.
Soins et préventions
L'usage du terme « prévention ", pour décrire les pratiques observées dans le Maasina est abusif. Pour des lecteurs occidentaux, il fait référence à la santé publique, à uncorps de médecins organisé et hiérarchisé, à des modalitésd'intervention bien établies en fonction des situations et desindividus. Tel n'est pas le cas dans le monde peul. Les pra-
330 Les maladies de passage
tiques que nous venons de présenter ne forment pas unensemble constitué. Elles font référence autant à des techniques qu'à une représentation du monde et du malheur. La« prévention » en milieu peul ne concerne pas la maladie enparticulier mais le malheur en général.
Le terme même de prévention n'existe pas en fulfulde.On peut bien sûr trouver des correspondants, mais cestermes ne sont pas strictement synonymes et font référence àun univers plus large que la santé publique et à des pratiques qui sont plus proches de la gestion de l'aléatoire, de lastratégie de survie que d'une action préventive. La pratiquede l'islam, la recherche de la chance par la bienveillance deDieu et par la conformité aux règles de conduite de l'islam etde la société peule, ainsi que les bénédictions des maraboutssont autant d'actes de prévention.
Les termes qui reflètent le mieux cette réalité sontdonc « ndeenaagu ngu » la protection, la sécurité (y comprisgrâce à des bénédictions ou des charmes magiques), « sakkade » empêcher, prévenir quelque chose ; « haJ.1ude hunnde »
empêcher quelque chose; « faddaade » empêcher magiquement le mal d'entrer.
Dans bien des cas, soins et préventions vont de pair.Ainsi pour ko dow ko, les principes de prévention appliquésau bétail ne le sont que lorsqu'un cas de maladie est observédans le troupeau. On soigne donc l'animal atteint, et on prévient la contagion.
Deux sortes de soins nous ont été relatées. Parmi cessoins, un seul emporte les faveurs des éleveurs: le tupay (enbambara kunbilennin, lit. : petite tête rouge, adapté parfoisen peul sous la forme konbleni). L'usage du tupay est combiné avec la pratique de la saignée. Après avoir incisé uneveine dans le cou de l'animal, on laisse couler le sang puis oninjecte à l'aide d'une piqûre un mélange d'eau et de poudrecontenue dans les gélules de « tupay ».
Chilliot a décrit au Niger l'usage du tupay. Il écrit(1996 : 98-99) : « Un terme spécifique, tupay, est donné àtoute une gamme de gélules provenant du Nigeria et correspondant généralement à des antibiotiques (ainsi nous avonspu relever parmi les tupay des produits de spécialités géné-
Prévention et contagion des maiadies animales en milieu peul 331
raIement anglo-saxons tels que Marcelcap®, Ricodol 500®,Ampicillin®, Tetracyclin®, Indocap® ou IndomethacinR. .. ). »
Dans le cas qui nous intéresse, c'est la Tetracyclin® qui estnommée « tupay ".
L'objectif de la saignée est d'évacuer le mauvais sangaccumulé dans le corps de l'animal. Les éleveurs constatentque le sang qui tombe au sol est noir et épais, preuve de samauvaise qualité (On dit de lui qu'il est très noir ou bienmort ou seulement mauvais) Constance M. Mc Corkle etEvelyn Mathias-Mundy (1992 ; 65) citent Edmond Bernus(1969) et expliquent que les Peul, comme nombre de sociétéspastorales, effectuent des saignées aux animaux pour fairesortir le mauvais sang, le sang noir, le sang mort.
Le fait de faire une saignée n'est pas contradictoireavec l'utilisation de tupay, ce dont ne se privent pas les éleveurs, maximisant ainsi les chances de voir les soins réussir.La quantité de tupay injecté varie en fonction de la taille del'animal, elle peut correspondre à une douzaine de gélules.L'usage vétérinaire du tupay est très répandu en brousse. Onen trouve sur tous les marchés. Il est parfois administré parvoie nasale aux bovins, notamment en cas de morsures deserpents (on vide les gélules dans une théière et on y ajoutede l'eau. Le mélange est ensuite versé dans un naseau del'animal préalablement immobilisé).
En plus de l'usage du tupay, les éleveurs témoignentde l'utilisation de pifJi. Cette pratique semble être en voie dedisparition face à l'efficacité reconnue du tupay. Les pifJi(sing. pifJol) sont des cordelettes sur lesquelles ont fait desnœuds. Ces nœuds servent à « attacher " des incantationspréalablement récitées sur la cordelette. Ils sont fixés sur lesanimaux sains du troupeau pour les protéger de la contagion.Ces pifJi sont confectionnés en raphia. Mis à part les piqûresde tupay et l'usage préventif de pifJi sur les animaux sains,aucune autre thérapie n'a été observée ou recueillie contre leka dow ka, si ce n'est un comportement préventif: l'éloignement. Un berger dima explique ainsi à propos de cette maladie:
Si un animal meurt ici, nous décampons, nous allons ànos affaires. Nous laissons ici le cadavre.
332 Les maladies de passage
Cette pratique d'évitement d'une zone infectée est également relatée par Constance M. Mc Corkle et EvelynMathias-Mundy (1992 ; 67). Elles citent (Bonfiglioli et al.,1988) et expliquent que les bergers laissent de côté les pâturages où des animaux ont souffert d'infections du sabot ou dumuseau. Ils les contournent sous le vent, pour que les bêtesne soient pas contaminées par l'air porteur de la maladie. Ilsempêchent également les animaux de s'approcher des carcasses des animaux morts.
Quand le ko dow ka se déclare chez un être humain,les soins sont assez différents. Par exemple, on n'utilise pasle tupay, on ne scarifie pas (dans le cas du ka dow ka, alorsque par ailleurs c'est une pratique courante, dans le cas defoulures ou de maux de têtes notamment). On applique sur lebouton de la bouse de vache fraîche, de la fiente de poule ouencore du bula bula sur les bords du bouton (( bleu » enpoudre, servant pour la lessive à rendre le blanc éclatant).Cette thérapie doit calmer la démangeaison et « refroidir» lemal. Notons que « refroidir» (traduit littéralement) signifiediminuer l'intensité du mal, rafraîchir lentement la chaleurdu mauvais sang. L'objectif est de ne pas créer de conflitentre très chaud et très froid. C'est pourquoi durant le tempsdes soins, le malade ne doit pas entrer en contact avec l'eau.Cette aversion pour l'eau est la conséquence logique des qualités attribuées respectivement à l'eau et au bouton (causécomme nous l'avons expliqué par le mauvais sang). Le bouton est très chaud, le mauvais sang aussi et l'eau quant àelle est froide. Le contact entre l'eau froide et le boutonchaud ne pourrait qu'être violent. Il est donc prohibé car ilrisque de faire éclater l'inflammation alors que l'objectif dutraitement est de faire poindre doucement le bouton afind'évacuer le mal.
On applique aussi une plante nommée artume15 (nonidentifiée) sur le bouton. Quant à l'emploi du tupay, il n'a pasété signalé pour cette maladie. Par contre l'efficacité du dispensaire (piqûres, comprimés) est reconnue, quand il est
15 Osborn et al (1993) traduisent ce terme par médicament. Nous nesommes pas en mesure d'infirmer ou de confirmer cette traduction qUidevrait être vérifiée sur le terrain.
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 333
accessible ... Les pipi ne sont pas employés à titre préventifsur les êtres humains, mais ils soulagent la douleur lorsquela maladie est déclarée. L'individu porte le pipaI autour ducou, de la cheville ou du poignet, en fonction de l'endroit où lebouton apparaît sur le corps ...
Les pratiques de prévention, comme les soins, pour lebétail sont donc différentes de celles conseillées pour lesêtres humains. Si on peut tirer une certaine expérience deconnaissances thérapeutiques animales, on ne peut mélanger complètement les espèces.
Ainsi, certains modes de transmission ne fonctionnentque du semblable au semblable et la contagion entre deuxêtres de nature différente n'est concevable que selon desmodalités spécifiques. Si une vache et un cadavre de vachecontaminent une autre vache par l'odeur qu'ils dégagent, ilsne contaminent pas l'homme. De la même façon, un tuberculeux contamine un parent si celui-ci passe au-dessus de sescrachats, mais pas les animaux. Pour que la vache contamine l'homme dans le cas de ko dow ka, il faut qu'il ingère saviande ou qu'il entre en contact direct avec le sang de l'animal. La contagion entre les semblables est possible aveccomme vecteurs les émanations du corps, ses traces (sueur,odeur) alors qu'entre les dissemblables il faut un contactdirect non médiatisé avec le corps malade: ingestion d'unepartie du corps, contact avec le sang de l'animal. Il n'est pasinutile de rappeler que nous parlons bien ici de contagion,c'est à dire du passage d'une maladie d'un être vivant à unautre. En effet de nombreuses maladies sont attribuées auxanimaux, mais ils ne sont alors que la cause de la maladie etne sont pas eux-mêmes malades. On accuse la poule parexemple de rendre l'individu épileptique s'il mange dans unplat où elle a picoré et laissé sa bave, on attribue au chat quise frotte contre une femme enceinte la capacité de rendre sonbébé chétif, mais il ne s'agit plus alors de contagion. Dans lecas du chat, le caractère chétif à l'origine duquel il est chezl'enfant, n'est pas considéré chez lui comme une maladiemais comme une qualité constitutive de son être ...
La connaissance de ces mécanismes de contagionsemble assez largement partagée dans la société, pourtant lediscours sur la prévention évolue entre une position normati-
334 Les maladies de passage
ve édictant des règles de conduite et les conduites plus pragmatiques du commun des mortels. Ainsi un vieux peulbadya, convenant que la viande d'un animal atteint de lamaladie ka dow ka est extrêmement contagieuse, expliqueque bien que le sachant, il mange la viande ...
Certains récitent des incantations qu'ils crachent surla viande avant de la consommer (moccol ngol : incantationrécitée en vue de protéger ou de guérir), d'autres conseillentde bien faire griller la viande infectée pour la manger...
Des notions de prévention existent donc à propos de kadow ka. Des pratiques sont connues et expliquées, qui justifient le fait de manger une viande pourtant contaminée.
On peut donc se demander jusqu'à quel point les Peulcroient en leur prévention ? En fait, il est nécessaire de mettrela connaissance des modalités de la contagion en perspectiveavec « l'échelle des valeurs locales ". Reprenons l'exemple de laviande contaminée et de la confiance de l'éleveur en sa technique de prévention. On doit savoir, avant de statuer sur laconfiance aveugle de l'éleveur en sa technique, que dans cettesociété, malgré les idées véhiculées par les étrangers de passagepour qui l'on égorge un mouton ou une chèvre, on ne consommeque très rarement de la viande. Dès lors, le risque représentépar la consommation d'une viande contaminée, est minime comparé au plaisir attendu pour qui se prépare à la manger...
De plus, la connaissance des modalités de la contagionest intimement liée à la perception de l'environnement. Lespratiques décrites précédemment sont limitées dans le tempset à une saison bien définie (la saison chaude). Elles découlentde l'observation de la réalité et de l'expérience issue d'une pratique spécialisée. Cela favorise l'émergence d'un savoir compartimenté. Il repose sur un socle de connaissances communesqui s'enrichit en fonction des activités des individus. Lesmembres d'une société ont la possibilité d'exercer leur librearbitre dans le choix de leurs activités, cependant celui-ci restelargement contraint par l'organisation hiérarchisée de la société (statuts, rapports de genres). Cette situation participe enmilieu peul à une spécialisation des savoirs. Ainsi les hommesont une connaissance plus approfondie des modalités de lacontagion dans le troupeau (dont ils s'occupent), alors que les
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 335
femmes développent un savoir et des pratiques en rapportavec le lait et la maladie que les hommes ignorent parfois. Cesvariations de savoir s'observent aussi entre agriculteurs et éleveurs, Peul urbains et Peul citadins. A travers elles se lit lahiérarchie sociale, les savoirs étant en effet plus ou moinsvalorisés et toujours emblématiques d'un statut social.
Conclusion
L'exemple de ka daw ka autorise quelques remarques.La contagion et de la prévention de ka daw ka , sont connueset des pans de la maladie (son origine première notamment)sont plus développées chez certains individus, en fonction dela répartition des tâches. Dans le Maasina, seuls les hommess'occupent directement des animaux. Ce sont eux qui effectuent la traite au retour des pâturages. D'autres sociétéspeules confient la traite des vaches aux femmes (Fuuta Jalaapar exemple). Il serait intéressant d'y mener une enquêtecomparative et de voir si l'extension des rôles s'accompagned'une extension sensible des connaissances sur la contagion.
Soulignons aussi qu'en milieu peul, il n'y a pas, à proprement parler, de théorie de la contagion érigée en systèmepour l'ensemble de la population mais quelques représentations communes, plus ou moins étoffées selon les sphèresd'activité, qui forment autant de catégories identitaires.
Ces catégories identitaires se calquent verticalementsur la hiérarchie sociale: noble plutôt qu'éleveur, artisancasté plutôt que forgeron, tisserand, potier ou « captif » plutôt qu'agriculteur. Ces activités parfois revendiquées, sansêtre pratiquées, produisent néanmoins des savoirs spécifiques. Le lien entre statut social et réaction face à une situation écologique donnée a déjà été montré pour la sociétépeule du Hayre (de Bruijn 1995)16. Cependant les catégories
16 Mirjam de Bruijn (1995) montre dans un article consacré aux stratégiesde survie des femmes peules face à la sécheresse dans la région duHayre au Mali (nord-est de Mopti) la corrélation existant entre statutsocial et capacité de réaction face à une situation nouvelle (les femmesd'origine captive montrant plus d'aptitude à développer des activitéscommerciales lucratives).
336 Les maladies de passage
identitaires ne sont pas toujours calquées sur la hiérarchiesociale. Horizontalement, des catégories identitaires transversales aux catégories sociales se forment. Elles s'appuientnotamment sur une différenciation de genre (hommes plutôtavec les animaux, hors concession ; femmes plutôt avec lesenfants, s'occupant des activités internes à la concession).Face aux préoccupations de genre, certains clivages sociauxs'estompent. Ces catégories identitaires ne sont évidemmentpas closes. Néanmoins, on a pu constater que les éleveursmaîtrisent mieux que quiconque les modalités de la contagion de ka daw ka au sein du troupeau. Ce savoir se constitueen lien direct avec l'entretien exclusif du troupeau par leshommes. De même la connaissance de la contagion desenfants par le lait maternel, ainsi que le traitement de maladies liées au lait sont mieux connus par les femmes et exclusivement de leur ressort.
Bibliographie
AugéM.1975 Théorie des pouvoirs et idéologie. Etude de cas en Côte
d'Ivoire, Coll. Savoir, Hermann.
Bernus E.1969 « Maladies humaines et animales chez les Touaregs sahé
liens ". Journal de la société des Africanistes, XXXIX, 1 :111-137.
Bourdelais P.1998 « La construction de la notion de contagion: entre médecine
et société. " Communications, nO 66 [nO spécial: la contagion]. EHESS-Centre d'Etudes Transdisciplinaires (sociologie, anthropologie, histoire), Seuil, mai 1988 : 21-39.
Bonfoglioli A.M., Diallo YD., Fagerberg-DialloS1988 Kisal : production et survie au Ferlo (Sénégal), Dakar,
Oxfam.
De Bruijn M.1995 « A pastoral women's economy in crisis : The Fulbe in cen
tral Mali ", Nomadic peoples, 36-37 : 85-104
Prévention et contagion des maladies animales en milieu peul 337
Chilliot L.1996 « La vente informelle de produits de laboratoires au Niger
: une réponse aux problèmes d'accessibilité au médicament. ", in Programme de recherche : Concepts et conceptions populaires relatifs à la santé, à la souffrance et à lamaladie (Afrique de l'Ouest) , vol. V : Quelques entitésnosologiques populaires, üRSTüM-EHESS-CNRS : 99108. (draft paper)
Dupiré M.1970 Organisation sociale des Peul. Etude d'ethnographie com·
parée, Paris, Plon.1985 « Contagion, contamination, atavisme. Trois concepts
sereer Ndut (Sénégal) ", L'Ethnographie, 2 : 123-139.
FayC.1995
1993
« Car nous ne faisons qu'un. Identités, équivalences,homologies au Maasina (Mali) », in Cahiers des SciencesHumaines, 31 (2) : 427-456.« Repères technologiques et repères d'identité, chez lespêcheurs du Macina (Mali) ", in Jeux d'identités, Etudecomparatives à partir de la Caraïbe, M-J. Jolivet et D.Rey-Hulman (éds.), Paris, L'Harmattan: 167-202.
Fainzang S.1984 « Le regard du serpent. Réflexions sur la théorie de la
contamination chez les Bisa de Haute Volta ", L'Homme,XXIV (3-4) : 83-89.
Gallais J.1967 Le Delta intérieur du Niger, Etude de géographie
régionale, Dakar (Sénégal), IFAN, (2 tomes, Mémoires del'Institut Fondamental d'Mrique Noire, n° 78).
Good B.J.1994 Medicine, rationality and experience. An anthropological
perspective, Cambridge University Press, 1998 (pour la trad.française) comment faire de l'anthropologie médicale ?,Paris, Synthélabo, Les empêcheurs de penser en rond
Institut d'élevage et de Médecine Véterinaire des Pays Tropicauxseptembre 1972 « Etude agrostologique de la cinquième région du
Mali (région de Mopti) », in Etude agrostologique, nO 37,Maisons-Alfort.
338
Jaffré Y.1990
Les maladies de passage
« Education et santé ", in Sociétés, développement et santé,Fassin D. et Jaffré Y. (sous la dir.), Paris, Ellipses 1AUPELF : 50-66.
Kintz D., Toutain B.1981 « Lexique commenté peul-latin-français des flores de
Haute-Volta ", in Etude botanique, n° 10, IEMVT.
Legrosse P.1999 « Perception de redevances de pâturage et transhumance
des Peuls au Maasina (Mali) ", in Figures peules, RogerBotte, Jean Boutrais & Jean Schmitz (sous la dir.), Paris,Karthala : 239-266.
Mc Carkle C., Mathiès-Mundy E.1992 « Ethnoveterinary medicine in Africa », Africa, 62 (1) : 59-93.
Maliki AB.1981 Ngaynaaka : herding according to the wodaafJe. Rapport
préliminaire, Discussion paper 2, Tahouat : Ministry ofRural Development, Niger Range and Livestock Project.
Olivier de Sardan J.-P.1994 « La logique de la nomination. Les représentations fluides
et prosaïques de deux maladies au Niger ", SciencesSociales et Santé, 12 (3) : 15-45.
Osborn D.W., Dwyer D.J., Donohoe J.!. Jr.1993 Lexique Fulfulde {Maasina}-Anglais-Français. Une compi
lation basée sur racines et tirée de sources existantes suiviede listes en anglais-fulfulde et français-fulfulde, EastLansing, Michigan State University.
Paillard B.1998 « Petit historique de la contagion », Communications,
n° 66 [n° spécial: la contagion], EHESS-Centre d'EtudesTransdisciplinaires (sociologie, anthropologie, histoire),Seuil, mai 1988.
Zempleni A1962 « Anciens et nouveaux usages sociaux de la maladie en
Mrique. », in Archives des sciences sociales des religions,54 (1), (janvier-mars): 5-19
Chapi"tre 14
Anthropologie et hygiènehospitalière
Yannick Jaffré
En 1847, au mitan du siècle de la « révolution pasteurienne » (Latour 1984, Ackernecht 1986, Murard & Zylberman1986), Semmelweiss « inventa» l'hygiène hospitalière moderne, concluant au décours d'une étude sur la fièvre puerpéraleque « le portage de particules cadavériques » par les mains desétudiants en obstétrique de la maternité de Vienne est la voiede transmission des miasmes, responsables de la mortalité desjeunes gestantes. Il préconise alors l'antisepsie des mains avecune solution de chlorure de chaux (Lejeune 1998). Mais cettepréoccupation concernant la transmission des maladies dansles milieux de soins était encore isolée et la fin de cette histoire, pour être décevante, n'en est pas moins instructive. « Cetimmense progrès offert à l'obstétrique et à la chirurgie futnoyé sous les jalousies, les sottises et les vanités, et bientôtremis en cause. Le personnel se lassa de « ces lavages malsains » (. •• ), le ministre dut révoquer le premier des hygiénistes modernes le 20 mars 1849 » (Kouchner 1998). Prenonsce bref récit, outre les légitimes préoccupations prophylactiques qu'il souligne, comme un apologue. Abruptement, ilouvre la réflexion sur une des principales questions de l'hygiène hospitalière : celle des liens entre les infections nosocomiales1 et les pratiques des acteurs de la santé.
1 Au sens étymologique, nosocomial vient du grec nosos qui signifie maladieet komein qui signifie soigner, nosocomium signifie maladie à l'hôpital.
342 Les maladies de passage
D'un point de vue de santé publique, cette question estd'importance. En effet, on estime globalement que sur 190millions de personnes admises chaque année dans les hôpitaux du monde entier, l'infection hospitalière atteindrait9 millions de malades et serait responsable de la mort de1 million d'entre eux (Tasseau & Baron, 1989). En France,par exemple, « toutes les études depuis dix ans montrentqu'entre 5 et 10 % des patients hospitalisés contractent uneinfection nosocomiale, les chiffres étant identiques en Europeet en Amérique du Nord)} (Laveran 1998). Plus spécifiquement, la fréquence de ces infections varie de 20 à 24 % dansles services de réanimation en Europe (Berthelot & Lucht1998), étant en Mrique, dans ces mêmes services, située auxalentours de 25 % (Bouvet & Brücker 1998). Enfin, au Mali,des analyses effectuées dans les trois principaux hôpitaux dudistrict de Bamako montrent la présence de nombreux microorganismes (cocci gram positifs et négatifs, bacilles grampositifs et négatifs), forts dangereux puisqu'ils sont habituellement résistants aux produits antibiotiques et antiseptiques(Maïga 1978). Plus récemment, une étude faisait état d'untaux de prévalence de 8,16 % d'infections nosocomiales d'origine bactérienne dans un service de réanimation de l'un deces mêmes hôpitaux (Maïga 1999).
L'hygiène hospitalière: des" marqueurs" aux acteurs
Le monde médical s'est attaché à comprendre et améliorer cette situation. Pour cela, avec rigueur, il a construitdes études et a élaboré des propositions d'actions dontl'ensemble constitue l'hygiène hospitalière. Bien que lesapplications de cette spécialité médicale soient multiples etimpossibles à résumer brièvement, au regard de l'anthropologue, trois principales caractéristiques ordonnent la formede son discours.
L'infection nosocomiale est donc habituellement définie par sa survenueau-delà de 48 heures après l'admission à l'hôpital, ce qui signifie qu'ellen'est ni en incubation ni présente à l'admission (Lucet & Astagneau1998).
Anthropologie et hygiène hospitalière 343
Tout d'abord, concernant ses assises biologiques, cettediscipline est organisée selon une sorte d'implicite paradigmede la pathocénose - une analyse fine du déploiement, deséquilibres et des variations des parasites pathogènes2
conduisant à décrire les paysages hospitaliers, pour ainsidire, du point de vue des germes (staphylocoques, klebsielles,etc.) : on précise leur résistance aux traitements; on les localise (dans l'eau, dans l'air) ; on les caractérise selon leur provenance (flore commensale de la bouche, de l'œsophage, etc.) ;on indique les voies qu'ils empruntent pour se transmettre(blouses, mains, examens divers) ; on les traque dans les cuisines et les vestiaires ; on s'inquiète des lieux où ils prolifèrent (services de réanimation, bloc opératoire).
La description et la lutte contre les « vecteurs pathogènes » de ces agents infectieux, sont ensuite présentéescomme un ensemble de tâches dont l'accomplissement relèved'un vouloir anonyme présenté ou postulé sous une formeimpersonnelle : « les blouses seront lavées », « le matérielrentre dans le service par un sas ", « l'entrée et la sortie dupatient, du lit ... ». Plus que les personnels sanitaires, lessujets de l'action semblent, dès lors, être les gestes et lesobjets médicaux.
Enfin, corrélativement à cette description des risquesnosocomiaux potentiellement présents dans toute structuresanitaire, un ensemble de règles et de procédures est édictéconcernant la désinfection et la décontamination3 des lieux, desinstruments, des linges ou des repas. L'ensemble des gestesmédicaux et hôteliers qu'effectuent les praticiens de la santé
2 Nous empruntons ce concept à Grmek (1983) qui le définit ainsi: 1 - Lapathocénose est un ensemble d'états pathologiques qui sont présents ausein d'une population déterminée à un moment donné (. .. ), 2 - la fréquence et la distribution de chaque maladie dépendent en plus dedivers facteurs endogènes et écologiques, de la fréquence et de la distribution de toutes les autres maladies, 3 - la pathocénose tend vers unétat d'équilibre, ce qui est particulièrement sensible dans une situationécologique stable (15).
3 La désinfection est une opération permettant d'éliminer ou de tuer desmicro-organismes nocifs. La décontamination peut être considéréecomme une" pré-désinfection " ayant notamment comme fonction de "protéger le personnel lors de la manipulation des instruments, et d'éviter la contamination de l'environnement" (Allaux-Boiko & Chopineau,1998).
344 Les maladies de passage
est ainsi passé au crible d'un discours fortement normatif préconisant de multiples mesures et conduites prophylactiques.
Ces traits grammaticaux, organisant des connaissances biologiques et des mesures prophylactiques selon unesyntaxe particulière, ne sont pas anodins. Ils dévoilent comment l'hygiène hospitalière tente d'assurer son efficacitétechnique en s'élaborant comme un pur énoncé injonctif effaçant toute la question de la subjectivité des acteurs. Cettecaractéristique discursive, qui est aussi celle du droit édictant la loi4, conduit cette discipline médicale à se présentercomme une sorte de règle sanitaire doctrinale, une idéalitéréférentielle de l'organisation des pratiques des personnels,des malades, et des visiteurs. Mais forclos des textes de référence, les acteurs, dans leur épaisseur humaine et sociale,font retour dans le réel. Et c'est ainsi, qu'au fil des études, ilsapparaissent discrètement comme ombres et traces : cellesdes marques de la souffrance - sang, pus ... - sur les linges àlaver, celle des goûts et des régimes dans le circuit des plateaux que l'on achemine, celle des craintes lors des rapportsentre soignants et soignés et des tâches de traitement desdéchets médicaux. Leur présence, ne serait-ce que technique,se dévoile aussi sous la rubrique des " ressources humaines ",à l'ombre d'objectifs de formation, ou encore lorsque despourcentages évaluent des conduites à l'aune des connaissances acquises et des statuts occupés. Acteurs en filigrane,tolérés et normalisés, plus que sujets5.
L'hôpital africain, parce qu'il confronte à d'autres difficultés, oblige à adopter une autre perspective. Tout d'abord,parce que les mesures précédemment évoquées nécessitentun équipement complexe et performant de cuisines, douches,toilettes, vestiaires, salles de repos, blocs chirurgicaux, etc.qui sont pratiquement inexistants et économiquement horsd'accès pour les pays en voie de développement. Ensuite,parce que l'harmonisation des conduites réellement effectuées par les personnels, les malades et leurs familles, avec---------------
4 Nous renvoyons sur ce point aux remarques de Clavreul (1978) : " C'estau moment où la loi se donne comme un pur énoncé que s'efface la question de la subjectivité de l'énonciateur. "
5 Signalons cependant le travail publié à la documentation françaIse etqui tente de combler cette lacune (Roodenbeke & Fontaine 2001).
Anthropologie et hygiène hospitalière 345
des normes définies en fonction des risques, implique, sansaucun doute, une bonne formation des agents de santé et unelarge intercompréhension entre les soignants et les populations. Cet ensemble de références communes est aussi, pourune grande part, absente de nombre de pays subsahariens.
Dans ce contexte de pénurie, les difficultés comme lespossibilités d'actions, reposent donc largement sur les choixet les actions des acteurs de l'institution hospitalière. Cettepauvreté, son cortège de dysfonctionnements et les détressesqui s'y éprouvent, obligent ainsi, paradoxalement, à porterun autre regard sur cette discipline complexe qu'est l'hygiènehospitalière. Comme une sorte de « retour des acteurs refoulés », ces spécificités incitent à risquer une approche différente et complémentaire, construite non seulement sur l'idéalitédes normes, mais aussi en fonction des identités et deslogiques comportementales des soignants et des soignés.
Les lieux et les actes de soins
Mais allons au plus court. L'hôpital c'est tout d'abordun plan et ses modifications. En France, par exemple, s'yrecueille une histoire allant de ces espaces de compassionque furent les Hôtels-Dieu, jusqu'aux nouvelles structuresintégrant des plateaux techniques complexes et une hôtellerie assurant au malade la possibilité d'une chambre individuelle. En Mrique, cette structure de soins est plus récenteet prend place dans l'histoire coloniale. Elle correspond largement aux jeux politiques d'une offre et d'une demande où« la médecine hospitalière mobilisait la majeure partie de lanouvelle classe médicale montante» et où « les nouvellesélites urbaines traduisirent le programme politique d'africanisation » en demandant l'expansion de ce qui à leurs yeuxsymbolisait les soins de santé de bon niveau: la technologiecurative des capitales C.. ) (Lerberghe & de Brouwere 2000).
À ce lieu de soins correspond aussi une organisation.Pour le meilleur d'une prise en charge thérapeutique, commeparfois pour le pire d'un mépris des individualités, s'y ordonnancent « des procédures par lesquelles on assurait la distribution spatiale des corps individuels (leur séparation, leur
346 Les maladies de passage
alignement, leur mise en série et en surveillance) et l'organisation, autour de ces corps individuels, de tout un champ devisibilité» (Foucault 1997). Mais ce dispositif global de « biopouvoir» - dont il ne faut pas oublier qu'en rêvent ceux quien sont privés - plus qu'être une structure rigide et stable,varie en fonction des contextes et des multiples interactionsentre soignants et soignés qui s'y déroulent. « Comme toutesles activités sociales, l'exercice médical, bien que relevantd'une culture universelle qui est la science médicale, se fondeen pratique dans les structures, les normes et les dynamiques spécifiques des innombrables sous-cultures queconstituent les communautés locales. Or ces communautésagissent comme des systèmes médicaux clos. Elles sont composées de praticiens et non de chercheurs, et les règles universelles qui régissent la recherche ne s'y appliquent plus »
(Giraud 1992). Cette discrète liberté des acteurs n'est passans conséquences pour la santé des populations. Et c'estainsi que « de nombreuses décisions médicales semblentavoir un certain caractère arbitraire, et hautement fluctuant,sans explications apparentes » (Eddy 1990). Ces variationsne concernent pas que les modalités psychosociales de laprise en charge des patients. Elles se nichent au cœur mêmede l'acte de soin. Et c'est ainsi, pour ne prendre qu'unexemple, qu'en confrontant les pratiques chirurgicales dans16 centres de quatre états américains une enquête démontre« que la fréquence des indications variait du simple au triplepour les pontages coronariens, la chirurgie prostatique etthyroïdienne ; du simple au quintuple pour la chirurgie durachis et de l'abdomen, d'un facteur 1 à 7 pour la mise enplace de prothèses du genou ... » (Eddy ibid.). Bref, une nouvelle fois, le diagnostic médical correspond aussi à uneconstruction sociale et l'apparente fixité des lieux et desnormes de soins dissimule un ensemble complexe de jeuxd'acteurs. Mais pour mieux comprendre ces multiples interactions, revenons à notre « terrain », ici constitué par deuxservices d'un des principaux hôpitaux du Mali6.
6 L'ensemble des données que nous présentons iCI provient d'une enquêted'une année, menée dans différents services d'un des principaux hôpitaux du Mali. Elle a consisté en des observations de l'ensemble destâches hospItalIères, des comptages des actes et des entretiens avec les
Anthropologie et hygiène hospitalière 347
Le premier, comprenant deux unités d'hospitalisation,est situé dans un bâtiment isolé. Entièrement rénové, ilenglobe une quarantaine de lits inégalement répartis dansvingt salles. Deux toilettes, des salles de garde et diversespièces dévolues aux soins et aux examens dont les fibroscopies parachèvent cette structure. La deuxième unité de soinsoccupe les deux étages d'une bâtisse de briques. Au rez-dechaussée, cinq salles comprenant seize lits jouxtent le bureaudu major, une salle de soins et trois autres de consultations.Dans l'une d'entre elles se déroulent les endoscopies et lesbiopsies de la muqueuse rectale. Une salle de garde pour lesinfirmiers et une toilette complètent cet ensemble. À l'étage,cinq salles, toutes « nanties » de douches non fonctionnelles,abritent une vingtaine de lits. L'une des façades de ce bâtiment abrite une salle pour les internes et trois toilettes.
Les personnels de santé sont sensiblement en nombreégal dans chacun de ces services : trois médecins - dont lechef de service -, trois « majors ", cinq infirmiers, quelquestechniciens, une fille de salle, un aide soignants, deux garçons de salle, et selon les heures, en nombre variable, desinternes et des externes qui bien souvent assurent seuls lesgardes. Ces locaux sont le lieu d'une intense activité thérapeutique puisque chacun de ces services hospitalise, enmoyenne, sept cents malades par an et réalise un grandnombre de fibroscopies. Dès lors, le quotidien résulte descroisements entre ces tâches et les multiples interactionsqu'elles suscitent entre les différents segments de la profession médicale, ainsi que des rapports entre les soignants, lessoignés et leurs « accompagnants ,,7, et, pour ce qui concernel'hygiène hospitalière, des enchaînements gestuels quiconstituent le plus banal de l'activité de soin8 . Quelques
sOIgnants et clients des services. Des enquêtes portant sur les conduitesd'hygiène en milieu urbain et rural nous ont permis de compléter cesdonnées. Nous remercions Alou Dembéle, Gilles Koupko, et le regrettéBinet Poudiougou qm nous ont aidé à réaliser ces enquêtes.
7 En Mrique, ce terme désigne ceux qm sont choisis pour accompagner lemalade lors de son hospitalisation et subvenir à ses besoins de nourriture, d'hygiène et de traitement.
8 Sans entrer dans le détail de notre méthodologie, outre une longueobservation partiCIpante, nous avons tiré au sort, divers professionnelset nous les avons observés lors d'activItés précises comme les Injections
348 Les maladies de passage
notes soustraites de notre carnet d'enquête révèlent ce« cours ordinaire des choses » que tisse la trame routinièredes instants de vie et des actes de soins. C'est pourquoi ellesserviront d'introduction à quelques réflexions sur cettehygiène hospitalière telle qu'elle se construit au quotidiendes services et des populations.
L'ordinaire d'un service hospitalier
Il y a deux types de balayage des salles d'hospitalisations : un balayage sec et un balayage humide. Le premierest effectué dans toutes les pièces d'hospitalisation par ungarçon de salle. Le balayage humide est effectué à l'aided'une serpillière et de Crésyl dont on asperge le sol. Lenettoyage se fait par des « allés et retours » dans le mêmesens. Toute la salle est nettoyée, sauf sous les lits desmalades. La paillasse et la faïence de la salle de soin nesont jamais ni nettoyées ni désinfectées par les garçons desalles. (. .. )
Les alentours du service sont recouverts d'un sol cimenté, et c'est là que se trouvent les poubelles. C'est encore làque crachent certains patients tuberculeux, personnels, etaccompagnateurs. Le nettoyage de cet endroit se fait parbalayage sec, et est effectué par des femmes recrutées auvillage situé à proximité de l'hôpital. Ces femmes se protègent le nez avec un morceau de pagne. (. .. )
Les toilettes sont situées à l'extrémité de chaquepavillon. Elles sont au nombre de quatre, et composéeschacune de deux douches et de deux W.-C. La quatrièmetoilette, située à proximité de la cuisine, est réservée auxaccompagnants. Elle est, en général, délaissée au profitdes trois autres. Trois de ces W.-C. sont bouchés et l'utilisation de la chasse d'eau inonde les toilettes. Leur nettoyage est irrégulier, en moyenne une fois par semaine.L'agent habillé d'une blouse bleue et de chaussures fermées, utilise un tuyau branché sur le robinet des toilettes.
intraveineuses ou intramusculaires, les endoscopies, etc. Nous avonseffectué des comptages, confrontations avec les normes, etc.
Anthropologie et hygiène hospitalière 349
Il procède à un nettoyage à grande eau sans désinfectant.Dans une des toilettes de l'unité de tuberculose se trouveun robinet d'approvisionnement en eau. Ce point d'eau estutilisé pour la vaisselle et les ablutions précédant lesprières. Les malades y prennent souvent de l'eau pour lepetit-déjeuner. (. .. )
Le ramassage des ordures est effectué par une petitesociété, le plus souvent entre dix et onze heure. Lesagents, au nombre de deux, sont habillés de blousesbleues ou marrons, munis de gants de ménage et dechaussures fermées. Les ordures sont entassées dans unecharrette découverte, tirée par un des opérateurs. Lesordures sont déversées dans un angle de l'hôpital situé àproximité de la cuisine. (... )
Assis au bord du lit ou déambulant dans les couloirs, leplus fréquemment, deux accompagnants - généralement,un seul reste pendant la nuit - veillent le malade durantla journée. Ils s'occupent des besoins quotidiens de « leur»malade : la vaisselle, la préparation du repas, la prière,les formalités administratives, la toilette intime, faire lelit du malade, vider le crachoir, et souvent du balayage dela salle d'hospitalisation. Ils passent la nuit, couchés surune natte, dans la salle d'hospitalisation. (. .. )
Dans un des services, les injections intramusculairessont particulièrement fréquentes. Nombre de maladesatteints de tuberculose y sont soignés par des injectionsquotidiennes d'antibiotiques. Suivons ce geste d'amont enaval, depuis l'arrivée de l'infirmier chargé d'effectuer cestraitements. Vers huit heures, après avoir revêtu sa blouse, il va, au dépôt, chercher les médicaments antituberculeux qu'il distribue ensuite à la main en se rendant desalle en salle. Il va ensuite prendre les seringues et lesflacons de streptomycine. Ces flacons et ces seringues stériles sont déposés dans la salle de soins, sur un coin depaillasse où se trouvent aussi des serpillières sales, descartons, des boîtes de lait vides, et des coques d'arachides.L'infirmier descelle toutes les seringues stériles dans leplateau. Les flacons de streptomycine sont ouverts et laissés sans couvercle. Les seringues - leur nombre varie de11 à 20 - sont emplies une à une du produit et déposées
350 Les maladies de passage
dans le plateau. Chargé du plateau contenant lesseringues, du coton et un flacon d'alcool dans la poche, cesoignant se rend ensuite dans chaque salle pour y faireles injections. Un léger passage de coton imbibé d'alcoolsur une partie de la fesse est effectué avant l'injection. Letemps d'administration de ce traitement varie de 20 à 30secondes. À la fin des soins, les aiguilles et les seringuessont directement jetées dans une poubelle ordinaire. Leplateau est reposé sur la paillasse. Les autres produitssont préparés directement dans les salles d'hospitalisation. Ce n'est qu'en fin de journée, que l'agent se nettoieles mains avec du savon et un peu d'alcool. (. .. }
La séance de fibroscopie est régulièrement effectuéepar le médecin chef de l'un des services. Le début de cetexamen dépend de l'heure d'arrivée du responsable. Lenombre de patients est de trente à quarante par séance.L'aide porte une blouse blanche et des gants non stériles.Sur le bidon du produit utilisé pour désinfecter le matériel, il est inscrit: « ne pas diluer, temps d'immersionbactéries végétatives et virus : 10 minutes, bacille deKoch: 30 minutes, bacilles sporulés: 10 heures, garde sonefficacité pendant 14 jours ». Sur la paillasse deux bassines. L'une contient une solution d'eau de javel chlorométrée à 8°, mélangée à une solution de savon local diluédans la proportion d'un demi-sachet pour 10 litres d'eau.L'autre contient de l'eau. (. .. )
L'infirmière « secrétaire », appelle le premier malade.Le garçon de salle s'occupe de le placer sur la table aprèsune prémédication de xylocaïne en gel. Le médecin introduit le fibroscope dans la bouche à travers une canule.Après inspection du tube digestif, il ôte le fibroscope.L'aide prend alors une compresse pour l'essuyer9 . Cettecompresse est déposée sur la paillasse. Le fibroscope estensuite plongé dans l'eau savonneuse javellisée, puis dansde l'eau simple et essuyé avec une autre compresse. Elle
9 Soulignons, simplement que la durée minimale de trempage est devingt mmutes, voire une heure, compte tenu du risque potentiel lié auxmycobactéries et aux virus. Le risque encouru est d'autant plus grandque les patients présentant une hépatite ou porteurs du HIV sont nombreux.
Anthropologie et hygiène hospitalière 351
est déposée à côté de celle déjà utilisée. Une unique compresse est fréquemment utilisée pour le premier et lesecond nettoyage. Lorsqu'une biopsie doit être effectuée,la pince utilisée est nettoyée de la même façon. Le tempsd'immersion de la pince à biopsie dépend du nombre et dela fréquence des patients. En fin de séance, le garçon desalle procède au nettoyage de l'appareil: un nettoyage dessécrétions par une compresse stérile, une évacuation dessécrétions grâce à une seringue de 50 ml remplie d'eauprise au robinet, une immersion dans une solution deJavel diluée, suivie d'un brossage de la tuyauterie pendant une à deux minutes, puis une seconde immersiondans la bassine d'eau, et enfin une évacuation des sécrétions contenues dans la tuyauterie à l'aide d'une seringueremplie d'air. Le séchage du fibroscope est réalisé par suspension au mur sur une pointe ...
Cette brève description emprunte volontairement laforme d'un récit, et tente ainsi de rendre compte de l'enchaînement des gestes et des situations. Mais plus encore, pourrendre compte du réel de ces services, il faudrait dépeindrel'emmêlement des gestes, leur simultanéité. Le malade quicrache, alors qu'un manœuvre nettoie ; le médecin qui signeune ordonnance tout en préparant une fibroscopie; lesseringues qui tombent là où se trouvaient des restes de nourriture ; les mots et les regards, enfin, compatissants ouagressifs lors des soins ... Rien ici n'est linéaire, tout est touffu, enchevêtré. Chaque geste comme une recépée de descriptions et d'interprétations potentielles. Reste qu'il faut biensérier pour analyser. C'est pourquoi, plus qu'une sorte degravure espérant représenter le réel, nous présentons maintenant quelques traits qui nous semblent susceptiblesd'éclairer les conduites d'hygiène hospitalière, non pas, tellesque le discours médical voudrait, à justes raisons prophylactiques, qu'elles soient, mais telles qu'elles s'observent quotidiennement.
352 Les maladies de passage
Les jeux des acteurs de l'hygiène hospitalière
D'un point de vue sanitaire, certaines conduites observées sont dangereuses et contestables. Elles s'expliquent, enpartie tout au moins, par un ensemble de larges raisonsconcernant le fonctionnement du système hospitalier dansson ensemble et ne sont pas spécifiques au domaine del'hygiène hospitalière. C'est ainsi qu'une première cause dedysfonctionnement provient du « décalage " des hiérarchiesque l'on observe de manière régulière dans toutes les structures de soin. De ce fait, si, à juste raison technique, diversesréformes hospitalières s'attachent à faire correspondre destâches techniques aux fonctions médicales occupées, l'activitéeffective des services correspond plutôt à un déplacement deshiérarchies vers le haut. C'est ainsi, par exemple, que lesaccompagnants, à la place des manœuvres, nettoient le sol;que les manœuvres à la place des aides-soignants distribuentcertains traitements, que les aides-soignants et des « bénévoles» à la place des infirmiers effectuent certains soins, etque les internes endossent bien souvent les responsabilitésdes médecins ... Les fonctions ne sont donc pas spécifiquement attribuées à des segments de la profession médicale,mais sont « poreuses» et franchissables, pour peu, qu'enapparence, on assimile les techniques qui en sont l'apanage.Ce faisant, les gestes ne sont plus les prolongements deréflexions thérapeutiques, mais, vides de sens, correspondentplutôt au mime de conduites, dès lors effectuées sans les précautions qui devraient s'y attacher lO •
Une seconde cause, non moins importante et déterminante, concerne un évident manque de connaissance des personnels de santé. Ainsi, nombre d'infirmiers et d'internespensent qu'il est normal d'utiliser une seule seringue pour
10 De semblables remarques sont faites par Gobatto (1999 : 19) : " On estsaisi par la façon dont les gens investissent les lieux. L'hôpital est àl'image de la ville, il grouille de monde, de bruit, de couleur vive despagnes côtoyant les blouses vertes, roses, blanches. Loo) Les accompagnateurs semblent être des pièces très importantes dans le fonctionnement du heu. Ils prennent en charge le malade pour tout ce qui entoureles soins, de la nourriture à l'achat des médicaments ". Sur l'ensemblede ces questions, nous renvoyons aussi à Jaffré (1999) et à Jaffré &Olivier de Sardan 12002J.
Anthropologie et hygiène hospitalière 353
effectuer diverses injections à un malade. La plupart de cessoignants ignorent aussi les normes et procédures de désinfection des blouses, des thermomètres, ou des crachoirs. Laquasi-totalité méconnaît les techniques adéquates pourposer, sans risque infectieux, une sonde urinaire. Tous setrompent quant aux règles de composition des solutionsdécontaminantes ...
Mais la réflexion ne peut se limiter à cette descriptiongénérale de difficultés liées à l'organisation des services et àun manque de formation initiale et permanente. En effet,d'autres conduites apparaissent comme éthiquementcondamnables tant elles semblent relever de négligences« volontaires ", puisque les connaissances nécessaires àl'accomplissement correct des gestes techniques furentacquises lors de longues études spécialisées. Fréquemment,ces observations suscitent, de la part de responsables sanitaires, une compréhensible condamnation morale. Mais ilimporte aussi de comprendre, au cœur même du développement sanitaire, ce qui explique que ce travail de soins soit« mal fait ».
Retenons la simplicité, voire la naïveté, de cette question. Elle offre l'avantage d'orienter clairement la réflexion,même s'il nous faut maintenant proposer quelques détourspour espérer quelques réponses. Pour cela, nous proposeronsune approche sous la forme de sept principes, sortes de règlesdu jeu des acteurs de l'hygiène hospitalière, dont les rapportsdynamiques nous semblent susceptibles d'éclairer les dysfonctionnements observés dans ces services hospitaliers.
Principe des empiétements et des recouvrements territoriaux
Prenons au plus immédiat et considérons l'espace,puisqu'il s'agit avant tout de lieux, même s'ils sont qualifiésde soins. « Aux espaces » serait plus juste, puisque ces services s'apparentent plus à une marqueterie, voire un kaléidoscope, qu'à des secteurs différenciés selon leurs fonctions officielles, et policés selon des normes idoines.
En effet, dans ces services, les salles n'abritent pas queles activités qui leur sont techniquement dévolues. Elles ont
354 Les maladies de passage
aussi bien d'autres fonctions. Et c'est ainsi, par exemple, quecertaines salles de soins sont aussi celles où l'on prépare lespetits-déjeuners, où l'on expose des pagnes, etc. Les activitésmédicales varient aussi selon les heures, comme ces blocschirurgicaux qui, le soir ou durant le week-end, permettentaux soignants de faire des circoncisions, des avortements,etc. transformant ainsi un lieu officiellement stérile en unestructure septique. Bref, au réel des services, l'emprise territoriale des agents ne se limite pas à celle que leur confèreleur fonction ou statut, mais englobe leurs diverses activitésoccultes. Dès lors, les actions prophylactiques sont parfoisbien naives lorsqu'elles sont élaborées selon les actes médicaux déclarés, sans pouvoir englober ce qui se pratique certes« clandestinement » mais au su de tous. Activités illicitesparfois « dénoncées » par les traceurs biologiques comme laprésence de germes uro-génitaux correspondant aux actesprécédents, là où ils n'ont aucune raison d'être ...
Outre ces constants débordements des fonctions etdétournements de matériel, diverses conduites de maladesconduisent aussi à une interpénétration des espaces sociauxet techniques. Au plus simple, le lit - parfois acquis de hautelutte et sans qu'il soit nettoyé avant d'y accueillir un autrecorps - et son environnement sont ainsi appropriés commedes lieux privatisés. A certains moments on y masque lescorps derrière des draps tendus, on y dort sur sa natte. Nonsans heurts, on y dépose ses maigres provisions :
Un accompagnant qui vient de la brousse, la plupartdu temps détient les finances et s'occupe de l'alimentationdu malade. Généralement ces types d'accompagnantsarrivent avec leur sac de mil et les condiments. Tout estposé sous le lit, car il n'y a pas de place pour ça. Cela créeun problème d'hygiène, et de plus un manœuvre qui metdehors les gens pour nettoyer la salle verra entrer desgens dans la salle et cela sera source de conflit.Onf.)
Dans ces conduites spatiales, rien n'est stable. Toutpeut devenir l'objet d'une négociation et ce qui pour certainsmanœuvres pourrait correspondre au respect d'une frontièrevirtuelle de l'intimité peut être interprété, à tort ou à raison,par les patients, comme une démission de leurs fonctions.
Anthropologie et hygiène hospitalière 355
Ils balaient et essuient le matin seulement. Après, tupeux attendre jusqu'au lendemain... Je ne peux pas direen ce moment qu'il y de l'hygiène en cet endroit. Il n'y aaucune satisfaction ici pour l'hygiène. Ils ne font pas bienle balayage, le dessous du lit n'est pas balayé ni essuyé,les cafards sont partout. (Accompagnant)
Enfin, lieu d'inquiétude, de douleur et de fin de vie,l'hôpital abrite une intense vie religieuse. Au rythme desprières, réunissant parfois pour un bref moment les soignants et les soignés, les salles et les couloirs se couvrent denattes et de tapis, offrant à l'orant un espace vécu commepurifié. Mais si l'espérance est socialement et psychologiquement nécessaire, médicalement il ne s'agit le plus souventque d'une mince surface symbolique posée sur des sols biologiquement contaminés par des restes de crachats, de vomissure ou de déjection.
Principe de l'opacité des chaînes opératoires
La difficulté d'accorder ses gestes avec ce qui est prescrit par l'hygiène hospitalière s'explique ensuite fort simplement par le nombre et la segmentation des conduites qu'ilfaudrait concomitamment mettre en œuvre afin que desrègles prophylactiques soient respectées. Or, au long de ceschaînes opératoires en quoi consiste la plupart des actessanitaires en milieu hospitalier, chacun ne connaît réellement que ses propres tâches. De ce fait, plus qu'à unensemble harmonieux d'actions concertées, les suites gestuelles s'apparentent plutôt aux étranges créations du jeu du« cadavre exquis» : des sortes d'enchaînements d'activités oùnul ne maîtrise vraiment ni l'avant ni l'après de son geste.
C'est ainsi, par exemple, que les soignants jettent desseringues dans des poubelles, qui seront ensuite regroupéespar des garçons de salle, puis transportées par les agentsnon techniquement formés d'un groupement d'intérêt économique (GIE), puis déversées dans un espace ouvert au seinde l'enceinte hospitalière. Maintes semblables segmentationsdes opérations pourraient être décrites, mais qu'il suffised'évoquer les préparations des solutions de désinfection dontla composition est inconnue de leurs utilisateurs, etc. Bref,
356 Les maladies de passage
dans cette longue table des gestes sanitaires, plus qu'unevolonté des acteurs, l'addition opaque des conduites correspond à une multiplication des risques.
Le principe des sociolectes et des variations sémantiques
Concernant la question des infections nosocomiales,une seconde difficulté provient, bien évidemment, du sensaccordé aux notions centrales de l'hygiène et de la propreté.Or, ces signifiants, selon les langues distinctement ouconjointement utilisées, et selon les personnes et les groupessocioprofessionnels qui en usent, correspondent à diverscontenus sémantiques.
C'est ainsi que, loin des digressions savantes des responsables médicaux évoquant différents agents pathogènes,certains malades et leurs proches fondent leur jugement surle visible: est propre (jèya) ce qui ne comporte pas de traceapparente de souillure. Dans bien des cas, comme dans cespropos d'un accompagnant de malade, l'hygiène équivautalors au balayage.
L'hygiène, c'est de se prémunir de la saleté dans le butde la santé (Saniya, 0 yè k'i yèrè tanga nàgà ma ka takènèya sira fè). En principe on doit balayer et essuyermatin et soir parce que le lieu où se trouve un malade doitêtre propre (0 yàrà kakan kajèya).
D'autres, comme la plupart des infirmiers, fondentplutôt leurs connaissances sur les canons de quelquesouvrages scolaires scindant, sur un mode pédagogique classique, l'hygiène en trois points:
Premièrement c'est l'hygiène corporelle, en ce sensl'agent de la santé doit être propre (k'a yèrè saniya) ; deuxièmement, dans le travail il doit y avoir de la propreté (saniya) ;et puis les matériels doivent être propres (jèya), les lieux detravail doivent aussi être propres (jèya).
Au fil des conversations quotidiennes se constituentainsi pour chaque groupe d'acteurs des sortes de sociolectesoù s'ébauchent de modestes concaténations accordantdiverses connaissances avec les résultats de multiples observations. Les « opérateurs d'images" (Bachelard 1975) que
Anthropologie et hygiène hospitalière 357
sont les signifiants « hygiène» ou « saniya » en langue bambara, sollicitent ainsi diverses conceptions, allant des pratiques ménagères populaires à des conceptions plus ou moinssavantes.
Mais il ne s'agit pas uniquement de dégager des contenus de sens. Il importe surtout de comprendre, et de prendresur le vif, les effets produits par cette circulation de signifiantsrecouvrant des significations diverses. Il en résulte, en effet,puisque l'apparente homogénéité des termes utilisés dissimuleune hétérogénéité des représentations, que si tout le mondecommunique, il n'est pas certain que tout le monde se comprenne. De ce fait, ces complexes interactions langagières sontà l'origine de trois principales conséquences pratiques.
Tout d'abord les patients, ou les différents segments dela profession médicale, n'agissent pas souvent de conserve etentrent parfois dans des conflits que structurent diversesconfusions autour de ces notions. Ainsi en témoigne cetaccompagnant:
Parfois je dis aux garçons de salle que la salle a déjàété nettoyée. Malgré cela, ils reprennent le nettoyage. Ilsdisent qu'eux nettoient dans le cadre de l'hygiène (saniyasim kan, lit. « sur la voie de la propreté»). Pourtant je faisici comme j'ai l'habitude de faire chez moi ...
Ensuite, d'un point de vue sanitaire, le visible ne pouvant servir de référence à des pratiques d'hygiènes pertinentes, un accroissement des risques nosocomiaux est évident. Les propos d'un infirmier sont ici « parlants »11 :
La propreté du matériel est capitale, ça veut dire parexemple que le plateau ne doit pas avoir de traces de saleté ni de rouille. Si le plateau est en bon état, tuenflammes. Mais comme ce sont les seringues stérilesqu'on met dedans c'est pas trop obligatoire qu'on enflamme, ou on peut aussi se limiter au nettoyage par l'alcool.
Ce manque de support cognitif, stable et pertinent, faitaussi que bien souvent les mots n'accompagnent pas les
11 Soulignons une nouvelle fois que d'un point de vue strictement technique, ces propos ne correspondent aucunement à une décontaminationet une stérilisation correctes.
358 Les maladies de passage
gestes techniques, mais disjoignent plutôt les conduites desoins de leurs supports et raisons scientifiques. Dès lors, cespersonnels de santé dérogent aux normes d'hygiène etconstruisent leurs conduites selon « ce qui se fait ", entrantainsi, comme cet autre infirmier, dans la « routine ", autrement dit dans ces normes discrètes que construisent despetits groupes interactifs de professionnels.
A mes débuts ici, je prenais des précautions face aurisque, mais à la longue, tu regardes le comportement desanciens et tu fais comme eux. (... ) avant je me lavais les mainsaprès chaque acte de soin, maintenant je ne le fais plus.
Contrairement aux discours techniques, ces pratiquesprofessionnelles des personnels de santé se construisent ets'annoncent modestement. Par exemple, il suffit, pour déroger aux préceptes d'hygiène, de s'attacher aux apparencesdes instruments ou d'user « naturellement" de quelquesadverbes comme « assez " ou « suffisamment " : Traces discrètes aux effets considérables.
Pour le dosage et le mélange de ces produits, ce n'estpas « fixé ", c'est à toi de voir si ton mélange est bien oupas, selon la mousse et la couleur de l'eau.( ... ) Tu mets del'eau de Javel assez (kosèbèJ, et puis du savon liquideassez. Si tu laves sous le lavabo, si tu veux, tu mets duCrésyl, après cela, tu laves avec de l'eau de Javel.
Souvent tu trouves des malades têtus qui crachent àmême le sol. Dans les toilettes, ils défèquent par terre enlaissant la chaise et le mur sales. On augmente le dosageselon le degré de saleté.
C'est ainsi que ces personnels de santé, privés deconnaissances précises et exerçant leurs activités sans cerappel à l'ordre discret que constitue une pratique exigeanteconfirmée par la régularité des gestes de leurs pairs, nemodifient plus leurs conduites qu'en fonction d'une craintede leur hiérarchie. Les règles d'hygiène ne sont pas incorporées, ne constituent pas une « conscience professionnelle ",mais vécues comme extérieures à soi, ne sont respectées quepar crainte d'une réprimande ou d'une « honte » encourue.
Parfois le « patron » fait des observations, te dit deschoses désagréables (a b'i dàgàya, lit. il te diminue)
Anthropologie et hygiène hospitalière 359
devant les gens. Si on voit que le patron est présent, onmet tout en œuvre pour ne pas être disputé.
En fait, les personnels ne s'accordent vraiment que surune sorte de souci de soi et des siens, s'exprimant dans desconduites ayant, avant tout, pour but de maintenir une coupure entre l'intérieur de l'hôpital, globalement ressenticomme étant « à risque », et l'extérieur, correspondant auxlieux où l'on est responsable de son foyer. C'est pourquoi,sans doute, les mesures d'hygiène s'appliquent surtout aumoment du départ, lorsque l'on s'apprête à rejoindre safamille, mettant ainsi à jour une sorte de déontologie pardéfaut: ce n'est qu'envers ses proches que l'on est précautionneux.
Après le travail, je me lave les mains, à la « descente ",j'enlève ma blouse et je ne la toucherai plus. (infirmier)
Principe de l'enchâssement des risques sanitaires dansles conduites sociales
Bien que de manière savante, en évoquant certainescauses et mécanismes de l'infection hospitalière, les manuelsmédicaux ne désignent en fait que les plus habituelles desconduites sociales: manger, boire, se laver, déféquer. Or, parmanque - ou mauvais emploi - de personnel, ces tâches deprise en charge des malades dépendent en grande partie des« accompagnants ». Ils le font à leur manière. Loin de larigueur normative des ouvrages précédemment évoqués, ilsdisent plutôt comment prendre soin d'une personne malade,et combien cela implique de négociations et de compromisentre leurs craintes et les obligations sociales qui règlent cescomportements ordinaires. Ils déclinent alors, en une casuistique affective subtile, les multiples raisons de leursconduites. C'est ainsi, au plus proche, souvent entre parentset enfants, que certains refusent d'isoler leur malade.
Lorsque moi j'étais malade, c'était ma mère qui s'occupait de moi. Même si on lui disait qu'on ne doit pas mangerensemble, elle n'acceptait pas puisqu'il y a le lien parental.
D'autres, par contre, mettent en œuvre diverses précautions ou pratiques de « prévention ".
360 Les maladies de passage
Moi je distingue les gobelets pour boire, je ne mangepas les restes de sa nourriture, mais quant aux loucheselles s'échangent car elles sont lavées avec du savon. C.. )Si tes parents ne mangent pas dans un plat parce que tues malade, cela te fait très mal, mais là aussi la peur de lamaladie.
Pauvre bricolage des craintes, des obligations, et desincompréhensions, tout cela fait maladie, malgré quelqueshumbles et incertains conseils, comme ceux de cet aide-soignant...
On conseille aux accompagnants de ne pas manger« dans le vent » pour ne pas attraper de maladie,puisqu'un malade peut tousser, et l'air peut transporterles microbes ainsi. Si cela coïncide avec le moment demanger, obligatoirement tu vas trouver la maladie (i bèbana sàrà). Ils ne doivent ni manger avec le malade, niboire le restant de leur eau. Beaucoup d'accompagnateurstêtus trouvent la maladie ici. Ils reviennent en sachantque c'est un de leurs parents qui les a « contaminés» (enfrançais dans l'entretien).
Le reste est à l'identique, et « la nappe brouillonne desactivités» (Farge 1994) conserve cette tension entre protection de soi plus ou moins fragile, obligation sociale d'accompagner celui qui souffre, et incapacité du service public d'assurer le minimum de ces fonctions hôtelières et préventives. Ilen va de même pour d'autres gestes quotidiens, eux aussi trèslargement laissés à la charge de la famille du malade, telsque le couchage, la toilette ou la défécation, conduisant biensouvent à des conflits entre ce que l'on à l'habitude de faire etce qui serait préconisé dans des lieux de soin.
Quand un malade arrive, on demande tout d'abord àses accompagnants de mettre des draps propres «< drapsjèlèn ») sur les matelas, car ils sont en mauvais état. (... )Si le malade doit être lavé, tu l'aides dans les toilettespour se laver. Au cas où tu n'as personne pour t'aider tulaisses. Toi qui est près du malade, tu dois lui donner del'eau potable qu'il se lave les mains ou pour boire, tu doisaussi lui laver ses habits sales. ( ... ) Il Y a certainsmalades qui urinent dans le pot qui est gardé toute la
Anthropologie et hygiène hospitalière 361
nuit dans la salle d'hospitalisation. Certains défèquent lematin, et l'accompagnant verse ces déchets par terre C.. ).A plusieurs reprises, ceux d'en haut versent des déchetset ils te salissent si tu es en bas.
Cette dévolution des tâches, outre qu'elle décharge lessoignants de certaines de leurs obligations, est aussi favorisée par une sorte de respect des « secrets» (mogo sutura) quiprotègent l'intimité de chacun. Il en est ainsi du linge dontles modes de lavage révèlent le sens attribué aux souillures selles, urines - et à certains états, qui comme les règles,imposent la discrétion12. Ces dévoilements que révèle lamaladie ne peuvent être pris en charge que dans les liensaffectifs intimes d'une mère s'occupant de son enfant, lafemme de son mari ou, parfois, de la fille s'occupant de sonpère. Comme le souligne un des malades :
Si le beau-père défèque dans ses habits, cela est honteux et tout le monde ne doit pas voir, a fortiori une bellefille. Ce genre de secret doit se passer entre l'enfant et sesparents. Tout ce qui est honteux doit être secret.
Pudeur et dégoût qui s'appliquent encore, pour le pired'un risque sanitaire, à des activités « paramédicales»comme ce qui concerne le recueil et le balayage des crachatsdans « des services de tuberculeux».
Si un tuberculeux arrive, on lui recommande de chercher une boite dans laquelle les crachats sont mis. Celaveut dire qu'il ne doit pas cracher par terre et que si celasèche, le microbe peut prendre (yèlè, lit. monter) une personne saine. Autrement, on demande aux accompagnateurs de mettre à part les objets du malade, tels que legobelet et son plat pour manger.
Ces préoccupations concernant le respect dû aux personnes sont particulièrement importantes pour ce qui concerne les toilettes funéraires. Cette purification (janaba ko, lit.toilette des relations sexuelles) correspond largement au riteislamique. Et, modeste syncrétisme oblige, elle est effectuéepar un musulman pratiquant, connu, de plus, pour sa discré-
12 Sur cette question et dans un autre contexte, nous renvoyons à Corbin(1991).
362 Les maladies de passage
tion : il saura taire des secrets que pourrait révéler le dévoilement du corps et notamment les parties génitales Cdàgodàgàkànànaw, lit. les choses cachées). C'est ainsi que lorsqu'unhomme ou une femme en lave un ou une autre, le cadavrepeut être laissé nu. Par contre, lorsque les genres du purificateur et du mort sont différents, les parties sexuelles doiventêtre dissimulées. Mais pour tous, comme avant une prière, levisage du défunt doit être lavé, puis le côté droit, puis legauche. Commisération humaine qui n'est pas exempte derisques dans des pays où les hépatites, le choléra, la rage et leSIDA sont fréquents 13 . Enfin, soulignons pour clore cesremarques, qu'aucune information n'est donnée au malade:
Pratiquement il n'y a pas de conseils qu'on nous donneici. C.. ) Personne parmi les infirmiers n'est venu à moipour me dire qu'il faut se protéger, par exemple la bouchequand je tousse, ou chercher un crachoir, même la question de contagiosité de cette maladie, ils ne nous disentabsolument rien.
Bref, en ce domaine de la vie quotidienne à l'hôpital, plusque des normes médicales, les gestes sont effectués« selon leshabitudes ", comme « on fait chez soi ". Ils obéissent ainsi à unesorte de syntagmatique populaire, couplant systématiquement,pour le meilleur d'un environnement psychoaffectif rassurantet respectueux comme parfois pour le pire des risques sanitaires encourus, les actes de prise en charge du malade avec lesplus communes des normes sociales de conduite.
Principe de la polysémie des gestes de soin
Abordées « du côté " des soignants, ces questions liantle social et le thérapeutique, ne sont pas non plus sans conséquences. En effet, si bien des actes médicaux peuvent êtreeffectués de manière quasi anodine14 (peser, mesurer, etc.),
13 En France, l'arrêté du 17 novembre 1986 fixe la liste des maladiescontagieuses entraînant une interdiction de certains rites funéraires.Notons aussi que si le sens de la mort en Mrique a été largement commenté (Thomas 1982) cette question du décès en milieu hospitalier n'apratlquement Jamais été abordée.
14 Ce qui ne n'exclut pas que tout acte médIcal puisse avoir pour un sujetsingulier une valeur particulière.
Anthropologie et hygiène hospitalière 363
d'autres sont, par contre, particulièrement polysémiques naître, mourir, souffrir, craintes liées à certains gestescomme les injections etc. - et ne peuvent être accomplis sansqu'y résonnent les multiples harmoniques des affects, desvaleurs et des normes de conduites sociales. Ces moments etces actes thérapeutiques, diversement liés à des significations socioculturelles, constituent des sortes de cadres desinteractions entre soignants et soignés et, de fait, ces liaisonsdiscrètes entre les actes techniques et leur sens social, sontune des variables déterminantes des comportements enmilieu hospitalier.
Mais il ne s'agit pas que du sens attribué à des pratiques de soins. Certes, au plus simple, prendre soin dumalade semble uniquement correspondre à la mise en œuvrede diverses conduites normalisées. Mais ces gestes engagentaussi une certaine relation au corps et à l'histoire du malade.Dès lors, des sentiments de pudeur, de gène, de dégoût, ourlent toutes les conduites sanitaires et expliquent les modalités d'exécution des gestes de soin. C'est ainsi, au plus quotidien, que le rapport aux plaies ou aux déjections du maladene correspond jamais à l'unique accomplissement techniqued'une tâche. Ces pratiques thérapeutiques sont englobéesdans un mouvement plus large où « la vie se saisit à traversl'usage que les hommes font de l'oreille, de l'œil, de labouche, de la main, du nez" (Huizinga 1975), et de fait, desattirances ou des répulsions involontaires, souvent tues parles soignants, orientent discrètement les conduites desoins15. C'est ce qui apparaît dans les propos de cet infirmier.
Les docteurs nous ont dit de ne pas prendre de la nourriture. Si certains malades t'en veulent, ils mettent ducrachat sur quelque chose. Ils te dégoûtent (nyugun, lit.donner la nausée), (. .. ), s'ils te donnent la nourriture.
Tous les sens sont concernés et notamment l'odoratdans des régions où l'on sait l'importance que revêtentl'odeur (kasa) et les parfums. Mais tout ne peut se dire, retenons donc qu'au fil des attractions et des répulsions seconstitue une sorte d'anthropologie des « sensorialités ",
15 De semblables remarques sont faites par Peneff(l992).
364 Les maladies de passage
concernant, autour des actes de soins, tout autant les soignants que les malades.
Cette dimension est oubliée des manuels de formation,comme des évaluations. Et pourtant, comme des sortesd'accords plus ou moins dissonants ponctuant spécifiquement le contrepoint des interactions observables, ces sortesde « connotateurs discontinus» (Barthes 1982) que sont lessignifications ou les valences sensorielles expliquent aussiles modalités de la rencontre entre soignants et soignés.
Principe de co-présence des identités professionnelleset sociales
Il découle au moins deux conséquences de ce qui précède. Tout d'abord, l'identité du professionnel de santé ne peutêtre confondue avec son unique statut. Elle s'apparente plutôt à un feuilleté complexe de composantes techniques,sociales et religieuses, de plus altéré selon les interlocuteurs,les pathologies ou les tâches. Dès lors, s'il est légitime deparler des rapports entre soignés et soignants, il serait, parcontre, bien réducteur de n'imaginer cette relation que selonune dichotomie des rôles les plus apparents.
En effet, tout ici se déroule selon ce que, faute demieux, nous nommerons une sorte de logique de l'estran16,
soulignant ainsi que loin de coïncider avec l'apparence monolithique que lui confère sa fonction, l'identité du professionnel correspond plutôt à un rassemblement où nulle couchesensible, cognitive ou technique n'en annule une autre. Maisprécisons, en décrivant, outre ce que nous avons déjà évoqué,quelques-uns des plus fréquents de ces recouvrements.
Le principal de ces adents est celui qui lie les connaissances acquises et les croyances les plus partagées. Lesconduites syncrétiques sont ici nombreuses, sans aucundoute, favorisées par la difficulté à comprendre ce que sontdes micro-organismes que l'on ne peut voir. Entités pathogènes d'ailleurs souvent subsumées, comme dans ces propos
16 « Entre la mer Jamais découverte et la terre jamais recouverte ... »
comme Michel Deguy (1964) qualifie ce lieu.
Anthropologie et hygiène hospitalière 365
d'un garçon de salle, sous le terme de nyama qui en milieumandingue désigne une force occulte plus ou moins néfaste.
Eviter d'être contaminé, C.. ) c'est éviter que le nyama nemonte sur toi (nyama kana yèlè i fè). Il Ya certains cadavresici qui possèdent du nyama et dont il faut se protéger.
Chevauchement des craintes et des termes, dès lors,bien des personnels de santé cumulent les prudences localeset les précautions médicales, comme cet autre garçon de sallequi « teste » la dangerosité de la nourriture à l'aide d'une« ceinture magique» appelée tafo.
On peut dire que s'il y a quelque chose dans la nourriture,le tafo se coupe, mais s'il ne se coupe pas c'est qu'il n'y arien de dangereux dans la nourriture, et tu peux manger.
Enfin, lorsque l'on progresse dans la hiérarchie,d'autres notions plus « scientifiques » prennent la place préventive précédemment accordée à des entités magico-religieuses. Il en est ainsi, pour cet infirmier, pour qui des « gazmédicamenteux» sont promus au rang d'une active, bienqu'involontaire, protection.
Depuis que je suis venu ici, on n'a pas pris de précautions qui puissent nous protéger, seulement, si tu as lamain dans le médicament, ses gaz peuvent t'éviter d'êtrecontaminé ; sinon normalement on devrait posséder desbavettes.
Mais ces chevauchements et ces phénomènes de recouvrement sémantiques ne concernent pas que les rapportsentre savoirs acquis et croyances populaires. Ils intéressentaussi le domaine des rapports entre les genres, comme lorsqu'un garçon de salle n'accepte de balayer que les surfacescarrelées, les surfaces en terre correspondant, comme il enest à son domicile, aux tâches féminines, ou que l'âge confèreun pouvoir supérieur à celui des titres officiels.
Bref les conduites et représentations des personnels desanté, loin de constituer un ensemble cohérent, se présententsous la forme de coupes, de rejets et d'emprunts d'une chaînede langage à une autre, une sorte de prosodie mêlantconnaissances, discours commun et obligations sociales.L'acte médical et l'engendrement cognitif des actions ne seconstruisent pas sur un effacement des conceptions popu-
366 Les maladies de passage
laires, mais sur leur fragile suspension. L'équilibre entre lesperceptions du sens commun et les prescriptions scientifiqueest toujours instable l7 , basculant de l'un à l'autre, selon lateneur des sujets abordés, entraînant face à certaines pathologies des automatismes de réponses diagnostiques et thérapeutiques, et face à des mesures prophylactiques de discretssyncrétismes, comme ces sages-femmes recommandant deconsommer des betteraves - rouges comme le sang - pourlutter contre l'anémie.
Principe des conduites déontologiques sélectives
Une des caractéristique des attitudes de soins est queleur raison ou leur modification ne dépend pas uniquementde l'acquisition de connaissances ou d'informations nouvelles.Dans bien des cas, il s'agit avant tout d'une certaine manièrede se conduire avec un autre, malade. Autrement dit, l'hygiène hospitalière est aussi une affaire de déontologie: forme dudevoir qui dans ce contexte est traduit comme « se sacrifier »,
(lit. « se donner soi même », en bambara k'i yéré di).
Pour les personnels de santé, il peut, en effet, s'agir decela. En effet, dans ces milieux sociaux sans assurance collective, où rien ne décharge chacun au profit d'un anonymecollectif, l'engagement est, pour ainsi dire absolu, et uneexpression souligne d'ailleurs que « lorsqu'on commence, ilfaut finir ». De plus, bien des cadres de l'interaction sanitaire- comme, par exemple, qu'une consultation ait un début etune fin - ne sont pas strictement définis. Dès lors, dans cecontexte, très concrètement, compatir à la souffrance d'unpatient, l'aider une première fois, ou « pour une fois », est
17 S'interrogeant sur les rapports entre traditions folkloriques et culturesavante dans la société féodale aux xne et XIIIe siècle, Schmitt (p. 142)remarque fort Justement: " Pour échapper à l'aporie des notions indéfinissables (" populaire") ou au piège des mots hérités (" religion "," magie ", " survivances ", " superstitions »), il faut faire l'analyse desrelations sociales, bâtir un modèle mettant en valeur les pôles d'opposition, les tensions, les enjeux idéologiques d'une société au fil de son histoire ou à un moment précis de celle-ci ".
18 Dans la plupart des pays sahéliens, ce n'est, en effet, pas celui quidemande qui a honte mais celui à qui l'on demande et qui ne peut satisfaire cette demande.
Anthropologie et hygiène hospitalière 367
quasiment impossible. « Aider» marque une proximité etpour cela un premier « geste» ouvre à la possibilité d'autresdemandes auxquelles on ne pourra, parfois à sa grandehonte18, pas répondre.
En l'absence d'un état fonctionnant comme un tierspayant et exerçant un contrôle social sur la qualité de l'offrede soin, les relations entre soignants et soignés seront soumises au caractère arbitraire et aux aléas de toute relation.Et de fait, les conduites des soignants oscilleront entre uneextrême générosité, lorsque la proximité sociale ou la formede la pathologie et de la plainte « touchent » ces acteurs, etun refus d'établir une quelconque relation voire une complèteindifférence lorsque rien ne confere une existence au patient.Le contraste entre la cruauté et la pitié domine partout.
Pour un malade, il faut donc exister aux yeux des personnels soignants, si l'on veut être soigné. Dans ce contextegénéral de bas salaires, cette sorte de logique sélective fondée sur une personnalisation des relations, incite à mettre enœuvres diverses pratiques « d'approche» des personnels desanté.
Dans certains cas, l'interconnaissance est ancienne.Elle correspond à un voisinage, à une même appartenancefamiliale, à des études communes... Dès lors, lorsque ce lienn'existe pas « naturellement» il faut le construire, puisqu'ence domaine sanitaire une seule règle est constante : il fautêtre « confié à quelqu'un » (yan an kalira màgà dà la), il faut« établir des relations » (ka nyàgàn don) avec les soignants,puisque l'attention et les soins accordés au malade en dépendront pour une très grande part. Comme le souligne un infirmier : « ce n'est pas le malade que l'on regarde mais qui estderrière lui» (banabagaato tè lajè a kà de bè lajè).
Dans le cadre de la motivation, si une de tes connaissances amène un malade, je m'occupe de lui pour que leschoses lui soient faciles. D'autre part rien qu'en voyant lagravité de la maladie, tu te dis qu'il faut soulager à toutprix car certains sont soumis (u majigilen) depuis leurarrivée c'est la conduite du malade qui t'a motivé pourfaire un bon travail. (Inf.)
Il suffit même parfois d'un patronyme commun.
368 Les maladies de passage
L'infirmier qui est là se nomme Sidibé. Moi aussi etc'est ainsi qu'est née la parenté entre nous. Il s'est trouvéqu'il connaissait mon père, ce fut une facilité pour moi(nàgàya). (Accompagnant d'un malade)
Cependant, pour tous, la personnalisation de la relation passe par la mise en œuvre de pratiques de « cadeaux ".
Il Y a une différence entre le simple patient (<< patientsimple », en français) et un autre avec qui tu as uneaffinité (donbaga). Mais c'est selon la motivation «< motivation » en français). (. .. ) Celui dont tu reçois un cadeau,tu fourniras un effort supplémentaire lors de son traitement. (Infirmier)
En fait, patients et soignants s'accordent pour reconnaître la déontologie non pas comme ce qui donne forme àune relation au départ anonyme, mais au contraire, commeétant liée à l'établissement d'une proximité sociale. Il faut,pour être correctement soigné, entrer dans une sphèred'interconnaissance souvent pécuniairement négociée: banale corruption (donbolo, lit. ce qui est donné à la main) vécuecomme une norme de conduite dans les services de santé.
Pour les relations sociales, certains s'occupent de toiparce que tu es proche d'eux, tu es un ami de leur père, ily a de la parenté, de plaisanterie, de voisinage ...Autrement c'est de donner un don (bonya, lit. don et respect). Ça peut être de l'argent, de la nourriture, deshabits, mais ce qui est fréquent c'est l'argent, c'est lui quifait que l'on s'occupe vite de toi. Ces « bonya ') doivent sedonner discrètement. (Malade)
Avec le donbolo avec ça, en cas de besoin, à n'importequel moment, il suffit de les appeler, ils viennent voir tonmalade.C. .. ) Le donbolo n'est pas obligatoire, mais si tudonnes, le travail est bien fait. Les agents ne refusentjamais de prendre le donbolo. Il y a tous les montants,moi parfois je donne 5000 CFA, ou 2000 CFA, 1000 CFA.Ils ne rejettent rien.
Ces pratiques de « motivation» du personnel sontaussi extrêmement importantes pour ce qui concerne laquestion de l'hygiène hospitalière et des affections iatrogènes. En effet dans bien des cas, les injections doivent être
Anthropologie et hygiène hospitalière 369
payées pour être faites correctement. Il en va de même si l'onveut bénéficier d'une bonne place, être classé dans les premiers lors des endoscopies. Précaution utile puisque, commenous l'écrivions précédemment, l'endoscope n'est pas décontaminé entre les patients. Globalement, pour les malades, laréduction du risque iatrogène, ne dépend donc pas uniquement de mesures techniques. Très largement, elle impliqueun ensemble de conduites sociales ayant comme finalité depersonnaliser les relations avec les soignants, afin, en utilisant privativement des structures publiques de soins, debénéficier d'une prise en charge plus respectueuse et prévenante.
L'hygiène hospitalière et ses acteurs
L'hygiène hospitalière déborde donc très largement leslimites que lui assignent la biologie et l'organisation dessoins. Si elle doit, bien évidemment, se consacrer à identifierdes micro-organismes pathogènes et à codifier des gestes etdes procédures techniques, elle ne peut s'y cantonner. Fairecorrectement ces gestes techniques implique, en amont, unvouloir socialement déterminé; et c'est pourquoi, au gré deleurs conduites, les divers acteurs des services de santé viennent froisser ce qui souvent ne correspond qu'à une trop lisseet livresque présentation. Qu'il suffise de souligner troispoints.
Aux espaces fonctionnels, les personnels et les maladessuperposent une sorte de marqueterie complexe et variable,une mosaïque délicate correspondant à des territoires affectifs et à des sortes d'annexions discrètes des lieux thérapeutiques par des conduites sociales. Salles pour les soins, biensûr, mais aussi de visite, de repos et « cantine» parfois pourles soignants. Dès lors les normes de conduites et les pouvoirs sur les lieux oscilleront entre ce qui relève du médicalet ce qui satisfait des sociabilités quotidiennes.
Aux connaissances que l'on suppose partagées par touscorrespondent, en fait, entre les différents segments de laprofession soignante, de multiples ruptures communicationnelles, puisque selon son statut et ses connaissances, on
370 Les maladies de passage
n'accorde pas aux mots le même sens. Plus intimement encore, aux purs sujets de savoir - supposés intégrer des connaissances scientifiques - correspondent souvent des personnels" clivés », usant conjointement de leurs langages techniqueset de leurs croyances profanes.
Enfin les interactions entre soignants et soignés nesont pas uniformes, mais s'accordent avec une déontologiesélective fondée sur des choix économiques et sociaux.
Mais concluons sur un espoir. Révélateur du fonctionnement du monde hospitalier, l'hygiène en condense la complexité et impose la rencontre du médecin et de l'anthropologue. Au premier de comprendre que les germes profitentdes pratiques humaines, au second de relever le défi d'améliorer l'offre de soins, en aiguisant ses concepts sur le fil desmarqueurs biologiques.
Bibliographie
Ackernecht E. H.1986 La médecine hospitalière à Paris (1794-1848), Paris,
Payot.
Allaux-Boiko V., Chopineau J.1998 « Stérilisation: Principes, mise en œuvre contrôles ",
Hygiène hospitalière, Hygis N., Lyon, PressesUniversitaires de Lyon: 213-240.
Bachelard G.1961 La flamme d'une chandelle, Paris, PUF.
Barthes R.1982 L'obvie et l'obtus, Essais critiques III, Paris, Ed. du Seuil.
Berthelot P., Lucht F.1998 « Investigation d'épidémies d'infections nosocomiales : les dif
férents types d'enquêtes épidémiologiques et leurs méthodologies d'analyse », Med. Mal. Infect., 28 nO spécial: 469-473.
Bouvet E., Brücker G.1998 «L'isolement en pratique hospitalière", Med. Mal. Inf, 28
n° spécial: 485-491.
Anthropologie et hygiène hospitalière 371
Corbin A.Le Grand Siècle du linge, in Le temps, le désir et l'horreur,Essais sur le X/Xe siècle, Paris, Champs Flammarion: 2352.
DeguyM.1964 Biefs, Paris, Gallimard.
EddyD. M.1990 Le défi, JAMA, vol 15, n0121 : 425-433.
Farge A.1994 Le cours ordinaire des choses, Paris, Ed. du Seuil.
Foucault M.1997 « Il faut défendre la société », Cours au Collège de France,
1976, Paris, Hautes Etudes-Gallimard-Seuil.
Giraud A.1992 Evaluation médicale des sozns hospitaliers, Paris,
Economica.
Gobatto 1.1999 Etre médecin au Burkina Faso, Paris, l'Harmattan.
GrmekM.1983 Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale, Paris,
Payot.
Huizinga J.1975 L'automne du Moyen Age, Paris, Payot.
Jaffré Y.1999 Les services de santé « pour de vrai n, Bulletin APAD.
Jaffré Y. & Olivier de Sardan J.-P.2002 Les dysfonctionnements des systèmes de soins, Marseille,
SHADYC-EHESS, Rapport Projet UNICEF-Coopérationfrançaise.
Kouchner B.1998 Préface à Infections nosocomiales et environnement hospi
talier, Brücker G., Paris, Flammarion.
372 Les maladies de passage
Latour B.1984 Les microbes guerre et paix, suivi de irréductions, Paris,
Métailié.
Laveran H.1998 c L'infection nosocomiale », dans Hygiène hospitalière,
Hygis N., Lyon, Presses Universitaires de Lyon: 35-50.
Lucet J.-C., Astagneau P.1998 Transmission des infections nosocomiales. Principes et
prévention, Infections nosocomiales et environnement hospitalier, Brücker G., Paris, Flammarion: 6-10.
Lejeune B.1998 Préface à Hygiène hospitalière, Hygis N., Lyon, Presses
Universitaires de Lyon.
Maïga A.1999 Aspects bactériologiques des infections nosocomiales dans le
service de réanimation à l'hôpital national du point « G »,
Thèse, Bamako, Faculté de Médecine du Mali.
Maïga Y. 1.1978 Contribution à l'étude des infections intrahospitalières
dans les trois hôpitaux nationaux du Mali, Thèse,Bamako, Faculté de Médecine du Mali.
Murard L., Zylberman P.1986 L'hygiène dans la République. La santé publique ou l'uto
pie contrariée, 1870-1918, Paris, Fayard.
Pennef J.1992 L'hôpital en urgence, Paris, Métailié.
Peter J.-P.1996 Connaissance et oblitération de la douleur dans l'histoire
de la médecine, in De la violence, Héritier F. (sous la dir.),Paris, Ed. Odile Jacob: 367-392.
Roodenbeke de E., Fontaine D.2001 Améliorer l'hygiène hospitalière, La Documentation
Française.
Schmitt J.-C.
Anthropologie et hygiène hospitalière 373
2001 Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d'anthropologie médiévale, Paris Gallimard.
Tasseau F., Baron D.1989 Infections nosocomiales, in Santé publique, Brücker G. &
Fassin D. (eds), Paris, Ellipses: 478-492.
Thomas L. -V.1982 La mort africaine idéologie funéraire en Afrique Noire,
Paris, Payot.
Van Leberghe W., de Brouwere V.2000 « Etat de santé et santé de l'Etat en Afrique subsaharien
ne ", in Afrique contemporaine, Numéro Spécial, La santéen Afrique Anciens et nouveaux défis, Paris, La documentation Française n° 195, Juillet-Septembre: 175-190.
Chapitre 15
L'hygiène et les pratiques populairesde propreté. Le cas de la collectedes déchets à Thiès (Sénégal)
François Enten
Nous traiterons du thème de la transmission des maladies à travers une étude de cas sur les activités de collecte dedéchets à Thiès, au Sénégall en comparant un discourshygiéniste médical et un registre profane associé auxdéchets, ce qui reviendra, en somme, à traiter de manièredocumentée de l'opposition classique entre les notions scientifiques d'hygiène et les notions populaires de la propreté.
Le registre médical est fréquemment utilisé par les opérateurs de la collecte lors de séances publiques d'InformationEducation Communication (I.E.C.), lorsqu'ils présentent leursactivités auprès des habitants des quartiers. Dans leurs discours, ces animateurs tendent à reproduire un savoir de type« technico-scientifique », où l'hygiène est à prendre dans sadéfinition contemporaine, comme une « science» qui se réfèreau modèle étiologique pasteurien. Selon ce dernier, dans saversion vulgarisée, l'explication de la maladie est simple :c'est le germe pathogène, le microbe, qui constitue « l'élément
1 Le type de collecte étudié ici se singularise par l'organisation d'unramassage quotidien des déchets effectué de porte à porte par des charretiers. Elle s'accompagne de comportements originaux et participatifschez les particuliers qui, en payant volontairement ce service, déposentrégulièrement leurs déchets devant leur porte, au lieu de les jeter dansla rue.
376 Les maladies de passage
étranger au malade qui, du dehors, vient s'abattre sur ce dernier» (Laplantine, 1986). Selon cette logique, les gestes denettoyage se justifieraient donc par la volonté de se protégerdes germes pathogènes susceptibles d'être contenus dans lesdéchets. Cependant, il s'avère que les pratiques de propreté,une fois détachées de la « pathogénie» et de l'hygiène, peuvent être également interprétées comme un « opérateur» demise en ordre du milieu (Douglas, 1992).
En explorant les notions populaires de propreté, cetarticle propose de mettre en lumière ces autres logiquesétrangères au registre biomédical. Je me référerai à l'observation des pratiques de nettoyage de l'espace domestique etau discours des femmes sur leurs représentations desordures ménagères. Cette exploration me permettra de préciser comment les explications des femmes peuvent divergerdu savoir biomédical pasteurien tout en intégrant des bribesde données technico-scientifiques.
En somme, en procédant par une comparaison desdeux types de discours, je vais « déplacer mon analyse duchamp de l'hygiène, dont les fondements se veulentaujourd'hui essentiellement scientifiques, vers celui de lapropreté qui est d'essence culturelle » (Poloni, 1990).
Loin de croire qu'il y ait une absence de propreté au seinde l'espace domestique, on pourra constater, à l'issue de cetteanalyse, qu'un tri sélectif extrêmement sophistiqué des déchetsest opéré par les femmes et que les pratiques de propreté sontmotivées à la fois par des représentations socioculturelles nonmédicales et par des conceptions liées aux odeurs2.
2 L'enquête a été menée en juillet et en août 1998. Les discours biomédicaux ont été collectés lors d'entretiens menés auprès des opérateurs desprojets de collecte: membres du service d'hygiène de la vIlle, desOrganisations Non Gouvernementales (O.N.G.) et des Groupementsd'Intérêt Economique (G.I.E.). J'ai principalement accompagné lesmembres du G.I.E ETPAS et de la fédération des G.I.E. « Bokk Diom "qui collectment les déchets dans les quartiers Som et Médina Fall.Les représentatIons populaires présentées dans cette étude sont issuesd'entretiens menés auprès de trente femmes à leur domicile, sur lesdeux quartiers d'opération des GIE. Ces informations ont été complétéespar une observatIOn participante conduite pendant le séjour auprès demes familles d'accueil L'observation des pratiques de balayage a pu êtreeffectuée auprès de trois familles (Poular, Wolof) et à chaque fois, sur 3quartiers différents. L'observation a été menée en fin de saison sèche.
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté
Brève histoire des campagnes d'hygiène au Sénégal
377
Lors de la première phase de la présence coloniale auSénégal, l'option pasteurienne fut introduite au Sénégal parles médecins militaires. Les organismes de santé coloniauxvisaient d'abord à protéger les troupes et les colons contre lesépidémies. Puis, avec l'ouverture des grands travaux de« mise en valeur », la prévention sanitaire s'attacha aussi àla santé des travailleurs africains. Les médecins coloniaux etmilitaires n'étant pas assez nombreux pour satisfaire à lafois les services militaires et civils, l'Assistance MédicaleIndigène (A.M.!.) fut créée en 1905 pour constituer un corpsde médecins et d'auxiliaires africains.
Les colonies ont constitué un lieu privilégié de l'application et du développement de l'hygiénisme pastorien. Dansl'urgence de protéger les troupes militaires puis la maind'œuvre africaine des épidémies tropicales, une sorte de « placage» direct des pratiques métropolitaines du système hygiéniste a été effectué en Afrique. Il s'est doté d'une infrastructure administrative calquée sur l'infrastructure pyramidale occidentale et d'un arsenal réglementaire quasi-identique, voireplus coercitif (Becker et Collignon, 1998 ; Diop, 1997 ;Domergue-Cloarec, 1997 ; Ndiaye, 1997 ; Ngalamulume,1997).
Il résulte de ce choix un refus de reconnaître les solutions qui auraient pu être élaborées à partir des savoirslocaux. Au contraire, « du point de vue de l'administrationcoloniale c..), les savoirs et les savoirs-faire locaux, les stratégies et les tactiques des agents de santé ou des populations, apparaissent comme des obstacles à la résolution desproblèmes sanitaires, et non comme des tentatives de réponse » (Fassin, 1997).
Dans les années 1920, ni les programmes de médecinecurative et préventive, ni les mesures d'assainissementn'étaient parvenus à éradiquer les épidémies, par insuffisance en moyens et en hommes. Le bilan de la pénétration médicale à cette époque était « dans l'ensemble insignifiant»(Hado, 1996 & 1997). Fassin prolonge ce constat en concluantque l'idéologie de l'hygiénisme fut remise pratiquement enquestion. Il constate que le programme universaliste de
378 Les maladies de passage
l'hygiéniste céda « le pas à des solutions particulières, prenant en compte les projets politiques et les présupposés culturalistes du colonisateur ». Le projet de santé publique sousles tropiques devint une « médecine coloniale» comprenantde moins en moins de soins et de plus en plus de prévention(Passin, ibid. J.
Par contre, l'hygiène constituait un excellent supportidéologique à l'action coloniale. Légitimant l'entreprise decolonisation, elle apportait un mobile apparent à la présencecoloniale, couvrant les mobiles économiques et stratégiques.L'idéal hygiéniste considérait la médecine comme un vecteurd'une nouvelle civilisation progressiste, qui allait transformer les modes de vie et les mentalités traditionnelles. Grâceà l'hygiène, on soutenait que l'efficacité de l'intervention dumédecin fera « la démonstration de la supériorité du colonisateur et attestera les bénéfices qui peuvent être espérés del'œuvre civilisatrice française» (Passin, ibid.).
L'éducation de l'hygiène en Afrique Occidental Française
L'historien Papa Amadou Gaye décompose en deuxtemps le transfert de l'enseignement pasteurien en AO.F : uneappropriation par les médecins militaires et civils coloniaux etune formation centrée sur l'hygiène auprès des auxiliaires desanté chargés de transmettre ce savoir aux populations.
Les médecins militaires formés à l'école de médecinenavale furent les premiers émetteurs des notions d'hygiène.Vers 1880, certains pasteuriens débutèrent dans la médecinemilitaire ou navale (Latour, 1984 ; Léonard, 1981). A partirde 1905, les médecins civils furent formés à l'école de médecine du Pharo, à Marseille. Ces hommes furent les principauxformateurs du personnel médical africain (Gaye, 1997).
La mise en place des canaux de diffusion du discourspasteurien auprès de la population africaine remonte à 1905,avec la mise en place de l'Assistance Médicale Indigène(AM.U. La formation des auxiliaires de santé était liée ausavoir médical occidental, et ce personnel représentait unrelais actif de la domination coloniale. Ils ont constitué lesmeilleurs vulgarisateurs de l'hygiène et des méthodes pro-
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté 379
phylactiques. L'objectif pédagogique à atteindre était commel'énonce Olcomendy, directeur de l'enseignement scientifiqueen 1919, de réduire la méfiance des Africains et de « fairenaître puis grandir leur confiance en la science des blancs »(cité par Gaye, 1997). Globalement, les messages transmisaux populations comportaient des notions d'hygiène pratique, les explications sur les mécanismes de contagion interhumaine, sur les cycles du paludisme et de la fièvre jaune etsur les techniques de prévention.
A partir de 1920, les instructions traduisaient la volontédu gouverneur général de rompre avec la médecine individuelle curative afin d'entreprendre le programme de médecine préventive sociale au sein duquel les auxiliaires indigènesdevaient jouer un rôle important. Le personnel autochtoneétait donc considéré comme le moyen d'éducation et de pénétration le plus sûr « grâce à ses affinités de race et de langue,par sa connaissance des habitudes et des préjugés » (instructions données par le gouverneur général en 1926 cité parGaye, 1997). C'est seulement à partir de 1930 que l'instituteurse vit confier une tâche d'éducation sanitaire (Gaye, 1997).
Les pasteuriens étaient donc les acteurs dominantsdans l'apport du discours sur le microbe, les « tradipraticiens »
n'ayant pas été associés au programme sanitaire colonia13.Cette domination prévalait d'autant plus que la pratiquemédicale des marabouts et des guérisseurs, considéréecomme illégale par le pouvoir colonial, était frappée d'interdiction. Il s'avère que le « discours biomédical occidental s'estérigé en un système culturel dominant et dominateur, qui aconstitué un aspect des attitudes générales des Européens àl'égard des autres et une facette du pouvoir colonial»(Becker, 1993).
Aujourd'hui, l'éducation de l'hygiène en Afrique constitue toujours un programme à part entière au sein de la politique sanitaire. Elle est considérée par les professionnels dela santé une « partie intégrante et élément vital de tout pro-
3 Par ailleurs, Gaye explique dans sa thèse que des marabouts sénégalaisont également véhiculé auprès des populations des notIOns biologiquesde contagIon. Ils se référaient à un ouvrage intitulé" Les trésors de lasanté ", retraduit en 1825 par un médecin égyptien qui s'inspirait desthèses « contagionistes ".
380 Les maladies de passage
gramme de santé publique et de soins médicaux » (Bomba,1983).
Les discours actuels des professionnels de l'hygiène
Les données présentées ici sont tirées de manuelsd'assainissement de l'Organisation Mondiale de la Santé(O.M.S.), destinés aux techniciens sanitaires (Lanoix, 1960 et1976 ; Rajagopalan, 1975). L'argumentaire développé dansces manuels reproduit la rhétorique pasteurienne, qui, aprèsune rapide exposition des faits bruts, aboutit immédiatementaux mesures sanitaires à appliquer.
L'exposition des problèmes par la causalité germe-vecteur-maladie
Par exemple, l'explication des modes de transmissiondes maladies intestinales privilégie la radicalisation del'imputation étiologique exogène: « Les maladies intestinalespeuvent être dues à des bactéries, des parasites ou des virus(la source d'infection). Ces agents, rejetés par les malades (oules porteurs) dans leurs excréta, infectent les personnes enbonne santé qui les ingèrent (l'hôte réceptif) » (Lanoix, 1960et 1976).
L'explication du « mode de transmission» entre lasource et l'hôte fait intervenir différents vecteurs, qui transmettent la maladie de façon mécanique. En effet, « l'infectionse produit, soit par l'intermédiaire de mains contaminées pardes excréta et portées à la bouche, soit lors de la consommation d'eau, de lait ou d'aliments contaminés. Les mouchesdomestiques peuvent également jouer un rôle dans cettetransmission ». Outre la source de la contamination, lesmesures d'hygiène vont s'attaquer à ces vecteurs clairementidentifiés (Lanoix ibid. ).
Les mesures à prendre
Les mesures à prendre sont présentées comme radicales: « La seule solution efficace consiste à pourvoir tout lepays d'adductions d'eau potable et d'installations sanitaires
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté 381
pour l'évacuation des excréta, et à prendre des mesures complémentaires en matière d'hygiène alimentaire, d'éducationsanitaire et d'hygiène personnelle » (Lanoix, ibid.).
Ce découpage rhétorique en 2 temps permet plus efficacement de mettre en relief l'impact des mesures sanitaires.Dans certains manuels, des schémas illustrent cet argumentaire à 2 temps : les modes de la « transmission de la maladieet l'arrêt de la transmission des maladies par l'assainissement.
Le discours actuel des opérateurs de développement
Nous ne présenterons dans ce paragraphe que les discours sur l'hygiène, centrés sur les programmes d'assainissement et de collecte des déchets. Nous soulignerons les traitsconvergents des argumentaires des différents opérateurs desprogrammes, membres des O.N.G et des responsables desG.I.E. de quartier!. Ces arguments théoriques forment aussil'armature des messages d'éducation sanitaire délivrés parles membres des G.I.E. auprès des habitants des quartiers.Argumentation qui reproduit et simplifie la rhétorique pasteurienne6 en articulant ses explications en 3 temps: la source de maladies, le mode de contamination et les mesures àprendre.
La source des maladies est associée aux déchets
De façon abstraite, les animateurs présentent toujoursles « déchets» aux familles de façon générale et simplifiée.Désignés indistinctement comme « déchets ménagers » ou« domestiques », ils constituent une catégorie unique, homogène et standardisée, sans faire de distinction sur leur com-
4 Les arguments des discours sont issus d'entretiens tenus avec la responsable de la sensIbilisation du " volet féminin» de rÜ.N.G. RüDAL et sontextraits d'un document destiné aux formateurs (selon la méthode" Sarar »)utilisé par le service d'Hygiène et les comités de salubrité de la ville.
5 Retenons que les animateurs argumentent aussi les actions de collectepar des logiques d'ordre économique et écologique. Au final, les motivations des activités de collecte et de recyclage des déchets sont triples:hygiénique, économique et écologique.
382 Les maladies de passage
position ou la nuisance générée. C'est le « déchet» qui, via des« microbes » et autres vecteurs, transmet « des maladies ».
Vecteur de maladies, il constitue « un grand risque de pollution avec pour conséquence l'éclosion de maladies infectieuses et parasitaires » (journal de RODAUAoût 98).
L'explication des modes de contamination s'appuie sur uneétioloérie simpliste
Pour une animatrice, la maladie est provoquée par le« transfert d'un microbe », ce dernier étant décrit comme« un être invisible qu'on ne peut pas voir à l'œil nu », en letraduisant en Wolof par l'expression « Doomu Dianéroro » (lagraine de la maladie).
Pour expliquer le concept de microbe lors des séancesde sensibilisation, certains animateurs recourent à une miseen scène du caractère microscopique des germes pathogènes.Ils comparent un seau d'eau limpide à un seau d'eau danslequel ont été ajoutées quelques gouttes de parfum. Le premier représenterait une eau pure indemne de microbes; ledeuxième une eau contenant des « microbes invisibles à l'œilnu ». L'aspect de ces deux eaux ne diffère pas, alors qu'ellesdiffèrent par le goût. Ils en concluent que « le microbe agitcomme le parfum, il transforme la qualité de l'eau sans quecela soit visible ».
Les circuits de contamination sont aussi présentés defaçon mécanique comme des liens entre la source, le vecteuret la bouche. Les sources de contaminations sont « les excréta, les sources d'eau polluées, les déchets ». Les voies decontaminations sont « la main, une mouche, des animaux etdes oiseaux ». Ce sont « les routes que vont suivre lesmicrobes pour nous rendre malades ». Concernant lesdéchets, le message majeur se concentre sur « les mouches(qui) se développent sur un tas de déchets, et sont en contactavec la saleté et viennent ensuite se poser sur les aliments ».
Pour expliquer le concept de microbe, les animateursont également recours au terme religieux « Sobe », qui feraitréférence à une notion d'impureté. D'après mes interlocuteurs, « Sobe » signifierait « quelque chose accolé à un objet
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté 383
et qui n'est pas propre ". Il s'approcherait du tenne religieuxde souillure. Dans ce cas, la traduction en Wolof de « microbe"à « Sobe " génère un glissement de sens, qui nous fait alorspasser d'un concept biologique à une représentation culturelle traditionnelle que les agents de santé associent au domaine du religieux.
Les modes de préventions hygiéniques sont présentés commedes « barrières» pour éviter la contamination
En préconisant « l'usage de latrines, de sandales, depoubelles, de sources d'eau protégée (puits, source) " et« l'habitude de protéger sa nourriture et de jeter les excrétades enfants dans des latrines ", ces mesures sont présentéescomme opérantes à différentes échelles: individuelle (lavagede mains, usage de sandales), domestique (protection de lanourriture, usage de poubelles, latrines) et publique (protection de sources).
Confrontons maintenant ce discours aux pratiques etaux discours associés à la gestion des déchets.
Les pratiques de propreté sur le terrain: la gestion des déchets
Des déchets sont produits au cours des opérations denettoyage de l'espace domestique et de préparation des aliments de cuisine. Deux types de déchets sont générés:
- les résidus du balayage « Mbalit ", déchets ordinairesqui sont le plus souvent stockés dans l'enceinte de la cour ousur le pas de porte avant leur collecte
- les résidus de cuisine, qui font l'objet d'un traitementspécial avant collecte ou qui sont jetés immédiatement horsde l'enceinte de la cour
Les résidus de balayage « Mbalit »
Balayé, amoncelé, tamisé, le « mbalit », déchet ordinaire de la maison, est le résidu de la mise en ordre, de la réorganisation quotidienne de l'espace domestique lors du
384 Les maladies de passage
balayage et du nettoyage. Il finit par être éliminé, mis dansun récipient pour être évacué hors de l'espace de la cour. Ilest principalement constitué de matériaux composites. Il rassemble tout ce que l'on ramasse après le balayage: vieuxpapiers, feuilles mortes, branches, charbon, restes de repasmais aussi bouts de tissus et sachets plastiques usagés, potsvides (contenants), vieilles piles et plus généralement « ceque les enfants jettent par terre "...
L'opération simple du balayage, « balaie ", est toujoursconfiée à une jeune fille ou à la bonne de la maison. Elledébarrasse le sol des objets divers qui y traînent tout autantqu'elle permet d'effacer les traces des activités de la veillesur le sable par de nouveaux tracés réguliers de balayage enépi ou en cercle.
Un balayage « en grand" est effectué au minimum unefois par jour sur tout l'espace de vie familial. Les espaces depacage des animaux ne sont nettoyés qu'une fois par semaine, souvent le dimanche. Aussi, de nombreux balayagesrapides « en petit » sont répétés au cours de la journée sur deplus petites surfaces. On balaiera par exemple les reliefsjetés sur le sol pendant les repas (os ou arêtes de poissons),les urines et excréments abandonnés par un bébé gambadeur, les traces d'éclaboussures des eaux de cuisines oud'ablutions qui auront séché sur le sable, des feuilles mortesaccumulées, le sable sur une surface cimentée ou sur le solen lino d'une chambre, etc.
Effectué dès l'aube, avant le petit-déjeuner, le grandbalayage matinal commence dans la cour « Ker gi ". Puis ilest effectué sur l'espace extérieur devant la maison « Buntuker ", sur l'espace limitrophe empiétant sur une portion ousur la totalité de la rue face à la maison. Les chambres de lamaison sont balayées en dernier. Généralement, la cour deshabitations de Thiès est séparée de la rue par un mur, ouvertpar un portail. C'est dans cette enceinte clôturée que lebalayage commence, à partir d'un point opposé à ce portail.
Le sol des cours de Thiès est ordinairement sableux,rarement dallé, empierré ou cimenté, sauf par endroits.Lorsqu'on utilise le balai à manche long« balai taxaw » (balaidebout), c'est pour balayer une grande surface, où les résidus
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté 385
vont être accumulés en plusieurs petits tas. Les petites surfaces, comme les surfaces cimentées (dalles, pas de porte,espace de mosquée) sont balayées avec le petit balai en herbe« balai sëgg » (balai courbé). Le travail peut s'effectuer defaçon circulaire autour d'un point fixe, comme un arbre, oude façon linéaire à partir d'une surface rectiligne, commecelle d'un mur.
Pour la partie extérieure hors de l'enceinte de la cour,des bandes sont balayées à partir du mur de la concessionparfois jusqu'à une frontière qui peut fluctuer d'une pratiqueà l'autre. On balaie parfois jusqu'au centre de la rue, les voisins d'en face nettoient alors l'autre moitié. Sinon, on s'arrêtesouvent à un léger changement de relief du sol (passage dusable à la latérite) ou passage du sable au goudron. Ce dernier marque concrètement des frontières symboliques avecun territoire à la charge de la municipalité.
Les chambres des maisons sont balayées en dernier.Après le balayage avec le « balai sëgg ", le sol souvent recouvert de lino plastique peut être lessivé avec de l'eau et de lapoudre de lessive. Ces tâches se font évidemment du fond dela pièce jusqu'à la porte.
Les feuilles mortes « Xob » méritent une attentiontoute particulière par le soin qu'on applique à leur élimination quotidienne. Il arrive que les feuilles constituent le volume le plus important des déchets ramassés par le charretier.Les cours sont systématiquement débarrassées des feuilles.Dans certains quartiers de la ville de Thiès, tels que la citéBallabey, ancien quartier colon, aujourd'hui aire résidentielle des cadres fonctionnaires de la Société Nationale desChemins de Fer, les larges rues ombragées font l'objet d'unbalayage minutieux des feuilles, qui seront brûlées ou mêmecollectées par le charretier.
Après le balayage, le plus gros des déchets composé derésidus divers (os, plastique, papier etc.) et de feuilles mortesest ramassé directement à la main ou en s'aidant d'un boutde carton, en faisant un tri grossier entre les résidus, lesfeuilles mortes, le sable ou le gravier.
La femme effectue pour finir une opération de tamisage de ce qu'elle ne peut pas séparer à la main. A l'aide d'un
386 Les maladies de passage
petit tamis « tamé ", elle opère la séparation des petits résidus « Mbalit » avec le sable et le gravier. Ces derniers sontdispersés sur le sol. Seul le « Mbalit » doit être jeté dans lefût. Lors de la collecte, le charretier peut refuser d'emporterles déchets mélangés à de grande quantité de gravier ou desable; il vide alors le fût, effectue son propre tri à l'aide d'unrâteau, en haranguant les femmes pour qu'elles tamisentleurs déchets. Le tamisage est donc essentiellement pratiquépour les sols sablonneux. Les espaces intérieurs de la courainsi que les espaces extérieurs limitrophes sont soigneusement tamisés pour séparer les résidus du sable.
Le déchet terminal « Mbalit » est finalement jeté dansun récipient ouvert. On utilise des grandes bassines métalliques au fond usé, appelées « Grangal » et ayant servi auparavant pour la lessive du linge, ou la « baignoire Xotoupan »,
grande bassine plastique pour la conservation de l'eau, despaniers tressés « Panier » généralement utilisés pour lavente des produits maraîchers et des mangues. Les demi-fûtsmétalliques appelés « poubelle » sont utilisés plus rarement.Avant d'être vidés, ces récipients sont conservés dans unendroit derrière la maison « ginnaaw kër gi " ou « dans lacour, au coin, au fond » Mais le plus souvent ils sont entreposés dans la cour, au plus près de la porte, ou encore à l'extérieur de la maison, près de la porte. Exceptionnellement, lesdéchets sont jetés dans un trou creusé dans la cour.
Les déchets de cuisine
Les déchets de cuisine ne sont pas forcément mis à lapoubelle ou jetés sur un tas d'ordures dans la rue. Du fait deleur composition différente et par la nuisance directe qu'ilsgénèrent, ils subissent un traitement particulier. Ils sontrarement mélangés au « Mbalit ». On distingue les restes desaliments « Desitu nam » des déchets de poisson « Tiaxon ».
Les restes des aliments « Desitu nam »
Les restes des aliments « Desitu nam » sont constituésde manière générale de riz, mil, poisson et légumes auxquelssont ajoutées les épluchures de la préparation. Ces résidus
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté 387
sont le plus souvent destinés aux animaux: on les porte auxmoutons ou aux volailles élevés dans la cour. Parfois on lesabandonne aux chats et chiens, en les disposant sur un carton, devant la maison ou plus loin sur un dépotoir.
Fréquemment, ces déchets sont collectés par des éleveurs de porcs, qui les utilisent comme nourriture pour lescochons, appelée « Nyamumbam ». Les restes alimentaires« Desitu iiam » sont alors déposés dans un petit seau couvert, gardé près des poubelles jusqu'au passage de l'éleveur.Ils sont parfois transportés jusqu'au tas extérieur de déchets,pour être déversés à côté du tas de « Mbalit » sans y êtremélangés pour permettre leur récupération par l'éleveur.Pour faciliter sa collecte, il arrive que les familles du voisinage viennent verser leur « Desitu iiam » dans un seau accrochéà un arbre près du dépôt d'ordures. Par le choix d'un lieuparticulier de dépôt et l'usage d'un container spécifique, onévite soigneusement tout mélange des restes alimentaires« Desitu iiam » avec les autres déchets. Par cette opération,le " Desitu iiam » perd son statut de déchet et se tranformeen un précieux aliment d'élevage: le « Nyamumbam ».
Les déchets de poisson « Tiaxon »
Les déchets de poisson « Tiaxoii » sont constitués d'unmélange d'ouïes, d'écailles et de viscères provenant de la préparation des repas, entre Il h 00 et midi parfois après lepassage du charretier. Le plus souvent, à cause de l'odeur deputréfaction très forte qui s'en dégage rapidement, on évitede mélanger le " Tiaxoii » frais avec les autres déchets. Troiscas de figure ont été rencontrés au cours de l'enquête: ledéchet est soit jeté directement sur un dépotoir de la rue oudans le container, soit, après séchage au soleil, jeté avec le« Mbalit », soit encore enterré dans un petit trou creusé spécialement dans la rue. Pour le séchage, après séparation del'eau et des parties solides, le « Tiaxoii » est étalé au soleildevant ou derrière la maison. Après séchage (et passage deschats), il ne reste plus que les écailles sèches qui pourront,après tamisage, éventuellement rejoindre la poubelle de« Mbalit ». Les femmes s'arrangent donc pour éliminer auplus vite ce déchet sans attendre la collecte.
388 Les maladies de passage
D'autres types de déchets sont encore produits dansl'espace domestique. On peut citer pour mémoire les eauxusées, les eaux d'ablution, les selles des enfants, les déchetsde pacage des animaux. Les eaux usées sont jetées au milieude la rue ou dans le puisard. Si elles sont produites en petitequantité (toilette rapide, rinçage d'un ustensile), elles peuvent être jetées au pied d'un arbre de la cour. Les ablutionsprécédant la prière sont effectuées à un endroit spécifique dela cour, le « diapukay ", sur une pierre, une brique posée àmême le sable, où les eaux pourront s'évaporer d'ellesmêmes. Les selles nocturnes des enfants contenues dans despots de chambre ou celles des bébés récupérées avec un morceau de bois, du carton sont jetées dans les latrines. Lesdéchets de pacage des animaux « Nefre Xer » sont jetés hebdomadairement avec le «Mbalit ".
En résumé, ces pratiques génèrent au moins troistypes de déchets, qui vont chacun suivre une filière de traitement qui lui est propre.
Type de déchet Composllion Traitement
RésIdu de balayage/
taml,age:
Mbalit Papiers et contenants Poubelle/collecte par le
usagés. feuille, mortes. charretler/ mise en dépôts
etc. extérieurs
Déchets de CUISIne'
Restes des alIment, Epluchures et reste, de nourriture pour les
Desltu nam nz. mIl. pm,son , légumes animaux domestiques ou
etc pour les éleveurs
exténeurs
Déc het de poisson
Tiaxoii Têtes, OUles, écaIlles etc. séchage au soleil ou
enfouissement Immédiat
On constate donc que la pratique domestique du tri estplus complexe que ne le pensent des discours de sensibilisation, qui n'évoquent qu'un type unique de déchet et supputent un nettoyage succinct des cours africaines.
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté
Les discours populaires autour des déchets
389
Deux registres principaux de discours se sont dégagésdes commentaires des femmes sur leurs pratiques de gestiondes déchets. Le premier registre n'a aucun lien direct avec lasanté, il se rattache aux nuisances générées par la visibilitéimmédiate des déchets. Le deuxième registre traite directement des maladies. Le discours musulman d'ordre symbolique n'a pas été évoqué par les femmes 7.
Les déchets visibles
Les déchets générateurs de désordre
Les notions d'ordre et de désordre apparaissent implicitement par l'emploi en Wolof de deux termes différentspour désigner un même déchet qui se présente dans des étatsdifférents: le terme « Salté » et le terme « Mbalit ».
La « Salté »8, c'est le déchet à l'état dispersé, noncontrôlé. On l'utilise pour désigner l'ensemble des matériauxencore éparpillés sur le sol de la cour avant le balayage. Leproduit ultime de cette mise en ordre, une fois rassemblé entas, devient le déchet « Mbalit ». La « Salté » fait donc référence à l'idée de désordre : on utilise aussi ce terme en montrant les feuilles mortes sur le sol ou des herbes qui n'ont pasété coupées. Cet exemple permet d'étayer la thèse de MaryDouglas, qui constate qu'après avoir « détaché la pathogénieet l'hygiène de nos idées sur la saleté, il ne nous reste decelle-ci que notre vieille définition: c'est quelque chose quin'est pas à sa place» (Douglas, op. cit. 1992). La saletéconstitue « une offense contre l'ordre ». Si le déchet fait sale,c'est parce qu'il est « essentiellement désordre ». L'acte denettoyage des déchets, en éliminant la « Salté » de l'espace,permet alors « d'organiser le milieu ». Le déchet devient le
7 Les pnncipes coraniques sont rarement évoqués, peut-être du fait qu'ilss'intéressent plutôt aux souillures provoquées par les excrétionshumaines qu'à celles liées aux déchets?
8 Terme d'emprunt au Français.
390 Les maladies de passage
« sous-produit d'une organisation et d'une classification dela matière, dans la mesure où toute mise en ordre entraîne lerejet d'éléments non appropriés ". (Douglas, ibid.). On a vuprécédemment qu'en assignant une nouvelle place et uncontainer spécifique au déchet alimentaire « Desitu fiam ", onlui confère un autre statut: il n'est plus déchet mais alimentpour cochons « Nyamumbam".
Les déchets et la norme sociale
Le balayage s'apparente donc à une gestion du visible,liée à des notions d'ordre ou d'esthétisme. Le balayage régulier des feuilles mortes « Xob » serait vraisemblablementmotivé par ce type de logique. Souvent, les femmes ont souligné l'importance du travail de balayage et d'élimination desfeuilles mortes. A priori, les feuilles constituent plus une nuisance visuelle qu'un risque d'ordre sanitaire. En jonchant lesol de la cour, elles renforcent cette impression de désordre,de « salté " qui émane d'une cour non balayée.
On dira parfois que « balayer sa cour, c'est comme porter de beaux habits" ou si on balaie devant sa porte, c'estparce que c'est beau à voir« Rafetna giis ", « chacun balaie saplace pour faire beau ", comme on donnera un coup de balaisur le sable pour effacer les traces d'éclaboussures séchées oud'ablutions. Toujours sur les traces du visible qui se donne àvoir, les femmes m'ont souvent souligné l'importance querevêt la propreté de sa cour pour retenir un visiteur de passage. L'espace propre doit lui « donner envie de rester ",parce qu'après avoir balayé, « c'est tellement propre qu'onpeut presque s'asseoir ou dormir par terre ".
La propreté de l'espace révèle ainsi les capacités de lafemme à gérer l'ensemble de la vie familiale. Cette préoccupation participe aussi aux rivalités entre des co-épouses(dénommées « Wujj " en WoloD, chacune essayant de s'attacher leur mari par des démonstrations de son excellence àmaintenir un foyer en ordre.
Dans le même ordre d'idée, l'enlèvement des ordures àdomicile relève d'une concurrence de voisinage pour le prestige.Ce service peut représenter un signe extérieur de richesse: « il
L'hvgiène et les pratiques populaires de propreté 391
y a les familles qui peuvent payer ce service à leur porte etcelles qui en sont réduites à les jeter nuitamment ",
L'acte de nettoyage apparaît donc à travers ces proposcomme étant conditionné par les normes sociales de bonneconvenance, le nettoyage de l'espace domestique est motivépar un respect des normes sociales fondées sur une propretévisible dissociée des principes d'hygiène, Cette propretévisible appliquée à l'espace participe ainsi à un processus dedistinction sociale.
A cet égard, les toilettes corporelles faites avec négligence peuvent susciter des moqueries. Ainsi, un termemoqueur désigne en wolof les pratiques des gens qui n'ontqu'une propreté d'apparat, extérieure et superficielle: la« Tiet Guinar », c'est-à-dire la « propreté de la poule ».Comme la poule qui entretient fièrement un plumaged'aspect toujours propre, mais qui défèque partout et salittout; ces gens ont un « extérieur qui est propre» mais « leurintérieur reste sale ». « Leurs vêtements sont propres quandils sont dans la rue ou quand ils mangent, ils ne veulent pastrouver un grain de sable dans leur plat. Par contre, chezeux, c'est sale, même leurs ustensiles de cuisine ne sont paslavés ». L'intérieur de la maison correspond aux partiescachées du corps, ils sont aussi ceux, qui ne font qu'une toilette extérieure « Tiet / set guistal » (la propreté visible) en secontentant de ne laver que les parties visbles (visage, piedset mains).
Les déchets et les maladies
Deux tendances associées aux notions de santé se sontdégagées des commentaires des femmes. L'une se limite àdes notions générales issues des discours officiels ; l'autre,plus empirique, associe plus précisément les déchets et lesmaladies via les vecteurs de transmission.
Une étiologie pasteurienne tronquée
Les premières explications générales s'appuient surune logique qui associe globalement les déchets « Mbalit,
392 Les maladies de passage
salté " aux maladies, sans apporter plus de précision. Ondira simplement que « le déchet est responsable de maladies ",que « c'est pas bon".
Ces explications reprennent généralement des bribesde discours officiels. Les termes de « microbes ", « germes"sont alors associés à la « salté ". Certaines femmes se référent aux émissions de télévision hebdomadaires ou aux messages de sensibilisation prodigués par les agents du Serviced'Hygiène: « des fois, nous regardons la télé avec les enfantsoù on nous montre les dangers avec les microbes» ou encore,« Je ne connais pas comment les maladies se transmettent,on me demande de me méfier des déchets par les messagestélévisés ou par les agents du service d'hygiène ". Cependant,cette notion de danger associée aux déchets est bien évidemment intégrée à l'organisation quotidienne de l'espace de vie.Une femme m'expliquera qu' « on met les ordures dehors eton garde les enfants à l'intérieur, parce qu'on peut perdre devue les enfants qui vont jouer dans la cour avec les déchetsqui contiennent des microbes ".
Par ailleurs, les liens de causalité déchets-vecteursmaladies sont souvent morcelés et les termes mélangés.Pratiquement « toutes les maladies" sont citées en vrac: lepaludisme « Sibbiru ", les maux de ventre, le choléra et lesdiarrhées, les démangeaisons « waga ou xamou », la fièvrejaune, les vers « qui vont rentrer dans la peau des enfants ",le rhume ... Ce premier degré de discours assez évasiftémoigne cependant de l'attention que les femmes portentaux messages de sensibilisation, sans pour autant les avoirassimilés dans toutes leur complexité9.
9 Cette tendance à amalgamer les maladies dans une sorte d'inventaire« à la Prévert" se retrouve aussi dans les journaux. Je cite un articleconcernant un projet d'élimmatIOn des déchets biomédicaux à Dakar,où le journaliste reprodUit les propos d'animateurs de projets: « Cesdéchets constituent des menaces réelles sur les populations. A ce titre,(ils) soulignent une panoplie de maladies transmIssibles par le biais desdéchets biomédicaux: l'hépatite, le tétanos, les anguilles, les ankylostomes, l'ascaris, la tuberculose, VOIre même le Sida, la fièvre de Lassa,les maladies à VIrus Ebola et de Marbourg, la fièvre hémorragique et lafièvre hémorragique de Crimée-Congo peuvent se produire à travers lesdéchets médicaux" (Le Matin du 29 Juillet 1998).
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté
Des étiologies empiriques
393
Abordant un deuxième degré de discours plus précis,les femmes identifient trois vecteurs principaux responsablesde maladies en rapport avec les déchets: les insectes(mouches et moustiques), les odeurs et les poussières,
Premièrement, on attribue aux mouches de nombreuses maladies, Elles provoquent des maux de ventre, desdiarrhées et des vomissements par simple « contact avec lesaliments» ou même en « libérant du poison (Pusen) dans lanourriture ». Elles provoquent aussi la fièvre « Sibbiru » :
lorsque « la mouche te pique, elle libère du poison dans l'organisme avant de sucer le sang ». Elles peuvent aussi transmettre des démangeaisons «Xassan », des plaies« Gomm» etla lèpre : « Si la mouche touche un lépreux, elle transmet le« tjangoro» (poison originel) à la personne saine ».
Plus précisément, le lien de causalité entre le déchet etla fièvre « Sibbiru » (<< paludisme ») est toujours clairementexpliqué à partir des moustiques, ce qui apparaît comme lesigne d'une intégration des messages de sensibilisation. Laprolifération des moustiques peut être associée soit auxdéchets, « Les ordures permettent le développement desmoustiques qui transmettent le paludisme », soit aux eauxusées, « Il y a beaucoup de moustiques à cause des égouts.Après avoir vidangé les fosses septiques, certains versent çadans les caniveaux ».
Deuxièmement, les mauvaises odeurs sont considéréescomme responsables du rhume. Le lien direct entre l'odeur etla santé est résumé par le proverbe wolof qu'une femme citera en plaisantant : « Xet Gu bonn, dei gatal aw fan; Xet guneex, dei gudel aw fan» (Mauvaises odeurs, vie brève;Bonnes odeurs, longue vie). En effet, « les mauvaises odeurs,c'est dangereux» : elles vont «jusqu'au fond des poumons»et provoquent les trois caractéristiques du rhume: le« Xurfann » (mal de gorge), le « Sëd » (écoulements du nez)et le « Diamboutan Xulet » (combinaison des deux). C'estpourquoi on accorde donc une attention particulière auxdéchets de poisson « Tiaxoii ». Une femme m'expliquera que« C'est surtout le Tiaxoii qui peut apporter les maladies àcause de l'odeur. La mauvaise odeur (Xet Bubann), ça ne se
394 Les maladies de passage
supporte pas. Parmi les mauvaises odeurs, ça, c'est trèsgrave. Le Tiaxoii peut apporter le rhume et n'importe queltype de maladie. Après 5 minutes, ça commence à sentirmauvais, alors que les épluchures ça ne pue pas; les épluchures peuvent être jetées avec les autres déchets (MbalitJ.Mais si on mélange le Tiaroii avec les ordures, l'odeur seraencore plus forte « Dafaxeii » (ça sent), et si on les garde pendant 1 à 2 jours « Dafaxeii bubbar » (ça sent très fort) ».
L'odeur de putréfaction appartient aussi aux cinq catégories d'odeurs perceptibles chez les Sereers Ndut : le Sunqualifie l'odeur d'urine, le hot le pourri, le hes le lait et lepoisson, le pirik et le pen désignent des odeurs acides etdésagréables. Dans ces représentations, l'odeur de pourri neconcerne que la pourriture végétale. Les animaux vivant également dans la boue ou la saleté sont associés à ces odeursnauséabondes (Dupire, 1987).
Cette étiologie empirique basée sur les odeurs apparaîtcomme universelle (Le Guérer, 1987). Déjà, elle était dominante dans les doctrines pré-pasteuriennes occidentales del'infectionnisme1o et elles étaient considérées comme agissant directement sur la santé. Les odeurs de putréfactiontelles les effluves de cimetières, les fosses d'aisances, lesmarécages étaient considérées comme pathogènes. L'originede la peste était attribuée à la corruption de l'air provoquantun déséquilibre interne du corps mis en contact avec ces« miasmes» malodorants. Jusqu'aux découvertes à la fin duXIXe siècle du bacille pesteux par Yersin, la peste a été pensée en rapport avec l'odeur (Le Guérer, 1990).
L'approche structuraliste soutient que toutes les cultures font la distinction entre des odeurs attirantes et desodeurs repoussantes, catégories naturelles qui symbolisentles extrêmes sociaux. (Almagor, 1990).
Les historiens ont constaté que les odeurs associéesaux maladies ont contribué à la stigmatisation de certainescatégories professionnelles sociales ou raciales. En Occident,
10 L'odeur a également pu agir en Occident comme un révélateur de lamaladie dans un diagnostic médical. Le diagnostic olfactif était déjàprôné par Hippocrate et repris par des médecins du XVIIIe et XIxesiècles.
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté 395
les corps de métiers voués aux tâches malodorantes ont faitl'objet d'évitement dans la France de la Renaissance ou del'Ancien Régime. Tenues comme responsables des maladies àcause de leur forte odeur, les populations pauvres ont étéstigmatisées par des mesures d'isolement dès le XVIIe siècle.Au XIXe, le peuple a été l'objet d'une vigilance inquiète de lapart du monde bourgeois qui cherche à le désodoriser(Corbin, 1982; Larguey, 1972 ; Le Guérer, 1990).
Sans rapport avec la maladie ou la sorcellerie, l'odeurpeut aussi agir exclusivement comme instrument de discrimination sociale: au Nord du Nigeria, l'odeur permet de distinguer la caste des forgerons des autres villageois (VanBeek, 1992).
Notons aussi, que dans le registre religieux sénégalais,certaines associations existent entre la maladie et l'air. Eneffet, sans faire directement référence aux odeurs, certainesmaladies sont attribuées à l'air par les Seerer siin duSénégaL Des entités maléfiques ou des djin, en pénétrantsous la forme d'un tourbillon d'air chaud par les pores de lapeau, migrent vers les poumons pour les assécher (Kalis,1997).
Enfin, la poussière est considérée comme déclencheurdes formes de rhume, particulièrement lors du balayage oudu tamisage. On cite aussi la poussière comme vecteur de lafièvre jaune lorsque qu'on respire « la poussière de déchetscontenant les crachats de quelqu'un de malade ». Ces notionsde transmissions de maladies par les poussières n'entraînentpas de conduites particulières et il est assez rare lors dutamisage ou du balayage, qu'une femme se protège le visageà l'aide d'un foulard.
En résumé, on constate que les femmes essaient dereconstituer une logique générale des discours officiels, oùsont évoquées des notions de liens de causalité entre déchetset maladies et des notions de microbes en recomposant lesmessages suivant d'autres « raisons ", plus sociales que sanitaires. Par ailleurs, il existe des « décalages " entre les discours médicaux et populaires. Ainsi, :
Les résidus de balayage « Mbalit » et « Salté " sont perçus par leur visibilité immédiate, comme responsables de
396 Les maladies de passage
perturbations d'ordre visuel au sein de l'espace de vie familial. Leur gestion répond avant tout à des normes socialesapparentes de bonne convenance. La transmission de maladies n'apparaît qu'en second plan
- les déchets de poisson « Tiaxon » sont perçus par leurodeur de putréfaction. L'odeur peut alors affecter le corps enprofondeur pour provoquer le rhume
Il en résulte que le discours populaire correspond àune sorte d'hybride associant à la fois des bribes d'une étiologie médicale pasteurienne et une étiologie empirique baséesur la perception sensible immédiate. Le registre exclusivement hygiéniste ne permet donc pas d'intégrer la complexitéd'une logique domestique composant avec une certaineappréhension du déchet défini comme ce qui est visible et unregistre socioculturel où la propreté symbolise des notionsd'ordre et d'esthétisme et participe à des processus de discrimination sociale
A comprendre cette complexité, on peut se demandercomment les messages d'IEC ramenés à de simples formulespeuvent avoir une quelconque fonction informative auprèsdes femmes,?
Conclusion
Les messages d'IEC sont souvent conçus de manièrestandardisée par des organismes internationaux, et ce volet« Information Education Communication ". Cette activité,reconnue à part entière dans les projets de développement,fait intervenir nombre de spécialistes professionnels, deconsultants, de manuels, d'outils pédagogiques, de stages deformations, de séminaires etc. Elle se présente donc commeune institution incontournable et correspond à diverses stratégies « internationales" et locales des acteurs des projets dedéveloppement. Ces projets et programmes constituent une« arène " entre des « groupes stratégiques " dont les enjeuxsont divers (Olivier de Sardan, 1995).
Ainsi, à Thiès, de multiples acteurs interviennent dansla collecte. Ils appartiennent tant au domaine institutionnel« public" (services municipaux d'hygiène et de voirie) qu'au
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté 397
domaine du « privé» (G.I.E. et O.N.G.)l1, qu'au monde de« l'informel» (charretiers et récupérateurs). Ces différentsopérateurs entretiennent des rapports oscillant entre complémentarité et rivalité. Au moment de l'enquête, troisgroupes principaux se trouvaient effectivement en concurrence ouverte. L'enjeu de la compétition entre ces groupesapparaissait comme double: il visait d'une part l'obtentionde financements publics de la municipalité et d'autre part lastabilisation ou l'accroissement de la clientèle et de territoires d'activités (quartiers et marchés).
Dans cette course aux financements, les membres desGIE déployaient essentiellement des stratégies d'ordre politique par des jeux d'alliance et de rupture entre groupes pourmieux contrer le concurrent. A ce niveau économique, tenirun discours cohérent sur l'hygiène n'est pas indispensablepuisque l'action s'inscrit d'office dans une politique sanitairedéjà instituée. L'enjeu ne consiste pas à convaincre les décideurs de la nécessité de programmes sanitaires mais plutôt àmettre en valeur ses capacités à réaliser un programme. Ilest alors plus crucial de maîtriser le montage technico-financier du projet et la mise en forme de la proposition écrite.
Par contre, l'usage du discours sur l'hygiène est opératoire pour s'attacher une clientèle. Sur le terrain, il participepleinement aux stratégies des opérateurs dans la recherchede la stabilisation ou de l'accroissement de familles adhérentes à leurs services. Dans leur quartier, les membres d'unG.I.E. sont directement confrontés à la concurrence dont ilspeuvent ressentir de façon aiguë les effets au jour le jour, parl'accroissement ou le recul du nombre de client(e)s. L'usagedu discours sur l'hygiène intervient alors à deux niveaux :
11 Les G.I.E. (Groupements d'Intérêts Economique) sont, pour la plupart,d'anciennes associations féminines" Mbotaye ". Au nombre de trenteréellement opérationnels sur la ville, ils constituent aujourd'hui lesprincipaux opérateurs privés de la collecte dans les quartiers. LesO.N.G (Organisation Non Gouvernementale), dont les principalesœuvrant pour la collecte des déchets sont ENDA (Sénégal), RODAL(USA) et LVIA (Italie), interviennent comme intermédiaires concepteurs des projets en apportant un encadrement technique à la réalisation des activités des G.I.E. Elles reçoivent les financements debailleurs (coopération, UNICEF, PNUD, CEE etc. ) qui sont ensuitealloués aux G.I.E. opérateurs de terrain.
398 Les maladies de passage
lors des séances collectives de « sensibilisation » et lors desconversations quotidiennes entre les membres du G.I.E. etleurs clients.
C'est pourquoi les cadres des G.I.E effectuent desvisites régulières auprès des habitants de leur quartier, dansdes buts de démarchage et de sensibilisation à leurs activités. Ces visites sont l'occasion de sonder l'état de satisfactionde leurs clientes et de recueillir des conseils pour améliorerleur service. Lors de ces visites, les arguments de protectioncontre les maladies sont souvent évoqués pour soulignerl'importance des activités de collecte. Les opérateurs duG.I.E. tiennent à cet égard un discours assez clair reproduisant la rhétorique pasteurienne. Les femmes acquiescent pardes réponses composant un discours hybride intégrant lesnotions vagues sur le microbe et les notions populaires decontagion.
Le plus souvent, les arguments liés à la santé ne sontévoqués par les femmes que lorsqu'elles commentent la gestion et le tri des déchets à l'échelle domestique. Par contre,leur choix d'adhérer à un service de ramassage de déchets àleur porte est motivé par des raisons d'ordre pratique ou économique. Pratique parce que la collecte leur évite de transporter leurs déchets jusqu'au dépôt de la rue ; économiqueparce qu'en les allégeant de cette charge de travail, elle éviteparfois d'employer une bonne.
Mais plus globalement, l'hygiène correspond aussi à unmarché économique et peut devenir une sorte d'argumentpublicitaire permettant de valider des actions selon des critères médicaux et scientifiques. Le message hygiéniste,banalisé par les opérateurs de terrain, est intégré dans leurstratégie commerciale comme un argument de vente supplémentaire pouvant séduire leur clientèle, et c'est pourquoi lesformules « éducatives» cherchent alors à être percutantes, àl'instar des slogans publicitaires12 .
12 Comme par exemple, ce message publicitaire publié dans une plaquettede luxe pour promotion du savon Pharmapur, longuement commentépar les jeunes vendeurs lors de sa distribution dans chaque maison. Eneffet, il stlpule, d'aprés « des études scientifiques ", que se laver avecPharmapur permet « de réduire de façon significative le risque d'attraper le virus du rhume ou de le transmettre aux autres» !
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté 399
On peut donc s'interroger sur la réelle valeur éducative de telles séances I.E.C", Bref, à l'issue de notre analyse, ilapparaît clairement que les enjeux ne résident pas dansl'apport d'explications supplémentaires des mécanismes étiologiques liés aux déchets. Les raisons empiriques (odeurs,mouches, poussières) couplées avec d'autres motivationsd'ordre socio-culturel (propreté visible, compétition de voisinage, etc.) sont en elles-mêmes suffisantes pour motiver desgestes d'organisation de la propreté domestique sans devoirles fonder sur des concepts biomédicaux.
Rien ne nous empêche de penser que ces motifs de nettoyage de l'espace privé soient également transposables àl'échelle des espaces urbains collectifs. Mais à ce niveaud'intervention, les vrais enjeux pour l'amélioration des conditions de l'environnement urbain, sont sans doute d'ordre institutionnel et politique et non pas pédagogique ou éducatif.Améliorer l'hygiène consisterait alors à aider à une meilleurecoordination entre les différentes dynamiques « privées» et« publiques» participant à ces processus d'appropriation desespaces collectifs.
Bibliographie
Almagor1990 « Odors and private language: observations on the pheno
menology of scent », in Human studies, 13: 253-274.
Bado J.-P.1996 Médecine coloniale et grandes endémies en Afrique, Paris,
Karthala.1997 « La santé et la politique en AOF et à l'heure des indépen
dances (1939-1960) », in Becker, Mbaye et Thioub., AOF :Réalités et héritages: sociétés ouest africaines et ordre colonial1895-1960, Dakar, Direction des archives du Sénégal:1242-1259.
BECKERC.1993 « Quelques réflexions sur l'histoire, la santé et l'environ
nement en Afrique », in Vie et Santé, n° spécial, Dakar,ORSTOM: 1-10.
400 Les maladies de passage
Becker C., Collignon R.1998 " Epidémies et médecine coloniale en Mrique de l'Ouest»
in Cahiers santé, n° 8 : 411-416.
Bomba1983 " Rôle de l'éducation sanitaire dans les programmes
d'hygiène ", in Problèmes d'assainissement dans les paysen VOle de développement. Compte rendu du colloque sur laformation tenue à Lobatsi, Centre de recherches pour ledéveloppement international d'Ottawa.
Corbin A.1982 Le miasme et la jonquille. L'odorat et l'imaginaire socwl
XVIIIe-XIXe Siècles, Paris, Flammarion.
Diop1997 « La question sanitaire durant les premières années de
l'AOF, 1895-1914 », in Becker, Mbaye, Thioub, AOF:Réalités et héritages Sociétés ouest africaines et ordre colonial1895-1960, Dakar, Direction des archives du Sénégal:1212-1227.
Domergue-Cloarec D.1997 " La prévention dans la politique sanitaire de l'AOF ", in
Becker, Mbaye, Thioub, AOF : Réalités et héritagesSociétés ouest africaines et ordre colonial 1895-1960,Dakar, Direction des archives du Sénégal: 1228-1239,
Douglas M.1992 De la souillure. Essais sur les notions de pollution et de
tabou, Paris, La découverte.
Dupiré M.1987 " Des goûts et des odeurs: classifications et universaux »,
in L'Homme, n° 104, ocUdéc : 5-25.
Fassin D.1997 " L'internationalisation de la santé: entre culturalisme et
universalisme ", in Esprit, n° 2 (février 97) : 83-105.
Gaye P. A.1997 La diffusion institutionnelle du discours sur le microbe au
Sénégal au cours de la IIIe République française (18701940), Thèse de doctorat de 3° cycle de l'Université Paris
L'hygiène et les pratiques populaires de propreté
VII Denis Diderot.
401
Kalis1997 Médecine traditionnelle, religion et divination chez les see
rers siin du Sénégal. La connaissance de la nuit, Paris,L'harmattan.
Laplantine F.1986 Anthropologie de la maladie, Paris, Payot.
Largey, Watson1972 « The sociology of odors ", in Americanjournal of sociology,
vol. 77, n° 6: 1021-1034.
Latour B.1984 Les microbes, guerre et paix, Paris, Ed. Métaillé.
Le Guerer1987 « Du miasme au microbe", in Autrement, nO 92: 115-121.1990 « Le déclin de l'olfactif. Mythe ou réalité? ", in
Anthropologie et Sociétés, vol. 14, nO 2 : 25-45.
Léonard J.1981 La médecine entre les pouvoirs et les savoirs, Paris,
Aubier.
Ndiyae1997 « La formation du personnel africain de la santé en AüF ",
in Becker, Mbaye et Thioub, AOF, Réalités et héritages .sociétés ouest africaines et ordre colonial 1895-1960,Dakar, Direction des archives du Sénégal: 1193-1201.
Ngalamulumé1997 La question sanitaire durant les premières années de
l'AüF 1895-1914, in Becker, Mbaye et Thioub, AOF,Réalités et héritages. Sociétés ouest africaines et ordre colonial1895-1960, Dakar, Direction des archives du Sénégal:1203-1211.
Olivier de Sardan J.-P.1995 Anthropologie et développement, Paris, Karthala.
Poloni A.1990 « Des pratiques de propreté dans les secteurs périphé-
402 Les maladies de passage
riques de Ouagadougou ", in Sociétés, développement etsanté, Paris, Ellipses: 273 -287.
Van Beek W.1992 « The dirty smith: smell as a social frontier among the kap
sikilhigi of north cameroon and north-eastern Nigeria ", inArrica, vol. 62, n° 1 : 38-58.
Chapitre 16
Transmission des maladies etgestion de la saleté en milieu ruralsenufo (Burkina Faso)
Fatoumata Ouattara
Selon la logique biomédicale, les mesures d'hygiènesont des pratiques incontournables pour limiter certainseffets de la contamination. De ce point de vue, il suffirait - etc'est le présupposé des interventions de développement - dechanger les pratiques d'hygiène des populations pour diminuer le taux de prévalence de certaines maladies comme lesaccès de paludisme, de dysenterie amibienne et de diarrhées.Mais les constats d'échec des multiples politiques en matièrede santé dans les sociétés africaines montrent que la réalitén'est pas simple à transformer. L'hygiène est une notionmédicale alors que les populations parlent en termes de saleté ou de propreté. Pour progresser dans ce dialogue, il estdonc utile d'investiguer les conceptions locales sur la transmission des maladies et de comprendre les modes populairesde gestion des saletés1.
Mon hypothèse est la suivante: à l'opposé de certainesconceptions biomédicales nous ne croyons pas que les conceptions populaires relatives à la transmission des maladies suf-
1 « L'idée que nous nous faisons de la maladie n'explique pas C.. ) toute lagamme de nos réactions à la saleté, que nous la nettoyions ou que nousl'évitions. La saleté est une offense contre l'ordre. En l'éliminant, nousn'accomplissons pas un geste négatif; au contraire, nous nous efforçons, positivement, d'organiser notre milieu »(Douglas, 1992 : 24)
404 Les maladies de passage
tisent à expliquer les manières de gérer la saleté quelle quesoit la nature de celle-ci. Autrement dit, les pratiques de propreté et les pratiques préventives ne se confondent pas. Lespremières relèvent des mécanismes de reconnaissance sociale propres à l'univers féminin ; les secondes semblent êtreassociées aux conceptions générales de la transmission desmaladies.
Des matériaux ethnographiques recueillis en milieusenufo nanerge2 nous permettront d'examiner cette hypothèse.
Les modes de transmission des maladies
Avant d'aborder les codes et les pratiques de propreté,il est important de présenter les représentations locales de latransmission. Cette description peut nous aider à comprendre comment les notions liées à la propagation des maladies ne se limitent pas à celles de la propreté et de la saleté.
Globalement, certaines maladies se transmettraient(po dorogiJ et d'autres pas. Plus précisément, la transmissiondes maladies s'exprime en langue nanerge par les verbes toro(passer), torogo (accompagner). On dira par exemple qu'unemaladie « passe » (be yamb'a dorogiJ. Nous précisons maintenant leurs modes de propagation.
La transmission par la salive
Le contact avec la salive est évoqué comme un moyende transmission rapide. Ce contact bien que fréquent du faitdes pratiques de consommation (boire et manger ensemble)est cependant toujours mentionné comme étant extrêmementredoutable.
2 Le travail d'enquète a été effectué de fin janvier à fin février1999 àKourouma, village de 5500 habitants situé à 80 kilomètres au nordouest de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Des entretiens non directifssur le thème de la transmission des maladies ont été effectués auprèsde la population locale. D'autres ont été conduits avec des personnels desanté. Nous avons aussi observé des conduites pour appréhender lespratiques en matière de saleté. Enfin de longs moments ont été consacrés à l'observatIon des interactions entre soignants et soignés au dispensaire et à la maternité.
Maladies et gestion de la saleté en milieu rural senufo 405
Bien que n'étant pas très fréquente, « l'épilepsie »3 estsouvent citée par les informateurs comme une maladie qui setransmet par le contact de la salive. L'une des premièresrègles appliquées à l'encontre d'un épileptique consiste doncà le faire manger seul.
L'épilepsie est aussi une maladie qui se transmet facilement. En mangeant avec le malade, tu prends sa salivequi est l'eau de son corps, tu prends la maladie. C'est pourcela que dès qu'une personne a l'épilepsie, nous la faisonsmanger seule. S'asseoir à côté du malade ne donne pas lamaladie. Une femme peut avoir l'épilepsie et ne pas transmettre sa maladie à son mari, mais s'ils mangentensemble elle lui transmettra sa maladie. CO.K.)
Ce risque ressenti de contamination conduit à des pratiques d'ostracisme, et l'on imagine l'ampleur de la souffrance des personnes mises à l'écart quand on sait l'importancede la prise en commun des repas dans les liens de sociabilité.Ces malades auront aussi du mal à trouver un conjoint.Difficulté qui semble plus grande pour les femmes car la préparation des aliments est une tâche essentiellement féminine rendant ainsi le risque de souillure des aliments plusélevé. Cette crainte de la contamination conduira aussi desadultes à ne pas porter secours à un jeune épileptique terrassé en brousse par une crise. De même une eau souillée par lecorps d'un épileptique détournera de la consommer4.
D'autres maladies, non moins graves, seraient également transmissibles par la salive. Par exemple, on supposequ'il y a deux formes de lèpres, l'une d'origine divine etl'autre sorcellaire. Cette dernière serait transmissible par lasalive.
3 Il s'agit ici de ce qui est perçu, c'est à dire les crises convulsives. Voirdans ce même ouvrage l'article de Arborio. Dans tout notre texte, nousutilisons les termes médicaux (tuberculose, méningite, etc.) comme unetraduction « naïve » des termes locaux.
4 Dans un rapport de recherche sur les stratégies d'acteurs et les jeux depouvoirs autour du service de l'eau à Bandiagara en milieu dogon, il estnoté qu'après la chute d'une épileptique dans un puits, il a fallu despratiques de purification de l'eau (tirage de 100 seaux d'eau sur lesconseils d'un marabout et versement de 20 litres de chlore par un agentdu service de l'hygiène) pour que les gens recommencent non sanscrainte à la consommer Œouju, 1998 : 21-22).
406 Les maladies de passage
De même, la tuberculose et la méningite sont redoutées à cause de ce même risque de contamination. De l'avisd'une thérapeute, la toux des jeunes enfants se transmettraitplus rapidement que celle des adultes, par la salive contenuedans les postillons. Ce témoignage évoque ce risque mêmepour un enfant « au dos », si sa mère marche dans les vomissures d'un autre enfant malade:
La toux des enfants se transmet aussi. C'est kalosabasogosogoni (terme jula lit. « petite toux de 3 mois »).
L'enfant tousse et maigrit. Cette toux se transmet. Unenfant passe sa maladie à un autre s'ils boivent ensembleou s'ils mangent ensemble. Si l'enfant tousse et vomit, dèsqu'une femme portant son enfant au dos marchera surcette vomissure, celui-ci attrapera la maladie. (S.A.)
Pour parer à ce risque, les vomissures sont toujoursramassées ou recouvertes d'une couche de poussière. Mais leramassage immédiat des vomissures s'explique aussi parcequ'elles sont considérées comme une saleté qui risque de ternir la réputation de propreté de la maîtresse de maison.
Une maladie fréquente comme yimbe qui correspond àsumaya en milieu bambara - et que l'on traduit souvent unpeu trop rapidement par paludisme - n'est pas considéréecomme pouvant se transmettre par la salive. En revanche,sayi, une maladie5 associée à une forme de « sumaya quidure» (Roger, 1993 : 88) se transmet, elle, par la salive. Parconséquent, à partir du moment où un malade souffre decette maladie l'entourage fait en sorte qu'il mange seul etque ses restes de nourritures soient donnés aux chiens.
En réalité, il arrive souvent que certaines personnescontinuent à manger ou à boire dans le même récipient qu'unépileptique, un lépreux, un tuberculeux ou une personnesouffrant de méningite. Et s'il existe bien la crainte d'attraper la maladie en approchant le malade, on craint aussi de lechoquer en s'éloignant de lui.
5 Sur l'ensemble de ces pathologies ressenties notamment dans l'airemandingue, nous renvoyons à Jaffré & Olivier de Sardan (2000).
Maladies et gestion de la saleté en milieu rural senufo 407
Ici les maladies qui se transmettent sont la méningite,les toux et l'épilepsie. L'épilepsie: si on touche au maladeou bien si on mange avec lui. Ce n'est pas à cause del'écœurement qu'on refuse de manger avec le malade, c'estsurtout à cause de la peur d'attraper cette maladie. Mêmela femme ne doit pas continuer à manger les restes denourriture de son mari. Il faut donner les restes aux chiens.Mais il y a toujours des gens qui ne veulent pas laissermanger seul le malade. Ils disent « le malade n'a pas àm'écœurer }), c'est pour cela que les maladies ne finissentpas. Les gens disent toujours « Dieu va nous aider ", maisla maladie arrive à finir les gens de la famille. (C.Z.)
Quoi qu'il en soit, certaines précautions peuvent êtreadoptées pour limiter les risques de la transmission par lasalive alors qu'il semble difficile d'empêcher un autre modede transmission: lorsque la maladie de la mère se communique à son enfant.
La transmission par le sang et par le lait
La maladie d'une mère « passe}) à l'enfant qu'elle portependant la grossesse. Ce mode de transmission s'effectueraitpar le biais du sang.
J'ai une femme qui souffre de rhumatisme et tous sesneuf enfants ont cette maladie. Quand une femme estmalade et qu'elle est enceinte, elle transmet sa maladie àl'enfant car la maladie se trouve dans le sang. (DS)
Dans ce mode de transmission, certains informateurscomparent le lien entre l'enfant et la maladie à une sorte derelation de parenté où l'enfant jouerait le rôle de père pour lamaladie. La notion de « père}) de la maladie rend compte dulien évident entre l'enfant et la maladie « portée }) par samère.
La femme enceinte transmet toujours sa maladie àl'enfant qu'elle porte. C'est la transmission la plus rapide.Dans ce cas, l'enfant est comme un père pour la maladie.Avec le lait, la maladie se transmet aussi. (T.I.)
L'inverse peut aussi se dire et c'est alors la maladiequi prend la place de père.
408 Les maladies de passage
Une femme enceinte qui a gnigwobe (sumayaba enjula) transmet la maladie à son enfant. L'enfant naît avecla maladie; dans ce cas gnigwobe devient comme un pèrepour l'enfant. (O.K.)
Sans doute faut-il ici se méfier d'une « surinterprétation6 » en termes symboliques. Cette expression soulignesimplement et fortement, de façon métaphorique, les liensentre les maladies de la mère et celles de l'enfant.
De même, l'allaitement est considéré comme une période propice à la transmission de la maladie de la mère àl'enfant. Et les Senufo disent alors que la maladie « passe»par le lait.
Une femme enceinte transmet la maladie à son enfant;elle peut aussi transmettre la maladie par le sein puisquela maladie marche dans tout le corps. (O. D. B.)
Cependant des informateurs soutiennent que ce modede contamination n'est pas systématique puisque la transmission de la maladie dépendrait de la qualité du sang7,
quelle que soit la modalité de la transmission. On dit aussiqu'un enfant peut prendre la maladie de sa mère pendant lagrossesse ou pendant l'allaitement et n'en souffrir qu'à l'âgeadulte ou carrément à l'âge qu'avait la mère quand elle a eula maladie. Bref, il s'agit ici plus de probabilités que de certitudes stables.
Mais tout est une question de chance. Une femme peutavoir la tuberculose et avoir des enfants qui n'aurontjamais la maladie qu'elle a. La transmission est aussi liéeà la chance. (TIl
En pratique très peu de précautions sont prises pourlimiter les risques de contamination de la maladie de la mère
6 En ce qui concerne les écueils de la surinterprétation, cf. Olivier deSardan (1996).
7 Les Senufo expriment la bonne qualité du sang en lui attribuant uneamertume. Un bon sang serait amer (sora). Ce type de sang (sisamb'asora) témoigne de la santé et de la force de caractère d'une personne,caractéristique censée empêcher le développement des maladies. On ditaussi de quelqu'un qui a le sang" amer» qu'il peut diffiCilement être lavictime d'un sorcier. Cette qualité du sang à travers sa prétendue amertume a également été soulignée chez les Lobi, voisins des Senufo. Cf.Cros (1990 : 28).
Maladies et gestion de la saleté en milieu rural senufo 409
à l'enfant pendant la période de l'allaitement. En effet, l'utilisation du biberon est encore loin d'être une pratique courante dans ce milieu même si les gens savent que son usagelimite le « passage » de maladies d'une mère à son enfant. Ceque l'on observe par contre, c'est que dans certaines situations d'aggravation de l'état de santé d'une mère, un enfantest confié à une femme appartenant au même matrilignagecar selon les conceptions nanerge, un individu partage lemême lait que les membres de son matrilignage et le mélange des laits avec d'autres n'est pas recommandé. Cependantdans de tels cas, la séparation de la mère et de l'enfants'explique moins par un souci de transmission que par uneincapacité physique de la mère à pouvoir allaiter sa progéniture.
La transmission par les rapports sexuels
Les rapports sexuels sont cités comme un mode parlequel les maladies peuvent être transmises. Ceci étant,toutes les maladies ne se transmettent pas de cette façon.Par contre, Tchesube est une maladie sexuelle que les informateurs nomment fréquemment comme un exemple demaladie qui se transmet uniquement par voie sexuelle.
Tchesube est une maladie qui se transmet seulementpar les relations sexuelles, jamais par l'alimentation.(O.K.)
Bien qu'il s'agisse d'une maladie associée (du moinsimplicitement) à un excès de rapports sexuels, tchesube est del'avis des informateurs, la preuve d'un manque d'hygiène corporelle chez une femme. Le traitement de cette maladie relèverait de la médecine et ses symptômes (maux de bas-ventreet pus) évoquent la syphilis ou la blennorragie. Mais auxdires des Senufo, tchesube a disparu de leur environnement.
On relie aussi tchesube à l'adultère. Car, dit-on, unhomme peut, s'il doute de la fidélité d'une épouse, « mettre»la maladie dans son corps afin qu'elle la transmette à un partenaire illégitime lors d'un rapport sexuel.
Tchesube est une maladie grave. Ce sont les hommesqui fabriquent cette maladie et la mettent sur leurs
410 Les maladies de passage
femmes. Dès que la femme a des rapports sexuels avec unautre homme, celui-ci attrape la maladie. Il a ensuite malau ventre. Ce sont les gens qui donnent la maladie. (S.K.)
Il y a plusieurs sortes de tchesube : les parties sexuellesfont mal, on est constipé, on ne peut plus uriner; ce sontles gens qui fabriquent tchesube. Ce ne sont pas lesfemmes qui donnent la maladie mais c'est à cause d'ellesqu'on attrape cette maladie. Si un homme fait ce médicament à sa femme, tous les hommes qui auront des rapports sexuels avec elle auront cette maladie. (T.L.)
Les conceptions senufo supposent que l'époux lui-mêmepeut contracter la maladie s'il ne pense pas à 1'« extraire " ducorps de son épouse avant la reprise des rapports sexuels avecelle. On prétend également que dans certains cas, si la femmene contamine aucun partenaire (amant ou époux), c'est ellequi contracte alors la maladie. C'est pour cela que les informateurs comparent souvent tchesube à un piège qui guettetrois personnes: l'amant, le mari et la femme.
Quand tchesube attrape une personne, le bas-ventreenfle avec douleurs terribles; le sexe de l'homme grossit,il y a des boutons et du pus. À ce moment, l'homme saitqu'il a été piégé par le mari d'une femme. Ce sont donc leshommes qui donnent cette maladie mais les blancs onttrouvé le médicament. Tchesube est une maladie gravecar elle peut conduire à l'impuissance. (O.K.)
La particularité des descriptions de ce type de contamination réside dans le fait qu'il ne s'agit pas toujours d'unmalade qui transmet la maladie à une personne saine. Unepersonne a priori saine contamine une autre à cause d'unetransgression sexuelle. Tout se passe comme si la femme servait de « vecteur» ou de courroie de transmission de tchesube.
Cependant, d'autres informateurs n'associent pas tchesube uniquement aux rapports adultérins et considèrent qu'ils'agit simplement d'une maladie qui se transmet lors d'unerelation sexuelle qu'elle soit légitime ou pas. Pour d'autres, iln'est même pas toujours nécessaire d'avoir eu un contactsexuel pour contracter ce type de maladie. Ainsi, toute maladie entraînant l'écoulement d'un liquide du sexe se transmettrait en utilisant le même siège qu'un malade.
Maladies et gestion de la saleté en milieu rural senufo 411
Si tu as une maladie et qu'un liquide coule de ton sexedès qu'une personne saine s'assied sur un siège que tu asoccupé, elle attrape la maladie. C'est comme si tu as unechose vivante qui tombe ; alors il lui faut un corps pourcontinuer à vivre. (T.I.)
Selon une thérapeute mossi réputée pour l'efficacité deses soins, la propagation des maladies sexuelles chez lesfemmes serait due à l'utilisation de la même table d'accouchement à la maternité. À ses yeux le savon seul ne suffiraitpas à désinfecter.
Je soigne aussi les adultes. Tu as vu la femme quivient de se lever, elle est venue pour elle-même. Il y aquelque chose sur son sexe qui a la forme d'un épis demaïs, c'est rouge, et il faut que cette chose rentre. Elle aun liquide qui coule de là. Si on attend trop longtemps, onne peut plus soigner la maladie. C'est une maladie qui faitmaigrir et peut tuer. C'est aussi une maladie qui se transmet facilement. Maintenant qu'elle est partie, je vaislaver le siège avec de la potasse et du citron pour fairepartir la maladie. Sinon si une autre personne s'assoit surle siège, elle attrapera la maladie si son sang est léger.Beaucoup de femmes attrapent cette maladie pendantleur accouchement au dispensaire parce qu'elles se sontcouchées sur la maladie d'une malade. (S.A.)
Il s'agit là d'un discours de spécialistes et dans la viecourante, il est rare d'observer le lavage d'un siège parcequ'il aurait été utilisé par une personne souffrant d'unemaladie sexuelle8 .
8 Ceci peut cependant s'observer. Ainsi, chez les Nanerge, on considèreune catégorie sociale, les Cili (les hommes pratiquent la cordonnene etles femmes la poterie) comme des gens" souillés ". AinsI, tout rapportsexuel et toute alliance matrimoniale sont proscrits avec un membre dece groupe. Mais en dehors de cet interdit matrimonial, les contacts physiques avec les Ccli sont lImités. En février 1994, alors que des jeunespotières me rendaIent visIte, je VIS un jeune paysan qui se trouvait là,refuser avec un air de dégoût d'occuper la place que venait d'occupermes visIteuses. Doris Bonnet (communication personnelle) dit avoirassisté en 1977, en pays mossi à une scène comparable : lors d'uneconsultation une femme refusa de poser son enfant, là où, une autrefemme s'était assise et avait faIt une fausse couche.
412
La transmission par les urines
Les maladies de passage
Le contact avec les urines, par proximité ou en marchant dessus, faciliterait aussi la transmission de certainesmaladies.
Marcher dans les urines d'un malade peut donner lamaladie. C'est pour cela que nous disons que la maladies'attrape par le pied. Une personne malade urine, toi tuvas uriner au même endroit si la chaleur de son urinemonte sur toi, tu attrapes la maladie. (O. D. B.)
De même, le fait d'uriner sur les urines d'un maladepourrait permettre la transmission d'une maladie. LesSenufo considèrent que les urines dégagent de la chaleur etque le contact avec la maladie s'établit par le biais de cettechaleur.
On peut aussi attraper les maladies par les urines.Une personne malade urine et toi tu viens uriner aumême endroit alors que son urine n'est pas encore sèche,tu attraperas la maladie. En urinant sur les tracesd'urines, la chaleur monte vers le sexe de la femme. (O.K.)
Tandis que certains informateurs prétendent quen'importe quelle maladie serait transmissible par l'intermédiaire des urines, d'autres au contraire soutiennent queseules les maladies de sorciers et les maladies sexuelles, àl'exception du sida, peuvent être transmises par les urines.
Tchesube s'attrape par les urines. Les maladies que lesgens donnent s'attrapent de cette manière aussi. Le sidane s'attrape pas de cette façon là. Si tu as des rapportssexuels avec une personne qui a le sida et que vous avezle même sang alors tu peux attraper la maladie. (O.D.B.)
Les urines non sèches auraient une forte capacité decontamination à cause de la chaleur corporelle qu'elles dégagent. Ainsi, les toilettes sont perçues comme un lieu propiceà la contamination par l'intermédiaire des urines ou deseaux de toilettes.
Tchesube : une personne a cette maladie, elle se laveavec un médicament si tu rentres dans cette eau tuattrapes la maladie. C'est pour cela que les gens ne rentrent pas dans n'importe quelle toilette. (C.Z.)
Ma/adies et gestion de /0 saleté en milieu rural senufo 413
C'est pour cela qu'on évitera de marcher dans les eauxde toilettes car elles véhiculeraient les saletés et les maladiesdu corps.
Les urines aussi transmettent les maladies, c'est lamême chose que ce que je viens de te dire. Tu déposes lachose vivante qui ne cherche qu'à vivre dans un corpshumain, dès le premier contact, elle rentrera dans toncorps. (T.I.)
Les femmes seraient les premières touchées par cemode de contamination à cause de la position basse qu'ellesprennent pour uriner. C'est pourquoi il est préconisé de verser de l'eau sur les urines pour atténuer « la chaleur« quis'en dégage. Discours surtout, puisqu'en réalité, une tellepratique est peu répandue dans la région.
Les urines transmettent aussi les maladies. Nous nesavons pas si les tas d'ordures transmettent les maladies.Mais ce qui est sûr, ce sont les toilettes. Une personnemalade se lave ou urine, si après tu te laves au mêmeendroit la chaleur de sa maladie monte sur toi et tuprends la maladie. Les urines dégagent de la chaleur.Quand une personne urine même si l'urine sèche, dès quetu urines à cet endroit la chaleur se dégage et monte verston corps. Si la personne verse de l'eau sur ses urines, iln'y a plus de chaleur ... Mais ici il y a beaucoup de gensqui n'utilisent pas d'eau pour uriner dans les toilettes.Quand une personne malade se lave, elle met à terre samaladie, elle disperse sa maladie. C.. ) Toucher un maladene donne pas la maladie, c'est l'eau de la toilette quidonne la maladie. (T.L.)
Cependant, une personne malade continue à utiliserles toilettes communes. Rarement, quand son état de santéest jugé grave et contaminant, son entourage peut décider del'éloigner des toilettes communes.
En revanche, le contact avec les selles n'est pas citécomme un mode de transmission des maladies. Sans doute àcause d'une conception des selles comme résultant d'unesimple transformation des aliments consommés, alors que lesurines seraient en relation étroite avec le sang et les autresliquides du corps.
414 Les maladies de passage
Les maladies ne se transmettent pas par les selles. Lesurines sont les liquides du corps et la maladie rentre dansle liquide du corps. Par contre les selles sont ce que nousmangeons et les maladies ne se mélangent pas aux aliments dans le corps. (T.L.)
Un contact direct avec les selles se pose moins quepour les urines puisqu'elles se font encore largement en pleine nature. Les quelques latrines constituées d'un trou à cielouvert se limitent souvent aux habitations des fonctionnaireset à certaines concessions appartenant à des notables villageois. Un vieux paysan voyait d'ailleurs dans l'utilisation deslatrines la raison de l'abondance actuelle des maladies.
Maintenant les temps ont changé, on creuse des trouspour faire les selles, c'est aussi pour cela que les maladiessont nombreuses maintenant. Nous faisons les selles surcelles des autres et à chaque fois on prend la chaleur desautres selles qui montent. (S.K.)
La transmission héréditaire
Les maladies se transmettraient aussi au sein deslignées paternelle et maternelle. Par exemple, la maladied'un père de famille « passe » (dora) à ses enfants ou à certains d'entre eux. Les maladies respiratoires et les affectionsdentaires sont citées comme des exemples de maladies quiseraient transmissibles par ce biais.
Il y a des maladies de famille. Ton père a la maladie, ilmeurt. Il peut arriver que tu aies la même maladie à l'âgede ton père. Les maladies de patrilignage ou de matrilignage sont surtout les maladies respiratoires. (O. K.)
Les maux de dents sont une maladie de lignage. Onpeut manger sans crainte avec une personne qui a malaux dents car on sait qu'on ne va pas attraper sa maladiesi on n'est pas dans le même lignage. CD. S.)
La transmission par la tension du regard
Le croisement du regard d'un malade suffirait àcontracter certaines maladies. Il s'agit en l'occurrence de
Maladies et gestion de la saleté en milieu rural senufo 415
maux d'yeux dont les descriptions se rapprochent de laconjonctivite. Ces maladies se transmettraient sous la pression du regard, et en fixant une personne qui a mal auxyeux, on contracterait notamment la maladie si une larmevenait à l'œil au moment du regard9 .
La transmission par le vent
Le vent est largement considéré comme un élément depropagation des maladies. Chaque type de vent apporteraitson lot de maladies : la tuberculose, la méningite, la rougeole, et la varicelle sont régulièrement citées.
Tu vois comment va la fumée? Alors, la maladie vientaussi de cette manière. Elle vient de certains endroits etse déplace par le vent. La maladie marche avec le vent.(... ) Les maladies du vent; ça peut être sumayaba, la touxou bien la méningite. Chaque vent amène sa maladie.Quand c'est grave, on dit aux femmes de ne plus aller audispensaire avec les enfants. La méningite s'attrape etc'est surtout sur les enfants que la maladie tombe. Lesenfants sont faibles. (... ) C'est la saleté qui rend maladeet c'est le vent qui amène la saleté. (CZ)
Au plus proche, partager le même air que certainsmalades serait contaminant. Ainsi certaines maladies, disparues de nos jours, sont encore évoquées comme forè qui laissaitle corps couvert de plaies dont coulait un liquide purulent.Cette maladie était très contagieuse car même en évitant demanger avec le malade, on pouvait attraper la maladie en partageant le même air que lui. Quand une personne mourait decette maladie, on faisait sortir son corps par une ouverturespécialement faite à cette occasion pour éviter d'être contaminé par l'intermédiaire du même air que le cadavre.
Le vent transporte les saletés d'un village à un autre,d'une région à une autre et même d'une ethnie à une autre.Les Senufo attribuent l'avènement de nouvelles maladies àl'arrivée de populations nouvelles dans la région.
9 Marguerite Dupire (1985 : 125) notait une forme de contagion similairechez les Sereer Ndut du Sénégal, pour des remarques plus larges, cf.Ja!fré (1999).
416 Les maladies de passage
La maladie marche, elle vient de l'intérieur du pays etmaintenant nous sommes mélangés et la maladie circuleentre les gens plus facilement. Le vent aussi amène lesmaladies. (T. L.)
Le vent amène la maladie des autres pays. C'est lachaleur des maladies que le vent amène. La respirationc'est le vent, et nous respirons le vent qui contient lesmaladies. Les maladies nouvelles, en ce moment, ce sontles Mossi qui sont descendus avec les maladies ici.Autrefois nous n'avions pas ces maladies là. Maintenantnous nous sommes mélangés et c'est pour cela que lesmaladies sont nombreuses, car les maladies se sontmélangées. Avant chaque ethnie avait ses maladiesqu'elle pouvait soigner. Les Mossi avaient les leurs, nous,nous avions les nôtres. Les maladies se sont mélangéescomme des races de graines. (O. K.)
Le fait de rendre les étrangers responsables de l'avènement de nouvelles maladies n'est pas une originalitésenufo10. Car « la peur conduit au repli et à la recherche deresponsables » Œourdelais, 1989: 19).
Pratiques d'hygiènes?
Tous ces discours populaires sur la propagation desmaladies laissent penser qu'il existe des pratiques localesorientées vers la protection du corps. Ils présupposeraientd'une certaine manière des pratiques d'hygiène. Et pourtant,à écouter les agents de santé, les pratiques relatives àl'hygiène seraient inexistantes dans le milieu senufo. Le responsable du centre de santé de K. nouvellement affecté dansla région explique la fréquence de certaines maladies (lepaludisme dont il estime soigner près de 28 cas par semaine,les diarrhées et les dysenteries amibiennes) par un manqued'hygiène des populations. Selon lui cette absence d'hygiènen'est pas une particularité senufo et il l'aurait observée dans
10 En Afrique, il est fréquent d'entendre les gens rendre les Européensresponsables de l'avènement du sida. Au XIxe siècle en France, quandcommencèrent les épidémies de choléra, les étrangers étaient accusés etmaltraités (BourdelaIs : 1989)
Maladies et gestion de la saleté en milieu rural senufo 417
d'autres sociétés. Il prend un exemple à propos de l'absencede latrines.
Il y a très peu de puisards par exemple. L'une deschoses que nous faisons est la suivante: nous rencontronsle délégué local, on travaille avec les notables. Si les gensarrivent à comprendre cela et qu'ils font des puisards, lesautres imitent. J'ai déjà pratiqué cela dans des villages dela région de Tenkodogo (Mossi), à Dori (Peul) où je suisresté cinq ans et aussi à Ouargaye dans le pays bissa.Sincèrement les pratiques des Senufo, des Peuls et desBissa sont les mêmes. À Ouargaye par exemple, il fallaitabsolument que les gens aient des latrines, ils déféquaient dans la nature comme ici; ceci est grave pourl'hygiène. Dans les alentours de Dori c'est la même chose.Ici, je viens d'arriver et je suis encore dans une phased'observation. Je veux savoir ce qui se passe réellement etce que nous pouvons faire et demander au délégué del'aide pour faire ce que nous avons envie de faire. (OA)
Les conditions d'évacuation des eaux usées sont aussicitées.
De temps en temps, nous on donne des conseils d'éducation pour la santé. Par exemple si nous savons qu'unepersonne souffre du palu et qu'elle a fait plusieurs crisesde suite, on lui dit: « c'est le palu, c'est le moustique quitransmet la maladie» et on lui demande si dans sa cour iln'y a pas de retenue d'eau. Généralement ici, il n'y a pasde puisards dans les douches, ce sont des nids de moustiques; dans ce cas, on lui dit de trouver une solution àcela qu'elle fasse un puisard. On lui conseille aussi l'utilisation d'huile de vidange pour les eaux sales. On luidemande si c'est possible d'acheter une moustiquaire.(O. A.)
Le personnel soignant déplore fréquemment le manqued'hygiène corporelle au sein des populations et ce reprocheest fréquemment adressé par les matrones aux parturientesau moment de l'accouchement. Ainsi la réaction d'une matrone à la suite d'un toucher vaginal à une jeune parturiente futun air d'écœurement face à ce qu'elle ressentait comme unemauvaise odeur du corps.
418 Lesmaladies de passage
L'odeur ! Ça fait peut être cinq jours qu'elle ne s'estpas lavée. Il y a des fois, je refuse de faire un toucher à lafemme tant qu'elle ne se lave pas. (. .. J. C'est pour cela quesouvent quand je vois que la femme est très sale, je prescris de la nivaquine en lui disant de revenir le lendemain.Je lui dis de prendre deux comprimés le matin, deux lemidi et deux le soir et je sais très bien qu'elle accoucheradans la nuit chez elle. Le lendemain, ils reviennent medire qu'elle a accouché. Moi je reste tranquille. Je veuxbien faire mon travail, mais je veux continuer à manger.Une fois, j'ai eu une femme qui était âgée. La premièrefois, je lui ai dit qu'elle était sale. La deuxième fois, elleest encore venue pour accoucher sale, je l'ai renvoyée pourqu'elle aille se laver. Elle n'est pas revenue. Certainesfemmes sont tellement sales qu'on voit des couches quiressemblent à du lait caillé sous les aisselles... (T. M.)
Ce jour-là, la jeune parturiente n'a pas été renvoyéechez elle. Elle accouchera d'un mort-né. Et les mots del'accoucheuse furent des mots de culpabilisation et non deconsolation.
Quand je te dis de pousser, tu refuses, voilà le résultat:mort-né!
Il n'y aurait donc pas selon le personnel soignant, depratiques d'hygiène au sein de la population. Mais ce qu'onsemble déplorer le plus est le fait que les populations ne tiennent pas compte des conseils qui leurs sont prodigués.
Le problème c'est quand on parle, ils écoutent, ils sontd'accord, mais quand ils arrivent chez eux, c'est le contraire. (... ) Les gens ne sont pas faciles, il faut aller doucement. Ils disent: « quand tu viens pour ton travail, faiston travail et pars. Si on ne les voit pas au dispensaire, ilsconsidèrent que ce n'est plus dans le cadre du travail, ilsdisent que tu cherches à faire de la politique ou bien quetu veux te mêler de leurs affaires villageoises. Le soignantpour eux doit être dans sa blouse pour soigner, faire desinjections. Par rapport aux campagnes de sensibilisationaux pratiques d'hygiène, ils se disent qu'ils connaissent.Nous profitons des campagnes de vaccination, on choisitsur place un cas de maladie et on sensibilise. On fait aussi
Maladies et gestion de la saleté en milieu rural senufo 419
des visites à domicile, c'est comme ce que tu fais, tu vaschez les gens et tu regardes comment ils font. Vous observez et après on récapitule ce qui va à l'encontre de lasanté. (OA)
Ces désaccords sont fréquents au sein du dispensairemême si une aide assistante sociale me confiait que lesfemmes autochtones pratiquaient plus l'hygiène que lesMossi.
Je n'ai pas de problème avec les femmes du village.Elles pratiquent l'hygiène. Elles sont propres. Le problème, c'est avec les étrangères. Elles sont sales. Ce sont lesMossi, elles ne pratiquent pas du tout l'hygiène.
Mais prenons un peu de recul. L'hygiène, on le sait, estune notion liée à l'histoire des mœurs. « La saleté absoluen'existe pas, sinon aux yeux de l'observateur » (Douglas,1992 : 24). A chaque société, ses critères de saleté et de propreté (Peeters, 1982 ; Vigarello, 1985 & Poloni, 1991) et c'estpourquoi j'ai choisi d'observer les pratiques quotidiennes quisont en rapport avec l'entretien du corps, la transformationdes aliments et la gestion de l'environnement.
Une morale et des pratiques de propreté
Interroger les règles de la propreté dans un universsocial, suppose de dépasser certaines positions « simplistes»se traduisant par des actions de « conscientisation » ou de« culpabilisation» des conduites des populations (poloni,1991 : 274). En fait, ces pratiques locales de propreté obéissent à des codes sociaux que nous allons maintenant brièvement présenter.
La propreté, une affaire de femmes?
Les actes de propreté concernent les hommes autantque les femmes, mais la propreté est plus attendue dessecondes que des premiers. En effet, les femmes sont impliquées dans pratiquement toutes les sphères de la propreté:l'entretien du corps, la préparation des aliments, l'entretiende l'espace habité. Quiconque veut observer les pratiques de
420 Les maladies de passage
propreté est donc obligé de s'intéresser aux activités féminines, et de ce fait, le manque de propreté chez une femmen'implique pas les mêmes réactions de la part de l'entourageque lorsqu'il est constaté chez un homme. La reconnaissancede la saleté chez une femme peut même entraîner undivorce ll . Elle peut aussi être une source de honte12. Maisalors en quoi consiste socialement la propreté?
Les éléments de la propreté
De l'eau pour le corps, le linge et la vaisselle
L'eau intervient pour une grande part dans les pratiques de propreté. On pourrait même dire qu'il n'y a pas depropreté sans eau. Elle est exigée, tout d'abord, pour l'entretien du corps. Un corps propre est avant tout un corps lavé.Si on attend généralement la fin de la journée pour prendreune douche qui délasse, certaines parties du corps (visage,mains et pieds) doivent être lavées dès le réveil matinal. Larègle minimale de propreté corporelle impose qu'un individuse lave au moins le visage dès son réveil.
La propreté est liée aux rapports entre un individu etautrui. On ne mange et on n'entreprend une conversationqu'une fois le visage lavé. La toilette matinale s'associe à uncode du savoir-vivre.
La brillance de la peau est également un critère depropreté notamment chez les bébés et les femmes. Ainsi, leslavages quotidiens des bébés sont-ils accompagnés deséances de massage au beurre de karité. Ces massages apaisent, et sont aussi destinés à rendre de la vivacité et dutonus au corps. On utilise après la toilette de la pommadegénéralement à base de beurre de karité ou bien de fabrication industrielle pour donner une peau brillante. Si on peut y
11 Dans le recueIl de chroniques amoureuses rassemblées par GérardDumestre et Seydou Traoré 0998: 163), il y en a notamment une où unpêcheur raconte qu'il a répudié sa femme à cause de sa saleté.
12 Cette conception se retrouve aussi en milieu songhay-zarma où il est ditpar exemple qu'une concession sale est la honte pour une femme(OlivIer de Sardan, 1982 : 184)
Maladies et gestion de la saleté en milieu rural senufo 421
voir de la coquetterie féminine, ces pratiques sont aussi uneexigence de propreté. Une peau féminine sèche est perçuecomme étant sale. Par contre sa luisance reflète son état depropreté.
Les vêtements dénotent aussi la saleté ou la propretéd'un individu, et on doit les changer ainsi que le linge decorps après chaque toilette. La blancheur et l'éclat du lingeest un critère de propreté. De ce fait, l'utilisation du bleuindustriel intervient au cours de la lessive. Inversement, levêtement un peu jauni est signe de saleté. Il est bien évidentque les fumées de cuisine, les activités champêtres, la poussière et la boue rendent difficile l'usage quotidien du blanc.Les vêtements blancs sont donc portés à des moments situésen dehors des activités quotidiennes.
Si la saleté se voit, elle se sent aussi. L'odeur du corpset du linge est un critère de propreté. Laver les habits c'estaussi les débarrasser des mauvaises odeurs d'urine et lasaleté d'une femme sera critiquée en évoquant ces odeurs.
La vaisselle est un autre registre où l'on observe dessignes de propreté de la femme. Les femmes disent que lavaisselle doit être faite après le balayage de la cour pour éviter de recouvrir les plats par la poussière soulevée. Mais enréalité, j'ai pu remarquer qu'elle est faite en fonction des disponibilités et des urgences. On s'attache ainsi à éliminer lessaletés visibles des plats et la propreté des ustensiles de cuisine est jugée à leur éclat. Seaux, marmites et plats en aluminium doivent briller pour être considérés comme propres.Que les marmites d'une femme soient sales et c'est la hontepour elle! Une adulte obligera une fillette à laver le dos noirci de la marmite qui doit aussi briller de l'extérieur. Unevieille parente en visite reprochera aux jeunes femmes lanoirceur de leurs marmites qui à ses yeux rappelle le comportement des femmes mossi ...
La mousse du savon et la désinfection de la potasse
L'usage du savon accompagne les pratiques de propreté, il nettoie le corps, les vêtements et les ustensiles de cuisine. On utilise de moins en moins le savon local à base de
422 Les maladies de passage
potasse et de beurre de karité et le savon moderne devient deplus en plus courant.
Mais ce qui semble le plus attendu d'un savon est queson contact avec l'eau produise de la mousse. Selon lesconceptions locales, un savon qui lave est un savon qui mousse. De même, une eau difficile à faire mousser au contact dusavon ne serait pas une « bonne» eau. En dépit d'un emplacement distancié des concessions, la difficulté à produire dela mousse au contact du savon amène souvent les femmes àabandonner un puits ou un forage.
Les vertus protectrices et purificatrices de l'encens
Certains soins s'accompagnent aussi de la fumigationd'encens pour chasser de l'environnement du malade lesmauvais génies. Mais en plus de sa vertu protectrice, l'utilisation de l'encens se double d'une vertu purificatrice. Onl'utilise aussi pour rendre propre. En effet, si l'on peut sécherou laver les chiffons et nattes de couchage mouillés par lesurines nocturnes des enfants, on utilisera de l'encens pourchasser les mauvaises odeurs de la maison.
S'agissant des toilettes, toute tentative de lavages'annonce difficile sinon impossible à cause de la qualité dessols. Aucun moyen n'est utilisé pour atténuer les odeursgênantes qui se dégagent des toilettes contrairement à ce quia été par exemple observé dans les quartiers périphériquesde Ouagadougou (Poloni, 1991 : 276). Cependant l'encens estdavantage utilisé pour ses vertus thérapeutiques que pourses propriétés assainissantes. L'encens brûlé uniquementpour donner une odeur agréable à la maison reste l'apanagede quelques femmes qui ont pour la plupart une connaissance des pratiques urbaines.
De quelques interprétations du balayage
Le balayage est une pratique importante qui conferepropreté à l'espace habité (takarge) en le débarrassant dessaletés matérielles. Il s'agit d'une activité essentiellementféminine qui n'est pas sans quelques résonances symbo-
Maladies et gestion de la saleté en milieu rural senufo 423
liques. Ainsi une femme évitera de passer le balai sur lespieds d'un homme car elle risquerait, dit-on, de le rendrecélibataire.
Quotidiennement la maison est balayée ainsi que lacour et le coin de cuisine, les espaces ombragés utilisés pourles repas et les causeries. L'aire de cuisine est sans doutel'endroit le plus soumis au balayage, à chaque fois qu'ons'apprête à faire du feu.
Le balayage s'effectue le matin et le soir. Certaines raisons de ce choix sont d'ordre symbolique. Par exemple,balayer la nuit serait cause d'infécondité ou de pauvreté13.
Ceci étant, les actes de balayage peuvent recevoir une autreinterprétation qui ne contredit pas du tout celles qui viennent d'être évoquées. Balayer n'est pas uniquement un actetechnique (élimination des saletés) ou symbolique. Il s'agitaussi d'un acte imposé par le système de normes. Balayer estun acte par lequel une femme revendique son statut defemme respectable.
Des moments de propreté
Les moments où l'on prépare les repas sont des occasions pour juger de la propreté ou de la saleté d'une cuisinière. Poser la marmite de ta (pâte de mil) au feu sans avoirbalayé le coin de cuisine et nettoyé les cendres du foyer dénote de la négligence d'une femme. De même la vue de déchetsd'animaux domestiques ou d'enfants (selles ou morves) traÎnant à côté du foyer souligne un manque de propreté. La préparation des aliments nécessite l'éloignement des déchetsanimaux et humains et la cuisinière qui ne peut empêcherson bébé de déféquer pendant qu'elle prépare le repas,s'arrangera pour éloigner rapidement de tels déchets afin dene pas être traitée par son entourage de femme sale.
13 De tels faits sont soulignés aussi en zone mossi (Poloni, 1991 : 279). LanUIt tout comme le milieu de journée sont considérés comme étant desmoments idéaux pour la présence des génies parmi les humains. L'actede balayage susciteraIt leur colère qu'ils manifesteraient en attribuantdes infortunes telles l'infécondité et la pauvreté. De telles conceptionssont largement partagées dans de nombreuses sociétés ouest-africames.
424
La séparation des saletés
Les maladies de passage
Une première distinction est corporelle. L'utilisationde la main gauche ne doit pas selon les normes nanergeintervenir dans de nombreuses activités en rapport avec laconfection des aliments. Comme chez les Mossi, « les préparations exigeant malaxages ou brassages C.. ) ont toujoursété effectuées exclusivement de la main droite. Une telle pratique assure de la séparation des ordres, de la discriminationentre le propre et le sale, et plus largement du pur et del'impur» (poloni, 1991 : 277).
La vaisselle et la lessive, considérées comme des activitéssales, se feront au bord de puits qui sont généralement publicset situés en dehors des concessions. Dans les cours où il y a unpuits, un coin est réservé spécialement à de telles activités.
La propreté intègre également la séparation desespaces et des objets qui leurs sont affiliés. Certains objetsen contact avec les toilettes telle la bouilloire seront mis àl'écart des activités liées à la transformation alimentaire.L'utilisation d'une bouilloire pour rincer une marmite ménagère est considérée comme sale et l'on distingue souvententre un sceau destiné à la toilette et un autre essentiellement réservé à la cuisine.
Conclusion
Les pratiques et les représentations sociales se transforment et les conceptions de la transmission et de la propreté ne sauraient constituer des exceptions. Par le contact avecla ville, avec d'autres populations mais aussi avec la biomédecine, les mœurs changent. Le parfum et l'encens (utilisés uniquement pour leurs vertus odorantes) entrent dansles mœurs locales par le contact avec la ville et plus spécialement avec le milieu bambara. De même, l'introduction de lasalade verte dans les modes de consommation culinairess'accompagne souvent du lavage des feuilles avec de l'eau dejavel ou du permanganate de potassium. Ce sont là quelquesfaits qui témoignent de la progression de la conception hygiéniste dans les milieux populaires.
Maladies et gestion de la saleté en milieu rural senufo 425
L'analyse des représentations relatives à la transmission et à quelques codes de propreté a permis de mettre enévidence que la prévention bien qu'importante dans l'universcognitif des acteurs sociaux ne détermine pas forcémenttoutes leurs pratiques et notamment celles associées à la propreté. Ces remarques tendent à montrer que le domaine dela transmission fait partie des" savoirs-représentations»tandis que la propreté se range plutôt du côté des « savoirsactions ». Les unes se confinent largement dans la sphère dudiscours, les autres se situent du côté des pratiques.« Transmission» et « propreté " ne sont pas dans un rapportde stricte détermination.
De plus, l'interprétation des codes de propreté exigeplusieurs niveaux de lecture. S'ils dépendent effectivementdes contraintes économiques et écologiques (Poloni, 1991 :275), ils font aussi partie des normes de savoir-vivre. La saleté est quelque chose que l'on craint moins à cause d'un risquede contamination de la maladie qu'en fonction d'un jugementde valeur porté par les autres. Si la propreté se voit et semontre, la saleté se dit et suscite la critique de l'entourage.Désapprobation qui peut, dans la logique senufo, susciter dela honte. Ce qui soulève d'autres questions ...
Bibliographie
Bouju J.1998 " Approche anthropologique des stratégies d'acteurs et des
jeux de pouvoirs locaux autour du service de l'eau àBandiagara, Koro et Mopti (Mali) ", Rapport final du projet PSlEau - Opération de Recherche n° 10 du Ministèrede la Coopération, Marseille, EHESS.
Bourdelais P.1989 " Contagions d'hier et d'aujourd'hui ", Sciences Sociales et
Santé, 7 (1) : 7-20.
Douglas M.1992 De la souillure, Paris, La Découverte.
Dumestre G., Touré S.1998 Chroniques amoureuses au Mali, Paris, Karthala.
426 Les maladies de passage
Dupire M.1985 « Contagion, contamination, atavisme: trois concepts
sereer ndut (Sénégal) ", L'Ethnographie, tome LXXXI, n°96-97: 123-139.
Jaffré Y.1999 La visibilité des maladies des yeux, in La construction
sociale des maladies. Les entités nosologiques populairesen Afrique de l'Ouest, Jaffré Y. & Olivier de Sardan ,J.-P.(edsl Paris, PUF : 337-357.
Jaffré Y. & Olivier de Sardan J.-P., 1999, La construction socialedes maladies. Les entités nosologiques populaires enAfrique de l'Ouest, Paris, PUF.
Olivier de Sardan J.-P.1982 Concepts et conceptions songhay-zarma, Paris, Nubia.1996 « La violence faite aux données. De quelques figures de la
surinterprétation en anthropologie ", Enquête, 3 : 31-59.
Peeters A.1982 « L'hygiène et les traditions de propreté, l'exemple des
Antilles françaises ", Bulletin d'Ethnomédecine, 11 : 3-24
Poloni A.1990 « Sociologie et hygiène. Des pratiques de propreté dans les
secteurs périphériques de Ouagadougou ", in Fassin D. &Jaffré Y. (éds.l, Sociétés, santé et développement, Paris,Ellipses/Aupelf, : 273-287.
Roger M.1993 « Sumaya dans la région de Sikasso : une entité en évolu
tion ", in Brunet-Jailly J. (éd.), Se soigner au Mali. Unecontribution des sciences sociales, Paris, Karthala-ORSTOM: 83-125.
Vigarello G.1985 Le propre et le sale. L'hygiène du corps depuis le Moyen
Age, Paris, Seuil.
Chapitre 17
Médicaments et préventionen milieu populaire songhay-zarma(Niger)
Laurent Chilliot
Au Niger comme ailleurs en Afrique, la préventionconstitue un des principaux thèmes des politiques de santépublique à travers notamment la mise en œuvre de campagnes d'informations et d'éducation pour la santé et de programmes de vaccinations. Toutefois, la bonne réception deces programmes par les populations est une difficulté majeure rencontrée par les équipes médicales (Fassin 1986, Jaffré1996), ceux-là reposant sur des concepts et des savoirs médicaux parfois difficilement compréhensibles pour les populations locales qui, de leur côté, ont, elles-mêmes, en matièrede prévention leurs propres conceptions.
Ce sont de ces dernières, dont nous voudrions rendrecompte, en montrant comment, au sein d'une société ouestafricaine, en l'occurrence en milieu songhay-zarma nigérien,est pensée la prévention.
Le sujet est cependant vaste. Nous proposons ici del'aborder sous un angle bien particulier, en privilégiant lespratiques et représentations locales relatives aux médications populaires préventives, laissant ainsi de côté l'ensembledes pratiques ou comportements d'hygiène, d'évitement...
428 Les maladies de passage
Les propos qui suivent! tâchent donc de déterminer lesdifférentes formes de médications préventives locales et lesprincipaux critères sur lesquels repose leur emploi : dansquelles mesures et à travers quelles logiques le remède (qu'ilsoit prescription magico-religieuse, plante médicinale ou produit pharmaceutique) est employé à titre préventif face à lamaladie ?2
La notion de remède et la maladie dans le champ del'infortune
Dans les représentations locales, la maladie3 , est largement conçue comme une manifestation de l'infortune, lerésultat de la fatalité. De ce fait, elle s'inscrit dansl'ensemble des événements malheureux de tous ordres pouvant survenir au cours de l'existence: accident, échec professionnel, malheur affectif, voire catastrophe naturelle.
La notion de remède telle qu'elle est partagée par laplupart des sociétés africaines souligne cette conception. Eneffet, le terme local désignant les remèdes, les médicaments,recouvre souvent un sens beaucoup plus large que le termefrançais. C'est ainsi qu'en milieu songhay-zarma, safari estle terme employé pour « médicament », " remède ", construitsur la racine verbale safar, généralement traduit par « soigner ". Il désigne ainsi l'ensemble des plantes ou autres sub·stances (animales, minérales) confectionnées et employées à
1 Les données « de terrain» à la base de cet artIcle ont été recueillies lorsde séjours d'enquêtes réalisés pour une thèse d'anthropologie sur lespratiques de médication et leurs représentations en milieu songhayzarma (Niger) Elles ont pu être complétées et approfondies au coursd'une mission effectuée dans le cadre du programme de recherche ORSTOMIUnion Européenne: « Interactions entre les systèmes de santépublique et les conceptions et pratiques populaires relatives à la maladie (Mrique de l'Ouest) ».
2 Il ne sera donc pas non plus question des diverses interprétations populaIres élaborées face aux actes médicaux préventifs proposés sur le planlocal, tels que les vaccinations.
3 Les éqUIvalents donnés ici des maladies, sont ce que l'on peut nommerles « traductions médicales par défaut" : des noms de maladies localesgénéralement proposés par les agents de santé et les locuteurs francophones.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 429
des fins médicinales, incluant donc également les produits dela pharmacopée biomédicale (comprimés, injections... ).
Safari ça veut dire médicament. Ça comprend lesécorces, les racines, les feuilles et même les comprimés ettout ceci. (11)4
Mais au-delà du champ strictement thérapeutique oumédicinal, safar et safari sont des termes du vocabulairemagico-religieux. On dira par exemple d'un marabout préparant une amulette protectrice qu'il safar un individu, qu'il luifait un safari; de même, une personne s'estimant être victime d'un mauvais sort, dira qu'elle a été safar (i na ay safar),qu'on lui a fait un safari.
Lorsqu'on dit safari, c'est très vague (hay huI no go ara, litt. « il y a tout dedans»), il Y a ceux pour la paix(baani)5, ceux pour le malheur (bone), il y a les mauvais(laaIo) comme les bons (hanno). (U.)
Ainsi, si la définition locale de safari inclue bien l'idéedu « médicament» tel qu'on le conçoit dans le monde occidental (substance médicinale), elle renvoie de façon plus globale àtout objet ou technique, élaborés et employés par l'homme àdes fins déterminées et procédant par une force (magique ouautre) capable de produire une action (salutaire ou pernicieuse) non seulement sur la santé de l'individu, mais sur sa vieen général, son destin, son environnement social ou naturel ...
Le vaste champ d'action accordé à l'objetlforce-safaripermet ainsi de recadrer la place de la maladie dans letableau général des événements néfastes ou malheureux6.
Ainsi en tant que force salutaire, safari procure certes lasanté mais de façon plus générale la paix, la tranquillité,sens que recouvre le seul terme baani (bien être).
Par ailleurs, l'idée de force que suggère la notion safarien milieu local n'est donc pas seulement pensée comme unmoyen de « remédier », de permettre un retour à la paix ou
4 Une liste des mformateurs est donnée en fin d'article.
5 Le terme baani désigne à la fois la santé, la paix, la tranquillité.
6 Voir notamment à ce sujet l'étude critique de Pool (1994) sur la tendance de tout un pan de la recherche ethno-médicale à privilégier la causalité naturelle des maladies au sein des sociétés africaines.
430 Les maladies de passage
santé (baani) (force réparatrice/curative). Elle suggère également l'inverse, un moyen de troubler cette paix, l'ordre normal des choses (force agressive/persécutive) ou enfin unmoyen de favoriser le bien ou de protéger du mal (force protectrice/propitiatoire).
Safari
force réparatrice /curative >~
baani (paix.santé)
orce protectrice /propitiatOire
--1 boneforce agressive /persécutiVe (malheur)
doori(maladie, douleur
souffrance)
Ainsi si safari désigne la technique ou l'objet grâceauquel on peut venir à bout de la maladie, comme un médicament au sens occidental, c'est aussi celui par lequel elle peutêtre causée (par exemple par un mauvais sort) et enfin lemoyen qui permet de s'en préserver (amulette, vaccination).
Le type qui est contre toi, il peut te faire du safari,ainsi s'il voit que tu es plus aisé que lui, il peut te jeter unsort, il t'a fait du safari. Toi, de ton côté, pour te protégercontre certaines choses de la nature tu peux faire du safari. C'est ça le mot safari Loo] Donc celui qui fait le sortpour une personne, on dit qu'il a fait du safari, celui quise protège contre les sorts là, on dit qu'il fait du safari ;celui qui soigne sa maladie on dit qu'il a fait aussi dusafari. (RB)
C'est donc seulement en fonction du contexte d'énonciation (dans les discours) et d'utilisation (dans les pratiques)que se détermine le sens du terme et de l'objet safari. Nousprivilégierons donc dans cet article la façon dont on a recoursaux « remèdes» en tant que force protectrice ou propitiatoire,bref en tant que moyen préventif.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 431
Si cette dimension spécifique n'est pas forcément évidente au premier abord, elle est pourtant souvent un desprincipaux trait que certaines expressions métaphoriques dulangage courant construites sur le terme safari mettent envaleur: il s'emploie pour les bombes insecticides (soborosafari, litt. « le safari des moustiques») ou bien des produitsanti-acridiens répandus sur les champs de cultures?
Les recettes propitiatoires: se préserver de la maladieinfortune
Que l'on y voit l'effet d'une agression surnaturelle(ganji doori : « maladie de génie») ou la marque de la fatalité(lrkoy doori : « maladies de Dieu»), la maladie constitue enmilieu local un des nombreux visages de l'infortune. En tantque telle, elle n'est pas distincte des divers autres fléaux ouévénements malheureux auxquels l'homme doit faire face.
Ainsi la prévention des maladies relève pour une largepart de techniques propitiatoires visant à s'épargner du malheur, du mal en général, dont les responsables magico-religieux détiennent les recettes.
En milieu songhay-zarma ces personnages sont divers.Les plus nombreux sont les marabouts (alfaga) et les responsables du culte de possession (zimma). Il s'agit par ailleursdes magiciens sohance et de divers autres détenteurs decharmes magiques (kotte koyni) que sont, principalement, lesgens dits « de caste» : pêcheurs (sorko) ou« maîtres du fleuve »
(do), forgerons (zem) , barbiers (wanzam), descendants decaptifs familiaux (horso) ...
Toutefois, à la différence des marabouts, des zimma etdes sohance, les compétences des gens dits de caste sont souvent limitées à leur domaines d'activité. Ainsi, les zemdétiennent les charmes de protection contre les brûlures, les
7 Et de telles expressions semblent communément répandues en Mrique.Ainsi en Ouganda, Whyte 0988 : 218) note: « To get a good cash crop,"cotton medicine" (DDT) was sprayed on the plants ". De même,Luxereau (1989 : 325) rapporte qu'en mIlieu haoussa nigérien « unimperméable est un "remède à la pluie" comme le feu peut être un"remède au froid" ".
432 Les maladies de passage
coupures par le fer, les sorko ceux préservant des dangers dufleuve, les horso ceux permettant de ne pas être vu parl'ennemi et d'être invulnérable aux agressions armées(flèches, sabre)8.
Donc, si ces derniers pratiquent si l'on peut dire unemagie « de spécialité )', les marabouts, zimma et sohanceapparaissent comme des « généralistes» en matière demagie9 : leurs prescriptions peuvent être élaborées à des finsspécifiques ou de manière plus globale afin de solliciter laprotection ou les grâces des entités diverses peuplant lemonde surnaturel, les génies (ganji) notamment, ou de Dieu(Irkoy) 10. En effet, leurs compétences en matière de protection sont largement plus étendues. Ayant la faculté d'entreren relation avec les forces de l'au-delà, ils peuvent du coup,par leur entremise, agir sur le devenir des choses, le destin.
Dans leur élaboration, les techniques et objets préventifs magico-religieux, mises à part quelques exceptions - telque le kusu que nous présentons plus bas - sont généralement identiques à ceux employés à des fins curatives ouréparatrices.
Différents termes génériques les désignent: ganji haw«< attacher la brousse »), c'est-à-dire contrôler, maîtriser lesforces surnaturelles, Irkoy Naare «< prier Dieu ») ou sumbulku, terme désignant toute forme de bénédiction maraboutique parfois généralisé à toute pratique magique.
Ces différents termes recouvrent des formes de prescriptions diverses, et au plus simple, la parole à elle seuleconstitue une force protectrice. C'est d'ailleurs fréquemmentà travers elle que les prescriptions magiques et maraboutiques acquièrent leurs vertus.
8 C'était le horso qui autrefois confectionnait des charmes pour sonmaître quand celui-ci se rendait au combat.
9 S'ils sont principalement fréquentés pour leurs compétences magicoreligieuses, ces personnages détiennent généralement un savoir important sur les plantes médicinales.
10 Si ganji est le terme générique pour désigner les génies, on parlera plusparticulièrement de zin (djins musulmans) à propos des génies alliésaux marabouts et de holley pour les génies de posseSSIOn. Par ailleurs,parmi l'ensemble des responsables magico-religieux, seuls les marabouts prétendent invoquer DIeu (en l'occurrence Allah) directement.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 433
Ainsi les responsables magico-religieux peuvent formuler de simples bénédictions directement sur l'individu enprononçant des charmes, kotte, ou paroles magiquesjinde-ize(lit. « produit du cou ,,)11, des versets du Coran (adduwaJ oudes sourates entières (fatiya ou kurana zumendi, lit. « fairedescendre le Coran»).
Ces récitations se font fréquemment par la techniquedu tufa «< cracher ,,) qui consiste à ponctuer la déclamationde crachotements successifs.
Mais si la simple énonciation de ces paroles propitiatoires constitue à elle seule le remède « administré» directement à la personne, les thérapeutes ont aussi fréquemmentrecours à la confection d'objets assurant ainsi un supportmatériel au pouvoir invoqué. Ce sont notamment les amulettes ou « gri-gri ». Ces objets magiques peuvent être detoute nature: une simple pierre ou un morceau de bois surlequel est récitée une formule peut faire l'affaire. Mais lesplus répandus sont le tiira-ize (litt. « morceau de papier ,,) etle guli «< noeud '» ou gurmi «< nouer ),).
Le tiira-ize est une amulette communément confectionnée par les marabouts: pochette de cuir comportant desbouts de papier sur lesquels sont inscrits des versets. Le guliou gurmi est généralement une lanière de cuir ou bien unécheveau de fils comportant un certain nombre de nœudsconsacrés, que l'on attache à la ceinture, au poignet ou à lacheville, amulette confectionnée tant par les marabouts quepar les zimma.
Par ailleurs, à côté de ces prescriptions propitiatoirespersonnalisées, d'autres sont parfois élaborées à plus grandeéchelle, comme par exemple pour un village ou une concession. C'est par exemple le hampi kanendi «< le hampi qui faitle bien »)12 que décrit Rouch (1989 : 283) comme « un vasedans lequel on fait germer du mil et qui sera une protection
11 Rouch (1989) donne différents exemples de jinde-ize (op. cit. : 280-288)et de kotte (id. : 303-305 J.
12 Le hampi est un vase rituel aux usages divers. S'il est au centre de lacérémonie de possession yeenendi (rite de pluie, litt. « rafraîchir»), ilsert également à confectionner des décoctions, ou comme c'est le cas icid'objet propitiatoire; kanendi est la forme factitive (-endiJ du verbekaanu : être bon, doux, agréable.
434 Les maladies de passage
contre toutes les choses mauvaises ». En y répandant unepoudre de plante elle-même déjà consacrée, l'officiant (ici unzimma-magicien) prononce lejinde·ize suivant (dont le contenu révèle le pouvoir « généraliste» du zimma) :
( ... )
Le hampi a reçu la poudre.
Pour le zima méchant, la poudre.
Pour la femme méchante, morte en couches13, la poudre.
Pour les maux de tête méchants, la poudre.
Pour les maux de ventre méchants, la poudre.
Pour la fièvre méchante, la poudre.
Jusqu'à jamais.
Jamais, jamais (id. : 283).
Les prescriptions propitiatoires peuvent enfin se présenter sous formes de breuvages ou de mets consacréscomme par exemple le hantumo hari des marabouts ou lekusu des magiciens et zimma :
- Le hantumo hari (lit. « eau de l'écriture») ou walahadawa Oit. « encre de l'ardoise») des marabouts est une desformes les plus courantes. Elle consiste à administrer enbain et en breuvage une eau ayant servi à rincer une tablettesur laquelle des versets coraniques ont été préalablementécrits. Ainsi, en fonction des versets inscrits par le maraboutsur la tablette, l'eau acquiert des vertus propitiatoiresdiverses.
Mais une autre pratique effectuée par les maraboutsest d'administrer à boire tout simplement de l'eau sur laquel·le des versets ont été récités.
- Le kusu (litt. « marmite») est une recette essentiellement préventive qu'élaborent les magiciens sohance et certains zimma. Il s'agit d'un met (galette, plat de riz ou demiL.) préparé dans une marmite auquel sont ajoutées despoudres de plantes consacrées et/ou des formules magiques.
13 "Le biya "ombre", "double", "âme"] de ces femmes est extrêmementdangereux car Il tente de se venger sur les autres femmes enceintes, deles faire avorter en leur faisant peur" (op. cit. : 225).
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 435
Kusu, c'est quand une personne est guérie d'une maladie provoquée par des génies (dooro kan seytaney ta), etqu'elle ne veut plus être encore attrapée : il existe desparoles (senniyan) que l'on prononce sur la nourriture(hawru) qui est dans la marmite (kusu) , cela peut être àbase de riz (moo bi) ou d'épis de mil (hayni jeni bi) quel'on pile, et à laquelle on ajoute du beurre (jii) et du sel(ciiri kwaarey) ; C'est cela le kusu. L..] Tu sais aussi qu'onne fait pas seulement des kusu pour la maladie (jonte se).(BN)
Le kusu, ça se fait surtout pour les enfants pêcheurs.On leur prépare le kusu pour qu'ils puissent rentrer dansl'eau sans crainte, ils ne seront pas attrapés par un caïman... Chez nous [à Niamey] par exemple, comme il y ades tessons de bouteilles quelquefois dans le fleuve, unefois que le kusu est préparé, vous êtes protégés, rien nevous arrive dans le fleuve. Il y a aussi le kusu, pour lesgens de la brousse: il faut leur préparer le kusu contre lesmauvais animaux sauvages. Il y a également le kusu duZermaganda qu'il faut préparer pour les gens qui craignent des maladies épidemiques. Tout ça ce sont différentes plantes.
L..] C'est préventif. Si on vous a préparé le kusu maintenant, vous êtes « vaccinés" pendant un an L.. ] Maisl'année prochaine il faudra recommencer, c'est comme unevaccination. (DZ)
D'une manière générale, ces diverses protections sontmises en œuvre afin de s'épargner tout événement néfaste,d'ordre physique, affectif, ou social, en sollicitant la chance,la réussite, la prospérité, la paix, la santé ...
En fait, ces ganji haw ou Irkoy Naare ne sont généralement recherchés que face à l'idée toujours présente de risque,quelle que soit sa nature. On y aura par conséquent recourslors de moments où l'on se sait (se sent) vulnérable, momentoù, selon l'expression locale, on a un « double ", une « âme"fragile, légère (biya dogon)l4. Cette expression désigne géné-
14 Moumouni (1996: 74) en donne un explication: « ••. on dit par exempleque telle personne a un bzya lourd (biya tmo) pour marquer la façondont il s'impose à certaines épreuves, ou que tel autre n'a pas de biya,
436 Les maladies de passage
ralement les personnes particulièrement vulnérables àl'agression de forces surnaturelles hostiles, ainsi en proie aumoindre malheur: « voilà pourquoi on dit que ces personnesont un biya fragile, elles attirent toutes le malheur. N'as-tupas remarqué qu'on fait des médicaments qu'on met àl'entrée des cases de circoncis, de jeunes accouchées ou deveuves? » Œisillat & Laya, 1973 : 349).
Le corps malade: conceptions populaires et recettes préventives
Mais si toute maladie est pensée comme une manifestation de l'infortune, un coup de la fatalité dont on peut seprotéger en sollicitant les forces de l'au-delà, elle s'inscritcependant dans un espace aux limites bien précises: lecorps, et cela de façon bien concrète puisqu'elle le marquepar des signes et des douleurs.
A partir de cette réalité physique de la maladie,d'autres représentations sont élaborées qui assignent à cesmarques des causes disons plus immédiates, renvoyant à desexplications prosaïques essentiellement physiologique15,
expliquant non pas le « pourquoi? » mais le « comment? » dela maladie (Gillies, 1976).
Se déploient alors d'autres formes de savoirs non plusspécifiques à quelques initiés mais largement partagés ausein de la société, relatifs aux « mécanismes» généraux ducorps, tels qu'ils sont conçus en milieu local, sur la base desquels se conçoivent d'autres formes de prescriptions ayantpour effet de « travailler» le corps.
une manière de faIre allusion à son manque de poigne ... J. Les bzyalégers (biya doWm) se recrutent chez les enfants, les femmes enceinteset les malades, ils constituent de surcroît des personnes à rIsques que lasociété se doit de protéger". Cf. également Bisillat & Laya (1973 : 348349J.
15 En effet, les interprétatIOns nosologiques populaires en milieu songhayzarma ne reposent pas sur une théorie symbolique globale comme c'estle cas dans certaines socIétés voisines (ex. opposition chaud 1 froid chezles touareg) (Ohvier de Sardan 1994 : 17-19J.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhav-zarma 437
Le ventre et le sang dans les conceptions populaires dela maladie: étio-Iogiques et symptomato-Iogiques
Ainsi en milieu songhay-zanna, mais c'est le cas dansde nombreuses autres sociétés ouest-africaines (Jaffré &Olivier de Sardan, 1999), l'explication d'un grand nombre demaladies est attribuée au ventre. C'est depuis le ventre quela plupart des troubles se développent.
A côté des divers problèmes gastro-intestinaux, destroubles, tels les maux de tête, les fièvres, les douleurs articulaires, les dennatoses, l'impuissance ou la stérilité etc., sontgénéralement présentés comme des manifestations dues audéveloppement d'un principe morbide localisé à l'intérieur duventre que l'on attribue généralement au weyno. Weyno est eneffet donné en milieu local comme un état pathologique d'origine congénitale auquel la plupart des individus sont sujets.Siégeant à l'intérieur du ventre, il est présenté comme unprincipe morbide « en léthargie » qui peut, en fonction de certaines conditions (l'alimentation notamment), « se réveiller »,
« se lever » et donner lieu à certains troubles bénins (perte del'appétit, sensation de fatigue, maux de tête ... ) pouvantdéboucher cependant, à plus ou moins long terme, sur desmaladies plus préoccupantes (moo-sey : jaunisse, dankanooma : hémorroïdes, heemar-ize : paludisme, cantu : maladievénérienne... ) (Olivier de Sardan, 1994). Toutefois, sans pourautant évoquer chaque fois weyno, les discours populaireslocaux diront d'une manière plus générale des maladiesqu'elles sont dues aux « saletés du ventre » (gunda ziibi) ouqu'elles viennent de l'intérieur du ventre (gunda kuna harey).
Lorsque tu vois que ta tête te fait mal (dooru) , c'estque ton ventre est sale (ziibi). [... ]. Heemar-ize, c'estlorsque le ventre est sale (ziibi). (LI)
Yeyni, c'est dans ton ventre, cela fait une sorte degraisse (maane) qui court (zuru-zuru) à l'intérieur de tonventre. (MSa)
Lorsque tu as beaucoup de kaajiri à l'intérieur de tonventre, il sort ({atta) alors sur ton corps (gahamo). (AZ)
Cela lui donnait de la fièvre (konni), il ne mangeaitpas, il ne buvait pas, tout son corps était enflé (buku-
438 Les maladies de passage
buku) ; ça se levait (tun) puis ça se calmait (daama). Ons'est dit que peut-être (hambara), la maladie (dooro) étaità l'intérieur de son ventre (gundo ra). (FBi)
Par ailleurs, sur les rapports entre le principe morbideinitial et les manifestations sensibles (douleurs, fièvres ... ) ouvisibles à la surface du corps (œdèmes, lésions, boutons... ),c'est généralement le sang (kuri) qui est évoqué, présentécomme le véhicule de la maladie à l'intérieur de l'organisme.C'est bien souvent par lui que ces manifestations concrètesde la maladie s'expliquent.
Bien que les représentations relatives à ce processusphysiologique du passage de la maladie du ventre à l'intérieur du sang restent la plupart du temps imprécises etimplicites, les discours s'accordent généralement sur le faitque la maladie « gâte le sang » (a ga kuri sara), elle « fait dusang mauvais)> (a ga te kuri laalo) ou « du sang noir)> (a gate kuri bi). Cette altération de la qualité du sang sera parfoisdonnée comme conséquence d'un dérèglement de son mouvement, de son flux à l'intérieur du corps. Ainsi Bisillat et Laya(1973) rapportent les propos d'un guérisseur: « lorsqu'unemaladie attrape l'homme à cet endroit-là [les reins, donnésici comme le lieu de production du sang] elle arrête rapidement le sang qui devient noir. De même lorsqu'une personnea peur16, le corps s'arrête de faire du sang qui devient noir etla personne se met à dépérir. [. .. ]. Il [le sang] marche dans lecorps ; s'il ne marche pas et s'arrête, la personne devientmalade)> (op. cit. : 339)17.
Qu'il soit ou non pensé dans une relation de cause àeffet avec le ventre, le sang apparaît donc comme un secondélément fondamental dans les conceptions locales de la maladie, permettant essentiellement d'expliquer moins les circonstances de son apparition à l'intérieur du corps que lesmanifestations concrètes, sensibles ou perceptibles, aux-
16 Le guérisseur fait ici allusion à la maladie à étiologie surnaturelle humburukumey (<< peur ", « effroi ,,) survenant généralement suite à la rencontre avec un génie ou un être malfaisant qui plonge le malade dansun état de grande torpeur.
17 8isillat (1982) rend compte également de l'importance accordée au mouvement du sang dans les conceptions de la maladie recueillies auprès dedeux guérisseurs songhay.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 439
quelles elle donne lieu. Si le ventre est évoqué afin de donnerun sens à l'apparition et au développement des maladies(étio-Iogique), c'est généralement en évoquant le sang que lesressentis et les « traces » physiques que présente le corpssont rendus intelligibles (symptomato-Iogique).
On trouve ainsi le sang non seulement dans les interprétations en aval de la maladie, dans ses effets, mais également en amont, dans ses conditions d'apparition: si c'est parlui que s'expliquent la plupart des manifestations ressentiesou visibles causées par la maladie, c'est également en fonction de lui que le corps est conçu comme plus ou moins vulnérable à la maladie. En effet, « ne plus avoir de sang» (si ndakuri), « avoir le sang qui s'amenuise (qui « finit ») à l'intérieur du corps» (kuri ban hamo ra) ou « avoir un sang léger»(go nda kuri dogon)18 sont des expressions communémentemployées pour exprimer un affaiblissement physique important, où le sang réfère à la force du corps, à sa vigueur, à sontonus. Par conséquent, un corps « qui n'a plus de sang » ouqui a un « sang léger» est un corps fragile, vulnérable, exposé à la moindre maladie. La moelle (londi) est parfois évoquée pour exprimer cette faiblesse du corps: on l'attribueraainsi à la« mort de la moelle» (londi buyan ou londi buna).
Tu ne vois pas la fièvre (konno) que j'ai au point quetout mon sang s'en est allé (kala ay kuro kul ma fun) ;cette fièvre est à l'intérieur de mon ventre. (MC)
Lorsque tu« n'as plus de sang» (si nda kuri), que tu asl'impression, lorsque tu marches, que le vent va t'emporter (hewo ga ni sambu), pour cela nous pouvons te donnerune plante. Si tu la bois durant deux jours, ton sang varevenir (ga yee ga kaa). On l'appelle barre [euphorbia balsamiferaJ19. (CM)
Moo-sey ne fait rien en dehors de « boire» (haaN) tonsang. Ainsi lorsque tout ton sang est tari (ban), tu meurs.(CM)
18 On retrouve ici, à propos du corps, la même notion de fragilité (dogon),de vulnérabilité rencontrée plus haut à propos du biya.
19 Les noms scientifiques des plantes citées dans l'article ont été déterminés à partir des deux ouvrages suivants: Peyre de Fabrègues (1979) etBernard & White-Kaba (1994).
440 Les maladies de passage
La dernière maladie qui m'a attrapé (di) : mon corpsétait complètement « mort » (a bu turuk ! turuk !), jen'arrivais plus à soulever quoi que ce soit L..) J'ai commencé à me soigner, on m'a piqué (pike), on m'a donné descomprimés (kini), puis cet état de faiblesse (ay hamo londibuna, litt. « la mort de la moelle de mon corps ») s'estamélioré L.. ] C'était londi buyaNo. Lorsqu'une personne acela tu vois qu'elle n'a plus du tout de force (sahaN). (FBi)
Ainsi, pour résumer, si l'on schématise globalement lafaçon dont la maladie est communément pensée en milieupopulaire local, on peut dire qu'elle a généralement pour pointde départ le ventre à l'intérieur duquel elle se développe (weynoou « saletés du ventre» : gunda ziibi) jusqu'au point où, s'yétant accumulée de manière excessive (baa), elle se diffuse parl'intermédiaire du sang à travers le corps, donnant lieu à destroubles « périphériques» précurseurs (fatigue, fièvre, douleursdiffuses dans le corps... ) ou véritablement pathologiques, « terrassant » (zeeriJ l'individu (état léthargique, amaigrissementimportant, fièvre récurrente...) et/ou en « attrapant» (di) certaines parties du corps (douleurs localisées aigues, boutons,oedèmes...) que l'on désigne par des noms spécifiques de maladies (moo-sey, yeyni {ara, heemar-ize.. .J.
L'idée d'un tel processus de développement de la maladie se trouve renforcée par les combinaisons que présententgénéralement les cures en milieu local. Face à de nombreuses pathologies20, le traitement a pour base l'administration de purgatifs (breuvages laxatifs, émétiques, diurétiquesou lavements) visant à débarrasser le ventre de la substancemorbide qui l'affecte. Parallèlement, suivant les troubles« périphériques» que la maladie induit, des procédures thérapeutiques adjacentes sont prescrites (saignées, fumigations, bains, onguents ... ) afin de libérer le corps des substances conçues à l'origine de leur manifestation (sang etsueur) et lui permettre de retrouver de sa vigueur: les thérapeutiques adjacentes auront généralement pour effet de soulager le corps malade et douloureux.
20 C'est le cas par exemple, de la jaunisse Imoo-sey), des hémorroidesIdankanooma), des dermatoses en générales IkaaJlri), du paludismeIheemar-Ize) ou des maladies des os Iyeyni fara).
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 441
C'est donc essentiellement à l'intérieur du ventre et enfonction du sang que se joue l'équilibre fragile entre santé etmaladie. Un ventre « propre» sera une des principales conditions de la bonne santé, de la forme physique, de la vigueurdu corps. Un ventre « sale» sera l'occasion de troubles multiples (fatigue, douleurs... ), expressions d'une fragilisation ducorps, en proie à la moindre maladie ou favorisant son développement, son aggravation.
L'utilisation préventive des recettes médicinales locales:renforcer le corps
Face à cette conception populaire de la physiologie dela maladie, les pratiques préventives mises en œuvre visentprincipalement par conséquent à éviter la formation etl'accumulation de saletés à l'intérieur du ventre.
Outre l'attention accordée à certaines conduites21,l'essentiel de ces pratiques repose sur la consommation detisanes ou décoctions à base de plantes diverses présentéescomme des fortifiants et ayant pour principal rôle de « laver»le ventre des déchets qui s'y accumulent.
Toutefois, les recettes employées à titre préventif nesont généralement pas distinctes dans leur composition desprescriptions curatives. En effet, le caractère préventif assigné à un traitement ne dépend pas du remède employé maisdu contexte dans lequel celui-ci s'emploie. Face au caractèreévolutif de la maladie (principe morbide latent -> signes précurseurs -> manifestations pathologiques), il n'y a pas véritablement de rupture entre prévention et cure. C'est l'apparition des premiers signes qui déclenche la procédure derecherche du remède, lequel aura pour but de traiter ces premiers symptômes en même temps qu'il parera à leur éventuelle aggravation22.
21 Ainsi parmi les principaux comportements à éviter nous pouvons citer:changement dans l'alimentation habituelle et dans le rythme de prisedes repas, mélange de nourritures variées, rester trop longtemps sousle soleil, rester assis trop longtemps, etc.
22 Nichter & Vuckovic (1994) considèrent ainsi: " Distinctions betweencurative, preventive and promotive health care often abstract and theproduct of western conceptualization. For many people in Less
442 Les maladies de passage
Elles renvoient ainsi à une conception de la prévention« à large spectre » dans la mesure où la logique en œuvreconsiste en un rapport de force entre la maladie en général(et non telle ou telle maladie spécifique) et le corps. Il s'agitpour ainsi dire de donner au corps les moyens de faire frontaux nombreuses maladies qui peuvent l'affecter. La prévention repose donc essentiellement en milieu local sur l'idéed'un renforcement du corps. On agit moins vis à vis de telleou telle maladie potentielle que vis à vis du corps fragile,affaibli.
C'est ainsi que l'essentiel des mesures préventives estmis en œuvre lors de la petite enfance. Le jitti (litt. « âpre ,,)23
constitue en effet, le fortifiant préventif par excellence. Prispar la mère lors de sa grossesse, il est ensuite une boissonadministrée quotidiennement à l'enfant durant une périodeplus ou moins longue de croissance.
L'administration de ces fortifiants aux enfants commence généralement très tôt, dès le lendemain du baptêmeou dans les premiers mois suivant la naissance et s'étend surune période variable (de quelques mois à plusieurs années).Elle consiste en un véritable gavage quotidien de l'enfant quel'on pratique deux à trois fois par jour24 .
Developed Countries (LDCsI, preventive health means keepmg astateof marginal health from becommg worse by taking or purchasing medicines as forms of commodified health " (Op.Clt. : 1511-1512). Ils ajoutentpar ailleurs que ces 3 concepts se confondent tout autant en Occidentdans certains contextes : " Popular health carl' behavlOr involves thepreventive use of antibiotics in "flu season" when one doesn't "havebme to be ill" » (id.).
23 Si )lftl désigne le plus souvent ces boissons pour enfants, il peuts'employer pour désigner tout breuvage médicinal Le nom donné à cestisanes VIent de leur goût. On notera qu'en milieu local, la force du goût(hottu! constitue un critère Important de l'efficience attrIbuée auxremèdes. ToutefOIs, admmistrés aux enfants, les jittl seront fréquemment confectlOnnés à base de laIt, accompagnés d'mgrédients doux(sucre, beurre ) ou versés dans de la bouillie, afin qu'ils puissent lesprendre sans difficulté.
24 ... ou parfois plus. Ainsi, les propos d'infirmières recueillis par Gelhon0997 : 56) : " La mère ne sait souvent pas doser la quanbté de )lttl. Enplus elle donne ça à longueur de journée dès que l'enfant a soif" ; " certaines mères donnent Jusqu'à six louches correspondant à un htre de)ltti, ce qui est énorme pour la taille de l'estomac de l'enfant... ".
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 443
Dès que l'enfant est né, quand on lui a fait son baptême (caba) , le lendemain tu vas cueillir le jitti. Lorsqu'ilatteint deux ans on arrête. Certaines mères attendentmême trois ans pour arrêter. Mais on peut faire boire lejitti à tout âge, même un père de famille (boro to baaba)peut en boire. (H)
Le lendemain du baptême (cabaJ, on lui prépare (hina)du habu-lamba. S'il est habitué au jitti (nda jitti haaNkow no, litt. « si c'est un buveur de jitti ») et que sa mèrelui donne sans mesure (si nda dedendi), il boira jusqu'àdeux ans.
Certains boivent jusqu'à deux ans, d'autres jusqu'à unan...
Si la mère n'oublie pas (dirney), elle lui donne le matin(susubaJ après l'avoir lavé, dans la journée (zaaro) et à latombée de la nuit (ciino almaro). CF, Yan)
Les jitti sont divers. Suivant l'âge ou la croissance del'enfant, la composition des recettes varie, auxquelles onattribue des vertus différentes25 mais qui consistent toutes àagir sur le ventre de l'enfant: évacuer les « saletés de l'accouchement ", «disperser le lait maternel» pendant la périoded'allaitement, « remplacer le lait maternel » juste après lesevrage...
Lorsque l'enfant boit le jitti, les saletés de l'accouchement (haayaNo ziiboJ qui sont dans le ventre vont sortiravec la diarrhée (sattu), jusqu'à ce qu'il n'yen ai plus.C'est le marga-marga26 qui permet de tout faire sortir(kaa tareyJ. Ensuite on lui donne une plante qui va« attraper» (di) le ventre, on lui donne du namaro. (AG)
Les jitti que l'on donne aux enfants sont différents deceux que l'on donne aux adultes.
25 Les plantes les plus couramment citées sont: habu gossypium herbaceum, « cotonmer ,,1. bani acacia nilotica adansoni ou tomentosa 1,namaan bauhmia rufescens], diney sclerocarya birreaJ, doro chrozophora brocchianal, nune base waltheria indlca], hoboko tacazzea apiculata 1, saabara gUiera senegalensisJ ..
26 Nom d'un Jlttl fait du mélange de plusieurs plantes (margu : « rassembler ", «mettre ensemble "l.
444 Les maladies de passage
Pour les petits enfants (zanka keyna) on y met duhabu, cela va disperser (sey) le lait maternel (nyayon waa)qu'ils ont dans le ventre. Si le lait ne se disperse pas, celava lui donner des maladies. (MS)
De la naissance au sevrage (kosu) on leur donne desjitti. Lorsqu'on les a sevré, on leur en donne pendant unesemaine ou deux pour remplacer le lait qui n'entre plusdans le ventre (kan ga nan waa ma si hura gundo ra) ...Lorsqu'on les a sevré, c'est la racine du saabara qu'on leurfait bouillir. (FB)
C'est donc en fonction de ces différents rôles qu'ils sontcensés avoir « sur" le ventre de l'enfant que l'on accorde auxjitti en milieu local leurs qualités fortifiantes/préventives27 .
En maintenant le ventre propre, c'est à dire en évacuant lesdéchets par la diarrhée ou en garantissant son fonctionnement normal (jitti remplaçant le lait maternel ou qui « attrape " le ventre), ces tisanes permettent d'éviter le développement de troubles internes qui affaiblirait l'enfant et le rendrait vulnérable28 . De même, administrées à la femmeenceinte, ces tisanes ont également pour rôle cette « hygièneinterne" : « faire sortir le weyno » et « laver le foetus ".
On va cueillir le saabara et on vient faire boire l'enfantpour que le lait qu'il a tété et qui est dans son ventreparte avec la diarrhée (sooru). Le ventre va devenirpropre (henen tass !) et toute la maladie va sortir. Plusaucune maladie ne va l'attraper facilement (waasu ga di).(U)
Le ganda damsi [tephrosia lupinifolia}, on dit que lorsqu'une femme est enceinte (nda weybora go nda gunde),on lui fait bouillir (waasendi), elle boit, ça va faire sortirle weyno, cela lave (nyume) l'enfant qui est dans le ventre.(HD)
27 Jaffré (1996 : 57) rapporte par mileurs les vertus protectrices symboliques que l'on assignait autrefois à certains jitti spécifiques. Ces stloJlttl (" JittI identitaire ,,) lui garantissait une protection face aux risquespropres à son appartenance statutaire (ex. dangers du fleuve pourpêcheurs... ).
28 Elles ont à ce niveau le même rôle que les lavements eux-mêmes fréquemment administrés aux enfants en bas-âge.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhav-zarma 445
On considère par conséquent communément qu'enadministrant quotidiennement le jitti à l'enfant, celui-ciacquiert un corps robuste, vigoureux, il agit sur son sang, illui « fait de la moelle» lui garantissant ainsi une bonnecroissance...
Nos sangs [entre blancs et noirs] ne sont pas lesmêmes (ir nda ngey kurey man ti a (o). Le corps du noir(bor-bi gahamo) est plus fort (gaabu) que celui du blanc(annasaara wone), parce que nous autres, dès la naissance nous buvons des jitti, aucune maladie ne peut nousvaincre (hin). (U)
Lejitti « fait de la moelle » (ga te londiJ à l'enfant, il luidonne de la force (te gaabi) . (MSa)
Cela va lui être bénéfique (na{a) , il va grossir (huro).(AG)
Le jitti favorise la poussée des premières dents (subey(attayaNo) (Coll. f yan).
(Avec le jitti) l'enfant deviendra fort, son ventre ne luifera pas mal, il sera fort ... (FE)
et parant par conséquent aux divers troubles auquel ilpeut être sujet et aux différentes maladies qu'il est susceptible de contracter.
C'est pour les nombreuses petites maladies (dooribuney). (U)
C'est pour le prémunir l'enfant contre les petites maladies (dooro-dooro ma si baa zankey gaa) et pour qu'il nefasse pas le gunda-gani (( ventre frais»?). Tous lesenfants qui ne boivent pas dejitti, le mal au ventre ne lesquitte pas (si moora) ... (H)
C'est pour que le ventre de l'enfant ne soit pas ballonné(ma si« bozon-bozon ») qu'on lui fait boire desjitti. (RI)
La personne doit être forte (te gaabi), elle doit être préservée (wa nda) du weyno. (PPMI Yan)
Bien sûr, on évoquera weyno mais également plus précisément les troubles tels que gunda kuubi «< ventre » /
« tordre » ; colique), biiri {ara «( os » / « fendre » ; douleursarticulaires ou des os), boN-sari (( tête» / « saut» ; maux detête), hanga-goro (( oreille » / « piquer » ; oreillons ou otite).
446 Les maladies de passage
Tout se passe donc comme si la santé de l'individu sejouait au cours des premières années de sa vie durant lesquelles la prise de jitti permet de donner un futur corpsvigoureux et robuste.
Mais si l'administration de telles médications est principalement préconisée lors de la croissance de l'enfant, lesadultes y ont également souvent recours. Ils le font de façonplus ponctuelle, en fonction des risques auxquels on se sentsoumis, utilisant pour cela des médications visant auxmêmes effets, et notamment épurer le ventre des déchets etdes saletés qui peuvent l'encombrer, afin de limiter le développement de la maladie, d'en contenir le principe morbide.
Autre exemple fréquent, à l'approche de la moisson(heemar) , saison propice à la maladie heemar-ize (litt. « fruitde la moisson»), généralement assimilée au paludisme, certains auront recours à des décoctions afin de ne pas y succomber.
A l'instant, je viens de boire [un remède]. C'est pour nepas attraper (ma si di) heemar que je l'ai bu. Le heemarize n'aura pas de force (si nda gaabi) si la personne boitça. Parce que c'est lorsque la personne a le ventre sale(bora gunda ga ziibi) que le heemar-ize l'attrape, tutrembles Uijiri kaw-kaw}, tu as froid, tu cries « couvrezmoi! » Donc si le ventre n'est pas sale, ça n'arrive pas (halgunda si ziibi a si te yaa din). (LI)
Mais c'est le plus souvent en fonction de l'idée quel'individu a de sa propre santé que les recours à ces recettespréventives sont enclenchés.
Ainsi, les individus s'estimant sujets au weyno apparaissent comme les consommateurs les plus assidus de telsbreuvages. Selon eux, l'emploi régulier de ces médicationspermet de parer au déclenchement toujours possible duweyno et aux troubles et maladies que celui-ci peut développer. Dès l'apparition de ce qu'ils considèrent comme lessignes annonciateurs d'un futur « épanchement» de leurweyno (perte d'appétit, fatigue, somnolence, maux de tête,dérèglement de la fréquence quotidienne de la défécation oude la miction... ), ou plus préalablement, dès l'approche deconditions dont on sait qu'elles sont favorables au « réveil»
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 447
de leur weyno (long moment à passer assis ou en plein soleilou encore rupture dans l'habitude alimentaire... ), les recoursà ces décoctions sont alors entrepris dans le but de fortifier lecorps.
J'en prends tout le temps [des remèdes locaux], mêmelorsque je vais bien j'en prends (baa ay go nda baani ay gahaaN) , en tout cas le remède contre le weyno mêmelorsque je vais bien j'en prends. Comme je connais beaucoup de gens qui en vendent, dès que je les vois je leur enachète pour en prendre assez régulièrement. Tu sais, leweyno un seul thé peut le provoquer si tu ne manges passuffisamment (nda ni si Nwaa ga maa kaani), parce qu'ily a des moments dans la semaine où tu n'arrives pas àmanger comme il faut, cela peut alors te le provoquer.Donc, lorsqu'il se déclare (tun) dans mon ventre (ay gundagaa) je le sais : quand je vais faire mes besoins (koy saajora) si c'est dans mes urines (hari-mun), je ne le néglige(murey) pas.
C'est pour ne pas qu'il me surprenne que j'en bois,parce que je sais que s'il terrasse (zeeri) quelqu'un, il lefait souffrir (taabendi). (ST)
La plupart des chauffeurs de taxis, chaque matin lorsqu'ils se lèvent, se rendent chez ceux qui vendent lesweyno safari, ils vont acheter pour boire [. .. ]. Tu sais lefait de rester toujours assis (goro) provoque principalement weyno, ça va te mettre de l'air dans le ventre (a mahew dan ni gundo ra) [... ] Ces remèdes traditionnels(kwaara tuurey) , c'est pour que la maladie ne t'attrape(dooro ma si boro di) pas qu'on les boit. On ne le prendpas seulement pour avoir de la force (gaabi) : dès que tuas le weyno, tu n'as plus de forces. Tu le bois pourqu'aucune maladie ne t'attrape. Dès que tu es en bonnesanté tu as la force. Dès que tu bois les remèdes locaux, tusens aussitôt leurs effets en toi, tu te sens fort. (Has)
Ainsi à Niamey, de nombreux vendeurs de décoctions(weyno safari) bénéficient d'une clientèle régulière (ex. lesvendeuses ambulantes béninoises appelées localement kotikoli). L'un d'eux notamment, installé aux abords du GrandMarché (quartier Balafon), jouissait, lors de nos enquêtes,
448 Les maladies de passage
d'une forte popularité. De nombreux clients chaque matinvenaient prendre leur gobelet.
J'ai l'habitude de me rendre chez lui, tout le monde leconnaît. Son médicament est très bon parce que tous lesmatins lorsque je me lève, je me rends chez lui pour boireson médicament. Son médicament, si tu n'as pas de saletés dans le ventre (nda ziibi si ni gunda ra), tu urines(hari-mun, litt. « verser l'eau») seulement, il ne te donnepas de diarrhée (a si ni kar) ...
Son remède, c'est juste un remède contre le weyno(weyno safari) L.. ] C'est pour éviter que le weyno « t'attrape » (weyno ma si bora di). Tu sais si quelqu'un n'a pas leweyno, elle a toujours de la force (go nda gaabi) et du courage pour travailler, mais si tu as le weyno, tout ton corpsne cesse d'être douloureux (dooru) , c'est pour l'éviter...(SY)
Ces discours révèlent la dimension essentiellementsymptomatique accordée aux recettes médicinales employéesà titre préventif.
Le weyno n'est pas différent d'un individu à un autre(si nda boro-boro). Simplement il ne faut pas qu'il s'accumule dans la personne (ma si baa bora ra). La seule distinction selon les personnes réside dans le fait qu'il y en acertaines qui, lorsqu'elles n'en ont pas beaucoup, ne sesoignent pas ; d'autres même si elles n'en ont pas, vontboire des remèdes. Celui qui boit chaque jour ces remèdes,si le weyno l'attrape, il se porte aussi bien que celui quin'a pas de weyno. (SY)
De tels discours sont intéressants dans la mesure oùils révèlent qu'à l'instar d'autres maladies, on ne peut en finde compte éviter le weyno (principe morbide congénital). Parconséquent la prévention en ce milieu n'a pas pour but depermettre d'échapper à la maladie, conçue semble-t-il commeinéluctable, mais de donner au corps la force de la surmonter, afin de ne pas trop en souffrir:
Quelqu'un qui boit tout le temps des tisanes jitti,même si le weyno le terrasse (zeeri) , son état ne sera pascomparable à quelqu'un qui n'en boit jamais (a si ta borakan si a haaN waati hulu). (PPMI Yan)
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 449
Prévention populaire et pharmacopée biomédicale
La pharmacopée locale ne se limite pas à ces recettes.Elle englobe aussi des produits biomédicaux. Ces « médicaments du blanc » (annasaara safari)29 bénéficient quant àleur efficacité de représentations très ambivalentes : si d'uncôté on les considère très souvent comme de simples calmants, ne soignant pas véritablement la maladie, ils connaissent d'un autre côté une énorme popularité, difficilementcontestable à voir leur profusion sur le marché parallèle.
Plusieurs explications peuvent justifier cette ambivalence, mais elle renvoie largement à la double logique à partir de laquelle la maladie est pensée suivant qu'on la considère d'un point de vue étiologique (saletés du ventre/weyno) ouplus symptomatique (à partir de « l'état du sang »).
En effet, si l'on considère les conceptions populairesdominantes relatives à l'action thérapeutique des remèdeslocaux, leur effet purgatif apparaît, nous l'avons dit, commeun des principaux critères d'efficacité: le remède doit chasser la maladie hors du corps. Or, les produits généralementprescrits au sein des dispensaires n'induisent pas cette évacuation visible de la maladie3o. D'où les doutes légitimes
29 Parmi les annasaara safari ou encore les loktoro kwaara safari mu.« remède de chez le docteur/infirmier, du dispensaire"), on distingue globalement les kinL (du français « quinine ,,) regroupant de façon généralecomprimés, pastilles ou gélules... des pikir (du français « piqûre") ou sana(<< aiguille "J, désignant tout acte thérapeutique effectué à l'aide d'uneseringue (injections curatives, vaccins, sérums, prélèvement sanguin... ).
30 Quelques rares informateurs lièrent toutefois l'efficacité de certains produitsà leurs effets sudorifiques: « J'avais de la fièvre. On m'a emmené au dispensaire. Là on m'a donné des comprimés et on m'a dit de les boire. C'était del'aspirine et du ganidan. La fièvre s'est calmée. Lorsque je les ai bu, dès queje me suis couché j'ai commencé à transpirer" (FBi);« J'emploie les comprimés lorsque J'ai une fièvre qui persiste ; cela fait comme avec les fumigations et cela sort de mon corps" (MC). Il est intéressant de noter que ce liende cause à effet n'est pas propre aux représentations africaines de l'efficacité des médicaments dIts « modernes ". Laplantine rapporte les propos d'unmédecin: « L'idée de beaucoup de malades, mais il n'est pas sÛT qu'un certain nombre d'entre nous ne la partageons pas aussi, c'est qu'il y a quelquechose de mal dans le corps et qui doit sortir. D'où peut être cette réticenced'une partie de ceux qui viennent nous consulter aux médicaments qui fontentrer dans le corps quelque chose en plus et qui n'en font rien sortir, et àl'inverse la préférence qu'ils manifestent pour des médicaments commel'aspirine qui, elle, fait transpirer" <Laplantine, 1986 : 202).
450 Les maladies de passage
quant à leur réelle efficacité face à l'ensemble des troublesinternes.
La maladie, si elle se trouve dans le ventre d'une personne (hala a go boro gunda ra), mieux vaut qu'elle sorteplutôt qu'elle n'y reste (a ma (aUa bisa a ma goro). On nedoit pas la calmer (i si a kanendi), la piqûre endort lamaladie (pikir no ga kanendi). (LI)
Le blanc, il fait des piqûres (a ga te pikir), ils donnentdes comprimés (a ga no kiniJ que l'on doit boire régulièrement (boro ma haaN i (0 nda i (0 yan). Les nôtres ce n'estpas ça. Dès que tu as bu tu sens l'effet (za ni haaN no niga maa hari kan te). Ceux du blanc, ils calment (a gakanendi no) ; à peine as-tu mangé quelque chose (nda nina hari Nwaa), que la maladie se réveille (tun : « se lever ,,).Les nôtres, au contraire, enlèvent tout (ga hari kul kaa),tu vas retrouver la santé (ni ma du baani). (CM)
Tu sais la piqûre (pikir) quelques fois ça calme, maisdeux jours après ça revient (a ga yee ga kaa). Le « palu»tant que tu ne vomis (yeeri) pas, ça ne sert à rien (yaamano), ça va revenir.
Il y a un médicament de chez nous (boro-bi safari :« médicament des noirs») qui, dès que tu l'as bu, te faisvomir à plusieurs reprises. Il va enlever également toutesles saletés (ziibi kul a ga kaa) en te donnant de la diarrhée (hal a ga ni kar). Après plusieurs diarrhées, tu esfatigué ((arga), mais après que tu te sois lavé (nyumey) ,c'est terminé (kul a ban no yaa). Ainsi tu vois (ni go ga di)la saleté (ziibo) et le weyno qui sont à l'intérieur de tonventre (kan go ni gunda ra) sortir ((aUa) en même temps.Le Quinimax (kinimax) par contre, si tu le prendsaujourd'hui et demain, cela va parfois te calmer, maisdeux jours après cela va revenir (a ga yee ka tun). ŒY)
On pourra certes voir dans ce type de discours, unevolonté de valoriser et de défendre l'efficacité de la médecinelocale, et c'est probablement le message que veulent fairepasser les deux premiers informateurs cités, tous deux guérisseurs.
On trouvera toutefois d'autres arguments justifiant lesdiscours communs « discriminant " l'efficacité des médica-
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 451
ments biomédicaux. Ces produits, le plus souvent délivrés ouprescrits dans les formations sanitaires (aspirine,Chloroquine, métronidazole, Solution de RéhydratationOrale), nécessitent pratiquement tous le respect d'une posologie et d'une durée de traitement pour qu'ils aient une réelleefficacité. Or, fréquemment, la disparition des signes visiblesou ressentis étant assimilée en milieu local à la guérison,l'interruption du traitement est souvent prématurée, induisant alors une rapide réapparition du trouble. Dans cesconditions, l'action éphémère accordée à ces produits est réelle et contribue donc à qualifier les « médicaments du blanc »
de simples calmants.
Mais si ces remèdes souffrent de peu de reconnaissance quant à l'efficacité qu'ils peuvent présenter pour les maladies internes dans la mesure où les signes visibles de leurexpulsion sont rares, on leur reconnaît d'autres mérites dontun fort pouvoir d'action pour traiter les maux, la douleur.D'une certaine manière on peut dire que si l'on attribue àl'action des médicaments modernes des effets simplementcalmants, on accorde à cette qualité « soulageante ", apaisante en même temps qu'éphémère, une puissance incontestable;et il semble que ce soit essentiellement sur la base de ceteffet que se fonde leur utilisation à des fins préventives.
La présentation du traitement apparaît notamment31
comme déterminante dans l'élaboration de telles représentations32 : en effet, la forme du remède ainsi que son moded'administration influent sur la façon dont on conçoit sonaction à l'intérieur du corps.
Ainsi, à l'inverse de la médecine locale reposant souvent sur l'ingestion de quantités importantes de remèdes(gavage, purge... ), la médecine se caractérise par l'emploi deremèdes en quantité généralement infime, elle repose surl'administration de médicaments aux dimensions extrême-
31 Cette puissance assignée aux « médicaments du blanc» reposera biensûr sur d'autres critères tels que par exemple leur origine étrangère,critère d'une efficacité a priori jouant d'ailleurs tant au mveau desrecettes magico- ou phyto-thérapeutiques (importées de pays voiSInS)que des prodUIts bIOmédIcaux (importés d'occident) (Cf. Whyte 1988 .225-229).
32 C'est aussi ce que souligne Jaffré au Mali (1999).
452 Les maladies de passage
ment réduites (comprimés, gélules, ampoules, doses injectables).
De fait, la place fondamentale assignée au ventre dansla thérapeutique locale est très rarement évoquée à l'égarddes traitements biomédicaux. C'est le sang directement queles produits de la pharmacopée biomédicale sont censés « travailler ».
Le comprimé (kiniyo) , il transforme mon sang (kurobere). (AG)
Moi, au dispensaire, c'est l'injection (pika) que je veux,elle fait mieux travailler mon sang (ay kuro goyendi) queles comprimés (kini). Ceux-ci travaillent (goy), mais selonmoi, ils n'égalent pas la piqûre. (AH)
A partir de cette conception générale de l'action desproduits biomédicaux, les injections sont en effet penséescomme particulièrement efficaces, le remède pénétrant et circulant directement dans le sang33 et assurant ainsi une plusgrande action fortifiante.
La piqûre ne soigne pas seulement la maladie pourlaquelle elle t'est administrée, elle soigne toutes les maladies. L.. ]. Les comprimés (kiniJ ils vont dans ta tête se disperser (sey) , alors que la piqûre, elle, entre dans le sang(kuro ra aga huro). (U)
L'injection (pika) est bonne (ga boori) , elle donne de laforce (a ga boro no gaabiJ. (AZ)
L'administration de sérums en particulier est considérée comme un moyen efficace de substitution ou de « réactivation » du sang:
Certaines maladies font épuiser le sang (kuro ga ban)des malades, ils leur mettent alors une seringue (i masereng dan 1 gaa), lorsque le sang se « réactive» (tun, « selève»), ils guérissent (du baani). (MK)
------- ----------
33 Sans doute, amsi que le remarquent Bledsoe & Goubaud (1988 : 263) enmilIeu mende (SIerra Leone), Diarra (1993 : 185) à Bamako (Mali) ouDorier (1989 . 276) à Brazzavile (Congo), la douleur associée à sonadministration participe-t-elle à cette idée d'une plus grande efficacitéde l'injection. Sur la question générale de la popularité des injectIOnsdans les pays en développement cf. notamment l'article de synthèse deVibeke Reeler (19901.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 453
Lorsque tu vois qu'il mettent une seringue à la personne (i ga serengo dan bora gaa), c'est qu'elle n'a plus desang (bora kuro ga ban). (RI)
Au dispensaire, si tu n'as plus de sang (nda kuri ban nise), ils t'injectent des sérums (i ga serom dan ni se)... (Has)
Une telle conception de l'action se retrouve généralement à propos des produits de couleur rouge. Ainsi lesgélules de Falbitone® disponibles sur le marché illicite sontcommunément appelées kuri cenji (<< changer le sang»)34.
Certains revendeurs possèdent des médicaments, les« kuri cenji » (kuri cenji yan), dont nous n'avons pas laconnaissance (ir wey si waani a). (KI)
Ça, c'est de la vitamine (vitamin) , certains l'appellent« kuri cenji ». (Colp. Saw. 1)
Ça, c'est palviton [Falbitone®] vitamine C, c'est pourchanger le sang, il contient d'autres vitamines regarde,vitamine B, B12, B5...
Pour nous, c'est de la vitamine, mais même pour unepersonne malade (boro jonte), si elle en prend chaquematin en se levant, au bout d'une semaine, tout le sang deson corps sera changé (kul gahamo kuri ga cenji). (V.T.)
Le vocabulaire local relatif à l'action de ces produitssur le sang est donc varié : le médicament entre (furo) dansle sang, le fait « travailler » (goyendi) ou « l'active » (tun), le« transforme » (bere) , autant de métaphores suggérant sonaction fortifiante. L'importance accordée à cette seule actionfut par ailleurs suggérée indirectement, mais d'autantmieux, à travers certains discours recueillis au sujet de lapénurie touchant le dépôt pharmaceutique d'un villageenquêté.
34 Cette mise en correspondance de la couleur rouge du médIcament et del'actIOn qu'il est censé avoir sur le sang est un trait commun à de nombreuses sociétés AinsI, Bledsoe & Goubaud (988) rapportent qu'enSierra Leone: " ...western medicines that are red in color are widelyused to build or punfy the blood. Hence, ail the red medicines (... ) weresaid to be SUItable for blood. These included iron tablets, diuretics, piletablets to relieve constipation, and folic acid to promote healthy pregnancies. C.. L Blood tonics manufactured abroad that are red or brownin color - undoubtedly, intentional!y - are extremely popular. " (op.cit. :
454 Les maladies de passage
A l'époque de sa création, tu voyais de tout à l'intérieur, même les femmes y allaient pour acheter desampoules (ampulo) pour grossir (naasu). Aujourd'hui,tout est « gâté ». (SB)
Au début il y avait de quoi panser les plaies (bii halle),des comprimés qui faisaient grossir (wargendi), despoudres (hamni) qui empêchaient les moustiques depiquer (han sobora si bora naama), tout cela, si la personne part aujourd'hui les chercher, elle ne les obtiendra pas.(MK)
A entendre de tels témoignages, on est en effet tentéde se demander dans quelle mesure, aux yeux de cesfemmes, la pénurie a plus affecté les pratiques locales courantes de médication à des fins esthétiques (consommationd'ampoules ou de comprimés « qui font grossir »)35, que lespratiques de médication purement thérapeutiques.
C'est principalement en fonction de cette action fortifiante que les produits de la pharmacopée biomédicale sontemployés en milieu local à titre préventif ou plus exactementafin de préserver sa santé, de maintenir sa forme. En effet,on y recourra fréquemment, préalablement à certaines activités physiques prévenant ainsi l'affaiblissement du corps etdu coup sa fragilisation, ou dès l'apparition de troubles(maux de tête, fièvre, fatigue.. .) qui, s'ils sont a priori bénins,sont perçus, nous l'avons vu, comme des signes préliminairesà de nombreuses maladies.
Le marché parallèle des médicaments est à ce niveauun lieu d'observation privilégié : son développement important un peu partout en Afrique depuis maintenant plusieursannées36 a contribué à libérer une consommation médica-
35 L'embonpoint est en effet souvent donné comme un critère de beautépour les femmes. Une coutume locale. le haanendi (litt. « faire boire ".gavage), donne d'ailleurs lieu à une sorte de concours aboutissant à une« fête de la graIsse" (maalll hoore) où sont désignées les femmes vainqueurs Icf Olivier de Sardan, 1982 : 1881. Les médicaments modernesoffrent ainsi de nouveaux moyens pour acquérir de l'embonpoint, qu'ils'agisse de produits stImulant l'appétIt comme Périactme® ou de produits corticOldes tels que Dexamercortin® communément appelé iafusi(defuusi: grossirl.
36 cf. notamment Geest (19821, Fassin (1985), Amadou (1994).
Médicaments et prévention en milieu populaire songhaY-ZQrma 455
menteuse auparavant beaucoup plus faible (mais aussi beaucoup plus sûre), favorisant du même coup un accroissementimportant de l'utilisation de ces produits à titre préventif.
En effet, alors qu'auparavant les conditions mêmed'accessibilité aux produits biomédicaux les limitaient à unrôle essentiellement curatif (pendant longtemps, seul lerecours à la formation sanitaire ouvrait l'accès au médicament), avec leur large diffusion dans les rues des villes et surles marchés (ruraux et urbains), les vertus préventivesdiverses qu'ils pouvaient renfermer ont rapidement été« décelées » par les populations. Les discours promotionnelsdes revendeurs, notamment, y ont aussi largement contribuéen présentant un grand nombre de produits comme des vitamines (vitamin), sachant l'engouement local dont ce type deproduits est l'objet.
« 5 minutes » est un nom que les vendeurs ont donnéau produit [un antalgique]. On dit que c'est pour donnerde la force. L..]. (Colp. Saw 2)
« Ça (gélules rouges), c'est de la vitamine, certainsl'appellent kuri cenji. (Montre un autre remède) : lui aussiest de la vitamine, c'est peractin (Périactine®), c'est seulement de la vitamine.
Et « 5 minutes » ?
Je n'en ai plus, mais c'est simplement une vitamine.
C'est pareil que peractin ?
Ils sont différents (waani-waani), parce que « 5 minutes »a un effet plus rapide (a ga waasu), mais peractin, lui soneffet dure (a ga gey) plus longtemps dans le corps.« 5 minutes» ne dure pas longtemps ». (Colp. Saw 1)
« Peractin, ça c'est de la vitamine. Par exemple quelqu'un qui n'a plus d'appétit (si maa nwaari kaanu) peut leprendre. De même si on le donne à quelqu'un qui travaillela nuit (hanna ka goy), cela lui permettra de bien dormir(kul agagirbi) [1ejour] ». (VT)
En fait, sont couramment désignés comme vitamin,par les revendeurs comme par les consommateurs, non seulement les produits vitaminés mais la plupart des médicaments présentant des effets analgésiques, antalgiques ou
456 Les maladies de passage
antipyrétiques37 , anti-inflammatoires, ainsi que, comme indiqué précédemment, permettant d'augmenter l'appétit oud'acquérir de l'embonpoint. Certains de ces produits bénéficient d'ailleurs d'appellations locales très explicites.
type de produits appellatIOn locale DrodUlt~ désillnés
antalgiques / "5 mmutes" APC+®. Bodrex®.antipyrétiques lahlva vites ("santé vItesse") Sudrex®. Dai!a®...antl-mtlammatOlre, dotlijo ma bal ~ll ("le Vieux dOit PhenylbutaLone®.
frapper dans la balle") Butazolidine®
dotllJo ma yaabi ("le VIeux doit lndocap®marcher, Ite") Indometacm®laabu nyarfa nda gaabi ("gratter laterre avec force")
sl1mulant d'apDél1t "une ~emame..3M Pénactme®
cortlcaldes lafusi (lu ,i = "grossIr") Dexamercartm®
kI/ri cen/l ("changer le sang") Falbitone®
Ces produits, avec par ailleurs les antibiotiques dontles multiples vertus sont couramment vantées (cf. lestupay)39, constituent véritablement le fer de lance de la venteinformelle. Ainsi, côté consommateurs, la quête de fortifiants, de « vitamines », apparaît fréquemment comme l'objetprincipal du recours aux médicaments du marché informel.
37 Ces types de produits, avec également les antIbiotiques, sont de loin lesplus nombreux sur les étals des revendeurs.
38 Interrogé sur la raison d'un tel nom, un revendeur s'exphque : " C'estune vitamine. Elle est très puissante (a go nda gaabi) parce que lorsquela personne en boit, en une semaine (habu foi son corps va bien grossIr(boro gahamo Ra tar ka furo gumo). Cela fait grossir (wargendi) la personne" (Colp. Saw. 2).
39 Tupay est le nom donné aux gélules bicolores (rouge et jaune) de tétracycline dont les emplOis sont extrêmement divers: douleurs abdominales, dIarrhée, constipation, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires. lièvre, dermatoses, maladies sexuelles, douleurdes yeux, hémorrOides, plaies... Toutefois, ce terme tend aujourd'hui àdésigner de façon générale l'ensemble des gélules (antibiotiques pour laplupart) étant donné leur dIversité sur le marché informel.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 457
J'achète ces médicaments pour les mettre de côté.Lorsque ma tête me fait mal ou que mon corps est douloureux, je les bois. (RY)
Madam nda muse40 c'est contre les maux de tête, lafatigue. [. .. ]. Il Y a Daga également contre les maux detête, c'est à dire la force aussi. [. .. ]. Parasetamol, ça sert àdonner de la force, à ne pas avoir sommeil, j'en prend souvent. (US)
J'en prend pour la fatigue. Je sais que c'est le weynoqui provoque ça des fois, mais je les prend pour la fatigue,pour le rhume aussi. (BH)
Si tu as des maux de tête, si tu as pris un Daga, tupeux même courir, tu te sens très bien, en forme comme sic'était une drogue. (ST)
On en prend pour le travail (goyo se). Pour certaineskini, on dit que si la personne les prend, elles vont luidonner la force (a ga gaabi dan ni gaa), ou elles pourrontsoigner le weyno ; parce que tu sais, quelqu'un qui travaille toujours assis, le weyno est sa principale maladie.[. .. ]. Les médicaments modernes qu'on nous dit de prendrepour avoir de la force, je ne connais pas leurs noms [demarque], parce que lorsqu'on y va, on dit seulement qu'ilnous donnent quelque chose qui va nous permettre demanger pour avoir la force et on nous les donne. [. .. ]. Si onvoit ceux qui portent les kini, on va à leur rencontre, onleur demande celui qui donne la force (ga boro no gaabi).Ils le prennent et nous le donnent. [' .. J.
Daga, Aspro, « 2 couleurs »41, ceux qui « travaillent»un peu la personne, c'est seulement ceux-là que je prend.[' .. J. Je ne les bois pas tout le temps, seulement de tempsen temps quand je suis fatigué (farga), si tu ne les prends(sambu) pas, tu ne peux rien faire. (Has)
40 C'est à dire « madame et monsieur ". Il s'agit d'un produit antalgique(procold®) dont l'emballage est illustré, de part et d'autre, d'un hommeet d'une femme se tenant la tête entre les mains.
41 Il s'agit là encore d'un antalgique ŒudreX®) sous forme de comprimésbicolores.
458 Les maladies de passage
La consommation de ces produits repose donc souventsur la même logique de prévention que celle évoquée plushaut à l'égard des décoctions médicinales locales. Elle permet de renforcer le corps, de « travailler la personne », et dela rendre par conséquent moins vulnérable à la maladie. Làencore, la consommation préventive de remèdes reposeessentiellement sur la volonté de maintenir un bien-êtregénéral, se distinguant ainsi d'une conception faisant desmédications préventives, des traitement à l'action immunisante, neutralisante qui permettent d'éviter l'apparition detel ou tel trouble spécifique.
Cette dernière conception existe cependant localementmême si elle reste toutefois, et dans une large mesure, marginale.
Celui-ci c'est Daga. On le donne à boire par exemplelorsqu'une femme enceinte (weyboro kan go nda gunde)travaille près du foyer (kan ga goy ganji gandeJ. Ainsilorsqu'elle l'a bu, la chaleur du feu (konno) n'atteint pasl'intérieur du ventre ou se trouve l'enfant (si to izo do kango gunde ra) et cela ne le blesse pas (a mana a maarey) ».
(SM)
Si une femme avec laquelle tu veux avoir des rapportssexuels a une maladie, tu peux prendre deux tupay avantde commencer l'acte. Ainsi pendant l'acte, la maladie qu'ala femme ne t'attrape pas (dooro kan go weyboro gaa, a sini di). (Sa)
Bledsoe & Goubaud (1988 : 270) rapportent cettemême conception générale de la prévention en milieu mende,comme le désir de maintenir sa santé, et le potentiel important que l'on accorde à ce niveau «< health maintenancepotentials ») aux médicaments occidentaux. Ils signalentnotamment le succès populaire des gélules bicolores, généralement des antibiotiques42 , comme remèdes préventifs: « Asecondary school graduate reported he took a "red and black"capsule, which he knew to be the antibiotic Ampicillin, aftera hard day of work on the farm, to prevent a sore body the
42 Le succès particulier de ces gélules reposerait sur le fait qu'elles sont dedeux couleurs différentes, indiquant ainsi la présence de différentessortes de remèdes à l'intérieur des capsules.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhav-zarma 459
next day and to wake refreshed for the next day ofwork. C.. ).People with wealth often buy capsules - which usually happen to be antibiotics - and take them once a day, like vitamins ».
Ce sont également des effets que l'on assigne en milieusonghay-zarma aux gélules tupay, dont nous avons signaléles multiples emplois dont elles sont l'objet.
J'achète des tupay quand je sens mon corps fatigué(gahamo buyaNo). (HY)
Avant, il y avait empiss [. ..]43. Il donnait de la force, parexemple pour aller cultiver les champs; même pour laconstruction d'une maison en banco on pouvait finir deuxvoyages [de transport de briques] en une heure ou deux. (US)
Le succès populaire des antibiotiques, ou en tout casdes produits considérés comme tels, en Mrique44 comme dansde nombreuses autres sociétés (Cunnigham 1970, Calva 1996)semble donc reposer à la fois sur les valeurs tant curativesque fortifiantes / préventives qu'ils sont censés renfermer.Ferguson (1988) signale ainsi lors d'une enquête menée dansune ville du Salvador: « Two women reported that they gavea teaspoon of Pantomicina (tetracycline) to their childreneach day to prevent colds. C.. ). In one of the town pharmacies,a pharmaceutical company sales representative stronglyrecommended to the investigator and to the pharmacy personnel that we take one Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) anytime we felt a cold developing» (op. cit. : 28).
43 Nom donné à un tupay, présenté comme particulièrement puissant etaujourd'hui dIsparu du marché. Son nom suggère qu'il s'agissait degélules d'ampicllline. Il importe toutefois de noter que s'il y a une réappropriation des noms de médicaments ou de familles de médicaments surle plan local (vitamin, parasetamol, antibitik, ... ) ceux-ci sont fréquemment attribués aux produits en fonction de leurs effets (assignés ou réellement ressentis) et plus rarement en fonction de leurs constituants (quel'on aura pu lire sur le conditionnement ou la notice). De fait, la gammede produits inclue sous ces diverses appellations s'avère, ainsi que nousl'avons vu à propos des" VItamines ", généralement anarchique.
44 "La croyance en un "médicament pour chaque maladie" qui guérirait instantanément est répandue parmi la population (malades et certains prescripteurs) et l'antibiotique représente souvent ce médicament miracleC.. ). Ils [les malades] attendent du prescripteur qu'il leur donne un médicament, plus particulièrement un antibiotique" (OMS, 1993 : 45).
460
Conclusion
Les maladies de passage
A travers nos propos, une idée est apparue de manièrerécurrente: la frontière entre médications curative et préventive sur le plan local s'avère souvent difficilement perceptible. Bien souvent c'est moins le médicament dans sa composition que les circonstances de son emploi qui l'inscriventdans telle ou telle option thérapeutique. Ainsi, fréquemment,un même médicament peut être consommé comme fortifiantpréalablement à une activité physique pénible, comme préventif face à l'apparition de symptômes conçus commeannonciateurs de troubles pathologiques sérieux et enfincomme curatif dans le cas où un de ces troubles est apparu etperdure.
Cela dit, nous avons vu par ailleurs que la préventionest pensée et mise en œuvre diversement, suivant le typed'interprétation de la maladie que l'on privilégie : dans lamesure où celle-ci est conçue comme une infortune, les actespréventifs engagés consistent en procédures propitiatoires,sollicitant la protection des forces surnaturelles (génies,Dieu). Mais, parallèlement, les souffrances et ressentisqu'induisent la maladie, génèrent d'autres représentationsliées, celles-ci, au corps et à ses dysfonctionnements.
Là, les soins préventifs constituent alors des moyensde « travailler » le corps, de parer, en le fortifiant, au déclenchement ou à l'aggravation des affections ou, plus exactement, des manifestations invalidantes (fatigue, fièvre ... ) oudouloureuses par lesquelles ces affections se caractérisent.C'est en effet sur l'idée d'un renforcement du corps et lavolonté de conserver un certain bien-être que repose l'essentiel des médications préventives employées.
Dans ce domaine, à côté des divers breuvages médicinaux locaux, les médicaments de la pharmacopée biomédicale connaissent aujourd'hui un succès important, dû, en grande partie, au développement de la vente informelle. L'abondance d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires facilementaccessibles ainsi que les discours des revendeurs valorisant(souvent à tort) les vertus soi-disant fortifiantes de nombreux médicaments favorisent actuellement le développement de leur consommation à titre préventif.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhav-zarma 461
Enfin, cette réflexion sur le cas particulier des médications préventives populaires en milieu songhay-zarma, permet de révéler l'influence que peuvent avoir les pratiques demédications en général sur les conceptions locales de lamaladie45 . Si l'on a souvent tendance à déterminer la logiquedes traitements à partir des représentations de la maladie, ilsemble que le traitement influe tout autant sur la manièrede concevoir la maladie.
Bibliographie
AmadouA.1994 Marché parallèle des médicaments au Niger: exemple de
la communauté urbaine de Niamey, Thèse de Phannacie,Dakar, Université Cheikh Diop.
Bisilliat J.1981 « Maladies de village et maladies de brousse en pays son
ghay : essai de description et des classification en vued'une typologie ", Cahiers OR8TOM, série scienceshumaines, 18 (4): 475-486.
Bisilliat J., Laya D.1973 « Représentations et connaissances du corps chez les
Songhay-Zarma : analyse d'une suite d'entretiens avec unguérisseur ", in G. Dieterlen (éd.), La notion de personneen Afrique Noire, Paris, CNRS : 331-358.
Bernard Y., White-Kaba M.1994 Dictionnaire zarma-français (République du Niger), édité
par l'ACCT & Bernard Y.
Bledsoe C.R., Goubaud M.F.1988 « The reinterpretation and distribution of western pharma
ceuticals : an example from the Mende of Sierra Leone ", inGeest and Whyte (eds), The context ofmedicines in develo-
45 Cf. Geest & Whyte (1989) : « The notion of illness as an entity withinthe body is widely found. The ethnographie literature suggests thatpeople in many cultures live by this metaphor, using emetics, purgatives, sweat baths, and cupping horns to remove the sickness from thebody. Our point is that the treatment caUs for the conception as muchas the conception caUs for the treatment" (op. cit. : 356).
462
Calva J.1996
Les maladies de passage
ping countries, Dordrecht : Kluwer Academie Publishers :253-276.
« Antibiotic use in a periurban community in Mexico: ahousehold and drugstore survey ", Social Science andMedicme,42 (8) : 1121-1128.
Cunningham C.E.1970 « Thai « injection doctors ", antibiotic mediators ", Social
Science and Medicine, 4 : 1-24.
Diarra T.1993 « Représentations et itinéraires thérapeutiques dans le
quartier de Bankoni ", in Brunet-Jailly (éd.), Se soigner auMali, une contribution des sciences sociales, Paris,Karthala :177-19.
Dorier E.1989 « Le service public et son double à Brazzaville ", in
Urbanisation et santé dans le tiers monde, transition épidémiologique, changement social et soins de santé primaires,Paris, üRSTüM, « Colloques et Séminaires" : 271-279.
Fassin D.1985 « Du clandestin à l'officieux. Les réseaux de vente illicite
des médicaments au Sénégal", Cahiers d'EtudesAfricaines, 25 (2) : 161-177.
1986 « La bonne mère: pratiques rurales et urbaines de la rougeole chez les femmes Haalpulaaren du Sénégal ", SocialScience and Medicine, 23 : 121-123.
Ferguson A.1988 « Commercial pharmaceutical medicine and medicaliza
tion : a case study from El Salvador ", in Geest and Whyte(eds) : The context of medicines in developing countries,Dordrecht : Kluwer Academie Publishers : 19-46.
Gellion V.1997 Malnutrition infantile et représentations populaires en
Afrique Noire. Représentations de la maladie et pratiquesthérapeutiques en milieu villageois songhay-zarma(Niger), Mémoire de Maîtrise en Sciences et Techniques,Université de Metz.
Médicaments et prévention en milieu populaire songhay-zarma 463
Gillies E.1976 « Causal criteria in african classification of disease ", in
Loudon (éd) : Social anthropology and medicine, LondonNew York-San Francisco, Academic Press : 358-395.
Jaffré Y.1996
1999
« Dissonnances entre les représentations sociales et médicales de la malnutrition dans un service de pédiatrie auNiger ", Sciences Sociales et Santé, 14 (1) : 41-71.« Farmacie cittadine, farmacie « per terra" », Bologne,Africa e mediterraneo, 1,99 : 31-36.
Jaffré Y., Olivier de Sardan J.P. (éds)1999 La construction sociale des maladies (les entités nosolo
giques populaires en Afrique de l'Ouest), Paris, PUF.
Laplantine F.1986 Anthropologie de la maladie, Paris, Payot.
Luxereau A.1989 « Le corps vivant, la santé, les remèdes à Maradi ", in
Salem & Jeannée (éds) : Urbanisation et santé dans lesvilles du tiers monde. Transition épidémiologique, changement social et soins de santé primaires, Paris, Editionsde L'ORSTOM, collection colloques et séminaires : 319331.
Moumouni A.1996, « Humburukumey ", in Bulletin du programme derecherche Concepts et conceptions populaires relatifs à lasanté, à la souffrance et à la maladie (Sahel Ouest-africain), vol. III, ORSTOM-EHESS-CNRS : 73-75.
Nichter M., Vuckovic N.1994 « Agenda for an anthropology of pharmaceutical pratice ",
Social Science and Medicine, 39 (11) : 1509-1525.
Olivier de Sardan J.-P.1982 Concepts et conceptions songhay-zarma, histoire, culture,
société, Paris, Nubia.1994 « La logique de la nomination. Les représentations fluides
et prosaïques de deux maladies au Niger ", SciencesSociales et Santé, 12 (3) : 15-45.
464
O.M.S.1993
Les maladies de passage
Prescription des antibiotiques dans trois pays d'Afrique del'Ouest. Mauritanie, Niger et Sénégal. Programme d'Actionpour les médicaments essentiels, Organisation Mondialepour la Santé.
Peyre de Fabregues B.1979 Lexique des plantes du Niger (noms scientifiques-noms
vernaculaires), Niamey, INRAN.
Pool R.1994 « On the creation and dissolution of ethnomedical systems
in the medical ethnography of Mrica ", Africa, 64 (1) : 120.
Rouch J.1989 La relIgion et la magie songhay, Bruxelles, Ed. de
l'Université de Bruxelles, (le édition 1960, PUF).
Van der Geest S.1982 « The illegal distribution of western medicines in develo
ping countries : pharmacists, drug pedlars, injection doctors and others. A bibliographie exploration ", MedicalAnthropology,4: 197-219.
Van der Geest S., Whyte S.R. (éds)1988 The context of medlcines in developing countries, Studies
ln pharmaceutical anthropology, Dordrecht, KluwerAcademie Publishers.
1989, « The charm of medicines : metaphors and metonyms ",Medical Anthropology Quarterly, 3 (4) : 345-367.
Vibeke Reeler A.1990 « Injections: a fatal attraction? ", Social Science and
Medicine, 31 (l0) : 1119-1125.
Whyte S.R.1988 « The power of medicines in East Mrica ", in Geest and
Whyte (édsJ, The context of medicines in developing countries, Dordrecht, Kluwer Academie Publishers : 217-233.
Chapitre 18
La prévention dans la modernitésanitaire dogon (Mali)
Sidiki Tinta
La société dogon d'aujourd'hui reçoit, par de multiplescanaux d'information, de nombreux messages sanitaires pourprévenir les principales maladies qui affligent le pays. Les villageois et citadins receptionnent de manière diversifiéel'ensemble de ces discours en provenance de« l'éducation pourla santé ». On va ici traiter de la réception de ces messagessanitaires et de leurs reconstructions par la population1.
L'éducation pour la santé, dans les discours de ses promoteurs, est définie comme l'ensemble des stratégies etactions informatives développées dans le cadre de la prévention sanitaire (Bouchayer 1984). Elle se caractérise notamment par une volonté d'efficience car il s'agit, par ce moyen,d'arriver à diminuer à moindre coût, sinon à annuler,l'impact de certaines maladies. Pour cela cette activité mobilise des techniques comme l'information, la communicationde masse, la sensibilisation, etc. Il s'agit de concevoir, sur labase d'un savoir fortement médicalisé, un message dontl'intégration permettrait d'éradiquer les comportements nuisibles et de promouvoir ceux qui seraient favorables à l'épanouissement de la santé de l'individu et de son groupe2.
1 Ce chapitre est extrait de ma thèse portant sur « Les conceptionsautour de la transmission de la maladie et les pratiques préventiveschez les Dogon du Mali» (Tinta, 1999).
2 Pour une critique de ces modèles, voir Jaifré (1990).
466 Les maladies de passage
Certes, pour que ce dispositif fonctionne, il faut que lemessage ait été formulé de façon à faire sens dans l'universdu récepteur. Mais l'objectif n'est pas seulement que le message soit compris. Il faut encore qu'il induise des changements dans les comportements du récepteur, c'est-à-dire qu'ilse traduise en actes chez l'individu ou le groupe cible. Mais lemessage sanitaire, parce qu'il arrive rarement à tenir comptedes réalités sociales dans toute leur complexité, n'aboutit pastoujours à ses objectifs. Pour le dire simplement, l'individucomme le groupe social auxquels le message est destiné sontdes acteurs ayant leurs propres logiques et des besoins àsatisfaire.
En effet, ces acteurs, que l'on considère comme des« récepteurs de messages sanitaires ", n'en reçoivent paspassivement le sens. Ils le reconstruisent « en fonction decontextes, de contraintes et de stratégies multiples. L'acteursocial de base, aussi démuni ou dominé soit-il, n'est jamaisun récipiendaire qui n'aurait le choix qu'entre la soumissionou la révolte» (Olivier de Sardan 1990). Deux situations sontfréquentes. Soit le message sanitaire est construit autour descatégories biomédicales avec le risque de ne pouvoir révélerson contenu réel au récepteur, soit il est construit selon lesreprésentations locales et reste alors « prisonnier » desmobiles et des catégories sociales du récepteur.
Ces variations expliquent que certains messagesconnaissent plus de succès que d'autres, ou qu'un même message suscite des réactions différentes selon les individus etles groupes d'une même société. Ce sont ces situations complexes que je tenterai d'illustrer à travers quelques expériences de terrain.
Situation 1
Il arrive que le message ait été bien formulé et comprisdes populations. Mais du fait qu'il interfère avec d'autresinformations et savoirs préalablement acquis, il est reléguéau rang de savoir alternatif en attente ... Ce n'est que lorsquece qui est habituel échoue qu'on active ce nouveau savoir.Mais il se peut aussi que le message sanitaire ne soit perçu
La prévention dans la modernité sanitaire dogon 467
que comme étant complémentaire des acquis premiers. Danstous ces cas, le message finira par être intégré dans lesreprésentations des populations cibles, et cela aboutira généralement à des pratiques syncrétiques. Nous illustreronscette première situation par l'exemple d'une épidémie de rougeole dans un village du plateau de Bandiagara.
Le Mali a fait des Soins de Santé Primaires (SSP) undes axes de sa politique nationale à partir de 1979 (Berche1994). Dans ce cadre, un certain nombre de villages ont étéinvités à envoyer à Bandiagara des représentants, pour y êtreformés comme agents de santé villageois (ASV). Le village deS. a bénéficié de la formation d'un hygiéniste-secouriste etd'une accoucheuse traditionnelle recyclée (ATR) dès 1979.Ceux-ci devaient servir de relais villageois pour l'éducationsanitaire et les méthodes de prévention. Par exemple, ilsdevaient expliquer l'intérêt de la vaccination contre les maladies infectieuses. C'est dans ce contexte qu'à la fin de leur formation, ces ASV ont réuni les villageois pour leur faire partde ce qu'ils avaient appris ... mais sans succès, comme leconstate, en 1992, l'hygiéniste-secouriste lui-même:
Lorsque les autorités sanitaires de Bandiagara demandèrent deux personnes à former, le village nous a désignées. On nous a appris comment on fait les premierssoins, les pansements, les prises de comprimés dont l'aspirine et la nivaquine et comment être propre, et à quoi celasert. On nous a appris beaucoup de méthodes pour prévenir certaines maladies comme la rougeole. À notre retour,nous avons dit tout cela aux gens du village. Mais onaurait dit à l'époque que cela n'intéressait personne. Ilsont dit tout simplement qu'ils ont entendu et que c'est bienpour le village. Mais personne n'a fait quelque chose dansce sens, personne non plus n'est venu nous consulter.
Cette attitude peut s'expliquer par le fait qu'on se fiaità cette époque principalement aux pratiques de protectiontraditionnelles (sacrifices sanglants d'animaux, libation surles autels, confection de fétiches) pour prévenir toutes espècesd'infortunes. Tout au moins jusqu'en 1992, année où une épidémie de rougeole a éclaté dans le village. L'échec de toutesles pratiques locales pour endiguer le mal amena les populations, cette année là, à consulter leurs ASV pour y parvenir.
468 Les maladies de passage
En 1992 il Y a eu l'épidémie de rougeole. On a fait unepremière réunion autour de ce problème. On nous a ditqu'il fallait activer nos traditions, c'est-à-dire faire dessacrifices sur les vieux objets du village. On disait quec'était parce qu'on les avait négligés que l'épidémie étaitentrée dans le village. Nous avons sorti de l'argent dans lacaisse du groupement villageois3 pour faire le nécessaire.Mais l'épidémie continuait. On a fait une deuxièmeréunion. C'est au cours de celle-ci que le chef de village arappelé ce que nous leur avions dit depuis longtemps. Il aété décidé de nous confier le problème. On a sorti encore del'argent dans la caisse du groupement. J'ai été voir l'infirmier de Sangha qui est venu faire la vaccination. À partirde cet instant, il y a eu un mieux.
Un second exemple, à propos de la mort d'une femmeépileptique dans un puits, nous permettra d'illustrer encore,ces nouvelles pratiques de prévention de la maladie.
Traditionnellement lorsqu'un épileptique tombait dansun puits ou une mare, cette eau n'était plus consommée. Lespuits étaient généralement refermés définitivement ou toutau moins pour très longtemps. Un cas de chute mortelled'une épileptique dans un puits de Bandiagara le dix-huitfévrier 1997 a donné lieu à des pratiques qui annoncaient lechangement qui affecte les pratiques anciennes dans cedomaine.
C'est dans le puits dit bundu kapi - « puits de Kapi »
du nom du chef de quartier - que la fillette de douze ans estmortellement tombée au cours d'une crise épileptique. Justeaprès cet événement, conformément aux pratiques traditionnelles, le puits a été fermé. Mais dans le même temps, unancien auxiliaire du service d'hygiène souligna que si on traitait le puits avec un certain nombre de produits, il n'y avaitaucun risque de contagion. Le quartier se cotisa pour l'achatde produits, notamment de l'eau de Javel. Après le traitement du puits, les notables du quartier allèrent, de plus,
3 Nouvelle fonne d'association villageoise mixte d'entraide et de sohdarité.Ces groupements tirent leurs ressources de travaux collectifs effectuéspar les membres au profit d'un particulier qui les paye ou de donsvenant d'autres associations et organismes Ces ressources sont utiliséesà des fins festives ou dans le financement d'actions d'intérêt général.
La prévention dans la modernité sanitaire dogon 469
consulter des marabouts, Bandiagara étant aussi une villefortement islamisée. Les marabouts conseillèrent d'enlevercent fois le contenu d'une « outre à puiser» [do: yaba} en eaudu puits, de la verser au sol, puis de refermer le puitsjusqu'au lundi suivant, avant de l'utiliser à nouveau. Desconsidérations écologiques ont peut-être été aussi à l'originede la non obstruction du puits, puisque chaque année, à partir du mois d'avril, la ville connaît depuis plusieurs annéesde graves problèmes d'approvisionnement en eau.
Un troisième exemple, cette fois ci, pris dans le contexte d'une maladie spécifique, « la maladie de l'oiseau »4,illustre une nouvelle fois le syncrétisme de ces pratiques desoins. Ce terme de « maladie de l'oiseau », utilisé spécifiquement chez l'enfant, recouvre très largement deux pathologies:l'accès palustre pernicieux et le tétanos néonatal. Même siles équipes médicales recommandent l'utilisation de la chloroquine pendant la grossesse et dès les premiers mois del'enfant ainsi que le recours à la vaccination pour prévenir letétanos néo-natal, les femmes continuent de recourir auxpratiques traditionnelles pour éviter la maladie de l'oiseau.Ainsi, la femme enceinte doit-elle chasser l'oiseau en simotant lorsqu'elle entend son cri pour éviter « la prise du fœtus»(autrement dit, une fausse-couche). De même, si elle estenceinte ou si elle porte son enfant au dos, doit-elle jeter unepierre devant elle lorsque cet oiseau traverse le chemindevant elle. Elle chasse ainsi le nyama de l'oiseau qui pourrait capturer celui de l'enfant (interprétation d'un avortement spontané ou d'un décès du nourrisson). Parfois, commechez les Mossi (Bonnet 1990), la femme enceinte ne dormirapas dehors afin d'éviter d'être survolée par l'oiseau contaminateur. Si elle est amenée à le faire on lui recommandera dedéposer auprès d'elle, une calebasse remplie d'eau afin quel'ombre de l'oiseau, qui représente son âme soit captée parl'eau au moment où son image s'y reflète. On peut aussi faireporter à l'enfant une amulette faite à partir d'un des éléments de l'oiseau (plume, serres, terre où des traces depattes ont été laissées sur le sol) ou de certains oiseaux carnivores tels que les vautours. Parfois encore, on prévient
4 Sur cette entité nosologique populaire, voir Bonnet (1999).
470 Les maladies de passage
cette maladie nommée sada par des pratiques de lavementsréalisés à partir de plantes. Ainsi, selon un guérisseur:
Sato fréquente les cimetières où il épie les tombes.Quand il survole une femme enceinte et que la poussièreprise au cimetière tombe sur celle-là, l'enfant à naître estdit « pris» [aije] par le sato. C'est la même chose quand ilsurvole un nourrisson [ï iru dagali, lit. enfant n'ayant paslaissé le sein). Mais il y a un arbre sur lequel le sato nemonte jamais et que les femmes utilisent très souventdans le lavement des enfants, pour les protéger ou les soigner. On enlève les feuilles et les racines de cette plante,et on prépare une décoction avec laquelle on fait des lavements aux enfants. On la leur fait boire aussi. Nous enfaisons aussi des « amulettes» [sebi]. (AT)
Cette impossible articulation entre les conceptionspopulaires de sada et celles de la biomédecine, conduit à lasuperposition de diverses pratiques pour la prévention d'uneseule pathologie. De sorte qu'il est fréquent de voir unefemme qui accepte la vaccination et qui applique, plus oumoins bien, la chloroquinisation, consulter parallèlement unguérisseur ou un marabout pour protéger son enfant contresada. Ce fut le cas de N.T. que j'ai rencontrée chez le chef devillage de D. que l'on considère aussi dans la zone, commel'un des meilleurs spécialistes de sada.
J'ai fait neuf maternités. Le premier enfant est mortde cette maladie de l'oiseau. Quand j'ai fait ma secondematernité, une vieille de Bandiagara m'a conseillé d'allervoir le chef de village de D. dès que j'aurai fini avec mesquarante-cinq jours. Elle m'a dit d'amener cinq centsfrancs. C'est ce que j'ai fait. Effectivement le chef m'adonné une amulette à mettre au cou de l'enfant. Et il m'aconseillé aussi de ne pas interrompre cette pratique.Après chaque accouchement, dès qu'un nom est attribué àl'enfant, je vais chercher l'amulette. (NT)
La rencontre entre une pratique médicale et un usagepopulaire reste donc complexe, même si maladroitement, lesagents de santé tentent parfois de rapprocher sada et paludisme par le biais d'un symptôme commun (le tremblementou la contracture des membres), et que les populations recon-
La prévention dons la modernité sanitaire dogon 471
naissent que le sada se manifeste, en effet, comme certainesformes de paludisme, par le raidissement du corps del'enfant.
Situation 2
Dans certains cas, ce n'est pas la formulation du message qui fait obstacle à son intégration, mais le fait que soncontenu soit incomplet. Ce déficit de connaissance peutdéterminer diverses conduites de la part des populations.
Pour illustrer cette situation, nous prendronsl'exemple des campagnes de vaccination et de lutte contre lesmaladies diarrhéiques, toujours au Mali, et dans cette mêmezone de Bandiagara.
Lors de sa première phase dite de « coup de balai » quiva de 1987 à 1990, le PEV avait pour objectif de vacciner80 % des enfants de °à 6 ans, ainsi que les femmes en âgede procréer. Cet objectif a été loin d'être atteint dans toutesles zones. Une des explications réside dans le fait que le message sanitaire n'avait pas intégré d'informations concernantles effets secondaires des vaccins tels que fièvres et éruptionscutanées. Ce n'est que face aux plaintes des mères que l'on aconseillé de donner de l'aspirine en cas de réactions5. Voici cequ'en dit une mère:
On nous demande de faire vacciner nos enfants. Nousamenons des enfants sains qui reviennent malades.Quand on explique cela aux dogotoro, ils nous disent dedonner de l'aspirine aux enfants. À quoi sert l'aspirine? Àsoigner [jogno !J. Ils rendent donc nos enfants maladespour qu'on paye leurs médicaments.
Le fait de n'avoir pas prévenu les mères sur l'éventualité des effets secondaires est à l'origine du dysfonctionnement du programme vaccinal. A cela s'ajoute que, fauted'une bonne chaîne de froid permettant la conservation desvaccins, certains enfants vaccinés peuvent décéder lors d'unépisode de rougeole.
5 Ces mêmes questions ont été évoquées pour d'autres populations (Jaffré1991, Tinta, 1992).
472 Les maladies de passage
A ce niveau d'interprétation s'en ajoute parfois unautre, provenant de la collusion entre plusieurs campagnesde santé publique. Il en est ainsi lorsque la vaccination etdes conseils de planning familial sont proposés, sans précautions ni distinctions, au même groupe de population, notamment, les femmes en âge de procréer. Dès lors, ainsi quel'évoque notre interlocutrice, une apparente mise en relationpeut compromettre ces deux actions :
Ils nous avaient demandé d'avoir moins d'enfants. Estce que ce n'est pas ce qu'ils veulent faire avec les vaccinations?
Un autre exemple concerne la prévention et le contrôledes maladies diarrhéiques. En effet, la Solution deRéhydratation Orale (SRO) a le plus souvent été présentéeaux mères en leur disant: « lorsque vos enfants font la diarrhée, donnez leur le SRO ". Or, ce produit n'est pas un médicament contre la diarrhée, mais une prévention de la déshydratation de l'enfant. Cette précision ayant manqué au discours médical, les populations ont compris que le SRO étaitun traitement qui pouvait stopper la diarrhée, ce quiexplique leurs critiques:
Ce n'est pas un bon médicament. J'en ai donné à monenfant, son ventre continue à couler. On nous trompe toujours. En plus, on nous avait dit que c'était gratuit. Seulesles premières femmes qui sont allées au dispensaire, l'onteu sans payer. Nous autres on l'a acheté.
Pour tenter de combler le déficit d'explications, leséquipes médicales ont traduit SRO par « compensation de laperte d'eau du corps» [gesu le ni go ma ka kuno]. Maiscomme dans les conceptions locales la diarrhée n'impliquepas une perte d'eau du corps chez le malade, ce nouveauterme peine à trouver sa place dans les systèmes locaux dereprésentations de la maladie.
La prévention dans la modernité sanitaire dogon
Situation 3
473
Une autre difficulté apparaît dès lors que le messagevise à modifier un état qui n'est pas ressenti par les populations comme pathologique.
Nous prendrons l'exemple du projet de lutte contre laschistosomiase à Bandiagara. Ce programme sanitaire initiévers 1977 était destiné à lutter contre la bilharziose urinaire(Berche, op.cit. 1994). On supposait, en effet, qu'en raison decertaines modifications écologiques intervenues dans larégion, et notamment à la suite du développement des cultures maraîchères et de la mise en place de petits barrages,cette pathologie s'était accrue.
Malgré ce « juste » objectif, les propositions préventivesdes équipes sanitaires se confrontèrent aux deux principalesinterprétations locales de la bilharziose en milieu dogon.
Certaines personnes interrogées considèrent que cettemaladie est surtout infantile et cesse d'elle-même lorsque lapersonne affectée arrive au stade adulte. Ceux qui font prévaloir cette conception disent que la maladie est liée à l'eau,et que l'enfant l'attrappe lorsqu'il nage dans l'eau des marigots, par l'introduction dans l'anus de petites bêtes rougeâtres. Quelques rares informateurs disent que cette maladie serait due au fait de consommer beaucoup de pain desinge. Cette forme de bilharziose urinaire est dite mogobanu, c'est-à-dire le « mogo rouge» à cause de l'aspect sanguinolent de l'urine du malade.
Pour d'autres, le « mogo rouge» n'est pas considérécomme une maladie mais comme le signe de la future fertilité d'un enfant. Cette conception établit même qu'un jeunegarçon qui n'est pas « affecté» par ce symptôme a de fortsrisques d'être stérile. Ces troubles sont du reste nommés les« menstrues des hommes» [anam puno]. On distingue cependant cette entité pathologique d'une autre forme de « mogoblanc» qu'on assimile à une maladie sexuelle. Certainsl'identifient par le terme « d'urine blanche » [isari pilu] àcause des pertes blanches qu'elle provoque chez le malade.
C'est dans ce contexte d'une double conception de labilharziose que le « projet schisto » devait inscrire son action
474 Les maladies de passage
préventive. Dans les zones où l'on concevait déjà la bilharziose comme un mal sans gravité il y a eu très peu de résistanceau discours préventif. Mais en zone dogolu en particulier, oùles secondes interprétations sont largement répandues, on aconsidéré que les informations contenues dans les messagessanitaires étaient une « agression » à l'encontre du savoirlocal.
Dans nos traditions, on n'a jamais appris que le mogoest une maladie. Nos parents avaient même peur que leurenfant ne connaisse pas le mogo ; personne n'a jamais soigné le mogo. Après sa période, il disparaît comme lesrègles d'une femme après une semaine. Aujourd'hui lesdogotoro disent que c'est une maladie donnée par les eauxdes mares. On nous demande de ne pas consommer ceseaux et de ne pas laisser les enfants entrer dedans. Entout cas, tant que nous ne verrons pas de nos propresyeux, notre « pensée» est ailleurs... (BT)
Le message de prévention, bâti sur les conceptions biomédicales de la bilharziose, privilégie donc l'aspect parasitologique de la maladie, et méconnaît ces conceptions localesqui n'attribuent pas à l'individu « affecté» par la bilharzioseun statut de malade. Ce décalage explique, en grande partie,l'insuccès de ce projet dans certaines zones.
Situation 4
Dans certains cas, le discours préventif connaît deséchecs parce que le message n'est pas congruent avec lesconduites de ceux qui le profèrent.
Nous développerons nos arguments en prenant maintenant un exemple dans le domaine de la planification familiale au sein d'un programme qui avait, fort classiquement,pour objectif de promouvoir la santé maternelle et infantile àtravers des thèmes comme les méthodes contraceptives,l'espacement des naissances ou leur limitation.
Pour animer la première phase de ce projet, appelée« phase de sensibilisation », il a été décidé de recruter unejeune sage-femme dans la capitale régionale. Cette personnerencontra deux handicaps majeurs. Le premier était son sta-
La prévention dans la modernité sanitaire dogon 475
tut de célibataire n'ayant jamais enfanté, et donc du point devue des populations, n'ayant aucun droit à la parole enmatière de procréation. Trois questions adressées à cettesage-femme par un groupe qu'elle « sensibilisait » sont icisignificatives. Premièrement, on lui demanda si elle étaitmariée, la réponse fut négative; puis, si elle avait desenfants, la réponse fut négative; enfin, si elle en avait déjà euet s'ils étaient morts, la réponse fut encore négative. C'estalors qu'il lui fut dit: « Je ne sais pas ce que tu vas nousapprendre, ma fille; il vaut mieux qu'on ne continue pas cetteréunion". Les femmes se levèrent alors et se dispersèrent.
Le deuxième handicap a concerné son collègue, puisqu'en effet, l'infirmier en poste à K. est polygame et père deplus d'une dizaine d'enfants. Dès lors, la situation de cetagent de santé démentait ses propos en matière de planification familiale ! La réaction des femmes est ici fort claire puisqu'une des femmes, qui était une parente à plaisanterie del'infirmier, s'est rendue au domicile de l'infirmier pour dire àses épouses :
Vous et vos maris êtes tous des égoïstes. Il y a combiend'hommes dans ce village qui ont autant de femmes quelui? Il y a combien de femmes qui ont autant d'enfantsque vous? Et vous demandez aux autres d'arrêter oud'avoir peu d'enfants.
Situation 5
Dans d'autres cas, les interlocuteurs choisis, ou lesrécepteurs des messages, ne disposent pas du pouvoir dedécider d'un changement de comportement tel qu'il est proposé par les éducateurs sanitaires.
Qu'il nous suffise ici de décrire les réactions desfemmes d'une petite localité. Lorsqu'on leur parla de planification familiale, elles répondirent qu'« elles sont des queueset non des têtes" (la tête étant assimilée au pouvoir) et quepour discuter de cela il fallait qu'elles en parlent d'abord àleur mari. En effet, dans cette localité, un islam chiite qualifié de Wahabia est dominant et laisse peu d'initiative auxépouses. Ainsi d'ailleurs répliqua un des hommes :
476 Les maladies de passage
C'est Dieu qui donne les enfants. Ceux qui essayentd'en limiter le nombre commettent une faute grave enversla loi divine. Nous sommes ici fidèles à cette loi, donc noussommes contre cette parole des « dogotoro ».
Situation 6
Certains gestes « techniques» peuvent heurter la sensibilité des populations et les détourner des conduites préventives préconisées.
Ainsi, les consultations pré et postnatales devraientpermettre de détecter les grossesses à risque et ainsi de lesréférer, au plus tôt, à l'instance sanitaire supérieure. Mais,pour cela, les matrones utilisent systématiquement des actesqui choquent les consultantes. Il s'agit principalement dutoucher vaginal. Les femmes y sont très réticentes parce que,disent-elles, « nous n'acceptons pas qu'on s'amuse avec notrecorps ».
Ainsi à Djenné (Tinta 1992) comme dans certainesmaternités de Bandiagara, les matrones elles-mêmes reconnaissent que celles à qui on avait fait le toucher vaginal lorsde la première consultation, ne revenaient plus. Ce gestemédical a donc un impact négatif sur la fréquentation desmaternités.
Soulignons que cette pratique des matrones semble nepas être toujours médicalement justifiée, compte tenu de leurniveau de formation. Elle peut s'expliquer par la volonté devaloriser un nouveau savoir faire. En effet, pour lesmatrones, la consultation prénatale (ou postnatale) se résumait jusqu'à présent à la pesée de la mère et de l'enfant.C'est pourquoi en milieu dogon, mais aussi de façon généraleen Afrique de l'Ouest, les actes des matrones, sauf pourl'accouchement, sont globalement appelés la « pesée» : pezeen dogon, pesigol en peul, peseli en bambara, etc. Pour prouver qu'elles font mieux qu'une simple pesée et par là démontrer qu'elles ont un savoir-faire spécifique, ces agents desanté miment des gestes techniques, sans qu'ils soient véritablement efficaces donc nécessaires.
La prévention dans la modernité sanitaire dogon
Situation 7
477
Les programmes de prévention s'inscrivent dans deslogiques de « détournement» ou « d'accaparement» du pouvoir (Olivier de Sardan, 1990), et les populations utilisent lesoccasions fournies par un programme pour les mettre au service de leurs objectifs et pour certains groupes particulierspour acquérir ou accroître leur prestige.
Ce « pragmatisme » de recherche d'avantages et depouvoir conduit à diverses incompréhensions allant, de lapart des populations, jusqu'à des mises en scène laissantcroire qu'elles adoptent l'offre sanitaire alors qu'elles souhaitent uniquement bénéficier des avantages matériels liés à ceprojet (Tinta 1999).
Nous illustrerons, cette fois-ci, nos propos parl'exemple d'un programme de lutte contre le paludisme.
Afin d'aider à la diffusion du message, un certainnombre de guérisseurs ont été associés ce programme. Dansce cadre, on leur proposa une formation d'environ deux àquatre jours, assurée par les agents du Centre de santé ducercle et ceux du Centre Régional de Médecine Traditionnelle(CRMT), ce dernier collaborant avec les guérisseurs organisés en Association de Thérapeutes Traditionnels (ATT). Laqualité de membre de ces associations donne à son titulairele droit d'avoir une carte, et parfois même une blouse pourles collaborateurs les plus fidèles. Après cette formation, cesguérisseurs savent répéter intégralement le message qui leura été enseigné. Ils savent dire, comme cette vieille guérisseuse, que le moustique donne le paludisme:
Ce qui donne précisément le paludisme ce sont lesmoustiques. C'est la manière dont les moustiques transmettent le palu. Le palu s'il vient, souvent ça commencepar une personne. Le moustique après avoir bu le sang dumalade, s'il arrive à piquer celui qui n'a pas le palu, ça lecontamine [sic.]. (VK)
Ils savent aussi indiquer les traitements.
L..] Pour ne pas être atteint de palu, on peut prendre troisnivaquines par semaine. Mais une fois qu'on est atteint, poursoigner, l'enfant jusqu'à onze mois c'est un comprimé par
478 Les maladies de passage
jour; soit un demi-comprimé le matin et un demi le soir pendant trois jours. De douze mois à 5 ans, tu prends un comprimé le matin et un le soir pendant trois jours. De six ans à dixans, c'est un comprimé le matin, un à midi et un le soir, pendant trois jours. De onze ans à quinze ans, il faut donnerdeux comprimés le matin et deux le soir pendant trois jours.À seize ans et plus, on donne deux comprimés le matin, deuxà midi et deux le soir pendant trois jours. (VK)
Mais ces discours relèvent plus d'une logique decontrôle du savoir reçu, que d'une réelle appropriation desnouvelles connaissances transmises. En effet, au moment decette formation, les guérisseurs ont été prévenus que dessuperviseurs passeraient vérifier s'ils ont bien compris etretenu les leçons de la formation. Pour prouver donc qu'ilsont été de bons élèves, ils répéteront les leçons apprises aucours de cette formation.
Par contre, au quotidien et loin des formateurs, les discours changent. Le style devient indirect: « on nous a dit quele moustique donne le palu et que la nivaquine protège ousoigne contre le palu », et les propos intègrent les anciennesconceptions :
Ce que nous savions avant dans la tradition, certainsdisent que le wobu, nous on dit argu enjamsay, est donnépar la saleté logo notamment les aliments « sales » ou« avariés» [nyowon]. Parfois c'est le « changement d'eau»[ni duluwu] qui amène le argu ; d'autres disent que c'estDieu ou le « mauvais vent» [onyo monyu] ; mais en milieudogon partout il est reconnu que le argu vient avecl'hivernage. Il existe en d'autres saisons, mais c'est avecla verdure de l'hivernage qu'on voit beaucoup le argu.Selon les Dogon, c'est la période où il pleut beaucoup, onmange les fruits sucrés comme le yulo [parkia biglobosa],le mignu [Butyrospernum parkii], le kambu [Saba senegalensis glabiflora}. C'est cela qui donne le «argu ». (ûT)
Dans ces paroles, ce n'est plus le moustique, mais undéséquilibre alimentaire, par un excès de « sucré », qui donnele palu. Et, dès lors, la thérapie curative comme préventiveconsiste à recourir à une logique de l'opposition (amer 1sucré) pour rétablir cet équilibre:
La prévention dans la modernité sanitaire dogon 479
Depuis nos ancêtres nous utilisons les plantes pourprévenir le wobu. Nous utilisons les plantes amères endécoction pour boire ou se laver et en « fumigation»[uguruj, surtout à l'approche de l'hivernage. (OT)
Pour les guérisseurs, plus qu'un réel changement deconception, l'adhésion au programme de santé publique estdonc, avant tout, l'occasion d'initier une collaboration avec laseule médecine considérée comme légale et pouvant leuraccorder une légitimité et une protection légale.
Enfin, l'adhésion à ce programme permettait une source de revenus supplémentaires, puisque le comprimé de nivaquine qui leur est cédé à cinq francs est revendu à dix francsà la population.
Situation 8
La complexité des programmes sanitaires rend parfoisleurs orientations, ou leurs modifications, incompréhensiblespour les populations.
C'est ainsi qu'une campagne de chloroquinisation aentraîné des résistances du parasite à cause d'une priseinsuffisante de nivaquine. Cette erreur de dosage annulaittout bénéfice de protection et toute possibilité de diagnosticpar les examens biologiques, notamment par la goutte épaisse. C'est pourquoi l'équipe médicale pour essayer de mieuxdiagnostiquer les cas de paludisme demanda l'arrêt des pratiques prophylactiques par la nivaquine. Ce qui a été interprété par les populations en général, y compris les guérisseurs, comme un déficit du savoir médical.
Situation 9
Des pratiques populaires interfèrent avec des préceptes médicaux et les discréditent aux yeux des populations.
C'est ainsi que des campagnes de chloroquinisation ontmis l'accent en direction des femmes enceintes. Or, dans lesconceptions locales, la nivaquine prise à certaines dosesdevient un abortif. Il faut donc prendre garde de ne pas être
480 Les maladies de passage
l'auteur ou le complice d'un tel accident et se méfier de cesconseils sanitaires.
Situation 10
Une dernière situation correspond à l'inadéquationentre les méthodes préventives préconisées et les possibilitéset conduites des populations.
C'est ainsi que, outre l'utilisation de la chloroquine, ona proposé aux populations l'usage de « moustiquaires et derideaux trempés » (moustiquaires imprégnées d'insecticide),de fumigènes, etc. On sait que le Mali figure parmi les paysles plus pauvres du monde et que 80 %6. de sa population estrurale. Disons-le simplement: pour un paysan avoir unemoustiquaire est déjà un luxe, alors comment trouver lesmoyens de les imprégner chaque année, non seulement pourlui, mais aussi pour l'ensemble d'une grande famille? Plusencore, les médecins spécialistes ont indiqué que le pic desmoments de piqûre des anophèles correspond à l'aurore et àl'aube, moments où l'on a toutes les chances de ne pas trouver le paysan sous une moustiquaire puisqu'à ces heures, s'ilne revient pas des champs, il s'y dirige.
Conclusion
L'éducation pour la santé basée sur la transmission de« bons messages" et fondée sur des critères d'efficiencedevrait être davantage pensée comme un processus de négociation que comme une simple opération logique du type « sil'offre correspond aux besoins de santé des populations, alorselle entraînera forcément des changements de comportement ".Nos exemples, soulignent, en effet, qu'il s'agit d'une opération complexe de négociation entre des éducateurs et desbénéficiaires ; négociation dont personne ne peut présagerl'issue, et qui dépend des contextes et des contraintes desuns et des autres.
6 Source: recensement démographique 1967-1987.
La prévention dans la modernité sanitaire dogon 481
Une nouvelle information peut déboucher sur uneréussite si elle intervient comme un savoir alternatif ou complémentaire d'autres savoirs que détenaient les populations.Il ne s'agit pas cependant uniquement d'une opération cognitive. Sa réussite dépend aussi de cette ligne opaque qui correspond à la liberté des acteurs pour développer leurspropres stratégies, et notamment, dans un contexte de pénurie, des pratiques de détournement et d'accaparement évoquées ci-dessus. C'est dire que ces multiples échanges,enjeux et réflexions aboutissent souvent à des savoirs et pratiques syncrétiques et à des dérives dans la réalisation desbuts initiaux des programmes.
Cette « éducation» peut aussi échouer lorsqu'il y a tropd'incompréhensions entre éducateurs et bénéficiaires. Cesmalentendus interviennent soit lorsque le contenu du message est perçu comme transgressant les conceptions locales,soit lorsque l'émetteur n'est pas congruent avec le message,soit enfin lorsqu'un déficit dans la connaissance de l'émetteur ou dans la manière dont cette connaissance est transmise l'empêche de prendre en compte ces nouvelles informations.
Enfin, la réussite ou l'échec d'une action en éducationpour la santé n'est pas prédéterminée uniquement par unproblème de formulation et de communication de bons messages. Son impact est aussi fonction de la prise en compte del'ensemble des déterminants sociaux et psychologiques desconduites pouvant influencer l'ordre social en général et lasanté en particulier. Comme l'a souligné Jaffré, « en face del'émetteur se trouve un récepteur pris dans les réseaux deson désir, de son environnement objectif et des règles du jeusocial de son milieu» (1990).
La modernité sanitaire, dans le domaine de la prévention, est devenue un véritable marché au sens d'un espace depropositions d'offres et de demandes émanant d'acteurs auxstratégies multiples. En réponse, les bénéficiaires accepteront les offres parfois par nécessité, parfois par convictionmais aussi souvent par le concours de stratégies de captationdes avantages liés à une offre.
482 Les maladies de passage
Entre ces deux pôles se cachent des conflits d'acteursqui expliquent outre l'échec ou la réussite des projets dedéveloppement sanitaire, une forme de vie et de liberté dessociétés.
Bibliographie
Berche T.1994 Un projet de santé en pays dogon. Enjeux de pouvoirs et
stratégies (1987-1992), Thèse de doctorat d'anthropologiesociale et ethnologie, Marseille, EHESS.
Bonnet D.1990 <. Anthropologie et santé publique. Une approche du palu
disme au Burkina Faso" in Fassin et Jaffré (éds),Sociétés, Développement et Santé, Bruxelles, Ed. del'Université de Bruxelles : 243-258.
1999 Les différents registres interprétatifs de la maladie del'oiseau, in, La construction sociale des maladies, Jaffré &Olivier de Sardan (éds), Paris, PUF, 305-320.
Bouchayer F.1984 « Les logiques sociales des actions en éducation pour la
santé ", in Sciences Sociales et Santé, vol. II, n° 3-4, octobre.
Jaffré Y.1990 Education et santé in Sociétés Santé et développement (en col
laboration avec D. Fassin), Paris, Ellipse AUPELFIUREF :51-66.
1991 Education pour la santé et conceptions populaires de laprévention, Paris, Revue du Praticien Médecine générale,n° 154, Sept à Juin: 2485-2489.
1991 Anthropologie et éducation pour la santé, Paris, CahiersSanté AUPELF-UREF, n° 1,406-414.
Olivier de Sardan J.-P.1990 « Sociétés et développement ", in Fassin & Jaffré (éds) :
Sociétés, développement et Santé, Paris, Ellipses.
Tinta S.1992 Créer un centre de santé communautaire? Le cas de
Kamba (arrondissement de Sangha), Bamako, INRSP,multigra.
La prévention dans la modernité sanitaire dogon 483
1999 Les conceptions autour de la transmission de la maladie etles pratiques préventives chez les Dogon du Mali, Thèse dedoctorat d'anthropologie sociale et ethnologie, Marseille,EHESS.
Conclusion
Transmission, prévention et hygiène,en Afrique de l'Ouest, une questionanthropologique de santé publique
Yannick Jaffré
Habitués à l'apparente objectivité des chiffres épidémiologiques, nous oublions souvent ce qu'ils dissimulentcomme conduites sanitaires banales et quotidiennes ou ceque ces données recouvrent comme gestes originaires, difficultés et douleurs.
Ainsi, que savons-nous des mots qu'utilisent les populations pour dire les maladies du grand nombre? Quellesréflexions et quels savoirs suscite la répétition des mêmesévénements pathologiques? Quelles conduites sont adoptéespour tenter d'éviter leurs régulières répétitions? Ces questions, diversement partagées par des anthropologues et desmédecins, expliquent, pour une grande part, les raisons de celivre consacré à la construction sociale des notions de transmission des maladies et aux pratiques de prévention qui ysont afférentes.
Mais, avant de conclure, revenons aux chiffres. EnMrique1, le choléra sévit encore de manière endémique dansde nombreuses régions. Il « touche » environ 200 000 personnes et est responsable de la mort de 9 000 d'entre elles.Les maladies diarrhéiques sont une autre cause majeure de
1 On peut trouver l'ensemble de ces données sur les différents sites internet de l'OMS.
486 Les maladies de passage
mortalité et de morbidité avant l'âge de cinq ans, et l'on estime à 800 000 les décès d'enfants dus à celles-ci ou aux déshydratations qu'elles provoquent. La pneumonie tue environ unmillion et demi d'enfants. L'hépatite B est aussi fortementendémique dans la zone sub-saharienne, et la sérologie faitapparaître une primo-infection chez 70 % à 90 % de la population. Liée à ce contact avec le virus, la mortalité par cancerprimitif du foie figure au premier rang des causes de décèspar cancer. Le nombre de disparitions par rougeole est deplus de 500 000, les épidémies de méningite accompagnentpresque toutes les saisons sèches. Le SIDA, bien que demanière extrêmement variable selon les pays, affecte pratiquement toutes les familles.
Face à cela, la réponse sanitaire reste fragile et peuinsérée tant dans les activités dépendant de l'État que dansle tissu social local. Les taux de couvertures vaccinales, quelsque soient les antigènes, restent faibles et se situent globalement entre 30 % et 50 % des populations concernées. L'adoption de mesures personnelles de prévention contre les infections respiratoires et les maladies sexuellement transmissibles est insuffisante. Les pratiques d'hygiène du milieu,indispensables notamment à la prévention des pathologieshydriques, restent précaires. Enfin, l'hospitalisation ou laprise de traitements ne vont pas sans errance et sansrisque ...
Fort pragmatiquement, un des buts de ce livre2 consiste, outre à progresser dans les connaissances anthropologiques, à tenter d'améliorer cette situation en fournissant àdes équipes de santé publique quelques outils indispensablespour mieux comprendre les populations à qui elles s'adressent.
Certes, cela n'est pas suffisant, et, pas plus qued'autres, nous ne croyons que la description de quelquestermes puisse suffire à transformer radicalement lesconduites des équipes sanitaires ou résoudre les apories économiques et politiques des systèmes de santé dans des paysen voie de développement. Il n'empêche. Il nous paraît indis-
2 Comme de l'ensemble du programme de recherche financé par l'UmonEuropéenne.
Conclusion 487
pensable de faire entendre d'autres paroles et comprendred'autres pratiques aux responsables sanitaires, à tort et àraison nommés « décideurs ». Ce n'est qu'un début. Maisintroduire la parole des acteurs dans le champ des programmes de développement, pour être une pratique politiquemodeste, nous semble cependant approprié pour aider à laformulation de propositions concrètes fondées sur un réelsavoir anthropologique et non sur de vagues présupposés« culturels,,3.
C'est pourquoi nous avons privilégié les données empiriques. Décrire avant d'interpréter. C'est pourquoi aussi, certains des auteurs, en lisière, mais aussi forts de ces étudesqualitatives rigoureuses, se sont aventurés plus avant, enmarquant un écart entre ce qui est, et ce qui pourrait êtreamélioré par quelques mesures simples. Disons le clairement, c'est ainsi, plus que se situer dans une extériorité parfois aisément critique, articuler modestement un travailscientifique avec une nécessaire réforme des pratiques sanitaires dans les pays en voie de développement.
Mais, outre cette préoccupation d'intervention sociale,une autre caractéristique, plus méthodologique, peut définirnotre posture: l'ensemble de ce livre s'inscrit dans un espacequi est explicitement circonscrit par la différence entre ceque nous sommes et savons grâce à la science biologique etce et ceux que nous décrivons comme étant extérieurs à cetteconnaissance4 .
Il ne s'agit pas uniquement d'être ainsi lucide surl'écart qui suscite notre travail et fonde notre lecture. Il endécoule aussi une certaine forme d'interprétation de nos données.
Nous pensons, en effet, que les études cliniques ou épidémiologiques mettent en évidence et permettent de comprendre sur quels matériaux les populations doivent exercer
3 Sur les difficultés, mais aussi sur le fait que" la rencontre de l'anthropologie et de la santé publique est en train de passer de l'état d'une évidence espérée à celui d'une pratique nécessaire ", nous renvoyons auxremarques de Benoist (2001).
4 Mais n'est-ce pas implicitement cet écart qui ouvre et permet toute laréflexion de l'anthropologie de la santé?
488 Les maladies de passage
leur sagacité: maladies liées aux épidémies de la saisonsèche, ou, au contraire, affections de la saison froide, complexité des expressions cliniques des variations génétiques etdes pathologies infectieuses, etc. Bref, cet appui pris dans leréel du corps et du morbide permet de ne pas uniquementretranscrire des discours et d'en souligner la cohérencesémantique, mais aussi de les confronter à la complexitépathologique qu'ils ont à penser. Enfin, lorsque l'on adopteune visée comparative, il devient possible de s'attacher, nonseulement à rapprocher des contenus d'énoncés, mais aussi àcomprendre comment, sous la diversité des langues, de semblables processus cognitifs naissent de la confrontation à demêmes énigmes biologiques.
Mais si ces maladies affectent le corps, leur spécificitéest de se transmettre - ou d'être interprétée comme se transmettant - des uns aux autres: maladies particulières d'êtred'emblée « sociabilisées ", pourrions-nous dire. En révélant cequi devait être tu, comme des relations sexuelles illicites, endévoilant des craintes ou en confrontant à l'obligation de surmonter son inquiétude ou son dégoût pour soigner un proche,ces passages pathogènes laissent apparaître, en filigrane,diverses formes des liens sociaux. Evitements, appréhensions, sollicitude, mais aussi ambivalence des sentimentsentre habitudes locales et connaissances modernes, composent alors, avec le plus concret des affections corporelles etselon de multiples stratégies d'acteurs, des sortes de kaléidoscopes comportementaux. Si les éclats de verre biseauté sonten nombre limité, la diversité de leurs miroitements est quasiment infinie. D'autres - plus chagrins peut-être? - parleraient ici de conduites variables à détermination « multifactorielle » ••• Qu'importe.
Essayons simplement, par ces textes, de comprendrecomment certaines entités nosologiques populaires (Olivierde Sardan 1999) et leur passage des uns aux autres sontinterprétées parmi diverses sociétés d'Afrique de l'Ouest.Soulignons aussi les points communs entre ces conceptionspartagées par le plus grand nombre, et précisons commentces constructions sociales, de la transmission, de la prévention et des hygiènes, viennent parfois troubler le bel ordonnancement « théorique " des objectifs et des programmes de
Conclusion 489
la santé publique. Toutes lectures faites, quatre larges caractéristiques nous semblent communes à l'ensemble desconceptions présentées par les auteurs, et propres à ordonnerle foisonnement de la diversité des textes. Mais la précisionde ces descriptions oblige de fait à un regard critique. C'estpourquoi la présentation de ces organisations du sens se présente aussi comme une traverse critique, tant d'une certaineanthropologie parfois bien prompte à prendre les mots pourdes actes, que d'une santé publique souvent bien sourde auxmots de son « public ».'
Des régularités discursives dans l'ensemble ouest africain
Une remarque pour débuter. Les études réunies dansce livre s'appuient sur divers types de discours. Certains correspondent à des réflexions, d'autres à des rumeurs, des opinions, des suppositions. Certains propos s'appuient sur desconnaissances locales, produites par une libre démarched'observation ou, comme la notion de « quarantaine », paremprunt aux pratiques et au vocabulaire médical. D'autresencore ne sont que des supputations sujettes à discussion,voire des on-dit que l'on hésite à « prendre à son compte ». Achacune de ces assertions correspondent divers types d'énonciations - bruits, échanges informels, sources autorisées, propos nés du questionnaire etc. - unis de plus, à différentsmodes de communication allant de l'instruction autoritairejusqu'à la libre discussion entre égaux. Bref, les rapports desacteurs à leur dire ne sont pas homogènes. Cependant, endépit de cette diversité, ils roulent les mêmes mots et sontorganisés selon les mêmes soubassements logiques. L'hétérogénéité des propos révèle des similarités et des régularités desens.
En effet, dans l'ensemble de nos contextes d'étude, lanotion de « transmission» se décline selon de semblables distinctions, comme une sorte d'hyperonyme englobant cinqtypes de processus.
Au plus simple, la transmission peut être externe,directe et accidentelle. Elle correspond à un contact. Mais,cette contiguïté ne se limite pas au tactile et aux rapports
490 Les maladies de passage
corporels. Par exemple, ici comme ailleurs, « on touche avecles yeux » et ce processus est régulièrement évoqué puisquele regard, à l'insu du sujet, souvent trahit l'envieS.
Ces mêmes supports physiques se retrouvent lorsqu'ils'agit d'une transmission externe directe et, cette fois, volontaire. Simplement on incrimine à l'origine du passage pathogène une certaine « intentionnalité» malveillante.
Cette transmission peut aussi être indirecte, et distinguée comme précédemment, entre ce qui est involontaire ouce qui résulte d'une action volontaire. Ce passage s'effectuealors par l'intermédiaire d'un « média pathogène », qui globalement peut correspondre à tout ce qui peut subsister dumalade et de sa maladie dans ses empreintes corporelles. Ences cas, que l'intention soit malveillante ou que l'acte relèved'une négligence, toute trace peut s'avérer être dangereuse;et pour cela tout lieu de passage ou d'intimité être affectéd'une valence négative. Globalement, tout endroit quiconjugue le nombre des utilisateurs, la fréquence des actesprivés et l'éventuelle dissimulation de pratiques symboliquesou de soins, est potentiellement ressenti comme étant à« haut risque ». Divers espaces quotidiens apparaissentcomme paradigmatiques de ces appréhensions normales.Fort banalement, il suffit bien souvent de caractériser lestypes de lieux en « croisant » la fréquence des passages ou cequ'ils accordent à la dissimulation de l'intimité (douche, lit,chemin ... ), avec ceux qu'ils accueillent (femme enceinte ouallaitant, malade « en crise » ... l, et les humeurs qui peuvents'y déposer (sang, urine, sueur, lait, sperme... ), pour obtenirune sorte de relevé topographique d'un espace des craintes etdes prudences locales.
Enfin, un dernier processus souligne qu'au sein desfamilles, d'autres maladies se transmettent des parents auxenfants, comme les traces visibles d'un irrécusable héritage.
Si l'on s'accorde sur cette sorte de « structure profonde»de la transmission, une première conclusion s'impose. Laluxuriance et la diversité des propos concernant la transmission des maladies n'est qu'apparente. En fait, la variabilité
5 Sur ce point nous renvoyons à Jaffré (1999) et dans un autre contexte àMarin (1990).
Conclusion 491
des thèmes évoqués par les populations, n'habille diversement qu'une semblable ossature cognitive. La complexité desinterprétations ne provient pas des opérations intellectuellesqui les sous-tendent, mais, fort banalement, des liens que cedomaine de la transmission ne peut manquer d'entreteniravec celui plus vaste de la recherche et de la qualification descauses des maladies. Par exemple, lorsqu'une transmissionmorbide est supposée « naturelle ", on peut, pour en trouverla raison, faire « flèche de tout bois" explicatif: traces, voyage, bain, nourriture... Dans le cas d'une contamination supposée volontaire, les ensembles sémantiques convoquésseront différents, englobant généralement une réflexion surle vouloir individuel et de plus larges supputations magicoreligieuses. Enfin soulignons que ces hypothèses interprétatives ne sont pas exclusives les unes des autres. Elles sontmêlées. Les conjectures peuvent varier au décours de lamaladie et une affection supposée « naturelle » pourra êtreréinterprétée comme provenant d'une volonté maléfique, dèslors qu'elle dure et se refuse à guérir.
L'interprétation causale est donc toujours actualiséeen fonction de l'évolution de la maladie ou du résultat d'untraitement: lorsqu'un système ne rend plus compte du réelobservable, on en incrimine un autre. « Circonstances causales" dit Sophie Arborio. Soulignons que la notion « d'âmefaible ", fréquemment évoquée, est un utile adjuvant de cesystème. Elle n'est pas, en effet, une caractéristique identitaire de la personne permettant de prédire sa résistance à lamaladie. Elle se présente plutôt comme une explicationaprès-coup, autorisant, sur le mode tautologique, de commodes réorganisations interprétatives: lorsque l'on résiste àla maladie, c'est que l'on était assez fort pour le faire, etinversement. On est bien loin ici d'une anticipation objectivedu risque tel que le définit la santé publique.
Des incertitudes empiriques et des certitudes sociales
Au fil des maladies et des douleurs, la multiplicitéobservable des formes de transmission se présente avanttout, pour les populations, comme une suite d'énigmes. Par
492 Les maladies de passage
exemple, lors d'une épidémie, nombreux sont ceux qui sontatteints par la même maladie, mais certains y échappent etd'autres pas. De même, dans une famille, certains sontatteints par diverses affections comme la drépanocytose oul'albinisme, mais, « visiblement », pas tous. Certains troublesdébutant par des symptômes apparemment identiques évoluent de manières différentes ...
Face à cela, et dans des sociétés où, « avant l'inventiondu microscope, l'infection ne pouvait être vraiment détectéeque dans les cas de transmission par contact de quelquesmaladies bien déterminées par leurs symptômes » (Grmek1984), comprendre consiste à démêler l'écheveau complexedu nombre et de la singularité, et à établir un rapportconstant entre le visible et l'énonçable.
Pour ce faire, une première opération consiste à interroger le processus morbide à partir de raisonnementsconstruits selon des rapprochements analogiques où le semblable produit le semblable ou son contraire6. Il en est ainsilorsque le regard produit des maladies des yeux, lorsqu'unlézard à la peau granuleuse est supposé transmettre la lèpre,ou que certains gestes, comme celui de nouer, sont interdits àune femme enceinte de crainte d'une circulaire du cordon7...
Une seconde opération consiste à discriminer parmi lespathologies, les modalités de leur transmission. Visiblement,certaines « passent » rapidement des uns aux autres,d'autres sélectivement d'une personne à une seule autre,d'autres encore des parents aux enfants. Bref, si les termeslocaux désignant la « transmission » peuvent, bien sûr, icicomme ailleurs, apparaître dans de nombreux contextes8 , leprocessus de transmission est quant à lui toujours qualifié. Ilne s'agit donc pas d'un large usage métaphorique de lanotion de transmission, mais au contraire, une limitation de
6 Ces caractéristiques sont notamment analysées par Caprara (1991).
7 De nombreux exemple de ce type de contamination sont donnés parFamzang (1984l.
8 De même qu'en français on peut" transmettre» une lettre et une maladie, sans penser au postier comme à un vecteur ou à un « facteur derisque ". Nous renvoyons ici aux remarques déjà anciennes de Dujardin(1932), voir aussi à propos de la psychiatrie, les remarques de Goldstein(1984).
Conclusion 493
son sens: un usage contraint et restreint par les observations empiriques. Ces constructions sociales ou « abstractionsempiriques9 ", correspondent donc plutôt à d'incertainssavoirs en cours d'élaboration, qu'à un vaste domaine symbolique organisé par la prégnance massive d'un terme unifiantdes processus pathologiques divers, au gré des possiblesextensions sémantiques du signifiant « transmission ,,10.
Une troisième opération consiste à rendre compte de lasingularité des réponses individuelles face à la maladie.Comme nous l'évoquions précédemment - en l'absence desconcepts de terrain, de résistance immunitaire, d'acquisitiond'une immunité, de génétique, etc. - quelques notions commecelles de « vie », de « sang" ou « d'âme plus ou moins forte »
permettent de penser les variations individuelles face à despathologies qui se présentent comme semblablesll . Ellesménagent aussi un peu de jeu dans un système interprétatifpour qu'il puisse perdurer malgré ses échecs prédictifs.
Une nouvelle fois si l'on s'accorde sur ce qui précède,deux conclusions s'imposent.
Tout d'abord, la régularité de cet ensemble de conceptions des pathologies et des processus de leur transmissionpermet d'évoquer une sorte d'épistémé Ouest-Mricaine. Maispoursuivons, et envisageons cette question d'un point de vuede santé publique. Il apparaît alors des sortesd'allométries12, variables selon les pathologies (existence de
9 Nous ne pouvons iCI aborder la question du processus d'élaboration deces connaissances. Pour une perspective synthétique, nous renvoyonsaux remarques de Piaget (1979).
10 Une idée semblable est soutenue dans le domaine européen par Erhard(1957) : « Ainsi l'histoire de l'idée de contagion depuis ses premiers balbutiements apparaît-elle analogue à celle des autres concepts scientifiques empruntés au langage commun: au départ toute la richesse et laconfusion du concret, plus lourdes d'affectivité que de signification précise; au terme - au moins provisoire - de l'analyse, une notion rigoureusement définie et quasi abstraite ... "
11 De semblables remarques sont faites par Bernand (1983) : « Cettecontagion ne frappe pas de façon aveugle mais dépend de deux facteursessentiels. Il faut d'abord qu'il y ait un terrain propice: que la personnesoit une personne affaiblie, malheureuse, seule, infortunée... "
12 Les biologistes désignent par le terme d'allométrie des variations relatives des taux d'accroissement observables au cours du développementd'un organisme. A tout moment de sa croissance physique, un enfant,
494 Les maladies de passage
signes pathognomoniques, stabilité des signes cliniques oudisparition, etc.) entre les conceptions populaires de cesmaladies transmissibles et les connaissances et pratiquesmédicales. Par exemple, lorsque face à la rougeole médecinset populations s'accordent sur la reconnaissance des signes,l'identification du syndrome, et la contagiosité de la maladie,une action de santé publique, ou tout au moins un dialogue,est rapidement envisageable. Un savoir simple, vulgarisé,peut être rapidement et aisément partagé entre populationset équipes soignantes. Cette caractéristique est soulignée parChiara Alfiéri : « Les mères sont parfois en mesure de reconnaître la nature et la gravité de quelques toux pour lesquelles l'appellation traditionnelle coïncide en grande partieavec la catégorisation biomédicale. Il s'agit, par exemple, dela coqueluche ou « toux de trois mois ", kulukulu en bobo.Elle touche surtout les enfants et si ces derniers ne sont passoignés rapidement ils peuvent en mourir : « ça commenceavec la toux normale, ensuite l'enfant à le corps chaud, etparfois pendant la crise [convulsive] il tourne les yeux ".Cette connaissance préventive se manifeste surtout parmiles mères qui ont plusieurs enfants et qui ont recouru aumoins une fois à l'hôpital ou au dispensaire, ainsi certainessont-elles capables de formuler un diagnostic correct lorsd'une éventuelle expérience ultérieure ".
Obtenir cet accord autour d'une base interprétativecommune est parfois plus complexe, notamment lorsquel'expression d'une pathologie bactérienne dépend du sexe(cas du gonocoque), que sont impliquées des questions degénétique, ou lorsque des symptômes comme ceux du grandmal épileptique laissent évoquer une « crise de possession »
magico-religieuse. Selon les cas, diverses médiations sontindispensables pour que s'accordent des discours populaireset scientifiques plus ou moins hétérogènes.
Ensuite, d'un point de vue profane, le risque n'est défini ni par des fréquences objectives ni en corrélant des pathologies à des conduites, mais, très largement en fonction des
par exemple, se définit donc par l'ensemble de ces allométries, et non parla dimension qui croît le plus visiblement ou le plus fortement. Ainsi,quel que soit l'àge de l'enfant, la main et le pied sont toujours plusproches de leur taille définitive que ne le sont l'avant bras ou la jambe...
Conclusion 495
caractéristiques des individus. Pour les populations, il n'y apas d'égalité devant le mal, et prévenir ne peut strictementsignifier éviter la maladie, mais surtout espérer qu'elleépargne ceux qui ne seraient pas assez forts pour la supporter. Ceux dont après coup on pourrait détecter « l'âme tropfaible », Disons le simplement, les catégories locales de laprudence sont ainsi lucides et s'accordent à l'âpreté desconditions de vie. Elles ne peuvent espérer maîtriser tous lesdangers, ni surtout les éviter pour tous. Sans doute est-cepourquoi elles se limitent, plus modestement, à espérer protéger ceux qui ne seraient pas capables de les affronter.
Mais globalement, pour éviter le risque on pallie lepire et on évite certaines conduites, notamment d'irrespect,qui sont largement prohibées et supposées être sanctionnées,presque systématiquement, par la maladie et le malheur.Bref, là où la santé publique « cible» globalement desconduites à risque, les populations sont précautionneusesdes relations sociales: à la prévention sanitaire répond uneprudence sociale, notamment pour les plus faibles comme lesenfants ou les femmes enceintes. Comment, dès lors, donnerun contenu « scientifique» à cette conscience d'un risque corrélé aux âges et aux états du corps?
Un régulier « décrochage" entre lespratiques et lesdiscours
On a souvent insisté sur le rapport entre les conceptions locales de la contagion et un ensemble de pratiques quileur seraient liées et qu'attesteraient, notamment, diversesformes de ritualisations des conduites d'hygiène.
Pour les Alladian, d'abord, il ne s'agit pas seulementde l'acte de se laver, comme pratique d'hygiène, maisaussi, symboliquement, d'un véritable et réel acte de purification accompli au moyen de l'eau, élément qui est aucentre de la culture alladian. Deuxièmement, dans lalogique binaire du pur et de l'impur, le bain représente unmoment de transition, de passage, qui exige une attentionparticulière. (Caprara 2000 : 87)
Certes les gestes sont polysémiques, mais nos étudesnous obligent à nuancer l'importance accordée aux détermi-
496 Les maladies de passage
nations symboliques des conduites. Bien sûr, comme le souligne Chiara Alfiéri, certains produits sont souvent ajoutés àl'eau du bain. Bien sûr aussi, certaines pratiques d'hygiène,comme celles précédant les prières ou qui accompagnent desévènements comme les mariages ou les décès, peuvent êtrequalifiées de rituelles. Mais au quotidien - et comment pourrait-il en être autrement? -, la plupart du temps, le sens despratiques se limite aux gestes accomplis13 . Incontestablementces conduites sont répétitives dans leur rythme et régulièresdans leur gestuelle. Elles varient aussi historiquement etsont contraintes socialement (Goubert 1986 ; Vigarello 1985& 1993), mais leur sens n'est jamais hétéronome aux gesteseffectués. Contrairement à ce qui définit un rituel, aucunprincipe ni lois extérieures à la sphère de l'action effectuéen'en gouverne l'ordonnancement. Fort simplement, et qu'onnous excuse ici de rappeler cette banalité: sans crainte particulière, ici comme ailleurs, on se lave pour être propre, mêmesi l'on ajoute quelques « fortifiants » à son eau, et le plus souvent sans penser à se purifier: acte de distinction socialeplus que pratique symbolique.
Il en va de même pour la plupart des conduites quidans les discours sont désignées comme exposant à desrisques. On déambule sans se préoccuper des traces, oncontinue de fréquenter ceux qui sont malades, on utilise lesmêmes toilettes pour se laver. Bref, sauf événement exceptionnel, le quotidien se déroule dans l'indifférence auxrisques largement évoqués dans les entretiens, et une desprincipales caractéristiques du domaine constitué autour desnotions de transmission des maladies, est un constant décrochage des pratiques et discours. Plusieurs raisons expliquentcela.
- Tout d'abord une plus ou moins grande proximitéentre le locuteur et son dire fait, que dans bien des cas, lespropos relèvent plus d'une sorte d'acte social de partage depropos et de vagues croyances que d'une intime conviction.
Ceci est accentué par le fait que les notions de passage,de contagion et de contamination ne sont jamais d'absolues
13 C'est pourqUOI, on ne peut ici parler de « rite" sauf à utilIser ce termeau sens de Goffman comme une régulière interaction (1974),
Conclusion 497
certitudes. Au dire de tous, ce domaine sémantique, n'est pasinclus dans un régime de véridiction simple. Il se présente,par contre, comme toujours problématique. Bref, la transmission des maladies est une sphère du vraisemblable, pas del'entière conviction14. Et puis, pour le dire simplement, comment, concrètement éviter de franchir toute trace, de saluertout malade, d'utiliser les mêmes lieux d'aisance que d'autres?Et puis encore, que faire des contre-exemples que constituentceux qui ne respectent pas les interdits mais ne sont pas nonplus malades? Ce que les observations de FatoumataOuatara confirment:
Mais en réalité, il arrive souvent que certaines personnes continuent à manger ou à boire dans le même récipient avec un épileptique, un lépreux, un tuberculeux ouune personne souffrant de méningite. Et s'il existe bien lacrainte d'attraper la maladie en approchant le malade, oncraint aussi de le choquer en s'éloignant de lui.
- La deuxième raison est que, dans ce domaine plusencore qu'ailleurs, l'ordre pragmatique ne correspond pas àun rapport de détermination d'une conduite par une représentation. Il résulte plutôt de tractations et de négociationsentre plusieurs systèmes de contraintes. Il découle de laconfrontation entre diverses obligations sociales. Mais précisons, grâce à quelques exemples simples, quelques-unes deces configurations adverses qui déterminent des conduites.
Un premier domaine correspond au croisement descraintes et des obligations: même conscient d'un risque comment ne pas, littéralement, compatir à la souffrance de sesproches, comment ne pas accepter de s'exposer à la maladiesi l'on doit accompagner un parent à l'hôpital? Comment nepas honorer ses obligations religieuses en effectuant sur lecadavre les dernières ablutions?
14 Cf. Schmitt (2001 : 96) .. .l'analyse des modalités du croire et de sa production fait ressortir des analogies avec notre époque et révèle le cadred'une problématique de la croyance en général : les termes principauxen sont la plasticité de la croyance et de la vérité elle-même, la dialectique entre croyance individuelle et croyance collective, le rapport entrela dimension intérieur et " psychologique" et les manifestationsrituelles et publiques du croire, les usages et les manipulations possibles de la crédulité.
498 Les maladies de passage
Un second domaine est celui qui notamment, face à uncorps malade ou certaines pathologies comme la lèpre ou l'épilepsie, oppose parfois les répulsions physiques à un vouloirsocialement construit et contraint. On veut faire ce que l'on doit,mais le corps se dérobe. Qu'il suffise ici de souligner ce que nousprésente Sophie Arborio à propos de l'epilepsie : « Sentiments decrainte et de dégoût se mêlent alors, entraînant une intoléranceà l'égard de la personne en crise. En effet, l'émission de bavemoussante, voire d'urine, renvoie à un manque de contrôle de lapersonne sur ces matières considérées sales ».
En ces hésitations et ces gestes, « la vie se saisit à travers l'usage que les hommes font de l'oreille, de l'œil, de labouche, de la main, du nez» (Mettra & Le Goff 1975), et lesconduites de soins ou d'évitement, composent, selon la proximité affective des malades, des compromis variables entreprise en charge, risques consentis et répulsion maîtrisée.Cette anthropologie des « sensorialités », et des sensibilités,révèle que les conduites des acteurs correspondent autant àd'involontaires mouvements du corps, comme la fuite et ledégoût devant certains symptômes, qu'au respect de normessociales idéales15 ...
Bref, les comportements des populations résultent plusdes choix opérés entre diverses obligations, selon une casuistique des choix conflictuels, que d'un rapport simple dedétermination des actes par quelques discours. Plus qu'une« profondeur» des représentations expliquant des conduites,des sortes de vicinalités de normes conflictuelles obligentl'acteur social à effectuer des choix souvent contradictoires lB.
Illustrons cela en soulignant ce que décrit François Enten :
15 Soulignons que cette anthropologie qui pourrait prendre commemodèles théoriques ceux proposés par des historiens comme Corbin(1982, 2001) et s'attacher à décrire le rapport aux sentiments auxodeurs, au paysage, etc. reste à construire pour L'Mrique.
16 Qu'il suffise de rappeler le conflit entre déclarer une hypertension et ladissimuler pour être épousée, prenant ainsi le risque d'un accouchement socialement indispensable mais sanitairement dangereux, destratégies matrimoniales qui obligent à ne pas utiliser de préservatifs,etc. Nulle représentation de la maladie à l'origine de ces conduites àrisque, mais des systèmes de contraintes contradictoires (entre statutsocial et risques sanitaires) vécues conjointement.
Conclusion 499
On balaie parfois jusqu'au centre de la rue, les voisinsd'en face nettoient alors l'autre moitié. Sinon, on s'arrêtesouvent à un léger changement de relief du sol (passagedu sable à la latérite) ou passage du sable au goudron. Cedernier marquant concrètement des frontières symboliques avec un territoire à la charge de la municipalité.
Comme on est loin ici des emboîtements simplistesentre connaissances, attitudes, pratiques mis en valeur parles fameuses enquêtes CAP !
- Enfin, une dernière raison du « décrochage » entreles discours et les actes provient de la diversité des sphèressociales qui peuvent être concernées et traversées par uneaction sanitaire supposée homogène par ses initiateurs. Fortsimplement - et c'est retrouver ainsi la diversité voulue desarticles qui composent ce livre - proposer à un seul maladede modifier des conduites dangereuses pour les siens, n'engage pas les mêmes contraintes que s'il faut modifier toute unehygiène familiale ou, plus encore, celle d'une collectivité. Lesmêmes mots et les mêmes discours ne désignent ni lesmêmes actes, ni les mêmes acteurs. Ils subsument des pratiques effectuées de manière autonome par un seul individujusqu'aux conduites de divers ensembles humains bardés decontraintes économiques et politiques.
Bref, les notions de transmission et les conduites préventives afférentes à ce terme n'ont pas de contenus sémantiques ou comportementaux stables. Elles ne prennent sensqu'en fonction du contexte. Plus théoriquement dit: elles secomportent comme des concepts dispositionnels17, et il faudrait donc être bien naïf ou « mécaniste» pour croire que l'onpeut relier de manière invariante un ensemble de discoursportant sur les craintes ressenties et les prudences avec lesconduites réellement mises en œuvre. En ce domaine, plusqu'une structure comportementale rigide, les conceptionspopulaires correspondent à un stock lexical, une sorte de
17 Les concepts dispositionnels sont des concepts qui, comme « fragile ",« malléable ", « soluble dans l'eau ", « collérique », « courageux ", etc.décrivent la propension qu'à une chose ou un être quelconque à réagirou à se comporter d'une façon déterminée dans certaines circonstances.(Bouveresse 1998). Nous renvoyons aussi sur cette question à Popper(980).
500 Les maladies de passage
matrice cognitive offrant aux acteurs la possibilité d'uneréflexion ouverte sur le choix d'actions adaptées auxcontraintes des situations rencontrées.
C'est pourquoi, en termes d'action de santé, il fautcertes apporter de nouvelles connaissances. Mais ce sont surtout les conditions concrètes - économiques, légales, etc. qui motivent les choix des populations qu'il faut modifier, enapportant des solutions plus qu'en ajoutant des mots nouveaux à d'autres plus anciens, sous la forme d'une logorrhéeéducative parfois nommée « sensibilisation ». Ce que soulignefortement François Enten dans son texte en affirmant que« les vrais enjeux pour l'amélioration des conditions del'environnement urbain, sont d'ordre institutionnel et politique et non pas pédagogique ou éducatif'».
Liens sociaux, risques, prudenceset préventions
Prenons au sérieux le terme de « risques ressentis ».
Ils ne se limitent pas, loin de là, à ce qu'évoque sous ces motsla santé publique: une sorte de préoccupation sanitaire,encore confuse, des populations. Hors d'un strict domainemédical, ce terme ouvre, au contraire, sur ce que sont lesstructures du vraisemblable dans ces diverses sociétés, etrévèle quelques formes des liens sociaux en Afrique del'Ouest. Nous nous bornerons à les qualifier brièvement.
Il s'agit, tout d'abord, des traces d'une psychologienormale. Dans ces groupes d'interconnaissance, chacun peuou prou subit et envie ses voisins, et désire leurs avoirsautant qu'il craint leur courroux. Parfaite situation pour quetrouve à s'exprimer une des dimensions essentielles etbanales d'une psychologie où le rapport à l'autre se joueselon les lois des relations imaginaires: ce que l'on éprouvepour l'autre fait retour comme ce que l'on suppose que cetautre éprouve pour soi 18. Dans ces contextes où l'intimité esttoujours précaire, l'indifférence aux autres est impossible, et
18 «L'expérience subjective doit être habilitée de plein droit à reconnaîtrele nœud central de l'agressivité ambivalente, que notre moment culturel nous donne sous l'espèce dominante du ressentiment, jusque dansses plus archaiques aspects chez l'enfant. »{Lacan 1966).
Conclusion 501
tout geste ou regard, peut éventuellement signifier unrisque. La transmission, et plus encore les craintes d'unetransmission, témoignent ainsi des difficultés de la coexistence sociale, et révèlent, notamment, la complexité des lienset des pouvoirs régissant les relations entre les genres ouentre les aînés et les cadets.
Les conceptions populaires débordent ainsi le systèmemédical. On anticipe peu des risques précis par des préventions adaptées, mais on met en œuvre, par contre, de multiples prudences sociales pour protéger sa santé19.
Pour conclure: « donner la parole à ", malgré tout...
De tout ce qui précède, une conclusion s'impose. EnAfrique de l'Ouest comme ailleurs, hors certains contextesprécis, le risque, n'est ni nécessaire ni valorisé, mais il n'estpas toujours évitable puisqu'il faut sans doute être richepour être pusillanime ... C'est peut-être cela qui se dissimulesous les mots et les chiffres. Plus que de grandes constructions symboliques, en filigrane, ces conceptions populaires dela transmission disent l'inquiétude et une volonté désemparée de maîtriser la douleur et la maladie. Elles soulignentainsi la violence qui s'exerce sur des vies fragiles, et la précarité des prises en charge sanitaires.
Cette violence est diverse. Elle inclut tout d'abordl'ensemble de la vie. Comme le souligne Patrice Bourdelais,la mise en œuvre des politiques de santé publique est d'abordcontrariée par « les conditions de travail faites aux plus nombreux », « le régime de la propriété» et enfin le fait que « deschangements d'attitude profonds à l'égard du corps supposent qu'un certain seuil de niveau de vie soit atteint tant ilest vrai que toute norme de comportement hygiènique nepeut être adoptée par les personnes dont le premier soucidemeure de trouver un toit et de la nourriture» (2001 : 26).C'est aussi, au plus simple de la vie, ce qu'indique Chiara
19 Cette idée est aussi soulignée par Fainzang (1992) : « L'acte qui consisteà penser la prévention revient donc en grande partie, dans descontextes culturels variés, à penser le rapport que l'on entretient avecl'Autre, ou les autres. »
502 Les maladies de passage
Alfiéri «en matière d'hygiène, il y a des conditions objectives qui ne permettent ni d'effectuer certaines pratiqueshygiéniques, ni d'activer les modalités de la prévention ditetraditionnelle. La pauvreté extrême d'une grande partie dela population, aggravée par la dévaluation de la monnaie,implique que cette population est dépourvue de vêtementssuffisants pour se protéger du froid. Si l'on ajoute la carencestructurelle de puits, de fontaines et de robinets, on comprend bien la difficulté de mettre en œuvre les conseils pourappliquer les mesures d'hygiène, au sens biomédical duterme, les plus élémentaires ».
Mais cette injustice est aussi celle des actions de santéelles-mêmes, qui sous couvert d'actions sanitaires tissent desliens de domination. Pour ne prendre qu'un exemple, « l'Irandu temps du Shah, est passé de l'influence française àl'influence américaine en changeant de vaccins » (Moulin1996: 31).
Enfin que dire des inégalités où le sida récapitule tousces travers, allant des inégalités politiques et économiquesaux iniquités éthiques et où, à l'instar du vaccin contrel'hépatite B qui fût expérimenté au Sénégal pour servir prioritairement à protéger les personnels de santé d'Europe, « lesvolontaires des essais expérimentaux du vaccin contre le sidavont se situer en Afrique et en Asie, et les véritables bénéficiaires seront dans les pays développés » (Moulin ibid.).
Devenir acteur de sa santé n'est donc pas qu'affaire deparole et l'anthropologie semble parfois bien éthérée face à cequi contraint les choix des acteurs et des sociétés: les dimensions sociales et politiques de la gestion des épidémies2o.
C'est pourquoi, pour analyser ces mouvements de l'histoire et leurs effets, il importe de positionner autrementl'anthropologie de la santé. Lui donner comme objet « plutôtque de se focaliser sur une critique de la médicalisation ou del'hégémonie planétaire de la biomédecine, d'en constater au
20 Pour une approche articulant des données épidémiologiques, historiques et sociolOgIques autour de cette question de la contagion, nousrenvoyons à l'ouvrage très complet de Bardet, Bourdelais, Guillaume,Lebrun, Quetel (1988) amsi qu'à l'article inaugural de Ackernecht(1948).
Conclusion 503
contraire l'inégale distribution » (Dozon & Fassin 200nCertes, et pour cela il faut aussi comprendre et agir au plusprécis. Il faut aussi donner aux uns soignés, et aux autressoignants, les moyens d'agir. Bref il importe de ne pas seulement « parler de » mais aussi « de donner la parole à » ceuxque l'on écoute si peu et si mal dans les centres de santé, ceque Marc Egrot et Bernard Taverne soulignent fortement :« Les stratégies de communication se limitent alors à larépétition d'informations biomédicales simplifiées, comme sila seule vertu de cette répétition devait suffire à convaincreles auditeurs de leur justesse. Les savoirs populaires sontconsidérés comme des « fausses croyances » et la rationalitédes comportements des personnes par rapport à ces savoirsest évacuée ».
En regard, il est non moins indispensable d'habituerles autres, professionnels de santé, à entendre ces conceptions profanes et leurs harmoniques de malheurs sociaux.Dans ce cadre, décrire est donc un préalable pour donner dusens à des conduites populaires, pour souligner les mots quiaccompagnent les plus humbles des pratiques de soin et deprévention, et pour ainsi éclairer les uns et les autres surleurs modes de compréhension et leurs raisons d'agir. « Rêvemodeste et fou », c'est espérer que l'anthropologie puisseaider à initier un dialogue entre soignants et populations,voire stimuler la mise en place d'utiles contre-pouvoirs. Plusque craindre un indispensable et bénéfique déploiement dusavoir et des pratiques médicales, ouvrir la relation thérapeutique à un dialogue plus humain.
Remerciements: Nous remercions Jacques Cheyronnaudqui nous a aimablement confié sa bibliographie sur cettequestion.
Bibliographie
Ackerknecht E. H.1948 « Anticontagiosm between 1821 and 1867 >', Bulletin of
Hystory ofMedicine, vol XXII: 562-593.
Bardet J.-P., Bourdelais P., Guillaume P., Lebrun F., QUETEL C.(sous la dir,), 1988, Peurs et terreurs face à la contagion.
504 Les maladies de passage
Choléra, tuberculose, syphilis, XIXe-XXe siècle, Paris,Fayard.
Benoist J.2001 « Perspectives en guise de clôture, in Systèmes et poli
tiques de santé ", Hours B. (sous la direction), Paris,Karthala Médecines du Monde, 345-354.
Bernand C.1983 « Idées de contagion dans les représentations et les pra
tiques andines ", LACITO-CNRS, Bull d'Ethnomédecine,Mars: 3-18.
Bourdelais P.2001 (sous la dir.l Les Hygiénistes, enjeux, modèles et pratiques,
Paris, Belin.
Bouveresse J.1998 Le philosophe et le réel, Entretiens avec Jean Jacques
Rosat, Paris, Hachette.
Caprara A.1991 « La contagion. Conceptions et pratiques dans la société
alliadan de Côte-d'Ivoire ", Anthropologie et Société, vol.15, nO 2-3 : 189-203.
2000 Transmettre la maladie. ReprésentatIOns de la contagionchez les Alladian de la Côte d'IvoIre, Paris, Karthala,Médecines du Monde.
Corbin A.1982 Le miasme et la jonquille, l'odorat et l'imaginaire social
XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Aubier.2001 L'homme dans le paysage, Paris, Textuel.
Dozon J.-P., Fassin D.2001 (sous la dir.), Critique de la santé publique, Une approche
anthropologique, Paris, Balland.
Dujardin E.1932 Le facteur de risques sonne toujours trois fois, Saint
Tugdual, Fondation Universitaire des PTT Armoricaines.
Ehrard J.1957 «La peste et l'idée de contagion", Annales nO] : 46-59.
Conclusion 505
Fainzang S.1984 « La théorie de la contamination chez les Bisa de Haute
Volta ", Bull. d'Ethnomédecine, Mars, n° 29 : 3-20.1992 « Réflexions anthropologiques sur la notion de prévention ",
in Comportements et Santé. Questions pour la prévention(P. Aïach, N. Bon & J.P. Deschamps éds.), PressesUniversitaires de Nancy: 18-27.
Goffman E.1974 (pour la trad. française) Les rites d'interaction, Paris
Editions de Minuits.
Goldstein J.1984 « Moral Contagion" : A professional ideology of medicine
and psychiatry in eighteenth- and nineteenth-centuryFrance, in Geison G.L. (éd.), Professions and the FrenchState 1700-1900, Philadelphia, University of PennsylvaniaPress: 181-222.
Goubert J.-P.1986 La conquête de l'eau, Paris, Robert Laffont.
GrmekM. D.1984 Les vicissitudes des notions d'infection, de contagion et de
germe dans la médecine antique, in Textes MédicauxLatins Antiques (articles réunis et édités par Sabbah G.),Publications de l'Université de Saint-Etienne: 53-70.
Jaffré Y.1999
Lacan J.1966
« La visibilité des maladies des yeux ", in Jaffré Y. &Olivier de Sardan (éds) La construction sociale des maladies, les entités nosologiques populaires en Afrique del'Ouest, Paris, PUF : 337-357.
L'agressivité en psychanalyse, in Ecrits, Paris, Eds. duSeuil.
Marin L.1990 « L'efficace de l'image religieuse: de la relique à l'image ",
Chimère, n° 10 : 103-119.Mettra C., Le Goff J.1975 (pour la réédition), « Préface à Huizinga J. ", L'automne
du Moyen Age, Paris, Payot : I-X.
506 Les maladies de passage
Moulin A.-M.1996 (sous la dir.), L'aventure de la vaccination, Paris, Fayard.
Olivier de Sardan J.-P.1999 « Les représentations des maladies: des modules? », in
Jaffré Y. & Olivier de Sardan (édsJ, La construction sociale des maladies, les entités nosologiques populaires enAfrique de l'Ouest, Paris, PUF : 15-40.
Piaget C.1979 « La psychogenèse des connaissances et sa signification
épistémologique ", in Théorie du langage, Théories del'apprentissage, Le dialogue entre Jean Piaget et NoamChomsky, Piattelli-Palmarini (éd.J, Paris, Le Seuil: 53-90.
Popper K.R.1980 La démarcation entre la science et la métaphysique, in De
Vienne à Cambridge, Jacob P. (Sous la dir. de), Paris,Gallimard: 131-213.
Schmitt J.-C.2001 Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d'anthropolo
gie médIévale, Paris, Gallimard
Vigarello G.1985 Le propre et le sale, l'hygIène du corps depUIS le Moyen
Age, Paris, Eds. du Seuil.1993 Le sain et le malsain, santé et mieux être depuis le Moyen
Age, Paris, Eds. du Seuil.
Présentation des Auteurs
• Alfieri Chiarra. Assistante en ethnologie à la Faculté deLettres Modernes et de Philosophie de l'Université deGênes (Italie).
• Arborio Sophie. Docteur en anthropologie, actuellementChercheur associé à la Harvard Medical School,Department of Social Medicine (Boston, USA).
• Bonnet Doris. Directeur de recherche en anthropologie àl'Institut de Recherche pour le Développement, membredu Centre d'Etudes Africaines ŒHESS-CNRS) à Paris(France).
• Chilliot Laurent. Doctorant à l'EHESS Marseille(France).
• Dagobi Elhadji Abdoua. Doctorant en anthropologie, chercheur au Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur lesDynamiques Sociales et le Dévelopement Local (LASDEL)à Niamey (Niger).
• Diallo Yveline. Ingénieur de Recherches à l'IRD (UR 002DSS) Marseille (France).
• Duchesne Véronique. Docteur en anthropologie, membrede l'UPRES-A, EPHE-CNRS « Systèmes de Pensée enAfrique Noire» à Ivry (France).
• Egrot Marc. Docteur en médecine et Docteur en anthropologie. Chercheur au LEHA à Aix-en-Provence (France).
• Enten François. Doctorant à l'EHESS Marseille,Technicien sanitaire en Ethiopie pour Médecins SansFrontières (Suisse).
• Jaffré Yannick. Docteur en anthropologie, Chercheur auSHADYC ŒHESS-CNRS) à Marseille (France).
• Koné Yaouaga Félix. Docteur en anthropologie etChercheur à l'ISH à Bamako (Mali).
• Le Marcis Frédéric. Docteur en anthropologie, actuellement post-doctorant à l'Agence Nationale de Recherche surle Sida (ANRS) en poste à Johannesburg (Afrique du sud).
508 Les maladies de passage
• Moumouni Adamou, Doctorant en anthropologie,Chercheur au Laboratoire d'Etudes et de Recherches surles Dynamiques Sociales et le Dévelopement Local (LASDEL) à Niamey (Niger).
• Ouattara Fatoumata, Docteur en anthropologie, chercheur associé au SHADYC (EHESS-CNRS) à Marseille(France), actuellement post-doctorante à l'AgenceNationale de Recherche sur le Sida.
• Soubeiga André. Maître de conférence en anthropologie àla Faculté des lettres de Ouagadougou (Burkina Faso).
• Souley Aboubacar. Socio-anthropologue, doctorant(EHESS) au SHADYC à Marseille (France), chercheur auLASDEL à Niamey (Niger).
• Taverne Bernard. Ethnologue, médecin, chargé derecherche à l'Institut de Recherche pour leDéveloppement, Unité de recherche 36 « Prise en chargedu sida en Afrique ", actuellement en poste à Dakar(Sénégal).
• Tinta Sidiki. Docteur en anthropologie à Bamako (Mali).
Table des matières
Introduction: Transmissions, préventions et hygiènes en Afriquede l'Ouest, une question anthropologique. Doris Bonnet. . . . .. 5
Première partieDes notions de transmission aux conduites préventives
Chapitre 1: Transmissions, prudences et préventionsen pays mande. Yannick Jaffré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29
Chapitre Il : Maladies héréditaires et maladies du contacten milieu hausa (Niger). Aboubacar Souley . . . . . . . . . . . . .. 61
Chapitre III : Les conceptions de la transmission} de la contagionet de la prévention de la maladie en milieu dogon (Mali).Sidiki Tinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77
Chapitre IV : Conceptions populaires soso de la transmissiondes maladies et pratiques de prévention en Guinée Maritime.Yveline Diallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101
Chapitre V : Modes de transmission de la maladie en milieusonghay-zarma [Niger). Adamou Moumouni 131
Chapitre VI : Les maladies transmissibles chez les Senufodu Mali. Yaouaga Félix Koné 147
Deuxième partieTransmissions et préventions au regard de quelques
maladies
Chapitre VII: Connaissances populaires et pratiques de préventiondes infections respiratoires aiguës (IRA) infantiles en populationbobo (Burkina Faso). Chiara Alfieri 163
510 Les maladies de passage
Chapitre VIII: Fluides, transmission et filiation. Les « maladiesdes femmes» dans une société matrilinéaire ivoirienne.Véronique Duchesne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 199
Chapitre IX : La transmission des maladies sexuelles chezles Mossi. Rencontre des catégories nosologiques populaireset biomédicales dans le champ de la santé publique(Burkina Faso). Marc Egrot et Bernard Taverne 221
Chapitre X : La transmission de kirikirimasien en milieu bambaraau Mali: une variation des savoirs et des pratiques autourde « l'épilepsie» Sophie Arborio 253
Chapitre XI : Les conceptions populaires moose de la méningite(Burkina Faso). André Soubeiga 279
Chapitre XII : La gestion locale des épidémies dans la valléedu fleuve Niger. Abdoua E/hadj Dagobi 295
Chapitre XIII: Prévention et contagion des maladies animalesen milieu peul. Frédéric Le Marcis 31 1
Troisième partieHygiènes et pratiques de prévention
Chapitre XIV: Anthropologie et hygiène hospitalière.Yannick Jaffré .. . 341
Chapitre XV : L'hygiène et les pratiques populaires de propreté.Le cas de la collecte des déchets à Thiès (Sénégal).François Enten 375
Chapitre XVI: Transmission des maladies et gestion de la saletéen milieu rural senufo (Burkina Faso). Fatoumata Ouattara ... 403
Chapitre XVII: Médicaments et prévention en milieu populairesonghay-zarma (Niger). Laurent Chi/liot 427
Chapitre XVIII: La prévention dans la modernité sanitaire dogon(Mali). Sidiki Tinta 465
Conclusion: Transmission, prévention et hygiène en Afriquede l'Ouest, une question anthropologique de santé publique.Yannick Jaffré 484
Présentation des auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
La collection Médecines du monde
Allaitement et VIH en Afrique de l'Ouest. De l'anthropologieà la santé publique.Sous la direction d'Alice Desclaux et Bernard Taverne,556 p.
Anthropologie et sida.Sous la direction de Jean Benoist, 380 p.
Convocations thérapeutiques du sacré.Raymond Massé et Jean Benoist, 496 p.
Femmes d'Abidjan face au sida.Judith Hassoun, 208 p.
Le mauvais œil de la lune.Ethnomédecine créole en Amérique du Sud.Odina Sturzenegger, 304 p.
Mères, pouvoirs et santé en Haïti.Johanne Tremblay, 216 p.
Sida en Haïti. La victime accusée.Paul Former, 416 p.
Soigner au pluriel. Essai sur le pluralisme médical.Sous la direction de Jean Benoist, 520 p.
Systèmes et politiques de santé. De la santé publiqueà l'anthropologie.Bernard Hours, 360 p.
Transmettre la maladie.Andrea Caprara, 216 p.
Achevé d'Impnmer en mal 2003sur les presses de la Nouvelle Imprimene Laballery
58500 ClamecyDépôt légal: mai 2003
Numéro d'impression: 305022
Imprimé en Fral1ce
Dix sept contributions étudient, du Sénégal au Niger,les notions de transmission , J 'hygiène et les
co nduites préventives. Les auteurs montrent les liensentre les idées d 'impureté , de force vitale, et lesreprésentations du corps et de son fonctio nne ment.Analyses ethnolinguistiques et donnée s empiriquesmettent au jour une th éori e po pulaire des contacts oùl'autre est perc,;u COml11\.: po tentielleme nt dangere ux. Laprévention de la maladie est alors constru ite sur lemode d'urie maîtrise de s liens sociaux, Ces interprétation s dl' la transmission permettent de co mprendre lalogique de s r ègles de pruden ce et d ' évitement, les anirudes de stigmatisation ou de so llicitude :1l'égard dema lade s.
En introduisant la parole des acte urs, l'anthropologiede la santé permet de compre nd re la complexité desrappo rts entre les représent ation s et co nd uites localeset les connaissances et propositions sanitaires mod ernes. Elle fournit aux équipes de Santé Publique desou tils indispensables ~l la co mpré he nsio n des po pula tions auxque lles e lles s'ad ressent.
Doris Bonnet, antbropok .gu « à l 'Inst itu t cfe rccbcrcb c pour
le dc;['ef()PjJull lU//I, m ètu: act uellement des rech erches su r III
dr«1){/l I()C)'I()Se el la representation de {li g l/( ;ri.\"() /1 C'/1 Ill' de
France da ns les population s im mignies d 'Afriqrt« subsabartcnnc. liik : est I/ /(}/II /;r e assoct éo du Cel/ Ire d 'Entetes
Africaines ( IHI;S~')
Yan n icl: ./lI!/i 'u l'si (lII tbrn/ )()loglle el ancien maitre de
co nférences il l Unircrsitc dl' Ba malso . Apri« .zn 1IliS de tm
uail l' I l autbropologi« dl' la su n t« en. "Vi-il/ Il e dl' l'Oues t, i/ est
I//I'I///;re de l'l;llltijJl' dl' recbcrcbe Soctoloyic. Histoire et
A l l thml)()I(),~ù' des D yna miques cu lturelles (.I [m:çeil/e j ct
cherchell r a ssocii: li [ '( "R sucio-anth rnpolog ù- de III s(JI//( ; de
l'iRD
Collection Médecines du MondelVltnror-ologle comparée de la nalddre
dirigée parJea ., BenoIst
111/ 11 1111111111 11 11111 11111119 782845 8637 29