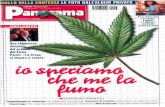Les gastéropodes pleurotomaires. 2 : panorama des espèces du Bajocien normand
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Les gastéropodes pleurotomaires. 2 : panorama des espèces du Bajocien normand
23
La Normandie au Bajocien
Le Bajocien est un étage du Jurassique moyen dont lessédiments, souvent richement fossilifères, sont largementreprésentés à l’échelle européenne. En France, les sériesbajociennes sont bien exposées dans la plupart des régions, etparticulièrement sur les pourtours des Bassins aquitain etanglo-parisien : la Normandie fait partie des auréoles les plusoccidentales de ce dernier, cette région étant particulièrementréputée pour sa richesse en fossiles remarquablementconservés ; si les ammonites constituent le groupe le plusdiversifié, tous les taxons zoologiques y sont représentés,notamment les gastéropodes et, parmi eux, les pleurotomaires,dont les représentants, nombreux et parfois spectaculaires, ontété remarqués dès l’orée du 19e siècle (Gerville, 1814, 1817 ;Caumont, 1828 ; Hérault, 1832 ; J.-A. Eudes-Deslongchamps,1838, 1848 ; d’Orbigny, 1852 ; E. Eudes-Deslongchamps,1865 ; Munier-Chalmas, 1892...).
Pendant l’Aalénien-Bajocien, les faunes d’ammonitesconnaissent d’importants bouleversements corrélés avec unepériode de bas niveau marin, suivie d’une phase transgressive :radiation des superfamilles Haploceratoidea (Sonniniidae) etStephanoceratoidea (Otoitidae, Stephanoceratidae), à partir desderniers Hammatoceratoidea (Hammatoceratidae, Erycitidae,Graphoceratidae) ; quasi-extinction des Stephanoceratidae(hors Cadomitinae), “synchrone” d’une radiation dePerisphinctoidea (Parkinsoniidae, Perisphinctidae) et del’apparition des Spiroceratoidea (Spiroceratidae). Au Bajociensupérieur, la Téthys (océan dont l’actuelle Normandie est
en marge de la bordure nord) reste largement ouverte sur leGondwana, ce qui est souligné par la vaste distribution deformes comme Subcollina lucretia (D’ORBIGNY 1847) ouParastrenoceras caumontii (D’ORB. 1842).
Le Bajocien : cet étage du Jurassique moyen a une duréeestimée à 4 à 5 millions d’années (-173 Ma à -166,1 – Harland,1990 in Cariou & Hantzpergues, 1997), a été défini pard’Orbigny (1849) à partir d’un affleurement d’une carrièreouverte près de Bayeux (Bajoce en latin – Calvados, France),aujourd’hui abandonnée et recouverte par la végétation. Cet étage correspond alors à l’ “Oolithe inférieure” deConybeare & Phillips (1822) ; ses limites d’alors coïncidaientrespectivement à la base de la Zone à Murchisonae (Aalénienactuel), et à la base de la Zone à Progracilis (Bathonien actuel).Peu après, d’Orbigny (1852) considère que le début de “son”étage jurassique coïncide avec la base de l’actuelle Zone àHumphriesianum.
D’Orbigny avait malencontreusement attribué des espècesd’ammonites du Toarcien au Bajocien et inversement ; cetteconfusion a induit la création de l’étage Aalénien par Mayer-Eymar (1864) pour la partie la plus basale du Bajocien. A la findu 19e siècle, Munier-Chalmas (1892) et Bigot (1882)proposent de ramener la limite supérieure du Bajocien à la finde l’actuelle Zone à Parkinsoni.
En Basse-Normandie : dans la région, le Bajocien esttraditionnellement “couvert” par trois formations (Dugué et al.,1997 ; Rioult, 1980 ; et notices cartes géologiques) : Oolitheferrugineuse de la Malière pars. (Bajocien moyen ancien),Oolithe ferrugineuse de Bayeux (fin du Bajocien inférieur -Bajocien supérieur pars.) et Calcaires à Spongiaires (fin duBajocien supérieur).
• L’Oolithe ferrugineuse de la Malière garde une épaisseuret un faciès constants dans le Bessin, mais elle s’amincit et
Les gastéropodes pleurotomaires2 : panorama des espèces du Bajocien normand
Philippe COURVILLE (a) & Patrice LEBRUN (b)
Contributions de Pierre-Yves BOURSICOT (c) et Patrick CATTO (d)
Fossiles, n°15
Gastropod pleurotomariid. Part 2: Species from the Bajocian of Normandy. - Abstract: In Normandy, pleurotomariids are abundant in the middleJurassic, particularly in the Bajocian strata. In the mid-19th century, these gastropods attracted the curiosity of two eminent naturalists, J.-A. Eudes-Deslongchamps and A. d’Orbigny, who published some of their most famous studies. More than 150 years after these pioneering works, the Bajocianpleurotomariids of Normandy still fascinate fossil collectors, probably because of their beautiful preservation, their important taxonomical diversity and theenormous sizes of some specimens.
Today, if various genus names are available to classify the numerous species and ‘varieties’ described by Eudes-Deslongchamps, d’Orbigny, and theirsuccessors (such as Pleurotomaria, Anodomaria, Bathrotomaria, Cyclostomaria, Laevitomaria, Leptomaria, Obornella, Pygotrochus, Stuorella, andTalantodiscus) most of the pleurotomariids of the Jurassic of Normandy are difficult to place in this taxonomic subdivision without a complete revision ofthese invertebrates and a re-examination of the ‘limits’ of every genus (considering that some have a stratigraphical range that exceeds more than 100 m.y.). For this overview we used only the genus Pleurotomaria in a rather broad sense, with the exception of the relatively homogenous group of smallpleurotomariids characterised by a discoid and low shell and belonging to the informal ‘obornelles’.
Keywords: Gastropoda, Pleurotomariidae, Pleurotomaria, Obornella, middle Jurassic, Bajocian, Normandy.
[a] Université de Rennes 1, Géosciences Rennes UMR 6118, 263, avenueGénéral Leclerc, 35042 Rennes cedex – [email protected]
[b] 52B, rue Victor Hugo, 93500 Pantin – [email protected][c] 14, rue Johannes, 49450 Villedieu-la-Blouère – [email protected][d] 3B, rue Général De Gaulle, 35470 Bain-de-Bretagne
Les pleurotomaires du Bajocien normand sont parmi les gastéropodes les plus recherchés dans les horizons duJurassique, probablement en raison de leur excellente préservation, de leur importante diversité et leurs dimensionsparfois exceptionnelles. Dès le milieu du 19e siècle, alors que la paléontologie des invertébrés est à peine naissante,
elles font l’objet d’importantes études par deux éminents naturalistes, le Normand Jacques-Armand Eudes-Deslongchamps (1794-1867) et le Breton Alcide Dessalines d’Orbigny (1802-1857). Dans une “course contre-la-montre”, ils tentent de publier au plus tôt leurs résultats, entraînant une multiplication des taxons et une certaineconfusion dans la désignation de nombreuses espèces et “variétés”. Depuis, ces pleurotomaires n’ont jamais réellementfait l’objet d’une révision qui prendrait en compte l’ensemble des espèces récoltées depuis plus de 150 ans.
Bien qu’une telle étude se fasse attendre, cette seconde partie consacrée aux gastéropodes pleurotomaires ne peutnaturellement la remplacer, notamment en raison des imprécisions stratigraphiques qui entachent la quasi-totalité desspécimens que nous avons pu rassembler. Toutefois, ce panorama permettra de se familiariser avec l’étonnante diversitédes taxons du Bajocien normand et de donner des pistes pour une meilleure connaissance taxonomique etphylogénétique de cette famille dont des représentants vivent encore dans les eaux de nos océans.
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:53 Page23
Jusqu’au début des années 1980, le Bajocien est traditionnellementsubdivisé en trois sous-étages : Bajocien inférieur, moyen et
supérieur. Par la suite, la Zone à Humphriesianum (c’est-à-dire leBajocien moyen) est incluse dans le Bajocien inférieur, puisque leschangements fauniques majeurs (disparition des Stephanoceratidae /apparition des Perisphinctoidea) est situé à la fin de celle-ci. C’est cette “classification” (cf. détails in Cariou & Hantzpergue, 1997 etfigure ci-contre) qui est utilisée dans cet article.
En 1962, lors du Colloque du Jurassique à Luxembourg, l’étageBajocien est défini comme s’étendant de la base de la Zone à Sowerbyiau sommet de celle à Parkinsoni. Westermann & Riccardi (1972) ayantmontré que l’holotype de Sonninia sowerbyi (MILLER in SOWERBY 1818)correspondait au nucléus d’un grand Sonniniidae Papilliceras de laZone à Sauzei, sus-jacente, la limite inférieure de cet étage est redéfiniecomme correspondant à la base de la Zone à Discites, définie parl’apparition des plus anciens représentants du GraphoceratidaeHyperlioceras (Toxolioceras), issus de Graphoceras. Dans la littératureancienne, la limite inférieure du Bajocien supérieur correspondait à labase de la Zone à Subfurcatum ; aujourd’hui, elle est située à la basede la Zone à Niortense, après que Dietl (1981) ait démontrél’appartenance de l’holotype de “Strenoceras” subfurcatum (ZIETEN
1830) au genre Garantiana.Lors du même Colloque du Jurassique à Luxembourg de 1962,
l’affleurement de la falaise des Hachettes, voisin de la “localité deréférence” de d’Orbigny, est choisi comme stratotype du Bajocien(Rioult, 1964). La falaise des Hachettes étant caractérisée par“l’absence” d’une partie du Bajocien inférieur et par un Bajociensupérieur pour l’essentiel condensé (25 cm, hors Calcaires àSpongiaires), la G.S.S.P. (stratotype de la limite [inférieure]) du Bajocien a été fixée sur la coupe de Cabo Mondego, au sud deMurtinheira (Portugal – Henriques, 1992 ; Henriques et al., 1994 ;
Pavia & Enay, 1997).Ce profil correspond à une alternance
plus ou moins rythmée de calcaires gris et de marnes, parfois fossilifères (ammonites,brachiopodes), à bioturbations et fragmentscharbonneux. La limite inférieure du Bajocien,affleurant à 77,8 m au-dessus du pied decette coupe, correspond à la base du niveauAB11 qui marque l’apparition de l’associationd’ammonites caractérisée par Hyperlioceras(Toxolioceras) mundum (BUCKMAN 1904),Hyperlioceras furcatum BUCK. 1904, Braunsinaaspera BUCK. 1904 et B. elegantula BUCK.1904. La limite choisie est située juste sous lenanno-horizon marquant l’apparition descoccolites Watznaueria communis REINHARDT
1964 et W. fossacincta (BLACK 1971), qui estpresque synchrone avec une inversion duchamp magnétique dont la polarité devientnormale.
La G.S.S.P. pour le Bathonien (qui, de fait, matérialise la limite supérieure du Bajocien) a été proposéeultérieurement par Fernández-López et al. (2009). Il s’agit de la based’un banc calcaire (RB071) du Ravin du Bès, près du hameau de Bas-Auran de Chaudon-Norante (Alpes-de-Haute-Provence, France). Dansce site très fossilifère composé d’une alternance marno-calcaire (13 m)s’étageant de la Sous-zone à Bomfordi (Zone à Parkinsoni) à la Sous-zone à Tenuiplicatus (Zone à Aurigerus), la base du Bathonien (Horizonà Diniensis, Zone à Zigzag) est marquée par l’apparition des ammonitesGonolkites convergens BUCK. 1925 et Morphoceras parvum WETZEL
1937 (Olivero et al., 2010).
Le Bajocien, un étage du Jurassique moyen
Fossiles, n°15 24
représentent pas moins de treize sous-zones d’ammonites. Sonsommet est toujours marqué par une nette surface d’érosion.Malgré son épaisseur variable, la formation montre unecontinuité régionale remarquable sur toute la partie nord-est de la bordure armoricaine, du Cotentin jusqu’à la région du Havre. Dans le Bessin et la plaine de Caen, elle estparticulièrement bien développée, et s’épaissit encore,localement, à l’aplomb des écueils paléozoïques : à May-sur-Orne, elle atteint 2 m et devient sableuse ; vers l’est, diverssondages ont permis d’estimer sa puissance (1,2 m) ; plus ausud, dans la région de Falaise, elle passe latéralement auxCalcaires à Acanthothyris spinosa.
• Les Calcaires à Spongiaires, très caractéristiques dupaysage normand, se traduisent en géomorphologie par unpaysage fréquemment karstifié (dolines, entonnoirs dedissolution comblés par un résidu argileux…) ; à la surface du
devient très fossilifère vers le sud en direction de May-sur-Orne, sur les écueils paléozoïques. Vers l’est (plaine de Caen),elle a été recoupée par plusieurs sondages, où elle apparaît sous la forme de niveaux condensés d’une puissance de 1,3 m.Dans sa partie supérieure, elle témoigne d’une séquencetransgressive de plate-forme encadrée par deux épisodesd’érosion-condensation. Le maximum de cette transgression se situe au sommet du membre moyen tandis que des “Couches vertes” témoignent d’un ralentissement du taux desédimentation, avec démantèlement et remaniement.
• L’Oolithe ferrugineuse de Bayeux, très fossilifère,correspond à une série condensée dont la base repose sur les“Couches vertes” ou directement sur le membre moyen de laFormation de la Malière : les 50 cm de dépôts ferrugineux etcalcaires de l’Oolithe ferrugineuse de Bayeux s. s. ne
C
B
A
D
Fig. 1 - La falaise des Hachettes entre Sainte-Honorine-des-Pertes et Port-en-Bessin (Calvados) : stratotype du Bajocien. A : vue de la falaise (photo : T. Rebours) ; B : carte de localisation ; C : coupe stratigraphique montrant l’ensemble des formations observables :
D : coupe détaillée de part et d’autre de la limite Bajocien inférieur - Bajocien supérieur (d’après Lithothèque de Normandie [C-D]).
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:54 Page24
de Falaise, la Formation s’amincit et passe progressivementaux Calcaires à Acanthothyris spinosa.
Les pleurotomaires du Bajocien normand
Caractères utilisés pour séparer les espèces jurassiques :comme Benfrika (1984) l’a exposé dans sa thèse, lesnombreuses espèces de pleurotomaires trouvées dans lesterrains jurassiques ont été principalement distinguées par : (1) l’angle de la spire dans ses premiers tours (angle apical –A1) et dans ses derniers tours (angle de croissance final – A2),
sol, ils se signaient par un semis de cailloutis calibrés de tailledécimétrique à cassure porcelanée. Avec son taux desédimentation plus élevé (la dizaine de mètres de calcairecorrespond à une unique sous-zone d’ammonite), la formationtraduit un retour rapide vers une sédimentation carbonatée demer ouverte, en limite de plate-forme interne subsidente. Sonfond est alors peuplé d’éponges vivant en dessous du niveau del’action des houles ordinaires, mais parfois soumis à l’actiondes vagues de tempêtes. Dans la région de Caen, son épaisseuravoisine les 10 m, mais elle s’épaissit vers l’ouest, doublant sapuissance dans la région de Bayeux. Vers le sud, en direction
Potentiellement, les sédiments bajociens affleurent largement dans le Bessin et dans la région de Caen, mais dans la plupart
des cas, ils ne seront guère observés que dans des travaux ponctuels,limités géographiquement et dans le temps, en raison de la forteurbanisation du secteur. C’est le cas, par exemple, pour l’essentiel des sites qui furent accessibles dans la région de Bayeux à l’époqued’Eudes-Deslongchamps et d’Orbigny.
La falaise des Hachettes (fig. 1) [rappel : ce site de référence historiqueest protégé, et à ce titre, est à préserver des déprédations de tousordres ; les prélèvement sont interdits, comme les marteaux] : commeévoqué plus haut, ce profil a été choisi comme stratotype du Bajocienlors du Colloque du Jurassique à Luxembourg (Rioult, 1964). Située à mi-chemin entre Sainte-Honorine-des-Pertes et Port-en-Bessin, cette coupe– étudiée par d’Orbigny (1852) – montre, de la base à son sommet, lasuccession lithologique suivante (Dugué et al., 1997 ; Rioult, 1980) :
- la “Malière”, composée d’une alternance de calcaires gris beige àglauconie et bancs siliceux verts tabulaires et dont seule la partiesupérieure (4-5 m) appartient au Bajocien (Zone à Discites à l’Horizon à Jugifera de la Zone à Laeviscula). Celle-ci (correspondant au membremoyen de la Formation de la Malière), affleurant sur le platier et au bas de la falaise, est composée de bancs calcaires bioclastiques gris beigedécimétriques aux surfaces ondulées, creusées de poches de dissolutionet à nombreux silex verdâtres ou gris noir, en rognons ou tabulaires. Son sommet est marqué par la présence d’un petit horizon fossilifère(gastéropodes, bélemnites) intercalé entre les deux derniers bancscalcaires (dont le dernier correspond au “Calcaire verdi”, riche englauconie et remanié par l’érosion). La partie inférieure, d’âge Aalénienmoyen et supérieur (Zones à Murchisonae et à Concavum), est composéed’une alternance de marnes et de calcaires argileux bioclastiques quin’affleure que sur les parties basses du platier rocheux ;
- la “Couche verte” (Bathonien inférieur – Sous-zone à Patella de la Zone à Propiquans), qui doit sa couleur à la présence deglauconie. Correspondant au remplissage conglomératique demarmites d’érosion (0-30 cm), plus ou moins coalescentes et creuséesdans le dernier banc calcaire de la Malière, elle est encadrée par deuxsurfaces d’érosion, de Sainte-Honorine 1 et 2 (Dugué et al., 1997).Cette couche discontinue contient des galets anguleux ou émoussésde calcaire de la Malière et des fossiles (bélemnites, ammonitesSonniniidae et Otoitidae), souvent remaniés ;
- le “Conglomérat de Bayeux” (Bajocien inférieur – Zone àHumphriesianum), qui constitue un précieux niveau repère (couche “a”de l’Oolite ferrugineuse de Bayeux), avec ses oncolites[1] ferrugineuxhétérométriques (3-15 cm), arrondis ou aplatis, et enrobés de calcairebiomicritique à oolites ferrugineuses. Ce niveau est surmonté par undallage stromatolitique[2] ferrugineux (3-10 cm) plus ou moins continu, à lamines légèrement ondulées, et tronqué par la surface de Sainte-Honorine 3 ;
- l’“Oolithe ferrugineuse de Bayeux” (Bajocien supérieur – Zone àNiortense à la Sous-zone à Densicostata de la Zone à Parkinsoni),correspondant à des niveaux condensés épais de 1 à 35 cm et richesen ammonites, brachiopodes et gastéropodes (dont nombreusespetites pleurotomaires). Trois niveaux sont reconnus : deux couches(“b” et “c” – 10-15 cm) de calcaires bioclastiques durs, grisâtres, àpatine jaunâtre ou rouille à oolites ferrugineuses abondantes bienréparties et nombreux grands fragments de coquilles de mollusques(bivalves, gastéropodes, céphalopodes), avec cordon discontinu degrands oncolites ferrugineux aplatis. Puis vient une couche “d” (20 cm) de calcaire marneux grumeleux, clair à presque blanc, à oolites ferrugineuses irrégulièrement réparties et concentrées par labioturbation ; elle se termine par la surface de Sainte-Honorine 4 ;
- le “Calcaire à spongiaires” (“Oolithe blanche” des anciens auteurs ;Bajocien supérieur – Zone à Parkinsoni, Sous-zone à Bomfordi), trèsclair, presque blanc, et peu stratifié, terminé par une discontinuité de
sédimentation matérialisée par une surface d’érosion ondulée (surface de Port 1). Au nord de la faille des Hachettes, où sa puissanceatteint 10 à 12 m, il est composé principalement de bancs de calcairebiomicritique massif qui devient noduleux dans la partie supérieure, et riche en éponges (principalement siliceuses : desmosponges ethyalosponges – accompagnées de bryozoaires, brachiopodes, serpules et, parfois, oursins).
Ces couches bajociennes sont coiffées par : (1) les “Couches depassages” (Bathonien inférieur - base de la Zone à Zigzag), épaisses de 50 cm et correspondant à trois bancs de calcaire bioturbé, intercalésd’interlits marneux. La surface supérieure du banc sommital, plus épais et plus massif, correspond à une discontinuité de sédimentation(surface de Port 2) ; (2) les “Marnes de Port-en-Bessin” (Bathonieninférieur – Zone à Zigzag pars.) ; (3) les “Calcaires de Bessin”(Bathonien moyen – Zone à Progracilis).
La carrière Guérin, à Feuguerolles [attention : accès contrôlé] :une coupe plus complète de “l’Oolithe ferrugineuse de Bayeux” pouvait être observée au-dessus du Toarcien local dans la carrièreGuérin, à Feuguerolles-sur-Orne (Gauthier et al., 1995…), avec,notamment : présence de sédiments autour de la limite Bajocieninférieur / supérieur ; épaississement des dépôts calcaires des couches“a”, “b” et “c” ; discontinuités sédimentaires plus discrètes. Onremarque ainsi la disparition des oncolites et des stromatolitesferrugineux du “Conglomérat de Bayeux”, dans la Zone àHumphriesianum et la base de la Zone à Niortense.
Selon Dugué et al. (1997), il est possible de reconnaître quatre unités :- une unité 1 (1,55 m), équivalente à la couche “a” pars. du stratotype,
composée d’une couche argileuse brunâtre (25 cm) puis de bancscalcaires micritiques blanchâtres, décimétriques et fossilifères (bivalves,bélemnites, brachiopodes), dont le dernier est bioturbé par des terriersverticaux (Skolithos) ;
- une unité 2 (0,9 m), équivalente aux couches “a” pars. et “b” pars., débutant par des bancs calcaires décimétriques très micritiquessurmontés par des calcaires micritiques finement bioclastiquesgrisâtres. La macrofaune est principalement représentée par desbrachiopodes ;
- une unité 3 (0,6 m), équivalente à la couche “b” pars., représentéepar des calcaires micritiques jaunâtres, très riches en ammonites ;
- une unité 4 (0,6 m), équivalente aux couches “c” et “d”, constituéepar un calcaire micritique bioclastique, plus grossier, à nombreuxpleurotomaires, bélemnites et bivalves.
Bretteville-sur-Odon : les travaux entrepris lors du tracé dupériphérique sud de Caen ont permis à Dugué (1997) d’établir une autre série de référence pour le Bajocien normand. Située sous le pont de Bretteville-sur-Odon, elle expose :
- l’Oolithe ferrugineuse de la Malière (6 m), qui débute par unealternance régulière de bancs calcaires grisâtres, bioclastiques et bioturbés, et d’interbancs marneux centimétriques à grossestérébratules (3 m). Après un gros banc calcaire à terriers verticaux(Arenicolites, Skolithos), la sédimentation se poursuit avec un banc decalcaire grisâtre à bélemnites, surmonté de bancs calcaires noduleuxmal stratifiés, glauconieux et bioturbés (Thalassinoides) puis de bancscalcaires micritiques toujours bioturbés mais plus massifs (2,4 m). Cette formation se termine avec un horizon lenticulaire (0,4 m)correspondant à la “Couche verte”, représentée par des sablesglauconieux de remplissage ;
- l’Oolithe ferrugineuse de Bayeux, subdivisée en trois unités. La couche “a” (équivalente au “Conglomérat de Bayeux” de la coupedes Hachettes) correspond à un calcaire micritique crème, bioclastique(fragments d’échinodermes, bivalves, foraminifères) et à petites oolites.Les couches “b” et “c” regroupent des bancs calcaires micritiques plusmassifs, contenant toujours des oolites ferrugineuses. La couche “d”est représentée par un calcaire micritique bioclastique grossier quidébute par un niveau lumachellique et dont les oolites sont localementconcentrées par une intense bioturbation. Dans cette couche, lamacrofaune est principalement composée de Pleurotomariidae et de térébratules ;
- les Calcaires à spongiaires, composés d’une micrite blanchâtre,bioclastique, mal stratifiée à rares oolites ferrugineuses. Vers lesommet, elle fait place à un calcaire blanc grumeleux et pyriteux.
Les hauts-lieux du Bajocien normand
[1] Formées par précipitation du fer autour d’éléments remaniés des couches sous-jacentes, elles ont été roulées sur le fond dans un milieu de forte énergie.
[2] Ils ont été construits grâce à l’activité de cyanobactéries, dans la zone photique dehauts-fonds éloignés des côtes armoricaines.
Remarques : les deux notes se réfèrent à des conditions paléo-écologiques (profondeuret/ou agitation) peu compatibles avec le contexte général (faunistique notamment :faciès à ammonites) ; pour une interprétation différente de ces faciès, se référer auxtravaux sur des séries condensées analogues (Collin et al., 2005).
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:54 Page25
qui permet de séparer des formes cyrtoconique (A1/A2 > 1),conique (A1/A2 = 1) et coeloconique (A1/A2 < 1) ; (2) lerapport entre la hauteur totale et le diamètre de la coquille, quipeut être quasi-planispiralée à conique haute ; (3) le profil destours, concave, plan, convexe ou anguleux ; (4) la largeur de lasélénizone, sa position, son ornementation et son profil ; (5) la longueur et la largeur de la fente sinusaire, courte et large (Pleurotomaria, Bathrotomaria, Obornella) ou longue et étroite (Leptomaria, Conotomaria) ; (6) la présence
ou non d’un ombilic, et son développement relatif ; (7) l’ornementation de la surface des tours.
L’ornementation de la surface des tours, souvent bienpréservée chez les coquilles jurassiques (alors qu’elle estbeaucoup plus difficile à observer chez les formes crétacéessouvent connues sous la forme de moules internes), est trèsvariable, qualitativement et quantitativement, d’une espèce àune autre, ou au sien d’un même individu. Elle reposeprincipalement sur la combinaison : (1) d’une ornementation
26Fossiles, n°15
1a 1b
2
Fig. 2 - Pleurotomaria proteus EUDES-DESLONGCHAMPS 1848. 1 : grand individu(incomplètement développé ?) ayant les
proportions de la forme excelsa DESL. 1848, mais à ornementation juvénile persistante ;
2 : forme à base large ayant les proportions de la forme undulosa DESL. 1848. Fin du Bajocien
inférieur probable [tous les échantillons desfigures 1 à 9 sont en grandeur naturelle –
toutes les photos : P. Lebrun].
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:54 Page26
27 Fossiles, n°15
1a 1b
2 3a
3b 3c
Fig. 3 - Grandes pleurotomaires du groupe de P. proteus. 1 : petite forme peu élevée, très proche de la forme paucistriataDESL. 1849 (pl. I:2) ; 2 : forme à base large et tour anguleux, ornementation faible et peu persistante = P. paucistriata D’ORB. 1849*
(non forma paucistriata DESL.) ; 3 : forme intermédiaire entre les deux précédentes, à ornementation proche de la forma subturrita DESL. 1848. Fin du Bajocien inférieur probable.
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:54 Page27
28Fossiles, n°15
Pleurotomaria : ce genre a été proposé par Defrance (1826) à partir d’une espèce noduleuse et trochiforme du Jurassique anglais(Somerset) : Trochus anglicus SOWERBY 1818 ; il inclut PleurotomariumDE BLAINVILLE 1825 (ICZN opinion 582). Il est connu du Trias moyen(Pleurotomaria hectori TRECHMANN 1918 de l’Etalien [~ Anisien] deNouvelle-Zélande – Begg & Grant-Mackie, 2003) au Crétacé inférieur(Cox in Knight et al., 1960).
Parmi la cinquantaine d’espèces triasiques assignées àPleurotomaria, nombreuses sont celles qui ne sont nullement des représentants de ce genre (Begg & Grant-Mackie, 2003 : 259), comme P. yongshengensis PAN 1977, P. indica BLASCHKE 1907, P. fischeri var. concinna KOKEN 1897, P. albertiana (ZIETEN 1830) et P. haueri HÖRNES 1855.
Remarquons que certains auteurs ont considéré que les espèces vivantes attribuées aux genres Perotrochus FISCHER 1885,Entemnotrochus FISCHER 1885 et Mikadotrochus LINDHOLM 1927 étaientdes Pleurotomaria et, qu’au mieux, ces trois genres actuels pouvaientconserver un statut de sous-genre au sein du genre de Defrance(Hickman, 1976, 1984b, 1988). Cette conclusion a toutefois été réfutée par d’autres spécialistes, notamment par Bayer (1965) quiadmet la validité des genres actuels, mais propose aussi de subdiviserPerotrochus en trois groupes distincts : “groupe A”, pour les petitesespèces à coquille conique (P. quoyanus) ; “groupe B”, pour lesgrandes espèces à coquilles turbinées et tours renflés ; “groupe C”,pour Perotrochus hirasei. Plus récemment les vues d’Hickman ont été objectées par Das (2002). Il en va de même pour les Perotrochusjurassiques de Fischer & Weber (1997) qui ont été ultérieurementconsidérés comme des Leptomaria (Das et al., 2005).
Selon Cox (in Knight et al., 1960), Pleurotomaria se caractérise parune coquille « trochiforme, modérément haute à déprimée, anomphalée[sans ombilic] à largement phanéromphalée [ombilic ouvert], en gradins,avec une face externe du tour aplatie, au moins dans les premiersstades de la croissance ; sélénizone modérément large, près du mi-flanc ; ornementation [composée] de cordons spiraux sinueux avec des tubercules à l’épaulement et, chez certaines espèces, aussi à la bordure de la base ».
Les espèces jurassiques possèdent habituellement une coquille de grande taille (20-40 mm de diamètre) à tours de section arrondie,sélénizone médiane et, communément, une ornementation composéede côtes collabrales épaisses, au-dessus de la sélénizone, et de finescôtes spirales (d’Orbigny, 1852 ; Hudleston, 1895 ; Gründel, 2003).
Anodomaria : chez ce taxon originellement décrit comme un sous-genre de Pleurotomaria à partir d’une espèce du Pliensbachien de Sicileoccidentale et des monts Bakony hongrois (Szabó, 1980), la coquille,en gradins, montre une section de tour pentagonale à angulationdépourvue de nodosités. La base, convexe, est ombiliquée ou non. La sélénizone, aplatie à concave, est sise sous l’épaulement axial, à mi-flanc. La fente sinusaire est modérément large. L’ornementation,réticulée, repose sur des cordons spiraux et des rubans collabraux.
La forme et l’ornementation de la coquille juvénile de Pleurotomariaressemblent ainsi à celles d’Anodomaria.
Bathrotomaria : caractérisé par une faible diversité interspécifique, engénéral facilement reconnaissable par sa coquille trochiforme souventde grande taille (jusqu’à 130 mm) ; cependant, pour Benfrika (1984 : 19)« quelques espèces relativement basses de Bathrotomaria présentesdans la plupart des niveaux, semblent ne montrer aucune différenceimportante avec certaines espèces à tour anguleux et relativement hautsd’Obornella », comme Bathrotomaria zetes (D’ORBIGNY 1855) [Toarcien],B. trapeza (HUDLESTON 1895) [Bajocien], B. muensteri (ROEMER 1839) etB. buchiana (D’ORB. 1845) [Oxfordien]. La spire, en gradins, peut êtreélevée ou déprimée. La base est convexe, avec un ombilic large àtotalement absent. La section du tour est généralement anguleuse etatuberculée, avec une large rampe et une seconde carène qui recouvretout juste la spire. La sélénizone court sous la rampe. L’ornementationrepose sur des cordes spirales et des rubans, communément effacésau niveau de l’intersection avec les cordons collabraux. La sélénizoneest modérément large, la fente sinusaire courte.
Connu dès le Jurassique inférieur (B. paipotensis GRÜNDEL 2001 du Sinémurien du Nord du Chili), Bathrotomaria devient l’une despleurotomaires les plus largement distribuées et diversifiées entre leJurassique moyen et le Crétacé inférieur, avant son déclin au cours du Crétacé supérieur.
Conotomaria : il se distingue par une coquille conique à base aplatiequi montre un large ombilic chez certaines espèces, alors que d’autresen sont dépourvues. La section des tours est aplatie ou légèrementsigmoïdale, avec une périphérie anguleuse. La sélénizone courthabituellement le long ou au-dessus du mi-flanc ; chez certainesespèces, elle est toutefois très proche de la suture, sans toutefoiscoïncider avec l’angulation. La fente sinusaire est étroite et profonde.
L’ornementation repose essentiellement sur des cordons spiraux. Comme chez Leptomaria (cf. infra), Conotomaria a été originellement
défini pour inclure une grande diversité de formes. L’espèce-type,Conotomaria mailleana, est toutefois caractérisée par une grandecoquille conique à section de tour sigmoïdale et périphérie anguleuse à légèrement renflée, sélénizone sise au niveau ou au-dessus du mi-flanc et grand ombilic.
Cyclostomaria : la coquille est basse et turbinée à section de tourovale, avec une sélénizone sise au-dessus de la périphérie. La base,fortement convexe, montre un large ombilic. La suture est faiblementcanaliculée. La fente sinusaire est étroite. L’ornementation repose surdes cordons spiraux et des nodosités alignées transversalement.
Laevitomaria : la coquille, conique et à tours légèrement convexes,montre une section quasi-trapézoïdale et une base aplatie à grandombilic. La sélénizone est située sous le mi-flanc. La fente sinusaire est étroite. L’ornementation est composée de cordons et de rainuresspiraux. Les lignes de croissance sont prosoclines au-dessus de lasélénizone, opisthoclines au-dessous, et opisthocyrtes (falciformes) à leur base. La forme de la coquille juvénile est comparable à celle de Pyrgotrochus.
Remarquons que Conti & Szabó (1987 : 46) considéraient quel’inclusion au sein des Pleurotomariidae n’était que temporaire puisqueles « Pleurotomariacea ont grandement besoin d’une révision ».
Leptomaria : ce genre se différencie par une grande coquille coniqueou cyrtoconique, lorsqu’elle est marquée par une diminution de l’anglede croissance le long de la coquille, comme chez L. ajax (D’ORB. 1850),L. amoena (EUDES-DESLONGCHAMPS 1848) et L. monticuloides (HUDLESTON
1895). Les tours sont légèrement à fortement convexes. La baseconvexe comporte ou non un ombilic pouvant être circonscrit par unecarène plus ou moins saillante (L. athulia (DESL. 1848), L. obesa (DESL.1848)). La sélénizone est sise à mi-flanc. L’ornementation repose surd’étroits cordons spiraux et de plus fins cordons collabraux.
Bien que cette diagnose puisse accommoder une large gammemorphologique, on remarquera que l’espèce-type, Leptomaria amoena,se caractérise par une “grande” coquille à tours très convexes,périphérie très arrondie le long du dernier tour, sélénizone sise à mi-flanc et absence d’ombilic.
Obornella : ce genre, basé sur une espèce du Bajocien normand (O. plicopunctata), se caractérise par une coquille conique faiblementturbinée à sublenticulaire qui montre un ombilic légèrement ouvert etune base très convexe. La sélénizone est étroite, lisse et souventprojetée sur la face supérieure du tour près de la périphérie, souventcrénelée. La fente sinusaire est courte. L’ornementation repose sur des costules collabrales serrées associées à des cordons spiraux.
Ce genre, exclusivement jurassique, est surtout bien diversifié enEurope.
Pyrgotrochus : la coquille, conique à coeloconique, montre unesection de tour aplatie ou concave, à base aplatie portant ou non unétroit ombilic. La sélénizone court sous le mi-flanc. La fente sinusaireest large. L’ornementation repose sur des cordons spiraux et desbandes collabrales noduleuses.
Stuorella : la coquille, plutôt petite, est conique à section de touraplatie. La base est aplatie et peut porter un petit ombilic. La sélénizoneest sise sous le milieu du flanc, juste au-dessus de la périphérie qui est ornée de nodosités. La fente sinusaire est étroite. L’ornementationrepose sur des costules axiales et des cordons spiraux.
Talantodiscus : ce genre se caractérise par une coquille discoïdale à premiers tours légèrement proéminents, tubercules sur la surfacesupérieure près de la périphérie, côtes collabrales sigmoïdales sur la base et cordons spiraux sinueux, et sélénizone située au-dessus du mi-flanc (Cox in Knight et al., 1960).
Considéré comme un Pleurotomariinae par Wenz (1938), en raison de son ouverture (qui passe d’une section arrondie à une sectionsubrectangulaire au cours de l’ontogenèse), Cox (in Knight et al., 1960)préférait inclure Talantodiscus dans les Porcelliidae. Pour Begg &Grant-Mackie (2003), il ne fait toutefois aucun doute que ce genre estune pleurotomaire, puisque l’espèce-type (Pleurotomaria mirabilis) etles taxons néo-zélandais (T. trechmanni MARWICK 1953 et T. ? mackayi)montrent une large sélénizone, déprimée et sise à mi-flanc.
Remarquons que pour ces auteurs, Pleurotomaria aglaia D’ORB. 1850pourrait appartenir à Talantodiscus puisque cette espèce possède denombreux caractères observés chez T. mackayi, comme une spire trèsbasse, une sélénizone médiane sur la face externe très pentue, unebase abaxiale légèrement concave et une base adaxiale convexe.
Genres utilisables pour désigner les fossiles bajociens
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:54 Page28
1a 1b
3c
3b
3a
2b
2c
4a 4b
2a
1c 1d
Fig. 4 - Pleurotomaires moyennes à grandes, basses et vigoureusement ornées, proches de P. armata MÜNSTER 1840. 1, 2 : P. ornata DESL.1848 ; 1 : forme à bourrelets et stries périombilicaux forts, = forma macroptyca DESL. 1848 ; 2 : forme à côté antérieur très peu orné =forma sublaevigata DESL. 1848 ; Bajocien supérieur probable. 3 : P. actinomphala DESL. 1848 (non D’ORB. 1849*) ; Bajocien inférieur
probable. 4 : P. armata DESL. 1848 ; petit individu proche de sa forma münsteriana ; Bajocien supérieur probable.
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:54 Page29
collabrale (transversale, radiale), principalement composée de stries, de costules, de crénulations, de tubercules et de plis,et dépourvue de continuité avec l’ornementation de lasélénizone ; (2) d’une ornementation spirale, constituéeessentiellement par des stries, des filets, des cordons et descarènes. Selon la prédominance de l’une de ce deuxornementations, il est possible de distinguer : (1) uneornementation simple, reposant sur des stries spirales etcollabrales plus ou moins dominantes (Leptomaria) ; (2) uneornementation tuberculeuse, habituellement composée de deuxrangées de tubercules (nombreux Pleurotomaria bajociens) ;(3) une ornementation à costulations et crénulations plus oumoins marquées (espèces du groupe de Pleurotomariaconoidea (DESHAYES in D’ORBIGNY 1855) et Obornella).
Comme le souligne Benfrika (1984 : 54) : « L’ornementationde la bandelette [= sélénizone] peut être identique dans ledernier tour de la plupart des espèces d’un même groupe etd’un même niveau stratigraphique. Cependant, comparées enfonction de la croissance, les espèces d’un même genre ouencore des individus d’une même espèce ne présentent que
rarement des ornementations semblables ». Sur une coquillebien conservée, il est ainsi possible d’observer plusieurs stadesornementaux, au cours de la croissance. Les cinq principauxsont : (1) un stade simple, à sélénizone concave à stries decroissance en relief et imbriquées (premiers tours) ; (2) un stade unicaréné, à carène plus ou moins saillante(Pleurotomaria precatoria EUDES-DESLONGCHAMPS 1848, P. anglica (SOWERBY 1818), P. princeps KOCH & DUNKER1837) ; (3) un stade pluricaréné (Pleurotomaria gr. conoidea) ;(4) un stade lisse plan-convexe, issu de l’élargissement de la(les) carène(s) (Pleurotomaria proteus DESL. 1848) ou dusoulèvement progressif du stade simple (Bathrotomariagyroplata (DESL. 1848) ; (5) un stade bombé, obtenu parbombement du stade précédent (Pleurotomaria armataMÜNSTER 1844, P. agatha (D’ORB. 1850)) ou par bombementdu stade simple (Obornella disca (DESL. 1848), Leptomariadistinguenda (TAWNEY in HUDLESTON 1895), Pleurotomariaagassizii MÜNSTER 1844).
Remarque : les listes évoquées précédemment indiquentqu’un très grand nombre de genres et/ou sous-genres pourraient
30Fossiles, n°15
1d
1c
1a
1b
Fig. 5 - Grande pleurotomaire très voisine de P. dentataDESL. 1848, et notamment de sa forme “commune” micromphala ;
Bajocien supérieur très probable.
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:54 Page30
sans doute être utilisés pour désigner et ranger les diversesespèces rencontrées en Normandie, particulièrement dans l’étageBajocien. En fait, les discussions récentes ou non et lesconceptions très diverses apparaissant dans la littératuremontrent que cette catégorie taxinomique est toujours loin d’êtrestabilisée. Une révision massive s’impose toujours, qui induiranécessairement des regroupements et des changements dans lesaffectations des espèces à l’un ou l’autre des genres, mêmecelles du Bajocien qui paraissent les mieux circonscrites et quiservent “d’espèce-type”. Egalement, la pertinence del’utilisation des mêmes genres pour désigner des groupesfossiles à actuels, avec 170 millions d’années d’écart, est unpoint qui méritera d’être discuté très méticuleusement, sachantque le registre fossile pour les formes post-Mesozoïque est loind’être bien connu (formes mal représentées dans nos régions, oùsont présentes des formations liées à des environnements tropproximaux pour les pleurotomaires ; cf. la première partie de cetarticle dans le numéro 13 de “Fossile” : Lebrun & Courville,2013). L’objet de cet article n’est pas, évidemment, de discuterlonguement ces problèmes ; en conséquence, il nous paraîtjudicieux, comme nous l’avions fait dans le précédent numéro,de laisser toutes (ou presque toutes) les espèces évoquées ci-après rangées dans une sorte de grand “Pleurotomaria”, eninvitant les lecteurs intéressés à se référer à l’encadré page 28,mieux, à parcourir la littérature idoine…
Choix et définition des espèces : il est évident que laplupart des noms validés pour désigner les taxons du Bajociennormand ont pour la plupart été inventés et déjà discutés trèsanciennement : les pleurotomaires ont été remarquées dès lestravaux pionniers d’inventaires au milieu du 19e siècle. Onpense naturellement à la “Paléontologie Française”, partieJurassique, d’A. d’Orbigny (1851-1860), qui s’appuiefréquemment sur ses propres baptêmes plus anciens, sansfigurations [“Prodrome”, 1847*]. En fait, on notera le plusgrand intérêt présenté par la monographie presque synchrone,mais antérieure (1848) d’Eudes-Deslongchamps sur le sujet(pleurotomaires normandes) : souvent négligé face àd’Orbigny, cet auteur conserve la paternité d’un très grandnombre de formes, qu’il a éclairées par des concepts originauxet très biologiques, ce qui est très singulier à cette date “pré-darwinienne” (cf. l’encadré ci-dessous)…
Principales pleurotomaires du Bajocien de la régionstratotypique : faute d’une véritable actualisation voire d’unerévision des différentes espèces (et genres) réellementassociées dans les différents et nombreux niveaux du Bajociende la région stratotypique, toute présentation de ces fossilesremarquables ne peut être que très “typologique” et,obligatoirement, sujette à discussion. En attendant une révisionsérieuse, les noms fournis par Eudes-Deslongchamps en 1848(et associés à de bonnes figurations) restent souvent d’un usagerelativement pertinent après 165 ans… Une véritable révisiondevra impérativement prendre en compte les distributions
stratigraphiques réelles des groupes, espèces et diverses“variétés”, ce qui reste à préciser et sera difficile : la diversitéapparente considérable, dont rendent compte les nombreuxnoms utilisés, est à relativiser : 6 ou 7 millions d’années estune période suffisamment longue pour permettre le relai ou lasuccession d’espèces biologiquement indépendantes les unesdes autres.
Dans ce qui suit, nous nous appuierons sur des données“nouvelles” : pour l’essentiel, les fossiles illustrés sont issus derécoltes tout à fait récentes (collections des co-auteurs,Boursicot, Catto & PC), éventuellement complétées parquelques fossiles de collections anciennes conservés àl’université de Rennes 1. Néanmoins, les conditions de récoltene répondaient pas aux “normes” modernes, notamment cellesinduites par la précision stratigraphique souhaitée, sur de grandschantiers de travaux publics affectant les séries condensées àoolites ferrugineuses : les indications stratigraphiques fourniessont donc toujours relativement évasives.
De façon tout à fait arbitraire, tout observateur ayant unecertaine pratique constate qu’il existe plusieurs groupes deformes faciles à repérer sur le terrain, manifestement associés àde grands ensembles stratigraphiques.
1. Formes “géantes” à spire haute, ornementation surtoutconstituée par des nodosités accentuant un épaulement haut surle tour, limitée aux premiers tours de spire ; par la suite, lacoquille est à peu près lisse, à l’exception de nodosités aplatiesqui s’étalent au-dessus de la suture et deviennent grossières ettrès persistantes. Les plus grandes (environ 200 mm) ont destours totalement lisses croissant moins en hauteur ; lasélénizone est bien marquée au tiers supérieur du tour etprolonge une fente large et plutôt courte ; pas d’ombilic chezles plus grandes. C’est le groupe de P. proteus EUDES-DESLONGCHAMPS 1848 [fig. 2:1], forme plutôt rare (complète),a priori propre à des niveaux élevés du Bajocien inférieur. Descoquilles à angle apical plus ouvert (= undulosa DESL. 1848[fig. 2:2]) coexistent. Des fragments, remaniés jusqu’à preuvedu contraire, ont été observés à des niveaux plus récents. Trèscurieusement, nous n’avons eu entre les mains aucune formede petite taille (vrai juvénile).
Des coquilles voisines mais plus petites (max. observé env.L = 90 mm, l = 90mm) existent a priori avec les précédentes,qui sont caractérisées par un angle apical plus ouvert et unombilic très ouvert ; ornementation très persistante, induisantun épaulement persistant même quand les nodosités sont estompées (forma paucistriata sensu DESL.) [fig. 3:1].Certaines coquilles très graciles sont larges et lissesrapidement, avec un épaulement très atténué et la partieadapicale du tour pincée [fig. 3:2] ; pour cette forme,d’Orbigny (1849*) a utilisé paucistriata avec le statutd’espèce, terme qui n’est manifestement pas équivalent au nomin Eudes-Deslongchamps (1848). [fig. 3:3 illustre un individuintermédiaire entre ces “deux” paucistriata].
Remarque : si on accentue la tendance illustrée parpaucistriata sensu D’ORB. non EUDES-DESL., notamment avec
Il y a peu de chances de se tromper si on estime que de “légers différents”
opposaient d’Orbigny et Deslongchamps(note ci-contre, in Desl. 1848 : 15).L’histoire a largement honoré le premier,à juste titre, en raison du poids qu’a eu eta encore son œuvre monumentale ; elle alargement “mis au placard” le second.
Pourtant, si on lit l’œuvre deDeslongchamps, par exemple la longueprésentation des concepts sous-tendantson approche des pleurotomaires, onnote la référence préalable aux faunesmodernes connues à l’époque (p.5, 14) ou la prise en compte de l’ontogenèse
sous-tendant une variabilité forte et généralisée (15-17, 19). Il évoque (p.16 : 11) le« défaut de fixité dans la valeur des mêmes caractères » et note (p. 23 : 21-24) que« les exemplaires peu nombreux conduisent toujours à multiplier le nombre desespèces nominales ». Pour finir, on notera (p. 22 : 13-15) l’association dans la mêmephrase des mots “espèce” et “parenté”… Toutes notions peu “orbignyiennes” !
Deslongchamps revendique également, et par anticipation, ses erreurs éventuelles, en affirmant fournir par ses variétés, le support déjà disponible pour décrired’éventuels autre taxons (p. 25)…
J.-A. Eudes-Deslongchamps versus A. d’Orbigny : des vues opposées...
A. d
’Orb
igny
J.-A
. Eud
es-D
eslo
ngch
amps
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:55 Page31
Fossiles, n°15 32
Fig. 6 - Grandes pleurotomaires allongées, graciles et peu ornées. 1 : forme du groupe de P. scalaris DESL. 1848, à tour nettement épaulé mais faiblement caréné = P. strigosa D’ORBIGNY 1849* (non forma strigosa DESL. 1848) ; Bajocien supérieur.
2 : P. scalaris DESL. 1848 ; forme peu allongée nettement bicarénée (= forma expansa DESL. 1848) ; Fin du Bajocien inférieur probable. 3 : P. gyroplata DESL. 1848, très voisine de sa forme inaequistriata ; Fin du Bajocien inférieur probable. 4 : P. gyrocycla DESL. 1848,
mêlant les caractères de différentes formes ; fin du Bajocien inférieur probable.
1a3a
2a
2b
4a
3b
4b
1b
2c
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:55 Page32
33 Fossiles, n°15
Fig. 7 - 1 : P. saccata D’ORBIGNY 1849* [non P. gyrocycla var. saccata DESL. 1848] ; Bajocien supérieur très probable. 2 : P. sp., non déterminable car insuffisamment préparé ; forme de taille médiocre très voisine de P. gyroplata forma inaequistriata Desl. 1848
[(pl. 3:1) = ? P. allica D’ORBIGNY 1847* – figuré 1854] ; fin du Bajocien inférieur probable. 3-9 : petites pleurotomaires trochiformes, dugroupe de P. mutabilis DESL. 1848. 3-8 : Bajocien supérieur très probable ; 9 : fin du Bajocien inférieur probable. 3, 6 : deux coquillestypiques à spire moyennes, cordon noduleux bien marqué, voisines de P. m. forma ambigua DESL. 1848 ; 4 : forme à sculpture très peu
marquée, probablement P. allionta D’ORBIGNY 1847* [figurée 1854] ; forme à ornementation plus gracile, forma mutica DESL. 1848. 7 : forme large à spire courte à ornementation treillissée très gracile = ? P. agatha D’ORBIGNY 1847* [figuré 1854]. 8 : forme large à spire courte, ornementation gracile et stries épaissie, = P. mutabilis forma corrugata DESL. 1848. 9 : forme grande à base très élargie,
flancs de la spire concaves = P. patula DESL. 1848 ; fin du Bajocien inférieur probable.
1a 1b
2
3a
3b
7a
4a
4b
4c
8 9 7b
6b
5a
6a
5b
5c
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:55 Page33
une ornementation plus gracile encore et exprimée moinslongtemps sur la spire (sauf tubercules plats supra-suturaux), ilest “facile” de “réaliser” l’extraordinaire P. fasciata EUDES-DESL. 1848 (pl. 5 : fig. 1 seulement = forma crenata), formeérigée par d’Orbigny (1849*, pl. 394) au rang d’espèce dont ila d’ailleurs changé le nom (P. subfasciata), tout enreproduisant la figure d’Eudes-Deslongchamps…
2. Formes rares à modérément communes d’assezgrande taille plus larges que longues, à spire très courte,ombilic très ouvert, fente très courte et située très haut sur letour dans la plupart des cas, et très vigoureusement ornée.
• P. ornata DESL. 1848 correspond à des formes surbaisséesde taille assez modeste, bien ombiliquée, à fente très courtesituée très haut sur le tour. Leur ornementation est vigoureusemais demeurant assez gracile. Plusieurs formes ont été distinguées par Eudes-Deslongchamps, en fonction de l’ornementation développée sur la base [fig. 4:1-2].Généralement, elles sont récoltées dans le Bajocien supérieur(Oolithe de Bayeux par exemple).
• Une forme récoltée dans les niveaux anciens du Bajocien,très gracile et très aplatie d’avant en arrière, correspond assezbien à P. actinomphala DESL. 1848 [fig. 4:3].
• Associée aux grands “proteus”, P. armata MÜNSTER 1840,correspond à des coquilles parfois grandes, très trochiformes,chez lesquelles l’ornementation est constituée par de grostubercules “mousses” et des carènes prononcées sur les flancs[fig. 4:4] ; malgré les commentaires d’Eudes-Deslongchamps,P. armata paraît bien proche des grands P. dentata, a priori plusvigoureusement ornés et à base striée [fig. 5]. Apparemment,des individus de ce dernier “taxon” existent dans les niveauxrécents du Bajocien. Comme toujours, Eudes-Deslongchamps abaptisé différentes formes ; sans juger leur validité ou leursignification, on notera les similitudes ou analogies étonnantesde ses formes graciles de taille modeste (P. a. precatoria et P. d.alternans), avec les types morphologiques réalisés par lescoquilles du groupe proteus illustrées figure 2…
Remarque : comme pour l’ensemble précédent, il n’est passimple de trouver des juvéniles. L’un, probable, d’entre eux estillustré [fig. 9:12]. La forme générale plus basse que chez lesadultes, l’ornementation aux proportions un peu différentes etl’aspect frais, non altéré de celle-ci (ce qui n’est pas le cas desstades initiaux chez les grands adultes), rendent très incertainel’attribution systématique de ce jeune du Bajocien supérieur[nomenclature ouverte].
3. Formes très allongées à spire haute d’assez grande tailleadulte (env. 80 mm), sans ombilic, à fente large et courte situéeà mi-flanc ; suture entre les tours relativement prononcée etornementation constituée uniquement par des carènesnormalement très graciles, même si une peut être plus oumoins développée, induisant alors un épaulement plus oumoins prononcé. Au moins trois types (“espèces”) apparaissentà différents niveaux du Bajocien inférieur ; deux ont étérécoltés récemment dans le Bajocien supérieur [fig. 4:6 et 7 pars.]. Apparemment, longueur de la spire inversementcorrélée avec le développement d’épaulements (i.e. d’unecarène latérale forte).
• P. strigosa D’ORB 1849*, forme probablement liée au groupe de P. scalaris DESL. 1848, mais non homologue à la forme strigosa DESL. 1848 ; coquille rare du Bajociensupérieur, à tours nettement épaulés, mais très faiblementcarénés, uniquement sur les premiers tours de spire [fig. 7:1].
• P. scalaris DESL. 1848, forme du Bajocien inférieur (commeles deux suivantes) à tours très étagés, en liaison avec une carènemédiane très puissante, conférant un aspect en toit de pagode.Différentes “variétés”, en fonction de la force de la carène et,parfois, d’une seconde au niveau de la suture [fig. 7:2].
• P. gyroplata DESL. 1848 qui, comme son nom l’indique,possède des tours à peu près plans ; carène médiane existantedans les tous premiers tours très juvéniles. Variants parfois à peu près lisses, comme celui illustré [fig. 7:3]. Eudes-Deslongchamps a bien sûr baptisé plusieurs formes chez cette“espèce” : parmi ses formes, l’une montre des carènes plusdéveloppées au tiers inférieur des tours (= var. inaequistriata,1848, pl. 3, fig. 1) [fig. 7:2] ; cette forme est certainementsynonyme de P. allica D’ORB. 1849*, taxon encore basé surune description de 1847* (“Prodrome”, n° 131).
• P. gyrocycla DESL. 1848, des mêmes niveaux et à peu prèslisse également, mais qui possède des tours arrondis et, enliaison, une suture très accusée ; carène médiane assezprononcée dans les tours juvéniles. La forme illustrée [fig. 7:4]pourrait être regardée comme “compilant” les caractères deplusieurs des coquilles précédentes.
• P. saccata D’ORB. 1849* [non équivalent malgré ce qued’Orbigny écrit, à P. gyrocycla var. saccata DESL. 1848] ;curieusement, il utilise un nom pré-existant, tout en s’attribuantla création de l’espèce (du nom)… Cette coquille du Bajociensupérieur a les tours plutôt régulièrement convexes, maispresqu’étagés au voisinage de la suture ; ornementation spiraleconstituée par des carènes égales, denses mais très perceptibles[fig. 7:1].
4. P. mutabilis DESL. 1848 peut être utilisé pour décrire lespetites pleurotomaires très prédominantes dans le Bajociensupérieur, particulièrement dans l’Oolithe de Bayeux [fig. 7pars. et 8 pars.]. Ces pleurotomaires très communes montrentune spire plutôt haute et pointue, un tour anguleux souligné parune carène supra-suturale nette peu aigüe. Fente large et courte,sur la carène principale. L’ornementation est très constantependant toute la croissance, associant des tubercules fins quirendent la carène principale cordée. Souvent d’autres carènessecondaires l’accompagnent, l’une étant assez prononcée, entrele tiers inférieur et la moitié du tour. Dans certains cas, les striesde croissance sont très marquées, induisant un aspect treillissé ;il arrive, chez les petites formes (jeunes ?), que se développentdes côtes parfois divisées. Normalement, ombilic absent ; chezcertaines formes, plus rares, el peut être bien ouvert. Il n’est pasimpossible que ce nom soit utilisé comme un fourre-tout, etregroupe plusieurs vrais taxons… Face à cet imbroglio, Eudes-Deslongchamps avait désigné d’innombrables variants, qued’Orbigny avait immédiatement redéfinis, supprimés, et/ouérigés au rang d’espèces. Parmi les formes illustrées ici, onpeut insister : sur la très élancée et gracile allionta D’ORB. [fig. 7:4] ; sur une forme à flancs concave ombiliquée (? = Agatha D’ORB. [fig. 7:7]) ; sur les formes à tours étagés etpeu ornés, le dernier étant très élargi [fig. 7:9] – ils atteignentune taille plus grande et sont apparemment propres à la fin duBajocien inférieur (= patula DESL.) ; sur les coquillesextraordinairement allongées rapportables à subelongataD’ORB. [fig. 8:1-2] ; ou enfin sur les petites vigoureusementtuberculées et costulées de type coelata DESL. [fig. 8:3].
Au voisinage de cette “cohorte” de formes, on trouverarement et au même niveau stratigraphique, de petitescoquilles très trochoïdes basses, à fente large sise au-dessus dela carène, qui est ornée par des tubercules espacés, plats et pointus, comme chez la grande forme ombiliquéeP. subfasciata D’ORB. De surcroît, la coquille est ornée de striesnettes et de côtes parfois divisées et saillantes, qui lui confèrentun aspect très particulier ; laissée en nomenclature ouverte, ellese rapproche peut-être de la P. fallax sensu DESL., ou de P. mutabilis sensu D’ORB. 1830.
5. Ensemble de formes de taille modeste à petite, raresmais présentes dans tous les niveaux, trochiformes à spireplutôt basse et contour arrondi, parfois galbées à flancsconvexes ; ornementation généralement faible (surtout, fines et nombreuses carènes) [fig. 8 pars.]. Sauf exception, lescoquilles sont largement ombiliquées. Leur caractéristique laplus remarquable est la présence d’une fente étroite et filiformesituée à la moitié du tour, ouverte sur au moins un quart detour, donc très longue. Au sens strict, ce groupe correspond defacto au genre Leptomaria DESL. 1864, puisque l’auteur a érigéce genre en donnant comme espèce-type son propre taxon de1848, P. amoena. On peut noter que très curieusement, cecaractère n’est même pas évoqué par Cox (in Knight et al.,1960 : I311). Beaucoup des formes de ce groupe baptisées parEudes-Deslongchamps en 1848 ont été “datées” de 1849 pard’Orbigny dans sa “Paléontologie Française”, les dessins étantalors parfois très incorrects, particulièrement pour la fente (cf. d’Orbigny, 1849*, amoena, laevigata et monticulus, pl. 388et 398). Plusieurs formes ont été récoltées récemment :
• P. amoena DESL. 1848. Au sens initial, c’est une forme trèspetite ressemblant beaucoup à une troque ; ombilic minusculevoire absent, ornementation complexe pour ce groupe (finescarènes agrémentées de petits tubercules). Généralement, le nom
34Fossiles, n°15
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:55 Page34
35 Fossiles, n°15
Fig. 8 - 1-3 : autres formes voisines de P. mutabilis ; Bajocien supérieur très probable. 1, 2 : coquilles remarquables par leur spire excessivement élevée, comparable à P. subelongata D’ORBIGNY 1847* [figurée 1854, = ? P. mutabilis forma turrita DESL.
1848, pl. X:16] ; 3 : petite coquille trochiforme très vigoureusement ornée, = P. mut. forma coelata DESL. 1848. 4, 12 : P. amoena DESL.1848 (non D’ORB.), forme turbinée à spire courte, ornée de carènes et tubercules bien marqués ; encoche longue et très étroite ; fin du
Bajocien inférieur probable. 5 : P. sp., très probablement juvénile à faisceaux de côtes, voisin de la forme fallax sensu DESL. 1848 ou jeunemutabilis sensu D’ORB. 1830 ; Bajocien supérieur très probable. 6 : P. cf. agathis DESL. 1848 ; coquille atypique aux côtés moins bombésque les formes des anciens auteurs, plus récentes ; fin du Bajocien inférieur probable. 7 : P. laevigata DESL. 1848 ; individu à spire peu
élevée ; fin du Bajocien inférieur ancien très probable. 8, 9 : P. monticulus DESL. 1848 ; 8 : forme assez typique à spire élevée ; 9 : formebeaucoup plus trapue, ayant les proportions de P. agathis str. s. ; toutes deux du Bajocien supérieur. 10 : P. sp. ; petite forme anguleuse à
courte spire, seulement ornée de sillons latéraux, peut-être proche de P. alcyone D’ORBIGNY 1847* [figuré 1854] ; Bajocien supérieur. 11 : P. unisulcata D’ORBIGNY 1854, forme à spire plutôt élevée ; fin du Bajocien inférieur probable. 13 : P. sp. ; individu juvénile, homologue
morphologique des stades initiaux de grandes formes comme P. ornata/armata/actinomphala ; fin du Bajocien inférieur probable.
1a 2a
2b1b
4a 4b 4c
3b 3a
3d3c
7c
7a
7b
10b 10a
10d10c
11d
11b 11a
11c
12a 12b 12c
13c13b13a
8a
8b
9b 9a
9d9c
5b5a 5c
6a 6c 6b
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:55 Page35
amoena n’est pas appliqué à ces formes, mais à d’autres mieuxplacées au voisinage de P. monticulus. Notons que P. fragaDESL. 1848 (non retrouvée récemment) est particulièrementproche, mais avec un ombilic plus ouvert et une ornementationplus soutenue (fraga évoquant l’aspect d’une fraise…). Les deuxindividus illustrés [fig. 8:4, 12] ne sont pas montrés côté fente,où cette dernière est pourtant bien conservée (photosinexploitables) ; ils proviennent tous deux de niveaux récents duBajocien inférieur.
• P. monticulus DESL. 1848 [fig. 8:8]. Forme plus grande,très haute, à tours anguleux (carène plus forte au-dessus du mi-flanc). Stries très prononcées au quart supérieur des flancs,dans les tous premiers tours de spire. Le pourtour de l’ombilic,très abrupt, porte également des carènes. Forme rare du Bajocien supérieur. Il existe des variants tout aussi rares au même niveau, à coquille plus basse et à tours plus arrondis,ornementation plus homogène, aux proportions plus proches del’espèce suivante [fig. 8:9].
• P. cf. agathis DESL. 1848 [fig. 8:6]. Associées aux
précédentes dans les mêmes niveaux, existent des coquillesbasses, que distinguent leur taille plus modeste et leurornementation visiblement dominée par des plis bien développéssous la suture (structures homologues à celles visibles en débutde croissance chez monticulus ?). Ces plis se retrouve sur lepourtour de l’ombilic ; ces caractères sont bien exprimés sur lafigure d’Eudes-Deslongchamps (1848, pl. 13:8), et sont fortaccentués sur celle fournie par d’Orbigny (1849*, pl. 398:7-9),pourtant « copies des figures données par M. Deslongchamps... »La très petite forme illustrée ici montre ces caractères trèsaccentués, notamment sur le pourtour de l’ombilic ; l’individumontre de plus des tours très étagés au voisinage d’une sutureplus profonde. Il provient de niveaux récents du Bajocieninférieur, donc plus anciens que la forme-type.
• P. laevigata DESL. 1848. Très rare forme à spire assezbasse, sélénizone légèrement saillante, tours globalement plan-arrondis, suture marquée ; ensemble à peu près lisse. Lacoquille figurée [fig. 8:7] possède un apex légèrement abîmé,d’où l’aspect aplati. La base est très plane et lisse. Forme très
36Fossiles, n°15
Fig. 9 - Petites pleurotomaires à spire basse et dernier tour très développé, fente courte située au-dessus (en arrière) de l’angle trèsprononcé du tour (= genre Obornella Auct., voire Leptomaria Auct.). Pratiquement, formes toutes rangées dans P. granulata (SOWERBY
1818) par Eudes-Deslongchamps (1848), groupe bien sûr “splitté” par d’Orbigny (1854) ; à part 8 (fin du Bajocien inférieur), toutes lescoquilles illustrées ont été récoltées dans les niveaux du Bajocien supérieur. 1 : forme à spire moyenne à ornementation intermédiaire
entre 2 et 5 (voir ci-après). 2, 3 : spire haute, ornementation uniforme à carènes marquées et stries épaissies (carènes moins nettes sur la“base” de 2), donnant un aspect réticulé = forma reticulata DESL. 1844. 4 : uniquement des côtes sur la “base” = forma plicopunctataDESL. 1848. 5 : spire assez basse, stries de croissance seules marquées = forma laevigata DESL. 1848. 6-8 : coquilles à spire très basse
voire “concave”, ornementation variable mais plutôt peu marquée, compilant ou accentuant les caractères de la forme lentiformis DESL.1848 = P. palemon D’ORBIGNY 1847* [figuré 1854]. Ces formes présentent des similitudes extraordinaires avec les groupes callovo-
oxfordiens de P. striata LECKENBY 1848 ou P. montreuillensis HÉBERT & DESL. 1860.
1b
2b 2c
2a
3c
3a
3b
8a8b
8c
8d
6a
6b 6c 7b 7c 7a
5a5b
5c 5d
4a4b
4c 4d
1d
1a
1c
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:55 Page36
rare, des niveaux anciens du Bajocien inférieur.Remarque : en 1848, Eudes-Deslongchamps a attribué cette
très rare forme au « banc sous-jacent à l’oolite ferrugineuse.Bayeux », ce que d’Orbigny (1849*) traduisit ironiquement par« couches immédiatement inférieures à l’oolite ferrugineuse deSaint-Vigor, près de Bayeux » […] « de l’étage 9è : toarcien »,en “reproduisant” la figure d’Eudes-Deslongchamps. La formeillustrée ici provient d’un banc compact à très rares oolites,inféodé à l’Oolite de Bayeux, d’âge Bajocien inférieur ancienou possiblement Aalénien…
• P. sp., sans doute proche de P. cf. alcyone D’ORB. 1849[fig. 8:10] est utilisé pour une unique petite coquille à l’apextronqué et à péristome incomplet du Bajocien supérieur ; largeet anguleuse, à ornementation très fine presque imperceptiblemême en début de croissance, ombilic large.
• Enfin, P. unisulcata D’ORB. 1854, nouveau baptême(apparemment juste, dans ce cas), pour une figuration d’Eudes-Deslongchamps (pl. 13, fig. 4). P. sulcata, sensu DESL. taxonselon lui dû à Deshayes (p. 791), en réalité simple commentairepar Deshayes (1822*) d’une espèce inventée plus tôt parSowerby (1818, pl. 220, fig. 2). Cette espèce trochoïde à tourspeu anguleux, base plane, ombilic moyen est très faiblementornée (carènes très discrètes sauf une, médiane, au niveau de lasélénizone), à stries fines et discrètes, paraît plutôt commune àla fin du Bajocien inférieur [fig. 8:11].
6. Obornelles : enfin, ensemble relativement homogèneconstitué par de petites pleurotomaires que caractérisent leuraspect discoïdal, leur profil très surbaissé à spire peu développée,très courte voire plane, leur ombilic peu large mais profondcreusant une base arrondie ; échancrure courte ou très courte etlarge, prolongée par une sélénizone située sur une carènemarquée. L’ornementation varie entre des formes lisses, à striesaccentuées, côtes, carènes absentes, fines ou grossières,associations conférant parfois aux coquilles un aspect treillissé.Les mêmes associations de caractères peuvent exister sur la base.Habituellement, ces formes classiques pendant tout le Jurassiquemoyen et supérieur sont rangées dans le genre Obornella COX1959, l’espèce-type étant une forme bajocienne (P. plicopunctataDESL. 1848 [en fait, P. granulata var. d. plicopunctata]).
Plusieurs remarques peuvent être formulées à propos des
obornelles, bajociennes ou non. (1) En premier lieu, il estdifficile de comprendre pourquoi Cossmann (1906, 1907,1924...), a inclus les obornelles calloviennes dans Leptomaria,genre crée par Eudes-Deslongchamps (1865), pour son propregroupe de P. amoena et formes affines. (2) Comme pratiquementtoujours, face à la diversité des formes présentes dans leBajocien normand, Eudes-Deslongchamps a choisi un regard“variabiliste”, constituant une seule espèce (P. granulata (SOW.1818)) se déclinant en 5 variétés ; il subsiste un doute quand à lapaternité de ce taxon, Eudes-Deslongchamps se référant, pourcaractériser “son” granulata, aux figures de Goldfuss (1844) etnon à Sowerby ; quand à d’Orbigny (1849*), il n’analyse que letravail immédiatement antérieur d’Eudes-Deslongchamps, nefigure comme forme typique que la var. plicopunctata, isole lavar. lentiformis (coquilles lisses et aplaties) pour l’attribuer à uneespèce indépendante (P. palemon), qu’il avait lui même désignéeun an avant le travail d’Eudes-Deslongchamps, sans la figurer(“Prodrome”, 1847* : 207).
Comme le suggérait Eudes-Deslongchamps, il est sansdoute raisonnable de considérer que toutes les formesconstituent un seul ensemble variable ; les variants principauxsont figurés, du moins des coquilles récoltées récemment [fig. 9:1-8], et leurs caractères “distinctifs” précisés au fil de lalégende ; toutes se rencontrent strictement associées dans lesmême bancs, notamment dans la partie ancienne du Bajociensupérieur. On peut penser qu’elles existent également dans les niveaux un peu plus anciens, mais toutes n’y ont pas étéréobservées de façon sûre. A la fin du Bajocien inférieur,existent des formes inhabituellement grandes rapportables à laforme plicopunctata, que caractérise sa base ornée de côtesflexueuses ; à l’instar de Cox, on pourrait lui attribuer un statutd’espèce autonome…
Enfin, signalons des coquilles, sans doute rares (en tous cas,non illustrées à l’époque d’Eudes-Deslongchamps), accentuantles caractères de lentiformis/palemon, et qui possèdent une spireexcessivement aplatie sur une coquille parfaitement lisse :trouvées dans plusieurs niveaux bajociens [fig. 9:6-8], elles sont parfaitement homéomorphes d’obornelles callovo-oxfordiennes ; s’agit-il d’un groupe indépendant à “range”anormalement long ? ■
37 Fossiles, n°15
Remarques : les références citées dans la première partie [in “Fossiles” n° 13 : 39-40] ne sontpas reprises dans cette liste. Les appels suivi d’un “*”conservent les dates de parutions citées(ou utilisées) par d’Orbigny dans les diverses livraisons de sa “Paléontologie Française”, bienqu’elles soient en désaccord avec les dates imprimées sur les ouvrages cités ; ainsi : d’Orbigny,1847*, 1849* = 1851-1860 ; Deshayes, 1822* = 1832. La plupart des auto-citations ded’Orbigny dans sa “Paléontologie Française” (livraison de 1854) faisant référence au“Prodrome” sont erronées et antérieures à l’année de publication du travail d’Eudes-Deslongchamps (1848).
Bayer, F. M., 1965 - New Pleurotomariid Gastropods from the Western Atlantic, with a summaryof the recent species. Bull. Marine Sci., 15 : 737-796.
Bigot, A., 1882 - Esquisse géologique de la Basse-Normandie. Bull. Labo. Géol. Fac. Sci., univ.Caen, 2 (2) : 65-92.
Cariou, E. & Hantzpergue, P., (coord.), 1997 - Biostratigraphie du Jurassique ouest-européen etméditerranéen : Zonations parallèles et distribution des invertébrés et microfossiles. Bull.Centre Rech. Elf Explor. Prod., 17 : i-xvi + 1-422.
Caumont, A. de, 1828 - Essai sur la topographie géognostique du département du Calvados. Mém.Soc. linn. Normandie, Caen, 4 : 59-366.
Collin, P.-Y., Loreau, J.-P. & Courville, P., 2005 - Depositional environments and iron ooidformation in condensed sections (Callovian– Oxfordian, south-eastern Paris Basin, France).Sedimentology, 52 : 969-985.
Conybeare, W. D. & Phillips, W., 1822 - Outlines of the Geology of England and Wales, with anIntroduction Compendium of the General Principles of that Science, and Comparative Views ofthe Structure of Foreign Countries. Part. 1. William Phillips, 1-470.
Cossmann, M., 1906 - Essai de paléoconchologie comparée. 7e liv. L’auteur, Rudeval, 1-261.Cossmann, M., 1907 - Catalogue illustré des coquilles fossiles de l’Eocène des environs de Paris.
Appendice 4. Ann. Soc. royal Zool. Malaco. Belgique, 41 : 182-286.Cossmann, M., 1924 - Extension dans les Deux-Sèvres du Callovien de Montreuil-Bellay. Mém.
Soc. Géol. Minéral. Bretagne, 1 : 10-53.Deshayes, G.-P., 1832 [= 1822*] - Encyclopedie méthodique. Histoire naturelle des vers. Vol. 3.
Chez Mme Veuve Agasse, 595-1152.Dietl, G., 1981 - Zur systematischen Stellung von Ammonites subfurcatus Zieten (Bajocium,
Mittlerer Jura). Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. B (Geol. Paläont.), 81 : 1-11.Dugué, O., 1997 - La série jurassique (Carixien à Bajocien) de l’agglomération caennaise : la
coupe du périphérique entre Bretteville-sur-Odon et Eterville (stratigraphie et sédimentologie).Rapp. Int. Dép. Geol. Univ. Caen, 1-28.
Dugué, O., Fily, G. & Rioult, M., 1997 - Le Jurassique des Côtes du Calvados. Biostratigraphie,sédimentologie, paléoécologie, paléogéographie et stratigraphie séquentielle. Bull. Trim. Soc.Géol. Norm. Amis Mus. 85 (2) : 1-132.
Eudes-Deslongchamps, J.-A., 1838 - Remarques géologiques sur un banc calcaire qui surmonte,dans quelques localités du département du Calvados, le Calcaire à Polypiers des géologuesnormands. Mém. Soc. linn. Normandie, Caen, 6 : 238-248.
Eudes-Deslongchamps, J.-A., 1848 - Mémoire sur les Pleurotomaires des terrains secondaires duCalvados. Mém. Soc. Linn. Normandie, 8 : 1-160.
Fernández López, S., Pavia, G., Erba, E., Guiomar, M., Henriques, M. H., Lanza, R., Mangold,
C., Olivero, D. & Tiraboschi, D., 2009 - Formal proposal for the Bathonian GSSP (MiddleJurassic) in the Ravin du Bès (Bas-Auran, SE France). Episodes, 32 : 222-248.
Fischer, J.-C. & Weber, C., 1997 - Révision critique de la Paléontologie française d’Alcided’Orbigny. 2. Gastéropodes jurassiques. Masson, 1-300.
Gauthier, H., Rioult, M. & Trévisan, M., 1995 - Enregistrement biostratigraphique exceptionneldans l’ “Oolithe ferrugineuse de Bayeux” au Sud de Caen (Normandie, France) : complémentau stratotype du Bajocien. C. R. Acad. Sci., 321, II-a : 317-323.
Gerville, C. de, 1814, 1817 - Lettre à M. Defrance sur les fossiles du département de la Manche.J. Phy., Chimie Hist. Nat., 79 : 16 et 84 : 197.
Goldfuss, G. A., 1844 - Divisio quinta. Molluscorum gasteropodum reliquiae. PetrefactaGermaniae... 3 (5) : 1-120.
Gründel, J., 2003 - Neue und wenig bekannte Gastropoden aus dem Dogger Norddents-deutschlands und Nordwestpolens. N. Jahrb. Geol. Paläont., Abh., 228 : 61-82.
Henriques, M. H., 1992 - Biostratigrafia e paleontologia (Ammonoidea) do Aaleniano emPortugal (Sector Setentrional da Bacia Lusitaniana). Thèse, Centro Geociéncias Univ.Coimbra, Inst. Nac. Investigacao Cientifica.
Henriques, M. H., Gardin, S., Gomes, C. R., et al., 1994 - The Aalenian-Bajocian boundary atCabo Mondego (Portugal). In Proceed. Third Inter. Meeting on Aalenian and BajocianStratigraphy, Cresta, S. & Pavia, G., (eds), Vol. 5, Inst. Poligrafics e Zecca deuo Stato, 63-77.
Hérault, A., 1832 - Tableau des terrains du département du Calvados. Bonneserre, Caen, 1-192.Lebrun, P. & Courville, P., 2013 - Les gastéropodes pleurotomaires. 1. Des mollusques
”impériaux”. Fossiles, Rev. Fr. Pal., 13 : 25-40.Mayer-Eymar, K., 1864 - Tableau synchronistique des terrains jurassiques. Zurich.Munier-Chalmas, E., 1892 - Etude préliminaire sur les terrains jurassiques de la Normandie. C. R.
somm. Soc. Géol. Fr., 3e sér., 20 : 161-170.Olivero, D., Pavia, G., Fernández-López, S.R., Mangold, C. & Guiomar, M., 2010 - Le G.S.S.P.
du Bathonien à Bas Auran (Réserve naturelle géologique de Haute-Provence, France). Géol.Fr., 2010 (1) : 65-77.
Orbigny, A. d’, 1849 - Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques.Masson, Paris, I : 1-299.
Orbigny, A. de, 1850 [= 1847*, 1849*] - Prodrome de paléontologie stratigraphique universelledes animaux mollusques et rayonnés ... Vol. 1, Paris.
Orbigny, A. d’, 1851-1860 [= 1849#] - Paléontologie Française. Terrains jurassiques.Gastéropodes. Masson, Paris, 1-621.
Orbigny, A. d’, 1852 - Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphique.Masson, II (2) : 383-847.
Pavia, G. & Enay, R., 1997 - Definition of the Aalenian-Bajocian Stage boundary. Episodes, 20 :16-20.
Rioult, M., 1964 - Le stratotype du Bajocien. In Colloque du Jurassique à Luxembourg, 1962,Maubeuge, P.-L., (ed.), Publ. Inst. Gr.-Duc. Sect. Sci. Nat. Phys. Math., 239-258.
Rioult, M., 1980 - Bajocien. In Les étages français et leurs stratotypes, Cavelier, C. & Roger, J.,(coord.), Mém. BRGM, 109 : 73-83.
Westermann, G. E. G. & Riccardi, A. C., 1972 - Middle Jurassic ammonite fauna and biochronologyof the Argentine-Chilean Andes. I. Hildoceratacea. Palaeontogr., Abt. A, 140 : 1-140.
Références bibliographiques
F15-05-Pleurotomaires2:F15-05-Pleurotomaires2 05/08/13 18:55 Page37