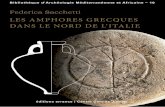Cadre institutionnel et investissements des diasporas dans les pays en développement
Les diasporas grecques Bréal
-
Upload
univ-montp3 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les diasporas grecques Bréal
Les diasporas grecques, du VIII° au III°
I) Définir les diasporas grecques du VIII° à la fin duIII°
A) Qu’est-ce qu’une diaspora ?
Diaspeirein : distribuer, disperser, disséminer. Apparition chez Plutarque au Ier après JC dans sa significationbiologique (dissémination du corps). Désigne ensuite la dispersion des Juifs après l’annexion de laJudée et la destruction du Temple de Jérusalem par Titus en 70après J.C. Etats-nations : la diaspora inclut ceux qui vivent àl’extérieur des frontières nationales, dispersés à travers lemonde. Puis aujourd’hui terme qui qualifie toute migration,expulsion... Larousse : 1) Ensemble des communautés juives établies hors dePalestine, 2) Dispersion d’un peuple, d’une ethnie à travers lemonde.
B) Diasporas grecques moderne, contemporaine et antique
3 caractéristiques essentielles du concept de diaspora selon M.Bruneau, Diasporas, 1995:
- Conscience et revendication d’une identité ethnique ounationale
- Existence d’une organisation politique, religieuse ouculturelle du groupe dispersé
- Existence de contacts sous diverses formes, réelles ouimaginaires, avec le territoire d’origine.
Pas question ici de frontières nationales. La « Grèce propre »peut jouer le rôle de « centre » par rapport aux établissementsgrecs fondés à l’époque archaïque mais par plus tardivement. Les colons hellénistiques : venus de toutes les régions,majoritairement des mercenaires, n’avaient aucun lien àentretenir avec qui que ce soit car n’avaient pas de « paysd’origine » ≠ colons de l’époque archaïque. + les Etats« hellénistiques » étaient des conglomérats ethniques où lesGréco-macédoniens constituaient une minorité.
Il existe plusieurs diasporas antiques appuyées sur desphénomènes différents et à des périodes différentes.
- D’abord à l’époque archaïque (VIII°-VI°): constellationd’établissements grecs installés en Méditerranées, en merNoire. = la « grande colonisation grecque ».
- Ensuite époque classique (500-323) : fondationscomparables et émigrations vers les établissements déjàexistants outre-mer. Phénomène des clérouquies fondées parAthènes. « Recolonisation de la Sicile » vers 340-338.
- Enfin époque hellénistique : Alexandre le Grand, villesfondées par les rois, colonies militaires (clérouquies enEgypte, katoikiai en Asie Mineure).
G. Prévélakis : il s’agirait de deux « stratégies » distinctes.- Organisation « galactique » : pas de centre- Organisation « dendritique » (en arbre) : cités grecques
des royaumes hellénistiques, avec « centre » (tronc) sedivisant en branches et sous branches.
Faire la distinction entre les diasporas issues d’actionsplanifiées comme la « grande colonisation grecque », lesimplantations initiée par les rois hellénistiques et lesdéportations et les diasporas spontanées dictées par lesraisons du moment.
C) Le vocabulaire grec ancien à propos des diasporas etquelques conventions modernes
Installation de colonies sur les rives des mers à l’époquearchaïque = phénomène contemporain à l’émergence de la cité. Terme de « colonisation » est moderne. Colonia : réuniond’hommes installés dans un autre pays. Mais ne pas parler de« colonialisme ».
Oikos : la maison, les biens, la famille. Donc « cellulefamiliale » et par extension « communauté ». Polis : communauté civique. Apoikos : celui qui quitte sa famille. S’installe dans uneapoikia. Oikistès : fondateur de l’apoikia, cher de l’entreprise« colonisatrice ».
Epoikos : colon venu dans un second temps. Ktistès : fondateur, surtout à l’époque hellénistique.
II) Les moyens d’aborder la question
A) Les sources
1) Sources littéraires
Archiloque de Paros : première moitié du VII° Sinon aucunesource réelle contemporaine de la « grande colonisationgrecque ». Hérodote et Thucydide se fondent sur une tradition orale et desouvrages perdus entre-temps.
Epoque classique : sources contemporaines. Thucydide, Xénophon,Platon, Aristote. Epoque hellénistique : Polybe.
Hérode et Thucydide (complété par Diodore de Sicile) sontdignes de foi concernant les dates avancées. Mais pas le caspour Eusèbe de Césarée.
Deux écrits anonymes. Un périple compilé à l’époque d’Alexandrele Grand, par le soi-disant pseudo-Scylax. Et un texte dupseudo-Scymnos.
Récits de fondation : Ktiseis. Pas d’originaux. Sujets à cautioncar se concentrent sur le fondateur et insèrent des épisodesmythiques. Quelques cas sont exploitables cependant. Hérodote sur Cyrène.Insistent parfois sur les causes de la colonisation, fontparfois l’apologie de cette dernière. La perception de ces mouvements est négative (départ douloureuxde chez soi) et positive (héroïque).
Absence de l’indigène. Présent seulement comme adversaire oupartenaire éphémère. Erèmos chôra : « territoire désert » que les colons auraientdéfriché, mythe.
Imaginaire des philosophes du IV° : recherche de matièrespremières, échappatoire pour le surpeuplement, solution pourprévenir les séditions (Platon), répartition égalitaire deslots et « démocratie » (Aristote).
2) Sources épigraphiques
Actes publics fournis par les cités grecques fondées ou par leschancelleries royales hellénistiques. Rareté des documentsarchaïques.
3) Sources numismatiques
Iconographie de la monnaie en tant qu’emblème civique :référence à l’histoire réelle ou imaginaire de la communauté etréférence au quotidien.
4) Sources archéologiques et iconographiques
Renseignements divers. - Moment de la première installation des colons grecs- Questions de la topographie (aménagement de l’espace,
emplacement du port, évolution de la zone sacrée...)- Commerce local et de longue distance- Démographie (nécropoles)- Evènements (incendies)
Archéologie aérienne utilisée pour les cadastres.
5) Sources papyrologiques
Egypte ptolémaïque : connaissances sur l’administration.
B) Thèmes d’étude et historiographie
D. Raoul-Rochette, Histoire critique de l’établissement des colonies grecques,1815 : observations encore valables parfois. Défavorisés etproscrits qui s’exilent, départ vécu comme un drame maisaboutit à la liberté politique et juridique des colonies. Mais affirmation fausse : colonisation été faite pour érigerune barrière devant la menace des « barbares »...
Causes économiques importants pour certains : accès auxmatières premières et possession des nouveaux territoires. XIX° : affirmation de l’indépendance politique et juridique del’apoikia à l’égard de sa métropole. Mais insiste sur ladépendance culturelle.
A. Gwynn, « The character of greek colonisation », 1918 :tournant dans l’histoire de la recherche. La colonisationgrecque est publique et n’est pas une action « civilisatrice ».Elle est planifiée. Ne vise des intérêts commerciaux que dansune moindre mesure et se veut surtout une réponse ausurpeuplement et à la crise agraire.
A l’époque des empires coloniaux indigènes peu cités etétudiés. Depuis la décolonisation on commence à étudier lesrelations de ces derniers avec les Grecs. Il y a« rayonnement » mais aussi « résistance ».
R. Osborne, 1998 : « a proper understanding of archaic Greekhistory can only come when chapters on ‘Colonization’ areeradicated from books on early Greece ».
C) Lexique
Agora : « place publique » où se rassemblent les citoyens pourprendre les décisions. Indice de la constitution de lacommunauté civique. Centre du commerce local.
Anabase : expédition militaire (Dix-mille de Xénophon,Alexandre le Grand).
Antigonides : rois de la dynastie ayant régné en Macédoine àl’époque hellénistique.
Apoikia : « le départ de chez soi ». Etablissements d’outre-mer.
Apoikos : membre de la communauté de l’apoikia, « colon ». Apoikoi :« colons originaires ». Epoikoi : « colons additionnels ».
Archégète : « guide en chef », « fondateur d’une cité ».Synonyme de l’oikiste.
Asty : noyau urbain de la polis.
Attalides : dynastie régnante à Pergame.
Autarcie : « autosuffisance ». Idéal de la polis : ne pas êtredépendante des importations.
Cabotage : navigation le long des côtes.
Chôra : territoire agricole de la polis. S’y trouvent les lotsdes citoyens (klèroi). Mythe de l’érèmos chôra (« territoiredésert »). Mythe de la doryktètos chôra (« conquise à la lance »).
Clérouque : militaire-colon, bénéficiaire d’un lot (kléros) àcondition qu’il défende la zone relevant de sa responsabilité.
Clérouquie : colonie militaire. Athènes puis les roishellénistiques. Les clérouques athéniens restent des citoyensd’Athènes (≠ apoikiai). En Egypte pas question des terresconfisquées car le roi est propriétaire de son royaume : lekléros assigné est alors inaliénable et héréditaire.
Diadoque : « successeur », première génération des successeursd’Alexandre le Grand, se partagent l’empire en 323.
Dynaste : toute personne ayant une part de souveraineté. Dansles sources littéraires et épigraphiques seuls les souverainsindigènes sont désignés comme tels.
Emporia : commerce à longue distance, commerce maritime donc.
Emporion : place de commerce maritime. 1) port d’une cité, 2)port de commerce situé outre-mer, place de commerce entremarchands grecs et autochtones, 3) marché installé àl’intérieur d’un pays sur les principales routes commerciales.
Emporos : commerçant à longue distance, outre-mer.
Epiclèse : tout nom ajouté ou substitué à un autre.
Epigone : successeurs des diadoques donc seconde générationaprès Alexandre.
Epimachia : « alliance défensive ».
Epoikos : « colon additionnel ». Réfugiés, expéditions derenfort organisées par la métropole (parfois pour simplementassurer l’avenir démographique d’une fondation). Apoikias’attend à en recevoir à tout moment : espaces délimités maisnon occupés donc réservés aux colons potentiels. Imprévul’emporte sur la planification : epoikoi deviennent souvent(selon Aristote) une source de discorde.
Eponyme : 1) Le nom peut être donné à une cité par un dieu ouun héros. L’éponyme (souvent mythique) est donc à distinguer del’oikiste réel ou imaginaire. 2) Le magistrat éponyme est celuiqui donne son nom à l’année civile en cours.
Ethnique : « indique l’appartenance à un ethnos » c'est-à-dire àun peuple ou à une cité.
Evergète : « bienfaiteur », citoyen ou étranger ayant apportédes bienfaits à une cité. A l’époque hellénistique désigne unroi ayant concédé des libéralités à une communauté civique. Leroi est considéré comme l’évergète absolu à l’époquehellénistique donc parfois marqué dans titulature.
Gymnase : lieu public pour les exercices du corps. Lieu où lesjeunes sont initiés à l’art du combat en formation (phalangehoplitique). S’y ajoutent, surtout à l’époque hellénistique,des activités relevant de l’éducation spirituelle.
Hégémonie : prééminence.
Hérôon : tombeau monumental consacré entre autres à un oikistedéclaré héros après sa mort. On y dépose des offrandes.
Héros : « demi-dieu », mais aussi mortel rangé parmi les dieux.Peuvent être héroïsés les oikistes.
Hilote : membre d’une des communautés paysannes soumises auxSpartiates. Hilotes de Laconie puis de Messénie. La communautédes hilotes est soumise au corps civique composé de Spartiates.
L’Etat assigne à chaque Spartiate un certain nombre d’hilotespour travailler ces lots.
Hoplite : soldat armé notamment d’une lance (dory), d’unbouclier (hoplon) et d’un casque. Entraîné à combattre dans unebataille rangée. Servir comme hoplite est à la fois un droit etune obligation pour tous les citoyens. Les progrès dans lacohésion de la phalange hoplitique vont de pair avecl’homogénéisation du corps civique (dèmos) de la polisémergente.
Iatros : « médecin ». Epithète divine adjointe à Apollon dansles apoikia milésiennes en mer Noire. Il demeure la principaledivinité dans le panthéon de la plupart des fondations de larégion et son prêtre en est le magistrat éponyme.
Isomoiria : supposée distribution égalitaire des lots (klèroi)assignés aux citoyens dans le territoire agricole (chôra) d’unecité.
Isopolitie : « égalité de droits civiques ». Privilège accordé àdes ressortissants d’une autre cité. Si ces derniers veulents’installer dans la polis leur ayant octroyé ce droit ilsdeviennent citoyens de leur patrie adoptive à condition derenoncer à leur citoyenneté originaire. De plus en plus deconventions bilatérales d’isopolitie entre cités.
Katoikia : « établissement », n’importe quel établissement demoins envergure. Désigne souvent des colonies installées àl’intérieur du pays dans le cadre d’une politique cohérente desrois hellénistiques, surtout des Séleucides et Attalides. Katoikos : colon résidant dans une katoikia.
Klèros : « lot », lopin de terre.
Kômè : « village ».
Ktistès : « fondateur », synonyme d’oikiste mais fait son apparitionau IV° donc surtout utiliser pour qualifier le fondateur d’unecité à l’époque hellénistique. Peut appartenir à la titulatureroyale officielle ou une épithète divine.
Lagides : rois d’Egypte de l’époque hellénistique, de 306 à 31.Le premier roi fut Ptolémée Sôtèr (« le Sauveur »). Egyptehellénistique souvent désignée comme « Egypte ptolémaïque » ou« Egypte lagide ».
Limèn : « port », au niveau topographique et technique.
Métropole : « cité-mère ».
Misthophoros : « mercenaire ».
Nomina : ensemble des lois.
Oikiste : chef des colons ayant fondé une apoikia. A l’époquehellénistique les nouvelles fondations n’était plus des oikoiindépendants, le mot figure alors rarement dans les sources :on préfère alors ktistès.
Oikizein : « fonder ».
Olympiade : intervalle de 4 ans entre 2 éditions consécutivesdes concours olympiques (Olympia).
Panhellénisme : ensemble des perceptions et des sentiments desGrecs d’appartenir, malgré le morcellement politique, à uneseule et unique communauté, ainsi que les manifestations qui endécoulent dont la fréquentation de sanctuaires communs à tousles Grecs. Hérodote : « Il y a le monde grec, uni par la langue et par lesang, les sanctuaire et les sacrifices qui nous sont communs,nos mœurs qui sont les mêmes ».
Paroikos : « qui demeure auprès ». A l’époque hellénistiquedésigne le statut juridique de certains étrangers domiciliés etdes indigènes établis sur le territoire rattaché à une cité.Ils sont propriétaires fonciers mais n’appartiennent pas aucorps civique (ne prennent pas part à la décision politique).
Parthénien : enfants issus des unions illégitimes des épousesde Spartiates avec des hilotes pendant que leurs épouxparticipaient à la « première guerre de Messénie ». Sparte
décida de les envoyer fonder Tarente sous les ordres del’oikiste Phalantos vers 706.
Pérée : frange continentale appartenant à une île située justeen face.
Phalange : « troupe rangée » constituée d’hoplites.
Philos : « ami du roi » à l’époque hellénistique, un statut unpart.
Phoros : « tribut ».
Phylè : membres dits provenant d’un ancêtre commun mythique. Lesphylai finissent par devenir des divisions civiques. Et l’époquehellénistique elles sont établies dès le moment de lafondation.
Polis : « cité », « ville » au sens topographique. Jusqu’auxconquêtes de Philippe II et d’Alexandre le monde grec étaitconstitué d’une multitude de « cités-Etats ». Seuls lescitoyens peuvent être propriétaires fonciers et participent àla vie politique ainsi qu’aux combats dans la phalange.Caractère agricole essentiel. L’ensemble des lois régissant lavie politique s’appelle politeia. Les poleis continuent d’exister àl’époque hellénistique mais sont englobées dans des royaumes.
Séleucides : roi de la dynastie régnant en Syrie de 306 à 64.Séleucos Ier Nikatôr (« le Vainqueur ») en premier.
Solécisme : faute faisant violence aux règles de la syntaxe.
Stasis : « soulèvement », discorde pouvant aller jusqu’à laguerre civile. Constante de l’histoire grecque, elle accompagnel’émergence de la cité à l’époque archaïque. Conséquences :violences, appel à des législateurs pourvus de pleins pouvoirs,coup d’Etat, instauration de tyrannies, masses d’exilés et deréfugiés, envoi d’apoikoi ou d’époikoi. Dans les diasporasarchaïque et classique elle se manifeste souvent comme unelutte pour la redistribution des terres entre les colonsoriginaires et les nouveaux venus. Là aussi apparition de
législateurs et de tyrans. Plus rares à l’époque hellénistiquecar surveillance des rois.
Sténochôria : manque objectif de terres cultivables dans lescirconstances d’un accroissement démographique inattendu. Oumanque relatif : répartition injuste des mêmes terres due à unaccaparement originaire par quelques familles dominantes.Souvent mise en avant par les sources comme principale cause dela « grande colonisation grecque ».
Symmachia : « alliance ».
Sympolitie : union de deux cités voisines. Accord commun ouconquête de l’une par l’autre. Le corps civique n’en faitdésormais qu’un seul. Les deux entités bénéficiaient déjà destructures propres à une polis (≠ synœcisme). Aussi parfoisabsorption d’une cité plus petite par sa voisine pluspuissante : la première est reléguée dans ce cas au rang d’unekôme.
Syngéneia : descendance d’un ancêtre commune, réelle ou fictive.
Synœcisme : « réunion de plusieurs oikoi ». Pour Aristote c’estla condition de la naissance des poleis. Synœcismes issus dedeux ou plusieurs poleis déjà existantes : on peut parler desympolitie. Le synœcisme exprimerait alors l’unificationterritoriale, la sympolitie l’unification « politique ».
Téménos : « zone sacrée », ensemble de sanctuaires d’unecommunauté. Topographie ici. Le hiéron est le sanctuaireconsacré à une ou plusieurs divinités, le téménos constitue latotalité des sanctuaires regroupés dans un même espacedélimité.
Topos : « lieu ». Peut avoir le sens de division administrativedans le cadre d’un royaume hellénistique.
Tryphè : « vie de plaisir ». Sybaris : les riches habitants enont subi les conséquences quand la cité fut détruite parCrotone.
Tyrannie : régime caractérisé par la domination d’un tyran. Ilprend le pouvoir par la violence et ne s’y maintient que grâceà la force. Peut être renversé à tout moment. Il y eu cependantde « bons » tyrans archaïques. A l’origine le terme sembleavoir été plutôt neutre. Epoque archaïque : instauration de latyrannie qui est souvent la conséquence directe de la stasis.Recrudescence de la tyrannie au IV, dans les milieux coloniauxoccidentaux (Italie du Sud et Sicile).
Xénia : « liens d’hospitalité ».
III) Caractères généraux de la « grande colonisationgrecque »
Précédés par les Mycéniens durant l’âge du bronze récent.Partaient de l’Egée vers le Levant, l’Egypte, l’Italie etl’Ouest méditerranéen. A la recherche de métaux. Ils ont mis enplace un véritable réseau commercial avec l’installation decomptoirs. Chute du monde des palais mycéniens vers 1 200.Ensuite « siècles obscurs ». Puis Phéniciens. S’installent parfois durablement : Carthagevers 814. Rencontrent les Grecs alors au début de leurexpansion. A l’époque classique le rôle des Phéniciens estassuré par leurs descendants, les Carthaginois, qui sedisputent avec les Grecs la suprématie dans le bassinoccidental de la Méditerranée.
« Grande colonisation grecque » est spécifique. C’est uneentreprise publique et planifiée. Stratégies commerciales(métaux ou céréales), sociales (surplus de population ouindésirables). Parfois même affaires privées évoquées par lessources mais ne seraient à l’origine qu’une phase exploratoirevisant à une stratégie plus lointaine à termes. La fondation d’une colonie n’implique alors pas une intégrationterritoriale, une annexion, même pas un rapport de domination àla métropole. Thucydide, Corcyréens, colons venus de Corinthe : « Que lesCorinthiens apprennent donc que toute colonie honore samétropole tant que celle-ci la traite avec égards, mais qu’elles’en détache quand on la traite injustement. Quand les colonsquittent la patrie, ce n’est pas pour être les esclaves de ceuxqui restent, mais pour être leurs égaux ».
Les apoikia sont de nouvelles poleis reproduisant les modèlesempruntés aux cités-mères. Modèle dominant de la polis qui estexporté et transplanté outre-mer. On estime qu’il y eu 140 apoikia issues de la colonisationarchaïque. Emporia (comptoirs) continuent d’exister parallèlement.Naucratis dans le delta du Nil, Al Mina (Syrie), Gravisca(Etrurie)... Points de contact entre Grecs et populationslocales.
Au total : les cités issues d’actes de fondation représentent1/5 du monde poleis. Après l’époque classique on recense 230apoikia. Monde grec = îles de l’Egée + littoral égéen de l’Asie Mineure+ Grèce continentale. On y ajoute la « Grande Grèce » (Italie),Corse, Sicile, Sardaigne, côte méditerranéennes de l’Andalousieaux bouches du Rhône, Afrique du nord, côte syro-phénicienne,mer de Marmara (appelée Propontide) et mer Noire (Pont Euxin). Platon : « Nous, qui habitons de Phasis jusqu’aux colonnesd’Héraclès, nous n’occupons qu’une petite parcelle, logés àl’entour de la mer, fourmis ou grenouilles, comme à l’entourd’une eau stagnante ».
IV) Débats sur les causes de l’aventure outre-mer
Réponse à la crise profonde et chronique des cités grecques dèsleur émergence. Poleis créées dans un contexte de troubles :troubles sociaux, problèmes de partage des terres (économique)et de participation à la décision (politique). Changementscruciaux : apparition des lois écrites, réformes sociales etjuridiques, innovations militaires et aventure outre-mer. Mobiles commerciaux : recherche de minerais, identification degreniers à céréales... Mobile typique : manque de terres.
Mais thèse « commerciale » : premiers établissements grecs duVIII° sont dans les mêmes régions que celles fréquentées parles Mycéniens : Italie, Sicile, détroit de Messine. On aparfois parlé d’une « route des métaux » mais vision en réseauxun peu trop simpliste, tout n’est pas rationaliste. Eubéens :Tarente se trouver sur leur route vers le détroit de Messinmais leur échappe... apoikia y est fondée par Sparte que vers
706. Difficile de reconstituer des « stratégies » commerciale àl’époque archaïque. Par contre la recherche des minerais reste une des causesmajeures de la colonisation grecque. Ils furent un mobileimportant dans le tâtonnement et dans l’implantation des« comptoirs » en Syrie, Phénicie et sur les côtes ibériques. Mais les histoires consacrées aux fondations ne disent presquerien des métaux et céréales.
Thèse du problème de la terre. Sources unanimes sur lasténochôria. Manque objectif de terres cultivables. Mais ils’agit aussi d’une répartition déséquilibrée des terres :accaparées par les grandes familles aristocratiques (problèmedes règles de transmission et ravages du surendettement). On sesitue avant l’apparition des premières lois écrites et loin desgrandes réformes sociales et juridiques mises en œuvre par lasuite pour remédier aux maux des poleis. Agriculture primitive soumise aux aléas climatiques. Périodesde famine. Archiloque de Paros : témoin oculaire de lacolonisation de Thasos, « la misère de tous les Grecs » avaitrejoint, selon lui, les colons originaires de Paros, lesquelsétaient eux-mêmes des « crève-la-faim ». Hérodote décrit le mobile qui pousse la cité de Théra à envoyerdes citoyens fonder Cyrène, en Libye. Sécheresse, disettes. Oikiste dans les récits de fondation : s’empare de terrescultivables (par les armes ou la négociation) et en assure ladistribution au sein de la nouvelle communauté.
Agriculture et commerce vont de pair. Les céréales, comme lesminerais et autres matières premières, sont objets de commerce.Pithécusses : vocation commerciale du site sur la « route desmétaux », présence d’ateliers métallurgiques. Les mêmes Eubéensde Pithécusses préfèrent ensuite Cumes sur le continent avec uncaractère agricole fort.
Sparte en dehors du phénomène, à part pour l’épisode de lafondation de Tarente. N’agit qu’avec des renforts occasionnelssur des fondations de cités extérieures. Fidèle à sa« doctrine » traditionnelle : hégémonie sur le Péloponnèse(refuse de prêter son aide aux Ioniens lors du soulèvementanti-perse de 499).
Athènes aussi absente. Polis pas impliquée mais certains de sescitoyens semblent avoir suppléé le manque d’initiativepublique. Le tyran Pisistrate, pendant son exil en Thrace, sejoint à une expédition coloniale eubéenne. Miltiadel’ « Ancien » se taille un domaine en Thrace où il fondeChersonèse de Thrace ? Deux grandes régions aussi à l’écart : Béotie (sauf pourHéraclée du Pont) et Thessalie. Les conditions agricoles yétaient meilleures et ne bénéficient pas d’une marinecompétitive.
Polis grecque : a une chôra (territoire agricole) et l’autarcieest promue au rang d’idéal économique. Des fondations n’ont jamais revêtu le statut de polis.Emporion : port avec activités commerciales qui s’y déroulent.Ne sont pas des apoikia et par conséquent pas des polis.Naucratis : mercenaires grecs recrutés dès Psammétique Ier(Ioniens et Cariens) et s’installent dans le delta du Nil.Amasis concède des privilèges au Grecs de l’emporion Naucratis.
Les emporia sont des établissements « commerciaux » et lesapoikia sont des poleis à territoires agricoles aux activitéscommerciales moins intenses.
Contexte social et politique des métropoles. Stasis : luttes quipeuvent être à l’origine d’un exile imposé par une décisionpublique. Il prend la forme d’une installation outre-mer.Archias : membre déchu du clan des Bacchiades qui font la loi àCorinthe, banni de son pays natal car condamné pour meurtre. Vafonder Syracuse avec ses partisans en 734. Tarente vers 706 : Sparte y envoie les Parthéniens issusd’unions entre femmes spartiates et hilotes ou jeunes gens derang inférieur.
Parfois grosse partie de la communauté concernée quand menaceextérieure : émigration de la peur. Ioniens de Colophon : chassés par les Lydiens, partents’installer en Italie méridionale, sur le golfe de Tarente en650. Conquête de l’Asie Mineure en 547 : panique chez les citésgrecques d’Ionie. Phocée et Téos sont abandonnées. Phocéenss’installent dans leurs colonies déjà existantes en
Méditerranée occidentale, surtout à Alalia. Ils deviennent desépoikoi. Les Téiens fondent des colonies en Thrace égéenne etsue la côte septentrionale de la mer Noire (respectivementAbdère et Phanagoria)Vagues d’époikoi milésiens vers les apoikiai déjà existantes :durant les années qui suivent la conquête perse de l’AsieMineure et après l’échec de l’insurrection anti-perse de Mileten 494.
« décolonisations » à la fin de l’époque archaïque : Perses,Etrusques, Carthaginois. Vers 540 les Phocéens doivent quitterAlalia et parte fonder Elée (future Vélia). Himère, Agrigente et Géla sont désertées après la bataille deGéla en 405, leur population se retire dans la région deSyracuse. La pression extérieure fut un facteur important dans ladynamique « coloniale ».
V) Les principales directions de la « grande colonisationgrecque »
- Apoikiai avec date exacte de fondation confirmée parl’archéologie. Italie méridionale et Sicile.
- Apoikiai avec date de fondation avancée par sourceslittéraire invérifiable. Côte sur de la mer Noire etbassin de la mer Marmara.
- Apoikiai avec des dates différentes avancées. - Etablissements sans sources écrites. Datation
archéologique. Comptoirs grecs d’Asie Mineure méridionale,de Syrie et de Phénicie.
- Apoikiai avec écart chronologiques entre source et donnéesarchéologiques. Parfois les sources archéologiques peuventrévéler des contacts précédant l’installation durable,« précolonisation ».
- Apoikiai sans sources et sans données archéologiques.
L’installation durable des Grecs dans une communautéd’outre-mer avait été précédée par un certain tâtonnement,une sorte de « précolonisation ». Majoritairement à titreindividuel, à des allers et retours à des fins strictementcommerciales.
Le mouvement de « colonisation » comprend deux grandesétapes.
o La première de la fin VIII° jusque vers 680 :concerne Italie + Sicile + côte illyrienne del’Adriatique + nord de l’Egée + bassin oriental de laMéditerranée (Asie Mineure, Syrie, Phénicie)
o La seconde étape jusqu’à la fin de l’époquearchaïque : régions déjà touchées + Méditerranéeoccidentale (Sardaigne, Provence, Espagne et Corse) +Afrique du Nord (Libye et delta du Nil) + mer deMarmara + mer Noire.
A) Première phase
Points de départ : - Eubée ; Chalcis. - Cités doriennes. - Cités dites « achéennes »
De manière occasionnelle Sparte, Messéniens, Locriens etIoniens d’Asie Mineure.
...
VI) Récits de fondation. La phase d’installation
Cause. Parfois tâtonnements préliminaires. Argumentd’autorité : consultation de l’oracle de Delphes qui devientpresque obligatoire. Hérodote : Dorieus, un spartiate, a tentéune aventure en Libye vers 514-512 sans consulter l’oracle maisfut chassé deux ans plus tard par les gens du lieu... Oraclepopulaire avant les expéditions ou rendu populaire justementgrâce à la colonisation ? sanctuaire panhellénique, lieu derassemblement donc possibilité d’échanger des impressions surdes voyages outre-mer.
Organisation de l’expédition ; commandement d’un oikiste.Parfois deux oikistes s’il y a collaboration entre deuxmétropoles. Colons font le serment de ne pas manquer à leursobligations. Effectifs entre 200 et 1000 personnes mais tourneautour de 300 en moyenne.
Véritable opération navale. Usage de navires militaires à 50rames (pentèkontoroi). Hérodote les mentionne pour les Théréenspartis pour Cyrène et des Phocéens embarqués par Alalia. Cesont les seuls passages qui fournissent des détails sur ledéroulement du voyage, les récits de fondation passent cespréliminaires du voyage.
Une fois débarqués les colons doivent obéir à l’oikiste quicommence par sacrifier aux dieux et allumer le feu emporté dufoyer de la métropole sur l’autel. Encadré par des devins parfois et par des arpenteurs il tracele plan de la future ville et délimite l’espace sacré. Lesecteur public comprend l’agora et la zone d’habitat. Cettedernière est lotie et prévoit des parcelles inoccupées pour lescolons ultérieurs. Puis s’empare du territoire environnant : négociations ouarmes. Partage la chôra ensuite. Oikiste : aristocrate marginalisé, chassé de la métropole ouexilé volontairement. ≠ époques ultérieures.
Eponyme : donne son nom à la fondation. Souvent dieu ou héros.Parfois héros inventé à partir du nom de la cité : Byzas pourByzance. Quête de prestige pour la fondation. Le héros auraitfréquenté le lieu avant la fondation par l’oikiste. Ulysse a été vu comme un protocolonisateur (Irad Malkin). L’oikiste devient lui-même un héros. Il peut fonder unedynastie étant un archégète : Battiades de Cyrène, successeursde Battos. Un tombeau est érigé pour lui dans l’agora.
Mais peu de colons donc peu de territoire acquis. Le premieraménagement fut donc peu avancé. Il y a eu un écart entre ledébarquement et la construction des premiers bâtiments. Il afallu un effort de plusieurs générations et un dynamismedémographique plus grand que celui potentiellement issu d’unpetit groupe de colons. Les premiers bâtiments culturels utilisaient des matériaux troppérissables et étaient trop modestes pour laisser des tracesarchéologiques.
Les expéditions initiales ne concernaient que des hommes. Saufexceptions : Strabon raconte que les Phocéens amenèrent une
femme à Massalia, Artémis d’Ephèse lui aurait donné l’ordred’accompagner les colons. Les femmes ne peuvent qu’être trouvées sur place. Rapt :Hérodote le rapporte pour les Milésiens installés en Carie. Ou« contrats » : noces de Massalia, entre le grec Alexidamos etAntée, la fille du roi Libyen. Mariages forcés : les tyransAristodème à Cumes et Cléarque à Héraclée du Pont auraientimposé des mariages entre femmes issues de l’aristocratie etdes esclaves (issus des populations indigènes soumises). Le corps des colons est métissé depuis le début. Nécropole dePithécusses : fibules féminines et de production autochtone.
Croissance démographique par assimilation de nouveaux colonsaussi. Zancle de Sicile a été fondée par des Chalcidiensd’Eubée en collaboration avec leurs congénères installés àCumes. Ensuite les Messéniens, chassés du Péloponnèse parSparte ont accompagné les Eubéens et des colons de Zancle pourfonder Rhégion. Le tyran Anaxilas de Rhégion changea d’ailleursle nom de Zancle en Messine.
Parfois il y a changement de site : les colons de Pithécussesdébarquent à Cumes sur le continent.
Les corps des colons est aussi hétérogène. Parfois apoikoi deprovenances différentes, epoikoi arrivés à plusieursreprises... Donc répartition égalitaire des lots discutée.Battos, roi de Cyrène : seul cas d’inégalité explicité dans lessources. Isomoiria (distribution égalitaire des lots) semblepourtant être une reconstruction idéal et anhistorique de lapensée du IV°. Les cadastres sont plus récents que la date defondation des apoikiai.
Plan en damier : Hippodamos (milésien), l’introduit à Thourioi,Rhodes et Milet. En fut le théoricien mais pas l’inventeur.C’est une création coloniale : Sicile et Italie du Sud. Ce planne répond alors qu’aux nécessités pratiques que suppose la vied’une communauté dont la cohérence n’est pas encore acquise.L’idée « égalitaire » n’est pas comprise. Les apoikia voient très vite se constituer une aristocratiefoncière. Les géomores (gomoroi), « possesseurs de terres » deSyracuse. De plus les législateurs (Zaleucos de Locres
Epizéphyrienne) et les tyrans (Cumes, Géla, Syracuse...) nesurgissent que s’il y a eds troubles et des luttes de factions.
VII) Rapports entre les apoikiai grecques et les populationsautochtones
Récits de fondation peu bavards sauf si épisode guerrier oudiplomatique. Problèmes du départ : se procurer des femmes +des terres + de la main d’œuvre. 2 types de traditions :
- Exploits des colons, obligés de se défendre et deconquérir petit à petit le territoire indispensable à lasurvie
- Bon accueil de la part des autochtones et conclusion d’un« contrat ».
Premier des modèles : Archiloque, poète archaïque participant àla conquête de l’île de Thasos par les colons de Paros, évoquedes combats menés contre « ces chiens de Thraces ». Par lasuite récits héroïques pour rendre hommage à des ancêtres etfaire revivre un passé glorieux ou pour expliquer l’état deservitude de plusieurs communautés autochtones du mondecolonial. Le terrain occupé par les colons aurait été unedoryktètos chôra (« territoire conquis à la lance »). Des communautés indigènes ont été soumises et contraintes detravailler les terres occupés. Les Corinthiens ont chassé lesSicules d’Orthygie avant de s’installer à Syracuse et desoumettre les Kyllyriens locaux (même statut ensuite que leshilotes de Sparte quasiment). Echecs aussi : Cnidiens menés par Pentathlos devant lesCarthaginois en Sicile vers 580. Pentathlos y perdit la vie,les colons s’installèrent dans les îles éoliennes. LesSpartiates de Dorieus, en Sicile, furent repoussés en 510 parles Elymes locaux alliés aux Carthaginois : ils se réfugièrentà Héracléa Minoa, la colonie de Sélinonte. Parfois sites indigènes détruits par des incendies (Métaponte).D’autres sites indigènes voient le jour dans l’arrière-paysreculé. Retraite et essai de regroupement des autochtones.Plusieurs anciens sites indigènes sont peu à peu fortifiés. Côtes de la mer Noire : peu de contacts avec autochtones quisont plus continentaux.
Deuxième modèle : cliché du « bon sauvage ». Barbare pascorrompu et donc plus proche de « l’âge d’or » alors que Grecserait entré dans l’âge de fer, corrompu par tous les maux.Justin rapporte un « contrat » conclu entre les Phocéensdébarqués à Massalia et les Gaulois alentours. Alliance scelléepar un mariage. Nicolas de Damas (historien) informe que lesPhocéens cultivaient chez eux l’ « amitié » et les mariagesmixtes avec les dynastes locaux. Stratégie payante du momentque leur était concédé « un territoire se suffisant à soi-même ». Il y a donc ici exportations des procédures auxfondations coloniales. Hyblon, le roi des Sicules, aurait concédé aux colons de Mégarele territoire de la future Mégara Hyblaia selon Thucydide. Le paradigme de la « concession » est plus manifeste pour lesemporia qui ne peuvent subsister que si leur existence esttolérée. Grecs dans le delta du Nil, à Naucratis. Ampurias, surla côte ibérique : existence de deux quartiers séparés pour lesPhocéens et les indigènes. Véritable « charte » (document épigraphique) délivrée par leroi thrace Cotys Ier et amendée par ses successeurs : définitles droits et obligations des emporitai venus de Maronée, deThasos et d’Apollonia du Pont pour s’installer dans la régionde Pistiros. Emporion de l’arrière-pays ici, pas sur la côte.
Collaboration entre Grecs et autochtones parfois poussées.Parfois action de colonisation commune. Miltiade l’Ancien,athénien, s’implante à Chersonèse et demande pour cela l’aidede Dolonques, tribu thrace. Les Sicules accompagnèrent aussiles Grecs de Sicile à Catane. Mais collaborations ne caractérisent pas l’ensemble desrelations entre les deux entités.
Onomastique présente une colorature phocéenne très prononcée :certaine fermeture à la pénétration indigène après les premierscontacts. Hérodote : les rapports entre les colons de Théra et lesindigènes étaient plutôt pacifiques. Puis expansion conséquentede l’apoikia sous Battos II. Riposte des indigènes. Autochtones essayent de récupérer ce qu’ils avaient alorsperdu. Cumes est attaquée par les Etrusques. Massalia estattaquée par les Ligures.
Byzance vers 220 : Polybe montre que les Thraces pillent lachôra et confisquent la récolte. La cité est alors contraintede racheter son bien contre d’énormes tributs.
Richesse du lexique grec autour de la mixité ethnique ouculturelle. Mixobarbaroi (« barbares mélangés » avec des Grecs),mixhellènes (« Grecs mélangés » avec des barbares), hémihellènes(« à moitié grecs »)... + les termes ethniques composés.
Chôra = territoire de la cité proprement dit ET/OU sphère dedomination.
Vision négative des Anciens sur l’influence autochtone sur lesGrecs : devienennt des hémibarbaroi. Syncrétisme religieux... Denys d’Halicarnasse : les Achéens du Pont-Euxin pratique enmer Noire une piraterie et seraient devenus plus sauvages queles barbares eux-mêmes. Sous l’influence des barbares d’Italie les gens de Sybaris etTarente auraient trahi la frugalité digne d’un Grec. LesSybarites en paye le prix, leur cité étant détruite en 510.Vision moralisatrice.
Les diasporas ont pourtant fourni Pythagore (Crotone),Archimède (Syracuse)... Héritage dialectal de la métropole : Mégara Hyblaia utilise lesous-dialecte mégarien. La pénétration des anthroponymes nongrecs est marginale. Il n’y a pas de raison de remettre enquestion « l’hellénité » des Grecs des diasporas.
VIII) Rapports entre les apoikiai et leurs métropoles
Oikiste emporte le feu sacré de la métropole. Une partie de lacité-mère se détache pour toujours afin de donner naissance àune nouvelle communauté. Rupture évidente politiquement :définition de la citoyenneté, mise en place d’un Conseil, demagistratures. Les apoikoi installés à Cyrène deviennent des citoyens deCyrène et cessent d’être des citoyens de Théra.
Mais pour le reste métropole qui se reproduit à petite échelle.Colons emportent les coutumes, les mœurs, les règles, les lois.La structure du corps civique aussi, les magistratures
originaires et la vie religieuse (culte, régime des sacrifices,calendrier...). L’éponyme est en principe le même. Basileus pour Mégare commeMégara Hyblaia, et par conséquent comme Sélinonte. Exceptionscependant : dans les apoikia milésiennes du Pont-Euxinl’éponyme est le prêtre d’Apollon Iètros.
En cas de fondation mixte il n’y a qu’une seule métropole qui apour l’essentiel légué ses nomina à la nouvelle polis.Généralement c’est la mieux représentée parmi les colons.
Si l’éponyme est un prêtre il peut être remplacé par le prêtred’une autre divinité devenue plus importante dans le panthéonde la cité entre-temps. A Odessos (fondation milésienne)Apollon Iètros cède l’éponymie au prêtre du « grand dieu ».
Langue : le grec n’est pas encore unifié. Dialectes (ionien,dorien, éolien) et sous-dialectes (mégarien pour le dorien).Géographiques. Les fondations parlent la langue des métropoles.Héritages cohérent le long de la période malgré le relatifisolement et en dépit de la coexistence avec des autochtonesnon grecs. Les alphabets sont aussi ramenés des métropoles. Callatis ou Chersonèse taurique : cités mégariennes entouréesde cités milésiennes. Mais conservent leur dorismes jusqu’à lafin de la période hellénistique voire impériale.
En tant que polise indépendante l’apoikia peut tourner le dosdéfinitivement à sa métropole. Mais avantages évidents à unerelation privilégiée : peuvent en être issus des colonsadditionnels, la métropole peut même déplacer sa flotte pouraider dans les conflits. Aussi possibilité de fonder unecolonie de deuxième degré conjointement à la métropole. Mise enœuvre de circuits commerciaux aussi. Et désir de se faireattribuer un passé lointain et prestigieux grâce à safiliation. Souvent alliances défensives ou offensives. S’y ajoutent desconventions d’isoplitie. Après sa « libération » par Alexandrele Grand et pendant la guerre des diadoques Milet s’empresse derenouer des liens avec ses fondations de la Propontide et duPont-Euxin en concluant des traités d’isoplitie. Surtout liens de piété : des deux côtés ont prend toujours soinde proclamer la syngéneia, la « consanguinité ».
Corinthe : seule métropole à parvenir à constituer un« empire » colonial à la haute époque archaïque. Liens forts. Thasos aussi : effet direct de la proximité car pérée plusqu’apoikia.
664 : Corcyre se soulève contre sa métropole Corinthe. Plustard ils renouent les liens et collaborent pour des entreprisescoloniales. Mais, selon Thucydide, « Ils se dispensaient eneffet de témoigner (à Corinthe), à l’occasion des fêtesnationales, les marques de respect habituelles et d’offrir lesprémices de leurs sacrifices à des citoyens de Corinthe, commecela se fait dans les autres colonies ». Les Corcyréens serapprochèrent d’Athènes en dépit des sommations de Corinthe etfurent décisifs dans le déclenchement de la guerre duPéloponnèse. Les impératifs du moment ont rendu la syngéneiacaduque.
Thasos : liens étroits aussi. En 407 les citoyens de Néapolisde Thrace demandèrent à leurs alliés athéniens, avec lesquelsils combattent les Thasiens, de supprimer du décret athénien enleur honneur le syntagme « apoikoi de Thasos ».
IX) « Colonisation de deuxième degré » et« décolonisation »
Apoikiai longues, aux circonstances favorables et surtout àl’essor démographique assurant une stabilité : Syracuse,Tarente, Massalia, Cyrène, Byzance, Chalcédoine, Héraclée duPont, Istros, Olbia. Parmi les apoikiai les plus importantes certes décident defonder de nouveaux établissements. Mais pas de grandesexpéditions outre-mer, les circuits sont plus restreints.
Cyrène met en place un réseau local. Thasos organise sontpérée. Seules expéditions à distance : apoikiai fondées par Syracuseau IV° sur la côte illyrienne de l’Adriatique. Et apoikiai deSinope, Chalcédoine et Héraclée du Pont en mer Noire. Cependant ces fondations restent des polis, même à proximité deleur métropole. Pas juste chôra fortifiée donc. Mais fort degréde dépendance à l’égard des métropoles tout de même.
Problème récurrent du surpeuplement : afflux d’époikoi...Fondation de Sélinonte s’explique par le fait que MégaraHyblaia est déjà surpeuplée au bout de 2 à 3 générations. Aussi buts stratégiques : fondation de Rhégion par les Eubéenspour s’emparer du contrôle du détroit de Messine. Pérée deThasos permet d’avoir des avants postes sur le continent. Recherche de matières premières aussi, mobiles commerciaux. Emigration forcée parfois : Phocéens chassés par les Etrusques.Finalement mêmes causes que pour la colonisation primaire.
Parfois existence courte : Siris, 660-550. Sybaris détruite parCrotone en 510.
2 causes de « décolonisation » à l’époque archaïque : - Pression exercée par les grands royaumes d’Asie :
destructions des comptoirs de Cilicie par les Assyriens deSennahérib.
- Guerres coloniales : conquête et abandon de Siris etSybaris, destruction de Parthénopè par sa propremétropole, Cumes...
3 causes à l’époque classique :- Pression exercée par les indigènes : « massacre
hellénique » de Rhégion (Diodore) dans le contexte de laguerre Tarente-Iapyges, abandon des apoikiai de Lucanie...
- Conquête d’une colonie par une autre : destruction deplusieurs colonies en Sicile par les tyrans de Syracuse audébut V° (Géla, Mégara Hyblaia), déportation desChalcidiens de Naxos et Léontinoi.
- Pression extérieure : conquête carthaginoise de la plusgrande partie de la Sicile en 405.
X) Phénomènes diasporiques à l’époque classique
A) Apoikiai plus ou moins comparables à celles d’époquearchaïque
Moindre intensité et nouveaux protagonistes.
Athènes parmi les métropoles : époque de la confédération deDélos, commence à envoyer des colons. Amhipolis e, Trace,
fondée en 437 : habitants désignés comme « Amphipolitains »donc distingués des clérouques qui sont forcément des« Athéniens ». Mais il s’agit d’un type particulier de fondation,politiquement dépendante de sa métropole. Il s’agit d’une« propriété athénienne. L’orateur athénien Eschine dira àPhilippe II : « Mais si tu t’empares d’Amphipolis, la ville desAthéniens, tu ne possèdes pas ce qui est à eux, mais la terredes Athéniens ». Décret athénien sur l’envoi d’une apoikia à Bréa enChalcidique : oikiste surveillé par les autorités athéniennes.
Rapport de dépendance résulte de la tradition autour de lafondation « panhellénique » de Thourioi. 2 oikistes. En 434,selon Diodore, il y eu une querelle, « Les Athéniensrevendiquaient la conduite de la colonie, arguant que lamajorité des colons était venue d’Athènes ». Les Péloponnésiensavançaient le nombre important de colons venant de leursvilles. « Ils finirent par envoyer à Delphes demander quidevait être appelé colonisateur, et le dieu répondit qu’ilfallait le tenir lui-même pour le fondateur. Ainsi fut apaiséela dispute, on proclama Apollon fondateur de Thourioi ».
Sparte : exception de Tarente auparavant. Puis fondationd’Héraclée Trachinienne en Thessalie en 426.
Côte illyrienne avec jusque-là pirates protégés par lesdynastes locaux. Retarde l’exploration. Mais envoi progressifde colons : Syracuse veut développer son réseau en dehors del’île de Sicile, implante des fondations à Issa et Pharos (deuxîles en face de la côte illyrienne). Issa implantera desfondations de « troisième degré » : Corcyre la Noire...
En mer Noire : colons envoyés par Héraclée du Pont s’installentà Chersonèse taurique en 422.
B) Clérouquies athéniennes
Invention de la fin du VI°. D’abord île de Salamine mais perduerapidement. Ensuite Sigée en Troade qui semble avoir été unepropriété personnelle des Pisistratides plutôt qu’unepossession gérée par la cité athénienne.
506 : Chalcis d’Eubée est conquise par Athènes. 4 000clérouques y sont installés et allotis selon Hérodote. « loi deSalamine », document public athénien qui définit le but de laclérouquie implantée : « payer des taxes aux Athéniens etprêter le service militaire pour eux ». Dans les textes officiels athéniens du V° le terme d’époikossemble pouvoir désigner un clérouque. Le but de ces garnisons est de répondre à la crise agraire etau surpeuplement ainsi que mieux surveiller les pointsstratégiques. Les clérouquies semblent plus économiques quel’envoi d’apoikiai car ces dernières n’ont pas de taxes à payerni de service militaire à rendre. Les clérouques demeuraient des citoyens athéniens.
Les soldats-colons sont allotis. Le mot klèros a d’ailleursdonné son nom aux clérouquies. Tirage au sort (sens premier deklèros) évoqué parfois dans la distribution des lots : Mytilènede Lesbos en 427, Thucydide, « Les Athéniens partagèrent toutle territoire de Lesbos, Méthymna mise à part, en 3000 lots.Ils en consacrèrent 300 aux dieux et attribuèrent les autrespar tirage au sort à des clérouques athéniens, qui furentenvoyés dans l’île ».
Aussi manière de caser les démunis.
Athéniens devaient aussi surveiller leur « empire » constituéde cités membres. Surveiller des « alliés » récalcitrants. En revanche les clérouques ne sont pas tous issus desdéfavorisés, il y en avait des biens nantis que l’allotissementrend plus riches encore. Les clérouquies devinrent une excellente solution deravitaillement, surtout en céréales, pour une Athènessurpeuplée et surtout un réservoir essentiel au trésor public :les revenus rapportés annuellement par les clérouquiestournaient autour de 400 talents, soit autant que les tributscollectés des « alliés » de la confédération.
Le territoire appartient à Athènes, les clérouques en ontl’usufruit. Effectifs : 2 700 à Lesbos en 427, 1 000 à Chersonèse de Thraceen 447, 500 sur les îles de Naxos, Mélos et Andros.
Installation de clérouquies qui entraîne souvent une réductionparfois spectaculaire du tribut dû à Athènes par les citésconcernées : Chersonèse de Thrace payait 18 talents en 453 etseulement 1 talent en 447 après l’installation de laclérouquie. Cependant : les clérouquies sont l’expression d’une politiquede force, territoire confisqué aux dépens de la communautélocale, déportations voire anéantissement de la populationlocale. A Chalcis les Athéniens « tuèrent beaucoup de monde eten firent 700 prisonniers », selon Hérodote. A Lesbos ilsexécutèrent « un peu plus de 1000 hommes », Thucydide.
Histiée d’Eubée, Lemnos, Imbros : sources considérables pour leravitaillement d’Athènes. Cette dernière y envoie ses élitesterriennes pour nourrir les démunis de la ville. L’essor des clérouquies concorde chronologiquement avec l’envoiplanifié d’apoikiai. C’est peut être vers ces dernièresqu’auraient été dirigés les démunis. Les clérouquies ne sontconcernées que dans une moindre mesure.
Apoikiai : alléger la masse de la population urbaine et gagnerde futurs hoplites l’allotissement des thètes (les citoyens lesplus pauvres). Clérouquies : assurer le ravitaillement et caractère militaire.
Athènes capitule en 404 devant Sparte et doit retirer toutesses clérouquies sauf Scyros, Lemnos et Imbros. Il ne s’agit pasd’un coup militaire mais économique : la retraite desclérouques entraîne une croissance énorme de la population queles ennemis comptent voir mourir de faim + suppression d’unesource de ravitaillement primordiale. Deuxième confédération maritime athénienne en 377 mais sanshégémonie : prévoit explicitement qu’il est interditd’installer des clérouquies chez les alliés. Mais rien destipuler sur les non-membres. Des clérouquies athéniennes sontalors réinstallées à Salamine, Chersonèse de Thrace et Potidée.Occupation en plus de Samos : 3 contingents de clérouques ysont installés dont un de 2 000 individus. Chassés par PhilippeII en 356 après 10 ans d’occupation.
On a retrouvé une inscription de Samos comportant une liste declérouques athéniens. Il y avait en fait parmi ces clérouquesun nombre important de personnes résidant effectivement àAthènes. Les clérouques sont donc très mobiles. Athènesdevaient attendre de leur part des convois céréaliers et destaxes plutôt que des compétences militaires : peu importe s’ilsséjournent sur l’île ou à Athènes.
C) Villes fondées par des tyrans, des stratègesvictorieux ou des rois
Terme ktistès fait son apparition. Fonder des villes répond à la nouvelle nécessité : caser lessans-patrie issus des mercenaires non utilisés, des réfugiés etdes exilés. Degré croissant de professionnalisation de l’arméeamène une croissance des sans emploi dans les temps de paix.Ils pillent donc.
Sparte : première à avoir fonder une apoikia en Grèce même :Héraclée Trachinienne. Suivie par Epaminondas, héros thébain vainqueur à Leuctres, quifonde Messène en Péloponnèse pour mieux surveiller Sparte. Yfurent installés des hilotes. Diaspora au sein de la Grèce propre qui obéit largement auxtraditions de fondation archaïques. Epaminondas est perçu commeun oikiste d’antan.
Sicile : tyrans deviennent fondateurs. Hiéron Ier : oikisteautoproclamé d’Etna. Denys l’Ancien pour Tyndaride.
Fondations royales : Philippe II de Macédoine fonde Philippesen 356 en Thrace. Puis Philippopolis. Désormais le roi fondateur Ktistès incarne l’éponyme etl’oikiste.
D) Epoikoi
Installation à Naupacte d’un groupe venu de la Locrideorientale et Chaleion. Epoikoi samiens à Zancle, mais rapidement chassés vers 486 parle tyran Anaxilas de Rhégion qui rebaptise alors Zancle enMessine.
E) Diasporas militaires : garnisaires et mercenairesitinérants
Après les défaites des Perses les Athéniens installèrentsurtout des garnisaires dans les villes grecques d’AsieMineure. Le but premier était de surveiller Corinthe,adversaire traditionnel.
10 000 de Xénophon : diaspora mobile ou errante.
F) Diasporas composées de réfugiés et d’exilés
Luttes politiques de plus en plus acharnées entre cités. Le roi macédonien Alexandre Ier Philhellène a accueilli desréfugiés en provenance de Mycènes dans les années 460. Les factions démocratiques renversées après des coups d’Etatdans leurs cités se réfugient souvent auprès des Athéniens qui,à l’époque de Périclès, étaient des champions de la démocratie.Installation de réfugiés messéniens à Naupacte en 456 par lesAthéniens.
Essor important au IV°. 3 000 Messéniens impliqués dans un coupd’Etat périrent dans leur tentative de s’emparer de Cyrène en401 : ces réfugiés perpétuels fuyaient constamment Sparte quivoulait les attacher à la glèbe. Ils se sont installés enpartie à Naupacte puis en furent chassé, se sont installés àTyndaride... en 370 le thébain Epaminondas leur donna unepatrie.
Entre 359 et 347 6 cités seront détruite en Grèce centrale etdu Nord : Sestos, Potidée... les habitants de ces deux citésseront transformés en esclaves. Les rescapés des désastres sontcontraints au refuge et donnent naissance à de nouvellesdiasporas.
G) Diasporas issues de recolonisations
En Grèce disparition de communautés et dislocations depopulations semblent dépasser la fondation de nouvelles villes.En Grande Grèce et Sicile les deux phénomènes sont pluséquilibrés.
Attaques de peuples italiques, politique agressive des tyransde Syracuse au début V°, conquête de la Sicile par lesCarthaginois en 405.
Cumes fonde une « nouvelle ville », Néapolis vers 470. Géla et Camarine sont restaurées après la chute de la tyrannievers 465. Naxos et Léontinoi aussi mais ces dernières serontannexées à Syracuse par Denys l’Ancien. Thourioi refonde Siris qui devient Héraclée de Lucanie.
XI) Processus de colonisation à l’époque d’Alexandre leGrand et de ses successeurs
Conquête de l’Orient jusqu’à l’Indus, largement continenetal. Cadre politique assuré par la conquête. Masse énorme demercenaires. Alexandre fonde plusieurs Alexandries dont celle d’Egypte en331, invite à la mixité gréco-indigène par les « noces deBabylone ». Les diadoques, les épigones et autres roishellénistiques fondent des établissements également.
Région urbanisée et politisée : façade égéenne de l’AsieMineure avec poleis anciennes. Régions déjà en contact avec la Grèce : Carie, Lycie, île deChypre.
Les nouvelles fondations hellénistiques sont plus nombreusesdans les régions auparavant non urbanisées, surtout en Syrie,sans préjudice des satrapies orientales. Plus rares dans lapartie occidentale de l’Asie Mineure, déjà fortementhellénisée.
A) Villes fondées par les rois
Ktistès, fondateur : officiellement adjoint aux noms des roishellénistiques.
- Auteur d’une fondation ex nihilo- Initiateur par décision impérative d’un synœcisme
réunissant des communautés de moindre taille déjàexistantes
- Auteur par décision officielle d’une promotion d’unecolonie militaire ou d’une communauté initialementindigène au rang de cité.
+ sens métaphorique : décrets honorant les rois pour leslibéralités et franchises accordées. Le roi est alors « denouveau fondateur » car la vie en communauté recommence sousles meilleurs auspices...
Est aussi l’éponyme. Alexandreia, Antigoneia, Ptolémaïs,Antioche, Nicomédie... aussi Laodicée, Bérénikè pour lesreines. Le changement de nom fait suite au changement politique.
2 vagues : - Alexandre le Grand puis Antigone le Borgne et Lysimaque. - Séleucides. Séleucos Ier pour la Tétrapole syrienne
(Séleucie de Piérie, Antioche sur l’Oronte et Apamée) etLaodicée sur Mer. Antiochos Ier et II ensuite ; Antiochedu Méandre,...
B) Villes issues de synœcismes et de sympolitiesentre des poleis préexistantes
En Troade Antigone le Borgne créa une autre Antigoneia enréunissant 7 petites communautés initiales en 309. Lysimaquerefonda cette cité qu’il rebaptisa Alexandrie.
Sympolitie : réunion de deux poleis voisines en une seule. EnIonie Héraclée du Latmos avec Pidassa.
C) Villes issues d’anciens établissements indigènes
Parfois simple promotion. Sardes en bénéficia de la part du roiAttale Ier. Mais plupart des cas : colonie militaire préalable ou affluxremarquable de Grecs. Parfois réunion de plusieurs villages indigènes autour descolons militaires déjà établis dans la région : un politeuma,comme Tyraion en Phrygie.
Syrie : cohabitation en villes juxtaposées. Alep : un fort dunom de Béroia témoigne de l’origine macédonienne de colons.
Colonisations secondaires conçues comme renforts pour lesgréco-macédoniens. Colons additionnels dirigés vers des régionséloignées et donc plus isolées. Magnésie du Méandre fournit denouveaux colons à Antioche de Pisidie par exemple.
Différence quantitative entre royaume séleucide et l’Egyptelagide : cette dernière est relativement peu urbanisée.Alexandrie devient, certes, la plus importante cité du mondegrec, mais elle est seule. Peu de villes fondées par lesPtolémées et presque toujours à l’extérieur de l’Egypte.
D) Autres colonies gréco-macédoniennes : clérouquieset katoikiai
Egypte des Ptolémées : pays agraire. 3 problème : caser lesmilitaires ° surveiller la terre occupée + profiter dupotentiel agraire. Solution = clérouquies. Klèroi temporairement détachés de laterre royale et assignés à des soldats en échange de leursservices militaires. Clérouques implantés dans des villageségyptiens. Leur terre est en fait exploitée par des autochtonesmais ils en perçoivent le revenu. Il y a parmi eux des vétérans mais pour la plupart ils viventen garnisaires et donc peuvent être recrutés à tout moment pourune guerre. Le klèros est héréditaire et ne peut être repris par le roi quesi celui-ci estime que le clérouque ne s’est pas acquitté destâches nécessaires.
Attention : clérouquie ≠ katoikia. Dans les sourceshellénistiques il y a des katoikoi mais rarement des katoikiai.Et rien n’indique que ce sont des fondations militaires. Il existe 3 types de colonies :
- Militaires composées de garnisaires (parfois appelékatoikoi)
- Agraires- Agraires et militaires à la fois. Seules celles-ci peuvent
être rapprochées des clérouquies lagides. -
Ces colonies répondent à des buts stratégiques. Susceptiblesd’offrir une base solide de mobilisation en cas de guerre.
Certaines colonies militaires peuvent être promues au rang decités.
« Les trois caractéristiques du concept de diaspora sont : laconscience et le fait de revendiquer une identité ethnique ounationale ; l’existence d’une organisation politique,religieuse ou culturelle du groupe dispersé ; l’existence decontacts sous diverses formes, réelles ou imaginaires, avec leterritoire ou pays d’origine. L’on est membre d’une diasporapar choix. ». Dichotomie Grecs/non-Grecs est partout présente dans lessources de l’époque. Diffusion de l’organisation politique, religieuse et culturellede la mère-patrie : la polis. Extrême mobilité propre à cette époque donc contacts avec lesterritoires d’origine. Communautés intégrées à des royaumes sur lesquels régnaient desGrecs mais demeurent entourées de non Grecs. L’hellénisation adonc des limites évidentes.