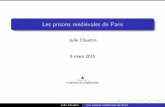4. Les Grands Paris de Paul Delouvrier (préface de Jean-Paul Huchon)
Les Cris de Paris ou le peuple travesti. Les représentations des petits métiers parisiens...
-
Upload
univ-paris8 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Les Cris de Paris ou le peuple travesti. Les représentations des petits métiers parisiens...
1
« C’est la canaille… ». Est-ce que j’en suis ?
« Ce n'est pas le pilier du bagne, C'est l'honnête homme dont la main Par la plume ou le marteau Gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille Des jours et quelques fois des nuits. C'est la canaille, et bien j'en suis »1.
À Daniel Roche
Au moment de prendre la plume pour rédiger le texte qui doit accompagner la réédition de mon premier livre, Les Cris de Paris ou le peuple travesti, deux lectures se sont imposées à moi, par les hasards de l’édition et d’une curiosité maintenue pour ce qui concerne le peuple de Paris2. Le dernier ouvrage d’Arlette Farge tout d’abord, La déchirure, qui poursuit avec une belle obstination le questionnement des « vies fragiles », celles des existences ordinaires et des milieux populaires3. Cet essai explore la souffrance des corps au travail, des corps malades, des corps blessés ou accidentés, des corps enfermés par décision de justice ou pour fait de vagabondage, des corps vendus pour des amours vénales, des corps tenaillés par la faim, des corps qui s’affrontent dans l’urgence de la survie et la promiscuité ordinaire4. De ces corps que le discours des élites de la culture et de la fortune décrit, hors quelques élans de compassion, comme animal, ensauvagé, brutal, mais surtout presque « naturellement » accoutumé à la souffrance. En ouverture et par souci du contraste, Arlette Farge évoque la progression du « souci de soi » au sein des élites, le désir de médicalisation, les formes multiples d’accompagnement de la douleur, de moins en moins acceptée comme une épreuve nécessaire au Salut quand le Siècle des Lumières valorise « l’idée neuve » du bonheur ici-bas. Pour les observateurs, moralistes, voyageurs, correspondants de la Société royale de médecine, le corps du peuple reste enfermé dans son étrange altérité et manifeste l’étonnante résilience de ceux qui sont - « de naissance » - durs à la peine. Ceux-là peuvent aussi être motivés par le souci d’améliorer un certain ordre des choses, de préserver la « peuplade » qui fait la puissance des Etats, la richesse de leur économie. Mais la « naturalisation » de la misère conduit le plus souvent à l’indifférence, à l’acceptation. À travers ce contraste, Arlette Farge suit son fil rouge coutumier : comment retrouver les traces de ces vies ordinaires, l’expression des sentiments, des joies et des peines de ceux qui n’ont « pas d’histoire » ? Et que dit de la société d’un temps, la manière de considérer le peuple, les pauvres et la misère sociale ? Le second ouvrage est d’un autre registre. La géographe Anne Clerval dans Paris sans le peuple, analyse de manière implacable la progressive éviction des classes populaires de la capitale5. Ce livre s’inscrit dans un courant de recherche de la géographie sociale et de la sociologie, bien représenté dans le monde anglo-saxon, qui s’attache à décrire le processus et 1 La canaille, parole et musique de J. Darcier et J.-B. Clément (1865, 1871) 2 Les contraintes de cette réimpression sous un nouveau format ne permettent pas de corriger les coquilles et imperfections de la première édition. Je reste donc responsable de ce qui dépare. La bibliographie sera également datée. 3 A. Farge, La déchirure. Souffrance et déliaison sociale au XVIIIe siècle, Paris, Bayard, 2013. 4 Ce dernier ouvrage se situe dans le prolongement de, A. Farge, Effusion et tourment, le récit des corps. Histoire du peuple au XVIIIe siècle, Paris, Odile Jacob, 2007. 5 A. Clerval, Paris sans le peuple. La gentrification de la capitale, Paris, La découverte, 2013
2
les modalités de la gentrification des villes6. La transformation matérielle de la ville qui accompagne la modification de la sociologie de ses habitants passe beaucoup moins désormais par des opérations de rénovation radicale, supposant la destruction du bâti ancien à la différence de ce qui se pratiquait dans les années 1960-1970. On privilégie plutôt la réhabilitation de l’habitat et l’embellissement d’un environnement urbain dont on souhaite préserver l’authenticité formelle. Les acteurs de la gentrification aiment les quartiers populaires, leurs immeubles et leurs places, mais sans le peuple, sans les bruits du peuple, sans les pratiques sociales et spatiales du peuple citadin qui ne parvient plus de toute façon à suivre la courbe des prix immobiliers. Le diagnostic posé est plutôt pessimiste car la politique de « logement social » poursuivie depuis une dizaine d’années, analysée avec précision, ne parvient pas enrayer le processus, quand elle ne l’accompagne pas7. On pourrait voir dans les pratiques des gentrificateurs, dans leurs discours et leurs représentations, l’équivalent d’un désir d’encanaillement sans risque… Et celui-ci m’a fait inexorablement songer à ce que j’avais cru percevoir en étudiant dans le temps long les séries gravées de Cris de Paris, c’est-à-dire un processus de dé-réalisation du peuple, de travestissement et d’apprivoisement, parfaitement compatible avec sa « patrimonialisation ». Le peuple ne devient acceptable que lorsqu’il n’est plus qu’un « signe » susceptible d’être investi par autre chose que lui-même. Reste une fois encore le sentiment que le discours qui constitue le Paris populaire fonctionne d’autant mieux que le peuple en est absent, comme un nouvel avatar de cette « beauté du mort » qui caractérise l’entreprise folkloriste, dont Paris a aussi été un objet8. Le chercheur butte une fois encore sur les enjeux socio-politiques, culturels, parfois implicites, qui se nouent autour de la mise en scène du « populaire ». Ce qui unirait mes curiosités anciennes et ces lectures récentes, ce serait l’intérêt que je porte au peuple de Paris, partie de mes « racines », comme sujet essentiel, mais toujours fuyant de l’histoire sociale. Comme si je pouvais, mieux aujourd’hui qu’au moment de mes études, concevoir une obsession du silence et de la perte, une gêne sous-jacente envers des discours construits par d’autres et qui peuvent s’apparenter à une forme de dépossession, même si la réappropriation et la contestation de ces discours « dominants » par les principaux intéressés est dans l’ordre des possibilités libératrices. Les milieux populaires parlent d’eux-mêmes avec parcimonie, laissent, en apparence, peu de traces ou de traces dignes d’être conservées. Les traumatismes vécus confortent parfois ces silences entêtants et assourdissants pour les générations suivantes, autant qu’ils favorisent d’autres fois les prises de parole, la construction des identités et des mythologies familiales. L’histoire économique et sociale des années 1960-70, dans le sillage de l’Ecole des Annales a pourtant su collecter une masse d’informations permettant d’éclairer les conditions de vie ordinaires et majoritaires, les cadres matériels et humains, la précarité longtemps dominante du royaume paysan comme du petit peuple citadin. L’itinéraire de Pierre Goubert, à la recherche de ces éclairages éloignés des ors
6 Outre la bibliographie de l’ouvrage précédent, on peut se reporter aux diverses contributions rassemblées par S. Tissot dans Centres-Villes. Modèles, luttes, pratiques, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 195, Décembre 2012. 7 L’évolution en cours n’est toutefois pas linéaire et il existe des noyaux de « résistances » où la présence de certains groupes de populations gêne ou retarde la gentrification. J.-L. Robert, qui parie sur une certaine inertie du bâti et sur le rôle des cultures politiques et associatives, sur la présence d’espaces d’habitation populaires, insérés dans un tissu urbain qui ne peut devenir un espace de relégation, présente des analyses moins pessimistes ; voir J.-L. Robert, Plaisance près Montparnasse, quartier parisien, 1840-1985, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012 ; voir également le travail plus ancien de thèse de G. Jacquemet, Belleville au XIXe siècle : du faubourg à la ville, Paris, EHESS , 1984. 8 M. de Certeau, D. Julia, J. Revel, « La beauté du mort », La culture au pluriel, Paris, U.G.E., 10/18, 1974, p. 55-94.
3
des palais, depuis l’histoire démographique jusqu’aux sources de l’histoire judiciaire et de la criminalité, en passant par les cahiers de doléances est à ce titre exemplaire9. Plus qu’historien du peuple, même s’il entendait lui rendre une justice posthume, Pierre Goubert fait l’histoire des rapports de dépendance et de domination ; il ne néglige jamais la complexité du monde social et ses dynamiques. Il refuse tout ce qui pourrait s’apparenter à une réification des milieux populaires, forme élaborée du mépris social, stade ultime de la dépossession. Dans cette histoire des formes de domination, Goubert est pourtant resté en deçà de leur expression à travers les sources que l’on dira culturelles, textes littéraires, iconographie notamment, dont il se méfiait beaucoup. L’introduction qu’il donne au livre resté inachevé que Mariette Erica-Benabou a consacré à la prostitution parisienne et à la police des moeurs au 18e siècle, avoue très honnêtement à la fois ses réticences envers ce type de documentation et son intérêt face à qui parvient à les mettre en œuvre de manière convaincante10. Pouvait-on hors des grandes séries des sources de l’histoire démographique, de l’histoire économique et sociale, bientôt des sources notariales et de la culture matérielle, contribuer à une histoire du peuple et des vies ordinaires ? Que pourrait-on tirer de documents ne permettant pas a priori de reconstituer ces « vies fragiles » sinon de manière trompeuse ou suspecte ? Mais la tromperie me semblait faire partie du sujet et devoir être mise à jour. Et le sujet n’était-il pas plutôt de s’interroger sur les mises en scènes du peuple, pour ce qu’elles disent, non du peuple, mais de la société dans son ensemble ? La tromperie supposait l’intention de dissimuler ou de manipuler. Peut être fallait-il se contenter plus modestement d’admettre une incompétence. Savait-on lire ces images représentant les métiers de la rue, en apparence simple et presque trop frustres, dénuées d’appareil symbolique, restées à l’écart de l’histoire de l’art, comme longtemps les livrets de colportage restèrent hors des cadres de l’histoire littéraire ? Les comprenait-on encore ? Et que pouvait-on faire pour en exhumer les significations possibles ? Pourquoi les Cris ?
Je fus d’abord tenté – ce qui n’était pas forcément original - de travailler sur des « mythologies », celles du « bandit d’honneur », porteuses de révoltes contenues et des aspirations contestatrices du peuple, du moins était-ce ainsi que j’envisageais alors les choses. Peut être vecteur aussi d’un certain conformisme puisque l’ordre devait finalement rester à la Loi. D’autres que moi, plus avancés, s’y étaient déjà aventurés, ce qui rendait ce projet caduc11.
Celui qui encouragea alors et encadra mes premiers travaux, qui les accompagna longtemps, Daniel Roche, plus habitué à se mouvoir de la « cave au grenier » - c’était peut être aussi affaire de générations d’historiens – n’avait plus de ces réserves envers les sources littéraires et iconographiques12. Il animait au tout début des années 1980 deux chantiers
9 P. Goubert, Clio parmi les hommes, Paris-La Haye, Mouton, 1976 ; V. Milliot, « Une Histoire des classes populaires », Demain l’Histoire sociale. Hommage à Pierre Goubert, conférence inédite, Sorbonne, 9 juin 2012. 10 E.M. Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIIIe siècle, Paris, Perrin, 1987. 11 H.-J. Lusebrink, « Images et représentations sociales de la criminalité en France au XVIIIe siècle », RHMC, t. XXVI, juillet-septembre 1979, p. 345-364 et (textes présentés par), Histoires curieuses et véritables de Cartouche et Mandrin, Paris, Athaud-Montalba, coll. La bibliothèque bleue, 1984 ; P. Peveri, Techniques et pratiques du vol dans la pègre parisienne de la régence d’après les archives du procès de Louis Dominique cartouche et de ses complices : une contribution à l’histoire des milieux criminels urbains de l’Ancien Régime, Thèse de doctorat sous la direction de J.L. Flandrin, EHESS, 1994, ex multigraph. 12 Selon la formule de M. Vovelle, De la Cave au grenier : un itinéraire en Provence, de l'histoire sociale à l'histoire des mentalités Aix, Edisud, 1980.
4
parallèles. D’abord, celui qui était issu de la grande enquête consacrée à l’histoire du livre et qui l’avait conduit à se pencher à son tour sur le fonds de la bibliothèque de colportage dont il avait entrepris la réédition et, avec d’autres, une sorte d’analyse thématique13. Ensuite, celui de la « culture matérielle » et de l’exploitation des inventaires après-décès, jalonné par la publication du Peuple de Paris en 1981, puis, bientôt, de La culture des apparences (1989)14. Au point de rencontre entre ces deux chantiers, les « cultures du peuple », autre objet d’intenses débats dans la communauté historienne d’alors15. Dans le fonds du colportage, Daniel Roche me proposa la « ville », et, de son sein, ressortirent les figures du petit peuple urbain ou « Cris de Paris », mais aussi celle des métiers et de l’embarras de ville. Les « Cris » constituaient un thème et s’affirmaient à travers des séries qui excédaient les seules frontières du colportage pour intéresser d’autres consommations, y compris celles des élites sociales, des collectionneurs et des amateurs d’art au siècle des Lumières. Ces dernières permettaient de réfléchir à une circulation élargie des imprimés, dans des contextes de production et de consommation potentiellement très différents, du livre à l’image et dans la longue durée, du 16e au 18e siècle, depuis la mise au point des formules éditoriales à bas prix par les imprimeurs-libraires lyonnais ou parisiens, jusqu’au triomphe de la « bibliothèque bleue », troyenne ou normande, depuis le monde de l’imagerie de la rue Montorgueil à Paris jusqu’à celui des imagiers et des dominotiers provinciaux16. Les textes et les images inspirés par les Cris de ville, dont la collection semblait avoir été faite dés la fin du XIXe siècle par les amateurs du Vieux Paris et les folkloristes, montraient rapidement au moins deux choses. D’une part que ces productions avaient été l’objet d’une considération et d’un intérêt durables, mais qui avaient fluctué dans le temps, en mobilisant les producteurs d’images courantes comme des maîtres reconnus, des versificateurs anonymes comme les inventeurs de genres littéraires, certes « mineur », comme le poissard. D’autre part, du fait de l’hétérogénéité de ses interprétations, de la diversité de ses supports (textes, images, chansons et interprétations musicales) le thème, loin de pouvoir s’apparenter à l’expression de formes
13L’enquête collective, « Livre et société » joue un rôle décisif ; F. Furet (dir.), Livre et société dans la France du XVIIIe siècle, Paris-La Haye, Mouton, 2 tomes, 1965 et 1970 ; R. Chartier et D. Roche, « Le livre, un changement de perspective », J.L Goff, P. Nora (dir.), Faire de l’Histoire, tome 3, Nouveaux objets, Paris, Gallimard, 1975, p. 115-136 et le chantier trouve un aboutissement majeur avec la publication, dans les années 1980, de la monumentale Histoire de l’édition française, sous la direction de R. Chartier et H.-J. Martin, aux éditions Promodis (réédition Fayard). D. Roche dirigeait alors la collection « bibliothèque bleue » aux éditions Montalba et avait sollicité pour des présentations thématiques, R. Chartier, (Figures de la gueuserie (textes présentés par), Paris, 1982), G. Bollème, A. Farge, J.-L Flandrin… 14 D. Roche, Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle, Paris, Aubier, 1981 (réédition Fayard, 1998) ; La culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1989. 15 R. Mandrou, De la culture populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles. La Bibliothèque bleue de Troyes, Paris, Stock, 1975 (1ere édition, 1964) ; H.-J. Martin, « Culture écrite et culture orale, culture savante et culture populaire dans la France d’Ancien Régime », Journal des savants, 1975, n° 3-4, p. 225-282, repris dans Le Livre français sous l’Ancien Régime, Paris, Promodis, 1987 ; R. Chartier, « La culture populaire en question », Le peuple, H-Histoire, n° 8, avril-juin 1981, p. 85-99 et « Popular culture : a concept revisited », Intellectual History Newsletter, 5, 1993, p. 3-13 ; J. Revel, « La culture populaire : sur les usages et les abus d’un outil historiographique », Un parcours critique. Douze exercices d’histoire sociale, Paris, Galaade éditions, 2006, p. 293-313 (article paru une première fois en 1986). 16 L. Febvre et H.-J Martin, L’apparition du livre, Paris, A. Michel, 1971 (1ere édition, 1958) ; J. Queniart, L’imprimerie et la librairie à Rouen au XVIIIe siècle, Paris, Klincksieck, 1969, à compléter désormais avec J.-D. Mellot, L'édition rouennaise et ses marchés (vers 1600-vers 1730). Dynamisme provincial et centralisme parisien. Préface de Henri-Jean Martin, Mémoires et documents de l'Ecole des Chartes, 48, Paris, Ecole des Chartes, 1998.
5
culturelles « immobiles », figées, propres aux milieux populaires, avait tout pour accompagner la remise en cause d’une assignation sociale trop stricte de tels imprimés au profit de l’étude de leurs réceptions et leurs ré-interpétations socialement différenciées, toujours recommencées17. Textes et images, inspirées par le petit peuple urbain, nourrissaient à la fois le projet d’interroger sans concession la notion de « culture populaire » au regard de la circulation des motifs culturels, et de mettre en perspective la construction nostalgique d’un folklore citadin.
J’allais aussi pouvoir m’efforcer de mieux comprendre un apparent paradoxe, celui du mépris universel et de la condamnation accrue de la pauvreté – un mépris que la compassion religieuse et les attitudes charitables ne me semblaient pas devoir tout à fait compenser - qui s’attachait dans la société d’Ancien Régime à ceux qui n’avaient pas d’état, vivant au seuil de l’errance et de la survie tout en accomplissant les tâches essentielles de la revente, et qui, pourtant, avaient inspiré des séries pluriséculaires de textes littéraires, une iconographie variée et maintes interprétations musicales18. Les pauvres d’entre les pauvres semblaient, quoi qu’on dise, avoir bien des séductions et cela à une vaste échelle, puisque dans nombre de pays d’Europe ayant une civilisation urbaine développée, il y eut des séries iconographiques de « cris de ville » : cris dans les villes italiennes, cris dans les villes rhénanes, cris de Londres et jusqu’aux villes du Nouveau Monde si l’on voulait étendre l’enquête jusqu’au 19e siècle19. Au-delà des gravures, on pourrait faire la recension des traces littéraires de ce thème, du récit de voyage au roman, du « Tableau » de ville à la poésie, érigé un peu partout en lieu commun du désordre sonore urbain, emblème d’un désordre matériel plus général. Le roman de Zola, le Ventre de Paris, qui s’ouvre sur la description des Halles au lever du jour m’avait semblé emblématique d’une transformation possible des sensibilités dans la seconde moitié du 19e siècle. Zola fait une description visuelle plus que sonore de l’agitation qui lève au cœur de la capitale ; il me donnait à comprendre et à ressentir ce que Robert Mandrou dans son célèbre essai, La France moderne. Essai de psychologie historique, avait souligné, la variation de la hiérarchie des cinq sens au fil du temps et de l’évolution des sociétés20. Dans les mêmes années, Alfred Certeux, l’un des fondateurs de la société des « arts et traditions populaires » s’employait d’ailleurs à collecter les cris subsistants et à en proposer une transcription musicale, bribes d’une civilisation urbaine traditionnelle et d’une culture populaire, orale, sonore, en train de disparaître dans les fumées de l’industrie et les chantiers de l’hausmannisation21.
17 R. Chartier, « La culture populaire… », art. cit. La discussion , alors assez générale chez les littéraires et les historiens du livre et de la culture, des analyses liées à « l’esthétique de la réception » contribuait à ce changement de perspective, H.R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978 (pour la trad. fr.) et Pour une herméneutique littéraire, Paris, Gallimard, 1988. 18 B. Geremek, La potence ou la pitié. L’Europe et les pauvres du Moyen âge à nos jours, Paris, Gallimard, 1987 et Les fils de Caïn. L'image des pauvres et des vagabonds dans la littérature européenne, Flammarion, 1991. 19 J.K.F Beall, Kaufrufe und strassen händler, eine bibliographie/ Cries and itinerant trades, a bibliography, Hambourg, Ernst Hauswedell, 1975 ; S. Shesgreen, The image of the outcast. The urban poor in the Cries of London, Manchester University Press, 2002 ; S. O’Connel (dir.), London 1753, The British Museum Press, 2003. 20 E. Zola, Le Ventre de Paris, dans Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire, Bibliothèque de la Pléiade, Tome I, Paris, Gallimard, 1960 ; R. Mandrou, Introduction à la France moderne (1500-1640). Essai de psychologie historique, Paris, Albin Michel, 1961. 21 A. Certeux, Les Cris de Londres au XVIIIe siècle, illustrés de 62 gravures avec épigrammes en vers (…), Préface, notes et bibliographie des principaux ouvrages sur les Cris de Paris (…), Paris, Chamuel éd., 2e édition, 1893.
6
De cette ambivalence permanente - ou de cette osmose - entre la représentation des personnages des vendeurs/ses de rue, des petits métiers et celle de la ville, surgissait une question assez immédiate : s’agissait-il de représenter le peuple ou de dire la ville ? Pouvait-on appréhender les uns sans l’autre ? Une telle longévité du thème culturel n’était-il que la marque de l’emprise croissante de la civilisation urbaine et de sa valorisation, y compris à travers des genres mineurs ? Comment comprendre cet engouement apparent, marqué par une grande diversité des interprétations, envers les représentations de petits métiers, des crieurs et des vendeurs de rue ? Dans les contraintes temporelles qui étaient celles d’une thèse nouveau régime au début des années 1980 et alors que les dispositifs de mobilité des jeunes chercheurs n’étaient pas aussi institutionnalisés, ni les incitations aussi fortes qu’en ce début du XXIe, même pour les élèves de l’Ecole Normale Supérieure, l’adoption d’une perspective comparatiste avait semblé hasardeuse, d’autant que le rassemblement d’un corpus et surtout de tout ce qui allait pouvoir renseigner pratiquement sur les conditions de circulation de ces petits imprimés s’avéra d’emblée difficile et source de nombreuses incertitudes. C’est encore aujourd’hui un regret, habité par la question de savoir si les interprétations proposées pour Paris pourraient avoir une forme de pertinence pour d’autres villes, si ce que l’analyse des Cris de Paris révèle finalement d’un fonctionnement culturel et social pouvait être élargi, nuancé, complété pour un temps où la visée « nationale » de l’historiographie n’a que peu de vertu. La manière dont la riche tradition d’histoire sociale anglaise a pu s’emparer depuis des séries de Cris de Londres, ou des gravures de W. Hogarth, montre que cette préoccupation n’était pas sans fondement22.
Relire les Cris ?
La réédition d’un ouvrage soumet à la tentation redoutable de confronter un travail accompli à ses premières réceptions. Quelle contribution le livre paru plusieurs années auparavant a t-il pu apporter à un ensemble de questions que l’on pouvait se poser alors, mais qui ne sont plus nécessairement les mêmes aujourd’hui ? Il y a aussi les maladresses que l’on voit mieux avec le temps, les imperfections que l’on ne peut plus redresser et avec lesquelles on doit composer, dont je reste encore aujourd’hui comptable. Les contributions à la réflexion commune peuvent s’appréhender à travers l’incorporation de certaines analyses de l’ouvrage dans d’autres analyses23. On peut aussi replacer les Cris dans un ensemble de productions qui ont pris, désormais sans hésitation, l’iconographie comme objet d’étude et comme source, avec des réussites inégales, une représentativité et une inventivité variables selon les époques historiques24. Partir de quelques recensions permet plus facilement de revenir sur certaines 22 T. Hitchcock, Down and Out in Eighteenth century London, London and New York, Hambledon continuum, 2004, chap. 9. 23 A. Croix et J. Quéniart, Histoire culturelle de la France (sous la direction de J.-P. Rioux et J.-F. Sirinelli), De la Renaissance à l’aube des Lumières, tome 2, Paris, Le Seuil, 1997, p. 242-244 ; D. Roche, Le peuple de Paris, op. cit, réédition, Fayard, 1999, introduction ; C. Delporte, L. Gervereau, D. Maréchal, Quelle est la place des images en Histoire ?, Paris, Nouveau Monde éditions, 2008, p. 44-45. 24 Une bibliographie désormais abondante, notamment en histoire contemporaine, interdit de se lancer ici dans un inventaire exhaustif. On peut néanmoins citer quelques exemples pour l’histoire moderne, P. Hamon, L’or des peintres. L’image de l’argent du XVe au XVIIe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2012 ; G. Sabatier, Versailles ou la figure du Roi, Paris, Albin Michel, 1999, ou encore rappeler la contribution essentielle de S. Gruzinski qui accorde une place de premier plan aux images dans l’étude des processus d’acculturation, La guerre des images de Christophe Colomb à « Blade runner », Paris, Fayard, 1989 et signaler, enfin, la richesse des suggestions des historiens médiévistes pour l’étude de l’iconographie. On peut citer par exemple les travaux de J. Baschet, Le sein du père. Abraham et la paternité dans l’Occident médiéval, Paris : Gallimard, “Le temps des images”, 2000 ;
7
observations formulées au moment de la publication du livre car l’exercice, lorsqu’il ne se limite pas à la synthèse, permet d’ouvrir la discussion scientifique et de réfléchir aux limites d’un travail donné. Deux lectures avaient notamment été consacrées au « Peuple travesti », celle d’Isabelle Backouche dans les Annales ESC et celle de Nicole Pellegrin dans la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine25.
Les deux recensions insistent sur le refus fondateur qui fut le mien, à savoir celui de la source « reflet », et sur les solutions proposées pour s’en émanciper. Ce refus était à double détente puisqu’il s’agissait à la fois de ne pas chercher à lire simplement dans des textes et des images l’indication de ce que furent les conditions vie du petit peuple des villes, mais aussi de ne pas considérer que le thème des « cris de ville » constituait une sorte de voie d’accès à la « culture populaire », ce que les ouvrages des folkloristes, des érudits et des amateurs du vieux Paris tendaient à accréditer depuis la fin du XIXe siècle. Le corpus des Cris de Paris, littéraire et iconographique principalement, invitait dans sa diversité même à révoquer en doute le principe d’une assignation sociale trop stricte des images comme des textes dont les formes et les registres avaient variés avec le temps. Cette diversité d’interprétation du thème soulevait assez vite celle des réceptions potentiellement différenciées des Cris de Paris, de la diversité des publics.
La première solution allait donc consister à rassembler tout ce qui pouvait intéresser la fabrication, la commercialisation et la circulation, des textes et des images en suivant les pistes proposées depuis Lucien Febvre et Henri-Jean-Martin pour étudier à la fois les professionnels de l’imprimé et la diffusion du livre26. Mon travail a, par exemple, très directement profité de l’extension du questionnaire au monde des graveurs et des imagiers développée par des élèves d’Henri-Jean Martin, tels Pierre Casselle, Marianne Grivel, ou Corinne le Bitouzé, comme il a bénéficié des travaux qui intéressaient la constitution d’un marché de l’art et la compréhension renouvelée des consommations artistiques à travers l’exploitation des catalogues de vente des cabinets d’amateurs27. Les résultats furent inégaux, fragmentaires, parfois éclairants et stimulants comme dans le cas des catalogues susceptibles de fournir parfois des prix de vente aux enchères, le palmarès des séries collectionnées par les amateurs et surtout leur mode de classement, leur place dans la hiérarchie des genres figuratifs.
La deuxième exploration principale renvoyait à la question de savoir ce qui était véritablement montré à travers ce thème polymorphe, suffisamment souple pour se fondre dans des registres burlesques ou documentaires, très ordinaires ou plus élaborés. Et surtout récurrent, permanent. Elle était susceptible de plusieurs déclinaisons visant toutes à restituer le cheminement de significations et de lectures possibles du thème au sein de publics divers, à des époques différentes. Certaines interrogations intéressaient les formes matérielles de ces imprimés dont la construction du sens dépend pour partie, les rapports entre les légendes et l’image, dans le sillage des propositions formulées par les tenants de la bibliographie matérielle que R. Chartier s’était employé à faire connaître et que R. Laufer avait mis en
L’iconographie médiévale, Paris, Folio-Gallimard (Inédit), 2008 ; « Inventivité et sérialité des images médiévales. Pour une approche iconographique élargie », dans Annales HSS, 51, 1996, 1, p. 93-133. 25 Annales. Histoire, Sciences sociales, Année 1999, volume 54, n° 2, p. 513-515 et Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 47-3, juillet-septembre 2000, p. 638-640. 26 Outre L’apparition du livre, voir H.-J Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève, Droz, rééd. 1984. 27 Outre leurs thèses mentionnées dans la bibliographie, voir le précieux instrument de travail auquel ces auteurs ont contribué avec M. Préaud, Dictionnaire des éditeurs d’estampes à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Promodis, 1987 , et, K. Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Gallimard, 1987.
8
pratique dans des approches « génétiques » de l’édition d’un livre28. D’autres se plaçaient, par exemple, au cœur de l’image pour tenter de décrypter les codes utilisés afin de représenter les corps et le geste, le vêtement, le rapport à l’espace urbain. Le souci d’éviter ce que l’on pourrait qualifier « d’enfermement sémiologique », un risque pointé par Michel Vovelle lorsqu’on s’aventure à analyser des images, m’avait conduit à raisonner de manière sérielle, pour tenter de faire ressortir des régularités ou des anomalies, sans discriminer les images en fonction de leur statut – gravures courantes ou gravures de maîtres29. La lecture des grands travaux « d’histoire des mentalités » de la fin des années 1970 et du début des années 80, fondés sur l’exploitation de vastes corpus iconographiques – les retables, les ex-voto – m’avait convaincu des ressources offertes par l’application des méthodes venues de l’histoire sérielle et quantitative30. La mise en série des Cris de Paris avait ainsi fait ressortir des temps forts dans cette production, même s’il faut toujours compter avec les aléas de la conservation, des types et des styles dans leur mise en scène, des variations qui trouvaient leur sens grâce à la documentation rassemblée autour des conditions de fabrication et de commercialisation des gravures. Mais elle m’avait également laissé sur ma faim, parce que trop sèche, trop descriptive et insuffisamment interprétative car une autre tradition s’offrait alors aussi à moi, celle de « réalité figurative », de la sociologie de l’art portée par Pierre Francastel31. En effet rendre compte de ce que certains auteurs qualifiaient hâtivement « d’évolution du goût » exigeait d’autres catégories d’analyses, la mobilisation d’autres sources. La lecture – une révélation - au début des années quatre-vingt de l’ oeil du Quattrocento de M. Baxandal avait achevé de me persuader qu’il fallait, au-delà d’une grille de lecture « sérielle », accumuler tous les indices susceptibles d’informer sur une « culture visuelle » de manière large, depuis le sens de la couleur, l’organisation des formes, jusqu’aux codes de représentation qui s’attachaient aux personnages, à leur gestuelle, à leur environnement et qui renvoient très concrètement à certains usages commerciaux et sociaux, à des échelles de valeurs et de distinction, comme l’exemple du corps et des apparences le montre32. Du Traité des passions de Charles Lebrun aux salons de Diderot, des civilités aux manuels de pédagogie corporelle et aux arts de danser, s’ouvrait un ensemble de références utiles à méditer à cet égard33. 28 R. Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris, Le Seuil, 1987 ; Id. (sous la direction de), Pratiques de la lecture, Marseille, Rivages, 1985 et R. Laufer (dir.), La bibliographie matérielle, Paris, CNRS, 1983 et A.R. Lesage, Le Diable boiteux, texte de la deuxième édition avec les variantes de l’édition originale et du remaniement de 1726, précédé d’une étude de bibliographie matérielle par R. Laufer, Paris, La Haye, Mouton, EPHE, 1970. 29 Michel Vovelle, « Des mentalités aux représentations », entretien avec Ch.-M. Bosséno, Société et représentations, n° 12, oct. 2001, p. 16-28 ; Iconographie et Histoire des mentalités, Aix-en-Provence, Université de Provence, Paris, CNRS, 1979 ; J. Baschet, « Inventivité… », art. cit. 30 M. Ménard, Une histoire des mentalités religieuses aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mille retables de l’ancien diocèse du Mans, Paris, Beauchesne, 1980 ; B. Cousin, Le miracle et le quotidien : les ex-voto provençaux. Images d’une société, Aix-en-Provence, Edisud, 1983. 31 P. Francastel, La réalité figurative. Eléments structurels pour une sociologie de l’art, Paris, Gonthier, 1978 ; P. Bourdieu, Y. Delsaut, « Pour une sociologie de l’œil », Sociologie de l’œil, ARSS, n° 40, 1981, p. 3. 32 M. Baxandall, L’œil du quattrocento. L’usage de la peinture dans l’Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, 1985 (pour la trad. fr.).. 33 Ch. Le Brun, Méthode pour apprendre à dessiner les passions… Enrichie de nombreuses figures, Amsterdam, 1702 ; D. Diderot, Essais sur la peinture. Les Salons de 1759, 1761, 1763, textes établis et présentés par G. May et J. Chouillet, Paris, Hermann, 1984 ; G. Vigarello, Le corps redressé. Histoire d’un pouvoir pédagogique, Paris, Delarge, 1978 ; J.-J. Courtine et C. Haroche, Histoire du visage, XVIe-début XIXe s. Exprimer et taire ses émotions, Marseille, Rivages, 1988. Le corpus des manuels d’escrime et d’équitation peut désormais rejoindre les autres textes relevant de l’art du maintien, P. Brioist, H. Drévillon, P.
9
Je conserve toutefois de ce moment le souvenir d’une tension parfois un peu anxieuse, qui était un peu celle du débat aujourd’hui sans objet entre le qualitatif et le quantitatif, mais aussi celle d’un dépassement incomplet, ou difficile, de « l’illusion référentielle », ce que relève Nicole Pellegrin dans sa lecture, comme si l’historien confronté aux images (et aux textes littéraires) restait sujet à une sorte de retour du refoulé, éprouvait au moins une difficulté à trancher définitivement cette question du « rapport au réel » et de l’imaginaire, au-delà de la pétition de principes34. Les pages qui concernent la représentation du vêtement sont habitées par cette ambiguïté et la grille que j’avais constituée sur cette thématique s’était avérée parfaitement tautologique, d’un intérêt limité, à l’exception des anomalies qu’elle avait fait ressortir tel le manchon en fourrure de la vendeuse de mottes35.
Les deux lectrices formulent également, chacune à leur manière, le risque pas toujours évité de la sur-interprétation. L’exploitation d’une documentation très éclatée, très diverse et qui posait parfois de redoutables problèmes d’usages, de mise en œuvre, m’a plus d’une fois inquiété et m’incitait, par contre-coup, à chercher ce qui permettrait de tenir assemblé le puzzle et de donner de la cohérence à des fragments d’interprétation. Le recul progressif du registre grotesque et du comique burlesque dans l’image, la transformation de la gestuelle et de l’apparence des personnages, ce qui me semblait relever d’un processus de déclassement des séries littéraires des Cris de Paris trouvaient apparemment leur clef dans un grand processus d’épuration culturelle, de hiérarchisation des formes d’expression et d’institutionnalisation des pratiques culturelles, amorcé depuis la Renaissance, triomphant au grand Siècle… De Bakhtine à Norbert Elias, de la culture carnavalesque renaissante à la société de cour, la succession, le déclassement parfois, et, les transformations des diverses séries littéraires, musicales, iconographiques des Cris trouvaient une sorte de logique. De là à faire des images assagies, « travesties » des Cris un vecteur, un instrument parmi d’autres, de la diffusion des valeurs de la « civilisation des mœurs », il y avait plus qu’un pas, pourtant assez allégrement franchi par enthousiasme, tant le modèle exerçait alors une sorte de fascination au point de devenir un véritable pont-aux-ânes…. Quelques années plus tard, j’ai appris à manier de tels arguments avec davantage de prudence, voire à récuser cette notion et ce « modèle interprétatif » aux usages trop souvent téléologiques et problématiques au regard de la reconstitution des pratiques sociales36. Le « redressement des corps » que l’on peut effectivement constater dans les représentations successives des petits métiers constitue un indice, parmi d’autres qui renseignent sur la lente diffusion d’une esthétique, qui donnent à voir les codes corporels « légitimes » de telle ou telle époque, par homologie avec les pratiques corporelles des élites sociales, mais pas plus et guère au-delà.
De ces imperfections et de ces tâtonnements, je reste comptable. Pour autant de ce foisonnement, je retiens toujours aujourd’hui de nombreux éléments que je crois encore utiles à nourrir la réflexion si j’en juge par certains échanges encore récents lors de séminaires de
Serna, Croiser le fer. Violence et culture de l’épée dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Seyssel, Champ Vallon, 2002 ; D. Roche, La gloire et la puissance, Histoire de la culture équestre, XVIe-XIXe siècle, tome 2, Paris, Fayard, 2011, chap. 6. 34 Voir sur ce point les propositions de Claire Zalc, Claire Lemercier, Méthodes quantitatives pour l'historien, La Découverte, coll. « Repères », 2008. Lors d’une présentation en séminaire à Paris 1/ENS Ulm, de ma thèse alors récemment soutenue, J. C Perrot avait conclu de manière définitive en affirmant qu’opposer le « réel » à sa représentation ne pouvait conduire qu’à une impasse totale, la « représentation » du réel étant constitutive de celui-ci. 35 La vendeuse de mottes, gravure des frères Bonnart, ca. 1680, BnF est. Oa 53. 36 M. Nassiet, La violence, une histoire sociale. France, XVIe-XVIIIe siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2011. Les enseignements tirés de la grande enquête dirigée par J. Nicolas pondèrent également fortement la vulgate de la « civilisation des mœurs », La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, Paris, Le Seuil, 2002.
10
recherche37. C’est d’abord l’importance de restituer et de comprendre les conditions de fabrication, d’élaboration et d’appropriation des images qui fournissent dans le cas des Cris de Paris la clef de la longévité du thème et de son succès auprès de publics divers. C’est l’intérêt qu’il y à considérer la notion de circulations dans ses dimensions pratiques, matérielles, sociales, mais aussi symboliques ou anthropologiques38. Je pense également avoir contribué dans ce travail à éclairer le processus de travestissement du peuple, ses motifs et les logiques socio-culturelles qui le sous-tendent. Dans le temps long, j’ai eu le sentiment de parvenir à documenter, afin de mieux comprendre, la manière dont certaines figures de la rue parisienne devenaient emblématiques de la ville, constitutives d’un « folklore » urbain que l’on ne prit longtemps pas la peine de questionner, ni dans ses intentions idéologiques, ni dans ses productions.
Cette dernière remarque entre en résonance avec un regret formulé par I. Backouche, celui de n’avoir pas suffisamment enjambé la césure révolutionnaire et jeté mes filets vers la première moitié du XIXe siècle. Ce choix avait en apparence pour lui le mérite d’une certaine cohérence. Les grandes séries gravées des Cris de rue disparaissent de tous les secteurs de la production iconographique pendant la décennie révolutionnaire, même si le personnage du crieur, du colporteur, du petit métier apparaît encore dans les images ; les versions littéraires subsistent, marginales, dans le fonds des imprimés de large circulation, moins présentes à tout prendre que la veine des « misères de métiers ». L’apparition de nouveaux procédés de reproduction des images dans la première moitié du XIXe siècle, plus tard l’intervention de la photographie, le changement d’échelle de la diffusion pouvaient encore fournir une autre justification, plus « formelle »39. Reste que le « rebond » du genre tant pour les interprétations littéraires sous la forme de tableaux pittoresques que pour l’iconographie, bien constaté, aurait mérité d’autres prolongements. La coïncidence entre les caricatures du petit peuple que l’on trouve dans l’imagerie d’Epinal et les soubresauts révolutionnaires du premier XIXe siècle aurait mérité d’être, par exemple, confrontée à la diffusion d’une stéréotypie sociale héritée du siècle des Lumières, du travail des moralistes, de celui des dessinateurs et graveurs « d’après nature ». Le récent ouvrage que D. Kalifa vient de consacrer aux « bas-fonds » montre l’intérêt qu’il y a à considérer le temps long des représentations sociales et des discours sur le peuple urbain40. De même, les rapports entre la construction de ces imaginaires de la ville et les transformations effectives de l’espace et de la société urbaine n’ont-ils été qu’esquissés. Cette ouverture chronologique plus franche aurait probablement permis d’identifier des scansions plus amples et de diversifier les motifs et les logiques du « travestissement », depuis le foisonnement du XVIe siècle, le cloisonnement et la hiérarchisation renforcée des productions à l’âge classique jusqu’à la diversification du Siècle des Lumières (de la gravure de mode à la feuille de dominotier), jusqu’au naturalisme moralisateur qui court du XVIIIe au XIXe siècle. La grande série de « Cris de Paris, dessinés
37 Je pourrais citer, par exemple, les échanges avec J.-P. Lethuillier, ses travaux sur le portrait et les sources iconographiques en général ; voir sa récente intervention à l’université de Caen, « La série des ports de France de Vernet », http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6234 ; voir également J.-P. Lethuillier et O. Parsis-Barubé (dir.), Le pittoresque. Métamorphoses d’une quête dans l’Europe moderne et contemporaine, Paris, Classiques Garnier, 2011. 38 D. Roche, Histoire des choses banales. Naissance de la consommation, XVIIe-XIXe siècle, Paris, Fayard, 1997 ; voir également les nombreux éléments qui figurent dans V. Milliot, P. Minard, M. Porret (dir.), La Grande chevauchée. Faire de l’Histoire avec Daniel Roche, Genève, Droz, 2011. 39 Atget, Geniaux, Vert. Petits métiers et types parisiens vers 1900, Musée Carnavalet, Paris, 1984 ; A. Rouillé, « Les images photographiques du travail sous la Second Empire », Le savoir voir, ARSS, n° 54, sept. 1984, p. 31-43. 40 Le peuple de Paris au XIXe siècle. Des guinguettes aux barricades, Paris, Musée Carnavalet, 2011 ; D. Kalifa, Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Le Seuil, 2013.
11
d’après nature » que l’on doit sous la Restauration à Carle Vernet (1ere édition, 1825) joue un rôle assez semblable (de matrice notamment) à celui de la série de Bouchardon-Caylus au milieu du XVIIIe siècle ; il m’est arrivé de regretter de n’avoir pas poussé davantage la comparaison.
« Sur l’air des Cris de Paris » Parmi les orientations qui étaient restées à l’état d’esquisse, faute de temps, faute de
compétences suffisantes également, il y avait les sources littéraires médiévales qui constituent à l’évidence la première matrice des cris de ville, des quatrains des Cris de Paris sans cesse réédités dans le fonds des imprimés de large circulation à partir du XVIe siècle. Il y avait aussi au carrefour de la poésie, de la chanson et des interprétations musicales, l’usage du thème dans la polyphonie savante de la Renaissance, en France, mais aussi par exemple en Angleterre41. C’est à ce socle qu’entend s’attacher aujourd’hui le travail du médiéviste Laurent Vissière42. Preuve est faite de la fécondité, que j’avais simplement entrevue, de la période du Moyen-âge et de la Renaissance, pour l’élaboration d’une « littérature du cri » qui invite à reconsidérer les rapports entre l’oralité et l’écriture. Plusieurs sollicitations émanant du monde des musicologues avaient également, après coup, attiré mon attention sur l’intérêt de réfléchir à cette piste, mais aussi à ses difficultés à la fois méthodologiques et documentaires43.
Autour de la chanson, des rapports entre culture orale et culture écrite, se joue une manière essentielle et rénovée de comprendre les circulations culturelles entre des espaces et des milieux sociaux différents. Ce qui est en cause, c’est la porosité entre l’écrit et les formes orales d’appropriation et de diffusion, - on pourrait presque dire l’osmose, puisque la composition même des textes intègre des procédés mnémotechniques – qui démultiplie les publics des pièces d’actualité, d’information, de divertissement. La culture orale est souvent et de plus en plus, mêlée aux pratiques de l’écrit, évidemment à l’oeuvre dans les pratiques de lecture, pas seulement dans la sphère de la religion ordinaire, au sein de la société rurale comme au sein de la société urbaine, mais selon des modalités qui peuvent varier. Les travaux de R. Darnton, notamment les plus récents, poussent à envisager la construction d’un système
41 O. Halevy, I. Hiss, J. Vignes (éd.), Clément Janequin, un musicien au milieu des poètes, Paris, Société française de musicologie, 2013 ; P. Brioist et V. Milliot, “ Echanges culturels et sensibilités auditives : le ‘chant des rues’ (Cris de Londres, Cris de Paris) aux XVIe-XVIIe siècles ”, dans J. Quéniart (dir.), Le chant, acteur de l’histoire, Presses Universitaires de Rennes,1999, pp. 199-211 ; “ 'Le Parisien n'a point l'oreille musicale (…)' (L.-S. Mercier). Musique, musiciens et chanteurs de rues à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles ”, A. Croix, A. Lespagnol et G. Provost (dir.) Eglise, Education, Lumières … Histoires culturelles de la France (1500-1830),PUR, 1999, pp. 409- 415. 42 L. Vissière, « La bouche et le ventre de Paris », Histoire urbaine n° 16, août 2006, p. 71-89 et « Des Cris pour rire ? Dérision et autodérision dans les «’Cris de Paris’ (XIIIe-XVIe s.), E. Crouzet-Pavan, J. Verger (dir.), La dérision au Moyen Âge. De la pratique sociale au rituel politique, Paris, PUPS, p. 85-107 et « Les cris de Paris : naissance d’un genre litétraire et musical (XIIIe-XIVe siècles) », dans O. Halevy, I. Hiss, J. Vignes (éd.), Clément Janequin…, op. cit.. 43 Je songe ici aux échanges avec Florence Gétreau, ethno-musicologue ; V. Milliot “ ‘Génie populaire’ et ‘âme de la grande ville’ : les Cris de Paris ou le folklore musical de la capitale (18e-19e siècles), journées d’études organisées autour de l’exposition Musiciens des rues de Paris , Musée national des ATP, par le Centre d’ethnologie française-CNRS et par le laboratoire d’anthropologie urbaine–CNRS, 12-13 mars 1998 (inédit) ; « Les Cris de Paris ou le ‘chant’ des rues, XVIe-XVIIIe siècles », Musiciens des rues de Paris, Musée national des Arts et Traditions populaires 18 novembre 1997 – 27 avril 1998, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1997, pp. 29-33. Au titre d’une tentative de restitution de la culture orale, voir l’exposition Rennes en chanson, 19 novembre 2010 au 13 mars 2011, http://www.rennes-en-chansons.fr/rennes-en-chansons/presentation.html.
12
de communication complexe et articulé, tissé d’échanges entre les supports qu’il produit : imprimés de nature diverse, manuscrits, performances orales spontanées ou organisées (théâtre)44. Ce système associe au temps des Lumières les circuits officiels de la diffusion de l’imprimé, avec son filtre de la censure préalable et ses marges de tolérance, mais aussi le massif souterrain, essentiel, du livre contrefait et prohibé qui pénètre dans le royaume par les réseaux de contrebande, animés par des professionnels dont certains ont pignon sur rue, à Paris, à Rouen, à Lyon, pour ne citer que ces villes-là. Il est alimenté par d’amples circulations manuscrites, que peuvent illustrer les nouvelles à la main, copiées et recopiées, largement diffusées, par le théâtre de foire et la chanson de rue45. Il bruit, enfin, de ce qui est colporté de bouche à oreille et dont on peut s’efforcer de trouver trace. L’intérêt de cette démarche est d’éviter toute lecture linéaire et téléologique de l’évolution des dispositifs de communication, pour insister sur la diversité des combinaisons possibles entre oralité, manuscrit et imprimé, comme sur la liberté des acteurs46. A l’évidence, ces propositions méritent d’être discutées, nuancées, éprouvées dans des contextes et au sein d’une chronologie élargies.
La curiosité manifestée par les historiens à l’égard d’une communication orale laissant peu de traces ou des traces déformées (par l’écrit) reste à ce jour encore limitée, en dépit de son importance, même si l’on peut constater l’existence d’une aspiration bien identifiée visant à interroger un environnement sonore et des cultures de l’oralité47. Si l’histoire médiévale s’est assez tôt interrogée sur les « pratiques de bruit »48, la réflexion collective dirigée par Jean Quéniart, sur le Chant, acteur de l’histoire, est restée relativement confidentielle, au moins dans le monde dans historiens modernistes49. On peut noter dans le sillage de ce chantier, nourri des enseignements de l’anthropologie culturelle, le beau travail qu’Eva Guillorel a consacré récemment aux rapports entre chansons et justice en Bretagne, entre le XVIe et le XVIIIe siècles50. La chanson bretonne de tradition orale pose certes des problèmes
44 Robert Darnton, “Presidential Address: An Early Information Society : News and the Media in Eighteenth-Century Paris,” The American Historical Review, February 2000. http://www.historycooperative.org/journals/ahr/105.1/ah000001.html ; Jeffrey S. Ravel, The Contested Parterre : Public Theater and French Political Culture, 1680-1791, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1999 et « Le théâtre et ses publics : pratiques et représentations du parterre à Paris au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 3/2002 (no49-3), p. 89-118. 45 François Moureau (éd.), De Bonne main. La communication manuscrite au XVIIIe siècle, Paris et Oxford, Universitas et Voltaire Foundation, coll. «Bibliographica», 1993. 46 G. Noiriel, « L’histoire culturelle aujourd’hui. Entretien avec R. Chartier », Genèses 15, mars 1994, p. 115-129. 47 A. Corbin, Les cloches de la terre : paysage sonore et culture sensible dans les campagnes du XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1994 ; voir l’esquisse de J.-P. Gutton, Bruits et sons dans notre histoire : essai sur la reconstitution du paysage sonore, Paris, PUF, 2000 et P. Borsay, « « Sounding the town », Urban History, Volume 29, issue 01, may 2002, p. 92-102, dans un numéro thématique consacré aux rapports entre musique et histoire urbaine. 48 C. Gauvard et A. Gokalp, « Les conduites de bruit et leurs significations à la fin du Moyen Âge », Annales ESC, 1974-3, p. 693-704 ; D. Lett, N. Offenstadt (dir.), Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003 ; N. Offenstadt, En place publique : Jean de Gascogne, crieur du XVe siècle, Paris, Stock, 2013. 49 D. Garrioch, «Sounds of the city : the soundscape of early modern European towns », Urban History, mai 2003, vol 30, issue 1, Cambridge University Press, Cambridge UK, pp. 5-25. Approche interdisciplinaire de l’environnement urbain sensible dans A. Cowan, J. Steward (ed.), The City and the Senses : urban culture since 1500, Almdershot, Ashgate Publishing Ltd, 2007 et dans une perspective très contemporaine, M. Zardini (ed.), Sensations urbaines. Une approche différente de l’urbanisme, Montréal, Baden, Centre canadien d’architecture, Lars Müller Publishers, p. 158-208. 50 Jean Quéniart (dir.), Le Chant, acteur de l’histoire, Presses universitaires de Rennes, 1999 ; Eva
13
méthodologiques très différents de la chanson urbaine et écrite, mais la démarche scientifique qui tend à reconsidérer l’importance de l’oralité dans la société d’Ancien Régime est commune51. Autour de certains massifs de manuscrits, par exemple à Paris celui des Gazetins de police conservés aux Archives de la Bastille, se pose également nombre de questions autour des rapports entre écrit et oralité52. À n’en pas douter, le décloisonnement, notamment chronologique, ne peut qu’enrichir le questionnaire et les résultats.
Toutefois dans la présentation que Laurent Vissière fait de ses pistes de réflexion centrées sur la reconstitution d’une culture du bruit et de l’oralité, on peut aussi aujourd’hui lire l’écart entre les intentions d’un ouvrage comme Les Cris de Paris ou le peuple travesti et ses réceptions à vingt ans de distance. Cet écart peut relever pour une part – c’est le propre de la vie et du débat scientifiques – d’un désaccord d’interprétation. Il oppose ainsi une thèse ancienne, héritée des folkloristes, faisant des Cris l’expression du génie propre et spontané du peuple à la thèse plus récente, illustrée par le Peuple travesti, hypercritique, qui ne voudrait voir dans les productions attachées au thème des Cris qu’une « mystification d’intellectuels se moquant du peuple ». Il n’y aurait là dit l’auteur que deux avatars de la théorie du reflet, mais appliqué au domaine des « mentalités » : reflet des « mentalités populaires » dans un cas, reflet des « mentalités des élites sociales » dans l’autre cas. Alors que l’engouement pour ce thème et les versions littéraires des cris de ville, dénués de toute visée critique et satirique, s’expliquerait d’abord selon L. Vissière, par le triomphe d’une civilisation urbaine, par l’importance sociale, économique et politique des pratiques de cris, par leur insertion dans la vie quotidienne urbaine, au point d’en faire un matériau évident pour qui souhaite brosser le tableau, notamment sonore, d’une grande ville. Pour cet auteur, il s’agit essentiellement de poésies « documentaires » illustrant les consommations urbaines, les saisons, les couleurs de la vie quotidienne, une organisation économique et sociale.
C’est, de mon point de vue, une lecture possible et recevable, mais s’en tenir là équivaut à ne pas s’affranchir davantage de l’illusion référentielle et, surtout, à ne pas concevoir la pluralité des significations socio-culturelles de telles productions. Déconstruire un ensemble de codes, dans les textes, les images ou les versions musicales, s’attacher à en retrouver certains fondements, à reconstituer leurs circulations et leurs adaptations, à s’efforcer de comprendre ce qui les rend à un moment donné, pour certains publics, légitimes, et, pour le dire en peu de mots, ce qui est constitutif de la diversité de leurs significations, cela ne s’apparente en aucune façon à la recherche d’un déterminisme sociologique sommaire, fût-il situé dans la sphère de l’histoire culturelle et des « mentalités ». Ce qui résiste à l’analyse, ce qui est difficile à documenter, c’est ce qui est de l’ordre des appropriations effectives, des usages. La quête relève parfois de l’indice, plausible, mais si elle doit nourrir une certaine prudence dans les analyses, elle n’invalide pas, par principe, le questionnement. Pluralité de publics, pluralité de significations, pluralité des niveaux de lecture et des réceptions, labilité
Guillorel, La complainte et la plainte. Chanson, justice, cultures en Bretagne (XVIe-XVIIIe siècles), PUR, 2010. 51 Claude Grasland, « Chansons et vie politique à Paris au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, XXXVII, 1990, p. 537-570 ; Claude Grasland, Annette Keilhauer, « La rage de collection. Conditions, enjeux et significations de la formation des grands chansonniers satiriques et historiques à Paris au début du XVIIIe siècle (1710-1750) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2000/3 (juillet-septembre), 47-3, p 458-486 ; A. Keilhauer, Das französische Chanson im späten Ancien Régime. Strukturen, Verbreitungswege und gesellschaftliche Praxis einer populären Literaturform, Hildesheim, Georg-Olms-Verlag, Reihe Musikwissenschaftliche Publikationen, 1998. 52 Voir suggestions d Arlette Farge, Dire et mal dire. L’opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, Le Seuil, 1992, travaux en cours de Lisa Jane Graham, outre son ouvrage, If the King Only Knew Seditious Speech in the Reign of Louis XV, Charlottesville and London, University Press of Virginia, 2000.
14
des frontières et importance des échanges entre les productions et les consommations, méritent d’être appréhendées ensemble et sans exclusive. Relever l’effet comique produit par la trivialité du texte d’une chanson avec la technique éminemment savante de la polyphonie, n’est pas réduire « l’art subtil » de Clément Jannequin à de « gros effets comiques »53. Toute proportion gardée, de même que Jeffry Kaplow dans un ouvrage important sur les pauvres de Paris semblait n’envisager l’alimentation populaire en plein vent, que frite dans une mauvaise graisse, on peut avoir ici le sentiment que mettre en chanson (savante) le « bas corporel » pour parler comme Bakhtine, c’est jeter un voile sur la pureté de l’art54. Préjugé « d’en haut » envers un peuple le plus souvent « gardien des mauvais usages », ou bien, de qui refuse peut être d’admettre l’existence de formes de domination sociale et d’affrontements entre les groupes – on n’ose plus dire « classes » - y compris sous une forme symbolique55. C’est pourtant le propre de nombre de ceux qui disposent d’un bagage culturel élevé, que de savoir jouer sur plusieurs registres d’expression, selon les circonstances. C’est ce qui constitue, par exemple, l’un des ressorts du comique poissard au XVIIIe siècle où l’on voit des nobles triompher dans des joutes verbales, injurieuses, avec des poissonnières des Halles. Au-delà, c’est une marque des pratiques du « travestissement » que l’on pourrait étendre jusqu’à celles inspirées par la fascination envers les « bas fonds »56.
Aborder la question sous cet angle, témoigne donc à la fois de l’affirmation de questions nouvelles – celles qui sont liées à la compréhension renouvelée de la culture sonore et orale, aux sensibilités auditives et aux pratiques sociales de l’oralité – mais aussi de la perception incertaine aujourd’hui du contexte intellectuel dans lequel des questions sont posées à un moment donné, ce qu’il ne faut peut être pas totalement oublier, même si les résultats obtenus un temps sont faits pour être dépassés, critiqués, complétés. Restituer ce contexte me semble important, parce qu’il a déterminé tout un parcours et qu’il permet sans doute de mieux appréhender ce dont on peut encore partir, ce qui peut avoir du sens encore aujourd’hui. « Les formes de l’expérience »
Au risque de la reconstitution nostalgique, pour moi, ouvrir Les cris de Paris, c’est encore aujourd’hui, retrouver la saveur juvénile de l’expérimentation et d’une certaine liberté. Je me garderais bien d’idéaliser les conditions du travail universitaire voici 30 ans, même si ceux de ma génération ont à l’évidence profité d’une conjoncture favorable, notamment en termes de recrutement dans les universités, il est vrai après une période de vaches maigres et de sous-investissement notable dans l’enseignement supérieur et la recherche qui avait été ravageuse. Mais l’inventaire des occasions manquées depuis les années 1980, en particulier dans la réflexion autour des conditions d’une meilleure mobilité entre enseignement et recherche qui ne s’apparenterait pas à un nouveau cloisonnement des parcours, au figement de situations acquises, reste malheureusement loin d’être clos57. Le souvenir de cette liberté reste
53 L. Vissière, « La bouche… », art . cit., p. 73. 54 D. Roche, Le peuple de Paris, op. cit., note 17, page 275 faisant allusion à J. Kaplow, Les noms des rois. Les pauvres de Paris à la veille de la Révolution, Paris, Maspero, 1974, p. 131. 55 S. Hall, Identités et cultures. Politiques des Cultural Studies, édition établie par Maxime Cervulle, trad. de Christophe Jaquet, Paris, Éditions Amsterdam, 2007. 56 P. Frantz, « Travestis poissards », Des poissardes au réalisme socialiste, Revue des Sciences Humaines, 1983-2, n° 190, p. 7-20 ; D. Kalifa, Les Bas-fonds, op. cit., p. 205-241. 57 Voir le constat déjà ancien et pessimiste de D. Roche, « Les historiens d’aujourd’hui. Remarques pour un débat », Vingtième siècle-Revue d’Histoire, n° 12, octobre 1986 ; ARESER (Association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la recherche), Diagnostics et remèdes urgents pour une
15
celui qui s’apparente à la possibilité et à l’encouragement de fréquenter des séminaires de recherche, sans l’utilitarisme de la quête de « crédits » inscrits dans des « maquettes » toujours à refaire, mais plus simplement à partir des questions que l’on se posait, de la culture que l’on cherchait à acquérir, des besoins de méthode que l’on rencontrait58. Il faut comprendre les Cris de Paris ou le peuple travesti, comme le produit d’un certain nombre d’échanges, de débats et de confrontations, d’interrogations à travers lesquels le sujet de cette recherche a pris sa véritable forme, à travers lesquels ma « vocation » d’historien s’est précisée et ma formation pour une bonne part jouée.
Ces échanges auxquels j’assistais plus que je n’y participais alors parce que trop néophyte, même s’ils imprimèrent leur empreinte sur ma façon de réfléchir et de travailler, prenaient place dans le séminaire alors animé à l’EHESS par Roger Chartier où il me fut donné d’écouter des historiens majeurs. Ce qui était en cause à ce moment-là n’était rien moins que la remise en cause des apports de l’histoire sérielle et quantitative qui avait régné en maître dans la décennie précédente et qui avait fini par atteindre la « troisième niveau », celui des « mentalités » pour reprendre les vocables utilisés par Pierre Chaunu d’un côté et Michel Vovelle de l’autre59. Cette remise en cause se jouait à travers les propositions que je découvrais de Carlo Ginzburg, fondatrices de la micro-storia, à travers un débat sans concession autour de la « culture populaire » dont l’un des points d’accroche résidait justement dans l’interprétation à donner aux usages de l’imprimé, aux pratiques de lectures. De Roger Chartier à Michel de Certeau en passant par les premiers travaux de C. Jouhaud, de Michel Vovelle (Joseph Sec) à Daniel Roche (Ménétra) en passant par J.-M Goulemot (Valentin Jamerey-Duval), ce qui était en cause au-delà de l’inventaire des régularités et de « l’exceptionnel normal », c’était la redécouverte des singularités, la part de créativité propre à tout phénomène d’appropriation qui n’abolissait pas pour autant le poids des déterminations, ni l’effet du nombre60. Le chantier de l’histoire du livre et des imprimés constituait un creuset particulièrement actif parce qu’il pouvait organiser la rencontre entre des démarches très érudites et techniques (la bibliographie matérielle, l’art du catalogage), les méthodes et les approches de l’histoire sociale (le monde des spécialistes de l’imprimé) et de la sociologie de la culture (les variables de la diffusion et distribution des oeuvres, les déterminants de la consommation) mais aussi de l’histoire économique – le célèbre livre consacré par R. Darnton à l’Encyclopédie levait le voile non seulement sur une grande aventure intellectuelle et sur sa diffusion, mais aussi sur une entreprise majeure du capitalisme commercial appliqué à la Librairie61-. Sur le front des « échanges et des circulations culturelles », du déclassement ou de valorisation de certaines formes, l’ouvrage de Bakhtine sur l’oeuvre de Rabelais et la culture carnavalesque était âprement discuté, tous comme l’oeuvre de Norbert Elias pour université en péril, Raisons d’agir, 1997 ; Que faire pour l’Université ?, Mouvements 55-56, sept.-déc. 2008 ; Qui veut la peau de la recherche publique ? Mouvements 71, automne 2012 ; C. Charle, « Être historien en France : une nouvelle profession ? », Homo Historicus. Réflexions sur l’histoire, les historiens et les sciences sociales, Paris, A. Colin, 2013, p. 27-47 et la conclusion de l’ouvrage, p. 241-251. 58 Effet d’une polarisation scientifique qui s’est probablement accentuée, l’offre en séminaires à Paris et dans la région parisienne constituait une aubaine pour les étudiants. 59 P. Chaunu, Histoire quantitative, histoire sérielle, Paris, Cahier des Annales, Armand Colin, 1978 ; M. Vovelle, Idéologies et mentalités, Paris, Maspéro, 1982. 60 C. Jouhaud, Mazarinades : la Fronde des mots, Paris, Aubier, 1985 ; Journal de ma vie de Jacques Louis-Ménétra, présenté par D. Roche, Paris, Montalba, 1982 ; J.M. Goulemot, Valentin Jamerey-Duval. Mémoires, enfance et éducation d’un paysan au XVIIIe siècle, Paris, Le Sycomore, 1981 ; M. Vovelle, L’irrésistible ascension de Joseph Sec, bourgeois d’Aix et de quelques clefs pour la lecture des ‘naïfs’, Aix-en-Provence, 1975. 61 R. Darnton, L’aventure de l’Encyclopédie, histoire d’un best-seller au XVIIIe siècle, Paris, Perrin, 1982.
16
l’âge classique ou la sociologie de P. Bourdieu62. Les affrontements autour des rapports entre culture populaire et culture des élites (ou culture savante) donnaient lieu à argumentaires serrés, et l’écho ne s’en limitait pas à la France63. Bien avant les sommations de la « connected history », ce thème des circulations et des appropriations culturelles, des phénomènes d’acculturation et de déculturation nourrissait des travaux particulièrement riches, dans le domaine de l’histoire religieuse, mais bien au-delà, que l’on songe aux ouvrages de Serge Gruzinski, des anthropologues-historiens Carmen Bernand, ou Philippe Jacquin64. De manière plus confidentielle, le séminaire de Geneviève Bollème, en philosophe et en littéraire, me permettait d’interroger la catégorie du « populaire », les manières « d’écrire le peuple », et sans doute déjà d’écrire l’histoire65. Ce « braconnage », terme emprunté à M. de Certeau et que j’assume bien volontiers tant l’idée d’expérimentation me semblaient convenir aux pistes que je comptais explorer, est venu s’arrimer à la réflexion menée en séminaire, plusieurs années durant par D. Roche et J.-C Perrot, autour des formes de la culture matérielle, des consommations et des catégories d’une histoire intellectuelle de l’économie politique, dont je retrouverai les fruits, plus tard, notamment sur les terrains de l’histoire administrative et de celle de la police66.
Cet inventaire esquissé n’est nullement un panthéon et n’a pas de prétention à l’exhaustivité. Il veut rappeler que le livre que l’on réédite aujourd’hui, avec les remises en causes et les déplacements qu’il s’efforçait d’apporter, est le produit de ce qui m’apparaît encore comme une période de grande effervescence. Le statut d’expérimentation que je voudrais défendre, même à plus de vingt ans de distance, n’empêche pas d’avoir des convictions, d’apprendre à construire ses arguments, de les reconsidérer si nécessaire ; il préserve peut être de la guerre de tranchées et de certaines querelles. Ce serait un empirisme assumé, mais qui ne récuserait pas un certain goût pour les idées et la conceptualisation. Plutôt que de craindre le paradoxe, il faut peut être y voir la part qu’il laisse à l’invention. Ce statut que, faute de mieux, je qualifierai donc d’expérimental, avait également été conforté par la direction de recherche impulsée par Daniel Roche.
Le dialogue avec lui encourageait la prise de risques, le test, l’apprentissage de la liberté scientifique. C’est ainsi que j’ai pu suivre sans exclusive des voies très variées, quitte à les abandonner ensuite faute de résultats probants, le principe de départ étant celui d’une pertinence minimale au regard des problèmes à traiter. J’ai exploré, par exemple, les apports 62 M. Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 1970 ; N. Elias, La civilisation des moeurs, Paris, Calmann-Levy, 1973 (pour la trad. fr.) et La Société de cour, Paris, Calmann-Levy, 1974 (pour la trad. fr. ; réédition en 1985, avec une préface de R. Chartier, en collection Champs-Flammarion) ; P. Bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979, constituait une lecture ‘incontournable ‘ ; voir Les Historiens et la sociologie de Pierre Bourdieu, Bulletin de la SHMC, 1999, 3-4. 63 L’ouvrage de R. Muchembled, Culture populaire et culture des élites, Paris, Flammarion, 1978 avait, par exemple, été fortement discutée, cf. la recension de R. Chartier dans Revue d'histoire moderne et contemporaine, T. 26e, No. 2 (Avr. - Juin., 1979), p. 298-300, et la thèse initiale nuancée dans l’avertissement de la réédition parue en 1991 ; P. Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, Burlington, Ashgate publishing, 1978. 64 S. Gruzinski, La colonisation de l’imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation dans la Mexique espagnol, XVIe-XVIIIe s., Paris, Gallimard, 1988 ; C. Bernand et S. Gruzinski, De l’idôlatrie. Une archéologie des sciences religieuses, Paris, le Seuil, 1988 ; P. Jacquin, Les Indiens blancs. Français et Indiens en Amérique du Nord, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Payot, 1987. 65 G. Bollème, Le peuple par écrit, Paris, Le Seuil, 1986. 66 M. de Certeau (dir.), La Culture au pluriel, 3e éd. corrigée et présentée par Luce Giard, Paris, Le Seuil, 1993 (1974) ; J.-C. Perrot, Une Histoire intellectuelle de l’économie politique, Paris, EHESS, 1992.
17
que pouvaient représenter la lexicologie politique et de la socio-linguistique liée au laboratoire de l’ENS-Saint Cloud qui éditait la revue MOTS pour réfléchir à une manière de systématiser le travail sur les textes et éviter les biais de la citation impressionniste67. De la même manière que j’avais carte blanche pour m’aventurer du côté de la sociologie de l’art ou de l’histoire de l’art, jusqu’à repousser les limites de mes corpus aux frontières du monde de la peinture et des dessins, donc loin de l’imprimé, voire des objets décoratifs (les céramiques, faïences et porcelaines). À la fois pour questionner les catégories du jugement esthétique, le classement des œuvres, l’évolution des genres, la diffusion des thèmes et des motifs. Je me souviens aussi comment Daniel Roche pouvait me faire part de telle ou telle lecture toute « fraîche », source d’une possible inspiration pour les questions que je me posais, ainsi sur la manière d’exploiter des vues d’optique pour laquelle les analyses de Keith Thomas sur la transformation des sensibilités anglaises à partir de la représentation des paysages, semblaient pouvoir offrir quelques ressources68. Ces extensions et cette liberté n’étaient pas sans difficulté, ni sans nourrir mes angoisses, puisqu’elles exigeaient à chaque fois l’acquisition d’un minimum de compétences, l’assimilation de notions, parfois de méthodes, qui n’étaient pas immédiatement celles mises en œuvre par les historiens « classiques », au risque de mécontenter tout le monde faute d’être suffisamment spécialisé dans chacun des domaines abordés. Mais c’était là encore, bien avant le temps des injonctions académiques, une manière d’inciter au décloisonnement de la réflexion et aux échanges transdisciplinaires, une façon d’élargir l’horizon et de faire partager une croyance optimiste dans les vertus de la discussion intellectuelle. C’était aussi avant la modification assez radicale des conditions du travail intellectuel par la « révolution internet », un moment où maîtriser documentation et bibliographique semblait moins relever de l’utopie. Vu de cette année 2014, ce constat signale probablement les limites « datées » de ce travail. Mais il lui confère la saveur d’une sorte d’artisanat que l’on peut continuer de trouver sympathique, et pas forcément dénué de résultats.
Longtemps après avoir quitté un chantier, on demeure comme habité par lui. On peine
parfois à s’en défaire alors que durent les sollicitations, les demandes d’intervention qui vous y rattachent au moment où l’on rêverait de cingler vers d’autres rivages, de fréquenter quelques terres vierges dans les archives, de retrouver une manière d’innocence des premiers temps. C’est peut être faire peu de cas de ses obsessions les plus intimes, toujours manifestes d’un projet à l’autre. Je m’amuse parfois aujourd’hui du regard des étudiants sur mes recherches « actuelles » consacrées à la police d’Ancien Régime, ou des interrogations ambiguës de l’auditoire lors d’une conférence publique. Même si dans le domaine des sciences sociales, la police n’est plus un « objet sale » pour reprendre une formule de Jean-Marc Berlière, le sujet apparaît encore certaines fois nimbé d’une aura sulfureuse69. Et comment justifier d’avoir abandonné le terrain de l’histoire culturelle et des représentations, potentiellement plus consensuel, pour celui plus aride, parfois plus propice aux malentendus, de l’histoire des polices ? Passer du peuple à la police, serait-ce pour schématiser « trahir », employant ce terme à dessein et me sachant issu d’un milieu familial où la tradition 67 R. Robin, La société française en 1789. Semur en Auxois, Paris, Plon 1970 ; Histoire et linguistique, Paris, A. Colin, 1973 ; M. Tournier, « Mots et politique, avant et autour de 1980. Entretien », Trente ans d’étude des langages du politique, MOTS Les langages du politique, ENS, 2010-3, n° 94. 68 K. Thomas, Dans le jardin de la nature. La mutation des sensibilités en Angleterre à l’époque moderne, 1500-1800, Paris, Gallimard, 1985. 69 Pour les historiens français, J.-M. Berlière est le pionnier de la rénovation de ce chantier historiographique, voir sa synthèse en collaboration avec R. Levy, Histoire des polices en France de l’Ancien Régime à nos jours, Paris, Nouveau monde éditions, réédition complétée, 2013.
18
révolutionnaire et libertaire, bien représentée, ne pouvait qu’inciter à tenir les représentants de « l’ordre établi » dans la plus haute suspicion ?
D’un terrain à l’autre, ma réponse d’historien consisterait d’abord à souligner des éléments de continuité dans mes interrogations, attentives à comprendre des circulations de textes, des systèmes d’emprunts et de réemplois, des manières de produire des discours de légitimation à travers une confrontation entre des pratiques sociales, des conceptions et des intentions politiques, entre des acteurs et des institutions70. D’un terrain à l’autre, il s’agit aussi de raisonner sur des sources qui « parlent » du peuple pour exprimer finalement beaucoup d’autres choses, comme l’attestent à l’envi les nombreux ouvrages d’Arlette Farge, et cela sans pour autant s’interdire de questionner désormais ceux qui ont produit ces discours, leurs pratiques et leurs visions du monde. D’un terrain à l’autre, ce qui est en cause pourrait s’apparenter ou faire écho, en partie, aux divers registres d’une « history from below », telle que les tenants de la tradition d’histoire sociale anglo-saxonne s’efforcent de la pratiquer en mobilisant un répertoire de sources très divers, de la littérature aux archives judiciaires, du registre à l’iconographie71. D’un terrain à l’autre enfin, ce qui m’intéresse est de mettre à jour certains mécanismes du fonctionnement social, dans le domaine des échanges « symboliques » ou des représentations d’abord, dans un domaine plus pratique, plus politique et socio-institutionnel aujourd’hui, mais l’un et l’autre bons observatoires possibles des formes du « vivre ensemble ». Ce qui n’est peut être pas si éloigné des intentions, du propos tenu par Arlette Farge dans La déchirure ? À un moment du Peuple de Paris, Daniel Roche rappelait « qu’écrire sur le peuple », c’était, en quelque sorte, « choisir son camp »72. J’ai choisi le mien depuis longtemps et c’est ce qui donne sans doute à mes premiers travaux une coloration qui a rebuté et rebute peut être encore certains lecteurs, gênés par l’insistance mise à expliquer la « popularité » des figures stéréotypées du peuple et les formes du travestissement dont il fait l’objet, par le « mépris » ou la condescendance qu’il inspire. A défaut du peuple, le « mépris », dont le corolaire serait la revendication permanente et toujours actuelle d’une dignité trop souvent déniée, peut-il constituer un objet d’histoire73 ?
Vincent Milliot
70 C’est l’un des fils « directeurs » des ouvrages suivants, V. Milliot (dir.), Les Mémoires policiers, 1750-1850. Écritures et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire, Presses universitaires de Rennes, 2006 ; C. Denys, V. Milliot, B. Marin, Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2009. 71 Voir notamment les travaux de M. Rediker, de P . Linebaugh, dont on pourrait citer, L’hydre aux mille têtes. L’histoire cachée de l’Atlantique révolutionnaire, Amsterdam, 2009, de T. Hitchcock ou de R. Shoemaker, dont on pourrait citer, The London Mob. Violence and Disorder in Eighteenth-Century England, London and New-York, Hambledon, 2004., voir aussi la recension et les références fournies par M. Vaillant, « La foule des pauvres à Londres au XVIIIe siècle : une histoire par en bas », RHMC 60-3, juillet-septembre 2013, p. 137-150. 72 D. Roche, Le peuple de Paris, op. cit., p. 39 ; et les remarques formulées par P. Minard, « L’histoire sociale en héritage », in La Grande Chevauchée, op. cit., p. 22-24. 73 On pourrait utilement relire les réflexions de C. Grignon et de J. C. Passeron, Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Gallimard-Le Seuil-EHESS, 1989 et R. Hoggart, La culture du pauvre, Paris, Minuit, 1970 (pour la traduction française).