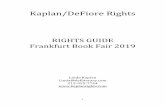Le texte de fiction francophone comme discours tant social que littéraire
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le texte de fiction francophone comme discours tant social que littéraire
Le texte de fiction francophone comme discours tant social que littéraire Monique Lebrun, UQAM
Lebrun, M. (1995). Le texte de fiction francophone comme discours tant social que littéraire. Dialogues et cultures, no 39, 143-156.
Introduction On envisage généralement une séquence textuelle en se basant sur un thème donnée, ou encore sur un genre littéraire précis. L'approche que nous proposons ici est combinatoire, à la confluence de deux champs de savoir: elle convoque certaines théories littéraires relatives à des caractéristiques narratologiques, mais également des arguments de type socio-historique fondés tant sur la pragmatique que sur la sociocritique. La complexité de cette démarche nous oblige à nous interroger à la fois sur les savoirs antérieurs des élèves et sur le développement de leurs structures cognitives. En ce sens, le parcours présenté trouverait son sens à la fin du cycle secondaire, constituant une révision des théories sur le récit déjà vues et permettant de déboucher sur des objectifs de type culturel au sens large du terme, sollicitant les représentations des élèves et leurs acquis objectifs. Nous prendrons tout d'abord la peine de justifier notre démarche englobante à la lumière de ce qu'est, pour d'aucuns, l'oeuvre littéraire et en posant la délicate question de la référence. Nous expliquerons ensuite notre choix des paradigmes du récit, à savoir le personne, le temps et l'espace, que nous retenons pour notre analyse. Viendront ensuite les trois parties pédagogiques proprement dites, où l'on analysera chacun des paradigmes à l'aide d'une grille et où l'élève sera invié à poursuivre la démarche à l'aide de deux autres textes, tous tirés de la LFA . Quelques pistes d'activités complémentaires cloront la démarche, permettant à l'élève de déboucher sur une interprétation plus personnelle . Justificatif Parce qu'elle institutionnalise les textes en les encadrant dans une démarche didactique, l'école s'obtine à créer un concept de culture officielle. Pour peu que les dits textes réflètent des idéaux esthétiques et sociaux propres à une époque, ils sont vite qualifiés de "classiques": on les célèbre, on les fétichise. Sans doute cela est-il vrai, jusqu'à un certain point, dans nos pays francophones, pour la littérature "française", à l'aune de laquelle on a jaugé, et de laquelle on jauge toujours, dans certains milieux et chez certains critiques révérencieux, des littératures "nationales" dites minoritaires. Quant aux élèves, on ne leur demande évidemment leur avis ni sur le corpus, ni sur la démarche pédagogique. On s'interroge cependant de plus en plus (cf les travaux de Reuter , de Petitjean, et,
plus largement, de la revue "Pratiques") sur leur "culture" propre, sur leur capacité à saisir les référents sociaux-culturels propres à une oeuvre donnée. L'oeuvre littéraire, faut-il le rappeler (cf Barthes, 1953 et Kristéva,1969), n'est pas axée sur la communication avant tout. Elle est par essence hétérogénéité, éclatement de la langue, regénération illimitée des sens. Ici se pose donc, pour l'enseignant, le problème fondamental: comment faire saisir la part de l'irréductible de l'oeuvre littéraire, cette mouvante pluralité, comment rendre des novices sensibles à des "effets de texte". La partie "communicable" de l'oeuvre, essentiellement référentielle et argumentative, est-elle, elle aussi, de l'ordre du littéraire? Blanchot (1955) penchait, quant à lui, pour la neutralité du texte littéraire, ne lui reconnaissant de référent valable que par rapport à lui-même. Cette attitude, qui perdure encore aujourd'hui, n'est-elle pas aussi le fait de critiques littéraires pour lesquels la littérature française constitue toute la littérature, dispensant ainsi les lecteurs francophiles de chercher ailleurs d'autres référents? Ou, pour parler davantage en termes théoriques, faut-il faire fi, en enseignement comme ailleurs, de la sociologie du texte littéraire? L'idéologie perceptibles (pour certains) à travers une oeuvre serait-elle un vain message, empêchant le liseur d'accéder aux arcanes de la jouissance textuelle pure? Faut-il considérer les explications lexicales, historiques et sociologiques comme superflues, lorsqu'on étudie des oeuvres de la francophonie élargie? L'esprit (des écrivains des critiques... et des pédagogues) ne soufflerait-il que sur l'Hexagone? Le propos de la démarche didactique que nous suggérons ici est que les littératures francophones constituent un corpus valables, non seulement au plan sociologique, mais également littéraire, le mot étant ici pris dans son sens général. De plus, nous suggérons une mise en perspective des textes par le recours à l'intertextualité, formule susceptible, croyons-nous, de faire éclater les sens. Les francophones sont à la fois unis et séparés par la même langue: derrière des acceptions particulières se profilent des modalités culturelles "différentes". C'est donc dire que notre démarche nous permettra de déboucher sur la question identitaire, sur les interrogations concernant l'énonciateur et l'énonciataire du discours, sur l'écrivain en tant qu'artiste, que sujet social... et sur l'élève en tant qu'être humain et que membre d'une communauté culturelle. Notre démarche, en ce sens , convoque des visions du monde différentes, mais, faut-il le croire, complémentaires, à la découverte de "significations" issues de la pluralité des possibles, de l'"étrangeté" "inquiétante" (selon les termes de Freud) ou stimulante. Le texte littéraire "autre", quand on prend le temps de le condidérer en perspective, cesse de projeter son exotisme de pacotille. Il faudrait au fond se dire que, quelle que soit son origine, le texte littéraire nous conduit à la recodification d'un réel revêtu des habits d'une culture différente, mais identifiable tout de même, et surtout stimulant pour l'esprit et pour le coeur. C'est à l'enseignant de trouver, en classe, les chemins voulus. Les paradigmes du récit choisis pour la démarche Si l'on prend pour acquis que toute lecture est teinté d'idéologie, on se facilite sûrement la tâche en étudiant le discours social et littéraire à travers le récit (catégorie polymorphe englobant, entre autres, tant le roman que la nouvelle, le conte, le mythe et l'autobiographie). Les paradigmes sont en effet facilement cernables: le sujet, le temps, l'espace et l'action, le tout traversé par un "procès du sens" avant que d'être référentiel (Cambron,1989). Rappelons Ricoeur(1983-85), pour lequel
le récit est un acte de langage articulé à trois niveaux: a) la préfiguration (mimésis I), ou maîtrise des réseaux conceptuels, d'une sémantique de l'action, identification des médiations symboliques, des caractères; b) configuration (mimésis II), ou intérêt pour l'intrigue (agents, buts, moyens, circonstances); c) refiguration (mimésis III) (en parallèle avec les théories de la réception de Jauss (1978) et Iser (1976) ), ou importance du rôle du lecteur, du problème de la référence, de la pragmatique. On connaît la définition de l'intertextualité (cf Kristéva 1969; 1978): tout discours en répète un autre en ce sens qu'il reflète l'absorption et la transformation d'un texte préalable. C'est ce qui fait dire à Kristéva qu'un texte se construit comme une mosaïque de citations. On peut dire, parallèlement, que toute lecture est tabulaire puisqu'elle établit, verticalement, un rapport du texte à son contexte et, horizontalement, de l'écrivain à son oeuvre. Lorsque Bakhtine (1987;1975) parle de dialogisme, il s'inscrit au fond dans une perspective intertextuelle. Si le texte littéraire est un langage de connotation, comme le dit Arrivé (1972), alors, l'intertexte, ou ensemble de texte entrant en relation avec un texte donné, contitue le lieu de manifestation de cette connotation. Nous utiliserons de façon large la perspective intertextuelle en mettant en relation des textes non pas sur des thématiques particulières, mais bien sur des éléments constitutifs du récit, soit le personnage (ses procédés de caractérisation et de prise de parole), le lieu comme symbole culturel (locus de contrôle, diraient les psychologues) et le temps dans sa dimension sociale et historique, en particulier. Ces caractéristiques narratives permettent de faire apparaître des "motifs" et de les classer selon un système sémantique. Nous n'oublions pas qu'il y a des règles d'acceptabilité de ces caractéristiques narratives selon les époques et les lieux: si nos textes sont contemporains, ils sont par ailleurs d'auteurs très divers au plan de la culture et pour qui le français n'est pas toujours (c'est le cas des écrivains africains) la langue maternelle. La médiation de la parole à travers le récit permet l'émergence des valeurs culturelles, soit les règles de construction du sens consolidant les représentations du monde propres à une société. Projetée dans l'univers du lecteur, cette parole suscite (devrait susciter, à l'école, par le biais d'une maïeutique appropriée) la prolifération d'autres paroles, la construction d'autres sens : les "nous" et les "eux" pragmatiques se constituent, en même temps que les sensibilités vibrent aux accents personnels d'une expérience partagée, parce qu'esthétiquement rendue. Le personnage et ses "rôles" Pour cerner le personnage, nous nous appuierons sur Hamon (1977) et surtout sur l'excellent travail de Reuter(1987). Des trois axes qui, selon lui, permettent de le définir, deux sont littéraires au sens strict, alors que le troisième nous oriente vers la sociologie. En raison de l'orientation de notre parcours didactique, c'est ce dernier que nous privilégierons, sans négliger pour autant les deux autres, puisqu'ils permettent de modéliser la notion elle-même de personnage. Considérons d'abord le personnage comme marqueur typologique, ici de la catégorie récit. Bien que le personnage apparaisse dans d'autres types de textes, c'est en tant que marqueur du narrateur qu'il acquiert toute son épaisseur, même si les contours varient selon les sous-genres (ex.: le roman historique par opposition au roman sentimental), ou encore, les époques (cf le personnage balzacien et celui du nouveau roman).
La seconde utilité reconnue au personnage est celle d'organiser le narratif, de le découper en tranches nommées différemment selon les théories de référence. Ainsi, les sémioticiens vont parler de "séquences d'actions", d'"agents" et de "patients", d'"acteurs" et d'"actants" (n'entrons pas ici dans les définitions). Il faut se demander si ce 2e axe, largement tributaire d'une mécanique narrative, permet de rendre compte de toute la complexité des sens convoqué par le texte, surtout le texte littéraire. Surgissent alors des questions relatives à cette "organisation". Existe-t-il dans l'oeuvre un "système" des personnages, qui ferait en sorte que chacun serait différencié et occuperait sa place? Comment découvre-t-on cette caractérisation, directement (ex.: dialogues), ou indirectement (ex.: commentaire rapporté)? Le personnage est-il doué d'une vie propre, ou n'est-il, au contraire que moyen pratique d'introduire descriptions, explications et autres jugements de l'auteur? On connaît la typologie de Hamon (1977), distinguant les personnages référentiels (renvoyant au monde extérieur), des personnages embrayeurs (renvoyant à une instance d'énonciation) et des personnages anaphores (renvoyant à un signe disjoint du même énoncé); elle fait hardiment la part du littéraire et du sociologique. Considérons enfin le troisième axe: le personnage comme lieu d'investissement psychologique et social. Nous éloignons -nous de la perspective esthétique si nous disons qu'il permet d'ajouter un "effet de réalité"? Selon Hamon (1977, p. 12), les personnages référentiels sont de cette catégorie : Tous renvoient à un sens plein et fixe , immobilisé par une culture à des rôles , des programmes, des emplois stéréotypés, et leur lisibilité dépend directement du degré de participation du lecteur à cette culture (ils doivent être appris et reconnus). Intégrés à un énoncé, ils serviront essentiellement d'"ancrage" référentiel en renvoyant au grand Texte de l'idéologie, des clichés, ou de la culture." C'est ainsi que le vraisemblable oriente vers le véridique, au grand dam de certains, et que la "crédibilité" de la fiction lui fait presque perdre ce caractère fictif, justement: le sens de la lecture s'en trouve parfois perverti, surtout si l'identification du lecteur joue à plein, avec hypertrophie de l'émotif. On a déjà souligné (cf Glaudes, 1987) les liens entre le système narratif et la structure fantasmatique, qui permettent de faire surgir des figures de l'inconscient. Ce qui nous intéresse ici, toutefois, est d'avantage de nature sociale, c'est-à dire le personnage comme support de l'axiologisation, donc du système de valeurs. Hamon (1984) a très bien démontré comment les personnages articulent le dispositif évaluatif intra-textuel. Il parle de "personnage focalisateur", celui dont le point de vue est présenté, qui sert de référence et de présupposé à l'oeuvre, mettant en marche le processus euphorie/dysphorie. Ce personnage "évalue" des "sujets sémiotiques" (qui peuvent être des personnages de l'oeuvre), il impose ses grilles culturelles et esthétiques, son langage, ses conduites, ses normes. Ce type de personnage organise l'espace idéologique du récit, le désambiguise, réduit les isotopies, le pluriel du texte. Les effets de langue (ex.: métaphore, superlatifs, modalisateurs) et le recours éventuel à la doxa (cf les clichés) permettent de faire ressortir des normes culturelles, même si l'auteur s'ingénie parfois à pratiquer le "brouillage polyphonique" pour réorienter les interprétations... ou pour pratiquer, simplement, le dialoguisme des valeurs. En ce sens, les personnages complexes, ambigus, défocalisateurs, en un mot, prennent une densité sociologique et culturelle qui nous
oriente vers la pluralisation des normes. Nous suggérons, à la page suivante, une grille d'analyse du personnage qui tient compte des deuxième et troisième axes de Reuter. Nous l'illustrerons en prenant comme exemple l'un des textes de Simone Schwartz-Bart, à savoir "La noce de Toussine et de Jérémie", tiré de son roman Pluie et vent sur Télumée Miracle (LFA, pp 368-369)
Grille d'analyse du personnage 1- Organisateur textuel 1.1 identification des voies narratives: nature du narrateur et du narrataire 1.2 identification du rôle narratif: de premier plan (=héros ou personnage principal) ou secondaire 1.3 caractérisation des "actions" en différents lieux et à différentes époques 1.4 caractérisation linguistique (système anaphorique le désignant, temps de verbes, figures de style, etc.) 1.5 marques de l'évaluation dont il est l'objet (ex.: commentaire rapporté) 2- Lieu d'investissement psychologique et social 2.1 modalités d'ancrage dans le réel (qualités de véracité, de réalisme) 2.2 modalités de création d'un "nous" psychologique (=identification) et/ou pragmatique(=consensus social) 2.3 émergence et modalisation axiologique (système de valeurs) 2.4 catharsis/distanciation du narrateur (Lebrun, 1994)
Application de la grille d'analyse du personnage à l'extrait de S. Schwartz-Bart 1- Organisateur textuel 1.1 identification des voies narratives: nature du narrateur et du narrataire La narratrice, S. S.-Bart, ne se pose pas explicitement comme telle. Pour employer la terminologie de la sémiotique, elle n'est pas le destinateur du discours repérable dans l'énoncé. La présentation de l'extrait nous laisse savoir que la narratrice est Télumée Lougandor, vivant en Guadeloupe durant la première moitié du XIXe siècle. Le narrataire/destinataire peut être sa propre communauté de parole, à laquelle elle adresse directement ses remarques (voir lignes 1 à 3; lignes 48 et 49). Cette précision nous amène à parler des "actants" sémiotiques (destinateur et destinataire) en tant qu'ils jouent un rôle dans l'énoncé au plan communicatif. Peut-on aller jusqu'à dire, ici, qu'à travers Minerve, Toussine et Jérémie, d'une part, et les villageois, d'autre part, nous avons affaire à deux "actants sociaux" représentant chacun leur propre "valeurs" face à la vie en général et au mariage en particulier? Les modalités d'énonciation du discours (jouant tantôt sur l'implicite, tantôt sur l'explicite des valeurs) nous permettent de le croire. Ajoutons que le narrateur , pour reprendre Genette, en sait plus que ses "personnages"; il s'agit ici de "focalisation externe", perceptible dans les remarques au narrataire. 1.2 identification du rôle narratif: de premier plan (=héros ou personnage principal) ou secondaire Le personnage le plus important du texte est indéniablement le couple, contre lequel se prononce le village, au début, à qui on pardonne, par la suite, en vertu de la musique, et que l'on voit couler des jours heureux, dans une troisième partie. Les habitants du village sont indifférenciés. La mère de Toussine forme un personnage secondaire chaleureux. 1.3 caractérisation des "actions" en différents lieux et à différentes époques On suit la trajectoire de l'"actant collectif", en fait les commères aigries du village, jusqu'à la noce (échange de paroles doucereuses avec la mère, Minerve). La "logique" des actions s'inverse, au mariage, par la vertu de la musique: on danse, on rit, on oublie les tracas, on félicite même les mariés. Dans le dernier paragraphe, on passe des actions ponctuelles au "temps long" et aux actes "itératifs" d'une vie de dur labeur (ex.: pêcher, cultiver le jardin). 1.4 caractérisation linguistique (système anaphorique le désignant, temps de verbes, figures de style, etc.) Le système anaphorique désignant les commères du village est assez élaboré, transcrivant par là le souci de l'auteur pour elles: "humains", "femmes", "celles qui vivaient en case", "elles", "belles langueuses", "chiennes enragées". Il y a donc ici inflation verbale, qui se tarit lors du mariage.Toussine et Jérémie, quant à eux, représentent, et c'est très évident dans le système anaphorique, la "femme" et l' "homme" des premiers temps du monde, le couple éternel. On peut souligner la disjonction temporelle évidente dès le mileu du texte: avant la noce, c'est le
temps "indéfini", dont la lenteur nous est largement transmise par l'imparfait de l'indicatif. La scène de noce sert de plaque tournante temporelle: le passé simple nous transmet l'idée de la fragilité du temps du bonheur (voir les travaux de Benvéniste, 1966, sur les temps du passé). La vie commune des héros est ensuite évoquée par un retour à l'imparfait de l'indicatif qui permet de boucler la boucle. On a déjà, par ailleurs évoqué la connotation des termes utilisés pour désigner les commères. Il faudrait souligner la beauté de la métaphore finale, noces avec la mer, noces avec la terre, l'une annonçant l'autre. 1.5 marques de l'évaluation dont il est l'objet (ex.: commentaire rapporté) Ce texte constitue, en quelque sorte, un croisement de regards, celui du village sur le couple (avec le basculement déjà indiqué, pour la scène de la noce), et celui de la mère sur le village. Il y a renversement du discours enthymématique: "la vie est difficile et le mariage dure peu" devient, le temps des réjouissances, "deux jeunes gens peuvent s'aimer pour toujours". Le discours direct (cf les échanges bien sentis entre la mère et les commères) cède la place au "discours indirect" (cf, lignes 57 et 58 , "On ne put compter combien de lèvres prononcèrent le mot chance"). 2- Lieu d'investissement psychologique et social 2.1 modalités d'ancrage dans le réel (qualités de véracité, de réalisme) Ce texte, écrit en 1972 et marque les véritables débuts de romancière de Simone Schwartz-Bart, puisque son oeuvre antérieure était écrite en collaboration avec son mari, André Schwartz-Bart. Le roman veut illustrer la place de la femme dans l'histoire de la Guadeloupe. L'intention d'écriture est donc à la fois patriotique et ethnographique: on ne sent pas la volonté d'embellir, mais de transposer, ce qui est visible dans la scène finale. 2.2 modalités de création d'un "nous" psychologique (=identification) et/ou pragmatique(=consensus social) Il y a ici création d'un "nous social" guadaloupéen, perceptible lorsque la narratrice évoque la coutume de "vivre en case", avec les inquiétudes que pareille situation entraîne pour les femmes, lorsqu'elle décrit à plaisir les préparatifs des noces (plats et musiques typiques) et même lorsqu'elle laisse entrevoir le quotidien des nouveaux mariés (ex.: pêche et petite culture vivrière). 2.3 émergence et modalisation axiologique (système de valeurs) On peut parler de deux systèmes de valeurs, en opposition/complémentarité, à partir de ce texte: le système de valeurs négatif des commères du village,né d'une vie difficile et propre aux "coeurs enflés", et le système de valeurs positif des époux et de leur famille, qui souhaitent briser la loi du talion (cf, ligne 34) et envisagent la vie à deux comme des noces perpétuelles (cf la métaphore finale).
2.4 catharsis/distanciation du narrateur La narratrice opère, au fil du texte, une certaine distanciation, non immédiatement perceptible, par rapport à ses personnages principaux. Ceux-ci, dans le dernier paragraphe, semblent vivre leur vie de façon autonome, loin des qu'en-dira-t-on.
Poursuite de la démarche sur l'analyse des personnages Nous venons d'illustrer, à l'aide d'un court texte, l'application d'une grille d'analyse des personnages. Nous suggérons de poursuivre la démarche en utilisant deux autres textes: 1- Un poète, s'écria mon père, de Marie-Claire Blais (LFA, pp 366 et 367) 2- Ils marchaient à la file indienne, de Driss Chraïbi (LFA, pp 220-221) L'enseignant pourrait procéder de la façon suivante: 1- lecture personnelle du texte de Blais, afin de favoriser une première prise de contact; 2- relecture annotée, selon les différents éléments de la grille; 3- discussion en classe des points obscurs ou des aspects originaux du texte (ex., ici, le symbolisme des couleurs; la crédibilité des personnages; le langage "superlatif") 4- lecture personnelle du texte de Chraïbi; 5- relecture annotée selon les différents points de la grille. Cette fois, l'enseignant donne des pistes (ex.: Peut-on dire que l'on a ici affaire à un seul personnage, indifférencié? En quoi la langue vient-elle accentuer la mécanique de la répétition? On oppose le "on" et le "ils": pourquoi?) 6- rédaction, par chacun, d'un court commentaire (une quinzaine de lignes) sur les personnages de cet extrait. 7- mise en parallèle des trois textes, sous forme de discussion: l'enseignant pourra recourir à des questions du type suivant, pour habituer les élèves soit à nuancer, soit à généraliser. -une langue neutre, objective, aide-t-elle à caractériser les personnages? -est-il nécessaire qu'un personnage soit réaliste pour qu'il devienne un actant social? - en quoi la documentation sur l'auteur vous aide-t-elle à comprendre les personnages qu'il crée? 8- Le travail pourra être complété par une recherche en bibliothèque sur les auteurs étudiés, ou encore, sur les littératures nationales qu'ils représentent. N'oublions pas qu'il existe, dans la collection "Que sais-je", d'excellents résumés, autre autres sur la littérature québécoise et sur les littératures maghrébines d'expression française; voir Mailhot, 1974 et Déjeux, 1992)
Le lieu et ses fonctions Non seulement les lieux permettent de dessiner les itinéraires des personnages, mais encore cristallisent-ils leur personnalité, leurs projets. Ils sont souvent associés à des symboles psychologiques et sociaux. C'est ainsi qu'on peut distinguer, dans les paradigmes de l'espace: 1- l'espace réel et l'espace rêvé; 2- l'espace clos et l'espace ouvert; 3- l'espace souterrain et l'espace élevé; 4- l'élément féminin ou masculin; 5- la ville et la campagne; 6- le labyrinthe et la voie droite; 7- l'espace géopolitique et le lieu indifférencié Qui dit lieu dit description, même sommaire. Comme le souligne Raimond (1989), le morceau descriptif est un lointain héritage de l'épopée antique. Hamon (1982), quant à lui, analyse la fonction de la description des lieux: est-elle décorative, documentaire, ou autre? On se souvient de l'héritage romantique ici: qui n'a rêvé, devant des pages de Lamartine, de l'harmonie entre la nature et l'état d'âme du héros. Au fil du XIXe siècle, les romanciers ont emprunté leurs techniques descriptives à l'esthétique picturale: mise en relief des contrastes, opposition des plans rapprochés et des plans lointains, délimitation du "spectacle" à l'aide d'un cadre strict, par exemple, une fenêtre. C'est à Balzac que l'on doit l'insistance sur la fonction symbolique de la description (des lieux comme des personnages). Les psychanalystes ont pris le relais: ainsi, ils ont beaucoup glosé sur la signification des différents étages de la maison, la cave étant assimilée à l'inconscient et le grenier, à l'élévation spirituelle. Hamon (1984) nous rappelle les forts liens entre le "topographique" et le personnage: il ancre le sujet, en fait la condition d'existence du lieu. Il peut, en ce sens y avoir redondance (ou discordance) entre lieu et personnage. Les personnages n'ont pas tous les mêmes droits sur l'espace: celui-ci étant réticulé, décomposé, on y "situe" les personnages en conséquence. L'espace et les objets culturels qui l'encombrent sont souvent "évalués" par l'écrivain grâce au recours à l'hyperbole, à l'oxymore (ainsi, les qualités contradictoires d'un lieu), à la métonymie (ainsi, la fusion entre l'habitat et l'habitant). Quant à la dimension géopolitique du lieu, plusieurs écrivains contemporains refusent de s'y laisser enfermer. Rappelons la thèse de Blanchot (1955), que nous évoquions en début de ce texte: la littérature est une déterritorialisation fondamentale qui propulse les oeuvres dans l'espace littéraire.Ainsi, Habersaat (1985), écrivaine romande, oppose au territoire"réel" le territoire de la page blanche, territoire intime et potentiel, nourri d'imaginaire, même si elle avoue, du même souffle, que l'imaginaire est toujours branché sur un passé culturel, donc situé géopolitiquement. Même dans des sociétés très politisées, nombreux sont ceux qui considèrent avant tout que la littérature est l'infini de tous les espaces, tendant vers tous les possibles .
Parallèlement, il existe au Québec des poètes et romanciers en quête d'un territoire à nommer: pour Grandbois, Miron, Chamberland, Tremblay, avant qu'elle ne devienne toutes les terres du monde, la terre est d'abord l'espace natal. Antonine Maillet elle-même (ancien prix Goncourt), dont tous les romans sont situés dans son Acadie natale, a déjà dit, dans une interview à Radio-Canada (1992): "C'est parce que je suis profondément régionale que j'atteins parfois, je crois, l'universel." Nous illustrerons notre démarche sur l'analyse des lieux à l'aide du texte de Abdelwahab Meddeb, Le sentiment de l'étrangeté (LFA, 298-299)
Grille des paradigmes de l'espace: 1- l'espace réel et l'espace rêvé; 2- l'espace clos et l'espace ouvert; 3- l'espace souterrain et l'espace élevé; 4- l'élément féminin ou masculin; 5- la ville et la campagne; 6- le labyrinthe et la voie droite; 7- l'espace géopolitique et le lieu indifférencié
Analyse du texte de Abdelwahab Meddeb, Le sentiment de l'étrangeté Meddeb appartient à la nouvelle génération des écrivains tunisiens qui reconsidèrent leurs relations avec l'Occident, dans la foulée de l'héritage de Fanon, tout en restant curieux, sinon nostalgiques des "ailleurs". L'acculturation devient un thème à la mode, de même que la recherche identitaire, Meddeb rejoignant en cela cet autre grand écrivain africain qu'est Tahar Ben Jelloun, récent prix Goncourt. Les mouvements du narrateur dans les arcanes (les différentes parties) de la ville, au sens codé du terme, sont limités, ici. On suit sa trajectoire exploratrice que l'on situe, par une habile mise en abyme, dans le prolongement de celle d'un roman antérieur, Talismano. Il y a césure entre deux lieux de l'enfance, le narrateur opposant les venelles de la médina (espace clos, populeux et désordonné) (ligne 13) à la Zitouna, grande mosquée (espace clos, solitaire et ordonné). D'autre part, ces lieux s'assimilent pour le narrateur à un passé révolu (voir les lignes 8-9 et 41-42, où il nous fait part de son sentiment d'étrangeté). Pour le narrateur, la mosquée, par les synthèse des cultures qu'elle représente (cf les chapitaux romains et byzantins, aux lignes 23 et 24) constitue le refuge, suite à sa quête identitaire: il n'est plus tout à fait de son peuple, mais appartient à la commune humanité. L'espace est également un lieu d'ancrage de l'esthétique: le "musée de colonnes" qu'est la Zitouna, est décrit comme harmonieux dans ses formes et ses contrastes (cf les divers styles, les jeux d'ombre et de lumière). Bref, c'est un lieu non seulement chargé de mémoire, mais projetant également la beauté
Poursuite de la démarche sur l'analyse de l'espace Nous venons d'illustrer, à l'aide d'un court texte, l'application d'une grille d'analyse de l'espace. Nous suggérons de poursuivre la démarche en utilisant deux autres textes: 1- Un primitif Eden, de Claude Simon (LFA, p. 169) 2- Le ciel de Djémila, d'Albert Camus (LFA, pp 166-167) L'enseignant pourrait procéder de la façon suivante: 1- lecture personnelle du texte de Simon, afin de favoriser une première prise de contact; 2- relecture annotée, selon les différents éléments de la grille; 3- discussion en classe des points obscurs ou des aspects originaux du texte (ex., ici, les détails "exotiques"; les caractéristiques de l'espace remémoré; les noirs immobiles assimilés à un élément du décor, une "frise") 4- lecture personnelle du texte de Camus; 5- relecture annotée selon les différents points de la grille. Cette fois, l'enseignant donne des pistes (ex.: Montrez que le voyage à Djémila est représenté comme une conquête. Le vent est plus qu'un élément du décor: montrez en quoi il participe des pensées du narrateur.). 6- rédaction, par chacun, d'un court commentaire (une quinzaine de lignes) sur la notion d'espace personnalisé, à travers cet extrait. 7- autre possibilité de travail: réflexion sur l'épicurisme de Camus, à travers ses réflexionssur le "hic et nunc" 8- mise en parallèle des trois textes, sous forme de discussion: l'enseignant pourra recourir à des questions de type suivant, pour habituer les élèves soit à nuancer, soit à généraliser. -quelles ressources linguistiques aident à la caractérisation des lieux? - en quoi peut-on dire que les trois espaces ici décrits sont inscrits dans une mouvance géo-historique? 9- Le travail pourra être complété par une recherche des "lieux" de prédilection des auteurs, à travers certaines de leurs oeuvres. On peut également demander aux élèves de retrouver, dans des anthologies, diverses illustrations des types de lieux mentionnés dans la grille. Enfin, pour ce qui est des lieux relatifs à l'habitation, il existe une interprétation symbolique et psychanalytique, nous l'avons dit, selon que l'on se retrouve dans les étages supérieurs (soit les plus haut degré de lucidité, ou de spiritualité), ou dans le sous-sol (soit dans le domaine de l'inconscient), qu'il est possible d'appliquer à certains lieux romanesques. à
Les expressions du temps On associe souvent temps et espace, dans l'étude de la fiction , puisqu'ils permettent tous deux de situer à la fois les personnages et l'action. Le récit, parce qu'il est mouvement, est aux prises avec la succession, donc avec le temps, ainsi que le rappellent Bourneuf et Ouellet (1972). Le romancier rêve de créer son temps propre (pensons ici à Proust) et y réussit dans les limites de son roman.La temporalisation (comme la spatialisation et l'actorialisation) contribue à construire le "discours", à renvoyer à l'instance d'énonciation. Nous distinguerons ici le temps interne et le temps externe. Parler du temps interne permet de faire intervenir la distinction des sémioticiens entre temps raconté et temps racontant. Le temps raconté est celui de la fiction, du déroulement de l'action ; il peut être long ou court. Le temps racontant est celui de la narration, qui nous oriente vers les conditions de production de l'oeuvre. La "programmation temporelle" permet de distinguer l'ordre logique de l'enchaînement des "programmes narratifs" et leur ordre chronologique (et souvent causal). La temporalisation au sens strict organise les embrayages et débrayages temporels, organise les temps, accélère ou réduit les rythmes. C'est ainsi qu'on peut parler de retours en arrière, d'anticipations, d'ellipses, de télescopages, de chevauchements, de retours cycliques, et qu'on aboutit à une histoire. Le temps externe, quant au lui, ne participe pas en tant que tel au programme narratif. C'est le temps social ,à la fois de l'écriture du roman et de sa lecture. C'est ainsi qu'on s'intéresse au contexte de production d'une oeuvre (l'auteur,sa communauté de parole, sa culture d'origine et son époque), de même qu'au contexte de sa réception, encore là, variée selon les époques et les lieux. L'analyse suivante d'un texte de Ramuz (LFA, pp 342-343) permettra à l'enseignant d"illustrer la conception du temps chez un auteur.
Grille des expressions du temps 1- Le temps interne 1.1 le temps raconté: précisions sur le déroulement de l'action (=l'histoire) 1.2 le temps racontant: précisions sur la narration que fait l'auteur 1.3 l'ordre logique des programmes narratifs, i.e. les changements d'états successifs des personnages 1.4 les embrayages et débrayages temporels: retours en arrière, anticipations, ellipses, télescopages, chevauchements, retours cycliques 2- Le temps externe 2.1 le temps de la production de l'oeuvre: milieu social de l'auteur; contexte socio-politique; référents culturels 2.2 le temps de la réception de l'oeuvre: milieu social du récepteur; contexte socio-politique; référents culturels.
Analyse des expressions du temps dans Nous réussissions à nous échapper, de Ramuz 1- Le temps interne 1.1 le temps raconté: précisions sur le déroulement de l'action (=l'histoire) 1.2 le temps racontant: précisions sur la narration que fait l'auteur Ramuz écrivit ce texte en 1927, alors qu'il atteignait presque la cinquantaine (temps racontant). Ce texte, largement autobiographique, évoque son enfance paysanne (temps raconté) 1.3 l'ordre logique des programmes narratifs, i.e. les changements d'états successifs des personnages Les personnages principaux sont trois jeunes garcons de 10 à 12 ans (âge de la pré-puberté), qui, délaissant les travaux "de femmes", c'est-à-dire la cueillette du raisin, vont espionner les hommes au pressoir. 1.4 les embrayages et débrayages temporels: retours en arrière, anticipations, ellipses, télescopages, chevauchements, retours cycliques La brièveté de l'extrait réduit en conséquence les embrayages et débrayages. Le temps de verbe privilégié ici, l'imparfait de l'indicatif, suggère un passé continu et laisse entendre que la scène décrite était devenue, pour les protagonistes, une habitude. L'absence de télescopage, mais, au contraire, le rythme lent du texte fige la scène dans une éternité bienheureuse. 2- Le temps externe 2.1 le temps de la production de l'oeuvre: milieu social de l'auteur; contexte socio-politique; référents culturels Comme Bosco et Giono, Ramuz appartient à la lignée des écrivains du terroir. Sa qualité de Suisse et surtout son amour pour la classe paysanne transparaissent dans plusieurs oeuvres. Tant par ses thèmes que par sa langue, il a fait sa marque parmi les écrivains suisses et ceux de la francophonie. L'oeuvre d'où est tirée ce texte, Vendanges, date de l'entre-deux guerres (1927), époque où l'auteur avait regagné la Suisse, après ses années "françaises". Le principal référent culturel de ce texte est la vigne, symbole à la fois païen et judéo-chrétien. C'est non seulement le liquide sacré dont le culte (celui de Dionysos) est lié aux mystères de la vie, mais aussi l'arbre sacré du jardin d'Eden et une "manifestation" du Christ (qui se désigne lui-même, dans le Nouveau Testament, soit comme le vai cep, soit comme le Vigneron). Pour les sémiologues, le vin, par l'alcool qu'il contient, est symbole de jeunesse, de victoire sur la fuite du temps. Sa couleur pourpre est signe de la célébration du mariage entre l'air (cf les vignes en espalier; le travail des femmes) et la terre (cf la cave du pressoir et le travail des hommes). C'est, par excellence, le breuvage de l'initiation, le passage du temps de l'enfance à celui de l'adulte. La société décrite ici est familiale, conservatrice: les rôles traditionnels de l'homme et de la femme sont bien définis et les valeurs d'honnêteté et de responsabilisation, mises en évidence.
L'image est-elle idéalisée, trop idyllique? Il ne faut pas oublier que la campagne, ici, est avant tout un lieu de travail (cf les efforts musculaires évoqués en début de texte) et de sante morale. 2.2 le temps de la réception de l'oeuvre: milieu social du récepteur; contexte socio-politique; référents culturels. L'oeuvre prend des résonnances diverses selon les milieux ou les époques. Ainsi, si elle se situe dans une série textuelle bien définie en Europe, il n'en est pas de même en Amérique francophone, ou l'univers de la vigne, pour ne parler que de celui-là, est quasi inconnu. Par contre, la peinture d'une société agricole traditionnelle rejoindra des lecteurs québécois familiers de Hémon, Guèvremont, Grignon, Ringuet, chantres d'une société (celle des années 1910 à 1940) qui n'avait pas encore opéré son virage urbain.
Poursuite de la démarche sur l'analyse du temps Nous venons d'illustrer, à l'aide d'un court texte, l'application d'une grille d'analyse du temps. Nous suggérons de poursuivre la démarche en utilisant deux autres textes: 1- Peut-être ai-je une histoire, de Mohammed Khaïr-Eddine (LFA, p 297) 2- La négraille accepta tout, de Yambo Ouologuem (LFA, pp 236-237) L'enseignant pourra procéder de la façon suivante: 1- lecture personnelle du texte de Khaïr-Eddine, afin de favoriser une première prise de contact; 2- relecture annotée, selon les différents éléments de la grille; 3- discussion en classe des points obscurs ou des aspects originaux du texte (ex.:ce que signifie le refus de l'histoire pour le narrateur, le temps de production et de réception de l'oeuvre, selon le paratexte de LFA) 4- lecture personnelle du texte de Ouologuem; 5- relecture annotée selon les différents points de la grille. Cette fois, l'enseignant donne des pistes (ex.: le passé de la narration, le déroulement des "programmes narratifs" des personnages, les télescopages temporels) 6- rédaction, par chacun, d'un court commentaire (une quinzaine de lignes) sur la notion de temps personnalisé, à travers cet extrait. 7- autre possibilité de travail: recherche en bibliothèque sur le contexte socio-politique d'évolution de la littérature africaine depuis 1960; marquage de l'opposition entre la période colonisatrice et celle des indépendances 8- mise en parallèle des trois textes, sous forme de discussion: l'enseignant pourra recourir à des questions de type suivant, pour habituer les élèves soit à nuancer, soit à généraliser. -quelles ressources linguistiques aident à la caractérisation du temps? - en quoi peut-on dire que les deux derniers textes se rejoignent par leur conception du temps? Conclusion Nous avons dit, dans nos précautions préliminaires, que l'oeuvre littéraire combine une multiplicité des sens tout en n'échappant pas à un ancrage socio-culturel. Notre dispositif didactique nous a conduit, au coeur même des trois grilles présentées, à tenir compte de l'un et l'autre aspect. Une démarche intertextuelle complète pourrait permettre à l'élève d'analyser les neuf textes soumis à la lumière des trois paradigmes envisagés, et non d'un seul. On pourra tenter avec les élèves des exercices de réécriture sur un paradigme particulier (ex.: décrivez les lieux de votre enfance). Il est cependant évident que l'exercice prendra tout son sens à la lecture d'une oeuvre complèle: ainsi se fera jour le "système" des personnages et l'individualité du cadrage spatio-temporel d'un auteur. Si la pratique des morceaux choisis et la technique du groupement de textes a ses vertus, impératifs scolaires obligent, il n'en reste pas moins que la lecture intégrale seule permet de vivre une expérience littéraire complète, puisqu'elle offre une combinatoire des niveaux d'analyse
Références Arrivé, M. (1972). Les langages de Jarry. Essai de sémiotique littéraire. Paris: Klincksieck. Bakhtine (1987; 1 ère édition russe en 1975). Esthérique et théorie du roman. Parsi: Gallimard, coll Tel. Barthes (1953). Le degré zéro de l'écriture. Paris: Seuil. Benveniste, E. (1966). Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard. Blanchot (1955) .L'espace littéraire. Paris: Gallimard. Bourneuf, R. et R. Ouellet (1972). L'univers du roman. Paris: Presses universitaires de France, coll, Sup. Cambron, M. (1989).Une société, un récit. Discours culturel au Québec (1967-1976). Montréal: L'Hexagone, coll. Essais littéraires. Déjeux, J. (1992). La littérature maghrébine d'expression française. Paris: Presses universitaires de France, coll. Que sais-je no 2675 Glaudes, P. (1987) Psychanalyse et personnage.dans Y. Reuter (dir.) La question du personnage. (pp 45-89) Clermont-Ferrand: Annales du centre régional de documentation pédagogique Habersaat, E. (1985). (Communication non titrée). dans L'écrivain et l'espace. Communications de la 12e rencontre québécoise internationale des écrivains tenue à Québec du 27 avril au premier mai 1984 (pp 131-140). Montréal: L'Hexagone. Hamon, P. (1982). Un discours contraint. dans G. Genette et T. Todorov (dir). Littérature et réalité. (pp 119-181). Paris: Seuil, coll. Points. Hamon, P. (1984). Texte et idéologie..Paris: Presses universitaires de France, coll. Ecritures. Iser W. (1976). L'acte de lecture: théorie de l'effet esthétique. Bruxelles: Mardaga. Jauss, H.R. (1978).Pour une esthétique de la réception . Paris: Gallimard Kristéva, J. (1978; 1ère éd.: 1969). Recherches pour une sémanalyse (extraits). Paris: Seuil, coll. Points. Mailhot, L. (1974). La littérature québécoise. Paris: Presses universitaires de France, coll. Que sais-je no 1579. Raimond, M. (1989). Le roman. Paris: A. Colin, coll. Cursus. Reuter, Y. (1987). Le personnage. dans Y. Reuter (dir.) La question du personnage. (pp 9-44) Clermont-Ferrand: Annales du centre régional de documentation pédagogique Ricoeur, P. (1983;1984;1985)Temps et récit. Tome 1: L'intrigue et le récit historique. Tome 2: La configuration dans le récit de fiction. Tome 3: Le temps raconté. Paris: Seuil.