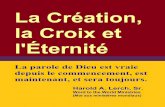Le bilan des expérimentations normatives dans les collectivités territoriales depuis la révision...
-
Upload
univ-angers -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Le bilan des expérimentations normatives dans les collectivités territoriales depuis la révision...
Faculté de Droit – UM1 CERCOP
39 rue de l’Université 34060 Montpellier
Mémoire de recherches réalisé par : Albéric Baumard
Sous la direction de :
Guillaume Merland, maître de conférences HDR à l’Université de Montpellier I
LE BILAN DES EXPERIMENTATIONS
NORMATIVES DANS LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES DEPUIS LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU 28 MARS 2003
Master 2 Droit public Parcours droit constitutionnel
Soutenu publiquement le
29 juin 2009
Année universitaire 2008-2009
2
Remerciements
À ceux qui m’ont soutenu, encouragé et supporté
tout au long de cette aventure montpelliéraine.
Mes remerciements les plus sincères vont tout d’abord à Monsieur Guillaume Merland
sans qui cette étude n’aurait jamais été possible. Je le remercie de m’avoir guidé tout au long
de ce parcours de recherches, de m’avoir prodigué les conseils nécessaires à la rédaction de
ces lignes et d’avoir été toujours disponible pour répondre à mes questions et inquiétudes.
Je veux aussi remercier celles et ceux qui m’ont aidé, conseillé et épaulé durant cette
initiation à la recherche scientifique. J’adresse une pensée toute particulière à toute l’équipe
d’enseignants et de chercheurs du CERCOP pour leur accueil et pour avoir partagé leurs
expériences dans la construction d’un travail de recherche. Une pensée amicale va également
à tous mes camarades du Master 2 de Droit public grâce à qui la préparation et la rédaction de
ce mémoire se sont déroulées dans des conditions optimales.
Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la
rédaction de ces lignes.
3
SOMMAIRE
PARTIE I – UNE MANIFESTATION DE L’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION NORMATIVE CHAPITRE 1. UNE TECHNIQUE DE DÉSENGAGEMENT APPARENT DE L’ETAT CHAPITRE 2. LA CONCILIATION DE L’EXPÉRIMENTATION AVEC LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS PARTIE II – LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPÉRIMENTATION
CHAPITRE 1. UNE EFFICACITÉ INCERTAINE CHAPITRE 2. UN CONTENTIEUX POTENTIELLEMENT ABONDANT
4
TABLE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
AJDA Actualité juridique – droit administratif AJFP Actualité juridique – fonction publique al. Alinéa art. Article Cf. Confer CGCT Code général des collectivités territoriales CJCE Cour de justice des Communautés Européennes CNRS Centre national de la recherche scientifique Coll. Collection Cons. (n°) Considérant (n°) Dir. Sous la direction de EDCE Etudes et documents du Conseil d'État ex. Exemple Ibid. Ibidem JCP-A et CT Jurisclasseur périodique (La semaine juridique), édition administrations et collectivités territoriales JCP-G Jurisclasseur périodique (La semaine juridique), édition générale JOCE Journal officiel des Communautés Européennes JORF Journal officiel de la République française LPA Les petites affiches LGDJ Librairie générale de droit et de jurisprudence LO Loi organique n° Numéro op. cit. Opus citatum p. Page p.(n°) s. Pages (n°) et suivantes RDP Revue du droit public Rec. Recueil RFDA Revue française de droit administratif RGCT Revue générale des collectivités territoriales RIDC Revue internationale de droit comparé RMI Revenu minimum d’insertion RSA Revenu de solidarité active V. Voir
6
« C’est dire qu’avant d’apprécier la portée réelle de cette innovation,
il conviendra, en quelques sortes, d’expérimenter l’expérimentation… »
ROUX André, « Constitution, expérimentation et décentralisation »
in Constitution et finances publiques. Études en l’honneur de Loïc Philip,
Economica, 2005, p.218.
Introduit dans notre droit constitutionnel positif lors de la révision de mars 20031,
relative à l’organisation décentralisée de la République, le droit à l’expérimentation était alors
annoncé comme « une chance de renouvellement, de revitalisation »2 de la production
normative. Aujourd’hui, six ans après cette modification de notre norme fondamentale, le
temps semble être venu de réaliser un bilan des expérimentations menées.
Initialement, l’expérimentation est étrangère à la matière juridique. C’est du côté des
sciences dures, et notamment de la médecine, qu’il faut rechercher les origines de la méthode.
Il est impossible de faire l’impasse sur l’œuvre de Claude Bernard3. C’est à ce médecin
français, qui a vécu à la fin du XIXè siècle, qu’on doit la théorisation de la méthode
expérimentale appliquée à la médecine. Il publie en 1865 un ouvrage intitulé Introduction à la
1 Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République, JORF, 29 mars 2003, p.5568. 2 PONTIER Jean-Marie, « Décentralisation et expérimentation », Tribune, AJDA, 2002, p.1037. 3 Claude BERNARD (1813-1978) : médecin et physiologiste français, il est considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale.
7
médecine expérimentale4. S’il n’est pas l’inventeur de la méthode expérimentale, ni même de
la notion, l’œuvre de Claude Bernard revêt une importance capitale. L’Introduction, comme il
est coutume de nommer son ouvrage, a pour principal apport de théoriser la méthode
expérimentale et d’en mettre à jour les éléments constitutifs. L’expérimentation est déjà
connue au XIXe siècle. Elle est employée en chimie ou encore en physique. Claude Bernard
va importer cette technique dans l’étude des corps vivants, à savoir la médecine et la
physiologie. Il ne faut pas oublier qu’à cette époque, la médecine est encore considérée par
beaucoup comme un art, l’intuition de Claude Bernard à travers son ouvrage, est de la
conduire « vers sa voie scientifique définitive ».5
Pour le médecin, l’expérimentation se définit comme « un raisonnement à l’aide
duquel nous soumettons méthodiquement nos idées à l’expérience des faits ».6 À partir de
cette définition, Claude Bernard développe les différentes étapes constitutives de la méthode
expérimentale. Selon l’auteur, l’expérimentateur « 1° constate un fait ; 2° à propos de ce fait,
une idée naît dans son esprit ; 3° en vue de cette idée, il raisonne, institue une expérience, en
imagine et en réalise les conditions matérielles ; 4° de cette expérience résultent de nouveaux
phénomènes qu’il faut observer, et ainsi de suite ».7 La séquence de l’expérimentation débute
et s’achève par une observation. Entre les deux l’intervention de l’expérimentateur suppose
que celui-ci ait une idée et qu’il cherche, par l’intermédiaire de l’expérimentation, à valider ou
invalider cette idée. Cette succession d’étapes permet à Claude Bernard d’expliquer la
différence qui existe entre l’observation et l’expérimentation et d’insister sur la nécessité
d’une hypothèse a priori, et du doute qui l’accompagne.
Si l’observation trouve sa place dans la méthode expérimentale, les deux activités
diffèrent. Dans la méthode expérimentale, le scientifique intervient sur des faits afin d’obtenir
des résultats qui corroborent ou non son idée de départ. Au contraire, dans le cadre de la
simple observation, le scientifique se contente d’observer les faits naturels, tels qu’ils se
présentent à lui, sans y apporter une quelconque modification. « C’est là précisément, dans
cette puissance de l’investigateur d’agir sur les phénomènes, que se trouve la différence qui
sépare les sciences dites d’expérimentation, des sciences dites d’observation ».8
L’observation joue cependant un rôle très important dans la méthode expérimentale, comme 4 BERNARD Claude, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865, Pris Flammarion, rééd. 1984 318p. 5 BERNARD Claude, op. cit., p.25. 6 Ibid, p.26. 7 Ibid, p.54. 8 Ibid, p.47.
8
l’admet lui-même Claude Bernard, « l’esprit du savant se trouve […] toujours placé entre
deux observations ».9 L’observation est le point de départ de l’expérimentation, puisque c’est
à partir d’elle que le scientifique construit son hypothèse à tester. L’observation est aussi le
point d’arrivée de l’expérimentation, puisque c’est par elle que le scientifique conclu à la
validation ou à l’invalidation de son hypothèse. Entre les deux, « le fait que doit constater
l’expérimentateur ne s’étant pas présenté naturellement à lui, il a dû le faire apparaître, c'est-
à-dire le provoquer ».10 Tout cela conduit l’auteur à conclure que « l’expérience est une
observation provoquée dans un but de contrôle ».11
Claude Bernard insiste sur un second élément qui est l’hypothèse a priori de
l’expérimentateur, et le doute qui l’accompagne. Toute expérimentation suppose que le
scientifique ait une idée ou une hypothèse avant de commencer. Cette idée doit germer dans
l’esprit de l’expérimentateur, non pas de façon fantaisiste, mais à partir de ses observations
préalables. Cette idée préalable est nécessaire à la mise en œuvre d’une expérimentation,
comme le souligne le médecin français « la méthode par elle-même n’enfante rien ».12
Corollaire de l’idée a priori, l’expérimentateur doit constamment rester soumis au doute. Le
risque pour l’expérimentateur est d’avoir trop confiance en son idée de départ. Pour Claude
Bernard, l’expérimentateur doit savoir observer tous les résultats de son expérience et non pas
seulement ceux qui confirment son hypothèse. Il doit admettre que son hypothèse de départ
peut être fausse et doit accepter les résultats de son expérience. Le doute est tellement
nécessaire à toute activité expérimentale que, pour Claude Bernard, « les hommes qui ont une
foi excessive dans leurs théories ou dans leurs idées sont non seulement mal disposés pour
faire des découvertes, mais ils font aussi de très mauvaises observations. Ils observent
nécessairement avec une idée préconçue, et quand ils ont institué une expérience, ils ne
veulent voir dans ses résultats qu’une confirmation de leur théorie ».13 Au-delà du simple
doute, l’auteur invite même le scientifique à soumettre toute expérience au jugement de la
contre preuve. La contre preuve permet de mettre en évidence que les résultats de
l’expérimentation ne sont pas qu’une coïncidence. Si en agissant sur un fait, l’expérimentateur
obtient un résultat déterminé, la contre preuve permet de démontrer qu’en n’agissant pas sur
ce fait le résultat obtenu est différent. La contre preuve met en évidence la relation de cause à
effet entre l’action de l’expérimentateur et le résultat. Comme le souligne, d’ailleurs à juste
9 Ibid, p.54. 10 Ibid, p.49. 11 Idem 12 Ibid, p.67. 13 Ibid, p.71.
9
titre Claude Bernard, « jamais en science la preuve ne constitue une certitude sans la contre
preuve ».14
L’apport de Claude Bernard à la science expérimentale est fondamental. Toutefois,
son enseignement va se diffuser au-delà de la seule médecine. Le XIXè siècle voit la méthode
expérimentale se développer dans les autres sciences et même dans les arts. Il est alors aisé
d’en conclure que « la question de l’expérimentation est fondamentalement
multidisciplinaire ».15
À l’époque où Claude Bernard publie son Introduction, on observe le développement
de la psychologie expérimentale. Le premier ouvrage sur cette question est publié en 186016,
soit quelques années avant l’Introduction. La psychologie expérimentale vise à « prouver le
bien-fondé de l’hypothèse. Et pas n’importe comment : la relation supposée entre les faits
observés n’est considérée comme vérifiée qu’à partir du moment où l’expérimentateur est
capable de la reproduire ».17 La méthode expérimentale appliquée à la psychologie a toujours
le même objectif : tester la relation de cause à effet entre une action de l’expérimentateur et le
résultat obtenu. « En France, le premier laboratoire est créé en 1889, sous le titre de
laboratoire de psychologie physiologique ».18 Qu’ils soient médecins, psychologues ou autres
scientifiques, tous partagent en commun de pouvoir exercer leur activité au sein de
laboratoires. Or en matière de sciences sociales, parmi lesquelles le droit, l’expérimentateur
n’a pas accès à ces mêmes laboratoires. Cette différence fondamentale n’est pas sans
incidences sur la transposition de la méthode expérimentale à la matière juridique. Toutefois,
le développement de la méthode expérimentale dans la littérature démontre que l’absence de
laboratoire n’est pas un obstacle insurmontable.
La fin du XIXè siècle voit, en effet, la publication du Roman expérimental d’Émile
Zola. L’auteur, marqué par la lecture de l’Introduction à la médecine expérimentale, décide
de transposer la méthode au travail de romancier. Le Roman expérimental est publié en 1880.
Il s’agit en fait d’un compilation d’articles que l’auteur avait publié dans différents journaux
de l’époque : Le Bien public, Le Voltaire et Le Messager de l’Europe. Il s’agit là
véritablement d’une nouvelle méthode pour écrire un roman que Zola veut imposer. « Le
14 Ibid, p.91. 15 GAUDIN Jean-Pierre, « Épistémologie de l’expérimentation », in Les collectivités locales et l’expérimentation : perspectives nationales et européennes, Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des libertés locales, Paris, La documentation française, 2004, p.111. 16 FECHNER, Elemente der Psychophysik, 1860. 17 FRAISSE Paul, La psychologie expérimentale, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 13e édition, p.4. 18 Ibid, p.12.
10
romancier n’est plus seulement un observateur, il est un expérimentateur, montant une
expérience dont le résultat doit confirmer l’hypothèse dont il a eu l’idée d’après ses
observations ».19
L’expérimentation en matière normative est apparue plus tard. Le recours à cette
méthode se développe au cours du XXè siècle, ce qui fait dire à certains auteurs que
« l’expérimentation est l’une des nouvelles figures de la réforme administrative sous la Vè
République ».20 Le droit à l’expérimentation a été constitutionnalisé en 2003 mais pour autant
la technique était déjà utilisée, éprouvée et encadrée.
Le législateur et l’administration avaient déjà eu recours à des formes
d’expérimentation en matière juridique que leurs juges respectifs étaient venus encadrer21. En
matière juridique, l’expérimentation est, pour reprendre les mots du Doyen Boulouis, « une
procédure de mise au point sur échantillon ».22 Il s’agit de préparer une norme en la testant
sur un petit échantillon avant de procéder à sa généralisation. La loi Veil de 197523 relative à
l’interruption volontaire de grossesse était une loi expérimentale, puisque prévue pour durer
seulement cinq ans avant que la question de sa généralisation se repose. En 1996, la notion
d’expérimentation est consacrée dans le titre même d’une loi relative aux expérimentations
dans le domaine des technologies et services de l’information24. Cette loi prévoit
expressément la possibilité d’expérimentations « en vue de favoriser le développement des
infrastructures et des services de télécommunications et de communication audiovisuelle […]
en dérogation aux dispositions législatives ».25 Cette loi démontre l’utilité de
l’expérimentation pour adapter la législation à « un domaine hautement évolutif, où les
dispositions, à peine adoptées, sont souvent dépassées ».26 L’expérimentation va trouver un
terrain favorable à son développement en matière de décentralisation.
19 BECKER Colette, GOURDIN-SERVENIÈRE Gina, LAVIELLE Véronique, Dictionnaire d’Émile Zola, Paris, Robert Laffont, Coll. Bouquins, 1993, p.369. 20 PONTIER Jean-Marie, op. cit., p.1037. 21 V. notamment : Conseil Constitutionnel, n°93-322 du 28 juillet 1993, loi relative aux établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel, JORF, 20 juillet 1993, p.10750 ; Conseil d'État, 1967, Sieur Peny, Rec. p.365. Ces décisions feront l’objet de développements plus amples ultérieurement. 22 BOULOUIS Jean, « Note sur l’utilisation de la « méthode expérimentale » en matière de réformes », in Mélanges en l’honneur du Doyen Louis Trotabas,LGDJ, 1970, p.34. 23 Loi n°75-17 du 17 janvier 1975, relative l’interruption volontaire de grossesse, dite Loi Veil, JORF, 18 janvier 1975, p.739. 24 Loi n°96-299 du 10 avril 1996, relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, JORF, 11 avril 1996, p.5569. 25 Loi n°96-299, précitée, art. 1er. 26 PONTIER Jean-Marie, « L’expérimentation et les collectivités locales », RA, n°320, 2001, p.172.
11
La décentralisation, et notamment le transfert de compétences aux collectivités
territoriales, a été l’occasion de nombreuses expérimentations. La première expérimentation
en ce domaine a été mise en place par la loi d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire de 199527 et est relative à la régionalisation ferroviaire.
L’expérimentation a débuté en 1997 et a été généralisée par la loi du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains28. Six régions s’étaient portées candidates
et avaient été admises à expérimenter. « La région Limousin, marquée par une faible densité
de population, s’est ensuite jointe à l’expérimentation sur proposition du ministre chargé des
transports, laquelle a été motivée par la volonté d’étendre l’expérimentation à des situations
variées ».29 Tel est l’intérêt de l’expérimentation que de préparer une réforme par son test
dans des situations variées afin d’en corriger les défauts avant de procéder à la généralisation.
Par la suite, c’est la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité qui a engagé
une expérimentation relative aux ports maritimes30. L’expérimentation proposée transférait la
compétence en matière d’aménagement, d’entretien et d’exploitation de ces ports, de l’État
aux régions. Cette expérimentation n’a rencontré aucun succès, au point que la loi du 13 août
200431 l’a abrogée. Une autre expérimentation mérite d’être signalée car elle a été mise en
place en dehors de toute disposition législative. Cette expérimentation a été engagée en 2001
par le Ministère de la Culture et de la communication et porte sur les « Protocoles de
décentralisation culturelle ». Cette expérimentation vise à mettre en place un nouveau partage
des compétences et des responsabilités entre l’État et les collectivités territoriales dans les
domaines du patrimoine et des enseignements artistiques. En tout sept protocoles ont été
adoptés, soit par des départements soit par des régions. La loi de 2002 sur la démocratie de
proximité a étendu cette expérimentation, mais aucune collectivité ne s’est portée candidate.
Enfin la loi du 13 août 2004 a tenté de relancer en partie cette expérimentation mais sans
grand succès.
C’est à la suite de la censure par le Conseil Constitutionnel de la loi sur la Corse en
200232 que l’expérimentation est revenue sur le devant de la scène juridique. Cette décision a
27 Loi n°95-115 du 4 février 1995, d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, JORF, 5 février 1995, p.1973. 28 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, JORF, 14 décembre 2000, p.19777. 29 CHAVRIER Géraldine, « Expérimentation territoriale », JCP-A, Fasc. 116-20, 2005, p.6. 30 Loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, JORF, 28 février 2002, p.3808 31 Loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, JORF 17 août 2004, p.14545. 32 Conseil constitutionnel, n°2001-454DC du 17 janvier 2002, loi relative à la Corse, JORF, 23 janvier 2002, p.1526.
12
mis en évidence les limites du statut jurisprudentiel de l’expérimentation et la nécessité de
mettre en place un véritable statut juridique.
La loi adoptée prévoyait d’offrir la possibilité à la Collectivité de Corse un pouvoir
d’adaptation, des dispositions législatives en vigueur, aux spécificités de l’île. Cette
adaptation, adoptée par l’Assemblée de Corse, ne devait avoir qu’un caractère expérimental,
dans l’attente « de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives
appropriées ». Le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition dans sa décision du 17
janvier 2002. Le Conseil Constitutionnel considère dans cette décision « qu’en dehors des cas
prévus par la Constitution, il n’appartient qu’au parlement de prendre des mesures relavant
du domaine de la loi ». Dès lors, le législateur ne pouvait pas ouvrir, « fût-ce à titre
expérimental, dérogatoire et limité dans le temps », le droit pour une collectivité locale
d’intervenir dans le domaine de la loi. Cette décision a mis en avant les limites du statut
jurisprudentiel de l’expérimentation. Il est d’ailleurs assez étrange de voir, qu’en même temps
que le Parlement adoptait cette loi sur la Corse, deux propositions de révision
constitutionnelle, relatives à l’expérimentation, étaient déposées, l’une devant l’Assemblée
nationale et l’autre au Sénat. La première était l’œuvre du député Pierre Méhaignerie et fut
adoptée par l’Assemblée nationale, elle tendait à introduire dans la Constitution un droit à
l’expérimentation pour les collectivités territoriales. La seconde proposition de loi fut
présentée à l’initiative de Christian Poncelet, alors président du Sénat. Elle était relative à la
libre administration des collectivités territoriales. Il semble quelque peu schizophrénique de la
part du Parlement d’adopter par la voie législative normale des dispositions pour lesquelles il
reconnaît en même temps la nécessité d’une révision constitutionnelle.
Dès lors, durant la campagne présidentielle de 2002, M Jacques Chirac se prononce en
faveur d’une réforme constitutionnelle d’ampleur relative à l’autonomie des collectivités
territoriales, prévoyant notamment un volet « droit à l’expérimentation ». Cette volonté est
affirmée dans un discours fait à Rouen le 10 avril 200233. Le Président de la République –
alors candidat à sa propre réélection – explique à cette occasion qu’une « nouvelle distribution
des pouvoirs et responsabilités entre les collectivités et la République exigera une importante
révision de la Constitution ».34 Le candidat Chirac annonce clairement la
constitutionnalisation d’un droit à l’expérimentation pour les collectivités territoriales. 33 Discours de M. Jacques Chirac à Rouen, campagne pour l’élection présidentielle, 10 avril 2002. Le discours est disponible dans son intégralité sur le site de l’Elysée, dans la section Archives – discours et déclarations. www.elysee.fr 34 Idem
13
L’ensemble des éléments constitutifs d’une expérimentation est déjà présents dans ce
discours. Selon M. Jacques Chirac, l’expérimentation permet de « faire l’expérience d’une
réforme en grandeur nature, dans des collectivités volontaires, avant de les généraliser à
l’ensemble du territoire ».35 Le discours met même déjà en lumière, le fort lien qui existe
entre l’expérimentation et le principe de subsidiarité, principe également introduit dans la
Constitution lors de la révision de 2003. En effet, l’expérimentation a pour objectif de
« rechercher le meilleur échelon pour l’efficacité de la démocratie ».36
Alors en pleine campagne électorale, le Président de la République annonce même que
cette réforme constitutionnelle sera adoptée par référendum. Promesse électorale non tenue,
c’est finalement le Congrès qui va ratifier la révision constitutionnelle. La révision va se faire
alors que M. Jean-Pierre Raffarin dirigeait le Gouvernement. Celui-ci, qui est un élu local, est
favorable à une plus grande décentralisation. Le Parlement a travaillé très rapidement sur cette
réforme ce qui n’a pas « toujours permis un débat approfondi ni une rédaction complètement
satisfaisante ».37 Lors de l’adoption finale du texte au Congrès, le Premier ministre présente le
droit à l’expérimentation comme « le deuxième levier important de réforme »38, le premier
qu’il ait présenté étant le principe de subsidiarité. L’adoption de cette réforme a tout de même
posé quelques difficultés. Il s’agissait de concilier la volonté du Gouvernement d’approfondir
la décentralisation tout en ménageant les parlementaires qui étaient, pour certains, hostiles à
cette réforme. « L’expérimentation a semblé alors constituer un des « piliers » de la réforme
parce qu’elle vise à permette la réalisation de ces […] objectifs, et aussi parce qu’elle
constitue une des rares méthodes d’action publique qui ne cristallise pas le scepticisme ou le
fatalisme : elle est nouvelle, elle porte encore des espoirs ».39 Le projet de loi
constitutionnelle, devant être adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, soit 518 voix, au Congrès, a été ratifié par une majorité de 584 voix.
Cette révision constitutionnelle40 a inséré deux articles relatifs à l’expérimentation
dans notre norme fondamentale. Il s’agit de l’article 37-1 et de l’article 72, alinéa 4. La
rédaction de ces deux articles diffère largement et aboutit à deux types d’expérimentations
très différentes. L’article 37-1 dispose que « la loi ou le règlement peuvent comporter, pour
un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». L’article 72, alinéa 35 Idem 36 Idem 37 VERPAUX Michel, Droit des collectivités territoriales, Paris, PUF, Coll. Major, 2005, 1ère édition, p.36. 38 RAFFARIN Jean-Pierre, Congrès du 17 mars 2003, JORF, 18 mars 2003, p.15. 39 CHAVRIER Géraldine, op. cit., p.3. 40 Loi constitutionnelle n°2003-276 du 26 mars 2003, op. cit.
14
4, beaucoup plus long, dispose, quant à lui, que « dans les conditions prévues par la loi
organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté
publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre
expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou
réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ». L’article 37-1 permet une
expérimentation par l’État tandis que l’article 72, alinéa 4, ouvre la voie à des
expérimentations par les collectivités territoriales mais avec l’accord de l’État :
expérimentations transferts dans le premier cas, expérimentation dérogations dans le second.41
« Dans les deux cas, l’expérimentation est territoriale puisqu’elle vise soit à déterminer la
pertinence d’un transfert d’une compétence étatique au niveau local par l’expérimentation de
sa gestion locale, soit à faire participer le niveau local à l’exercice du pouvoir normatif
national en testant localement des normes, et ainsi en les adaptant à leur milieu
d’application ».42 Si la cible des expérimentations est dans les deux cas les collectivités
territoriales, les objectifs et les effets de ces dispositions sont différents.
Conformément à l’article 72, alinéa 4, le Parlement a adopté une loi organique relative
à l’expérimentation43. Cette loi a été intégrée au Code général des collectivités territoriales.
Elle complète et précise les différentes étapes de l’expérimentation dérogation. La
combinaison de ces dispositions fait apparaître une procédure en grande partie maîtrisée par
l’État où les collectivités locales n’ont que le statut de candidats. Dès lors, « l’idée d’un droit
à demander l’expérimentation paraît mieux rendre compte de l’ambition du constituant que
celle d’un droit à l’expérimentation ».44
Depuis mars 2003, les deux types d’expérimentations ont été mises en œuvre avec des
succès divers. C’est la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales45 qui
la première a prévu des expérimentations sur le fondement de l’article 37-1.
L’expérimentation relative au revenu de solidarité active, qui a débuté en janvier 2008, est,
pour l’instant, le seul exemple d’expérimentation dérogation.
41 La distinction expérimentation transfert et expérimentation dérogation provient de CHAVRIER G. op. cit. 42 CHAVRIER Géraldine, op. cit., p.3. 43 Loi organique n°2003-704 du 1er août 2003, relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales, JORF, 2 août 2003, p.13217. 44 FAURE Bertrand, « L’intégration de l’expérimentation au droit public français », in Mouvement du droit public. Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, Dalloz, 2004, p.184. 45 Loi n°2004-809 du 13 août 2004, op. cit.
15
Si pour certains auteurs, « la révolution annoncée n’a pas eu lieu »46, faut-il pour
autant porter un jugement aussi critique sur le droit à l’expérimentation tel qu’il a été introduit
dans notre droit constitutionnel ? S’il est vrai qu’assez peu d’expérimentations ont été mises
en œuvres depuis 2003, celles menées ont déjà produit leurs résultats. Dès lors quels sont les
enseignements qui peuvent être tirés de ces expérimentations. La notion de bilan implique de
réaliser une critique constructive à partir de ces premières expérimentations. C’est pourquoi il
sera également nécessaire de porter un regard – toutefois limité – sur de possibles
améliorations du régime juridique du droit à l’expérimentation. Il convient de porter un regard
à la fois critique et constructif sur les raisons du recours à l’expérimentation mais aussi sur ses
effets.
L’intérêt de cette étude est de pouvoir confronter trois points de vue, d’une part les
textes constitutionnels et législatifs, d’autres part les attentes et critiques de la doctrine et
enfin la réalité des expérimentations menées depuis 2003. Dans le cadre de cette étude,
l’objectif est de comparer la révolution annoncée lors de la réforme de 2003 avec la réalité des
faits, six ans plus tard. Suivant la méthode expérimentale, le point de départ de l’étude est une
intuition, celle que l’État se sert de la méthode expérimentale dans son seul intérêt. Il s’agit
donc de confronter cette intuition à l’épreuve des faits pour la confirmer, l’infirmer ou encore
la nuancer.
Face à un manque évident de temps, le champ de cette étude sera nécessairement
circonscrit. L’étude se limitera dans le temps à l’analyse des dispositifs expérimentaux mis en
œuvre depuis 2003 uniquement. Des exemples d’expérimentations antérieures seront appelés
en renfort de certaines démonstrations. Cependant, l’objet de l’étude étant le bilan des
expérimentations depuis 2003, ce sont les expérimentations postérieures à cette date qui
seront au cœur des développements. De même, l’expérimentation ayant trouvé un terreau
favorable à son développement dans le cadre de la décentralisation, cette étude se concentrera
sur les expérimentations menées au sein des collectivités territoriales. Enfin, si le droit
comparé sera parfois invoqué en renfort de certaines démonstrations, c’est le droit français, et
plus particulièrement le droit constitutionnel qui sera au cœur de l’étude.
46 LONG Martine, « L’expérimentation : un premier bilan décevant pour les collectivités territoriales », Tribune, AJDA, 2008, p.1625.
16
Pour la réalisation de ce bilan, il convient d’analyser les raisons du recours à
l’expérimentation et les effets que cela engendre.
Dans un premier temps de l’étude, il sera nécessaire d’analyser les raisons de la
constitutionnalisation et du recours à l’expérimentation normative. Il s’agit d’exposer l’idée a
priori selon laquelle l’expérimentation est une technique de désengagement de l’État. Le
jugement ne doit cependant pas être aussi péremptoire, la constitutionnalisation du droit à
l’expérimentation a nécessité la conciliation de ce droit avec les autres normes contenues dans
la norme fondamentale. Dès lors le respect de ces normes empêche l’État de dévoyer
totalement l’expérimentation. Il faut en conclure que l’expérimentation est avant tout la
manifestation d’une nouvelle manière de produire la norme.
Dans un second temps, cette étude visera à mettre à jour les effets de la mise en œuvre
de l’expérimentation. Transposition d’une méthode née dans les sciences dures,
l’expérimentation normative demeure encore incertaine quant à son efficacité pour améliorer
le droit. Un élément est toutefois certain parmi les effets de l’expérimentation, c’est la
complication de la procédure que cela apporte, en témoigne l’important risque de contentieux
qui existe.
PARTIE I – UNE MANIFESTATION DE L’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
NORMATIVE
PARTIE II – LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPÉRIMENTATION
18
L’expérimentation normative est réellement une nouvelle manière de concevoir la
règle de droit. Par l’expérimentation, il s’agit de tester sur une petite échelle une nouvelle
norme avant de procéder à sa généralisation. Ce test a pour but d’adopter ensuite la règle la
plus efficace possible et la plus à même de répondre aux besoins de la société.
L’expérimentation est « une procédure de mise au point sur échantillon ».47 Elle est une
méthode empruntée aux sciences dures. Elle n’est pas une évidence en matière de sciences
sociales, en particulier dans le domaine juridique. Dans la tradition juridique française héritée
de la Révolution, la loi est l’objet d’une forme de culte. La loi, « expression de la volonté
générale », ne peut souffrir d’être remise en cause. Elle est devenue un fétiche intouchable. À
côté de la loi trône également le principe d’égalité, lui aussi hérité de la Révolution. La
conception française de l’égalité conduit à appliquer la même règle de droit pour tous. Trop
souvent l’égalité mène à l’uniformité. La loi et l’égalité, depuis la Révolution de 1789, sont
deux objets juridiques intangibles. Les remettre en cause semble impossible. L’infaillibilité de
la loi et le principe d’égalité aiguillent toute l’action publique. L’expérimentation est un
moyen de désacraliser ces objets.
L’État a subi au cours du XXe siècle une profonde mutation qui l’a amené à se
repositionner sur ses missions essentielles. Parallèlement les exigences des citoyens se sont
accrues. La décentralisation a permis de répondre, en même temps, à ces deux mouvements
contraires. En se dessaisissant de certaines compétences au profit des collectivités
territoriales, l’État a pu ne conserver que les missions jugées essentielles. Dans le même
temps, les collectivités locales ont développé leurs moyens d’action pour répondre aux
attentes des citoyens. L’expérimentation permet, là aussi, de réaliser cette conciliation
puisqu’elle offre de nouvelles compétences aux collectivités territoriales et leur permet de
devenir de véritables acteurs de la production normative.
L’expérimentation a été constitutionnalisée en 200348, au même titre que le principe
subsidiarité dont elle est le corollaire. L’inscription dans notre norme fondamentale de ces
techniques nouvelles traduit une mutation en profondeur de la manière de produire la règle de
47 BOULOUIS Jean, « Note sur l’utilisation de la « méthode expérimentale » en matière de réformes », in Mélanges offerts à Monsieur le doyen Louis Trotabas, op. cit., p.34. 48 Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, op. cit.
19
droit. Pour autant, la Constitution n’a pas été totalement réécrite. L’expérimentation doit être
conciliée avec la conception, héritée de la Révolution, de la loi et du principe d’égalité.
L’expérimentation, en s’inscrivant dans une révision constitutionnelle relative à la
décentralisation, apparaît alors comme un moyen pour l’État de transférer des compétences
aux collectivités territoriales (Chapitre 1). Toutefois, la constitutionnalisation de
l’expérimentation induit un important travail d’harmonisation des principes contenus dans la
norme fondamentale (Chapitre 2).
20
Chapitre 1. Une technique de désengagement
apparent de l’État
L’expérimentation n’as pas été inscrite de façon anodine dans notre droit positif. Elle
apparaît comme une méthode de réforme de l’État. Il est, en effet, incontestable
qu’aujourd’hui l’État procède à une mutation de son action en profondeur, afin de se
concentrer sur ses prérogatives centrales. Cette mutation se traduit par le transfert d’un certain
nombre de compétences à des entités autres que l’État, que ces transferts soient contraints
comme dans le cas des compétences données à la Communauté Européenne ou qu’ils soient
volontaires comme dans les transferts de compétences dans le cadre de la décentralisation.
L’expérimentation normative est donc prise dans un mouvement beaucoup plus large
qui la dépasse et qui est l’apparition d’une nouvelle forme d’État. Or, avec l’apparition de
cette nouvelle forme d’État est apparue également une nouvelle conception du droit, qualifié
de droit post-moderne. L’une des caractéristiques de ce droit, mise en avant avec
l’expérimentation, est de faire apparaître de nouveaux acteurs dans la production normative,
en l’occurrence les collectivités territoriales. L’État y trouve cependant lui aussi un intérêt
puisque, dans le cadre de sa réforme, l’expérimentation est un moyen de procéder à des
transferts de compétences, sans donner l’impression d’imposer ces transferts aux collectivités
infra étatiques. Les motifs pour lesquels l’État a recours à l’expérimentation doivent donc être
mis à jour.
Le fait que les motivations de l’État doivent être mises à jour démontre que l’État
conserve un rôle ambigu dans l’expérimentation. En effet, deux types d’expérimentations ont
été rendues possibles par les textes. Dans les deux cas, l’État donne l’impression de jouer un
rôle prépondérant. Si dans le cadre des expérimentations transfert, l’État joue effectivement
un rôle central, dans le cadre des expérimentations dérogation, la marge de manœuvre
accordée aux collectivités territoriales est en réalité assez importante. Il est donc nécessaire de
revenir sur ce rôle ambigu.
Dès lors, il conviendra d’analyser les motivations du recours à l’expérimentation
(Section 1), puis d’étudier le rôle de l’État dans la procédure d’expérimentation (Section 2).
21
Section 1. Les motivations du recours à l’expérimentation
L’expérimentation normative a été constitutionnalisée en 200349. Il s’agit d’une
méthode issue non de la technique juridique mais des sciences dures. L’inscription de cette
technique dans notre norme fondamentale traduit donc une profonde évolution des mentalités.
Ce changement se traduit également par la redistribution des compétences qui a été opérée
suite à la révision constitutionnelle. En effet, cette révision a permis de redéfinir tant le rôle
des collectivités territoriales que le rôle de l’État dans la production normative. Les
expérimentations ne vont pas seulement permettre à l’État de procéder à une nouvelle
répartition des compétences entre échelon central et échelons décentralisés ; le recours à
l’expérimentation permet aussi de faire basculer le centre de gravité de la production
normative en faveur des collectivités locales.
Si l’expérimentation normative s’est largement développée au cours de ces dernières
années ce n’est pas un hasard. Elle participe d’un mouvement beaucoup plus large de
modification en profondeur du droit et de l’État lui-même (§1). Si le recours aux
expérimentations est avant tout un moyen pour l’État de procéder à des transferts de
compétences en douceur (§3), il a également permis de mettre en avant le rôle des
collectivités locales dans la fabrication de la norme (§2).
§1. L’inscription de l’expérimentation dans le mouvement juridique post-
moderne
Le droit à l’expérimentation a été constitutionnalisé par la révision du 28 mars 2003.
L’État avait, cependant, recours à cette technique bien avant cette date. En effet,
l’expérimentation s’inscrit dans un mouvement beaucoup plus large d’apparition d’une
nouvelle méthode de régulation juridique, qualifiée de droit post-moderne50. Cette évolution
de la production normative s’inscrit elle-même dans la crise de l’État moderne. Cette crise de
l’État a notamment des conséquences sur le droit et la production du droit. C’est ainsi que « la
49 Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, op. cit. 50 Cette idée a été développée notamment par Jacques Chevalier, dans un ouvrage paru en 2003 : L’État post-moderne, LGDJ, coll. « Droit et société », n°35.
22
rationalité du droit ne se présume plus : la norme est désormais passée au crible de
l’efficacité, qui devient la condition et la cause de sa légitimité ».51
Le recours à l’expérimentation en matière normative n’a d’autre but que de tester
l’efficacité d’une nouvelle règle avant sa généralisation. La norme expérimentée, puisqu’elle
est évaluée à la fin de l’expérimentation, peut être testée et les pouvoirs publics peuvent
déterminer l’efficacité de cette règle. « L’expérimentation participe de cette manière à la
dynamique d’un droit post-moderne. L’on passe du bien fondé de la loi a priori, à l’efficacité
évaluée a posteriori, qui se veut factuellement indiscutable ».52
Les auteurs ont mis en avant quatre éléments caractérisant le droit post-moderne. Cette
nouvelle façon de produire les normes se traduit par une explosion de la technique juridique,
un éclatement de la régulation, une démarche plus pragmatique et un souci accru d’efficacité.
L’expérimentation normative remplit ces caractéristiques. On peut même avancer qu’elle
sublime, en quelque sorte, l’idée d’un droit qui se veut plus pragmatique et qui est en
constante recherche d’efficacité.
Le droit post-moderne est ainsi marqué en premier lieu par la multiplication des
sources du droit. Avec l’expérimentation normative, l’échelon local va apparaître comme
l’une de ces nouvelles sources. À travers le droit à l’expérimentation, les collectivités locales
vont pouvoir devenir de véritables sources du droit national. La règle qui aura été
expérimentée au niveau local a pour objectif d’être généralisée. L’expérimentation apparaît
comme un moyen de prendre en compte les solutions adoptées localement pour développer la
législation nationale. Dès lors l’État, au sens du bloc Gouvernement et Parlement, n’est plus
le seul à pouvoir imposer des normes par le haut. La loi a perdu sa légitimité ab initio, c’est-à-
dire qu’elle ne peut plus se donner comme obligatoire du simple fait qu’elle est l’œuvre du
Parlement. Elle doit trouver sa force obligatoire ailleurs que dans le seul énoncé d’une règle.
La loi est profondément remise en cause. C’est pour répondre à cette crise de légitimité de la
norme imposée par le centre que se développent de nouveaux foyers de régulation juridique.
L’expérimentation s’inscrit pleinement dans ce mouvement. Elle apparaît comme un
moyen pour les collectivités territoriales, échelon proche du citoyen, d’essayer la norme, d’en
mettre à l’épreuve son efficacité et de mieux la faire accepter ensuite. C’est ainsi qu’au règne 51 CHEVALLIER Jacques, « Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique », RDP, 01/06/1998, n°3, p.669. 52 CHARENTENAY Simon (de), « Les implications juridiques de la constitutionnalisation du droit de l’expérimentation », VII Congrès français de droit constitutionnel, Paris, 25-27 septembre 2008.
23
de la loi expression de la Raison succède le « pragmatisme glacial des experts qui
expérimentent la procréation normative dans les éprouvettes territoriales ». 53
L’avènement d’un droit post-moderne est également marqué par une évolution de la
perception du droit et de la loi54. C’est la fin de « la splendeur révolutionnaire qui
ambitionnait de légiférer pour l’éternité ».55 La loi n’est plus l’expression sans faille de la
Raison. Dès lors, le droit ne peut plus jouer la fonction unificatrice qu’on lui connaissait et
que notre héritage révolutionnaire lui prêtait. L’expérimentation joue ici parfaitement ce rôle
de remise en cause de la conception unificatrice du droit. Durant la période
d’expérimentation, le droit applicable ne va pas être le même sur tout le territoire de la
République. Certaines collectivités locales vont appliquer la législation nationale de principe,
alors que d’autres vont pouvoir déroger à ces règles. C’est la loi elle-même qui permet de
porter atteinte à l’unité de son application. Le droit n’est plus le même sur tout le territoire.
On assiste à une territorialisation de la norme, « à travers le développement de poches
d’autonomie normative au sein de l’appareil d’État, comme celles qui résultent de l’extension
du pouvoir réglementaire local ».56 Cette évolution conduit nécessairement à la remise en
cause de l’État centralisateur. L’État, même en restant un État unitaire, est obligé de
développer et d’approfondir son administration déconcentrée et décentralisée, afin de mieux
répondre aux attentes des citoyens au niveau local. « Dans les Etats unitaires, le nouveau
rapport entre le centre et la périphérie se traduit par l’extension de la marge d’action et le
renforcement de l’autonomie des différentes structures implantées sur le territoire ». 57 Le
droit à l’expérimentation permet de renforcer cette autonomie des collectivités territoriales.
Durant la période d’expérimentation, les collectivités locales sont libres d’adopter des règles
qui leur seront spécifiques. Il y a une véritable explosion de la régulation juridique. Les
collectivités territoriales ont vu, grâce à la révision constitutionnelle de 2003, croître leur
pouvoir décisionnel. « Les autorités locales sont devenues des producteurs de droit : même
s’ils restent inclus dans l’espace juridique national, les différents niveaux territoriaux tendent
53 CHARENTENAY Simon (de), op. cit. 54 « La thèse de l’infaillibilité de la loi et du législateur fait place maintenant à une vision plus réaliste du droit, et singulièrement de la norme législative, qui doit sans cesse appréhender des contraintes du réel multiformes et mouvantes. » PIRON, Michel, Rapport n°955, sur le projet de loi relatif à l’expérimentation par les collectivités territoriales, 18 juin 2003, p.5. Il est d’ailleurs saisissant que ce soit un parlementaire qui soit à l’origine de ces lignes et donc reconnaisse de lui-même la remise en cause du travail parlementaire. 55 Idem 56 CHEVALLIER Jacques, op. cit., p.674. 57 CHEVALLIER Jacques, « L’État post-moderne : retour sur une hypothèse », Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n°39, 2004, p.112.
24
à constituer des espaces juridiques autonomes ». 58 Cette remise en cause de l’unité de la
norme est toutefois, dans le cadre de l’expérimentation, limitée dans le temps puisque l’issue
normale de celle-ci est le retour à une même règle de droit applicable sur tout le territoire.
Cette multiplication des sources du droit et l’éclatement de la régulation juridique ne
signifient pas pour autant un effacement total de l’État. Il est toujours nécessaire d’avoir une
certaine centralisation du système, mais l’action des pouvoirs publics centraux est marquée
par l’adoption d’une démarche beaucoup plus pragmatique (A). Cette nouvelle approche de la
norme juridique poursuit un objectif précis, la recherche de l’efficacité (B).
A. Une démarche pragmatique
Le droit post-moderne se caractérise par l’adoption d’une démarche beaucoup plus
pragmatique dans le processus de fabrication de la norme. La loi ayant perdu sa légitimité ab
initio, l’État a été obligé de repenser son mode d’élaboration afin de tenir compte de
l’apparition de cette multiplicité d’acteurs dans la régulation juridique. Dès lors, « la force de
la règle de droit ne provient plus de ce qu’elle s’énonce comme un ordre obligatoire, auquel
tous sont tenus de se soumettre ; elle dépend désormais du consensus dont elle est entourée.
Ce consensus suppose que les destinataires soient partie prenante à son élaboration : la
concertation préalable, la participation à la définition de la règle devient la caution de son
bien fondé ; le droit devient ainsi un droit négocié, qui est le fruit d’une délibération
collective ».59 Dans cette logique, la règle de droit n’apparaît plus comme le fruit de la volonté
d’un seul, l’État. La règle de droit est issue d’une discussion entre les différents acteurs
juridiques et c’est cette discussion qui va fonder la légitimité de la norme.
L’expérimentation permet d’obtenir ce consensus, cette concertation préalable à
l’adoption de la règle. Il ressort très nettement de l’expérimentation relative au revenu de
solidarité active (RSA) que les acteurs locaux, en l’occurrence le Conseil Général, ont
réellement été associés au processus décisionnel60. Il y a eu non seulement une véritable
concertation entre l’État et le département relative aux normes mises en œuvre à titre
expérimental, mais le département a par la suite été véritablement associé à la rédaction de la
loi de généralisation. Il faut même relever qu’il ressort de l’exemple héraultais que ce ne sont
58 Ibid, p.113. 59 Ibid, p.114. 60 Cf. Infra p.50.
25
pas les acteurs politiques qui ont été consultés lors de la rédaction de la loi de généralisation
du RSA et de ses décrets d’application. Ce sont en effet les administrateurs, les fonctionnaires
qui mettent en œuvre quotidiennement le dispositif qui ont été consultés. La participation de
ce personnel, non politique mais administratif, est un gage d’une meilleure efficacité de la loi.
Les acteurs locaux ont bien compris que le recours à l’expérimentation « permet au
département de peser concrètement sur la rédaction finale des textes de lois et de décret ».61
Ainsi pour les responsables locaux, « la grande différence entre un projet de loi non
expérimenté et un projet de loi expérimenté, si on doit le résumer, c’est que du coup les
personnes qui appliqueront la loi, les techniciens, les travailleurs, les administratifs, qui sont
vraiment dedans, ont plus leur mot à dire ».62 L’expérimentation normative illustre
parfaitement l’idée selon laquelle « la production de la norme juridique s’abrite alors
derrière le savoir, qui est censé garantir sa légitimité et son bien fondé ; et la « compétence »
acquise sur le plan professionnel devient le véritable fondement de l’autorité normative ».63
Le recours à l’expérimentation permet de légitimer la norme puisque la règle qui en est issue a
été discutée, débattue, négociée. Dès lors, les citoyens ont plus de facilité à accepter une
norme qui n’est pas issue de la seule décision du pouvoir central.
Les modes de production normative, dans le cadre d’un État post-moderne, sont
porteurs de ce pragmatisme. Cependant, il faut réguler cette production afin que les acteurs
juridiques et politiques ne soient pas conduits à faire n’importe quoi. Ainsi, « il faut accepter
qu’une place accrue soit donnée à l’expérimentation, au pragmatisme, mais pour autant ça
ne doit pas être un pragmatisme sans rivage, c’est un pragmatisme qu’il faut savoir encadrer
et maîtriser »64. C’est ce que permet la contractualisation des relations entre État et
collectivités locales durant l’expérimentation. L’État conserve un certain contrôle sur l’action
des autorités locales, mais ce contrôle n’est plus imposé de force par le haut. Les relations
entre les autorités centrales et les collectivités décentralisées font l’objet d’un contrat. Ce
recours à la technique contractuelle est une des marques là aussi du système juridique post-
moderne. « L’existence au sein de l’État de foyers autonomes de production du droit explique
le recours à des procédés nouveaux de mise en cohérence : c’est ainsi que le contrat est
devenu un moyen privilégié de régulation des rapports entre États et collectivités locales ; il 61 Annexe : entretien Mme Vaugelade p.135. 62 Idem. 63 CHEVALLIER Jacques, « Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique », op. cit., p.676. 64 GAUDIN Jean-Pierre, « Epistémologie de l’expérimentation », in Les collectivités locales et l’expérimentation : perspectives nationales et européennes, op. cit., p.118.
26
permet de contrebalancer les effets du pluralisme juridique par un dispositif souple
d’harmonisation ».65
Dans le cadre de l’expérimentation normative, si les textes ne font pas mention de
cette contractualisation des relations, la pratique démontre tout autre chose. Les départements,
dans le cadre de l’expérimentation relative au RSA, ont passé des contrats avec l’État. Ces
contrats portent sur « les modalités d’organisation concrètes de l’expérimentation ainsi que
[sur] les moyens spécifiques engagés pour la conduire ».66 Ces contrats sont de véritables
« cahiers des charges »67 engageant les deux parties. Ils décrivent, d’une part, les modalités
techniques de conduite de l’expérimentation par les départements et, d’autre part, les
engagements financiers de l’État pour soutenir l’expérimentation. « La convention sert en
définitive à se mettre d’accord sur le contenu et les contours précis de l’expérimentation ».68
Ce contrat est un élément central de l’expérimentation – il est d’ailleurs étonnant que tant la
Constitution que la loi organique du 1er août 200369 n’en fassent pas mention. Le contrat est
un élément de l’organisation de l’expérimentation et permet d’arrêter les relations entre l’État
et les collectivités locales. L’expérimentation s’inscrit ainsi pleinement dans la logique post-
moderne.
L’expérimentation permet non seulement une conception plus pragmatique de la
norme. Elle permet aussi de rechercher son efficacité maximale.
B. Une constante recherche de l’efficacité
La technique juridique post-moderne se caractérise par une volonté d’adopter une
norme qui soit la plus efficace possible. L’efficacité suppose une adéquation entre les effets
concrets de la règle de droit et les résultats qui en étaient escomptés pour répondre aux
attentes sociales. La norme n’est plus légitime par le simple fait qu’elle est l’expression de la
volonté du souverain. Pour que les citoyens s’y conforment, la règle de droit doit édicter la
réponse la plus efficace possible aux attentes de la société. Pour savoir si une norme est
efficace, ou non, il faut procéder à son évaluation. C’est là que l’expérimentation s’inscrit à 65 CHEVALLIER Jacques, « Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique », op. cit., p.674 66 Conseil d'État, Rapport public 2008, « Le contrat, mode d’action publique et de production de normes », EDCE, 2008, p.40. 67 DRAGO Roland, « Le droit de l’expérimentation », in L’avenir du droit, Mélanges François Terré, Dalloz 1999, p.247. 68 Conseil d’État, Rapport public 2008, op. cit., p.40. 69 Loi organique n°2003-704 du 1er août 2003, op. cit.
27
nouveau pleinement dans ce mouvement juridique post-moderne. En effet, toute
expérimentation suppose une évaluation, afin d’en tirer un bilan et de déterminer si la norme
peut ou non être généralisée.
Cette recherche de l’efficacité passe par une rationalisation de la production
normative. Il faut constater que le nombre de lois s’est considérablement accru, ce qui nuit à
l’efficacité de l’action administrative. L’expérimentation puisqu’elle permet de tester une
règle de droit avant de procéder à sa généralisation est un moyen de limiter la multiplication
des lois. L’expérimentation permet de n’adopter au final que les lois qui non seulement sont
nécessaires mais dont l’efficacité a été avérée. « L’expérimentation peut être un moyen de
rationaliser le processus de création législative et d’adopter des lois mieux adaptées à leur
objet ».70 L’expérimentation est un moyen d’atteindre une production normative beaucoup
plus rationalisée et d’éviter la multiplication des « lois jetables et [des] règlements
inflationnistes ».71 L’expérimentation participe d’un mouvement plus large qui tend à
réhabiliter le travail parlementaire, en conduisant le Parlement à n’adopter que les lois qui
sont nécessaires et efficaces.
Cette idée d’efficacité de la loi suppose qu’à un moment donné celle-ci soit évaluée.
Une telle évaluation de la loi était tout à fait inenvisageable auparavant. La France reste très
attachée à son héritage révolutionnaire et à l’idée d’une certaine infaillibilité de la loi.
L’expérimentation suppose, justement, qu’au moment de l’évaluation puissent être remises en
cause les normes décidées par le pouvoir central. L’expérimentation permet ainsi de
rechercher quelle sera la norme la plus efficace, la plus à même de répondre aux attentes et
aux besoins des citoyens. « La démarche évaluative s’inscrit dans le cycle de l’action : elle
assure le bouclage des processus décisionnels, au sein desquels les phases
d’élaboration/décisions/exécution/évaluation rétroagissent constamment les unes sur les
autres. Or l’évaluation d’une politique implique nécessairement une réflexion sur l’effectivité
de la législation qui l’a concrétisée, et donc une évaluation de celle-ci ; et, dès l’instant où
cette évaluation déborde les considérations traditionnelles relatives à la légitimité de la
législation au regard de certaines valeurs, ou à la validité de son édiction au regard des
normes en vigueur, pour s’intéresser à l’efficacité de l’action engagée, elle implique un
processus d’ajustement qui conduit tout droit à l’idée d’expérimentation, qui permet 70 PERROCHEAU Vanessa, « L’expérimentation, un nouveau mode de création législative », Revue française des affaires sociales, n°1, 2000, p.12. 71 MÉHAIGNERIE Pierre, « Décentralisation, expérimentation et évaluation », Pouvoirs locaux, n°57, 2003, p.114.
28
d’intégrer pleinement l’évaluation au cycle de production du droit. L’apparition dans les
pays, et en France aussi, de lois expérimentales traduit la remise en cause de la conception
traditionnelle de la loi ». 72 Notre perception de la règle de droit, et plus particulièrement de la
loi, a évolué. L’expérimentation s’inscrit dans ce changement. L’évaluation, qui a lieu à la fin
de la procédure d’expérimentation, permet de déterminer si les mesures envisagées sont ou
non à même de répondre aux attentes de la société. L’évaluation remet en cause l’idée de
l’infaillibilité de la loi pour obliger celle-ci à se confronter aux réalités socio-économiques.
L’évaluation inscrit pleinement l’expérimentation dans la logique juridique post-moderne.
« Ainsi deux conceptions bien différentes de la loi s’affrontent : d’un côté, la loi – conception
rousseauiste – comme incarnation de la Vérité et de la Raison, qui ne peut souffrir, à l’issue
d’un essai préalable, une remise en cause et, de l’autre côté, une loi qui, au risque de perdre
son aura traditionnelle, doit se plier, avant sa généralisation et son adoption définitive, aux
exigences de la réalité sociale et économique en passant l’examen des contraintes de
faits ». 73
L’expérimentation apparaît comme une modification en profondeur du processus
normatif, modification qui s’inscrit toutefois dans un mouvement beaucoup plus large
d’apparition d’un droit post-moderne. L’expérimentation remplie toutes les caractéristiques
du droit post-moderne. Du fait de l’expérimentation, l’État n’apparaît plus comme l’unique
source de droit, celui-ci étant d’application diverse durant l’expérimentation, il perd de sa
fonction unificatrice. La prise en compte de l’avis des acteurs locaux et la contractualisation
des relations font la part belle à un pragmatisme très important dans la méthode
expérimentale. Enfin, l’évaluation de l’expérimentation conduit à la recherche de la plus
grande efficacité possible. L’expérimentation illustre la mise en œuvre de ces nouvelles
modalités de production normative. L’inscription de l’expérimentation dans la Constitution,
lors de la révision du 28 mars 2003, va même plus loin et est « le signe de l’avènement d’une
post-modernité constitutionnelle ».74 Cette inscription, dans la norme fondamentale, est le
signe que la post-modernité juridique est un véritable mouvement de fond qui modifie les
modes de production et la perception de la norme.
72 CHEVALLIER Jacques, « Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique », op. cit., p.681. 73 RRAPI Patricia, « Bilan des expérimentations prévues par la loi du 13 août 2003 : la difficile introduction du concept d’expérimentation en France », VII Congrès français de droit constitutionnel, Paris, 25-27 septembre 2008. 74 CHARENTENAY Simon (de), op. cit.
29
L’une des caractéristiques du droit post-moderne étant de faire apparaître de nouveaux
centres de décisions, de nouveaux acteurs dans la production normative, l’expérimentation ne
fait pas exception à la règle. Dans le cadre de l’expérimentation, les collectivités territoriales
font leur apparition dans le processus de fabrication de la règle juridique.
§2. Un nouvel acteur de la production normative : les collectivités territoriales
Le droit post-moderne est caractérisé par la multiplication des sources du droit. À côté
de l’État, on voit se multiplier des sources internationales : droit communautaire, droit
européen de la Convention européenne des droits de l’homme, mais on assiste aussi à
l’apparition de sources infra étatiques. Les collectivités locales ont vu leur autonomie
s’accroître, l’affirmation du pouvoir réglementaire des autorités locales à l’article 72, alinéa 3,
de la Constitution en est un signe incontestable.
L’expérimentation normative, et en particulier l’expérimentation dérogation prévue à
l’article 72, alinéa 4, de la Constitution, est un moyen de faire participer les collectivités
territoriales à la production de la règle de droit, même si cette participation est indirecte
puisqu’elle sera médiatisée par un texte – loi ou règlement – adopté au final par les autorités
centrales. L’expérimentation est un moyen de reconnaître que les collectivités locales peuvent
participer à la mise au point de solutions pour répondre aux attentes de l’intérêt général (A).
Cependant, pour trouver ces solutions qui pourront s’appliquer dans un cadre national,
l’expérimentation suppose une évolution du mode de raisonnement des décideurs locaux (B).
A. Des solutions locales pour améliorer la norme générale
Le but de l’expérimentation, et surtout de l’expérimentation normative, est de
permettre aux collectivités territoriales de développer leurs propres solutions pour répondre
aux besoins de l’intérêt général. Ces solutions pourront ensuite être reprises au niveau
national si l’expérimentation est généralisée. Les collectivités locales vont participer,
indirectement, à la production normative. Il s’agit grâce à l’expérimentation de reconnaître
que « l’État à travers l’administration centrale, n’incarne plus à lui seul l’intérêt général ; les
collectivités locales, à leur échelon, peuvent être également des lieux d’initiative, de réforme
et de débat public pouvant servir de référence pour l’élaboration de la norme nationale ».75
75 PIRON Michel, Rapport n°955, op. cit., p.6.
30
L’expérimentation est un moyen de reconnaître que les collectivités territoriales sont
aujourd’hui un échelon d’administration dynamique et qui peut apporter des réponses aux
attentes sociales. Si l’État central n’est pas la solution adaptée pour répondre aux besoins des
citoyens, l’expérimentation se présente alors comme un approfondissement de la
décentralisation qui reconnaît de plus en plus ce rôle crucial des collectivités territoriales.
L’expérimentation est un mécanisme qui permet aux collectivités territoriales « de participer
à la réalisation de l’intérêt général ». 76
Il y a véritablement une inversion de la production normative. Dans la vision
classique, c’est l’État qui détermine les moyens de répondre à l’intérêt général et les impose
par un acte d’autorité, loi ou règlement. On est dans une relation verticale où la norme est
imposée par le haut. Au contraire, dans le cadre de l’expérimentation, les réponses à apporter
à l’intérêt général ne sont plus imposées d’autorité par les organes centraux. Les solutions
adoptées localement, durant l’expérimentation, vont permettre de déterminer quelles seront
les meilleures solutions applicables au niveau général. C’est de façon indirecte, mais certaine,
que l’expérience des collectivités expérimentatrices va les conduire à devenir de véritables
acteurs de la production normative.
Dans l’exemple de l’expérimentation relative au RSA, il est tout à fait notable que les
collectivités territoriales ont réellement été associées à l’écriture de la loi de généralisation et
de ses décrets d’application. Les collectivités expérimentatrices vont réellement pouvoir faire
état de leur expérience pour apporter des améliorations au texte qui sera débattu par le
Parlement. L’expérimentation permet ensuite au Législateur de se prononcer sur un texte qui,
tenant compte des résultats de l’expérimentation, sera véritablement à même de répondre aux
besoins sociaux. Ainsi « il y a toute une préparation de la loi complètement différente, il n’y a
pas que le débat parlementaire avec des amendements ». 77 En matière de RSA, la prise en
compte de l’expérimentation dans les différents départements est même entière, puisque la loi
de généralisation contient une disposition qui est directement inspirée de la manière dont le
département de l’Hérault a expérimenté ce dispositif78.
76 BAGHESTANI-PERREY Laurence, « Le pouvoir d’expérimentation locale », Les petites affiches, n°55, 2004, p.7. 77 Annexe, Entretien Mme Vaugelade p.134. 78 « D’ailleurs on a une petite ligne dans la loi du RSA, qui vient un peu de ce que le département de l’Hérault a pu négocier. C’est la possibilité d’une aide supplémentaire qui peut être accordée par le département aux entreprises qui s’engageraient à pérenniser des conditions négociés. Mine de rien c’est une petite victoire. » Annexe, Entretien Mme Vaugelade, p.132. Il s’agit de l’article 16 de la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, Journal officiel du 3 décembre 2008, p.18424.
31
Il y a véritablement une participation, une implication des collectivités territoriales
dans la production normative par l’intermédiaire de l’expérimentation. L’État n’est plus le
seul légitime pour imposer les normes. Il doit s’assurer du concours des acteurs locaux pour
permettre à la norme d’être mieux adaptée, mais aussi mieux acceptée par les citoyens. À
travers l’expérimentation, les collectivités territoriales sont véritablement reconnues « comme
lieux d’invention, d’initiative, de débat public voir d’élaboration de la norme ».79
L’expérimentation permet aux collectivités locales de devenir véritablement un acteur de la
production normative à part entière. Toutefois, elle suppose que les décideurs locaux
modifient leur manière de penser, afin d’intégrer des contraintes nationales à leurs décisions
locales.
B. Un nécessaire effort d’abstraction
L’expérimentation est l’occasion pour les collectivités territoriales de « raisonner au-
delà de l’échelon local »80 afin de déterminer des solutions qui pourraient être par la suite
généralisées. L’objectif premier de l’expérimentation est de généraliser les mesures qui auront
été testées sur certains territoires. Cela implique que les collectivités locales, et les décideurs
locaux, aient conscience que les règles, qu’ils ont adopté à titre expérimental, doivent être à
même de pouvoir être appliquées sur l’ensemble du territoire de la République.
Il semble que l’on soit là en présence d’une première limite au recours à
l’expérimentation, ou du moins d’une source de difficultés pour les collectivités locales. Tout
au long de l’expérimentation, celles-ci devront avoir le « souci de trouver des solutions
adaptées aux contexte local tout en les concevant comme ayant vocation à la
généralisation ».81 Il s’agit là pour les décideurs locaux d’une profonde modification de leurs
comportements. Ceux-ci sont habitués à raisonner de façon très locale et, de par la clause
générale de compétence, ils n’ont l’habitude de régler que des questions relatives aux affaires
de leur niveau de collectivité. L’expérimentation les oblige au contraire à faire un effort
d’abstraction pour déterminer des solutions localement qui pourront ensuite être appliquées au
niveau national. Cela « demande une démarche intellectuelle nouvelle qui doit être intégrée
dans la réflexion des décideurs locaux ».82
79 CHARENTENAY Simon (de), op. cit. 80 BAGHESTANI-PERREY Laurence, op. cit., p.7. 81 LAPOUZE Patrick, « L’expérimentation par les collectivités territoriales », JCP-A, n°10, 2006, p.309. 82 Idem.
32
Cette évolution des modes de décision n’est pas évidente. Les résistances à cette
modification ne sont pas que le fait des décideurs locaux mais aussi des autorités de l’État.
Les autorités centrales doivent également admettre que les collectivités territoriales sont à
même de produire cet effort d’abstraction et peuvent prendre des décisions qui pourront par la
suite être généralisées. Bien souvent, les décideurs nationaux « sont convaincus de servir
mieux l’intérêt général que les élus toujours tentés, pensent-ils, par le clientélisme ».83 S’il est
indéniable que la décentralisation a parfois pu aboutir à certaines dérives chez les élus locaux,
les garanties qui entourent l’expérimentation normative permettent de se prémunir de telles
dérives. L’expérimentation nécessite avant tout une modification des modes de pensée des
décideurs locaux, mais aussi des instances nationales. Si cette évolution ne se produisait pas,
l’expérimentation resterait lettre morte, le constituant n’aurait alors fait qu’admettre un droit à
l’adaptation, certes temporaire, des règles nationales pour l’ensemble des collectivités
territoriales de la République.
Si l’expérimentation apparaît comme une nouveauté dans la manière de faire le droit et
qu’elle permet d’associer les collectivités territoriales à cette production, il ne faut pas perdre
de vue que la France reste un État unitaire. L’objectif de l’expérimentation n’est pas de
conduire à une totale autonomisation des collectivités locales. Si l’État accepte de procéder à
des expérimentations, c’est qu’il y trouve un intérêt.
§3. Un moyen pour l’État de faire accepter les transferts de compétences
Si l’expérimentation « permet d’aborder le droit en tant que science »84, elle est aussi
un moyen de contourner un certain nombre d’obstacles qui s’élèvent face à la réforme de
l’État. L’expérimentation ne sert pas uniquement à parer le droit d’une certaine scientificité,
elle est une méthode pour procéder à des transferts de compétences dans le cadre de la
décentralisation. Cette motivation intrinsèque de l’expérimentation (A) conduit à un
dévoiement de la procédure puisque l’État ne semble pas l’assumer totalement dans sa mise
en œuvre (B).
83 SAVY Robert, « Réflexions sur la gouvernance territoriale », in Les mutations contemporaines du droit public, Mélanges en l’honneur de Benoît Jeanneau, Paris, Dalloz, 2002, p.611. 84 MAMONTOFF Catherine, « Réflexions sur l’expérimentation du droit », RDP, n°2, 1998, p.356.
33
A. La motivation intrinsèque de l’expérimentation
La simple observation des expérimentations mises en œuvre depuis la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003 atteste que l’État cherche avant tout à procéder à un
transfert de compétences. L’idée des transferts de compétences est corollaire à celle de
décentralisation. Dès les premières lois de décentralisation, les collectivités territoriales se
sont vu confier des compétences qui étaient auparavant exercées par l’État. Ce qu’il convient
d’appeler l’Acte II de la décentralisation, s’il a constitutionnalisé de nouvelles modalités
d’action pour les collectivités locales, a aussi eu parmi ses objectifs de permettre de nouveaux
transferts de compétences au profit des collectivités décentralisées.
L’expérimentation, et notamment l’expérimentation transfert prévue à l’article 37-1 de
la Constitution, n’est rien d’autre qu’un moyen de réaliser ces transferts de compétences.
Lorsque le projet de loi constitutionnelle a été présenté aux parlementaires, cette motivation
n’apparaissait pas. L’expérimentation était alors présentée comme un moyen de « vaincre les
réticences et de mieux faire accepter le changement ».85 Cependant, les expérimentations
mises en œuvre depuis 2003, et notamment par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, conduisent à penser que l’État cherche avant tout par
l’expérimentation à se dégager de certaines de ses compétences en les transférant aux
collectivités territoriales. Ainsi, « l’apparence de l’expérimentation est celle du
désengagement de l’État ». 86 L’expérimentation se présente comme un moyen pour l’État de
dépasser des blocages qui pourraient exister au niveau local pour réaliser des transferts de
compétences. Au lieu de transférer la compétence de façon autoritaire à l’ensemble des
collectivités d’un même niveau, en procédant à une expérimentation, l’État prépare
progressivement les acteurs locaux à recevoir cette compétence. L’État se sert de
l’expérimentation comme d’un moyen de dépasser les oppositions et de réaliser au final les
transferts de compétences. L’expérimentation est une première étape vers le transfert définitif
des compétences.
Politiquement, l’expérimentation est très intéressante. Elle est le moyen de faire
accepter une réforme qui aurait été combattue par l’opposition si jamais le débat
parlementaire avait eu directement lieu. Vont participer à l’expérimentation, tant des
collectivités de la même couleur politique que le gouvernement que des collectivités dirigées
85 CLÉMENT Pascal, Rapport n°376, relatif à l’organisation décentralisée de la République, p.71. 86 CHARENTENAY Simon (de), op. cit.
34
par des partis qui sont dans l’opposition au niveau national. Les acteurs locaux sont tout à fait
conscients de ce risque d’utilisation politique de l’expérimentation. « L’autre façade
intéressante politiquement, c’est quand on veut faire une loi et essayer de ne pas avoir trop de
querelles au niveau du Parlement, on le fait expérimenter par des collectivités territoriales
qui n’ont pas la même étiquette politique que le gouvernement et c’est une façon de dire « on
est ensemble maintenant, on est un groupe, on est unis, on est amis ». C’est de bonne guerre
c’est la politique ». 87 Cet aspect relève ici plus de la science politique que de la science
juridique à proprement parler, mais l’une n’étant pas toujours dissociable de l’autre, il faut
bien noter que le comportement des acteurs politiques peut conduire à dévoyer la procédure
de l’expérimentation. « Il semble même qu’en matière de transfert de compétences
l’expérimentation ne peut avoir, compte tenu de son objectif, une autre fonction – la fonction
véritable de la loi expérimentale, par exemple – que celle de permettre un transfert progressif
de compétences ». 88
Le problème de ce dévoiement de la procédure expérimentale, c’est que l’État limite
par là même l’intérêt du recours à l’expérimentation. Cette motivation intrinsèque de l’État est
encore plus dangereuse, pour la procédure expérimentale, qu’elle est mise en œuvre de
manière camouflée.
B. Une mise en œuvre camouflée
Lors de la révision constitutionnelle de 2003, deux dispositions relatives à
l’expérimentation ont été introduites dans la Constitution. D’une part, l’article 37-1 permet
désormais ce que la doctrine qualifie d’expérimentation transfert et, d’autre part, l’article 72,
alinéa 4, autorise les expérimentations dérogations. Si l’objet de ces deux dispositions est
similaire, à savoir tester sur une petite échelle une nouvelle norme avant sa généralisation,
leurs modalités de mise en œuvre en font deux outils totalement différents. La première
dispositions est une « expérimentation par l’État, laquelle peut évidemment concerner entre
autres domaines, celui des collectivités territoriales »89, tandis que la seconde est une
« expérimentation par les collectivités territoriales [mais qui] suppose l’accord de l’État ».90
87 Annexe : Entretien Mme Vaugelade, p.138. 88 RRAPI Patricia, op. cit. 89 ROUX André, « Aspects constitutionnels des droits à l’expérimentation », in Les collectivités locales et l’expérimentation : perspectives nationales et européennes, op. cit., p.156. 90 Idem
35
Les dispositions de l’article 72, alinéa 4, permettent réellement d’accorder un véritable
pouvoir normatif, certes encadré par la loi ou le règlement, aux collectivités territoriales.
Celles-ci pourront intervenir librement dans le domaine législatif ou réglementaire pour
adopter des mesures à titre expérimental. Le recours à l’expérimentation dérogation autorise
« un véritable dialogue entre l’État et les collectivités territoriales ».91 Dans le cadre de
l’article 37-1, au contraire, c’est l’État qui dirige totalement la procédure et qui décide quelles
seront les mesures qui seront expérimentées. Il n’est d’ailleurs pas inopportun de s’interroger
sur la pertinence de l’insertion de cet article lors de la révision de 2003. Cette révision
constitutionnelle était relative aux collectivités territoriales et à leur libre administration, or
les dispositions de l’article 37-1 « sont destinées à l’État pour les besoins de ses propres
réformes ».92
Tout se passe comme si l’État avait voulu jouer un double jeu lors de cette révision.
En constitutionnalisant le droit à l’expérimentation pour les collectivités territoriales, il
donnait l’impression d’approfondir toujours plus la décentralisation, alors qu’en réalité, il
constitutionnalisait en même temps un puissant levier de transfert de compétences. Les
regards tant des acteurs locaux que de la doctrine se sont essentiellement concentrés sur les
dispositions de l’article 72, alinéa 4. L’expérimentation dérogation a été qualifiée de
« possibilité remarquable ».93 Elle a été présentée comme une « grande nouveauté ».94
Il faut bien constater que six ans après la révision constitutionnelle, « la révolution
annoncée n’a pas eu lieu ».95 Les expérimentations sur le fondement de l’article 72, alinéa 4,
de la Constitution, n’ont pas été les plus nombreuses – il n’y en a même eu qu’une seule et
dont les conditions de mise en œuvre seront discutées ultérieurement. Par contre, l’État a
multiplié le recours aux expérimentations transferts. La loi du 13 août 2004, qui est la
traduction législative de l’Acte II de la décentralisation, ne prévoit aucune expérimentation
dérogation, alors qu’elle met en place des expérimentations transferts dans sept domaines de
91 VERPAUX Michel, Droit des collectivités territoriales, Paris, PUF, Collection Major, 1ère édition, 2005, p.109. 92 FAURE Bertrand, « L’intégration de l’expérimentation dans le droit public français », in Mouvement du droit public français, Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, op. cit., p.179. 93 BROSSET Estelle, « L’impossibilité pour les collectivités territoriales françaises d’exercer le pouvoir législatif à l’épreuve de la révision constitutionnelle sur l’organisation décentralisée de la République », Revue française de droit constitutionnel, n°60, 2004, p.707. 94 PONTIER Jean-Marie, « La loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales », AJDA, n°32, 2003, p.1716. 95 LONG Martine, op. cit., p.1625
36
compétences96. Il est tout de même assez déconcertant d’avoir du attendre près de cinq ans
pour voir être mise en œuvre la nouveauté constitutionnelle de 2003 ; alors que l’État a
largement utilisé les expérimentations transferts pour « se désengager financièrement de
postes économiquement lourds ».97
L’article 37-1 de la Constitution semble avant tout servir le désengagement de l’État.
Le fait que l’État ait eu recours plus souvent à cette disposition semble démontrer que
l’expérimentation représente un outil juridique pour procéder à la réforme de l’État.
L’expérimentation est dévoyée de son objectif initial et risque donc de tomber en disgrâce,
auprès des acteurs politiques. « Tout se passe comme si, au théâtre de la décentralisation et
sur la scène du droit constitutionnel, se jouait la représentation du sacre de l’expérimentation
locale. Seulement, c’est en coulisse que s’organise la réalité dissimulée de la réforme, à
savoir le recentrage de l’État sur ses missions essentielles ».98
Cette utilisation pour le moins très orientée de l’expérimentation renvoie d’ailleurs à la
question de la place occupée par l’État dans le cadre de l’expérimentation.
96 Ces expérimentations seront détaillées ultérieurement, mais elles concernent notamment le transfert de la conception des schémas régionaux de développement économique, la gestion de l’inventaire du patrimoine culturel. 97 CHARENTENAY Simon (de), op. cit. 98 Idem.
37
Section 2. Le rôle ambigu de l’État
La rédaction adoptée pour les articles 37-1 et 72, alinéa 4, de la Constitution, est
foncièrement différente. Cependant, il existe une constante dans ces deux dispositions. Dans
les deux cas, c’est « la loi ou le règlement » qui autorise l’expérimentation. C'est-à-dire que
dans les deux cas c’est l’État, au sens des autorités centrales, qui décide de mener une
expérimentation et qui l’organise.
L’article 37-1 prévoit que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». L’article 72, alinéa 4, dispose,
quant à lui, que « dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en
cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent,
lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger à titre expérimental et pour un
objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent
l’exercice de leurs compétences ». Si ces deux dispositions introduisent un droit à
l’expérimentation dans notre Constitution, force est de constater que leur rédaction diffère très
fortement. Elle laisse planer un doute sur les objectifs poursuivis par l’État à travers ces deux
articles. Le constituant a mis en place « deux droits bien distincts ».99 La rédaction de ces
deux dispositions entraîne un important déséquilibre entre les deux modes d’expérimentation.
Le problème de ce déséquilibre est qu’il masque une réalité, à savoir que c’est l’État qui reste
au cœur des deux procédures. Ainsi, le « droit à l’expérimentation, c’est un droit qui
appartient à l’État. Les collectivités territoriales n’ont pas […] un droit à l’expérimentation.
L’article 37-1 est clair : c’est le droit pour l’État d’expérimenter à travers des lois ou des
règlements, mais l’article 72 alinéa 4, c’est pareil. C’est le droit pour l’État d’autoriser les
collectivités territoriales à expérimenter, mais en aucun cas le droit pour les collectivités
territoriales à bénéficier de l’expérimentation ».100
Ce sont deux droits à l’expérimentation très différents qui cohabitent dans notre
Constitution. L’un permet à l’État de réaliser des transferts de compétences (§1), tandis que
l’autre malgré ce rôle central de l’État permet une certaine autonomie des collectivités locales
(§2). Les conditions de mise en œuvre de ces deux dispositions démontrent parfaitement ce
rôle ambigu de l’État. Comme certains commentateurs l’ont relevé « à l’inconditionnement de
99 CHARENTENAY Simon (de), op. cit. 100 ROUX André, « Table ronde : expérimentations pour quoi faire ? », in Les collectivités locales et l’expérimentation : perspectives nationales et européennes, op. cit., p.189.
38
la première procédure (37-1), on ne peut opposer que le strict encadrement de la seconde (72
alinéa 4), signe de leur inégales signification et portée ».101
§1. L’expérimentation transfert : un levier de transfert de compétences
L’expérimentation transfert, telle qu’elle est prévue par l’article 37-1 de la
Constitution n’est pas vraiment une nouveauté. Il s’agit de la constitutionnalisation d’une
pratique déjà utilisée. La rédaction de cet article laisse planer certains doutes. Il semble que
cette constitutionnalisation ne s’est pas faite à droit constant et que cette disposition
constitutionnelle laisse une très large marge de manœuvre aux autorités étatiques.
L’expérimentation, telle qu’elle est prévue dans le cadre de l’article 37-1 de la
Constitution, n’est pas une totale nouveauté. S’il serait trop long de revenir ici sur l’ensemble
des expérimentations qui se sont tenues avant la révision constitutionnelle de 2003, il faut
bien se rendre compte qu’il s’agit là d’une technique largement éprouvée, acceptée et
encadrée par la jurisprudence.
L’État avait déjà recours à un certain nombre de lois expérimentales. La loi de 1975
relative à l’interruption volontaire de grossesse102 est un exemple de loi expérimentale. Cette
loi, même si elle s’appliquait sur l’ensemble du territoire, n’a été votée au départ que pour
cinq ans ; il s’agit là d’une expérimentation limitée dans sa durée. Cependant, ces lois à
l’application limitée dans le temps ne sont pas les plus nombreuses. Elles peuvent parfois
même poser problème à être qualifiées de lois expérimentales, car elles ne contiennent pas
l’idée d’échantillonnage normalement présente en matière d’expérimentation.
Les exemples les plus fréquents sont en effet à chercher du côté des expérimentations
qui se déroulent dans un espace limité et prédéterminé. L’expérimentation vise alors à tester
une nouvelle norme sur une partie seulement de la population avant de procéder à sa
généralisation à l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, les expérimentations menées sous la
Cinquième République sont beaucoup plus nombreuses. Ainsi, « l’exemple le plus ancien date
vraisemblablement de 1962, avec une expérimentation portant sur une nouvelle organisation
101 FAURE Bertrand, « L’intégration de l’expérimentation dans le droit public français », in Mouvement du droit public français, Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, op. cit., p.178. 102 Loi n°75-17, du 17 janvier 1975, op. cit.
39
des services déconcentrés de l’État ».103 Les expérimentations se sont multipliées au cours des
années, devenant une méthode bien éprouvée.
La décentralisation a très vite trouvé dans l’expérimentation un moyen de progresser.
Le département d’Ille-et-Vilaine a mis en place en 1986 à titre expérimental un complément
de ressources qui allait préfigurer la loi de 1988 relative au revenu minimal d’insertion104.
Plus près de nous encore, la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité105 a eu recours
au principe de l’expérimentation. Cette loi a prévu des transfert de compétences à titre
expérimental pour les régions en matière de développement des ports maritimes, des
aérodromes et de patrimoine culturel. L’expérimentation est devenue au fil des années une
technique largement connue et utilisée. Elle a trouvé dans le cadre de la décentralisation un
écrin propice à son développement.
Ce développement ne s’est cependant pas produit de manière totalement anarchique.
En l’absence de règles législatives, et encore moins constitutionnelles, relatives à
l’expérimentation ce sont les juges qui ont encadré cette technique. Jurisprudence
constitutionnelle106 et jurisprudence administrative107 ont posé les premiers jalons d’un droit à
l’expérimentation. Ce sont ces solutions dégagées par la jurisprudence qui ont été en partie
constitutionnalisées par la réforme de 2003 au sein de l’article 37-1, mais d’une manière qui
est loin d’être satisfaisante.
La rédaction laconique adoptée pour l’article 37-1 laisse une large marge de
manœuvre à l’État dans l’organisation des expérimentations et ne fait apparaître que très peu
de limites. Cette disposition de la Constitution, contrairement à l’article 72, alinéa 4, ne fait
pas de renvoi à une loi organique pour la compléter. L’expérimentation n’est limitée que par
les dispositions de l’article 37-1. Or les seules précisions que comporte cet article sont que
l’expérimentation doit avoir « un objet et une durée limités ». Ce sont là de bien maigres
limites par rapport aux exigences antérieures de la jurisprudence constitutionnelle et
administrative.
103 PISSALOUX Jean-Luc, « Réflexions sur l’expérimentation normative », RA, 2003, p.14. À l’initiative du pouvoir réglementaire, cette expérimentation va d’abord concerner quatre départements, puis sera généralisée à l’ensemble du territoire par décret en 1964. 104 Loi n°88-1088, du 1er décembre 1988, instituant le revenu minimum d’insertion, JORF, 3 décembre 1988, p.15119. 105 Loi n°2002-276, du 27 février 2002, op. cit. 106 Conseil Constitutionnel, n°93-322DC du 28 juillet 1993, op,. cit. ; n°93-333DC du 21 janvier 1994, JORF, 26 janvier 1994, p.1377. 107 Conseil d'État, Sect., 1967, Peny, op. cit. ; Conseil d'État, 1968, Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris, Rec. p.123. ; Conseil d'État, Sect. Travaux publics, avis, 1993, n°353605, Rapport public 1993..
40
Le Conseil Constitutionnel avait mis à jour un certain nombre d’exigences pour les
lois prévoyant des expérimentations. La loi devait définir la nature et la portée des
expérimentations ; définir le cas où l’expérimentation pouvait avoir lieu ; prévoir les
procédures et conditions de l’évaluation ; enfin l’expérimentation devait nécessairement avoir
pour issue la généralisation, l’abandon ou une prolongation avec modification. Les exigences
du nouvel article constitutionnel sont finalement très limitées par rapport aux exigences
jurisprudentielles. Il faut d’ailleurs ici saluer l’intervention du Sénat, soutenu par le
Gouvernement, qui a permis d’insérer dans cet article la limite de l’objet et de la durée. Le
projet initial prévoyait simplement « la loi et le règlement peuvent comporter des dispositions
à caractère expérimental ». Le Conseil d'État, lorsqu’il s’était prononcé sur le projet de loi,
avait d’ailleurs rendu un avis négatif, notamment sur cette disposition qui selon la Haute
Assemblée « se bornait à réaffirmer la jurisprudence administrative et constitutionnelle ». 108
Il semble qu’il convient cependant de faire une appréciation plus critique des
dispositions de l’article 37-1. Si cette disposition reprend les affirmations de la jurisprudence
antérieure, elle ne le fait qu’a minima. La Constitution ne fait, notamment, aucune référence à
l’obligation de prévoir une évaluation de l’expérimentation. Or sans évaluation,
l’expérimentation n’en est plus une. Elle ne correspond alors qu’à une mise en œuvre
progressive d’une disposition. Il faut cependant soulever ici une différence qui existait entre la
jurisprudence administrative et la jurisprudence constitutionnelle. Dans les affaires que le
Conseil d'État avait eu à juger, notamment l’arrêt Peny de 1967 ou l’arrêt Ordre des avocats à
la Cour d’appel de Paris, les dispositions en cause n’étaient pas réellement des
expérimentations, mais l’entrée en vigueur progressive, en fonction des destinataires de la
mesure dans le premier cas et en fonction des ressorts juridictionnels dans le second, d’une
nouvelle mesure. Le juge administratif ne fait jamais dans ces arrêts référence à la nécessité
d’une évaluation. D’une part, la constitutionnalisation s’est donc faite a minima, mais surtout,
d’autre part, si les juges, constitutionnel et administratif, maintiennent leurs jurisprudences
relatives à l’expérimentation, il va subsister une différence d’exigences et de régimes
juridiques entre l’expérimentation prévue par la loi et l’expérimentation prévue par le pouvoir
réglementaire. En l’absence de contentieux sur cette question, le débat reste ouvert. Un
premier constat doit être fait, les dispositions constitutionnalisées à l’article 37-1, de par la
souplesse de leurs exigences, laissent une relative liberté à l’État dans la manière de conduire
les expérimentations. Il est nécessaire de s’en remettre sur ces questions à la vigilance des
108 PISSALOUX Jean-Luc, op. cit., p.17.
41
juges, notamment constitutionnel109, pour éviter des abus dans l’utilisation de la méthode
expérimentale.
Une autre différence fondamentale de rédaction entre l’article 37-1 et l’article 72,
alinéa 4, de la Constitution est que le premier ne fait aucune référence à une quelconque
limite matérielle. Les dispositions de l’article 72, alinéa 4, prévoient qu’une expérimentation
dérogation ne peut être conduite si celle-ci remet « en cause les conditions essentielles
d’exercice d’une liberté ou d’un droit constitutionnellement garanti ». Une telle limite
n’existe pas à l’égard des expérimentations transfert. Faut-il en déduire que l’État peut
disposer de ces droits et libertés pour procéder à des expérimentations dans ces domaines à sa
guise ? Même s’il faut espérer une vigilance des juges pour ne pas laisser l’État totalement
libre de procéder à de telles expérimentations, il semble que l’absence de limites relatives aux
droits et libertés constitutionnellement garantis pourrait permettre des expérimentations,
notamment dans le domaine judiciaire110.
La constitutionnalisation des dispositions relatives à l’expérimentation ne s’est pas
faite à droit constant. Les exigences de l’article 37-1 de la Constitution sont finalement bien
en deçà des exigences que la jurisprudence constitutionnelle avait posées. Cela confirme
l’idée que l’État a voulu à travers l’expérimentation transfert mettre en place un moyen
d’action grâce auquel il soit entièrement libre d’agir, afin de procéder à sa réforme.
Toutefois, l’intérêt fondamental de la disposition de l’article 37-1 est surtout pour
l’État de pouvoir procéder à des transferts de compétence de façon moins autoritaire. À cet
égard, il suffit d’analyser la loi du 13 août 2004111, qui est la mise en œuvre législative de
l’Acte II de la décentralisation. La simple lecture des dispositions contenues dans cette loi
oblige à un constat : les expérimentations prévues sont toutes des expérimentations transferts
et visent avant tout à délester l’État de certaines compétences. Ces expérimentations avaient
plusieurs objets : permettre aux régions d’adopter un schéma régional de développement
économique afin que celles-ci soient compétentes pour attribuer des aides économiques (art.
1er, §II) ; transférer aux régions la gestion des fonds structurels européens (art. 44) ; transférer
aux départements la mise en œuvre des mesures d’assistance éducative relatives à la 109 L’épreuve des faits semble cependant aller à l’encontre de cette idée. Cf. infra p. 110 Voir à cet effet l’hypothèse avancée par G. Chavrier relative à une expérimentation sur l’échevinage de juges professionnels et juges non professionnels pour le jugement d’une infraction correctionnelle. CHAVRIER Géraldine, « L’expérimentation locale : vers un État subsidiaire ? », Annuaire des collectivités locales 2004, CNRS, 2004, p.47. 111 Loi n°2004-809 du 13 août 2004, op. cit.
42
protection judiciaire de la jeunesse (art. 59) ; le financement par les régions d’équipements
sanitaires (art. 70) ; transférer à certaines communes la lutte contre l’insalubrité dans l’habitat
(art. 74) ; transférer la gestion des écoles primaires aux communes en les transformant en
établissements publics locaux d’enseignement primaire, sur le modèle de ce qui se fait pour
les collèges et lycées (art. 86) ; transférer, aux collectivités qui le souhaitent, les crédits
relatifs à l’entretien et à la restauration du patrimoine culturel n’appartenant pas à l’État (art.
99).
Ces expérimentations ont avant tout pour objectif de transférer de nouvelles
compétences aux collectivités territoriales, compétences qui sont autant de charges
budgétaires qui sont également transférées de l’État aux collectivités locales. Or, on peut
également voir que, mis à part le transfert de la gestion du patrimoine culturel n’appartenant
pas à l’État, les dispositions législatives qui procèdent à ces transferts de compétences
désignent d’avance le niveau de collectivité bénéficiaire. C’est l’État ici qui est au cœur de
l’organisation de l’expérimentation. Les organes centraux contrôlent absolument toute la
procédure et décident comment se déroule l’expérimentation. D’ailleurs, les « fortunes
diverses »112 de ces expérimentations tendent à démontrer une certaine méfiance des
collectivités territoriales qui y voient un simple outil de transfert de compétences de la part de
l’État, transferts opérés non pas à leur avantage, mais dans une logique de réduction des
dépenses de l’État. Ces variations, allant d’une absence totale d’engouement (la gestion des
écoles primaires par le biais d’établissements publics ou la lutte contre l’insalubrité dans
l’habitat) à un engagement de toutes les collectivités dans l’expérimentation (adoption d’un
schéma de développement économique par toutes les régions) – entre ces deux extrêmes, les
situations les plus diverses peuvent être observées. Tout cela pose la question de la gestion de
l’échantillonnage d’une expérimentation113.
Dans le cadre des expérimentations de l’article 37-1, le constat est sans appel. L’État
conserve une maîtrise totale de la procédure. Il ne s’agit pas d’un nouveau moyen d’action
pour les collectivités territoriales qui leur permettrait d’accroître leur pouvoir de décision. Au
contraire, cette disposition est réellement au service de l’État et de sa réforme. L’État dispose
ici d’un moyen très efficace pour se délester de certaines compétences, qui sont autant de
postes budgétaires qui grèvent les dépenses de l’État.
112 MARCOU Gérard, « Le bilan en demi-teinte de l’Acte II. Décentraliser plus ou décentraliser mieux ? », RFDA, n°2, 2008, p.299. 113 Cf. infra p.79.
43
Il en va tout autrement lorsqu’on se place dans le cadre des expérimentations
normatives de l’article 72 alinéa 4 de la Constitution.
§2. L’expérimentation dérogation : des faux-semblants néfastes
L’expérimentation dérogation est très fortement encadrée. Aux dispositions de l’article
72, alinéa 4, de la Constitution, il faut ajouter la loi organique du 1er août 2003 relative à
l’expérimentation par les collectivités territoriales, qui a inséré un chapitre III relatif aux
expérimentations normatives dans le titre unique, du livre premier de la première partie du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). L’ensemble de ces dispositions encadre
très fortement les expérimentations dérogations. Ces dispositions sont tellement
contraignantes que leur simple lecture donne l’impression que « le processus est entièrement
contrôlé par le législateur (pour l’expérimentation législative) et par le gouvernement (pour
l’expérimentation réglementaire), qu’eux seuls décident de la possibilité ou non d’une
expérimentation ».114 Si effectivement la procédure d’expérimentation est largement pilotée
par l’État et laisse finalement l’impression que l’État s’occupe de tout durant
l’expérimentation (A), l’épreuve des faits conduit à nuancer cette première conclusion.
L’expérimentation relative au RSA, et notamment la façon dont elle a été conduite dans le
département de l’Hérault, tend à démontrer qu’en fait les collectivités sont largement
associées à la prise de décision tout au long de l’expérimentation (B).
A. L’impression d’un rôle important de l’État
Le libellé de l’article 72, alinéa 4, de la Constitution, comporte trois limites, au
pouvoir d’expérimentation des collectivités territoriales, qui sont expressément indiquées et le
renvoi à une loi organique est également source de toute une nouvelle série de limitations.
1. L’encadrement constitutionnel de l’expérimentation dérogation
La Constitution dispose, en son article 72, alinéa 4, que « dans les conditions prévues
par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une
liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou
114 PONTIER Jean-Marie, « La loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales », op. cit., p.1717.
44
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu déroger, à
titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou
réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ». Cet article contient trois
limites successives à l’expérimentation : celle-ci ne doit pas porter atteinte à une liberté
publique ou à un droit constitutionnellement garanti, elle doit être autorisée par la loi ou par le
règlement et enfin elle doit avoir un objet et une durée limités.
Cette dernière condition, l’objet et la durée limités, est similaire à celle qu’on trouve
dans le texte de l’article 37-1 de la Constitution. Ces dispositions ne sont nullement déplacées
ou trop encadrantes puisqu’elles sont la condition même d’existence d’une expérimentation.
Si on s’en réfère à la définition donnée par le Conseil Constitutionnel des lois expérimentales
leur objet et leur durée doivent nécessairement être circonscrits. L’expérimentation n’a pas
pour objectif de créer un droit à la différenciation entre collectivités territoriales, mais de
tester une disposition pour une durée précise. C’est donc à l’État que revient la mission de
déterminer ces différents éléments.
C’est d’ailleurs pour cela que l’expérimentation ne peut être décidée que par une loi ou
un règlement. Le constituant n’a pas voulu consacrer un droit d’initiative aux collectivités
territoriales et la décision de démarrer une expérimentation relève uniquement de l’État. « Le
déclenchement de l’expérimentation législative relève du législateur et de lui seul : une loi
d’habilitation doit être adoptée pour que l’expérimentation puisse avoir lieu, lorsque la
dérogation porte sur la loi. S’agissant de l’expérimentation réglementaire, elle est autorisée
par le gouvernement ».115 Il ne faut pas totalement écarter cependant le recours à des voies
informelles. Les connexions entre élus nationaux et élus locaux sont nombreuses – quand
ceux-ci ne sont pas les mêmes, par l’intermédiaire du cumul des mandats – ce qui leur permet
de transmettre des demandes d’expérimentations. « L’influence politique d’un élu local, ses
relations au plus haut niveau de l’État, joueront un rôle essentiel pour suggérer une
expérimentation. Mais la source juridique demeurera la loi ou le décret ». 116 Juridiquement,
l’initiative de l’expérimentation est entre les mains de l’État, c’est lui qui va décider de
l’opportunité ou non de procéder à une expérimentation sur tel ou tel objet.
Enfin, troisième limite contenue à l’article 72 alinéa 4, l’expérimentation ne peut
porter atteinte à une liberté publique ou à un droit constitutionnellement garanti. Cette limite
est spécifique aux expérimentations dérogations, puisqu’on ne la retrouve pas à l’article 37-1.
115 Ibid, p.1719. 116 DRAGO Guillaume, « Le droit à l’expérimentation », in La République décentralisée, Dir. Yves Gaudemet et Olivier Gohin, Paris, Editions Panthéon Assas, 2004, p.75.
45
Si cette limite semble tout à fait logique, sa rédaction peut toutefois soulever quelques
interrogations. Il est normal que les collectivités territoriales ne puissent pas expérimenter
dans le domaine des droits et libertés constitutionnellement garantis. Ceux-ci sont le socle de
l’unité de la République. L’indivisibilité du territoire suppose que les droits fondamentaux
soient les mêmes pour tous en tout point du territoire et qu’ils soient garantis par le
législateur. La constitution prévoit, en effet, à l’article 34 que la loi fixe les règles concernant
« les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés
publiques ». On sait d’ailleurs que le Conseil Constitutionnel est très vigilant à ce que le
pouvoir réglementaire local ne puisse pas intervenir dans ce domaine117. Si cette limite est une
limite classique au pouvoir réglementaire local, plus étrange est la rédaction que le constituant
a retenue. Il évoque « l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement
garanti ». Il est plus habituel de trouver le vocable de droits et libertés fondamentaux. Si les
deux notions se recoupent certainement sur bien des points, la différence de rédaction devra
conduire le Conseil Constitutionnel à préciser le contenu de la notion employée à l’article 72,
alinéa 4.
2. Les conditions de l’expérimentation complétées par la loi organique du 1er
août 2003
La constitution prévoyait l’adoption d’une loi organique pour encadrer le recours aux
expérimentations de l’article 72, alinéa 4. C’est chose faite avec la loi du 1er août 2003 qui a
inscrit les règles relatives à l’expérimentation dans le Code général des collectivités
territoriales.
Le premier article ajouté au Code (article LO 1113-1) par cette loi est redondant par
rapport à la Constitution puisqu’il rappelle que l’expérimentation ne peut être autorisée que,
selon le domaine, par la loi ou le règlement et que l’objet de l’expérimentation doit être défini
précisément. Il ajoute de nouveaux éléments. Cet article dispose que la durée de
l’expérimentation ne peut être supérieure à cinq ans et que la loi portant expérimentation doit
prévoir « les dispositions auxquelles il peut être dérogé ». Les collectivités territoriales ne
sont donc pas totalement libres d’adopter de nouvelles mesures comme elles le souhaitent
dans le domaine faisant l’objet de l’expérimentation. Dans le cadre de l’expérimentation
relative au RSA, les circulaires d’application prévoyaient de façon exhaustive la liste des
117 Conseil Constitutionnel, décision n°96-373DC, du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, JORF, 13 avril 1996, p.5724.
46
dispositions que les collectivités étaient autorisées à écarter durant l’expérimentation118. C’est
très important puisque cela limite finalement le pouvoir d’initiative des collectivités
territoriales. Celles-ci ne peuvent innover que dans le cadre que l’État leur aura fixé. « La
marge d’autonomie locale est certes étendue, mais dans un cadre strictement réglementé qui
vient préciser de façon explicite les dispositions auxquelles les collectivités territoriales sont
autorisées à déroger ».119
Cet article précise ensuite que la loi portant expérimentation doit prévoir quel sera le
niveau de collectivité concerné par l’expérimentation et sur quels critères seront sélectionnées
les collectivités candidates. Les demandes des collectivités territoriales pour participer à
l’expérimentation doivent être déposées dans un délai qui sera également fixé par la loi.
L’article LO 1113-2 prévoit ensuite les modalités à suivre pour que les collectivités
locales déposent leur candidature à l’expérimentation. La décision de participer à une
expérimentation est de la compétence de l’assemblée délibérante, qui doit adopter une
délibération motivée120. Cette délibération doit être transmise au préfet qui l’adressera lui-
même ensuite, « accompagnée de ses observations », au ministre en charge des collectivités
locales. Le Gouvernement devra vérifier que les collectivités remplissent bien l’ensemble des
conditions déterminées par la loi portant expérimentation et devra ensuite publier la liste des
collectivités admises à participer à l’expérimentation par décret.
Cette disposition appelle plusieurs remarques. On peut d’abord s’étonner de la
complexité, voire de la lourdeur, de la procédure de candidature. Pourquoi obliger les
collectivités locales à transmettre d’abord leur demande au préfet, alors qu’elles pourraient
très bien la transmettre directement au ministre ? Même si le représentant de l’État n’a ici
aucun pouvoir de décision, il semble que l’on cherche déjà à effectuer un premier filtre. On
retrouve cette idée dans le fait que le préfet transmet la demande au ministre, associée de ses
propres observations. La loi ne précise pas quelle est la teneur de ces observations, ni quelle
est leur portée. En dehors de toute précision, on ne peut qu’y voir un moyen de contrôle de
l’État et donc de filtrage des demandes de participation aux expérimentations. Un tel filtrage
peut se comprendre comme la mise en place d’une sorte de tutelle de l’État sur les
collectivités. De plus, ce filtrage des demandes par le préfet fait double emploi avec celui qui
118 Circulaire du 22 août 2007, relative à la mise en œuvre des expérimentations locales prévues par l’article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié et la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat – revenu de solidarité active (RSA), Annexes, p.6-8. 119 LONG Martine, « Revenu de solidarité active : l’expérimentation », Droit social, n°12, 2007, p.1241. 120 En matière de RSA, ces délibérations ont d’ailleurs été publiées au Journal officiel du 1er janvier 2008.
47
est expressément prévu ensuite au profit du Gouvernement. La marge de manœuvre de l’État
est cependant ici limitée puisqu’elle se limite à vérifier que les collectivités territoriales
remplissent les conditions déterminées par la loi portant expérimentation. Le choix du
Gouvernement ne peut pas être fait de manière discrétionnaire. Il semble d’ailleurs qu’il soit
obligé d’admettre dans l’expérimentation toutes les collectivités qui remplissent ces
conditions.
Le Code général des collectivités territoriales prévoit ensuite (article LO 1113-3) que
les actes réglementaires, intervenant dans le domaine de la loi ou du règlement, que les
collectivités vont adopter durant l’expérimentation devront être publiés au Journal Officiel, en
plus de leur classique transmission au représentant de l’État. Ces actes n’entrent en vigueur
qu’une fois publiés. Cette disposition est pour le moins étrange, puisqu’elle complique la
procédure. Cette publication au Journal Officiel n’est pas exigée pour les actes habituellement
adoptés par les collectivités territoriales. Dès lors, on peut s’interroger sur l’objectif d’une
telle procédure. Si la publication des actes est nécessaire dans un souci d’information du
public, la publication au Journal Officiel semble ici avant tout être un moyen de contrôle de
l’État. Lors de la présentation du projet de loi organique, l’objectif de cette mesure était de
respecter un certain parallélisme des formes. « L’expérimentation autorisant des dérogations
aux dispositions législatives, il est indispensable de prévoir des formes de publicité
comparables à celles prévues pour la loi ».121 Si l’argument n’est pas dénué de logique, il
n’empêche que cette procédure reste particulièrement lourde et sa « nécessité ne s’impose pas
à l’évidence ».122 Tout conduit donc à conclure que cette obligation de publication permet
avant tout à l’État de savoir en permanence les dispositions à caractère dérogatoire que les
collectivités territoriales ont adoptées. Sans être véritablement une tutelle, l’État s’autorise ici
une présence – en tant qu’observateur muet certes – sur les actions menées par les
collectivités locales.
L’article LO 1113-4 prévoit le régime juridique des actes à caractère dérogatoire
adoptés par les collectivités territoriales. Ces actes sont formellement administratifs, mais
peuvent intervenir dans le domaine de la loi. Ils sont donc soumis à un régime juridique
spécifique123.
Le CGCT prévoit ensuite l’obligation de transfert au Parlement d’un rapport aux fins
d’évaluation des expérimentations menées dans le domaine de la loi. Cette disposition 121 PIRON Michel, Rapport n°955, op. cit., p.30. 122 RICCI Jean-Claude, « Regards juridique sur l’expérimentation en matière de collectivités territoriales », in Les collectivités locales et l’expérimentations : perspectives nationales et européennes, op. cit., p.203. 123 Cf. infra p.121 et s.
48
consacrant l’obligation, jurisprudentielle, d’évaluation des expérimentations, sera analysée
ultérieurement124. Toutefois, il faut relever que l’alinéa 2 de l’article LO 1113-5 prévoit
également une autre obligation à la charge du Gouvernement. Celui-ci doit en effet
« transmettre chaque année un rapport retraçant l'ensemble des propositions
d'expérimentation et demandes formulées au titre de l'article LO 1113-2 que lui ont adressées
les collectivités, en exposant les suites qui leur ont été réservées ». Force est de constater
qu’on ne trouve aucune trace de ces rapports d’information dans la documentation du
Parlement. Cette disposition est également intéressante car elle consacre, sans réellement le
dire, un droit d’initiative des collectivités territoriales. Cependant, ce droit d’initiative est très
limité puisque aucune obligation n’est faite au Gouvernement d’y donner suite. Cette
possibilité est pour l’instant donc restée lettre morte. Il est dommage qu’une telle disposition
ne soit pas respectée, puisqu’elle serait justement un moyen pour les collectivités territoriales
d’essayer de peser un peu plus dans le cadre de l’expérimentation normative. Si un tel rapport
était vraiment publié, l’État se verrait dans l’obligation de donner suite à ces demandes ou du
moins de se prononcer dessus, au risque de voir l’opinion publique s’en saisir et le
sanctionner politiquement ensuite lors d’élections.
La loi organique prévoit ensuite, à l’article LO 1113-6 du CGCT, les modalités d’issue
de l’expérimentation. Ainsi, l’expérimentation peut être prolongée ou modifiée pour une
durée qui ne peut cependant excéder trois ans. Le problème, ici, c’est que la loi organique ne
détermine pas à quelles conditions peut être faite cette prolongation ou cette modification. Les
collectivités qui avaient déjà participé à la première expérimentation, sont-elles obligées de
continuer en cas de prolongation ? L’expérimentation se faisant sur la base du volontariat des
collectivités, on peut supposer qu’il en sera de même pour sa prolongation. Plus délicate est la
question de la modification de l’expérimentation. En effet, qu’est-ce qui relève de la
modification de l’expérimentation ou de la mise en place d’une nouvelle expérimentation ? Il
semble que l’État a ici une marge de manœuvre assez importante, sous le contrôle du juge à
condition que celui-ci soit saisi. La question qui pourrait se poser serait celle d’une
modification tellement importante des conditions de l’expérimentation que finalement on
entrerait dans une nouvelle expérimentation. Dans un tel cas, il semblerait qu’il faille
recommencer la procédure d’appel à participation des collectivités et non reconduire les
mêmes.
L’expérimentation peut ensuite être soit généralisée à l’ensemble du territoire, soit
124 Cf. infra p.91.
49
abandonnée. Ces questions seront étudiées ultérieurement puisque derrière cette dualité
d’issues de l’expérimentation se pose en filigrane la question de l’adéquation entre le principe
d’égalité et l’expérimentation125.
Enfin le CGCT a été complété par une dernière disposition relative à l’expérimentation
qui est l’article LO 1113-7. Cet article étend les dispositions précédentes, qui étaient
applicables aux expérimentations en matière législative, aux expérimentations en matière
réglementaire. Cet article oblige le Gouvernement à adopter un décret en Conseil d’État pour
procéder à une expérimentation dans le domaine réglementaire. Une telle obligation permet
de marquer une certaine solennité du recours à l’expérimentation, même en matière
réglementaire. Cette procédure permet également d’avoir un certain contrôle des
expérimentations, le Conseil d'État se prononçant a priori sur leur mise en œuvre, on peut
supposer qu’il pourra limiter les ardeurs du Gouvernement à entreprendre des
expérimentations fantaisistes. Pour le reste, les expérimentations en matière réglementaire
sont soumises aux mêmes obligations, contraintes et régimes juridiques que les
expérimentations intervenant dans le domaine de la loi.
La conjonction des dispositions de la Constitution et de la loi organique laisse planer sur
les expérimentations l’ombre d’une importante présence de l’État. L’intérêt du recours à
l’expérimentation normative serait alors automatiquement limité puisque l’État semble
pouvoir piloter toute la procédure. D’ailleurs, le peu de succès de ce type d’expérimentation
semble abonder en ce sens. Les lourdeurs de la procédure et le rôle central conservé par l’État
durant toute la procédure seraient un frein au recours à l’expérimentation dérogation. Le
constat est sans appel, depuis la révision constitutionnelle de 2003, une seule expérimentation
dérogation a été mise en place. Il s’agit de l’expérimentation en matière de RSA prévue tout
d’abord par l’article 147 de la loi de finances pour 2007126. Certains éléments de
l’expérimentation ont également été prévus dans la loi du 5 mars 2007 instituant le droit
opposable au logement127. Enfin, ces dispositions ont été complétées par la loi, dite loi TEPA,
de l’été 2007128. « L’expérimentation du revenu de solidarité active prouve la complexité de
la mise en œuvre des mesures d’expérimentation telles que prévues dans le cadre de la
125 Cf. infra p.65. 126 Loi n°2006-1666, du 21 décembre 2006, portant loi de finance pour 2007, art. 142, JORF, 27 décembre 2006, p.19641. 127 Loi n°2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, JORF, 6 mars 2007, p.4190. 128 Loi n°2007-1223, du 21 août 2007, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (art. 18 et suivants), JORF, 22 août 2007, p.13945.
50
réforme constitutionnelle de 2003 ».129
L’expérimentation est un mécanisme compliqué à mettre en place si on se contente
d’une simple lecture des textes. La mise en place de l’expérimentation relative au RSA a
confirmé cette complexité. Les auteurs ont été sceptiques face à cette expérimentation.
Cependant, l’épreuve des faits montre que durant l’expérimentation, la place des collectivités
territoriales est réellement renforcée.
B. Des collectivités largement associées à la procédure
Les conclusions présentées ici sont tirées de l’expérimentation du RSA dans le
département de l’Hérault. Si l’expérience du département montre que les collectivités
territoriales ont été associées à la procédure d’expérimentation et n’ont pas totalement été
encadrées par la volonté de l’État, la limite de la démonstration est qu’elle s’appuie sur le seul
exemple héraultais. Il semblerait un peu hâtif de généraliser l’ensemble de ces conclusions,
mais elles permettent en tout cas de nuancer les craintes exposées précédemment.
L’expérimentation menée par le Conseil Général de l’Hérault démontre qu’il y a eu une
importante négociation préalablement à l’expérimentation. Cette phase de négociation, qui
n’était pas prévue dans les textes, a été l’occasion pour les départements de mettre en place
des conditions d’expérimentation satisfaisantes. L’exemple héraultais prouve ensuite que les
collectivités territoriales sont largement associées à l’issue de l’expérimentation à la rédaction
des dispositions de généralisation.
1. La négociation préalable à l’expérimentation
Ce cycle de négociation préalable à l’expérience n’a pas été prévu par les textes relatifs
à l’expérimentation. Il s’inscrit dans le mouvement de contractualisation des relations entre
l’État et les collectivités territoriales. Ces négociations vont aboutir à une convention entre les
différentes parties, convention qui est véritablement une « feuille de route » pour les deux
parties contractantes. Pour les collectivités territoriales, cette convention contient la
description des mesures que la collectivité compte adopter durant l’expérimentation ; pour
l’État, cette convention retrace les engagements financiers de celui-ci pour soutenir
l’expérimentation.
129 LONG Martine, « Revenu de solidarité active : l’expérimentation », op. cit., p.1241.
51
Il faut relever ici que ni la Constitution, ni la loi organique du 1er août 2003 n’ont prévu
de dispositions relatives au financement de l’expérimentation. Il est indéniable que la question
financière est au cœur de l’expérimentation. Il paraît inconcevable de demander à une
collectivité territoriale de supporter intégralement le poids financier d’une expérimentation,
dont elle n’aurait pas eu l’initiative et où sa marge d’action reste somme toute encadrée. Il est
étrange que rien n’ait été prévu dans les textes constitutionnel et organique. Cela pose
d’autant plus question que la révision constitutionnelle de 2003 a également introduit dans
notre norme fondamentale le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Obliger une collectivité à financer une expérimentation décidée par l’État revient à créer dans
son budget une nouvelle catégorie de dépenses obligatoires. Il est dommageable qu’aucune
disposition, de rang constitutionnel ou organique, ne soit venue organiser cette question. Lors
de l’expérimentation relative au RSA, l’État s’était engagé à financer 50% du surcoût induit
par l’expérimentation dans les départements. Si le détail exact de la convention ne peut pas
être communiqué au public, il ressort des discussions avec les responsables de
l’expérimentation que l’État a effectivement financé la moitié de l’expérimentation.
L’intérêt premier de cette phase de négociation préalablement à l’expérimentation est de
permettre aux collectivités territoriales de négocier les conditions dans lesquelles
l’expérimentation va être menée. L’objectif est ici de permettre à chaque collectivité de
réaliser les aménagements qu’elle souhaite aux dispositions normalement applicables.
« L’expérimentation par définition a laissé des marges de manœuvre sur la manière de faire
sachant qu’il y avait un socle légal, quand même, à l’intérieur duquel il fallait se placer ».130
Tout au long de cette phase, le département de l’Hérault a pu « négocier avec Martin
Hirsch »131, il y a eu des « tractations assez importantes sur des grands débats ».132 C’est un
véritable dialogue qui s’est mis en place entre les autorités centrales et la collectivité
territoriale.
Si l’État a prévu au début de l’expérimentation les dispositions auxquelles les
collectivités expérimentatrices pourraient déroger, celles-ci ont tout de même été assez libres
de conduire l’expérimentation comme elles le souhaitaient à l’intérieur de ce cadre légal.
La place des collectivités territoriales a également été fortement valorisée à l’issue de
l’expérimentation. Les résultats étant différents dans chaque département, l’expérimentation a
130 Annexe : entretien Mme Vaugelade p.131. 131 Ibid, p.132. 132 Ibid, p.133.
52
été l’occasion d’associer les collectivités à la rédaction des textes de généralisation du
dispositif.
2. L’association des collectivités territoriales à l’issue de l’expérimentation
L’un des intérêts majeurs de l’expérimentation est de profiter de l’expérience conduite
dans les différentes collectivités territoriales. Ce retour d’expérience permet d’adopter un
dispositif qui sera le mieux à même de répondre aux attentes de la population.
L’expérimentation permet aussi, plus simplement, d’éviter un certain nombre de « problèmes
techniques, incohérences, manque de coordination ».133 Toutes les questions n’ont pas
toujours le temps d’être abordées lors des débats au Parlement, ou lorsqu’elles sont réglées
par le pouvoir réglementaire, celui-ci n’est pas forcément au fait de tous les problèmes
techniques qui peuvent se rencontrer ensuite sur le terrain. L’expérimentation « permet de
rôder, d’huiler en fait ces projets de loi, et d’arriver à ce que le projet normalement en bout
de course soit complètement opérationnel parce qu’il a été très bien testé ».134
Dans le cadre de la généralisation du RSA, cette logique a même été suivie jusqu’au
bout, puisque la rédaction des décrets d’application de la loi s’est faite avec l’aide des
personnes qui ont localement appliqué le dispositif. Ce sont véritablement les personnes, qui
sont au contact quotidiennement avec les administrés auxquels s’adresse la loi, qui vont
pouvoir faire part de leur expérience et surtout de leur compétence pour la rédaction de ces
textes. « Il y a des gens chez nous [dans le département de l’Hérault] à des postes corrects,
mais pas des grands directeurs qui ont participé à la rédaction des décrets. Le Gouvernement
a intégré un certain nombre de personnes, ce n’est pas Mme Machin, et elle n’est pas
députée, elle n’a pas d’étiquette, elle est une simple technicienne avec sa compétence propre.
Ce st souvent des gens très riches ».135 L’expérimentation permet réellement de s’appuyer sur
les compétences de chacun pour obtenir le meilleur texte possible. Cet exemple rejoint
parfaitement l’idée exposée précédemment que l’expérimentation s’inscrit dans le mouvement
post-moderne. L’expérimentation normative illustre parfaitement le fait que la règle de droit
n’a plus une légitimité ab initio aujourd’hui, mais cette légitimité repose au contraire, sur sa
capacité à apporter des solutions concrètes aux besoins de la société. De telles solutions
peuvent être apportées par les administrateurs qui appliquent quotidiennement la norme.
133 Idib, p.134 134 Idem 135 Ibid, p.138.
53
Cependant l’exemple du RSA démontre également une limite importante de
l’expérimentation. Celle-ci ne peut fonctionner correctement qu’à condition que tous les
acteurs soient dans des dispositions tendant à sa réussite. Dans le cadre du RSA, la réussite de
l’expérimentation semble tenir en partie à la personnalité de Martin Hirsch. Il ressort de
l’expérience héraultaise que le Haut Commissaire aux solidarités actives a su entendre, lors de
négociations préalables, les avis des départements expérimentateurs et a su en tenir compte
pour leur laisser une importante marge de manœuvre. Comme toute politique innovante, la
réussite de l’expérimentation tient en partie à la personnalité de celui qui au niveau central va
gérer cette expérience. Il est nécessaire que ce décideur ne soit pas un jacobin inconditionnel
et qu’il reconnaisse les collectivités locales comme lieu d’innovation. « Si on tombe sur une
autre personnalité beaucoup plus formatée étatique, avec la prédominance de l’État, ça peut
être que de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu’on fait expérimenter dans des conditions
beaucoup plus difficiles en termes de négociation, c'est-à-dire qu’on a un cahier des charges
quasiment pas négociable ».136 L’expérimentation du RSA, si on peut admettre qu’elle a été
en partie une réussite, c’est d’abord grâce à la personnalité de Martin Hirsch.
L’analyse des textes relatifs à l’expérimentation normative nécessite d’aller au-delà de
leur lettre. La simple lecture des dispositions constitutionnelles et organiques laisse à penser
un État omnipotent dans les différentes procédures d’expérimentation. Tel n’est pas toujours
le cas, puisque l’intérêt de l’expérimentation est justement de profiter des solutions adoptées
localement pour édicter une règle générale qui soit la plus adaptée à répondre aux attentes de
la population. Cette idée d’associer les collectivités infra étatiques à la création de la règle de
droit nationale inscrit l’expérimentation dans un mouvement beaucoup plus vaste de
modification de la perception de la norme. L’expérimentation normative est un très bon
exemple de ce qu’on appelle la post-modernité juridique.
La spécificité du système juridique français est que cette post-modernité a été inscrite
dans notre Constitution. La France est le seul État à avoir constitutionnalisé le droit à
l’expérimentation normative. Cela conduit nécessairement à opérer une confrontation entre
l’expérimentation et les autres principes contenus dans la Constitution.
136 Ibid, p.137.
54
Chapitre 2. La conciliation de l’expérimentation
avec les principes constitutionnels
La constitutionnalisation du droit à l’expérimentation oblige à concilier
l’expérimentation avec les principes déjà présents dans la Constitution. Cette conciliation sera
prioritairement opérée par le juge constitutionnel. Le travail du juge constitutionnel est de
retrouver une certaine cohérence entre les différents éléments de la Constitution qui peuvent
parfois entrer en contradiction. « Par son principe aussi bien que par la manière dont sont
nécessairement définies ses conditions d’exécution, l’expérimentation produit dans l’ordre
juridique une série de discontinuités plus ou moins graves qui créent autant d’atteintes à la
sécurité juridique et d’altérations aux principes sur lesquels se fonde l’ordonnancement
juridique des règles de droit ».137
L’expérimentation doit être confrontée à deux autres principes constitutionnels plus
particulièrement. Pendant la durée de l’expérimentation, tous les territoires de la République
n’appliqueront pas des règles de droit identiques. Dès lors, l’expérimentation porte atteinte au
principe d’égalité. Cependant cette atteinte, puisqu’elle est limitée dans sa durée et vise un but
d’intérêt général, est justifiée. Les possibilités d’issues de l’expérimentation, à savoir
l’alternative entre la généralisation de la norme ou l’abandon de l’expérimentation,
démontrent l’attachement du constituant à une vision un peu dépassée du principe d’égalité.
Un tel attachement est plus que critiquable et juridiquement rien n’empêchait les
Parlementaires de mener l’expérimentation sur le terrain d’un droit à la différenciation
encadré. Le second principe, auquel l’expérimentation doit être conciliée, est le principe de
subsidiarité. La situation est ici un peu différente, puisque les deux principes ne se
contredisent pas mais sont complémentaires. L’expérimentation apparaît comme un
mécanisme juridique permettant la mise en œuvre du principe de subsidiarité. « N’étant pas
opérationnel par lui-même, le principe [de subsidiarité] est condamné à rester lettre
137 BOULOUIS Jean, « Note sur l’utilisation de la « méthode expérimentale » en matière de réformes », in Mélanges offerts à Monsieur le doyen Louis Trotabas, op. cit., p.35.
55
morte ».138 L’intervention de l’expérimentation donne une plus grande effectivité au principe
de subsidiarité.
L’expérimentation permet de concrétiser le principe de subsidiarité (Section 1), en
portant cependant atteinte à un principe constitutionnel central, le principe d’égalité (Section
2).
138 DENAJA Sébastien, Expérimentation et administration territoriale, Thèse dactylographiée, Montpellier, 2008, p.439.
56
Section 1. La mise en œuvre du principe de subsidiarité
La nouvelle rédaction de l’article 72 de la Constitution, issue de la révision du 28 mars
2003, introduit un alinéa 2 qui dispose que « les collectivités territoriales ont vocation à
prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en
œuvre à leur échelon ».
Il s’agit là d’une nouveauté de cette révision constitutionnelle. Cet article sans le
nommer expressément constitutionnalise le principe de subsidiarité. Ce principe n’est pas une
invention française puisqu’on le retrouve en droit communautaire, et dans de nombreux Etats
fédéraux. Cependant, si ce droit est largement connu en dehors de nos frontières, sa
constitutionnalisation en droit français n’est pas entièrement satisfaisante (§1). Le principe de
subsidiarité reste avant tout un principe politique et nécessite des outils de mise en œuvre, tels
que l’expérimentation (§2).
§1. La subsidiarité, un principe à la normativité incertaine
Le principe de subsidiarité a été constitutionnalisé lors de la révision du 28 mars 2003.
Toutefois, c’est un principe largement connu dans les système fédéraux et dans le droit
communautaire. La conception française du principe pose un certain nombre de questions. La
subsidiarité se contrôle sur un critère qui n’a rien de juridique, le « mieux ». Il est donc
nécessaire de brosser un rapide tableau de la genèse du principe (A) avant de se poser la
question de son effectivité (B).
A. L’émergence du principe de subsidiarité
L’introduction du principe de subsidiarité en droit français peut effectivement poser
question dans le mesure où c’est un principe qui tend à régir les compétences plutôt dans les
Etats fédéraux, ou dans le cadre de la Communauté européenne. Le principe de subsidiarité
est souvent considéré « comme une notion étrangère et un mode d’organisation des
compétences entre les différents pouvoirs autonomes existants à l’intérieur des Etats ».139
139 DELCAMP Alain, « Principe de subsidiarité et décentralisation », Revue française de droit constitutionnel, n°23, 1995, p.611.
57
Le principe de subsidiarité trouve son origine, non pas dans le droit constitutionnel d’un
quelconque État fédéral, mais dans le droit canon. La première véritable définition du principe
de subsidiarité est contenue dans une encyclique du pape Pie XI en 1931. Il y est énoncé qu’il
serait contraire à l’ordre social que « de retirer aux groupements d’ordre inférieur, pour les
confier à une collectivité plus vaste et d’un rang plus élevé, les fonctions qu’ils sont en
mesure de remplir eux-mêmes. L’objet naturel de toute intervention en matière sociale est
d’aider les membres du corps social, et non pas de les détruire, ni de les absorber ».140 Le
principe de subsidiarité trouve une formulation très précise dans la doctrine sociale de
l’Eglise.
En droit français, avant 2003, l’unique référence au principe de subsidiarité dans les
écrits juridiques ou politiques est dans le rapport « Vivre ensemble », dit rapport Guichard, de
1976. Ce rapport définit la subsidiarité comme la recherche du « niveau adéquat d’exercice
des compétences, un niveau supérieur n’étant appelé que dans les cas où les niveaux
inférieurs ne peuvent pas exercer eux-mêmes les compétences correspondantes. L’État doit
ainsi déléguer aux collectivités tous les pouvoirs qu’elles sont en mesure d’exercer ».141 Il
faudra attendre cependant près de trente ans pour que le principe soit admis en droit positif
français. C’est ailleurs qu’il faut aller chercher une application du principe et le droit
communautaire offre ici un réceptacle propice. Dans le cadre du droit communautaire, il
existe des compétences concurrentes, qui appartiennent par principe aux Etats membres mais
dont la Communauté peut se saisir. Le principe de subsidiarité trouve alors un terrain propre à
s’appliquer.
Le traité de Maastricht en 1992 a introduit un article 3 B relatif au principe de
subsidiarité. Cet article dispose que « La Communauté agit dans les limites des compétences
qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. Dans les
domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient,
conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action
envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent
donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au
niveau communautaire. L’action de la Communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour
140 PIE XI, Encyclique Rerum novarum – Quadragesimo Anno, 1931, cité par DELCAMP, Alain, op. cit., p614. 141 Ibid, p.619.
58
atteindre les objectifs du présent traité ».142 Le principe de subsidiarité est en droit
communautaire un outil de répartition des compétences concurrentes entre la Communauté et
les Etats membres. Cette subsidiarité fonctionne de façon ascendante. La Communauté n’est
amenée à intervenir que si, et seulement si, les Etats membres ne sont pas le niveau le mieux à
même de mettre en œuvre la politique en question.
Cette mise en œuvre du principe de subsidiarité par le droit communautaire illustre
l’origine étymologique latin du mot subsidiarité. Ce mot « provient du terme subsidium qui
signifie « renfort, ressource » et donne aujourd’hui le terme « subside » qui implique cette
idée de secours : obtenir un subside signifie obtenir une aide financière. D’autre part, il
provient d’un terme dérivé du premier, subsidiarius, signifiant « qui est en réserve » : dans
l’Antiquité romaine, les troupes subsidiaires étaient les troupes de réserve, celles que l’on
appelait en renfort lorsque nécessaire ».143 La Communauté Européenne, lorsqu’elle applique
le principe de subsidiarité, c’est dans cette logique de secours, de renfort. Elle n’intervient
qu’en renfort des Etats membres, si jamais ceux-ci ne sont pas capables d’atteindre
l’ensemble des objectifs fixés. Le principe de subsidiarité fonctionne de façon ascendante,
c'est-à-dire que par principe la compétence est attribuée aux Etats membres et ce n’est que par
dérogation, en application du principe de subsidiarité, que la Communauté peut intervenir.
La conception française du principe fonctionne sur une logique inverse, à savoir
descendante. En effet, par principe la compétence appartient à l’État central et ce n’est, que
par exception, que les collectivités territoriales peuvent se voir confier la compétence, si elles
peuvent mieux la mettre en œuvre. On retrouve cette logique en matière d’expérimentation
puisque c’est l’État qui décide du niveau de collectivité territoriale qui va expérimenter. C’est
au niveau central qu’est décidé, de façon descendante, quel sera le niveau de collectivité, le
plus proche des citoyens, le plus à même de prendre en charge cette compétence.
Sans être expressément nommé, le principe de subsidiarité gouverne l’action de
l’administration déconcentrée depuis la loi de 1992 relative à l’administration territoriale de la
République144. L’article 2 de cette loi dispose que « sont confiées aux administrations
centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution, en
vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial ». La subsidiarité vise dans ce 142 Désormais, article 5 du Traité instituant la communauté européenne, Journal Officiel, n°C 325 du 24 décembre 2002. 143 DEROSIER Jean-Philippe, « La dialectique centralisation/décentralisation. Recherches sur le caractère dynamique du principe de subsidiarité. », RIDC, n°1, 2007, p.125. 144 Loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République, JORF, 8 février 1992, p.2064.
59
cas à répartir les compétences entre les autorités centrales et déconcentrées de l’État. Par
principe les compétences administratives de l’État appartiennent au niveau déconcentré et ce
n’est que par exception que les services centraux sont compétents. Cette exception est
strictement encadrée puisqu’elle n’intervient que pour les missions présentant « un caractère
national » ou si la loi l’a prévu. « L’exception est donc la compétence de l’administration
centrale et la règle la compétence des services déconcentrés ».145
L’apparition du principe de subsidiarité en droit constitutionnel français en 2003 n’est
pas neutre. Au même titre que l’expérimentation, le principe de subsidiarité s’inscrit dans la
logique post moderne. L’une des caractéristiques de la post-modernité juridique est de
modifier la perception de la règle de droit. Un auteur écrivait en 1995 à propos de l’idée de
constitutionnalisation du principe de subsidiarité qu’une « telle insertion doit être appréciée,
nous semble-t-il, à la lumière d’une évolution du droit qui perd ses caractéristiques de norme
générale, immuable et impersonnelle et s’adapter à l’évolution d’une société complexe et
parfois imprévisible ».146 L’inscription du principe de subsidiarité dans notre constitution
participe, tout comme l’expérimentation normative, à un mouvement d’ensemble de réforme
de l’État.
Le principe de subsidiarité n’a pas été pleinement constitutionnalisé, mais sa limite la
plus importante est qu’il est une notion difficilement saisissable par le juge.
B. Un principe difficilement justiciable
Le principe de subsidiarité tel qu’il a été constitutionnalisé comporte cependant une
importante limite. L’article 72, alinéa 2, fait en effet référence à la notion de « mieux ». Cette
notion n’a rien de juridique. Ce principe pourrait être un outil au service de la répartition des
compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Il ressemble plus finalement à une
notion politique, à une sorte de déclaration d’intention dépourvue de portée. D’ailleurs la
doctrine a largement relevé ce problème. « La subsidiarité ne doit pas uniquement acquérir
rang constitutionnel, mais elle doit également devenir un principe normatif (de rang
constitutionnel) ».147 Les collectivités territoriales n’ayant pas de moyen de saisir directement
le Conseil Constitutionnel, elles ne peuvent pas faire valoir devant le juge la pleine
application de ce principe. C’est entièrement sur l’appréciation du législateur que repose la 145 ROUQUETTE Rémi, « La loi d’orientation relative à l’administration territoriale de la République », LPA, n°143, 1992, p.12. 146 DELCAMP Alain, op. cit., p.623. 147 DEROSIER Jean-Philippe, op. cit., p.138.
60
mise en œuvre de ce principe. « C’est en cela qu’il peut être, à bon droit, relevé le caractère
subjectif et variable de la mise en œuvre du principe de subsidiarité ».148
La seule application du principe de subsidiarité par le Conseil Constitutionnel tend à
démontrer que celui-ci ne veut pas se faire juge de cette appréciation par le législateur. Dans
sa décision du 7 juillet 2005149, le Conseil Constitutionnel avait à connaître de la question de
zones départementales de développement de l’éolien. La loi déférée prévoyait que ces zones
étaient déterminées par les préfets de département. Les requérants ont estimé que cette
compétence attribuée au préfet méconnaissait le principe de libre administration des
collectivités territoriales et le principe de subsidiarité. Le Conseil Constitutionnel a dû
interpréter l’alinéa 2, de l’article 72 de la Constitution. Il a estimé « qu'il résulte de la
généralité des termes retenus par le constituant que le choix du législateur d'attribuer une
compétence à l'Etat plutôt qu'à une collectivité territoriale ne pourrait être remis en cause,
sur le fondement de cette disposition, que s'il était manifeste qu'eu égard à ses
caractéristiques et aux intérêts concernés, que cette compétence pouvait être mieux exercée
par une collectivité territoriale ».150 Le Conseil Constitutionnel reconnaît une large marge de
manœuvre au législateur dans l’application du principe de subsidiarité. Il ne sanctionnera que
s’il y a une erreur manifeste d’appréciation du législateur, ce qui n’était pas le cas dans la loi
qui était soumise à son contrôle en l’espèce. « Il faut admettre que le juge n’est certainement
pas « le mieux » placé – si l’on ose dire – pour apprécier un niveau pertinent de gestion
d’une compétence ».151 Cependant, le Conseil Constitutionnel a déjà attribué une valeur
normative à des dispositions constitutionnelles qui en étaient dépourvues à la base.152 Rien
n’empêche le Conseil de contrôler de façon plus approfondie un transfert de compétences à
l’aune du principe de subsidiarité. Dès lors, c’est la rédaction du principe de subsidiarité dans
notre Constitution qui est porteuse de cette précarité. « Sa signification incertaine laisse à
terme place à des interprétations imprévisibles du juge constitutionnel ».153
148 DENAJA Sébastien, op. cit., p.434. 149 Conseil Constitutionnel, n°2005-516DC du 7 juillet 2005, relative à la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, JORF, 14 juillet 2005, p.11589. 150 Idem 151 DENAJA Sébastien, op. cit., p.434. 152 C’est le cas pour l’article 88-1 de la Constitution qui avait été inséré en 1992 comme une déclaration politique réaffirmant l’attachement de la France aux Communautés. Le Conseil Constitutionnel y a découvert une obligation de transposition des directives communautaires : Conseil Constitutionnel, n°2004-505DC du 19 novembre 2004, relative au Traité établissant une Constitution pour l’Europe, JORF, 24 novembre 2004, p.19885. 153 FIALAIRE Jacques « Le droit à l’expérimentation des collectivités territoriales et la subsidiarité : : les apparence et « faux semblants » d’une prétendue territorialisation des normes », in Subsidiarité infranationale et
61
La subsidiarité revêt avant tout, semble-t-il, un caractère politique. Sa mise en œuvre
nécessite des mécanismes juridiques plus précis, parmi ceux-ci l’expérimentation.
§2. La concrétisation du principe de subsidiarité
L’effectivité du principe de subsidiarité passe nécessairement par la mise en œuvre
d’autres outils juridiques. L’expérimentation est l’un de ces outils. « Le recours à
l’expérimentation peut permettre de remédier aux faiblesses, principalement en terme de
« justiciabilité », du principe de subsidiarité ».154 Le droit à l’expérimentation permet de
compléter le principe de subsidiarité (A). Toutefois, cette complémentarité aurait pu être
encore plus développée (B).
A. Expérimentation et subsidiarité, des principes complémentaires
Pour trouver une application pleine et entière, le principe de subsidiarité nécessite
l’intervention d’autres instruments. L’expérimentation a été qualifiée de « corollaire »155 du
principe de subsidiarité. « La technique de l’expérimentation apparaît alors comme un
complément nécessaire à l’effectivité de l’objectif de subsidiarité ».156 L’expérimentation est
un moyen de donner corps au principe de subsidiarité. L’objectif de la subsidiarité est
d’accorder l’exercice d’une compétence à niveau de collectivité qui sera le plus à même de
l’exercer. Pour déterminer ce niveau de collectivité, il faut procéder à une évaluation de la
mise en œuvre de cette compétence par les collectivités territoriales. Le principe de
subsidiarité et l’expérimentation se rejoignent au travers du prisme de l’évaluation. « Le lien
entre expérimentation et subsidiarité apparaît alors clairement : l’évaluation expérimentale
est un relais nécessaire à l’objectif de subsidiarité ».157
En procédant à une expérimentation – notamment une expérimentation transfert – avant
de généraliser l’exercice de la compétence, l’État va pouvoir déterminer quel est le niveau de
collectivité le plus à même de se charger de cette compétence. L’expérimentation permet la
territorialisation des normes, état des lieux et perspectives en droit interne et en droit comparé, Dir. Jacques Fialaire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p.18. 154 DENAJA Sébastien, op. cit., p.438. 155 CLÉMENT Pascal, Rapport n°376, op. cit., p.89. 156 MILANO Laure, « La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, premier jalon de la réorganisation de l’État », RGCT, n°33, 2005, p.95. 157 Ibid, p.96.
62
mise en œuvre du principe de subsidiarité. L’expérimentation détermine le niveau de
collectivité locale qui peut le « mieux » mettre en œuvre la compétence. « La subsidiarité
expérimentale a donc comme hypothèse préalable de tester in vivo l’échelon le plus efficace
avant de légiférer globalement ».158 L’expérimentation, puisqu’elle sera généralisée ou
abandonnée, est une façon d’essayer qui de l’État ou d’un niveau donné de collectivité
territoriale est le niveau le plus approprié à l’exercice d’une compétence. L’expérimentation
permet de déterminer le « mieux ». Elle est un outil de mise en œuvre du principe de
subsidiarité. L’article 37-1 de la Constitution qui permet les expérimentations transferts se
révèle être un mécanisme d’activation de la subsidiarité. Il faut noter que la loi du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales ne fait aucune référence au principe de
subsidiarité, alors même que sept domaines de transferts de compétences à titre expérimental
y sont inscrits. Cela traduit une certaine méconnaissance des politiques à l’égard de la notion.
Si le principe de subsidiarité a besoin de l’intervention de l’expérimentation pour
devenir un principe effectif, le droit à l’expérimentation comporte certaines limites. Dès lors,
l’expérimentation ne sublime pas totalement le principe de subsidiarité.
B. Une complémentarité inachevée
La mise en œuvre du principe de subsidiarité par l’expérimentation comporte également
une limite. L’expérimentation ne peut pas être conduite dans différents niveaux de
collectivités territoriales en même temps. « Les collectivités territoriales habilitées relèveront
de la même catégorie juridique. Il n’est pas envisageable de penser qu’une même
expérimentation pourrait être conduite, par exemple, dans un département et dans une
commune, puisque l’expérimentation est une dérogation à la loi régissant une compétence
donnée ».159 Il est indéniable que les compétences des collectivités locales sont aujourd’hui
largement enchevêtrées. Dès lors, dans un tel contexte, pour déterminer le niveau de
collectivité le plus à même d’assurer une compétence, il aurait été utile de prévoir la
possibilité d’expérimentations dans des cadres territoriaux différents. S’il est indéniable
qu’une telle possibilité compliquerait les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation,
cela conduirait réellement à déterminer quel est le niveau de collectivité le plus à même
d’assurer la compétence. Il y aurait une pleine application du principe de subsidiarité. Les
158 CHARENTENAY Simon (de), op. cit. 159 PIRON Michel, Rapport n°955, op . cit., p.27.
63
textes relatifs à l’expérimentation n’ont pas été aussi loin puisque c’est l’État qui détermine à
l’avance quel sera le niveau de collectivité qui participera à l’expérimentation. Il y a une
décision unilatérale préalable des services centraux qui décident quelle collectivité participera
à l’expérimentation. L’application du principe de subsidiarité est limitée, d’autant plus que le
juge constitutionnel ne sanctionnera qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Le principe
de subsidiarité apparaît alors ici non pas au service des collectivités territoriales mais
instrumentalisé par l’État.
Cependant de telles modalités d’organisation ont été prévues pour certains transferts de
compétences prévus par la loi du 13 août 2004, notamment dans le cas du transfert des
aérodromes civils appartenant à l’État. Cet exemple est d’autant plus intéressant qu’il
ressemble à une expérimentation – et à d’ailleurs été qualifié d’expérimentation par certains
auteurs – mais ne remplit pas l’ensemble des conditions pour en être réellement une. L’article
28 de la loi prévoit le transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des
aérodromes civils appartenant à l’État, se situant dans leur ressort géographique. Ce transfert
devait être définitif au plus tard le 1er janvier 2007. Cependant, la loi autorisait les
collectivités qui le souhaitaient à assurer la gestion de ces équipements avant la date du
transfert définitif, « à titre expérimental ». Si cette disposition autorise un transfert
expérimental de la compétence, il ne semble pas pour autant qu’elle puissent être réellement
qualifiée d’expérimentation, telle qu’elle a été définie précédemment. D’une part, cette
disposition ne prévoit pas d’évaluation de l’expérimentation et, d’autre part, la généralisation
définitive du dispositif est prévue d’avance dans la même loi. L’intérêt en matière de
subsidiarité est toutefois que l’État n’a pas prévu à l’avance le niveau de collectivité auquel
sera transféré la compétence, même si une priorité est accordée à la région. C’est un principe
de subsidiarité à la carte qui se met place. L’importance des aérodromes transférés peut varier
et chaque transfert est dans une situation différente. Dès lors, si dans un cas une commune ou
un établissement public de coopération intercommunale peut tout à fait gérer cette nouvelle
compétence, dans un autre cas, c’est peut-être la région ou le département qui serait le plus à
même de gérer cette infrastructure. Le principe de subsidiarité est ici appliqué de façon très
efficiente. Dans chaque cas particulier, c’est le niveau de collectivité territoriale le plus à
même d’exercer la compétence qui gérera l’aérodrome. Malgré la priorité de la région pour
ces transferts, sur les 150 aérodromes concernés par la disposition, seuls 19 ont été transférés
64
à des régions160. L’intérêt est que « la loi ne considère donc pas a priori une collectivité
territoriale comme pertinente pour l’exercice d’une compétence ».161 Le principe de
subsidiarité peut alors être pleinement effectif.
Rien n’empêche de prévoir des expérimentations, notamment des expérimentations
transferts, à destination de différents niveaux de collectivités territoriales. D’ailleurs, c’est ce
qui a été fait, mais de façon timide pour le transfert, à titre expérimental des crédits
d’entretien et de restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés n’appartenant
pas à l’État (art. 99 de la loi du 13 août 2004). Cette expérimentation concernait les régions,
ou à défaut les départements. Il y a deux niveaux de collectivité différents qui peuvent
participer à l’expérimentation. Le principe de subsidiarité est alors réellement mis en œuvre.
Ces éléments du patrimoine culturel, en fonction de leur taille mais aussi de leur situation
géographique ou de leur intérêt, peuvent être gérés par des niveaux de collectivités
différentes. L’expérimentation transfert est un moyen juridique de mettre en œuvre le principe
de subsidiarité dans ce cas.
Si différentes collectivités proposaient de gérer cette compétence, la loi a prévu, en
matière d’aérodrome comme en matière de patrimoine culturel, l’intervention du préfet.
Celui-ci doit organiser une concertation entre les collectivités candidates afin de déterminer
laquelle exercera la compétence. Une concurrence se créée entre les collectivités durant cette
concertation, avec comme objectif de déterminer le niveau le plus à même de recevoir le
transfert de la compétence. Les collectivités candidates exposent leurs arguments démontrant
qu’elles sont l’échelon le plus adapté à l’exercice de la compétence. Cet arbitrage par le préfet
est le moyen de déterminer le niveau de collectivité le plus compétent. C’est donc un moyen
de mettre en œuvre le principe de subsidiarité.
Subsidiarité et expérimentation sont donc deux notions complémentaires. Leur
inscription dans deux alinéas successifs d’un même article de la Constitution plaide en ce
sens. La conciliation entre ces deux principes constitutionnels ne pose pas de difficultés. Il
n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de confronter l’expérimentation au principe
constitutionnel d’égalité.
160 Ces chiffres proviennent de : MAMONTOFF Catherine, « Le transfert de compétences en matière aéroportuaire », AJDA, 2007, p.2078. 161 MARCOU Gérard, « Le bilan en demi-teinte de l’Acte II. Décentraliser plus ou décentraliser mieux ? » op. cit., p.305.
65
Section 2. La mise en cause apparente du principe d’égalité
L’expérimentation entre en confrontation directe avec le principe constitutionnel
d’égalité. C’est un principe très important. Il a une longue histoire, puisque son fondement est
à chercher dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette histoire a
marqué ce principe « à tel point qu’il apparaît aujourd’hui comme un dogme
incontournable ».162 Il est très fréquent que les saisines du juge constitutionnel ou du juge
administratif invoquent ce principe. L’égalité « constitue ainsi un principe transversal qui
gouverne toute l’action publique ».163
Les juges ont développé une importante jurisprudence relative au principe d’égalité.
Dépassant la lettre des textes constitutionnels, ils ont admis des atteintes au principe. Ces
atteintes sont strictement encadrées. Dès lors, le cadre juridique de l’expérimentation permet
de limiter l’atteinte à l’égalité. Si le juge a une vision souple du principe d’égalité, les
parlementaires ne la partagent pas. Les seules possibilités d’issue de l’expérimentation,
abandon ou généralisation, le prouvent. Cette alternative démontre l’attachement de nos
représentants à une égalité conçue formellement. Il est temps d’en finir avec le dogme, de
certains de nos élus, qui assimile égalité et uniformité. « À la complexité affectant
respectivement l’expérimentation et le principe d’égalité s’ajoute le caractère ambivalent des
relations que l’une et l’autre entretiennent ensemble ».164
L’expérimentation ne porte pas une atteinte aussi importante qu’on pourrait le croire au
principe d’égalité. Cette atteinte est limitée et justifiée (§1), ce qui permet au juge
constitutionnel de ne pas censurer l’expérimentation. Toutefois, les textes, constitutionnel et
organique, relatifs à l’expérimentation traduisent la persistance d’une conception formelle de
l’égalité (§2).
§1. Une atteinte limitée et justifiée au principe d’égalité
Le principe d’égalité est inscrit dans notre norme fondamentale en divers endroits. La
récurrence du terme d’égalité, et de ses subsides, dans le bloc de constitutionnalité conduit à
162 LONG Martine, « Faut-il maintenir le principe d’égalité ? », in Egalité et services publics territoriaux, Dir. Martine Long, Paris, LGDJ, 2005, p.13. 163 FAURE Bertrand, « Les relations paradoxale de l’expérimentation et du principe d’égalité », RFDA, 2004, p.1150. 164 DENAJA Sébastien, op. cit., p.466.
66
en faire l’un des principes centraux. L’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous ». Cette conception de la loi,
héritée de la Révolution, a pendant longtemps été un obstacle à l’adoption de lois
expérimentales. Il a fallu une profonde mutation de la perception de la loi pour autoriser le
recours à l’expérimentation normative. « L’assimilation de la loi à l’intérêt général et la
correspondance de celui-ci à l’unité du peuple interdisaient que la loi ne fût pas d’application
universelle et immédiate ».165 La profonde mutation de l’État et de son droit, exposée
précédemment166, explique le passage d’une conception formelle à une conception réaliste du
principe d’égalité.
Si l’expérimentation porte une atteinte indéniable au principe d’égalité (A), cette
atteinte est admise à certaines conditions (B).
A. La remise en cause du principe d’égalité par l’expérimentation
L’expérimentation créée des disparités de droits applicables sur le territoire durant un
laps de temps défini. Elle est donc en contradiction avec le principe d’égalité. Durant
l’expérimentation, la loi ne sera pas la même pour tous puisque certaines collectivités sont
admises à déroger à la loi. « Toute procédure expérimentale ou dérogatoire pose par
définition un problème de compatibilité avec le principe d’égalité des citoyens devant la
loi ».167 Il existe « une profonde contrariété entre le principe d’égalité et la nature de la
démarche expérimentale en raison de ce qu’elle est essentiellement regardée comme un
procédé dérogatoire ».168 L’expérimentation et la principe d’égalité sont en contradiction
l’une avec l’autre. L’expérimentation suppose une rupture de l’égalité puisque deux droits
différents s’appliquent sur le territoire. Durant l’expérimentation, certaines collectivités
appliquent le droit commun, tandis que d’autres peuvent y apporter des dérogations. L’égalité
est remise en cause, tous les citoyens ne sont pas soumis au même droit.
L’expérimentation induit qu’une dérogation au principe d’égalité soit admise. Cette
dérogation est encadrée et admise par la jurisprudence, tant constitutionnelle169
165 Conseil d'État, Rapport Public 1996, « Sur le principe d’égalité », EDCE, 1996, p.51. 166 Cf. supra p.21. 167 Conseil d'État, Rapport public 1996, op. cit., p.51. 168 DENAJA Sébastien, op. cit., p.468. 169 V. par ex. Conseil Constitutionnel, n°79-107DC du 12 juillet 1979, loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, JORF, 13 juillet 1979.
67
qu’administrative.170 Le travail des juges est central. La constitutionnalisation du droit à
l’expérimentation en a fait un droit de même rang que le principe d’égalité. Le juge doit
concilier ces deux dispositions qui apparaissent antinomiques mais qui sont contenues dans le
même texte. Le juge a pour cela développé une conception souple du principe d’égalité, qui
lui permet d’y apporter des dérogations.
Le juge ne s’en tient pas à une lecture formelle du principe d’égalité. Il existe des
différences de situations qui peuvent conduire à des discriminations si elles sont traitées de la
même façon. Il est donc possible, pour le législateur et l’administration, de traiter de façon
différente des citoyens qui sont dans des situations différentes. « Si le principe d'égalité
devant la loi implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions
semblables, il n'en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l'objet de
solutions différentes ».171 Le juge a dégagé une conception réaliste du principe d’égalité. La
vision purement égalitariste qui prévalait sous la Révolution a été abandonnée. En effet,
l’objectif des révolutionnaires de 1789 était d’abolir le système d’ordres et les privilèges qui
l’accompagnait. Dès lors, la loi devait être la même pour tous et s’appliquer indifféremment à
tous les citoyens. Ce dogme révolutionnaire a traversé les époques et, aujourd’hui, « le sacro-
saint principe d’égalité est encore souvent conçu comme requérant une application uniforme
de la loi ».172 Le risque de cette conception est que la recherche d’une égalité formelle peut
conduire à créer des discriminations. C’est pourquoi le juge a développé une jurisprudence
plus souple sur le principe d’égalité. Le juge autorise des dérogations au principe d’égalité.
B. La justification des atteintes au principe d’égalité
Ces dérogations ne sont admises qu’à certaines conditions. La jurisprudence a mis à jour
deux cas de figure où il est possible de déroger au principe d’égalité : soit lorsque la
différenciation est commandée par l’intérêt général, soit lorsque les destinataires de la règle
sont dans une situation objectivement différente. L’expérimentation, pour pouvoir être
conciliée avec le principe d’égalité, doit rentrer dans l’un de ces deux cas de figure. L’atteinte
au principe d’égalité est admise, durant l’expérimentation, puisqu’elle répond à une nécessité
de l’intérêt général. L’objectif de l’expérimentation est de tester sur une petite échelle une
170 V. par ex. Conseil d'État, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec.274. 171 Conseil Constitutionnel, n°79-107DC, op. cit. 172 MÉHAIGNERIE Pierre, op. cit., p.114.
68
nouvelle norme afin d’éprouver son efficacité avant de la généraliser. L’expérimentation est
un moyen d’adopter une règle générale qui sera la plus à même de répondre aux attentes
sociales. L’atteinte au principe d’égalité est justifiée par la recherche de l’efficacité grâce à
l’expérimentation. « La mise en place d’une expérience s’analyse ainsi comme l’objectif
d’intérêt général qui justifie que l’on puisse déroger à l’égalité abstraite au même titre que
n’importe quelle autre politique publique ».173 La constitutionnalisation du droit à
l’expérimentation est même un pas supplémentaire puisqu’elle fait basculer la charge de la
preuve. En effet, en principe l’État, s’il y a un contentieux, doit démontrer devant le juge qu’il
existe un motif d’intérêt général qui justifie la rupture de l’égalité. Désormais au contraire,
l’intérêt général de l’expérimentation est présupposé. « La constitutionnalisation de
l’expérimentation induit que celle-ci bénéficie d’une présomption de régularité par rapport
au principe d’égalité et qu’à ce titre l’expérimentation permet régulièrement de s’affranchir
de l’obligation de traiter de façon semblable des situations pourtant analogues ».174
L’atteinte au principe d’égalité par l’expérimentation est constitutionnelle. Lors de la
présentation du projet de loi constitutionnelle, le Conseil d'État avait émis un avis négatif. Il
aurait souhaité que les dispositions relatives à l’expérimentation indiquent expressément qu’il
y avait une dérogation au principe d’égalité.
Au niveau local, les décideurs ont compris cette nécessité de rompre l’égalité durant une
période déterminée pour expérimenter. Les autorités locales semblent être moins attachées à
une vision ferme du principe d’égalité. « On est là pour expérimenter quelque chose qui va
permettre d’améliorer le dispositif dans son ensemble, et c’est l’intérêt général qui va être
servi au bout du compte ».175 Cette rupture momentanée de l’égalité est même vécue comme
« une espèce de mal nécessaire ».176 Il ressort même de l’exemple héraultais que ce ne sont
pas les administrés qui sont le plus choqués par cette atteinte au principe d’égalité. Dans le
cadre de l’expérimentation relative au RSA, ce ne sont pas les bénéficiaires de cette aide qui
se sont sentis discriminés par rapport aux bénéficiaires du RMI. Ce sont, au contraire, les
travailleurs sociaux qui n’étaient pas toujours prêts à cette rupture d’égalité. Les
fonctionnaires, qu’ils soient nationaux ou territoriaux, restent très attachés au dogme de la loi
porteuse de l’égalité. Dans le cadre de l’expérimentation, ces administrateurs pouvaient être
173 FAURE Bertrand, « Les expérimentations et le principe d’égalité », in Egalité et services publics territoriaux, Dir. Martine Long, Paris LGDJ, 2005, p.44. 174 DENAJA Sébastien, op. cit., p.485-486. 175 Annexe : Entretien Mme Vaugelade p.139 176 Ibid, p.138.
69
amenés à rencontrer des personnes, dont les situations ne différaient que de peu, mais qui ne
bénéficiaient pas de la même aide. Ils pouvaient être décontenancés face à cela. Pour que le
recours à l’expérimentation soit une réussite, il faut nécessairement former le personnel
administratif qui participe au quotidien à cette expérimentation. Les administrateurs doivent
abandonner le dogme de l’égalité conçue formellement et admettre que la discrimination,
induite par l’expérimentation, sert l’intérêt général. L’une des conditions de la réussite de
l’expérimentation est la formation des acteurs, locaux et nationaux, afin de les habituer à ce
nouveau mode d’action publique. D’ailleurs, l’expérimentation a pour but de rechercher le
dispositif normatif qui soit le plus efficace possible lors de sa généralisation.
L’expérimentation, même si elle ouvre un brèche temporaire dans le principe d’égalité, est au
service des citoyens. Le bénéfice de l’expérimentation rejaillira sur les destinataires de la
norme, puisque la règle généralisée à la fin sera la plus efficace et la plus à même de restaurer
une véritable égalité entre les citoyens. « Au-delà des considérations tirées de l’intérêt
général, en tant que l’expérimentation est censée renforcer l’efficacité et la qualité du droit, il
est permis de considérer que, dans certains cas, le recours à l’expérimentation peut même
aller jusqu’à constituer un instrument de recherche d’une plus grande égalité entre les
citoyens ».177
L’atteinte au principe d’égalité est d’autant plus circonscrite lors de l’expérimentation
que celle-ci est limitée dans le temps. L’objectif de l’expérimentation n’est pas de créer un
droit à la différenciation permanant. L’expérimentation peut au maximum durer huit ans, à
savoir cinq ans sur une première expérimentation puis trois ans supplémentaires en cas de
prolongation ou de modification de l’expérimentation. L’expérimentation ne peut aller au-
delà de ce cadre temporel. « L’expérimentation dérogatoire n’est pas destinée à être
pérenne ».178 L’objectif de l’expérimentation est de tester une nouvelle réforme, elle précède
un changement. Au contraire, la différenciation consiste à créer un droit dérogatoire
permanant pour certaines collectivités territoriales ou au bénéfice de certains citoyens. La
différenciation créée une exception durable – traduite par l’adoption d’un statut particulier en
matière de collectivité territoriale – alors que l’expérimentation permet de tester sur un
échantillon sélectionné une nouvelle norme avant de la généraliser.
La rédaction de la loi organique relative à l’expérimentation, et notamment l’issue
177 DENAJA Sébastien, op. cit., p.486. 178 DRAGO Guillaume, « Le droit à l’expérimentation », in La République décentralisée, op. cit., p.82.
70
prévue pour l’expérimentation, porte cependant la marque d’une crainte. Il semble que les
Parlementaires ont été effrayés par une remise en cause profonde du principe d’égalité.
Rejailli alors de façon éclatante une conception formelle de l’égalité. « En somme, la
consécration constitutionnelle de l’expérimentation ainsi que les lois qui l’ont accompagnée
ont marqué le passage d’une jurisprudence conciliante avec un principe d’égalité
relativement souple, vers une égalité qui renoue avec la conception très formelle de la
règle ».179
§2. L’attachement critiquable à l’égalité formelle
L’expérimentation doit nécessairement aboutir au retour de l’application d’une même
règle sur tout le territoire. L’expérimentation n’ouvre nullement un droit à la différenciation
entre collectivités locales. Le principe d’égalité demeure un point de mire qu’il faut atteindre.
L’issue de l’expérimentation suppose une application uniforme de la règle de droit (A). Le
problème est que « égalité ne veut pas dire uniformité ».180 Le constituant et le législateur
organique disposaient de moyen d’accorder une certaine diversité, sans pour autant remettre
en cause radicalement le principe d’égalité (B).
A. Le nécessaire retour à l’égalité
L’article LO 1113-6 du Code général des collectivités territoriales prévoit, en dehors du
cas de la prolongation, une unique alternative comme issue de l’expérimentation. La mesure
doit nécessairement être généralisée ou abandonnée. L’expérimentation suppose dès le départ
le retour à une même règle applicable sur tout le territoire. « Il est impératif d’unifier le droit
après expérience, soit en généralisant la norme expérimentale, soit en l’abandonnant pour
maintenir la norme ancienne ».181 C'est-à-dire que l’expérimentation ne conduit pas à un droit
à la différenciation, mais demeure un outil juridique au service de la réforme de l’État. « Il
s’agit désormais moins de retranscrire dans le droit les disparités locales que d’utiliser les
collectivités au perfectionnement de la législation générale ».182 Cela renvoie à la réflexion
179 CHARENTENAY Simon (de), op.cit. 180 MÉHAIGNERIE Pierre, op. cit., p.114. 181 FAURE Bertrand, « Les relations paradoxales de l’expérimentation et du principe d’égalité », op. cit., p.1153. 182 FAURE Bertrand, « Les expérimentations et le principe d’égalité », in Egalité et services publics territoriaux, op. cit., p.45.
71
sur l’objectif du recours à l’expérimentation183. Est-ce que l’État cherche vraiment à
promouvoir les collectivités territoriales comme un lieu d’innovation ou est-ce que l’État ne
se sert pas des collectivités locales dans son propre intérêt ?
Le problème de cette alternative, généralisation ou abandon, c’est qu’elle s’intéresse
moins aux conditions de possibilité d’une norme qu’à son application de manière identique
sur tout le territoire. En effet, une règle expérimentale, qui est efficace dans une collectivité
locale donnée, n’est pas forcément la réponse adaptée pour l’ensemble du territoire de la
République. Le statut juridique de l’expérimentation ne tient pas compte de cette possibilité.
L’expérimentation ne doit rester qu’une parenthèse et le retour à la même norme applicable
sur l’ensemble du territoire le principe. Alors que des solutions identiques peuvent avoir des
effets différents en fonction des collectivités territoriales où elles sont appliquées,
l’expérimentation normative ne peut nullement conduire à une territorialisation du droit.
« Qu’à l’issue de l’expérience des résultats contrastés se révèlent et il sera impossible de s’en
prévaloir pour adopter des mesures différenciées ». 184 L’expérimentation demeure une
méthode de test d’une nouvelle norme et n’ouvre pas le droit à une différenciation.
Il semble que cet attachement à une vision formelle du principe d’égalité est le fait de
nos représentants. En effet, juridiquement rien ne s’opposait à ce que des différences puissent
être faites entre collectivités locales à l’issue de l’expérimentation. Les parlementaires ont
craint un éclatement des règles juridiques applicables sur le territoire. Ils ont eu peur de la
création d’un patchwork de droits en vigueur. « Le risque contre lequel les parlementaires
entendaient se prémunir était celui de l’éclatement de la règle au niveau territorial ».185
Derrière cet attachement au principe d’égalité, c’est la volonté de protéger l’indivisibilité de la
République qui se fait jour.
Le principe d’indivisibilité de la République, rappelé à l’article 1er de la Constitution,
peut se décomposer en trois éléments : l’indivisibilité de la souveraineté, l’indivisibilité du
territoire et l’indivisibilité du peuple. Si l’indivisibilité de la souveraineté, dans son aspect
souveraineté interne, suppose que le pouvoir d’adoption des lois soit centralisé, rien dans le
principe d’indivisibilité de la République n’interdit que des dispositions différentes
s’appliquent pour un même niveau de collectivité locale. D’ailleurs, certains territoires de la
République appliquent des normes différentes, sans que l’indivisibilité de la République soit 183 Cf. supra p.32 et s. 184 FAURE Bertrand, « Les expérimentations et le principe d’égalité », in Egalité et services publics territoriaux, op. cit., p.45. 185 Ibid, p.46.
72
remise en cause et sans que le principe d’égalité ne soit violé. C’est, par exemple, le cas de
l’Alsace et de la Moselle qui ne connaissent pas la séparation de l’Eglise et de l’État puisque
la loi de 1905 ne s’y applique pas186. C’est aussi le cas dans la région Île-de-France où un
régime spécifique de péréquation entre les collectivités a été mis en place187. C’est enfin le cas
de la Corse, qui en plus d’être une collectivité à statut particulier, bénéficie de certaines
dérogations, notamment en matière de droit de succession188. Il existe déjà de nombreux
régimes juridiques spécifiques ou dérogatoires sur l’ensemble du territoire de la République.
Ni les élus, ni la jurisprudence n’ont jusqu’ici remis en cause ces statuts. Dès lors, il est
étrange que, dans le cadre de l’expérimentation, les parlementaires aient voulu à ce point
protéger le principe d’égalité. « Ce que les réformateurs ont pu ressentir comme une atteinte
au principe d’égalité ne procède finalement que de l’attachement à une manifestation
formelle de ce principe ».189
L’égalité est certes un principe constitutionnel central de notre système, mais
l’expérimentation n’aurait pas dû se conjuguer avec un principe conçu formellement.
B. Des alternatives inexplorées
Tous les représentants ne sont pas autant attachés au principe d’égalité, et même
certains, tel Pierre Méhaignerie190, sont prêts à aller plus loin dans la voie de
l’expérimentation et de la différenciation. Celui-ci aurait « souhaité que la réforme aille plus
loin, et qu’une expérimentation, si elle a fait ses preuves dans un territoire donné, ne soit pas
obligatoirement généralisée mais puisse s’adapter à la spécificité du cadre territorial ».191 Il
paraît compliqué d’abandonner une expérimentation, alors même que, dans certaines
collectivités les résultats seraient positifs. Une expérimentation peut très bien se révéler avoir
été efficace sur un échantillon donné mais ne pas pouvoir être généralisée. Dans un tel cas,
186 V. par ex. : BERGUIN Francis, « De la porté du droit local alsacien et mosellan sur le service public de l’éducation nationale », AJFP, n°6, 2001, p.9-18. 187 V. par ex. : QUEROL Francis, « La solidarité financière entre collectivités territoriales, la nouvelle donne », JCP-G, n°3, 1993, p.33-38 ; ou plus récemment « Fonds de solidarité entre les communes de la région Île-de-France », Revue Lamy des collectivités territoriales, n°24, 2007, p.15. 188 V. par ex. : « Le régime discriminatoire en matière de successions entre la Corse et le continent n’est pas contraire au principe constitutionnel d’égalité », Droit Fiscal, n°47, 2006, p.2023-2024. 189 FAURE Bertrand, « Les relations paradoxales de l’expérimentation et du principe d’égalité », op. cit., p.1154. 190 Avant la révision de 2003, Pierre Méhaignerie avait déjà déposé une proposition de loi constitutionnelle reconnaissant un droit à l’expérimentation pour les collectivités locales, Assemblée nationale, proposition n°2278, 24 mars 2000. 191 MÉHAIGNERIE Pierre, op. cit., p.114.
73
l’abandon de l’expérimentation et le retour à l’application de la norme ancienne serait
assurément mal vécu par la collectivité en cause. Le constituant et le législateur disposent de
certains outils qui permettent de ne pas faire fi de ces spécificités locales, tout en maintenant
le principe d’indivisibilité de la République.
Deux possibilités s’offrent au législateur pour tenir compte de ces différences entre
collectivités locales : soit accorder la compétence au pouvoir réglementaire local, soit créer
une collectivité à statut particulier.
Le premier cas apparaît comme le plus simple. Il s’agirait pour le législateur de donner
la compétence de mise en œuvre des dispositions en cause au pouvoir réglementaire local. Ce
pouvoir réglementaire existe et est reconnu par la jurisprudence depuis longtemps, il a même
été constitutionnalisé lors de la révision de 2003, à l’article 72, alinéa 3, de la Constitution.
Dans un tel système, les collectivités territoriales qui auront expérimenté pourront continuer à
appliquer les normes adoptées durant l’expérimentation mais de façon pérenne. Les autres
collectivités territoriales auraient, quant à elles, le choix de continuer d’appliquer la loi telle
qu’auparavant, d’adopter les mesures expérimentées ou encore de développer leurs propres
solutions. Le recours au pouvoir réglementaire local a un double avantage. D’une part,
l’atteinte au principe d’égalité et à l’indivisibilité de la République demeure limitée. La loi
reste la source unique et centralisée de la norme, tandis que les collectivités territoriales
n’interviennent que pour sa mise en œuvre. D’autre part, le recours au pouvoir réglementaire
local constitue un moyen de développer l’autonomie des collectivités territoriales. Il s’agit de
donner un plein effet aux dispositions de l’article 72, alinéa 3.
La seconde possibilité d’issue différenciée de l’expérimentation est le recours à des
statuts particuliers. L’article 72, alinéa 1er, autorise la loi à créer des collectivités avec de tels
statuts. L’objectif d’une telle mesure serait de faire des collectivités expérimentatrices, où
l’expérimentation a réussi, des collectivités à statut particulier. Ce statut, dérogatoire au droit
commun, autoriserait la collectivité en question à gérer de façon définitive la compétence qui
avait été expérimentée. C’est la situation spécifique de cette collectivité vis-à-vis de cette
compétence qui serait le fondement de la création d’une collectivité à statut particulier. Rien
n’interdit au législateur, pas même la Constitution, de créer une nouvelle catégorie de
collectivité « même ne comprenant qu’une unité ».192 Cette seconde méthode est cependant
plus risquée. C’est ici que réside le véritable danger d’un patchwork institutionnel. Il y a le
192 Conseil Constitutionnel, n°91-290DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, JORF, 14 mai 1991, p.6350.
74
risque de créer des collectivités à statut particulier pour l’exercice d’une ou deux compétences
seulement. Ces collectivités bénéficieraient alors d’un statut dérogatoire, alors même que
leurs compétences ne varieraient que très peu par rapport aux autres collectivités de même
niveau. De plus, l’organisation institutionnelle resterait la même dans ces collectivités à statut
particulier. Loin de faciliter la lecture de notre grille administrative, un tel système
participerait au contraire à l’éclatement de notre paysage institutionnel. La remise en cause du
mille feuilles administratif étant à l’ordre du jour, il semble que la création de collectivités à
statut particulier, suite à une expérimentation, ne soit pas la meilleure solution à retenir.
Il existe des solutions pour sortir de la seule alternative, généralisation ou abandon de
l’expérimentation, mais le constituant et le législateur organique n’ont pas admis de telles
solutions. Ils sont restés attachés au « mythe fondateur »193 de l’égalité. Sans aller jusqu’à une
véritable territorialisation du droit, notamment en adoptant des statuts particuliers,
l’expérimentation aurait pu être un outil de promotion de l’autonomie locale et du pouvoir
réglementaire local. Au lieu de cela, l’expérimentation est restée un outil au service de l’État.
L’expérimentation normative illustre l’évolution de la production normative. Une
nouvelle conception de la règle de droit fait son apparition. Reste à savoir si les effets de cette
méthode ont été ceux attendus.
193 LONG Martine, « Faut-il maintenir le principe d’égalité ? », in Egalité et services publics territoriaux, op. cit., p.15.
76
L’objectif de l’expérimentation est de tester à une petite échelle une norme, puis de
procéder à l’évaluation de ce test, pour décider ensuite de la généralisation ou de l’abandon du
dispositif. Les effets attendus de l’expérimentation sont donc clairs, une amélioration de la
norme.
L’expérimentation normative, transposition d’une méthode issue des sciences dures
aux sciences sociales, et plus particulièrement au droit, est soumise à un risque : la
subjectivité de l’évaluateur. L’expérimentation dans les sciences dures répond à des
protocoles précis et détaillés. L’expérimentateur, entièrement soumis au doute, doit mettre de
côté les idées préconçues qu’il peut avoir sur son expérimentation pour en évaluer de la façon
la plus objective possible les résultats. Au contraire, en matière de sciences sociales beaucoup
d’éléments de l’expérimentation sont soumis à la subjectivité de l’expérimentateur, le
Législateur ou le Gouvernement dans le cadre de l’expérimentation normative. Ainsi, le choix
de l’échantillon participant à l’expérimentation et son évaluation sont confrontés à la liberté
de l’expérimentateur. Ce risque, que l’expérimentateur laisse une trop grande place à sa
propre subjectivité dans l’expérimentation, doit être pris en compte. Il faut relativiser le
caractère scientifique du recours à l’expérimentation dans l’activité normative. L’objectif
n’est pas de considérer l’expérimentation normative comme inutile ou comme une méthode à
laquelle il ne faudrait pas recourir. L’objectif est de reconsidérer l’expérimentation normative.
En effet, les exemples d’expérimentations menés depuis 2003 invitent à la prudence. Dans un
certain nombre de cas, l’expérimentation semble être conduite non pas dans un objectif
d’amélioration de la norme, mais elle sert, alors, la communication du Gouvernement.
D’ailleurs les exemples étrangers abondent en ce sens.
Autre effet induit par l’expérimentation, comme par toute activité juridique, le risque
d’un contentieux. L’expérimentation normative peut aboutir à la naissance de différents
contentieux, tout d’abord devant le juge constitutionnel et ensuite devant le juge administratif.
Force est de constater que les textes constitutionnels et organiques relatifs à l’expérimentation
n’ont pas précisés de façon détaillée le contenu des contrôles opérés par ces juges. De plus, en
l’absence d’un contentieux qui serait abondant sur cette question, les contentieux produits par
l’expérimentation ne peuvent faire l’objet, pour l’instant, que d’observations prospectives.
Les Sages de la rue Montpensier n’ont connu qu’une seule fois des dispositions portant
77
expérimentation. Le contrôle qu’ils ont alors effectué n’était pas une totale nouveauté mais
certains éléments semblent avoir été ignorés. Le contentieux administratif que produira
l’expérimentation, notamment à l’égard des actes dérogatoires adoptés par les collectivités
locales, peut cependant être rapproché de certains éléments déjà connus de la jurisprudence du
Conseil d'État. Les actes dérogatoires ont pour caractéristiques de découpler le contenu de la
forme de l’acte. Dès lors, le juge administratif devra nécessairement adapter son contrôle à
ces actes hybrides.
Parmi les effets attendus de l’expérimentation, l’amélioration de la norme reste un
objectif douteux (Chapitre 1). Parmi les effets secondaires de toute activité juridique, le risque
de contentieux relatif à l’expérimentation est important (Chapitre 2).
78
Chapitre 1. Une efficacité incertaine
L’expérimentation juridique est inspirée de l’expérimentation dans les sciences
qualifiées de dures, telles que la médecine ou encore la physique. Présentée à la fin du XIXè
siècle, la théorisation de la méthode expérimentale par Claude Bernard a clairement exposé
les principes constitutifs de la médecine expérimentale. Trois étapes se dégagent dans la
méthode expérimentale. Tout d’abord, l’expérimentateur doit formuler une hypothèse. Il doit
ensuite tester cette hypothèse sur un échantillon. Enfin, il doit analyser les résultats, afin de
confirmer ou d’infirmer son hypothèse de départ.
Ces différentes étapes de la méthode expérimentale ont été transposées aux sciences
sociales, et notamment au droit. Tout comme le médecin, l’expérimentateur en matière
juridique doit formuler une hypothèse, qui sera contenue dans le texte prévoyant
l’expérimentation. Il doit ensuite tester cette hypothèse sur un échantillon déterminé. Enfin, il
doit évaluer son expérimentation afin d’en tirer des conclusions sur la généralisation ou non
du dispositif. « Ainsi, nous retrouvons bien dans l’utilisation des lois expérimentales, les trois
phases du processus expérimental tel qu’il est usité dans les sciences de la nature : la
construction d’une hypothèse à partir de l’observation des faits, celle-ci étant constituée de la
situation de fait observée et d’une proposition de solution ; la vérification de cette hypothèse
par l’introduction d’une variable dépendante et, enfin, l’analyse des résultats issus de
l’expérimentation ».194 Cependant l’expérimentation normative rencontre deux écueils que
l’expérimentation scientifique, elle, semble pouvoir éviter. Il s’agit d’un défaut de
systématicité des résultats et d’un important risque de subjectivité de l’expérimentateur. « La
question se pose de l’échantillon nécessaire à une évaluation pertinente ».195
Il convient dès lors d’étudier le fait que l’expérimentation normative connaît des
difficultés pour déterminer le juste échantillon pour son test (Section 1) et que son évaluation
est soumise à un important risque de subjectivité (Section 2).
194 PERROCHEAU Vanessa, « L’expérimentation, un nouveau mode de création législative », Revue française des affaires sociales, 2000, n°1, p.13. 195 LONG Martine, « Revenu de solidarité active : l’expérimentation », op. cit., p.1239.
79
Section 1. La difficulté pour déterminer un juste échantillon
L’expérimentation suppose qu’un échantillon soit déterminé. C’est sur cet échantillon
que sera testée la norme expérimentale et à partir duquel sera évaluée l’expérimentation afin
de procéder, ou non, à sa généralisation. L’échantillonnage implique que l’État fasse un
choix, c'est-à-dire qu’il doit désigner, dans le niveau de collectivité territoriale admis à
expérimenter, qui seront les collectivités expérimentatrices. La participation des collectivités à
l’expérimentation étant basée sur le volontariat de celles-ci, deux logiques contradictoires
s’affrontent, d’une part, l’exigence de limiter dans l’espace le test et, d’autre part, la
contrainte d’autoriser les collectivités candidates à expérimenter. C’est un difficile et délicat
équilibre que l’État doit ici trouver entre ces deux exigences.
Si l’échantillonnage est nécessaire dans la méthode expérimentale (§1), sa mise en
œuvre dans l’expérimentation normative est source de difficultés (§2).
§1. Nécessité et limite de l’échantillonnage
La notion même d’expérimentation suppose qu’un échantillon soit déterminé. C’est
sur un échantillon, et uniquement sur lui, que l’expérimentateur pourra tester son hypothèse.
Dans le cadre de l’expérimentation normative, cet échantillon correspond à une zone
géographique délimitée : une collectivité territoriale (A). Cet échantillon peut aussi
correspondre à un groupe de population spécifique ou à une catégorie d’usagers. Toutefois, en
l’absence d’expérimentation portant sur ce type d’échantillon, cette question ne sera pas
abordée. En matière de sciences sociales, l’expérimentateur n’a aucun contrôle sur un certain
nombre de facteurs qui peuvent remettre en cause la « scientificité » de la méthode (B).
A. L’échantillon géographique : la collectivité territoriale
L’expérimentation normative est inspirée par les sciences dures. Elle fonctionne sur un
schéma assez simple. L’expérimentateur doit déterminer un échantillon sur lequel il intervient
pour tester son hypothèse de départ. L’analyse des résultats obtenus sur l’échantillon permet
de vérifier cette hypothèse. Différents échantillons peuvent même être déterminés afin de
tester différentes hypothèses. Il est toutefois nécessaire de toujours conserver un échantillon
témoin ou échantillon neutre, c'est-à-dire un échantillon sur lequel l’expérimentateur n’agira
80
pas. L’objectif de cet échantillonnage est de pouvoir comparer les résultats obtenus. À travers
l’échantillonnage, l’expérimentation permet de déterminer si une nouvelle règle est efficace.
Le résultat de l’expérience sur l’échantillon permet de déterminer si la norme peut être
généralisée.
L’échantillon, pour l’expérimentation normative, est constitué par les collectivités
territoriales qui participent à l’expérimentation. La procédure même de l’expérimentation
induit cet échantillonnage, seules certaines collectivités doivent être autorisées à participer à
l’expérimentation. Cet échantillon de collectivités, admises à participer à l’expérimentation,
doit être déterminé soit par le Législateur, soit par le Gouvernement selon qu’il s’agit d’une
expérimentation législative ou d’une expérimentation réglementaire. L’article LO1113-1 du
CGCT dispose que « la loi précise également la nature juridique et les caractéristiques des
collectivités territoriales autorisées à participer à l’expérimentation ». C’est en déterminant
ces « caractéristiques » que l’État influe sur le nombre de collectivités territoriales qui
constitueront l’échantillon. Plus les caractéristiques déterminées dans le texte ouvrant
l’expérimentation seront précises et détaillées plus le nombre de collectivités candidates sera
restreint. Il faut alors veiller à déterminer un échantillon qui soit suffisamment représentatif et
qui permette de réellement prendre en compte les résultats de l’expérience. Le risque est que
l’expérimentateur développe une certaine subjectivité dans le choix de ces critères de
sélection. Des considérations personnelles de l’expérimentateur peuvent interférer dans la
détermination des caractéristiques des collectivités expérimentatrices. « Les préférences
territoriales ne peuvent manquer d’être influencées par des considérations tout à fait
subjectives et pour tout dire rigoureusement personnelles ».196 Ce risque ne semble pas
pouvoir être évité. Il ne condamne pas l’expérimentation, mais il appelle à une certaine
vigilance. Le caractère scientifique de l’expérimentation normative doit être relativisé.
Si l’État procède à une expérimentation sur l’ensemble du territoire, l’intérêt de la
méthode est moindre. « Par sa nature même, l’expérimentation concerne une zone
géographique définie ou une matière délimitée. En fait, elle correspond à la conjonction d’un
espace et d’une matière car elle est, par définition, partielle ».197 Il faut souligner la double
dimension des collectivités expérimentatrices. Celles-ci subissent l’expérimentation en même 196 BOULOUIS Jean, « Note sur l’utilisation de la « méthode expérimentale » en matière de réformes », in Mélanges offerts à Monsieur le doyen Louis Trotabas, op. cit., p.33. 197 DRAGO Rolland, « Le droit de l’expérimentation », in L’avenir du droit, Mélanges François Terré, Paris, Dalloz, 1999, p.231.
81
temps qu’elles agissent dessus. D’une part, les collectivités territoriales sont les cobayes de
l’expérimentation, puisque celle-ci se déroule sur leur territoire et ce sont les réactions de ces
collectivités face à la nouvelle norme qui seront analysées. D’autre part, les collectivités
territoriales sont aussi les expérimentateurs puisqu’elles vont prendre des mesures qui leur
seront propres pour vérifier leur efficacité, notamment dans le cadre de l’expérimentation
dérogation. Il existe une certaine « confusion […] entre les notions d’expérimentateur et
d’échantillon [qui] trouve une explication dans la nature même de l’échantillon ou du cobaye
en droit ».198 Dans le cadre de l’expérimentation normative, le cobaye ne fait pas que subir
l’expérience. Le cobaye ne reste pas passif face à l’expérimentation, au contraire, il y prend
part et y participe, devenant alors lui-même l’expérimentateur.
L’objectif de l’expérimentation est de tester une nouvelle norme avant de procéder à
sa généralisation. L’expérimentation a pour but d’éprouver l’efficacité d’une règle de droit.
Pour déterminer l’efficacité de la norme, il est nécessaire de l’appliquer dans un cadre
géographique réduit et non sur tout le territoire. En effet, si une réforme est immédiatement
appliquée partout, on pourra constater ses effets mais on ne pourra pas déterminer si elle est
une solution plus efficace par rapport à une autre, ou si elle est meilleure que la solution
précédente. Au contraire en testant seulement sur un échantillon donné, l’expérimentation
permet de comparer les résultats obtenus en différents endroits du territoire.
L’échantillonnage s’avère donc une nécessité pour qu’une expérimentation soit qualifiée
comme telle. L’expérimentation normative s’inscrit dans la filiation de l’expérimentation
scientifique. « L’expérimentation relève du domaine de la recherche, du tâtonnement. Elle est
toute entière placée sous le signe du doute puisqu’il s’agit d’établir la véracité ou
l’inexactitude d’une hypothèse issue de l’observation en la soumettant à l’épreuve des
faits ».199 La difficulté toutefois en matière d’expérimentation normative est de déterminer un
échantillon qui soit représentatif. L’objectif de l’expérimentation étant de tester une nouvelle
mesure avant de procéder à sa généralisation, il faut que les collectivités qui expérimentent
soit suffisamment représentatives de la diversité des situations du territoire national. La
détermination de l’échantillon fait alors entrer en jeu un nombre considérable de variables
humaines. Il faut prendre en compte la forte urbanisation ou au contraire le caractère rural des
collectivités expérimentatrices, il faut aussi prendre en compte la démographie de
l’échantillon. Toutes ces variables doivent être étudiées pour chaque collectivité candidate à
une expérimentation afin que l’échantillon soit le plus représentatif possible. Il existe autant
198 DENAJA Sébastien, op. cit., p.361. 199 PERROCHEAU Vanessa, op. cit., p.11.
82
d’échantillons possibles qu’il existe d’expérimentations. On ne peut pas prédéfinir de façon
abstraite l’échantillon. « Il peut en tout état de cause être affirmé que la représentativité de
l’échantillon expérimental doit être examinée au cas par cas et dépend de considérations,
somme toute, contingentes ».200
Dans le cadre de l’expérimentation relative au RSA, l’expérimentation induisait même
un double échantillonnage. En effet, à l’intérieur des départements admis à expérimenter,
ceux-ci pouvaient déterminer des cantons où l’expérimentation du RSA avait lieu et d’autres
où elle n’avait pas lieu. Ce système d’échantillonnage dans l’échantillon permet d’affiner
encore un peu plus les résultats de l’expérience. Au lieu de comparer les résultats de
l’expérimentation d’un département à l’autre, l’évaluation peut se faire en comparant des
territoires géographiquement et sociologiquement proches. L’objectif est de ne pas
expérimenter sur tout le département, mais sur des « territoires témoins, intéressants et
représentatifs ».201
À travers l’échantillonnage, l’expérimentation normative se présente comme une
méthode résolument scientifique. Toutefois dans la matière juridique, « il est impossible
d’atteindre la même rigueur scientifique compte tenu de l’objet de l’étude, les faits
sociaux ».202 L’expérimentateur et son expérience subissent des éléments extérieurs sur
lesquels ils n’ont aucune prise.
B. Des facteurs exogènes perturbateurs
L’expérimentation normative ne peut atteindre une parfaite rigueur scientifique,
puisque l’expérimentateur ne peut pas contrôler l’ensemble des éléments. Dans le cadre d’une
expérimentation scientifique, l’expérimentateur confiné dans son laboratoire peut intervenir à
sa guise et contrôler les facteurs externes à l’expérimentation. Dès lors qu’il aura maîtrisé ces
éléments et confirmé son hypothèse de départ, le scientifique pourra systématiser ses résultats.
Cette systématisation des résultats d’une expérience scientifique permet d’être, quasiment,
certain à l’avance des résultats d’une reproduction de l’expérience à plus grande échelle. Au
contraire pour l’expérimentation normative il existe des variables sur lesquelles
l’expérimentateur n’a aucune prise. « L’expérimentation normative ne peut pas en effet avoir
200 DENAJA Sébastien, op. cit., p.356. 201 Annexe : Entretien Mme Vaugelade p.136. 202 PERROCHEAU Vanessa, op. cit., p.13.
83
la même portée que l’expérimentation scientifique fondée sur des expériences reproductibles
indéfiniment, s’appuyant elles-mêmes sur des protocoles strictement définis et encadrés,
impliquant des conditions expérimentales parfaitement identiques écartant toute influence de
l’être humain ».203 L’expérimentation normative, en tant qu’elle est une science sociale, ne
peut prétendre au même degré d’exactitude.
Au-delà des différences qui existent d’un échantillon à l’autre, l’expérimentateur est
confronté à des facteurs humains, psychologiques et conjoncturels qui vont avoir des
incidences sur les résultats de l’expérimentation. Il est impossible de « rendre le champ
expérimental parfaitement étanche ou autonome ».204 Il est nécessaire que ces variables soient
prises en compte pour pondérer les résultats de l’expérimentation. L’association des citoyens
à l’expérimentation205, une mauvaise conjoncture économique ou une situation politiquement
instable sont autant de facteurs qui influencent sur la réussite de l’expérimentation.
L’expérimentateur n’a aucune prise sur ces facteurs, il ne peut ni les prévoir, ni les éviter et
encore moins les contrôler. L’analyse des résultats de l’expérimentation doit prendre en
compte ces variables afin d’essayer d’en déterminer l’incidence. La réussite de
l’expérimentation du RSA est peut-être en partie due à un contexte social, économique et
politique où la demande d’aide sociale se fait de plus en plus pressante.
Les sciences sociales, parmi lesquelles le droit, sont soumises à des facteurs exogènes
sur lesquels elles n’ont aucune emprise et qui les empêchent d’atteindre la même rationalité
que les sciences dures. « Il est assez connu que la plupart des sciences que l’on devrait bien
continuer d’appeler morales et politiques rencontrent dans l’expérimentation quelques graves
difficultés. Non seulement elles sont en général dans l’incapacité de disposer de ces
laboratoires faute desquels il n’y a pas de véritable science expérimentale mais elles se
heurtent en outre à la complexité des phénomènes qu’elles étudient, à leur mobilité, à leur
interdépendance dialectique qui rendent presque toujours approximative l’individualisation
de ces phénomènes et leur reconstruction provoquée, incertaine ».206
203 PISSALOUX Jean-Luc, op. cit., p.16. 204 BOULOUIS Jean, « Note sur l’utilisation de la « méthode expérimentale » en matière de réformes », in Mélanges offerts à Monsieur le doyen Louis Trotabas, op. cit., p.33. 205 D’ailleurs le doyen Boulouis soulignait à juste titre qu’une « expérience de ce genre ne réussit jamais mieux que lorsqu’elle est tentée dans un milieu déjà acquis à son principe et à l’essentiel de ses objectifs ». BOULOUIS Jean, « Note sur l’utilisation de la « méthode expérimentale » en matière de réformes », in Mélanges offerts à Monsieur le doyen Louis Trotabas, op. cit., p.33. 205 BOULOUIS Jean, « Note sur l’utilisation de la « méthode expérimentale » en matière de réformes », in Mélanges offerts à Monsieur le doyen Louis Trotabas, op. cit., p.33. 206 Ibid, p.32.
84
Les échantillons sont, de plus, très variables de l’un à l’autre, alors que dans les
sciences dures l’expérimentateur peut avoir recours à des échantillons parfaitement
identiques. En matière de sciences sociales au contraire, si l’échantillonnage se fait de façon à
ne sélectionner que des cobayes les plus ressemblants, on ne peut atteindre la même
représentativité que dans les sciences dures. Même si le principe d’égalité s’applique entre
collectivités territoriales, toutes ne sont pas égales à l’intérieur d’une même catégorie.
Certaines collectivités sont économiquement plus développées ou disposent de plus de
moyens humains. Ces facteurs ont une influence sur la réussite de l’expérimentation. Une
expérience menée dans une collectivité locale disposant de plus de moyens financiers,
matériels ou humains sera plus concluante que la même expérience menée dans une
collectivité moins bien dotée. « Il en est des collectivités comme des individus : il y a ceux qui
« font » et ceux qui « ne font pas ». La parabole des talents vaut pour les premières comme
pour les seconds ».207 De même, les politiques menées auparavant par la collectivité peuvent
influencer une expérimentation conduite dans un domaine similaire ou proche. En matière de
RSA, le succès de l’expérimentation tient aussi à la manière dont les départements géraient le
RMI auparavant. « Ça fait des années et des années qu’on travaille avec des entreprises,
qu’on les a aidées à se structurer, qu’on a aidé à avoir une plateforme qui les regroupe et
avoir un dialogue social et citoyen avec elles. Du coup, c’est un terroir ça. Donc quand une
loi arrive, forcément elle va être appliquée de façon différente ici [dans le Département de
l’Hérault] où on a déjà semé, d’un endroit où le Conseil Général s’est beaucoup plus orienté
sur une politique purement sociale et non pas d’insertion économique et qui n’a donc pas de
lien direct avec les entreprises ».208 L’expérience du Conseil Général de l’Hérault en matière
d’insertion a été un atout dans l’expérimentation du RSA. Tous les départements
expérimentateurs ne bénéficiaient pas forcément des mêmes relations avec le tissu socio-
économique. Ces différences de situation ont des incidences sur les résultats de
l’expérimentation. Il est nécessaire d’être conscient de ces différences afin d’en tenir compte
au moment de l’évaluation de l’expérimentation. « Il n’y a pas deux groupes, deux entités, par
exemple deux communes strictement identiques (par leur population, par leur histoire, leurs
atouts, etc.) : comment dès lors être certain – comme en science – qu’un résultat obtenu avec
telle collectivité locale sera obtenu avec telle autre ? ».209
207 PONTIER Jean-Marie, « Décentralisation et expérimentation », op. cit., p.1037. 208 Annexe : Entretien Mme Vaugelade p.139. 209 PISSALOUX Jean-Luc, op. cit., p.16.
85
L’intervention de ces facteurs exogènes et leurs incidences sur les résultats de
l’expérimentation doivent être prises en compte. Il est impossible d’ignorer cette nécessité de
pondérer les résultats. Ces éléments extérieurs qui influencent l’expérimentation ne peuvent
pas être contrôlés par l’expérimentateur. Celui-ci n’a aucun pouvoir sur eux. Il se doit alors
d’être conscient de leur existence et essayer de pondérer les résultats de son expérience en
fonction de l’importance qu’il estime devoir accorder à ces éléments. L’expérimentation
normative se trouve ici face à une limite qu’elle ne peut dépasser.
Il ne faut pas pour autant totalement remettre en cause le recours à la méthode
expérimentale en matière juridique. Il est simplement nécessaire de ne pas auréoler du sceau
de la science une norme juridique issue d’une expérimentation. Si la loi n’est plus
l’expression de la Raison, elle ne doit pas devenir l’objet d’une science exacte. La loi se doit
de ne pas être le fétiche d’un culte, encore moins d’un culte « scientifique ». Contrairement
aux sciences dures, les sciences sociales, et en particulier le droit, ne peuvent prétendre à
connaître des vérités absolues. Dès lors, l’expérimentation, malgré le fait qu’elle trouve son
origine dans les sciences dures, ne doit pas conférer une valeur absolue aux règles de droit qui
en sont issues. « L’expérimentation ne doit pas être utilisée comme un moyen de conférer un
« label scientifique » à une innovation ».210
Ces difficultés à trouver un juste équilibre dans l’échantillonnage de l’expérimentation
ne sont pas seulement des interrogations théoriques. Les expérimentations menées depuis la
révision constitutionnelle de 2003 montrent qu’il s’agit là d’une véritable difficulté.
§2. Une difficulté avérée dans les faits
La participation à l’expérimentation n’est pas obligatoire pour les collectivités
territoriales, elle se fait sur la base du volontariat. Dès lors, la réussite de l’expérimentation
dépend de l’intérêt que vont y porter les collectivités territoriales. L’échantillon de
collectivités sera plus ou moins important en fonction de la volonté des collectivités
territoriales de participer à l’expérimentation. Dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales211 deux expérimentations illustrent cette difficulté. Il s’agit, d’une
part, de l’expérimentation relative à la décentralisation de la gestion des fonds structurels
210 PERROCHEAU Vanessa, op. cit., p.27. 211 Loi n°2004-809 du 13 août 2004, op. cit.
86
européens (art. 44) et, d’autre part, de l’expérimentation relative à la conception des schémas
régionaux de développement économique (art. 1er, §II) (A). L’exemple de l’expérimentation
relative au RSA est également intéressant dans le cadre de cette étude (B).
A. Des échantillonnages variés : l’exemple des expérimentations transferts
Les deux exemples d’expérimentations issues de la loi du 13 août 2004 illustrent deux
situations extrêmes et opposées. Dans le cadre de l’expérimentation sur la gestion des fonds
structurels européens, une seule région s’est portée candidate, et expérimente encore
aujourd’hui, l’Alsace. Au contraire, avant même la fin de l’expérimentation, toutes les régions
s’étaient dotées d’un schéma régional de développement économique.
Une expérimentation menée dans une seule collectivité territoriale peut-elle être
pertinente ? Il semble que la réponse doit être négative. D’ailleurs, le dispositif de gestion
décentralisé des fonds européens n’a pas été généralisé. Dans le cadre des nouveaux plans de
la politique économique Européenne pour la période 2007-2013, l’État français a de nouveau
proposé aux régions qui le souhaitaient de gérer à titre expérimental les fonds structurels. Il
faut cependant remarquer que cette proposition n’a eu aucun succès. La frilosité des
collectivités à s’engager dans cette expérimentation vient peut-être du fait que « l’État semble
encore le gestionnaire le plus impartial et le mieux à même d’assurer la cohérence
territoriale des politiques publiques ».212 Cet exemple pose toutefois la question de l’intérêt
de poursuivre une expérimentation menée dans une seule collectivité locale. Une
expérimentation menée dans une seule collectivité territoriale, même si elle est concluante, ne
peut pas être considérée comme garantissant une généralisation qui serait bénéfique. Si les
résultats sont probants dans la région Alsace, mais que l’État ne veut pas procéder à la
généralisation du dispositif, il serait plus intéressant pour cette région de se doter d’un statut
particulier lui donnant la compétence de principe pour la gestion des fonds structurels
européens. De plus, dans le cadre des fonds structurels européens, il s’agit de la gestion d’une
importante masse financière que les décideurs locaux ne sont peut-être pas les mieux à même
de gérer. « Juridiquement rien ne s’oppose désormais à cette généralisation. Elle serait même
plutôt encouragée afin de répondre à la demande de décentralisation. Politiquement est-elle
souhaitable ? La réponse doit être nuancée car les élus ne disposent peut-être pas toujours de
212 DEGRON Robin, « La décentralisation de la gestion des fonds structurels : une expérimentation au milieu du gué », AJDA, 2007, n°17, p.900.
87
l’indépendance suffisante pour résister aux pressions ».213 Au final, il semble que la mauvaise
gestion de l’échantillonnage dans cette expérimentation conduise aujourd’hui l’État dans une
impasse. La poursuite de l’expérimentation dans l’unique région d’Alsace montre bien la
difficulté qu’il y a à prendre une décision définitive face à une expérimentation dont
l’échantillonnage n’est pas représentatif. La poursuite de cette expérimentation dans une seule
région démontre aussi la difficulté, sur un plan politique, à revenir en arrière. La réversibilité
de l’expérimentation, si théoriquement elle est possible, semble compliquée dans les faits.
L’expérimentation relative à la conception des schémas régionaux de développement
économique par les régions elles-mêmes se trouve dans l’extrémité inverse. Toutes les régions
se sont dotées à titre expérimental d’un tel schéma. L’objectif de ce schéma, adopté par le
Conseil Régional, est de « coordonner les actions et de définir les orientations stratégiques en
matière de développement économique ».214 La réussite, quantitative de cette expérimentation,
est notamment due au fait qu’il s’agissait là d’une demande des collectivités locales. Les
régions voulaient pouvoir gérer par elles-mêmes les aides d’État aux entreprises. L’adoption
du schéma régional de développement est donc un moyen pour les régions d’affirmer leur
primauté en matière de développement économique. Toutes les régions se sont dotées d’un tel
schéma, alors même que l’expérimentation doit encore se poursuivre jusqu’au 31 décembre
2009. Mais peut-on alors parler d’une expérimentation si toutes les collectivités
expérimentent ? L’intérêt de l’expérimentation est nettement diminué dès lors qu’il n’y a pas
de comparaison possible entre divers échantillons. La situation est ici d’autant plus critiquable
que les schémas de développement économique permettent aux régions de gérer des aides
financières, accordées notamment aux entreprises. Ces aides peuvent entrer en contradiction
avec la législation communautaire. Dès lors, il semble qu’il aurait été plus opportun de limiter
à quelques régions le soin d’expérimenter ces schémas de développement économique afin de
limiter les risques d’atteinte au droit communautaire. « Il convient donc de tempérer le succès
en nombre de cette expérimentation par les spécificités des configurations locales, qui
peuvent donner à un même schéma des orientations et des conséquences très variables ».215
213 COLLIN Mathilde, « L’expérimentation de la gestion des fonds structurels par la région Alsace », RGCT, n°35, 2005, p.280. 214 SESTIER Jean-François, « Le renouveau législatif du développement économique », JCP-A, n°1, 2005, p.8. 215 GEST Alain, rapport n°3199, sur la mise en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, p.74.
88
B. La gestion critiquable de l’échantillon de l’expérimentation du RSA
L’expérimentation relative au RSA démontre elle aussi la complexité de
l’échantillonnage. Cette complexité va ici de paire avec la mise en place laborieuse de
l’expérimentation. Lors du premier appel à candidature, suite à l’article 142 de la loi de
finance pour 2007216, seize départements s’étaient portés candidats à participer à
l’expérimentation. La loi ne prévoyait aucune limite quant au nombre de Conseils Généraux
admis à expérimenter. Cependant, seuls deux départements ont, finalement, été autorisés à
participer à l’expérimentation. Les autres se sont soit désistés « en estimant que leur marge
d’autonomie était trop réduite »217, soit ils n’ont pas rendu les dossiers de candidatures dans
les délais impartis ou encore les dossiers étaient incomplets. Le lancement de
l’expérimentation relative au RSA n’a pas été couronné de succès immédiatement.
Puis la loi du 21 août 2007, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat218,
conformément aux promesses électorales faites lors de la campagne présidentielle219, a
relancé le processus d’expérimentation relatif au RSA. La loi, en son article 21, prévoyait que
le nombre de départements pouvant être autorisés à expérimenter ce nouveau système d’aide
sociale serait limité à dix. La loi prévoyait même le cas où plus de dix candidatures
parviendraient au Gouvernement et elle indiquait la procédure à suivre pour classer les
dossiers de candidature. « Dans le cas où le nombre de candidatures excède dix, les dix
départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l’expérimentation
sont retenus par un rang décroissant de la moyenne de : 1° leur rang de classement, parmi
l’ensemble des départements, selon le montant du dernier potentiel fiscal par habitant connu
[…], établi par ordre croissant ; 2° leur rang de classement, parmi l’ensemble des
départements, selon le nombre de bénéficiaire du revenu minimum d’insertion rapporté au
nombre d’habitants du département considéré, établi par ordre croissant ».220 Or il faut
constater qu’au moment de la généralisation du dispositif, à la fin de l’année 2008, une
trentaine de départements participaient à l’expérimentation221. Ce cas pose diverses questions.
Tout d’abord l’intérêt de l’expérimentation est de mettre au point une nouvelle législation sur
216 Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006, op. cit. 217 LONG Martine, « Revenu de solidarité active : l’expérimentation », op. cit., p.1239. 218 Loi n°2007-1223 du 21 août 2007, op. cit. 219 « Les deux candidats à l’élection présidentielle en lice pour le second tour s’étaient prononcés pour l’instauration du revenu de solidarité active prôné par Martin Hirsch. Cette volonté se traduira par une nouvelle expérimentation une fois M Sarkozy élu Président de la République ». LONG Martine, « Revenue de solidarité active : l’expérimentation », op. cit., p.1238. 220 Art. 21, II, al. 2, de la loi n°2007-1223, du 21 août 2007, op. cit. 221 En tout, trente quatre départements ont expérimenté le RSA.
89
un échantillon limité. Le fait, qu’un tiers des départements français expérimente, remet en
cause cette idée d’échantillon limité. De plus cet exemple questionne sur l’attitude du
gouvernement vis-à-vis de cette expérimentation. Alors même que la loi prévoyait
d’expérimenter le RSA dans un nombre limité de départements et prévoyait de façon précise
la manière dont devait se faire la sélection des Conseils Généraux admis à expérimenter, le
Gouvernement est passé outre la loi. Le Gouvernement a autorisé tous ces départements à
participer à l’expérience. C’est donc de la responsabilité du Gouvernement que relève ici le
problème de l’échantillonnage. Cela renvoie à une dernière interrogation, celle de la
responsabilité du Gouvernement. Celui-ci doit nécessairement se soumettre à la loi.
Cependant quelle juridiction pourrait connaître de la responsabilité du Gouvernement et qui
aurait un intérêt à agir dans pareil cas ? Le Conseil Constitutionnel ne résout que les questions
de conformité de la loi à la Constitution et non de leur application. Le Conseil d'État pourrait
être saisi du décret énumérant les collectivités territoriales admises à participer à
l’expérimentation. Si la question du juge peut trouver une solution, la question du requérant
est plus difficile à résoudre. Dès lors que les collectivités territoriales sont admises à
participer à l’expérimentation, on comprendrait mal qu’elles fassent un recours contre le
décret portant la liste des collectivités expérimentatrices. L’absence de contentieux sur cette
question empêche pour l’instant d’y apporter une réponse précise.
Ces exemples posent la question du crédit à apporter à une expérimentation menée
avec des échantillonnages aussi variés. Si l’expérimentation normative ne pourra jamais
atteindre le même degré de systématicité que les sciences dures, il semble nécessaire de
prévoir des règles concernant l’échantillonnage. De telles règles n’ont été prévues ni par la
Constitution, ni par la loi organique du 1er août 2003. Elles seraient pourtant un élément
essentiel dans la réussite de la méthode expérimentale. La définition d’un échantillon
représentatif ne peut pas être faite de façon abstraite à l’avance. La loi organique aurait pu
prévoir que chaque loi portant expérimentation déterminerait le nombre de collectivités
territoriales admises à participer, en sus des caractéristiques de celles-ci. L’initiative prise à
propos de l’expérimentation sur le RSA de limiter, dans la loi, à dix départements, le droit de
participer à l’expérience est un bon exemple de ce qui pourrait se faire. L’exemple du RSA
amène ensuite à s’interroger sur la responsabilité du Gouvernement de respecter les
prescriptions de la loi. Le CGCT pourrait ici être modifié pour rendre contraignant, sous peine
de sanctions si nécessaire, le respect par le Gouvernement des dispositions relatives aux
échantillonnages. Les parlementaires au moment de la rédaction de la loi organique relative à
90
l’expérimentation n’ont pas été aussi loin. L’État reste entièrement libre de gérer l’échantillon
de collectivités participant à l’expérimentation comme il l’entend. Une nouvelle fois se pose
alors la question de l’intérêt du recours à l’expérimentation : est-ce qu’il s’agit d’un outil
permettant une plus grande dynamique des collectivités locales ou est-ce un outil au service
de l’État ?
Les difficultés relatives à l’évaluation des expérimentations renforcent d’ailleurs ce
questionnement.
91
Section 2. La subjectivité de l’évaluation
L’évaluation, dernière étape de l’expérimentation, est un élément crucial. Le Conseil
Constitutionnel, dès les années 90, exigeait qu’une évaluation soit prévue pour qu’une loi soit
qualifiée d’expérimentale. Le protocole expérimental implique, par définition, une évaluation.
L’évaluation « a pour but de porter une appréciation sur l’efficacité d’un programme, d’une
politique ou d’une action, à la suite de la recherche de leurs effets réels au regard des
objectifs affichés ou implicites et des moyens mis en œuvre ».222 C’est à partir de l’évaluation
de l’expérimentation que le dispositif sera ensuite généralisé ou non. Malgré l’importance
cruciale de cette étape, la Constitution et la loi organique n’ont prévu que peu de choses
relativement à l’évaluation (§1). Le risque est alors que l’État instrumentalise l’évaluation
pour atteindre un objectif qu’il s’était initialement fixé (§2).
§1. Des modalités d’évaluation à préciser
Il est nécessaire ici de remarquer que la différence de rédaction entre l’article 37-1 et
l’article 72, alinéa 4, de la Constitution emporte des conséquences importantes en matière
d’évaluation de l’expérimentation. L’article 37-1, de par sa rédaction très lapidaire, ne prévoit
rien quant à l’évaluation. Il est alors nécessaire de se référer à la jurisprudence antérieure du
Conseil Constitutionnel. Celui-ci exigeait dans sa décision de 1993 que la loi portant
expérimentation doit prévoir les modalités de son évaluation. La charge de garantir
l’évaluation de l’expérimentation, ainsi que ses modalités, repose donc sur le législateur. Le
juge constitutionnel devra alors veiller à ce que cette évaluation soit correctement prévue.
Force est de constater cependant, que dans la décision du 12 août 2004223, le Conseil n’a fait
aucune mention dans cette décision à l’obligation d’évaluation. S’agissant de
l’expérimentation dérogation, la situation est différente puisque les dispositions de la
Constitution ont été complétées par la loi organique du 1er août 2003. Cette loi a inséré dans le
Code général des collectivités territoriales un article relatif à l’évaluation de
l’expérimentation.
222 MÉHAIGNERIE Pierre, op. cit., p.115. 223 Conseil Constitutionnel, 2004-503DC du 12 août 2004, loi relative aux libertés et responsabilités locales, JORF, 17 août 2004, p.14648.
92
Le CGCT, en son article LO 1113-5, dispose que « avant l’expiration de la durée fixée
pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un
rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à
l’expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par ces collectivités en ce
qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l’organisation
des collectivités territoriales et des services de l’État ainsi que leurs incidences financières et
fiscales ». Cet article nous renseigne à la fois sur qui doit procéder à l’évaluation (A) et sur les
éléments à prendre en compte (B).
A. Une évaluation dirigée par le Gouvernement
L’évaluation de l’expérimentation, dans le domaine de la loi, se déroule en deux
temps. D’abord le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le déroulement de
l’expérimentation, ensuite c’est le Parlement qui au vu de ce rapport décide du sort à réserver
à l’expérimentation. Le rapport remis par le Gouvernement revêt une importance capitale
puisqu’il décrit comment s’est déroulée l’expérimentation. C’est sur la base de ce rapport que
le Parlement se prononce sur la poursuite, la généralisation ou l’abandon de
l’expérimentation. « L’expérimentation ne doit pas être un acte sans suite, le bilan établi à la
fin devant soutenir la décision conduisant soit au maintien du test, avec d’éventuelles
modifications, soit à sa généralisation, soit à son abandon ».224 Il faut comprendre que ce
rapport ne lie pas le Parlement. Seul celui-ci peut décider de la suite à donner à
l’expérimentation, y compris contre l’avis du Gouvernement tel que formulé dans le rapport.
Le rapport remis par le Gouvernement n’est qu’une indication pour le Parlement. « Il apparaît
clair que le législateur bénéficie ici d’un pouvoir de vie et de mort ».225 Juridiquement, le
législateur n’est pas contraint de suivre l’avis que le Gouvernement émet. C'est-à-dire que
l’évaluation finale de l’expérimentation repose dans la décision du Parlement. Le rapport
remis par le Gouvernement n’est qu’un bilan, qui fait partie de l’évaluation, mais ne la réalise
pas à lui seul. « Il semble permis d’opposer aux déterminations d’un bilan la liberté du
législateur. Celui-ci paraît, en effet, autorisé à renoncer à une expérimentation en dépit des
priorités précédentes. On doit même reconnaître au législateur une liberté d’appréciation
224 PIRON Michel, Rapport n°955, op. cit., p.34. 225 BROSSET Estelle, op. cit., p.722.
93
subjective sur une évaluation, celui-ci restant finalement maître d’imposer toute solution que
les circonstances lui suggéreront ».226
Ces dispositions illustrent une nouvelle fois l’importante de l’État dans la conduite de
l’expérimentation. Outre le fait que ce soit le Gouvernement, c'est-à-dire celui qui
juridiquement a décidé de procéder à l’expérimentation, qui fait le rapport d’évaluation, celui-
ci n’associe pas pleinement les collectivités expérimentatrices. La loi prévoit simplement que
le rapport est « assorti des observations » des collectivités cobayes. Les collectivités
territoriales ne semblent donc être associées qu’à la marge à ce rapport, alors même que ce
sont elles qui ont expérimenté. Cela peut paraître étonnant quand on connaît la démarche
pragmatique dans laquelle s’inscrit l’expérimentation. L’objectif de cette technique est de
profiter de l’expérience des collectivités pour adopter la norme générale la plus efficace
possible. Pour pouvoir profiter de cette expérience, il faut associer pleinement les collectivités
expérimentatrices à la réalisation du bilan qui sera remis au Parlement. Alors même que la
constitutionnalisation de l’expérimentation s’est faite lors d’une révision de notre norme
fondamentale relative aux collectivités territoriales, il semble une nouvelle fois que celles-ci
soient écartées au profit de l’État.
L’expérimentation du RSA montre cependant que les collectivités sont plus largement
associées à ce rapport d’évaluation. Pour l’évaluation de cette expérimentation, il a été mis en
place un comité d’évaluation composé de représentants des départements, des services de
l’État et des organismes de sécurité sociale ainsi que des personnalités qualifiées « dont la
compétence est reconnue en matière d’évaluation des politiques publiques ».227 Une nouvelle
question se pose alors ici. Le comité d’évaluation est composé de personnes, les représentants
des départements et des services de l’État, qui sont à la fois juge et partie. Cela peut conduire
à s’interroger sur l’objectivité de l’évaluation. Il est étonnant que des personnes, parties
prenante dans l’expérimentation, participent à la réalisation du bilan. Un doute peut alors être
émis sur l’objectivité avec laquelle le bilan de l’expérimentation est réalisé. Il existe le risque
d’une certaine subjectivisation de ce bilan, qui pose par la même la question de l’objectif réel
de cette évaluation.228 On peut alors s’interroger sur le crédit à apporter aux conclusions,
relatives à l’expérimentation du RSA, selon lesquelles « le rapport d’étape du comité
d’évaluation fait état, sur cinq premiers mois d’expérimentation dont les données sont 226 FAURE Bertrand, « L’intégration de l’expérimentation au droit public français », in Mouvement du droit public. Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, op. cit., p.169. 227 Circulaire interministérielle du 22 août 2007, relative à la mise en œuvre des expérimentations locales prévues par l’article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié et la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat – revenu de solidarité active (RSA), Annexes, p.24. 228 Cf. infra p.99.
94
connues, de taux moyen de retour à l’emploi régulièrement supérieur dans les zones
expérimentales par rapport aux zones témoins ».229 Cette remarque appelle d’ailleurs une
autre question à savoir l’adéquation entre la durée de l’expérimentation et le moment de son
évaluation230.
Il semblerait donc qu’il soit nécessaire de revoir les dispositions relatives à la
réalisation de ce bilan de l’expérimentation. « L’objectivité de l’évaluation dépendant de celle
de son auteur, ceci doit conduire à privilégier le recours à des organes externes et
spécialisés ».231 Deux solutions peuvent être explorées, soit confier l’évaluation à des cabinets
d’audit privés et externaliser totalement la réalisation du bilan de l’expérimentation, soit, à la
suite de la proposition de Guillaume Drago232, confier cette évaluation à l’Office d’évaluation
de la législation. Il serait même concevable de cumuler ces deux possibilités. « L’évaluation
puise incontestablement son efficacité dans la pluralité de ses sources. Elle doit permettre au
Parlement de disposer des informations suffisantes et adaptées à l’exercice de ses
pouvoirs ».233
La solution de l’externalisation du bilan, auprès de cabinets d’audit privés, a le
bénéfice d’assurer une plus grande objectivité et une plus grande rigueur dans la réalisation de
ce bilan. Les cabinets d’audit disposent des moyens financiers, humains et techniques ainsi
que des compétences nécessaires pour réaliser ces évaluations. C’est même là leur activité
principale. Cette solution a, toutefois, comme inconvénient d’être, d’une part, coûteuse en
termes de finances publiques et, d’autre part, l’administration est encore assez peu habituée à
avoir recours à ce genre de technique. L’argument du coût de la réalisation du bilan doit
cependant être relativisé. Quelle que soit la personne qui la mène, « une véritable évaluation
est coûteuse ».234 Cet argument est donc réfutable.
La seconde possibilité serait de confier cette mission à l’Office d’évaluation de la
législation. Cet office, créé par la loi n°96-516 du 14 juin 1996235, avait au moment de sa
création pour mission de « renforcer l’évaluation de la législation jusqu’alors confiée aux
229 DAUBRESSE Jean-Philippe, Rapport n°1113, relatif au projet de loi portant généralisation du RSA, p.36. 230 Cf. infra p.103. 231 PERROCHEAU Vanessa, op. cit., p.25. 232 DRAGO Guillaume, « Le droit à l’expérimentation », in La République décentralisée, op. cit., p.84. 233 CHEVILLEY-HIVER Carole, « La mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale », RDP, n°6, 2006, p.1681. 234 BRAUD Caroline, « L’évaluation des lois et des politiques publiques », LPA, n°95, 7 août 1996, p.11. 235 Loi n°96-516 du 14 juin 1996, tendant à créer un Office parlementaire d’évaluation de la législation, JORF, 15 juin 1996, p.8911.
95
seules missions d’informations ».236 Cet organe est composé paritairement de dix députés et
de dix sénateurs et a été « jusqu’ici peu actif ».237. Ces membres peuvent faire appel dans leur
mission d’évaluation à des experts et disposent d’amples pouvoirs d’information. L’Office
d’évaluation de la législation étant un organe interparlementaire, il ferait ainsi du Parlement la
véritable clef de voûte de l’évaluation de l’expérimentation. Le Parlement se chargerait de la
réalisation du bilan et du vote de la suite à donner à l’expérimentation. Il maîtriserait ainsi
toute l’évaluation. Le risque d’une évaluation subjective serait minimisé puisque le
Gouvernement ne réaliserait plus, lui-même, le bilan de l’expérimentation. De plus, confier
cette mission d’évaluation entièrement aux assemblées revaloriserait en même temps le travail
parlementaire. L’évaluation de ces dispositifs par les élus nationaux est un gage de leur pleine
implication par la suite dans la rédaction et l’adoption du dispositif de généralisation de
l’expérimentation. D’autre part, l’Office d’évaluation de la législation « trouverait dans
l’évaluation des expérimentations un nouvel essor et pourrait ainsi, au fil des évaluations,
acquérir une expérience de ce domaine et procéder à des comparaisons de dispositifs
expérimentaux ».238 Enfin, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit
en son article 15 que « la société a le droit demander compte à tout agent public de son
administration ». Confier la réalisation du bilan de l’expérimentation à nos représentants
serait alors une forme d’application de cette disposition. Le législateur disposait de moyens,
lors de la rédaction de la loi organique, pour assurer une évaluation la plus objective possible
des expérimentations.
S’agissant des expérimentations en matière réglementaire, le CGCT prévoit que c’est
le décret portant expérimentation qui « précise les modalités d’évaluation des dispositions ».
On peut supposer que cette évaluation sera alors confiée au Ministre concerné par
l’expérimentation. Une fois de plus, l’objectivité de l’évaluation pourra être remise en cause.
Deux solutions se présentent ici aussi pour éviter cet écueil, soit confier l’évaluation à un
cabinet d’audit privé, soit confier l’évaluation à un organe indépendant. L’intervention de
l’Office d’évaluation de la législation n’est pas concevable ici puisque l’expérimentation
évaluée intervient dans le domaine réglementaire.Toutefois, puisque les expérimentations
réglementaires supposent l’intervention d’un décret en Conseil d'État, on pourrait associer le
Conseil à la réalisation de l’évaluation. Il s’agirait alors de créer des commissions ad hoc au 236 MIABOULA-MILANDOU Arsène, « Les moyens d’action du Parlement à l’égard de la loi votée », Revue française de droit constitutionnel, n°33, 1997, p.49. 237 DRAGO Guillaume, « Le droit à l’expérimentation », in La République décentralisée, op. cit., p.84. 238 Idem.
96
sein du Conseil pour l’évaluation de telle ou telle expérimentation. Sans être un organe
totalement indépendant du Gouvernement, l’intervention du Conseil d'État pourrait être le
gage d’une plus grande objectivité de l’évaluation.
Une nouvelle fois la Constitution et la loi organique comportent de graves lacunes qui
peuvent remettre en cause l’intérêt du recours à l’expérimentation. « Par essence partisane,
relative et idéologiquement orientée, l’expérimentation politique est tributaire des critères
d’évaluation qu’elle développe ».239 Une fois précisé qui réalise l’évaluation, il est encore
nécessaire de déterminer ce qui doit être évalué.
B. Le contenu de l’évaluation
L’article LO 1113-5 du CGCT dispose que l’évaluation porte « notamment [sur] le
coût et la qualité des services rendus aux usagers, l’organisation des collectivités territoriales
et des services de l’État ainsi que leurs incidences financières et fiscales ». L’utilisation de
l’adverbe « notamment » indique que ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui peuvent
être pris en compte dans l’évaluation. Cette disposition appelle deux remarques, d’une part,
l’évaluation de chaque expérimentation reste libre et, d’autre part, l’accent est mis sur les
critères économiques de l’évaluation.
En l’absence de plus de précisions dans la loi organique relative à l’expérimentation,
c’est à chaque texte portant expérimentation qu’il reviendra de préciser les éléments que le
bilan doit faire apparaître. Ceci est logique du fait que chaque expérimentation peut porter sur
des domaines très variés, et c’est en fonction de ces domaines que les critères d’évaluation
doivent être déterminés.
Dans l’expérience relative au RSA, les éléments à prendre en compte dans l’évaluation
sont développés au X, de l’article 142, de la loi de finance pour 2007. Le bilan de
l’expérimentation doit faire apparaître « les données comptables concernant les crédits
consacrés aux prestations ; les données agrégées portant sur les caractéristiques des
bénéficiaires et sur les prestations fournies ; les informations sur la gestion de ces prestations
dans le département et sur l’activité des organismes qui y concourent ; les éléments relatifs à
l’impact de ces mesures sur le retour à l’emploi ». La circulaire d’application du dispositif
239 CHARENTENAY Simon (de), op. cit.
97
renvoie ensuite au comité d’évaluation le soin de « définir un socle commun d’indicateurs
statistiques à suivre ».240 Cette circulaire indique aussi que l’avis des bénéficiaires du RSA
devra être pris en compte dans la rédaction du bilan de l’expérimentation. L’évaluation de la
mesure expérimentale revêt donc un caractère interne et un caractère externe. Il s’agit, d’une
part, d’analyser comment l’administration a géré cette nouvelle compétence, quelles ont été
les difficultés rencontrées et les solutions retenues. D’autre part, l’évaluation doit aussi
s’intéresser aux effets concrets de la norme expérimentée et à leur perception par les usagers.
La place du citoyen dans l’expérimentation est très importante. L’objectif de
l’expérimentation étant d’améliorer la norme, il est important que le destinataire premier de
cette norme, l’usager, soit consulté lors de l’évaluation. Dès lors, parmi les critères
développés par le CGCT sur lesquels doit porter l’évaluation, on peut regretter l’absence de
référence à la consultation des citoyens.
Les dispositions de la loi organique se sont contentées de faire référence à des critères
de nature économique. Si la rédaction de l’article LO 1113-5 du CGCT, laisse à penser qu’il
ne s’agit pas là de critères obligatoirement pris en compte, leur énumération interroge.
On retrouve cette insistance sur les critères économiques du fait qu’est évoqué tout
d’abord « le coût […] des services rendus aux usagers » puis les « incidences financières et
fiscales ». Il ne s’agit pas là d’une redondance puisqu’il s’agit d’évaluer, d’une part, le prix
que l’usager devra verser en contrepartie de ce service et, d’autre part, les conséquences du
service sur le budget des collectivités. Il est toutefois notable de voir que sur les trois critères
proposés par le Code, deux sont de nature économique. À l’heure où l’État, dans un souci de
contenir ses dépenses, se recentre sur ses compétences essentielles et où les collectivités
territoriales n’ont pas toujours les moyens financiers d’assumer de nouvelles compétences, la
multiplication des critères d’évaluation de nature économique est compréhensible. La
décentralisation est, en partie, un moyen pour l’État de déléguer des compétences aux
collectivités territoriales qui sont aussi des charges en moins sur le budget de l’État. Le
problème est que les collectivités locales cherchent à limiter elles aussi leurs dépenses.
Toutefois, la présence de nombreux critères financiers dans les critères d’évaluation d’une
expérimentation demeure critiquable. La réussite d’une expérimentation ne tient pas
nécessairement à ce qu’elle a permis de proposer un service aux usagers à un moindre coût.
240 Circulaire interministérielle du 22 août 2007, relative à la mise en œuvre des expérimentations locales prévues par l’article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié et la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat – revenu de solidarité active (RSA), Annexes, p.25.
98
« L’expérimentation ne peut avoir pour « philosophie » qu’une amélioration du service
public. Et il ne s’agit pas nécessairement de « faire plus » que ce que fait l’État (ce sera
souvent financièrement impossible) mais de faire « autrement » en espérant qu’il en sortira
un « mieux » ».241
C’est pourquoi il est nécessaire d’accorder une plus grande place aux usagers dans
l’évaluation de l’expérimentation. Une simple modification de l’article LO1113-5 du CGCT
pourrait réaliser cette adjonction. Il suffirait d’ajouter à l’énumération déjà présente à la suite
de l’adverbe « notamment » que les citoyens doivent être associés, aussi souvent que possible,
à la réalisation du bilan de l’évaluation. C’est en consultant les citoyens que l’évaluation
déterminera au mieux si l’expérimentation a permis une amélioration du service offert.
La manière dont doit être réalisée l’évaluation de l’expérimentation n’est pas
exhaustivement prévue par les textes. L’État conserve une marge de manœuvre pour mener
cette évaluation comme il l’entend. L’évaluation peut très vite devenir non seulement
subjective mais aussi instrumentalisée.
§2. Le risque d’une évaluation orientée
L’intérêt que l’État place dans l’expérimentation, à savoir de procéder à des réformes
sans donner l’impression de les imposer unilatéralement, comporte des risques. L’État peut se
servir de l’expérimentation dans son propre intérêt. L’évaluation ne doit pas donner des
résultats contraires à ces intérêts. L’évaluateur peut alors chercher à donner sa propre lecture
des résultats de l’évaluation. « Le fait est que la dimension politique de l’expérimentation
trouble la limpidité de la méthode scientifique dans la mesure où la loi à l’essai se trouve être
l’instrument d’une volonté politique souvent voilée par le slogan de l’efficacité, mais dont le
véritable objectif est d’acclimater, de faire accepter une solution déjà considérée comme
manifestement préférable ».242
La procédure expérimentale, et son évaluation, peuvent parfois être dévoyées de leur
objectif premier et ne faire alors que servir une logique de communication de la part de l’État
(A), d’ailleurs les exemples d’expérimentations menées à l’étranger abondent en ce sens (B).
Enfin, la durée de l’expérimentation a également une influence sur l’évaluation de celle-ci
(C).
241 PONTIER Jean-Marie, « Décentralisation et expérimentation », op. cit., p.1037. 242 CHARENTENAY Simon (de), op. cit.
99
A. Une évaluation servant une logique de communication
Le Gouvernement, lorsqu’il décide d’une expérimentation, peut très bien savoir à
l’avance qu’il procédera à la généralisation du dispositif. L’évaluation de l’expérimentation
sert alors à justifier la décision du Gouvernement de généraliser la norme. C’est d’ailleurs en
partie ce qui s’est passé pour le RSA.
L’objectif est d’éviter que l’évaluation ne devienne « le « faire-valoir » d’un
processus de réforme sur lequel on ne veut pas revenir, instrumentalisant ainsi la technique
expérimentale ».243 Il est tentant pour le Gouvernement de procéder à une expérimentation
afin de ne pas procéder à une réforme de façon unilatérale et autoritaire. L’évaluation est une
étape qui permet alors de mettre en avant la réussite d’une expérimentation et donc
l’opportunité de sa généralisation. Il est alors loisible au Gouvernement de mettre en avant les
résultats positifs obtenus par l’expérimentation dans certaines collectivités territoriales. Le
Gouvernement possède une importante arme de communication auprès de l’opinion publique.
Il instrumentalise la procédure de l’expérimentation à ses propres fins, pour réaliser des
réformes. L’expérimentation peut être utilisée comme « une tactique pour faire passer petit à
petit une réforme qui donne lieu à des prises de positions contrastées ».244 Ce dévoiement de
la procédure expérimentale va s’appuyer sur l’évaluation. L’évaluation de l’expérimentation
sera, dans de tels cas, jugée positive et la généralisation du dispositif encouragée.
L’évaluation ne ferait alors que servir la volonté du Gouvernement, à savoir celle de
généraliser la norme. Ceci est d’autant plus vrai que par le fait majoritaire, le Gouvernement
dispose en général de la majorité nécessaire au vote d’un nouveau texte au Parlement. Il suffit
alors au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’évaluation qui mette l’accent
sur la réussite de l’expérimentation pour que la mesure soit généralisée. L’évaluation est alors
le moment pour le Gouvernement de se targuer des bons résultats de l’expérimentation dont il
avait eu l’initiative.
L’expérimentation relative au RSA a connu un tel sort. Dès le lancement de
l’expérimentation dans les départements, il était acquis qu’il y aurait « d’ores et déjà une
243 DRAGO Guillaume, « Le droit à l’expérimentation », in La République décentralisée, op. cit., p.84. 244 MAMONTOFF Catherine, « Réflexion sur l’expérimentation du droit », op. cit., p.371.
100
généralisation de la mesure pour fin 2008 »245, alors même que l’expérimentation était prévue
pour durer trois ans. On peut légitimement se poser la question de l’intérêt de procéder à une
expérimentation alors même que la généralisation du dispositif est déjà prévue. On peut
penser qu’il y avait tout de même une volonté de tester le dispositif avant de la généraliser
mais l’expérimentation « paraît, dans notre hypothèse, faussée dès le départ »246. Les
critiques à l’égard de la marche suivie par le Gouvernement dans cette expérimentation sont
acerbes. Pour les décideurs locaux, ils sont face à « un Gouvernement qui travaille
énormément son image, c’est une image importante à cultiver ».247 De la proposition du
candidat Sarkozy à la nomination de Martin Hirsch comme Haut commissaire aux solidarités
actives, l’expérimentation du RSA et sa généralisation à la fin de l’année 2008 paraît avoir
servi une logique de communication de l’équipe présidentielle de Nicolas Sarkozy. « Tout se
passe comme si, pressé par une logique de communication et de résultats, le Gouvernement
avait péché par précipitation ».248
Une telle attitude est dommageable car elle nuit à la procédure expérimentale. En
matière de RSA si les résultats de l’expérimentation avaient été mitigés, il aurait été risqué –
du moins politiquement – de ne pas procéder à la généralisation annoncée. La réversibilité de
l’expérimentation apparaît comme étant impossible. L’expérimentation n’en est plus une, s’il
est déjà prévu que la mesure sera généralisée. L’évaluation de l’expérimentation n’est alors
qu’un moyen de conforter le Gouvernement dans la politique qu’il a adoptée.
L’expérimentation ne rempli plus son rôle de test, de mise au point et d’amélioration. « Cela
est sans doute regrettable pour le principe même de cette expérimentation [relative au RSA]
et surtout pour les départements qui, ayant imaginé un processus innovant, devront retrouver
la norme commune au 1er juin »249 2009. L’expérience sert une logique de communication du
Gouvernement qui, grâce à elle, entend légitimer son action. L’évaluation de
l’expérimentation est utilisée par le Gouvernement comme argument de la nécessité de son
action. « L’effet d’annonce semble ici primer sur une capacité de recul et d’analyse ».250
Le risque de détournement politique de l’expérimentation à des fins de communication
n’est pas propre à la France. Les autres pays européens, où l’on retrouve des systèmes
d’expérimentation normative proches du nôtre, connaissent la même dérive. 245 LONG Martine, « Revenue de solidarité active : l’expérimentation », op. cit., p.1238. 246 Ibid, p.1242. 247 Annexe : Entretien Mme Vaugelade, p.137. 248 LONG Martine, « Revenu de solidarité active : l’expérimentation », op. cit., p.1241. 249 RIHAL Hervé, « La généralisation du revenu de solidarité active », AJDA, n°4, 9 février 2009, p.198. 250 LONG Martine, « Revenu de solidarité active : l’expérimentation », op. cit., p.1238.
101
B. L’exemple des expérimentations dans les pays nordiques
La France est le seul État à avoir constitutionnalisé le droit à l’expérimentation. On
retrouve toutefois des mécanismes similaires chez certains de nos voisins Européens,
notamment en Suède ou en Allemagne. En Suède, l’expérience de la Commune Libre
(frikommunförsöket), initiée en 1992, démontre l’utilisation politique qui peut être faite de
l’expérimentation251.
Cette expérimentation avait pour objectif d’accroître les libertés des collectivités
locales. Cependant, un régime juridique complexe en a freiné la mise en œuvre. Il est possible
de faire ici un parallèle avec le modèle français. Théoriquement, l’expérimentation, telle
qu’elle est prévue dans les textes français, est plus simple à mettre en place. Toutefois, on l’a
vu dans l’exemple du RSA, la mise en œuvre d’une expérimentation s’est révélée complexe.
C’est au moment de l’évaluation que l’expérimentation menée en Suède a démontré ses
limites et le risque d’instrumentalisation par le politique. Le Ministère de l’Administration
Publique avait commandé une évaluation de l’expérimentation auprès d’universitaires, mais
chaque Ministre a tout de même commandé une évaluation. Cette évaluation, commandée par
chaque Ministre, comporte un risque d’être orientée en fonction des résultats dont le ministère
à besoin pour mener sa politique. Le rapport remis par « l’enquêteur spécial » contient avant
tout des appréciations de nature politique. Il met en avant le fait que les collectivités locales
sont des lieux d’innovation, le fait que l’expérimentation a permis de mieux s’adapter aux
conditions locales, mais « on n’y trouve aucun élément d’évaluation des améliorations que les
solutions expérimentées auraient permis d’atteindre ».252
L’expérimentation de la Commune Libre semble avoir été fortement instrumentalisée
par le Gouvernement suédois. On a l’impression que l’État central a cherché, dans cet
exemple, à conforter son pouvoir tout en donnant l’impression d’agir en faveur des
collectivités territoriales. D’ailleurs les trois conclusions qui ressortent du rapport
d’évaluation sont sans appel sur cette question « 1) l’expérimentation est de nature à
provoquer des conflits entre les intérêts nationaux et sectoriels d’une part, et les intérêts
locaux d’autre part ; 2) le pouvoir central doit conserver la primauté car il contrôle le
251 Les conclusions présentées ici à ce sujet sont tirées de : MARCOU Gérard, « Expérimentation et collectivités locales : expériences européennes », in Les collectivités locales et l’expérimentation : perspectives nationales et européennes, op. cit., p.15 et s. 252 MARCOU Gérard, « Expérimentation et collectivités locales : expériences européennes », in Les collectivités locales et l’expérimentation : perspectives nationales et européennes, op. cit., p.75.
102
système des règles et il doit veiller aux intérêts nationaux ; 3) en dehors de circonstances
particulières sur le plan politique comme celles de la fin des années 70 (en Suède) les intérêts
locaux ne peuvent pas l’emporter sur les intérêts généraux de l’État ».253 Le système suédois,
s’il est très décentralisé sur le plan des structures, conserve énormément de prérogatives au
niveau central. Tout se passe alors comme si l’expérimentation avait eu, parmi ses objectifs,
de démontrer la nécessité que le pouvoir central conserve ses importantes compétences.
L’expérimentation est utilisée à l’inverse du système français, où elle sert plutôt l’État à se
décharger de certaines compétences au profit des collectivités locales. Toutefois dans les deux
cas, le pouvoir central utilise le vocable de l’expérimentation, alors même qu’il s’agit
d’instrumentaliser cette technique, non pas pour améliorer la législation mais pour procéder à
une réforme délicate ou au contraire s’y opposer. L’exemple suédois laisse à penser « que le
recours à l’expérimentation correspondait d’avantage à une stratégie de réforme, dont les
buts et l’objet avaient déjà été délibérés, qu’à la volonté de tester réellement les solutions
envisagées ou proposées ».254
L’expérimentation normative, en France comme en Suède, si elle se veut une méthode
« scientifique » d’amélioration de la législation, demeure un instrument pour le pouvoir
central. L’expérimentation a trouvé un terreau favorable dans la décentralisation pour se
développer. Toutefois, les organes centraux de l’État ont une tendance à dévoyer la procédure
dans leur propre intérêt. « Il se peut que l’objectif visé ne soit pas celui qui est annoncé par
l’expérimentation, ou encore que les décisions politiques soient prises avant la fin de
l’expérimentation ou avant que l’évaluation n’en soit terminée, ou encore les décisions qui
sont prises s’écartent des recommandations issues de l’expérimentation ».255 L’exemple
suédois démontre comment l’expérimentation, même utilisée dans le cadre d’une politique de
décentralisation, peut servir à renforcer le pouvoir central.
Le cas français n’est donc pas isolé. La théorie et la pratique de l’expérimentation et
de son évaluation ne visent pas à atteindre les mêmes buts. Alors que l’expérimentation
devrait être un outil d’amélioration de la législation, elle se transforme en un instrument de
l’État central. Ceci conduit même, Gérard Marcou, à conclure que « la séquence que suppose
253 Ibid, p.74. 254 Ibid, p.96. 255 Ibid, p.95.
103
la notion d’expérimentation, c'est-à-dire un projet de réforme, un test et une réforme ou
l’abandon d’une réforme en fonction des résultats du test, ne se rencontre jamais ».256
L’’expérimentation peut être utilisée à bien d’autres fins que celle pour laquelle elle a
été conçue. Les résultats de l’évaluation sont aussi tributaires du moment où elle a lieu. Dès
lors, c’est la durée de l’expérimentation qui pose question.
C. La durée de l’expérimentation au cœur de l’évaluation
L’expérimentation est nécessairement circonscrite dans le temps. Ce n’est pas un droit
à la différenciation qui est créé, l’expérimentation a une durée limitée. « La différenciation
qu’implique toute opération expérimentale ne peut être que temporaire ».257 La loi organique
du 1er août 2003 prévoit, à l’article LO 1113-1, que l’expérimentation « ne peut excéder cinq
ans ». De plus, l’article LO 1113-6 dispose que l’expérimentation peut être prolongée pour
une durée de trois ans. Le même article prévoit, enfin, que le dépôt d’une proposition ou d’un
projet de loi relatif à l’issue de l’expérimentation proroge celle-ci « jusqu’à l’adoption
définitive de la loi, dans la limite d’un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé
l’expérimentation ». Dès lors, l’expérimentation peut durer jusqu’à neuf années. C’est à l’État
de prévoir, initialement, cette durée dans le texte portant expérimentation. Comme dans le cas
du choix de l’échantillon, il apparaît impossible d’éviter une certaine subjectivité de
l’expérimentateur dans la fixation de la durée de l’expérience. Ce choix est purement
discrétionnaire et peut être opéré en fonction d’échéances électorales, de priorités budgétaires
ou encore de décisions politiques. D’ailleurs, les expérimentations menées depuis la révision
constitutionnelle de 2003 illustrent la variété de durées des expérimentations. Si la plupart des
expérimentations prévues dans la loi du 13 août 2004 devaient durer cinq ans,
l’expérimentation relative au financement d’équipements sanitaires par les régions et celle
relative à la gestion du patrimoine culturel ont été prévues pour durer quatre ans.
L’expérimentation relative au RSA devait durer, quant à elle trois ans. Du fait de sa
généralisation à la fin de l’année 2008, elle n’aura duré en réalité que dix huit mois, c'est-à-
dire deux fois moins longtemps que prévu.
256 Idem 257 DENAJA Sébastien, op. cit., p.365.
104
Dans ce délai, il faut compter le temps de procéder à l’évaluation. Celle-ci doit avoir
lieu avant le terme initialement prévu, afin que le dépôt du projet ou de la proposition de loi
sur la suite de l’expérimentation soit fait avant la fin de l’expérience. C'est-à-dire que dans le
délai prévu pour expérimenter, il est nécessaire de prévoir la période d’évaluation. Or il n’est
pas toujours aisé de savoir, à l’avance, si la durée de l’expérimentation est suffisante pour lui
permettre de déployer tous ses effets. Il faut toutefois constater que la durée de
l’expérimentation doit nécessairement être conséquente. En effet, il faut prendre en compte le
fait que les collectivités locales vont devoir adapter leurs services administratifs pour gérer
l’expérimentation. Ce temps d’adaptation peut être plus ou moins long en fonction de la
complexité de l’expérimentation. Ensuite, il faut le temps que les effets de la politique menée
à titre expérimental se concrétisent. Toutes ces étapes, si elles ne sont pas correctement
respectées, vont avoir des incidences sur les résultats de l’évaluation. La durée de
l’expérimentation doit prendre en compte tous ces éléments afin que l’évaluation soit ensuite
la plus objective possible. Il peut être avancé qu’une expérimentation, dont la durée serait
fixée à un an ou à quelques mois, ne peut réellement être une expérimentation, car il est
impossible d’évaluer les effets d’une politique mise en œuvre dans un laps de temps aussi
court. « Il peut être avancé qu’un temps d’expérimentation inférieur à deux ou trois ans invite
à douter de la sincérité de la démarche expérimentale ».258 Cependant, dans l’exemple du
RSA, il ressort de l’expérimentation menée dans le département de l’Hérault que les dix huit
mois d’expérience ont été suffisants. Les premiers résultats obtenus sur cette période ont été
positifs. D’ailleurs pour les décideurs locaux, « trois ans c’est long quand même ».259 Il y a là
une réflexion à mener sur l’adéquation entre le temps de la prise de décision politique, qui est
un temps court, et le temps de la mise au point expérimentale d’une norme, qui devrait être un
temps long. L’expérimentation normative n’est pas totalement identique à l’expérimentation
scientifique. Alors que l’expérimentateur devrait pouvoir prendre son temps pour tester son
hypothèse, le politique soumet l’expérimentation normative à l’urgence, à la nécessité de
prendre une décision rapidement. S’il n’est pas possible de prévoir de façon contraignante la
durée d’expérimentation, il semble nécessaire que l’État soit contraint par les textes de
respecter la durée qu’il aura initialement fixée.
L’efficacité de la méthode expérimentale en matière normative est pour le moins
incertaine. Elle est une méthode soumise à la subjectivité de l’expérimentateur. Il n’est pas
258 Ibid, p.366. 259 Annexe : Entretien Mme Vaugelade p.136.
105
certain qu’elle porte tous les effets bénéfiques qui lui ont été attribués. Il ne s’agit pas pour
autant de remettre entièrement en cause l’utilisation de la méthode mais simplement de ne pas
l’idéaliser. « Il faut nécessairement relativiser le rôle de test de l’expérimentation normative
et ne pas lui prêter la même portée que l’expérimentation scientifique ».260
Comme toute activité juridique, l’expérimentation est susceptible de produire un
contentieux.
260 PISSALOUX Jean-Luc, op. cit., p.16.
106
Chapitre 2. Un contentieux potentiellement
abondant
Comme toute matière juridique, l’expérimentation est susceptible de produire un
contentieux. Le juge pourra alors connaître de différents types d’actes : soit des lois ou des
règlement portant expérimentation, soit les actes que les collectivités territoriales auront
adoptés à titre dérogatoire durant l’expérimentation. L’expérimentation produit alors des
contentieux qui auront lieu devant deux ordres de juridiction, d’une part devant le juge
constitutionnel et d’autre part devant le juge administratif.
Le Conseil Constitutionnel peut être amené à intervenir à deux moments soit en
contrôlant les lois portant expérimentation, soit en contrôlant les lois généralisant un dispositif
après expérimentation. Dans les deux cas, le contenu et la portée du contrôle sont assez
simples à déterminer. Cependant le peu, voire l’absence, de contrôle dans les faits remet en
cause la réalité de ce contrôle. Le juge administratif, quant à lui, connaîtra d’actes que les
collectivités locales adopteront durant la période expérimentale. Il s’agit là du contrôle inédit
pour le juge administratif puisque ces actes s’ils sont formellement administratifs peuvent
intervenir dans le domaine de la loi. Dès lors, le juge va développer un contrôle spécifique,
proche de celui qu’il exerce pour les ordonnances de l’article 38, de la Constitution.
Il s’agira alors d’analyser les possibles cas de contentieux constitutionnel (Section 1)
et de tenter de clarifier le contenu du contentieux administratif (Section 2).
107
Section 1. Les possibilités de contentieux constitutionnel
Le Conseil Constitutionnel dans son contrôle de constitutionnalité peut intervenir pour
deux types de lois concernant les expérimentations. Les sages de la rue Montpensier peuvent
connaître des lois portant expérimentation mais aussi des lois procédant à la généralisation
d’une expérimentation.
Dans le premier cas, le contenu du contrôle opéré par le Conseil est largement connu.
Malgré l’absence de précision dans la Constitution et dans la loi organique, on pourrait penser
que le Conseil reproduirait sa jurisprudence antérieure. Cependant l’exercice de ce contrôle
dans les faits, lors du contrôle de la loi relative aux libertés et responsabilités locales261, laisse
perplexe quant à l’attitude adoptée par le Conseil.
Le second cas de contrôle pose un peu plus de problèmes. Si le contenu théorique du
contrôle peut tout à fait être mis à jour, celui-ci se heurte à la souveraineté du Parlement.
D’ailleurs l’absence d’exemples de ce contrôle dans la réalité démontre bien cette difficulté.
Le contrôle des lois d’habilitation (§1) et le contrôle des lois de généralisation (§2)
diffèrent fondamentalement.
§1. Le contrôle des lois d’habilitation
La loi portant expérimentation malgré son objet spécifique, celui de permettre une
dérogation au droit commun pour une durée limitée, est une loi ordinaire. Elle est donc
soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel, à condition que celui-ci soit saisi. Le contrôle
que le Conseil va opérer sur cette loi est identique à tout contrôle qu’il opère sur une loi
ordinaire.
Le contrôle des lois portant expérimentation n’est pas une nouveauté pour le Conseil
Constitutionnel puisqu’il y a déjà procédé. La constitutionnalisation de l’expérimentation
s’étant faite à droit constant, on peut penser que le Conseil reprendra sa jurisprudence
antérieure. À ce travail de contrôle de la loi portant expérimentation par rapport aux exigences
de la Constitution, le Conseil Constitutionnel doit aussi veiller au respect d’une juste
conciliation entre le principe d’égalité et le droit à l’expérimentation. Dans la théorie, le
contenu du contrôle opéré sur les lois d’habilitation par le Conseil est connu et balisé.
261 Conseil Constitutionnel, n°2004-503DC du 12 août 2004, op. cit.
108
Toutefois, l’unique exemple de ce contrôle interroge. Le contrôle effectué par le Conseil
Constitutionnel dans sa décision du 12 août 2004 n’est pas pleinement satisfaisant puisque les
exigences des juges semblent moins importantes que par le passé.
Dès lors il convient d’analyser le contenu théorique du contrôle (A) pour ensuite le
comparer à son exercice dans les faits (B).
A. Le contenu du contrôle
La loi portant expérimentation doit respecter les prescriptions de la Constitution et de
la loi organique. Comme il a déjà été exposé, ces conditions ne sont pas développées de la
même façon dans les articles 37-1 et 72, alinéa 4, de la Constitution. Au vu de la rédaction de
ces deux articles, on peut toutefois supposer que le Conseil Constitutionnel renouvellera sa
jurisprudence antérieure relative à l’expérimentation. Cette jurisprudence est issue notamment
d’une décision de 1993262. Cette jurisprudence avait déjà défini les éléments de
constitutionnalité de l’expérimentation normative et permis son utilisation avant même la
révision constitutionnelle de 2003. Outre cet aspect de définition de l’expérimentation, ces
décisions nous renseignent encore aujourd’hui sur le contenu du contrôle opéré par le Conseil
Constitutionnel sur les lois d’habilitation.
Le considérant 9 de la décision de 1993 précise que « il est loisible au législateur de
prévoir la possibilité d’expériences comportant des dérogations aux règles ci-dessus définies
de nature à lui permettre d’adopter par la suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles
nouvelles appropriées à l’évolution des missions de la catégorie d’établissement en cause ;
que toutefois il lui incombe alors de définir précisément la nature et la porté de ces
expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les
procédures selon lesquelles elles doivent faire l’objet d’une évaluation conduisant à leur
maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon ». On peut affirmer à
la lecture de ce considérant que le juge constitutionnel est attentif à trois éléments. La loi
portant expérimentation doit circonscrire dans le temps et dans son objet l’expérimentation.
Le législateur doit prévoir l’évaluation de l’expérimentation. Enfin l’issue de
l’expérimentation doit être strictement prévue. « La normativité applicable [à une loi portant
262 Conseil Constitutionnel, n°93-322DC du 28 juillet 1993, op. cit.
109
expérimentation] étant très réduite, le juge constitutionnel ne pourra que se borner à vérifier
que cette loi respecte bien les conditions de forme et celles de fond s’imposant à elle ».263
Outre le contrôle de ces éléments qui participent de la définition même d’une loi
expérimentale, le Conseil Constitutionnel doit opérer une confrontation entre
l’expérimentation et le principe d’égalité. Il doit chercher à concilier les deux principes,
puisqu’ils ont tous deux valeur constitutionnelle. La jurisprudence admet depuis longtemps
des entorses au principe d’égalité, dans le cas de l’expérimentation, c’est au nom de l’intérêt
général qu’est acceptée la rupture momentanée de l’égalité. « De valeur juridique désormais
équivalente, le principe d’expérimentation et le principe d’égalité devront ainsi être conciliés
dans le respect de l’intérêt général ».264 L’expérimentation induisant par définition une
dérogation au droit commun, le contrôle effectué sur les lois d’habilitation doit demeurer
limité. « Les travaux parlementaires montrent en effet que l’encadrement nécessaire résulte
de la lettre même de l’article 37-1 : objet limité, durée limitée, réversibilité, bilan. On peut y
ajouter la non contrariété de l’objet de l’expérimentation avec les exigences
constitutionnelles autres que le principe d’égalité (dans la mesure où il est dérogé
nécessairement à celui-ci pour les besoins de l’expérimentation) ».265 Le même constat peut
être fait à propos de l’expérimentation prévue à l’article 72, alinéa 4. Le contrôle des lois
d’habilitation ne doit pas être trop contraignant au point de rendre encore plus difficile le
recours à l’expérimentation. Le Conseil Constitutionnel doit se contenter d’un contrôle
restreint et vérifier la présence des éléments constitutifs d’une loi expérimentale dans le texte
qui lui est déféré. Le Conseil doit procéder ici à un contrôle de l’erreur manifeste
d’appréciation. « La technique du contrôle de l’erreur manifeste pourra ici être utilisée à
plein, comme la conciliation entre principes constitutionnels. Il faudra y ajouter l’utilisation
par le Conseil Constitutionnel de réserves d’interprétation conditionnant la mise en œuvre
des expérimentations par les autorités nationales ou locales ».266
Le nombre d’expérimentations mises en œuvre depuis la révision du 28 mars 2003
étant limité, les exemple de contrôle du Conseil Constitutionnel sur les lois d’habilitation ne
font pas légion. 263 RICCI Jean-Claude, « Regards juridiques sur l’expérimentation en matière de collectivités territoriales », in Les collectivités locales et l’expérimentation : perspectives nationales et européennes, op. cit., p.208. 264 PIRON Michel, Rapport n°955, op. cit., p.15. 265 SCHOETTL Jean-Eric, « La loi relative aux libertés et responsabilités locales devant le Conseil Constitutionnel », LPA, n°174, 31 août 2004, p.10. 266 DRAGO Guillaume, « Le droit à l’expérimentation », in La République décentralisée, op. cit., p.80.
110
B. L’exercice du contrôle
Seules les expérimentations transferts contenues dans la loi du 13 août 2004 ont fait
l’objet d’un contrôle de la part du Conseil Constitutionnel (1). Les diverses dispositions
relatives à l’expérimentation sur le RSA n’ont pas fait l’objet d’un tel contrôle, la
jurisprudence constitutionnelle peut toutefois conduire à effectuer quelques remarques à leur
encontre (2).
1. Le contrôle des expérimentations contenues dans la loi relative aux libertés
et responsabilités locales
La loi relative aux libertés et responsabilités locales a fait l’objet d’un contrôle par le
Conseil Constitutionnel qui s’est prononcé dans une décision n°2004-503DC du 12 août
2004267. Le Conseil avait été saisi de cette loi par des députés, majoritairement issus de
l’opposition. Les requérants ne contestaient pas l’ensemble de la loi mais un certain nombre
de dispositions, parmi lesquelles les articles 1er, 44, 70 et 86 qui comportaient des
expérimentations. Pour les requérants, ces dispositions « [remettaient] en cause l’égalité des
citoyens faute pour le législateur d’avoir défini, par des dispositions suffisamment précises et
des formules non équivoques, l’encadrement des multiples expérimentations envisagées ». Les
requérants invitent, dans leur saisine, le juge constitutionnel à se prononcer sur les conditions
de mise en œuvre de l’expérimentation et sur la conciliation de celle-ci avec le principe
d’égalité. « L’originalité de cette argumentation était que les quatre premières des cinq
dispositions contestées présentaient le caractère de dispositions expérimentales268 et
donnaient ainsi l’occasion au Conseil Constitutionnel de se prononcer tant sur la base
constitutionnelle des expérimentations en cause que sur la nature de telles dispositions,
s’agissant en particulier de griefs tirés de la violation du principe d’égalité ou de
l’incompétence négative ».269
267 Conseil Constitutionnel, n°2004-503DC du 12 août 2004, op. cit. 268 Les requérants contestaient également sur la base du principe d’égalité l’article 203 de la loi relatif au transfert du personnel technicien et ouvrier de service dans les collèges et lycées des départements et régions d’outre mer. 269 SCHOETTL Jean-Eric, « La loi relative aux libertés et responsabilités locales devant le Conseil Constitutionnel », op. cit., p.9.
111
Le Conseil Constitutionnel répond à ce grief en deux temps. Il s’interroge d’abord sur
l’introduction du droit à l’expérimentation dans la Constitution à l’article 37-1, alors qu’il n’y
était pas invité (a). Puis, le juge analyse chacun des dispositifs expérimentaux pour déclarer
leur conformité à la Constitution (b).
a. L’étonnante validation de la constitutionnalisation de
l’expérimentation
Dans le considérant 9 de cette décision, le Conseil Constitutionnel se prononce sur
l’introduction du droit à l’expérimentation dans la Constitution lors de la révision du 28 mars
2003. Les Neuf sages indiquent en effet que le pouvoir constituant a le pouvoir d’introduire
dans la Constitution de nouvelles dispositions qui « dérogent à des règles ou principes de
valeur constitutionnelle ». Tel est le cas en l’espèce de l’article 37-1 qui introduit dans la
Constitution un droit à l’expérimentation. Ce droit déroge « au principe d’égalité devant la
loi ». Ce droit de déroger aux principes déjà présents dans la Constitution n’est pas une
innovation de la décision de l’été 2004. On retrouve le même considérant dans la décision de
2003 relative à la loi organique sur l’expérimentation270 et il est la reprise d’un considérant
qui trouve son origine dans la décision du 15 mars 1999 relative à la loi organique sur la
Nouvelle-Calédonie271. « Ainsi, la technique de la dérogation permet une adaptation ad hoc
des normes constitutionnelles aux nouvelles dispositions introduites dans la Constitution par
le pouvoir constituant dérivé ».272 Cependant, cette décision pose question car le Conseil
indique que « rien ne s’oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la
Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des
dispositions nouvelles ». Le Conseil Constitutionnel donne ici l’impression d’effectuer un
contrôle de constitutionnalité par voie d’exception de l’article 37-1 de la Constitution. Cette
incise semble relancer le débat sur le contrôle des révisions constitutionnelles. Initié par la
décision Maastricht II273, la position ambiguë du Conseil consistait à admettre que « le
pouvoir constituant est souverain ; mais certaines limites doivent être observées ».274 Ce
270 Conseil Constitutionnel, n°2003-478DC du 30 juillet 2003, loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales, cons. 3, JORF, 2 août 2003, p.13302. 271 Conseil Constitutionnel, n°99-410DC du 15 mars 1999, loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, JORF, 21 mars 1999, p.4234, cons. 3. 272 LE MOIGNE Marthe, « Bloc de constitutionnalité et « droit post moderne » », RGCT, n°34, 2005, p.178. 273 Conseil Constitutionnel, n°92-312 du 2 septembre 1992, loi autorisant la ratification du Traité sur l’Union européenne, JORF, 3 septembre 1992, p.12095, cons. 19 274 FAVOREUX Louis, PHILIP Loïc, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Commentaire n°49, Paris, Dalloz, 2005, 13e édition, p.872.
112
débat semblait pourtant définitivement clos depuis la décision de mars 2003 où le Conseil
s’était déclaré incompétent pour apprécier la conformité à la Constitution de la révision
constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République275. La décision de
l’été 2004 relance le débat puisqu’elle indique que le pouvoir constituant connaît des limites.
Le juge constitutionnel reproduit cependant le problème déjà rencontré en 1992 à savoir qu’il
ne se prononce pas sur qui doit procéder à un tel contrôle. « Le considérant 9 de la décision
commentée fait ressortir la situation paradoxale à laquelle aboutit la position adoptée par le
juge à propos des révisions constitutionnelles ».276
Le Conseil constitutionnel déduit de l’ensemble de ces considérations que le
Parlement peut autoriser une expérimentation à certaines conditions. Ces conditions,
développées dans le considérant 9 de la décision, sont que les expérimentations doivent être
menées « dans la perspective de leur éventuelle généralisation », qu’elles doivent avoir un
objet et une durée limitée et que, enfin, « le législateur doit en définir de façon suffisamment
précise l’objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur
constitutionnelle ». On retrouve là peu ou prou les exigences de la jurisprudence
constitutionnelle antérieure. Il est toutefois permis de critiquer le fait que le Conseil
Constitutionnel ne fait aucune référence dans cette décision à l’obligation d’évaluation de
l’expérimentation. Les dispositifs expérimentaux déférés devant lui prévoyaient cette
évaluation. Le Conseil n’y fait pourtant aucune référence. L’évaluation étant un élément
constitutif de l’expérimentation, il est étrange que le Conseil n’ait pas rappelé sa nécessité. On
peut naturellement s’interroger sur ce silence. Est-il lié au fait que les dispositifs contestés
prévoyaient leur évaluation ou est-ce que le Conseil aurait modifié ses exigences ? On peut
espérer qu’il ne s’agit là que d’un oubli de la part des Sages de la rue Montpensier. L’article
37-1 de la Constitution ne prévoit pas cette exigence d’évaluation. Le Conseil Constitutionnel
a peut-être adapté sa jurisprudence au nouveau texte de la norme fondamentale. Toutefois,
une expérimentation pour laquelle aucune évaluation ne serait exigée ne peut être qualifiée
comme telle.
Le Conseil indique également dans sa décision que la loi d’habilitation ne peut porter
atteinte aux « autres exigences de valeur constitutionnelle ». Cette disposition renvoie à
275 Conseil Constitutionnel, n°2003-469DC du 26 mars 2003, loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République, JORF, 29 mars 2003, p.5570. 276 LE MOIGNE Marthe, op. cit., p.177.
113
l’ensemble des dispositions constitutionnelles, en dehors du principe d’égalité. Il s’agit ici
d’une mise en garde à l’encontre du Parlement et du Gouvernement. Si la loi d’habilitation ne
peut porter atteinte à une disposition constitutionnelle, il doit en être de même durant
l’expérimentation. Le Conseil Constitutionnel se prononce au sujet d’actes qui n’ont pas
encore été adoptés, les actes expérimentaux. Ces actes devront nécessairement respecter la
Constitution. Il est possible d’opérer ici un parallèle avec le contrôle des lois habilitant le
Gouvernement à intervenir par voie d’ordonnance, conformément à l’article 38 de la
Constitution. Si contrairement à l’expérimentation, les ordonnances ont vocation à être
pérennes, elles ont en commun de faire intervenir une loi d’habilitation. Le Conseil
Constitutionnel pourra se prononcer sur cette loi. Toutefois dans les deux cas, le contenu de la
loi ne sera pas précis puisqu’elle permet la mise en œuvre de d’autres types d’actes,
expérimentaux ou ordonnances, qui ne sont pas encore adoptés. Dès lors, « par ce contrôle, le
Conseil se situe dans une logique prospective, qui le conduit à anticiper le contenu des
futures ordonnances par rapport aux dispositions de la loi d’habilitation, parce qu’il peut
seulement « supposer » une future inconstitutionnalité ».277 Le raisonnement peut être étendu
au cas de l’expérimentation. Le juge constitutionnel ne peut pas savoir à l’avance comment
vont se dérouler les expérimentations. En prononçant la constitutionnalité de la loi portant
expérimentation, le Conseil valide d’avance la constitutionnalité des expérimentations elles-
mêmes.
b. L’analyse des dispositifs expérimentaux
Le juge constitutionnel analyse ensuite chacun des dispositifs expérimentaux contestés
pour en déclarer la conformité à la Constitution. Sur les sept dispositifs expérimentaux que
contenait la loi relative aux libertés et responsabilités locales quatre ont fait l’objet de griefs
devant le Conseil Constitutionnel. Cette saisine portait sur l’adéquation de ces
expérimentations avec le principe d’égalité.
La première disposition contestée était l’article 1 §II relatif à l’expérimentation sur les
schémas régionaux de développement économique. La saisine exposait le fait que « les
critères de choix de l’État ne sont pas autrement précisés ». Selon le Conseil,
l’expérimentation prévue à l’article 1er de la loi ne contrevient pas au principe d’égalité
277 VERPEAUX Michel, « Les ordonnances de l’article 38 ou les fluctuations contrôlées de la répartition des compétences entre la loi et le règlement », Les cahiers du Conseil Constitutionnel, n°19, 2005, p.98.
114
puisque « toutes les régions pourront élaborer un schéma régional de développement
économique et que l’État leur délèguera les aides qu’il attribue dès lors que ce schéma
répondra aux conditions fixées par la loi ».
L’expérimentation prévue à l’article 44 est relative à la gestion des fonds structurels
européens. Cette disposition était critiquée par les requérants qui estimaient que le choix de la
collectivité expérimentatrice serait fait de façon discrétionnaire par les services centraux. Le
Conseil Constitutionnel rejette cette argumentation puisqu’il constate que « ces dispositions
prévoient explicitement la primauté de la région » et que les « autres collectivités territoriales
ne pourront être candidates à une telle expérimentation que si la région ne souhaite pas y
participer ». Contrairement à ce que soutenaient les requérants, il n’y a donc pas dans cette
expérimentation de possibilité de « contourner »278 les régions.
Le troisième dispositif expérimental contesté était celui prévu à l’article 70 de la loi,
qui permet aux régions de participer au financement et à la réalisation d’équipements
sanitaires. Les requérants critiquaient le caractère discrétionnaire du choix de la seule région
pour participer à cette expérimentation puisque « aucune indication ne figure sur les critères
de ce choix ». Les requérants faisaient également griefs à cette disposition de ne pas avoir
précisé le contenu de la convention, passée entre la région et l’agence régionale
d’hospitalisation, ce qui se traduirait par des inégalités de traitement. Le Conseil
Constitutionnel rejette, là aussi, les griefs. Il estime que cette expérimentation « est offerte de
plein droit à toute région qui en ferait la demande ». Quant au contenu de la convention, il
« se bornera à servir de cadre à l’intervention de la région et à fixer les modalités de sa
participation financière, après délibération du conseil régional ». Il n’y a là aucune incidence
sur l’égalité de traitement pour le juge constitutionnel.
Enfin, dernière disposition expérimentale contestée, l’article 86 de la loi, qui
permettait de tester un nouveau mode d’organisation des écoles primaires, grâce à la création
d’établissements publics d’enseignement primaire. Les requérants faisaient ici grief au texte
de « renvoyer à un décret en Conseil d'État les règles d’organisation qui ne sont pas plus
précisément définies par le loi ». La saisine voulait faire apparaître une incompétence
négative du législateur, non pas tant par rapport à l’expérimentation elle-même mais
concernant la création d’un établissement public. Selon l’article 34 de la Constitution, seul le
législateur est compétent pour « la création de catégorie d’établissements publics ». Le
Conseil Constitutionnel rejette cette argumentation puisqu’il considère que « ces
278 La saisine parlementaire faisait grief à cette disposition de donner, au Gouvernement, « la possibilité de contourner les régions qui refusent l’expérimentation ».
115
établissements publics locaux d’enseignement ne constituent pas une catégorie nouvelle
d’établissements publics ». Dès lors, il était loisible au législateur de renvoyer à un décret en
Conseil d'État la détermination de règles d’organisation et de fonctionnement de ces
établissements.
Les expérimentations prévues dans la loi relative aux libertés et responsabilités locales
ont fait l’objet d’un contrôle par le Conseil Constitutionnel, ce qui n’est pas le cas des lois
relatives à l’expérimentation du RSA.
2. L’absence de contrôle des lois portant expérimentation du RSA
Comme déjà exposé précédemment, la mise en place de l’expérimentation relative au
RSA a nécessité l’intervention de trois dispositifs législatifs. Parmi ces lois, aucune n’a fait
l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel concernant l’expérimentation du RSA.
La loi relative au travail, à l’emploi et au pouvoir d’achat de l’été 2007 a fait l’objet
d’une saisine du Conseil Constitutionnel, mais relative aux exonérations fiscales contenues
dans la loi279. Cette décision se termine par l’habituel considérant selon lequel « il n’y a lieu,
pour le Conseil Constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la
Constitution ». Ce dernier considérant a pour conséquence d’accorder un brevet de
constitutionnalité à l’ensemble des dispositions de la loi, non contestées devant le Conseil. Il
faut en déduire que les articles de la loi du 21 août 2007 relatifs à l’expérimentation sur le
RSA sont conformes à la Constitution. Une autre solution aurait été difficilement
envisageable puisque les dispositifs étaient suffisamment précis et remplissaient l’ensemble
des conditions relatives aux lois expérimentales. L’expérimentation était circonscrite dans son
objet et sa durée, l’évaluation était prévue et l’expérimentation avait vocation à préfigurer une
généralisation du dispositif.
Il est toutefois possible d’opérer une critique de cette expérimentation sur la base de la
jurisprudence constitutionnelle. Le législateur en faisant intervenir trois lois différentes pour
mettre en place cette expérimentation n’a pas respecté « l’objectif à valeur constitutionnelle
279 Conseil Constitutionnel, n°2007-555DC du 16 août 2007, loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, JORF, 22 août 2007, p.13959.
116
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ».280 Cet objectif vise à contrôler la qualité de la loi.
Il s’agit de vérifier que l’accessibilité, tant matérielle qu’intellectuelle de la loi, est assurée.
Du point de vue l’intelligibilité, il s’agit de « contrôler la clarté et la précision de la
disposition contestée ».281 Or la multiplication des dispositifs législatifs dans la mise en place
de l’expérimentation du RSA complexifie d’autant plus sa compréhension. Cette absence de
clarté des dispositions sur l’expérimentation n’aura pas pu être contestée devant le juge
constitutionnel puisque ce n’est pas une disposition en particulier qui contrevient à l’objectif à
valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi. Ce qui est critiquable dans cette
expérimentation, c’est un ensemble. D’autant plus que, à la suite de certains auteurs, on peut
admettre que « l’objectif à valeur constitutionnelle, s’il prend un sens positif de contrainte
pour l’État, exprimant ainsi un devoir des pouvoirs publics, n’engendre pas pour autant un
droit de créance que pourrait évoquer une personne ».282 L’expérimentation étant par nature
source de perturbation pour le citoyens, il est important que sa mise en œuvre au niveau
législatif soit claire. Telle n’est pas le cas pour l’expérimentation relative au RSA, ce qui est
d’autant plus regrettable puisque les destinataires de cette expérimentation sont les
administrés eux-mêmes.
Une fois l’expérimentation réalisée et évaluée, il faudra décider de son issue.
L’objectif d’une expérimentation, en principe, est de procéder à la généralisation du
dispositif. Si l’expérimentation avait lieu dans le domaine législatif, c’est par la loi que le
dispositif serait généralisé, offrant une nouvelle possibilité d’intervention du Conseil
Constitutionnel.
§2. Le contrôle des lois de généralisation
Les lois portant généralisation d’un dispositif expérimental sont des lois ordinaires.
Elles peuvent donc être déférées devant le Conseil Constitutionnel dans les conditions
normales du recours. Le juge opère alors un contrôle de constitutionnalité des dispositions qui
auront été auparavant expérimentées. L’intérêt d’un tel contrôle est essentiellement en matière
d’expérimentation dérogation. Dans le cadre de l’article 72, alinéa 4, les collectivités 280 Conseil Constitutionnel, n°99-421DC du 16 décembre 1999, loi portant habilitation pour le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie Législative de certains codes, JORF, 22 décembre 1999, p.19041, cons. 13. 281 MILANO Laure, « Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi », RDP, n°3, 2006, p.647 282 FRISON-ROCHE Marie-Anne, BARANÈS William, « Le principe constitutionnel de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi », Recueil Dalloz, n°23, 2000, p.362.
117
territoriales peuvent être autorisées à déroger aux domaine de la loi et du règlement. Elles
peuvent adopter des dispositions qui matériellement interviennent dans le domaine de
compétence du législateur. Ces dispositions seront ensuite généralisées et elles pourront être
soumise à un contrôle de constitutionnalité.
Un tel contrôle n’a jusqu’à maintenant encore jamais eu lieu (B) et on peut donc
s’interroger sur le contenu de ce contrôle (A).
A. Le contrôle du respect de la procédure
On peut supposer qu’une loi procédant à la généralisation d’un dispositif expérimental
soit soumise au Conseil Constitutionnel. L’intérêt d’une telle requête se trouve dans la
possible contestation du respect de la procédure expérimentale. La procédure expérimentale,
encadrée par la Constitution et une loi organique, doit être respectée. Toutefois, il faut
également préserver la souveraineté du Parlement. Une telle hypothèse conduirait alors le
Conseil Constitutionnel à opérer une conciliation entre l’obligation de suivre la procédure
expérimentale telle qu’elle est prévue dans les textes et la souveraineté du Parlement. Du
point de vue de la procédure législative, le droit à l’expérimentation impose le respect d’un
certain nombre de délais : pour la durée de l’expérimentation, pour sa prolongation, pour le
dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi sur sa généralisation ou son abandon. Le Conseil
Constitutionnel pourrait ici trouver des raisons de déclarer des dispositions contraires à la
Constitution. « On voit mal d’ailleurs, ce vice étant ici très probablement substantiel,
comment la loi pourrait échapper à la censure du juge constitutionnel ».283 Plus que le fond
de la loi, ce qui peut être source d’une inconstitutionnalité en matière d’expérimentation c’est
le non-respect de la procédure.
Le Parlement demeure toujours le maître de la production législative. Rien ne lui
interdit de se déjuger ou de revenir sur ce qu’il a décidé. Ainsi, il peut très bien décider de
l’abandon de l’expérimentation avant même la fin de celle-ci ou au contraire procéder à sa
généralisation avant même son évaluation. Le Conseil Constitutionnel pourrait difficilement
opérer la censure d’une loi sur le fondement d’une telle argumentation. Il y aurait un trop
grand risque pour lui d’être accusé de vouloir mettre en place un gouvernement des juges.
Visant alors à sa propre sauvegarde, le juge constitutionnel sera assez peu enclin à ce type de
contrôle. Toutefois un tel contrôle ne s’est encore jamais produit.
283 RICCI Jean-Claude, « Regards juridiques sur l’expérimentation en matière de collectivités territoriales », in Les collectivités locales et l’expérimentation : perspectives nationales et européennes, op. cit., p.215.
118
B. L’absence de contentieux dans les faits
La plupart des expérimentations prévues dans la loi du 13 août 2004 sont encore en
cours. Dès lors, aucune loi n’est encore intervenu pour procéder à la généralisation des
transferts et il n’existe donc aucun contentieux. Ces dispositions procèdent à des
expérimentations transferts. Si ces transferts sont généralisés, le risque devant le Conseil
Constitutionnel est de connaître une censure pour non-respect de l’autonomie financière des
collectivités locales. Le transfert de nouvelles compétences aux collectivités implique
également le transfert de nouvelles charges. Ces nouvelles charges obligatoires pour les
collectivités territoriales sont autant de limitations de leur autonomie financière. S’il est
loisible au législateur de créer de nouvelles catégories de dépenses pour les collectivités
territoriales, ces charges « doivent être définies avec précision quant à leur objet et à leur
portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni
entraver leur libre administration ».284 Le Conseil se montrera sûrement très vigilant sur cet
élément au moment de la généralisation de ces transferts.
L’expérimentation relative au RSA a fait l’objet d’une généralisation avant même la
fin de l’expérimentation. C’est l’objet de la loi n°2008-1249, du 1er décembre 2008285. Le juge
constitutionnel n’a pas été saisi de cette loi, essentiellement pour des raisons politiques
d’ailleurs. Le texte n’a donc été soumis à un aucun contrôle « alors que certaines de ses
dispositions auraient sans nul douté mérité un examen ».286 Il existe un consensus autour de
l’adoption de cette disposition. Toute la classe politique a admis la généralisation du RSA – la
proposition d’un tel revenu était d’ailleurs présente dans le programme des deux candidats au
second tour de l’élection présidentielle – la contestation de cette loi devant le Conseil était
alors peu envisageable.
En plus d’un contentieux devant le juge constitutionnel, l’expérimentation peut
conduire à l’intervention du juge administratif, dans un cadre qui reste encore à préciser
284 Conseil Constitutionnel, n°90-274DC du 29 mai 1990, loi visant à la mise en œuvre du droit au logement, JORF, 1er juin 1990, p.6518, cons. 16. 285 Loi n°2008-849 du 1 décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et reformant les politiques d’insertion, op. cit. 286 RIHAL Hervé, op. cit., p.198
119
Section 2. Un contentieux administratif à clarifier
Différents types d’actes relatifs à des expérimentations peuvent être source de
contentieux devant le juge administratif. On s’intéressera ici uniquement au contentieux des
actes dérogatoires adoptés par les collectivités territoriales durant une expérimentation
dérogation. Cette question est la plus intéressante car il existe une certaine incertitude quant à
la nature de ces actes et du contrôle opéré à leur égard.
Il existe effectivement un autre type de contentieux qui est celui relatif aux décrets
portant expérimentation. Les expérimentations intervenant dans le domaine réglementaire
sont décidées par le Gouvernement et mises en œuvre par décret en Conseil d'État. Ces
décrets peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, et plus particulièrement
devant le juge suprême de l’ordre administratif, puisque ce sont des actes administratifs.
Toutefois, il n’existe pas d’exemple d’un tel contentieux depuis la révision constitutionnelle
de 2003. Le contenu théorique du contrôle opéré par le Conseil d'État est toutefois simple. Il
s’agit pour le Conseil d'État de réaliser sur ces décrets un contrôle qui se rapproche de celui
exercé par le Conseil Constitutionnel sur les lois portant expérimentation. Le juge
administratif doit vérifier que le décret comporte bien l’ensemble des éléments nécessaires
pour qu’il soit qualifié d’expérimentation. On retrouve alors le triptyque définissant
l’expérimentation à savoir un objet et une durée limités, l’obligation de procéder à une
évaluation et l’objectif de procéder à la généralisation du dispositif en cas de résultats positifs.
De même pour les actes procédant à la généralisation du dispositif expérimental, ils peuvent
également faire l’objet d’un contrôle, similaire à celui que le Conseil Constitutionnel pourrait
opérer sur les lois de généralisation. L’objet de ce contrôle est alors de vérifier que la
procédure expérimentale a bien été respectée, notamment les différents délais impartis.
Il existe également un autre risque de contentieux administratif, c’est sur la base des
conventions passées entre l’État et les collectivités expérimentatrices. Ces conventions, qui
sont les feuilles de routes des administrations locales, relèvent de la compétence du juge
administratif puisqu’elle sont conclues entre deux personnes publiques et qu’elles portent sur
l’exercice de leurs compétences respectives. Ces conventions portent les engagements
réciproques de l’État et des collectivités territoriales dans le cadre de l’expérimentation. Elles
pourraient être annulés en « l’absence de précision suffisante de l’étendue (périmètre) de la
120
compétence expérimentée et des attributions y afférentes ».287 Ces conventions ont un
caractère obligatoire pour chacune des parties, leur responsabilité peut donc être engagée en
cas de non-respect de leurs engagements. Les collectivités locales peuvent exiger le paiement
par l’État de la part de l’expérimentation que celui-ci s’était engagé à financer ou encore
exiger le transfert des personnels et biens nécessaires à l’exercice de la compétence
expérimentale. « En revanche, on peut se demander de quel préjudice de l’État pourrait se
prévaloir en cas d’inexécution du contrat ».288 Le transfert de compétences par
l’expérimentation implique aussi un transfert de responsabilité. Les collectivités territoriales
mettent en jeu leur responsabilité, c'est-à-dire que les dommages causés par la mise en œuvre
de la compétence expérimentale sont imputés à la collectivité expérimentatrice. Le risque
engagé pour la collectivité semble être quelque peu excessif. Une collectivité locale peut voir
sa responsabilité engagée pour une compétence exercée à titre expérimental qu’elle n’est
même pas sûre de conserver définitivement.
L’objectif est ici d’analyser les actes pris dans le cadre de l’expérimentation prévue à
l’article 72, alinéa 4, de la Constitution. Durant l’expérimentation, les collectivités
territoriales sont autorisées à adopter des actes qui, s’ils sont formellement des actes
administratifs, peuvent intervenir à la fois dans le domaine de la loi et dans le domaine du
règlement. Cette dualité interroge sur le type d’acte dont il s’agit. D’ailleurs pour mettre en
évidence ce caractère dual, on a pu trouver ces actes qualifiés d’actes « chauve-souris »289
sous la plume d’un auteur. L’incertitude sur la nature de ces actes se retrouve dans leur
régime contentieux. Ces actes ne peuvent être soumis au régime contentieux de droit commun
des actes administratifs, mais le législateur organique n’a pas été jusqu’à créer un régime
contentieux totalement original pour ces actes. Les actes dérogatoires sont soumis à un
contrôle spécifique qu’on peut rapprocher de celui que le Conseil d'État opère sur les
ordonnances de l’article 38, de la Constitution, avant leur ratification.
Il faut donc analyser la nature juridique des actes dérogatoires (§1) pour comprendre le
contrôle opéré par le juge administratif (§2).
287 CHAVRIER Géraldine, « Expérimentation territoriale », op. cit., p.14. 288 Idem, p.14. 289 JANIN Patrick, « L’expérimentation juridique dans l’acte II de la décentralisation », JCP-A, n°41, 2005, p.1528.
121
§1. Des actes hybrides
Les actes adoptés par les collectivités locales durant la période d’expérimentation sont
des actes à part. Ils ont une double nature. « La nature juridique des actes dérogatoires
expérimentaux a fait l’objet de nombreux débats lors de l’examen de la loi
constitutionnelle ».290 Ce sont des actes administratifs puisqu’ils sont adoptés par les autorités
locales mais ils peuvent intervenir dans le domaine de la loi, à titre dérogatoire. Ils sont
formellement administratifs et leur contenu peut être de nature législative. On se retrouve
alors dans une situation quelque peu paradoxale où un acte administratif est autorisé à déroger
à des dispositions législatives. L’ordonnancement hiérarchique des normes n’est plus respecté
durant la période expérimentale. La Constitution demeure toujours au sommet de cette
hiérarchie, mais, au niveau inférieur, le règlement peut intervenir dans le domaine qui ressort
normalement de la compétence du législateur.
Cette double nature n’est pas plus développée dans les textes. Le CGCT dispose en
son article LO 1113-3 qu’il s’agit d’ actes « à caractère général et impersonnel d’une
collectivité territoriale portant dérogation aux dispositions législatives ». Durant la période
d’expérimentation, les collectivités territoriales – disposant en principe seulement d’un
pouvoir réglementaire – sont admises à déroger aux normes législatives. Le pouvoir
réglementaire local se voit accorder le droit de modifier des dispositions législatives.
L’expérimentation fait perdre, pour une durée limitée, le monopole dont dispose
habituellement le Parlement. Le domaine de la loi n’est plus réservé à la seule représentation
nationale, les autorités locales peuvent intervenir dans un domaine qui leur est normalement
interdit. L’expérimentation modifie, pour un objet et une durée limités, la répartition des
compétences en matière législative. Il n’est pas alors aisé de ranger ces actes dans la pyramide
des normes classique. « Ces actes s’apparentent à des sortes d’actes « intermédiaires » entre
la loi et le règlement ».291 Dès lors, comme en matière d’ordonnance, c’est le régime juridique
de ces actes qui les impose comme des actes administratifs. « En soumettant [une ordonnance
de l’article 38 de la Constitution] au régime contentieux des actes administratifs, le Conseil
d'État affirme la nature administrative de l’acte qui dès lors, découle du régime contentieux
qu’il suit et non l’inverse ».292 On peut admettre le même raisonnement pour les actes
dérogatoires. Le CGCT ne dispose pas qu’ils sont des actes administratifs. Cependant leur 290 PIRON Michel, Rapport n°955, op. cit., p.31. 291 BROSSET Estelle, op. cit., p.726. 292 BOYER-MÉRENTIER Catherine, Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, Thèse, Presses Universitaires d’Aix-Marseille – Economica, Paris, 1996, p.156.
122
régime contentieux est le même que ceux-ci – ce qui n’est pas sans conduire à quelques
interrogations sur les modalités du contrôle de légalité exercé sur ces actes.
§2. Un contrôle spécifique
La lecture du CGCT laisse à penser que les actes expérimentaux sont soumis à un
recours de droit commun (A). Toutefois, la nature spécifique de ces actes entraîne une
nécessaire adaptation du contrôlé opéré par le juge (B).
A. La soumission au recours de droit commun
C’est l’article LO 1113-4 du CGCT qui prévoit la nature du contrôle opéré par le juge
administratif sur les actes dérogatoires. Cet article dispose que « le représentant de l’État peut
assortir un recours dirigé contre un acte pris en application du présent chapitre [celui relatif
à l’expérimentation] d’une demande de suspension ; cet acte cesse alors de produire ses effets
jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal
administratif n’a pas statué dans un délai d’un mois suivant sa saisine, l’acte redevient
exécutoire ».
Il n’est pas évident à la seule lecture de cette disposition que les actes expérimentaux
soient soumis au recours de droit commun. Il n’est pas dit explicitement dans cet article que le
juge administratif connaît des actes expérimentaux dans les mêmes conditions qu’un recours
de légalité normal. C’est le fait que cet article évoque le tribunal administratif et le recours
opéré par le préfet devant celui-ci. La rédaction de l’article peut toutefois laisser planer un
doute. D’ailleurs, lors de son passage en Commission à l’Assemblée nationale cet article avait
été amendé. Il avait été « adopté un amendement du rapporteur indiquant de façon explicite
que les actes expérimentaux dérogatoires sont soumis aux mêmes règles de contrôle que les
actes de droit commun des collectivités territoriales ».293 Force est de constater que cet
amendement n’a finalement pas été adopté. C’est dommageable car un tel amendement, loin
d’alourdir un peu plus la rédaction du Code, aurait apporté une importante explication.
L’amendement, dans l’esprit des membres de la Commission, visait à améliorer « la clarté et
la bonne compréhension de la loi organique ».294 Les actes expérimentaux sont soumis au
régime de droit commun quant à leur contrôle de légalité. Cependant, ce sont des actes
293 PIRON Michel, Rapport n°955, op. cit., p.32. 294 Idem
123
spécifiques, puisqu’ils peuvent intervenir en matière législative, le contrôle sera donc
nécessairement adapté. Pourtant, « le contrôle administratif sur les actes expérimentaux pris
par les collectivités territoriales dans le domaine législatif ne paraît pas, a priori, très
spécifique ».295
La caractéristique des actes expérimentaux est marquée à l’article LO 1113-4 avec la
demande de suspension dont le préfet peut assortir son recours. Une telle demande de
suspension existe dans le droit commun, ce qui est frappant ici c’est son inconditionnement.
Dans le cadre d’un recours de droit commun, la demande de suspension pour être accordée
doit répondre à certains critères, tel n’est pas le cas en l’espèce. « Nulle condition n’est exigée
pour l’octroi de cette suspension alors que le droit commun prévoit que celle-ci est accordée
lorsqu’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte ».296
Pour que la suspension soit accordée, il y a tout de même une condition, la demande doit être
déposée par le représentant de l’État en même temps qu’un recours en contrôle de légalité de
l’acte. Cette suspension accordée automatiquement laisse planer un doute sur la finalité du
contrôle. Le renforcement des pouvoirs du représentant de l’État à l’égard des actes des
collectivités locales pose question. On a l’impression que c’est une tutelle qui se remet en
place, alors même que celle-ci a été abolie depuis 1982297. La suspension de l’acte est
automatiquement accordée pour une durée d’un mois. L’objectif de la suspension est d’éviter
que ne se créent des situations de fait sur une base illégale. Au-delà de ce délai, si le juge
administratif ne s’est pas prononcé l’acte redevient exécutoire. Ce délai d’un mois, s’il est
nécessaire pour que le juge puisse statuer, demeure long dans le cadre d’une procédure
expérimentale qui doit être circonscrite dans le temps.
B. L’adaptation du contrôle aux actes dérogatoires
Les actes dérogatoires adoptés durant l’expérimentation sont de nature spécifique. Dès
lors ils ne peuvent pas être soumis à un contrôle de légalité classique. Ces actes peuvent être
amenés à déroger à la loi, leur contrôle de légalité doit nécessairement être adapté.
« Comment admettre qu’un acte soit soumis à des normes qu’il peut en même temps écarter ?
Il s’agit d’une approche pour le moins schizophrénique puisqu’elle exige d’admettre le
295 BROSSET Estelle, op. cit., p.731. 296 VERPEAUX Michel, « La loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales », JCP-A, n°20, 2004, p.662. 297 Loi n°82-213, du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dite loi Defferre, JORF, 3 mars 1982, p.730, art. 2.
124
dédoublement du régime juridique de ces actes qui peuvent si hisser au rang législatif pour
modifier des dispositions législatives, mais retombent ensuite, comme « une énorme
baudruche », au rang réglementaire s’agissant de leur régime contentieux ».298 Le contrôle
de légalité opéré sur les actes adoptés à titre expérimental doit tenir compte de la nature
hybride de ces actes.
La réalisation d’un tel contrôle n’est pas une entière nouveauté pour le juge
administratif. Il est possible d’opérer un rapprochement entre le contrôle des actes
expérimentaux et le contrôle des ordonnances de l’article 38 de la Constitution avant leur
ratification. « Du point de vue, (…) de leur régime contentieux, ce sont des actes
réglementaires dont la validité peut être contrôlée tant au regard de la Constitution que de la
loi d’habilitation – ce qui est logique – mais aussi, à l’égard des principes généraux du droit
dont on sait qu’ils n’ont qu’un rang infra législatif et peuvent être écartés par la loi ».299 Les
deux types d’actes partagent ce caractère hybride, intervenant dans le domaine de la loi mais
relevant du régime contentieux des actes administratifs. Le Conseil d'État a développé depuis
longtemps une abondante jurisprudence relative au contrôle des ordonnances de l’article 38.
Cette jurisprudence peut largement être transposée au cas du contrôle des actes adoptés durant
l’expérimentation. Le juge administratif peut, ainsi, mettre en place un contrôle des actes
expérimentaux dont les éléments sont déjà connus. C’est un contrôle de légalité spécifique
mais pas entièrement nouveau qui doit se mettre en place.
Cinq éléments de contrôle peuvent être mis en évidence. Les actes adoptés à titre
expérimental doivent respecter la loi d’habilitation, les normes constitutionnelles, les
engagements internationaux de la France, les principes généraux du droit et, enfin, le juge doit
opérer un contrôle de proportionnalité sur les mesures adoptées.
Le juge doit s’assurer que les actes adoptés à titre expérimental respectent bien la loi
d’habilitation. Cette loi définit le cadre temporel mais aussi matériel dans lequel peuvent
intervenir les actes dérogatoires. Elle délimite le pouvoir d’intervention des autorités locales.
Le juge administratif doit veilleur au respect de ces limitations. Tout acte qui dérogerait à des
dispositions non prévues dans la loi d’habilitation devra être censuré. Le pouvoir
réglementaire local ne peut pas aller au-delà de l’habilitation qui lui a été donnée. Cependant,
l’expérimentation étant basée sur le volontariat, on ne pourrait pas censurer un acte
298 BROSSET Estelle, op. cit., p.730. 299 FAVOREU Louis (Dir), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2008, 11e édition, p.844.
125
dérogatoire pour incompétence négative. Les autorités locales sont autorisées à déroger à un
certain nombre de dispositions de nature législative ou réglementaire durant
l’expérimentation, mais nullement obligées de déroger à toutes. Au contraire, le risque auquel
doit veiller le juge administratif est celui qu’une collectivité adopte des actes expérimentaux
dans des domaines où elle n’y a pas été autorisée. En matière d’ordonnance de l’article 38 de
la Constitution, le contrôle est similaire et le Conseil d'État vérifie que le Gouvernement n’est
pas allé au-delà de l’habilitation qu’il a reçue300. « L’ordonnance est bien sur contrôlée au
regard de la loi d’habilitation. (…) Le gouvernement ne peut exercer sa compétence que dans
les matières énumérées, dont il est plus exact de dire qu’il s’agit de mesures législatives
rigoureusement déterminées quant à leur domaine d’intervention et quant à leur finalité ».301
Il s’agit là pour le juge administratif de la part la plus importante du contrôle qu’il opère sur
ces actes. La loi d’habilitation étant le cadre de l’expérimentation, le juge doit s’assurer que
les autorités locales ne sortent pas de ce cadre. Le juge administratif doit également veiller à
la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à sa procédure d’édiction. La loi portant
expérimentation ou encore les conventions passées entre les collectivités expérimentatrices
peuvent prévoir à quelle autorité en particulier est attribuée la compétence expérimentée :
assemblée délibérante de la collectivité ou son exécutif. Le juge administratif contrôle que
l’autorité qui a adopté l’acte dérogatoire avait bien compétence pour le faire. De même en
matière de procédure d’édiction, les actes dérogatoires sont soumis à une procédure
spécifique qui suppose, en plus de la transmission des actes au représentant de l’État, une
publication au Journal Officiel. Respect de l’étendue de l’habilitation législative, compétence
de l’auteur de l’acte et respect de la procédure d’édiction, le contrôle de légalité opéré par le
juge administratif sur les actes dérogatoires est pour l’essentiel un contrôle de légalité externe.
Il semble nécessaire qu’il soit opéré, ensuite, un contrôle des actes expérimentaux à
l’égard des principes constitutionnels. Un tel contrôle est opéré pour les ordonnances302. Dans
les deux cas, la loi d’habilitation n’est pas un écran entre l’acte contrôlé et la Constitution. La
loi d’habitation ne contient pas de dispositions précises, elle est un blanc-seing, pour
intervenir librement dans une domaine strictement limité, accordé à l’administration – le
Gouvernement dans le cadre d’une ordonnance, le pouvoir local dans le cadre d’une
300 V. par ex. Conseil d'État, 3 juillet 1998, Syndicat des médecins Aix et région, Rec p.266. 301 BOYER-MÉRENTIER Catherine, « Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution : une place ambiguë dans la hiérarchie des normes », RFDA, 1998, p.933. 302 V. par ex. Conseil d'État, 17 décembre 1969, Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Rec. p.584 ou, plus récemment, 1er décembre 1997, Union des professions de santé libérale SIS Action santé, Rec. p.449.
126
expérimentation. Dès lors cette habilitation ne peut pas faire écran entre l’acte contrôlé et la
Constitution. « La loi d’habilitation est par définition un écran partiel. Son contenu se limite
à établir la compétence matérielle et temporelle »303 des autorités administratives qui seront
autorisées à expérimenter. Ces autorités administratives détermineront ensuite elles-mêmes le
contenu des actes dérogatoires. C’est ce contenu qui devra être confronté aux normes
constitutionnelles. Même si ces actes peuvent intervenir dans le domaine de la loi, le juge
administratif devra opérer un contrôle de constitutionnalité à leur encontre. Seule spécificité,
le contrôle de constitutionnalité subit ici « un déplacement du juge constitutionnel au juge
administratif ».304
Le juge administratif doit également s’assurer que les actes dérogatoires adoptés par
les collectivités territoriales ne contreviennent pas aux engagements internationaux de la
France. Les actes adoptés durant l’expérimentation sont des actes administratifs, ils doivent
être conformes aux engagements internationaux. Le juge administratif pourra contrôler ces
actes à l’égard de traités internationaux, et notamment à l’égard de tout le droit
communautaire. Ce contrôle à l’égard des engagements internationaux de la France est
important. Si les dispositions avaient été adoptées directement par le Parlement, on sait que le
Conseil Constitutionnel – en l’état actuel de sa jurisprudence – refuse de contrôler une loi par
rapport aux traités. Au contraire le juge administratif contrôle le respect des traités. En
fonction de l’acte qu’il a à contrôler la nature du contrôle diverge. Face à une loi contraire à
un engagement international, le juge administratif ne peut qu’en écarter l’application en
l’espèce ; alors que face à un acte administratif contraire à ce même engagement, le juge peut
annuler cet acte. Le passage par le truchement de l’expérimentation permet alors d’effectuer
ce contrôle de manière plus approfondie.
Il existe un risque de contrariété, non négligeable entre les actes adoptés à titre
expérimental et le droit communautaire. Le droit communautaire est aujourd’hui une
importante source de notre législation nationale, notamment en droit économique.
L’expérimentation relative à l’adoption d’un schéma régional de développement économique
en est une illustration intéressante. L’adoption de ce schéma permet aux régions de gérer les
aides économiques attribuées aux entreprises, aides qui sont en principe gérées par l’État. Le
droit communautaire prohibe strictement les aides d’État, sur le fondement du paragraphe 2 303 BOYER-MÉRENTIER Catherine, « Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution : une place ambiguë dans la hiérarchie des normes », op. cit., p.926. 304 BOYER-MÉRENTIER Catherine, Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, op. cit., p.170
127
de l’article 86 du traité sur la Communauté européenne. La jurisprudence communautaire a
quelque peu assoupli cette interdiction en autorisant de telles aides, à condition qu’elles visent
à compenser des obligations de service public305. Sans aller jusqu’à dire que les régions sont
moins compétentes que l’État pour accorder ces aides, la diversité des schémas régionaux de
développement économique adoptés est une source potentielle de contentieux avec le droit
communautaire.
Les actes dérogatoires, en tant qu’ils sont des actes administratifs, demeurent soumis
au respect des principes généraux du droit. Il en va, d’ailleurs, de même pour les ordonnances
non ratifiées306. Il y a là une véritable difficulté, symbolique de la nécessité de créer un
contrôle spécifique pour les actes dérogatoires. Les principes généraux du droit ont une valeur
infra législative mais supra décrétale. Or les actes adoptés durant l’expérimentation sont des
actes administratifs, mais peuvent contenir des dispositions de nature législative. Les
contrôler à l’aune des principes généraux du droit signifierait, alors, qu’ils pourraient être
censurés pour non-respect d’un tel principe, mais que le législateur lors de la généralisation
du dispositif pourrait écarter l’application de ce principe. On aboutit alors à une situation
paradoxale, qui se rencontre également en matière d’ordonnance. On peut alors rejoindre les
auteurs pour qui « le non-respect par l’ordonnance d’un principe général du droit ne peut
être sanctionné que s’il s’agit en réalité d’un dépassement du domaine habilité ».307 Le même
raisonnement peut être transposé aux actes dérogatoires. Dès lors, le respect par ceux-ci des
principes généraux du droit revient à un contrôle du respect du domaine d’habilitation.
Dernier élément sur lequel le contrôle du juge administratif doit porter c’est
l’adéquation entre la mesure adoptée et l’objectif visé. Le juge doit ici réaliser un contrôle de
proportionnalité. On sait que par définition une expérimentation porte atteinte au principe
d’égalité. Cette atteinte est admise au nom de l’intérêt général. Le juge doit opérer un contrôle
afin de s’assurer que l’objectif d’intérêt général n’est pas oublié et que l’atteinte au principe
d’égalité demeure limitée.
305 CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH c/ Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH. , aff. C-280/00, Rec. p.I-7747. 306 V. par ex. Conseil d'État, 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de courses des hippodromes de province et autres, Rec. p.427. 307 BOYER-MÉTENTHIER Catherine, « Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution : une place ambiguë dans la hiérarchie des normes », op. cit., p.936.
128
En l’absence de contentieux dans les faits, ces quelques réflexions n’ont qu’une nature
prospective et ne peuvent préjuger du type de contrôle qu’effectuera le juge. Force est de
constater, toutefois, que le juge administratif dispose de l’ensemble des techniques
nécessaires à la réalisation d’un contrôle efficace sur les actes adoptés durant
l’expérimentation. Si les textes suggèrent, a priori, le recours à un contrôle de légalité
classique, il est nul doute que le juge adaptera ce contrôle à la nature hybride des actes
auxquels il est confronté dans pareil cas. Un contrôle de légalité de type classique serait trop
strict et conduirait à limiter l’initiative locale. L’expérimentation ayant pour but de permettre
aux collectivités territoriales d’adopter des normes innovantes et spécifiques, la réalisation
d’un contrôle de légalité classique ferait échouer un tel objectif. Un contrôle de légalité opéré
sur un acte dérogatoire par rapport aux dispositions législatives que ce même acte est autorisé
à écarter rendrait l’intérêt de l’expérimentation nul. Tout comme en matière d’ordonnances,
« la loi d’habilitation devient pour [les actes dérogatoires] la seule norme de référence que le
Conseil d'État peut leur opposer ».308 Lors du contrôle de légalité des actes dérogatoires, la
loi d’habilitation doit être l’horizon premier du contrôle du juge administratif. Il est cependant
dommage que ni le constituant, ni le législateur organique n’aient prévu les modalités de
contrôle des actes dérogatoires. Il aurait été plus « cohérent de reconnaître leur particularité
matérielle et d’adapter leur régime contentieux en conséquence, en prévoyant un contrôle de
légalité spécifique ».309
308 BOYER-MÉRENTIER Catherine, Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, op. cit., p.168. 309 BROSSET Estelle, op. cit., p.730.
130
Entretien réalisé le 20 janvier 2009
Mme Vaugelade et M Beldave
Responsables auprès Conseil Général de l’Hérault des questions d’insertion
Question : Pourquoi le département s’est-il lancé dans l’expérimentation sur le RSA ?
Réponse :
-Mme Vaugelade : Quand on a su qu’allait se mettre en place le revenu de solidarité active, on
avait depuis quelques temps déjà, dans l’Hérault, une expérience en matière de revenu
minimum d’activité, le RMA, qu’on avait beaucoup modifié. Le RMA quand il est sorti,
c’était un dispositif pour neuf mois renouvelables une fois, les mois travaillés ne
correspondaient pas aux mois cotisés pour la retraite et le nombre d’heures était relativement
bas. On s’était dit, ok on va dans le RMA mais on va le faire de manière héraultaise. Donc on
l’a fait plus court, six mois non reconductibles, sauf exception, et on avait accompagné le
RMA de toute une négociation avec l’entreprise pour mieux accompagner la personne dans
l’emploi. Fort de cette expérience on s’était rendu compte qu’on arrivait à un résultat de
l’ordre de 80% de nos RMA+ qui aboutissaient à une pérennisation dans l’emploi ; alors que
le résultat au niveau national du RMA classique était très mauvais. On s’est vite rendu compte
qu’en négociant avec les entreprises très tôt, en les sélectionnant et en accompagnant la
personne au RMI qui rentre dans l’emploi, on avait de très bons résultats en termes
d’insertion. Donc on était plutôt satisfaits. Du coup quand le RSA est arrivé on a été intéressé
puisqu’il parlait justement de la réintroduction dans le travail.
On a été assez en désaccord avec le principe à la base dans le sens, où pour nous, créer
un nouveau revenu de solidarité active ad vitam eternam, sans aucun accompagnement, sans
aucune négociation avec l’entreprise ça avait peu d’intérêt pour nous puisqu’en fait on allait
juste pallier le manque de revenu des salariés pauvres, mais on n’allait rien faire pour que la
précarité s’arrête et que ces salaires qui ne servent pas à vivre s’arrêtent aussi. Nous on n’est
pas pour la précarité, on est pour que les gens qui travaillent puissent vivre de leur salaire et
qu’ils n’aient pas besoin d’avoir des allocations ou des aides. Donc on a très tôt eu des
négociations avec Martin Hirsch, en lui disant qu’on pensait que dans le RSA il devrait mieux
intégrer la notion d’entreprise, de négociation, d’accompagnement et surtout avoir une
démarche très volontaire pour que le nombre d’heures augmentent. Si on reste à cinq heures
de travail par semaine, c’est très bien mais ça ne sert à rien. Donc on voulait à tout prix que le
nombre d’heures puisse augmenter. On a essayé de faire un RSA sur le modèle du RMA avec
131
un fort accompagnement dans l’emploi et surtout une négociation pour essayer d’augmenter
le nombre d’heures. Ce n’est pas ce qui a été retenu vraiment au niveau national, donc on va
appliquer le RSA tel que la loi nous l’impose. On va continuer quand même à avoir cette
démarche volontariste d’accompagnement dans l’emploi et d’essayer de faire monter le
nombre d’heures. Sauf que le volume de personnes qui va être au RSA demain va être
important, donc l’accompagnement demande des moyens. Et pour l’instant les moyens
alloués pour faire ce type de démarches ne sont pas très élevés. C’est un peu la problématique.
Au départ, le Gouvernement avait une idée un peu classique. Le RSA a été
expérimenté je crois dans les autres départements comme c’était prévu dans la loi, ils n’ont
pas eu autant de mesures d’accompagnement et de modification que nous avons demandées.
- M Beldave : L’expérimentation par définition a laissé des marges de manœuvre sur la
manière de faire sachant qu’il y avait un socle légal, quand même, à l’intérieur duquel il fallait
se placer.
- Mme Vaugelade : Je crois qu’on est quand même le département qui est allé le plus loin.
- M Beldave : Disons qu’on a innové, parce qu’on a inventé un certain nombre de choses.
Tirant parti de l’expérience du RMA notamment, une aide particulière qu’on a inventée qui
est une innovation de l’Hérault. Il y a peut-être les Bouches du Rhône qui avaient dû faire
quelque chose de similaire à ce qu’on a fait sur un levier qui permet d’inciter les entreprises à
donner plus d’heures aux bénéficiaires du RSA, les salariés à temps partiel de l’entreprise.
Cette aide consistant à financer la moitié du surcoût. Par exemple une entreprise qui s’engage
à donner plus d’heures à un salarié, le Conseil Général finance la moitié du surcoût pendant
six mois, sous conditions évidemment. C’est ce « sous conditions » qui est déterminant
d’ailleurs et qui vient de notre expérience du RMA. C’est le fait de conditionner l’aide à un
certain nombre de points sur lesquels on est vigilant, en particulier l’engagement de
l’entreprise à pérenniser les conditions qui ont été négociées au-delà du terme de l’aide. Pour
éviter l’effet d’aubaine, et mine de rien ça marche pas mal. Et pour le RMA c’est évident que
cette condition est efficace.
132
Question : Le Conseil Général a donc eu les mains assez libres durant l’expérimentation. Il y
a eu un côté très volontariste de la part du département.
Réponse :
- Mme Vaugelade : Oui on a été autorisé à faire ce qu’on voulait.
- M Beldave : D’ailleurs on a une petite ligne dans la loi du RSA, qui vient un peu de ce que
le département de l’Hérault a pu négocier. C’est la possibilité d’une aide supplémentaire qui
peut être accordée par le département aux entreprises qui s’engageraient à pérenniser des
conditions négociées. Mine de rien c’est une petite victoire.
- Mme Vaugelade : Ce qui est sûr c’est que quand on a commencé à négocier avec Martin
Hirsch, le fait qu’on insiste énormément sur cette volonté d’impliquer les entreprises dans le
dispositif et notre acharnement à vouloir augmenter le nombre d’heures, ça il ne le comprenait
pas du tout. Les premières négociations, il nous écoutait mais ne nous comprenait pas. Pour
lui, ce n’était pas possible qu’une entreprise accepte ces conditions. Et il nous demandait
comment on contraignait ces entreprises, où on les trouvait et pourquoi elles vont faire ça.
Donc on a eu un certain nombre de réunions un peu stériles, je dirai au départ, où on a mis un
certain temps avant qu’il ne nous prenne plus pour des fous mais qu’il accepte que notre idée
n’est pas forcément saugrenue. Ce qui le dérangeait, puisque l’intérêt d’une expérimentation
c’est qu’on ne soit pas tous d’accord, sinon il n’y a aucun intérêt parce que du coup on n’a pas
de bénéfice. Alors ce qui le dérangeait dans notre système c’est qu’il pensait que notre
système pouvait être un système élitiste et qu’il ne pourrait pas être un système généralisable,
à toutes les personnes bénéficiaires du RSA. C’est une question d’ailleurs en suspend car vu
le volume de personnes dont on doit s’occuper, je ne sais pas si on y arrivera. Donc c’est un
argument dont on peut tenir compte. Sauf que pour nous, ce n’est pas parce que c’est difficile
et que ça va demander d’énormes implications qu’il faut abandonner cette pratique. À la base
on n’est pas d’accord sur le principe fondateur du RSA. Pour Martin Hirsh, c’est une aide
objective qui tombe parce que « tu as un revenu qui ne te suffit pas pour vivre, donc on doit
t’aider ». Nous notre principe de base c’est qu’on ne doit pas accepter qu’un salaire soit à ce
niveau-là et empêche quelqu’un de vivre, on veut un salaire pour vivre. Donc on n’est pas
d’accord sur les principes, tout qui entérine cette vérité en disant on met des salaires bas, il y a
des travailleurs pauvres, on l’accepte, on les aide. Nous, ça, on n’arrive pas. On refuse
d’accepter une société qui ait des travailleurs pauvres. Donc on sait qu’ils existent mais notre
133
objectif c’est de faire qu’ils sortent de cette situation là et qu’ils n’aient plus besoin de nous.
C’est à partir de là qu’est arrivé un peu le quiproquo. À partir du moment où on a réussi à
négocier avant d’être un projet validé – puisque après il faut qu’on monte un projet, qu’on le
dépose à Paris, qu’il soit validé pour qu’on puisse être réellement reconnu comme
département expérimentateur et qu’on ait notre cahier des charges. Avant cette longue série de
négociations avec Paris, on a fini par les faire accepter et ils ont dit banco vous le faites.
Ensuite se mettent en place des réunions de travail avec des comités de pilotage dans lesquels
il y a tous les départements expérimentateurs, des réunions bilatérales entre le cabinet de
Martin Hirsch et le département qui expérimente. De là, il y a un peu un suivi de ce qui se
passe dans les départements pour avoir à la fin de l’expérimentation les différents résultats
selon les méthodes employées. Donc ça c’est l’intérêt même de l’expérimentation, et c’est
vrai que ça serait à renouveler. J’opposerai peut-être un bémol : c’est que c’est toujours très
dur pour un département qui expérimente un modèle qui marche, et qui n’est pas repris tel
quel au niveau de la loi, on ne supporterait pas qu’on nous empêche de le faire continuer.
Donc c’est pour ça que c’est important pour nous qu’il y ait cette phrase, on s’est battu pour
que la loi la prenne. Donc c’est un petit peu le côté ambigu de l’expérimentation. On ne peut
pas demander à une collectivité territoriale, surtout en matière sociale, de mettre en place tout
un dispositif et après de lui dire bon ok c’est pas mal votre truc mais vous arrêtez.
Question : N’y avait-il pas une peur du département de dire, on s’engage dans
l’expérimentation, mais à quoi ça va nous mener ? Est-ce qu’on va garder la compétence ?
Comment ça va être généralisé à la fin ?
Réponse :
- Mme Vaugelade : C’est un risque politique indéniable, mais on est un peu têtu.
- M Beldave : Et puis finalement ce qui se passe, c’est que sur les grandes idées de
l’expérimentation du RSA, telles qu’on les a appliquées dans l’Hérault, la loi de
généralisation est finalement assez proche. Il y a eu notamment des tractations assez
importantes sur des grands débats sur le mode de calcul de l’allocation RSA. Sur la version
expérimentale version État, on ajoute au plafond du RMI, 70% des revenus du travail, c’est ce
qui se pratique encore actuellement sur l’API – Allocation Parent Isolé – qui est gérée par
l’État. Sur le département de l’Hérault, il y a deux expérimentations, celle du Conseil Général
en direction du public bénéficiaire du RMI et à côté il y a la version État sur le public API,
134
gérée entre la CAF et l’État. Finalement cohabitent sur l’Hérault deux systèmes. Il se trouve
que ce qui est retenu par la loi de généralisation ça ressemble très fort à ce que le département
a fait. C'est-à-dire, au lieu de 60% ça va être 62%. Finalement c’est nous qui avions eu la
bonne idée les premiers. Ce qui permet au bout du compte de dire : une personne isolée qui
bénéficie du RSA, elle sort du dispositif un peu au-dessus du SMIC, c’est ce que permet ce
calcul. Alors que dans la version État, on sort à 1400€, donc nettement au-dessus du SMIC.
- Mme Vaugelade : Juste une parenthèse, l’intérêt aussi d’une expérimentation, c’est qu’avant
on avait des propositions de lois, des projets de lois qui sont discutés entre les députés et qui
sont votés. Là en fait avant que ne sortent les lois, il y a beaucoup plus de dialogue puisqu’il y
a des collectivités territoriales qui sont en train de travailler sur cette loi et qui expérimentent.
Donc il y a toute une préparation de la loi complètement différente, il n’y a pas que le débat
parlementaire avec des amendements. (…) L’inconvénient d’une loi souvent c’est qu’après il
y a des décrets d’application et qu’en fait en pratique quand on essaye d’appliquer on a X
problèmes techniques, incohérences, manque de coordination. Ça vient en contradiction avec
autre chose et en fait après le vote d’une loi, il y a toute une série de modifications, on doit
voter une autre loi pour modifier. Enfin on perd beaucoup de temps. Alors que là on est en
phase d’expérimentation, donc c’est normal qu’il y ait des flottements, c’est normal que ça
bouge ; tout le monde sait que c’est une expérimentation donc tout le monde accepte aussi que
les règles évoluent et l’administré sait aussi que c’est une expérimentation. Ça permet de
rôder, d’huiler en fait ces projets de loi, et d’arriver à ce que le projet normalement en bout de
course soit complètement opérationnel parce qu’il a été très bien testé. Donc ça je pense que
c’est l’intérêt premier de l’expérimentation. Sur ce cas-là, c’est vrai qu’on aurait eu la loi telle
que, tout le monde y aurait apporté des amendements, mais on aurait eu une loi quasiment
inapplicable dès le départ. En plus, quand on voit toutes les difficultés d’organisation que ça a
demandé dans les Conseils Généraux ; on a mis un certain temps à comprendre comment on
allait s’organiser, comment il fallait qu’on fasse, on change encore un peu nos systèmes, forts
de cette expérimentation. Mais toute cette somme d’expériences, ça veut dire qu’en fait, on va
parler avec les autres départements. Les autres départements qui n’ont pas expérimenté
peuvent demander aux départements qui l’ont fait comment ils se sont mis en place. Le
dialogue est plus facile parce qu’on est de collectivité à collectivité ; donc ce n’est pas
demander à l’État comment on va s’organiser mais c’est demander à une collectivité
équivalente comment elle l’a fait, on a plus de similitudes. Donc il y a le bénéfice de tout un
travail de beaucoup de gens qui apporte énormément en termes de cohérence et de pratique.
135
- M Beldave : Très concrètement ces derniers mois, il y a un certain nombre de groupes de
travail qui se sont réunis à Paris, qui réunissaient les grands acteurs de l’insertion : la CNAF
pour l’emploi, le Haut commissariat et les départements. Il y a une dizaine de groupes de
travail qui ont travaillé ces derniers mois sur différents thèmes qui sont au cœur du sujet, par
exemple l’accompagnement et l’orientation, les applicatifs informatiques qui vont permettre
ensuite de gérer le RSA en introduisant de nouvelles données qu’on n’avait pas l’habitude de
gérer dans le cadre du RMI. Tous ces sujets, notamment la participation des personnes
intéressées, c'est-à-dire des bénéficiaires, dans l’élaboration, la conduite et l’évaluation des
politiques d’insertion, tous ces grands thèmes ont été traités, négociés ces dernières semaines
et encore maintenant un petit peu puisqu’on est en train d’écrire les décrets, et le département
de l’Hérault y participe. Et donc ça permet au département de peser concrètement sur la
rédaction finale des textes de lois et de décrets.
- Mme Vaugelade : Oui, je pense que la grande différence entre un projet de loi non
expérimenté et un projet de loi expérimenté, si on doit le résumer, c’est que du coup les
personnes qui appliqueront la loi, les techniciens, les travailleurs, les administratifs, qui sont
vraiment dedans, ont plus leur mot à dire. Alors que normalement c’est très politique quand
on négocie une loi, ce sont les députés entre eux qui parlent, mais bon ils ne sont pas tous
dans les structures qui vont devoir appliquer ou dans des collectivités qui vont devoir
l’appliquer. Donc c’est quand même intéressant que les gens qui vont le mettre en œuvre
réellement tous les jours puissent avoir une implication dans la rédaction des lois. Parce que
souvent on se rend compte quand même que dans une loi ou même dans les décrets, la
personne est au fait du fond, elle sait ce qu’elle veut et elle a un objectif précis, sauf qu’elle ne
sait pas comment on le met en œuvre et soit il y a des choses qui ne sont pas traitées –
problème informatique qui peut être complètement oublié parce que personne n’y pense -
alors que les personnes qui sont vraiment les mains dans le goudron, elles vont dire halte là,
comment on fait là ? Donc les questions sont posées les unes après les autres, avec quand
même pour cette expérimentation là un très bon esprit.
Après sur l’aspect budgétaire, c’est vrai que quand on fait une expérimentation on a un
budget alloué par l’État pour nous aider dans cette mise en œuvre et que du coup ça permet à
un département de mettre des moyens, de perdre du temps, de réfléchir sans que tout le coût
pèse sur la collectivité. L’État prend en charge une bonne partie de l’expérimentation, c’est
plus que correct, après le reste on verra. C’est vrai qu’après le problème de fond quand on
136
travaille avec l’État c’est l’argent. Souvent ils commencent par dire qu’ils vont voter une
enveloppe, souvent en deçà de ce qu’on espère et une fois qu’ils ont déterminé l’enveloppe on
attend, on ne l’a jamais. C’est vrai que le Haut Commissaire Martin Hirsch jure aux grands
dieux que ça ne sera point comme pour les autres réformes auxquelles nous avons eu droit et
que lui ce qu’il a dit on l’aura. (…)
Sur le fait qu’on n’applique pas les mêmes règles partout, on n’est pas habitué à ça en
France, même si on est très attaché à la décentralisation, on a tous intrinsèquement l’esprit
État, un peu jacobin, partout en France c’est la loi qui s’applique. C’est un problème de
culture. Je pense qu’en partant pour trois ans, on aurait eu des gens qui auraient dit « oui mais
pourquoi lui il a le droit à ça et moi je n’ai pas le droit », parce que nous par exemple sur le
département de l’Hérault on n’a pas expérimenté sur tout le département, on a expérimenté
sur des territoires qu’on considérait être des territoires témoins, intéressants et représentatifs.
Donc gérer ce problème n’est pas aisé, trois ans c’est long quand même, les gens l’ont intégré,
au bout de trois ans le RSA tout le monde aurait su que ça existait. C’est la petite difficulté :
soit on arrive à changer un petit peu de mentalité, soit il faudra réduire les délais. Après le
côté impératif, c’est qu’il ne faut pas avoir un faux dialogue. C'est-à-dire qu’il y a des gens
qui disent « oui moi je suis pour la négociation », sauf qu’ils savent où ils veulent aller et ce
qu’ils veulent c’est convaincre les gens avec qui ils parlent. Ce sont des personnalités, ce sont
des systèmes qui existent très souvent. Martin Hirsch, on peut lui reconnaître une chose, c’est
qu’il est très volontariste, sauf que quand même il a une certaine capacité à écouter et à
intégrer ce qu’il entend. Donc ça ce n’est pas donné à tout le monde et certainement pas
facilement à des gens qui ont une culture étatiste, qui sont formatés différemment avec du
« descendant » et pas du « ascendant ».
- M Beldave : Il faut lui reconnaître aussi une qualité, c’est qu’il s’applique à lui-même les
préceptes qu’il met en avant. Par exemple, la démocratie participative, la participation des
personnes intéressées, dans la plupart des réunions de travail sur le sujet il y a à chaque fois
des représentants de bénéficiaires qui sont là.
- Mme Vaugelade : Après ça fait partie aussi de son image. Quand pour travailler son image,
on fait quelque chose de positif, c’est toujours bon à prendre.
137
Question : Le RSA donne un peu l’impression d’une partie de communication du
gouvernement. Derrière la façade, on expérimente, on sait déjà qu’on veut généraliser par la
suite.
Réponse :
- Mme Vaugelade : Notre président n’avait pas voté la loi sur le RSA, mais on a été
expérimentateur parce qu’on a considéré qu’il fallait aller plus loin. On n’est pas dupe, on sait
très bien que c’est l’image et la face sociale du gouvernement Sarkozy, qui n’est pas un
gouvernement social et qui n’en a rien à secouer en gros des pauvres. Sauf que c’est un
gouvernement qui travaille énormément son image, c’est une image importante à cultiver. Il a
su prendre Martin Hirsch, il le montre. Maintenant on a bien vu aussi quand il faut faire des
gros choix politiques ce qu’ils ont fait. On s’est bagarré pour avoir 1,5 milliard alors qu’au
départ il nous fallait 3 milliards de budget. Sur les 1,5 milliard, il a quand même souhaité que
ce soit financé en partie sur de l’épargne de couches sociales plutôt modestes. Donc il a
trouvé son argent, il a choisi son mode de financement, à côté de ça on a quand même les 300
millions d’euros pour les banques quand on est en crise et qu’en fait elles ont encore pas mal
d’immobilier et de biens. Donc ça on en n’est pas dupe, on le sait. Sauf que politiquement, on
a toujours dit que même si on n’est pas dupe, si ça peut être mieux pour les pauvres et pour
les gens qui ont besoin, nous, vu nos convictions politiques, on ne ferait pas de la politique
politicienne, on irait.
Question : Mais finalement n’a-t-on pas l’impression que l’État avait déjà son idée et qu’il
savait qu’il allait généraliser ?
Réponse :
- Mme Vaugelade : On savait qu’il allait généraliser, ça c’est évident. Là c’est la marge de
manœuvre, ça dépend de qui gère le projet. Martin Hirsch avait son idée bien précise, mais il
a su avoir cette capacité réelle à quand même entendre un certain nombre de choses et intégrer
des points et des idées qui sont remontés de l’expérimentation. Si on tombe sur une autre
personnalité beaucoup plus formatée étatique, avec la prédominance de l’État, ça peut n’être
que de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu’on fait expérimenter dans des conditions beaucoup
plus difficiles en termes de négociation, c'est-à-dire qu’on a un cahier des charges quasiment
pas négociable ; dans ce cas, c’est vrai qu’il n’y aura que des bénéfices de l’expérimentation
technique, c'est-à-dire est-ce que la loi est effectivement applicable ou pas. On aura quand
138
même un bénéfice, mais il n’y aura pas le bénéfice du savoir collectif et de toute la richesse
de l’application. Il y a des gens chez nous à des postes corrects, mais pas de grands directeurs,
qui ont participé à la rédaction des décrets. Le Gouvernement a intégré un certain nombre de
personnes, ce n’est pas Mme Machin, et elle n’est pas députée, elle n’a pas d’étiquette, elle est
une simple technicienne avec sa compétence propre. Ce sont souvent des gens très riches et ça
Martin Hirsch, l’a vu ; mais je ne suis pas sûre que toutes les expérimentations se passeront
comme ça. Après l’autre façade intéressante politiquement, c’est quand on veut faire une loi
et essayer de ne pas avoir trop de querelles au niveau du Parlement, on la fait expérimenter
par des collectivités territoriales qui n’ont pas la même étiquette politique que le
gouvernement et c’est une façon de dire « on est ensemble maintenant, on est un groupe, on
est unis, on est amis ». C’est de bonne guerre c’est la politique.
- M Beldave : Il y a une question centrale, c’est que le fait d’expérimenter crée de l’inéquité.
Entre deux territoires du département on a des gens qui sont traités de manière différente. J’ai
pas eu spécialement d’écho de la part des personnes mais plutôt des travailleurs sociaux,
parce que ce n’est pas dans leur culture. L’égalité est dans la loi, l’équité de traitement, ça se
sont les valeurs, nobles d’ailleurs, qu’ils portent ; mais lorsqu’ils sont confrontés à une
expérimentation où parfois ils rencontrent successivement dans la même journée des gens qui
sont au RMI, d’autres qui sont au RSA, avec des conditions différentes, ça les choque un petit
peu. Mais même au moment du débat de la loi, il y avait eu un débat là-dessus, et le
législateur avait répondu que finalement on acceptait un moment d’inéquité au motif que
c’était de courte durée et qu’à terme c’était au profit de l’intérêt général et que c’était à ça
qu’il fallait penser plus qu’au moment d’inéquité, qui était une espèce de mal nécessaire.
C’est un petit point de friction effectivement qu’on peut avoir avec les gens qui font le boulot
sur le terrain. Ou même par exemple des gens de Pôle Emploi, c’est une structure nationale
très jacobine et eux ils sont très porteurs de valeurs jacobines ; alors que dans les
départements on est plus dans la décentralisation. Déjà, en fait la décentralisation avait
introduit ça, c'est-à-dire que d’un département à l’autre on pouvait traiter différemment.
C’était déjà une première source d’inéquité mais qui était liée à un choix qui était de
décentraliser, donc d’adapter les politiques aux situations locales. Je trouve ça plutôt positif
personnellement. Mais déjà, il y avait un premier moment où il y avait des frictions sur le
terrain. J’avais rencontré personnellement à la fois les travailleurs sociaux du Conseil Général
et ceux de Pôle Emploi puisque j’ai travaillé dans les deux structures, donc j’ai bien vu les
deux manières de penser ; et j’ai rencontré ça des deux côtés. L’expérimentation introduit une
139
nouvelle couche d’inéquité. Mais moi ça ne me pose pas problème personnellement puisque
je m’approprie très bien cette idée qu’on est là pour expérimenter quelque chose qui va
permettre d’améliorer le dispositif dans son ensemble, et c’est l’intérêt général qui va être
servi au bout du compte. Mais c’est vrai que ça crée des frictions.
- Mme Vaugelade : De toutes façons, il faudra qu’on arrive à comprendre que les choses ne
peuvent pas être les mêmes partout en France, parce qu’on se rend bien compte qu’il y a des
expériences de méthodes de travail qui sont importantes et qui sont différentes. On a des
relations différentes avec les tissus économiques ou pas. C’est vrai que nous ici la chance
qu’on a eue, c’est que, bien que, n’ayant pas la compétence économique, on a toujours gardé
un lien fort avec le monde de l’entreprise. Le président a toujours pensé que de toutes les
manières, on ne pouvait pas parler d’insertion et d’emploi sans parler avec les entreprises. Ça
fait des années et des années qu’on travaille avec des entreprises, qu’on les a aidées à se
structurer, qu’on a aidé à avoir une plateforme qui les regroupe et avoir un dialogue social et
citoyen avec elles. Du coup, c’est un terroir ça. Donc quand une loi arrive, forcément elle va
être appliquée de façon différente ici où on a déjà semé, d’un endroit où le Conseil Général
s’est beaucoup plus orienté sur une politique purement sociale et non pas d’insertion
économique et qui n’a donc pas de lien direct avec les entreprises. C’est vrai que ça c’est de la
volonté politique. Dans le RMI, il y avait le « I » d’insertion qui demandait à ce qu’on ait
20% du budget du RMI sur des actions d’insertion, cela a été abrogé. Donc on n’avait plus
besoin de faire l’insertion dans les départements, nous on l’a maintenue voire renforcée. Donc
on n’a jamais lâché l’insertion par l’économie, on n’a jamais lâché les entreprises. C’est pour
ça que notre vision du RSA est telle. C’est pour ça qu’on a aussi fait modifier la loi pour faire
en sorte qu’il y ait à tout prix des éléments qui stimulent l’employeur à augmenter son nombre
d’heures. C’est fondamental et ça n’aurait jamais été dans la loi si on n’avait pas expérimenté.
Et ça n’aurait jamais été dans la loi si on n’avait pas décentralisé l’application du RMI et que
nous dans le département de l’Hérault on ait eu la politique du RMI qu’on a eue.
141
BIBLIOGRAPHIE
I. MANUELS ET OUVRAGES
AUBY Jean-Bernard, AUBY Jean-François et NOGUELLOU Rozen, Droit des collectivités
locales, Paris, PUF, Thémis droit, 2008, 4ème édition, 379p.
BECKER Colette, GOURDIN-SERVENIÈRE Gina, LAVIELLE Véronique, Dictionnaire
d’Émile Zola, Paris, Robert Laffont, Coll. Bouquins, 1993, 700p.
BERNARD Claude, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865, Paris,
Flammarion, rééd. 1984, 318p.
COLLECTIF, Les collectivités locales et l’expérimentation : perspectives nationales et
européennes, Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des libertés locales, Paris, La
documentation française, 2004, 278p.
FAVOREUX Louis (dir.), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2008, 11e édition, 1055p.
FAVOREUX Louis, PHILIP Loïc, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Paris,
Dalloz, 2005, 13e édition, 1065p.
FRAISSE Paul, La psychologie expérimentale, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 13e édition,
128p.
VERPEAUX Michel, Droit des collectivités territoriales, Paris, PUF, Coll. Major, 2005, 1ère
édition, 312p.
II. MÉLANGES
Mélanges offerts à Monsieur le Doyen Louis Trotabas, LGDJ, 1970, 572p.
L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, PUF – Dalloz – Ed. du Juris
Classeur, 1999, 868p.
142
Les mutations contemporaines du droit public. Mélanges en l’honneur de Benoît Jeanneau,
Dalloz, 2002, 720p.
Mouvement du droit public : du droit administratif au droit constitutionnel, du droit français
aux autres droits. Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, Dalloz, 2004, 1264p.
Constitution et finances publiques. Études en l’honneur de Loïc Philip, Economica, 2005,
622p.
II. THESES
BOYER-MÉRENTIER Catherine, Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution du 4
octobre 1958, Thèse, Paris, Presses Universitaires d’Aix-Marseille - Economica, 1996, 416p.
DENAJA Sébastien, Expérimentation et administration territoriale, Thèse dactylographiée,
Montpellier, 2008, 669p.
III. ARTICLES
B
BAGHESTANI-PERREY Laurence, « Le pouvoir d’expérimentation normative locale, une
nouvelle conception partagée de la réalisation de l’intérêt général », LPA, n°55, 17 mars 2004,
p.6-10.
BOYER-MÉRENTIER Catherine, « Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution : une
place ambiguë dans la hiérarchie des normes », RFDA, septembre-octobre 1998, p.924-941.
BRAUD Caroline, « L’évaluation des lois et des politiques publiques », LPA, n°95, 7 août
1996, p.7-12.
143
BRISSON Jean-François, « Les nouvelles clefs constitutionnelles de répartition matérielle des
compétences entre l’État et les collectivités locales. », AJDA, n °11, 24 mars 2003, p.529-539.
BROSSET Estelle, « L’impossibilité pour les collectivités territoriales françaises d’exercer le
pouvoir législatif à l’épreuve de la révision constitutionnelle sur l’organisation décentralisée
de la République », Revue française de droit constitutionnel, n°60, octobre 2004, p.695-739.
C
CHAVRIER Géraldine, « L’expérimentation locale : vers un État subsidiaire ? », Annuaire
des collectivités locales 2004, CNRS, 2004, p.43-52.
CHAVRIER Géraldine, « Expérimentation territoriale », JCP A, Fascicule 116-20, 2005
CHEVALLIER Jacques, « Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation
juridique », Revue du droit public, n°3, 01/06/1998, p.659-690.
CHEVALIER Jacques, « L’État post-moderne : retour sur une hypothèse », Droits. Revue
française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n°39, 2004, p.107-120.
CHEVILLEY-HIVER Carole, « La mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée
nationale », RDP, n°6, 2000, p.1679-1699.
COLLIN Mathilde, « L’expérimentation de la gestion des fonds structurels par la région
Alsace », RGCT, n°35, août 2005, p.271-284.
CROUZATIER-DURAND Florence, « Réflexions sur le concept d’expérimentation
législative », Revue française de droit constitutionnel, n°56, octobre 2003, p.675-695.
CROUZATIER-DURAND Florence, « L’expérimentation locale (loi organique du 1er août
2003) », RFDA, n°1, janvier-février 2004, p.21-30.
144
CROUZATIER-DURAND Florence, « Première évaluation des expérimentations normatives,
trois ans après leur consécration constitutionnelle », Revue Lamy Collectivités territoriales,
n°13, mai 2006, p.19-22.
D
DEGRON Robin, « La décentralisation de la gestion des fonds structurels : une
expérimentation au milieu du gué », AJDA, n°17, 30/04/2007, p.896-901.
DELCAMP Alain, « Principe de subsidiarité et décentralisation », Revue française de droit
constitutionnel, n°23, 1995, p.609-624.
DEROSIER Jean-Philippe, « La dialectique centralisation/décentralisation. Recherches sur le
caractère dynamique du principe de subsidiarité », Revue Internationale de Droit Comparé,
n°1, 2007, p.107-140.
DOMERGUE Isabelle, « Pour ou contre le droit à l’expérimentation », Regards sur
l’actualité, n°286, p.17-20.
DRAGO Guillaume, « Le principe de subsidiarité comme principe de droit constitutionnel »,
RIDC, n°2, 1994, p.583-592.
DRAGO Guillaume, « Le droit à l’expérimentation », in La République décentralisée, Dir.
Yves Gaudemet et Olivier Gohin, Paris, Editions Panthéon Assas, 2004, p.65-85.
F
FAURE Bertrand, « Les relations paradoxales de l’expérimentation et du principe d’égalité »,
RFDA, n°6, novembre-décembre 2004, p.1150-1156.
FAURE Bertrand, « Les expérimentations et le principe d’égalité », in Egalité et services
publics territoriaux, Dir. Martine Long, Paris, LGDJ, 2005, p41-49.
145
FIALAIRE Jacques, « Le droit à l’expérimentation des collectivités territoriales et la
subsidiarité : les apparences et « faux-semblants » d’une prétendue territorialisation des
normes », in Subsidiarité infranationale et territorialisation des normes, état des lieux et
perspectives en droit interne et en droit comparé, Dir. Jacques Fialaire, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2004, p.11-23.
FRISON-ROCHE Marie-Anne, BARANÈS William, « Le principe constitutionnel de
l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi », Recueil Dalloz, n°23, 2000, p.361-368.
G-J
GUILLOUD, Laetitia, « Le principe de subsidiarité en droit communautaire et en droit
constitutionnel », LPA, n°79, 19 avril 2007, p.53-62.
GUILLOUD, Laetitia, « Transferts de compétence et pouvoir normatif des collectivités
territoriales (Splendeur et misère de la décentralisation sous Vè République) », LPA, numéro
spécial, n°138, 10 juillet 2008, p.51-61.
JANIN Patrick, « L’expérimentation juridique dans l’acte II de la décentralisation.
Observations sur une réforme. », JCP-A, n°41, 10 octobre 2005, p.1524-1528.
I
LAPOUZE Patrick, « L’expérimentation par les collectivités territoriales », JCP-A, n°10, 10
mars 2006, p.307-309.
LE MOIGNE Marthe, « Bloc de constitutionnalité et « droit post-moderne » », RGCT, n°34,
mai-juin 2005, p.175-194.
LONG Martine, « Faut-il maintenir le principe d’égalité » in Egalité et services publics
territoriaux, Dir. Martine Long, Paris, LGDJ, 2005, p.13-26.
LONG Martine, « Revenu de solidarité active : l’expérimentation », Droit social, n°12,
Décembre 2007, p.1236-1243.
146
LONG Martine, « L’expérimentation : un premier bilan décevant pour les collectivités
territoriales », Tribune, AJDA, n°30, 15 septembre 2008, p.1625.
M-N
MAMONTOFF Catherine, « Le transfert de compétences en matière aéroportuaire », AJDA, 5
novembre 2007, p.2076-2082.
MAMONTOFF Catherine, « Réflexions sur l’expérimentation du droit », RDP, n°2, 1998,
p.351-371.
MARCOU Gerard, « Le bilan en demi-teinte de l’Acte II. Décentraliser plus ou décentraliser
mieux ? », RFDA, n°2, mars-avril 2008, p.295-315.
MÉHAIGNERIE Pierre, « Décentralisation, expérimentation et évaluation », Pouvoirs
locaux, n°57, 2003, p.113-116.
MELIN-SOUCRAMIEN Ferdinand, « Le principe d’égalité entre collectivités locales », Les
Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°12, 2002, p.93-95.
MIABOULA-MILANDOU Arsène, « Les moyens d’action du Parlement à l’égard de la loi
votée », Revue française de droit constitutionnel, n°33, 1997, p.35-70.
MILANO Laure, « La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
premier jalon de la réorganisation de l’État », RGCT, n°33, mars-avril 2005, p.87-103.
MILANO Laure, « Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi », RDP, n°3, 2006,
p.637-671.
NICOLAÏEFF Bernard, « L’expérimentation, nouvelle frontière de la gouvernance ? »,
Pouvoirs locaux, n°49, 2001, p.96-102.
147
P-R
PERROCHEAU Vanessa, « L’expérimentation, un nouveau mode de création législative,
Revue française des affaires sociales, n°1, janvier-mars 2000, p.11-27.
PISSALOUX Jean-Luc, « Réflexions sur l’expérimentation normative », Droit administratif,
novembre 2003, p.12-19.
PONTIER Jean-Marie, « L’expérimentation et les collectivités locales », RA, n°320, 2001,
p.169-177.
PONTIER Jean-Marie, « Décentralisation et expérimentation », Tribune, AJDA, 28 octobre
2002, p.1037.
PONTIER Jean-Marie, « La loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités
territoriales », AJDA, n°32, 29 septembre 2003, p.1715-1723.
RIHAL Hervé, « La généralisation du revenu de solidarité active », AJDA, n°4, 9 février
2009, p.198-205.
ROUQUETTE Rémi, « La loi d’orientation relative à l’administration territoriale de la
République », LPA, n°143, 27 novembre 1992, p.11-16.
S-T-V
SCHOETTL Jean-Eric, « La loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités
territoriales devant le Conseil Constitutionnel », LPA, n°195, 30 septembre 2003, p.5-8.
SCHOETTL Jean-Eric, « La loi relative aux libertés et responsabilités locales devant le
Conseil Constitutionnel », LPA, n°174, 31 août 2004, p.3-14.
SESTIER Jean-François, « Le renouveau législatif du développement économique », JCP-A,
n°1, 10 janvier 2005, p.7-10.
148
THUILLIER Guy, « Les principes de l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale
(1865) de Claude Bernard », RA, n°349, 2006, p.27-30.
VERPEAUX Michel, « La loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités
territoriales », JCP-A, n°20, 10 mai 2004, p.655-663.
VERPEAUX Michel, « La loi du 13 août 2004 : le demi-succès de l’acte II de la
décentralisation », AJDA, n°36, 25 octobre 2004, p.1960-1968.
VERPEAUX Michel, « Les ordonnances de l’article 38 ou les fluctuations contrôlées de la
répartition des compétences entre la loi et le règlement », Les Cahiers du Conseil
Constitutionnel, n°19, 2005, p.96-100.
IV. CONTRIBUTIONS A DES COLLOQUES
CHARENTENAY Simon (de), « Les implications juridiques de la constitutionnalisation du
droit de l’expérimentation », Atelier Constitution et territoires, VII Congrès français de droit
constitutionnel, Paris, 25-27 septembre 2008.
RRAPI Patricia, « Bilan des expérimentations prévus par la loi du 13 août 2004 : la difficile
introduction du concept d’expérimentation en France », Atelier Constitution et territoires, VII
Congrès français de droit constitutionnel, Paris, 25-27 septembre 2008.
V. LOIS, ACTES COMMUNAUTAIRES ET CIRCULAIRES
A. Lois constitutionnelles et lois organiques
Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de
la République, JORF, 29 mars 2003, p.5568.
Loi organique n°2003-704 du 1er août 2003, relative à l’expérimentation par les collectivités
territoriales, JORF, 2 août 2003, p.13217.
149
B. Lois ordinaires
Loi n°75-17 du 17 janvier 1975, relative à l’interruption volontaire de grossesse, dite loi
Veil, JORF, 18 janvier 1975, p.739.
Loi n°82-213, du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, dite loi Defferre, JORF, 3 mars 1982, p.730.
Loi n°88-1088 du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d’insertion, JORF, 3
décembre 1988, p.15119.
Loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la
République, JORF, 8 février 1992, p.2064.
Loi n°95-115 du 4 février 1995, d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire, JORF, 5 février 1995, p.1973.
Loi n°96-299 du 10 avril 1996, relative aux expérimentations dans le domaine des
technologies et services de l’information, JORF, 11 avril 1996, p.5569.
Loi n°96-516 du 14 juin 1996, tendant à créer un Office parlementaire d’évaluation de la
législation, JORF, 15 juin 1996, p.8911.
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
JORF, 14 décembre 2000, p.19777.
Loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, JORF, 28 février
2002, p.3808.
Loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, JORF, 17
août 2004, p.14545.
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006, portant loi de finances pour 2007, JORF, 27
décembre 2006, p.19641.
150
Loi n°2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale, JORF, 6 mars 2007, p.4190.
Loi n°2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite
loi TEPA, JORF, 22 août 2007, p.13945.
Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion, JORF, 3 décembre 2008, p18424.
C. Actes communautaires
Traité instituant la communauté européenne, JOCE, n°C325, 24 décembre 2005.
D. Circulaire
Circulaire interministérielle du 22 août 2007, relative à la mise en œuvre des
expérimentations locales prévues par l’article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances
pour 2007 modifié et la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat – revenu de solidarité active (RSA).
VI. JURISPRUDENCE
A. Jurisprudence constitutionnelle
Conseil Constitutionnel, n°79-107DC du 12 juillet 1979, loi relative à certains ouvrages
reliant les voies nationales ou départementales, JORF, 13 juillet 1979.
Conseil Constitutionnel, n°90-274DC du 29 mai 1990, loi visant à la mise en œuvre du droit
au logement, JORF, 1er juin 1990, p.6518.
Conseil Constitutionnel, n°91-290DC du 9 mai 1991, loi portant statut de la collectivité
territoriale de Corse, JORF, 14 mai 1991, p.6350.
151
Conseil Constitutionnel, n°92-312 du 2 septembre 1992, loi autorisant la ratification du
Traité sur l’Union européenne, JORF, 3 septembre 1992, p.12095.
Conseil Constitutionnel, n°93-322DC du 28 juillet 1993, loi relative aux établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, JORF, 30 juillet 1993, p.10750.
Conseil Constitutionnel, n°93-333DC du 21 janvier 1994, loi modifiant la loi n°86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF, 26 janvier 1994, p.1377.
Conseil Constitutionnel, n°96-373DC du 9 avril 1996, loi organique portant statut
d’autonomie de la Polynésie française, JORF, 13 avril 1996, p.5724.
Conseil Constitutionnel, n°99-410DC du 15 mars 1999, loi organique relative à la Nouvelle-
Calédonie, JORF, 21 mars 1999, p.4234.
Conseil Constitutionnel, n°99-421DC du 16 décembre 1999, loi portant habilitation pour le
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie Législative de certains
codes, JORF, 22 décembre 1999, p.19041.
Conseil Constitutionnel, n°2001-454DC du 17 janvier 2002, loi relative à la Corse, JORF, 23
janvier 2002, p.1526.
Conseil Constitutionnel, n°2003-469 du 26 mars 2003, loi constitutionnelle relative à
l’organisation décentralisée de la République, JORF, 29 mars 2003, p.5570.
Conseil Constitutionnel, n°2003-478DC du 30 juillet 2003, loi organique relative à
l’expérimentation par les collectivités locales, JORF, 2 août 2003, p.13302.
Conseil Constitutionnel, n°2004-503DC du 12 août 2004, loi relative aux libertés et
responsabilités locales, JORF, 17 août 2004, p.14648.
Conseil Constitutionnel, n°2004-505DC du 19 novembre 2004, relative au Traité établissant
une Constitution pour l’Europe, JORF, 24 novembre 2004, p.19885.
152
Conseil Constitutionnel, n°2005-516 du 7 juillet 2005, relative à la loi de programme fixant
les orientations de la politique énergétique, JORF, 14 juillet 2005, p.11589.
Conseil Constitutionnel, n°2007-555DC du 16 août 2007, loi n°2007-1223 du 21 août 2007
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, JORF, 22 août 2007, p.13959.
B. Jurisprudence administrative
Conseil d'État, 13 octobre 1967, Sieur Peny, Rec. p.365
Conseil d'État, 21 février 1968, Ordre des avocats près la Cour d’appel de Paris et autres,
Rec. p.123.
Conseil d'État, 17 décembre 1969, Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Rec. p.584.
Conseil d'État, 10 ami 1974, Denoyez et Chorques, Rec. p.274.
Conseil d'État, Avis de l’Assemblée générale (Section des travaux publics), 24 juin 1993,
n°353605, Rapport public 1993.
Conseil d'État, 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de courses des
hippodromes de province et autres, Rec. p.427.
Conseil d'État, 1er décembre 1997, Union des professions de santé libérale SIS Action santé,
Rec. p.449.
Conseil d'État, 3 juillet 1998, Syndicat des médecins Aix et région, Rec. p.266.
C. Jurisprudence communautaire
CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH c/ Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, aff.
C-280/00, Rec. p.I-7747.
153
VII. RAPPORTS
A. Rapport au Président de la République
Comité pour la réforme des collectivités locales (dit Comité Balladur), « Il est temps de
décider », 5 mars 2009, 174p.
B. Rapports parlementaires
CLEMENT Pascal, « Rapport relatif à l’organisation décentralisée de la République », rapport
n°376, 18 novembre 2002, 99p.
DAUBRESSE Marc-Philippe, « Rapport sur le projet de loi généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques d’insertions », rapport n°1113, 18 septembre 2008,
365p.
GEST Alain, « Rapport d’information sur la mise en application de la loi 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales », rapport n°3199, 28 juin 2006, 167p.
PIRON Michel, « Rapport relatif à l’expérimentation par les collectivités territoriales »,
rapport n°955, 26 juin 2003, 51p.
C. Rapports du Conseil d'État
Rapport public du Conseil d'État 1996, «Sur le principe d’égalité», EDCE, 1996, 509p.
Rapport public du Conseil d'État 2008, « Le contrat mode d’action publique et de production
de normes », EDCE, 2008, 397p.
154
VIII. SITES INTERNET
http://www.assemblee-nationale.fr
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr
http://www.droitconstitutionnel.org
http://www.elysee.fr
http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.premier-ministre.gouv.fr
http://www.senat.fr
156
TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE p.3
Table des abréviations utilisées p.4
INTRODUCTION p.5
PARTIE I. UNE MANIFESTATION DE L’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
NORMATIVE
p.17
Chapitre 1. Une technique de désengagement apparent de l’État p.20
Section 1. Les motivations du recours à l’expérimentation p.21
§1. L’inscription de l’expérimentation dans le mouvement juridique post-moderne p.21
A. Une démarche pragmatique p.24
B. Une constante recherche de l’efficacité p.26
§2. Un nouvel acteur de la production normative : les collectivités territoriales p.29
A. Des solutions locales pour améliorer la norme générale p.29
B. Un nécessaire effort d’abstraction p.31
§3. Un moyen pour l’État de faire accepter les transferts de compétences p.32
A. La motivation intrinsèque de l’expérimentation p.33
B. Une mise en œuvre camouflée p.34
Section2. Le rôle ambigu de l’État p.37
§1. L’expérimentation transfert : un levier de transfert de compétences p.38
§2. L’expérimentation dérogation : des faux-semblants néfastes p.43
A. L’impression d’un rôle important de l’État p.43
1. L’encadrement constitutionnel de l’expérimentation dérogation p.43
2. Les conditions de l’expérimentations complétées par la loi organique
du 1er août 2003
p.45
B. Des collectivités largement associées à la procédure p.50
1. La négociation préalable à l’expérimentation p.50
157
2. L’association des collectivités territoriales à l’issue à l’issue de
l’expérimentation
p.52
Chapitre 2. La conciliation de l’expérimentation avec les principes constitutionnels p.54
Section 1. La mise en œuvre du principe de subsidiarité p.56
§1. La subsidiarité, un principe à la normativité incertaine p.56
A. L’émergence du principe de subsidiarité p.56
B. Un principe difficilement justiciable p.59
§2. La concrétisation du principe de subsidiarité p.61
A. Expérimentation et subsidiarité, des principes complémentaires p.61
B. Une complémentarité inachevée p.62
Section 2. La mise en cause apparente du principe d’égalité p.65
§1. Une atteinte limitée et justifiée au principe d’égalité p.65
A. La remise en cause du principe d’égalité par l’expérimentation p.66
B. La justification des atteintes au principe d’égalité p.67
§2. L’attachement critiquable à l’égalité formelle p.70
A. Le nécessaire retour à l’égalité p.70
B. Des alternatives inexplorées p.72
PARTIE II. LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE
L’EXPÉRIMENTATION
p.75
Chapitre 1. Une efficacité incertaine p.78
Section 1. La difficulté pour déterminer un juste échantillon p.79
§1. Nécessité et limite de l’échantillonnage p.79
A. L’échantillon géographique : la collectivité territoriale p.79
B. Des facteurs exogènes perturbateurs p.82
§2. Une difficulté avérée dans les faits p.85
A. Des échantillonnages variés : l’exemple des expérimentations transferts p.86
B. La gestion critiquable de l’échantillon de l’expérimentation du RSA p.88
158
Section 2. La subjectivité de l’évaluation p.91
§1. Des modalités d’évaluation à préciser p.91
A. Une évaluation dirigée par le Gouvernement p.92
B. Le contenu de l’évaluation p.96
§2. Le risque d’une évaluation orientée p.98
A. Une évaluation servant une logique de communication p.99
B. L’exemple des expérimentation dans les pays nordiques p.101
C. La durée de l’expérimentation au cœur de l’évaluation p.103
Chapitre 2. Un contentieux potentiellement abondant p.106
Section 1. Les possibilités de contentieux constitutionnel p.107
§1. Le contrôle des lois d’habilitation p.107
A. Le contenu du contrôle p.108
B. L’exercice du contrôle p.110
1. Le contrôle des expérimentations contenues dans la loi relative aux
libertés et responsabilités locales
p.110
a. L’étonnante validation de la constitutionnalisation de
l’expérimentation
p.111
b. L’analyse des dispositifs expérimentaux p.113
2. L’absence de contrôle des lois portant expérimentation du RSA p.115
§2. Le contrôle des lois de généralisation p.116
A. Le contrôle du respect de la procédure p.117
B. L’absence de contentieux dans les faits p.118
Section 2. Un contentieux administratif à clarifier p.119
§1. Des actes hybrides p.121
§2. Un contrôle spécifique p.122
A. La soumission au recours de droit commun p.122
B. L’adaptation du contrôle aux actes dérogatoires p.123