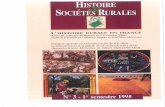carry on wayward son_rv192_kansas.pdf - Apprendre la Guitare
L'Atelier de l'invisible, apprendre à philosopher avec Platon
-
Upload
univ-fcomte -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of L'Atelier de l'invisible, apprendre à philosopher avec Platon
L’Atelier de l’invisible
Apprendre à philosopher avec Platon
Arnaud Macé
Collection Chercheurs d’èreanimée par V. Bourdeau, F. Jarrige, J. Vincent
Série Travaux
illustration de couvertureCoupe à figures rouges, 490-480 av. J.-C
© BPK, Berlin, Dist. RMN / Ingrid Geske-Heiden
è®e
platon160p_V2.indd 3 13/10/10 10:35:14
5
Prologue
I
Devenir philosophes ?
Si nous voulions devenir menuisiers, pianistes ou yogis, il nous faudrait accomplir avec assiduité certains exercices : réaliser régulièrement telles pièces dans tel ou tel bois et les ajuster les unes aux autres en de rigoureuses constructions ; chaque jour faire nos gammes, à l’endroit et à l’envers, en déchiffrant les signes sur la page qui se convertissent en mouvements sur le clavier ; encore et toujours enchaîner des positions corporelles exigeantes portées par une intense concentration du souffle et de l’esprit. Pour devenir philosophe, y a-t-il aussi de tels exercices à faire sans relâche ? Pour répondre à cette question, il faudrait savoir ce que c’est qu’un philosophe et à quoi cela pourrait bien nous servir, de devenir philosophes. Nous avons affaire à une pratique ancienne – peut-être moins ancienne que la menuiserie et le yoga, mais bien plus ancienne que le piano. Les anciens Grecs, les premiers, ont parlé de gens qui « philosophent » (du verbe philosopheô) : il s’agit de gens qui « poursuivent le savoir », sont prêts à parcourir le monde et à vaincre de nombreux obstacles dans le simple but de voir et de connaître des choses. Un auteur grec du Ve siècle avant J.-C. nommé Hérodote1 nous rapporte, au premier livre de son ouvrage, l’Enquête (I 30 11-12), une anecdote. Crésus, un roi resté fameux pour la richesse dont il disposait lorsqu’il régnait au VIe siècle avant J.-C. sur cette région occidentale de l’actuelle Turquie que l’on appelait la Lydie, vante l’attitude de son hôte, un certain Solon d’Athènes, qui, « désirant le savoir » (philosopheôn) s’est présenté « dans de nombreux pays, dans le but d’observer ». Ce Solon ne faisait pas que l’admiration des rois : il avait, chez lui à Athènes, été choisi pour arbitrer une crise politique majeure et avait proposé à ses concitoyens une nouvelle constitution, avant de se retirer de la vie politique pour parcourir le monde connu. Il ne voyageait ni pour affaires ni pour des raisons diplomatiques : seule l’envie de savoir, et pour ce faire de tout voir, l’aurait poussé à partir sur les chemins. Sa curiosité semble avoir fait l’admiration d’un roi, peut-être a-t-elle aussi incité ses concitoyens à en faire l’arbitre de leurs différends. Admettons que l’on puisse trouver quelque utilité à être philosophe – comment le deviendra-t-on ? Les gammes du philosophe seraient-elles ses voyages d’observation à la rencontre des peuples, des institutions, des fleurs et des moineaux ? Hérodote, dont l’œuvre parcourt ainsi le monde connu
1 Pour une chronologie générale des auteurs et des événements, voyez les « repères chronologi-ques » en fin de volume.
platon160p_V2.indd 5 13/10/10 10:35:15
6
comme s’il suivait, un siècle plus tard, les traces de Solon, aurait pu procurer à ses lecteurs l’occasion d’un exercice philosophique sans avoir à quitter leur salon. Nous qui connaissons aujourd’hui un monde bien différent aurions tout à refaire. Précisons encore néanmoins ce que cherche le philosophe. Parmi les descendants de Solon, on trouve un citoyen athénien né vers 428 avant J.-C. et surnommé « Platon », qui s’est à son tour engagé à philosopher. Il confirme le jugement de Crésus sur son aïeul : philosopher, c’est bien le fait de gens qui ont envie de voir beaucoup de choses. Le philosophe doit être « synoptique », écrit-il dans un livre que l’on appelle en français La République, ce qui signifie que son regard doit chercher à embrasser une grande multiplicité de choses en même temps, et, en outre, essayer d’en saisir le point commun, l’unité. Serait-ce cela que Solon cherchait dans ses pérégrinations ? L’unité cachée des institutions perses, des crocodiles d’Egypte, des fleurs des îles et des chevauchées des amazones ? Oui, ce pourrait bien être cela. Et Platon, comme un menuisier aurait laissé à ses élèves en un certain lieu une série de patrons, d’outils et de méthodes, comme un pianiste aurait rassemblé une variété de gammes, ou un maître yogi un certain agencement de postures enchaînées, nous aurait laissé un lieu pour nous exercer à trouver cette unité, en cultivant cet art qui, semble-t-il, suscite l’admiration des rois et l’espoir des peuples.
II
Pourquoi les Grecs ?
Pourquoi faut-il que nous allions si loin dans le temps ? Peut-être notre apprentissage suppose-t-il plus qu’un voyage dans l’espace : le temps nous ouvre aussi l’exploration d’une multiplicité de choses à visiter, d’autant plus intéressantes, peut-être, qu’elles viennent de loin. Or les anciens Grecs viennent de loin. Ils sont certes des membres de la même espèce, mais aussi, en un sens, ils sont déjà une autre humanité, dotée d’une pensée, de mœurs et de sentiments qui ne sont plus les nôtres : ils sont un monde englouti dont nous déchiffrons les bribes. Et pourtant cette civilisation disparue nous regarde encore : les anciens Grecs sont peut-être ce qu’il y a de plus proche dans ce qui est déjà lointain, ce avec quoi, parmi les autres formes de vie humaine, nous partageons encore suffisamment de mots et de pratiques pour que la considération de ce qu’il nous reste de commun, par delà la distance et les variations, nous renvoie de nous-mêmes une image venue d’un autre monde. Ce sont des aborigènes qui nous parlent des pratiques que nous tenons encore pour être le fleuron de notre culture : la science, les arts, l’organisation de l’État. Ils projettent l’ombre d’une soudaine altérité sur ce qui nous semble nous constituer si intimement. À nous regarder en eux, c’est à nous-mêmes que nous paraissons appartenir un peu moins chaque jour.
platon160p_V2.indd 6 13/10/10 10:35:15
7
Or cette humanité si lointaine nous dit déjà qu’il faut philosopher, c’est-à-dire aimer le savoir, tous les savoirs. Les anciens Grecs les aimèrent sous toutes leurs formes, à commencer par celles sous lesquelles ils se présentent dans la vie la plus quotidienne. Homère, en racontant les aventures d’Ulysse, est toujours attentif aux œuvres de l’esprit humain : construire un bateau, naviguer aux étoiles, accomplir un sacrifice, faire du bois un meuble, de la laine un vêtement. C’est partout « l’éloge du professionnalisme » qui est fait par le poète : qu’il chante, soigne, dise l’avenir ou fasse des charpentes, l’artisan est constamment loué pour ses performances, et son savoir-faire l’expose individuellement à l’admiration et le propose à la mémoire2. Le charpentier, le médecin, ou l’aède qui chante de village en village : voilà autant de gens que les Grecs appelaient des « dêmiourgoï », c’est-à-dire des gens qui travaillent pour la communauté, qui rendent un service au public et qui sont, pour cette raison, toujours bienvenus partout où ils vont, comme il est dit dans l’Odyssée (17, 383). Les Grecs ont perçu le savoir, tel qu’il se présentait sous la figure du charpentier ou du médecin, comme un « bien commun (xunon agathon) », pour reprendre l’expression même d’Hippocrate, le médecin grec, s’il est bien l’auteur du traité intitulé Les Vents (1.1-21). Le savoir donne corps à la collectivité en faisant exister un bien qui appartient en propre à celle-ci : un service public. Quoi d’étonnant dès lors à ce que l’ouvrage des gens de métier soit devenu pour les Grecs une référence commune ? Quoi d’étonnant à ce qu’Homère, lorsqu’il veut nous faire voir le nuage de poussière au-dessus du choc des armes sur le champ de bataille, nous demande d’imaginer un groupe de paysans en train de battre le blé avec des vans, de voir l’écorce du grain qui volète au-dessus de leurs têtes (Iliade V 494-506) ? Quoi d’étonnant, lorsqu’il veut nous faire sentir la force de la parole d’Achille parlant à ses troupes, qu’il nous demande d’imaginer le moment où, sous les coups du charpentier, les pièces de bois se resserrent les unes contre les autres, comme les soldats resserrent leurs rangs à l’écoute du chef (Iliade XVI 210-217) ? Le savoir-faire à l’œuvre n’est pas seulement un bien commun, c’est aussi un langage commun : une source d’analogies permettant aux Grecs de partager les expériences les plus diverses, de les rendre palpables, visibles au plus grand nombre. Voilà donc le miroir que nous tendent encore les Grecs. Ils nous demandent ce que nous avons fait de leur amour des savoirs, de l’idée d’un bien public et d’un langage commun dont cet amour était le pilier. Qu’avons-nous fait de l’étrange idée que cette disposition à connaître et à savoir faire, qui nous met en contact avec la structure même des choses, est une expérience qui modifie profondément le vivant que nous sommes, en développant sa capacité à construire le monde commun d’une vie collective heureuse et à trouver sa juste place au sein des choses ?
2 Nous citons et paraphrasons Norman Austin, Archery at the dark of the moon : poetic problems in Homer’s Odyssey, Berkeley, 1982, University of California Press, p. 179.
platon160p_V2.indd 7 13/10/10 10:35:15
8
III
Les dialogues3
notre lieu d’exercice
Platon n’écrit pas comme les philosophes qui l’ont précédé. Il n’écrit pas de poèmes, comme Parménide, pour exposer la doctrine véritable et réfuter les doctrines illusoires ; il ne fait pas, comme Anaxagore, un livre qui déclare démontrer quels sont les premiers principes de toutes choses ; il n’écrit pas comme le feront encore les philosophes à venir, c’est-à-dire en vue de partager le résultat de leur pensée, la thèse à laquelle ils souhaitent associer leur nom, en proclamant ainsi haut et fort l’opinion qu’ils se sont faite. Platon, comme un auteur de théâtre, nous laisse en compagnie de personnages qui défendent des points de vue divers sans jamais paraître en son nom propre, sans dire clairement quelle est « sa » philosophie, quelles sont « ses » thèses, dont on pourrait ensuite faire le catalogue – même si, au fil des siècles, les lecteurs ont bel et bien constitué une telle liste de thèses « platoniciennes ». On a dit4 du reste qu’il voulut être poète, et qu’un jour où il courait soumettre ses tragédies au festival des Dionysies, il aurait rencontré Socrate, après quoi il serait rentré chez lui brûler son œuvre poétique naissante. Platon s’inscrit dans un genre littéraire nouveau au début du IVe siècle avant J.-C. et qui semble avoir connu une certaine vogue à l’époque, celle du « dialogue socratique », par lequel on s’ingéniait à faire revivre l’esprit d’un personnage fameux du Ve siècle qui, comme Solon avant lui, avait pu incarner aux yeux des Athéniens l’image de celui qui « philosophe », puisqu’il avait été représenté ainsi sur scène, au théâtre – il faut bien comprendre que le théâtre, pour les Athéniens du Ve siècle, n’était pas un simple divertissement auquel certains se rendaient davantage que d’autres, mais une scène irremplaçable au cœur des principaux festivals religieux, avec une représentation unique et un concours couronnant les meilleurs dramaturges, avec des citoyens choisis pour être acteurs, d’autres pour financer le spectacle5. Socrate, présenté sur scène par Aristophane comme le philosophe-type, ne pouvait manquer de l’incarner aux yeux des Athéniens. Comme la vie de Socrate s’était terminée de manière tragique par une condamnation à mort prononcée par un tribunal populaire où tout citoyen pouvait siéger et prononcer la sentence
3 L’étude de la stylométrie (les variations du style) permet de dessiner trois groupes chronologiques parmi les dialogues de Platon, ceux des œuvres dites de jeunesse, de maturité et de vieillesse. Mais toute tentative d’affiner la chronologie à l’intérieur des groupes s’est avérée vaine ; Groupe I : Apologie, Charmide, Criton, Cratyle, Euthydème, Euthyphron, Gorgias, Hippias Majeur et Mineur, Lachès, Lysis, Menexène, Ménon, Phédon, Protagoras, Symposium, Groupe II : Parménide, Phè-dre, République, Théétète. Groupe III : Lois, Philèbe, Sophiste, Politique, Timée, Critias. L’édition de référence est celle d’Henri Estienne (1578), en grec avec une traduction latine : on cite universelle-ment la pagination de celle-ci (page, colonne, ligne, ex. : 185a8).4 Diogène Laërce, Vies et Sentences des philosophies illustres, III, 5.5 Voyez Paul Demont et Anne Lebeau, Introduction au théâtre grec antique, Livre de Poche, coll. « références », 1996.
platon160p_V2.indd 8 13/10/10 10:35:15
9
au nom de la cité, il était décidément une figure publique. Il est peu étonnant que de nombreux écrits aient tenté de le faire revivre, de le défendre, de le montrer exemplaire dans des situations réelles de son existence ou dans des situations inédites et fictives : il ne s’agissait pas d’une littérature cherchant l’exactitude du témoignage mais plutôt à frapper par l’imitation d’un noble caractère – il faut même se méfier de la façon dont les auteurs y défendent parfois l’authenticité de leur témoignage, car c’est là un tour rhétorique propre au genre6. Les auteurs de dialogues socratiques cherchent une autre vérité que celle de l’exactitude des faits : ils transmettent l’inspiration qu’ils tiennent d’un esprit qui les a profondément modifiés, inspiration que chacun développe à sa manière. Platon s’inscrit donc dans un genre littéraire libre et vivant, qui n’est pas celui des philosophes et qui lui permet plutôt de suivre un personnage public insolite à travers l’Athènes de la deuxième moitié du Ve siècle, une ville en guerre, une ville cosmopolite, une ville caractérisée par un bouillonnement artistique et scientifique hors du commun. Il fait ainsi rencontrer à Socrate le plus grand nombre de figures des arts et du savoir, de la société et du pouvoir. Il manie toutes les formes d’écriture, imite tous les genres, de l’oraison funèbre au traité constitutionnel, de la prose médicale à celle de l’historien. Platon a tout lu et sa prose se nourrit aussi bien de la lecture de Thucydide ou d’Euripide que de celle des traités de médecine, de mathématiques et de rhétorique7. Au total, cette écriture se disperse parmi la multiplicité des voix, des discours et des personnages – sans que jamais la voix d’un auteur n’interrompe ce joyeux théâtre pour nous indiquer ce qu’il pense en son nom propre. L’écriture platonicienne, en créant une surface où tous les savoirs cohabitent, où les mots et les concepts se meuvent librement d’un genre à l’autre, tend un miroir à ce Ve siècle où les savoirs et les sciences n’étaient pas encore si différenciés qu’ils ne puissent se nourrir d’un échange permanent des images et des concepts. Bref, c’est un véritable voyage que nous proposent les dialogues, peut-être tout aussi foisonnant que ceux de Solon à travers l’Egypte et la Lydie. Un champ d’observation de choix pour l’apprenti philosophe. Quoi de mieux en effet que cette écriture qui se perd dans les méandres de son temps pour mettre à l’épreuve notre capacité à faire l’unité du multiple et à acquérir le coup d’œil du philosophe ? Depuis vingt-cinq siècles, nombreux sont justement ceux qui ont appris à philosopher en lisant Platon, de l’ancienne Académie aux écoles impériales d’Athènes ou d’Alexandrie, de l’école médiévale de Byzance à Marcile Ficin8, du Coutançais
6 Sur le genre du dialogue socratique et ses caractéristiques principales, voyez Louis-André Dorion, Socrate, collection « Que sais-je ? », Paris, PUF, 2004. Pour prolonger, on lira l’étude séminale de Karl Joël, « Der logos Sokratikos », Archiv für Geschichte der Philosophie, VIII (1895), 4, 466-483 et IX (1896), 1, p. 50-66.7 Voir ce sur point Emily F Kutash, « What did Plato Read ? », Plato, The Internet Journal of the International Plato Society, n° 7, février 2007.8 Pour une présentation de l’histoire de la tradition platonicienne à travers les différentes écoles qui lui ont permis de traverser deux millénaires, de la fondation de l’école à Athènes jusqu’à la Renais-sance, voyez Luc Brisson, parties VI, VII, VIII du manuel Philosophie grecque, sous la direction de
platon160p_V2.indd 9 13/10/10 10:35:15
10
Louis Le Roy, dit Regius, auteur des Douze livres de la vicissitude ou variété des choses de l’univers (1576) au contemporain Hans-Georg Gadamer. Ils se sont soumis à cette épreuve de recherche de l’unité du multiple : certains l’ont trouvée, d’autres ont jugé qu’elle était impossible à trouver9. Apprendre à philosopher dans Platon, c’est recevoir cette question de l’unité comme une question posée à sa propre époque : parce que l’unité du texte platonicien se disperse à travers tous les savoirs et toutes les écritures de son temps, Platon nous amène à nous demander si, pour nous, lecteurs d’une autre époque, un tel lieu est encore possible où la diversité des savoirs et des pratiques, en laquelle se disperse naturellement l’expérience humaine du monde, trouve un espace et un langage communs où se réfléchir. Un tel lieu est celui de la philosophie ; en lisant Platon aujourd’hui nous recevons, comme d’autres l’ont reçue avant nous, l’invitation d’en tracer à nouveau les contours, pour notre temps comme pour ceux qui viennent. Les dialogues sont un monde virtuel au sein duquel l’apprenti philosophe peut faire ses premières armes avant de sortir au grand large, affronter la multiplicité de son époque. Or, nous l’avons dit, c’est de la possibilité d’une telle unité, c’est-à-dire d’un espace commun où la diversité des savoirs trouvent à traduire leurs expériences, que dépend l’idée même d’un bien commun. Telle est peut-être l’une des plus profondes leçons de l’exercice platonicien : le travail de la philosophie, par la mise en œuvre du désir des savoirs qui trame le tissu de leurs affinités, prépare la possibilité pour notre vie politique de s’articuler autour de choses communes et de l’intelligence collective10.
IV
La philosophie trouve son chemin vers l’invisible dans l’atelier Pour accomplir cet exercice d’initiation philosophique que constitue la lecture des dialogues, il faut commencer par suivre un fil très simple, en suivant quelques indices disséminés par Platon, qui, dans la multiplicité bariolée de son œuvre aux reflets multiples, a pris soin de nous indiquer quelques motifs plus voyants que d’autres. Bien sûr, il y a le personnage de Socrate : sans en faire un « porte-parole », comme si Platon n’avait écrit que pour restituer la pensée de Socrate, il faut admettre que ce personnage
Monique Canto-Sperber, Paris, PUF, 1997.9 Pour un panorama général des manières de lire les dialogues, voir Christopher Gill, « Le dialogue platonicien », dans Lire Platon, sous la direction de Luc Brisson et Francesco Fronterotta, Paris, PUF, 2006.10 Ce qu’il convient de ne pas nécessairement confondre avec la forme institutionnelle démocrati-que, qu’elle soit ancienne ou moderne. Comme nous le verrons (deuxième partie, chapitre 6), le fait que l’intérêt individuel soit subordonné au bien commun et que l’intelligence collective progresse n’est pas, rigoureusement parlant, nécessairement et strictement lié à des formes institutionnelles de type démocratique, et l’imagination politique ne saurait être bridée dans la libre création de formes institutionnelles adaptées à l’idée du bien commun.
platon160p_V2.indd 10 13/10/10 10:35:15
11
est doté d’une récurrence signifiante. Plus encore, le Socrate de Platon a tendance non seulement à revenir souvent sur la scène, mais, comble de la récurrence, à se répéter inlassablement. Comme le note très justement Calliclès dans le Gorgias, Socrate insiste à dire « toujours les mêmes choses » (490e9). Il en est fier, en outre : ce sont, dit-il, ceux qui sont amoureux du peuple, comme Calliclès, qui ont un discours varié, car le peuple est changeant ; celui qui est amoureux de la philosophie dit toujours la même chose, car celle-ci tient toujours le même langage – la philosophie est le seul objet d’amour qui rende fidèle à soi-même et à sa propre parole (481d5-482c2). Voilà peut-être un fil à suivre pour lire les dialogues : nous montrer attentifs à ce qui, de le part de Socrate, fait l’objet d’un rabâchage intensif. Or, il y a deux refrains favoris du Socrate platonicien. Du premier, c’est encore Calliclès qui parle le mieux : « Par les dieux, franchement, tu ne cesses donc jamais de parler de cordonniers, de cardeurs, de cuisiniers et de médecins, comme si c’était de ces gens-là que nous parlions ! » (491a1-3). C’est vrai, en lisant les dialogues de Platon, on entend un Socrate qui ne cesse de nous ramener à l’échoppe des artisans et aux étals des marchands auprès desquels il aime à traîner11, cherchant en permanence à dresser, à propos du moindre sujet de conversation, une analogie avec les procédures et les prestations des arts et métiers, de ce que les Grecs appellent tekhnê et qui désigne la compétence, le savoir, tout autant que l’activité de l’artisan, ou de celui en général qui possède un savoir-faire, des techniques, du marin qui parcourt la mer au berger qui prend soin du troupeau en passant par le laboureur ou le poète12. Calliclès exprime un préjugé social courant chez les aristocrates athéniens, considérant que de telles tâches sont plutôt le fait des esclaves en tant qu’elles avilissent les corps et les âmes de ceux qui les pratiquent. Il arrive à Socrate lui-même de faire la différence entre le fait d’étudier des arts, comme la grammaire, la cithare ou la gymnastique, pour simplement parfaire une éducation d’homme libre, et le fait de devenir praticien et spécialiste de ces arts (Protagoras 312b2-4). Il faut surtout éviter de lire dans une telle distinction, faite par Socrate en s’adressant à un fils de bonne famille qui ne se destine pas à un métier technique, l’idée que de telles occupations auraient été le fait d’esclaves à Athènes, puisque l’artisanat était aussi pratiqué par les hommes libres et les étrangers résidents (appelés métèques)13 : l’Assemblée des citoyens est même peuplée de ces foulons, de 11 Au début de l’Apologie de Socrate, Socrate invite le jury populaire à ne pas lui tenir rigueur de sa façon de plaider sa cause en parlant le même langage que celui qu’il emploie en s’adressant à tout un chacun « sur la place du marché (agora) auprès des comptoirs des commerçants », 17c8-9.12 Sur la diversité des sens du terme, voir Anne Balansard, Technè dans les Dialogues de Platon, L’Empreinte de la Sophistique, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2001. Nous traduirons le plus souvent ce terme par le français « art », au sens des arts et métiers.13 On s’en rend compte aisément en consultant les inscriptions de l’Acropole où se trouve consi-gnée la liste des artisans qui ont participé à la sculpture des frises et colonnes de l’Erechtheion, le temple d’Athéna et Poséidon. Voyez le tableau reproduit par M. Austin et P. Vidal-Naquet, Economies et sociétés en Grèce ancienne, Paris, Armand Colin, 1972, p. 303. Les citoyens sont plus nombreux que les esclaves (24 contre 20), et les métèques les plus nombreux (42). Dans les spécialités, les maçons et les charpentiers, également divisés entre citoyens, métèques et esclaves sont de loin
platon160p_V2.indd 11 13/10/10 10:35:16
12
ces cordonniers, de ces charpentiers, de ces bronziers, de ces paysans, de ces marchands et autres trafiquants du marché, comme le rappelle Socrate chez Xénophon (Mémorables, III, 7, 4-7). Que les arts et métiers soient plutôt le fait de simples citoyens que de riches aristocrates ne surprendra personne. Cela n’empêche en aucune manière l’artisan d’avoir cette place culturelle considérable que nous avons décrite : qu’Homère ou Platon ne se destinent pas eux-mêmes à devenir charpentiers ne leur interdit pas d’ouvrir la porte de leurs œuvres à cette figure de l’artisan qui fut si centrale dans la perception que les Grecs avaient de leur monde. Or à cela il n’y a qu’une raison, comme le dit bien Socrate, au moment même où il distingue l’éducation technique de l’éducation d’un homme libre : les peintres, les charpentiers et tous les gens de ce genre font partie des gens qui savent (epistemones ; voyez Protagoras 312d1-3). Comme le récit de l’Apologie de Socrate le confirme, Socrate, après s’être entendu dire par l’oracle de Delphes que personne n’était plus sage, plus savant que lui (sophôteron) (21a6-7), et se sentant lui-même bien peu savant, entreprend de se confronter aux hommes réputés savants afin de réfuter l’oracle. Or aucun des hommes jouissant de la plus haute réputation de sagesse, ceux qui s’occupent des affaires publiques et ceux qui composent des poèmes, ne soutient l’épreuve : seuls les gens de métier s’avèrent enfin savoir quelque chose (21c-22d). Le problème de ceux-ci est néanmoins que l’assurance qu’ils tirent du fait de disposer d’un véritable savoir sur une chose précise et délimitée leur donne l’audace de vouloir parler avec autant de fermeté des choses qui ne sont pas l’objet de leur art, ce qui s’avère le plus souvent aventureux. Lorsqu’ils prétendent savoir ce qu’ils ne connaissent pas avec autant de certitude que ce qu’ils savent, les artisans ne sont pas indemnes du problème des politiques et des poètes, qui, croyant savoir, ignorent jusqu’à leur ignorance – face à quoi Socrate paraît en effet le plus sage, le plus savant des hommes en sachant quant à lui à quel point il est ignorant. Pour autant qu’ils exercent leur métier, les artisans sont néanmoins le modèle même de tout savoir, en sa limitation même. Toute science, tout savoir14 est en effet relatif : il est toujours savoir de quelque chose. C’est ce rapport spécifique à un objet précis qui différencie les savoirs entre eux, et qui permet par conséquent de différencier les arts en tant qu’ils sont des savoirs. Ce principe est explicité dans l’Ion, où le personnage de Socrate rappelle d’abord que si deux sciences ont le même objet, alors il s’agit nécessairement de la même science. Or comme un art est une science, il faut les plus nombreux – mais ce sont dans ces deux spécialités que se partagent tous les esclaves : les sculpteurs, modeleurs, scieurs, jointoyeurs, peintres, le doreur et les manœuvres sont tous libres, athéniens ou étrangers. Les contremaîtres et le secrétaire sont citoyens d’Athènes.14 Nous traduisons indifféremment par « science » ou « savoir » le grec epistêmê : dans ce type de contexte, Platon ne réserve pas ce terme pour des savoirs plus difficiles et plus rigoureux que d’autres. « Science » désigne ici tout savoir théorique ou pratique, la dimension épistémique de toute technique. Nous traduisons la plupart du temps le terme sophia de la même manière.
platon160p_V2.indd 12 13/10/10 10:35:16
13
dire qu’un art se distingue d’un autre parce qu’il est la connaissance d’un objet différent. La différence d’objet est un critère de distinction des arts (Ion 537c-538b). Socrate, dans la discussion avec Gorgias, dans le dialogue éponyme, introduit, à partir de 449d, ce trait constitutif. Gorgias dit avoir la science (epistêmê) de la « rhétorique » et donc être en mesure de former d’autres orateurs. Mais alors de quoi la rhétorique est-elle la science ? Quel est l’objet de cette science parmi les choses qui existent (peri ti tôn ontôn, 449d1-2) ? Si elle était un art (ce qui lui sera refusé par Socrate) et ne se réduisait donc pas à un autre art, elle devrait avoir son objet spécifique : une chose parmi les choses qui sont. C’est là un résultat qu’Aristote reprendra pour en faire un trait fondamental de toute science, lorsqu’en Métaphysique E, 1 il énumère différents objets tels la santé et les objets mathématiques, et affirme qu’il y a des sciences qui s’occupent spécifiquement de chacun de ces objets, car « toutes les sciences de ce type circonscrivent un être donné, un genre donné, et s’occupent de celui-ci » (1025b8-9). Circonscrire quelque chose qui existe : telle est l’opération constitutive de tout savoir. Les artisans, par la limite de leur compétence, en témoignent. Et parce qu’ils sont un exemple de savoir authentique dont chacun est familier, ils sont un modèle idéal pour se représenter ce que peut le savoir, en particulier si l’on veut essayer de trouver la moindre certitude dans les sujets qui nous préoccupent et nous causent du souci. C’est donc pour cette raison que Socrate invoque constamment ce modèle pour mettre de l’ordre dans les discussions portant sur les affaires humaines (c’est-à-dire non divines) et les circonstances quotidiennes de nos actes. Dès lors, il faut limiter la portée du fameux aveu d’ignorance Socratique : Socrate sait qu’il ne sait pas et sait qui d’autre ne dispose pas d’un savoir véritable parce qu’il est en possession, avec le modèle technique, d’un véritable modèle de savoir dont il entend tirer tous les principes et concepts d’un nouveau savoir moral. L’ignorant qui possède déjà le critère de validité du savoir et la capacité de reconnaître le savoir véritable quand il le croise est un ignorant qui a bien de la chance. Que sait donc l’artisan ? C’est ce que nous apprend un second motif parmi les choses que Socrate aime à répéter. L’autre refrain attribué par Platon au personnage de Socrate concerne des objets dont celui-ci ne manque jamais de rappeler qu’il ne cesse de les ressasser, de les avoir « déjà maintes fois évoqués » (Gorgias 507a8-9), ces choses « que nous ne cessons de répéter » (Phédon 76d7), à savoir qu’il existe quelque chose de beau, quelque chose de bon, une réalité (ousia, 76d7-9) de ce type pour chaque multiplicité de choses à laquelle nous donnons le même nom. Il s’agit des fameuses « Idées » platoniciennes, que nous appellerons toujours des « formes », traduisant ainsi les deux termes que Platon utilise pour désigner ces étranges objets (idea, eidos) et laissant de côté la majuscule un peu intimidante (« Forme ») qu’on leur octroie souvent : dans l’atelier philosophique, nous allons apprendre à manipuler ces choses, à les entrechoquer dans tous les sens, sans ménagement, et il vaut mieux dès maintenant ne pas faire de
platon160p_V2.indd 13 13/10/10 10:35:16
14
manières. Nous n’en dirons pas plus pour l’instant à propos de ces choses, puisque l’essentiel des pages qui suivent ont pour objet de tenter de nous familiariser avec elles. Pour l’instant, il nous faut simplement comprendre quel lien possible unit ces deux refrains : les cardeurs et les cordonniers, d’un côté, les formes de l’autre. Historiquement, il y a un lien fort entre ces deux motifs, puisque les concepts d’idea et d’eidos, avant de devenir des concepts centraux de la philosophie platonicienne, sont d’abord apparus, avec un sens technique, dans les traités médicaux et rhétoriques, comme on l’a montré : avec ces termes, le médecin identifie des récurrences, des configurations symptômales, l’orateur des tours rhétoriques et des styles15. Platon, à son tour, va désigner par là une chose elle aussi récurrente à travers la multiplicité des variations, cette chose unique que l’artisan a en vue à chaque fois qu’il fabrique, par exemple, un lit : ainsi le menuisier sait ce qu’il faut faire pour fabriquer un lit dans tel ou tel matériau, et tout lit que l’on a fabriqué ou que l’on fabriquera un jour doit respecter, si l’on a l’ambition de vouloir dormir dessus, quelques traits fondamentaux, que le menuisier connaît et qu’il reproduit à chaque fois. C’est ainsi auprès de l’artisan que le philosophe apprendra ce que c’est que maîtriser l’unité d’une multiplicité, c’est-à-dire une forme, et savoir en reproduire des exemplaires. Or, la forme, cet objet central de la philosophie platonicienne, est une chose que l’on ne saurait voir, mais seulement penser. Elle est invisible. En ce sens, tous les ateliers sont des ateliers de l’invisible, où les artisans manipulent les matériaux en ayant à l’esprit l’invisible structure des choses. Si les dialogues de Platon regorgent de savoir-faire et de pratiques innombrables, c’est que ceux-ci poursuivent cette structure invisible des choses qu’est la forme et que saisissent les hommes pour autant qu’ils développent en eux des dispositions à connaître, à transformer et à produire des choses. Or les dialogues entendent nous faire avancer dans la compréhension que seul le savoir transforme l’être humain d’une manière qui le rende apte à accomplir sa nature et à administrer son existence collective de manière heureuse, juste et plaisante. Pour prendre en main leur destin commun, les hommes doivent développer de nouveaux savoir-faire, sur le modèle de ceux qui existent déjà, et de nouvelles façons de les partager. Et, à force de travail, devenant savants et sages, chacun pris séparément et tous ensemble collectivement, nous en venons à ressembler à l’univers en son libre mouvement. N’en disons pas plus pour l’instant sur ces choses étonnantes, suivons Socrate dans les échoppes et les ateliers. Le présent ouvrage se divise en deux temps, qui correspondent à deux grandes phases de transposition de la méthode des artisans dans la philosophie. Dans un premier temps, on se familiarisera avec le travail de l’artisan, avec ses procédures et avec l’objet de son savoir, en vue de s’inspirer de lui pour parvenir à une représentation nouvelle de la réalité, fondée sur la méthode de la division et du rassemblement : de même qu’un bon artisan doit connaître toutes les 15 Voir l’étude de A. E. Taylor, in Varia Socratica, Oxford, James Parker & Co., 1911, p. 187 et sui-vantes, en particulier la synthèse p. 201.
platon160p_V2.indd 14 13/10/10 10:35:16
15
espèces de lits ou de maisons qu’il est possible de construire, de même le philosophe devrait savoir comment se diversifient les unités de toutes choses. On trouvera à l’occasion quelques exercices pour s’approprier ces outils ; on recommande au lecteur de les prolonger en faisant à son tour l’exercice de lecture des pages des dialogues concernées. La seconde partie permet de suivre la philosophie au grand large, lorsqu’elle s’élance à la conquête de l’être, du cosmos et de la cité. Or ce nouvel élan s’appuie sur un approfondissement de la compréhension de la méthode des hommes de l’art : toute technique est fondée sur la compréhension des ingrédients de la réalité que l’on manipule et la façon dont ils acceptent de se combiner. C’est ce savoir du mélange qui est au fondement de l’art de diviser : pour savoir combien il y a d’espèces de choses, il faut savoir de combien de façons ses éléments acceptent de se mélanger. Il y a donc deux grandes méthodes à apprendre à maîtriser en cet atelier de l’invisible : d’un côté la division et les rassemblements, de l’autre la juste détermination des ingrédients et des proportions du mélange. Seule la possession complète de ces méthodes confère le véritable savoir, qui est indissociablement et immédiatement théorique et pratique, puissance de connaissance et puissance de transformation de soi-même et de toutes choses.
Partie I
Outils I : diviser, rassembler
Chapitre I
Les règles de l’art
§ 1. Un modèle pour juger de toutes choses
Les circonstances fluctuantes de la vie nous placent face à de nombreuses décisions difficiles, tout particulièrement lorsqu’il n’est pas facile de savoir immédiatement ce qu’il est juste ou injuste de faire, beau ou laid, courageux ou lâche, raisonnable ou déraisonnable. Nous éprouvons dans ces circonstances la faiblesse de notre jugement et cherchons le secours d’autres qui sauront peut-être mieux que nous-mêmes et à qui nous demandons conseil16. L’idéal serait qu’il y ait des gens fiables à qui confier chacune de nos décisions difficiles : des gens qui, sur chaque chose, savent. Socrate,
16 Voyez comme Aristote, dans son analyse de la délibération, souligne la difficulté qui résulte du fait que nous devons prendre nos décisions dans des contextes fluctuants ; aussi, dès que l’affaire est importante, nous nous défions de notre capacité à faire seuls le bon choix et nous en appelons au conseil d’autrui (Ethique à Nicomaque III 1112b8-11).
platon160p_V2.indd 15 13/10/10 10:35:16
16
dans les dialogues de Platon, est un personnage que l’on voit chercher de telles gens, afin d’examiner leurs prétentions à prodiguer de bons conseils à celles et ceux qui ont des choix à faire. Ainsi, dans l’Hippias Majeur, Socrate rencontre en Hippias une première espèce de gens réputés pour leur savoir dans l’Athènes du Ve siècle : un sophiste17. C’est une occasion pour Socrate de soumettre à ce savant homme une objection que lui a récemment faite un individu peu poli. Lors d’une discussion où Socrate blâmait certaines choses et en louait d’autres, les premières pour leur laideur, les secondes pour leur beauté (il faut entendre ici la nuance morale que comportent ces termes), on lui a demandé sans ménagement « d’où » il savait « quelles choses sont belles et quelles choses sont laides » (286c8-d1). Comment en effet Socrate décide-t-il quelles choses sont dignes d’être louées et quelles choses sont dignes d’être blâmées ? Le sait-il de source sûre ? L’individu qui lui fait cette objection complète sa question en demandant si Socrate possède un tel critère pour faire le tri entre les choses, et s’il en a un, de le révéler en disant « ce qu’est le beau (ti esti to kalon) » (d1-2). Un certain nombre de dialogues nous placent dans un tel contexte : on aimerait savoir à quoi reconnaître des choses ou des actions qui soient dignes d’éloge ou de blâme. C’est un contexte pratique : il s’agit d’obtenir un repère pour s’orienter dans ses choix et ses jugements. La mise en scène de l’Euthyphron insiste à son tour sur ce point. Socrate se rend sur l’acropole pour répondre à l’accusation qui lui est faite et selon laquelle il introduirait de nouveaux dieux et ne croirait pas aux anciens ; il exercerait dès lors une influence corruptrice sur la jeunesse (2c-3b). Or il a la chance de croiser Euthyphron, représentant d’une autre espèce de gens réputés pour leur savoir en Grèce ancienne : un devin, qui lit les intentions des dieux dans les signes où elles s’annoncent à qui sait les voir18. Un tel homme se targue de savoir exactement ce qui est impie ou ne l’est pas dans telles ou telles circonstances. Si, à la place de Socrate, il était accusé d’impiété, il aurait tôt fait de mettre ses accusateurs dans l’embarras. Du reste, Euthyphron se présente lui-même au Portique pour une affaire qui n’est pas banale, puisqu’il poursuit son père pour le meurtre d’un employé, une décision d’autant plus difficile à prendre qu’il semble impie pour un fils, aux yeux de nombreux Grecs, de poursuivre son père. En outre, les circonstances de l’affaire sont confuses : la victime est un meurtrier que le père a fait ligoter après son forfait, puis garder dans une fosse pendant qu’il envoyait quelqu’un s’informer de la conduite à suivre, et c’est pendant cette détention que l’homme est mort. Comme le remarque Socrate, voilà un cas bien difficile : comment se comporter correctement dans un tel cas ? Ce ne sera pas le fait du premier venu, mais de celui qui est déjà bien avancé dans la voie de la sagesse (4a12-
17 Il s’agit de gens fort savants qui font profession d’enseigner leur savoir. Ils affluent de diverses cités grecques vers Athènes dans la deuxième moitié du Ve siècle. Voyez Les Sophistes, Écrits complets, éd. J.-F. Pradeau, Paris, Flammarion, 2009.18 Pour une présentation de la religion grecque antique, de ses pratiques et de ses rites, voir J. Rudhart, Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce classique, Paris, Picard, 1992 [2]. Sur les devins voir en particulier p. 266-271.
platon160p_V2.indd 16 13/10/10 10:35:17
17
b2). C’est qu’il faut, parmi les circonstances, savoir quel trait saillant isoler : doit-on retenir qu’il s’agit du père d’Euthyphron, comme le ferait la plupart des Grecs ? Doit-on plutôt considérer que le père est un meurtrier comme un autre ? Euthyphron s’autorise de son savoir pour trancher : il conteste l’opinion courante, qui est celle de gens ignorants de la position véritable des dieux sur le pieux et l’impie (4e1-3), car il sait que les dieux exigent que le fils poursuive le père pour laver la souillure entraînée par cet acte. Voilà la marque du savoir : choisir avec fermeté parmi les détails d’une affaire compliquée, savoir s’y orienter en sachant immédiatement où se trouve le juste, ou en l’occurrence, le pieux. Socrate prie Euthyphron de lui livrer le critère qui lui permet de s’orienter ainsi, de faire le partage entre les actions pieuses et celles qui ne le sont pas : « quelle chose dis-tu que le pieux et l’impie se trouvent être, en ce qui concerne le meurtre et tout le reste ? » (5c9-d1). Euthyphron ayant d’abord donné une réponse correspondant au cas du meurtre, comme le lui demandait Socrate (5d-6d), ce dernier lui demande de lui enseigner plus généralement ce qui est pieux et ne l’est pas, non pas seulement dans le cas du meurtre commis par un père, mais pour tous les cas. Considérons attentivement la forme dans laquelle est alors décrite un tel savoir : « Apprends-moi donc ce que se trouve être cette forme (idea), de telle sorte qu’en gardant un œil sur elle (apoblepôn) et me servant d’elle comme modèle (paradeigma), je puisse dire, parmi les actes que toi ou un autre accomplit, pieux ce qui est tel et impie ce qui ne l’est pas » (6e3-6). Ce serait donc là ce que voit celui qui sait ? Appelons cela la conception paradigmatique de la connaissance, qui suppose que l’on cherche un modèle qu’il nous suffise ensuite de consulter pour retrouver, parmi les actes et les choses, ceux et celles qui lui ressemblent, comme ceux et celles qui ne lui ressemblent pas. Ce modèle est appelé une « idée » ou une « forme » que l’on garde en vue, que l’on « garde à l’esprit », que l’on consulte, pour savoir reconnaître en toutes circonstances ce qui ressemblera au pieux, au juste, au courage. Notons aussi que le même modèle sert pour les deux types de choses contraires : mesurant aussi bien la ressemblance que la dissemblance, il permet de reconnaître les actions pieuses et d’écarter les impies. La connaissance devient un problème de reconnaissance, pour les hommes comme pour les dieux : un problème de qualification des actes, par la reconnaissance du modèle auquel ils ressemblent. Or le même acte pourra être impie pour certains, et pieux pour un autre. En s’en prenant à son père meurtrier, il se pourrait qu’Euthyphron fasse un acte cher à Zeus, mais hostile à Kronos et Ouranos19. Et le désaccord ne porte absolument pas sur le fait
19 Ouranos et Kronos ont tous deux subi la révolte d’un fils : Ouranos est châtré par son fils Kronos alors qu’il vient couvrir Gaïa, qui souffre de ces étreintes (voyez le récit chez Hésiode, Théogonie, v. 160-205, avec la naissance d’Aphrodite issue de l’écume produite par les testicules d’Ouranos tombées sur les flots) ; Kronos sait qu’il doit tomber sous les coups d’un fils et dévore ses enfants jusqu’à ce qu’advienne Zeus, qui grandit en cachette (ibid., v. 453-507).
platon160p_V2.indd 17 13/10/10 10:35:17
18
que celui qui ait tué injustement doive être puni : là-dessus, tout le monde est d’accord. Les tribunaux sont emplis de cette querelle : « ils ne disputent pas le fait que celui qui a commis l’injustice doive être puni, mais ils se disputent sur la question de savoir qui l’a commise, ce qu’il a fait exactement, et à quel moment » (8d4-6). Ce que l’on cherche, dans le détail des choses, pour reprendre le mot utilisé par le médecin à la recherche des symptômes, c’est « l’indice (tekmêrion) » (9a2)20 qu’elles ressemblent ou ne ressemblent pas au modèle, qu’elles appartiennent ou n’appartiennent pas à l’ensemble de choses que celui-ci définit : ensemble d’actes, de circonstances, d’agents impliqués dans telles ou telles mésaventures qui en viennent à ressembler, pris tous ensemble, à la justice, par exemple. Or à quoi reconnaître dans le détail des circonstances, par exemple celles, particulièrement compliquées, qui ont entraîné la mort de l’un des esclaves du père d’Euthyphron, la situation qui exige qu’il soit pieux pour un fils de chercher à châtier son père ou au contraire celle qui exige qu’il soutienne ce même père ? Il s’agit donc tout à la fois d’avoir un modèle et de savoir le reconnaître dans les circonstances changeantes, de savoir à quels traits parmi la multiplicité de ceux que comporte la situation on pourra reconnaître qu’une chose est juste, pieuse ou belle. Il faut avoir le paradigme et savoir repérer les indices qui y renvoient dans les choses et leurs particularités inextricables. Il faut donc retenir que le modèle paradigmatique implique une relation entre trois pôles : la forme qui sert de modèle, le sujet connaissant qui la garde en vue, les indices qui, dans les choses, permettent de percevoir une ressemblance au modèle. Tableau 1 : Le triangle paradigmatique
20 Pour l’usage du terme chez les médecins, voyez par exemple, dans les traités attribués à Hippocrate, le traité De l’Ancienne médecine XVII, 4, ou bien encore le traité Des Airs, des eaux, des lieux VIII 10 et 44 ; IX, 30 ; XVI, 23 ; XX, 1 ; XXI, 13.
platon160p_V2.indd 18 13/10/10 10:35:19
19
§ 2 Savoir définir et conseiller : la prérogative des hommes de l’art
Le Lachès s’ouvre aussi sur une question difficile à juger : encore une histoire de pères et de fils. Deux pères de famille, Mélèsias et Lysimaque, ont le sentiment d’avoir été délaissés par des pères trop occupés par la chose publique, et craignent à leur tour de ne pas savoir s’occuper correctement de leurs fils et de ne pas parvenir à en faire des hommes dont ils puissent se sentir fiers. Que leur apprendre, quelle activité leur faire pratiquer pour qu’ils deviennent meilleurs ? Mélèsias et Lysimaque ont approché deux hommes qui représentent là encore une forme d’autorité reconnue en ces matières : Lachès a été stratège21 pendant la guerre du Péloponnèse, et Nicias, qui a aussi commandé des expéditions militaires, fut un homme politique de premier plan après la mort de Périclès. Les deux pères de famille, eux-mêmes fils d’hommes qui ont exercé des charges publiques à Athènes, cherchent donc conseil auprès d’hommes qu’ils estiment très compétents dans le domaine dont il s’agit : il ne s’agit pas en effet seulement de rendre ces fils meilleurs dans leur vie privée, mais de les rendre dignes de s’imposer dans les affaires publiques. L’ironie de Platon se manifeste dans le fait de choisir parmi le personnel politique Athénien deux hommes qui ont surtout laissé le souvenir de cuisantes défaites où ils périrent eux-mêmes22. Mélèsias et Lysimaque ne manquent pas de justifier leur choix en explicitant deux qualités qu’ils reconnaissent aux deux généraux et qui, à leurs yeux, font la preuve de leur compétence à conseiller en ces matières. Tout d’abord, les deux pères de famille se plaignent des gens qui ne se prêtent pas véritablement à l’activité de conseiller, ne disent pas ce qu’ils pensent quand on sollicite leur avis (178a1-b5) : on retrouve dans cette invitation à la franchise un trait fondamental de la manière de discuter qu’exige Socrate. Comme y insistera encore Lysimaque, quiconque approche Socrate se trouve bientôt amené à dialoguer et à se laisser promener de raisonnement en raisonnement, jusqu’à devenir lui-même l’objet dont il faut rendre raison, « relativement à la manière dont il vit aujourd’hui et à celle dont il a vécu sa vie passée » (187e10-188a2). La discussion avec Socrate suppose que chacun, prenant parti sur la meilleure manière de vivre sa vie, y engage aussi sa propre existence : comme nous le constaterons en maintes occasions, définir les vertus avec Socrate, dire ce que c’est qu’un acte courageux ou un juste partage, ce n’est jamais un exercice purement théorique, mais aussi une enquête pratique sur la façon dont il faut vivre sa vie. Nicias et Lachès sont donc choisis par Mélèsias et Lysimaque parce que ces derniers estiment que les deux généraux sont hommes à dire franchement leur opinion et à gager celle-ci sur leur propre expérience et leur propre existence s’il le faut.
21 Les stratèges sont des magistrats en charge des opérations militaires. Ils font partie des ma-gistrats élus et non tirés au sort, ce qui a donné une importance considérable à cette magistrature en temps de guerre. Voyez M.-H. Hangers, La Démocratie à l’époque de Demosthène : structure, principes et idéologie, Paris, Les Belles Lettres, 2003, ch. 9.22 Lachès meurt à Mantinée, en 418, lors de la défaite des troupes athéniennes face aux Spartia-tes, tandis que Nicias, réputé trop prudent et sujet à l’indécision, est responsable d’une des plus tragiques débâcles connues par les Athéniens, en Sicile en 413 – il est lui-même fait prisonnier et mis à mort par les Syracusains.
platon160p_V2.indd 19 13/10/10 10:35:19
20
Outre leur franchise, c’est un deuxième trait qui justifie le choix de ces deux conseillers : Mélèsias et Lysimaque avouent qu’ils estiment que Nicias et Lachès ont dû s’occuper « comme personne au monde » de la question de savoir comment rendre leurs propres fils meilleurs. Et si ce n’était pas le cas, alors, assurent Mélèsias et Lysimaque, nous vous inviterions à « prendre soin de vos fils en commun avec nous » (179a8-b6). Il est donc possible aussi de chercher entre ignorants, et c’est le plus souvent dans ces circonstances que la discussion avec Socrate aura lieu dans les textes que nous allons examiner, celui-ci mettant souvent en avant le fait que lui non plus, ne sait pas. Prenons garde à une chose : pour de nombreux lecteurs de Platon, cette ouverture de Socrate à la discussion avec tout un chacun, tous ceux qu’il peut croiser près des étals des marchands, a été comprise comme une forme d’esprit démocratique. C’est là un contresens qui tient au fait que l’on néglige, au sein des pratiques sociales, la différence entre celles qui relèvent de la sphère publique et celle qui relèvent de la sphère privée. Socrate, dans un texte fameux de l’Apologie de Socrate, souligne bien le paradoxe qui est le sien : disponible à tous pour des entretiens privés, se mêlant volontiers des affaires de chacun, il se garde au contraire de se mêler des affaires de tous et de participer au débat public caractéristique des institutions démocratiques (31c4-32a3). La recherche en commun avec n’importe qui, même ignorant, est possible en privé, puisque Socrate ne semble vouloir repousser personne ; elle ne saurait pourtant être un modèle politique pour diriger les affaires de l’État23. C’est du reste ce que prouve la façon dont Socrate introduit dans le Lachès la nécessité de chercher des définitions afin de se rendre apte à prendre des décisions difficiles. Les quatre interlocuteurs croisent Socrate et se penchent ensemble sur la question de savoir comment éduquer les fils de Mélésias et Lysimaque. À la suggestion qui lui est faite d’exprimer, après avoir entendu les thèses contradictoires de Lachès et de Nicias, son suffrage en faveur d’un des deux orateurs – mimant ainsi la procédure utilisée à l’Assemblée démocratique pour parvenir à une décision –, Socrate oppose un refus très net : est-ce à la majorité qu’il faut trancher une telle décision ? S’en remettrait-on à la majorité (tois pleiosin) des présents pour savoir quels exercices un fils devrait pratiquer en vue d’une compétition sportive, ou plutôt à celui qui aurait été formé par un bon maître de gymnastique (184d8-e3) ? Rapporter tout débat éthique au modèle du savoir-faire technique a la conséquence immédiate de destituer le critère du nombre comme fondement du choix : « c’est en se fondant sur le savoir (epistêmê) qu’il me semble qu’il faut trancher, et non en se fondant sur le nombre (plêthei), si l’on veut que
23 Sur ce paradoxe, voir notre étude “Publicité politique et publicité sensible : le paradoxe poli-tique du Socrate platonicien”, Etudes platoniciennes 6 (2009) : 83-103. Le fait que ce que nous appelons aujourd’hui « démocratie » n’implique pas, comme à Athènes, la participation directe des citoyens à la gestion des affaires publiques, explique aussi peut-être la facilité avec laquelle on fait aujourd’hui ce contresens : le citoyen des démocraties contemporaines étant essentiellement confiné à la sphère privée et son rôle dans les affaires publiques majoritairement restreint à l’opi-nion qu’il s’en fait, il semble inévitable que l’on lise une dimension politique dans l’attitude privée de Socrate à l’égard des opinions de chacun.
platon160p_V2.indd 20 13/10/10 10:35:19
21
cet arbitrage soit juste » (184e8-9). Or comment décide-t-on de la compétence des uns et des autres ? Socrate propose deux critères, dont nous savons par ailleurs qu’ils proviennent d’un type de procédure par laquelle l’Assemblée démocratique désignait, à main levée, les magistrats et officiers chargés de fonctions techniques : les chefs militaires, les instructeurs des éphèbes (les pédotribes), les superintendants des Arsenaux (chargés aussi de la flotte)24, ainsi que les médecins publics. Pour être reconnu compétent en tant que médecin ou architecte, il faut pouvoir nommer ses maîtres et présenter ses œuvres (pour un médecin, il pourra s’agir de faire témoigner des malades qu’il a soignés25). Dans le Gorgias aussi, Socrate prend cette procédure d’attribution des charges publiques techniques comme modèle de test de compétence pour savoir qui saurait, à la tête de l’État, rendre les citoyens meilleurs : il faudrait nommer son maître et, en outre, prouver que l’on a rendu des gens meilleurs, à l’instar du médecin qui en a soignés (514a5)26. Cette procédure publique que Socrate reprend ici, dans le cadre privé, pour décider qui est compétent pour conseiller Mélèsias et Lysimaque, est précisément celle qui fait taire les ignorants, comme le rappelle un texte du Protagoras (319b3-d7). Socrate y affirme en effet, non sans quelque ironie, que les Athéniens sont des gens sages, ou qu’ils ont du moins la sagesse de faire la différence suivante : lorsqu’ils siègent à l’Assemblée et qu’il s’agit d’entreprendre des grands travaux, construire des édifices, des navires, et de manière générale lorsqu’il s’agit de choses « susceptibles de s’apprendre ou de s’enseigner », des choses « qui relèvent de la technique (tekhnê) », ils ne laissent personne d’autre que celui dont c’est le métier (dêmiourgos) leur donner des conseils et chahutent l’ignorant qui tenterait de le faire ; au contraire, lorsqu’il s’agit de « l’administration de la cité », ils laissent se lever « aussi bien un charpentier, un forgeron, un cordonnier, un négociant, un armateur, un riche ou un pauvre, un aristocrate ou un homme sans naissance » et laissent quiconque donner des conseils, même s’il n’a rien appris et n’a eu aucun maître – au prix d’un irrésistible brouhaha27. Il s’agit d’appliquer ce modèle aussi à la discussion privée que sont en train d’avoir nos interlocuteurs sur la question de l’éducation des fils de Mélésias et Lysimaque. Il faudra donc nommer ses maîtres, ou, si on n’en a pas eu, ses ouvrages (186a-b). Socrate déclare quant à lui ne pas avoir eu de maître en la matière, n’ayant pas eu le moyen de payer des professeurs de savoir, des sophistes (186c), et n’être pas capable de discerner lequel de Nicias et Lachès est compétent. Il ne faut
24 Voir Mogens H. Hansen, ibid. ; pour les instructeurs des éphèbes, voir aussi Aristote, Constitu-tion d’Athènes, 42, 3.25 Sur le statut de médecin public, spécificité de l’organisation sanitaire des Grecs destinée à favo-riser l’installation dans la cité de praticiens compétents, pour une période qui pouvait être limitée, voir Évelyne Samama, Les Médecins dans le monde grec, sources épigraphiques sur la naissance d’un corps médical, Paris, Droz, 2003, p. 38 pour la présentation générale de la question, et p. 39-41 sur la question du recrutement qui nous intéresse ici.26 E. Samama (loc. cit.), invoque ce texte comme unique témoignage, en dehors de l’épigraphie, sur cette procédure. Platon mentionne aussi le médecin public en Politique 259a.27 Sur le brouhaha comme manifestation des assemblées démocratiques, voir République VI 492b5-d1.
platon160p_V2.indd 21 13/10/10 10:35:19
22
pas se méprendre sur le sens politique d’un tel aveu d’ignorance, récurrent chez Socrate : avouer son ignorance sur les choses qui concernent la vertu, c’est-à-dire sur un sujet dont les Athéniens pensent qu’il est connu de tous sans nécessiter d’apprentissage spécifique, c’est rétablir la différence entre le savant et l’ignorant là où la démocratie vit de l’oublier, c’est ramener les sujets « démocratiques » dans le champ des choses qui s’apprennent et sur lesquelles l’avis de tous n’est pas équivalent. L’examen proposé est relativement facile à mener pour un maître de gymnastique, un médecin ou un architecte. Comment, en revanche, attester de sa capacité à rendre meilleurs les jeunes gens ? Socrate propose un examen de substitution : au lieu de chercher à savoir quels ont été nos maîtres et quels sont ceux que nous avons rendus meilleurs, une autre forme d’examen pourrait conduire au même but, et même s’avérer plus fondamentale encore (189d5-e3). Socrate propose un substitut à l’examen de compétence précédemment évoqué : « si nous savons, à propos de quoi que ce soit, ce qui, se produisant en quelque chose, rend meilleur ce dans quoi elle advient, et si nous sommes nous-mêmes capables de faire se produire cette chose dans une autre, il est alors manifeste que nous connaissons la chose même à propos de laquelle nous donnerions des conseils, en particulier sur la façon dont on peut l’acquérir facilement et parfaitement » (189 e3-7). Ainsi le médecin sait que la vue, en se produisant dans les yeux, rend ceux-ci meilleurs, et, comme il sait comment rendre la vue aux yeux et la faire advenir en eux, il est évident qu’il connaît « la vue elle-même, ce qu’elle se trouve être » (190a4). Il est frappant de voir surgir ici la fameuse formulation socratique de l’essence. Le médecin qui sait rétablir la vue dans l’œil sait aussi dire ce qu’elle est : il sait définir la vue. La capacité à définir est signe de la capacité à produire, car elle en est un effet. La question socratique de l’essence, loin d’être un pur jeu théorique doit au contraire être mieux comprise comme l’expression d’une capacité pratique à faire advenir des choses, que l’on sait définir parce qu’on sait précisément les faire venir à l’existence. Peut-être sommes-nous là tout simplement en train d’approfondir cette idée, par laquelle nous avons commencé, que tout art est fondamentalement, en tant que savoir, quelque chose qui a un objet. Savoir définir, c’est manifester que l’on a un objet et que l’on s’y rapporte sur une modalité qui est celle du savoir. En retour, cette même question gagne la dignité de servir à l’examen des compétences techniques, à titre de question même peut-être plus « fondamentale » que celle du nom du professeur et des œuvres déjà produites. Quand la capacité de production s’atteste comme capacité de définition, la question de l’essence devient un test de la capacité à produire à côté du fait de pouvoir nommer ses maîtres ou montrer son œuvre : elle témoigne du savoir qu’a le producteur de la chose qu’il sait produire. Nous pouvons ainsi comprendre l’invention socratique de l’interrogation de ses contemporains en vue de la définition des vertus comme une réforme de la pratique athénienne de vérification des compétences dans le cadre de
platon160p_V2.indd 22 13/10/10 10:35:19
23
la procédure d’attribution des magistratures et des charges techniques28. Demander de définir les vertus, c’est demander à chacun s’il sait les produire : produire des actes qui leur ressemblent, qui ressemblent au courage et à la justice, ou encore produire autour de soi de la vertu dans les actes et les discours de ceux que l’on fréquente. Faire de la vertu une compétence technique, c’est en outre priver l’assemblée démocratique d’un sujet de discussion qu’elle tenait à ne pas considérer comme spécialisé, en proclamant tout un chacun également compétent en cette matière.
Tableau 2 : Triangle du test de compétence technique
§ 3. Que sait donc l’artisan (I) ? Fonction, puissance, vertu. Premiers pas vers l’invisible
Posséder un art, c’est avoir un objet, que l’on connaît. Il convient d’envisager la diversité des rapports possibles à cet objet. Les personnages platoniciens attribuent à l’art (tekhnê) une puissance (dunamis). En dehors des sens courants du terme, celui de la force, de la puissance, de la richesse29, le sens de capacité à agir qui donne lieu, dans les dialogues, à une élaboration plus technique. Chaque art est ainsi défini par une puissance spécifique : chacun des arts est différent d’un autre par le fait qu’il possède une capacité différente, corrélée à un objet spécifique. Dans un passage de la République, la puissance de chaque art est définie comme capacité à procurer un avantage qui lui est propre : la santé pour l’art médical, la
28 Pour approfondir ce point, on peut lire notre étude « La Surpuissance morale des âmes savantes à l’aune de la procédure athénienne d’examen public des compétences techniques », in Études Platoniciennes IV, 2007, p. 69-102.29 En ce qui concerne les diverses significations du terme chez Platon et dans la littérature grecque avant lui, nous nous référons au travail de Joseph Souilhé, Étude sur le terme Dunamis dans les Dialogues de Platon, Paris, Alcan, 1919.
platon160p_V2.indd 23 13/10/10 10:35:20
24
sécurité dans la navigation pour l’art du pilote30. On peut distinguer les types d’avantages qu’un art est susceptible de procurer. Les dialogues manifestent un souci constant de distinguer les types d’activités techniques en fonction du type de prestation qu’elles offrent. Ainsi, dans le Sophiste, on distingue les arts qui procurent l’acquisition et ceux qui permettent la production. La définition de l’art de production, ou art « poiétique » est la suivante : « toutes les fois que quelque chose qui auparavant n’existait pas est ensuite amené à l’existence, nous disons que ce qui amène produit et que ce qui est amené est produit » (219b4-6). Il faut prendre garde à ne pas limiter la production à la manufacture d’objets artificiels, puisque Platon inclut aussi l’agriculture parmi ces arts producteurs : « l’agriculture et tous les soins (therapeia) consacrés à l’entretien des corps mortels ; tout travail relatif à ce qui, composé et façonné, est compris sous le nom d’objet mobilier ; la mimétique enfin, tout cet ensemble n’a-t-il pas vraiment droit à une appellation unique ? » (219a10-b2) – « celle-là même d’art poiétique » (b11). On vient de voir apparaître, au cœur de cette définition de l’art de production, l’art de soin, qui procure une prestation spécifique dont il existe par exemple une variante pastorale : celle du pasteur ou du berger qui prend soin de son troupeau. L’art de production s’oppose quant à lui à l’art d’acquisition, lequel « ne fabrique rien » : il « capture par les discours ou par l’action » des choses qui existent et sont déjà venues à l’être. L’art de la capture a toujours un objet précis, qu’il ne se laissera pas disputer par d’autres chasseurs. On notera que l’on place dans cette dernière catégorie un certain nombre des arts qui ont trait à l’apprentissage et à la connaissance : lorsque l’on découvre des objets de connaissance ou qu’on les acquiert, il s’agit d’une capture par le discours. Il faut encore distinguer l’art d’usage auquel les arts d’acquisition et de production sont souvent soumis. Un passage de l’Euthydème (289a-290a) distingue en effet l’art « qui sait produire quelque chose » et celui qui « sait comment utiliser (khrêsthai) ce qui est produit » : ainsi l’art de savoir fabriquer une lyre et l’art de savoir en jouer. On précise alors aussi que pour les discours aussi, il peut y avoir des producteurs qui n’ont pas l’art d’usage, ainsi que d’autres qui ont l’usage sans savoir fabriquer. Les premiers sont notamment les orateurs, faiseurs de discours ayant pour but d’envoûter leurs proies, juges, assemblées, foules. L’idéal serait tout à la fois de savoir produire les discours et les utiliser à bon escient – c’est à la philosophie et à l’art politique qu’il reviendra d’avoir une telle puissance. L’art d’usage occupe ainsi souvent la place la plus haute dans la hiérarchie des arts : c’est parce qu’un art possède l’art d’usage des produits ou des acquisitions d’un autre art qu’il peut se le subordonner. La suite du passage de l’Euthydème (290 b-d) insiste sur ce point en prenant pour exemple l’art de la chasse dont l’art du général d’armée (qui fait la chasse aux hommes et aux cités) est un cas particulier. Or l’art de la chasse est incapable de se servir de ce qu’il capture. Ceux qui vont à la chasse ou à la pêche remettent aux cuisiniers leurs
30 République I 346a6-8. On retrouve cette idée que l’attribution de la puissance est une façon de déterminer une chose comme une chose une dans le passage du Protagoras 330 a-b consacré à la question de l’unité et de la multiplicité des vertus.
platon160p_V2.indd 24 13/10/10 10:35:20
25
proies, ceux qui pratiquent les arts mathématiques (géométrie, astronomie, calcul) découvrent des figures et objets qu’ils ne produisent pas et dont ils ne savent pas non plus véritablement se servir, mais doivent remettre leurs résultats au dialecticien qui seul saura s’en servir même s’il ne produit pas lui-même les notions qui composent le discours mathématique; de même le général d’armée, lorsqu’il a pris une cité ou une armée la remet à l’homme politique qui sait comment faire usage de telles conquêtes. On retrouve cette idée de subordination à l’art d’usage dans un passage de la République (X, 601c-d). Plusieurs arts se rapportent au même objet, par exemple les rênes et les mors, ou encore la flûte. Dans le premier exemple, il y a le forgeron ou le sellier, qui sont capables de les produire, et le spécialiste du cheval qui sait en faire usage, dans le second, il y a le fabricant de flûtes et le joueur de flûte. On constate que la possibilité pour des arts d’avoir le même objet implique alors une hiérarchie : c’est à chaque fois le possesseur de l’art d’usage qui prescrit au fabricant comment il doit fabriquer l’objet pour qu’il puisse remplir sa fonction. Le tableau 3 rappelle les trois grandes puissances de l’art, en plaçant au centre un art de soin dont nous verrons qu’il peut prendre la forme des trois autres puissances (un pasteur a des compétences qui sont aussi bien de l’ordre de la production, de l’acquisition et de l’usage). Tableau 3 : Les puissances de l’art
Après avoir défini la puissance propre de chaque art au sens de l’avantage que chacun d’entre eux procure, puis défini les grands types de prestations fournies par les différents arts (production, acquisition, soin, usage), il convient de préciser le type de savoir-faire que, plus généralement, la possession d’un art confère. De manière générique, l’art rend capable d’accomplir certains gestes. Un médecin ou un cordonnier savent faire des gestes dont on admirera la précision en les comparant à ceux des ignorants. L’art en ce sens est ce qui nous permet de découvrir que les actions ont une
platon160p_V2.indd 25 13/10/10 10:35:21
26
véritable réalité. Dans un passage du Cratyle, on affirme, contre le relativisme de Protagoras31, qu’il y a une rectitude de l’action : réussir l’action suppose que l’on ne l’accomplisse pas « comme on le veut », mais comme elle doit être accomplie. C’est sur le fondement de cette rectitude que Socrate peut affirmer que les actions aussi, tout comme les choses, sont ainsi qu’elles sont par nature, disposant d’une réalité qui ne dépend pas du point de vue que l’on a sur elles : les actions sont bien « une espèce donnée d’êtres »32. La « nature » qu’ont les actions consiste dans la façon dont elles doivent être faites : leur « essence », leur appartenance à l’espèce des êtres, tient au fait que « les actions sont faites conformément à leur propre nature et non d’après notre opinion ». L’action ne se laisse pas faire comme on veut : il faut respecter sa nature, couper les choses selon la nature du couper et de l’être coupé, avec l’instrument naturellement adapté à cet effet33. Savoir agir avec art, c’est d’ailleurs aussi savoir se servir de l’outil. L’opinion droite sur la façon d’accomplir l’action comprend en même temps le savoir relatif à l’usage de l’outil, au moyen « naturellement » déterminé pour accomplir l’action. Le passage du Cratyle énumère un certain nombre de ces « moyens naturellement adaptés » pour l’action : « nous disions que ce qu’il s’agit de couper, il faut le couper avec quelque chose » ; « que lorsqu’il faut passer la trame, il faut le faire avec ce avec quoi passer la trame » ; « que lorsqu’il faut percer, il faut le faire avec ce avec quoi percer ». Pour percer, on utilise une percette, pour passer la trame une navette, pour désigner par un mot, un mot. L’instrument se définit par l’action qu’il permet de réaliser : « quel type d’instrument est la navette ? N’est-ce pas celui avec lequel nous passons la trame ? » (387c-388a). L’usage de l’outil s’inscrit donc au sein de la capacité d’action : la « puissance » qui lui est conférée est une capacité à servir à sa fonction et l’usage en est correct si la fonction est accomplie. La réalité intrinsèque des actions exige ainsi que nous ayons du savoir-faire pour les accomplir comme elles imposent qu’on les accomplisse.
Autre capacité générique de tous les possesseurs de savoir : savoir transmettre ce qu’ils savent. Le possesseur d’un art ne se voit pas seulement attribuer une capacité définie en termes d’action. On lui reconnaît immédiatement un autre type de puissance, celle qui consiste à pouvoir transmettre son art. C’est ce que Socrate met en évidence dans un passage du Protagoras (311b4-312a4) pour le rappeler à celui qui, comme Hippocrate, oublie que suivre un enseignement c’est entrer soi-même dans un devenir, qui mène à prendre le nom de son instructeur (devenir médecin, par exemple). Au début du Gorgias, on déduit du fait d’exercer un métier et d’en porter le nom la capacité à en former d’autres qui sauront l’exercer. Gorgias affirmant connaître la rhétorique, il faut donc l’appeler un orateur (449a5-6). Socrate en déduit immédiatement un type de puissance que cela confèrerait à Gorgias : « nous dirons que tu es aussi capable d’en former d’autres »
31 Il s’agit du relativisme qui s’exprime dans la doctrine de l’homme mesure, voir ci-dessous, par-tie II, chapitre II, §3.32 Cratyle, 386e6-8.33 Ibid. 387a1-8.
platon160p_V2.indd 26 13/10/10 10:35:21
27
(449b1). Une autre formule reprend en résumé : « Tu dis donc que tu es savant (epistêmôn) dans l’art de la rhétorique et que tu peux aussi former un autre orateur » (449 c9-d1). Cette prétention sera néanmoins invalidée lorsque la rhétorique se verra refuser la qualité d’art, de discipline technique.
Nous voici maintenant parvenus au seuil de la compréhension du concept fondamental de la philosophie platonicienne de la technique : celui de fonction (ergon), dont est dérivé le concept d’excellence (aretê). L’ayant saisi, nous pourrons affiner notre concept d’une puissance spécifique à chaque art. Dans un passage de la République, Socrate définit la fonction d’une chose comme « ce qu’elle seule peut accomplir, ou bien ce qu’elle accomplit mieux que toutes les autres » (I 353 a 10-11). On admet ainsi une fonction du cheval, quelque chose que l’on ne peut faire qu’avec lui, ou mieux avec lui qu’avec toute autre chose (352d9-e3). De même pour les yeux (voir), les oreilles (écouter). Après les organes, on passe ainsi en revue les outils (couteau, tranchoir, serpette, etc.) qui eux aussi ont une fonction et sont « fabriqués à cet effet ». La nuance inscrite dans la définition est claire : la fonction n’est pas seulement ce que la chose est seule à pouvoir accomplir, mais ce qu’elle fait mieux que les autres. On peut accomplir une action avec le mauvais outil, celui qui n’est pas exactement destiné à cet effet, mais moins bien. La serpette est le meilleur instrument pour tailler la vigne même si on peut le faire plus mal avec d’autres outils – on dira donc en ce sens-là aussi que tailler la vigne est la fonction de la serpette (352e2 – 353b1).
Ce premier résultat établi, Socrate introduit l’excellence sur le fondement de la fonction. Qu’est-ce que l’excellence ou la vertu ? Le terme grec aretê que l’on traduit ainsi a un emploi beaucoup plus large que ce à quoi nous réservons en français celui de « vertu » : on peut ainsi parler d’excellence aussi bien des choses que des animaux ou des êtres humains. Cette extension plus large résulte d’une différence de sens : le terme désigne le fait pour quelque chose ou quelqu’un d’exceller, d’être supérieur(e) aux autres. Homère peut ainsi dire de Polydore, le plus jeune des fils de Priam, que, poursuivi par Achille sur le champ de bataille, il eut la folie de vouloir « faire montre de sa supériorité (aretê ) à la course » (Iliade, 22, 411). Pour la terre, par exemple, c’est la plus grande fertilité que l’on peut désigner comme une excellence : ainsi Hérodote peut-il affirmer que la terre en Lybie n’a pas la qualité (aretê ) de celle d’Asie ou d’Europe (Histoires, IV 198.1-2). Pour les dieux et les hommes, elle désigne souvent par extension le courage, la noblesse, le mérite, ce dont tout particulièrement on « fait montre », en particulier sur le champ de bataille. Hector déclare ainsi que le lendemain, Diomède devra « faire montre de son courage (aretê) » (Iliade Il 8 535). Platon, comme souvent avec les termes qu’il prend dans la langue grecque pour en faire un usage plus technique, élabore un fondement conceptuel commun à la plus grande diversité possible de ses usages, en l’occurrence
platon160p_V2.indd 27 13/10/10 10:35:21
28
en construisant son concept d’excellence en liaison avec celui de fonction34. On dira ainsi qu’il y a « aussi une excellence pour chaque chose à laquelle une fonction donnée a été assignée » (République, I, 353 b 2-3) et qui consiste dans l’état qui doit être celui d’une chose pour bien accomplir sa fonction et son contraire est le défaut ou le vice qui fait qu’une chose accomplit mal sa fonction. Chaque chose ayant une fonction possède ainsi « son excellence propre » sans laquelle elle ne saurait accomplir sa fonction comme il se doit. L’excellence est donc la propriété des yeux qui permettent de bien voir, des oreilles qui permettent de bien entendre. La serpette émoussée aura perdu cette excellence. Chaque chose a une excellence qui lui est propre, qu’il faudra à chaque fois définir (353 b 2 – c 11).
Un art, puisqu’il rend capable d’accomplir une fonction spécifique, crée donc les conditions de l’excellence dans un certain nombre de fonctions, relevant, comme nous l’avons vu, de la production, de l’acquisition, du soin et de l’usage. Nous pouvons désormais revenir, pour le préciser, sur le concept de puissance (dunamis). Au livre V de la République, Socrate définit plus précisément la puissance comme ce qui rend capable d’exercer une action, et tout particulièrement d’exercer une fonction. Comme le montre l’exemple pris par Socrate pour expliciter cette définition, la puissance est précisément ce qui exerce une telle action spécifique, une fonction. « Nous disons que les puissances sont un certain type de réalités (genos ti tôn ontôn) grâce auxquelles nous avons la capacité de faire les choses dont nous sommes capables, qu’il s’agisse de nous-mêmes et de tout ce qui encore est capable d’accomplir quelque chose : par exemple je dis que la vue et l’ouïe font partie des puissances, si tu saisis l’espèce de chose dont je veux parler » (République 477c1-4). Or quel genre d’être les puissances sont-elles ? Socrate nous laisse entrevoir que leur statut ontologique n’est pas si facile à saisir. Les puissances, en effet, « n’ont ni couleur, ni figure (oute tina khrona… oute skhêma) ni aucune des nombreuses propriétés semblables qui me permettent, lorsque je les considère, de décider pour moi-même ce que telle chose est et ce qu’est telle autre » (477c6-9). Les puissances ne sont pas de ces propriétés qui se manifestent à nos yeux de telle sorte que nous reconnaissions à quelle chose nous avons affaire, comme lorsque nous reconnaissons un doigt ou une colline. Elles appartiennent à l’invisible : elle n’ont ni figure ni couleur. Et pourtant elles existent. Elles existent tant et si bien qu’elles nous rendent capables de faire advenir ces êtres que sont nos actes.
Comment donc pouvons-nous saisir de telles choses ? Il n’y a, à propos d’une puissance, qu’une seule question à se poser : « quel est son objet et ce qu’elle accomplit : c’est par là que j’ai désigné chacune d’elles comme une puissance, et j’appelle identique celle qui est attachée au même objet et qui accomplit la même chose et autre celle qui l’est à un objet différent et qui accomplit quelque chose de différent » (477c9-d5). La puissance, cette chose qui 34 Aristote saura prolonger cette façon platonicienne de faire usage de l’extension du vocabulaire de la langue courante, ainsi avec sa reprise de la définition fonctionnelle de la vertu, voir Éthique à Nicomaque, I, 6 1097 b 24 – 1098 a 20.
platon160p_V2.indd 28 13/10/10 10:35:21
29
spécifie la fonction et l’objet de celle-ci, ne se signale qu’à ses effets. L’origine de chaque art, par lequel toute chose peut être connue, saisie, transformée, se retire de toute visibilité, au-delà de toute figure, de toute couleur. Comme nous allons le voir, ce n’est pas la seule chose qui, dans l’art, recule en-deçà du visible : c’est non seulement le cas de son origine – dont l’artisan n’a pas nécessairement conscience – mais plus encore de son objet même.
§ 4. Que sait donc l’artisan (II) ? La forme et l’ordre : l’art et l’invisible
Deux passages, l’un dans le Cratyle, l’autre dans la République, explicitent le type de savoir qu’est celui de l’artisan maîtrisant un art de production. Une observation reviendra souvent, conforme au triangle paradigmatique que nous avons décrit : celui qui sait ce qu’il fait « dirige son regard » sur quelque chose qui guide son action. Ainsi, à la question du Cratyle : « vers où regarde-t-il (blepôn), le menuisier, quand il fait la navette ? » (389a6-7), on répond d’abord : « vers une chose telle qu’elle soit naturellement faite pour passer la trame » (a7-8), c’est-à-dire vers quelque chose dont c’est la fonction. Le menuisier, lorsqu’il construit les navettes dont a besoin le tisserand, garderait les yeux fixés sur une navette ? Une navette qu’il a déjà fabriquée ? Non : « si la navette se brise pendant la fabrication, en en faisant une autre, est-ce qu’il regardera (blepôn) vers celle qui est brisée ou vers cette forme même (pros ekeino to eidos) vers laquelle il regardait quand il fabriquait celle qu’il a brisée ? » (389b1-3). Une « forme » qu’il « garde en vue » : nous reconnaissons bien le sommet haut du triangle paradigmatique ; ce n’est pas vers le sommet de gauche, celui de la chose fabriquée qui ressemble au modèle, que regarde notre producteur. Mais de quoi peut-il bien s’agir concrètement ? L’équivalent d’un patron, comme on en voit chez les tailleurs ou les couturières ? Une sorte de schéma qu’il aurait en tête ? Un autre menuisier est évoqué dans la République, dans un passage où l’on précise ce qu’est cette forme que regarde l’artisan. L’artisan du lit ou de la table, l’« artisan de chacun de ces meubles, en regardant vers la forme (pros tên idean blepôn) produit ainsi, l’un des lits, l’autre des tables, les lits et tables dont nous faisons usage » (X 596b6-9). Il en va de même pour tous les autres objets fabriqués, ajoute Socrate. À chaque fois une forme (idea ou eidos) s’impose comme objet du regard porté par l’artisan. De quoi peut-il bien s’agir ? Le contexte de ce qui précède permet d’expliciter ce point. Socrate vient de proposer à Glaucon de reprendre l’examen des arts mimétiques « en recourant à la méthode qui nous est habituelle » : « nous avons en effet l’habitude de poser à chaque fois (hekaston) en quelque façon une unique forme (eidos… ti hen) pour chaque multiplicité de choses (peri hekasta ta polla) auxquelles nous donnons un nom identique » (596a5-7). Or l’exemple qui suit est très clair, puisqu’il s’agit bien des tables et des lits que nous venons d’évoquer : si nous acceptons qu’il y ait un ensemble de choses multiples comme des lits et une multiplicité de tables, nous poserons alors deux formes (ideai) pour chacun de ces ensembles, une du lit et une de la table (596b3-4). La forme permet d’identifier un ensemble de choses dont elle constitue la propriété commune.
platon160p_V2.indd 29 13/10/10 10:35:21
30
Nous pouvons désormais approfondir notre compréhension du triangle paradigmatique. Il faut comprendre que ce que le menuisier prend en vue, lorsqu’il produit une table, un lit, ou une navette, ce n’est pas un de ces objets déjà produits, mais plutôt l’unité, la chose commune à tous les lits, à toutes les tables, ou à toutes les navettes, c’est-à-dire ce qui leur permet, à travers leur diversité de formes ou de matériaux, de tous parvenir à être ce qu’ils sont et de remplir l’usage qui en découle : que l’on puisse dormir dessus, manger dessus ou croiser avec la trame et la chaîne. L’unité, dans le cas de la fabrication d’artefacts, est celle de la fonction : il y a unité d’une forme d’objet technique partout où il y a une fonction spécifique – permettre de dormir, de manger, de se vêtir, de voyager, de se battre, etc., cette unité étant susceptible de se diversifier selon la variété des matériaux et des circonstances dans lesquels la fonction première trouve à s’exercer. Le texte du Cratyle permet d’approfondir la compréhension de ce point. Immédiatement après avoir fait de la forme ce que le menuisier prend en vue pour faire la navette, Socrate entreprend de distinguer toutes les formes possibles de navettes : fait-on la navette pour faire un vêtement léger, un vêtement épais ? En lin ? En laine ? Quelles que soient les navettes que l’on veut produire, « toutes devront posséder la forme de la navette (to tês kerkidos ekhein eidos), et pour celle qui sera naturellement la meilleure pour tel ou tel ouvrage, il faudra adapter cette nature (tautên apodidonai tên phusin) à chaque type de fonction (eis to ergon hekaston) »35. Voilà un schéma plus complexe qu’il n’y paraissait au début. Il y a une forme de la navette, identique pour toutes les navettes – cette unité est appelée forme, ou encore nature. Sur le fondement d’une telle unité, il y a une variété de navettes possibles, en fonction des usages différents qui peuvent en être faits, s’il s’agit de tisser de la laine ou du lin, un vêtement épais ou léger. La nature unique de la navette doit être ainsi adaptée à l’usage à chaque fois attendu et se diversifier en une multiplicité de sous-espèces de navettes, autant d’espèces qu’il y aura d’usages différents selon les matériaux. L’art du menuisier consiste donc à la fois à connaître cette unité, c’est-à-dire cette chose qu’il faut donner à toutes les navettes pour qu’elles soient des navettes, et à savoir comment l’adapter précisément au type d’usage et de matériau à chaque fois impliqué. Et il en va de même pour tous les autres instruments, ajoute Socrate. Il faut d’abord adapter l’instrument au matériau envisagé : « ayant découvert l’instrument naturellement adapté à chaque ouvrage, il faut l’adapter à ce à partir de quoi est fait l’ouvrage, non pas comme on voudrait qu’il soit, mais tel qu’il est naturellement ». Ainsi, s’il s’agit d’une percette : « la percette qui en effet semble par nature adaptée à chaque ouvrage, il faut savoir la transposer dans le fer » ; de même, savoir traduire la navette adaptée à chaque ouvrage dans le bois adéquat. C’est qu’il y a en effet « par nature une navette spécifique pour chaque espèce de tissu et de même pour les autres choses » (389c3-d2). La forme se diversifie donc en fonction des matières où elle se réalise et des usages spécifiques auxquels elle est assignée.
35 Cratyle 389b8-c1.
platon160p_V2.indd 30 13/10/10 10:35:22
31
Tableau 4 : le triangle paradigmatique – cas de la production
Il nous faut approfondir notre compréhension de ce que c’est que réaliser une forme, la traduire dans une matière. Un texte du Gorgias permet de le faire et d’étendre cette réflexion à d’autres arts, car cette connaissance de la forme et la faculté de l’adapter à chaque type d’ouvrage n’est pas propre à la production d’artefact : il s’agit plutôt de production au sens large où ce terme est employé dans le passage du Sophiste que nous avons évoqué, comprenant aussi bien la production de meubles, d’imitations et le soin des corps. Platon entreprend de nous montrer ce que le savoir de ces différents spécialistes a de commun. On commence par ceux qui produisent de véritables artefacts. « Prends par exemple, si tu veux, les peintres, les constructeurs de maisons, de navires et tous les autres hommes de l’art, prends celui que tu voudras parmi ceux-là, et vois comment chacun dispose chacune des choses qu’il dispose en vue d’un ordre donné (eis taxin tina) et contraint chaque chose à convenir (prepon einai) avec les autres et à s’harmoniser (harmottein), jusqu’à ce que le tout constitue (to hapan sustêsêtai) une chose ordonnée et bien disposée (tetagmenon te kai kekosmênon pragma) » (503e4-504a1). Produire, c’est ainsi d’abord mettre en ordre un matériau : le peintre, le constructeur de la maison ou du navire rassemblent des matériaux divers et leur donnent une configuration ordonnée et harmonieuse. Et, pour Socrate, cette manière de décrire l’activité de l’art est valide aussi pour des formes d’activité qui ne produisent pas de tels artefacts. Le maître de gymnastique et le médecin, à leur façon, « mettent ainsi en quelque façon le corps en ordre (kosmousi) et en accordent les éléments (suntattousin) » (504 a 3-4) : en effet, le médecin, en rétablissant la santé, réintroduit une harmonie entre les éléments
platon160p_V2.indd 31 13/10/10 10:35:22
32
du corps, et le maître de gymnastique travaille à la faire perdurer et à la fortifier. Les arts que l’on pourrait dire de fabrication (les exemples pris sont la fabrication de meubles ou de navires), aussi bien que ceux qui prennent soin de l’objet qu’ils ne produisent pas en lui-même (ainsi le médecin et le maître de gymnastique) peuvent être caractérisés selon ce trait commun : ils donnent à leur objet un ordre, en forçant chaque élément à constituer un tout organisé, harmonieux. Or, Socrate résume tout cela avec une formule générale en affirmant que l’homme d’art, comme tous les spécialistes « qui gardent en vue (blepontes) la tâche (ergon) qui est à chaque fois la leur, ne choisit pas au hasard les choses qu’il emploie pour accomplir sa tâche, mais au contraire de telle sorte que ce qu’il réalise dispose en soi d’une forme déterminée (eidos ti) » (503e1-4). Traduire ainsi une forme, c’est produire un objet capable de réaliser une fonction déterminée. Or pour ce faire, il faut donner au matériau un certain ordre, créer une harmonie spécifique entre ses éléments, qu’il s’agisse des morceaux de bois qui constitueront un meuble ou des humeurs d’un corps malade auquel il s’agit de redonner un équilibre. On comprend aussi maintenant qu’une forme se diversifie selon les matériaux où elle se traduit, car sa réalisation suppose à chaque fois une mise en ordre des éléments : toutes les matières ont des manières différentes de se laisser équilibrer et mettre en ordre. On ne met pas en ordre de la même façon un corps jeune ou un corps vieux, un bois tendre et un bois dur. Il y a bien là un double savoir du producteur : il connaît l’unité de la forme et il connaît la diversité des matières qui sont susceptibles de la diversifer. Nous pouvons compléter notre description du triangle paradigmatique, dont un des côtés s’approfondit :
platon160p_V2.indd 32 13/10/10 10:35:22
33
Tableau 5 : le losange paradigmatique – cas de la production, complet.
L’artisan ne produit la chose qui porte le nom de la forme (une navette) que par une opération sous-jacente de mise en forme du bois : dès que cette mise en forme est accomplie, dès que le morceau de bois manifeste certaines caractéristiques (une forme géométrique, une texture, une taille, etc.) la navette particulière existe. Au total, nous pressentons que c’est ce type de savoir, dans sa diversité, qui permet au producteur d’être celui qui sait définir, comme l’indique Socrate dans le Lachès : connaître à la fois l’unité qui fait que tous les lits sont lits et aussi la façon dont cette unité peut être produite à travers la diversité des matériaux où les lits se réalisent, n’est-ce pas savoir toujours reconnaître l’exemplaire d’une forme à travers la multiplicité indéfinie des circonstances où elle est susceptible de se traduire ? Or, la véritable définition est précisément, comme nous allons le voir, celle qui résiste à la variation indéfinie des circonstances où la chose à définir peut se produire. On mesure l’intérêt de transposer le losange paradigmatique productif vers le domaine de la vertu. Nous retrouvons bien la double compétence que Socrate appelle de ses vœux dans l’Euthyphron : connaître le modèle que doit réaliser toute chose devant correspondre à la définition du courage, reconnaître tous les signes qui disent la présence
platon160p_V2.indd 33 13/10/10 10:35:23
34
de cette forme dans des circonstances particulières, de manière toujours différente : savoir reconnaître le courage partout où il se présente, à la guerre comme en amour, face à la mort comme face au plaisir, de la même manière que l’on reconnaît la diversité des bois où tel ou tel outil peut être réalisé selon les usages que l’on veut en faire. Le losange paradigmatique impose à celui qui sait de porter le regard simultanément dans ces deux directions et de savoir pressentir, sous la diversité des matières, la diversité des traductions de la forme. Suivre Socrate dans la tâche de définir les formes de l’excellence morale, c’est avancer à la recherche de la capacité de produire la vertu comme un médecin produit la vision dans l’œil. Et nous savons aussi que cela suppose une double capacité à saisir, pour les actes courageux par exemple, à la fois l’unité qui les rend tous semblables, au même titre que tous les lits partagent quelque chose de semblable, et la diversité des situations et des actes où ce courage se traduit et les signes qui le manifestent. Y a-t-il ainsi une forme invisible pour chaque vertu aussi invisible que la forme de la navette que le menuisier a en tête et qui n’est pas une navette particulière qu’il aurait déjà produite ? Entrons, sur les pas de l’homme de l’art, sur le terrain de l’existence individuelle et collective des hommes.
Chapitre II
Les vertus sur l’établi
§ 1. La plus belle femme du monde et le mètre-étalon
Revenons, avec le modèle artisanal en tête, aux épineuses questions que nous avions abordées pour commencer et faisons entrer les fameuses vertus dans l’atelier pour leur faire subir le test de la définition. Qu’est-ce qui, parmi toutes les choses qui se rencontrent, se font et se contemplent, est beau et qu’est-ce qui est laid ? Hippias, confronté à cette question, propose une solution : pour définir la beauté et donc la reconnaître partout où elle se trouve, pourquoi ne pas prendre pour modèle une chose particulièrement belle, indiscutablement belle ? Ainsi armé de cet étalon, il sera possible de discerner les choses belles et les choses laides, en repérant leurs ressemblances avec le modèle. Il faut donc, selon Hippias, entendre la question « ce beau, qu’est-ce que c’est (ti esti touto to kalon) ? » comme une question portant sur ce « ce qui est beau (ti esti kalon) » (Hippias Majeur 287d3-5) – en entendant par là ce qui est indiscutablement beau. Hippias propose donc l’exemple d’une chose belle aux yeux de tous : une belle jeune femme (le terme utilisé par Hippias, parthenos, désigne de manière générale la jeune femme qui n’est pas mariée). Hippias, qui connaît Homère sur le bout des doigts, comme en témoigne l’autre dialogue que Platon a consacré à ce
platon160p_V2.indd 34 13/10/10 10:35:23
35
personnage (L’Hippias Mineur), pourrait avoir en tête l’éclat d’Hermione, fille d’Hélène et de Ménélas, qui est si belle que l’on peut comparer sa beauté à celle de la déesse : « l’enfant charmante, Hermione, qui avait l’apparence d’Aphrodite aux joyaux d’or » (Odyssée 4,13-14). Comment pourrait-on dire que ce n’est pas beau, une telle jeune femme, comment le contester sans être ridicule, se demande Hippias (288b1-3) ? Il semble bien qu’avec un tel exemple en tête, on puisse reconnaître la beauté partout où on la rencontre, en reconnaître les signes, les attributs, les degrés. Cette solution ne pourrait-elle pas être généralisée à toutes les autres propriétés, comme la grandeur, le courage, la piété ? Pourquoi en effet ne pas trouver de même un exemple qui incarne telle ou telle propriété de manière éminente ? Définir le courage par une conduite éminemment courageuse dont on ait pu être le témoin et qui pourrait servir d’étalon à toute situation de courage ? Un modèle pris parmi les choses qui existent et que nous pouvons voir ou toucher semble avoir l’immense avantage de permettre une reconnaissance facile – le modèle existe, on peut s’y référer, et comparer – comme les mètre-étalons qui furent installés dans les rues de Paris en 1796 et 1797. Les personnages platoniciens n’ont pas manqué de proposer de telles définitions. Ainsi, selon Ménon, être un homme vertueux consiste à « être capable de s’occuper des affaires de la cité, et, ce faisant, faire le bien de ses amis et de faire du tort à ses ennemis, en se préservant soi-même de ne rien subir de tel » (Ménon 71e3-5). Il y a là plus qu’une simple description : c’est aussi l’énoncé d’un modèle de conduite, car tous ne parviennent probablement pas à bien s’occuper des affaires de la cité, à faire profiter leurs amis et à nuire à leurs ennemis, sans jamais subir de représailles. Voilà donc un modèle : chacun pourra se comparer soi-même à cette définition afin de reconnaître s’il est vertueux en mesurant la présence en soi-même de ces diverses qualités, demander à ses amis ce qu’ils en pensent, etc. De même pour le courage : dans le Lachès, la première définition proposée pour le courage consiste dans le fait de recevoir l’ennemi sans quitter son rang dans la bataille et sans fuir (190e4-6), et chacun pourra se demander s’il est de cette trempe ou s’il ne l’est pas. Ces tentatives, si elles poursuivent bien la finalité paradigmatique de saisir un modèle pour retrouver, dans la multiplicité des circonstances, les qualités recherchées, posent plusieurs types de problèmes. N’y a-t-il pas un problème avec le triangle paradigmatique ? Ne place-t-on pas au sommet du triangle des choses prises parmi celles qui appartiennent à son sommet inférieur gauche – comme si le menuisier prenait modèle sur une navette qu’il a déjà fabriquée ? Le fait qu’il s’agisse de la plus belle des navettes qu’il ait jamais réalisée suffit-il à qualifier ce qui reste une navette en bois pour remplir le rôle du modèle, au sommet du triangle ? Pour comprendre exactement pourquoi ceci reste un problème, il nous faut examiner plus précisément les types de cas proposés par ces définitions. Il y a une différence en effet entre la définition proposée par Hippias et celle mise en avant par Ménon et Lachès. Le premier a isolé une chose ou un type de chose qui lui semble tout
platon160p_V2.indd 35 13/10/10 10:35:23
36
particulièrement bien manifester la propriété recherchée : la belle jeune femme comme exemplaire de la beauté. Hippias n’a pas eu besoin de décrire la belle jeune femme : il nous laisse imaginer. Les seconds n’ont rien fait de tel : ils ont isolé et explicité quelques caractéristiques descriptives que devraient posséder les personnes, les actes ou les situations qui correspondront à la propriété recherchée. Ce sont là deux stratégies différentes pour établir un modèle : dans le premier cas, Hippias n’a pas décrit les propriétés que devrait avoir une belle jeune femme pour être considérée telle ; dans le second, Ménon et Lachès n’ont pas nommé un groupe de choses, qui, parmi la population susceptible d’être courageuse ou vertueuse, soit assuré de l’être plus que tous les autres. Pour la clarté de l’exposé, nous nommons le premier type d’étalon un « étalon-porteur » (on prend comme étalon une chose qui porte éminemment une qualité) et le second un « étalon-qualité » (on prend comme étalon une caractéristique censée rendre la qualité particulièrement présente en une chose). Si l’on reprend le losange paradigmatique, on peut reconnaître avec ces deux étalons le sommet gauche et le sommet inférieur de la figure : d’un côté, les propriétés qui servent directement d’indice de la présence de la forme (la forme d’un instrument qui le rend propre à tramer, par exemple) ; de l’autre, les choses qui sont susceptibles de les porter, ces supports qui, mis en forme de telle ou telle manière, ont telle ou telle propriété (le morceau de bois dont on fera une navette, par exemple). C’est à ces deux niveaux, typiques de la production artisanale, que des tentatives de fixation d’étalons peuvent avoir lieu.
§ 2. La lenteur du sage : examen de l’étalon-qualité
Commençons donc par considérer les définitions qui tentent de saisir immédiatement un trait caractéristique qui serait susceptible d’être l’indice, c’est-à-dire le signe de la présence d’une propriété, et par suite de faire de la chose où il est présent un exemplaire éclatant de cette propriété. Ajoutons quelques exemples de cette stratégie à ceux que nous avons déjà mentionnés. Euthyphron propose une première définition : le pieux, c’est de faire ce que je fais, à savoir poursuivre mon père pour meurtre. Charmide a lui aussi immédiatement proposé un trait caractéristique auquel on puisse reconnaître la sagesse : la sagesse, c’est « de tout faire avec ordre et bien posément, quand on marche dans la rue, quand on parle avec quelqu’un, bref faire toutes les autres choses de cette manière » (Charmide 159b2) ; au total, la sagesse serait donc « une espèce de calme ». Ménon propose de reconnaître la vertu chez tous ceux chez qui elle se manifeste à la « capacité à commander aux hommes » (Ménon 73c9-d1). Pour ce qui est de la beauté, on peut se souvenir que Socrate, dans le Phédon, nomme quelques caractéristiques qu’on donne habituellement pour expliquer qu’une chose est belle : « une charmante couleur ou figure (ê khrôma… ê skhêma), ou quoi que ce soit encore de tel » (Phédon 100d1-2). Dans tous les cas, la vertu, aretê,
platon160p_V2.indd 36 13/10/10 10:35:23
37
doit être comprise comme une forme d’excellence ou de supériorité : la belle fleur est supérieure aux autres sous cet aspect, de même que l’homme sage ou celui qui sait commander. Toutes ces définitions, nous le savons déjà, ont une dimension pratique immédiate : elles servent à juger des situations, à s’orienter dans l’action. Définir la vertu par la faculté de commander suppose une évaluation qui relève, parmi d’autres, un trait saillant dans la société pour en faire le signe de l’excellence humaine. Faire entrer ces définitions dans l’atelier pour les examiner, c’est supposer que toutes ne se vaudront pas, que certaines peuvent être défectueuses, comme un meuble ou une navette peuvent l’être lorsqu’ils sont mal faits ou abîmés. Toutes les opinions, toutes les évaluations ne se valent pas : telle est la conséquence d’une approche technique des problèmes humains. En quoi certaines tentatives de déterminer des étalons-qualité peuvent-elles être défectueuses ? Certains des traits caractéristiques proposés ne correspondent qu’à certains cas seulement où cette propriété est présente, et il est très facile de montrer à l’interlocuteur qu’il y a au moins une chose à laquelle il attribue cette propriété qui ne manifeste pas du tout le trait caractéristique isolé. Il est ainsi loisible à Socrate de montrer à Lachès qu’il y a bien d’autres façons d’être courageux que de rester en ligne, non seulement à la guerre, par exemple si on est cavalier, mais aussi en mer, ou face à la maladie, à la pauvreté, aux événements qui constituent la vie publique de la cité, ou encore face à ses propres plaisirs (Lachès 191c8-e2). Ce caractère ne constitue donc pas l’essence même de la propriété, à savoir un trait qui accompagnerait chacune de ses manifestations. C’est encore la mésaventure qui arrive à Euthyphron lorsqu’il définit la piété par son propre exemple (le pieux, c’est de faire ce que je fais, à savoir poursuivre mon père pour meurtre) et auquel Socrate fait immédiatement reconnaître, sans aucune difficulté, qu’il y a « plusieurs autres choses dont [il] affirm[e] qu’elles sont pieuses » (Euthyphron 6d6-7). En revanche, Charmide, lui, a bien visé un ensemble plus vaste de choses : il y a dans sa proposition une tentative de trouver dans la manière de faire une multiplicité d’actions, manière décrite par l’adverbe (« posément», « de manière ordonnée »), une marque à laquelle reconnaître une action modérée, sage, dans des circonstances multiples. Or Socrate s’emploie à faire reconnaître à Charmide des cas où cette lenteur, de sage qu’elle est dans certaines circonstances, ne l’est plus du tout : « Est-il plus beau, à l’école, d’écrire les mêmes lettres vite, ou bien posément ? » ; « et pour les lire ? vite ou lentement ? » (Charmide 159 c3-6). Il en va de même quand « on joue de la cithare », quand on lutte, où il faut aussi de la vivacité. « Pour courir, pour sauter, pour tout ce qui est exercice physique, ne sont-ce pas les mouvements vifs et rapides qui sont ceux de la belle façon ? de la vilaine, ceux qui ne se produisent qu’avec peine et posément ? » (159 c8-11). Voilà un usage inverse du contre-exemple par rapport aux types de problèmes précédents : on fait reconnaître au moins un cas pour lequel l’interlocuteur reconnaîtrait
platon160p_V2.indd 37 13/10/10 10:35:23
38
aisément qu’une chose présentant le trait qu’il a désigné comme caractéristique ne manifeste pas la propriété recherchée, mais exactement le contraire. Aujourd’hui, en termes logiques contemporains, nous pourrions dire que ces deux types de définitions ne parviennent pas établir la coextensivité de la définition proposée et de l’objet à définir : l’extension du trait servant à définir la propriété est trop petite dans le premier cas et trop grande dans le second. Nous commençons à découvrir ce que c’est que de traiter de manière « artisanale » les problèmes moraux : il faut commencer par cette mesure toute quantitative des multiplicités mises en œuvre dans les définitions spontanées afin d’en mesurer la défectuosité. Le test est très simple : il suffit à chaque fois de trouver un seul contre-exemple, soit un exemple de la propriété sans le trait choisi pour définir (le contre-exemple est en excès sur la définition : il y a du courage ailleurs qu’au combat), soit un exemple du trait choisi sans la propriété (le contre-exemple est en défaut sur la définition, qui est trop large : il y a au moins une lenteur qui ne soit pas sage). La première question, en cas de réponse positive, permet de distinguer une réponse à l’extension trop restreinte et d’inviter l’interlocuteur à élargir sa définition. La seconde permet de manifester que l’on a visé trop large. Entrons à notre tour dans l’atelier en faisant un exercice :
Exercice 1. Les définitions suivantes acceptent des contre-exemples. S’agit-il de contre-exemples en excès ou en défaut sur la définition proposée ?
a) L’homme, c’est un vivantb) L’amitié, c’est d’être disponiblec) L’intelligence, c’est de savoir ne pas s’obstiner inutilementd) Le courage, c’est de savoir refuser l’ordre donné par un supérieur hiérar-chique lorsqu’il est criminele) Le beau, c’est ce qui est seyant36
En faisant cet exercice, vous avez peut-être posé les deux questions du test du contre-exemple à chaque fois, pour vous assurer que vous aviez bien trouvé de quel type d’exception souffrait chacune de ces définitions. Si vous avez fait cela, vous vous êtes peut-être dit que plusieurs solutions étaient possibles – au nombre de quatre, mais vous n’en avez a priori rencontré que deux types : soit vous trouviez des exemples du trait définitionnel qui ne correspondait pas à l’objet recherché (des vivants qui ne sont pas des hommes mais des mouettes ; des gens disponibles qui ne sont pas forcément des amis mais plutôt des pompiers), soit vous trouviez des exemples de l’objet recherché ailleurs que dans le trait définitionnel proposé (des façons d’être intelligent autrement qu’en sachant ne pas s’obstiner, par exemple en sachant anticiper de nombreuses circonstances ; des façons d’être courageux autrement qu’en sachant refuser un ordre criminel, par exemple en mettant sa vie en danger pour sauver son prochain). De la même manière, personne n’a contesté à Lachès le fait que l’hoplite qui ne quitte pas 36 C’est une des façons d’entendre la définition examinée dans l’Hippias Majeur, en 293e-294e. Voyez ce passage pour obtenir la situation de ce problème.
platon160p_V2.indd 38 13/10/10 10:35:24
39
sa rangée dans la bataille soit courageux (il n’est venu à personne de contre-exemple d’un fantassin qui reçoive la charge ennemie sans fuir et qui ne soit pas courageux), simplement il y a d’autres exemples de courage que celui-là. Inversement, lorsque Lachès, pour sa deuxième tentative (Lachès, 192c), définit le courage comme une fermeté d’âme, personne ne conteste que le courage soit toujours une fermeté, même si l’on trouve de la fermeté sans courage, lorsque l’on tient fermement à sa résolution sans aucun risque, par exemple. Lorsque nous manions ainsi les deux questions du test, nous nous ne sommes plus simplement en train de repérer qu’un groupe de choses ou d’événements (par exemple les actes courageux) englobe des cas qu’un autre groupe n’englobe pas (par exemple ne pas fuir au combat), nous sommes déjà en mesure de spécifier la façon dont ces deux multiplicités se rapportent l’une à l’autre globalement. Dans les deux cas que nous venons d’examiner, les deux ensembles sont dans un autre rapport significatif où les membres de l’un d’eux sont tous membres de l’autre, mais pas inversement : rapport que l’on appelle aujourd’hui une inclusion entre deux multiplicités37. Tous les courageux sont fermes, tous les fantassins qui soutiennent la charge ennemie sont courageux, ce que l’on peut représenter ainsi, sans préjuger des nombres respectifs des différentes populations, à l’aide d’un diagramme d’Euler :
Nous verrons que les personnages platoniciens disent alors qu’une forme est « partie » d’une autre. Cela prouve bien que la définition est défectueuse – quoique dans le deuxième cas, comme nous le verrons, le défaut soit intéressant pour travailler l’échantillon en vue de produire une meilleure définition. Mais tel n’est pas le seul cas défectueux possible. Prenez les exemples suivants :
37 Pour la définition mathématique de l’inclusion entre ensembles, voir Paul R. Halmos, Introduc-tion à la théorie des ensembles, Paris, Gabay, 1997, p. 11 (traduction de Naive Set Theory, D. Van Nostrand, 1965).
platon160p_V2.indd 39 13/10/10 10:35:24
40
Exercice 2. Les définitions suivantes acceptent-elles des contre-exemples ?
a. Le beau, c’est ce qui est en or38
b. Ce qui est beau pour un homme, c’est d’être à la fois riche, en bonne santé, honoré par les Grecs, et de vivre vieux, d’ensevelir dignement ses propres parents, d’être soi-même enterré, dignement et de belle manière, par ses propres enfants39
c. Le bonheur, c’est d’être riched. La justice, c’est de donner à chacun une part égale
L’exercice 2 manifeste la possibilité qu’une même définition puisse accepter les deux formes d’exception. N’y a-t-il pas des choses en or qui sont laides, par exemples des cuillères en or trop lourdes pour tourner la soupe, et des choses belles qui ne sont pas en or, comme une statue de Phidias en ivoire ? On est souvent confronté à de tels cas, ainsi à propos de la définition de la sagesse par Charmide. Socrate, après avoir montré que certaines actions sages ne sont pas calmes, montre, en outre, que certaines actions calmes ne sont pas même sages. Ce dernier cas est aussi celui de la définition de la vertu comme capacité à commander dans le Ménon. Socrate enchaîne là aussi les deux formes d’usage du contre-exemple que nous avons explicitées : d’abord un exemple de vertu qui ne manifeste pas le trait caractéristique du commandement (le cas de l’enfant ou de l’esclave dont la vertu ne se manifeste pas par l’autorité), puis, immédiatement, un exemple de commandement non-vertueux : commander injustement. Là encore, nous sommes en mesure de spécifier la façon dont ces deux multiplicités se rapportent l’une à l’autre globalement. Il y a entre, entre l’ensemble de ceux qui savent commander et l’ensemble de ceux qui sont vertueux, ce que l’on appelle aujourd’hui une « intersection » : il y a des gens vertueux qui savent commander, mais il y a des gens vertueux qui ne commandent personne et des gens qui commandent sans être vertueux40. Nous pouvons le représenter ainsi :
38 C’est la deuxième définition d’Hippias (289e).39 C’est la troisième définition d’Hippias : on peut donc se reporter à ce passage (Hippias Majeur, 291d-293d) pour suivre la stratégie déployée par Socrate. Il est facile de trouver immédiatement des cas de gens qui ne présentent pas l’un des traits choisis et dont pourtant on accordera qu’ils ont fait des choses qui méritent d’être dites belles. Ainsi le héros Achille, qui meurt prématurément sur le champ de bataille à Troie : il ne sera jamais enterré par ses enfants, et sa mère, qui est une déesse, ne saurait mourir, a fortiori mourir avant lui.40 Pour la définition mathématique de l’intersection entre ensembles, voir Paul R. Halmos, op. cit., p. 21.
platon160p_V2.indd 40 13/10/10 10:35:24
41
Ce cas concerne la définition du beau par l’or, celle du bonheur par la richesse, et peut-être aussi celle de la justice par l’égalité arithmétique, car on pourrait trouver des situations où donner la même part à chacun, ainsi à un vivant affamé et à celui qui a déjà mangé, ne sera pas perçu comme juste. Nous avons affaire ici au type de définition le plus défectueux, qui est pourtant très fréquent. Ce défaut est typique de ce que les personnages platoniciens appellent « l’opinion », c’est-à-dire une forme de jugement qui repose sur la valorisation d’une expérience particulière et contingente, érigée en trait général d’une propriété. Lachès et Ménon valorisent l’expérience militaire dans leurs définitions du courage et de la vertu en général. On pourrait valoriser de la même même manière l’expérience de la puissance, de la richesse, ou au contraire celle du désir radical de l’égalité en toutes choses. Il reste un dernier cas, où l’on ne trouve pas de contre-exemple, ni d’un côté, ni de l’autre. On s’en aperçoit en prenant par exemple les cas suivants :
Exercice 3. Soumettre les définitions suivantes au double test du contre-exemple. « Ce qui est pieux, c’est de faire ce que les dieux aiment que l’on fasse »41. L’homme, c’est l’animal capable de rire42.
Le recoupement est parfait : on peut croire que toutes les choses pieuses sont bien celles qu’il plaît aux dieux que l’on fasse, et inversement ; que ce qui est un homme est capable de rire, et inversement que tout ce qui rit est un homme43. Les deux cercles se recouvrent parfaitement. Cela signifie seulement que ces définitions ne manifestent pas le type de défectuosité quantitative précédemment évoqué. Des tests plus fins vont pouvoir être faits. Pour l’heure, un dernier exercice permettra de s’assurer que l’on maîtrise bien l’ensemble des tests de l’étalon-qualité.
41 C’est la définition examinée dans l’Euthyphron à partir de 9d, une fois admis par hypothèse que les dieux sont d’accord sur ce qu’ils aiment (ce qui, dans le polythéisme ancien, ne va bien sûr pas de soi).42 Il s’agit du fameux « propre » de l’homme.43 C’est là une croyance traditionnelle que nous pouvons conserver pour les besoins de l’exercice, même si nous savons aujourd’hui que cette proposition réciproque est fausse. Sur l’humour et le rire chez les autres animaux, voyez D. Lestel, Les origines animales de la culture, Paris, Flamma-rion, 2001, p. 203-206. En toute rigueur, il faudrait remettre cette définition dans les simples cas d’inclusion : l’homme fait partie des animaux qui savent rire.
platon160p_V2.indd 41 13/10/10 10:35:24
42
Exercice 4. Soumettre les définitions suivantes au double test du contre-exemple. S’agit-il, par ordre de défectuosité décroissant : (a) d’une exception double ; (b) simple par défaut du trait définitionnel ; (c) simple par excès du trait définitionnel ; (d) d’une absence d’exception. (I) être populaire, c’est être apprécié de beaucoup de gens ; (2) savoir ne pas prendre plus que sa part, c’est être juste ; (3) un ami, c’est quelqu’un qui ne ment pas ; (4) la tempérance, c’est d’être sérieux ; (5) le courage, c’est de ne pas avoir peur de dire non à ses proches 44.
§ 3. Voir ou ne pas voir l’océan : examen de l’étalon-porteur
L’étalon-porteur nous fait descendre du côté du sommet inférieur du losange paradigmatique. Sous la propriété-étalon dont on voudrait faire l’indice par excellence d’une propriété, il y aurait des porteurs par excellence de cette propriété. Or, de même que nous avons appris qu’il fallait soumettre les propriétés à un calcul quantitatif de leur extension, apprendrons-nous que les porteurs eux aussi doivent être soumis à un tel traitement du multiple ? Lachès ou Euthyphron, avec leurs définitions en forme d’étalon-propriété, comprennent la limitation de leur définition lorsqu’on fait apparaître à leurs yeux de multiples autres choses qu’ils reconnaissent aisément comme faisant partie des choses susceptibles de manifester la propriété qu’ils cherchent à définir. Qu’en est-il pour les interlocuteurs qui ont opté pour la stratégie de l’étalon-porteur, c’est-à-dire celle de nommer plutôt un type de chose susceptible de recevoir cette propriété que de tenter de la définir par un trait caractéristique ? La tentative d’Hippias, avec sa première définition du beau, de proposer un exemple de chose particulièrement belle, la belle jeune femme, se heurte à un premier problème, qui ressemble au problème rencontré par ceux qui définissent une propriété par un trait dont l’extension est trop restreinte. La population des choses susceptibles de recevoir la propriété s’avère en effet avoir été arbitrairement restreinte, car il n’y a pas que les jeunes femmes qui peuvent être belles. Socrate use donc d’un argument analogue pour remédier à cette restriction abusive, en faisant apparaître à l’interlocuteur, à l’aide d’un contre-exemple, qu’il y a d’autres choses auxquelles il attribue la propriété. Une belle jument est aussi quelque chose de beau ; car comment admettre que « ce qui est beau ne soit pas beau » (Hippias Majeur 288c2-3) ? Hippias, qui se souvient des magnifiques juments dont on fait l’élevage dans son pays, à Elis, approuve. Et Socrate lui fait accepter qu’une belle lyre est aussi quelque chose de beau, et aussi une belle marmite – quoiqu’Hippias se révolte d’abord contre la vulgarité
44 Solution : (a) = 5 ; (b) = 2 ; (c) = 3,4 ; (d) = 1. Impossible d’être populaire sans être apprécié de quelques gens ; être juste c’est aussi savoir distribuer ; certains qui ne nous aiment pas nous disent aussi la vérité ; la modération dans les plaisirs et les passions n’épuise pas le sérieux, ainsi celui du cosmonaute qui pose son aéronef ; certains disent non à leurs proches tous les jours sans courage spécifique, ainsi par tempérament chagrin.
platon160p_V2.indd 42 13/10/10 10:35:24
43
de cet exemple. Pourtant, il y a de belles marmites, c’est indéniable : Socrate fait reconnaître ce fait à Hippias en décrivant la belle marmite au moyen de multiples caractéristiques qui sont autant de signes, d’« indices » de beauté : « si la marmite a été fabriquée par un bon potier, qu’elle est bien lisse, bien arrondie et bien cuite, comme sont, parmi les belles marmites, celles qui ont deux anses, et qui peuvent contenir six conges – de si belles marmites» (288d6-9). Socrate fait ainsi reconnaître à Hippias qu’il y a une diversité d’autres choses qui sont susceptibles d’être belles, pas seulement les jeunes filles. On a la situation suivante :
Plus encore, en décrivant à Hippias les traits qui font de la marmite une belle marmite, Socrate vient de jeter un doute sur la capacité d’un type de choses à rendre compte de la façon dont d’autres choses possèdent la même qualité. La belle jeune fille peut-elle nous servir à trier non seulement les jeunes filles mais aussi les juments, les lyres et les marmites ? La belle jeune fille, avec toutes ses caractéristiques, nous sert-elle à quoi que ce soit pour définir la beauté des marmites ? La façon dont on décrira la beauté d’une marmite, ses formes et son toucher, risque d’être fort éloignée de ce qui semblera beau chez une jeune femme ou une jument. En explicitant le type de caractéristiques propres à une partie de la population des choses belles, on retrouve le problème précédent (nommer un trait caractéristique trop restreint) : l’équivalent de la définition de la vertu comme capacité de commander serait ici la définition de la beauté comme fait d’être bien lisse, caractéristique propre à une partie seulement des choses susceptibles d’être belles. Or ce n’est pas nécessairement parce qu’elle est bien lisse ou qu’elle contient six conges que la jeune fille sera belle. L’extension du domaine des porteurs serait-elle en train de mettre en crise la possibilité même de qualités communes à l’ensemble de ceux-ci – c’est-à-dire la possibilité même de trouver des étalons-qualité ? Le discours de Diotime, la prêtresse, dans le Banquet, permet de bien comprendre le problème posé par le fait de savoir ou ne pas savoir, lorsque l’on cherche à définir une propriété, prendre en vue toute l’amplitude des choses susceptibles de recevoir ladite propriété. Il s’agit d’ailleurs, dans ce passage, de la même propriété que celle qui est recherchée par Hippias : la beauté. Or Diotime énumère les différents types d’objets dans lesquelles nous sommes susceptibles de trouver la beauté, dans une ascension qui correspond à une
platon160p_V2.indd 43 13/10/10 10:35:24
44
éducation progressive vers des formes de beauté de plus en plus fortes. Les jeunes êtres humains cherchent d’abord la beauté « en se dirigeant vers les beaux corps ». Rencontrant un beau corps, celui qui a ainsi suivi la beauté fera de beaux discours, avant de s’apercevoir que la beauté d’un corps est « sœur » de celle d’un autre corps (210a5-b1). Si l’on est intéressé par la beauté qu’il y a dans les formes des beaux corps, « ce serait très insensé de ne pas tenir pour une et identique la beauté qu’il y a dans les corps » (b2-3). Alors, étonnamment, on se trouve prêt à voir apparaître un nouveau type de choses qui sont susceptibles de beauté : les âmes. La beauté qui se trouve dans les âmes lui semblera plus digne d’éloge que celle qui est dans les corps, de telle sorte qu’il sera enclin à chérir et prendre soin d’une personne possédant une âme admirable, quand bien même son physique serait ingrat : elle lui inspirera néanmoins de beaux discours (210b6-c3). Or si l’on s’arrête sur la nature des discours qu’une âme admirable inspire, on s’aperçoit, poursuit la prêtresse, qu’il s’agit de discours qui ont pour but de « rendre la jeunesse meilleure » et qui supposent que l’on ait commencé à « discerner la beauté qui est dans les conduites et dans les lois (to en tois epitêdeumasi kai tois nomois kalon) ». Il lui restera alors à voir « la beauté qui est dans les sciences (epistêmôn) » et pouvoir, « regardant (blepôn) la vaste étendue déjà occupée par le beau (pros polu êdê to kalon mêketi) » (c3-d1), enfanter de nombreux beaux discours et finir par discerner une science unique qui ait pour objet le beau lui-même. Selon la fameuse expression, l’initié aux mystères d’Eros, se trouve alors « tourné vers l’immense océan du beau et le contemple (epi to polu pelagos tetrammenos tou kalou kai theôrôn) » (210d3-4). Qu’est-ce alors que cet océan ? Il s’agit de la vaste étendue des choses belles que l’on vient de parcourir, des corps jusqu’aux sciences, en passant par les âmes et les actions. À tous ceux qui ont voulu restreindre l’ensemble des choses dans lesquelles on est susceptible de trouver la beauté, il faut répondre que ces choses-là constituent un véritable océan : non pas un petit lac, mais un océan dans lequel aucune borne n’arrête notre regard. Impossible de saisir l’essence de quoi que ce soit sans avoir d’abord sous les yeux cette immensité. On notera encore cette étrange unité de la théorie et de la pratique, chez Platon : se rendre capable de voir la multiplicité des choses susceptibles de recevoir une propriété signifie aussi s’arracher soi-même à un attachement exclusif à tel ou tel type de choses parmi celles qui reçoivent cette propriété. Ainsi, ayant parcouru les différentes choses belles, celui qui est parvenu à saisir la beauté dans les sciences n’est plus attaché exclusivement à un type de beauté – au service d’un seul maître, exclusivement attaché à un jeune homme, ou une unique activité (210d2-3). Désormais, on le croisera en compagnie de choses hétéroclites, des marmites, des sciences, des jeunes femmes et des commissaires de police45.
45 Sur les collections hétéroclites du platonisme et le type de style qu’elles donnent aux amitiés, voir Gilles Deleuze, citant Tolstoï selon lequel, pour obtenir la joie, il faut attraper « comme dans une toile d’araignée et sans aucune loi, ‘une vieille, un enfant, une femme, un commissaire de police’ », « Les plages d’immanence », in L’Art des confins. Mélanges offerts à Maurice de Gandillac, Paris,
platon160p_V2.indd 44 13/10/10 10:35:25
45
§ 4. L’unité du multiple par éminence : la revanche des étalons ? L’étalon-porteur a donc volé en éclats au profit d’une multiplication effarante des porteurs hétérogènes. L’apparition de cette multiplicité, figurée sous la forme d’un océan, semble même être devenue un préalable à la possibilité de chercher la moindre propriété commune. Il reste pourtant encore des résistances à vaincre pour amener quiconque cherche la définition d’une propriété à se tenir face à l’océan des choses susceptibles de la recevoir. Nous n’en avons ainsi pas fini avec Hippias. Le sophiste d’Elis suggère en fait que la plus éclatante parmi les choses belles est néanmoins susceptible de manifester la propriété d’une manière plus intense que les autres choses, et ainsi de servir de référence à toutes. Il deviendrait alors superflu de les parcourir toutes. En effet, ayant accordé la beauté des marmites, Hippias se reprend : si un tel ustensile peut être une belle chose quand il est issu d’un beau travail, « dans l’ensemble, une telle chose ne mérite pas qu’on la place parmi les belles choses, au même titre que le cheval ou la jeune femme et que toutes les autres belles choses » (Hippias Majeur 288e7-9). Voilà qui est très intéressant, car il semble qu’une telle idée puisse nous prémunir contre la négligence de n’avoir pas fait un décompte exhaustif de tous les types de choses susceptibles d’être belles : si l’on choisissait directement une chose si belle que d’autres choses que l’on dit belles pourraient, par comparaison, n’apparaître qu’à peine belles, voire même pas belles du tout, le tour serait joué. On parviendrait alors à conserver une définition qui a pourtant échoué au test d’extension en s’en tenant à une petite partie de la population concernée. Ainsi l’éclat de la beauté d’Hermione nous donnerait au moins un repère à l’aune duquel mesurer toutes les beautés, même celles dont les caractéristiques empiriques sont très différentes : la grâce d’une jeune femme permettrait de hiérarchiser la rondeur des marmites, le profil racé des juments et la noblesse des actions. Il semble que l’on pourrait défendre de la même manière les définitions d’autres interlocuteurs de Socrate, celles qui avaient été immédiatement récusées pour avoir isolé un trait caractéristique trop restreint. Ces traits n’avaient-ils pas été choisis pour leur caractère exemplaire ? Le fait de poursuivre son père en justice contre l’avis de tous constitue certainement aux yeux d’Euthyphron une manifestation particulièrement éclatante de la piété, tout comme la capacité de l’hoplite de rester en ligne et de ne pas rompre le rang, à l’approche de la charge des fantassins, des chevaux, des chars, et de toutes les choses avec lesquelles on fait la guerre, semble à Lachès une preuve particulièrement éclatante de courage, à l’aune de laquelle mesurer tout courage – même le courage de ceux qui ne sont pas à la guerre, de ceux qui sont sur leur lit de mort, ou se trouvent confrontés au plaisir. De telles définitions donneraient des exemples susceptibles d’inspirer chacun, quelque soit le domaine ou les circonstances où advient pour elle ou pour lui la beauté ou le courage. Nous aurions un retour simultané de l’étalon-qualité et de l’étalon-porteur : PUF, 1985, p. 79-81, réimprimé dans Deux régimes de fous, textes et entretiens 1975-1995, Paris, Minuit, 2003, p. 244-246.
platon160p_V2.indd 45 13/10/10 10:35:25
46
certains porteurs, possédant certaines qualités, deviendraient les porteurs éminents d’une forme, de telle sorte que toutes les autres instances puissent se hiérarchiser en regard. Socrate accorde ce point à Hippias, lui indiquant qu’il vient même de retrouver la parole d’un savant homme, Héraclite. Grâce à Hippias, nous saurons quoi répondre à celui qui nous a fait reconnaître la beauté des marmites, en lui apprenant qu’il ignore la vérité qu’il y a dans ces mots d’Héraclite : « le plus beau des singes est laid en comparaison de l’espèce humaine » (289a3-4), et la vérité qu’il y a dans cet aphorisme du savant Hippias : « la plus belle des marmites est laide, en comparaison de l’espèce des jeunes femmes » (289a4-6) ! Voilà une logique pourtant dangereuse. Si l’on commence ainsi à chercher une chose parmi celles qui reçoivent une propriété donnée, qui possède celle-ci, comme dirait Aristote, « éminemment (kuriôs) »46, il est fort possible qu’aucune de ces choses ne parviennent véritablement à remplir cette fonction. C’est la déconvenue qui attend Hippias : celui-ci apprend à ses dépens que cheminer avec Héraclite risque toujours de nous emmener plus loin qu’on ne l’avait prévu. L’espèce des jeunes femmes, une fois comparée à l’espèce divine, sera-t-elle encore si belle ? Comparée à Aphrodite elle-même, Hermione sera-t-elle encore belle ? Héraclite ne dit-il pas aussi que « le plus savant des hommes paraît un singe auprès d’un dieu ; il en est de même pour le savoir, comme pour la beauté, comme pour toute chose » (289b4-5). Dès lors, aucune de ces choses ne peut être « le beau lui-même (auto to kalon) » : « ce par quoi les autres choses reçoivent leur parure et paraissent belles, lorsque s’adjoint à ces choses la forme (to eidos) » (289d2-5). La forme « s’ajoute » à la chose ? Nous savons déjà, grâce au triangle paradigmatique, qu’il ne faut pas nécessairement penser que la forme elle-même agit sur la chose en venant s’y ajouter : il faut différencier deux niveaux, celui de la forme elle-même, unité du multiple, et celui du type d’ordre qui se réalise en chaque chose particulière lorsqu’on y traduit une forme et arrange celle-ci. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point. Le recherche d’un étalon n’est pas un mal en soi, puisque c’est bien ce que nous cherchons : un modèle susceptible de nous orienter parmi les choses pour reconnaître assurément celles qui sont belles et celles qui ne le sont pas, ou, si elles sont toutes susceptibles d’être belles et laides relativement, pour reconnaître l’aspect sous lequel elles sont belles et l’aspect sous lequel elles ne le sont pas. En outre, nous percevons qu’il y a des choses qui manifestent une propriété avec plus d’éclat, avec éminence. La jeune femme semble être un bon candidat. La condition est néanmoins que le modèle ne soit pas soumis à des évaluations contraires : le modèle que nous cherchons, quant à lui, ne peut être à la fois beau et laid. Or, c’est là une thèse que Platon attribue à ses prédécesseurs, aussi bien Héraclite que Parménide avant de la reprendre à son compte : les choses que nous voyons et que nous touchons sont toujours susceptibles de recevoir des attributions contraires, 46 Sur les formes, cité par Alexandre d’Aphrodise, Commentaire à la Métaphysique d’Aristote, 82.13.
platon160p_V2.indd 46 13/10/10 10:35:25
47
et cela en même temps ! Elles ne peuvent donc pas jouer le rôle d’étalon pour ce type de qualités. Les bouts de bois égaux (deux à deux) peuvent en même temps être inégaux (par rapport à d’autres) (Phédon 74d-e), les hommes ou les doigts que nous voyons grands par rapport à certains se trouver petits par rapport à d’autres (Ibid. 102b-e pour les hommes ; République VII 523c-d pour les doigts). Aucune des choses que nous pouvons voir et toucher, en raison de cette capacité à recevoir les contraires, ne peut jouer le rôle de l’étalon pour aucune propriété. Il faut respecter le triangle paradigmatique : les choses qui peuvent prendre place du côté du produit ne peuvent prendre place du côté du modèle.
§ 5. La tentation de faire des petits morceaux Nous devons faire face à une autre manière de refuser de chercher l’unité de toutes les choses capables de recevoir une même propriété. Certains préféreront renoncer à la définition commune d’une même propriété pour des types de choses trop différents : la beauté des marmites et la beauté des jeunes femmes n’ont peut-être en commun que le nom – dès que l’on tentera de décrire ce en quoi consiste, pour une marmite, le fait d’être belle, nous ne parviendrons jamais à trouver suffisamment de traits communs avec la description de ce en quoi consiste, pour une jeune femme, d’être belle. Ne vaut-il mieux pas renoncer à chercher l’unité de choses si disparates ? Dès lors, on pourrait aussi se donner un étalon à l’intérieur de chacun de ces domaines de porteurs plus homogènes, manifestant des caractéristiques davantage comparables. Ainsi, définir une norme de beauté pour les jeunes filles, une autre pour les juments, une autre encore pour les lyres et pour les marmites. On peut voir dans la description de la marmite par Socrate une forme de définition de la beauté pour les marmites : une liste des qualités que devrait posséder une marmite pour être belle – bien faite, bien polie, bien arrondie. Ménon lui aussi propose une solution de cet ordre lorsque lui est posée la question « qu’est-ce que la vertu ? » : passant en revue les divers types de fonctions sociales selon l’âge et le sexe, il propose une description des tâches et des activités que l’on doit être capable d’accomplir dans chacune de ces situations pour les exercer avec excellence (Ménon 72a1-5). Comme nous l’avons déjà mentionné, pour être un homme vertueux, il faut « être capable de s’occuper des affaires de la cité, et, ce faisant, de faire le bien de ses amis et de faire du tort à ses ennemis, en se préservant soi-même de ne rien subir de tel » (71e3-5). Ménon ne fait pas l’erreur de vouloir universaliser une telle description afin d’y voir un énoncé valable pour toutes les formes de vertu. C’est là simplement une condition nécessaire et suffisante de la vertu pour un homme libre : il faut être en mesure d’accomplir cela. On reconnaîtra l’homme vertueux à ces résultats. La même dimension normative est présente dans la définition de la vertu de la femme : « il faut qu’elle sache bien diriger la maison, veiller sur ce qui s’y
platon160p_V2.indd 47 13/10/10 10:35:25
48
trouve et être docile à l’homme » (71e6-7). Et l’on pourrait préciser, ajoute-t-il, la vertu de l’enfant, en différenciant celle de la fille et du garçon ; la vertu de l’homme plus âgé, de l’esclave, etc. Ménon évite ainsi de nombreux écueils, que d’autres interlocuteurs de Socrate ne parviennent pas à éviter, en s’offrant immédiatement une diversité de groupes susceptibles de posséder la propriété recherchée. Voilà certes un progrès : nous ne risquons pas d’omettre les différents groupes susceptibles de posséder cette propriété en tentant de définir en général la vertu à l’aune d’une caractéristique qui ne se retrouve que dans l’un de ces groupes. On pourrait trouver là matière à invoquer, en soutien de Ménon, une des nombreuses objections aristotéliciennes contre la doctrine des formes intelligibles, celle que le Stagirite oppose à l’idée qu’il puisse y avoir une forme du bien qui unifie toutes les choses bonnes. Il y aurait ainsi une diversité irréductible dans les choses bonnes et l’on ne pourrait donner une définition unique pour toutes : ainsi une définition du bien serait possible en chaque catégorie (Ethique à Nicomaque I, 4). Mais l’objection ne tient pas véritablement, car elle concerne une forme très particulière, celle du bien, à laquelle il faut ainsi reconnaître une extension très grande. Or, Aristote, pour de tels concepts, refuse l’unification de toutes les définitions régionales en une unité supérieure, et n’admet à un tel niveau qu’une unité analogique : la vertu est à la qualité ce que la bonne occasion est au temps – l’unité du bien se trouve irrémédiablement dispersée entre les différents genres (1096a23-29). Néanmoins, dans le cas de la vertu ou d’une vertu particulière, à l’intérieur d’un genre donné, Aristote lui-même refuserait de suivre Ménon. L’unité d’une forme, tant qu’elle ne doit pas enjamber la limite d’un genre, suppose aussi, pour Aristote, l’unification des différents groupes susceptibles de manifester la propriété. Car la multiplication et l’unification des groupes de choses susceptibles de manifester une propriété est tout simplement un phénomène caractéristique de la recherche des essences. Aristote a remarqué ce point : lorsque l’on recherche l’essence (par exemple celle de la fierté), il faut considérer les choses semblables en ce qu’elles ont d’identique (par exemple qu’est-ce que la fierté chez Alcibiade, Achille et Ajax qui ne peuvent tolérer une insulte ?), ensuite faire la même chose pour des choses qui sont dans le même genre mais spécifiquement différentes (Lysandre et Socrate, quant à eux, sont indifférents à la fortune, n’est-ce pas là aussi une forme de fierté ?), afin ensuite d’essayer de trouver une caractéristique commune aux deux groupes (y a-t-il quelque chose de commun à ces deux formes de fierté ?) : si une telle unité existait (mais ce n’est pas le cas aux yeux d’Aristote), on tiendrait alors une définition véritable (Seconds Analytiques, 97b7-13). Partout où l’on veut donc pouvoir se référer à l’unité d’un même terme, par exemple une vertu, il est nécessaire de poser l’unité à l’œuvre dans tous les cas où cette vertu est présente, ou renoncer à employer le même terme sinon en un sens purement analogique. Comme le menuisier doit connaître ce qui fait l’unité des navettes à laine et des navettes à tissu, il faut savoir ce qui unit les hommes qui acceptent le destin et ceux qui ne
platon160p_V2.indd 48 13/10/10 10:35:25
49
tolèrent pas l’insulte. Ce point étant réglé, il faut encore faire face à une autre forme de résistance à la recherche de l’unité, plus radicale encore. Socrate, au livre V de la République, fait le portrait d’un type de gens qui ressemblent par certains traits aux philosophes : comme les amoureux du savoir, ils aiment apprendre et étudier. Leur curiosité a pourtant un objet différent : il ne s’agit pas du savoir sous toutes ses formes, comme dans le cas du philosophe, mais de choses qui s’écoutent et se regardent, à savoir les spectacles ; ils aiment entendre et ils aiment voir (hoi philêkooi kai philotheamones, République V 476b4). Ils parcourent la ville et la campagne lors des grandes Dionysies pour ne manquer aucun chœur. Or de telles gens aiment « les beaux sons, les belles couleurs, les belles attitudes et toutes les créations composées à partir d’éléments de ce genre, mais en ce qui concerne le beau lui-même, il leur est impossible par la pensée d’en voir la nature et de l’aimer » (476b4-8). Voici donc une figure très intéressante pour notre propos : de telles gens s’en tiendraient à la description de ce qui fait à chaque fois la beauté d’une mélodie, d’un ensemble de couleurs, d’une représentation théâtrale particulière, en refusant d’unifier ces expériences pour y trouver la marque d’une même propriété, comme un étrange menuisier qui croirait à la spécificité irréductible de chaque navette. La description à chaque fois possible des qualités de la chose ou de l’événement serait donc la seule cause de l’attribution de la propriété. On trouverait là une figure possible de ce que nous appelons aujourd’hui un critique d’art, de théâtre ou de cinéma – ou plutôt une figure tout à fait particulière du critique, celle qui se refuserait absolument à ne jamais penser qu’il poursuit à travers des œuvres différentes une même idée de la beauté infiniment déclinée (en ce sens, les critiques de notre temps sont bien souvent plus philosophes qu’amateurs de spectacles au sens platonicien, et se lancent lorsqu’ils le souhaitent à la poursuite d’une certaine idée de la beauté à travers la diversité des images47). Or, à s’en tenir à chaque belle chose particulière, à s’en tenir à la seule description de chaque belle chose, il devient même impossible de les évaluer les unes par rapport aux autres. Socrate a, quelques pages auparavant, produit par une analogie un portrait saisissant des amoureux qui épousent la particularité, toutes les particularités. Ainsi, qui aime les garçons sait qu’un garçon dans la fleur de l’âge émeut toujours, et invoquera la beauté des formes les plus diverses : « de l’un parce qu’il a le nez camus vous ferez l’éloge en disant qu’il est « charmant », d’un autre, vous direz que son nez d’aigle est « royal », et un troisième, qui a le nez entre les deux vous le tiendrez pour « très bien proportionné », vous direz que les garçons à la peau sombre sont virils, ceux qui ont la peau claire sont des « enfants des dieux » ; et qui d’autre penses-tu a forgé le nom de « couleur de miel », sinon un amant cherchant une appellation flatteuse pour le teint mat, pourvu qu’il s’agisse d’un garçon dans la fleur de l’âge ? » (République V 474d7-e5). Faiblesse des descriptions : elles peuvent servir à tout, justifier la beauté comme l’absence de beauté. Si l’on est décidé à aimer les garçons dans la fleur de l’âge, alors tous les physiques
47 Voyez par exemple Eric Rohmer, Le goût de la beauté, Paris, 1983, réédition Champs Flammarion.
platon160p_V2.indd 49 13/10/10 10:35:25
50
seront bons, de même que les amants du vin (hoi philoinous, 475a5) auront de la tendresse pour n’importe quel vin, sous n’importe quel prétexte. Tous les porteurs d’un certain type font l’affaire, et tous les traits peuvent leur être indifféremment attribués. Soit donc l’amateur de spectacle devra avouer qu’il aime tous les spectacles sous n’importe quel prétexte, soit il voudra les discriminer en les comparant et sera contraint d’expliciter les propriétés qui s’appliquent à plus d’une seule performance, et qui lui permettent de juger l’une admirable et l’autre mauvaise. Si l’on demande à l’amateur de spectacles fidèle à son goût de la particularité absolue, si, parmi les nombreuses belles choses qu’il aime, il y en a qui pourraient paraître laides, il répondra : « non, mais même les choses belles paraissent nécessairement laides aussi sous quelque aspect » (479b1-2). Tant que l’on s’en tient à une partie de la beauté, même en se concentrant sur le petit groupe des garçons dans la fleur de l’âge, il n’est pas possible de saisir quelque chose qui ne soit pas en même temps laid d’un autre point de vue. C’est au total au même argument de contrariété déjà évoqué que ces descriptions sont vulnérables : la possibilité de l’indifférence à la contrariété se manifeste dès que l’on essaye de faire d’une chose sensible une véritable cause d’attribution de la qualité, à savoir un vrai modèle.
§ 6. L’unité de la forme, cœur de la réalité
Pendant tout ce temps où nous parcourions tant de façons d’essayer de définir les vertus, notre menuisier pouvait bien rire de nous, lui qui sait l’unité qui fait l’identité de tous les lits et de toutes les navettes, par delà la différence la plus extrême de leurs qualités. Il faut se rendre à l’évidence de l’artisan : des vertus aussi, on ne saurait parler, ni espérer accomplir la production, sans la connaissance d’une telle unité, cette même unité qui rend le menuisier capable de faire des lits très divers. Les notions morales doivent manifester la même unité que celles qui sont au fondement du savoir-faire technique : l’unité d’une forme. Il n’y a plus moyen d’y échapper : pour définir une chose, il nous faut à la fois accepter la multiplicité la plus étendue des choses susceptibles de recevoir cette propriété et en même temps chercher l’unité qui tient ensemble cette multiplicité. C’est bien ce à quoi Diotime engage ses auditeurs. Pour revenir à la fin du passage déjà évoqué, il faut ajouter qu’il ne suffit pas, après avoir connu toutes les formes de beauté, de « tourner son regard vers le domaine, déjà vaste, du beau », faisant face à « cet océan immense du beau et le contemplant » et de tenir de multiples discours sur toutes ces choses (Banquet 210d3-4). Cette étape n’a pour but que de permette, un jour, « d’apercevoir une certaine connaissance unique (tina epistêmên mian) » (210d7) : non pas celle de telle ou telle chose belle, susceptible de naître ou de mourir, mais de la beauté même qu’en viennent à revêtir les choses qui deviennent belles et que perdent celles qui cessent de l’être, non pas la connaissance de telle ou telle chose belle pour les uns et susceptible d’être laide pour les autres, mais de la beauté même
platon160p_V2.indd 50 13/10/10 10:35:25
51
qu’ont les choses belles lorsqu’on les reconnaît comme telles. L’unité par delà l’hétérogénéité des porteurs et des qualités. Il faut donc encore aider Ménon, afin qu’il explicite l’unité de la vertu qui se diffuse dans la multiplicité de ses définitions. Ironique, Socrate affirme avoir beaucoup de chance, puisqu’il était en quête d’une unique vertu, et voilà qu’il en découvre un essaim niché en Ménon. Socrate entreprend, à partir d’un exemple, de lui faire comprendre la limite de sa réponse, en filant l’image de l’essaim : si l’on s’interrogeait « sur la réalité (peri ousias) de l’abeille, ce qu’elle se trouve être », et que tu faisais cette réponse, je te demanderais si c’est « du fait qu’elles sont des abeilles » qu’il y en a tant et de toutes sortes, ou bien si « par ce fait elles ne différent en rien, mais plutôt par autre chose, par exemple par la beauté, la taille ou une autre propriété de ce genre » (Ménon 72a6-7). Ménon acquiesce : « elles ne diffèrent en rien l’une de l’autre par le fait d’être des abeilles (72b8-9), c’est là « ce par quoi elle sont toutes identiques ». Ni beauté, ni taille, ni une quelconque autre qualité : les caractéristiques empiriques ne sont que des indices : elles ne sont pas l’unité qui fait la réalité. Qu’est-ce donc que l’être, la réalité de l’abeille en tant qu’abeille ? Ce par quoi elles ne différent en rien. Prenons garde, devant un tel texte, de ne pas lui insuffler une dimension substantialiste qu’il n’a pas : Socrate ne parle pas de la substance de l’abeille, de sa consistance propre d’abeille individuelle, par opposition à toute autre propriété contingente qu’elle pourrait avoir. S’il fait certes le partage ici entre l’invariant (être abeille) et les propriétés qui sont variables d’une abeille à l’autre (grandeur, beauté) et qu’il se trouve que cela recouvre ici la différence entre l’essence aristotélicienne (la substance seconde : l’espèce des abeilles) et les attributs accidentels (être grand ou petit)48, il faut bien voir que Socrate aurait tout aussi bien pu faire cette différence en prenant pour unité la grandeur, comme il le fait souvent. Il aurait alors interrogé sur la réalité de la grandeur, ce qu’elle se trouve être, cette réalité par laquelle toutes les choses grandes sont identiques lorsqu’elles sont grandes, alors qu’elles différent aussi par le fait d’être des abeilles, des hommes, des dieux, des contrées ou des astres. La réalité n’est pas du côté des choses individuelles qu’Aristote appellera des réalités ou des substances : la réalité, en son cœur, bascule du côté de l’unité constitutive de la propriété, laquelle existe aussi bien pour les traits qu’Aristote jugerait essentiels (l’humanité de l’homme) que pour ceux qu’il jugerait accidentels (la grandeur du même homme). Ce qui prouve encore ce point, c’est que cette analogie avec les abeilles a été faite pour être maintenant appliquée à des propriétés qui, d’un point de vue aristotélicien, ne sont pas dans l’essence mais dans la qualité, à savoir les vertus. De même pour les vertus, s’il y en a certes beaucoup et de toutes sortes, « elles possèdent néanmoins toutes une même et unique forme (hen.. ti eidos tauton) par laquelle elles sont des vertus » (72c7-8) – par laquelle elles ont la même et unique réalité. Telle est donc la réalité de la vertu, réalité que nous venons à partager lorsque nous agissons vertueusement dans la 48 Sur la différence entre substance première, substance seconde et accident, voir Catégories II et surtout V.
platon160p_V2.indd 51 13/10/10 10:35:25
52
multitude des circonstances où cela est possible, ce qui se traduira par des qualités à chaque fois différentes. On retrouve dans ce passage le verbe qui servait à décrire le regard du menuisier fixant le modèle de la navette : c’est « en ayant en vue (apoblepsanta) » une telle forme de la vertu que l’on peut répondre à la question de savoir ce qu’elle est en chaque circonstance. Cette chose par laquelle les choses ne diffèrent pas, elle est une « forme donnée (eidos ti) », une chose que l’on peut prendre en vue, comme un modèle, pour reconnaître dans la diversité des actions vertueuses, la vertu unique qu’elles possèdent à travers leurs différences vertigineuses, exactement comme il y a une forme unique du lit ou de la navette que partage tous les lits et toutes les navettes taillés dans les matériaux les plus divers. Toutes les propriétés que les choses possèdent ont cette même unité. Ménon ne comprenant encore pas bien, Socrate prend des exemples de propriétés corporelles : santé, taille, force. Faut-il penser qu’il y a aussi une santé, une taille ou une force de l’homme, de la femme, de l’enfant ? Nous serions bien tentés de répondre que c’est bien évidemment le cas. Et certes, au bout du compte, il pourrait s’avérer qu’il y a empiriquement une taille moyenne des enfants plus petite que celle des hommes. Mais ce n’est pas la question : il s’agit de savoir si nous saisissons une unité en disant « taille » ou « santé » avant même d’être capable de différencier des tailles et des degrés de santé : « en tant que la santé est santé, ne consiste-t-elle pas dans tous les cas en la même forme (eidos), que celle-ci se trouve chez un homme ou chez n’importe qui ? ». Ménon l’accorde, et de même pour la taille et la force : « Si une femme est forte, n’est-ce pas en vertu de la même forme et par la même force qu’elle sera forte ? Et voici ce que je veux dire quand je dis « par la même force » : par rapport au fait d’être la force, que la force se trouve chez un homme, ou chez une femme, cela crée-t-il la moindre différence ? » (72d4-e9). C’est en vertu de la même unité qu’ils possèdent – et il restera à déterminer sous quelle modalité ils la possèdent, quoique nous sachions déjà que c’est sous l’espèce d’une certaine configuration ou d’un certain ordre que les formes sont traduites dans les choses – que chacune de ces choses a la propriété déterminée et se trouve pouvoir agir conformément à celle-ci. C’est en possédant en quelque façon cette unité qu’elles « sont » telles que la propriété les détermine et ont la capacité d’action spécifique qui en découle. On trouve un développement similaire dans le Théétète, tandis que Socrate demande à Théétète de définir ce que c’est que la science (epistêmê) (146c3). Théétète commence par énumérer un certain nombre de sciences, comme la géométrie, l’art du cordonnier et de ceux de tous les autres artisans. Socrate le remercie lui aussi pour sa générosité, mais lui signale qu’il donne une multiplicité là où l’on demandait l’unité, une multitude en lieu et place du simple (146c7-d5). Théétète n’a pourtant rien dit de faux : toutes les techniques, toutes les disciplines mathématiques, tout cela, ce sont bien des sciences. Il essaye de décrire l’ensemble des choses qui reçoivent ce nom. Socrate lui fait pourtant différencier deux choses : « tu dénombrais
platon160p_V2.indd 52 13/10/10 10:35:25
53
(arithmêsai) les sciences » en fonction de leurs objets mais c’est différent de savoir « de la science ce qu’elle est elle-même » (146d6-e11). Dénombrer , ce n’est pourtant pas si facile. Cela suppose que l’on sache reconnaître une science lorsque l’on en voit une. Mais Socrate exige en outre qu’on saisisse l’unité de l’ensemble considéré. Pour cela, il se sert de sa méthode habituelle, une analogie sur la méthode à suivre, tirée d’une comparaison avec le monde des artisans : si on demandait ce qu’est la boue, au lieu d’énumérer la boue qu’il y a chez le potier, celle qu’il y a chez tel ou tel autre artisan, on répondrait que c’est de la terre mélangée à de l’eau, sans se soucier de tous les endroits où elle peut se trouver (147a1-c6). Théétète, qui a fort bien compris cette fois-ci, produit lui-même une analogie : quand il fait des mathématiques avec son maître Théodore, il cherche à montrer que toutes les puissances sont commensurables. Pour cela, comme le nombre des puissances semble infini, il faut « tenter de les assembler sous un terme unique, par lequel on puisse désigner tout ce qu’il y a de puissances » (147d7-e1). Tenir l’infini en un terme unique, tel est le pouvoir de la forme.
Ménon a tout de même avancé de quelques pas en direction d’une unité en précisant qu’il y a une vertu propre à chaque type d’activité, à chaque type d’œuvre propre – ce qu’il faudrait prolonger en ajoutant qu’une telle vertu consiste dans la capacité à accomplir sa fonction. Ménon, lorsqu’il place ainsi dans chacune de ses définitions particulières l’idée que la vertu consiste à se rendre tel que l’on soit capable d’effectuer une certaine activité, se trouve à deux doigts de l’énoncé de la définition de la vertu donnée par Socrate au début de la République49, une très bonne définition en effet, qui restera celle d’Aristote : la vertu est l’état dans lequel une chose accomplit bien la fonction qui est la sienne50. Ménon, parce qu’en réalité il est sur la voie de l’unité de la vertu, a disséminé le même élément dans toutes les circonstances qu’il différencie comme une multiplicité dispersée. Pour le dire en termes mathématiques, il a développé ce qui pourrait être factorisé. C’est néanmoins ce qui prouve encore qu’il n’y a pas de discours possible sans la présupposition de l’unité. Lorsque Socrate critique la première définition du Lachès (le courage de l’hoplite), il parvient à la même injonction de recherche de l’unité réelle : il faut isoler la capacité qui demeure la même dans le plaisir, la souffrance, toutes les situations possibles de courage (Lachès 191e9-b8). L’unité du courage rayonne dans tous les lieux et toutes les occasions de courage : l’unité essentielle est au fondement de la multiplicité des choses courageuses. Cette unité doit être essentielle et non relative : il peut arriver que l’on définisse le bon ensemble de choses, sans en omettre, tout en le désignant par un trait qui, pour être propre, n’est pourtant pas essentiel. Cette nécessité de saisir l’essentiel est tout particulièrement mise en évidence par la réfutation de la tentative d’Euthyphron de définir ce qui est pieux comme ce qui est aimé des dieux.
49 Voir ci-dessus, chapitre I, §3.50 Voir par exemple Ethique à Nicomaque I, 6 1096a7-17.
platon160p_V2.indd 53 13/10/10 10:35:25
54
Nous trouvons ici l’étape ultime de la réfutation des étalons-qualité. Nous avons pu mettre en cause leurs prétentions en mettant à l’épreuve la multiplicité à laquelle ils se distribuent. Mais il pourrait arriver qu’ils résistent à ce test. Si l’on accepte (disons à titre d’hypothèse) que, parmi les actes des hommes, ceux que les dieux aiment, correspondent bien à l’ensemble des actes pieux, on obtiendrait alors un recouvrement parfait des deux ensembles : tous les actes aimés des dieux sont pieux et tous les actes pieux sont aimés des dieux (voir l’exercice 3). Cette co-extension nous donne-t-elle la définition recherchée ? La qualité d’être aimé des dieux n’est-elle pas toujours présente là où est la piété ? C’est vrai. Nous allons comprendre à ce point toute la différence qu’il y avait, dans notre première version du triangle paradigmatique, entre l’indice et le modèle. Le fait d’être aimé n’est que l’indice, et non la réalité, car il restera qu’être aimé est le fruit de l’action d’une autre chose sur la chose que nous cherchons, c’est une affection (pathos), par conséquent une relation, et non la réalité (ousia) même de celle-ci (Euthyphron 11a7-8). Être aimé isole l’ensemble des choses pieuses, certes, mais par un trait qui ne leur est pas essentiel et n’en donne pas le sens même : par un trait qui n’en est que l’indice. Voilà éclairé l’être de l’indice, que l’artisan doit bien sûr aussi connaître : les indices sont toutes les qualités qui sont présentes lorsque la forme est traduite dans la chose. Mais elles ne sont pas la forme, elles n’en sont que la trace. L’unité du multiple tient au contraire le fondement de son unicité de sa priorité ontologique : la forme est l’unité d’une multiplicité parce qu’elle est la réalité que cette multiplicité partage, ce qui fait que chaque élément de cette multiplicité se trouve être, sous cet aspect, une même et unique chose. Il nous faut tirer les conséquences de cette distinction radicale entre la forme et son indice.
§ 7. Nous n’avons jamais vu la beauté ni la force : l’invisibilité de la forme
De la même manière que le menuisier ne regarde pas une navette parmi celles qui existent lorsqu’il fait une navette, et regarde non pas une navette que l’on peut prendre dans ses mains mais la réalité qu’il faut conférer à toute navette que l’on fabriquera jamais pour qu’elle accomplisse sa fonction, de même, l’unité des choses courageuses ou justes ou belles échappe à notre perception. Cela résulte déjà tout simplement de l’extension maximale exigée pour une définition satisfaisante : l’unité de la beauté doit être ce qui rend compte de la beauté de toutes les choses belles, marmites, jeunes femmes, juments, actions, savoirs, lois. Il risque d’être difficile de trouver des caractéristiques sensibles communes que l’on puisse décrire pour toutes ces choses différentes : la rotondité des marmites bien faites, la grâce des jeunes femmes et la noblesse des actes ne sont pas les éléments d’une description homogène. L’amateur de spectacles n’aime-t-il pas tous les spectacles ? Certes, mais il est capable de s’en remettre à chaque fois à n’importe quel éclat de beauté – de ce qu’il décide d’appeler beau
platon160p_V2.indd 54 13/10/10 10:35:26
55
ou charmant dans telle ou telle sensation. Mais seule la possession de la totalité de l’objet de l’amour pourrait lui permettre de faire le tri dans les occurrences. Et cette unification dissout le niveau sensible de la description : comment en effet unifier des descriptions hétérogènes ? Il serait déjà bien difficile d’unifier la partie sensible des objets susceptibles d’être beaux : ni les courbes, ni les couleurs, ni la fermeté des visages ou la prestance des actions que nous voyons ne saurait définir l’unité de la beauté. Mais aurait-on trouvé l’unité de cette multiplicité de la beauté sensible, unifié la surface admirablement polie de la marmite, la fraîcheur d’une jeune femme, les muscles fins et puissants de la belle jument, les couleurs chatoyantes de la fleur, qu’il faudrait encore unifier celle-ci avec la beauté dont les discours sont signes, celle de la vertu, des sciences et des âmes. Or on ne peut décrire ces choses et les corps dans des termes communs : l’idée de la beauté ne saurait être le produit d’une abstraction faite à partir des diverses définitions de la beauté dans les différents types de choses belles. Souvenons-nous des amateurs de spectacles comparés aux amants qui justifient leur amour par tel ou tel détail de l’être aimé. Au contraire, le seul véritable amant est celui qui aime toute la beauté, et non une partie de celle-ci : si l’on veut employer le terme correctement, il faut que celui qu’on désigne comme un amant, ne soit pas celui qui aime tel aspect et pas tel autre, mais celui qui désire le tout (pan stergonta) (République 474c10-11). Et quand, par hypothèse ou par miracle, une qualité commune pourrait être perçue parcourant l’océan des choses belles, justes ou pieuses, nous savons que cela ne suffirait pas à conférer à celle-ci d’autre titre que celui d’annonciatrice de l’unité réelle. Toutes les caractéristiques de toutes les choses belles seront toujours encore des propriétés perceptibles, appartenant à des choses situées, vulnérables à la présence de leur contraire dans la même chose. En revanche, le modèle ne peut pas être soumis au conflit des apparences, présenter la qualité recherchée d’un point de vue et pas d’un autre, s’il doit être le modèle qui nous permet de reconnaître toutes les instances. C’est un objet de l’esprit. Il constitue aussi la réalité la plus claire : seul il nous apprend ce que c’est véritablement d’être bon ou beau ou grand. Il en découle d’autres propriétés pour cet objet : comme la grandeur est l’unité qu’en viennent à partager les choses qui deviennent grandes et cessent un jour de l’être, elle se différencie des choses grandes qu’elle a unifiées, unifie et unifiera par le fait qu’elle ne vient pas à l’être et n’en sort pas – car alors il y aurait un temps où des choses ne pourraient devenir et cesser d’être grandes. Celui qui parvient à voir l’unité voit en effet apparaître un tel objet doté de telles caractéristiques : « ayant contemplé dans leur succession et dans l’ordre les choses belles », il « apercevra quelque chose d’étonnamment beau par nature » (Banquet 210e3-5) : « quelque chose qui, en premier lieu, existe toujours, ne naît ni ne périt, qui ne croît ni ne décroît, quelque chose qui, ensuite, n’est pas beau par un côté et laid par un autre, beau à un moment et laid à un autre, beau sous un certain rapport et laid sous un autre, beau ici et laid ailleurs, beau pour certains et laid pour d’autres » (210e5-211a5).
platon160p_V2.indd 55 13/10/10 10:35:26
56
Le beau lui-même doit donc échapper à la fois à la variation temporelle et à la variation des aspects qui caractérisent en revanche ses instances. Une marmite peut cesser d’être belle, ou être belle pour les uns et non pour les autres : il convient néanmoins que le modèle grâce auquel nous pouvons la reconnaître comme belle lorsqu’elle l’est ne soit pas quant à lui soumis à la même contingence de l’existence et des points de vue. L’unité de la beauté doit être posée au-delà de la multiplicité changeante de son océan : « elle lui apparaîtra elle-même pour elle-même (auto kath’auto), immuablement avec elle-même, unique dans sa forme (monoeides), tandis que toutes les autres belles choses participent d’elle d’une manière telle que ni leur naissance ni leur mort ne lui ajoutent ni lui ôtent rien, et ne l’affectent en rien » (211b1-5). Ainsi s’ouvre la distinction entre ce qui peut être pensé (noêton) et ce qui peut être vu (oraton) (République V 524c13) qui est la distinction fondamentale que la philosophie platonicienne tire de l’observation du savoir en action : celui qui sait connaît une chose invisible par laquelle le visible peut être reconnu51. La conséquence est à la fois limpide et stupéfiante : nous n’avons jamais vu la beauté, ni la bonté, ni la justice, ni la grandeur, ni la force, ni aucun de ces éléments qui constituent à chaque fois une réalité que les choses que nous percevons en viennent momentanément à arborer. Une telle affirmation paraît scandaleuse, tant il nous a semblé voir de choses belles et laides. Pourtant c’est encore ce que dit Diotime, dans le Banquet, à propos de celui qui s’est initié aux choses de l’amour : « le beau (to kalon) ne lui apparaîtra pas non plus sous l’aspect d’un visage (hoion prosôpon), de mains, ni de quoi ce soit d’autre qui relève du corps, ni sous la forme d’un discours, ni d’une science, ni de quelque façon comme quelque chose qui existe en autre chose, que ce soit dans un vivant, dans la terre, dans le ciel ou dans quoi que ce soit d’autre… » (211a5-b1). N’avons-nous pourtant pas vu de beaux visages et de belles mains, entendu de beaux discours qui manifestaient de belles connaissances, trouvé la beauté dans les paysages terrestres et les étendues du ciel ? N’avons-nous pas vu la beauté du ciel d’automne, la justice des répartitions équitables qui apaisent les hommes, la santé des jeunes gens aux joues roses, la vigueur de l’athlète et la grandeur des hautes montagnes ? N’avons-nous pas vu, pour reprendre l’expression de Plotin52, la présence du courage sur la fermeté d’un visage ? Comment le médecin travaillera-t-il, si l’on ne peut plus lire la santé ou la maladie sur le teint des visages ? L’exemple de l’art est bienvenu, il faut nous y reporter dès que nous sentons le sol se dérober sous nos pieds. Le menuisier nous rappellera toujours qu’il faut distinguer très nettement deux choses : la diversité des matières dans lesquelles une table peut-être faite, matières que l’on peut voir et toucher, et l’unité de la structure fonctionnelle que le menuisier a en vue et que l’on ne saurait ni voir ni toucher. Le triangle paradigmatique voit s’éloigner deux de ses sommets dans l’invisible : après la puissance de voir et de penser, choses déclarées invisibles par le Socrate 51 Pour une autre présentation complète de cette distinction voir aussi Phédon 78b-79e.52 Enneades 1, 6, 5,14 andrian blosuron ekhousan prosôpon.
platon160p_V2.indd 56 13/10/10 10:35:26
57
de la République, comme nous l’avons vu, c’est l’unité de la multiplicité qui échappe désormais au visible. Ce que nous n’avons jamais vu, c’est l’unité. La justice, la bonté, nous ne les avons jamais vues, de nos yeux vues – tel est encore l’idée sur laquelle Socrate et Simmias s’accordent sans difficulté dans le Phédon : « affirmons-nous qu’il existe quelque chose qui est la justice même (ti einai dikaion auto), ou qu’il n’y a rien de tel ? - Par Zeus oui, nous l’affirmons ! - Et ne disons-nous pas encore qu’il y a quelque chose de beau (kalon) et quelque chose de bon (agathon) ? - Comment ne le dirions-nous pas ? - Et alors, as-tu déjà vu, de tes yeux vu, l’une de ces choses ? - Jamais, dit-il. » (Phédon 65d4-10). Or il n’y a pas que le bon et le juste que nous n’ayons jamais vus, de nos yeux vus : « Et je veux parler de toutes ces choses comme la grandeur, la santé, la force, en un mot de ce qui relève de la réalité (tês ousias) : être de la réalité, voilà ce que chacune de ces formes se trouve être (ho tugkhanei hekaston on) » (65d12-e1). C’est bien là une étrange doctrine, qui fait basculer la réalité – nous persistons à dire « réalité » et non « essence », parce qu’il ne s’agit pas seulement de l’essentiel, mais de toutes les déterminations que les choses peuvent avoir – des choses dans l’invisible : toutes les propriétés qu’elles sont susceptibles de manifester et que nous pouvons nommer, le fait qu’elles soient grandes, vigoureuses, belles, en bonne santé, justes et bonnes ; toutes ces propriétés par lesquelles nous les disons être telles ou telles, toute cette réalité qu’elles sont susceptibles d’avoir est une chose que nous n’avons jamais vue et que nous ne pouvons que penser. On comprend en outre que Platon refuse que cette unité invisible soit le fruit d’une expérience faite à partir de la sensation (Phédon 75a-77a) - ainsi par répétition de la sensation comme dans le processus inductif dont Aristote fait l’origine en nous des concepts (Seconds Analytiques, II, 19). C’est pour exprimer cela qu’il transpose la croyance orphique à la transmigration de l’âme53. Platon introduit dans le mythe orphique l’idée de la réminiscence du séjour parmi les morts chez le dieu Hadès54 . Or Socrate, dans le Cratyle, joue justement sur ces mêmes mots, associant le dieu Hadès et l’invisible (to aidès, Cratyle 403a6 ; 404b3-4). Nous tirons notre connaissance de la réalité, c’est-à-dire des formes qui rendent les choses pensables, d’un royaume d’Hadès que nos âmes ont visité et dont nous nous souvenons : c’est une autre manière de dire que notre esprit tire toute connaissance d’une source qui précède toute expérience possible. Les interprètes kantiens de Platon ont tiré cette idée en un sens subjectif et transcendantal55. Il faut néanmoins ne pas oublier qu’il est essentiel à la doctrine platonicienne que les formes soient la structure même de la réalité et non seulement un ordre propre à la pensée humaine. La réminiscence signifie que nos âmes sont nées 53 Ménon 81b-c. Alberto Bernabé réinvestit la notion de transposition pour rendre compte de l’opé-ration faite par Platon sur l’orphisme, voir « L’âme après la mort : modèles orphiques et transposi-tion platonicienne », Etudes Platoniciennes IV, Paris, Les Belles Lettres, 2007.54 Sur cette innovation platonicienne, voir A. Bernabé, op. cit., p. 41-42.55 Voir Paul Natorp, Platons Ideenlehre : Eine Einführung in den Idealismus, Leipzig, Dürr, 1903, cha-pitre III et IV. Une traduction anglaise est disponible sous le titre Plato’s Theory of Ideas, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2004.
platon160p_V2.indd 57 13/10/10 10:35:26
58
dotées d’une affinité avec l’invisible réalité des choses. Nous n’en savons pas encore assez sur la structure de l’univers et de nos âmes pour comprendre pourquoi. Revenons pour l’heure à notre troublante question. Nous n’avons jamais vu la beauté ni la justice, mais avons-nous au moins vu la beauté de cette montagne et la justice de cette action ? Ce n’est pas sûr. Certes, nous avons souvent trouvé beau le chatoiement des couleurs du ciel ou juste l’égalité d’un acte de partage (la même somme à chacun, nous avons vu les tas, nous avons compté, recompté nous-mêmes). Nous avons vu le chatoiement, nous avons vu les tas. Mais est-ce cela, la beauté et la justice, cette propriété qui se voit dans beaucoup d’autres circonstances et beaucoup d’autres lieux ? Non, ce n’en sont que les signes dans certains types de porteurs de cette propriété, mais non dans tous : la beauté n’est pas dans les sciences sur le mode du chatoiement des couleurs. C’est bien la raison pour laquelle, dans le Phédon, Socrate refuse d’attribuer à un certain nombre d’éléments de la description d’une belle fleur la cause de sa beauté : « Et si quelqu’un me dit que quoi que ce soit est beau en raison de la vivacité de ses couleurs, de sa forme (ê khrôma… ê skhêma), ou de quoi que ce soit d’autre de ce type, voici les autres causes auxquelles je dis au revoir » (100c10-d2). Pourtant, ces éléments ne feront-ils pas toujours partie de la description d’une belle fleur ? Si, bien sûr, mais pas à titre de cause, seulement à titre d’effet, de signe, d’indice. Seule la connaissance de la forme permet de reconnaître les propriétés et les détails par lesquels elle se traduit dans la multiplicité des choses. Seul le modèle est véritablement cause. Seul le menuisier sait à quels détails on reconnaît la navette bien faite dans la diversité des matières. Seul celui qui a vu la beauté qu’on ne voit qu’avec les yeux de l’esprit sait à quels indices on reconnaît la beauté aussi bien d’un corps, d’un acte, d’une loi ou d’une science – sans risque d’universaliser indûment l’élément de la description de l’une de ces choses en particulier. Ainsi, nous avons cru voir beaucoup de beauté, de justice et d’injustice ; mais nous n’avons peut-être jamais eu qu’une opinion à ce sujet, c’est-à-dire que nous nous sommes attachés à tel ou tel trait descriptif, la pureté des lignes et la nudité de la forme, la prestance des actes ou leur discrétion, et nous avons cru savoir où trouver la beauté et la justice. Nous étions des ignorants, et cela non plus, nous ne le savions pas.
platon160p_V2.indd 58 13/10/10 10:35:26
59
Chapitre III
Les opérations du philosophe artisandécouper/rassembler
§ 1. Multiplicité sensible, multiplicité des formes Il nous faut reprendre notre apprentissage méthodique, car les exercices que nous avons pratiqués jusqu’ici en comparant des multiplicités ne nous ont pas encore menés à la saisie des essences qui en font l’unité. Nous nous sommes un peu familiarisés avec l’unité du multiple qu’est la forme et qui suppose la différence radicale entre la forme invisible et la multiplicité sensible qu’elle unifie. Mais ce n’est pas même encore le début de cet art que le Socrate de Platon appelle dialectique et qui est appelé à devenir l’art qui a pour objet le réel lui-même, quand le médecin s’occupe des corps et le cordonnier des chaussures. Pour s’en approcher, il faut commencer à saisir l’unité et la multiplicité au sein même des formes. Nous les avons déjà rencontrées, en regardant travailler le menuisier du Cratyle : celui-ci sait ce qui fait de toutes les navettes une navette, mais il sait aussi fabriquer des types de navettes différentes, selon l’usage qui en est attendu. Et, comme nous l’avons vu, il reconnaît, au sein de la forme navette, des articulations internes, des sous-ensembles qui témoignent à leur tour d’une unité propre. Il nous faut ainsi comprendre plus précisément comment des formes peuvent être incluses les unes dans les autres. Souvenons-nous aussi de la suggestion de Ménon de différencier des types de vertus. Il y a là une intuition dont on peut percevoir l’intérêt à partir du moment où cette invocation de la multiplicité n’est plus faite pour faire obstacle à la saisie de l’unité qui irrigue cette multiplicité même. Or c’est précisément en poursuivant ce qu’il y a de juste dans cette direction prise par Ménon que le dialogue éponyme s’ouvre sur un nouveau type de multiplicité. On ne se demande plus en effet seulement comment une forme fait l’unité d’une multiplicité de choses susceptibles de la recevoir, mais comment elle se différencie elle-même en une multiplicité de formes. La vertu se multiplie en plusieurs vertus à leur tour susceptibles de se trouver chez un homme, chez une femme, etc. Une fois posée l’unité de la forme, le retour de la multiplicité des façons d’être vertueux ne pose plus aucun problème. Une analogie permet d’éclairer ce point. La rondeur est « une figure (skhêma) » et non pas « la figure en général (haplôs) » (Ménon 73e4-5), de même qu’il n’y a pas que la justice mais d’autres vertus encore. Comme il y a diverses figures, il y a diverses vertus, ainsi selon la liste non-exhaustive de Ménon : le courage, la tempérance, le savoir, la magnificence, et toutes les autres. Or cette nouvelle multiplicité n’est pas du même ordre que celle de tout à l’heure. On pourrait croire que la même chose nous arrive, car, « en cherchant une seule vertu », nous en avons trouvé de nouveau plusieurs, mais « d’une autre manière » : nous tenons désormais « cette
platon160p_V2.indd 59 13/10/10 10:35:26
60
vertu unique qui traverse toutes les autres vertus » (74a7-b1). Plus tôt, c’était la multiplicité des choses qui peuvent être dites vertueuses et dans lesquelles la vertu peut se trouver (les porteurs), maintenant, il s’agit, au sommet du triangle paradigmatique, de la multiplicité des vertus elles-mêmes, lesquelles, chacune à leur tour, peuvent se retrouver dans de multiples choses sous l’aspect d’une qualité. De même, il y a le blanc et la multiplicité des choses blanches, le rouge et la multiplicité des choses rouges, mais aussi la couleur en général. Il y a à chaque fois une multiplicité (des vertus, des couleurs, des figures) et une unité nouvelle, quelque chose par quoi toutes les vertus, toutes les couleurs, toutes les figures sont la même chose. Apprenons ainsi quelle est cette chose « qui ne contient pas le rond moins que le droit » (74d7-8) et que précisément nous nommons figure. Plusieurs définitions de la figure sont avancées, par exemple le fait d’être la limite d’un corps solide. Il faut tenter de faire de même pour la vertu, en cessant de la morceler. Ménon échoue de nouveau à isoler l’unité constitutive de la vertu qui fait l’unité de toutes les vertus, en avançant des définitions générales (désirer les belles choses et avoir le pouvoir de se les procurer, avoir la puissance de se procurer les biens) qui de nouveau ne coïncideront pas avec l’ensemble des choses vertueuses. La puissance de se procurer le bien peut être possédée de manière injuste et, inversement, la vertu consiste parfois à renoncer à se procurer quelque chose (78e6-79a1) : il n’y a donc qu’une intersection entre cette puissance et l’ensemble des choses vertueuses. On se retrouve alors à nouveau face à une partie de la vertu, la justice, et à la nécessité d’attraper l’unité des différentes vertus (79d). La manière dont une erreur se produit et dont on peut se sortir de cette erreur est très instructive et les dialogues ne manquent pas de mettre souvent en scène de telles mésaventures56. Au sortir du Ménon nous sommes ainsi munis d’une grande idée : il n’y a pas seulement la multiplicité des choses pouvant recevoir une vertu, il y a aussi une multiplicité interne à la forme, ses articulations propres, qui font que la vertu elle-même est plusieurs, chacune des parties de la vertu (la justice, le courage, la sagesse, la piété, etc.) étant à son tour capable d’être présente dans une multiplicité de choses, en même temps que la vertu elle-même. C’est cette division interne des unités intelligibles qui est le cœur de l’exercice philosophique platonicien, celui que le Socrate des dialogues nomme du nom de dialectique. Le tisserand croise le fil et la trame, le menuisier taille, scie, rabote, agence. Le philosophe, sur son établi, divise et rassemble son matériau idéal.
§2. Rassembler : inclure une forme recherchée dans une autre forme plus grande
Pour définir une chose, il est avantageux de situer la forme recherchée dans un rapport avec une forme concernant un plus grand nombre de cas (une forme qui unifie une plus grande multiplicité) – c’est une 56 Voir par exemple le rôle de l’intervention du mythe dans Le Politique, afin de faire apercevoir une erreur commise dans le raisonnement précédent (274e-275e).
platon160p_V2.indd 60 13/10/10 10:35:26
61
opération qui ne va pas sans risque de méprise, comme nous allons le voir. Nous avons déjà rencontré des cas réussis de telles inclusions : le courage défini comme « une certaine fermeté (karteria) de l’âme », par exemple. Comme nous l’avons vu, nous avons une extension de la définition qui est simplement trop grande, mais qui inclut néanmoins tous les cas recherchés. Ce type de cas est exprimé par une formule plus générale mise en œuvre lors de la troisième tentative de l’Euthyphron : comme le devin éponyme peine à trouver une définition satisfaisante du pieux, Socrate suggère une voie détournée – on se demandera si « tout ce qui est pieux (pan to hosion) est juste (dikaion) », et si « tout ce qui est juste est pieux » ou s’il faut plutôt penser que « le pieux est entièrement juste mais que le juste n’est pas entièrement pieux », c’est-à-dire qu’il est « en partie pieux, et en partie autre chose » (11 e2-12 a3). Il faut reconnaître que l’exemple du Lachès est similaire : le ferme et le courageux sont aussi dans ce type de relation, puisque tout ce qui est courageux est ferme, mais toute fermeté n’est pas courage. De même, toutes les choses que l’on pourra décrire comme pieuses seraient donc incluses au sein des choses que l’on reconnaîtra comme justes. Mais est-ce le cas réciproquement ? Pour expliciter la question à l’intention d’Euthyphron qui peine à suivre, Socrate utilise un vers sur Zeus selon lequel « là où il y a crainte, il y a aussi respect » et conteste alors que les deux types de choses se suivent ainsi, car nous ne respectons pas toujours ce que nous craignons, ainsi la maladie ou la pauvreté, alors que nous ressentons une crainte devant ce que nous respectons : le respect implique la honte de manquer à ce respect et la crainte de le faire. Il est donc juste de dire que là où il y a respect, il y a aussi crainte, mais pas l’inverse. On dira donc que la crainte est « plus étendue (epi pleon) » que le respect et que le respect est une « partie (morion) » de la crainte, « comme l’impair est une partie du nombre, de telle sorte que là où il y a nombre, il n’y a pas forcément aussi impair, mais que là où il y a impair, il y a aussi nombre » (12 b4-c9). Socrate transpose alors ce résultat au cas de la justice et de la piété : la piété est partie de la justice. Là où il y a piété, il y a justice, mais la piété n’est pas « partout » où est la justice (12c10-d4). Il s’agit bien des éléments de la collection représentée par une forme : on se pose la question de savoir si « là » où se trouve un des éléments d’un des ensembles, c’est-à-dire lorsqu’une chose se trouve posséder telle qualité, alors un élément de l’autre ensemble est présent aussi, c’est-à-dire que cette chose se trouve aussi avoir telle ou telle autre qualité. On s’assure ainsi que l’on a bien une situation d’inclusion, en soulignant que tous les éléments du petit ensemble sont simultanément des éléments du grand :
platon160p_V2.indd 61 13/10/10 10:35:26
62
Telle est la nouveauté : nous comprenons que, dans les cas d’inclusion, la participation à un des deux ensembles (le petit), pour une chose, impliquerait la participation à l’autre (le grand). C’est le phénomène que l’on peut appeler la « participation adjointe » et qui est largement développée dans le Phédon, avec les mêmes exemples qu’ici pour le nombre trois et l’imparité, ou encore le froid et la neige (103c-105b). Une action qui en vient à être pieuse ne peut pas en même temps ne pas devenir juste, de la même façon qu’en venant à participer à la triade on ne peut éviter de participer à l’imparité, pas plus que l’eau ne peut devenir neige sans devenir froide. Pour une forme, être une partie d’une autre, cela signifie que toutes les choses qui la reçoivent reçoivent aussi cette autre chose dont elle est une partie. En revanche, la réception de la forme qui est en position de tout n’implique pas nécessairement l’attribution de ses parties. Si la piété est une partie de la justice, alors toutes les choses pieuses sont justes mais pas réciproquement. Partout où le pieux se trouve, le juste se trouve aussi. Nous comprenons ainsi comment des formes peuvent être « parties » d’autres formes, c’est-à-dire que dans ce cas, tous les éléments qui appartiennent à la première forme sont éléments d’une autre forme, sans que la réciproque soit vraie.
Exercice 5 : répondre aux questions suivantes et en déduire le type de rapport entre les deux notions.Y a-t-il paix sans justice ?Y a-t-il justice sans égalité ?L’animal suit-il toujours l’homme ?57
Nous allons comprendre pourquoi cette inclusion de la propriété que l’on cherche à définir au sein d’un ensemble plus vaste est le cas le plus intéressant pour la dialectique parmi ceux que nos premiers entraînements nous ont fait apercevoir. § 3. Diviser : retrouver une forme recherchée au sein d’une forme plus grande
Que faire une fois une inclusion établie ? Que faire après avoir établi que le pieux est une partie du juste, c’est-à-dire que chacune des
57 La déesse Eirênê (la paix) ne vient jamais s’installer durablement sans sa sœur Dikê (la justice) ; La justice quant à elle ne vient pas sans l’égalité, qu’elle soit arithmétique ou proportionnelle ; enfin l’animal suit décidemment l’homme partout.
platon160p_V2.indd 62 13/10/10 10:35:27
63
choses pieuse est, simultanément, tout aussi bien une chose juste ? Dès lors il faut identifier, parmi les choses justes, celles qui sont pieuses. Il faut faire apparaître le pieux comme une division du juste lui-même. On renverse ainsi la perspective : après avoir situé une forme au sein d’une autre afin de la saisir comme partie de celle-ci, nous repartons du nouveau tout en cherchant à laquelle de ses divisions correspond la partie que nous cherchions. Ainsi, nous pourrions demander à Euthyphron « quelle partie (meros) du juste serait le pieux » (12d6-7). Une analogie peut nous faire comprendre cela : si nous savons que le pair est une partie du nombre (étape 1), nous pouvons nous demander quelle partie du nombre est le pair. Or, le nombre se divise en scalène (le triangle scalène a trois côtés inégaux à la manière du nombre impair qui se divise en deux nombres inégaux) et isocèle (le triangle isocèle a deux côtés égaux comme le nombre pair se divise en deux nombre égaux) (d8-10) (étape 2). On peut alors reconnaître que le pair correspond à la partie scalène du nombre (étape 3). Ce petit exemple arithmétique a ceci de particulier qu’il nous propose une division exhaustive du tout en deux moitiés (scalène/isocèle) et une identification de la partie recherchée (le nombre pair), à l’une des moitiés.
Comment réaliser la même opération pour trouver quelle sorte de chose juste est ce qui est pieux ? Euthyphron suggère que l’on considère comme pieux ce qui, faisant partie de la justice, concerne les dieux et non les hommes : cette autre part est « la partie restante » (to loipon, 12e7).
Pour évaluer la façon dont Euthyphron vient de proposer une division du juste qui corresponde au pieux, il faut s’interroger sur la façon dont on détermine cette partie restante, qui correspond là encore à une propriété remarquable des multiplicités que l’on appelle aujourd’hui la « différence » entre un ensemble A et un ensemble B, ou encore le « complément » de B
platon160p_V2.indd 63 13/10/10 10:35:27
64
relatif à A58. Si A est l’ensemble des choses justes et B l’ensemble des choses pieuses, la différence entre A et B est l’ensemble de toutes ces choses justes qui ne sont pas pieuses. L’étape 1 montre que lorsque l’on parvient à dire qu’une forme est partie d’une autre, ainsi le pieux partie du juste, on se trouve dès lors face à un complément qui n’est pas encore déterminé : toutes ces autres choses justes qui ne sont pas pieuses. Or, si l’on veut pouvoir déterminer quel type de choses justes sont les choses pieuses, il nous faut mettre un nom sur ce « reste » qu’est la partie complémentaire. Lachès lui aussi se trouve confronté à ce problème, avec sa troisième définition, qui est en fait la deuxième, simplement améliorée. Suite au contre-exemple utilisé par Socrate, comme nous l’avons vu, pour montrer que toute fermeté n’est pas courageuse (la fermeté pouvant être irréfléchie, elle ne sera dès lors plus une vertu et donc ne sera plus du courage), Lachès cherche à restreindre adéquatement le champ des choses fermes : la fermeté réfléchie (phronimos karteria) peut-elle être le courage (Lachès 192d10) ? Lachès fait ainsi l’hypothèse que le complément de la fermeté irréfléchie pourrait être la partie courageuse que nous cherchons. On peut représenter de nouveau cette proposition ainsi :
Or Socrate montre à Lachès que l’ensemble d’actions pouvant être le fait d’une fermeté réfléchie est plus large que les actions courageuses. Faisons varier les exemples de fermeté réfléchie, concernant les petites choses comme les grandes (192e1) : on peut se montrer sagement ferme dans la dépense d’argent, par exemple dans un contexte où l’on pourra en tirer beaucoup en retour — appellera-t-on celui qui fait cela un homme courageux ? Le médecin peut fermement, en ayant bien réfléchi, refuser de donner à boire à un patient qui le réclame et auquel cela serait fatal : est-ce un exemple de courage ? Enfin, le dernier exemple pris par Socrate est celui du général dont la fermeté est aussi le fruit d’un bon calcul : il sait qu’il attend du renfort, qu’il se bat contre un ennemi moins nombreux que ses propres troupes et qu’il a l’avantage du terrain. Là encore on ne dirait pas que c’est un exemple de courage : l’ennemi a en l’occurrence bien du courage de ne pas battre en retraite. Or, souligne Socrate, la fermeté de cet adversaire moins nombreux est moins réfléchie. Lachès a donc bien vu (étape 1) que les choses courageuses devaient se situer à l’intérieur de ce qu’il tient déjà (les choses fermes), et il a cherché comment diviser cet ensemble (étape 2) et en isoler
58 voyez Halmos, op. cit., p. 26.
platon160p_V2.indd 64 13/10/10 10:35:27
65
la bonne partie (étape 3). Mais il n’a pas accompli une division satisfaisante lui permettant de parvenir correctement à l’étape 3. Il a sauté sur la partie irréfléchie de la fermeté, en supposant que son complément pourraît être l’ensemble des choses courageuses. Et il s’est avéré simplement que la différence interne à la fermeté entre fermeté réfléchie et fermeté irréfléchie ne suivait pas la couture qui, au sein des choses fermes, délimite le champ du courage. Qu’aurait-il fallu faire ? Il aurait fallu se préoccuper différemment des fameuses parties restantes à l’étape 2. C’est dans le Sophiste et le Politique que ce point de méthode est précisé. Ces deux dialogues mettent en scène une rencontre avec un philosophe issu de la prestigieuse école d’Élée (l’école de Parménide et de Zénon) sur la question des apparences du philosophe. Aux yeux du monde, les philosophes prennent l’apparence tantôt de politiques tantôt de sophistes, tantôt encore de gens possédés par le délire (Sophiste 216c-d). Il s’agit d’abord de dénombrer — le sophiste, le politique, le philosophe : est-ce que toutes ces choses sont une ou deux ou est-ce encore qu’il y a là trois noms qui correspondent vraiment à trois genres de choses distincts (217a6-8) ? L’étranger d’Elée affirme que chez lui on tient chacune de ces choses pour un genre distinct mais qu’il n’est pas facile de définir chacun. Le Sophiste fait le récit de l’entreprise de définition dudit sophiste, et le Politique celle de l’activité du même nom. On se séparera de l’étranger avant d’avoir pu passer au philosophe, dont l’art de division et de rassemblement est pourtant à l’œuvre tout au long de ce parcours. Comment chercher le sophiste ? Comment chercher le politique ? Comme pour la piété et le courage, il faut commencer par les reconnaître comme partie d’un tout. Dans les deux cas, ils prennent place au sein des activités : il s’agit d’une fonction (ergon). Là où il y a un philosophe ou un sophiste, il y a une activité – en revanche, là où il y a une activité, il n’y pas forcément un philosophe ou un sophiste : il peut y avoir un danseur, un cuisinier ou quelqu’un qui pêche à la ligne. D’ailleurs, c’est cette activité familière de la pêche à la ligne que l’étranger prendra pour exemple (218d9), dans le Sophiste, pour s’entraîner plus facilement à découper l’ensemble des activités avant de partir à la recherche du sophiste. Le schéma général de la méthode employée dans l’exemple de la pêche, puis lors de la recherche du sophiste, puis encore lors de celle du politique, peut être résumé assez simplement : on pose un ensemble dans lequel se trouve l’élément recherché, on divise cet ensemble en deux parties, on identifie dans quelle partie ce trouve l’élément recherché, et on recommence l’opération. Comme pour les nombres scalènes et isocèles, l’étranger nous proposera à chaque fois une grande division exhaustive en deux moitiés. Une bizarrerie peut être notée : dans les deux dialogues, l’ensemble des activités, s’il est toujours divisé par moitiés successives, n’est pas toujours divisé selon les mêmes moitiés. Lors de la division pour chercher la pêche, l’ensemble des arts manifeste « deux formes (eidê) » (219a8), les arts de production et les arts d’acquisition ; la pêche étant reconnue comme
platon160p_V2.indd 65 13/10/10 10:35:27
66
appartenant à l’art d’acquisition, on divisera à nouveau cette portion. On mobilisera pourtant d’autres coupures de cet ensemble en cherchant le politique : Socrate rappellera en effet qu’il faut de nouveau découper les sciences, puisque ce que nous cherchons en fait partie, « comme nous l’avons fait en menant notre enquête sur le personnage précédent », mais pas « selon la même coupure » (Politique 258b9-10). On distinguera d’abord les sciences selon que leurs prestations sont pratiques, manuelles (la technique des gens qui mettent la main à la pâte et qui de leurs mains font advenir de nouvelles choses) ou d’ordre cognitif (ceux qui les possèdent apportent un savoir et non un « coup de main » : c’est la science de l’architecte et non celle de l’ouvrier, elle peut s’exprimer par le conseil, le fait de donner des ordres, sans pour autant soi-même effectuer les actions qui amènent le résultat) (258d-259d). Pourquoi cette nouvelle division ? S’il doit s’agir d’une découpe qui n’est pas arbitraire, il ne peut pas y avoir trente-six manières de suivre la structure même des choses. Non pas trente-six, certes, mais peut-être deux, trois ou quatre, ou six. En l’occurrence, nous avons dessiné le triangle des puissances de l’art, et nous savons que l’ensemble des arts est susceptible de se découper en trois branches principales. Une certaine plasticité de la méthode de division n’est pas incompatible avec l’idée que les relations entre formes correspondent à une structure objective des choses. Il n’y a pas qu’une manière de descendre la montagne, et on choisira la division de telle sorte qu’elle fasse apparaître d’un côté un sentier qui mène très clairement et très directement à ce que l’on cherche : différencier l’acquisition de la production permettrait de mieux isoler un chemin vers la pêche ou vers la sophistique (car celui-ci s’avèrera être un chasseur de jeunes gens), alors que différencier les sciences à vocation plus généralement pratique de celles qui sont cognitives et directrices semble indiquer plus clairement où poursuivre le politique. Il convient néanmoins de ne pas s’arrêter au fait de saisir avec facilité la branche que nous cherchons. L’étranger, dans le Politique, affirme qu’il faut trouver « ce sentier qui mène vers la politique », le découvrir et surtout « le mettre à part des autres en le marquant du sceau d’une unique nature (idea) », sans oublier de « marquer tous les sentiers qui s’en écartent comme relevant d’une autre espèce », de telle sorte que l’on amène notre esprit à concevoir l’ensemble de toutes les sciences comme divisé selon deux espèces (duo eidê) (258c3-8). La division par deux ne doit pas nous empêcher de bien déterminer tous les chemins dont nous nous détournons : on profitera du fait de les rassembler sous une espèce unique pour les nommer. La précipitation à prendre le sentier dont on soupçonne qu’il est le bon et à ne pas prendre le temps de marquer les autres d’une espèce unique (une forme, et non pas un rassemblement hétéroclite) est le premier danger contre lequel il faut se prémunir. Il faut s’occuper de l’ensemble complémentaire. Manifestement, avec toutes les choses justes qui ne concernent pas les dieux, et toutes les fermetés irréfléchies, Euthyphron et Lachès n’avaient pas pris cette peine.
platon160p_V2.indd 66 13/10/10 10:35:27
67
§ 4. Pourquoi couper par moitiés sans faire de petits morceaux
Poursuivons la recherche de l’art politique parmi les activités humaines. On cherche donc du côté des pratiques cognitives et non pratiques. On distingue dans cette branche un côté plus purement théorique (où l’on se contente de connaître et de juger, en simple spectateur) et un côté prescriptif (on juge et on calcule afin de donner des ordres, 259e-260c). Cette technique directive, qui est manifestement le bon sentier à suivre, est à son tour divisée, entre une technique qui « dirige elle-même » (être au principe des ordres, et donner des ordres qui donnent naissance à des choses, vivantes ou artificielles, comme on le précisera peu après, 261a11-b2) et les autres où l’on est simplement quelqu’un qui transmet ceux d’autrui – l’étranger néglige alors de donner un nom au reste. On pourrait voir là une négligence quant à l’obligation où nous sommes de bien circonscrire les deux branches, ou tout au moins un mauvais exemple pour la jeunesse, encouragée ainsi à la désinvolture avec le découpage des branches que l’on ne retient pas. En réalité, la jeunesse doit aussi apprendre que le fait de ne pas toujours chercher un nom est bien plutôt de ces facilités salutaires que s’accorde celui qui sait ce qu’il fait. Ce qui compte, c’est en effet l’unité d’une essence, avec ou sans nom, avec un nom ou un autre, et de ce point de vue, celui qui ne se soucie pas trop des noms montre de la sagesse – comme l’étranger en fait le compliment au jeune Socrate, lorsque ce dernier avoue qu’il lui est indifférent que l’on appelle l’élevage non individualisé de vivants élévage « des troupeaux » ou « en groupe » (261e1-3) : ne pas être trop pointilleux sur les mots, voilà un gage de sagesse prometteur chez un jeune homme (e5-7). On divise les techniques auto-directrices entre celles dont les ordres donnent naissance à des choses vivantes et celles qui président à la naissance de choses artificielles : celui que nous cherchons donne des ordres à des vivants. On distingue alors le fait de s’occuper des vivants individuellement ou en groupes (261d3-5). C’est alors que le jeune Socrate s’empresse de suggérer la division suivante, celle de la direction de troupeaux vivants, en élevage d’hommes et en élevage d’autres bêtes (262a3-4). Pourquoi l’étranger repousse-t-il cette suggestion comme l’effet d’un empressement erroné ? « Ne détachons pas une petite partie en l’opposant à des parties grandes et nombreuses, la séparant de l’espèce (eidos), faisons plutôt en sorte que la partie soit en même temps une espèce (to meros hama eidos) » (262a8-b2). Que cela signifie-t-il ? L’étranger explique au jeune Socrate qu’il a été trop pressé d’arriver au bout en voyant un chemin qui menait tout de suite à l’homme. Ce serait très beau de pouvoir se saisir immédiatement de ce que l’on cherche, mais on risque de ne pas tomber juste. Or, ajoute-t-il, il n’est pas sûr de « découper en petits morceaux (leptourgein) » (262b5) ; il l’est davantage d’avancer en coupant « par le milieu » : on aura ainsi plus de chance de tomber sur des formes (ideais) (b6-7). Un exemple permet à l’étranger d’expliciter cette réponse. Si par exemple on devait diviser l’ensemble des humains, on pourrait le faire comme le font « la plupart des gens d’ici » (262d1), c’est-à-dire selon l’opinion dominante chez les
platon160p_V2.indd 67 13/10/10 10:35:27
68
Athéniens et plus généralement chez les Grecs. Ces gens-là en effet « d’une part séparent les Grecs comme une unité que l’on pourrait détacher de tous les autres hommes », d’autre part « donnent l’appellation unique de « Barbare » à toutes les autres races, quoiqu’elles soient en nombre indéterminé, sans mélange entre elles ni langue commune, et, par cette appellation unique, s’imaginent avoir affaire là à un genre unique » (262d2-6). Autre exemple : vouloir diviser le nombre en deux en mettant à part « dix mille » comme s’il était lui-même une espèce une et rassembler tout le reste des nombres en leur donnant un même nom, en croyant que par là on a mis à part un autre genre de nombre. C’est donc très clair, l’étranger associe ici une exigence méthodologique quantitative (mieux vaut faire des moitiés que des petits morceaux) à une exigence de faire coïncider la découpe avec des articulations réelles. C’est en divisant par moitié, ainsi le nombre en pair et impair, les hommes en mâle et femelle, les vivants en cornus et non cornus, que l’on suivra mieux l’articulation des choses en saisissant des termes qui sont à la fois partie et genre (genos hama kai meros) (262e1-7). Et l’on détachera des petites parties comme les Lydiens ou les Phrygiens de l’ensemble des hommes que lorsqu’il n’y a plus moyen de trouver une autre division qui permette cette coïncidence. On reconnaît là une exigence de continuité dans le découpage, qu’affirme très clairement un texte du Philèbe : quand on pose une unité, il ne faut pas sauter les intermédiaires en la découpant et sauter tout de suite dans l’infini, ni inversement de l’infini sauter directement à l’unité. Ni trop vite, ni trop lentement : il faut faire le juste compte des articulations. C’est cela, ajoute Socrate, qui différencie la dialectique de toutes les autres formes de pratique intellectuelle non spécialisée, comme cet art de s’imposer dans la discussion que Platon nomme « éristique » et qui renvoie aux débats des sophistes et des orateurs qui dominent la scène intellectuelle de son temps (16e4-17a5). C’est un milieu où règne l’opinion, c’est-à-dire les généralisations fondées sur notre expérience perceptive, la valorisation excessive par chacune et chacun du type de rencontres qui est, pour elle ou pour lui, à la source de la définition des choses. C’est parce que l’on veut absolument soumettre le réel à ses propres généralisations perceptives que l’on en vient à sauter les étapes intermédiaires dans les divisions et les rassemblements. Un exemple frappant en est la croyance largement partagée par les Grecs de l’époque, selon laquelle la différence entre hommes et femmes pourrait être significative lorsque l’on recherche les dispositions naturelles qui rendent des individus aptes à diriger, donner des ordres, en temps de paix comme à la guerre. On reconnaît l’opinion à cette valorisation d’une expérience perceptive particulière, ainsi le fait de voir avant tout des hommes commander : lorsqu’il s’agit de chercher dans quelle partie de l’humanité on doit trouver les gens qui commandent, il y a des chances pour que certains sautent directement sur la différence entre hommes et femmes, en gardant la partie masculine à diviser. C’est bien la rigueur dialectique qui amène au contraire Platon, en rupture avec l’opinion de ses contemporains, à poser l’indifférence du genre sexuel eu égard aux fonctions politiques et guerrières, dans la mesure où les dispositions naturelles requises, à savoir la capacité
platon160p_V2.indd 68 13/10/10 10:35:28
69
à apprendre rapidement de nombreuses choses, ne sont pas sexuées dans l’espèce humaine (République V 453e-457b). Il faut relier cette exigence de la bonne vitesse dans les divisions à celle qui est affirmée ici dans le Politique : « Lorsque quelque chose est dit être une espèce de quelque chose, alors nécessairement aussi elle est elle-même une partie de la chose dont elle est dite être une espèce ; la partie quant à elle n’est en rien nécessairement une espèce » (Politique 263b7-9). Chercher les espèces qui correspondent à des essences, c’est bien tenter de les isoler dans des ensembles plus grands. Nous risquons néanmoins à tout moment de choisir des parties qui ne suivent pas l’articulation naturelle des espèces. Et cela risque tout particulièrement de nous arriver, si nous nous précipitons sur une partie sans nous assurer que le reste que nous laissons est aussi une espèce. Voici un exercice sur ce point : Exercice 6. Les couples suivants constituent-ils, pour nous aujourd’hui, des divisions par le milieu ou le détachement d’un petit morceau ? Proposition de méthode : expliciter le critère de la division à partir d’un ensemble supérieur que l’on devra nommer.L’homme et l’animal59
La démocratie et le totalitarisme60
59 Nous avons déjà mentionné l’opposition entre l’homme et l’animal à propos de la tentative de voir dans le rire un propre de l’homme. L’opinion moderne nous offre un certain nombre de caractéristiques permettant d’établir l’opposition entre l’homme et l’animal, tout comme l’opinion ancienne permettait de s’assurer que l’opposition radicale entre Grecs et barbares était fondée sur des caractéristiques essentielles (ainsi l’idée que les barbares n’avaient pas de communauté politique véritable, étant tous soumis à un pouvoir comparable à celui du père de famille) : ainsi on pensera que la culture, l’ac-quisition et la transmission d’informations nouvelles, la capacité de transformer son environnement, séparent radicalement l’humanité du reste de l’ensemble supérieur des vivants. Pourtant l’avancée du savoir en éthologie indique que ces caractéristiques sont partagées par un ensemble plus grand qui ne correspond pas à la coupure proposée et qu’il faut trouver autrement la spécificité de l’homme au sein du continuum des vivants : sur les pratiques culturelles animales, afin d’y situer de manière plus fine la spécificité humaine, on lira par exemple D. Lestel, Les origines animales de la culture, Paris, Flammarion, 2001.60 La philosophie politique du XXe siècle a parfois invoqué une grande opposition entre la démocra-tie, caractérisée comme forme de gouvernement libre et comme société ouverte, et les régimes totalitaires, aux institutions hiérarchiques et sociétés contrôlées. Voyez par exemple Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis, Paris, Seuil 1979 (traduction de l’original The Open Society and its enemies, 1945) ; Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1970. L’une des caractéristiques invoquées, la liberté, semble bien opposer les deux systèmes, mais ceux-ci sont-ils des moitiés ou simplement des petits morceaux de l’ensemble plus grand des formes d’organisations politiques connues de l’espèce humaine ? Y aurait-il par exemple d’autres systè-mes politiques possibles que ce que nous appelons démocratie dans lesquels la liberté existe ? En artisans socratiques, il nous suffit de trouver un contre-exemple. Or le mot démocratie utilisé pour qualifier les systèmes représentatifs, désigne originellement une forme de pouvoir qui utilise peu l’élection, recourt davantage à l’action de citoyens tirés au sort (sur l’histoire du régime représen-tatif et l’oubli de cette caractéristique essentielle de la démocratie pré-moderne, voyez B. Manin, Principes du gouvernement représentatif , Paris, Flammarion, 1996). L’usage de parties plus petites que les moitiés a tendance à présenter une forme de régime, le régime représentatif, comme le seul exemple possible d’usage politique de la liberté, en occultant une autre partie, celle que les anciens appelaient en effet démocratie et dans laquelle les citoyens participaient à l’établissement des politiques publiques et à la gestion des affaires de la cité.
platon160p_V2.indd 69 13/10/10 10:35:28
70
Retenons donc qu’il faut éviter de se saisir trop vite d’une partie qui nous semble s’offrir à nous avec évidence. C’est en coupant par le milieu, selon l’opposition de contradictoires, comme cornu et non-cornu par exemple, que l’on a à la fois la certitude d’une découpe exhaustive (qui ne laissera pas dans l’ombre une partie des cas avec lesquelles on risque de ne pas voir une intersection possible entre l’espèce recherchée et ce que l’on enlève), un moyen facile de savoir de quel côté il faut se débarrasser (le contre-exemple est immédiat : le politique ne s’occupe pas des vivants à cornes), et, comme on le sait en pratiquant la méthode par dichotomie, un meilleur rendement quantitatif (on se débarrasse en moyenne du plus grand nombre de cas en coupant par le milieu à chaque fois). On ne confond donc pas l’espèce et la partie, mais en travaillant purement et simplement sur la découpe des parties, on s’assure néanmoins à chaque étape que la frontière de l’espèce n’a pas été franchie (un petit morceau du politique n’est pas oublié du côté des vivants à corne). Peu à peu, l’extension de la partie se rapproche de celle de l’espèce recherchée. Tout cela explique que l’on puisse prendre plusieurs chemins pour accomplir la division la plus efficace. Tous les moyens de regrouper sont bons sur la route de la forme. S’il faut, pour éviter les mauvaises définitions et finir par isoler l’essence, rassembler un jour le canard et l’homme comme non-cornus, le général et le flûtiste comme non-producteurs, et une autre fois l’homme et la poule comme bipèdes, ou le général et le mathématicien comme acquéreurs, il n’y a pas lieu de s’en plaindre.
§ 5. Mise en pratique : diviser et rassembler l’amour
Nous connaissons désormais les opérations fondamentales par lesquelles le philosophe manipule son matériau, à l’image du bon boucher qui découpe l’animal selon ses articulations. Pour finir, regardons Socrate manier cet art avec virtuosité. Le Phèdre consiste en grande partie en une telle démonstration. Il y a deux façons de procéder pour parler avec art : pour commencer, il faut « conduire, en l’embrassant du regard, une multiplicité de choses dispersées vers une forme unique (eis mian te idean), de telle sorte que, en le définissant à chaque fois, on rende manifeste ce à propos de quoi on veut à chaque fois enseigner quelque chose » (Phèdre 265d3-5). Socrate illustre ce premier type de mouvement de l’esprit en se référant à ce qui a été fait précédemment en tentant de donner une définition de l’amour ; il s’agit du premier discours de Socrate, où celui-ci avait commencé en affirmant qu’il faut « savoir ce qu’est l’objet sur lequel on délibère », et pour cela, saisir ce que la plupart des hommes ignore, à savoir quelle est « la réalité (ousia) de chaque chose », c’est-à-dire « ce qu’elle est et quel type de puissance (dunamis) elle a » : voilà ce qu’il faut définir et « ce sur quoi il faut garder les yeux (apoblepein) » (237c1-d1). Il faut donc rassembler tous les éléments d’un ensemble susceptible de correspondre à une forme unique afin de déterminer
platon160p_V2.indd 70 13/10/10 10:35:28
71
le type de puissance d’une chose participant à cette forme. La réalité que constitue chaque forme est immédiatement aussi la réalité que chaque chose qui y participe en vient à partager, et cela signifie tout simplement qu’elle y trouve une puissance, c’est-à-dire une capacité d’agir et de pâtir, de produire et de subir certains effets, et pas d’autres. Participer à l’amour, c’est ainsi savoir prendre et donner des choses d’une certain type, qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont prises et rendues lorsque quelque chose en vient à participer par exemple au feu : on échange, pour simplifier un peu, d’un côté des sentiments, des discours et des faveurs, de l’autre de l’oxygène et du gaz carbonique. Comme nous le savons, définir consiste bien dans un premier temps à inclure une multitude dans un tout. Socrate pose donc que « l’amour (erôs) est un certain désir (epithumia) » (237d3), chose évidente pour tous, précise-t-il. De quel type d’inclusion s’agit-il ici ? S’agit-il de la même sorte d’inclusion que celle que Lachès a accomplie en plaçant le courage dans la fermeté, c’est-à-dire dans un tout plus grand que le courage qui inclut de nombreuses choses qui ne sont pas courageuses ? C’est ce que l’on pourrait en effet immédiatement se dire en remarquant qu’il y a des gens qui « sans aimer ont du désir pour ce qui est beau » (237d4). Est-ce à dire que certains désirs comme celui du beau sont hors de l’amour et que l’amour est seulement une partie du désir qui n’inclut pas le désir du beau ? Est-ce ainsi que les choses vont se découper ? Il se pourrait en réalité que nous ayons là plusieurs formes d’amour et que notre contre-exemple (ceux qui désirent le beau sans aimer personne) nous ait déjà mené à une articulation interne à l’amour. Mais cela nous ne le saurons qu’en accomplissant cet autre mouvement qu’il convient d’accomplir une fois rapportée une multiplicité à une unité par un regard synoptique : « être capable, en retour, de découper (diatemnein) selon les espèces (kat’eidê), selon les articulations naturelles et s’appliquer à ne casser aucune partie en employant les façons d’un mauvais cuisinier » (265e1-3). Or ce double mouvement a été réalisé à travers les deux discours que Socrate, tour à tour, a précédemment livrés, l’un pour défendre l’idée qu’il fallait, en amour, donner ses faveurs à celui qui n’aime pas, et l’autre, au contraire, pour faire l’éloge de celui qui aime. C’est qu’en réalité, chacun de ces discours se fondait sur une des parties naturelles de ce tout qu’est l’amour. Le premier, comme nous le soupçonnions, a réduit l’amour à l’une des parties du désir, à cette passion sans retenue qui poursuit la beauté des corps, afin de montrer qu’un amant épris de cet amour-là était dangereux tant pour l’aimé qui lui accorde ses faveurs que pour lui-même. Socrate, au début de ce premier discours, a en effet distingué deux formes (idea) de choses qui nous commandent et nous meuvent : le désir naturel qui nous porte aux plaisirs ; une opinion acquise qui nous mène vers le meilleur (237d6-9). Ces deux tendances sont parfois en accord, parfois en lutte, et la domination de la seconde s’appelle tempérance (sôphrosunê), celle de la première démesure (hubris), cette dernière étant « en effet susceptible d’une multiplicité de noms, de membres, de formes » (237e3-238a3). Socrate
platon160p_V2.indd 71 13/10/10 10:35:28
72
distingue alors les formes et les noms de ces diverses démesures, selon que c’est un désir de plaisir en général qui domine, un désir de manger, de boire. Enfin, une dernière forme de domination du plaisir non réfléchi, lorsqu’il s’agit d’un désir de beauté corporelle, alimenté par tous les autres désirs de la même famille, s’appelle l’amour (erôs, c4). Il explore alors les effets néfastes d’un tel mouvement quand il lui est donné libre cours : effet néfaste pour celui qui lui laisse cours comme pour celui qui est l’objet de cet amour. Or, s’étant repenti d’avoir ainsi insulté l’amour en l’ayant réduit à cette espèce, Socrate a entrepris un second discours, par lequel il a distingué les espèces du « délire » (to manian, 244a6) dont les dieux sont la cause. Il a commencé par faire l’éloge de cet état dans lequel la prophétesse de Delphes ou d’autres prêtresses prodiguent leurs conseils aux individus privés et aux États, ainsi que du délire qui permet aux devins de prévoir l’avenir (244a6-d5) ; de cette possession divine qui a permis de découvrir les rites purificateurs des fautes les plus graves (244d5-245a1) ; de la possession par laquelle les Muses ajoutent à la technique ce qui manque à celle-ci pour faire œuvre de poésie (245a1-8) ; et enfin du délire amoureux envoyé par les dieux (245b4-257b6). Il a présenté les bienfaits qui découlaient de ces formes de délire, dont il précisera ensuite les noms : délire divinatoire, mystique, poétique et érotique (265b2-5). Au terme de ce parcours, Socrate reconnaît que ses deux discours ont consisté à tenir des propos contraires : l’un disait qu’il faut accorder ses faveurs à celui qui aime, l’autre à celui qui n’aime pas. Pourtant, ils visaient la même chose : dans les deux cas il s’est agi de dire que l’amour est un délire, et c’est le délire lui-même qui comporte deux espèces (265a6-9), l’une qui a pour cause les maladies humaines, l’autre les dieux. Ces deux discours peuvent être décrits comme les explorations successives de deux branches de la même réalité : la démence de l’esprit, « saisie dans l’unité d’une forme (eidos) commune » (265e3-4). L’analogie avec la découpe d’un corps animal par un bon cuisinier est tout à fait nette : « De même en effet que d’un corps unique sont issus des membres naturellement doubles et de même nom, bien qu’ils soient dits ‘gauche’ ou ‘droit’ », de même aussi, la divagation de l’esprit a été, « après avoir été considérée par le discours comme naturellement une en nous », découpée en une partie gauche et une partie droite : l’un de nos discours a découpé une partie gauche jusqu’à trouver une forme d’amour qu’il a vilipendée, l’autre a découpé le côté droit et y a trouvé « un certain amour divin » et « a fait son éloge comme de la cause pour nous des plus grands biens » (265e4-266b1). Il faut donc dire que la totalité n’avait pas été envisagée dès le début du premier discours. Or nous avons reproché à Ménon de ne pas avoir explicité la totalité qu’il pouvait avoir en vue en distinguant les articulations de la vertu qui lui semblaient naturelles (outre le fait qu’il n’avait pas fait un compte exhaustif de ses parties, laissant entendre qu’il y en avait encore beaucoup d’autres). Socrate l’affirme ici clairement : ce sont là des choses qu’il vaut mieux expliciter. Il nous révèle alors l’objet véritable de son amour : il est prêt à suivre partout la personne ainsi « capable de diriger le
platon160p_V2.indd 72 13/10/10 10:35:28
73
regard vers une unité, l’unité naturelle d’une multiplicité (hen kai epi polla pephukoth’horan, 266b5-6) » ; de telles personnes sont ce que l’on appelle des dialecticiens. Socrate nous dit bien ce dont il est amoureux — de ces divisions (diaresis) et de ces rassemblements (sunagôgê) que l’on fait afin d’être en mesure de parler et de penser (b3-5). Amour pour une méthode qui permet de substituer à l’aveuglement des débats d’opinion et leurs stériles chocs d’évaluations arbitraires et concurrentes, la joyeuse découverte en commun des articulations entre les choses. Se détourner du spectacle des sens pour lui substituer la réalité constituée par les formes et leurs combinaisons, commencer à parcourir ces combinaisons à la recherche des inclusions plutôt que des intersections : tel est le théâtre de cet amour. Le Philèbe propose une autre belle description de l’exercice dialectique. Socrate y décrit une méthode qui nous vient des dieux et que nous devons suivre en toute occasion si nous voulons connaître quoi que ce soit. Les dieux nous ont révélé que tout ce qui est dit exister est composé d’un et de multiple. Les choses étant ainsi arrangées il nous faut « poser toujours que pour chaque ensemble il y a une forme (idea) unique et la chercher : on la trouvera, en effet, présente en lui ». On pourra alors, une fois cette unité trouvée, regarder si elle peut se diviser en deux, trois ou plus, et fixer ce nombre. Puis recommencer pour chacune de ces nouvelles unités, jusqu’à ce qu’on voie quelle quantité précise a atteint l’unité primitive. Et c’est seulement une fois tous les intermédiaires comptés que l’on pourra laisser chacune des unités de l’ensemble « se disperser dans l’infini (apeiron) » (16c5-e4). Or, comme l’a précisé Socrate, telle est la méthode qui a dû être suivie lors de l’invention de tous les arts (16c2-3). Les arts et techniques ont manifesté, par leur résultats, leur capacité à se mettre en relation avec les choses telles qu’elles sont – leur invisible structure, qui n’est visible qu’à l’esprit. La dialectique consiste à extraire des arts et techniques des hommes la méthode qui permette de tenir un discours sensé sur la réalité dans son ensemble. L’unité profonde de tous les arts et métiers et le fait qu’elle se reflète dans l’activité philosophique tient donc à cette unité ontologique : tout ce qui existe est issu de cette composition d’un et de multiple que tous nos arts ont appris à apprivoiser. Ce que nous ne faisons encore que pressentir, c’est que cette extension est facilitée par le fait que la réalité de l’univers est aussi, pour Platon, l’effet d’une causalité technique à l’œuvre de manière immanente au sein du cosmos, qui est lui aussi une chose qui pense. L’ensemble du visible est le résultat d’une production technique continue dont le fondement, comme celui de toutes les productions, est invisible. Il nous faut explorer plus avant l’affinité entre la méthode dialectique et la structure même de la nature, si nous voulons progresser davantage dans le savoir découper. Car nous ne sommes pas encore en possession de la clef des divisions, ce qui permet de savoir exactement combien d’espèces d’une forme il y a. Nous l’avons entrevu une fois, en découpant l’amour : il faut savoir quels ingrédients se combinent dans chaque chose et de combien de combinaisons ils sont capables. Il faut entrer dans la philosophie combinatoire du mélange, qui est aussi la clef de la structure de toutes choses.
platon160p_V2.indd 73 13/10/10 10:35:28
74
Partie II
Outils II : combinaisons et mélanges
Chapitre I : l’ontologie sur le modèle artisanal
La réalité est un mélange
§ 1. L’océan de l’être
Ce que le menuisier du Cratyle sait faire pour la navette ou pour le lit, saurions-nous le faire pour la totalité du réel ? Or ce serait une expérience de nature à modifier la représentation que nous pouvons nous faire de la réalité, ou, pour le dire avec les mots de l’étranger du Sophiste, de nature à modifier la façon dont nous pensons pouvoir « déterminer combien il y a d’êtres (onta) et quels ils sont » (Sophiste 242c5-6). Cela d’autant plus que nous avons déjà rencontré l’idée que la forme constituait la réalité même des choses qui y participent : la poursuite de la question socratique de la définition a en effet, au fur et à mesure, produit cette étrange bascule, déplaçant le centre de gravité des choses vers leurs propriétés. Chaque propriété constitue une réalité à laquelle les choses « participent » : c’est alors qu’elles peuvent être dites ce qu’elles sont – grandes, rouges, belles, abeilles, etc. Nous avons compris le bénéfice méthodologique d’un tel phénomène : la substitution de la multiplicité des formes à la diversité sensible ouvre un nouveau paysage, fait d’ensembles de choses à manipuler, à découper, à rassembler sur l’établi dialectique du philosophe. Or une première question se pose : dans un tel dispositif, que disons-nous désormais de la réalité des choses sensibles lorsque nous disons de ces choses qu’elles doivent participer aux formes pour accéder à la réalité ? Reçoivent-elles ainsi l’existence même ? La réalité, l’existence même des choses est-elle une forme à laquelle on participe ou l’effet de participer à n’importe quelle forme ? Ou est-ce au contraire parce que l’on existe en premier lieu que l’on en vient ensuite à participer à des formes dont on tire simplement des propriétés – l’existence précédant ainsi l’essence ? Avec de telles questions, le dialogue socratique, commencé auprès de l’échoppe des artisans, est en train de rentrer dans les eaux profondes de la philosophie, celles où l’on rencontre de véritables continents qui ont pour nom Héraclite, Parménide, Empédocle, et tous les autres « anciens savants » face auxquels les hommes de la génération de Platon sont des enfants. Il est temps de voir si le frêle esquif est prêt pour le grand large. Dans le Sophiste, comme nous l’avons déjà vu, Platon met en scène un disciple de l’école philosophique d’Élée, l’école de Xénophane et de Parménide, qui en vient à avouer son embarras face à la manière dont toutes les écoles philosophiques ont jusqu’ici posé cette question, dite « de l’être » (que nous appellerons indifféremment « ontologique »), c’est-à-dire,
platon160p_V2.indd 74 13/10/10 10:35:28
75
au sens où les Anciens l’entendent, la question de la nature et de la quantité de ce qui est : combien y a-t-il de choses, quelles sont-elles ? Or cet embarras nouveau, dont s’inspirera au XXe siècle Heidegger qui cite ce passage du Sophiste au seuil de Être et Temps, est, nous allons le voir, l’effet porté sur le débat des Anciens par le nouveau regard introduit par Platon. À l’aune de ce nouveau regard, les débats les plus fondamentaux de tous les philosophes présocratiques semblent devenir des « histoires » que l’on raconte aux enfants, comme si ces philosophes, lorsqu’ils veulent expliquer la nature et le nombre des choses qui sont, nous narraient plutôt des épousailles et engendrements réciproques entre les différents éléments de la réalité. D’après l’un « les êtres sont trois », ils se font la guerre, s’aiment, engendrent d’autres réalités. Pour l’autre, il n’y en a que deux : l’humide et le sec, ou le chaud et le froid. Chez nous, ajoute celui qui provient de l’école d’Élée, au sud de l’actuelle Naples, on ne reconnaît qu’un être : le tout. Enfin, précise-t-il encore, il y en a certains, en Ionie et en Sicile, qui ont voulu entrelacer les deux thèses, marier l’un et le multiple en affirmant que l’être est à la fois un et plusieurs, et que la haine et l’amour y produisent en permanence rassemblement et division (Sophiste 242c8-243a4.). Platon dresse ainsi un panorama des options divergentes sur la nature et le nombre des éléments qui composent « l’ameublement du monde »61, tableau dans lequel on peut classer les différentes options philosophiques de son temps, comme on le pourrait encore pour le nôtre, où les philosophes – notamment australiens – poursuivent l’affrontement qui animait déjà, il y a plus de deux millénaires, les communautés philosophiques d’autres rives, celles de la méditerranée62. L’étranger, qui fut un élève rompu à toutes ces subtilités, avoue donc ne plus comprendre – que veulent-ils bien dire quand ils nous racontent ces histoires à propos de l’être et du non-être ? Il ne reste plus que l’embarras face à ces mythes (243b3-10). L’étranger est dans la situation du Socrate du Phédon, lorsque celui-ci avoue ne plus comprendre ces théories sur la nature qu’il a pourtant connues sur le bout des doigts, ces théories par lesquelles les Anciens avaient compris l’être et la genèse de toutes choses (Phédon 99d-100a). Cette enquête sur la nature de toutes choses manifestait néanmoins une trop grande dépendance à l’égard du témoignage des sens et un aveuglement corrélatif quant à la question de la forme. C’est le même remède qui est ici préconisé par le jeune Théétète : il est évident qu’il nous faut examiner l’être (to on) pour savoir « ce qu’il peut bien signifier pour ceux qui l’énoncent » (Sophiste 243d3-5). La question socratique de la définition, la question à laquelle l’artisan sait répondre, peut désormais s’avancer sur la grande scène de la philosophie, la gigantomachie à propos de la réalité, de la nature et de la composition de ce qui est.
61 L’expression est commune chez les métaphysiciens anglo-saxons contemporains pour désigner la composition de la réalité. Elle trouve son origine chez Berkeley qui parle des « chœurs du ciel et de l’ameublement de la terre » (« the choir of heaven and furniture of the earth », Principles of Human Knowledge, I, § 6).62 Pour un tel tableau des positions contemporaines sur la nature de la réalité, voyez celui que propose Frédéric Nef, Qu’est-ce que la métaphysique ?, Paris, Gallimard, 2004, p. 631-635.
platon160p_V2.indd 75 13/10/10 10:35:28
76
On la posera donc à tous les partis en présence. À ceux qui disent que le tout est fait de chaud et de froid, ou d’un autre couple, on demandera : « que dites-vous quand vous dites et que le couple et que chacun de ses termes ‘est’? Par ce « est », que voulez-vous nous faire entendre ? ». Est-ce un troisième terme qui s’ajoute aux deux autres ? Y a-t-il dès lors trois choses et non plus deux ? Car si les deux « sont » au même titre, il n’est pas possible de dire que l’une d’entre elles est l’être ; et si le couple est ce qu’ils appellent « être », alors ils appellent d’un nom unique deux choses différentes. Dans tous les cas, nous ne comprenons pas ce qu’ils entendent par ce mot (243d8-244b8). Quand à ceux qui disent que le tout est un, il n’y a donc pour eux qu’un « être ». Or, par « être », entendent-ils quelque chose d’autre que le fait d’être cette chose unique qu’ils disent être, c’est-à-dire autre chose que d’être « un » ? Si c’est le cas, voilà déjà deux noms pour une seule chose : l’ « un » et l’ « être ». L’unité ne sera-t-elle plus que l’unité d’un nom tandis que ce qu’ils disent un est déjà un tout, composé de propriétés différentes ? Donc soit l’être est un en un sens (être un tout) qui le fait être aussi plusieurs – mais alors l’être n’est pas unique – ; soit il est l’unité en soi et il est sans parties, mais alors il n’est plus le tout, et il y a des choses qui existent en plus de l’être, à côté de lui, et, derechef, la totalité n’est pas une mais plusieurs. S’il y a une nature du tout, de l’être, de l’un, le tout ne peut être rigoureusement un, car il est déjà trop de choses – et dès lors il risque de n’être plus même le tout, ne pouvant tout être à la fois, et si le tout n’est plus le tout, l’être se manquera à lui-même, en ce sens qu’il y aura des choses en dehors de lui, qui pourtant sont (244b9-245e5) ! La réfutation de la doctrine unitaire est décisive : elle nous montre que l’on ne peut identifier le tout et l’unité sans faire que ce tout ne puisse être véritablement un. De la même manière qu’il faut distinguer, comme nous le savons déjà grâce au triangle paradigmatique, la forme de la beauté d’une chose belle, fût-elle la plus belle – fût-elle Aphrodite elle-même ! – , la forme de l’unité, l’unité en soi, doit être différenciée d’une chose une, fût-elle le tout lui-même. Dès que l’on pose la question de la nature des choses, une multiplicité de formes apparaît que l’unitarisme ne peut supporter : voilà un fait décisif sur lequel nous allons revenir méditer constamment. La philosophie, conçue sur le modèle de l’artisanat, véhicule une irrémédiable multiplicité de modèles et d’objets à la ressemblances de ceux-ci. C’est cette philosophie du multiple qui, dans le présent chapitre, doit être défendue contre les partisans de l’unité. On commencera en utilisant les armes que l’on a apprises en mettant à l’épreuve les définitions des notions morales. Après avoir épuisé les deux premières positions ontologiques, l’étranger aborde un autre aspect du débat des philosophes sur l’être, qu’il appelle maintenant un véritable « combat de géants ». Des titans « essaient de tirer vers la terre tout ce qui provient du ciel et de l’invisible, attrapant sans façon roches et chênes dans leurs mains », et identifient la réalité et le corps, n’acceptant l’existence que de ce qu’ils peuvent toucher (246a7-b3). Leurs adversaires se prémunissent « du haut de quelque lieu invisible », et « luttent pour affirmer que certaines
platon160p_V2.indd 76 13/10/10 10:35:29
77
formes intelligibles et incorporelles (noêta…kai asômata eidê) constituent la réalité (ousia) véritable » (246b6-8). Ce n’est donc plus un débat sur la quantité des choses, ici, mais bien plutôt sur la nature de ce qui est. On y reconnaît du reste la logique de l’exemplarité recherchée par certains interlocuteurs de Socrate, définissant la beauté par la jeune femme ou le courage par l’héroïsme du soldat : il s’agit de définitions qui impliquent une dimension normative – non pas une définition de l’être par laquelle on tente de trouver l’unité de l’océan des choses que l’on dit être, mais au contraire une définition par laquelle on cherche à prouver que seulement certaines de ces choses « sont » véritablement et qu’à côté de celles-ci, les autres ne sont pas véritablement, ou même tout simplement pas. C’est un point sur lequel l’étranger prend soin d’insister. Ceux qui définissent le corps et l’existence comme identiques refusent d’entendre quiconque attribuerait l’être à quelque chose qui n’a pas de corps, et, de même, les partisans de l’invisible, dès qu’on leur présente un corps, lui refusent le nom d’existence et le morcellent en un devenir évanescent. La démonstration de l’étranger d’Élée, consiste alors à suggérer une solution qui puisse faire l’unité de toutes les choses que l’ensemble des protagonistes dit être. C’est la vertu de la définition de l’être qui est alors proposée : « il y a existence lorsqu’une chose possède la puissance d’agir ou de pâtir, même par rapport à la chose la plus insignifiante » (248c4-5). Disons qu’il s’agit moins d’une définition de la nature même de l’être que de ce à quoi on peut le reconnaître : lorsque nous croisons quelque chose que nous pouvons toucher ou penser, ou par lequel nous pouvons être touché ou pensé, alors nous avons affaire à quelque chose qui existe. Ce qui est du reste tout à fait intéressant, c’est que dans leur manque d’entraînement dialectique à prendre en compte la totalité du multiple auquel une forme se prête, les « fils de la terre » comme les « amis des formes » ont omis le même type de chose dans leur compte de ce qui existe : l’âme. L’âme est à la fois trop intouchable et trop mobile pour être reconnue comme existante par les uns comme par les autres. C’est la vie de l’esprit qui disparaît avec leurs définitions, comme l’étranger le rappelle avec insistance (248e). Ils ont les uns comme les autres échoué au même endroit que Lachès en sa première définition : n’avoir considéré qu’une trop petite partie des choses qui sont à définir. L’océan de ce qui est rejette sur la rive les définitions trop restreintes de l’être. Une inquiétude point alors : les dialogues de Platon sont-ils eux-mêmes, quand on entre sur le terrain difficile de l’être, à la hauteur de l’exigence d’unité habituelle à l’exercice de définition pratiqué sur les vertus ? Plusieurs textes platoniciens n’ont-ils pas clairement établi une distinction, en termes de degrés de réalité, entre l’intelligible et le sensible ? Timée n’affirme-t-il pas en effet qu’il faut établir la division suivante : « qu’est-ce qui toujours est et ne vient jamais à l’être, et qu’est-ce qui toujours advient et n’est jamais ? L’un est manifestement saisi par la pensée au moyen du raisonnement, étant toujours de façon identique, et l’autre quant à lui, qui vient à être et vient à mourir et n’est jamais véritablement, est l’objet de
platon160p_V2.indd 77 13/10/10 10:35:29
78
l’opinion au moyen de la sensation sans raison » (Timée 27d6-28a4). Nous avons déjà lu d’autres formulations de cette distinction, notamment dans le Banquet. Il y a aussi la fameuse image de la ligne dans la République (VI 510d-511d), avec sa façon de distinguer quatre puissances de l’âme et quatre objets corrélatifs pour ces quatre puissances, qui semble elle aussi devoir être lue dans le sens d’une distinction de niveaux de réalité, entre les objets invisibles de l’esprit et les objets des sens qui n’en sont que l’image dégradée. Ce passage redouble même sa hiérarchie dans l’être et dans la connaissance au prix d’une double subordination interne plaçant, dans les objets de l’esprit, les objets mathématiques sous les formes dont ils ne sont qu’une image, et dans les objets des sens, les reflets à la surface des lacs, objets de la croyance, sous les objets de la perception dont ils sont les images. La déclaration de Timée est tout à fait préoccupante. Diotime, dans le texte que nous avons lu, indiquait que les formes sont d’une nature telle qu’elles ne sauraient venir à l’existence ni en sortir, par opposition aux choses que nous connaissons par les sens. Mais cela ne supposait pas nécessairement que l’être, au sens d’existence, soit réservé aux formes : on pouvait simplement distinguer des degrés de stabilité dans la participation à l’existence. Timée s’est-il laissé emporter par l’impétuosité de la jeunesse en allant jusqu’à dire que les choses qui ont à accéder à l’être par la naissance et à le quitter par la mort, ne « sont » en réalité jamais, comme si « être » devait être réservé à ce qui l’est pleinement ? Dans ce cas, nous avons bien affaire à une solution à la Hippias : de la même façon qu’à côté de la jeune femme qui est véritablement belle on ne peut pas vraiment dire que la marmite soit belle, on devra, comme les « amis des formes », ou les « fils de la terre », refuser le titre d’ « être » aux choses qui n’existent pas aussi pleinement que d’autres, et par pleinement, il faut entendre en l’occurrence durablement. Une logique radicale de l’éminence semble contrevenir à la méthode qui nous impose de toujours tenir compte de l’océan des choses qui participent à la même chose. Il faut revenir à nos outils de base pour résoudre ce problème, et nous préparer à de sérieuses difficultés.
§ 2. Dans l’atelier de Zénon : les choses sensibles à l’épreuve du feu
En se risquant à affirmer que les choses sensibles n’existaient pas du tout parce qu’elles n’existent pas toujours, Timée a pris le risque d’énoncer une thèse qui ressemble à l’une de celles mises en avant par une redoutable école philosophique, l’école d’Élée. La confrontation avec cette école est décisive pour la philosophie des dialogues ; elle donne lieu à de véritables exercices philosophiques. Il s’agit d’abord de réfuter la thèse de Zénon, disciple de Parménide, le maître d’Élée. Au début du Parménide, Zénon vient d’accomplir la lecture d’un manuscrit qui concerne l’existence des choses sensibles. Zénon est parti de l’hypothèse « si les êtres (ta onta) sont plusieurs » pour en déduire qu’alors de telles choses devraient « être
platon160p_V2.indd 78 13/10/10 10:35:29
79
semblables (homoia) et dissemblables (anomoia) » (127e1-2) – ce que Zénon déclare impossible : comment en effet ce qui est semblable pourrait-il être dissemblable et ce qui est semblable dissemblable ? Dès lors comment accepter que les choses soient plusieurs, s’il s’ensuivait qu’il leur arrive ainsi des choses impossibles (127e8) ? Comme le souligne Socrate, il s’agit bien pour Zénon d’établir, à l’encontre de tout ce que l’on dit, que les choses ne sont pas plusieurs. Au total, Zénon défend la même thèse que Parménide, d’une manière différente : ce dernier défend l’idée que « le tout est un (hen… einai to pan) » (128a8-b1) tandis que Zénon avance que les choses ne sont pas plusieurs, afin de défendre son maître contre les attaques de ceux qui entreprennent de déduire des conséquences risibles de l’hypothèse de l’unité du tout, de l’univers. Deux arguments doivent être avancés pour réfuter cette position, et, tout aussi urgemment, différencier la thèse ontologique développée dans les dialogues de celle-ci. D’une part, les contradictions qui affectent en effet les choses sensibles n’impliquent pas leur inexistence. D’autre part, les choses sensibles ne sont pas le tout de ce qui est. Pensons à notre triangle paradigmatique : il y a des navettes produites et il y a un modèle pour toutes les navettes, qui doit aussi exister. Voilà deux formes d’existence à intégrer au sein de ce qui est, en les différenciant nettement sans s’empêcher de penser leur manière de communiquer entre elles. Telle est la difficulté que le modèle artisanal présente quand on en vient à en saisir la portée ontologique. C’est la doctrine éléate qui, de ce point de vue, produit le plus grand nombre d’objections contre le déploiement d’un tel modèle. Commençons par le côté gauche du triangle, en nous concentrant sur les images du modèle, et faisons quelques mises au point préparatoires avant de réfuter Zénon. Au livre V de la République se trouve le développement que nous avons déjà évoqué sur les amateurs de spectacles qui aiment les choses belles sans reconnaître qu’il existe une unité de la beauté dont toutes les choses belles participent. Or Socrate ajoute que ces gens qui ne séparent pas le sensible de l’intelligible, qui « ne tiennent ni les choses qui en participent (ta metekhonta) pour être lui, ni lui pour être les choses qui en participent » (V 476d2-3), ont une vie qui est un songe – une vie d’opinion et non de pensée. Si on interrogeait une telle personne, en lui demandant si celui qui connaît connaît quelque chose plutôt que rien (e7), il serait d’accord pour dire que lorsqu’on connaît quelque chose ce quelque chose existe, car comment connaître ce qui n’existe pas (477a1) ? À ce point Socrate surprend (et surprend toujours de nos jours) tous ceux qui pensent (légitimement) qu’il n’y a pas de milieu entre exister et ne pas exister (soit on est, soit on n’est pas) en proposant une gradation pour corréler les modes d’être et les façons d’être connu, comme ce sera aussi le cas dans l’image de la ligne du livre VI. Examinons cela. Il utilise très clairement un vocabulaire qui distingue la plénitude dans l’existence : « ce qui possède pleinement l’existence (to pantelôs on) est pleinement connaissable, tandis que ce qui n’a pas du tout d’existence est totalement inconnaissable » (a3-4). Quel est donc le critère qui permet de distinguer des degrés dans l’existence ?
platon160p_V2.indd 79 13/10/10 10:35:29
80
Il s’agit bien semble-t-il du même critère que celui employé par Timée : c’est la contingence de l’existence qui fait que l’on ne peut être « pleinement ». Dès lors en effet, « si quelque chose se comporte de façon à aussi bien être que n’être pas », ne faudra-t-il pas lui reconnaître un « être intermédiaire entre ce qui possède l’existence sans mélange et ce qui, inversement, n’a pas d’existence du tout » (a6-a7) ? Or on voit bien par là qu’il ne s’agit pas d’un sens différent de l’existence, mais seulement du fait qu’être « moins » signifie tout simplement être susceptible d’être et de n’être plus, tandis qu’être « pleinement », c’est aussi tout simplement le fait de ne pas risquer de sortir de l’ensemble des choses qui sont. Cet « intermédiaire » entre l’existant, objet de connaissance, et le non-existant, objet de non-connaissance, doit lui-même être objet de quelque chose d’intermédiaire entre le savoir et le non-savoir : il s’agit de l’opinion, ce mode de connaissance adéquat aux choses que nous percevons – ces choses qui existent un jour, et n’existent plus un autre. L’opinion ne peut être un non-savoir car elle aurait pour objet un non-être, c’est-à-dire aucun objet. Or l’opinion est opinion de quelque chose et même d’une chose unique (478b10). Notons que cette chose qui n’est pas l’être « absolument parlant » est aussi décrite comme un « mélange » d’être et de non-être. L’être absolu et le non-être sont sans mélange ; la grande découverte est celle de « ce qui participe aux deux, à l’être et au non-être et qui, par rapport à aucun des deux, ne saurait être dit sans mélange » (478e1-3). L’être et le non-être sont tous deux ramenés au rang d’ingrédients de la réalité que nous percevons. Ce vocabulaire du mélange, nous devons l’entendre comme un mélange de formes, c’est-à-dire un rapport entre des ensembles de choses : l’objet de l’opinion est susceptible de se trouver dans l’ensemble des choses qui sont, et aussi d’en sortir pour entrer dans l’ensemble des choses qui ne sont pas. Du point de vue de l’éternité, l’objet d’opinion se trouve dans les deux ensembles incompossibles que sont l’être et le non-être, comme s’il créait une intersection entre deux ensembles qui n’en ont, à rigoureusement parler, aucune. Une nuance s’impose donc entre la position de Timée et celle de Socrate. Socrate conserve l’unité de l’être, attribuée aussi bien à l’objet d’opinion qu’à l’objet de science : il respecte la plus grande extension des choses qui sont, sans en exclure une partie. Il admet simplement que l’objet de science ne reçoit que l’être et rien d’autre (ce qu’il faut entendre par absence de mélange et pureté) et l’objet d’opinion quant à lui peut recevoir aussi bien l’être que le non-être : il est intermédiaire au sens où il est susceptible de changer d’ensemble, de celui des choses qui existent à celui des choses qui n’existent pas, et vice versa. Être « intermédiaire » entre l’être et le non-être ne signifie donc pas que l’on vient d’inventer un troisième état entre la vie et la mort, l’existence et l’inexistence, mais seulement qu’il existe des choses qui sont susceptibles de passer d’un groupe à l’autre, celui des existants et celui des non-existants. L’opinion, dont nous avons souvent vu qu’elle était facilement productrice d’intersections (« être heureux, c’est être riche »), est elle-même, d’un point de vue épistémologique, le fruit d’une intersection :
platon160p_V2.indd 80 13/10/10 10:35:29
81
C’est bien parce que l’objet d’opinion fait partie de ces choses qui peuvent être puis n’être pas, qu’il est aussi susceptible d’être en permanence saisi à l’intersection de tous les autres attributs. Il semble que ce soit justement l’instabilité eu égard à l’être qui en entraîne d’autres, car ces choses qui sont intermédiaires entre les deux ensembles de l’être et du non-être se trouvent être aussi susceptibles d’apparaître dans les ensembles de choses qui ont la propriété contraire à celle qu’elles possèdent déjà : « parmi ces multiples choses belles, y en a-t-il une qui n’apparaîtra pas laide ? Une parmi les choses justes qui ne paraîtra pas injuste ? Une parmi les choses pieuses qui ne paraîtra pas impie ? » (479a6-8). Et Glaucon de renchérir : il est même nécessaire qu’ils « paraissent beaux d’une certaine manière et laids d’une autre », et ainsi pour toutes les autres propriétés évoquées (b1-2). Socrate tient le même raisonnement à propos des objets doubles, grands ou petits, légers ou lourds, auxquels il n’y aura pas plus de raison de donner les noms que nous leur donnons, plutôt que les noms contraires. C’est donc à plus d’un titre que l’objet d’opinion fluctue. On distinguera néanmoins deux cas : celui des propriétés contraires comme le juste et l’injuste, le grand et le petit, le léger et le lourd, etc., caractères que l’objet d’opinion est susceptible de manifester en même temps ; celui de l’être et du non-être, pour lesquels il doit se trouver nécessairement dans l’un ou dans l’autre à un moment donné, même s’il est susceptible de changer pour l’autre, car « d’aucune de ces choses on ne peut penser de façon fixe, ni qu’elle existe, ni qu’elle n’existe pas, ni qu’elle est l’un et l’autre, ni qu’elle n’est ni l’un ni l’autre » (c3-5). L’objet d’opinion fluctue donc à deux niveaux, celui de l’être et celui de toutes les propriétés contraires. Sa fluctuation est simultanée dans le second cas, mais successive dans le premier, puisqu’il n’est jamais à la fois existant et non-existant, jamais non plus ni existant ni non existant, car il faut soit exister soit ne pas exister : en revanche il est toujours susceptible d’être existant ou inexistant, indifféremment, et c’est cela que signifie être « le milieu (metaxu) entre la réalité (ousia) et le non-être (mê einai) » (c7). Voilà donc l’objet de l’opinion, que Platon décide de penser comme ayant un objet propre : l’opinion et le savoir ne sont pas deux façons de connaître la même chose, l’une moins certaine que l’autre ; l’opinion a son objet propre, qui lui ressemble – aussi fluctuant et incertain qu’elle. L’opinion est le fruit d’une généralisation faite sur le fondement de la sensation ; la science a une autre source, comme nous le savons déjà. Tout cela peut s’illustrer assez
platon160p_V2.indd 81 13/10/10 10:35:29
82
facilement en reprenant notre outil préféré, le triangle paradigmatique. On pourra dire qu’il appartient aux navettes produites par le menuisier (celles qui se trouvent au sommet gauche du triangle) d’être aussi bien susceptibles d’être des navettes et de cesser de l’être lorsqu’elles sont brisées, d’être aussi bien grandes, comparées à des objets plus petits, que petites, comparées à des objets plus grands, etc. Leur contingence ontologique accompagne leur contingence vis-à-vis de toutes les autres propriétés. Nous pouvons en retour approfondir notre compréhension de l’activité artisanale : ces navettes-là doivent être reconnues comme un objet d’opinion pour ceux qui les voient, les manipulent, pour ceux qui, en les observant, voudraient en dégager les caractéristiques communes. Seule la navette en soi, l’unité de toutes les navettes, en haut du triangle, est un objet de science pour celui qui sait les fabriquer. À celui là il est donné de voir toutes les navettes fabriquées comme des images de cette unité : il saisit leur ressemblance au modèle intelligible à travers leur existence contingente. Notons bien encore que, lorsque Socrate distingue la connaissance par intellection et l’opinion fondée sur la sensation, il ne s’agit pas d’attribuer en bloc à la sensation une déficience telle qu’il nous faille en toute circonstance nous en remettre aux seuls objets de l’esprit. Il s’agit plutôt de distinguer les cas où notre perception ne nécessite en aucune façon un tel recours – lorsque « les choses qu’il y a dans la sensation… sont distinguées de manière satisfaisante par la sensation » – des cas où il est requis « du fait que la sensation ne produit rien de sain » (République VII 523a10-b4), parce que, justement, les mêmes choses se manifestent en même temps avec une propriété et son contraire. Socrate indique bien qu’il y a des cas où la sensation est parfaitement saine et où nous pouvons nous en remettre à elle seule. À la différence des choses qui ont des contraires, celles qui n’en ont pas sont ainsi beaucoup moins problématiques pour nos sens. C’est bien le cas du doigt dans notre présent passage : si l’on considère trois doigts sur l’une de nos mains, « le plus court, le second et celui du milieu » (523c5-6), c’est-à-dire le pouce, l’index et le majeur, on peut dire que nous percevons sans problème que ce sont là des doigts, et nous reconnaissons en chacun d’eux un doigt, « et, de ce point de vue, il ne diffère en rien qu’il soit vu au milieu ou bien à l’extrémité, qu’il soit blanc ou bien noir, qu’il soit épais ou bien mince, et tout ce qui est du même genre » (c11-d3). Quelle que soit la variation des propriétés contraires, nous voyons toujours le doigt comme doigt et l’âme n’a pas besoin de poser à autre chose qu’à nos sens – c’est-à-dire à l’intellect – la question de savoir « ce que peut bien être un doigt », « car nulle part la vue, n’a, dans le même temps, signalé à l’âme que le doigt fût le contraire d’un doigt » (d4-6). Voilà un passage déterminant : nous n’avons besoin que des sens pour reconnaître de manière satisfaisante un doigt et avoir une familiarité avec l’unité du doigt, par delà la variation des propriétés contraires (même s’il faudrait probablement encore distinguer cette connaissance d’une connaissance de l’essence du doigt, celle par exemple du médecin capable de soigner le doigt). Le doigt, et de manière
platon160p_V2.indd 82 13/10/10 10:35:29
83
générale les corps et les actions, ont suffisamment de consistance pour que la seule perception atteste de leur existence et de leurs caractéristiques principales, sans même devoir recourir à l’intelligence. L’opinion, lorsqu’elle est droite, peut donc offrir une certaine consistance, et on peut penser, par exemple, que le tisserand, qui connaîtra la navette par l’usage, et non par la production, ait une opinion correcte à propos de celle-ci, suffisante pour en faire un outil de son art à lui, le tissage. Forts de ces conclusions, il nous faut donc corriger le jeune Timée, et répondre à Zénon. Contre Timée, nous dirons que le fait que les objets des sens et de l’opinion puissent exister, puis ne plus exister, ne peut permettre de dire qu’ils ne sont pas du tout. Tant qu’ils existent, ils existent de manière tout à fait tranquille, jusqu’au jour où ils disparaissent. Simplement, ils oscillent de manière générale entre les propriétés opposées, le non-être et l’être comme les contraires, même si c’est avec une modalité différente : ils sont intermédiaires entre l’être et le non-être (ils passent de l’un à l’autre) et susceptibles de recevoir les autres contraires en même temps (dans ce cas, il y a une véritable intersection entre les ensembles contraires) ; être moins n’est pas « moins » exister, c’est se prêter avec plus de désinvolture ou de générosité à la réception des propriétés contraires. Contre Zénon, il faut dire qu’a fortiori les contrariétés diverses qui affligent les choses multiples n’impliquent pas non plus leur inexistence. Dans le Phédon, on a ainsi reconnu que Simmias pouvait très bien recevoir la grandeur et la petitesse indifféremment (102c). Or, la suite du passage introduit une remarque importante : un corps peut bien recevoir des propriétés contraires, en revanche il serait étrange que la grandeur elle-même soit petite ou la petitesse grande. Si nous avons toujours en tête le triangle paradigmatique, la stratégie est ici très claire, puisqu’il s’agit de bien déterminer les comportements distincts mais solidaires du sommet gauche et du sommet haut : une navette produite peut être grande et petite, peut être une navette un jour et cesser de l’être le lendemain – il serait en revanche bien étonnant que la navette en soi, l’unité de toute les navettes, ne soit plus ce qu’elle est. Après avoir rappelé que les contradictions qui affectent les choses sensibles n’entraînent pas leur inexistence, il faut passer à la description de cette autre forme d’existence qui est celle du modèle. Socrate, dans le Parménide, développe cette argumentation en réponse à Zénon. Il y a d’une part « une forme en soi (auto kath’hauto eidos) de la ressemblance (homoiotês) et à une telle forme correspond une autre qui lui est contraire, ce qui est dissemblable » (128e6-129a2). D’autre part, à ces deux réalités, les choses que nous appelons multiples prennent part (a3) : « celles qui prennent part à la ressemblance deviennent semblables par là-même, et dans la mesure où elles y prennent part ; celles qui prennent part à la dissemblance deviennent dissemblables, et celles qui prennent part aux deux deviennent les deux » (a3-6). Dès lors, il n’y a en effet aucun problème à considérer qu’une des multiples choses qui peuplent ce monde en viennent à participer (metekhein) à l’un et à l’autre, successivement ou simultanément. Il n’y a là rien d’étonnant. La seule chose étonnante serait que la forme change de caractère, que la
platon160p_V2.indd 83 13/10/10 10:35:29
84
ressemblance devienne son contraire et vice versa, de la même façon qu’il aurait été étonnant que la grandeur de Simmias devienne petite. Le même résultat peut être ensuite tiré avec un autre couple de propriétés, celles dont précisément Zénon et Parménide se sont tant occupés : l’unité et la multiplicité. Pas plus qu’il n’est étrange que les choses soient semblables et dissemblables, il n’est étrange, avance Socrate, que toutes choses apparaissent unes par la participation à l’un et que ces mêmes choses soient à leur tour multiples par la participation à la multiplicité (b4-6) — en revanche il serait étrange que l’un en soi soit plusieurs ou le plusieurs en soi un. Le passage qui suit prend un exemple qui revient plusieurs fois dans les dialogues : l’unité et la multiplicité d’un corps, exemple trivial d’unité des contraires dans une chose du monde dont il serait vain de s’étonner. On peut montrer à l’envi qu’un corps est multiple : on prendra mon côté droit, puis mon côté gauche avance Socrate, puis ma face arrière et ma face avant, le haut, le bas, et on montrera ainsi que « j’ai part, en effet je crois, à la pluralité » (c8) ; à l’envi aussi on montrera qu’il est un en l’isolant au milieu du groupe d’individus où il se trouve. Socrate reprend des exemples que l’on a déjà rencontrés : des pierres, des morceaux de bois, et de toutes les autres choses on pourra montrer aisément qu’elles sont à la fois unes et multiples, ce qui ne veut pas dire que l’un soit multiple et le multiple un (d5). Cet exemple apparaît aussi dans le Philèbe, alors que Socrate évoque les gens qui essayent de produire trop facilement des oppositions enfantines là où il n’y a pas lieu de s’en étonner, comme ceux qui, en distinguant par le discours des parties d’une chose avant de faire reconnaître l’unité du tout, se gaussent alors du fait que l’on viendrait de dire des chose monstrueuses, en disant l’un multiple et le multiple un (14d8-e4). Socrate affirme donc, dans ce passage du Parménide, qu’il n’y a rien d’extraordinaire à ces oppositions, à condition que l’on fasse comme celui qui « distingue, en les mettant à part, les formes en soi (auta kath’hauta ta eidê) » (129d7-8) des choses qui y participent. La liste des formes peut être allongée : Socrate propose aussi le repos et le mouvement, et toutes les choses de ce genre – il ajoutera bientôt le juste, le beau, le bien, hésitera pour l’homme, le feu, l’eau, sera d’accord pour la grandeur peu après. Si ces choses-là commençaient à se mélanger et à se séparer, je serais émerveillé, ajoute Socrate : si en effet le semblable en soi devenait dissemblable, voilà qui serait bien étonnant. Cela n’exclut pas nécessairement tout mélange des formes, comme nous le savons déjà, puisqu’il y a les inclusions ou les intersections de formes : cela exclut le fait de recevoir des attributs contraires, chose qui est impossible pour une forme (Phédon 102d-e). Au total, il suffit de distinguer deux modes d’existence : celui des formes qui « sont toujours identiques à elles-mêmes et jamais ne peuvent accueillir en elles un changement quel qu’il soit » (Phédon 78d8-9) et celui des choses multiples qui les reçoivent et ne sont « jamais en aucune façon les mêmes », choses que nous pouvons « percevoir par le toucher, la vue et tous les autres sens » (79a1-2).
platon160p_V2.indd 84 13/10/10 10:35:29
85
Or faire cette distinction entre ces deux modes d’être, c’est aussi, de manière corrélative, ouvrir la possibilité de saisir la manière dont les formes sont véritablement présentes dans les choses, ce que Socrate appelle leur « communauté » avec celles-ci : « chacune en elle-même est une, mais parce que chacune se manifeste partout en communauté (koinônia) avec les actions (praxis) et avec les corps (sôma), et les unes en rapport avec les autres, chacune paraît alors être multiple » (République V 476a5-7). L’opinion navigue entre être et non-être parce qu’elle s’obstine à ne considérer que les multiples reflets (cas extrêmes des amateurs de spectacles) ou à faire des généralisations sur le fondement de ces occurrences sans saisir leur unité essentielle et en privilégiant telle ou telle occurrence comme plus digne de prix que les autres (régime général de l’opinion). Sortir de l’opinion, c’est commencer tout simplement à reconnaître qu’il existe déjà au moins deux types de choses bien distinctes : il y a des corps et des actes, contrairement à ce que pourraient croire ceux qui relèguent les actions dans l’invisible et le néant (Théétète 155e5-6) ; il y a des formes intelligibles, contrairement à ce que pensent ceux qui ne croient pas à l’invisible. S’il y a des modes d’être différents chez Platon et s’il peuvent être hiérarchisés, c’est en tant qu’il y a différentes façons de se prêter au mélange et à la communauté. Sur le fond d’un même concept d’existence et d’une même philosophie générale du mélange, les choses et les formes ont des façons différentes de se prêter au mélange : les unes n’acceptent que l’être sans autre mélange, les autres l’être mélangé au non-être, les unes ne sont que ce qu’elles sont, les autres acceptent les contraires. Être plus ou moins, pour Platon, cela signifie tout simplement avoir des manières différentes de se prêter au mélange. La réalité est un mélange, il s’agit d’en penser les proportions, sur le modèle du bronzier qui fond les métaux et réalise les alliages.
§ 3. Dans l’atelier de Parménide : obtenir la communication des formes
Le platonisme substitue à la rupture éléatique entre être et néant une doctrine de degrés d’être qui signifie simplement que les différentes choses qui existent ont des manières différentes et hiérarchisées de se prêter au mélange. Cela suppose l’affirmation de deux niveaux solidaires de mélange : celle du mélange des formes entre elles et celle du mélange des formes avec les choses sensibles. Il faut que les différentes formes de navettes communiquent (que l’on comprenne en quoi la navette pour la laine et la navette pour le lin sont tout de même des navettes), et il faut que chaque modèle de navette se communique aux navettes produites. L’éléatisme se définit au contraire, selon Platon, comme un double refus : celui de la communication entre formes et celui de la communication entre formes et choses sensibles, qui finit par engloutir ces dernières dans le non-être. Dans le Parménide, le personnage éponyme attaque le jeune Socrate sur ces deux terrains. D’une part il se saisit du type d’aporie, mentionnée dans
platon160p_V2.indd 85 13/10/10 10:35:29
86
le Philèbe, qui semble se présenter lorsqu’on ne pose plus comme unité les choses d’ici, mais l’homme, le boeuf, le beau ou le bien en soi, c’est-à-dire des unités réelles et éternelles, soustraites au devenir, et que l’on se demande comment celle-ci garde son unité tout en se trouvant multipliée (Philèbe 15a-b). Parménide oppose à Socrate une série d’objections de ce type dans la première partie du dialogue : une chose participe-t-elle à la totalité d’une forme, ou à une partie ? Si c’est à la totalité, comment la forme fait-elle pour être toute entière dans chaque chose ? Si c’est par une partie, comment par exemple une chose serait-elle grande par une petite partie de la grandeur ?63 Or, selon Parménide, il est fatal que la théorie de la participation (methexis) soit entraîne trop de proximité entre les formes et les choses, soit suppose une telle séparation entre celles-ci que les formes ne soient plus d’aucun secours pour penser les choses. Parménide écrase ou distend notre triangle. D’autre part, la seconde partie du dialogue est un exercice dialectique dans lequel entrent en concurrence deux logiques dialectiques opposées, l’une favorisant la communication entre les formes, l’autre la refusant, cette dernière option étant représentative de l’éléatisme. Pour ce qui est de la première série d’objections, elle atteint un point particulièrement intéressant lorsque le jeune Socrate tente de se sortir des premières apories par lesquelles Parménide a ruiné la possibilité pour la forme de rester une en étant dispersée parmi les choses, en invoquant l’idée du modèle et de la copie. Les formes seraient des modèles (paradeigmata) dont les choses sensibles seraient les images, à la ressemblance des premières : la participation aux formes se ferait par un rapport d’image à modèle (132d1-4). Or, c’est bien un tel statut de modèle que nous conférons aux formes depuis l’Euthyphron. L’image de la ligne, en République VI, a explicité qu’il s’agissait d’un rapport de modèle à image ou copie (VI, 509e-510a), et que cette relation était une relation de ressemblance. Parménide montre que pour établir la participation malgré la séparation des choses et des formes, il faut établir entre celles-ci un type de relation qui est par ailleurs posé par une forme. Il y a ressemblance entre les choses et les formes, et, par ailleurs, nous avons posé une forme de la ressemblance et une de la dissemblance pour expliquer le fait que les choses soient dissemblables ou semblables (Parménide 129a). C’est alors la catastrophe : ayant posé une forme pour faire l’unité des choses semblables, s’il apparaît que les choses sont semblables à la forme à laquelle elles participent, la ressemblance étant réciproque, il se trouve alors que la forme elle-même est une chose ressemblante, et qu’une nouvelle forme peut être posée pour faire l’unité de ce nouvel ensemble de choses ressemblantes, constitué de toutes les choses sensibles précédemment unifiées par la première forme, et de cette dernière. Et ainsi de suite à l’infini. Et il en ira de même pour toute forme : ainsi les choses grandes devront ressembler à une forme de la grandeur, elle-même grande,
63 Parménide 131a4-132c12. Ce passage inclut deux tentatives infructueuses du jeune Socrate de sortir du piège tendu par Parménide : comparer la forme au jour qui tombe sur une multiplicité de choses tout en restant un (131b3-132b2), faire de chaque forme une pensée qui n’existe que dans la pensée (132b3-132c12).
platon160p_V2.indd 86 13/10/10 10:35:30
87
laquelle sera susceptible d’être prise dans une nouvelle totalité unifiée par une autre forme, etc. Cet argument, exposé par le personnage de Parménide (132d5-133a10), est celui que la tradition a retenu sous le titre d’« argument du troisième homme ». Bien que Platon l’ait lui-même placé dans la bouche de l’un de ses personnages, la postérité, à commencer par Aristote64, semble avoir cru que c’était là une aporie à laquelle la théorie platonicienne était vulnérable. C’est pourtant un argument dont Parménide et Socrate tirent ensemble la conclusion qu’il ne faut pas penser la participation sur le mode de la ressemblance. Une solution est de ne pas accepter que la relation de modèle à copie soit une relation de ressemblance réciproque, comme celle que l’on peut trouver entre des choses dont la ressemblance est fondée sur des descriptions homogènes. Or nous savons que la position d’une forme détruit l’homogénéité des descriptions : les choses unies par une forme ont un modèle qui ne leur ressemble pas, parce qu’il ne peut être décrit comme elles peuvent l’être, mais seulement pensé. Nous verrons du reste que le dispositif ontologique du Timée permet de penser le rapport au modèle par delà le modèle de la ressemblance réciproque. Il y a néanmoins un point sur lequel l’objection parménidienne est très forte : sur le fait de laisser le moindre caractère défini par une forme devenir commun aux choses sensibles et aux formes. Nous pouvons tenir pour toutes les formes que, malgré les expressions par lesquelles Platon désigne le « le beau qui n’est que beau », la forme de la beauté n’est pas belle au sens où une chose est belle : l’unité de toutes les choses belles n’est pas belle à la manière dont elle rend belles les choses belles. Le pouvons-nous pourtant pour toutes les formes ? Ne venons-nous pas d’accorder l’existence aussi bien aux formes qu’aux choses sensibles ? Au moins, la solution de Timée avait l’avantage de nous débarrasser du problème : seules les formes existaient. Mais si nous choisissons cette voie, nous revenons au partage éléate strict entre l’être et le non-être. Comment parvenir à séparer les choses et les formes, sans pour autant faire basculer l’un des deux termes dans le néant ? Or pour cela ne faudra-t-il pas leur accorder l’être comme prédicat commun et ouvrir ainsi la porte à une régression à l’infini ? On peut voir la trace de ce problème et la proposition d’une solution dans un texte fameux de la République où Socrate détache une forme de toutes les autres, celle du bien, dont il nous dit qu’elle est pour l’intelligible l’équivalent du soleil dans le sensible. Or, affirme-t-il, la forme du bien procure à celui qui connaît la puissance de connaître et à ce qui est connu l’être vrai (alêtheia) : elle est la cause de la science et de la vérité de ce qui est connu (VI 508e1-4). Or cela implique, que de la même manière que le soleil est la cause de l’existence des choses sensibles et de notre capacité à les voir, le bien soit aussi cause de l’être même des formes : du bien les intelligibles reçoivent non seulement la capacité d’être connus mais encore « l’existence (to einai) et la réalité (hê ousia) » (VI 509b7-8). Or ce bien doit dès lors être déclaré ne pas relever de la réalité (ousia), mais être « au-delà de la réalité 64 Sur les formes, in Alexandre d’Aphrodise, Commentaire sur la Métaphysique d’Aristote, 83, 34 – 85,13.
platon160p_V2.indd 87 13/10/10 10:35:30
88
(epekeina tês ousias) », supérieur à celle-ci en pouvoir et en dignité (VI 509b8-9). Cette étrange doctrine trouverait une explication naturelle dans l’aporie placée par Platon dans la bouche de son personnage Parménide : il semble que la seule façon d’empêcher les formes et les choses sensibles de tenir l’être de la même forme, ce soit de donner aux intelligibles une autre cause à leur être, une cause qui soit elle-même au-delà de l’existence de telle sorte qu’il ne puisse être question de tenter de la placer dans un ensemble de choses existantes attendant une nouvelle forme pour les unifier. Le bien au-delà de l’être, c’est la seule manière de gagner sur les deux tableaux contre l’éléatisme : continuer à admettre aussi bien les choses que les formes dans l’existence et enrayer toute tentative de régression à l’infini sur le terrain de l’être. Maintenant que nous sommes parvenus à maintenir la double possibilité d’une distinction et d’un rapport entre modèles et choses qui leur ressemblent, il nous reste à éprouver que cette défense est solidaire de celle d’un rapport entre les formes elles-mêmes. Après avoir traversé la série d’objections avancées par le maître d’Elée, nous pouvons aborder la deuxième partie du dialogue, dans laquelle Parménide soumet le jeune Socrate à un exercice dialectique : ce dernier devrait s’entraîner à l’argumentation avant de poser des formes intelligibles pour chaque type de choses (135c8-d6). L’exercice comporte huit « hypothèses » sur l’unité et la multiplicité. On se demande par exemple : « s’il est un (ei hen estin) » (137c4), c’est-à-dire si quelque chose participe à l’unité, que se passe-t-il, quelles conséquences en découlent ? Quelles autres propriétés cette chose pourra-t-elle ou ne pourra-t-elle pas posséder ? On voit qu’il s’agit d’un exercice d’inclusion ou de refus d’inclusion, c’est-à-dire de construction et de destruction de rapports entre des formes : par hypothèse, si être un entraîne d’autres propriétés, c’est que l’unité fait partie de formes plus grandes ; si être un entraîne l’interdiction d’autres propriétés, c’est que l’unité est opposée à une forme qui inclut de nombreuses autres formes65. Il s’agit d’un exercice de grande ampleur : quatre fois on posera cette hypothèse, pour voir ce qui s’ensuit pour l’un comme pour les autres choses ; quatre fois on la niera, pour voir ce qui s’ensuit pour l’un comme pour les autres choses. Pourquoi quatre fois ? Deux fois n’auraient-elles pas suffi dans chaque cas, une fois pour tirer les conséquences pour l’un et une fois pour l’autre ? C’est que deux logiques dialectiques sont mises en concurrence. L’ensemble de ces hypothèses est comme un laboratoire où sont mises à l’épreuve deux façons de comprendre l’unité dans son rapport au multiple : soit en la posant comme une unité radicale qui n’a part à aucune multiplicité ; soit au contraire comme une unité qui peut communiquer avec la multiplicité. Dès lors, chaque hypothèse doit être développée deux fois, une fois selon chaque logique, afin que l’on puisse voir à leurs conséquences laquelle des deux mérite de passer victorieusement le test dialectique. Pour saisir le sens de cette mise à l’épreuve, nous nous pencherons sur le premier dyptique, où les déductions sont les plus complètes. Deux séries tirent les 65 Être un homme politique implique d’être un animal, mais pas réciproquement ; ne pas être un animal, en revanche, implique de ne pas être un homme politique, mais pas réciproquement.
platon160p_V2.indd 88 13/10/10 10:35:30
89
conséquences du fait qu’il y ait quelque chose qui soit un : la première avec une conception radicale de l’unité, qui n’accepte aucune forme de multiplicité (137c3-142a8) ; la seconde en acceptant que l’unité ait part à la multiplicité (142b-155e). L’enjeu est de savoir quel type de conception du rapport entre les objets de notre pensée est compatible avec l’élaboration d’un savoir et la transmission de celui-ci. Selon la première hypothèse, on doit concéder que si quelque chose participe à l’unité, alors il faudra nier de cette chose une série d’autres participations : la participation à l’un interdit la participation à toute une série de formes, qui elles s’impliquent toutes en cascade, jusqu’à devoir récuser la participation au temps et à l’être. Ainsi, s’il est un, il ne peut avoir de parties et donc il ne peut être un tout (car, comme nous l’avons vu lors de la réfutation des doctrines unitaires dans le Sophiste, le tout est ce à quoi aucune partie ne manque ; le tout est donc plusieurs66) ; s’il ne peut avoir de parties, il ne peut avoir de commencement, de fin ou de milieu, et donc il ne peut avoir de limites, il est illimité, sans commencement ni fin ; il ne peut donc avoir de figure – participer du rond ou du droit, qui sont deux formes dotés de limites dans l’ordre de l’espace cette fois-ci : le circulaire étant ce dont les extrémités sont en tout point à égale distance du milieu et le droit ce dont le milieu est au milieu des deux extrémités. Sans figure ni limite il ne saurait être nulle part : il ne peut ni être en autre chose (il faudrait pouvoir être encerclé par quelque chose et avoir de nombreux points de contact avec cette chose en des points variés) ni en soi (on ne peut s’envelopper soi-même) ; il en découle qu’il ne peut être ni en mouvement – ce qui supposerait soit de pouvoir devenir autre que soi (donc plusieurs), soit simplement de pouvoir changer de lieu, et donc de pouvoir au moins en occuper un (l’impossibilité de pouvoir faire cette dernière chose excluant aussi tout mouvement de rotation sur place) – ni en repos (il faudrait pour cela pouvoir rester en place) (Parménide 137c3-139b3). Une fois parvenus à ce premier résultat, il nous faut tenter de déduire de là que ce qui est un ne pourrait pas être autre (heteron) ni même (tauton) qu’autre chose ou que lui-même (139b4-5). Le premier couple ne pose pas de problèmes : la chose qui est « une » ne peut être autre qu’elle-même, car elle ne serait plus une, et si elle était la même qu’une autre, elle serait cette autre et ne serait plus elle-même. Pourquoi, néanmoins refuser qu’une chose une soit autre que les autres et même qu’elle-même ? Pourquoi la tour Eiffel ne serait-elle pas à la fois identique à elle-même et différente de tous les autres monuments tout en étant une chose une ? Parménide le refuse pourtant, à l’aide d’un étrange raisonnement : être « autre qu’un autre » et « même que soi-même » n’est pas possible pour l’un, car seul l’autre est autre et seul le même est même. Parménide fait comme si accorder l’altérité ou l’identité à ce qui est unique signifiait que le caractère de l’unité soit devenu la même chose que le caractère de l’identité ou de l’altérité, que la « nature de l’un » soit désormais la même que celle « du même » (139d2-3). C’est en effet la
66 Sur ce point voir Sophiste 244e-245e.
platon160p_V2.indd 89 13/10/10 10:35:30
90
condition requise pour que dès lors, devenir « même » signifie aussi devenir « un », pour toutes les choses qui deviennent identiques. Or c’est impossible, affirme-t-il, car « lorsqu’une chose devient la même qu’une autre, elle ne devient pas une » (139d3-4). Parménide est donc passé de la chose une dont on parlait précédemment (et dont on pouvait se demander si elle pouvait aussi, en plus d’être une, être quelque part, avoir des parties, etc.) à l’unité même qui n’est qu’unité et qui, en tant que telle, ne donne aux choses qui la reçoivent que l’unité. Nous pouvions déjà remarquer à l’occasion de l’objection sur les parties de la forme que Parménide ne semblait pas différencier les relations de participation des autres modes de relation. Or il requiert maintenant des choses unes qu’elles se comportent de la même manière que la nature de l’unité, en étant rien d’autre qu’unes – sans être identiques ni différentes. L’être n’est plus que l’être soi, et rien d’autre que soi, que l’on soit une chose ou une propriété. Parménide ressemble à ces jeunes gens et à ces vieillards qu’évoque le Sophiste : des jeunes qui s’exercent à débattre et des vieux qui sont venus tard sur les bancs fourbissent leurs premières armes en se jetant sur l’idée qu’il est impossible que le multiple soit un et que l’un soit multiple. Or tous prennent plaisir « à ne pas permettre que l’homme soit dit bon, mais seulement que le bon soit dit bon, et l’homme, homme » (251b8-c2). Nous reconnaissons aussi la logique de l’éléatisme réfutée dans le Sophiste : une logique qui doit refuser que l’être soit un s’il l’on veut qu’il soit, ou que l’un soit, s’il l’on veut qu’il reste un. Or nous verrons que le platonisme est au contraire fondé sur le refus d’une telle logique de l’identité aussi bien pour les choses que pour les formes . Contrairement à ce que pourraient laisser entendre certaines formules, la beauté en soi n’est pas que belle, pas plus que la belle jeune femme n’est que cela – nous verrons bientôt en quel sens cela est possible. Vérifions pour l’heure les conséquences de la logique de l’identité et de l’isolement de l’unité. Parménide tire la conclusion où l’entraîne son étrange raisonnement : si l’un doit être même que lui-même il ne sera plus un avec lui-même, puisqu’il sera déjà deux choses. On peut dès lors en déduire encore qu’il ne peut être ni semblable (homoion) ni dissemblable (anomoion) ni à lui-même ni à un autre, ni différent (139e7-8). Un être un aussi radicalement posé dans son unité, refusera en outre de se prêter à l’égal et l’inégal – il n’est égal ni inégal ni à lui-même, ni à un autre. Il ne participera de l’égalité et de la ressemblance, ou de l’inégalité et de la dissemblance ni sous le rapport de la taille (grandeur, petitesse, égalité de taille), ni sous celui du temps (plus jeune, plus vieux, du même âge). Il n’est donc pas dans le temps, on ne peut dire de lui qu’il était, qu’il est devenu, qu’il est, qu’il devient, qu’il sera, qu’il deviendra : il ne participe à aucun de ces temps et il ne participe à l’être en aucune manière, car comment pourrait-on participer à l’être sinon en ayant été, en étant ou devant être ? Donc l’un n’est pas, il ne peut être nommé, défini, connu, perçu et, conclusion, il n’a même pas assez d’être pour être un. L’un qui se refuse à tout mélange, à toute forme de multiplicité, aussi bien interne que de rapports, est une unité que l’on ne peut penser et avec laquelle le savoir meurt.
platon160p_V2.indd 90 13/10/10 10:35:30
91
Que nous apprend donc cette catastrophe ? Qu’il nous faut savoir faire des différences entre les choses et leurs propriétés, afin de ne pas compter les propriétés au nombre des choses, et les choses au nombre des propriétés, d’une part ; qu’il nous faut savoir penser la relation et le mélange, d’autre part. Il faut savoir penser la séparation et le mélange de ce qui est séparé. Le même Parménide en fait la démonstration dans la deuxième déduction (142b-155e) en obligeant cette fois l’un à accepter toutes les participations qui lui viendront nécessairement s’il est – être, voilà une chose qu’il ne saurait faire sans participer à la réalité (ousia) (142b6). Dans un premier temps (142b-143a), Parménide déduit de cette situation l’idée que l’un doit alors recevoir une multiplicité de rapports de participation. Si l’un est, il faut admettre que l’être de l’un est autre chose que son unité, sinon il reviendrait au même de dire l’un est ou l’un est un. Or il s’agit bien désormais d’explorer justement l’hypothèse : si l’un est, et non plus la précédente, à savoir : si l’un est un. Or, si l’un est, c’est-à-dire s’il participe à l’être, il doit avoir des parties, avance Parménide. Être, c’est accepter plusieurs prédicats : si être et un se disent de l’un qui est, et si son être et son unité sont des choses différentes, alors l’un qui est devient un tout dont l’un et l’être sont des parties. Or ces parties sont inséparables, et, en un sens, on peut dire qu’elles se contiennent l’une l’autre : l’un contient toujours l’être, et l’être l’un, et chacune des parties de parties de chacun d’eux de nouveau, et ceci à l’infini (tout ce qui est sera un et tout ce qui est un sera). L’un serait donc une « pluralité infinie (apeiron) (143a2) » que Parménide déroule jusqu’à retrouver tous les prédicats qui avaient été exclus dans la première hypothèse, et c’est enfin de la participation au temps que l’on peut déduire pour l’un le fait qu’il participe à l’existence, et qu’il peut y avoir science, opinion et sensation à son propos : on peut le nommer et l’exprimer (155e). La possibilité de la science suppose l’existence d’une pluralité infinie au sein de laquelle on puisse commencer à diviser et rassembler des unités-multiples. L’échec de la première déduction, qui est l’échec de l’éléatisme lui-même, manifeste la nécessité, pour qu’une science et un discours soient possibles, de distinguer radicalement les deux types d’ingrédients du mélange, à savoir les propriétés et les choses qui les reçoivent, et distinguer la façon dont elles sont ce qu’elles sont. Seule cette séparation nous met à l’abri de l’objection du troisième homme, car il ne saurait être désormais question d’attribuer à la même cause la façon dont une forme comme celle de la grandeur est la nature même du grand et la façon dont les choses grandes, qui la reçoive, le sont. Il devient alors possible, en pensant la façon dont les propriétés communiquent entre elles et participent les unes aux autres, de penser la façon dont les choses sont susceptibles d’avoir telles ou telles propriétés lorsqu’elles en ont déjà telles ou telles autres. Nous sortons d’un difficile combat avec l’éléatisme. L’ontologie des menuisiers a gagné son droit à l’existence dans cette épreuve. Ce sera plutôt une philosophie d’artisan bronzier : une philosophie du mélange. Elle seule nous donnera la
platon160p_V2.indd 91 13/10/10 10:35:30
92
clef pour déterminer la façon dont les ensembles de choses se rapportent exactement les uns aux autres.
§ 4. L’alliage ontologique : les règles du mélange
Reprenons en effet le fil de la discussion platonicienne des grandes thèses sur la nature de l’être dans le Sophiste. Une fois l’ensemble des thèses présocratiques réfutées, l’étranger pose lui-même à nouveau frais la question de l’être. Or elle prend désormais un visage très différent. Comme dit l’étranger : « ou tout consent, ou rien, ou ceci consent et cela se refuse à se mélanger (summeignusthai) » (252e1-2). La question de l’être est en réalité la question du mélange. Au terme de l’examen de la gigantomachie, qui a permis de renvoyer dos à dos ces deux partis opposés qui faisaient soit de l’immobilité soit du mouvement le contenu même de l’être, il a été reconnu que l’on ne pouvait conclure qu’il n’y ait que repos (car la pensée même est un mouvement) ou qu’il n’y ait que mouvement (car la pensée, elle encore, suppose aussi la stabilité, un arrêt dans le mouvement) (249b). Arrivé à ce point l’étranger a employé une analogie pour faire comprendre à Théétète la situation dans laquelle ils se trouvent : les questions qu’ils se posent maintenant sont les mêmes que celles qu’ils ont posées plus tôt à « ceux qui disent que le tout est chaud ou froid » (250a1-2) – qu’est-ce que l’être ? S’agit-il de quelque chose de plus outre le chaud et le froid (243d-e) ? En effet le repos et le mouvement sont « tout à fait opposés l’un à l’autre » (250a8-9), et, en leur accordant l’être, à l’un et à l’autre, on ne leur accorde ni le mouvement, ni le repos – donc l’être est bien un tiers « posé dans l’âme » à côté des deux autres : c’est une forme comme les deux autres, tout simplement. L’âme rassemble le repos et le mouvement, en tant que ceux-ci sont enveloppés sous l’être, et les contemple sous le rapport de leur communauté (koinônia) avec celui-ci, c’est-à-dire avec la réalité (ousia) : c’est de cette manière qu’elle les appelle des êtres (b7-9). Le repos et le mouvement sont, mais l’être est autre chose que la simple somme du repos et du mouvement pris ensemble, il est quelque chose d’autre qu’eux, il n’est « en vertu de sa nature propre » (c3-6) ni l’un ni l’autre : il y a des choses en repos, des choses en mouvement, des choses qui sont, ce sont là trois natures différentes. Ainsi nous attribuons l’être à trois formes : chacune doit être, indépendamment des autres, car chacune donne aux choses qui participent d’elle une propriété spécifique. Nous commençons à voir qu’une forme, en dehors de la nature qu’elle définit – le repos même, le mouvement même – , peut aussi avoir d’autres propriétés, à commencer par celle d’exister. Or les relations entre formes définissent immédiatement aussi des relations entre les choses qui y participent. Il semble en effet qu’il n’y ait rien qui ne soit ni en mouvement ni en repos : si en effet quelque chose ne se meut pas, comment ne pourrait-ce pas être en repos (c12-d1) ? Et, inversement, ce qui est en aucune façon au repos, comment pourrait-ce ne pas être en mouvement
platon160p_V2.indd 92 13/10/10 10:35:30
93
(d1-2) ? L’ensemble des choses qui sont est découpé sans reste possible entre l’ensemble des choses en mouvement et celui des choses en repos. Ainsi, lorsque l’on statue sur le rapport qu’il y a entre des formes, en parlant de leur communauté, c’est-à-dire de la façon dont elles se prêtent ou se refusent au mélange mutuel, on peut en déduire immédiatement des conséquences sur la façon dont les choses qui participent à celles-ci peuvent ou non combiner ces participations – le mélange des formes permet de connaître celui des choses. L’absence de communication entre les deux formes, entre l’unité du mouvement ou du repos, l’unité de la multiplicité des choses en mouvement et celle de la multiplicité des choses en repos, implique que les choses ne peuvent, sous le même rapport, participer simultanément à ces deux formes. Par ailleurs, on le voit bien, « communiquer » ne signifie pas, pour une forme, devenir quoi que ce soit d’autre qu’elle-même : c’est certes manifester une propriété à côté de cette nature propre qu’elle est fondamentalement sans la recevoir (ainsi le mouvement « est », en plus d’être le mouvement même, c’est-à-dire l’unité de toutes les choses mouvantes), mais aussi, par là-même, imposer à ses participants une autre participation ou l’exclure. Penser la communauté des formes, c’est penser une grammaire de la participation qui s’impose aux choses qui participent à celles-ci. Le repos « est » : cela implique qu’on ne peut le recevoir sans recevoir l’être (or le repos ne saurait cesser d’être, puisque les formes ne cessent jamais d’exister). Deux hypothèses symétriques doivent être exclues (251d-e) : que les choses soient incapables de participation mutuelle ou qu’elles puissent se mélanger indistinctement toutes ensemble (251d7-9). De la première option il découlerait que le repos et le mouvement n’auraient pas participation à l’existence. En conséquence les choses en repos comme les choses en mouvement n’existeront plus. Mais à ceux qui ouvrent une communication sans limites arrivent aussi de drôles d’aventures (252b-d). Il ne reste dès lors que la troisième hypothèse, selon laquelle certaines choses se mélangent et d’autres non, et toujours d’une manière bien définie, à la manière dont certaines lettres se combinent pour faire des mots, alors que d’autres combinaisons ne donnent rien : parmi les formes, certaines « consentent à une communauté mutuelle », d’autres non ; parmi celles qui l’acceptent, on peut distinguer des degrés : certaines l’acceptent seulement avec quelques- unes, d’autres avec beaucoup, et d’autres enfin « traversant tout », ne trouvent « rien » qui les « empêche de communiquer avec toutes » (254b8-c1). L’étranger prévient qu’il ne s’agit pas de faire cet examen pour toutes les formes, « afin de ne pas nous retrouver, au milieu d’une multitude, dans la confusion » : on se contentera d’en prélever quelques-unes parmi « celles que l’on nomme les plus grandes », c’est-à-dire celles qui unifient les plus grandes masses de choses ; on définira alors « ce qu’est chacune » puis « quelle part elle est à la capacité mutuelle de communiquer » (c2-5). Il faut bien noter ces expressions : le fait d’avoir sa nature propre, inaltérable, n’empêche en rien une forme de communiquer avec d’autres formes, de participer à d’autres formes, et, par là-même, nous l’avons dit, de faire en sorte que les choses qui
platon160p_V2.indd 93 13/10/10 10:35:30
94
y participent se voient aussi imposer de participer à d’autres formes. Si deux formes communiquent ou « participent » l’une à l’autre, cela signifie qu’il y aura, pour les choses, un lien entre le fait de participer à l’une et le fait de participer à l’autre. En l’occurrence, il s’agit d’un lien nécessaire : on ne peut participer à l’une sans participer à l’autre. L’enquête se concentre sur les plus grands des genres qui sont l’être, le repos et le mouvement. Or ces deux derniers refusent le mélange, comme cela a été dit plus haut, ce sont des formes tout à fait opposées, ce qui signifie que ce qui est en repos (absolument parlant) ne peut être en mouvement et vice versa. Ainsi le repos et le mouvement sont exclusifs. Mais la forme (idea) de l’être (tou ontos) (254a8-9) se mêle aux deux : le disciple de Parménide est désormais bien émancipé – nous nous souvenons que dans la première déduction, cette circulation de l’un qui est vers le même et l’autre était précisément ce qu’avait refusé Parménide. Cela fait déjà trois êtres, chacun identique à lui-même et différent des autres. « Identique » et « différent » ? Sont-ce là simplement des mots nouveaux, ou avons-nous affaire à deux nouveaux êtres ? Ce ne sont certes pas deux autres noms pour le repos et le mouvement, car si le repos (ou le mouvement) était le « même » ou « l’autre », il transmettrait aussi cette autre nature à toute chose venant participer : « le mouvement s’immobilisera et le repos sera mu ; qu’à leur couple en effet, l’un quelconque d’entre eux se vienne appliquer, il contraindra l’autre à changer sa nature propre en la nature contraire, puisqu’il le fera participant de son contraire » (255a10-b1). Voilà donc deux êtres, le même et l’autre, l’être soi-même et l’être autre (254e5-255a1), auxquels le repos et le mouvement « participent » (b3) tous deux, sans pourtant être identiques à ces deux formes. Mais sont-ils différents de l’être ? De même l’être ne peut être identique au même, car dès lors, être serait, pour les choses qui sont, être le même : elles seraient le même en tant qu’elles sont (c1). Il faut bien comprendre ici qu’il s’agit de l’identité et non de la ressemblance (le fait de partager des qualités communes) : être une même chose et non une chose similaire. Qu’en est-il de l’autre et du fait d’être autre chose qu’une autre chose ? Avec le même et l’autre, c’est la différence entre la prédication absolue et la prédication relative qui apparaît : « les êtres se disent toujours, les uns en eux-mêmes, les autres relativement » (c12-13). L’autre ne se dit que relativement : il est la forme même de la relation et la qualité d’être autre est purement relative. C’est une forme supplémentaire, une cinquième forme à reconnaître à côté des quatre précédentes. Et cette forme de l’autre est répandue à travers toutes les autres : chacune est autre « non par sa nature propre, mais par le fait qu’elle participe à la forme de l’autre » (e4-6). D’un point de vue de grammaire des formes, il faut donc admettre que même et autre se comportent quant à eux différemment du repos et du mouvement : ils se répandent à travers tout, simultanément. Chaque chose, comme chaque forme, est à la fois même que soi-même et différente des autres. Il reste à préciser les derniers rapports de communication entre les genres. Le mouvement est absolument autre que le repos, il existe néanmoins, du fait qu’il participe à l’être (256a1), et il est
platon160p_V2.indd 94 13/10/10 10:35:30
95
autre que « le même » dans la mesure où il n’est pas « le même », mais il est « même » en tant qu’il participe au même, puisque tout participe au même. L’être lui-même n’est ni en mouvement ni en repos, mais il est identique à lui-même et autre que les autres : il participe donc au même et à l’autre, qui à leur tour participent d’eux-mêmes et de l’être. L’ensemble des relations de participation de ces cinq genres peut être représenté par le pentagramme suivant :
La direction des flèches grises représente la direction des relations de communication. L’être et le même participent l’un à l’autre, de même l’être et l’autre, et le même et l’autre : ce sont les trois relations réciproques de communication. Le mouvement et le repos participent quant à eux aux trois autres genres, sans ce que cette relation soit réciproque pour aucun d’eux. Enfin, la double flèche noire représente l’absence de communication réciproque entre le mouvement et le repos. Voilà le véritable signe de la victoire sur les objections de Parménide : le fait que l’on puisse aller jusqu’à se permettre d’attribuer des propriétés aux formes et que, ce faisant, on soit en mesure aussi de déterminer la façon dont les choses peuvent participer à ces formes. L’éléatisme, en refusant de différencier ce que c’est qu’être X quand on est la forme du X et quand on est une chose qui possède la propriété X, nous empêchait de penser aussi bien les rapports entre formes que les rapports entre formes et choses participant aux formes. Désormais, en pensant la communication entre les formes, nous pensons en même temps les rapports entre choses et formes. Le pentagramme ci-dessus est en effet susceptible d’une double lecture : il décrit aussi bien les relations de communication entre formes que la grammaire possible des participations pour les choses. Participer à l’une de ces formes, c’est en effet, pour une chose, accepter les rapports de participation décrits par les flèches qui partent de la forme reçue : ainsi par exemple les choses ne peuvent participer
platon160p_V2.indd 95 13/10/10 10:35:31
96
à l’autre sans participer au même et à l’être, ou participer au repos sans participer à l’autre, au même, et à l’être, et ainsi de suite pour chaque forme. Le tableau des communications entre les genres est aussi immédiatement une cartographie des participations possibles pour les choses sensibles : elles ne pourront entrer dans des rapports exclus par ce pentagramme ni éviter ceux qu’il impose. Il est donc bien essentiel que le « même » auquel le repos participe soit bien la même forme que celle à laquelle participent les choses lorsqu’elles sont identiques à elles-mêmes. Mais nous ne risquons là aucun troisième homme : il n’y aurait troisième homme que si le même pouvait recevoir sa propre nature à la façon dont il la donne aux choses qui en participent, qu’il s’agisse d’une forme comme l’être ou d’une chose sensible comme un cheval. Or nous avons radicalement distingué ces formes de prédication : l’être X lorsqu’on est la forme X et lorsque l’on est la chose qui a la propriété X. C’était une des leçons de la deuxième partie du Parménide, comme nous l’avons vu, et elle protège désormais la philosophie du mélange contre les objections du maître d’Elée.
§ 5. L’artisan au fondement de l’ordre du monde
Il reste à compléter la réponse platonicienne à la question de l’être, c’est-à-dire à la question de l’ameublement du monde : qu’y a-t-il, en quelle quantité et de quelle nature ? L’ensemble de ce qui existe est un mélange réglé, à deux niveaux, l’un sensible et l’autre intelligible. C’est une première perspective qui permet de penser horizontalement la grammaire propre à chaque niveau. La description des ingrédients de la réalité doit néanmoins être complétée par une perspective verticale statuant sur la nature de chacun des niveaux. Il faut dès lors se tourner vers le Timée, où s’exprime la victoire philosophique de l’artisan. Platon soumet le discours sur l’origine de l’univers, cet objet par excellence du prestigieux discours des philosophes présocratiques, à l’hypothèse artisanale, en déployant l’idée que le monde tient son ordre de la simple mise en forme d’un artisan – comme une poterie. Platon compare son artisan cosmique à de nombreuses formes d’activité technique : métallurgie, construction, poterie, peinture, modelage de la cire, tressage, agriculture67. On note l’insistance sur les arts qui ont affaire à des ingrédients, qu’ils doivent fondre, agencer, mélanger, tresser. Il en sort une représentation des ingrédients qui composent la réalité de l’univers. L’un des types de choses qui existent est « le genre qui reste identique à soi-même, inengendré et indestructible, ne recevant en lui-même rien d’autre venant d’ailleurs et n’entrant pas lui-même en autre chose où que ce soit, invisible et imperceptible par un autre sens – voilà ce qui a échu à l’intellect comme objet d’intellection » (52a1- 52a4). La réponse à Parménide comme à tous ceux qui voudraient imaginer que la forme s’adjoint réellement aux choses qui en participent est nette : la forme ne reçoit rien, n’entre en 67 Voir le recensement de ces activités par Luc Brisson, Le même et l’autre dans la structure onto-logique du Timée, Paris, Klincksieck, 1974, p. 35-50.
platon160p_V2.indd 96 13/10/10 10:35:31
97
rien et par conséquent elle ne se divise pas en autant de parties qu’elle offre de parts sensibles d’elle-même. Elle est un modèle, objet de pensée, et rien d’autre. Il y a un deuxième type de choses : « le deuxième genre est homonyme et semblable (homoion) au premier, mais perceptible, engendré, toujours en mouvement, venant à l’existence en un lieu donné et de ce lieu encore disparaissant, saisi par l’opinion accompagnée de sensation » (52a4-7). On conserve donc le modèle de la ressemblance, mais on travaille à rendre cette relation asymétrique par l’inscription de la plus grande distance possible, et c’est l’introduction d’un troisième genre de chose qui permet cela68. L’image, en tant qu’elle est le « fantôme fugitif de quelque chose d’autre » ne peut exister qu’en autre chose que ce dont elle est image. Il faut donc donner un lieu à l’image pour qu’elle se produise. Cela nécessite l’introduction d’un troisième genre, qui, comme le premier, existe toujours et qui est celui « de l’emplacement (khôra) », « qui n’admet pas la destruction mais procure un lieu à toutes les choses qui naissent » (52a8-b1). Cette dernière réalité n’est accessible qu’au terme d’un raisonnement altéré (b2)69, où une forme de rêve les yeux ouverts se substitue à la sensation. L’existence d’une telle réalité s’impose en effet à nous lorsque nous nous faisons la réflexion qu’il « est nécessaire que tout ce qui est soit dans un lieu (topos) donné et occupe quelque place (khôra), or rien n’existe qui ne soit sur terre ou quelque part dans le ciel » (52b3-5). Il nous faut bien postuler ce matériau, cette étoffe des choses qui leur donne un lieu et une consistance. Reflet de l’intelligible dans un réceptacle pensé sur le modèle de la cire du copiste ou de l’onguent du parfumeur, l’être en devenir, malgré sa ressemblance, ne partage aucune caractéristique commune avec son modèle – sinon l’existence quand il trouve à s’y maintenir quelque peu. Nous savions déjà qu’un modèle technique de la réalité devraient avoir, outre l’artisan lui-même, trois pôles et non deux : nous avions développé le triangle paradigmatique en un losange. Or nous retrouvons bien les trois termes auxquels l’artisan fait face dans cette figure : le modèle, le matériau, la copie. Dans le Philèbe, Socrate en vient aussi à proposer une division de ce qui est, où nous allons retrouver trois termes comparables (une fois mise de côté, à nouveau, l’équivalent de l’artisan, à savoir la cause du mélange) : « tout ce qui existe maintenant dans l’univers, divisons-le en deux, ou plutôt, si tu veux, en trois » (23c4-5). C’est un don des dieux qui nous a été fait, que de savoir qu’il y a « dans les choses qui sont », à la fois de l’illimité (apeiron) et de la limite (peras) (23c9-10). À côté de ces deux premiers types de choses, il faut en poser un troisième, « constitué du mélange des deux premiers types
68 Sur ce point, lire l’article éclairant de Luc Brisson, « La participation du sensible à l’intelligible chez Platon », in Platon, les formes intelligibles, coordonné par J.-F. Pradeau, Paris, PUF, 2001, p. 55-85. Voir en particulier p. 74.69 On appelle souvent ce raisonnement « bâtard », en optant pour une traduction littérale de l’ad-jectif nothos qui désigne en effet l’illégitimité de la naissance, mais aussi, au figuré, le fait d’être corrompu, altéré.
platon160p_V2.indd 97 13/10/10 10:35:31
98
de choses » (23d1). L’illimité, c’est ce qui n’accepte aucune mesure. Il s’agit de ces phénomènes comme le « plus chaud » et le « plus froid » qui poussent à son comble cette capacité de recevoir en même temps les contraires qui caractérisent les choses de ce monde. Ce sont là des déterminations relatives qui impliquent toujours en même temps l’excès et le défaut : le « plus chaud » est toujours plus chaud que chaud mais moins chaud qu’encore plus chaud. Dans le « plus chaud » et le « plus froid » il y a donc toujours le plus et le moins présents dans la chose même que l’on dit plus chaude ou plus froide (24b4-5) : il est impossible de distinguer l’ensemble des choses « plus froides » de celui des choses « plus chaudes ». Il en va de même pour « fortement » ou « doucement », « plus sec » et « plus humide », « plus abondant » et « moins abondant », « plus rapide » et « plus lent », « plus grand » et « plus petit » (25c8-10), pour l’aigu et le grave, le rapide et le lent (26a2-3). L’infini est l’ensemble des processus qui se produisent sans atteindre une mesure déterminée et restent simplement toujours en excès et en défaut sur eux-mêmes, toujours en mouvement vers le plus et le moins, de telle sorte que l’indistinction entre les deux ensembles de choses contraires soit totale. On contraire, on placera l’égal et l’égalité, le double et tout ce qui instaure un rapport d’un nombre à un autre, de mesure à mesure (25a7-b1), dans le genre de la limite. Or comment produisent-ils ce rapport ? La limite a pour vocation de s’imposer à l’illimité et d’y produire la mesure. Par là, l’égal et le double « font cesser l’opposition mutuelle des contraires et les rendent commensurables et harmonieux en y produisant le nombre » (d11-e2). Dès lors, ces choses contraires se distinguent et acceptent de se mélanger d’une manière telle « qu’adviennent à partir de chacune d’elles des genèses » (e3-4), c’est-à-dire que le mouvement de passage de l’une vers l’autre soit possible. Les choses qui jusqu’ici courraient dans tous les sens sans ordre entrent dans une juste combinaison (koinônia) : c’est d’une telle combinaison que naît, dans la maladie, la santé (e7-8). De même, lorsque, dans des choses qui relèvent du genre de l’illimité, comme l’aigu et le grave, le vite et le lent, adviennent de telles combinaisons, alors naissent « toutes les formes de musique (26a2-a4) » ; c’est de l’apparition de ce juste mélange au sein du froid et du chaud que naissent aussi les saisons (a6-b3). Voilà bien le troisième genre de choses : « l’unité de tous les rejetons des deux autres : il s’agit d’une venue à l’existence (ousia) produite par les mesures introduites par la limite » (d7-9). Nous comprenons ce qui fait cesser la coprésence des contraires dans les choses sensibles ou la cantonne à un niveau inoffensif, comme dans le cas de nos doigts, qui, tout en restant des doigts, ne cessent jamais d’être à la fois petits et grands. Ce ne sont plus dès lors que des effets superficiels qui ne remettent pas en cause le fait que nous ayons affaire à des choses constituées par un processus qui, à un moment donné, a atteint sa mesure : une fois constitué, le doigt ne sera plus, en même temps, non-doigt. Par cette pensée du mélange, nous sommes en train de comprendre comment viennent à être les choses que l’on peut penser. Il est intéressant
platon160p_V2.indd 98 13/10/10 10:35:31
99
que le Philèbe nous amène en outre à définir ce que la limite produit dans l’illimité sous la forme d’une mesure, d’une harmonie. La tripartition du Timée, qui recouvre celle du Philèbe, permet aussi de faire apparaître ce qui est produit dans le matériau à la ressemblance de l’intelligible comme l’effet d’une mise en ordre, d’une harmonisation, au moyen de figures et de proportions mathématiques70. C’est sous la forme de la mesure, de la mise en ordre, que l’intelligible est traduit dans le sensible. Ce ne sont pas les formes qui entrent dans le sensible, mais les formes d’ordre qui, elles, tout en se tenant sous les apparences, constituent le monde visible tel que nous le voyons71. C’est parce qu’un ordre mathématique est à son fondement que notre monde en vient à ressembler à quelque chose de pensable, et que les choses se distribuent en effet selon différentes formes que l’on peut distinguer. Or l’ordre est typiquement l’effet d’une intelligence agissante, c’est-à-dire de l’art. L’ordre du monde ne fait pas exception. Que l’art consiste à donner mesure et proportion, nous le savions déjà. L’analyse de l’activité productive, dans le Gorgias, l’affirmait. Or c’est bien aussi le propos du Philèbe. Socrate affirme que tout ce qui existe est fait de limite et d’illimité, doctrine dont il nous dit qu’elle nous a été transmise par les anciens qui vivaient plus près des dieux que nous et ont pu recevoir d’eux un tel cadeau, comparable au don du feu par Prométhée (16c). Or, si cette doctrine est aussi importante que le don de Prométhée qui permit aux hommes de compenser par la technique la pauvreté de leur dotation naturelle, c’est parce qu’elle ouvre précisément la route de la maîtrise technique : « tout ce qui a jamais été inventé dans le domaine du savoir-faire, c’est par cette voie que c’est apparu » (c2-3). Découvrir comment une multiplicité indéfinie en vient à pouvoir être limitée par un nombre donné, telle est la méthode par laquelle tous les arts furent recherchés, découverts et enseignés. Nous reconnaissons là aussi la méthode même de la dialectique, celle qui unit l’un et le multiple : or savoir comment la limite et l’illimité constituent toute chose, c’est savoir comment toute chose est constituée d’un et de multiple (16c9). La dialectique et le don des dieux sont une seule et même chose : les arts sont en petit, sur un objet précis, ce que la dialectique est pour l’ensemble de ce qui est – un art de connaître la composition de l’un et du multiple. Socrate prend l’exemple de la grammaire : devenir grammairien, c’est sortir de l’infini des sons possibles pour connaître quelle quantité et quelles différences produisent un sens correct : c’est par là qu’un savoir naît en nous (17b6-8). De même, devenir musicien, c’est en venir à savoir le nombre d’intervalles qu’il y a entre l’aigu et le grave, en connaître toutes les combinaisons, connaître en outre les rapports entre ces harmonies et les mouvements du corps, rapports qui se mesurent par le nombre et que l’on appelle rythmes et mètres. C’est toujours ainsi, dans tous les domaines, que l’on devient savant. Le Timée permet d’étendre cette idée au cosmos tout
70 Timée 29a-b, 32b, 53b.71 Sur la constitution du sensible à partir des figures géométriques, voir notre étude « Activité démiurgique et corrélation des propriétés matérielles, Timée 55e-56b », Etudes Platoniciennes, II, 2006, p. 97-128.
platon160p_V2.indd 99 13/10/10 10:35:31
100
entier. Le récit de Timée déploie en effet un mythe cosmogonique de mise en ordre du monde. À la place du grand Zeus Olympien instaurant un nouvel ordre contre celui imposé par son père Cronos avant lui, un artisan a pris la place du dieu organisateur. Trouvant le receptacle traversé d’un flux sans ordre, il entreprend « de donner un arrangement à l’univers (kosmeisthai to pan) » en donnant aux éléments matériels « une configuration au moyen des figures et des nombres » (53b1-5). Il réalise un mélange parfait en donnant la juste proportion à son matériau, puisque c’est exactement ce que l’artisan sait faire, ainsi que nous l’apprend le Philèbe. Ce démiurge divin est-il un véritable artisan ? Ou la personnification d’autre chose ? Il y a eu beaucoup de discussions sur ce point72. En ce qui nous concerne, nous suivons la ligne d’interprétation qui voit dans la démiurgie du Timée une fonction en réalité assumée continûment par l’âme du monde telle qu’elle est décrite au livre X des Lois, laquelle, par ses droites pensées, entraîne tous les mouvements de l’univers de telle façon qu’ils soient bien accordés les uns aux autres et que la causalité régulière de la nature suive son cours (Lois X, 896e8-897b4). Cette âme savante « administre et habite (diokousan kai enoikousan) » tout ce qui se meut, à commencer par le ciel (896d10-e2). Nous découvrons que le mélange total qui constitue la réalité de tout ce qui existe est du même type que les mélanges que produisent nos activités techniques et que la dialectique nous a appris a manier sous la forme de l’opposition de l’un et du multiple. Cette affinité des choses et de notre pensée tient au fait que cette dernière est le fruit de l’activité d’un élément en nous qui est déjà présent dans les choses. L’univers signale par son ordre l’intelligence de sa cause (Philèbe 28e). Platon a déployé nombre d’arguments contre ses contemporains qui avaient selon lui cessé de croire à l’ordre immanent de l’univers et cesser de lire en celui-ci l’effet d’une pensée plus grande que celle de l’homme73. Le Philèbe présente à ce titre un argument étrange et frappant (29a-30e) : nous admettons que tous les composants de nos corps, le feu, l’eau, l’air et la terre rentrent aussi dans la constitution de l’univers et nous savons que de chacun d’eux nous n’avons qu’une petite partie, pauvre et non pure. Le feu qui est en nous l’est en petite quantité et sous une forme appauvrie. Et nous irions penser que la pensée qui est en nous, elle aussi en petite quantité et sous une forme souvent pauvre, ne serait présente que sous cette forme dans l’univers ? Les formes d’ordre que notre art parvient à produire en imitant l’ordre cosmique des saisons et des mois, seraient les seuls produits d’une intelligence ? N’y a-t-il pas une certaine présomption à imaginer que nous serions les seuls à savoir penser et à savoir mettre en ordre les choses, nous qui ne le faisons que si imparfaitement ? La pensée est en faible quantité et de qualité médiocre en nous, comme les éléments corporels : elle sera plus pure dans le ciel, comme l’est le feu lui-même. Il est temps de nous tourner vers cette réalité que l’on nomme l’âme et qui anime le ciel aussi bien que nos corps, afin de l’étudier à son tour comme nous avons appris à étudier toute réalité : en distinguant des formes.
72 Pour une synthèse, voir Filip Karfik, « Que fait et qui est le démiurge dans le Timée ? », Études Platoniciennes, IV, 2007, p. 129-152, notamment p. 146.73 Le livre X des Lois est dans sa plus grande partie un argumentaire contre cette forme d’athéisme.
platon160p_V2.indd 100 13/10/10 10:35:31
101
En quoi le savoir du mélange, savoir fondamental de l’artisan qui doit en chaque chose réaliser l’harmonie, est-il la clef des divisions et des rassemblements ? C’est parce que l’on sait combien il y a d’éléments, et quelles formes de mélange ils sont susceptibles d’accepter, que l’on peut dès lors diviser correctement les choses composées et déterminer le nombre de leurs espèces. Le Timée, qui compose les différents corps à partir d’une combinaison de corps élémentaires géométriques (quatre des cinq solides réguliers), eux-mêmes produits dans leur diversité à partir de combinaisons différentes de figures triangulaires élémentaires74, est l’expression de cette méthode, appliquée à l’univers. C’est encore sur le terrain de l’analyse de l’âme et de la cité que nous allons clairement voir à l’œuvre cette pensée combinatoire, matrice des divisions. C’est lorsque l’on possède un tel art que l’on peut se faire artisan de soi-même et de la collectivité.
Chapitre II
L’art de la mesure : l’âme ouvrière d’elle-même
Il est temps de nous tourner vers la source des sensations, des opinions et des savoirs, l’âme des vivants. Nous l’approcherons pas à pas, sans demander immédiatement à connaître son essence, ni même la puissance qui découle de celle-ci. Nous commencerons par nous arrêter en son vestibule, comme dit Socrate lorsqu’il s’agit de saisir une chose par ses effets75 : nous nous familiariserons ainsi avec les mouvements qui sont déterminés par cette puissance, en faisant corps avec elle, en épousant le regard qu’elle porte sur les choses et l’empreinte qu’elle y laisse. L’âme est, de prime abord pour les vivants, le sujet de la perception : commençons par là, afin de saisir la façon dont celle-ci organise le monde par son interaction perceptive. Nous commencerons alors à percevoir la puissance du savoir à la façon dont il est capable de bouleverser de fond en comble cette organisation au sein des âmes où il se déploie. Nous toucherons ainsi du doigt l’effet du savoir au sein d’une âme devenue ouvrière d’elle-même. § 1. Notre perception, un décor en trompe l’œil
Dans un passage du livre VII de la République où Socrate se propose de préciser la nature des limites de notre rapport perceptif au monde, une comparaison de la perception avec la skiagraphia est risquée par Glaucon. La
74 Voyez Timée 53c-61c. Pour les différentes figures, voyez l’annexe 6 de la traduction de Luc Brisson, Paris, Flammarion 1992.75 En l’occurrence le bien lui-même, voir Philèbe 64c1.
platon160p_V2.indd 101 13/10/10 10:35:31
102
skia, pour les anciens Grecs, c’est l’ombre, l’ombre d’un arbre par exemple. La skiagraphia, c’est donc le dessin qui marque les ombres et fait ainsi apparaître la profondeur et la perspective76. Le dessin crée l’apparence de la profondeur sur la surface d’un mur : il se comporte comme une fenêtre ouverte sur un paysage ou sur un groupe de personnages. Glaucon, à la suggestion qu’il pourrait y avoir des cas où la perception ne donne rien de sain en raison des attributs contraires qu’elle donne aux chose perçues, évoque ce type de peinture : « tu veux manifestement parler des choses qui sont aperçues de loin (ta porrôthen) ou de celles qui sont peintes avec leurs ombres (eskiagraphêmena) » (République VII 523b5-6). Glaucon doit avoir en tête le fait que de loin nous puissions nous tromper sur la forme, le nombre ou la taille des choses, et que nous puissions être trompés par ces peintures qui nous donnent l’impression de la profondeur. Or Socrate rejette ces deux exemples : ce n’est pas du tout ce à quoi il pense. Il est vrai que de tels phénomènes ne constituent pas un problème tel qu’il nous faille recourir à autre chose que la perception : il suffit en effet de s’approcher des choses vues de loin ou d’aller toucher le mur peint en trompe l’œil pour rectifier notre erreur. Pourtant, les problèmes qui inquiètent ici Socrate ne sont pas tout à fait sans rapport avec ces variations de la perception en fonction des distances ou avec ces effets de perspective. Socrate explique en effet que les propriétés telles que la grandeur et la petitesse, la grosseur et la minceur, ou encore la mollesse et la dureté posent un problème spécifique à notre perception : « La grandeur des doigts, et leur petitesse, est-ce que la vue les voit de manière suffisante, et est-ce qu’il ne diffère en rien, de ce point de vue, que le doigt se tienne au milieu ou à l’extrêmité ? » (523e3-5). Il ne s’agit plus seulement d’un problème de distance ou de perspective dans la profondeur, mais néanmoins d’un problème lié au type de relation dans lequel se trouve l’objet de la perception par rapport à d’autres objets de son environnement. La position est déterminante, car elle entraîne des comparaisons différentes : à côté du pouce, l’index peut paraître grand, mais s’il était entre le majeur et l’annulaire, il serait moins impressionnant. Il y a un autre exemple similaire dans le Phédon : pour mesurer la grandeur ou la petitesse de Simmias, il n’est pas indifférent que nous le voyons auprès de Phédon, qui est plus grand que lui, ou auprès de Socrate, qui est plus petit. En conséquence, il faut admettre que « Simmias reçoit donc pour appellation l’être petit comme l’être grand, puisqu’il se trouve à mi-chemin entre les deux : soumettant sa petitesse à la grandeur, il est dépassé, et, présentant sa grandeur à la petitesse, il dépasse » (102c10-d2). La grandeur et la petitesse sont des modes de l’inégal eu égard à la taille, de même que la jeunesse et la vieillesse sont des modes de l’inégalité eu égard à l’âge (Parménide 140c-e). Or l’égal lui-même n’est pas épargné, comme le montre un autre passage du Phédon : l’égalité des bouts de bois égaux ou de cailloux égaux est susceptible d’être inégale, dans le même temps : « est-ce que les cailloux égaux ou les bouts de bois égaux, paraissent parfois, tout en
76 Voir E. Keuls, Plato and Greek Painting, Leiden, Brill, 1978.
platon160p_V2.indd 102 13/10/10 10:35:31
103
restant les mêmes, égaux à l’un, et ne le paraissent pas à l’autre ? » (74b7-9). Ce sont à chaque fois des ensembles de choses contraires (par exemples les choses égales et les choses inégales) qui admettent au moins une intersection permettant aux mêmes choses de participer aux deux en même temps. Or nous retrouvons là typiquement les problèmes qui surgissent avec les choses vues de près ou de loin. Comme le précise en effet un texte du Protagoras, notre perception des grandeurs, des épaisseurs, des multiplicités, des intensités est modifiée par la distance à laquelle nous nous trouvons : « à la vue, les mêmes grandeurs ne vous paraissent-elles pas plus grande de près, et plus petites de loin ? ». Et il en va « de même pour les épaisseurs et les multiplicités », et aussi pour « les sons de même intensité, qui paraissent plus forts de près, et moins forts de loin (356c5-8) ». En outre, il n’y a pas que dans la profondeur que notre vision des grandeurs est troublée : elle l’est aussi selon les perspectives et les coexistences – devant quoi, derrière quoi, à côté de quoi la chose est-elle vue ? Il ne s’agit pas de la seule profondeur de champ : même à la même distance, les grandeurs que nous saisissons sont relatives. Par la perception, nous ne saisissons jamais une chose comme grande indépendamment d’un rapport, et cela implique que la même chose puisse être aussi bien qualifiée de petite sous un autre rapport. Et il en va de même pour tous les couples de contraires sur lesquels nos sens nous procurent une information : pour la vue, il en va de même avec l’épais et le mince, pour le toucher avec le dur et le mou, ou encore le lourd et le léger (République VII 524a9). Et nous pourrions reprendre pour l’ouïe l’exemple mentionné dans le Protagoras pour les autres sens : l’intensité du son – un son paraissant plus ou moins fort selon la comparaison avec un autre son. La proximité et le lointain ne sont qu’un des modes de cette relativité qui s’impose à toutes nos perceptions. Cette particularité provient du fait que le même et unique sens est affecté à la saisie d’un couple de contraires. « Tout d’abord, le sens qui a été assigné à percevoir ce qui est dur, a été forcément assigné à percevoir aussi ce qui est mou » (524a1-2), et un tel sens rapporte donc à l’esprit la sensation de l’un et l’autre de ces contraires à propos du même objet. Nous sommes alors obligés de réfléchir afin de déterminer « si les choses au sujet desquelles on lui fait un rapport sont une seule chose ou bien deux (b5) ». Il faut alors que l’esprit s’interroge pour séparer ce que les sens ont uni car la vue voit le grand et le petit non pas comme des choses séparées, mais comme quelque chose de mêlé (c3-4). C’est là un trait qui fait de cette unité des contraires dans la sensation une très bonne nouvelle : elle nous mène à ouvrir les yeux de l’esprit et à chercher à isoler par l’intellect ce que nous ne pouvons voir ou toucher qu’entremêlé avec d’autres choses ; Aristote s’en souviendra aussi pour placer au fondement même de la science cette unité des contraires dans la sensation77. Quelles sont néanmoins les conséquences perceptives
77 Métaphysique, III, 2, 1003 b 19-21 : pour tout genre, il n’y a qu’une sensation et aussi une seule science. Or les contraires sont les opposés dans le genre : la contrariété correspond donc à un type de sensation, et ce type de sensation correspond donc aussi à un genre de chose, et par consé-quent à une science dont il est le terreau, ainsi les sons articulés pour la grammaire.
platon160p_V2.indd 103 13/10/10 10:35:31
104
du fait que chaque sensation de grandeur est en même temps une sensation de petitesse, chaque sensation de dureté est en même temps une sensation de mollesse, notre saisie de l’un ou l’autre contraire impliquant toujours l’autre, et notre saisie relative de chacun impliquant toujours la possibilité de l’autre ? La conséquence est que notre monde perçu se dessine bien comme une peinture en perspective : percevoir, c’est produire autour de soi un monde polarisé autour d’un tel centre et imposer à des sens incapables de ne pas percevoir un contraire séparé de l’autre des évaluations en permanence affectées par les distances et les perspectives.
§ 2. Notre vie affective, un décor en trompe l’œil
Nous n’avons fait pour l’instant qu’apercevoir une des façons qu’ont les apparences de s’ordonner autour d’un vivant. Le motif de la vue de loin, des peintures et des dessins qui donnent l’impression de la profondeur vont encore être associés pour nous permettre d’explorer plus avant ce phénomène. Il y a ainsi un passage des Lois où l’étranger d’Athènes prononce cette phrase énigmatique : « ce qui est vu de loin (to porrôthen horômenon) donne à tous le vertige, pour ainsi dire, et plus encore aux enfants » (Lois II 663b6-7). L’étranger entend trouver là une expérience perceptive qui puisse servir de point de comparaison avec un autre aspect de notre vie – celle dans laquelle nous apparaissent des choses justes et injustes. Or, affirme l’étranger, cette situation là est le lieu d’un trouble similaire à celui qui nous saisit en voyant les choses de loin : les choses sont déformées par la distance. Pour faire disparaître le vertige (skotos), il faudrait réussir à faire comprendre à tous que ces situations où nous voyons du juste et de l’injuste sont le lieu d’une illusion tout à fait similaire à celle des peintures en ombre : « Les choses justes et injustes sont des motifs peints en ombre (eskiagraphêmena) » (b8-c2). Voilà qui est très intéressant, puisque nous retrouvons les deux types d’expérience perceptive évoqués par Glaucon dans le texte de la République – la peinture en perspective, la vision à distances variables. L’étranger entend alors expliciter son propos sur le juste et l’injuste en affirmant que ces deux types de choses ont une apparence différente selon les dispositions de qui les considère : l’injustice paraît plaisante à l’injuste, et la justice lui paraît déplaisante ; c’est le contraire pour le juste (c2-5). Quel rapport avec le fait de voir de près ou de loin ? Un indice : c’est dans le rapport au plaisir et au déplaisir, au plaisir et à la douleur, qu’une profondeur vertigineuse s’ouvre à nos yeux. Le modèle de la vision de près et de loin est en effet utilisé dans ce contexte d’une manière plus explicite dans le passage du Protagoras que nous venons de citer (356c5-8). Socrate n’y insiste sur l’effet de la distance sur notre perception des grandeurs, des multiplicités et des intensités, qu’afin d’expliciter un phénomène qui se produit dans notre vie affective, lorsque plaisir et douleur nous affectent. Le problème est en effet celui de notre
platon160p_V2.indd 104 13/10/10 10:35:32
105
capacité à évaluer correctement le plaisir et la peine, à en mesurer l’excès et le défaut : les gens affirmeront par exemple que « ce qui est agréable sur le champ diffère grandement de ce qui est agréable ou pénible plus tard » (356a5-7). Or ce trouble est particulièrement dommageable au calcul des grandeurs et des intensités de deux états qui ont tant d’importance pour tous les vivants. Nous reviendrons sur les raisons fondamentales de cela au prochain chapitre, lorsque nous serons en possession d’une vision plus précise de la nature de l’âme, et nous pouvons pour l’instant nous satisfaire de noter, avec l’étranger des Lois, que « ce qui caractérise le mieux ce qu’est naturellement l’homme, ce sont les plaisirs (hêdonai), les douleurs (lupai) et les désirs (epithumiai), auxquels, par nécessité, tout être vivant mortel est tout simplement comme suspendu et accroché par ses préoccupations les plus sérieuses » (Lois V 732e4-7). Cet affairement très sérieux, que l’homme partage avec les autres animaux, tient au fait que le plaisir et la douleur s’imposent comme le centre d’où rayonne notre vie psychique. Ce sont en effet « les deux conseillers à la fois antagonistes et déraisonnables » (II 644c6-7) dans nos âmes et c’est à partir de ces deux piliers que peut s’ériger toute la complexité de la vie psychique : outre ces deux « conseillers », nous avons des « opinions (doxa) sur les choses qui vont arriver », auxquelles on donne le nom général « d’attente (elpis) », en réservant deux noms spécifiques, celui de « crainte (phobos) », au fait de « s’attendre à la douleur », et celui de « confiance (tharros) », au fait de s’attendre au contraire (c9-d1). Voici comment s’ouvre la profondeur de la vie psychique, comparable à la vision à distance ou à la peinture en perspective qui crée l’apparence des distances relatives des objets peints : dirigée par le plaisir et la douleur, l’âme se projette en direction de ce qui est à venir, ouvre cette dimension de l’anticipation dont elle crée ainsi la profondeur, profondeur double du plaisir recherché et de la douleur crainte. Nous voyons là la racine du mouvement fondamental de la vie psychique : fuir les douleurs (pheugein tas lupas), poursuivre les plaisirs (hêdonas diôkein) (VII 792c8-d2). Nous tendons naturellement à fuir la douleur que nous craignons et à poursuivre le plaisir que nous attendons avec confiance, bienheureux à son approche. Et nous disposons en outre d’une capacité à calculer concernant « ce qui en toutes ces choses est meilleur ou pire pour chacun » (II 644d1-2) — c’est aussi ce calcul, que nous nommons loi (nomos), lorsqu’il en vient à être un « décret commun de la cité (dogma poleôs koinon) » (c9-d3), par lequel nous nous accordons tous sur ce qui nous semble notre meilleur intérêt face aux plaisirs et aux douleurs à venir. Le paysage psychique ainsi décrit est aussi bien celui de la vie individuelle que de la vie politique. Comme ses deux interlocuteurs ont du mal à suivre cette explication des mouvements fondamentaux de l’âme, l’Athénien propose une analogie. C’est le fameux passage qui compare chaque vivant à une « marionnette fabriquée par les dieux ». Le plaisir et la douleur, ces deux « affections (pathê) » fondamentales sont alors décrites comme « des tendons ou des ficelles » qui « nous tirent » et, « comme elles sont antagonistes », nous
platon160p_V2.indd 105 13/10/10 10:35:32
106
« conduisent à des actions opposées, et c’est en rapport à celles-ci que se fait la différence entre la vertu et le vice » (d7-e4). Des affections : il s’agit de choses subies en effet, comme l’explicite bien la métaphore de la ficelle de la marionnette. La suite du texte ajoute une nouvelle corde, celle de la raison — le calcul précédemment évoqué —, corde plus souple (644e4-645a4), et dont la douceur, qui la prive du pouvoir d’exercer elle-même la contrainte, suppose qu’elle mette une partie des autres mouvements psychiques à son service (a4-c1), ce en quoi précisément consiste l’éducation – à savoir en la réforme de nos mouvements affectifs. Cette profondeur de champ qui s’ouvre sous l’effet de l’importance que prennent pour nous plaisir et douleur, redoublée par l’anticipation dans laquelle nous place leur venue, introduit dans nos tentatives de nous assurer que nous nous attirons bien en effet plus de plaisir que de douleur des problèmes de calcul comparables à ceux qui affectent notre perception des grandeurs et des multiplicités en fonction de la distance.
Un tel effet de profondeur se traduit notamment dans l’idée, défendue par « la plupart des hommes », selon laquelle « bien des gens, alors qu’ils savent ce qui est meilleur, ne veulent pas agir en conséquence, alors qu’ils le peuvent, mais agissent autrement » (Protagoras 352d4-7), car on se laisse vaincre par le plaisir, la peine ou quelque autre affection. Ce phénomène, que la tradition philosophique ultérieure a nommé « faiblesse de la volonté », traduisant ainsi le terme grec akrasia employé par Aristote, mais jamais par Platon dans les dialogues, ne s’explique que par un effet de profondeur temporelle. Socrate interroge des interlocuteurs fictifs représentant la voix anonyme de la foule : se laisser « vaincre par les plaisirs », voilà ce que vous dites dans les circonstances où vous vous laissez vaincre par la nourriture, la boisson et les plaisirs de l’amour, parce qu’ils sont agréables, et où vous le faites, alors même que vous savez qu’ils sont mauvais. La question est de savoir ce qu’ils appellent alors « mauvais ». Ces choses pourraient-elles être mauvaises si elles n’apportaient que la joie ? Tout le monde serait d’accord pour dire de telles choses « que ce n’est pas au titre du plaisir même qu’elles procurent sur le champ que ces choses sont mauvaises, mais en raison des choses qui adviendront plus tard, les maladies et autres choses de ce genre » (353d7-e1, nous soulignons). Nous appelons « mauvaises » des choses dont les conséquences sont pénibles et nous pensons qu’elles nous ont vaincus parce que la proximité du plaisir qu’elles offraient s’est faite plus présente que la douleur à venir. Mais c’est aussi en tant qu’elles apportent des peines et non des plaisirs que nous les appelons mauvaises. Il est étonnant que cette profondeur temporelle nous mène ainsi à modifier les noms de choses identiques en fonction de leur degré d’éloignement et de proximité.
La perspective qui fait de notre vie morale un trompe l’œil explique donc cette incohérence qui nous fait succomber à un plaisir présent, quand bien même nous savons qu’il nous apportera des douleurs, peut-être plus grandes que le plaisir d’aujourd’hui, mais qui paraissent toutes petites vues
platon160p_V2.indd 106 13/10/10 10:35:32
107
de loin au moment où le plaisir de l’instant envahit notre champ de vision. C’est sur le fondement de cette expérience que nous en venons à penser que le savoir est la plus faible des choses : nous avons beau en effet savoir que tels ou tels plaisirs, si nous y succombons sans retenue, auront de fâcheuses conséquences, nous sommes en grande difficulté pour résister à la présence du plaisir lorsqu’il faudrait le combattre en invoquant des douleurs dont la distance amoindrit la menace. Au contraire, dans ce même dialogue, Socrate et Protagoras se rallient à l’idée que le savoir est la plus puissante des choses et que lorsqu’il est présent, il est impossible que le type d’accident qui arrive à tous, à savoir de succomber à ce que l’on sait pourtant être mauvais, nous arrive (352c2-d3). C’est bien que Socrate entend par « savoir » quelque chose de différent de ce que la foule entend par ce même mot – puisqu’il constate que la foule, elle, ne résiste pas à ses affects malgré la présence en elle de ce qu’elle appelle savoir. Avant de pouvoir saisir la nature de ce savoir, il nous faut explorer plus avant les états que suscite en nous l’effet de perspective dont notre vie morale est affectée.
§ 3. Hédonisme aristocratique, hédonisme populaire, hédonisme technicien
Prenons toute la mesure de la profondeur vertigineuse que le plaisir et la douleur sont susceptibles de produire en nos esprits. Certains personnages des dialogues proposent une adhésion complète à la perspective déformante de notre vie affective : ils nous serviront de guide. Protagoras livre le manifeste d’une telle attitude en affirmant que « l’homme est mesure de toutes choses, de l’existence des choses qui sont et de l’inexistence de celles qui ne sont pas » (Théétète 152a2-4). C’est bien là affirmer que ce qui nous apparaît, à chacun, doit à chaque fois être vrai – la mesure même de toute chose. Il n’y a plus, dès lors, de problèmes de perspective : toute perspective est toujours la bonne. Nous pouvons dès lors suivre la pente de nos impressions. Pour ce qui est des affections de plaisir, Calliclès, dans le Gorgias, représente la formulation la plus radicale d’une doctrine qui consisterait à toujours choisir le plaisir, tel qu’il se présente : le plaisir est toujours un bien, quel que soit le plaisir dont il s’agit. Calliclès défend l’idée que l’homme puissant est celui qui a de forts désirs que son courage et son intelligence lui permettent de satisfaire. On découvre en effet qu’il n’est pas facile de toujours choisir le plaisir tel qu’il se présente, que notre éducation et nos lois nous ont en réalité appris à résister à certains plaisirs. Pour Calliclès néanmoins, c’est là une erreur : la foule, en déclarant honteux de tels comportements, tente de dissimuler sa propre faiblesse. Elle vante la tempérance pour justifier sa propre lâcheté. La tempérance revient donc à se donner pour maître à soi-même les lois de la foule. C’est la vie facile, l’intempérance, la licence, qui font la vertu et le bonheur. Les meilleurs des hommes ont de grandes passions, des désirs puissants auxquels ils laissent libre cours. Socrate manifeste les contradictions de cet hédonisme
platon160p_V2.indd 107 13/10/10 10:35:32
108
aristocratique et radical, qui échoue autant à distinguer les hommes, dont la capacité au plaisir est la chose la mieux partagée, qu’à distinguer les plaisirs eux-mêmes : en faisant de tout plaisir un bien il ne peut plus en effet distinguer entre un plaisir noble et celui de se gratter tout son saoul (Gorgias 492e-494b).
Si nous revenons à la discussion du Protagoras, il est très clair que la position attribuée au peuple n’est pas l’hédonisme aristocratique de Calliclès : les gens entendent bien faire la différence entre de bons et de mauvais plaisirs, même s’ils se plaignent de ne pas parvenir à ne choisir que les bons et de bien souvent succomber aux mauvais, quand bien même ils savent qu’ils sont mauvais. Certes, Socrate a raison de dire que c’est en tant qu’elles apportent des peines et non des plaisirs que nous appelons certaines affections mauvaises, et donc que le mauvais est identifié au pénible, et, corrélativement, le bien au plaisir. Si la foule monnaye le bien en plaisirs et le mal en douleurs, il reste pourtant à ses yeux une grande différence entre un plaisir dont on jouit immédiatement et un plaisir anticipé que l’on a su se préserver par sagesse et prévoyance, c’est-à-dire un bien. En dernière instance, ce que la morale de la foule dit déjà, même si elle n’est pas à la hauteur d’elle-même, c’est qu’il faut savoir résister à quelques plaisirs et ne pas fuir toutes les douleurs. C’est aussi la doctrine affirmée dans les Lois : ne pas poursuivre tous les plaisirs ni fuir toutes les douleurs (VII 792c8-d4). L’éducation a en effet pour objet le plaisir et la douleur, ces « premières sensations » ressenties par les enfants et « au sein desquelles se produit pour la première fois dans l’âme la vice ou la vertu » (II 653a5-7). Celui qui parvient, en ce domaine, à quelque sagesse et à la stabilité de quelques opinions vraies, même au seuil de la vieillesse, peut s’avouer heureux. La foule du Protagoras serait tout à fait d’accord : il est bien difficile de parvenir enfin à savoir refuser quelques plaisirs et faire front face à quelques douleurs. Telle est l’éducation qui consiste en « l’éclosion initiale de la vertu chez l’enfant », laquelle advient « si le plaisir, l’amitié, la douleur et la haine apparaissent comme il faut dans l’âme », de telle sorte qu’à l’apparition de la raison, les affections s’accordent avec celle-ci – or un tel accord constitue précisément « l’excellence dans sa totalité ». On distinguera donc la vertu totale (accord de la raison développée avec la sensibilité) de l’éducation qui est la « la formation au bon usage des plaisirs et des douleurs » (Lois II 653a9-c4). Un bon usage des plaisirs et des douleurs, voilà ce à quoi la foule du Protagoras serait heureuse de parvenir. L’ensemble des Lois a ainsi pour but de produire et de préserver, au sein de la communauté politique, ce bon réglage des affections dans toutes les circonstances de la vie.
L’hédonisme présenté par l’étranger des Lois est le prolongement de l’hédonisme populaire auquel il s’agit de donner les véritables moyens d’atteindre son but, à savoir la vie la plus agréable. La vie vertueuse doit être aussi la plus plaisante, sinon elle ne saurait être choisie par un vivant. La nature en l’homme ne saurait s’y plier. Or il se trouve qu’elle est la plus
platon160p_V2.indd 108 13/10/10 10:35:32
109
plaisante. Cet hédonisme suppose la traversée des apparences et des effets de perspective qui nous font penser de manière erronée que la vertu n’est pas agréable, et le rétablissement d’une mesure véritable. La vie vertueuse est agréable non pas seulement parce que « vue de l’extérieur elle l’emporte par la réputation, mais aussi parce que, si l’on consent à y goûter et qu’on ne la fuit pas dans notre jeunesse, elle l’emporte aussi en ce que nous cherchons tous : davantage de joies et moins de souffrances durant toute notre vie » (Lois V 732e7-733a4). La vertu est la seule vie capable de réaliser ce que tous les vivants veulent, c’est-à-dire le maximum de plaisir en une vie et le plus grand bonheur. Nous comprendrons pourquoi en étudiant la nature de l’âme au prochain chapitre. Pour l’instant, il faut simplement admettre que la transformation morale, chez Platon, est l’effet d’une modification des apparences de notre vie affective : c’est un effet d’ordre cognitif sous l’effet de la technique de la mesure. Devenir vertueux suppose une modification de notre regard sur les choses. C’est ce que l’on peut appeler un « intellectualisme moral ». Seul le savoir peut garantir aux vivants le maximum de plaisir.
§ 4. Notre solitude face aux arts d’imitation
L’éducation doit donc nous apprendre à corriger quelque peu les effets de perspective de notre vie affective, en ne fuyant pas immédiatement toutes les douleurs et en ne poursuivant pas immédiatement tous les plaisirs, et en introduisant donc quelque calcul et quelque mesure dans nos choix. Nous commençons néanmoins notre vie dans cet état de dénuement où l’illusion est totale : rien n’existe que ce qui est au premier plan. Comme tous les vivants, nous naissons sans posséder l’intelligence que nous possédons une fois adultes : nous naissons insensés, « poussant des cris de manière incohérente », et, dès que nous nous dressons sur nos pieds, nous gambadons aussi de façon incohérente (Lois II 672b8-c5). Or il y a là quelque chose de très important à noter : si le petit d’homme, comme celui de nombreuses autres espèces, manifeste certes sa capacité spontanée à bouger ou à émettre des sons de manière désordonnée et trouve du plaisir à le faire, il se trouve néanmoins que ce plaisir, qui rend difficile l’éducation, est aussi ce qui la rend possible. Car ce même petit qui prend plaisir à gesticuler et à crier sans ordre est aussi susceptible de trouver du plaisir à coordonner ces gestes et ces sons. À la différence des autres vivants, l’homme a le sens des formes d’ordre et de désordre dans les mouvements qu’il exécute, ordre et désordre que l’on appelle en l’occurrence rythme et harmonie (653e3-5) : le rythme, c’est en effet « l’ordre dans le mouvement » (664e). Or cette sensation de l’ordre est accompagnée de plaisir (654a3). L’art choral est celui par lequel les dieux mènent chants et danses de manière ordonnée. Cette sensation de l’ordre est donc aussi accompagnée de plaisir – ainsi les dieux, tout en nous faisant plaisir, on trouvé la moyen de nous éduquer à l’ordre. Le rythme et l’harmonie seraient ce par quoi on peut commencer à éduquer les âmes, avant même qu’elles ne sachent s’exprimer : le bercement des enfants sera
platon160p_V2.indd 109 13/10/10 10:35:32
110
ainsi considéré au livre VII comme le premier moyen de l’éducation morale de l’homme. On comprend que l’étranger affirme dès lors qu’être éduqué, c’est faire partie d’un chœur : un homme qui a reçu une bonne éducation sera en mesure de chanter et de danser de belle manière – et pas seulement d’en être spectateur. C’est pour cela, et seulement pour cela que le citoyen doit apprendre à danser et à chanter – à quoi bon en effet exiger un tel apprentissage, long et éprouvant, de tous les citoyens, si ce n’est pour en espérer une amélioration des âmes ? L’apprentissage des arts et de la gymnastique s’avère donc le moyen de former progressivement les hommes, de telle sorte qu’ils apprennent à résister à quelques douleurs et à quelques plaisirs, tout en parvenant à s’élever à des formes plus durables et plus raffinées de ces deux sentiments. La République, au livre III, et les Lois, aux livres II, VII et VIII (jusqu’à 842a) détaillent les ressources d’une telle éducation. Il faut pourtant noter que cette éducation, par les arts et la gymnastique, ne peut à elle seule parfaitement réussir. Il y a une prise de distance relative de Platon à l’égard de cette éducation traditionnelle des Grecs par la poésie et la gymnastique. Relative, car il la conserve, mais réelle lorsqu’il en marque la limite et la nécessité, pour qui veut tout à fait s’affranchir des effets d’obscurité de notre vie affective, de prolonger cette éducation par une autre, mathématique et philosophique, comme le montre par exemple le livre VII de la République. En quoi consistent ces limites ? Deux thèmes apparemment éloignés, en réalité intimement liés, celui de la publicité et celui des arts d’imitation, permettront de les voir très clairement. Les vertus populaires, à l’aune desquelles nous jugeons de nos comportements et de nos capacités respectives à nous montrer quelque peu à la hauteur des plaisirs et des douleurs de demain, sans être toujours la marionnette de ceux d’aujourd’hui, se construisent et se soutiennent du regard public, tandis que nous devenons plus vulnérables à la présence insistante d’un plaisir ou d’une douleur dès que nous sommes libérés de ce regard. C’est ce qu’Adimante veut prouver au livre II de la République en racontant l’histoire de Gygès et sa morale : aucun d’entre nous ne résisterait à commettre une injustice qui lui rapporterait beaucoup s’il était sûr de ne pas être découvert (République II 358c-360d). C’est encore ce que prouve le beau portrait, au livre VIII de la République, de l’homme de guerre d’une société qui a commencé à s’amollir, et qui, ayant protégé son image publique de vertu derrière l’intimité de sa résidence, s’adonne clandestinement aux plaisirs de l’alcool et du sexe (VIII, 547e-548b). Mais c’est encore ce que montre le mieux l’analyse de la position du spectateur des arts d’imitation.
Considérons la forme la plus complète de l’imitation, à savoir celle qui ne se contente pas soit du son seul comme la musique des flûtes, soit de la vue seule, comme la peinture. La poésie, sous sa forme théâtrale, est une forme d’imitation qui réunit le visuel et l’auditif (X 603b6-7). Socrate se demande dès lors, au livre X de la République, quel commerce la poésie mimétique entretient avec notre pensée : quel est son effet sur notre esprit ? Il faut commencer par se demander ce que sont les choses imitées par la poésie mimétique. Socrate définit l’objet de l’imitation dramatique, d’une
platon160p_V2.indd 110 13/10/10 10:35:32
111
manière qui anticipe la Poétique d’Aristote : « des hommes qui agissent, dont les actes sont contraints ou volontaires, qui pensent que leur bonheur ou leur malheur est le résultat de leurs actes, et qui trouvent à ces événements motif à se réjouir ou s’affliger » (c4-7). Or, en étant témoin de toutes ces circonstances, le spectateur parvient-il à garder ses pensées en harmonie (c10) ? Socrate ici fait allusion au type de conflit déjà évoqué au livre VII (les doigts de 523e qui apparaissent à la fois grands et petits) : « de même que des choses entraient en conflit dans sa vision et qu’il avait en lui en même temps des opinions opposées à propos des mêmes choses, de même aussi il y a des choses qui entrent en conflit au sein des actes et qui s’affrontent en lui » (d1-3). Le passage du Livre VII n’abordait pas la dimension pratique de ces oppositions. Or il arrive qu’un homme, étant sage, s’il est exposé à un événement malheureux, comme la perte d’un fils ou d’une chose parmi celles qui comptent le plus à ses yeux, perçoivent certains actes alternativement comme honteux ou licites, selon les circonstances. D’un côté, il supporte la peine mieux que quiconque, lui imposant la mesure. Or cette capacité à se vaincre soi-même repose beaucoup sur le regard d’autrui : se battra-t-il de la même façon contre son chagrin s’il se trouve seul, sans compagnie ? Une fois seul, il ne craindra plus de dire et de faire des choses qu’il aurait honte de faire en public (604a1-8). Quelles sont les choses qui ainsi s’affrontent en lui ? D’un côté la raison et la loi, de l’autre cette affection (pathos) qui l’entraîne vers la douleur (a10-b1). Eu égard au même objet, dans le même homme, des choses sont en rivalité, et tirent chacune de leur côté : la loi qui désigne comme belle la maîtrise – nous interdisant de crier comme des enfants qui se tiennent la partie du corps où ils viennent de se cogner – , l’émotion qui, au souvenir de la perte, saisit ce qu’il y a en nous d’impossible à raisonner et nous pousse à la plainte. Or c’est exactement l’expérience que parviennent à reproduire les arts d’imitation : en étant spectateurs de ces arts, même lorsque nous sommes nombreux, nous vivons cette expérience de privauté affective où nous nous affranchissons du regard social qui assure le reste du temps notre maintien. L’expérience des arts de la scène est une sorte de réplique de l’expérience morale de la privauté (606a) : même en foule, nous sommes désespérément seuls. Les imitations tendent à solliciter les parties irrationnelles de nos âmes. Une première raison de cette attirance est la difficulté qu’il y a à imiter le tempérament raisonnable. C’est un point très important : les reflets sensibles des formes des vertus sont parmi les choses les plus difficiles à voir : « la justice, la sagesse et toutes les choses qui sont précieuses pour l’âme ne possèdent pas d’éclat en leurs images d’ici-bas » (Phèdre, 250 b1-3). Les signes de la vertu sont parmi les choses les plus difficiles à voir et à communiquer. Un poète imitatif qui veut plaire à un large public doit donc se tourner « vers le tempérament (êthos) irritable, vers le tempérament bigarré, parce qu’il se prête bien à l’imitation (République X 605a4-6). Mais dès lors, la pente psychique la plus forte suppose la multiplication des œuvres qui donnent satisfaction aux éléments de notre âme dont nous aurions normalement
platon160p_V2.indd 111 13/10/10 10:35:32
112
honte dans nos actes publics. Le livre II des Lois met en scène encore deux autres types d’incohérence morale que suscitent les arts d’imitation et manifestent bien notre capacité à prendre plaisir à ce que pourtant nous réprouvons : soit lorsqu’acteurs, dans un chœur (une expérience courante pour un citoyen athénien de l’époque classique), nous chantons et dansons de belles choses sans y avoir de plaisir, préférant les choses moins belles (654c3-d3), soit en tant que spectateurs, lorsque nous goûtons en réalité les choses que nous condamnons en présence des gens dont le jugement nous impressionne (655d5-656a5). Les arts d’imitation offrent ainsi un terrain privilégié à l’expression de notre incohérence morale et affective, cet état par lequel, dissociant le plaisir et la vertu, il nous semble encore improbable que l’on puisse n’éprouver du plaisir qu’à ce que l’on juge digne d’estime. Réunis autour d’une scène, spectateurs d’actions représentées, nous nous trouvons donc dans une situation comparable à celle de l’homme à l’âme noble qui s’abandonne au chagrin en privé. Pourtant réunis en masse, nous sommes privés du secours que nous nous portons d’ordinaire les uns aux autres pour nous soutenir et nous nous projetons dans les plaisirs et les douleurs que notre âme réprouve en temps normaux. Nous comprenons pourquoi la République et les Lois proposent un programme qui impose aux imitations une moralisation non seulement des contenus mais encore de la forme même du spectacle, soumettant la représentation à l’imitation des gestes, des voix, des intonations de la vertu78. De quoi l’art, et la situation de privauté qu’il reconstitue, sont-ils le révélateur ? De notre incohérence morale : notre capacité à résister à certains plaisirs et à certaines douleurs, qui faiblit à mesure que ceux-ci se rapprochent, trouve une béquille dans le regard public dont l’art sait nous priver. Face aux imitations, nous sommes libres de mesurer l’empreinte de notre désordre intérieur et de nourrir celui-ci.
§. 5 L’effet de l’art de la mesure dans la vie morale : la disparition du trompe l’œil Il est temps de voir l’œuvre du savoir en nous. Suivons la façon dont Socrate instille un progressif écrasement de cette perspective qui rend obscure notre vie morale, en faisant se rapprocher peu à peu les choses que la temporalité, au sein de notre perception, éloigne : en affirmant que certains plaisirs sont mauvais, nous voulons donc dire que certaines choses agréables sont désagréables (Protagoras 354a3), car c’est bien en tant qu’elles sont désagréables que les conséquences de ces plaisirs nous paraissent mauvaises. Des choses bonnes et désagréables ? Voilà une description que l’on accorde plutôt d’habitude aux choses désagréables sur le moment mais qui ont des effets bénéfiques, ainsi les exercices gymnastiques et militaires,
78 Pour approfondir ces questions, voir notre étude, « Que l’art ne peut pas tout pour la cité : la dissonance de l’art, du spectateur et de l’acteur selon Platon », Cahiers du Centre G. Glotz, n° 18, 2007 p. 303-322.
platon160p_V2.indd 112 13/10/10 10:35:32
113
les traitement médicaux (a4-7). Ces choses sont dites bonnes non à cause des douleurs du moment, mais parce qu’elles apportent par la suite la santé et la bonne constitution aux corps comme aux cités, et donc des plaisirs futurs. Socrate fait avouer à ses interlocuteurs fictifs de ce passage du Protagoras qu’ils n’ont qu’une seule et même définition pour le bien et le mal, à savoir le plaisir et la douleur : « vous poursuivez le plaisir parce qu’il est bon, et vous fuyez la peine parce que c’est un mal » (c3-5). La preuve en est que nous sommes capables de dire une joie mauvaise en tant qu’elle apporte des maux plus grands que le plaisir qu’elle donne, et une souffrance bonne en tant qu’elle préserve de peines plus grandes que celles qu’elle nous procure (c5-e2). Or ceci étant admis, la thèse de la foule selon laquelle, sachant ce qui était le bien, on a été vaincu par le plaisir, devient risible, puisqu’elle revient à dire que, voulant le bien, on a été vaincu par le bien. Un tel ridicule ne peut néanmoins paraître que si l’on aplatit la profondeur temporelle pour ne mesurer que la somme de l’agrément et du désagrément, indépendamment de tout facteur d’éloignement et de proximité temporel. Dans la façon de voir de la foule, on peut en effet très bien distinguer « agréable » et « désagréable », d’un côté, et « bon » et « mauvais », de l’autre, pour autant que ce dernier couple ne renvoie pas purement et simplement à l’agréable et au désagréable, mais à l’agréable et au désagréable vus de loin. Faire ce qui est bon et faire ce qui est mauvais c’est être ou n’être pas à la hauteur de plaisirs et de douleurs encore lointains, être capable de régler sa conduite d’aujourd’hui en fonction du lointain, ce qui, étant donné les effets de perspectives dans lesquels la perception de la foule est prise, lui semble un exploit extraordinaire, tant les peines et les joies d’aujourd’hui, même modestes, en viennent à voiler à nos yeux les peines et les joies de demain, même considérables. De là vient à tout un chacun l’idée d’un savoir inefficace : on a beau savoir qu’il y a de telles douleurs et de tels plaisirs à venir, cela est sans force contre les choses présentes. Regardons maintenant les choses en abolissant la perspective. Le bon, pour la foule, est toujours un plaisir, qu’il soit d’aujourd’hui ou de demain, et le mauvais de la douleur. Inutile de multiplier les appellations. Dès lors, savoir quelle chose est mauvaise et la faire parce qu’on se laisse vaincre par le plaisir peut se dire de la manière suivante : savoir qu’une chose est mauvaise et la faire néanmoins parce que l’on est vaincu par le bien (355c1-8) ; ou alors, savoir qu’une chose est désagréable et la faire néanmoins parce que l’on est vaincu par le plaisir (355e4-356a3). Il apparaît très clairement dans le premier cas que ce que la foule appelle se laisser vaincre, c’est plutôt « choisir des maux plus grands à la place de biens plus petits » (355e3). Dans tous les cas, il s’agit d’un échange de biens et maux. La seule question qui reste est de savoir si l’on a fait une bonne affaire. Socrate nie la profondeur de champ qui est le propre de la perspective de l’opinion de la plupart sur le bien et le mal – cette profondeur qui permet à l’injuste de croire l’injustice douce et la vertu pénible : l’injustice procure des plaisirs immédiats et des peines lointaines et incertaines,
platon160p_V2.indd 113 13/10/10 10:35:32
114
la vertu le contraire. En revanche, si l’on oppose alors à la vue la mesure, cette profondeur est écrasée : « comme un homme qui sait peser, rassemble les choses agréables et rassemble celles qui sont pénibles, place sur la balance aussi bien l’immédiat que le lointain et dis-moi de quel côté il y a en davantage » (356a8-b3). Si l’on pèse de l’agréable contre de l’agréable, il faut choisir le côté où la quantité est plus grande, si l’on pèse du pénible contre du pénible, on choisira le petit côté, si l’on pèse de l’agréable contre du pénible, on préféra une pesée où l’agréable l’emporte, et si le pénible est plus grand, alors il faudra s’abstenir, « que le proche l’emporte sur le lointain ou le lointain sur le proche » (356b7-8). Voilà donc comment s’explique l’éblouissement caractéristique de la vision des choses lointaines : sans le recours de la mesure qui aplanit les distances, un grande douleur vue de loin nous semble égale, voire inférieure, à un plaisir plus petit mais immédiat. Nous touchons du doigt l’effet de la pratique dialectique dans la vie morale : nous avons appris à rassembler les ensembles de choses, à ne pas limiter ou découper ceux-ci arbitrairement. Or qu’est-ce que cet effet de perspective, sinon une incapacité à réunir les choses qui relèvent d’une même nature sur le même plateau de la balance ? Nous appelons des « biens » des plaisirs de demain et des « maux » des plaisirs d’aujourd’hui au lieu de les réunir dans la même catégorie de plaisirs pour en faire lucidement la pesée. Nos illusions morales s’appuient sur des découpes arbitraires des ensembles de choses qu’une même forme désigne. Au contraire, le sage réunit les grands ensembles et donne ainsi de l’ordre à sa vie morale. Après avoir évoqué le fait que notre perception des grandeurs, des épaisseurs, des multiplicités et des intensités est troublée par la distance (c5-8), Socrate conclut en effet que voir ses actions couronnées de succès, consiste à choisir celles dans lesquelles s’ouvrent « les grandes masses » et à éviter celles où il n’y a que de « petites masses » ; il est évident que « pour la préservation de notre vie », « l’art de la mesure (hê metrêtikê tekhnê) » est plus sûr que « la puissance de l’apparence » (c8-d4). Cette puissance nous fera souvent prendre le grand pour le petit et vice versa, alors que « la mesure rendra l’illusion (phantasma) sans force » (d8). Nous voyons donc que l’homme juste, quant à lui, trouvera la vertu plus plaisante que le vice, puisque sa vision, sans perspective, lui permet de voir que la vie vertueuse recèle au total plus de plaisir que de peine. Le savoir en nous modifie la sensibilité. Platon utilise pour nous le faire comprendre plusieurs images assez saisissantes. Ainsi, au livre X de la République, Socrate nous invite à comparer ce qui arrive à la beauté des œuvres de l’art d’imitation lorsqu’on les dépouille de leurs séductions immédiates et que l’on en mesure la vérité : « ne ressemblent-elles pas aux visages de ceux qui ont la fraîcheur de la jeunesse, mais qui sont sans beauté, tels qu’on en vient à les voir lorsque cet éclat s’en va ? » (601b6-7). Voir avec les yeux de l’esprit amène à faire une expérience étonnante : comme si l’on voyait, tout de suite, sans attendre, le défraîchissement sur le visage d’un adolescent qui n’a pour lui que la jeunesse. Certaines séductions disparaissent
platon160p_V2.indd 114 13/10/10 10:35:32
115
le jour où elles sont mesurées selon leur poids réel de douleur et de joie et non plus artificiellement gonflées par des effets de perspective. Dès lors, un véritable hédonisme est possible, c’est-à-dire la possibilité de nous décider pour une vie dans laquelle il y a véritablement (et non apparemment) plus de plaisir que dans une autre. L’expérience de mesure des plaisirs et des douleurs proposée par Socrate dans le Protagoras trouve ainsi son illustration à l’échelle de la vie entière dans un passage des Lois. Il s’agit d’abord d’établir les critères de mesure. On commence par faire quelques mesures simples avec un seul critère, qualitatif : nous souhaitons avoir du plaisir, tandis que nous ne choisissons ni ne souhaitons avoir de la douleur ; quant à l’état neutre, nous ne le souhaitons pas à la place du plaisir, mais nous le souhaitons en échange de la douleur (V 733a9-b3). On peut ensuite introduire la quantité (et donc la fréquence) : nous dirons oui à un état où le plaisir est en plus grande quantité que la douleur, mais pas à un état où cette dernière l’emporte. S’ils sont en quantité égale, nous sommes indécis. Il faut introduire le critère de l’intensité. Une vie où ces deux états sont fréquents et intenses mais où l’un l’emporte : nous prenons la vie où l’emporte le plaisir et rejetons la vie avec la mesure inverse ; une vie où ces états sont, l’un et l’autre, en faible nombre et en faible intensité mais où l’un néanmoins l’emporte : nous rejetons la vie où l’emporte la douleur et acceptons l’autre ; enfin, dans le cas d’une vie où les deux opposés s’équilibrent en quantité et en intensité, alors l’indécision revient – nous choisissons de nouveau ce en quoi domine le plaisir et rejetons ce en quoi domine la douleur. Toutes les vies possibles sont nécessairement et naturellement liées à ces oppositions, et nous désirons par nature celles qui ont les proportions que nous avons dites (733d2-6). La vie vertueuse tire du savoir, et plus précisément d’un art de la mesure, le moyen de donner à notre nature vivante le calcul des plaisirs et des douleurs qui lui convient. Elle présente par conséquent le maximum de plaisir, en quantité par rapport aux douleurs qu’entraînent les vices, et, surtout, en qualité – la vertu s’accompagne d’un apprentissage des plaisirs les plus purs et les plus durables. Pour comprendre ce dernier point, il faut entrer dans l’examen de la nature même de l’âme. Ce sera aussi l’occasion d’étendre les possibilité de transformation de soi à l’ensemble de la collectivité.
platon160p_V2.indd 115 13/10/10 10:35:33
116
Chapitre III
La production des vivants : individus, cité, cosmos
Manuel du producteur
§ 1. Qu’est-ce qu’un vivant, qu’est-ce qu’une âme ?
Qu’est-ce qu’un « vivant » ? Nous traduisons ainsi le terme grec zôion que l’on pourrait être tenté de traduire par le terme français « animal », mais cette traduction est fâcheuse pour le lecteur d’aujourd’hui, parce que celui-ci est habitué à entendre par « animal » quelque chose qui n’est pas l’homme et qui n’est pas non plus la plante. Nous tendons aujourd’hui à réserver ce terme aux êtres doués d’une faculté de mouvement qui ne sont pas de notre espèce. Platon ne saurait mettre ainsi l’homme à part : celui-ci est simplement l’une des choses qui ont reçu la vie en partage, une parmi d’autres, ni la moins bonne, ni la meilleure. « Ce qu’on appelle un vivant, c’est cet ensemble, une âme et un corps fixé à elle » (Phèdre 246c5). Qu’est-ce que l’âme ? C’est pour Platon le principe des mouvements à l’œuvre dans l’univers, la cause de tous les autres mouvements. Le vivant le plus important est le monde lui-même : le monde dans lequel nous vivons est animé, sans quoi il ne serait pas la source de son propre mouvement. Cette idée est affirmée à l’occasion du développement cosmologique du livre X des Lois. Tout est un mixte de mouvement et de repos (893 b 7-8), et le mouvement se dit de multiples manières, puisqu’il y en a même dix formes (893 c 3 – 896 e X). La première distinction (que l’on retrouve en Théétète, 181 c6-d6, et en Parménide, 138 c 5-6) est celle du mouvement sur place (rotation sur un axe immobile, periphora) et du mouvement par changement de lieu (la translation, phora). Six mouvements résultant de la rencontre entre des mobiles sont distingués, par couples : division et composition, augmentation et diminution, génération et corruption. Il s’agit moins d’une typologie abstraite que de l’affirmation de la continuité naturelle entre des formes de mouvement qui passent les unes dans les autres : l’augmentation résulte de la composition, la diminution résulte de la division, et la génération est une somme de mouvements, un « métamouvement » par lequel toutes choses naissent (metakinoumenon gignetai pan, 894a6) – la corruption consistant dans le fait que la somme des mouvements finit par passer une limite et compromettre l’ordre propre à la chose. Les deux derniers mouvements énumérés par l’étranger sont : le mouvement qui meut tout le reste sans se mouvoir lui-même (le mouvement de la voûte céleste) et le mouvement qui peut se mouvoir lui-même et mouvoir autre chose, c’est-à-dire le mouvement de l’âme, principe automoteur. Ce mouvement est nécessairement le premier de tous, puisqu’aucune autre chose ne saurait se mettre en mouvement elle-même. Que l’on suppose en effet que toutes choses soient en repos,
platon160p_V2.indd 116 13/10/10 10:35:33
117
« toutes ensemble confondues » (895a6), laquelle, entre toutes ces formes de mouvement, aurait pu être la premiere à se produire en elles ? Rien d’autre que le mouvement qui se meut lui-même, puisqu’il n’y avait auparavant aucun mouvement en elles qui ait pu mettre en mouvement l’une des formes du mouvement qui ne se meut pas lui-même. Telle est donc l’âme, un mouvement qui se meut lui-même. Le mythe, lieu de mise en scène de l’invisible, est propice à une tentative de « connaître de manière véritable la nature de l’âme, qu’elle soit divine ou humaine, en regardant ses affections et ses actes » (Phèdre 245c2-4). Le point de départ d’une telle entreprise est la prémisse suivante : « toute âme est immortelle, car tout ce qui est toujours en mouvement est immortel » (c5). Or qu’est-ce qui pourrait être toujours en mouvement, sinon ce qui se meut soi-même ? « Ce qui meut autre chose tout en étant mû par autre chose, cesse de vivre quand cesse le mouvement : seul ce qui se meut soi-même, puisqu’il ne se fait pas défaut à lui-même, ne cesse jamais d’être mû, mais se trouve être la source et le principe du mouvement de toutes les autres choses qui sont mues » (c5-9). Sans un tel mouvement, sans le fait qu’il ne puisse ni être détruit ni naître, le ciel tout entier s’effondrerait, et tout ce qui est destiné à naître disparaîtrait aussi. Or, de « ce qui se meut soi-même », on peut dire que c’est « la réalité (ousia) de l’âme » et sa définition même (logos) ou encore sa nature même (phusis), en vertu de laquelle elle confère un pouvoir aux corps auxquels elle s’associe : « tout corps en effet qui reçoit le mouvement de l’extérieur est inanimé (apsukhon), et tout corps qui le reçoit de l’intérieur, de lui-même, est animé (empsukhon), car c’est là la nature de l’âme (e3-6). Dès lors il s’ensuit aussi que tout ce qui a part à une telle réalité a en charge de donner le mouvement à ce qui ne fait que le recevoir (que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur) : « toute âme prend soin de tout ce qui est inanimé », c’est-à-dire des corps, qui, par l’union avec l’âme, reçoivent le mouvement, qu’ils deviennent ensuite animés ou non. « Ainsi l’âme fait le tour du ciel tout entier, venant à prendre telle forme ou telle autre » (246b6-7). Il y a l’âme qui fait corps avec le monde et ainsi, parfaite, « administre le monde (kosmos) entier » ; il y a celle, déchue, qui « s’empare d’un corps fait de terre et paraît se mouvoir de lui-même grâce à la puissance de celle-ci » (c1-4). Or c’est cela, comme nous l’avons vu, cet ensemble formé d’une âme et d’un corps fixé à elle, que nous appelons un « vivant ». On distingue le vivant immortel, lorsque ce corps et cette âme sont unis pour toujours, comme c’est le cas pour le monde, du vivant mortel pour lequel une telle séparation est possible. Il y a donc des vivants de toutes sortes dans l’ensemble défini par la réalité de l’âme, depuis les dieux jusqu’à la plante, et nous ne sommes qu’une des formes possibles d’êtres doués de vie psychique. Comme nous l’avons appris pour la beauté, il faut éviter de privilégier un exemplaire qui nous est familier dans l’océan des choses qu’une forme unifie.
platon160p_V2.indd 117 13/10/10 10:35:33
118
§ 2. Les ingrédients de la réalité psychique
Après avoir défini la réalité de l’âme et statué sur l’immortalité qui en découle, Socrate, dans ce mythe du Phèdre, ajoute qu’il faudrait pouvoir ensuite dire ce qu’est la forme (idea) de l’âme, c’est-à-dire « quel type de chose elle est » (246a3-4) – par quoi Socrate entend parler de la puissance, comme nous allons le voir. Or cela supposerait, nous dit Socrate, un exposé beaucoup trop long pour la présente circonstance, et surtout, un exposé divin – fait par un dieu lui-même ou inspiré par un dieu. Les pauvres mortels pourront se contenter d’une représentation de ce que l’âme « semble » être, plutôt que d’une description véritable de sa forme. On peut s’étonner que la description du type de chose qu’est l’âme soit, après avoir si facilement énoncé la définition de sa réalité, si difficile à accomplir. Il s’agit en effet de décrire des choses moins fondamentales : non pas la nature même et l’immortalité qui en découle, mais le type de puissance qui pour l’âme découle aussi du fait d’être ce qu’elle est ; or la puissance, en tant qu’elle découle de la nature, lui est subordonnée. Pour expliquer que l’exposé sur ce qui est subordonné soit plus long et plus divin que l’exposé sur ce qui est plus fondamental et plus principiel, il faut probablement alléguer qu’un tel exposé serait plus difficile non parce qu’il faudrait connaître des choses plus fondamentales encore, et par là plus divines, mais au contraire connaître un grand nombre de détails et de précisions sur des choses plus mêlées, ce qui exige une minutie du détail qui elle aussi est digne d’un dieu : la connaissance divine s’atteste aussi dans la capacité à connaître la totalité des choses jusque dans leur infime détail (voyez Lois X 903b). Il est relativement facile de dire la réalité même de l’âme, qui est auto-mouvement, il est plus difficile de dire le détail de ses puissances. Le mythe offre une image, celle de l’attelage et du cocher, censée nous permettre de nous faire une idée de la puissance de l’âme, qui est le fruit d’une composition, et qui sera d’une nature différente selon le type de composition qui sera à chaque fois la sienne. Suivons le langage imagé du mythe : chez les dieux, nous dit Socrate, les chevaux et les cochers sont tous bons, alors que pour les autres, ils sont mélangés (246b1). Chez les hommes, le cocher commande à deux chevaux dont l’un est bon et l’autre mauvais. Le mythe décrit chacune des âmes comme un tel attelage et aussi comme une créature capable, grâce à ses ailes, d’aller vers le haut autant qu’elle le peut, et susceptible de tomber lorsque ses ailes sont endommagées : l’aile, parce qu’elle est, de toutes les parties corporelles, celle qui participe le plus au divin, représente ainsi ce qui, dans une âme, est développé par la beauté, la bonté, la sagesse ; les qualités contraires corrompent l’aile de l’âme (246d6-e4). Les deux types d’images sont conjoints par Socrate : on peut dire par exemple qu’à cause des mauvais cochers, ceux qui ne parviennent pas à dompter leurs chevaux, les âmes peuvent être endommagées, avoir leur plumage en mauvais état (248b). Les mauvais cochers sont ceux qui n’ont pas su dresser leur cheval (247b3-5). Que cela signifie-t-il ? Passons de la représentation imagée du mythe à la saisie directe de l’invisible puissance.
platon160p_V2.indd 118 13/10/10 10:35:33
119
Dans l’âme, il y a une multiplicité de choses différentes, comme dans un attelage – et nous verrons progressivement que l’image est très bien choisie, car, comme dans un attelage, il sera question de savoir quel type d’accord peut être atteint entre des entités en mouvement et sous la direction de laquelle d’entre elles. Les commentateurs de Platon ont beaucoup discuté de la question de savoir comment l’on doit appeler ces choses : des parties de l’âme ? Faut-il récuser ce vocabulaire comme nous y incite Aristote parce qu’il suppose une division de l’âme dont les conséquences risquent de ne pas être contrôlables 79 ? Pour notre part, nous pensons qu’il faut, selon Platon, réellement diviser l’âme. Il y a dans l’âme trois êtres qui sont bien plus que des parties : ce sont chacun de véritables principes d’action comme Socrate le précise lui-même – trois principes (arkhai), qui sont responsables en nous d’autant de désirs (epithumiai) tendus chacun vers une forme spécifique de plaisir (République IX 580d7-8). Dans le passage de la République qui accomplit la distinction très nette de trois tendances fondamentales dans l’âme humaine Socrate utilise semble-t-il indifféremment les termes de « partie » (meros), d’« espèce » (eidos) ou encore de « genre » (genos), comme le font aussi d’autres interlocuteurs des dialogues. Comme souvent chez Platon, il vaut mieux suivre le fil de l’idée que celui du mot. Or la conception que se fait Socrate du type d’altérité à l’œuvre au sein des âmes peut être clarifiée si l’on garde bien à l’esprit que la multiplicité est ici produite par l’application à la vie psychique du principe suivant : « Il est manifeste que le même ne consentira pas à faire ou à subir en même temps des choses opposées sous le rapport de la même chose et en relation avec la même chose, de telle sorte que si par hasard nous trouvons que cela se produit dans ces actes-là, nous saurons que ce n’est pas la même chose, mais plusieurs, qui font ou subissent cela » (436b8-c1). Les éléments actifs que l’on cherche à distinguer au sein de celle-ci devront être différenciés, individualisés, davantage que les simples aspects ou parties d’un tout – elles ne seront plus les différentes parties d’une même chose, comme le sont, pour invoquer les exemples pris immédiatement par Socrate, les différentes parties d’un même homme (d1-2) ou d’une même toupie (d4-e6), qui sont capables d’être en repos quand les autres sont en mouvement, mais de véritables principes d’action doués de leur puissance propre. Voilà donc la question, difficile, à laquelle il faut répondre, celle de savoir « si c’est par la même chose en nous-mêmes que nous accomplissons chacune de nos actions, ou si, comme il y en a trois, c’est par une chose différente que nous accomplissons chacune : est-ce que nous comprenons par l’une, est-ce que nous nous emportons par une autre, désirons par une troisième encore les plaisirs de la nourriture et de la reproduction et tous ceux qui sont frères de ceux-là ; ou est-ce que c’est par l’âme entière que nous accomplissons chacune de ces choses, à chaque fois que nous nous élançons ? » (436 a8-b2). Ormaô, je m’élance : Socrate emploie ici le verbe qu’il a aussi employé à propos de Thrasymaque, lorsque celui-ci, au livre I, 79 Aristote critique la séparation des parties de l’âme platonicienne notamment dans le traité De l’âme, III, 9, 432a22-b7.
platon160p_V2.indd 119 13/10/10 10:35:33
120
s’impatiente en écoutant Socrate s’entretenir avec Polémarque, plusieurs fois prend son élan pour se saisir de la parole (336b1-2), plusieurs fois est retenu par ses voisins, mais finit par « se rassembler sur lui-même comme une bête féroce » (b5-6) et « se jeter » sur ses proies. Thrasymaque est ici l’incarnation non pas seulement de l’élément irascible de l’âme, mais de l’élan qui est à l’œuvre plus fondamentalement dans celle-ci, sous diverses formes, et qui est l’expression de cette énergie qui lui est propre en fonction de sa nature dynamique. L’âme s’élance, se jette sur des choses, et, comme il ressort bien de ce texte, il n’y a pas là de différence entre les différents objets de l’âme : qu’il s’agisse de saisir l’objet du savoir, qu’il s’agisse de colère, de désir sexuel ou de nourriture et de boisson, dans tous les cas, quelque chose en nous s’élance. L’appétit du sexe n’est pas plus une tendance que celui du savoir : ils peuvent avoir des forces différentes selon les individus, mais chacun de ces mouvements de l’âme est au même titre un élan. Chacun de ces principes d’action correspond à un désir (IX 580d7-8). Ormaô : je m’élance ; typiquement, on pourra dire par exemple que je m’élance à la poursuite ou que je prends la fuite. Or la vie de l’âme est faite de ces élans positifs et négatifs. Chacun des élans qui nous anime est simultanément un élan vers et contre : c’est là l’origine de la polarisation de l’espace, physique et mental, autour des vivants – tout vivant poursuit et rejette immédiatement quelque chose. Socrate exprime bien cette liaison intime du poursuivre et du rejeter par une image, celle de l’archer. Il n’y a pas, dans l’âme, de désir indifférencié, tout élan étant un élan vers un objet déterminé – celui qui a soif désire boire, « c’est cela qu’il désire et vers cela qu’il s’élance » (IV 43b1) ; il n’y a pas de non-désir de quelque chose, mais seulement des élans vers des choses et contre des choses. Or, avant d’arriver à ce deuxième point, Socrate s’est d’abord demandé à quoi pourraient ressembler, dans l’âme, des « opposés » auquel notre principe des opposés puisse s’appliquer. Il s’est assuré que l’on pouvait opposer des mouvements d’approbation et de désapprobation, de convoitise pour un objet et de rejet de celui-ci, de volonté d’attirer à soi ou au contraire de repousser (437b1-5). Or tous les désirs appartiennent à la première espèce de mouvement : à chaque fois que l’on désire, l’âme convoite, veut attirer à soi, souhaite que cette chose arrive (437 b6-c7). Et, de même, afin de s’assurer de l’exhaustivité de cette division entre mouvements de poursuite et mouvements de rejet, on fait basculer les états intermédiaires, comme par exemple « simplement ne pas avoir envie de quelque chose », du côté du mouvement négatif de repousser quelque chose : « ne pas vouloir », « ne pas consentir », « ne pas désirer » , toutes ces choses seront classées du côté du « repousser » et du « chasser loin d’elle-même », et du côté de tout ce qui est opposé aux mouvements précédents (437c8-10). Ainsi sont présentés deux genres opposés, qui doivent partager le champ de toutes les actions : c’est seulement parce que la vie psychique est ainsi constituée de mouvements antagonistes que le principe des opposés peut s’y appliquer et nous permettre de reconnaître en nous de telles tensions (439b3-6). Dès lors
platon160p_V2.indd 120 13/10/10 10:35:33
121
on pourra reconnaître derrière d’apparentes oppositions entre un désir (je tends vers telle chose) et une négation de ce désir (cette chose ne m’attire pas), comme dans le cas des gens qui disent avoir soif et ne pas souhaiter boire (c2-3), un véritable antagonisme (quelque chose en nous veut cela, une autre chose le repousse) dont l’archer donne l’exemple, lui dont les mains « à la fois repoussent et attirent l’arc » (b8-10). L’archer à la fois tire et pousse la corde de son arc : les deux espèces de grands mouvements psychiques s’opposent comme tirer et pousser la corde d’un arc s’opposent – c’est-à-dire comme la même action inversée. Or une telle opposition ne peut être le fait du même agent au même moment : pas plus que le même agent ne peut en même temps être le patient de sa propre action, il ne peut en même temps faire une action et l’action inverse, tirer et pousser le même objet, aller vers la gauche et vers la droite, monter et descendre. Nous parvenons à une multiplicité de principes dans l’âme en constatant que des tendances antagonistes sont à l’œuvre en nous. Il ne reste plus qu’à isoler deux situations de conflit (entre désir et colère dans le cas de Léontios désireux de voir les cadavres, 439e-440b, entre raison et affliction dans l’homme qui frappe son cœur, 441c) pour établir la présence de trois principes indépendants dans l’âme. Ce que l’analyse de l’application du principe de conflit établit, c’est que ces parties de l’âme ont pour particularité d’être des principes d’action autonomes, dont les logiques sont étrangères les unes aux autres. Comme le rappelle Socrate dans son résumé du livre IX, il y a cet élément de nous-mêmes par lequel nous apprenons, celui par lequel nous nous emportons et le troisième, auquel, dit-il, il est difficile de donner un nom à cause de sa propension à prendre des formes différentes (dia polueidian) – et nous nous sommes résolus à l’appeler par ce qu’il y a en lui de plus puissant – le désir lui-même, particulièrement intense dans les cas où l’on poursuit la nourriture, la boisson, les plaisirs du sexe (les aphrodisia), et aussi la richesse qui est le meilleur moyen d’obtenir toutes ces jouissances (580d10-581a1). Comme c’est parfois le cas, une des espèces prend le nom du genre : l’une des trois formes de désir, à la fois parce qu’elle ne manifeste pas assez d’unité pour suggérer un nom qui lui soit propre et que ses expressions révèlent sous sa forme la plus brutale l’élan propre à tout désir, en vient à s’appeler désirante. Différencions bien les puissances qu’il peut y avoir dans l’âme. Il y a des « parties » qui sont plus que de simples parties au sens d’aspects différents d’une même chose, mais de véritables « principes » d’action, que l’on peut qualifier comme autant de formes du désir : un de ces éléments est « ami de la richesse (philokhrêmatos) et du gain (philokerdes) », l’autre « ami des victoires (philonikos) et des honneurs (philotimos) » et l’autre « ami de l’apprentissage (philomathès) et du savoir (philosophos) » (581a6-b9). Or si chacun de ces éléments est un désir, c’est parce que chacun d’eux s’élance vers quelque chose : un plaisir spécifique. C’est en reconnaissant qu’il y a trois plaisirs associés aux trois principes d’action qu’ils ont du reste pu être reconnus comme des désirs. Revenons une fois encore en effet à la phrase
platon160p_V2.indd 121 13/10/10 10:35:33
122
dont est déduite l’idée qu’il y a autant de désirs qu’il y a de principes dans l’âme : « Comme il y a trois êtres, il me semble qu’il y a aussi trois plaisirs, chacun d’eux étant spécifique à l’un des trois » (580d7-8). Il y a ainsi trois espèces du plaisir (c6), et trois espèces d’hommes correspondantes (c3-4), selon le type de plaisir que chacun juge le meilleur et le type de vie que chacun mène en conséquence : chacun de ces trois hommes désigne l’une de ces vies comme la plus agréable et vante l’une des formes de plaisir. On peut distinguer chacun des principes (qui a, en tant que principe, une puissance spécifique) de la configuration propre à chaque âme (le fait que tel type de désir y prend le dessus) qui définit son type spécifique et sa puissance spécifique : sa forme, pour reprendre l’usage du terme fait par Socrate dans le mythe du Phèdre. Or il faut clairement distinguer ces deux niveaux, celui des grandes tendances psychiques et celui de la puissance de l’âme qu’elles permettent de définir, de ce que l’on appellera par ailleurs les puissances de l’âme au sens des facultés diverses qui s’y trouvent, ainsi qu’elles sont présentées au livre V de la République (voir chapitre premier, §3).
§ 3. La combinaison des ingrédients psychiques : mode de présence des vertus dans les âmes et les cités
Les différentes formes d’âmes : voilà cet invisible qu’il nous faut parvenir à voir – les différents rapports entre parties, les diverses façons de les agencer qui constituent autant de sous-ensembles du multiple qui constitue la réalité de l’âme. Or la vertu dans les âmes, comme dans les cités, est le résultat d’une certaine répartition des éléments, un effet de structure. C’est bien de cela qu’il s’agit : parcourir les différentes formes d’âmes, c’est voir la vertu et les vices des âmes, les formes d’ordre et de désordre qui règnent en elles et assignent chaque âme à une forme différente. Cette idée que la vertu est présente dans les choses sous la forme d’un ordre est explicitée par le texte du Gorgias que nous avons déjà lu et qui décrit toute les formes de production comme une production d’ordre. L’artisan ne fait rien au hasard mais en ayant en vue un seul objectif, de telle sorte que ce qu’il réalise dispose en soi d’une forme (eidos) déterminée (503 e1-4). Donner à chaque fois la forme recherchée à un meuble ou à un corps, c’est parvenir à créer une harmonie entre ses éléments. Or l’ensemble de ce passage a quant à lui un but très précis : étendre cette analogie à un art supplémentaire, celui qui aurait pour objet l’âme. On peut dire d’une maison faite « avec ordre » et « bien disposée » qu’elle est une maison de valeur, et dans le cas contraire une maison minable, de même, pour un navire, pour un corps et aussi pour une âme, « c’est par l’ordre qu’on y trouve, par sa disposition intérieure », que l’on pourra dire que c’est une âme de valeur (504 a7-504 b6). Il faut ajouter une fonction causale attribuée ici à cet ordre en 504 b6-d3 : l’ordre produit dans la chose est cause des qualités qui y sont présentes, comme « ce à partir de quoi en elle… naît » la qualité (c9). Ce
platon160p_V2.indd 122 13/10/10 10:35:34
123
passage a le mérite de préciser la question de la causalité de la forme en nous amenant à distinguer la causalité paradigmatique de l’unité formelle et la causalité directe de l’ordre à chaque fois réalisé dans chaque chose particulière :
Lieu de la causalité Nom du type d’ordre produit Nom de l’effet de l’ordre
Dans le corps «sain» (hugieinos) La santé et toutes les autres qualités physiques (c9-d1)
Dans l’âme «discipline (nomimos) Justice et tempérance (c9-d1) et loi (nomos)»
L’ordre et la bonne disposition sont ce à partir de quoi les hommes deviennent policés et ordonnés – or, ajoute Socrate, c’est cela, la justice et la tempérance (d4). L’ordre est la cause des qualités tout simplement parce qu’il n’est autre que le mode de présence de ces mêmes qualités dans la chose : le mode de présence de la forme intelligible dans la chose, ce par quoi elle s’y traduit, comme nous l’avons vu dès notre étude de l’exemple de la navette80. Nous apprenons ici en outre qu’à ce titre, l’ordre est la cause de l’attribution de la qualité à la chose, et la cause de la participation de celle-ci à cette forme qui permet de nommer la qualité. Nous retrouvons très exactement notre losange paradigmatique : la production des vertus des âmes est analogue à celle de l’ordre dans le meuble. La multiplicité psychique est le matériau mis en ordre pour la production de la vertu, comme des morceaux de bois sont agencés pour la production du meuble.
Le Gorgias (507a-e) permet d’affirmer l’unité des vertus sur le fondement d’un tel ordre psychique – elles sont toutes l’expression de ce même ordre dans l’action de l’homme vertueux, et on nommera les différentes vertus selon le contexte d’action de l’homme vertueux : il agit pieusement si c’est en rapport avec les dieux, justement si c’est en rapport avec les hommes, courageusement si c’est en rapport avec la fuite et la poursuite du danger et, si c’est en rapport avec la fuite et la poursuite du plaisir, avec modération. La République permet d’expliciter davantage encore ce modèle, grâce à une combinatoire des formes d’âmes selon le type de hiérachie qui s’instaure en elles et corrélativement dans les cités. Le livre IV permet d’expliciter la définition de chacune des vertus en termes de rapports entre les parties de l’âme. La question de l’ordre et de la structure de la cité est primordiale pour déterminer si la cité est sage ou courageuse. L’une ou l’autre de ces deux vertus est attribuée à la cité si l’élément auquel cette vertu appartient se trouve en position de domination, car c’est seulement dans cette position
80 Voir chapitre premier, § 4.
platon160p_V2.indd 123 13/10/10 10:35:34
124
qu’il est susceptible de transmettre sa qualité au tout. La sagesse est, semble-t-il, « ce qui se manifeste en premier en elle » (428a11-b1). Or à quoi cela se manifeste-t-il ? Par le fait qu’elle délibère bien, qu’elle est avisée dans ses délibérations (b3-8). La sagesse est une certaine connaissance, non pas une certaine connaissance particulière, comme celle que possède le charpentier, mais une connaissance qui permet de déterminer la façon dont la cité doit se comporter vis-à-vis d’elle-même et vis-à-vis des autres cités (c11-d3). Or c’est une connaissance rare, et seuls certains parmi les gardiens en seront capables : c’est par le plus petit groupe, par la plus petite « partie » d’elle-même, et par le savoir qui s’y trouve, qu’elle sera « entièrement sage » (e7-9) – il faut que ce groupe là dirige, pour que la cité entière soit sage. Si les sages sont soumis à d’autres groupes, comme dans le cas de l’oligarchie, alors la cité ne sera pas sage. On comprend bien pourquoi le Gorgias parle d’ordre, de position des éléments les uns par rapport aux autres.
Le même élément de position dans la cité intervient pour la détermination de son courage, même s’il faut dans ce cas distinguer deux situations différentes, selon que l’élément courageux est l’auxiliaire d’un pouvoir rationnel, ou qu’il domine lui-même, comme c’est le cas de la cité timocrate. Mais l’essentiel est que l’on ne puisse pas dire d’une cité où la partie courageuse n’est pas du côté du pouvoir (qu’elle en soit l’auxiliaire, ou qu’elle en assume elle-même la responsabilité) qu’elle est toute entière courageuse : une cité oligarchique, dirigée par la quête de richesses, ne pourra pas être dite courageuse, en tant que tout, mais seulement selon une partie d’elle-même, si ses soldats sont courageux. C’est la partie « guerroyante » de la cité qui possède le courage (429b1-3). Si on affirme donc encore que « la cité est courageuse par une certaine partie d’elle-même » (b8), c’est toujours dans la mesure où cette partie se trouve dans une position spécifique au sein du tout de la cité, à savoir une position de domination. Ceci est nettement établi par la précision selon laquelle les autres parties qui composent ce tout ne sauraient disposer de la capacité de lui transmettre le courage, quand bien même elles posséderaient cette vertu (b5-6). L’attribution de la tempérance et de la justice semblent reposer sur des critères différents. Ainsi la tempérance ne se produit pas comme le courage et la sagesse, c’est-à-dire lorsqu’une partie de la cité est capable de donner ces vertus au tout. Au contraire, elle « s’étend tout bonnement à travers la cité toute entière », faisant chanter la même chose, à l’unisson, à ceux qui sont faibles comme à ceux qui sont forts et à ceux qui sont entre les deux » (431e10-432 a4). On pourrait ainsi distinguer les deux premières vertus, qui sont transmises au tout par une partie dominante, et la tempérance qui n’existe que comme une vertu du tout lui-même. Mais cela ne fait qu’accentuer la nécessité de ramener la détermination des vertus de la cité à l’analyse de sa structure. La tempérance de la cité toute entière consiste précisément « en une sorte d’ordre » et résulte du fait que dominants et dominés s’entendent sur cette hiérarchie elle-même : elle consiste dans cette « identité de vues (homonoia) », cet accord conforme à la nature entre les différents éléments,
platon160p_V2.indd 124 13/10/10 10:35:34
125
celui qui est meilleur et celui qui est moins bon, au sujet de qui doit diriger, et ce, aussi bien dans la cité qu’en chaque individu (432a6-9). En ce sens, la tempérance est le signe de la différence qualitative entre la domination des meilleurs et les autres types de domination qui prévalent dans les cités et les âmes injustes. La justice, à son tour, est aussi la traduction directe de l’ordre qui règne dans la cité. Elle est la dernière « espèce » qui fera que la cité participe à l’excellence. On affirme que la justice était depuis un certain moment « sous nos yeux ». C’est précisément de cette chose que nous sommes déjà en train de parler en ayant posé dès le départ que chacun devait s’appliquer à une seule des fonctions de la cité (433a4-6) : « eh bien voilà, dis-je, cher ami, ce que se trouve être la justice, lorsqu’elle se produit d’une certaine manière – s’occuper de ses propres affaires (to ta hautou prattein) » (b3-5). Il n’est pas tout à fait anodin que Platon, qui n’est pas favorable à la démocratie, ait choisi, pour définir la justice, la formule par laquelle le tyran renvoie chacun chez soi, dissolvant ainsi le corps collectif du peuple ayant pris son destin en main : ainsi les fils de Pisistrate poursuivent les combattants athéniens en leur enjoignant de rentrer chacun chez soi et de « retourner chacun à ses propres affaires (epi ta heôutou, Hérodote, I, 63, 12) ». Au total, on obtient une analyse topologique de rapports entre parties, qui est le fondement de l’attribution de qualités à la cité. L’excellence est, dans l’âme comme dans la cité, comme dans le corps ou le meuble, un effet de structure, une résultante de l’ordre dans lequel nous avons appris à reconnaître la traduction d’une forme. Toutes ces choses sont les effets d’un art de production spécifique.
§ 4. La combinatoire en mouvement : la transformation des âmes et des cités
Comment en sommes-nous venus à voir l’invisible des âmes ? Il y a le mythe, bien sûr, comme celui du Gorgias (522b sq) qui représente les âmes par la nudité des corps. Il y a aussi la saisie directe de la typologie des puissances, c’est-à-dire des formes d’agencements entre les éléments psychiques. L’un des intérêts des analyses des livres VIII et IX de la République est de montrer que les cités et les âmes injustes constituent d’autres formes de hiérarchies, d’autres structures constituées à partir des mêmes éléments que ceux qui composent la structure vertueuse – même si l’on ne peut plus parler d’ordre à proprement parler, mais de tentative de conserver une hiérarchie dans un désordre structurel grandissant. En outre, plutôt que d’exposer de manière statique la typologie des différents types de régimes politiques – et désormais corrélativement psychiques – , le personnage de Socrate choisit de montrer comment ils naissent les uns des autres : comment la timarchie naît de l’aristocratie, l’oligarchie de la timarchie, la démocratie de l’oligarchie, et la tyrannie de la démocratie. Il s’agit de soumettre la réalité politique au principe d’une « enquête sur la nature » qui ramène chaque chose au principe dont elle tire sa naissance. On cherche ainsi comment se produit
platon160p_V2.indd 125 13/10/10 10:35:35
126
le « changement », la « transformation » des cités et des âmes les unes dans les autres. À partir d’une structure vertueuse, on voit naître des hommes « mixtes » à mesure que l’élément irrationnel s’accroît dans les âmes. La dégradation peut être suivie parallèlement au niveau individuel et collectif. Le naturel du fils de « l’homme de bien » semble en effet affecté par le fait de grandir dans une société où la proportion des natures dominées par le désir a grandi. Sa partie rationnelle étant nourrie par les discours de son père, il entre dans un conflit psychique à la suite de la stimulation, par d’autres voix dans la société, de sa partie désirante. La première source du changement se trouve donc dans le rapport de force entre les sources extérieures qui nourrissent les différentes parties de l’âme : arrivant à une opposition égale entre partie rationnelle et désirante, la solution de la « mixité » n’est plus tenable. Les deux parties, à force égale, entrent en conflit. La structure de l’âme, parce qu’elle est composée d’éléments actifs et que la « scission » prend en elle la forme d’un conflit entre agents, donne lieu à des phénomènes dynamiques particuliers : c’est ainsi par l’action du troisième principe, celui qui échappait jusqu’alors au conflit, qu’un nouvel ordre peut être fondé : « il prend le milieu entre les deux parties qui le tirent à elles et livre le gouvernement de sa personne à la partie intermédiaire, celle qui aime la victoire et qui est apparentée au cœur : il devient un homme orgueilleux et entêté d’honneurs » (République VIII 550 b4-7). Voici donc au niveau individuel la source de la dissension : nourrir en même temps des parties antagonistes de l’âme. L’âme et la cité fonctionnant de la même manière, il y a des chances que les mêmes phénomènes se produisent au niveau de la cité. La loi psycho-sociale à l’œuvre ici, c’est l’impossibilité de rester dans la balance des pouvoirs : l’âme ou la cité ont besoin de direction. Cette loi apparaît comme l’application à la structure de l’âme du principe de conflit. Il ne s’agit plus simplement d’antagonisme d’actions précises prouvant la multiplicité interne de l’âme, mais de l’antagonisme des parties elles-mêmes : l’agent doit, pour préserver son unité, retrouver un ordre qui dépasse l’antagonisme en réinstaurant une hiérarchie. Par exemple, on se sort de l’antagonisme par recours à un troisième principe actif. Ceci ne veut pas dire que toutes les transformations suivront ce modèle de la troisième voie : cela dépend à chaque fois du type de rapport existant entre les forces en présence. Le nouvel ordre, timocratique ou timarchique, se signale par une soumission de la partie rationnelle et de la partie désirante à la partie courageuse. Les hommes de guerre s’imposent au pouvoir. La genèse de la structure oligarchique se fait sur la base de l’ordre timarchique. Le phénomène déclencheur est le même que dans le premier cas : l’accroissement de la partie désirante. La marque de l’instabilité grandissante de structures injustes est qu’elles nourrissent elles-mêmes l’accroissement du désir qu’elles n’ont plus les moyens d’éduquer. La vigueur de l’honneur encore dominant entrant en antagonisme avec le désir va provoquer à nouveau la recherche d’une troisième voie – quoiqu’il ne s’agisse ici que d’un
platon160p_V2.indd 126 13/10/10 10:35:35
127
substitut de troisième voie, consistant dans la mise au pouvoir d’un désir capable de les réprimer tous : l’avarice et la recherche du gain. L’important est bien que l’oligarchie consiste en un nouvel ordre. Le fils né d’un père timocrate a vu la partie qui recherche en lui les honneurs nourrie, mais dans une société où le désir a grandi et où celui-ci n’est pas doué pour faire des affaires, il voit son père humilié dans un environnement qui ne reconnaît plus sa vertu, ruiné. Mais c’est la partie cherchant des honneurs en lui qui vit cet événement comme une humiliation, et il retrouve une structure en se mettant à faire grand cas de ce qui l’a humilié : il fait monter sur le trône de son âme « l’élément désirant et amoureux des richesses » (553b7-c7). Le désir d’argent a la faculté de pouvoir procurer un ordre en s’imposant aussi bien aux autres désirs qu’aux deux autres parties. Le désir d’acquisition constitue en effet la possibilité d’un effort sur soi-même, d’une ascèse à l’égard d’un certain type de désirs : l’homme oligarchique « n’accorde à la nature que la satisfaction des désirs nécessaires ; il s’interdit toute autre dépense, et maîtrise les autres désirs comme étant frivoles » (554 a 5-8). Comme dans le premier cas, les deux autres parties de l’âme sont soumises : « il me semble que l’élément raisonnable et celui qui est apparenté au cœur, il les met à terre aux pieds de ce roi, et, les réduisant en esclavage, obligeant l’une à ne rien calculer ni rechercher que ce dont peut provenir plus de richesse, et l’autre à n’admirer, à n’honorer que la richesse et les riches, à mettre toute sa gloire dans la possession de grands biens et de ce qui peut contribuer à les procurer » (553d1-7). Le moteur des transformations semble donc toujours venir de la progression de la partie désirante réprimée par l’ordre en place. Ainsi lorsqu’on isole « le début de la transformation en lui d’un régime oligarchique en un régime démocratique » (559 e1-2) : elle se situe au moment où le jeune homme, élevé par un père oligarchique, a commencé à « goûter au « miel » des faux-bourdons », c’est-à-dire de ceux qui ont commencé à poursuivre les désirs non-nécessaires – cette partie de l’âme que l’oligarchie avaricieuse avait pour but de maîtriser. La démocratie semble constituer le moment le plus volatil des transformations psycho-sociales, dans la mesure où toutes les instances pouvant jouer un rôle dominant quelque peu durable ont été dépassées et que l’on se livre à la poursuite de tous les désirs. Des mini-structures temporaires doivent voir le jour, le temps de la poursuite d’un désir donné, tâche à laquelle les autres éléments doivent pouvoir être subordonnés. Mais l’instabilité fondamentale de ce régime apparaît dans le fait qu’il finisse par retrouver la nécessité d’un ordre et par l’imaginer sous la figure de la tyrannie, c’est-à-dire de la soumission de tous au désir d’un seul. Les trois dernières structures se trouvent ainsi, de manières différentes, face au même problème : comment faire tenir une structure où l’élément dominant doive provenir de la partie désirante ? Ces structures sont de plus en plus dysfonctionnantes et de moins en moins capables d’assurer la durabilité de leur agencement : la démocratie, dans les âmes comme dans les cités, représente ce moment de refus radical de l’autorité – les ânes refusent
platon160p_V2.indd 127 13/10/10 10:35:35
128
de s’écarter du passage et les chiens ne reconnaissent plus l’autorité de leurs maîtres (563c) – où les âmes ne parviennent plus à se donner une direction et se trouvent donc dans une situation d’inconfort, puisque la fonction biologique de l’âme est de diriger (353d). C’est l’ultime preuve de la thèse défendue par Socrate à travers l’ensemble de la République et selon laquelle la justice dans l’âme est ce qu’il y a de plus efficace, de plus avantageux et de plus bénéfique pour celle-ci.
§ 5. Le savoir-faire apte à transformer les âmes et les cités et son modèle cosmique
Nous savons désormais que les âmes et les cités aussi sont susceptibles de la même mise en ordre que le monde ou que les corps. La clef de voûte du Gorgias est bien une double analogie : non pas seulement entre les objets que sont les meubles, le corps, et l’âme, mais entre les arts susceptibles de prendre soin de chacun de ces objets. Socrate a patiemment construit cette analogie contre Gorgias, puis contre Polos, puis encore contre Calliclès, afin de définir par analogie à la médecine, 1) l’objet (la bonne disposition, euexia), 2) le mode d’action (débarrasser du mal, l’injustice), et 3) la connaissance (celle du patient) propre à un art ayant l’âme pour objet (respectivement 464a-466a, 477 e-478 b et 500b-501c). Cette analogie est du reste pressentie à travers la plupart des dialogues dits de jeunesse. Le Criton a posé un jalon décisif : Socrate, en y affirmant que la parole de l’expert devait primer sur celle du nombre, a indiqué qu’il devrait bien y avoir, par analogie avec l’art qui sait ce qui est utile ou nuit à notre corps (47c5-7), un art qui sache s’occuper de cela qui, en nous, est précisement « ce que l’injustice abîme et ce à quoi la justice profite » (e6-7). L’analogie entre la justice et la médecine est alors mise en place d’une manière particulièrement frappante, puisque la justice et l’injustice sont ici pensées comme des états de l’âme susceptibles de lui profiter ou de lui nuire, analogiquement à la santé et la maladie dans le corps. Cette analogie était aussi posée par le Lachès : nous cherchions, par analogie avec la médecine, un art susceptible, en définissant les vertus, de définir cela même qu’il est capable de produire ou de restaurer dans les âmes (Ch. I, § 2). Le Gorgias remplit cette promesse, en faisant du bon orateur, de l’homme de bien s’adressant aux autres hommes, cet homme capable de produire en d’autres âmes cet ordre qui y produit les vertus. L’homme de bien, par ses discours, produit l’ordre dans l’âme, comme l’architecte le produit dans la maison et le médecin dans le corps : « c’est en ayant en vue ces choses-là que cet orateur-là, celui qui est compétent et bon, présentera ses discours aux âmes auxquelles il s’adresse, et dans toutes ses actions, qu’il lui arrive de donner ou de prendre, il aura toujours l’esprit dirigé vers ce but : faire advenir dans les âmes des citoyens la justice et les débarrasser de l’injustice, y faire naître la tempérance et les débarrasser de l’incontinence, et y faire naître toutes les autres vertus et faire qu’en disparaissent les vices » (504 d5-e3). De la même façon que dans chaque autre type de chose, dans
platon160p_V2.indd 128 13/10/10 10:35:35
129
les meubles, les corps, la perfection ne vient pas dans l’âme des vivants par hasard, « mais par un ordre, par une rectitude, par un art adaptés à chacun de ces êtres » (506 d 5-8.)
Or, de ce que nous savons de la physique des âmes et des cités, une telle capacité à produire ce type d’ordre dans les âmes autour de soi lorsque l’on parle et que l’on agit tient au fait que celui qui parle ou agit favorise dans les âmes des autres une disposition similaire à la sienne, nourrissant dans leurs âmes la partie qui en lui aussi domine. Nous touchons là à une particularité remarquable de l’art des choses morales. La capacité à définir, dont nous avons vu dans le Lachès qu’elle était le signe d’une capacité à produire, est en effet aussi, dans le cas de la compétence morale, le signe de la présence du même ordre dans l’âme de celui qui définit, comme en témoigne le début du Charmide, lorsque l’on demande au jeune garçon s’il sait ce que c’est, qui, présent en lui, a pour effet de le rendre sage : « Alors à nouveau, repris-je, mon cher Charmide, il convient que tu t’examines avec davantage d’attention, et quand tu auras saisi quelle est la chose que la sagesse, présente en toi, produit, ainsi que le caractère qui lui permet de produire cela, dis-moi bien, avec courage, en considérant toutes ces choses, ce qu’elle te semble être » (160d5-e1). L’expert qui réalise la vertu dispose donc nécessairement de la même vertu ou du même ordre en lui pour être capable de la définir et de la produire en un autre qui à son tour, en vertu de la présence de la même excellence, devient capable de la transmettre : ainsi Charmide est aussi un agent potentiel, en tant que « par sa sagesse », il peut aussi agir à son tour et produire d’autres effets similaires. Une chaîne de contagion fondée sur le savoir – et non sur l’ignorance de l’inspiration (Ion, 535e sq.) – est en train de s’ouvrir et elle suppose un savoir d’une nature tout à fait différente de celle des autres arts. L’action productrice morale semble avoir cette particularité d’impliquer que le savoir de l’agent et celui du patient puissent être le même, dans la mesure où, dans ce type particulier d’action, on pâtit précisément par là où l’on agit, c’est-à-dire par l’âme, et plus spécifiquement encore, par la disposition de celle-ci qui peut être décrite comme ordonnée ou désordonnée. Une des particularités fondamentales d’un tel mode d’action, c’est la puissance qui est par là conférée au discours. C’est par les discours que l’on a de l’effet sur les âmes, que les âmes ont de l’effet sur d’autres âmes. On en trouve l’application dans le Charmide : pour soigner le corps il faut commencer par soigner l’âme, et pour soigner celle-ci, il faut lui faire entendre de beaux discours, ou encore, des « incantations ». Socrate présente ainsi la doctrine d’un médecin Thrace : « or, disait-il, on soigne l’âme (therapeuesthai… tên psukhên) au moyen de certaines incantations, bienheureux ami ; ces incantations, ce sont les discours qui sont beaux ; or c’est sous l’effet de tels discours que vient dans les âmes la tempérance, qui, étant apparue et étant présente, procure dorénavant aisément la bonne santé à la tête et au reste du corps » (157 a3-b1). La capacité à définir les vertus est bien le signe d’un savoir capable par la parole de produire la vertu dans les âmes. Cette leçon du Charmide est en parfait accord avec le Gorgias :
platon160p_V2.indd 129 13/10/10 10:35:35
130
l’homme de bien, comparé au médecin en 503, est celui qui, par ses discours (504d-e), produira cet effet dans les âmes, contrairement aux ignorants (les sophistes et les orateurs) qui ne peuvent y produire que désordre.
Par-là, le savoir moral se distingue des autres sciences sur un point essentiel. Dans les autres sciences, il y a bien en effet une distinction entre théorie et pratique, parce que ce que l’on produit n’est pas cela que l’on a en soi : la disposition à savoir soigner les corps de leur maladie n’est pas ce que l’on produit dans le corps malade – mais ce que l’on produirait dans le disciple à travers un autre mode d’action, à savoir l’enseignement. Comme nous l’avons vu, il y a plusieurs types de puissance de l’art : produire les effets de son art (la santé dans les corps, par exemple), produire des disciples (former des médecins). La seconde puissance découle nécessairement de la première : tout homme de métier sait former des disciples, mais, dans les sciences en général, ces deux puissances sont distinctes par leur mode d’action et leurs effets. Nous découvrons néanmoins que la façon dont Socrate a cherché à concevoir une science morale sur le modèle des arts mène à une conjonction de ces deux modes d’action : ce que l’on produit par l’art moral est très précisément la disposition à produire que l’on possède. Tout se passe comme si l’application à la vertu du modèle technique avait en retour un effet considérable sur la définition des puissances de l’art : l’action vertueuse de celui qui a la vertu-science réunit en une seule les deux puissances de l’art : exercer l’art (faire le bien), c’est faire des hommes de bien. C’est d’ailleurs ce qui fait ressembler l’art moral à un effet naturel (l’homme juste fait des hommes justes, l’injuste des hommes injustes, comme l’humidité fait des choses humides, République I, 335d) – sa puissance contagieuse ne se laisse penser que comme effet naturel, tout comme est naturelle aussi la contagion de l’injustice, effet de l’ignorance81. C’est cette conjonction qui fait la puissance du savoir dans l’action morale, plus puissant que tous les autres savoirs, et que toutes les autres sources de motivation dans l’action, inconscientes quant à elles de leurs propres effets. Avoir le savoir dont parle Socrate dans le Lachès, dans le Gorgias, dans le Charmide, avoir le savoir qui passe avec succès le test de compétence technique appliquée à la question morale, ce serait savoir, grâce à une âme elle-même ordonnée, à la fois agir droitement en toute circonstance, et transformer par là-même les âmes de ceux qui sont témoins de ces actes et de ces paroles justes.
Que savent donc ces dirigeants qui transformeront la cité ? C’est ce que décrit le fameux livre VII de la République. Prenons la description alternative du livre XII des Lois, qui a l’avantage d’expliciter le modèle cosmique, objet de l’astronomie, qui reste implicite dans la République, même si la science astronomique est prescrite aux futurs dirigeants comme
81 Que la perspective qui réintègre l’action des hommes au sein des actions naturelles ait pour conséquence inévitable de rendre l’injustice aussi naturelle que la justice, ce point sera notamment repris et développé avec vigueur par Spinoza, voyez par exemple Traité Politique, I, §5. Et cela n’empêche en rien que l’on distingue néanmoins entre les effets qui sont ceux du savoir en nous (Spinoza dira de la raison) et ceux qui sont ceux engendrés par des causes différentes.
platon160p_V2.indd 130 13/10/10 10:35:35
131
couronnement des études mathématiques. Une fois la législation des Lois déclarée achevée (XII, 960b), il convient de sélectionner les membres du conseil chargé de la sauvegarde de la cité. Par une analogie avec les autres arts, on se demande quel type d’objet ces dirigeants devront connaître. On testera la faculté des futurs membres du conseil à définir la vertu, voir ce qu’elle est en soi-même et ce dans quoi elle se manifeste (963c3) : on retrouve encore les deux versants de la connaissance technique – connaître l’unité en soi et les configurations dans lesquelles elle se manifeste. Seul cet exercice dialectique, manifestant l’unité de toutes les parties multiples de la vertu, peut attester que nos dirigeants sont bien formés pour la réaliser dans la cité – comme la définition de la vision manifestait la compétence du médecin dans le Lachès. Les plus hauts dirigeants de la cité des Magnètes, ceux qui parviendront au collège de veille décrit au livre XII (960b-968e) devront savoir définir les vertus, et donc être dialecticiens.
Un texte décisif (Lois XII 967d4-968a1) lie cette capacité de définition à l’apprentissage spécifique des gardiens, qui doivent avoir acquis la connaissance des mathématiques par laquelle on parvient à comprendre l’ordre qui règne dans le ciel et la primauté de l’âme du monde, ainsi que celle des disciplines qui relèvent des Muses. Pour ce qui est des sciences mathématiques, l’Athénien a insisté sur l’inclusion de l’astronomie comme aboutissement du programme d’éducation (VIII 817e-822d) : c’est une science peu prisée par les Grecs mais qui aura l’avantage de leur apprendre que là où ils ne voient que désordre et chaos arbitraire, il n’y a qu’ordre et beauté. Le livre X a permis de développer le contenu de cette science du cosmos (890d-899d) ici attribuée aux gardiens du collège de veille : ayant étudié l’astronomie, ils auront saisi que l’âme est la chose la plus ancienne de toutes les choses, la première cause du mouvement de l’univers et qu’elle guide tous les mouvements, celui des astres reflétant les mouvements de son intellect. Voici la véritable science de la « nature », terme qu’il faut réserver à ce qui est cause première de tout mouvement (X 892 c1-5), c’est-à-dire à l’âme du monde. Nous retrouvons donc dans le collège de veille des hommes et des femmes qui, comme Timée, sont au fait de l’étude de l’ordre de l’univers. La science de la nature est la science des hommes et des femmes d’État. Comme l’affirme déjà la République, c’est précisément parce qu’ils ont pour objet des choses « ordonnées et toujours semblables à elles-mêmes, qui ne commettent ni ne subissent d’injustices les unes des autres, qui sont toutes en ordre et proportionnées », parce qu’ils cherchent à imiter ces choses, qu’ils sont des femmes et des hommes d’Etat de qualité, capables de « déterminer les mœurs des hommes, aussi bien privées que publiques », et non pas seulement se « modeler » eux-mêmes – bref, c’est pour cette raison qu’ils sont de bons artisans (dêmiourgoi), bien choisis « pour faire advenir la tempérance, la justice et toutes les vertus communes » (VI 500b8-e5). Le parcours de ces objets ordonnés des sciences mathématiques doit s’achever par une étude de leur communauté (koinônia) et de leur parenté (suggeneia) (VII 531d1-2). Dans les Lois, on précise qu’il s’agira de
platon160p_V2.indd 131 13/10/10 10:35:35
132
saisir la communauté des sciences mathématiques et des disciplines relevant des Muses. Un tel lien doit assurément consister dans cet ordre psychique que les unes découvrent dans l’univers et que les autres contribuent à créer dans l’homme. Ceux qui savent définir les vertus sont ceux qui savent en reconnaître l’ordre dans l’univers et dans les hommes – et pour cela, il faut connaître les disciplines qui ont ces différents types d’ordre pour objet. Savoir définir, c’est précisément être capable de faire voir à quoi ressemble, dans telle ou telle circonstance, la justice ou la vertu : savoir manifester les « propriétés » des différentes vertus (Lois, XII, 964b8-d1). Toujours les deux versants de la même connaissance : savoir définir l’unité, savoir reconnaître et modifier les types de configurations, en l’occurrence psychiques, dans lesquelles chacune se manifeste. Les dialecticiens redescendus dans la caverne font donc cela : manifester à propos de telle ou telle chose en quoi elle participe ou ne participe pas à la vertu. C’est du reste dans leur personne même qu’ils doivent pouvoir accomplir cette manifestation. Les gardiens devront en effet, « dans la parole et dans l’action », « montrer une vertu plus achevée que la plupart des gens » (d3-5). Or nous nous souvenons que la justice, la sagesse, toutes ces choses précieuses pour l’âme, ont moins d’éclat que d’autres unités intelligibles dans leurs imitations – ce qui implique que seuls quelques-uns parviennent à contempler ces formes à travers leurs manifestations et voient les « airs de famille » qui y subsistent (Phèdre, 250bc). Voilà l’apport du savoir dans la vie collective : rendre plus visible ce qu’il est juste de faire en telle ou telle circonstance, sans jamais quitter des yeux le but de la vertu complète. Tout le programme des Lois, de la répartition des lots de terre à la législation sur les mariages est déduit de ce but unique : voyez la déduction du programme législatif en son entier à partir de ce seul but en I 630b-632d. C’est précisément dans la matérialité du détail que le dialecticien doit faire ses preuves.
Pour créer une cité vertueuse, il faut pouvoir créer un accord des vues entre les citoyens, une communauté des affections – que les citoyens prennent du plaisir et de la peine aux mêmes types de choses82. Nous avons longuement parlé du vertige dont le plaisir et la douleur sont responsables au sein des âmes qui n’ont pas atteint le savoir total – ce vertige que nous parvenons quelque peu à contenir par le contrôle social et où nous plongent à nouveau les espaces de privauté et le spectacle des arts d’imitation. Il faut maintenant saisir la portée politique de ce vertige, qui est un facteur de dissolution de l’intérêt commun et de la cité. C’est parce que chaque être humain poursuit son plaisir et sa douleur à lui, qu’il est poussé à la poursuite de ses intérêts individuels (idiopragia) ; c’est pour cette raison que l’homme n’est pas naturellement en mesure « de connaître les choses bénéfiques aux hommes en vue de l’organisation de la vie collective, et, les connaissant, de
82 Sur la communauté des affections, voir République, V, 462c7-e2 et notre étude « Les Affections sociales : l’édification platonicienne de la philosophie politique comme partie de la science de la nature », in Les affections sociales, édité par Frédéric Brahami, Besançon, Annales littéraires de l’université de Franche-Comté, 2007.
platon160p_V2.indd 132 13/10/10 10:35:35
133
toujours pouvoir et de toujours désirer faire ce qu’il est meilleur de faire » ; c’est pour cette raison qu’il n’est naturellement pas en mesure de mettre le commun (to koinon) au-dessus de l’individuel (to idion) ». Fuyant sans raison toutes les douleurs et se jetant dans les plaisirs, l’âme individuelle « produit en elle-même un vertige (skotos) » et se remplit « finalement de tous les maux — elle-même et la cité toute entière » (Lois IX 874e8-c2). Au contraire, l’accord des plaisirs et des peines n’est possible durablement entre tous qu’à la condition que les âmes de tous soient harmonisées par la raison. Comme nous le savons, une telle harmonie ne peut qu’être l’œuvre de ceux qui, à la tête de la cité, possèdent la science de l’ordre divin et le prennent, en bons artisans, comme modèle pour produire l’ordre des âmes et de la cité.
Nous saisissons aussi l’effet du savoir, identique sur le terrain politique et sur le terrain individuel. Je voyais le bien, mais je n’ai pas pu m’empêcher de faire le mal : comme nous l’avons vu, ce bien et ce mal sont en réalité deux plaisirs qui ont été arbitrairement séparés et placés dans des groupes artificiellement opposés, sous prétexte que l’un est présent (la tentation à laquelle on a succombé) et l’autre à venir (le bien-être de demain). Or, faire des occasions de se réjouir et de s’affliger l’objet de la législation, c’est s’intéresser à la même question au niveau d’une société entière, où les gens, spontanément, ne répartissent pas bien les blocs de peines et de plaisirs : la réalisation du gouvernement du savoir doit amener à remettre sur le même plateau de la balance, pour toute une société, les plaisirs d’aujourd’hui et ceux de demain, comme les douleurs d’aujourd’hui et celles de demain. La même exigence de complétude dialectique que celle qui présidait à l’analyse de l’action individuelle et aux réfutations des tentatives définitionnelles des interlocuteurs de Socrate impose de parcourir la diversité des occasions de se réjouir et de s’affliger qu’ont les hommes en société, de l’acquisition des biens aux mariages, du commerce au bercement des enfants – autant d’occasions pour chacun de mal mesurer les plaisirs et les peines, de ne pas les intégrer aux bons ensembles. La profondeur de la saisie platonicienne du social est un effet de la dialectique. Le fait qu’une collectivité humaine, en la moindre circonstance de la vie de chacun de ses membres, ne soit pas capable de résister à des plaisirs ou à des douleurs présents par manque de véritable mesure des maux et des plaisirs de demain, impose à la politique platonicienne d’avoir pour objet la perception même et l’existence d’effets de perspective aliénant dans les représentations collectives : la politique doit dès lors inclure une action sur les représentations, notamment par le contrôle des arts qui favorisent l’illusion psychologique eu égard au plaisir et à la douleur.
Nous pouvons enfin répondre à certaines des questions par lesquelles nous avons commencé. Nous cherchions un modèle pour reconnaître les actes justes ou les choses belles quand nous les rencontrons. Nous avons écarté la candidature de choses justes et de choses belles au titre de modèle, mais il faut désormais nuancer. Certes, la plus belle femme du monde ou la cité la plus juste ne peuvent tenir lieu de forme de la beauté ou de forme du juste, c’est-à-dire d’unité de toutes les choses belles ou justes,
platon160p_V2.indd 133 13/10/10 10:35:35
134
passées, présentes, futures ou même qui ne se produiront jamais. Nous savons que chacune d’elles peut aussi se voir attribuer un attribut contraire sous un autre point de vue : que le plus beau des jeunes hommes est laid en comparaison d’Apollon lui-même. Néanmoins, le déploiement, dans la République, de la description d’une cité juste, chose juste parmi les choses justes, incarnation « idéale », « dans le discours » (V 473ab), de cette forme – mais néanmoins incarnation et non forme même de la justice – , manifeste le besoin de se donner certaines traductions types de la forme considérée. L’étude des mathématiques offre à son tour une représentation idéale de l’ordre inscrit dans le monde par une âme cosmique suprêmement juste. Connaître des formes de réalisation optimale d’une forme donnée dans une matière épurée – celle du discours ou de l’imagination – , procure à l’artisan un sorte de patron idéal, intermédiaire entre la forme elle-même dans son unité et la multiplicité de ses traductions. L’ordre mathématique du ciel, la cité idéale de la République sont de tels patrons. On pourrait objecter que ces différentes choses ont des manières très différentes d’incarner la justice, de la même façon que la jeune femme, la marmite et la jument ont des manières très différentes d’être belles, dont les descriptions ne seront pas homogènes. En réalité, cet argument tombe dans le cas du juste : les choses susceptibles d’être justes, à savoir les cités et les âmes (leurs actes le sont par dérivation : un acte juste exprime la justice d’une âme ou d’une cité), sont, comme nous l’avons vu, des choses qui ont la même structure : être juste, pour l’âme du ciel, l’âme d’un individu ou pour une cité, cela signifie la même chose et se décrit de la même façon. C’est peut-être l’un des éléments qui font la supériorité de la forme du bien, qui se traduit notamment dans la présence du juste : cette forme se traduit en toute chose par le même effet, à savoir la possession d’un ordre et d’une mesure qui permettent à chaque chose d’être tout simplement ce qu’elle est.
§ 6. L’intelligence collective et la création de nouvelles formes de partage du savoir
La nécessité d’une domination du savoir récuse aux yeux de Platon les institutions de tous les régimes politiques connus à son époque : le pouvoir des rois, des nobles, des riches ou du peuple sont tous déficients, pour autant qu’ils ne mettent pas le savoir et la vertu au sommet. Si les institutions où chacun peut s’exprimer en vue des décisions, quel que soit sont état d’ignorance, sont aussi récusées, le gouvernement du savoir implique néanmoins une participation de tous les citoyens à un processus par lequel les sentiments et les visions de chacun s’accordent. La domination de la raison, nous l’avons dit, est supposée être la seule forme de domination qui puisse persuader tous ceux qu’elle domine de son bien-fondé. Elle doit créer les conditions d’un accord de tous au sein de la cité. Cela suppose donc que même ceux qui ne disposent pas du savoir nécessaire à prendre telle ou telle décision en sachent néanmoins suffisamment pour pouvoir en
platon160p_V2.indd 134 13/10/10 10:35:35
135
toute occasion reconnaître à son œuvre le savoir véritable, notamment à sa capacité à placer le bien commun au-delà de tout intérêt individuel et à prendre soin de toute chose avec justesse. C’est bien la raison de l’étrange « mélange » que Platon entend réaliser d’un point de vue institutionnel, entre démocratie et monarchie, entre liberté et autorité (III 693a5-694a1). La liberté pure de la démocratie porte l’ignorance au pouvoir et multiplie les désaccords, l’autorité pure ne parvient pas à créer le commun assentiment dans la cité. Il faut là aussi, trouver le juste mélange. Il nous semble que les formes spécifiques d’espace public que les Lois tentent de créer incarnent précisément cette recherche du mélange entre autorité et liberté destiné à créer l’accord des vues. Il y a certes la nouvelle visibilité des arts, avec les chœurs collectifs, qui ont pour vocation de créer une forme d’imitation des actions humaines par lesquelles les citoyennes et les citoyens prennent plaisir à accomplir les actions et les gestes qui sont ceux de la vertu, et à regarder de tels mouvements êtres accomplis. Ce faisant, ils apprennent à reconnaître les signes de la vertu, à renforcer celle-ci par le plaisir pris à ces manifestations. Mais nous avons vu que les arts ne peuvent tout à fait faire disparaître les formes d’incohérence morale et affective qui ne disparaissent définitivement qu’en fortifiant la partie rationnelle de l’âme, nourrie de la fréquentation des formes intelligibles. Un autre type d’expérience collective que la pratique festive des arts est néanmoins proposée aux citoyens des Lois. Certes, d’un point de vue institutionnel, la cité des Lois n’est pas démocratique : Platon prive l’Assemblée des citoyens et le Conseil qui en est tiré de tout rôle législatif ou judiciaire véritable83, et s’il a recours aux élections pour certaines magistratures et notamment celles des gardiens des lois (VI, 753b-755b), cela ne constitue pas en soi un mode de désignation particulièrement lié à la démocratie antique, qui lui préférait le tirage au sort. S’il était besoin de confirmer que le mélange de servitude et de liberté, ou de monarchie et de démocratie, dont il est question, ne veut pas dire du tout qu’il reste quelque chose de démocratique au sens institutionnel dans le nouveau mélange84, on pourrait tout simplement ajouter que l’étranger trouve dans le régime monarchique de Cyrus « la plus juste mesure entre servitude et liberté » (III 694a3-4). Comment cette mesure se réalise-t-elle ? Elle suppose qu’existe une véritable hiérarchie : il y a très clairement des dirigeants et des dirigés, mais les premiers donnent aux seconds la plus grande liberté, faisant de ceux-ci leurs égaux (III 694a6-7) – le soldat voit dans le général un ami, et tous sont vaillants au combat. Surtout, l’effet bénéfique d’une telle combinaison de liberté et de servitude, c’est qu’elle permet de mettre l’intelligence de chacun au service du bien commun : « et si d’autre part il s’en trouvait un qui fut intelligent parmi eux et capable de délibérer, celui-ci, comme le roi n’était pas jaloux, accordant au contraire la liberté de parole et distinguant ceux qui étaient en quelque façon capables
83 Sur ce point, voir Luc Brisson, « Les magistratures non judiciaires dans les Lois », Cahiers Glotz, XI, 2000, p. 85-101.84 Sur ce point, voyez J.-F. Pradeau, Platon, les démocrates et la démocratie, Naples, Bibliopolis, 2005, p. 121-139.
platon160p_V2.indd 135 13/10/10 10:35:36
136
de donner des conseils sur quelque sujet, procurait, en la mettant au milieu, une capacité de réflexion commune : ainsi, tout prospérait alors chez eux, à travers la liberté, l’amitié et la communauté de pensée » (694b1-6). Voilà un exemple remarquable de ce qui, au yeux de Platon, peut être considéré comme une intelligence collective : un dispositif par lequel l’intelligence de chacun, quel qu’il soit, peut être immédiatement communiquée au tout. Le tout devient intelligent à la faveur de la mise en commun, par un individu, de sa capacité de conseil. Platon nous demande ainsi une ultime étape dialectique : l’ensemble des groupes dotés d’une intelligence collective excède les formes institutionnelles auxquelles on pourrait être tenté de le restreindre. La critique de la démocratie ancienne, chez Platon, n’entraîne en aucune façon de renoncer à reconnaître l’intelligence collective, bien au contraire. On a noté que Platon attribue à des groupes humains une intelligence collective, notamment à propos du conseil de pairs savants que nous avons décrit, qui jouit d’une intelligence collective, alliant l’acuité des sens de la jeunesse à la sagesse de l’âge, et qui rend aussi la cité collectivement intelligente85. Le Socrate du Protagoras reconnaît lui-même, en citant Homère, que lorsque deux hommes marchent ensemble, on peut espérer que l’un comprenne lorsque l’autre ne comprend pas : « nous les hommes c’est tous ensemble (hapantes esmen oi anthropoi) que nous nous en sortons mieux par rapport à toute œuvre, tout discours, toute pensée (pros hapan ergon kai logon kai dianoêma) ». Et si c’est seul que l’on a eu une idée, on s’en va immédiatement chercher quelqu’un à qui la démontrer afin de l’éprouver (348c7-e1). L’objection contre la foule des assemblées démocratiques n’est donc pas une objection contre la nécessité d’une intelligence collective, mais bien plutôt l’affirmation que ces assemblées ne permettent justement pas le développement d’une telle intelligence. C’est, selon le Socrate de la République, ce qui se passe lorsque « la foule compacte s’assoit ensemble à l’Assemblée, au tribunal, au théâtre, au camp militaire ou lors de tout autre rassemblement commun de la masse et qu’ensemble, dans un grand tapage, ils portent le blâme et l’éloge sur les actes et les paroles, exagérant dans un sens comme dans l’autre, hurlant et applaudissant, et que les pierres avoisinant le lieu où ils se trouvent leur renvoient, deux fois grossi, le tapage qu’elles reçoivent de leurs blâmes et de leurs éloges » (VI 492b5-d1). Il s’agit de proposer des dispositifs qui respectent davantage la différence du savoir et de l’ignorance et permettent à l’intelligence collective de se constituer de manière étagée et progressive. Considérons par exemple la façon dont l’étranger des Lois propose d’organiser une élection à la procédure aussi spécifique que celle des gardiens des lois (V, 753b4-d6). Les citoyens portant les armes y participent tous. Au premier tour, chacun vient au sanctuaire déposer sur l’autel une tablette où il marque le nom du candidat de son choix, mais aussi le sien. Chacun pourra pendant un mois venir consulter les tablettes sur l’autel et exposer sur la place publique celui
85 Voyez sur ces questions J.-F. Pradeau, op. cit., p. 59-62 ; 73-83.
platon160p_V2.indd 136 13/10/10 10:35:36
137
auquel il trouve à redire : on imagine que l’on pourra dénoncer quelqu’un qui aurait voté pour un autre envers qui, par exemple, il a des dettes. Les trois cents noms (soit une proportion très importante de la population qui compte 5 040 foyers) qui ont reçu le plus de voix sont exposés, et l’on choisit à nouveau. Les cent premiers sont exposés à nouveau. Enfin les trente sept premiers parmi les cent seront élus. Il est manifeste que cette élection est un véritable concours de vertu, concours de manifestation de la vertu et de reconnaissance de la vertu : il faut être reconnu par ses pairs comme possédant la vertu et il faut savoir reconnaître qui de ses pairs est vertueux. La publication du vote impose à chacun le sérieux de la réflexion : elle est un procédé pédagogique destiné à aider le citoyen à se soumettre à la recherche de la vertu parmi ses concitoyens, sachant que son propre choix pourra être sondé par tous. La population s’exerce ainsi à essayer d’entrevoir ce que les sages, dont l’œil est guidé par celui de l’esprit, reconnaissent plus clairement. Par l’institution de nouvelles pratiques publiques et collectives, il s’agit de créer les conditions d’un savoir partagé par l’ensemble des citoyens et d’un accord des perceptions – sans pour autant que les différences des formes d’expérience et de savoir ne soient nivelées : elles déterminent au contraire des places différenciées dans un processus général de participation à la vie publique.
ConclusionLe platonisme à venir
travaux préliminaires
I
L’actualité d’une philosophie
Actualiser une philosophie ne s’impose pas. Il peut être préférable de la laisser là où elle se trouve. Cette recommandation peut s’entendre de deux manières. Certains jugent une pensée « dépassée » parce qu’elle préconise des décisions que l’on se représente comme néfastes pour le présent. C’est souvent à ce titre que Platon est considéré comme un penseur qu’il vaudrait mieux abandonner au passé dont il n’aurait pas dû sortir. Le paradoxe est qu’une telle inactualité suppose encore une grande capacité à inquiéter le présent. C’est sur ce mode que Platon a été très actuel depuis la seconde guerre mondiale – suffisamment pour qu’il paraisse urgent de dénoncer sa contribution intellectuelle à l’entreprise de destruction de la « société ouverte »86. Cette actualité n’a cessé de se confirmer. Platon serait 86 L’influence de Platon favoriserait au contraire le retour à la société « close » ou « tribale ». Je fais référence à l’ouvrage de K. Popper, The Open Society and its Enemies, I : The Spell of Plato,
platon160p_V2.indd 137 13/10/10 10:35:36
138
le creuset des critiques contemporaines de la forme politique moderne que l’on appelle démocratie libérale en ce qu’il aurait par avance dénoncé le consumérisme, le relativisme et le refus de l’autorité que supposerait ce régime87 ; il humilierait la démocratie d’aujourd’hui en ce que son épistémologie, fondée sur l’idée qu’il y a des choses qui peuvent être connues et que seule la science permet de connaître en effet, nourrirait la position de pouvoir des experts qui écrasent le débat démocratique88. Que l’on nous permette de distinguer cette forme d’inactualité comme un sens faible de celle-ci, puisqu’elle se fonde au contraire sur le sentiment d’une présence forte de la pensée concernée. Que l’on s’en réjouisse ou que l’on s’en afflige, que l’on y voit un allié ou un ennemi, la question est entendue : Platon nous parle. À cette trop actuelle inactualité, nous en opposerons une autre, en invoquant l’implacable distance de l’histoire. Il faut renvoyer Platon au monde qui est le sien et dans lequel son propos s’est déployé, dans le contexte des formes politiques, sociales et scientifiques qui étaient celles de son temps. Nous avons suffisamment dit que la pratique que les Grecs ont nommée philosophie n’avait de sens que dans l’opération de donner à un tel contexte son unité réfléchissante. Il en découle, sans doute possible, qu’il n’est rien en elle qui puisse sortir indemne de l’altération radicale du monde dans lequel elle est née. Les tentatives qui ignorent cette dépendance de la philosophie à son temps et se saisissent immédiatement de la façon dont une philosophie écrite il y a vingt cinq siècles s’adresserait directement à notre temps, sont le plus souvent victimes de ce que l’on a pu appeler l’« obstacle homonymique »89 : le fait que nous employons dans de nombreux cas les mêmes mots que les Grecs, ainsi pour les formes politiques (« démocratie ») ou pour les sciences (« physique », « géométrie ») peut laisser croire à la permanence d’une réalité ou d’une question. De telles comparaisons s’appuient sur un élément de similarité en négligeant le fait que le tout dans lequel il prend place en modifie profondément le sens : on transpose ainsi facilement la critique des mœurs démocrates (le refus de l’autorité, la dispersion des habitudes), sans s’apercevoir que Platon parle d’une forme politique qui n’a de commun avec ce que nous appelons démocratie que le nom, et que cette réorganisation du dispositif affecte profondément le sens de la partie que l’on entend isoler. L’ensemble de la transformation doit être pris en compte, si le sens d’un énoncé ancien doit être compris, avant même d’être réinvesti de nouveau, sur un autre sol.
Londres, 1945 ; traduction française par J. Bernard et P. Monod, Paris, Seuil, 1962.87 Pour une version de cette idée chez un auteur à qui une telle interprétation ne déplaît pas, voyez l’ « hypertraduction » de la République annoncée par A. Badiou, par exemple dans sa contribution au collectif Démocratie, dans quel état ? Paris, La Fabrique, 2009, où figure un exemple tiré des passages du livre VIII consacrés à la critique de la démocratie.88 Je résume grossièrement l’argument de B. Latour, Politiques de la nature, comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris, La Découverte & Syros, 1999. Le deuxième paragraphe du pre-mier chapitre (intitulé « D’abord, sortir de la Caverne ») explique en quoi l’Occident est héritier – et prisonnier – du dispositif platonicien.89 P. Pellegrin emploie l’expression dans l’article « Physique » de l’encyclopédie Le Savoir Grec, Dictionnaire critique, dirigé par J. Brunschwig et G. Lloyd, Paris, Flammarion, 1996.
platon160p_V2.indd 138 13/10/10 10:35:36
139
Platon est inactuel au sens où il appartient à un monde englouti. Cet engloutissement prive de sens la reprise directe de ses énoncés et de ses questions dans notre monde. Toute reprise directe ? Un chemin indirect, précautionneux et long, est en revanche possible. Toute continuité n’est pas rompue en effet : les Grecs furent des membres de la même espèce que la nôtre, et cela suffit à faire de la variation que leur portrait fournit à notre représentation de l’humanité un point inestimable d’intérêt – si nous pensons que l’essence de l’animal que nous sommes doit être trouvée dans l’invariant qui se dégage à travers les variations les plus arbitraires. Le fait que le portrait soit riche, parce que ces humains-là, les Hellènes, sont à l’origine d’un certain nombre de pratiques sociales et intellectuelles qui nous ont été transmises non sans subir de profondes transformations – à commencer par celle de la philosophie – , ne rend pas l’étude de cette variation moins intéressante, quoique délicate, puisque les effets de continuité risquent d’aveugler qui ne prend pas garde à la fondamentale discontinuité. Les Anciens, qui se sont retirés de notre culture et de nos normes éducatives, ont cessé de nous être familiers. C’est de leur étrangeté que nous avons désormais le plus à apprendre. Et faire nôtre ce qui ne l’est plus est le début de l’expérience anthropologique vertigineuse qui est celle de l’étude des sociétés anciennes et des œuvres qui en elles vinrent à maturité.
II
Répéter une philosophie
La question de sa diversité interne
La possibilité d’actualiser une philosophie, quelle que soit sa terre d’origine, dépend de son degré de dépendance vis-à-vis des savoirs et des techniques de son temps. Or, de même qu’une période historique n’est pas une réalité homogène donnant à toutes ses parties la même texture et le même sens, une philosophie n’est pas non plus un corps homogène dont les parties présentent des degrés équivalents de dépendance à leur contexte – si bien qu’en voyageant à travers de telles distances, elle risque de nous arriver fragmentée, dispersée, susceptible de n’être recomposée qu’à partir de certaines de ses parties. Si la philosophie est un désir qui prend pour objet les savoirs et les pratiques qu’elle trouve autour d’elle, il faut commencer par se demander ce que ce désir fait aux choses qu’il prend pour objet : par quelles opérations sur ceux-ci la philosophie se signale-t-elle ? La fréquentation des corpus philosophiques laisse peu de doutes sur le fait que de telles opérations soient en effet nombreuses et de multiples sortes. Prenons pour matériau le platonisme artisan que nous avons progressivement construit au cours de notre exercice de lecture des dialogues. Par quelles opérations philosophiques, c’est-à-dire par quelles opérations pratiquées sur
platon160p_V2.indd 139 13/10/10 10:35:36
140
l’ensemble des savoirs se signale-t-il ? Il s’agit en particulier de déterminer le degré de dépendance de chacune de ces opérations à l’égard du matériau scientifique et pratique qu’elle prend pour objet : ce degré marquera le degré de vulnérabilité d’une opération à l’altération de son contexte historique et la mesure dans laquelle une telle altération exige que cette opération soit réalisée à nouveau frais. Nous distinguerons à première vue trois types d’opérations : opérations métaphysiques, opérations scientifiques et opérations méta-scientifiques.
I – le niveau dialectique, ou métaphysique
Une première opération philosophique que l’on trouve dans les dialogues consiste à énoncer un schème général d’intelligibilité du réel : non pas simplement affirmer que le réel est intelligible, mais comment il l’est, en l’occurrence en ce qu’il est toujours le mélange d’une unité et d’une multiplicité, mélange qui est l’objet même du savoir et de la technique. Nous employons le terme « schème » à dessein : il s’agit d’une image. Nous avons défendu l’idée que Platon trouvait dans l’observation des objets et des méthodes de l’artisan le schème ou l’image permettant de décrire le style général avec lequel les choses se prêtent à la connaissance et à la manipulation. Rappelons cette image. Il fallait, à suivre l’artisan, apprendre à connaître deux choses (nous avons du reste décrit comme un triangle la relation unissant l’artisan à ces deux choses) : l’unité invisible qui confère sa réalité à toutes les multiplicités que nous pouvons rassembler, connaître et produire ; le type de mesure, d’ordre qu’il faut donner à un matériau pour qu’il en vienne à ressembler à l’unité qui lui donne son nom. Le menuisier sait ce que doit être tout lit pour pouvoir servir de lit et sait aussi comment agencer des matières pour qu’elles en viennent à prendre la disposition qui les fera entrer dans l’ensemble des choses qui peuvent servir de lit. Le platonisme tire donc de son schème général de l’intelligibilité des choses la nécessité qu’il y ait au moins deux niveaux de connaissance – celui des unités intelligibles et celui des formes d’ordre et de mesure immanentes à la matière par lesquelles des images des unités intelligibles naissent. Autant qu’une philosophie de la forme, le platonisme est une philosophie de la mesure et des formes d’ordre qui donnent consistance aux corps, aux âmes, aux cités, à l’univers. L’analogie avec le terrain technique et artisanal permet de présenter une structure commune à toutes les formes de choses connaissables et manipulables, à la décrire en explicitant le style général des choses en tant qu’elles sont connaissables (elles ont une mesure, présentent un certain arrangement, un certain « kosmos ») et le style général de ce que l’on fait lorsqu’on les connaît. Une méthode générale pour se représenter le réel est produite sur ce fondement : il s’agit de la dialectique. On appellerait aujourd’hui ce niveau « métaphysique ».
platon160p_V2.indd 140 13/10/10 10:35:36
141
Cette opération philosophique-là est-elle indépendante de l’histoire des savoirs et des pratiques ? La philosophie, telle que nous l’avons définie, ne connaît pas cette indépendance – elle est elle-même le produit d’un certain état des savoirs et des pratiques90 ; néanmoins, certaines de ces opérations peuvent manifester une dépendance plus faible que d’autres à l’égard de cette évolution. Dans la mesure où l’image du savoir supposée à ce niveau métaphysique est extrêmement générale, la possibilité de sa reprise dans un contexte très différent de l’histoire des sciences et des pratiques n’est pas nulle. Considérons en effet les deux niveaux de ce schéma général : les formes, d’un côté, les formes d’ordre correspondant à des combinaisons, de l’autre.
Il y a bien sûr une grande réticence, jamais démentie depuis Aristote, envers les formes intelligibles. Nous laisserons de côté tout ce qui tient à des réticences d’ordre scolaire, au sens du débat entre écoles ou systèmes philosophiques, où les formes jouent le rôle d’étiquette ou de slogan dans le débat sur le réalisme de la connaissance, avec des conceptions souvent très vagues de leur nature. Un tel débat est en dehors des limites de ce que nous avons défini comme l’opération philosophique proprement dite de rassemblement de la diversité des savoirs et des pratiques. La seule question est de savoir si les formes peuvent concrètement toujours servir à cette tâche. Dans cette perspective, il convient de rappeler certains de nos résultats. Les formes ne sont nulle part, tel est peut-être le trait, affirmé par Timée, qu’il faut le plus fermement garder en mémoire, tant la tentation est grande de concevoir les formes comme des entités situées quelque part, pourquoi pas par dessus la voûte céleste, comme le représente le mythe du Phèdre : ce ne sont pas des « caciocavalli »91 comme disait Antonio Labriola. Inutile de chercher à les poser quelque part, à les introduire dans d’autres choses, à les y faire agir : c’est toujours confondre la forme elle-même et le type d’ordre par lequel elle se traduit dans une chose, qui quant à lui exerce une causalité directe sur la chose – c’est l’ordre dans l’âme qui fait la vertu, la constitue effectivement et produit la ressemblance avec l’unité intelligible. Les formes n’ont aucune caractéristique des choses qui existent quelque part, mais cela ne les empêche en rien d’exister puisqu’elles peuvent être l’objet d’un mouvement et d’un contact, celui de la pensée, qui pourtant les laisse intactes. Elles sont pensées mais non produites par notre pensée : leur structure résiste à celle-ci et s’impose à elle aussi durement que la structure de la roche. On ne peut ni toucher ni voir les formes : c’est
90 Il faudrait retracer l’histoire de l’apparition d’un discours et d’un savoir ayant pour ambition de dé-crire le style d’intelligibilité générale de toutes les choses connues. La « philosophie » platonicienne prend la relève d’une entreprise que l’on peut identifier dès la fin du Ve siècle : il s’agit de « l’enquête sur la nature », qui doit être comprise comme un telle tentative de dire pour chaque chose, ce dont elle naît, comme elle se développe et comment elle disparaît. C’est là un schème de la croissance et du déclin qui permet aussi de produire une image générale de l’objet connu. Sur la possibilité d’identifier une telle entreprise dans la deuxième moitié du Ve siècle, voyez les développements de E. Schmalzriedt, Perì Phúseôs. Zur Frühgeschichte der Buchtitel, Munich, Fink, 1970.91 Ce sont des fromages italiens que l’on suspend en hauteur pour les laisser parvenir à maturité.
platon160p_V2.indd 141 13/10/10 10:35:36
142
l’occasion de découvrir que l’ensemble des existants est peuplé de choses que l’on ne peut ni voir ni toucher92. Au total, il vaut mieux les concevoir purement et simplement comme l’unité réelle de chaque multiplicité, l’unité définissant un ensemble de choses, car l’essentiel est là : l’art dialectique, qui est l’invention philosophique proprement dite de Platon, consiste à penser les rapports entre des multiplicités dont le fondement est réel et qui ne consiste pas en des regroupements relatifs et arbitraires. Quelles propriétés entraînent quelles propriétés pour les choses ? Penser le mélange des formes, c’est penser la façon dont les multiplicités qu’elles définissent se rapportent les unes aux autres. Comment découper l’amour ? Les vertus ? Les savoirs ? Les plaisirs ? Découper, dénombrer, recomposer : parce qu’elle place l’unité en dehors des choses et parce que sa rigueur est tout entière concentrée dans le fait de ne jamais introduire en elles une fixité qui en arrêterait le flux perpétuel, la philosophie platonicienne, poursuivant et dénombrant les motifs qui viennent à l’être et qui disparaissent sur le porte-empreinte de toutes choses, est en ce sens une philosophie de l’immanence. Or si nous reformulons, au sein de l’immanence, l’effet du platonisme, il faut dire que celui-ci consiste avant tout en un art du découpage qui dénonce les coupures arbitraires faites par l’opinion dans un ensemble dont celle-ci refuse de voir l’étendue. Il y a des regroupements dont le fondement est réel et non fictif, c’est-à-dire des regroupements qui renvoient à des formes et non à des concepts ou à des opinions : ce sont ceux qu’il faut connaître pour connaître la structure même des choses, la structure d’une chaussure comme celle d’une molécule. Or une telle position est bien entendu tenable et tenue dans le débat métaphysique contemporain. On pourra objecter qu’elle est suffisamment large pour être tout simplement soutenue aussi par ceux qui se disent plutôt aristotéliciens93. Il faut alors préciser une chose : la grande différence entre une forme platonicienne et une forme aristotélicienne, c’est que la première rassemble des populations de choses très diverses selon l’unité d’une propriété, sans donner de privilège à celle qui définit l’espèce à laquelle les choses appartiennent. On a pu argumenter qu’une telle métaphysique était plus propice à la saisie des singularités94.
Tenir une position platonicienne en métaphysique aujourd’hui supposerait de tenir ensemble les deux niveaux du schéma général
92 Il n’y a d’ailleurs pas que les formes qui sont invisibles. Quand on commence à se poser cette question, on voit rapidement la population des invisibles proliférer. Ainsi le devenir lui-même, et même l’acte lui-même : ce sont des invisibles que ceux qui entendent réduire l’existence à ce qu’ils peuvent toucher finissent par déclarer inexistants (voyez Théétète 155e5-6). Il y a bien une chose qu’on ne peut toucher, c’est le toucher lui-même, ou le fait d’avoir touché. On ne touchera jamais non plus le fait de vieillir ou de devenir savant. Personne n’a jamais vu vieillir personne : c’est le résultat du vieillissement que l’on a vu.93 Pour la présentation d’une position aristotélicienne et d’une position platonicienne dans le débat métaphysique contemporain, voyez par exemple D. Armstrong, A World of States of Affairs, Cam-bridge, 1997, p. 21-22.94 Frédéric Nef, « Platonisme et particularisme : À propos d’une histoire des propriétés individuel-les ou pourquoi Aristote a tort et Platon raison », Cahiers Philosophiques de Caen, Année 2003, Fascicule N° 38-39.
platon160p_V2.indd 142 13/10/10 10:35:36
143
d’intelligibilité tiré de la comparaison avec l’artisanat. La division des formes suppose une combinatoire des éléments : les formes se divisent et ces divisions correspondent aux différentes combinatoires possibles des éléments des choses. Une pensée combinatoire fonde les divisions et détermine le mode d’existence des choses qui participent aux formes : ce ne sont pas des substances et des accidents, ce sont des combinaisons, des formes de mélange. Un programme platonicien en métaphysique consisterait donc à défendre l’idée que les états de choses sont des formes déterminées de mélange, qu’il s’agisse de corps, de qualités ou d’actes, mélanges qui devront être déterminés comme des touts d’une nature particulière95. Or un tel programme n’est pas invulnérable à l’évolution des sciences et des techniques, tout au moins si l’on considère la métaphysique comme une philosophie au sens où nous l’avons définie : comme une façon de décrire le schéma général d’intelligibilité de ce que ces sciences et ces techniques connaissent et manipulent. Il ne s’agit donc pas d’émettre une préférence pour les propriétés plutôt que pour les substances, comme si l’on choisissait parmi les systèmes philosophiques au nom d’un jugement moral ou esthétique. Il s’agit se savoir si une telle idée éclaire de manière féconde le style général des savoirs. Or de ce point de vue, à supposer que l’on ne rejette pas l’hypothèse platonicienne sur le sol même des savoirs antiques, l’évolution des sciences ne lui semble pas nécessairement défavorable, puisqu’elle semble toujours permettre de décrire la façon dont la science se saisit du réel sous la forme de divisions trouvant à leur tour leur matrice dans un art combinatoire. Depuis les systèmes botaniques96 jusqu’au tableau de Mendeleiev97, de l’analyse des structures de parenté98 ou des modes d’identification des collectifs par les différentes cultures humaines99, de la typologie des constitutions politiques modernes100
95 Pour une présentation de l’apport platonicien au débat métaphysique contemporain sur la nature des totalités, voyez Verity Harte, Plato on Parts and Wholes, The Metaphysics of Structure, Oxford, 2002.96 On lira par exemple le volume collectif édité par T. Hoquet, Les fondements de la botanique, Linné et la classification des plantes, Paris, Vuibert, 2005. Le texte, inédit en Français, des Fun-damenta botanica (1736), publié dans ce volume (p. 177-227) permet de se rendre compte de l’ensemble des éléments dont la variation constitue la matrice de la classification.97 La variation du nombre de nucléons et d’électrons est la matrice du tableau. Sur la façon dont la chimie produit d’admirables tableaux où les propriétés des corps peuvent être déduites de la variation des constituants (par exemple de la simple variation du nombre d’éléments identiques), voyez par exemple l’interprétation dialectique de Engels (mais avec une dialectique qui a d’autres lois que celles de la dialectique platonicienne : en l’occurrence il s’agit de l’illustration du passage de la quantité à la qualité), Anti-Dühring, Leipzig, 1878 – je me réfère à l’édition de Berlin (Marx En-gels Werke), 1962, p. 118-120 (voyez la traduction française d’E. Bottigeli, Paris, Editions Sociales, 1977, p. 156-158).98 Sur la comparaison, très platonicienne dans l’esprit, entre la combinaison des éléments d’un domaine donné (en l’occurrence la parenté) et celles des éléments du langage (la linguistique mo-derne substituant au modèle des lettres du Sophiste celui du signe dans le système de la langue), voyez par exemple la partie « Langage et Parenté » qui ouvre l’ouvrage de C. Lévi-Strauss, Anthro-pologie structurale, Paris, Plon, 1958.99 La variation des éléments constitutifs permettant de déduire la table des quatre ontologies hu-maines apparaît bien dans le tableau p. 176 de l’ouvrage de P. Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.100 On peut considérer l’Esprit des Lois, de Montesquieu, comme l’actualisation de la tâche de
platon160p_V2.indd 143 13/10/10 10:35:36
144
à celle des genres cinématographiques101, les sciences modernes semblent continuer à classer des phénomènes en déterminant le nombre de divisions de ces tableaux à l’aide d’une combinatoire d’éléments plus fondamentaux. Elles semblent même avoir considérablement enrichi le panorama des formes de combinatoires possibles par rapport à ce que Platon avait sous les yeux. Un vaste champ d’études des formes de mélange et des manières de les composer s’ouvre pour une métaphysique platonicienne aujourd’hui. Il semble donc que le niveau dialectique ou métaphysique d’une philosophie comme le platonisme, s’il n’est pas indifférent à l’évolution des savoirs et des techniques, jouisse d’une certaine autonomie. Reprendre aujourd’hui l’affirmation métaphysique de la nature dialectique du réel n’implique en aucune façon de le faire sur l’état des savoirs valides il y a vingt cinq siècles ; cela n’implique pas non plus de renoncer à une telle métaphysique : celle-ci semble au contraire tout à fait à même de créer un espace philosophique, c’est-à-dire un lieu où les différentes sciences et les différentes pratiques d’une époque, aussi bien politiques qu’individuelles, peuvent manifester leurs affinités en tant que pratiques humaines d’appropriation des choses.
II – L’opération scientifique du philosophe
Indépendamment de la question de savoir si la description du réel sous la forme d’un système de combinaisons d’éléments est possible, il reste celle de savoir quelles sont exactement les combinaisons et configurations qui seront reconnues comme valides par chaque spécialiste : ainsi, pour reprendre les motifs platoniciens, on se demanderait quel agencement de morceaux de quel bois peut faire un lit utilisable, quel agencement de quelles institutions fait une cité viable, quel développement de quelles dispositions fait un individu en équilibre psychique. Il y a là une intervention directe du philosophe sur le terrain des sciences et des arts, puisqu’il doit y prélever un contenu objectif – ce qui constitue déjà une opération scientifique, au sens où il s’agit de trancher un débat entre des descriptions de ce contenu qui sont probablement multiples à un état donné de la science – voire s’aventurer à le produire lui-même. Platon entend disposer d’une description des sciences mathématiques comme de l’art musical et il entend donner lui-même ses principes à une science politique, de même qu’Aristote produira lui-même
classification des régimes à partir de ces éléments et parties qu’Aristote avait ouverte dans l’Anti-quité, avec cette pensée combinatoire qui, pour les lecteurs modernes, évoque immanquablement la chimie, et qui permet à Aristote d’envisager même de construire a priori toutes les formes pos-sibles de constitution, comme on devancerait la découverte d’éléments chimiques avec le tableau de Mendeleiev : voyez les commentaire de Pierre Pellegrin dans la préface à sa traduction de la Politique d’Aristote, p. 49-50 du volume GF-Flammarion.101 Voyez la façon souple dont Stanley Cavell constitue un genre comme celui de la comédie du remariage, avec la possibilité pour certains films de compenser l’absence d’un des ingrédients fondamentaux par une proposition inédite, Pursuits of happiness : the Hollywood comedy of remar-riage, Cambridge, Harvard University Press, 1981. Voyez la traduction française de C. Fournier et S. Laugier sous le titre À la recherche du bonheur. Hollywood ou la comédie du remariage, Paris, Cahiers du cinéma, 1993.
platon160p_V2.indd 144 13/10/10 10:35:36
145
une étude des animaux, de l’âme, du genre éthique ou des principes régissant le classement des constitutions politiques. L’âme est assurément une chose dont Platon entend dire ce qu’elle est et de quels agencements elle est faite, comme nous l’avons vu : il en tire du reste l’affirmation de la puissance des âmes, dans les vies des individus des différentes espèces, comme dans celle de l’univers. C’est une âme, immanente à toutes les formes de mouvement, qui crée l’ordre propre à chaque partie de l’univers, et ce sont des âmes humaines savantes qui créent l’ordre en elles-mêmes, dans les cités et dans les corps.
On dira que ce genre d’opération intervenant directement dans la production de savoir sur un objet donné du réel signalait le philosophe à une époque où, moins encerclé par les savants et les savoirs constitués, il était plus libre d’intervenir lui-même dans la constitution des savoirs. Une telle hypothèse surestime peut-être la simplicité du champ des savoirs des époques antérieures – ou surestime peut-être la complexité relative de notre temps. Les savoirs, au temps de Platon, sont déjà suffisamment nombreux et suffisamment techniques pour que l’on ne puisse les maîtriser seul. Platon n’est ni géomètre, ni astronome, ni musicien. Rédige-t-il lui-même toutes les parties de ses dialogues, en particulier les plus techniques, comme la partie du Timée consacrée aux interactions entre éléments corporels (56-61) ou les développements de droit pénal et criminel des Lois ? Certains lecteurs avisés en doutent. Inversement, les philosophes modernes se gardent-ils d’intervenir dans les sciences ? C’est probablement ce que dément le développement de la « philosophie de la science » et de ses espèces, de la « philosophie de la biologie » à la « philosophie des sciences sociales »102 : les philosophes tendent à s’inscrire de manière plus forte dans le champ d’une science, quitte à s’écarter de la culture philosophique traditionnelle pour mieux se trouver en mesure d’intervenir directement dans les controverses scientifiques – voire d’en résoudre certaines eux-mêmes.
Les dialogues de Platon manifestent des opérations qui visent à représenter une série de combinaisons d’éléments comme les espèces d’un phénomène considéré, que le philosophe soit lui-même l’auteur de cette combinatoire, ou qu’il la reçoive d’un autre spécialiste. En ce qui concerne un tel type d’opération, il semble que son degré de dépendance à l’égard de l’état des sciences de son temps soit maximal, et ceci pour au moins deux raisons. D’une part, la cartographie des sciences et des techniques est mouvante et cette mobilité est particulièrement nette au Ve siècle athénien où un certain nombre de savoirs ne sont pas encore autonomisés ou le sont d’une manière 102 Ces expressions décalquent l’expression anglaise de « philosophy of », qui correspond à la tendance actuelle du travail des philosophes qui s’inscrivent désormais au plus près du travail des sciences. Voyez par exemple A. Rosenberg, Philosophy of Science : A Contemporary Intro-duction, Londres, Routledge, 2000 ; Marjorie Grene & David Depew : The Philosophy of Biology : An Episodic History, Cambridge University Press, 2004, ou D. L. Hull, & M. Ruse, The Cambridge Companion to the Philosophy of Biology. New York, Cambridge University Press, 2007 ; L. Sklar, Philosophy of Physics. Westview Press, 1992 ; M. Hollis, The Philosophy of Social Science : An Introduction. Cambridge, 1994.
platon160p_V2.indd 145 13/10/10 10:35:36
146
qui ne correspond pas à la figure qu’ils prendront par la suite103, et cette situation est propice à l’obstacle homonymique que nous avons évoqué. D’autre part, même si l’on acceptait une certaine continuité, même partielle, des domaines de savoirs entre l’époque de Platon et la nôtre (en admettant par exemple que les objets de la géométrie de l’époque sont toujours inclus, même sur d’autres fondements, au sein de la géométrie contemporaine), il faudrait néanmoins reconnaître que chaque science a son histoire propre, et qu’en l’occurrence, dans ce laps de temps, les transformations ont été profondes, voire radicales. Pouvons-nous actualiser un propos platonicien sur l’âme, si la nature des combinaisons qui permettent de décrire la réalité psychologique s’est à ce point modifiée sous l’effet de l’évolution du réel et des savoirs qui le connaissent, que la description platonicienne soit devenue impossible à entendre comme un discours ayant la moindre référence ? D’autre part encore, la description de la structure et des mouvements psychiques, chez Platon, permet de dégager plusieurs thèses fondamentales : la vertu est un ordre qui rend l’âme plus heureuse et plus à même de réaliser sa fonction ; cette disposition est l’effet d’un certain savoir dont la possession annule la différence entre la théorie et la pratique (la définition de la vertu comme ordre de l’âme impliquant l’unité des vertus, intellectuelles aussi bien que morales, pour employer un vocabulaire aristotélicien) – sans même mentionner l’idée que ce savoir devrait par exemple inclure une étude complète des mathématiques, qui ont elles-mêmes beaucoup changé depuis lors, à la fois dans leur contenu propre et dans leur rapport aux autres sciences. Voilà donc des hypothèses psychologiques qui ne sauraient entrer dans notre temps en toute discrétion, ni être soustraites à une féroce discussion scientifique dont on ne saurait déterminer par avance le résultat positif – sans lequel l’idée d’une philosophie platonicienne serait gravement amputée.
C’est là néanmoins un nouveau champ d’aventure pour un platonisme d’aujourd’hui. Il faut refaire l’opération platonicienne d’affirmation de la puissance de la vertu et du savoir unis sur le terrain psychologique, au risque des savoirs d’aujourd’hui, sans savoir par avance si une telle hypothèse peut être maintenue. Si elle pouvait l’être, même partiellement, on ne saurait présumer non plus de la description effective du savoir susceptible de produire de tels effets psychiques. Inversement, ce n’est pas au philosophe d’aujourd’hui de décréter que cette partie de la théorie platonicienne ne saurait être actualisée car désuète. C’est une affaire empirique. Un point de vue platonicien pour notre temps, sur ce terrain, consisterait seulement à poser cette question à la psychologie. Les recherches actuelles sur la psychologie du travail, sur la valeur de certaines dispositions correspondant aux vertus anciennes (ainsi savoir commander et être commandé) pour l’harmonie et l’efficacité du groupe, ou celle, dans le même contexte, de phénomènes dans lesquels pourraient être traduits l’effet psychique du savoir, ainsi celui de la
103 Sur ces questions, voir le numéro « Science et Philosophie dans l’Antiquité » que j’ai édité pour les Archives de Philosophie, tome 68 – cahier 2, été 2005.
platon160p_V2.indd 146 13/10/10 10:35:36
147
sublimation, constituent des pistes stimulantes dans cette direction : il y a là des tentatives de formuler, en termes de santé psychique, conformément à l’analogie platonicienne entre santé du corps et santé (ou justice) de l’esprit, des phénomènes qui puissent être mis en rapport avec certaines dispositions de l’individu et du groupe en action, et de leur capacité à y réussir en trouvant là motif à une certaine joie104.
III - Savoir et démocratie : opérations méta-scientifiques supposant une hypothèse forte dans la distribution et l’articulation des savoirs
Il existe des opérations présentes dans des corpus philosophiques qui risquent elles aussi de présenter une dépendance forte au contexte épistémique de leur temps. Les philosophes sont parfois capables de formes d’intervention sur le terrain des sciences qui y produisent des effets non pas seulement de manière interne à tel ou tel savoir, mais aussi par l’articulation nouvelle qu’ils entendent produire entre les différents savoirs et les différentes pratiques. Ainsi c’est une chose que Platon ait pour ambition d’affirmer une doctrine originale de l’âme, c’en est une autre qu’il entende faire de celle-ci le fondement de son enquête sur la typologie des régimes politiques, quitte à importer en politique les lois psychologiques précédemment évoquées105 , en supposant que le savoir y est aussi la chose la plus désirable et la plus puissante et qu’on doit juger des formes d’organisations collectives des hommes à la façon dont elles instaurent un gouvernement du savoir. Une telle opération est-elle plus ou moins dépendante de l’évolution du contexte scientifique que la précédente ? Le fameux débat sur l’actualité de la critique platonicienne de la démocratie est un excellent terrain pour apprendre à faire la différence entre l’opération scientifique et l’opération méta-scientifique du point de vue de leur degré de dépendance à l’histoire des sciences et des techniques.
C’est une thèse constante des dialogues platoniciens que la démocratie, c’est-à-dire cette forme ancienne de régime caractérisée par la souveraineté des assemblées citoyennes, n’est pas propice au gouvernement du savoir et de la vertu, qui sont une seule et même chose selon Platon, comme nous l’avons vu106. L’ardent débat contemporain sur cette question est souvent biaisé par le fait que l’on omet de bien distinguer deux questions : une question interne à la science politique, qui relève de la
104 Sur ce point, lire l’article de C. Dejours, « La santé mentale entre ressorts individuels et réqui-sits collectifs », in S. Haber (éd.) Des Pathologies sociales aux pathologies mentales, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2010.105 Sur cette opération spécifiquement platonicienne d’assignation des phénomènes politiques à leur origine psychologique, voir notre étude « Santé des corps, des esprits, des cités : un modèle antique de liaison entre pathologie sociale et pathologie psychique », in S. Haber, op. cit.106 Il convient de ne pas douter de l’hostilité de Platon à l’égard du régime appelé démocratie à l’époque, malgré des tentatives contemporaines de réconcilier quelque peu Platon avec ce régime. Voyez J. Ober, Political Dissent in Democratic Athens. Intellectual Critics of Popular Rule, Princeton, 1999 et J. F. Pradeau, Platon, les démocrates et la démocratie, Essai sur la réception contempo-raine de la pensée politique platonicienne, Naples, Bibliopolis, 2004.
platon160p_V2.indd 147 13/10/10 10:35:37
148
deuxième opération philosophique que j’ai décrite, l’opération scientifique, et une question propre à l’articulation par Platon du psychologique et du politique, relevant de la troisième opération, l’opération méta-scientifique. Platon affirme la nécessité de rendre le savoir souverain dans nos âmes et dans la cité. Cette thèse découle du poids qu’il donne à la psychologie au sein de sa description du réel. Par ailleurs, Platon, considérant les formes de régimes politiques existant à son époque, reprenant l’analyse de ces formes après d’autres auteurs, tels Hérodote et Thucydide, produit une évaluation de ceux-ci à l’aune de la précédente thèse et aboutit à un classement des régimes en fonction de leur capacité à permettre la souveraineté du savoir. Deux formes de multiplicités sont ainsi mises en rapport par la démonstration magistrale de la République, celle des mouvements psychiques et des types d’âmes que leurs diverses combinaisons permettent de penser et celle des formes institutionnelles de la Grèce ancienne, réduites pour l’occasion à cinq formes. Au cours de cette opération méta-scientifique, la forme politique appelée à l’époque démocratie se classe avant-dernière sur cinq, juste devant la tyrannie. Deux questions doivent dès lors être posées : peut-on actualiser le propos platonicien sans vérifier si ce que Platon appelle démocratie ressemble à ce à quoi nous donnons le même nom ? Peut-on supposer que le maintien de la thèse psychologique selon laquelle le savoir est bénéfique désignerait aujourd’hui dans les formes politiques existantes la même configuration que celle qui pour Platon donnait au savoir la main ?
Il faut commencer par se tourner du côté de la science politique pour se demander à quel type de combinatoire d’éléments correspond ce que nous appelons aujourd’hui démocratie, et si cela ressemble à ce que Platon nomme tel et critique assurément. Or la science politique sera formelle : la démocratie des Anciens, dont discute Platon, est une chose très différente des formes de gouvernement représentatif que nous connaissons aujourd’hui, puisque les citoyens participent effectivement au fonctionnement des institutions, à la délibération, à la décision et au jugement, et qu’on y pratique la désignation de certains corps politiques par tirage au sort107. C’était un tel système que Platon récusait comme impropre à faire triompher le point de vue savant et vertueux – sage, courageux, juste. Ce que nous appelons démocratie aujourd’hui ne confie ni délibération ni décision aux citoyens : on a plutôt réhabilité un mode de désignation qui était considéré par les Anciens comme propice à permettre aux élites de faire approuver leur conduite des affaires, à savoir l’élection – processus que Platon intègre lui-même à ses projets constitutionnels, parfois assorti d’une condition de cens, comme nous l’avons vu dans le Lois. Dans les systèmes représentatifs que nous appelons aujourd’hui « démocraties », les partisans du rôle de l’expertise, qui insistent sur la fonction que doit jouer une technocratie non-élue auprès des pouvoirs politiques ou économiques, trouvent même un
107 Pour une synthèse sur ce point, voir Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
platon160p_V2.indd 148 13/10/10 10:35:37
149
allié de circonstance en Platon108. Rien ne prouve néanmoins que la forme moderne de combinaison d’expertise et de pouvoirs élus (pouvoir politique) ou nommés par des conseils d’administration (pouvoir économique), soit en mesure de réaliser le gouvernement du savoir de type de platonicien, c’est-à-dire, rappelons-le, l’unité stricte de la théorie et de la pratique, par laquelle il ne saurait être question d’agir à l’encontre de ce que l’on sait. Pour questionner le désir de certains partisans contemporains de l’expertise de trouver dans Platon une référence flatteuse, il suffit de poser une simple question. Imaginez des sociétés ou des groupes humains qui auraient les moyens de savoir, par exemple, vers quels types de crises (économiques, financières ou environnementales) et de déséquilibres sociaux (par exemple des inégalités de richesse, incompatibles, aux yeux de Platon, avec la vertu du tout et de chacun) les entraîne nécessairement leur mode de vie. Si de telles sociétés se montraient néanmoins incapables de ne pas se précipiter vers de telles conséquences, envisageriez-vous d’affirmer qu’en elles le savoir gouverne et détermine la prise des décisions ? Comme on le voit, le débat sur la question de savoir quelle forme de gouvernement serait en mesure de réaliser la domination du savoir qui fait l’unité des vertus devrait être reprise aujourd’hui à l’aune de la science politique moderne et des expériences les plus récentes d’analyse des formes de partages collectifs du savoir par des groupes humains. L’ironie de l’histoire pourrait venir du fait que des expériences inspirées par les démocraties anciennes, notamment auprès de corps politiques tirés au sort, soient plus à même de produire un alignement des conduites sur des buts rationnels et un accroissement de l’information des décisions dans la complexité des sociétés modernes109. Il se pourrait aussi que de tels corps s’avèrent davantage capables que nos pouvoirs politiques et économiques actuels d’agir conformément au savoir qui est le leur, en prenant soin de leur intérêt à long terme. Quoi qu’il en soit, l’énoncé selon lequel la « démocratie » ne peut être le gouvernement du savoir n’est pas directement transposable du IVe siècle athénien à l’époque moderne, si l’on suppose par là que le système représentatif connu aujourd’hui sous le même nom pourrait recevoir immédiatement l’évaluation que Platon faisait de la démocratie sous sa forme ancienne. Les effets de ressemblance ponctuels – que l’on trouve par exemple chez Platon une critique des mœurs de la société démocratique et que l’on trouve chez certains critiques de la démocratie aujourd’hui une perception similaire des sociétés libérales – ne doivent pas rendre aveugle à cette profonde différence de structure.
Si le contenu de l’emboîtement méta-scientifique est inactualisable comme tel, dans la mesure où il résulte d’une part de deux opérations scientifiques qui portent leur propre degré de dépendance (l’examen des formes psychologiques d’un côté, celui des formes politiques, de l’autre) et 108 Voir sur ce point J. Ober, Democracy and Knowledge, Princeton, 2008, p. 34-37.109 C’est dans une telle direction que pointe le livre de J. Ober cité à la note précédente, dans lequel l’auteur essaye de démontrer, à l’aide de théories sociales et économiques contemporaines, l’efficacité de la forme athénienne classique de la démocratie du point de vue du partage collectif du savoir et de la rationalisation des décisions engageant la communauté.
platon160p_V2.indd 149 13/10/10 10:35:37
150
d’autre part d’une évaluation, proprement méta-scientifique, des formes possibles de leur rencontre, il reste que la question générale de la possibilité de cet emboîtement reste. Si nous ne pouvons directement actualiser la réponse de Platon sur le terrain empirique, nous pouvons conserver la question platonicienne : quelles sont les conditions sensibles et structurelles d’une organisation collective irriguée par le savoir ? Du point de vue de l’analyse des formes politiques de notre époque, la question reste ouverte, et elle désigne un vaste chantier de réflexion sur la question de savoir comment, aujourd’hui, dans toutes les structures de pouvoir et de décision existantes, qu’elles soient privées ou publiques, nous parvenons à produire un savoir commun et agir en conséquence de ce que nous savons. Il s’agit se sonder l’existant comme le possible : quelles formes de dispositifs, quelles formes de pratiques publiques, à l’image de l’étrange élection des gardiens des lois, saurions-nous imaginer pour que des collectifs humains, aujourd’hui, se trouvent en mesure de déceler parmi eux les plus sages selon les sujets et les circonstances, de faire de l’intelligence et de l’expérience de ceux-ci un savoir qui meut la communauté, d’atteindre des formes de décision raisonnées et de créer les conditions d’une compréhension approfondie de leur propre action, de la justesse et de la pertinence de celle-ci, par eux-mêmes et par l’ensemble des hommes qui en sont les témoins ? Ces questions, loin d’avoir été résolues par les formes de pouvoir politique et économique que nous connaissons aujourd’hui, sont pourtant celles auxquelles on peut penser que la forme de régime qu’Athènes appela démocratie, et que Platon rejetait, savait répondre d’une manière plus satisfaisante que nous-mêmes110. Ce sont des questions auxquelles nous aurions affaire si nous voulions reconstruire, dans un monde où elles disparaissent peu à peu, des formes robustes, avisées et joyeuses de décision et d’action collectives.
III
Se raconter des histoires
Le platonisme est une philosophie qui aime les mythes et aime imaginer que notre univers pense et vit, ou encore que les âmes s’y promènent tranquillement à travers toutes choses, avec une insolente liberté, allant même parfois jusqu’à s’aventurer au-delà de la sphère céleste. Pourquoi se raconter ainsi des histoires ? Les mythes ont une fonction pratique, et ceux que nous évoquons servent avant tout à instiller l’idée que la réalité est telle que l’on puisse la connaître, la diviser, la dénombrer, la recomposer, et que travailler à produire des arrangements vertueux, dans nos esprits comme dans nos collectivités, est dans notre intérêt111. Pour cela, ils nous laissent
110 Voir J. Ober, op. cit.111 Sur la question du mythe, lire l’étude de L. Brisson, Platon, Les mots et les mythes, Paris, Maspero, 1982 et se reporter au recueil publié par J. F. Pradeau, Les Mythes de Platon, Paris, Flammarion, 2004.
platon160p_V2.indd 150 13/10/10 10:35:37
151
entendre qu’en travaillant à réaliser un tel but dans les objets qui nous entourent, dans nos corps, nos esprits et nos communautés, nous en venons à ressembler à l’ordre du ciel ; qu’une telle beauté céleste se reflète dans les discours et les actes des hommes qui trouvent leur place au sein des choses qu’ils ont appris à connaître, à commencer par eux-mêmes. L’avancée dans le savoir et dans la transformation de l’existence collective a parfois besoin d’un poème. Pourquoi un poème ? Pourquoi des fables ? Parce que ce sont des moyens de tramer un langage commun entre la diversité des écritures et des pratiques en laquelle l’expérience humaine du monde se dissémine jusqu’à la fragmentation la plus totale. L’espèce humaine est ainsi constamment menacée par le risque que la diversité des expériences de ses membres ne soit plus communicable au sein même de l’espèce, d’autant plus qu’elle est menacée par la disparition régulière de ses acquis. Comme nous l’avons dit pour commencer, l’écriture des dialogues est une réponse à un tel risque, d’une part parce qu’elle crée en son temps un espace où la diversité des savoirs et des pratiques peuvent paraître sur une scène commune, d’autre part parce qu’elle incite, par sa transmission, à la création de nouvelles scènes du même type. Dans ce contexte, le mythe sert à diffuser une image de la totalité à laquelle s’intègre chaque savoir et chaque expérience. Certains de nos contemporains trouvent qu’une telle forme de récit manque à notre époque112, dont l’éclatement de savoirs, notamment entre les sciences et le reste de la culture, est peut-être devenu dramatique, à un moment où nos modes de vie sociaux et nos activités économiques en sont venus à mettre en cause leur compatibilité avec les conditions de notre survie à long terme sur cette planète. Plus encore, certains pensent que c’est la possibilité même du partage des expériences qui est mis en danger par les formes contemporaines de communication – comme si l’équation platonicienne des arts d’imitation s’était démultipliée : les médias et la télévision auraient créé une foule de transmetteurs et de spectateurs dont l’expérience reste fondamentalement privée, et ne prend plus la forme du savoir partageable113. De nouvelles histoires sont donc attendues, qui redonnent vie à la forme même de l’expérience des choses en traversant la diversité de ses figures, pour nous rappeler que sous toutes ses coutures le réel est pensable en ses diverses formes objectives, que nous pouvons connaître ; d’autre part que la multiplicité de ces expériences s’inscrive dans un même monde, à son tour connaissable et qu’au total cette inscription leur procure une certaine affinité. La philosophie platonicienne naît de la perception de cette affinité, travaille à l’étendre et prépare l’avènement des formes politiques adéquates à ce nouveau partage du savoir et des pratiques, mue par l’idée qu’un tel savoir transforme l’humanité.
112 Voyez l’invitation à la construction de nouvelles fictions globales chez B. Latour, dans l’ouvrage déjà cité, page 195-196.113 Lire sur ces questions les chroniques de Serge Daney sur la télévision, réunies sous le titre Le Salaire du Zappeur, Paris, P.O.L. 1993.
platon160p_V2.indd 151 13/10/10 10:35:37
152
Finissons donc sur cette interrogation qui nous rappellera comment le mythe et le poème peuvent précéder l’avancée du savoir ou dire les choses qui ne sont pas objet d’un savoir certain, sans s’y substituer. Pourquoi tenir à dire ou à chanter que les hommes, lorsqu’ils réunissent les conditions de l’harmonie et de la justice dans leur existence collective, en viennent à se fondre parmi les choses naturelles au point de ressembler au ciel et à se faire le miroir de l’ordre de ce dernier ? Étrange idée pour nous que ce par quoi les humains sont les plus spécifiques, ce par quoi ils atteignent le sommet de leur éducation – quelques dispositions comme le savoir, la justice, le courage – et le sommet de leur culture – la capacité à organiser collectivement leur existence de manière harmonieuse et à la rendre joyeuse par l’excellence partagée dans les arts et les fêtes –, soit aussi ce par quoi ils ressemblent le plus à un effet naturel. Songeons à ces étranges affinités, en rendant la parole au poète. Qu’est-ce qu’un tout naturel ? C’est un tout dont on peut toujours compter les parties, une à une, comme les feuilles de l’arbre ou les abeilles de la ruche. Un tout qui ne se sépare jamais de sa fragilité : une totalité dont chaque partie, nécessaire à la force du tout, est pourtant éminemment vulnérable. Chez Tyrtée, un poète de la Grèce archaïque, les guerriers avancent comme un vol d’oiseaux, par exemple de grues et de cailles114 – une totalité à la fois compacte et solidaire, mais dont on peut toujours compter chaque unité et provoquer la dispersion. Un poète plus proche de nous, un poète d’images, Roberto Rossellini, fait déguerpir les troupes de partisans de la plaine du Pô comme des oiseaux de marais fauchés par les balles115, ou s’égayer les compagnons de Saint François d’Assise comme des moineaux s’en allant répandre la joie par les chemins116. Chacun d’eux peut être isolé, voir sa course brisée rendue à la matière ; un autre se lève à nouveau, puis un autre, qui de l’addition de leurs faiblesses forment bientôt la vigueur d’un torrent.
114 Fragment 19, 6-7.115 Païsa, dernier épisode.116 Les onze fioretti de Saint François d’Assise, scène finale.
platon160p_V2.indd 152 13/10/10 10:35:37
153
Repères chronologiques
534 Premier concours tragique lors des fêtes en l’honneur de Dionysos, à Athènes.
508 Réformes de Clisthène, naissance de la démocratie athénienne.
498-494 Anaxagore à Athènes.
490 Première guerre contre les Perses, victoire athénienne à Marathon. Naissance
d’Empédocle.
485 (env.) Naissance d’Hérodote, premier concours de comédie à Athènes.
480 (env.) Mort d’Héraclite, naissance d’Euripide.
480-478 Deuxième guerre contre les Perses : bataille des Thermopyles, de Salamine,
de Platées, de Mycale.
470 (env.) Naissance de Socrate.
460 (env.) Naissance de Démocrite, Thucydide, Hippocrate.
456 Mort d’Eschyle.
450 (env.) Visite de Parménide à Athènes ?
445 (env.) Naissance d’Aristophane.
443 Périclès stratège (jusqu’à sa mort en 429).
431 Début de la guerre du Péloponnèse qui oppose Athènes et Sparte et leurs alliés
respectifs.
428 Naissance de Platon.
426 Naissance de Xénophon.
423 Aristophane met en scène Socrate dans les Nuées.
420 Alcibiade stratège.
418 Défaite athénienne à Mantinée.
415-413 Expédition de Sicile.
411-410 Episode oligarchique à Athènes (dit « des Quatre Cents »).
406 Bataille des Arginuses, Socrate prytane ? Mort de Sophocle et d’Euripide.
404-403 Défaite d’Athènes, fin de la guerre du Péloponnèse. Nouvel épisode
oligarchique à Athènes (dit « des Trente »).
399 Procès et condamnation à mort de Socrate.
388-387 Premier voyage de Platon en Sicile.
387 Platon fonde l’Académie.
384 Naissance d’Aristote et de Démosthène.
371 Bataille de Leuctres.
367-365 Second voyage de Platon en Sicile.
362 Bataille de Mantinée entre Thèbes et Spartes.
361-360 Troisième voyage de Platon en Sicile.
348 Mort de Platon. Speusippe lui succède à la tête de l’Académie.
platon160p_V2.indd 153 13/10/10 10:35:37
154
Bibliographie
Œuvres de PlatonNous référons au texte grec dans l’édition suivante : Burnet, J., Platonis opera, Oxford, 1906, cinq volumes. Duke, E. A., Hichken, W. F., Nicoll, W. S. M., Robinson, D. B. & Strachan, J. C. G., Platonis opera, Oxford, 1995, vol. I. Les traductions présentes dans cet ouvrage sont les nôtres. Nous avons consulté les traductions suivantes : Léon Robin : Platon, Œuvres Complètes, Bibliothèque de la Pléïade, Gallimard, Paris, 1950, deux volumes. En Folio-Essais, Gallimard : République (P. Pachet, 1993) Chez Garnier-Flammarion : Gorgias (M. Canto, 1987), Euthydème (M. Canto, 1989), Ion (M. Canto, 1989), Ménon (M. Canto, 1991), Phèdre (L. Brisson, 1989), Phédon (M. Dixsaut, 1991), Timée/Critias (L. Brisson, 1992), Sophiste (N. Cordero, 1993) Théétète (M. Narcy, 1994), Parménide (L. Brisson, 1994), Lachès/Euthyphron (L.-A. Dorion, 1997), Apologie de Socrate/Criton (L. Brisson, 1997), Protagoras (F. Ildéfonse, 1997), Cratyle (C. Dalimier, 1998), Banquet (L. Brisson, 1998), Alcibiade (C. Marboeuf/J.-F. Pradeau, 1999), République (G. Leroux, 2002), Philèbe (J.-F. Pradeau, 2002), Politique (L. Brisson/J.-F. Pradeau, 2003), Charmide/Lysis (L.-A. Dorion, 2004), Hippias Majeur/Mineur (F. Fronterotta/J.-F. Pradeau, 2005), Les Lois (L. Brisson/J.-F. Pradeau, 2006), Ménexène (D. Loayza, 2006). Dans la collection « Guillaume Budé », Paris, Les Belles Lettres : Sophiste (A. Diès, 1925) (Platon, Œuvres Complètes, Paris, Les Belles Lettres, 1925, VIII, 3) ; Théétète (A. Diès, 1926) (Platon, Œuvres Complètes, Paris, Les Belles Lettres, 1926, VIII, 2). En dehors des ouvrages spécialisés cités dans les notes et des bibliographies très utiles de chacun des volumes de la collection GF, voici quelques suggestions pour accompagner la lecture des œuvres de Platon : Pour commencer : Brisson, Luc & Fronterotta, Francesco (dir.), Lire Platon, Paris, PUF, 2006. Brisson, Luc & Pradeau, Jean-François, Dictionnaire Platon, Paris, Ellipses, 2007. Pradeau, Jean-François, Les Mythes de Platon, Paris, Flammarion, 2004. Robin, Léon, Platon, Paris, PUF, 1935. Pour approfondir, voici quelques études récentes traversant l’oeuvre avec un prisme spécifique, en plusieurs langues : Desclos, Marie-Laurence, Aux marges des dialogues de Platon, Grenoble, Millon, 2003.Kahn, Charles H. Platon and Socratic Dialogue, Cambridge, CUP, 1996. Fronterotta, Francesco, Methexis, la teoria platonica delle idee e la partecipazione delle cose empiriche, Pise, Scuola Normale Superiore, 2001.
platon160p_V2.indd 154 13/10/10 10:35:37
155
Gonzalez, Francisco, Dialectic and Dialogue: Plato’s Practice of Philosophical Inquiry, Northwestern University Press, 1998. Karfik, Filip, Die Beseelung des Kosmos, Munich-Leipzig, K. G. Saur, 2004. Macé, Arnaud, Platon, Philosophie de l’agir et du pâtir, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2006. Pradeau, Jean-François, Platon, l’imitation de la philosophie, Paris, Aubier, 2009. Szaif, Jan, Platons Begriff der Wahrheit, Fribourg (en Br)-Munich, Alber, 1996.
platon160p_V2.indd 155 13/10/10 10:35:37
156
Table des matières
Prologue p. 5 I Devenir philosophes ?II Pourquoi les Grecs ?III Les dialogues notre lieu d’exerciceIV La philosophie trouve son chemin vers l’invisible dans l’atelier
Partie I Outils I diviser, rassembler Chapitre I Les règles de l’art p.15§ 1. Un modèle pour juger de toutes choses§ 2. Savoir définir et conseiller : la prérogative des hommes de l’art§ 3. Que sait donc l’artisan (I) ? Fonction, puissance, vertu. Premiers pas vers l’invisible§ 4 : Que sait donc l’artisan (II) ? La forme et l’ordre : l’art et l’invisible
Chapitre II Les vertus sur l’établi p.34§ 1. La plus belle femme du monde et le mètre-étalon§ 2. La lenteur du sage : examen de l’étalon-qualité § 3. Voir ou ne pas voir l’océan : examen de l’étalon-porteur§ 4. L’unité du multiple par éminence : la revanche des étalons ?§ 5. La tentation de faire des petits morceaux§ 6. L’unité de la forme, cœur de la réalité§ 7. Nous n’avons jamais vu la beauté ni la force : l’invisibilité de la forme
Chapitre III Les opérations du philosophe artisan : découper/rassembler p.59§ 1. Multiplicité sensible, multiplicité des formes§ 2. Rassembler : inclure une forme recherchée dans une autre forme plus grande§ 3. Diviser : retrouver une forme recherchée au sein d’une forme plus grande§ 4. Ne pas couper en petits morceaux§ 5. Mise en pratique : diviser et rassembler l’amour
platon160p_V2.indd 156 13/10/10 10:35:37
157
Partie II Outils II Combinaisons et mélanges
Chapitre I : l’ontologie sur le modèle artisanal. La réalité est un mélange p.74 § 1. L’océan de l’être§ 2. Dans l’atelier de Zénon : les choses sensibles à l’épreuve du feu§ 3. Dans l’atelier de Parménide : obtenir la communication des formes§ 4. L’alliage ontologique : les règles du mélange§ 5. L’artisan au fondement de l’ordre du monde
Chapitre II : L’art de la mesure : l’âme ouvrière d’elle-même p.101§ 1. Notre perception, un décor en trompe l’œil§ 2. Notre vie affective, un décor en trompe l’œil§ 3. Hédonisme aristocratique, hédonisme populaire, hédonisme technicien§ 4. Notre solitude face aux arts d’imitation § 5. L’effet de l’art de la mesure dans la vie morale : la disparition du trompe l’œil Chapitre III : La production des vivants : individus, cité, cosmos. Manuel du producteur p.116 § 1. Qu’est-ce qu’un vivant, qu’est-ce qu’une âme ? § 2. Les ingrédients de la réalité psychique § 3. La combinaison des ingrédients psychiques : mode de présence des vertus dans les âmes et les cités § 4. La combinatoire en mouvement : la transformation des âmes et des cités § 5. Le savoir-faire apte à transformer les âmes et les cités § 6. L’intelligence collective et la création de nouvelles formes de partage du savoir
Conclusion : Le platonisme à venir, travaux préparatoires p.137 I L’actualité d’une philosophie II Répéter une philosophie. La question de sa diversité interne III Se raconter des histoires
platon160p_V2.indd 157 13/10/10 10:35:37
éditions è®e60 rue Édouard Vaillant 94140 Alfortville - France
Tél. 09 50 44 27 35 - [email protected]
www.editions-ere.net
DIFFUSION DISTRIBUTION LIVRESLES BELLES LETTRES
25 rue du Général-Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre - France
Tél. 01 45 15 19 70 http://www.bldd.fr
platon160p_V2.indd 159 13/10/10 10:35:37

































































































































































!["Un filosofo mancato" Aporie della concezione plotiniana della natura ["A Philosopher manqué". On Some Difficulties in Plotinus' Doctrine of Nature]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63240d803c19cb2bd106ce51/un-filosofo-mancato-aporie-della-concezione-plotiniana-della-natura-a-philosopher.jpg)