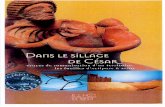Le voile: symbole de l’instrumentalisation de la femme au nom de l’idéologie républicaine.
La rue pavoisée. Une acclamation républicaine de la souveraineté
-
Upload
sciencespo-grenoble -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La rue pavoisée. Une acclamation républicaine de la souveraineté
Sous la direction de Robert Belot
, TOUS REPUBLICAINS !
ORIGINES ET MODERNITÉ DES VALEURS RÉPUBLICAINES
ARMAND COLIN 1 R EC HERCHES
La rue pavoisée. Une acclamation républicaine de la souveraineté
Olivier /hl
La rue emportée par un déferlement tricolore de drapeaux : ce motif n'a cessé en France d'exercer une étrange fascination. Jusqu'à ces dernières années, qui l'ont oumis aux surenchères de la « tradition républicaine». Campagne présidentielle de
2007 : la candidate socialiste cherche à se réapproprier l'idée de nation . D 'où l'exhortation lancée à « chaque foyer français » de « pavoiser le drapeau tricolore à ses fenêtre le jour de la tète nationale 1 ». Mai 2009 : «pavoiser tous les bâtiments publics en permanence» est l' une des propositions pour «le respect des symboles républicains» présentées par des députés UMP au ministre de l' Immigration et de l'Identité nationale. Une mesure qui ne visait pas seulement les mairie et préfectures mais aussi les « écoles, hôpitaux, stades, centres de secours, services départementaux d'incendie et de secours2 >>. Censé rendre visible la souveraineté de la nation, le pavoisement magnifie une rue devenue l'expression politique de l'opinion. Un geste qui est, en France, un u age, non une obligation juridique3
, c'e t-à-dire une mise en scène fixée par une sociologie, façonnée par une hi stoire.
Le rappeler n'est pas sans intérêt à un moment où le sentiment national est présenté comme la raison naturelle des États-nations, voire annexé à des récits mythologiques. Retrouver les procédés de mobili sation qui ont construit puis naturalisé ses conditions d'expression, c'est se donner les moyens de comprendre que la nationalisation des sociétés européennes au XIX0 siècle ne fut pas spontanée mais le produit de rituel s sociaux.
Observons-le : il fut une époque où l'acte collectif d 'arborer un drapeau équivalait à une acclamation visuelle de l'autorité. Osons même une analogie. À la manière dont l'électeur introduit un bulletin dans l ' ume, pavoiser c'était alors soutenir la candidature d' un gouvernement ou d'un régime. Un acte de souveraineté qui avait, lui aussi , ses abstentionnistes, voire ses votes nuls4
• Si le geste était individuel, sa synchronisation pouvait dissiper toute menace d 'atomisation. D'où, pour les préfets,
1. Le Figaro du 15 mars 2007. 2. Le Monde du 6 mai 2009. 3. À l'intervention de M. André Dulait (Deux-Sèvres- UMP) publiée dans le JO (Sénat du 2211 1/2001, p. 3684) «rappelant la nécessité du pavoisement des édifices publics dans toutes les communes de France à l'occasion (des) manifestations nationales», le ministère de l'Intérieur rétorqua qu'en dehors de l'article 2 de la Constitution de 1958 (« L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge»), aucun texte législatif ou réglementaire ne fixait les règles de pavoisement des édifices publics. Cérémonie nationale, récept ion de chef d'État , obsèques officielles : à chaque fois, la pratique est encadrée par simple circulai re du Premier ministre, une procédure présentée comme << conservant toute son efficaci té » (JO Sénat du 17/01 /2002, p. 161). Un tel déploiement est associé à des règles strictes de protocole: à la question d'André Wojciechowski (UM P, Mose lle) sur << l'opportunité de dresser un drapeau européen lors des cérémonies commémoratives» (JO, 25/ 11 /2008, p. 10087), il fut répondu (31 /03 /2009, p. 3087): «Le drapeau eu ropéen ne peut toutefois être hissé qu'en y associant les cou leurs françaises et sou réserve qu'il soit placé à droite du drapeau français et donc vu à gauche de ce dernier en regardant l'édifice public. » 4. Comme dans ce vi llage, où les drapeaux posés aux croisées de son grenier par l' adjoint monarchiste
107
1 'image d'un « élan admirable et .irrésistible » se propageant « partout, dans toute la France », symbole de «l'union fraternelle de toutes les parties de la nation et de tous les citoyens français' ». Comme si, par la force du drapeau arboré, «chaque Français se donnait la main pour célébrer la fête2 ».
L'acclamation par le pavoisement? On dira, aujourd'hui, la pratique désuète. N'a-t-elle pas été détrônée par la multiplication des opérations électorales ou par le déferlement de la pratique des sondages? Sans doute, mais la rue pavoisée suscite toujours de la nostalgie. Technique de mobilisation, elle continue d'être sollicitée pour réactiver le thème d'une fraternisation civique s'étendant de quartier en quartier, de ville en ville. Raison supplémentaire pour ne pas délaisser l'étude de sa genèse ou celle de ses conditions de mise en œuvre. Si les drapeaux aux trois couleurs ornent les bâtiments publics depuis la Révolution française, ils ne sont vraiment arborés à la fenêtre des milieux populaires que depuis l'aube de la Troisième République. Encouragé par une production industrielle à bon marché, le drapeau domiciliaire, c'est-à-dire acquis et exhibé à la croisée de larges fractions de la population, est devenu dans ces années un instrument de légitimation à part entière. Après la double commotion de Sedan et de la Commune, il fut mobilisé à une large échelle, oscillant jusque dans l'entre-deux-guerres entre manifestation patriotique et procédure de ratification, mise en scène de 1 'esprit public et expression souveraine de l'opinion.
La peinture a saisi 1 'apparition et le développement de cette pratique. Entre 1878 et 1914, nombreuses sont les œuvres qui donnent à voir des scènes de rue pavoisée. Prétexte au déploiement de la couleur comme au travail sur la lumière, le motif est, en ses débuts, un acte militant. Associé à la force d'entraînement du patriotisme dont elle peuple les fictions, la rue pavoisée participe de ce que Philip G. Nord a appelé « la peinture de la vie républicaine3 ». Sur les chevalets des impressionnistes, avantgarde ralliée au nouveau régime, l'explosion du bleu, du blanc et du rouge vient saluer l'avènement d'un espace public s'affichant comme «démocratique», « laïque», « populaire4 ». Jusqu'à nouer une correspondance impérieuse entre représentation politique et représentation artistique. Pour les organisateurs, cet arrangement cérémoniel- arborer un drapeau tricolore à sa fenêtre- remplissait une autre fonction. Il devait mesurer l'enthousiasme du rassemblement. En un mot, arrimer l'autorité à la popularité.
L'analyse d'un corpus d'une vingtaine de toiles consacrées au thème de la rue pavoisée permet de dégager les mécanismes au travers desquels un tel rituel a pu structurer collectivement et individuellement l'idée d'une souveraineté acclamative. Une fois mis en série et contextualisé par des enquêtes de presse et d'archives, ce corpus offre un point d'observation particulièrement stimulant. Il relativise, par exemple, la thèse mécaniste de célébrants captifs ou passifs, celle de gestes entièrement à la merci des stratégies d'enrôlement des ordonnateurs de la liesse. Il est bien des manières, on le verra, de confectionner ou de brandir un drapeau, voire d'en contester
du maire sont dénoncés : au nombre de cinq ou six, ils avaient à peine« la grandeur de la main », comme pour ridiculiser l'opération du pavoisement elle-même. Lettre du maire d'Arsac du 6 mai 1889. A.D. Gironde, 1 M 712. L'observation se rapporte au 14 juillet 1888. 1. Délibération de la commune d'Aiton, Il juillet 1880. A.D. Savoie, 9 MVS. 2. Lettre du maire de Champignolles du 7 juillet 1881. A.D. Eure, 1 M 359. 3. Les impressionnistes et la politique. Art et démocratie au XIX' siècle, trad. Jacques Bersani , Paris, Tallandier, 2009, P. 86. L'édition originale (lmpressionists and Politics : Art and Democracy in tlze Nineleentlz Centwy ) a été publiée chez Routledge en 2000. 4 . Sur la politisation des œuvres proposées sous le Second Empire par les peintres qui, en 1874, formeront le groupe des Impressionnistes, voir Jane Mayo Roos, Early lmpressionism and tlze French State (/ 866-1874). Cambridge University Press, 1996.
108
l'emprise. Par ailleurs, ces œuvres font découvrir, grâce à la profondeur de l'œil du peintre, comment les célébrations nationales, un demi-siècle durant, ont opéré pour naturaliser 1 'évidence de l' unité nationale'. Car cette dramaturgie politique est parvenu à lier jusqu'à les confondre deux types de significations associées au déploiement public du drapeau : accomplir un geste de souveraineté et marquer une allégeance civique, exprimer une conviction politique et traduire un conformisme
social. L'acclamation visuelle donnait corps à l'idée d'un vœu unanime du peuple, d'une rue et d'une ville se dressant pacifiquement pour défendre la nation. Un répertoire d'action d'autant plus célébré que le suffrage universel restait perçu, depuis l'échec de la Seconde République, comme ne légitimant qu'imparfaitement les institutions. En appeler au pavoisement, c'était mobiliser des consentements, voire agréger des opinions, mais de manière géométrique plus qu'arithmétique. Contrairement à l'élection, procédure de dénombrement qui abstrait l'individu de son environnement, la rue pavoisée préserve, elle, l'encastrement social des individus. Elle se confie aux rapports de voisinage comme aux liens hiérarchiques ou professionnels propres à chaque territoire (immeuble, rue, quartier. .. ). Le drapeau arboré à la croisée du domicile? Un dispositif de légitimation à la fois domestique et public, intime et collectif, dont le régime naissant de la Troisième République s'inspira pour nourrir le culte d'une démocratie d'assemblée.
UNE TRAME VISUELLE DE L' ACCLAMATIO
Chez les Romains, on désignait par acclamationes (de ad et clamare, «crier à») les marques de soutien ou de défiance par lesquelles le peuple considérait les personnages publics. Le mot s'étendait aux procédures matérielles d'expression comme les sifflets ou applaudissements, vivats ou quolibets, jets de fleurs ou de projectiles. On pense à la cérémonie romaine par laquelle, s'avançant sur son char, l'imperator se faisait prêter hommage aux cris de «Jo triomphe 2! ». La rue pavoisée relève du même arsenal : celui des pratiques acclamatives. Le peintre, lorsqu'il fixe les motifs de sa composition, offre le moyen d'en comprendre le déploiement. Parce qu'il lui faut projeter cette réalité dans un espace à deux dimensions mais aussi parce que son travail reste tout entier prisonnier d'un dédoublement scénique. Ne doit-il pas faire le tableau de ce qui s'énonce déjà comme un tableau? Ordonner la représentation d' une liesse ou d'un deuil qui a déjà été conçu comme une scénographie? Dès ce moment, ce que fixe le pinceau du peintre, ce ne sont plus seulement des dispositions visuelles mais, plus largement, les propriétés visibles du moment, sinon du milieu , qui les a façonnées. Un jeu de formes et d'emboîtements qu'une sociologie historique des rituels politiques ne saurait examiner avec dédain.
Faut-il le préciser? Représenter le tout du « peuple» est un défi tout autant technique que politique. Seule sa figure conventionnelle peut être appréhendée. Et encore, par des abstractions qui sont, en régime démocratique, de nature arithmétique et juridique3. Le rituel du pavoisement ouvre, quant à lui, sur une mise en scène plus
arick, " Festivals in Modem France : The Experience of the Third Republic", Journal of
ContemporaJ)' His lOI)', 12, 1977, p. 435-60. 2. L'acclamation vient du latin ace/amalio qui signifie au sens juridique : « le vote, par cris d' enthou-siasme, pour ratifier une élection », Richard Rose (dir.), International Encyclopedia of Elections , Londres, Mac Mi lian, 2000, p. 2. Sur la prégnance de cette forme antique de vœu social, voir Olivier lhl , (( Acclamation », in Pascal Perrineau, Dominique Reynié, (dir.), Dictionnaire du l'Ole, Paris, P.U.F. , 2001 , p. S-8. 3. Rappelons que pour Émile Littré le mot (( peuple » désigne non seulement la (( multitude d'hommes d ' un même pays et vivant sous les mêmes lois», une (( partie de la nation, considérée par rapport aux
\09
-... .,.1'
immédiate. À la manière dont le« feu» fiscal avait pu servir d'unité de mesure sous l'Ancien Régime, le drapeau arboré vient témoigner de l'fncl ination d'un ménage <?U d'un foyer. Il emblématise une participation à la solennité d'un groupe ou d'un Etat. Comme l'acte de vote avant son extension aux femmes, l'acte de pavoiser extériorise une attitude à la fois individuelle et familiale . En revanche, dans son éloquence matérielle, il s'éloigne des rapports de pure extériorité qui caractérisent la logique du scrutin en se cantonnant à des individus opérant isolément et en secret. Pavoiser, c'est afficher une résolution qui se confie au regard du voisinage ou du quartier. D 'où une trame visuelle du sentiment national qui a longtemps tiré sa force de son contraste avec la représentation majoritaire de la démocratie électorale, en l'occurrence avec la révolution de 1848 qui instaura le suffrage universel mais pour en amputer l'accès quelques mois plus tard, ou avec l'Empire de Louis-Napoléon Bonaparte qui , l'ayant rétabli après son coup d'État, le manipula par le biais du plébiscite.
Dénombrement géométrique, le pavoisement n 'a pas laissé insensibles les impressionnistes. La toile qui l'illustre le mieux est celle de Claude Monet, La rue SaintDenis. Fête du 30 juin 1878. Elle a pour sujet la première tète nationale organisée depujs la défaite de Napoléon Ill devant la Prusse et l'épisode sanglant de la Commune. Célébrant la fin de l'Exposition universelle, elle fut organisée quelques mois après l'épilogue de la crise institutionnelle du 16 mai: un contexte politique auquel cette représentation picturale doit beaucoup. Un mot sur ce contexte : effective à la mi-décembre 1877, la défaite politique du Président monarchiste Mac Mahon devait consacrer la toute-puissance du Parlement et des républicains. En brisant le rêve d'une restauration royaliste, avec son retour au drapeau blanc, la crise mettait fin à la prétention du chef de 1' État de représenter la nation par-delà les résultats des élections parlementajres. Ce que Léon Gambetta appelait « la voix souveraine de la France » prenait le pas sur le césarisme démocratique. Une autorité devant laquelle chacun ne pourrait que« se soumettre ou se démettre». Les élections d'octobre 1877 n'ayant pas tranché ce conflit sur la responsabilité dans un gouvernement représentatif, il fallut attendre le rejet du nouveau cabinet conduit par Gaétan de Rochebouet pour que Mac Mahon se soumette, le 13 décembre, en rappelant Jules Dufaure pour former un ministère de centre gauche. Cette capitulation laissait les mains libres à la majorité républicaine de la Chambre des députés. Sous prétexte de vérification des pouvoirs, elle invalidera plus de soixante-dix mandats avant d'arracher le Sénat aux monarchistes en janvier 1879 et de provoquer le départ de Mac Mahon : c'était la fin du dualisme parlementaire de type orléanist~. La disparition de la pratique de la dissolution, l'effacement du rôle du chef de l'Etat devaient désormais conforter la Chambre dans son ambition à représenter la nation de façon absolue.
En juin 1878, Monet peint une rue tricolore mise en cortège directement par le peuple de Paris1
• Les historiens de 1 'art ont insisté sur 1 'influence japonisante de cette
classes où il y a soit plus d'aisance, soit plus d ' instruction » mais aussi « par extension » le groupe synonyme de « foule, rassemblement» (Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette, 2e éd. augmentée, 1875, p. 1091 ). Une définition qui, du plus abstrait au plus concret, glisse d'une forme à l'autre des rituels de représentation politique: d' une communauté légale assujettie au droit commun du législateur à une classe sociale marginalisée sinon dépossédée, puis à une portion toute physique, celle de corps rassemblés par et pour une circonstance précise. 1. Un trait dont Louis-Edmond Duranty fit une singularité de << la peinture la plus récente» : << frapper les yeux des foules par des images saillantes, textuelles, aisément reconnaissables en leur vérité, dénuées d'artifices». Et de pronostiquer que « le public est tout disposé à tèter un art qui représente avec tant de fidélité ses habits, son visage, ses habitudes, son goût, ses inclinations et son esprit », La nouvelle peinture, Paris, Ed. du Boucher, 2002, 1re éd. 1876 (Paris, E. Dentu), p. 4. Rappelons que cet ouvrage fut publié à l'occasion de la seconde exposition des impressionnistes qui s' était tenue la même année à la galerie Durand-Rue!.
110
vue plongeante, sur la surenchère des jeux de couleurs, ceux par lequel le charroi des drapeaux aspire le trian,gle sombre de la foule 1• Reste que la peinture de Monet a une intention politique. Echelonnée par la perspective et comme impatiente de s'unir au vent tricolore, la foule s'y découpe en deux types de gratitudes bien distinctes. Tandis qu ' une banderole cache, en bas à gauche, un« VIVE LA FRANCE2 », une inscription, face à elle, brise l'anonymat de ce transport d'enthousiasme: «VIVE LA REP[ublique] ». Regarder cette inscription, c'est se heurter à une énigme: que recouvre la force de ce« VIVE LA REP . .. »?La mention paraîtra, de nos jours, bien inoffensive: en 1878, elle est militante. L'interdiction des emblèmes de la République (comme la Marseillaise ou le cri «Vive la République » toujours prohibé par le régime) en rend compte. «VIVE LA REP ... »: esquissée et comme bâillonnée, l'inscription est badigeonnée en lettres d'or sur le blanc d'un drapeau. Geste désinvolte? Il s'en faut de beaucoup.
En ce début d'été 1878, l' expression est un slogan3. Elle vient ponctuer la ferveur
républicaine du peintre au point de rester désignée, jusqu'à 1 'élection de Jules Grévy en février 1879, par des qualificatifs peu amènes: les procès-verbaux de police parlent d'« acte séditieux» ou d'« agitation». Dans la capitale, l'interdiction vise d'autres messages arborés par les habitants. Une maison, rue Rambuteau, est ornée en ce 30 juin d'une large tenture rouge semée d'étoiles d'or, avec à chaque extrémité les initiales « RF » et au centre le mot « Paix ». Rue du Sentier, ce sont les armes de l' Allemagne qui sont écartelées sur fond de blason d'Alsace-Lorraine : un spectacle qui suscita la réprobation du journaliste du Petit Parisien, Firmin Charlerie. Au coin de la rue du Petit Carreau, une tenure sur un balcon est surmontée de l'inscription : «R.F. Paix et Travail-Progrès et Liberté R.F. » À chaque fois, ce qui heurte, c 'est la présence du monogramme« R.F.», une indexation de la liesse voulue par les conseillers municipaux alors dans l'opposition. En répondant à l'invitation, les Parisiens assignaient à l'enthousiasme un référent distinctif. Ils tètaient la nation sans rallier le gouvernement de Mac Mahon . On le constate: l'exubérance des trois couleurs n'est pas à rapporter à la seule imagination du peintre ou à la complaisance de la presse. Elle naît bel et bien de 1 'entraînement festif, motif principal de la toile et enjeu politique de la célébration4
.
1. Voir, par exemple, Jane Mayo Roos, " With the Zone of Silence : Monet and Manet in 1878", Art HistOIJ', Il , 3 (septembre 1988), p. 374-407. 2. L' hymne << Vive la France! >> fut écrit par Paul Déroulède et Charles Gounod pour le l" mai 1878, jour d 'ouverture de l' Exposition universelle : il visait à opposer à la Marseillaise, chant de guerre et de combat, un chant de paix et de concorde. 3. << Formule concise et frappante, facilement répétable, polémique et le plus souvent anonyme, destinée à fa ire agir les masses tant par son style que par l'élément d'autojustification, passionnelle ou rituelle, qu 'elle comporte », le slogan excède toujours son sens explicite. 11 est un mot plein qui <<bloque le doute, !.'incertitude la pensée critique pour inciter à l' action sans réplique », Olivier Reboul , Le Slogan , Bruxelles, Editions Complexe, 1975, p. 24. 4. D'où les réactions d'une partie de la presse à l' exposition des impressionnistes ouverte avenue de l'Opéra le 1 0 avril 1879, tiraillées entre jugement de fom1e et jugement politique. Pour La Presse, « les numéros 105 et 134, deux rues de Paris pendant la tète nationale du 30 juin, sont de véritables tours de fo rce: il était difficile de mieux saisir le chatoiement des couleurs des milliers de drapeaux, des lanternes, des guirlandes qui remplissaient notre cher Paris ce jour-là ». Pourtant , la tonalité générale demeure négative. Comme Le Temps le déclare : <<le sanctuaire de l' art intransigeant » ne vaut pas qu 'on s' y arrête. Le Figaro est tout aussi hostile à cette peinture nouvelle : dénonçant les << fous furieux », << les fa bricants de vessie qui ont la prétention de nous vendre des lanternes», il s ' en prend aux <<paysages qu 'on dirait fait en un après-mid i », avec << trois coups de pinceau au hasard de la palette». Sur les 246 œuvres exposées, les deux toiles de Monet sur le 30 juin faisaient exception, <<deux toiles qui témoignent d' un retour au respect des lois de la perspective : ce sont deux souvenirs de la tète du 30 juin 1878, la tète des Récompenses, toute constellée de drapeaux. 11 y a là des coups de pinceau d ' une tonalité excessive; mais les rues représentées sont bien vivantes. animées, éclatantes et artistiquement vraies>> (Le Petil Joumaf) .
Ill
Pavoiser, c'est pour nombre d'individus endosser une affiliatipn. Revers de veston arborant la fleur tricolore, épingles peintes en rouge-blanc-bleu aux chapeaux des élégantes, casquettes aux trois couleurs sur la tête des gamins, cocardes aux oreill es des chevaux : le mimétisme tient une part importante dans cette dynamique. Mais la contrainte sociale n'est pas séparable d'une concurrence proprement politique: cell e qui vise à poser le sens revendiqué d'une participation. Pavoiser avec le monogram me R.F., c'était arguer d'une autre forme de ra ll iement que le gouvernemental «Vive la France» des tenants de l'Ordre moral. À la manière d'un placard ou d'un graffi ti , le drapeau déclame une conviction ou scande une frustration. Un usage dont les commémorations du 4 septembre ou du 14 juil let avaient favorisé 1 'apprentissage depuis plusieurs années. Qu'il suffise d'évoquer ce tonnelier de Sainte-Foy pavoisant sa demeure, le 4 septembre 1873, en inscrivant au côté de la devise républicaine : «Les Républicains sont des hommes et les esclaves des enfants ».
Le même jour, Édouard Manet représente la fête du 30 juin en mettant en scène une opposition politique assez semblable (La Rue Mosnier aux drapeaux). De sa fenêtre au second étage du n° 4 de la rue de Saint-Pétersbourg (aujourd'hui rue de Leningrad), il saisit le drapé coloré des immeubles récemment construits. Ce qui l'attire? Le mouvement du rassemblement, par exemple avec ses deux passagers descendus d'une voiture Hansom ou, au premier plan, un ouvrier portant une échelle. Si des étoffes tricolores serpentent le long des façades, une partie de la toile apporte, là encore, une touche dissonante. Face aux toilettes pimpantes, à l'arbre décoré, des gravats et pavés jonchent le sol d'une nouvelle voie de chemin de fer. À leur côté, un ancien combattant sur ses béquilles dresse, de dos, une mise en garde à la liesse cocardière. Le souvenir de la Commune n 'est pas dissipé, ni celui des barricades. «Peinture de démocrates, d'hommes qui ne changent jamais de linge», comme le disait le ministre des Beaux-Arts du second Empire, Nieuwerkerke? En tout cas, la fête porte avec elle une ombre(« le pauvre a-t-il une patrie?») qui rappelle l'opposition de 1 'ume et du fusil.
Le drapeau tricolore n'est pas en ces années un objet inerte ou un signe officie l. Par son contexte d'emploi , il vient signifier un volontarisme politique. Une orientation dont plusieurs peintres se sont plu à fixer le tranchant dans la lumière de la ville. Si Monet s'était installé sur un balcon du boulevard de Strasbourg pour saisi r une impression de plein air et non d'atelier' , la fête du 14 juillet à Paris en 1887 met en couleurs sa découverte de la ferveur populaire. Installé depuis février 1886 da ns la capitale, il met en valeur par des tons purs l'état de transe qui lui semble caractériser cette démocratie de drapeaux et de lampions. Une manière de faire d'un objet l' emblème d'un sujet2.
Le regard de ces peintres n'est-il pas comme celui de Fabrice dans La Chartreuse de Parme. On dira qu'il conduit, lui aussi , à un rétrécissement du champ de vision (le syndrome du «valet de chambre»). De ce regard qui faisait du maréchal Ney un gros général qui jure. Et de Napoléon un fantôme de champ de bataille. La rue pavoisée se mue, dans ces œuvres, en notations particulières qui, objectera-t-on, n'évoquent la réalité que« de loin». Comment voir la tète du 14 Juillet ou celle de la Paix et de l'Industrie dans cet agglomérat de couleurs et de façades? Comment
1. Vincent Yan Gogh
2. Comme l'observe Maurice Dommange!, s ' approprier une abstraction par un instrument est dans la logique de tous les rituels : « Prenez la salle de banquet d'une guinguette de banlieue et mettez-y un drapeau, accrochez-y une étoffe rouges : cela en fait un "banquet socialiste". Les participants, églantine à la boutonnière, vont pouvoir vivre ce banquet dans une temporalité autre et dans un état second, dans une identité chimérique concrétisée par du " rouge", identité de prolétaires, de militants révolutionnaires, de membres déjà de la Cité collectiviste dont ils rêvent », Histoire du drapeau rouge des origines à la guerre de 1939, Paris, Librairie de l' Étoile, 1967, P. 35.
112
LA KUt 1-'AVUI::.tt . UNE ACCLAMATION Kti"'Ut:SLILAINt U t LA ::.UUVtKAINt 1 t
y lire une expression républicaine du sentiment national? Fabrice se pose obstinément la question : «Ceci est-i l une véritable bataille? [ .. . ] cette bataille était-elle Waterloo?» Waterloo n'a pas eu Je spectaculaire auquel il s'était préparé. Mais la bataille a eu lieu. Sous ses yeux. Aussi , plutôt que d'incriminer le fantasme de la presse ou l'artifice de toute narration, il peut être judicieux d'appréhender la scène comme tant d'observateurs scrutent la rue : au gré de perceptions fragmentées, partielles et périphériques. C'est l'enseignement que nous livrent les peintres. En se multipliant et en se recoupant, ces vues fondent le pouvoir d'une analyse, qu'elle soit juchée ou non sur un balcon.
Rue Saint-Denis, les locataires qui n'ont pas de fenêtres sur la rue voulant quand même prendre part à la tète, ont dressé devant les maisons des mâts ornés de drapeaux avec cette inscription « Cour du n° ... ». Dans le 3c arrondissement, la rue du Temple, Jes rues Pastourel , de Bretagne, Michel-le-Comte, Montmorency et Chapon étaient Jes plus ' décorées: des rues de petits commerçants, d ' ouvriers en chambre et d' employés. Là, «pas une fenêtre qui n'ait son drapeau», plusieurs journaux le relèvent. Guirlandes, feuillages, palmes, branche d'olivier: tout est bon pour y signifier publiquement la liesse. Rue Saint-Antoine en face du 167, un arc de triomphe se dresse, avec quatre mats reliés entre eux par deux bandes tricolores surmontées de 1 'inscription « Aidons-nous les uns les autres» et sur une autre « Paix, travail et liberté». Dans le 6c arrondissement, boulevard Saint-Germain, des enfants avec des petits drapeaux tricolores« Le Chat botté» : il s'agissait de drapeaux-réclames dont cinquante mille exemplaires avaient été distribués par le théâtre de la Gaîté. Dans le Il c arrondissement, un buste de la République, dans la rue d ' Angoulême, constituait le principal ornement au côté d'un arc de triomphe, rue Mercœur, portant la formule « Union des Peuples ». Dans le faubourg Saint-Antoine, les maisons étaient pavoisées « jusqu ' à la dernière lucarne de mansarde» : de nombreux propriétaires ont même pavoisé 1 'intérieur de leur cour bien qu'elle ne se voit pas de la rue. La maison du Singe vert fut coiffée d'un immense bonnet phrygien. À ses côtés, un propriétaire a érigé devant sa maison une armature de petits drapeaux d'un sou qui la couvre entièrement : il y a plus de cinq cents drapeaux reliés les uns les autres par un treillis de ficelle. Dans le 14c, les magasins et restaurants vont jusqu'à mettre des stores et rideaux tricolores aux fenêtres . Sur les boulevards, on vend des rubans, des marguerites, des œillets, des cocardes, des boutons, des petits drapeaux, des plumes, des ceintures et des cravates tricolores mais aussi des casquettes, des corsets et des voilettes jusqu'aux colliers des chiens ou les dragées des confiseurs aux trois couleurs. Pour la presse, le ton est unanime : «Jamais tète à Paris ne s ' était passé comme celle du 30 juin. Jamais on n'avait vu la foule se mouvant avec cette allure libre, avec cette bonne volonté d'aide et de protection mutuelle» (Le Petit Journal du 3 juillet). Certains s'essaient même à dénombrer et comparer: «Dans la seule rue d ' Aboukir, très brillante il est vrai , il y a eu 1 479 drapeaux ; le 1 cr mai dans la même rue il n'y en avait que 729 »(Le Figaro). Il est d'autres chiffres qui visent à être éloquents. Comme ces cinq cent mille personnes venues de province et de banlieue par les seuls trains de la veille. Ou ces quarante-cinq mille familles qui ont eu 2 francs des bureaux de bienfaisance. Dans la rue Saint-Honoré, un marchand de vin offre une barrique de vin, sous l'écriteau «Une barrique de vin coulera gratis de 3 à 5 heures ». Il suffira de deux heures pour écouler deux cent vingt-huit litres de vin, verre par verre. Chiffres, mesures, évaluations : l' emphase se targue de données et de dénombrements . Comme pour mieux dire le caractère démocratique du pavoisement.
En 1878, la rue pavoisée offre aux « républicains véritables» de se jauger, sinon de se juger. De faire surenchère de leur opinion pour drainer le plus grand nombre. Les chroniqueurs et agents de police insistent pour souligner combien le drapeau
113
----~·
tricolore se rendit maître des rues de Pari s. Une façon d'encensvr la «spontanéité>> et« l'unanimité » de ce qu'il s· tenaient pour une ratification populaire. En somme, de rapprocher le pavoisement d'une élection visuelle. À la manière du vote à main levé ou de 1 'acclamation orale, le drapeau arboré venait signifier 1 'approbation par une procédure sensible de résolution, c'est-à-dire par un vœu : celui de la capita le de la France.
La tète est un culte : celui de la nation . Elle emprunte, comme 1 'a bien pressenti Maupassant, aux processions et liturgies des temps passés 1• Avec la République, le sacré n'est plus réduit au corps de gloire du roi. Il se réfugie dans des rituels de représentation dont la vocation est de manifester l ' unité du peuple souverain. D'où la nécessité d 'étendre la portée analytique de la notion de représentation . Celle-ci ne doit pas être restreinte à 1 'acte de délégation é lectorale. Au contraire, e lle doit être é largie à l 'ensemble des rituels d'agrégation dont procède la mise en scène du politique.
UN MODE SENSIBLE DE RÉSOLUTION ?
fnterpréter cette acclamation visuelle est un exercice codifié. Il revient, pour les journalistes et observateurs policiers, à reconstituer l 'état d'esprit dans lequel a pu se trouver, à un moment donné, telle rue ou tel quartier. D 'où la propension à fai re du récit de chaque pavoisement un di scours panoramique et rétrospectif. S'y ajoute la tendance à psychologiser les comportements entrevus. Un certain nombre de stéréotypes en résultent qui se répètent de compte rendu en compte rendu . Plutôt que de multipl ier les citations, reproduisons longuement un extrait particulièrement éloquent.
Journal des débats politiques et littéraires du 3 mai 1878
L'impression que la journée d'hier a produite sur tous ceux qui connaissent depuis longtemps Paris est une impression de surprise autant que de joie. Nous n'avions jamais ass isté à un pareil spectacle, et les plus âgés sont obligés de rappeler leurs plus vieux souvenirs pour y retrouver une manifestation aussi spontanée, aussi unanime, aussi éclatante du sentiment populaire. L'Exposition universelle a été préparée dans une sorte de silence, au milieu des sourdes critiques des uns et des espérances timides des autres. Si satisfaisant que soit en ce moment l'état intérieur de notre pays les agitations du dehors sont trop vives pour qu'une vague appréhension n'a it pas combattu jusqu'à la dernière heure la confiance qui s'était glissée et qui subsistait dans les cœurs. Ce qui est certain, c'est que personne ne songeait, il y a quelques jours à peine, à la grande fête dont nous venons d'être témoins. Aucun préparatif n'avait été fait, aucune mesure n'avait été prise pour
1. Le 14 Juillet 1886, Guy de Maupassant tente d'échapper à la ville en gaieté, bruyante et emponée, avec «ses bourgeois regardant les drapeaux d'un air heureux ». Trouvant cette «joie publique» intolérable, il se réfugie dans une église : « Elie était vide, haute, froide, mone. Au fond du chœur obscur, brillait, comme un point d'or, la lampe du tabernacle. Et je m'assis dans ce repos glacé. Au-dehors j'entendais, si loin qu 'elles semblaient venues d'une autre terre, les détonations des fusées et les clameurs de la multitude. Et je me mis à regarder un immense vitrail qui versait dans le temple endormi un jour épais et violet. Il représentait aussi un peuple, le peuple d'un autre siécle célébrant une tète d'autrefois, celle d'un saint assurément. Les petits hommes de verre, étrangement vêtus, montaient en procession le long de la grande fenêtre antique. Ils ponaient des bannières, une châsse, des croix, des cierges, et leurs bouches ouvenes annonçaient des chants. Quelques-uns dansaient, bras et jambes levés. Donc à toutes les étapes du monde, l'éternelle foule accomplit les mêmes actes. Autrefois on fètait Dieu, aujourd'hui on tète la République
1 » Jour de fête (1886), dans Comes et nouvelles, Paris, Ed. Omnibus, Ill. Félix Vallotton, 2008.
114
donner à l'ouverture de l'Exposition universelle de 1878 le caractère d'une immense démonstra tion national e et pacifique. On peut dire sans exagération que l'idée en est subitement sortie des entrailles mêmes de Paris. Il a suffi d'un projet lancé par quelques journaux et d'une décision du consei l municipal , pour qu'une sorte de commotion électrique parcourût à l'instant la vi lle entière et y produisît une véritable explosion patriotique. On a parlé de mot d'ordre, d'invitations menaçantes adressées par des meneurs au commerce parisien. Ceux qui hasardent de semblables insinuations ne savent-ils pas, par une expérience personnelle, combien les mots d'ordre et les invitations menaçantes sont incapables de produire de tels effets? Ont-ils oublié ce qu'étaient, sous l'Empire, les fêtes du 15 aoüt? Non, il n'a pas été nécessaire de soulever par des moyens subreptices l'enthousiasme populaire; il n'a pas été nécessaire de créer des sentiments factices pour les faire éclater en manifestations trompeuses. Comme l'a très bien dit M. Grévy dans un discours que tous les groupes de la Chambre ont applaudi, l'âme et le cœur de Paris ont été profondément secoués par une grande pensée nationale, et c'est ce qui fait qu'en deux jours, sans plan détenniné, sans injonction d'aucune sorte, sans préméditation, sans apprêt, toutes nos maisons se sont couvertes de drapeaux, toutes nos fenêtres de lampions, toutes nos rues d'une foule avide de participer à la première manifestation du relèvement de la France par la sagesse, par le travail et par la paix ! C'est la première fois peut-être depui s trop longtemps que la population parisienne s'est levée toute entière sous l'impulsion d'un même sentiment. Il n'y avait plus de partis, dans nos rues et sur nos places il n'y avait que des Français heureux et fiers de voir leur pays, écrasé il y a huit ans sous les plus grandes catastrophes qu'un peuple ait jamais subies, donner si rapidement une telle preuve de son impérissable énergie. Nous ne vou lons point dire que la République ne fût pour rien dans là satisfaction générale. Si la fête d'hier a été une fête républicaine, nous le répétons, elle n'a pas été une fête de parti. Un calme admirable, une gaieté tranquille ont régné partout. Tous les quartiers ont été couverts de drapeaux et d'illuminations. Les plus petites rues, les impasses à peine fréquentées brillaient autant que les grands boulevards. On sentait que tout le monde était uni dans une même pensée.
À l'évidence, la description se contente ici de prolonger l 'acte de représentation. D'où son insistance sur la spontanéité de la manifestation, la simultanéité de son déploiement, l ' homogénéité du sens attribué à chaque drapeau . Il s'agit de raconter des événements mentaux, d 'entrer dans la pensée des hommes pour expliciter les liens entre une forme et des circonstances. Ainsi, sous la plume de nombre de journalistes, 1 'expression « la gaîté vient se peindre sur les visages » revient avec vigueur. Comme pour conforter l ' un des attendus des spectacles publics, celui d'une «contagion morale» permettant à la «joie franche» de s'introduire« dans l 'âme des regardants». Plaider pour une hi stoire matérielle, c'est mettre à distance ces inférences entre l'âme et le corps, l'individu et le peuple, la rue et la vi ll e. C'est privilégier le terrain de l'explication historique plutôt que cel u i de l'herméneutique journalistique.
Dans la presse du lendemain, un maître mot domine : les rues se pavoisaient comme« par enchantement». En réalité, l'organisation n'avait pas manqué. La fête avait été décidée : par circu laire le 9 juin. Avec une date au début bien approximative : elle « aura probablement lieu le dimanche 30 de ce mois». Mais pour De Marcère, son instigateur, le but, lui , était c lair : « Afin de lui donner un caractère plus général et de la rendre accessible à tous, je pense qu'il , serait bon de nous assurer le concours de tous les habitants. C'est pourquoi je crois pouvoir m 'adresser à l ' init iative privée et à la bonne volonté de tous. » Le propos se prolongeait par une stratégie : « C haque quartier pourrait ai nsi avoir sa tète particulière dont 1 'ensemble donnerait aux réjouissances publiques ce caractère de grandeur qui a si vivement frappé l'opinion le jour de l 'ouverture de l'Exposition. Je compte sur vous pour susciter ce mouvement.» Enfin, des moyens avaient été alloués. 500 000 francs avaient été votés par l'État,
115
---~
plus 20 000 de Dufaure, mi ni stre de la Justice, sur ses frats de représentation. Le conseil municipal de Paris a voté, lui, 60 000 francs pour les illuminations et le pavoisement des édifices municipaux. Mais à contrecœur : les conseillers municipaux, par la bouche de Charles Hérisson, refusèrent de participer aux commissions d'arrondissement: «Ils ne peuvent considérer que leur rôle soit de prendre p lace sous la présidence des maires d'arrondissement [alors nommés par le pouvoir central] , dans des commissions qui ont été composées de telle sorte par l'administration que l'influence des conseillers y serait perdue dans des majorités dont les idées bien connues sont tout l'opposé des leurs» Finalement, un accord put être trouvé. Dans le sc arrondissement, le maire Dubief put annoncer la création d'une de ces commissions des tètes composée d'élus municipaux et de notables en charge des préparatifs. Elle était subdivisée en quatre sous-commissions correspondant aux différents quartiers pour se «mettre en rapport plus intime avec les habitants». C'est par là que passèrent notamment les souscriptions destinées aux habitants.
L'organisation tenait également aux compagnies des chemins de fer qui mirent à disposition des trains spéciaux à prix réduits composés de voitures de 2 ou 3c classe. Marchands et entrepreneurs de jeux et spectacles furent, eux, invités à se faire inscrire à la mairie où des emplacements leur furent assignés gratuitement. Les maires ont publié des affiches multipliant les appels les plus pressants : celle du 9c arrondissement, le 18 juin, est explicite: «Le gouvernement a pris l'initiative d'une tète nationale en 1 'honneur des hôtes de la ville de Paris venus du monde entier à l'occasion de l'Exposition universelle. Cette fête, la première donnée par la République, sera la tète du Travail, de l' Industrie, du Commerce, la tète de la Paix. [ ... ] Le maire ne doute pas que les habitants du neuvième arrondissement ne rivalisent de zèle pour donner à cette tète un éclat et une splendeur dont les étrangers emporteront un souvenir qui sera 1 'honneur de la France toute entière. » Pour Le Petit Parisien du 26 juin : «Devant ces affiches blanches, les gens s'arrêtent et disent: « Parbleu ! ! ! ». Les commerçants riches envoient de 1 'argent à la mairie et des sommes importantes. Hier, les industriels du Palais Royal ont envoyé 6 000 francs. » Dans le 2• arrondissement, chaque maison a reçu, ou recevra, la visite d'un délégué de la mairie, avec la mission de récolter le plus d'argent possible.
En mettant en scène l'assentiment public, la rue pavoisée n'a donc rien d'u ne geste spontanée. Elle n'est ni le fruit d ' une simple contagion d'enthousiasme ni le produit du charisme d'une institution. L'effervescence collective? Elle existe bel et bien mais soutenue par un travail de mobi lisation institutionnelle. Car elle est construite: par l'attente de l'événement autant que par l'encadrement du public. Tout un ensemble de déterminations qui vont du mot d'ordre gouvernemental aux directives municipales en passant par l'action des comités professionnels ou de quartier en témoignent. Repérer ces intermédiaires entre le contexte et le drapeau domiciliaire, c'est évidemment désenchanter 1 'expérience visuelle, notamment les propriétés picturales du tableau. Plaider l'histoire matérielle, c'est aussi et peut-être surtout expliquer une pratique en restituant ses conditions d'apparition, c'est-à-dire en établissant la solidité des correspondances sociologiques qu'elle entretient avec la réalité.
Transposer picturalement les signes d'adhésion à un régime était, on l'a vu, le trait dominant des œuvres des années 1880. Vingt ans plus tard, le point de vue a changé. Entre Monet en 1878 (La rue Mon/orgueil, célébration du 30 juin), et Raoul Dufy en 1906 (14 juillet au Havre) , la ligne expressive des drapeaux n'est plus la même. Si Monet se confiait au procédé de la vue plongeante, comme Caillebotte, Van Gogh ou Pissarro, avec leur rue morale à l'identité incertaine - sorte d'état de brume tricolore que renforce une perception du temps réduite à des harmoniques de couleur entrelacées - Dufy ramène, lui, le pavoisement à une pratique officielle : à l'empressement des marchands, au jeu cocardier des pavillons maritimes (d'où sa
116
référence à l'Union Flag australien: le Red Ensign, cet oriflamme commercial arboré avant 1908). Le pavoisement ne paraît ici mériter l'attention que parce qu'i l constitue te point d'application d'un patriotisme de façade. Ni porté par les cœurs, ni mobilisé
par les partts. Dans sa Rue pavoisée, Dufy qui passe alors plusieurs étés en Normandie, accentue l'annotation en fixant le regard sur la déambulation des badauds. Le motif principal du tableau? Un drapeau suspendu par la frontalité d'une absence de lumière. Au premier plan, des silhouettes se découpent par transparence dans la bande supérieure bleue. Les formes de cette intention ont été commentées: à l'exception d'une femme, wus les personnages sont saisis de dos, comme pour mieux souligner le caractère artificiel des surfaces de couleur. Autrement dit, la rue est devenue théâtre : le théâtre d'une joie populaire que Raoul Dufy reproduira dans pas moins d'une quinzaine de versions. Le thème de la rue pavoisée, cher à Monet, est repris à partir d'aplats (comme chez Gauguin) et de couleurs libérées de toute relation au réel. On connaît la formule de Dufy : « Quand je parle de la couleur, je ne parle pas des couleurs de Ja nature, mais des couleurs de peinture, les couleurs de notre palette qui sont les
mots dont nous formons notre langage de peintre. » Même appréhension chez Albert Marquet, compagnon d'escapade de ces toiles
de plein air, qui peint la même scène dans son /4 juillet au Havre . Le rôle principal n' est plus ici dévolu aux drapeaux flottant au vent, à la foule indistincte, amas de petites touches fragmentées en aplat. Car la force expressive se déplace. Elle ne réside plus dans l'appropriation souveraine d'un patriotisme tricolore : l'image d'un peuple s' élançant littéralement dans les couleurs du drapeau national. Son point de gravité se niche maintenant dans les pratiques débonnaires de quelques badauds, dans des façades d'immeubles dépouillées. Comme si la célébration républicaine
n' était plus qu'une festivité livrée à des gestes désinvoltes. Bravant les préjugés de son temps, Steinlen est parmi les peintres de la tète
républicaine celui qui le fait saisir avec le plus de force. Il ose notamment passer outre l'embarras qui pèse, au début du xxc siècle, sur la représentation sociale de la fête . Que montre-t-il sinon que les rehauts des drapeaux français sont dispersés? Le tricolore? Un lampion parmi d'autres. Le nombre? Il a cédé la place à un public disséminé. Quant au spectacle, il se situe loin des croisées pavoisées . Il réside désormais dans le plaisir de la déambulation et des retrouvailles . S'il s'assombrit au fil de la Troisième République, l'œil du peintre reste en harmonie avec son époque. Des retraites sans enthousiasme, des foules moins compactes au fil du temps, une lassitude qui s'insinue jusque dans le programme de la tète elle-même: dès la fin du XIX0 siècle, la liesse civique se présente sous un jour désenchanté. Démotivée, l' institution du drapeau domiciliaire évolue vers le conformisme.
Avec ses personnages attablés et ses danseurs enlacés, le peintre s'intéresse du coup à l'intimité populaire du bal: ouvriers, artisans, domestiques mais aussi souteneurs et demi-mondaines qui font du pavoisement un décor, sinon un prétexte. Une façon de signifier la fin du pouvoir de représentation du drapeau. L'inégalité sociale, creusée par l' exploitation capitaliste, fait de la foule un ensemble de groupes désolidarisés: voilà ce que dans leurs annotations sociologiques, les tableaux de Dufy, Steinlen ou Marquet capturent et soulignent. Les personnages regardent dans des directions différentes . Comme s' ils n'appartenaient plus vraiment à la même scène. Preuve que leur motivation s'est rattachée à leur univers social. Est-ce à dire que
ces gestes sont désorl)'lais dépourvus d'intention? Si Claude Monet, Edouard Manet et Vincent Van Gogh ont peint des rues en tète,
pavoisées de drapeaux tricolores, avec Fernand Léger (14 juillet, 1914 ou Le Drapeau, 1919), Ellsworth Kelly (Red White Blue, 1968), Hassam Childe (July Fourteenth , Rue Daunou, 191 0) ou Jasper Johns (Three Flags, 1958), le motif du drapeau
117
..J'
éclipse la rue pavoisée. À croire que l'histoire de ce mode dy représentation a atteint une limite. Les drapeaux .ne constituent plus qu'une surface plane. Ils sont j uchés sur la toile comme des tableaux. Avec une étendue qui finit par coïncider exactement avec celle du tableau . Tubes de cylindres colorés qui composent, par leur j uxtapo... sition, un drapeau tricolore, c'est-à-dire un emblème étiré par un concept de la représentation qui ne distingue plus entre mur et espace, foule et individu, géométrie et arithmétique.
LA STRUCTURE DE LA SPONTAN ÉITÉ
L'œil des peintres fait entrevoir la succession des stratégies de motivation ou au contraire, de routinisation qui s'attachent aux gestes acclamatifs. Comme celui cle ta presse montre les élites au pouvoir sachant faire de ce déploiement de couleurs une résolution politique. Pourtant, ce double regard ne suffit pas à épuiser la question du sens que revêt le pavoisement pour ceux qui ne veulent pas savoir qu ' il s le subissent ou même qu'ils l'exercent. La force d'accréditation d'un tel rituel tient aussi à la mise en commun d'états intentionnels même si leur motivation demeure à la fois très variable et peu explicite. La sociologie électorale nous l'apprend: l' acte de vote relève plus du conformisme social que de la conviction politique. Faut- il en déduire pour autant que l'élection se ramène à l'addition des gestes épars suscités par la pratique du dépôt de bulletin ? Non. Si la manière dont cette pratique est appréhendée par les participants diffère de celle dont les ordonnateurs l'ont conçue (et les observateurs interprétée), il ne s'ensuit pas que tous ces régimes de véri té se valent. L'observance d'un rituel ne se confond pas avec l'adhésion qu 'i l provoque, encore moins avec la croyance qu'il suppose 1
• La di ssociation de ces composantes du rituel loin de l'affaiblir, facilite son travail de mise en scène. Elle lui évite, en particulier, de dépendre d'une validation matérielle explicitement liée aux fonct ions qui lui sont assignées.
Comme les miracles qui naturalisaient le pouvoir des rois thaumaturges, les approbations des rituels contemporains n'ont guère besoin de preuves tangibles et manifestes. Le respect d'une simple convenance suffit : celle, civique, d'un culte du sentiment national. L'ordre politique est périodiquement réhabilité par ces démonstrations de liesse, quel que soit 1 'éparpi llement des intentions individuelles. Nul besoin ici d'un substrat psychologique ou anthropologique: la force du rituel y supplée. L'observance vaut soutien même si de la part de ceux qui s'y adonnent l'implication n'était pas conçue comme telle.
Est-ce à dire que le rituel du pavoisement n'est qu ' une badauderie instrumentalisée par les puissants? Nullement. Arborer un drapeau ou glisser un bulletin dans une enveloppe n'est pas un comportement orchestré par des notables devenus les régisseurs d'une émotion collective. La quant-à-soi de l'individu mais aussi le contexte de l' opération ou la sociologie des participants s'interposent parfois avec vigueur. Pour prendre le contre-pied de l'avertissement de Mary Douglas («Ne vous est-il jamais arrivé de vous endormir à la messe ?»), s'endormir à la messe n 'empêche pas celle-ci d'avoir lieu ... ni le participant de se dire pratiquant ou mieux croyant.
Quoi de plus touchant que d'apercevoir, dans un coin de bois perdu là-bas, parmi les arbres, au haut d'une masure de paysan quelque petit drapeau isolé qui dit l'espérance et la fierté d'un de ces anonymes, fils de la foule dont la patrie est faite.
1. Sur ce point, voir Nicolas Mariol, Bains de foule. Les voyages présidentiels en province 1888-2002, Paris, Belin, 2007.
118
j'ai pour voisins dans la forêt qui , de l'autre côté de la route, longe le jardinet où je vais l'été, des bCtchcrons qui ont, ces mois derniers, fait à travers bois leur tâche cruelle. ils ont coupé les hêtres, abattu les chênes, saigné les arbres, taillé, troué, changé les branches bruissantes vertes de feuilles et pleines de nids en fagots à brCtler, débités, rangés en tas géométriques. C'est leur métier et c'était l'ordre. Les pauvres gens ont bâti , improvisé pour les mois que dureraleur besogne une hutte où ils vivent, à ras de terre, avec une porte en planches, une vttre pour toute ouverture et une cheminée en brique par où s'échappe la fumée, comme l'haleine du pauvre logis. Mais comme il y a là une femme et que le rêve ne perd jamais ses droits, autour de la cahute on voit des géraniums et des rosés. Les fleurs égayent de leur poésie et de leur couleur cette pauvre maison de labeur et ?e misère, et .les pi~~ons voisins viennent voleter encore sur le tOit de zmc et de tot le goudronnee et reJOUir la masure de leurs ailes blanches. Or, ce matin, au-dessus des rosiers et parmi les pigeons étonnés, j'ai vu, sur l'humble toit, un petit drapeau tricolore. Les pauvres bCtcherons à demi ignorés de tous, ont tenu à pavoiser, eux aussi, en l'honneur de l'alliance, du président, du jour du retour, leur pauvre cabane perdue dans un coin de forêt. Personne ne le verra que moi, peut-être, ce drapeau qui sourit au-dessus du toit, parmi les arbres abattus par les cognées; mais eux l'ont vu et, pendant ces heures où Paris, fiévreux, enthousiaste, acclamait, saluait il ne savait quel souriant et consolant avenir, les bCtcherons sans nom contemplaient ces trois couleurs qui symbolisaient le devoir et la patrie comme le pain et le sel, dont parlait le rimeur du Chout, symbolisaient l'hospitalité. Et je suis resté pensif devant ce petit drapeau de mes voisins les bCtcherons de Viroflay, drapeau qui est comme le lointain salut du paysan de France à ces humbles, naïfs et admirables moujiks de Russie acclamant naguère nos matelots, nos couleurs, les soldats et le représentant de notre France. Il y a eu ainsi jusqu'au fond des hameaux, il y a eu, hier, communion entre deux grands peuples. Et le pavoisement de la masure misérable avec son drapeau tricolore clapotant panni les roses grimpantes, c'est bien peut-être ce qui m'a paru le plus touchant et le plus significatif dans l'émouvant spectacle que j'ai vu
1
•
La dimension politique du rituel? Elle tient au fait de constituer le geste d'observance en engagement. Arborer un drapeau tricolore à sa fenêtre, le jour de fête nationale, c'est consentir à endosser publiquement un soutien. Au fond, comme le bulletin de vote qui standardise intentions, motivations et conformismes pour n'en faire que des unités de compte, sous la forme d'un «partage des voix», le pavoisement agrège des résolutions hétérogènes pour les fixer dans un tableau visuel : celui de 1 'appro-
bation des motifs revendiqués de la célébration. Le pavoisement est une des formes institutionnelles qui trament le rassemblement
des hommes sur la voie publique. Une manière d'agir qui , une fois cristallisée sous les traits d'une convention sociale, peut opposer une résistance aux actions individuelles, voire les déterminer. Pourtant, l'idée d'un inconscient (cognitif ou collectif), celle d'un arrière-plan (séculaire ou coutumier) n'est guère utile. Elle réintroduit une réalité incertaine, une réalité qui opère comme un référent magique . C'est la critique que l' on peut adresser à John R. Searle lorsqu'il parle de l'ensemble des «capacités non intentionnelles ou pré-intentionnelles» qui permettent aux «états intentionnels» de fonctionner : il en fait une structure causale qui, transmuant un facteur en fonction (la langue), absolutise les aptitudes et dispositions d'arrière-plan
2
• L'anthropologie
1. Jules Clarétie, La Vie à Paris, Paris, G. Charpentier etE. Fasquelle, 1897, p. 287. 2. Dans sa critique du constructivisme, notamment sous sa version chère à Peter Berger et Thomas Luckmann, John R. Searle insiste sur la composante linguistique des faits institutionnels au point de faire de ceux-ci la simple traduction de celle-là. The Construction o.f Social Reality, New York, Free Press, 1995, p. 54 et sq. La sociologie historique vient démentir cette idée d'un langage catégorie auto-identitiante de l'institution. Sur ce point, voir ma recension « Rites politiques et intégration nationale >>, publiée dans la Re,·ue fi-ançai se de science politique, vol. 60, n" 1, février 201 O.
119
~·
a beaucoup usé de cette facilité dans son appréhension du rjte: elle a proposé d'en faire tantôt un formulaire· transmis ne variatur se répercutant par des sentiments obligatoires (Mauss), tantôt une croyance qui , après avoir institué une codification s'est désinvesti de ses formes publiques (Héran), tantôt une forme du sacré (comme le churinga chez Durkheim) qui, pris pour signe de ralliement, matérialise la puissance célébrante d'un groupe. C'est faire l'impasse sur l' investissement proprement politique qui conditionne le déploiement de chaque rituel.
Suscitée par un parti ou une autorité, l'acclamation visuelle du pavoisement produit bel et bien un verdict. Elle conforte le légitimisme de chaque célébration. Sans doute est-il difficile de trancher sur l'objet précis de cette mise en scène, tournée tantôt vers « les détenteurs du pouvoir» tantôt vers « un pouvoir politiquement spécifié'». Cela n'empêche pas le drapeau domiciliaire d'être une institution à part entière, en inclinant, selon les circonstances, plutôt au divertissement ou à 1 'adhésion, au conformisme ou à la protestation.
On le devine: rendre compte d'une intention, ce n'est pas raconter ce qui s'est passé dans l'esprit du peintre mais, comme l'enseigne Mickael Baxandall, construi re une analyse susceptible de rendre compte des moyens dont il disposait et des fins qu'il poursuivaif. On ajoutera qu'il faut aussi comprendre les conditions d'apparition de l'objet dont l'artiste s'est saisi , en l'occurrence le drapeau domiciliaire. Posons alors la question : jusqu'à quel point pouvons-nous pénétrer dans la structure des intentions de ceux qui pavoisent? On ne trouve pas plus fine critique inférentielle du drapeau domiciliaire comme acte patriotique que dans la littérature, surtout lorsqu'elle se veut sociologique. On pense à M. Patissot dans Le Dimanche d'un bourgeois à Paris. Il se lance dans des préparatifs après avoir lu sur les murs de son arrondissement la proclamation du maire : «C'est principalement sur la tète particulière que j'appelle votre attention. Pavoisez vos demeures, illuminez vos fenêtres. Réunissez-vous, cotisez-vous, pour donner à vos maisons, à votre rue, une physionomie plus brillante, plus artistique que celle des maisons et des rues voisines. » Reste que pour le personnage central du roman, le problème persistait : « Trois drapeaux, quatre lanternes, était-ce assez pour donner à cette tabatière une physionomie artistique? ... pour exprimer toute l'exaltation de son âme? .. . Non assurément ! » Malgré de « longues recherches et des méditations nocturnes », M. Patissot «n'imagina rien autre chose
3 ». L'intention peut avoir un caractère plus explicite:
celui de l'enivrement patriotique que suscite l 'amour de deux provinces reconquises. C'est celui que rencontre Maurice Barrès: «Une femme du peuple que je félicitais de sa modeste boutique brillamment pavoisée, m'a dit "Nous n'avons plus d'étoffe pour nous faire des chemises, nous en trouvons pour nous faire des drapeaux4" ». Ou le "sentiment puéril et déclamatoire" qui pousse le personnage d'André dans Le Boulevard "à marcher avec ce peuple, dans ce peuple", à se "laisser heurter et bousculer, fraternellement, tout son saoul" parmi "les gens qui promenaient leur
1. Pierre Vallin, « Fête, mémoire et politique : les 14 juillet en Limousin (1880- 1914) », Revue ji'Oitçaise de science politique, 32, 6, 1982, p. 955. Une « hypothèse d ' indifférence» que l'auteur écartait toutefois comme « cadrant mal » avec les « manifestations antérieures d ' extrême politisation » du rapport aux « détenteurs du pouvoir ». Une réalité dont témoignait à partir de 1880, le refus de pavoiser, par exemple, de telle commune acquise aux monarchistes, de tel « quartier aristocratique » au sein de la bourgade ou de tel curé conservant les clefs du clocher pour ne pas le voir arboré.
2. D'où la formule de Michael Baxandall : «On n'explique pas un tableau : on explique telle ou telle observation qu 'on a pu faire à son propos», Formes de l'intention. Sur l'explication historique des tableaux, Paris, Jacqueline Chambon, 1991 , p. 21.
3. Guy de Maupassant, Les Dimanches d'un bourgeois de Paris, Paris, Magnard, 2009, p. 35. Ce texte parut en feuilleton, en 1880, dans Le Gaulois.
4. « Le cœur des femmes de France », dans Chroniques de la Grande Guerre, Paris, Plon, 1928, p. 125.
120
liberté affichée, pavoisée, lumineuse">>. Pour d'autres, c'est une façon de revivre en un moment toute la Révolution française. De retrouver« dans l'enthousiasme au pas qui l'entourait l'odeur centenaire de guillotine et la poudre et le relent de discours et de tambours d'autour et d'avant». Une illusion d'éloquence que le peuple des drapeaux condense et reconstitue' .
Il n'empêche. Même individualisé par l' exercice littéraire, l'acte du pavoisement continue d'intriguer. La rationalité interne d'une conduite, aussi diverse soit-elle, ne suffit pas. Elle ne dit rien, en particulier, sur ses conditions externes d'adéquation. D'où cette énigme qui envahit Jules Clarétie lorsque le 8 octobre 1893 il observe, d'une fenêtre au coin de la rue de la Boétie, la foule venue applaudir l'empereur russe en visite à Paris2
• Si une «sorte de style de gaieté court à travers ces pavoisements » aux couleurs russes et françaises, une interrogation le tient en suspens : « À quoi songent tous ces êtres poussés là vers un même but ? » Pour Clarétie, la formule ne suffit pas: «J'entends bien la réponse que certains intellectuels dédaigneux pourraient faire et qu'ils ont toute prête: "Mais ils ne pensent à rien ." L'erreur est grande. Quand un peuple a une idée unique, il sait parfaitement la comprendre s'il ne sait point la définir. Le sentiment ici vaut toutes les raisons du monde, ou plutôt les raisons qui font agir la foule sont celles dont parle le moraliste et que le cœur seul entend3.»
Les sciences sociales ne sont pas restées démunies face à ces phénomènes d'entraînement. L'expression obligatoire des sentiments a, par exemple, été étudiée par Marcel Mauss dans un texte célèbre, en 1921 4
• Il y montre notamment que l'opposition héritée de la philosophie cartésienne entre corps et âme ne tient pas pour le savoir que requiert la compréhension des sociétés. En d'autres termes, que l'imposition du fait social aux individus n'est en rien incompatible avec la plus grande sincérité des agents . Ainsi des larmes qui sont, dans certaines populations, un moyen à la foi s ritualisé et intentionnel de salutation. Cette caractéristique vaut pour d'autres sentiments comme la reconnaissance. Exprimé à travers des cris et des chants, ils prennent un caractère obligatoire en ce qu ' ils surviennent à une occasion fixe mais sans exclure pour autant la sincérité de ceux qui s'y livrent. Preuve s'il en est que le caractère collectif d'une célébration ne nuit en rien à son intensité subjective.
Le retour de Jacques Clouard, communard foulant à nouveau le sol après dix ans de réclusion, en offre l'illustration. Le plus pressé, pour lui et ses deux camarades, c 'est alors de «courir à la tète». À l'intersection de la rue de Lyon et de l'avenue Daumesnil , ce fut comme une sensation très douce : là, face à la statue de la République en bonnet phrygien, entourée de mâts et de drapeaux, il se laisse alors pénétrer des « effluves d'une joie large, répandue dans l'atmosphère, voix humaines criant des vivats, orchestres en plein vent, explosions de pièces d'artifices. Le lointain brouhaha d'une capitale, la sensation chaude de deux millions d'êtres remués par une surexcitation commune». Comment s'étonner que dans ces circonstances le moindre sentiment personnel disparaisse? La force d'entraînement du rite avait pris le dessus. « Chapeau bas, chapeau bas, criaient quelques citoyens. On se découvrit. Il y eut quelques instants de pur enthousiasme, pendant que la foule entonnait un hymne. » Il ne lui resta plus alors qu'à rire aux larmes, «longuement, en s'essuyant les yeux ».
1. Ernest La Jeunesse, Le Boulevard : roman contemporain, Paris, J. Bosc, 1906, p. 55 et suiv. 2. La Vie à Paris, op. cit. , p. 277. 3. Paul Alexis, Le Besoin d 'aimer, Pari s, G. Charpentier, 1885, p. 319. 4 . « L'expression obligatoire des sentiments (rituels oraux funéraires australiens) >>, Journal de psychologie, 18, 1921 , p. 425-434. Texte reproduit ~a ns Marcel Mauss, Œuvres complètes, T. 3. Cohési011 soc:iale et division de la sociologie, Paris, Les Editions de Minuit, 1969, p. 269-278.
121
---~
Pour l'individu, le pavoisement tire d'abord sa signification de ses usages. Une logique inséparable des strategies de motivation ou de routinisation de ceux qui en explicitent les enjeux en lui assignant des fonctions 1• La relation construite entre les conduites et les perceptions sanctionne, plus généralement, les luttes politiques du moment et donc les luttes des groupes sociaux lorsqu'ils tentent d'infléchir les représentations de la légitimité nationale. Mais les instruments qui, tel le drapeau arboré, contraignent ces formes d'expression ne doivent pas être négligés: ils ont structuré en le différenciant le temps national du temps ordinaire et permis de matérialiser un sens individuel de l'appartenance à la nation. En délégitimant la trame communautaire de ce rapport, le drapeau domiciliaire a œuvré à définir la conviction politique comme principe de conduite dans les manifestations nationales. Un enrôlement qui a joué comme une forme de discipline. En individualisant l' acte d'expression du sentiment national, cette médiation nouvelle a rapproché son expression publique des individus. Mieux : elle l'a défini comme le produit des opinions. Et non plus de la tradition ou de la nature.
Pour les peintres de la Troisième République, le national avait cessé d'être une réalité invisible parce que naturalisée. Leur empressement à relier les drapeaux tantôt à leurs usagers tantôt à leurs destinataires vient de là. Comme leur souci de les additionner telles des unités comptables ou de les affecter d'une solennité d'État à la fois lointaine et différenciée socialement. Le pavoisement s'était transformé. Il était devenu cette opération dont la finalité, encensée ou déniée, consiste en la participation du plus grand nombre. L'institution du drapeau domiciliaire? Elle fut un moyen de résoudre un problème de représentation. Pour les peintres, de mettre à l'épreuve la clarté blonde et la transparence de l'air propre à un espace public renouvelé, de voir comment un mendiant se comporte, là, dans l'intensité de la lumière, face au luxe des fastes de la République. Pour les hommes au pouvoir, le drapeau domiciliaire fut une façon de concurrencer le vote universel.
Bien qu'il demeure toujours une règle fondamentale, le vote a au début des années 1870 la valeur d'un principe ambivalent. La consécration électorale apportée au Second Empire a, ne l'oublions pas, suscité un véritable traumatisme. Au point que le suffrage universel sera attaqué par les républicains eux-mêmes. Que l'on songe au Jules Ferry des pamphlets de l'Empire, stigmatisant la «douce apathie» de la France « locale, étroite, intéressée, timide», au Taine des Notes sur la Province raillant les « mécanjques d'enjôleurs» ou aux positivistes tel Wyrouboff décrivant les professions de foi électorales comme de simples « enseignes » qui « effrayent et attirent» les masses de façon mécanique2• Leur interrogation portait sur la meilleure façon de représenter politiquement l'interdépendance du corps civique, non pas le nombre en tant que tel , mais ce qui en assure à la fois l'unité et l'intelligibilité, à savoir la citoyenneté. Non pas la démocratie mais la République.
Lorsque l'élection, avec son pluralisme et la liberté de presse, remplacera le vote, 1 'acclamation visuelle aura vécu. Et avec elle des dispositifs de mise en scène qui, plusieurs décennies durant, fabriquèrent l'image d'une adhésion collective que pouvait n 'attester aucun agrégat de volontés individuelles. À Paris, cette sacralisation tricolore de l'autorité s'ancrait dans le contexte propre à chaque territoire: c'est pourquoi son intensité fluctua selon le degré ou le type de mobilisation
1. Sur ces stratégies qui forment et déforment la face publique du rite, François Héran, « L' institution démotivée. De Fustel de Coulanges à Durkheim et au-delà», Revue.fi-ançaise de sociologie, 28, 1, 1987, p. 67-97 . 2 . Successivement : Jules Ferry, La lutte électorale de 1863, Paris, 1863, p. 43; Henri Taine, Notes sur la Province 1863- 1865, Paris, Hachette, 1897, p. 8 et Grégoire Wyrouboff, « Les élections nouvelles et la vieille politique », Philosophie positiviste, Versailles, Cerf et fils, 1881 , p. 12.
122
réalisée. L' institution de l'isoloir en 1913 vint symboliquement en annoncer l'entrée en désuétude. Avec l'avènement de l'électeur, figure conquérante de la politique, étaient « mis entre parenthèses des liens sociaux 1 » dont le rituel de la rue pavoisée avait magnifié l'emprise, ceux d' un répertoire d'action désormais abandonné à la
simple rhétorique.
1. Alain Garrigou, Histoire sociale du suffi·age unil•ersel, Le Seuil , 2002, p. 44.
·-....J'