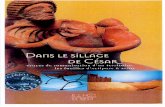Le voile: symbole de l’instrumentalisation de la femme au nom de l’idéologie républicaine.
Transcript of Le voile: symbole de l’instrumentalisation de la femme au nom de l’idéologie républicaine.
Postcolonial Studies et Genre à l’Université de
Genève. Sous la direction de Parini Lorena.
Le voile: symbole de l’instrumentalisation de la femme au nom de l’idéologie républicaine. Postcolonial Studies et Genre à l’Université de Genève.
Maxime Lamot
Table des matières.
Introduction ......................................................................................................................... 2
Ce qui est en jeu : pourquoi ce travail ? ....................................................................... 3
Un contexte accidenté. ..................................................................................................... 7
L'analyse : ce qui se cache derrière les discours. .................................................... 11
-La commission Stasi : Avant, pendant et après ................................................ 11
- Une Commission sous pression. .......................................................................... 13
-L'accommodement raisonnable : un refus « féministe ». ............................... 17
-Un féminisme post-colonial ? ................................................................................ 19
3) Le foulard : Un enjeu social ? -Le port du foulard face au « racisme républicain ». ................................................................................................................. 22
Conclusion ......................................................................................................................... 24
Bibliographie ................................................................................................................... 27
Introduction
Aujourd'hui l'interdiction du port du voile dans les établissements
scolaires est appliquée. Il s'agit ici de revenir sur les événements et les
discours qui ont eu lieu depuis 1989 jusqu'au vote de cette loi. Je me
pencherai sur les arguments qui sont « pour » ou « contre » le port du foulard
à l'école. Le contexte permet naturellement de comprendre de ce qui a animé
les passions, mais n'est pas suffisant pour saisir toute la complexité des
systèmes de valeurs qui sont en jeu dans cette affaire. Pour cela il faut sortir
des discours habituels que l'on entend régulièrement dans les médias à
l'instar des politiques. Ainsi il s'agit de mettre en évidence ce que sont
entendus par « laïcité », les « valeurs républicaines », le « foulard islamique »,
ainsi que le féminisme au sens large ainsi qu'au sens étroit. Il est important
de mettre en lumière ces concepts, car cela facilitera l'identification
d'amalgames qui nuisent au débat. Il est aussi question de savoir en quoi ce
rejet culturel est le produit d'un passé colonial « refoulé ». (Tévanian : 2011).
Autrement dit, en raison des déclarations politiques essentialistes, il serait
intéressant de voir en quoi l'on est confronté à des discours de type post-
colonial, et quelles pourraient être les répercussions sur les valeurs que la
France est censée défendre.
Ce qui est en jeu : pourquoi ce travail ?
Il est donc important de comprendre les fondements de la Commission
« Stasi » ainsi que sa mission. Quelle est-elle ? Quelles en été les conclusions
? Sur base de quels arguments ? Et en quoi est ce que ces conclusions ont eu
comme répercussions sur la suite du débat politique qui a conduit au vote de
la loi de 2004 ?
Le discours féministe a tout à fait sa place dans l ' « Affaire du foulard ».
Cela étant dit, les féministes se sont divisées sur la question, étant donné
que derrière l'interdiction du port du foulard est apparu un véritable
dilemme (Delphy : 2008). En effet une large frange du mouvement féministe,
qui se veut comme adversaire du port du foulard, fonde son argument sur
l'égalité dessexes ainsi que sur la dénonciation de l'oppression des femmes
musulmanes voilées symbolisant son infériorité par rapport à l'homme.
D'autres féministes accusent plutôt le caractère discriminatoire, voir même
raciste d'une interdiction du port du foulard à l'école. En quoi le féminisme
occidental classique pourrait prétendre savoir ce qu'il y a de mieux pour les
femmes « voilées », qui, selon certains, ne seraient pas capables d'un
véritable libre arbitre ou dotées d'une habilité de « choisir » ? L'interdiction
du voile constitue-t-elle une véritable protection de la liberté des femmes,
ou est-elle une interdiction de nature raciste ? Faut-il protéger la femme au
détriment de l'égalité pour tous ? Ne s'agit-il pas ici d'un faux débat sous
forme d'ultimatum ? L'essai largement commenté de la philosophe Susan
MollerOkin qui s'intitule « Is multiculturalisme Bad for Women ? » (1999)
(Le multiculturalisme est-il mauvais pour les femmes), aura le mérite d'avoir
posé les questions comme l'on fait beaucoup d'autres féministes. En outre,
son travail a suscité une véritable controverse qui a eu l'avantage de
consolider d'autres visions féministes « antiracistes » jusque-là peu visibles.
Il est donc tout aussi important d'étudier les arguments des femmes qui
soutiennent le voile. Certains témoignages, qui ont été largement ignorés
dans ce débat, ont pu nous éclairer sur le caractère paradoxal des arguments
féministes. À partir de là, il serait intéressant de voir en quoi le« féminisme
occidental» adopte, consciemment ou inconsciemment, un discours
postcolonial. Pour ce faire il est nécessaire de revenir sur le concept du post
colonialisme qui, par la suite, servira à y identifier les différents systèmes de
domination. La grille de lecture des postcolonial studies sera reprise afin
d'analyser la manière dont le débat sur le foulard a dévoilé certaines formes
de dominations culturelles, voir même sociales.
Le paradoxe féministe semble trouver racine dans une autre
contradiction encore plus insidieuse et qui, finalement, nous renvoie à la
problématique de la laïcité proprement française. Car il faut tout de même
rappeler que l' « Affaire du foulard » doit son apparition à sa soi-disant
incompatibilité avec les principes constitutionnels laïques. Il faut donc
recadrer ce qui a suscité la polémique dans un premier temps, hormis les
interventions féministes qui ont eu lieu dans un second temps.
Argumenter sur le problème de la laïcité n'est pas l'enjeu premier, bien
que cela ait été soulevé à de nombreuses reprises par les politiques, pour la
simple raison que le Conseil d’État a émis l'Avis selon lequel le port du
foulard n'allait pas à l'encontre du pacte laïque. Autrement dit, les insertions
telles que la loi de 1905 sur la « liberté de conscience », ou les dispositions
constitutionnelles de 1946 et de 1958 selon lesquelles « La France est une
république indivisible, laïque, démocratique et sociale », constituent des
cadres de sécurités qui assurent le bon fonctionnement de la République
Française (Jean Baudérot 2003). Cela étant dit, il ne s'agit pas icid'étayer des
arguments juridiques qui démontreraient en quoi les dispositions laïques
suffisent ou non à protection des libertés de conscience. Néanmoins je pense
qu'il est approprié de me fier à l'Avis du Conseil d’État comme quoi le port
du foulard ne nuit pas au bon fonctionnement des établissements scolaires
selon certaines conditions énumérées ci-dessous.
La question qui se pose alors, est pourquoi la polémique n'a-t-elle pas
désenflé suite à l'Avis du Conseil d'Etat ? Pour quelles raisons le Président
de l'Assemblée Nationale Jean-Louis Debrée, puis le Président de la
République Jacques Chirac, ont-ils jugé nécessaire de réétudier la question
de la laïcité Française ? On peut considérer cette prise de décision comme
une réponse à l « opinion publique » préoccupée par les tensions culturelles
voire religieuses. Dans ce cas d'où viennent de telles préoccupations ? En
quoi peut-on voir le port du foulard dans les écoles comme une menace ? Si
les Français ont peur de voir leurs valeurs être remises en question, alors de
quelles valeurs parle-t-on ? Qu'est-ce que l'idéal républicain que certains
politiques semblent se donner corps et âme pour le défendre ?
Il est important, à mon sens, que l'on puisse répondre le mieux possible
à ces questions, parce que cela permettra d'identifier les valeurs sous-
jacentes de ce débat face à l' « affaire du foulard ». Les réactions féministes «
occidentales » ont y pris une place tellement importante qu'elles semblent
avoir cachées ce qui est véritablement en jeu. Cela a fait apparaître certains
arguments racistes, qui nous font penser au discours colonial. Le clivage «
féministe séculier » vs« féministe islamique » est un indice (Abdallah : 2010).
Ce féminisme « séculier » tend à faire la distinction entre « nous » (celles qui
seraient les seules à savoir déceler la signification universelle), et « elles »,
(celles qui portent le voile seraient indignes de lutter pour les droits de la
femme). Il existe donc une prétention à l'universalité au sein de cette frange
féministe qui a dominé le débat sur le port du foulard dans les écoles. Il ne
s'agit pas ici de diminuer ou de ternir le rôle de la femme dans cette affaire,
bien au contraire. Il est aussi question ici de briser cette fausse idée que le
féminisme soit monolithique. Il faut aussi tenir en compte cette autre frange
féministe qui a été ignorée. Il est donc essentiel de prendre en compte non
seulement les femmes qui ont été déchirées sur la question, mais aussi les
femmes qui se sont clairement positionnées contre la loi de 2004.
En somme il est important de comprendre pourquoi et comment la
défense des droits des femmes a été plus efficace au niveau des médias que la
défense de la laïcité républicaine dans l' « affaire du foulard ». Il faut dire que
la victimisation de la femme a un caractère plus « choc » et que l'on peut
s'attendre à ce que l'image d « une femme voilée, dominée par l'homme
musulman intégriste » a plus d'impact sur les médias que la laïcité mise à
mal par le port du foulard à l'école.C'est la raison pour laquelle je m'intéresse
ici à l'instrumentalisation de la femme dans le l' « affaire du foulard », qui
cacherait plutôt une sorte de combat idéologique entre l' « Islam fanatique »
et l « universalisme républicain ».
Un contexte accidenté.
L' « affaire du foulard » aussi connu comme « l'affaire tchadors », éclate
le 18 septembre 1989. Elle est devenue aujourd'hui le symbole d'une soi-
disant « France qui se réveille » face à l'invasion islamique. Ce « réveil » se
traduit principalement par la peur alimentée par les médias et les politiques,
mais aussi par l' « affaire Salman Rushdie » qui incarne le défi occidental à
défendre ses valeurs démocratiques profondes face au monde arabe «
fanatisé » par l'Islam. Les Versets Sataniques de Rushdie, qui se réclament
être une description « véridique » du prophète Mahomet , sont publiés et
défendus au nom de la liberté d'expression. Or c'est justement cette liberté
d'expression qui semble avoir été mise en position de victime, à juste titre ou
non, lorsque la majorité des pays du Moyen-Orient décidèrent de bannir cet
ouvrage.
L' « affaire du foulard » n'est donc pas sans précédent. Il existe déjà à ce
moment-là une appréhension de l'Islam qui a conduit immanquablement à
un incident médiatisé tel que Fatima et Leïla Achahboun ainsi que Samira
Saïdani en ont été témoins. Ces jeunes filles portant le tchador se voient
refuser l'accès à l'établissement scolaire Gabriel-Havez de Creil dans l'Oise.
Ce collège composé de 870 élèves dont 500 sont de confession musulmane,
justifie ce refus en évoquant l'incompatibilité du port du voile avec le bon
fonctionnement de l'établissement. Cette affaire prend rapidement une
tournure politique qui marquera l'histoire de France. Lionel Jospin, ministre
de l'éducation à l'époque affirmera qu'il faut respecter « la laïcité de l'école
qui doit être une école de tolérance, où l'on n'affiche pas, de façon
spectaculaire ou ostentatoire, les signes de son appartenance religieuse » et
rajoutera que « l'école est faite pour accueillir les enfants et pas pour les
exclure ». Ces deux déclarations illustrent bien le paradoxe dans le discours
républicain par rapport au principe de laïcité et le principe d'égalité (Geertz
: 2010).
Bien que politiquement il ne s'agit que d'un préambule de ce qui va
suivre, l'affaire finie par être résolue juridiquement suite à l'Avis du Conseil
d’État. Selon cet Avis, le port du signe religieux à l'école n'est pas contraire à
la laïcité, à condition qu'il ne perturbe pas les programmes, les horaires, la
discipline scolaire, et qu'il ne s'accompagne pas d'une manifestation de
prosélytisme dans l'enceinte de l'école. Cette disposition juridique, qui
trouve son fondement dans la constitutionfrançaise, ne semble pas suffire
aux yeux de « l'opinion public », qui sera haranguée par les fervents
«défenseurs » de la laïcité républicaine. S'amorcera alors une succession
d'affaires du même ordre qui s'abattra un peu partout en France.
Le spectre islamique prend d'avantage d'ampleur dans les consciences
lors de la parution de l'ouvrage de Samuel Huntington « Le Choc des
civilisations ». Ce livre, très contesté en Amérique du Nord ainsi que dans
les milieux intellectuels, est une analyse sur le fonctionnement des relations
internationales post-guerre froide. L'auteur y donne sa vision de cette
nouvelle configuration mondiale laquelle serait désormais structurée selon
un clivage idéologique, non plus politique, mais culturel. Selon Huntington
la structure d'un monde multipolaire, suite à la perte de contrôle du monde
par les USA et l'URSS, réanime les passions enfouies et refoulées. La chute
du mur de Berlin aurait alors libéré voir déchaîné les sentiments identitaires
et culturels. Le monde serait désormais divisé selon un clivage «
civilisationnel », où il y aurait 8 grandes civilisations contemporaines
(Huntington :1996). Parmi elles, la civilisation occidentale, fondée sur le
christianisme, et la civilisation islamique.
Les critiques de cet ouvrage sont nombreuses, mais si l'on devait en
retenir quelques-unes, elles cibleraient principalement le caractère
extrêmement simpliste et essentialiste de son interprétation vis-à-vis des
cultures. En effet, la soi-disant «civilisation islamique » ne se limite pas à sa
confession religieuse. Elle n'est pas non plus figée dans le temps ,a-
historique ou fermée au monde extérieur, comme aucune autre culture
d'ailleurs. Le fondamentalisme religieux existe certes, mais il est une
véritable minorité face aux nombreux États de confession musulmane dont
il serait très difficile d'en saisir toutes leurs complexités. Huntington omet
aussi de prendre en compte les nombreuses variables économiques qui ont
un poids non négligeable à l'ère de la mondialisation. La religion chez
Huntington prend une place tellement importante qu'elle empêche une
interprétation objective de la configuration mondiale. Interprétation
dangereuse qui a malheureusement la faculté d'entretenir des idées
préconçues des cultures étrangères. C'est typiquement ce genre de discours
qui nuit au dialogue ainsi qu'au débat politique lors de « l’affaire du foulard
».
Les attentats du 11 septembre 2001 ne feront que conforter les dires de
Huntington, selon lesquels la civilisation occidentale est bel et bien entrée
en guerre contre une idéologie culturelle. Celle de l'Islam. Cet événement
affecte considérablement les consciences non seulement aux États- Unies
mais aussi à travers le monde entier. La France n'y échappe pas. Même si elle
affiche une politique étrangère plus tempérée que celle des Américains, la
France mènera une politique bien plussévère sur son territoire.
Depuis les multiples affaires sur le foulard jusqu'en 2003, les Français
ont été témoins de nombreux changements qui ont bouleversé la vie sociale,
économique, et politique. La fin de la guerre froide a libéré les consciences, le
triomphe de l'économie du marché, l'expansion économique mondiale
favorisant la libre circulation des populations, le chômage durable, les
tensions culturelles et sociales dans les banlieues, le « terrorisme islamique »,
le 11 septembre, la montée de l'extrême droite lors des élections en 2002, la
guerre en Afghanistan et en Irak etc...
L'année 2003 atteste un bilan peu rassurant pour la France. Et la presse
n'arrange pas les choses en agitant le spectre islamique qui menacerait les
valeurs démocratiques et républicaines de la France. Il faut dire que les
événements ne sont pas rassurants que ce soit du ressort de la politique
étrangère ou de la situation socio-économique du pays. Un contexte qui est
propice aux discours populistes qui cherchent à pointer du doigt les
responsables de ce que les Français sont en train de vivre. L'histoire nous a
montré que, comme dans l'affaire Dreyfus ( Grupper et al : 2004), dans les
moments difficiles le peuple en souffrance est à l'affût d'un bouc émissaire
(Gustave Lebon dans « La psychologie des foules » 1895). L'immigré de
confession musulmane qui impose sa loi à la femme en lui obligeant de
porter le foulard ,à des fins de domination culturelle, semble constituer le
suspect idéal. En réponse face à une telle atmosphère le Président de
l'assemblée nationale, Jean- Louis Débré instaure en 2003 une Commission
parlementaire chargée de se pencher sur la question. Ce qui provoquera de
multiples divergences, qui conduiront le Président Chirac à mettre en place
une Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la
République, plus connue sous le nom de « Commission Stasi ».
L'analyse : ce qui se cache derrière les discours.
-La commission Stasi : Avant, pendant et après
Elle est initialement appelée Commission de réflexion sur
l'application du principe de laïcité dans la République. Elle est présidée par
Bernard Stasi. Il est médiateur de la République depuis 1998. Énarque, il a
été député de 1968 à 1993. Il est auteur de « L'immigration, une chance pour
la France » (1984).
La Commission est composée de 20 « sages » dont 14 hommes et 6
femmes. Bien qu'elles soient minoritaires, elles sont mieux représentées que
dans d'autres Commissions similaires. La commission est aussi
majoritairement composée d'intellectuels (philosophes, historiens,
sociologues, politologues, juristes) ainsi que d'une parité de couleur
politique.
Le contexte de la création de cette Commission est déjà expliqué ci-
dessus. Pour rappel, il est important de lier l'affaire Rushdie à celle du
foulard afin de comprendre pourquoi cela a pris une telle d'ampleur
médiatique. C'est aussi dans une atmosphère post-11 septembre que la
Commission a été créée. D'après Jean Baudérot( ancien membre de la
Commission, historien et sociologue ) le foulard fut aussi régulièrement
associé à l'islamisme iranien. Il va sans dire que la condamnation en 1989 de
Rushdie par l'imam Khomeiny a certainement contribué à cet amalgame
(Baudérot : 2004). Cette peur de la menace islamique s'est exprimée parmi
les professeurs qui ont vu le port du foulard à l'école comme un danger pour
la liberté de conscience. Ceci est la première question adressée à la
Commission. La deuxième s'agit du danger que pourrait avoir le foulard sur
l'égalité de la femme.
Cette Commission a joué un rôle central dans l'adoption de la loi sur
l'interdiction du port de signes religieux dans les établissements scolaires en
France. Le rapport Stasi donne la première explication , dans l'histoire de
France, de ce qu'est la laïcité. Car bien que la laïcité soit insérée dans la
constitution depuis 1946, celle-ci n'a jamais véritablement été définie. Elle
était jusque-là sujette à de nombreuses interprétations juridiques. La
Commission Stasi avait donc pour mission de rédiger un rapport qui aborde
le différent aspect de la laïcité, afin d'en donner une définition le moins
équivoque que possible. D'après Jean Baudérot (Baudérot : 2004) le rapport
aurait atteint son objectif. La laïcité repose sur trois valeurs indissociables :
La liberté de conscience, l'égalité en droit des options spirituelles et
religieuses et la neutralité de pouvoir publique (Commission Stasi:2003).
La partie du rapport , intitulé « Le défi de la laïcité », aborde trois
problématiques : 1)L'égalité juridique vers l'égalité pratique : quelques
progrès, 2) Service publique et monde du travail : des atteintes
préoccupantes , et 3)le pacte social : des fondements sapés ». C'est surtout la
deuxième problématique qui nous intéresse ici. Les « atteintes
préoccupantes » , reprennent l'exemple du foulard ,parmi d'autres, comme
illustration des difficultés « annonciatrices de dysfonctionnement » dans les
services publics ainsi que dans « le monde du travail ». Le port du foulard
serait, entre autres, l'illustration d'un « repli communautaire » qui serait
d'avantage « subi que voulu »(Commission Stasi:2003 ; 99).
Finalement le rapport fait 26 propositions. Elles sont une
démonstration d'une formidable volonté de mettre en place un projet
d'intégration pour les immigrés étant donné qu'elles prennent en compte le
problème religieux face à la laïcité au sens large. Ces propositions tiennent
en compte le problème d'intégration aussi bien dans les écoles que dans
l’armée, les hôpitaux, dans les prisons,et dans les lieux de travail. En outre,
l'esprit de ce rapport incite à la promotion plutôt qu'à la sanction.
Malheureusement sur les 26 propositions, seule celle concernant
l'interdiction de « signes religieux ostensibles » a été retenue. En fin de
compte, deux votes ont eu lieu. Le premier portait sur le rapport dans son
ensemble et fut approuvé à l'unanimité. Quant au deuxième vote, il portait
sur cette même proposition d'interdire le port de « signes ostensibles » dans
les institutions scolaires.
- Une Commission sous pression.
Ce qui devait être une approche globale de la laïcité s'est traduit par
une fixation sur le port du signe religieux « ostensible » dans le service
publique. Il faut rappeler que pendant toute la durée du travail de la
commission, la France est continuellement accaparée par le débat social et
politique sur le « voile islamique ». On aurait pu espérer un moment de répit
le temps de calmer les passions, mais il n'en a pas été ainsi. Une nouvelle «
affaire du foulard » a éclaté au grand jour, impliquant deux jeunes filles
(Alma et Lila Lévy) dont le père était de confession juive et la mère de
confession catholique. Il va sans dire que c'est un cas extrêmement
complexe. Les partis politiques, se préoccupant surtout de leur calendrier
électoral, s'approprient l'affaire en exigeant l'adoption d'une loi contre les
signes visibles (Pour le Parti Socialiste) ou ostentatoires (pour l'UMP) à
l'école. Ce qui accroît la pression politico-médiatique déjà bien accablante
pour la Commission. D'après un des anciens membres , Jean Baudérot, « la
commission eut le sentiment que, si elle prenait position contre cette loi
annoncée, elle donnerait l'impression de reculer devant '' la menace
islamique '' prouvée, selon elle, par différentes auditions et qui nécessitait un
'' coup d'arrêt '' ».
Il y a deux points à relever dans cette déclaration. Premièrement, elle
illustre bien l'atmosphère dans laquelle la Commission effectue son travail.
L'on voit bien qu'elle subit en quelque sorte les pressions de l’extérieure. Ce
qui est nuisible à l'objectivité de son travail qui se devait être une réflexion
sur la laïcité républicaine et non une argumentation visant à justifier un
éventuel vote favorable à l'interdiction du port du voile. Mais les partis
politiques attendent ! Ils attendent le rapport de la Commission avant de se
prononcer sur un éventuel vote. La pression est donc à son comble. La
Commission semble avoir été influencée par l'émotivité de l' « opinion
publique ».
Deuxième remarque, l'idée selon laquelle la Commission ne peut
reculer devant une « 'une menace islamique , selon elle », révèle l'état d'esprit
de certains commissaires manifestement braqués sur des opinions
préconçues. Si je me permets une telle affirmation, c'est parce que
premièrement la « menace islamique » n'a jamais été déterminée et qu'elle
repose sur une fragile
interprétation des problèmes sociétaux qui font l'objet , non seulement en
France mais à travers le monde, d'amalgames. L'on pourrait argumenter que
le statut de commissaire autorise de telles allégations. Dans ce cas précis il
n'en n'est rien. Cela aurait pu être le cas si la Commission s'était penchée sur
la question de l'Islam en rapport avec le port du voile. Or la Commission
aurait accordé qu'un seul témoignage d'une femme voilée. Il est donc tout à
fait justifié de se demander en quoi la Commission peut prétendre être le
défenseur de la République face à « la menace islamique ». Il ne serait pas
non plus déplacé d'affirmer que la Commission avait déjà des prises de
positions de valeurs, voir idéologique face à l' « affaire du foulard ».
Il est donc moins surprenant que la Commission ait voté la seule des 26
propositions qui porte sur l'interdiction du foulard. Cela a naturellement eu
un impact sur le travail parlementaire quant à la légifération de la loi de
2004 interdisant le port du signe religieux ostentatoire dans les écoles
publiques. Jean Baudérot atteste d'ailleurs des mauvaises méthodes
empruntées par la Commission : « le choix des personnes auditionnées a été
discutable et surtout, les auditions ont été prises pour 'argent
comptant'...Aucune évaluation quantitative n'a été faite. » « À mon sens
l'islam est un miroir grossissant, [les] difficultés plus globales rencontrées
aujourd'hui par la laïcité en France et ce sont ces difficultés qu'il aurait fallu
analyser » (Baudérot:2003).
Pour revenir au vote de cette proposition, elle a été votée à l'unanimité
moins une abstention. Cette abstention du sociologue et historien Jean
Baudérot est justifiée par le fait que la loi n'était « pas bonne ». Si Baudérot
s'est abstenu , plutôt que de voter contre, c'est parce qu'il ne remet pas en
cause l'esprit de cette proposition qui cherchait à « défendre la laïcité contre
l'islamisme radical, de défendre l'égalité des femmes et des hommes, et de
défendre l'école ». Par contre s'il s'est abstenu c'est simplement parce que
selon lui les femmes ,qui décident de porter le voile, ne sont pas
nécessairement manipulées par l'islamisme radical. Car il existe bien des
femmes qui font le choix personnel de porter le foulard, ce qui ne les
empêche pas d'être féministes pour autant, loin de là. Le féminisme
islamique existe bien, même s'il est très critiqué par les féministes
occidentales qui perçoivent ces femmes comme étant embrigadées(Delphy :
2008). Il faut rajouter que cet islamisme radical existe aussi, il ne faut pas le
nier. Mais comme le dit très bien René Rémond (Kauffman et Bernard :
2004), membre de la Commission et président de la Fondation nationale des
sciences politiques, « le voile est un leurre qui dissimule l'enjeu central : la
capacité de la France à intégrer des populations nouvelles et l'acceptation de
la loi commune par ces nouveaux Français. On se crispe sur un problème
ultra-minoritaire , alors que le vrai défi est celui de l'intégration sociale et
professionnelle ».
-L'accommodement raisonnable : un refus « féministe ».
Une dernière remarque examine sous un autre angle les motifs du vote
de cette proposition. Pour cela il faut tout d'abord aborder la notion de
l’accommodement raisonnable qui est essentielle au bon fonctionnement de
la laïcité Française, basée sur le modèle « libéral et tolérant ».
L'accommodement raisonnable ' est une notion importée du Québec
qui a la vertu de tempérer les exigences d'une neutralité absolue de l’État.
Elle a permis, par exemple, d'assouplir le congé obligatoire du dimanche qui
a été remplacé pour une obligation ne pas travailler sept jours consécutifs.
L’accommodement raisonnable évite donc d'entrer dans une logique du 'tout
ou rien'. Toutefois l’accommodement raisonnable ne peut pas s'appliquer au
mariage forcé, ou à l'excision par exemple. Certaines pratiques sont donc du
ressort de l'inacceptable.
C'est sur ce point que la Commission s'est posé la question quant au
port du signe religieux dans les écoles. Selon elle, le port du foulard «
ostensible » relève de l'inacceptable. Il faut dire qu'il y a tout de même une
certaine marge de différence entre le mariage forcé, l'excision et le foulard.
Pour la Commission le port du foulard ne peut bénéficier de
'l'accommodement raisonnable' étant contraire à « l'égalité entre les hommes
et les femmes ». Selon Jean Baudérot la Commission a consolidé cet
argument en dénonçant le port du foulard comme« l'intériorisation, par les
femmes, d'un statut d'infériorité, et même de maltraitance ». Or ce point n'a
jamais été démontré. Ce sont des déclarations trop « faciles », car face à une
telle déclaration il est délicat de s'y opposer sans s'attirer les critiques, ou
sans être perçu comme un machiste dépassé par les événements. C'est
pourtant ce type d'affirmations à caractère tautologiques, voir même
idéologique, qui a pourtant contribué à trancher sur le vote. Il s'agit ici d'une
parfaite illustration d'une instrumentalisation de la femme « victime » d' «
infériorité » intériorisée et de « maltraitances » dont le bourreau idéal
semblerait être de toute évidence « l'homme islamiste intégriste ».
Comment se fait-il qu'une loi qui se présente comme portant sur la «
laïcité» a été débattue principalement en terme de droits des femmes ? À
mon sens, cela est dû au fait que les arguments laïques étaient faibles, et que,
par contre, parler de la femme « victime » avait bien plus d'impacts sur les
consciences. En outre l'argument donne une légitimité « progressiste ».
Quant à l'argument laïc, sa faiblesse se remarque avec cette prétendue
inapplicabilité de l' « accommodement raisonnable ». Mais ce caractère «
inacceptable » du foulard a été défini uniquement selon l'égalité des sexes et
non sur la laïcité. Là où le bât blesse c'est que la Commission n'explique pas
en quoi le port du foulard nuit au bon déroulement de l'enseignement dans
les écoles, et en quoi la laïcité s'en trouverait lésée !
En outre, cette interdiction ne concerne que les institutions publiques.
Cette disposition est dénudée de sens dans la manière où elle ne fait
qu'exclure les femmes des écoles publiques, les poussant à un « repli
communautaire ». Si le but de cette disposition était de protéger la femme
alors l'on se trouve face à une ineptie. D'autant plus que ces femmes « voilées
» partiront vers des établissements privés où l'interdiction n'est pas
appliquée. Sans oublier le fait que ces écoles privées bénéficient aussi de
fonds publics. Dans ce cas, le caractère inacceptable du foulard au nom de
l'égalité des sexes ne serait qu'une imposture. Le problème ne se situe-t-il
pas en réalité dans le fait que le port du foulard perturbe la conception que
les Français se font de la laïcité ? En ces termes, il semblerait bien que les
argumentations féministes « occidentales » se sont confrontées à un
paradoxe. Effectivement, cette large frange féministe dénonce une
domination pour en justifier une autre lorsqu'elles se prononcent pour
l'interdiction du port du foulard dans les écoles, car , en ce faisant, elles
relèguent les femmes musulmanes dans leur foyer, ou les cantonnent dans
des écoles privées. Cela peut avoir un effet pervers dans la manière où cette
interdiction qui vise initialement à mettre « un coup d'arrêt à l'intégrisme
islamique », encourage ce que l'on appelle plus communément le «
communautarisme ». Le paradoxe est qu'en luttant contre l'oppression de
l'homme « islamiste intégriste » , l'on porte atteinte à la liberté de la femme
musulmane.
-Un féminisme post-colonial ?
L'interdiction du port du foulard une « violence symbolique »(Bourdieu
: 1972) , car elle impose « des significations ...comme [étant] légitimes en
dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force
»(Zibouh : 2010) .
Quels sont alors ces rapports de force ? Y aurait-il donc une
instrumentalisation du discours féministe pour légitimer une forme de
domination? En tout état de cause, il existe chez la « femme occidentale »
une prétention à l'universalité qui fait étrangement penser à cette position
ascendante du colonisateur face au colonisé. C'est là que peut être identifié
comme une nouvelle forme de dialectique postcoloniale (Zibouh : 2010),
dans la manière où le colonisé, tout comme la femme voilée, ne peut pas
savoir ce qui est bon pour lui. Qu'il aurait, tout comme la « voilée », tout à
gagner en profitant de la civilisation à l'occidentale. À mon sens, même si le
parallèle peut paraître exagéré, il existe effectivement un raisonnement
postcolonial dans le discours féministe, car on peut y déceler aussi une
prétention à l'universalité englobante et uniformisante. Il y a donc de la part
du féminisme « occidental » un refus d'admettre une autre façon de vivre, un
refus de l'idée selon laquelle il y aurait plusieurs manières d'accéder à
l'autonomie individuelle. En d'autres termes, lapossibilité que le port du
foulard puisse être compatible avec la liberté de conscience entre en
contradiction avec l'universalisme républicain (Gily et Longman : 2010).
Il faut donc rejeter l'idée que le mouvement féministe soit
monolithique. La nuisance de cette conception vient du fait que jamais
auparavant les principes d'égalité des sexes ainsi que de l’émancipation des
femmes ont tant été repris dans un débat politique en France. Or il y a
d'autres arguments féministes, peu entendus, qui dénoncent le caractère
discriminatoire et raciste de l'interdiction du port du foulard à l'école.
D'après ces féministes « anti-racistes» , affirmer que le port foulard , dans un
pays tel que la France, comme étant le seul symbole de soumission de la
femme face à l'homme, c'est ignorer le code social vestimentaire occidental
qui constitue , lui aussi, une véritable pression sur la femme afin de satisfaire
l'homme. Pourquoi est-ce que les implantations mammaires , qui demandent
de lourdes interventions chirurgicales et dont les conséquences sur la santé
ont été prouvées ( l'affaire des prothèses mammaires PIP), ne seraient-elles
pas une oppression, alors que le foulard le serait ? Je ne veux pas dire ici que
le foulard n'a pas servi à la domination de la femme par l'homme. Car
historiquement le foulard est, dans tout le bassin méditerranéen et le
Moyen-Orient, symbole de la domination des hommes sur les
femmes(Bouamama : 2004). Néanmoins affirmer que le foulard est
systématiquement imposé par l'homme à des fins de domination serait
également faux. Là où je veux en venir , c'est que le port du foulard entant
que tel n'a pas une fonction sociale si différente que le string ou les
prothèses mammaires. Là où il y a une différence fondamentale, c'est au
niveau culturel(Stoler : 2011). À mon sens, c'est la raison laquelle le discours
féministe contre le port du voile à l'école est un faux débat. Le fait que cette
frange féministe investisse tant d'effort contre le port du foulard, alors que
peu s'exclament contre le code vestimentaire occidental inspire à mon sens
une certaine hypocrisie. Il y a là, une cristallisation de la femme voilée qui, en
route, cristallise les féministes « occidentales ». Le véritable défi féministe
serait de sortir de cette prise de position ethnocentrique et universaliste
selon laquelle il n'y aurait qu'une unique manière d’accéder à la « liberté de
conscience ». Il s'agirait de sortir du schéma patriarcal contre lequel les
femmes en occident se sont battues ( Delphy:2008).
Il y a donc une "racialisation" du débat sur le foulard, qui selon Fatima
Zibouh (2010) est causé par une « culturalisation » voir une «religiosation »
des questions sociales. Cela ne veut pas dire que toutes personnes ayant
manifestées des désaccords face au port du foulard, qu'elles ont eu des
intentions racistes. Les professeurs qui refusent d'enseigner à des élèves
portant le voile ne sont pas racistes pour autant. Et quand bien même ces
appréhensions se manifestent, elles ne sont pas nécessairement conscientes.
Comme Saroglou et alii (2009) le démontre dans son étudeuniversitaire à
Louvain, les animosités envers le foulard sont souvent motivées par des
préjugées entretenues par la peur. Il en conclut que ce sont souvent ces
mêmes préjugés qui nourrissent le ressentiment envers le foulard. Cela étant
dit, Saroglou n’exclut pas que la présence du foulard pu être aussi un
élément explicatif d'un racisme sous-jacent.
Cette « racialisation » du discours n'est pas renvoyée à une fatalité de la
nature, mais à la différence d'autrui. Elle est une construction sociale et
historique présente dans les esprits de ceux qui discriminent (Tévanian « La
mécanique raciste »:2008).
3) Le foulard : Un enjeu social ? -Le port du foulard face au « racisme
républicain ».
Le « racisme républicain » est un concept élaboré par Pierre
Tévanian dans « La république du mépris » (Tévanian ; 2007). Dans la « La
mécanique raciste » Pierre Tévanian (2008) décortique les systèmes de
pensée qui trouvent leur fondement dans la construction sociale. Il se
focalise tout particulièrement sur les mécanismes de pensée du dominant.
C'est ainsi qu'il entame une déconstruction de la pensée républicaine. Il
souligne entre autre l'utilisation abusive de certains concepts de la
République Française, tels que l' « universalité » ou l « 'égalité ». Christine
Delphy (2009) ne dit pas autre chose lorsqu'elle dénonce le discours «
catastrophiste » de Yvette Roudy , ancienne ministre du Droit des femmes,
qui , lors d'une réunion féministe en février 2005, avait déclaré que « [l'affaire
du voile] participe bien d'une stratégie d'intimidation menée par un courant
intégriste musulman, bien décidé, à placer les préceptes de leur religion au-
dessus des lois de la République » et rajoute que « l'entrée du voile à l'école
est un défi lancé par les intégristes à la République ». Ce type de discours a
d'autant plus d'impact étant fait par une ancienne porte-parole des
Françaises.
Selon Pierre Tévanian (« Islam, voile et laïcité : un débat empoisonné
»;2011) ce type de discours occulte les questions qui touchent véritablement
les Français, telles que celles portant sur le chômage, la précarité et autres
crises socio-économiques. Ce sont justement ces discours à connotation
ethnique et culturaliste qui masquent les maux de la société Française,
mettant sur l'avant-scène le bouc émissaire islamiste. C'est ce qu'Erving
Goffman (1975) explique à propos du « discrédit profond » que l'on colle à «
l'immigré ». Ce concept signifie une catégorie racialisante qui « stigmatise »
et est transmissible à travers les générations. Ce « discrédit » est flagrant
lorsquecertaines féministes refusent d'écouter les femmes voilées, victimes
d'un lavage de cerveau, et instrumentalisées par l'homme musulman
cherchant à véhiculer un « complot » islamique contre la République.
Cette stigmatisation a aussi été dénoncée par Saïd Bouamama (Avril
2004) qui accuse le « projet libéral...[de] construire une frontière qui
s'appuie sur des critères autres que sociaux, comme par exemple la culture,
l’ethnie, la religion, la civilisation etc (...) Le droit à une scolarité gratuite est
un des acquis sociaux remis en cause par le projet libéral (...) Il n'est pas
étonnant que l'école soit présentée comme le lieu où se joue de façon
essentielle le combat contre ce ''ennemi'' qu'est le ''foulard'' ou le
''communautarisme'' . La référenceà la ''laïcité'' est ici mobilisée pour
masquer la réalité des clivages sociaux... ».
L' « Affaire du voile » serait donc un faux problème qui a fait l'objet
d'une instrumentalisation politique et médiatique. Selon Bouamama, le voile
a certainement voilé les vrais problèmes sociaux de la République, que ce
soit à propos du chômage ou de la précarité. Néanmoins le voile a aussi
dévoilé un problème jusqu'alors peu visible : « l'enracinement du racisme
post-colonial en France. (Le foulard islamique en questions, Editions
Amsterdam, 2004 ; S. Bouamama).
Quant aux concepts tels que l « égalité » et « universalisme », Tévanian
accuse leurs déformations perverses. Ces concepts ne renvoient pas à un
universalisme uniformisant et englobant. Si cela était vrai, l’on se
retrouverait face à un État totalitaire. Tévanian explique au contraire que l'
« égalité » ne pourrait exister sans la « différence ». La « différence » est
d’ailleurs une condition fondamentale à l' « égalité » qui n’aboutit pas à une
uniformité des modes de vie, car elle permet justement la liberté de
conscience ainsi que celle de faire des « choix » sans lesquels l’individu ne
peut se construire. Or l’interdiction du « foulard » nuit à cette liberté de
conscience. Ces deux termes ne sont pas en contradiction. Et c’est
précisément cette « différence » indispensable qui contredit l’universalisme
républicain qui pour sa part tente d’imposer un code de conduite effaçant
toutes différences. Sous cet angle-là, l’universalisme républicain est en
contradiction avec le principe d’égalité.
Conclusion
L’ethnicisation des questions sociales aurait alors créé une
« conscience de race » plutôt qu’une « conscience de classe ». Elle a en outre
permis l’apparition d’une dialectique entre « nous » le groupe dominant et
« eux » le groupe discriminé. C’est donc dans un tel contexte qu’est apparue
'l’affaire du foulard' qui a symbolisé un danger épidémique accompagné du
spectre « islamique ».
Même si ce danger est faible, il prend une ampleur qui éclipse complètement
les enjeux sociaux qui, eux, sont bien plus préoccupants pour l’avenir des
Français. Cette « conscience de race », et les discours à connotation raciale
neutralisent les enjeux économiques et sociaux.
Alors que l « affaire » trouvait sa justification dans la défense du
principe de laïcité, l’on se rend compte, comme la Commission Stasi et le
discours féministe nous l’ont démontré, qu’il n’y avait pas un véritablement
mobile laïque à interdire le foulard à l’école. C’est justement l’argument
féministe qui a permis de trouver une justification à cette interdiction. Or ce
dernier point semble avoir été un prétexte.
Les discours catastrophistes à répétition, portant sur la femme
« victime » ou sur la « menace islamique » envers la république, semblent y
avoir joué un rôle déterminant. Ces discours paternalistes et universalistes,
tenus aussi bien par des hommes de « droite » que par des féministes, ont
contribué à discréditer les femmes « voilées ». D’une part la femme en soi est
discréditée parce qu’elle est considérée comme une embrigadée, et d’autre
part, la fonction sociale du voile est « universalisée » voir « uniformisée ».
C’est-à-dire que l’on refuse d’accorder l’hétérogénéité de la fonction sociale
du foulard. Le foulard n’aurait qu’une unique fonction : la domination
féminine.
Il faudrait alors les « émanciper » de force s’il le faut. L’interdiction du
foulard semble avoir été la « solution ». On peut y faire aisément une analogie
avec la « mission civilisatrice » de la colonisation qui avait la prétention d'
« émanciper » les indigènes. Il y a donc à nouveau cette conception
universaliste uniformisante dans l' « affaire du foulard », comme si l’on
assistait à un retour d’un épisode refoulé de l’histoire de France.
Le sujet est complexe en raison des valeurs sous-jacentes qui se
superposent à d'autres systèmes de valeurs. Proclamer la défense de la laïcité
et des droits des femmes est des causes humbles, qui ne peuvent être remises
en question tant qu'elles restent bienveillantes. Même si l'on peut accuser
des féministes occidentales, comme Okin, d'essentialisme et d'avoir tenu des
discours qui peuvent être qualifiés comme « raciale », elles ne font que
réitérer un système de pensée profondément ancré dans les consciences
depuis l'histoire coloniale.
Ce qui relèverait de la malveillance, serait de qualifier un événement tel
« l'affaire du foulard » comme contraire à la laïcité alors que l'on ne prend
pas la peine de vérifier concrètement ce qu'il en est véritablement. Ce qui
serait aussi malveillant, serait de se proclamer être défenseur des droits des
femmes et de reléguer ces dernières par la suite dans leur foyer. Or c'est
justement cequi s'est passé avec la Commission Stasi. Une femme
musulmane d'un milieu social modeste portant le foulard perturbe-t-elle
véritablement le déroulement des cours ? Quand bien même elle est obligée
de quitter l'école publique, doit-elle financer de ses propres moyens son
éducation , faute de quoi se retrouver au foyer ? C'est là où se situe le malaise
à mon sens.
Un des éléments de réponse à ce dévoiement se trouve dans les écrits de
Tévanian et Bouamama. La laïcité et le féminisme ont pris une place
disproportionnée dans le débat, à un point tel qu'ils ont masqué le discours «
racial » sous-jacent. Ce qui s'est passé durant cette période est une véritable
cristallisation de l'idéal républicain et du féministe, qui a donné à la laïcité
une forme idéologique conduisant à l'exclusion scolaire ainsi qu'à la
discrimination à l'encontre des femmes voilées.
Bibliographie 1. Bernard Philippe et Kauffmann Sylvie « Les états d'âme de quatre «
sages » de la Commission Stasi ». Ed : Le Quotidien LE MONDE 2 Février 2004.
2. Abdallah, Stéphanie Latte « Les féminismes islamiques au tournant du XXIe siècle » Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. N°128, Décembre 2010. URL :http://remmm.revues.org/6822 dernière consultation : 22/01/12.
3. Baudérot Jean, « La Commission Stasi vue par un de ses membres » Ed : French Politics, culture and Society, vol 22, n°3, Fall 200 4, pages 135-141.
4. Baudérot, Jean « Commission Stasi : La laïcité , le chêne et le roseau » Ed : Libération. 15 Décembre 2003. URL :http://www.liberation.fr/tribune/0101464784-la-laicite-le-chene-et- le-roseau Dernière consultation : 22/01/12
5. Berger Anne et Varikas Eleni « Genre et postcolonialismes » Edition des archives contemporaines 2011.1.1. Stoler Ann Laura « BeyondSex. Bodily exposures of yje colonial and postcolonial present » p.190-199.
6. Bouamama Saïd « Ethnicisation et construction idéologique d'un bouc émissaire » Ed : oumma.com 21 avril 2004. URL :http://oumma.com/Ethnicisation-et-construction Dernière consultation : 22/01/12.
7. Bouamama, Saïd (2004a). L’affaire du foulard islamique : la production d’un racisme respectable. Geai bleu Editions.
8. Bourdieu Pierre, « Esquisse de la théorie de la pratique -1972 » Edition Seuil 2000. Paris. 429p.
9. Delphy Christine « Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemme (Deuxième partie):Les arguments des féministes anti -voile et pro-loi » Ed : Collectifs ; Les Mots sont Importants. Décembre 2008. URL :http://lmsi.net/Antisexisme-ou-antiracisme-Un-faux,827 22/01/12
10. Delphy Christine « Classer, dominer. Qui sont les « autres » »? Éditions La Fabrique, Paris,2007, 277 pages
11. Delphy Christine « Un universalisme si particulier » Ed ; Collectif;Les Mots sont Importants, 1er mai 2010 URL : http://lmsi.net/Un-universalisme-si-particulier Dernière consultation : 22/01/12.
12. Delphy Christine «Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemme Retour sur la loi anti- foulard (Première partie) » Ed : Collectifs ; Les Mots sont Importants. Décembre 2008. URL :http://lmsi.net/Antisexisme-ou-antiracisme-Un-faux dernière consultation : 22/01/12
13. Geertz, Nadia « Le paradoxe du foulard ? » Les carnets de Nadia Geertz, 14 avril 2010. URL : http://nadiageerts.over-blog.com/article-le-paradoxe-du-foulard-48607893.html Dernière consultation : 22/01/2012
14. Goffman, Erving, Stigmate : les usages sociaux des handicaps / ErvingGoffman ; trad. de l'anglais par Alain Kihm Les Editions de Minuit (1 novembre 1975) , Paris 2007.
15. Grupper Catherine, BouteldjaHouria, Levy Laurent, Tévanian Pierre « Une nouvelle affaire Dreyfus ; sur l'affaire du voile » Ed ; Collectif;Les Mots sont Importants, Janvier 2004. URL : http://lmsi.net/Une-nouvelle-affaire-Dreyfus Dernière consultation : 22/01/12
16. Huntington P.Samuel « Le choc des civilisations »(1996) Édition :Odile Jacob 402p.2005 Paris.
17. Longman Chia et CoeneGily « Les paradoxes du débat sur le féminisme et le multiculturalisme » Livre « Féminisme et multiculturalisme : les paradoxes du débat » Direction :Longman Chia et CoeneGily. Edition : Europe des Cultures . Vol 2, Bruxelles 2010. p11 -29.
18. Stasi Bernard « Rapport de la Commission de réflexion sur l'application de laïcité dans la République remis au Président de la République le 11 décembre 2003 » Commission présidé par Bernard Stasi.Ed : La Documentation française ,151. Paris. 2004
19. Tévanian , Pierre « Islam, voile et laïcité : un débat empoisonné » Ed:Collectifs : Les mots sont importants. Mars 2011. http://lmsi.net/Islam-voile-et-laicite-un-debat Dernière consultation : 22/01/12
20. Tévanian , Pierre « La république du mépris : Les métamorphoses du racisme dans la Frances des années Sarokzy » Ed : Collectifs : Les mots sont importants, Octobre 2007. URL:http://lmsi.net/La-Republique-du-mepris Dernière consultation : 22/01/12
21. Tévanian Pierre « La mécanique raciste » Editions Dilecta (4 septembre 2008) p.126. 22. Tevanian, Pierre (2005). Le voile médiatique. Un faux débat : « l’affairedu foulard islamique ». Paris : Raisons d’agir.
22. Zibouh, Fatima « Le féminisme à l'épreuve du débat post -colonial » Ed : LaRevueNouvelle- (Dossier) Septembre 2010. URL : http://ulg.academia.edu/FatimaZIBOUH/Papers/549348/Le_feminisme_a_lepreuve_du_deb at_postcolonialDernière consultation:22/01/12.
23. Zoka, Négar , « Ce que le voile dévoile »VIDEO DOCUMENTAIRE , Réalisé par Zoka, Emission de Docs Ad Hoc, une coproduction LCP/Mécanos Production.2010 Durée 52 min.