La recherche d'informations sexuelles sur le Web par de jeunes Franco-Canadiennes et ses liens avec...
Transcript of La recherche d'informations sexuelles sur le Web par de jeunes Franco-Canadiennes et ses liens avec...
La recherche d’informations sexuelles sur le Web
par de jeunes Franco-Canadiennes
et ses liens avec l’expression
de leur agentivité sexuelle
Thèse
MARIE-EVE LANG
DOCTORAT EN COMMUNICATION PUBLIQUE
Philosophiae doctor (Ph.D.)
Québec, Canada
© Marie-Eve Lang, 2013
iii
Résumé
Dans les études anglophones sur les jeunes femmes, on fait de plus en plus appel à un concept relativement
récent en sciences sociales : l’agentivité sexuelle (sexual agency). Terme peu usité en anglais, et encore
moins en français, l’agentivité sexuelle fait référence à l’idée de « contrôle » de sa propre sexualité, c’est-à-
dire à la capacité de prendre en charge son corps et sa sexualité.
L’une des façons de prendre une part active dans sa sexualité est de s’y intéresser et chercher des réponses
à ses questions. Par le biais de blogues « privés » de recherche sur Internet et d’entrevues individuelles, nous
avons interrogé 30 jeunes femmes âgées de 17 à 21 ans sur leurs façons d’utiliser Internet pour répondre
à leurs questions sur la sexualité. Nous avons ensuite poussé plus loin la question de l’agentivité en
interrogeant la façon dont les jeunes participantes manifestent de l’agentivité dans diverses situations en lien
avec leur sexualité.
Ce rapport de recherche doctorale propose une définition du concept d’agentivité sexuelle, décrit la
méthodologie novatrice utilisée et présente ensuite de façon qualitative les résultats. Nous avons pu observer
qu’Internet constitue un moyen de choix pour répondre aux questions des participantes sur la sexualité, mais
qu’en certaines situations angoissantes, Internet présente certaines limites. Bien qu’Internet leur semble une
solution rapide, efficace et anonyme pour répondre à leurs questions d’ordre « physique », elles utilisent très
peu le Web pour répondre à leurs besoins d’ordre plus « psychologique » ou « relationnel ». Elles n’accordent
pas non plus aux sources Web le même crédit qu’à leurs parents, médecins ou amis. Nous avons également
constaté que les participantes, dans leurs pratiques, ont bien intégré certaines notions de contrôle (notamment
que « non », c’est « non »), mais éprouvent plus de difficulté à exercer du pouvoir quand leur partenaire est
insistant ou a plus d’expérience qu’elles. Nous verrons enfin que la méthode du blogue « privé », jumelée
à des entretiens individuels, présente de nombreux avantages sur les méthodes de recherche plus
« traditionnelles », notamment lorsqu’il est question de sujets délicats comme la sexualité.
v
Abstract
In the last few years, the concept of sexual agency has been used by many English-language studies on youth
and women to describe the ability to take control of one’s own body and sexuality. While the term is rarely
used in informal English, it appears even less frequently in French.
One way that young women can exercise their sexual agency is for them to take an active role by seeking
answers to their questions about their own sexuality. Using an innovative "private" blog method, combined
with in-depth interviews, we sought to determine how teenage girls and young women ages 17 to 21 are using
the Internet to learn about sexuality. We then interviewed the participants about the situations where they
exercise (or refrain to exercise) sexual agency in their lives.
In this thesis, we propose a definition of sexual agency, describe the method we have developed, and then
discuss our results. We show that the participants use the Internet to gather information on a wide variety of
sexual topics, but using the Internet has some limitations when a participant's situation is worrisome or taboo.
Although Internet seems to serve well their needs related to "physical" matters, the participants don’t really
use Internet to address their more "psychological" or "relational" concerns. They also do not grant the same
credence to some Internet sources as they do to their friends, doctors or parents. We also show that the
participants, in their sexual encounters, have integrated some agentic messages, such as "No means no", but
show some lack of sexual agency when their partner is more experienced or insistent. Finally, we will see that
our method of private blogs mixed with in-depth interviews is an ideal method for gathering qualitative data on
sensitive topics such as sexuality.
vii
Avant-Propos
Cette thèse de doctorat n’aurait pu voir le jour sans le soutien indéfectible de plusieurs de mes proches, de
mes professeurs et de certaines agences de recherche.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont facilité cette recherche, soit en la
commentant, en y participant ou en s'y intéressant de façon soutenue.
J’aimerais remercier particulièrement madame Estelle Lebel, ma directrice : merci pour votre patience, votre
disponibilité, votre perspicacité et vos conseils judicieux. Je n’aurais pu y arriver sans votre aide généreuse et
votre soutien tout au long de mes études supérieures.
Merci à mes parents, qui m’ont encouragée et soutenue sans relâche depuis le tout début. Vos
encouragements et votre intérêt marqué envers mes études m'ont appris l’importance de viser sans cesse
l'excellence, autant dans ma vie étudiante que professionnelle.
Merci à Vincent Fortin, mon conjoint, qui a mis au point le site Web permettant d’accueillir les blogues des
participantes. Ton ingéniosité et tes compétences m’épateront toujours.
Merci aussi à Garth Haller pour sa disponibilité et son aide précieuse à la traduction.
Un merci bien chaleureux également aux trente participantes qui ont bien voulu prendre le temps de tenir un
blogue et de participer aux entrevues. Votre générosité, votre ouverture d’esprit et votre volonté bien sentie de
fournir une représentation honnête et complète de votre expérience participent directement à la qualité de
cette recherche.
Merci enfin au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), à CTVglobemedia ainsi qu’au
Fonds de soutien au doctorat de la Faculté des lettres de l'Université Laval pour leur soutien financier
généreux.
ix
Table des matières
Résumé ............................................................................................................................................................... iii
Abstract ............................................................................................................................................................... v
Avant-Propos ..................................................................................................................................................... vii
Table des matières ............................................................................................................................................. ix
Introduction ......................................................................................................................................................... 1
Problématique ..................................................................................................................................................... 5
1 Sexualité, genre et pouvoir ............................................................................................................................ 11
1.1 Sexualité et discours ............................................................................................................................. 11
1.2 Sexualité et scripts ................................................................................................................................ 13
1.3 Sexualité et genre .................................................................................................................................. 16
1.4 Agentivité et structures sociales ............................................................................................................ 20
1.5 Agentivité et genre ................................................................................................................................. 26
1.6 Rappel des points importants ................................................................................................................ 27
2 Agentivité sexuelle ........................................................................................................................................ 29
2.1 Agentivité sexuelle : lignes directrices d’une définition .......................................................................... 30
2.1.1 Agentivité et le courant « Just Say No » ........................................................................................ 32
2.1.2 Agentivité et le discours sur la dangerosité et la vulnérabilité ........................................................ 34
2.1.3 Agentivité et le discours de la protection ....................................................................................... 38
2.1.4 Agentivité sexuelle dite par des jeunes femmes ............................................................................ 40
2.1.5 Agentivité sexuelle des garçons .................................................................................................... 43
2.2 Agentivité, perception du pouvoir sexuel et normativité ........................................................................ 45
2.3 Opérationnaliser le concept d’agentivité sexuelle .................................................................................. 59
2.4 Quelques mots sur le consentement sexuel .......................................................................................... 65
2.5 Rappel des points importants ................................................................................................................ 72
3 Internet et la quête d’informations sexuelles ................................................................................................. 75
3.1 La sociologie des usages ...................................................................................................................... 76
3.2 Les usages du Web : aspects théoriques et méthodologiques ............................................................. 83
3.3 Les usages d’Internet par les adolescents en lien avec la sexualité : choix méthodologiques, forces et
limites des études antérieures ...................................................................................................................... 87
3.3.1 L’étude de Gray, Klein et al. (2005) ............................................................................................... 88
3.3.2 L’étude de Smith, Gertz et al. (2000) ............................................................................................. 89
3.3.3 L’étude de Buhi et al. (2009) .......................................................................................................... 90
3.3.4 L’étude de Suzuki et Calzo (2004) ................................................................................................. 92
3.4 Rappel des points importants et de la question de recherche ............................................................... 93
4 Méthode ........................................................................................................................................................ 95
4.1 Le blogue « privé » et ses avantages .................................................................................................... 97
4.2 Profil des participantes ........................................................................................................................ 107
4.3 Entrevue et questionnaire .................................................................................................................... 110
4.4 Analyse ................................................................................................................................................ 114
5 Résultats relatifs à Internet, à la quête d’information et à l’agentivité sexuelle ............................................ 121
5.1 Thèmes cherchés ................................................................................................................................. 121
5.1.1 Thèmes à curiosité « simple » : des mots et des significations ................................................... 124
x
5.1.2 Thèmes à curiosité « concernée » ............................................................................................... 129
5.1.3 Thèmes relatifs à la norme........................................................................................................... 136
5.1.4 Thèmes relatifs aux craintes « centrales » ................................................................................... 148
5.1.5 Craintes vives mais passagères .................................................................................................. 168
5.1.6 Thèmes visant l’amélioration des relations de couple .................................................................. 175
5.1.7 Thèmes montrant le « comment » ............................................................................................... 191
5.1.8 Thèmes suscitant une prise de position ....................................................................................... 199
5.1.9 Thèmes pour s’amuser ................................................................................................................ 220
5.1.10 Thèmes « traumatisants » et thèmes pour « explorer » ............................................................. 221
5.2 Agentivité sexuelle et distribution du pouvoir dans le couple ............................................................... 225
5.2.1 Une initiation difficile .................................................................................................................... 228
5.2.2 Un pouvoir difficile à atteindre pour certaines .............................................................................. 237
5.2.3 « Non, c’est non. » ....................................................................................................................... 240
5.2.4 Le « point de non-retour » ............................................................................................................ 243
5.2.5 Quand la violence s’invite… ......................................................................................................... 256
5.2.6 Le cas des participantes homosexuelles ..................................................................................... 257
5.2.7 Conditions permettant une meilleure agentivité ........................................................................... 263
5.3 Appréciation d’Internet ......................................................................................................................... 269
5.3.1 Internet : ses avantages, ses désavantages, ses limites ............................................................. 269
5.3.2 Confiance, agentivité et Internet : les grands absents ................................................................. 275
5.3.3 Les forums et les sites officiels : deux mondes ............................................................................ 284
5.3.4 Internet, le sexe et les cours de formation personnelle et sociale ................................................ 286
5.3.5 Vers un « meilleur » Web : suggestions des participantes ........................................................... 292
6 Évaluation de la méthode et limites de l’étude ............................................................................................ 295
Conclusion ....................................................................................................................................................... 309
Bibliographie .................................................................................................................................................... 317
Annexe 1 : Codes utilisés pour l’analyse ......................................................................................................... 341
Annexe 2 : Autres images du blogue ............................................................................................................... 357
Introduction
Avec l’arrivée des moteurs de recherche comme Yahoo!, Altavista et Google, il y a quelques années, Internet
s’est révélé un outil de recherche convivial, efficace et pratique pour quiconque se met en quête d’une
information particulière sur presque tous les sujets. En partie grâce à l’explosion des sites Web reconnus et
à l’étendue du réseau (presque tous les domiciles et un nombre toujours grandissant de lieux publics sont
maintenant connectés), Internet continue de s’imposer. Il est encore impossible de dresser la typologie des
usages d’Internet : il semble en effet exister autant d’usages que de préoccupations ou d’occupations
(Rouquette : 2008). Malgré la « diversité maximale » des requêtes, les auteurs discernent deux types
d’usages significatifs : les usages « pratiques » et ceux visant le « divertissement » (ibid., p. 3 et 9). S’il est un
thème, toutefois, qui puisse marier les deux types d’usage, il semble que ce soit la sexualité. Ce thème de
recherche figure d’ailleurs parmi les plus populaires : dans une étude effectuée en 2002 sur les requêtes
effectuées dans les moteurs de recherche Altavista et WebCrawler, le mot « sexe » apparaît une fois sur 100,
ce qui est énorme (Lajoie : 2002).
Toutefois, malgré l’immense popularité de ce thème sur Internet, on connaît peu les usages que font les
jeunes adultes d’Internet au regard de la sexualité, en particulier des jeunes de sexe féminin. Pour mieux
comprendre ce que font les jeunes femmes et les adolescentes de cet outil, nous avons voulu observer leurs
usages et situer leurs interrogations dans leur contexte social. Pour ce faire, nous avons étudié leurs usages
selon une perspective plutôt novatrice : celle de l’agentivité des usagers. Ce concept, qui peut s’appliquer
à plusieurs domaines, est généralement défini comme la « capacité d’action » des individus, ou en d’autres
mots comme la capacité d’agir de façon compétente, raisonnée, consciencieuse et réfléchie (Smette et al.:
2009, p. 370).
Nous avons étudié de façon plus particulière les façons dont la quête d’informations sexuelles dans Internet
permet aux jeunes femmes de manifester leur agentivité sexuelle, c’est-à-dire leur volonté de s’investir dans
leur sexualité et leur capacité de prendre en charge de leur propre corps et leur sexualité. Nous nous sommes
donc intéressée aux questionnements des jeunes femmes au regard de la sexualité, ainsi qu’au contexte dans
lequel ces interrogations apparaissent. Nous avons voulu comprendre les motifs de leurs interrogations et
connaître les moyens qu’elles prennent pour obtenir des réponses, à savoir notamment si elles se servent
d’Internet indépendamment d’autres sources ou conjointement avec d’autres, et à quelles sources elles
accordent généralement leur confiance. Surtout, nous avons voulu laisser une place importante aux émotions :
nous avons donc tenté de comprendre comment elles se sentent lors de leurs recherches, et comment elles
intègrent les réponses trouvées à leur vie affective et sexuelle. Les résultats leur ont-elles permis de se sentir
ultimement plus en contrôle de leur sexualité, bref plus « agentiques »?
2
Comme la quête d’informations sur Internet ne s’effectue pas dans un vacuum, mais s’inscrit dans des
pratiques préexistantes et dans un contexte social où prennent part des jeux de pouvoir, de rapports sociaux
de sexe et des processus d’appropriation (Jouët : 2000, p. 499), il nous importait de problématiser la réflexion
sur l’agentivité sexuelle des participantes de façon à comprendre comment leurs requêtes sur Internet
s’insèrent dans leur réalité sociale et sexuelle. Nous nous sommes donc intéressée aux façons dont les jeunes
femmes exercent de l’agentivité sexuelle dans leur quotidien; nous avons ainsi voulu connaître les situations
propices au développement et à l’expression de leur agentivité sexuelle – et à l’inverse, les obstacles
susceptibles d’empêcher les jeunes femmes d’exercer pleinement leur agentivité –, et le degré d’agentivité
qu’elles souhaitent atteindre. Nous avons enfin voulu connaître les moyens que l’on pourrait mettre de l’avant
pour faciliter cette atteinte.
Pour répondre à nos questions sur ces usages contextualisés d’Internet et obtenir un portrait riche, précis et
nuancé de ces expériences du Web et de la sexualité, nous avons développé une méthode qualitative qui
s’inspire des nouvelles formes d’expression en ligne; nous avons invité plus d’une trentaine de jeunes femmes
âgées de 17 à 21 ans à rédiger un blogue sur leurs expériences passées et récentes de leurs usages
d’Internet pour obtenir des informations sur la sexualité. De façon à encourager la confiance et à veiller à la
confidentialité des données, nous avons toutefois tenu à garder ces blogues privés, c’est-à-dire que seuls
notre informaticien et nous-même avions accès aux données de chacun des blogues.
Une fois la période de carnetage1 terminée, nous avons rencontré les participantes en entrevue individuelle;
ces entrevues avaient pour but de compléter les résultats obtenus au moyen des blogues, d’une part, mais
aussi, d’autre part, de discuter avec elles des occasions où elles avaient fait preuve, selon leur interprétation,
d’agentivité sexuelle dans leur vie de couple, et des occasions où, à l’inverse, elles auraient souhaité faire
preuve d’agentivité, mais ne s’en sont pas senties capables. La méthode, double, permettait ainsi de répondre
aux deux « aspects » de notre recherche : celui des usages du Web pour la recherche d’informations sur la
sexualité en ce qui concerne le blogue, et celui de l’expression de l’agentivité dans le contexte relationnel du
couple en ce qui concerne l’entrevue – mais l’un et l’autre de ces aspects pouvaient participer au portrait des
expériences des participantes.
Les résultats obtenus fournissent un éclairage riche et nuancé sur l’expression sexuelle de jeunes filles franco-
canadiennes et permettent d’aborder autrement le débat sur l’hypersexualisation en pensant la sexualité des
jeunes femmes sous l’angle de l’agentivité sexuelle. Cet angle est particulièrement propice à l’implication de la
1 « Carnetage » est le terme privilégié par l’Office québécois de la langue française pour désigner l’activité consistant
à tenir un blogue (en anglais, « blogging »). L’Office préconise également la graphie francisée « blogue » plutôt que
« blog ».
3
parole des jeunes femmes dans ce débat et permet d’autre part de les laisser parler par et pour elles-mêmes
des occasions où elles se sentent en contrôle (ou non) de leur sexualité.
Éclairée par les apports des théories féministes, mais aussi des théories constructivistes sur le pouvoir, le
discours, les structures sociales et les usages des technologies de l’information (TIC), la thèse que nous
présentons ici est divisée en six sections qui suivent une organisation pouvant être comprise comme allant du
plus général au plus particulier. Le chapitre 1 vise à dresser un portrait des liens qui se tissent entre sexualité,
discours, genre, structures sociales et agentivité, de façon à montrer le cadre dans lequel s’inscrit,
historiquement et théoriquement, le concept d’agentivité sexuelle. Au chapitre 2, nous montrons comment le
concept d’agentivité a été compris et utilisé dans diverses études antérieures et faisons état des débats ayant
cours sur sa définition et sur son utilité même, débats dans lesquels nous tentons de prendre position. Après
un bref retour sur la généalogie et les principes fondateurs de la sociologie des usages, le chapitre 3 vise
à montrer comment l’usage, ce construit social, peut être compris et étudié. Nous faisons notamment un bilan
des études antérieures ayant porté sur les usages du Web par les adolescents et les adolescentes. Le
chapitre 4 présente la méthode, et le 5e, les résultats obtenus. Nous présentons enfin les limites de la
recherche au chapitre 6, pour ensuite conclure en en soulignant l’importance et la pertinence sur divers plans.
Problématique
La question de l’exercice de l’agentivité (en d’autres mots, de la possibilité même de pouvoir en exercer) est
source de conflits depuis plusieurs décennies au sein de la recherche et notamment de la recherche féministe.
Comment les femmes peuvent-elles exercer véritablement de l’agentivité (c’est-à-dire faire des choix estimés
libres, et agir selon leur propre vouloir) dans un contexte régulé par un pouvoir masculin que l’on considère
comme contraignant et, plus encore, instauré de façon systématique? Fraser et Bartky (1992) illustrent ici très
bien le dilemme :
Agency has become a problem in recent feminist theory because of the cross-pull of two
equally important imperatives. On the one hand, feminists have sought to establish the
seriousness of our struggle by establishing the pervasiveness and systematicity of male
dominance. Accordingly, we have often opted for theories that emphasize the constraining
power of gender structures and norms, while downplaying the resisting capacities of
individuals and groups. On the other hand, feminists have also sought to inspire women’s
activism by recovering lost or socially invisible traditions of resistance in the past and
present. Under the sway of this imperative, we have often supposed quasi-voluntarist
models of change. The net result of these conflicting tendencies is the following dilemma:
either we limn the structural constraints of gender so well that we deny women any agency
or we portray women’s agency so glowingly that the power of subordination evaporates.
Either way, what we often seem to lack is a coherent, integrated, balanced conception of
agency, a conception that can accomodate both the power of social constraints and the
capacity to act situatedly against them. (Fraser et Bartky : 1992, p. 17, leurs italiques)
Ce débat, qui pourtant dure depuis longtemps, n’est toujours pas résolu aujourd’hui; et les positions des deux
camps sont encore très polarisées. D’un côté, on retrouve des théoriciennes comme Rosalind Gill (2007,
2008a, 2008b, 2009b, 2010, 2011) qui estiment « nuisible » le concept d’agentivité et qui vont jusqu’à prôner
son abolition; de l’autre, on retrouve des chercheuses plus empiriques qui soutiennent et défendent son
utilisation (Duits et van Zoonen : 2006, 2007, 2009).
Récemment, par exemple, les chercheuses féministes Gill et Scharff ont déploré que les « mots du jour » en
recherche féministe soient « choice » et « empowerment » plutôt que « sexisme » (et donc subordination), et
que paradoxalement à l’émergence de ce discours semblable à celui du « girl power », que l’on a vu
apparaître dans les années 90 et au début des années 2000, l’on assiste, selon leur point de vue,
à l’émergence de nouvelles formes d’inégalité entre les sexes et de nouvelles modalités de pouvoir (Gill :
2011, 2009; Gill et Scharff : 2011). Elles craignent notamment que la résurgence de ce type de discours,
appuyé par une ligne de pensée qualifiée comme « postféministe » ou « néolibérale », évacue du coup la
possibilité de discuter de l’aspect politique de ces inégalités de pouvoir. Elles arguent que par ces discours
6
néolibéraux, l’on offre aux femmes certaines formes de pouvoir et d’empowerment qui soient en remplacement
des politiques féministes, comme si le discours misant sur le choix et l’empowerment (bref, sur l’agentivité des
femmes) ne pouvait fondamentalement être concilié avec le discours féministe plus traditionnellement politique
(voir aussi Gill : 2010).
Plus encore, elles déplorent que ce type de discours soit « célébratoire », c’est-à-dire que l’on se réjouisse des
réussites ou des acquis sur le plan de l’expression de l’agentivité des femmes, alors que cette expression leur
semble encore et toujours limitée par le genre et par le contexte social et relationnel de classe, de race, d’âge
et de capacité physique ou corporelle (able-bodied).
Mais pour bien comprendre les implications de cette prise de position, il importe d’abord de préciser ce
qu’elles entendent par « postféminisme » et « féminisme néolibéral ».
Gill et Scharff définissent le postféminisme comme un féminisme résultant d’un déplacement théorique où la
femme est de plus en plus conçue comme une « propriété corporelle » (bodily property), où l’accent est de
plus en plus porté sur le choix libre, l’idée plutôt vendeuse de la « réinvention de soi », et sur la subjectivation
des femmes plutôt que sur leur objectivation. Bref, il s’agirait d’un discours qui porte progressivement les
femmes comme étant « responsables », en quelque sorte, de leur propre sort et où l’on mise sur l’auto-
surveillance, le contrôle de soi et la discipline. Gill et Scharff estiment que ce discours marque d’autre part la
« resexualisation » du corps des femmes, ainsi que le consumérisme et la « marchandisation » de la
différence.
Dans ce même cadre d’analyse, Gill et Scharff décrivent le néolibéralisme comme un concept et une approche
théorique issus du milieu politique permettant de « gouverner » des sujets paradoxalement conçus comme
autonomes et « self managing », bref comme d’une gouvernance où la responsabilité individuelle est mise de
l’avant et où les individus sont conçus comme des agents rationnels, autonomes et responsables. La
gouvernance est alors technique plutôt que fondamentalement politique.
En ce sens, le féminisme néolibéral et le postféminisme sont très semblables; ils constituent tous deux, selon
Gill et Scharff (op. cit.), des lignes de pensée où l’accent porté sur l’individualisme remplace progressivement
les notions sociales et politiques – bref où l’idée que les individus soient sujets à des pressions et des
contraintes sociales est de plus en plus absente.
Dans ce contexte, la question de l’agentivité sexuelle des femmes, et particulièrement des jeunes femmes et
des adolescentes, devient un sujet particulièrement sensible : d’une part, certaines chercheuses féministes
déplorent le fait que le néolibéralisme et le postféminisme semblent imposer une nouvelle prescription de
7
contrôle et d’assertivité aux jeunes filles, alors même que le contexte dans lequel elles exercent ce contrôle
semble à ces chercheuses imprégné d’inégalités persistantes – où, par exemple, les hommes et les garçons
exercent toujours autant de pouvoir et où les filles se retrouvent injustement avec la responsabilité personnelle
de contrer ce pouvoir, qui pourtant s’exerce à un niveau beaucoup plus large.
L’une des raisons pour lesquelles le discours néolibéral serait particulièrement néfaste, estiment les
chercheuses Harvey et Gill (2011), se situerait dans le fait qu’il ait été insidieusement repris par les médias
pour créer un nouveau type de « sujet sexuel » qu’elles nomment « the sexual entrepreneur ». Ce nouveau
« type » de « féminité » proviendrait d’un enchevêtrement de discours néolibéraux de liberté sexuelle pour les
femmes et de tentatives de « récupération » de ces discours dans une optique capitaliste et consumériste. Il
en résulterait, au final, une figure stéréotypée de la femme qui reprend les vieux clichés sexistes, mais qui
a l’apparence d’une nouvelle forme de « pouvoir » et d’expression sexuelle « libre ». Les auteures donnent en
exemple les représentations de la sexualité féminine que l’on trouve dans l’émission britannique The Sex
Inspectors, une émission de téléréalité qui puise dans les discours de self-help, de la confession et de la
psychothérapie pour intervenir dans la sexualité de différents couples afin de « régler » leurs problèmes
sexuels. Aidés par des intervenants qui se présentent comme des « sexperts » (dont une chroniqueuse
« sexe » du magazine Cosmopolitan qui n’est ni psychologue, ni sexologue), les couples sont invités
à « réinventer » leur vie sexuelle à la façon d’un « makeover » télévisé.
Dans l’émission, les femmes sont encouragées à adopter un comportement sexuel calqué sur certains
principes de l’agentivité (le fait d’être actif et non passif dans sa sexualité, par exemple) et à projeter une allure
confiante de façon à séduire (et à garder) leur conjoint ou partenaire. En utilisant de façon particulièrement
insidieuse les discours néolibéraux et postféministes, on invite donc les femmes de l’émission à « gérer » leur
sexualité de façon à ce qu’elles projettent sans cesse une image d’elles « en charge » de leur sexualité, en
maîtrisant, par exemple, une infinité de « trucs » pour garder leur partenaire attiré. Plus encore, on leur
apprend à devenir ce nouveau « sujet sexuel » par l’instauration de cette nouvelle norme de la performance,
qu’on présente comme « empowering » et « authentically self-chosen », mais qui au final vise principalement
à satisfaire les « besoins » sexuels des hommes.
En imposant une nouvelle « norme » de la performance à des fins lucratives, ce discours perpétuerait aussi la
perception naturaliste de la différence entre les sexes (les hommes auraient naturellement des désirs sexuels
qu’il faut impérativement combler par un travail sur les femmes), tout autant qu’il instaurerait une nouvelle
« norme » des activités sexuelles souhaitables (masturbation, sexe oral, fantasmes « légers »,
expérimentation de nouvelles pratiques sexuelles, etc.) et non souhaitables (sexe anal, fétiches, absence de
8
sexualité dans le couple, etc.). On imposerait même aux femmes des attitudes « obligatoires », soit d’être
toujours « up for it » et « willing to try » (Harvey et Gill : 2011; voir aussi Gill : 2007).
On retrouve également et abondamment de telles représentations dans la publicité, où les femmes sont
dépeintes comme à la fois désirables, agentiques, aventurières et en contrôle de leur sexualité (Gill : 2007,
2008a, 2008b, 2009b, 2011).
Si nous partageons en grande partie l’analyse d’Harvey et de Gill et pensons que de telles représentations ont
peu de chances de servir aux femmes et aux filles, et qu’elles sont en ce sens problématiques sur plusieurs
plans, nous estimons cependant que ni l’analyse, ni (il va sans dire) les représentations médiatiques ne
justifient que l’on écarte du revers de la main tout discours promouvant l’empowerment des femmes et leur
capacité d’action en matière de sexualité.
Car il s’agit exactement de cela : de représentations médiatiques déformées de l’agentivité; bref d’une
agentivité factice, justement transformée par les médias soumis au modèle publicitaire. Mais le fait que ces
représentations déforment, voire détournent le concept d’agentivité en s’appropriant les discours néolibéraux
de liberté et de pouvoir implique-t-il nécessairement que l’expression réelle et non médiatique de l’agentivité
soit impossible?
Nous pensons évidemment que non; et estimons, à la suite, par exemple, de Duits et van Zoonen (2007,
2008) et d’Hasinoff (2010), que le fait de concevoir des individus comme étant « agents » n’évacue pas
nécessairement la notion de contrainte sociale; au contraire, comme nous allons le voir dans les chapitres qui
suivent, chaque action d’un agent est située socialement. En ce sens, l’agentivité des femmes et des filles est
nécessairement contrainte par le genre et le patriarcat, et s’exprime dans un monde où les représentations
médiatiques de la sexualité sont le résultat et le reflet de cette tension politique pour définir la réalité. C’est
dans ce contexte qu’il nous est apparu important de comprendre comment les adolescentes et les jeunes
femmes exercent leur agentivité sexuelle. Nous avons tenté de répondre aux questions de recherche
suivantes : comment les adolescentes et les jeunes femmes décrivent-elles ce qui leur semble un pouvoir sur
leur sexualité, et comment conçoivent-elles l’exercice de leur agentivité sexuelle? Dans le contexte élargi de
leurs relations de couple, quel rôle Internet joue-t-il comme outil d’information? Concourt-il à développer leur
agentivité, et si oui, comment? Si non, pourquoi? Et comment pourrait-il leur permettre de mieux prendre en
charge leur sexualité et de négocier la distribution du pouvoir d’une façon qui leur convienne vraiment?
Pour répondre à ces questions, il importe de comprendre que la relation entre agentivité et contraintes
sociales ne constitue pas les extrêmes d’une dichotomie binaire et diamétralement opposée, mais constitue
une dualité structurelle indivisible. Nous allons voir que cette idée de coexistence de contraintes sociales et de
9
capacité d’action est non seulement possible, mais déjà présente dans la définition du concept même, et
qu’ainsi en ancrant le concept d’agentivité sexuelle à la fois dans la tradition sociologique du développement
du concept d’agent et dans le cadre actuel des études empiriques sur la question, l’on se rend compte que
cette conciliation permet l’utilisation du concept d’agentivité sexuelle en sciences sociales de façon productive.
Mais d’abord, nous allons voir que le concept de sexualité est fondamentalement social et culturel.
1 Sexualité, genre et pouvoir
Avant d’aborder les thèmes de l’agentivité sexuelle et de la recherche d’information sur Internet, il nous
semble indispensable de faire un retour sur certains des grands textes qui ont constitué la pierre d’angle de
bien des approches modernes sur le genre, la sexualité et le pouvoir – l’œuvre de Michel Foucault, d’une part,
dont l’apport sur les mécanismes de pouvoir est incontournable pour le courant des Gender studies et pour les
études féministes en général; celles de Pierre Bourdieu (malgré les critiques), de Judith Butler et de Christine
Delphy sur le genre, entre autres auteurs; celle de Simon et Gagnon sur les scripts sociaux; et finalement celle
d’Anthony Giddens, sociologue souvent considéré comme l’un des premiers à cimenter la conception de
l’agentivité des individus au sein des structures sociales. Les différentes sections de ce chapitre ont pour but
de résumer les assises de leur pensée sur les concepts clés de notre ouvrage.
1.1 Sexualité et discours
Michel Foucault, dans son Histoire de la sexualité : La volonté de savoir (1994 [1976]), relève un paradoxe :
alors qu’on considère généralement, dans la société actuelle, que tout ce qui touche de près ou de loin la
sexualité a été, au courant des siècles derniers, tu, nié, caché ou réprimé, il démontre qu’au contraire,
l’histoire récente a vu naître sur la sexualité une multiplicité de discours. Que ce soit par le biais de la
« confession annuelle » de la religion chrétienne, par le biais des études en médecine et en psychiatrie sur les
« pathologies » sexuelles ou par celui des règles disciplinaires des collèges, « tout doit être dit » (p. 28),
examiné et observé.
Cet enchevêtrement de discours sur le sexe aurait contribué à rendre le désir dangereux; on le traque,
l’analyse, et le condamne sous toutes ses manifestations. Le sexe devient alors pour ainsi dire l’incarnation du
mal, « la racine de tous les péchés » (p. 28).
Cette « mise en place » de discours – qui se relancent et qui s’imbriquent les uns dans les autres – a pour
effet de fournir aux instances en question (religion, médecine, gouvernement) une assise par laquelle elles
exercent du contrôle – sur les individus, sur leurs comportements, sur leurs opinions. Ces « mécanismes de
pouvoir », selon Foucault, n’ont pu fonctionner que par le biais du discours, qui lui est « devenu essentiel »
(p. 33). C’est donc par le discours que le pouvoir s’exerce.
Pour le gouvernement, la sexualité devient un enjeu économique, et donc « public » : c’est par elle que les
populations sont gérées, et donc par elle qu’interviennent les ressources (p. 35-37).
La sexualité des enfants et des adolescents n’échappe pas à ce contrôle investi par les discours, qu’ils soient
médicaux, moraux, ou pédagogiques. Des discours qui, en s’entremêlant et en se relançant, contribuent
à faire de la sexualité adolescente un « problème public » (p. 40) :
12
Il serait inexact de dire que l’institution pédagogique a imposé massivement le silence au
sexe des adolescents. Elle a au contraire, depuis le XVIIIe siècle dernier, démultiplié à son
sujet les formes de discours; […] elle a codé les contenus et qualifié les locuteurs. Parler du
sexe des enfants, en faire parler les éducateurs, les médecins, les administrateurs et les
parents, ou leur en parler, faire parler les enfants eux-mêmes, et les enserrer dans une
trame de discours qui tantôt s’adressent à eux, tantôt parlent d’eux, tantôt leur imposent des
connaissances canoniques, tantôt forment à partir d’eux un savoir qui leur échappe, – tout
cela permet de lier une intensification des pouvoirs et une multiplication du discours. Le
sexe des enfants et des adolescents est devenu, depuis le XVIIIe siècle, un enjeu important
au cours duquel d’innombrables dispositifs institutionnels et stratégies discursives ont été
aménagés. (p. 41-42)
Les adolescents et les enfants deviennent ainsi à la fois « dangereux et en danger », et leurs comportements,
scrutés à la loupe, deviennent l’objet de discours de prévention et de protection, par le biais desquels on
« signal[e] partout des périls, éveill[e] des attentions, appel[le] des diagnostics, entass[e] des rapports,
organis[e] des thérapeutiques ». Bref, « autour du sexe, [les contrôles sociaux] irradient les discours,
intensifiant la conscience d’un danger incessant qui relance à son tour l’incitation à en parler » (p. 43).
Selon Foucault, si l’on a retiré du même coup « aux adultes et aux enfants eux-mêmes une certaine façon
d’en parler; et qu’on l’ait disqualifiée comme directe, crue, grossière », ce n’est « que la contrepartie, et peut-
être la condition pour que fonctionnent d’autres discours, multiples, entrecroisés, subtilement hiérarchisés, et
tous fortement articulés autour d’un faisceau de relations de pouvoir » (p. 42).
Des discours qui forcent justement à discourir sur le sexe, à le mettre en mots, bref, à lui donner une
« existence discursive » (p. 45), alors que pourtant, de prime abord, ces discours avaient plutôt pour but de le
cacher, comme si le sexe « vrai » était un « secret » (p. 49 et 71-72). Ce paradoxe, estime Foucault, fait
douter de l’existence même d’une sexualité qui soit « hors discours » (p. 48).
Les discours sur le sexe – religieux, moraux, médicaux – ont implanté leurs normes et défini des déviances (p.
50). Certains comportements sexuels ont été jugés comme des « perversions »; d’autres comme « illicites »
(p. 50-51). Seules les pratiques sexuelles menant à la reproduction ont été jugées acceptables, et un système
de règles et de recommandations strictes devait être rigoureusement respecté (p. 52). Par le discours de la
médecine, on a fait l’inventaire des pathologies; on a « install[é] des dispositifs de surveillance » (p. 58) qui ont
réduit au secret les sexualités marginales pour mieux les observer, les analyser et s’en scandaliser (p. 60-62).
De l’homosexuel, par exemple, on a fait un personnage; tout ce qui le caractérisait – vêtements, manières,
comportement, histoire de vie – a été réduit à sa sexualité et a trouvé pour cause cette « déviation »
pathologique (p. 59).
13
Ce discours normatif, que l’on a pourtant voulu scientifique, a été teinté « d’aveuglements systématiques »
(p. 74) : par une « péripétie de la volonté de vérité », l’on s’est entêté à « ne pas vouloir reconnaître » la
sexualité réelle (loc. cit.). Tout cela fait qu’au final, l’on « ait construit autour du sexe et à propos de lui un
immense appareil à produire, quitte à la masquer au dernier moment, la vérité » (p. 76). Une dynamique où
s’agencent pouvoir et savoir issu du XIXe siècle et dont, selon Foucault, « rien ne prouve, même si nous
l’avons modifié[e], que nous en sommes affranchis » (p. 76) : « encore aujourd’hui », l’aveu constitue « la
matrice générale qui régit la production du discours vrai sur le sexe » (p. 84). Toutefois aujourd’hui, cet aveu,
moins pris dans le carcan d’une étude qui se veut restrictive, a une motivation autre, qui est celle de
comprendre et de faire rayonner une espèce de « vérité » du sexe par un discours qui, cette fois, vient du
peuple, et non des instances au pouvoir dans une optique de contrôle. Cette position, moins moraliste, fait du
système de l’aveu un mécanisme acceptable, voire incontournable. En raison de la « latence » du sexe, de
son côté obscur même pour celui qui le pratique, l’aveu, la confidence est nécessaire : « Il faut bien l’arracher,
et de force, puisque ça se cache. » (p. 89). Plus encore, la confidence, la révélation est « incomplète » : il faut
la jumeler à l’interprétation de ce qui est dit pour la comprendre; il faut la « décrypter ». Mais « celui qui
écoute », cette fois, « ne sera pas le maître du pardon, le juge qui condamne ou tient quitte; il sera le maître
de la vérité » (loc. cit.).
Tel était l’enjeu pour l’établissement d’une science de la sexualité : pour « produire des discours vrais sur le
sexe », il fallait, selon Foucault, aligner « l’ancienne procédure de l’aveu » sur les bases qui constituent notre
méthode scientifique. Pour la rendre fonctionnelle, nous sommes ainsi passés de l’aveu à « l’écoute clinique »,
ainsi que par tout un ensemble de « dispositif[s] complexe[s] » destinés à assurer la production sur le sexe de
« discours vrais » (p. 90-91).
1.2 Sexualité et scripts
Cette quête d’un discours « vrai » sur le sexe est encore valide aujourd’hui, bien des années après l’écriture
du tome III de l’Histoire de la sexualité de Foucault. Mais ce qu’il faut comprendre du legs philosophique de
Foucault, ce n’est pas simplement que pour arriver à un discours « vrai » sur le sexe, il faudrait le dépouiller
de tous les discours « autres » qui l’encombrent – cette tâche, bien plus que d’être loin d’être terminée, est
utopique. C’est que la sexualité est plus qu’une sphère d’activité « naturelle » qui existerait sous des couches
de discours imbriqués les uns dans les autres : elle est elle-même constituée de discours, en ce sens qu’en
tant que « construction culturelle », la sexualité est « apprise », comme le sont les interactions sociales de
tous les jours (Bozon : 2009, p. 7). Elle est donc inextricablement liée au contexte dans lequel elle intervient,
et elle est imprégnée, comme l’a montré Foucault, de discours normatifs qui sont internisés, appris, répétés
(loc. cit.).
14
Bozon (2009) explique à quel point les actes qui composent la sexualité sont appris et à quel point la sexualité
est ainsi socialement construite :
[L]a sexualité humaine implique […] la coordination d’une activité mentale, d’une interaction
sociale et d’une activité corporelle, qui doivent toutes être apprises. La sexualité est
doublement politique, parce qu’elle se construit à partir du contexte culturel où elle est
inscrite, et parce qu’elle contribue en retour à structurer les rapports sociaux dont elle
dépend en les "incorporant" et en les mettant en scène. […] La sexualité est une sphère
spécifique mais non autonome du comportement humain, qui comprend des actes, des
relations et des significations. C’est le non-sexuel qui donne sa définition au sexuel, et non
l’inverse. Nous sommes habitués à penser que beaucoup de nos comportements ordinaires
s’expliquaient par un inconscient sexuel, alors qu’il conviendrait d’abord d’identifier
l’inconscient social et culturel à l’œuvre dans notre activité sexuelle. (p. 7-8)
Cette conception de la sexualité comme quelque chose de non autonome, de non indépendant, n’a pas
toujours dominé dans les discours scientifiques : longtemps on a considéré le sexe comme étant donné,
préexistant à la culture et dont les « manifestations » trouvaient leur cause, leur explication ou leur origine
dans la biologie. On estimait, par exemple, que les « pulsions sexuelles » des hommes étaient « par nature »
plus importantes ou plus fortes que celles des femmes, et que les femmes étaient « par nature » plus douces
ou plus axées sur les caresses et la sensualité. Le changement d’un discours naturalisant à une approche
plus constructiviste de la sexualité s’est opéré dans la foulée des apports du mouvement féministe de même
que dans le contexte d’une transition dans la philosophie sociologique des années 1980, qui a peu à peu
reconnu un rôle plus actif aux acteurs sociaux (Simon et Gagnon : 2003, p. 494).
Parmi ceux qui ont contribué à opérer ce changement, les sociologues William Simon et John H. Gagnon ont
été de véritables « précurseur[s] » (Deschamps : 2009). Leur théorie des scénarios sexuels (« sexual
scripts ») a mis en lumière le caractère construit et « variable » de la sexualité et a marqué le champ de la
sociologie de la sexualité (Deschamps : 2009; Simon et Gagnon, op. cit., p. 494 et 491; Simon et Gagnon :
1998, p. 29).
Leur théorie des « scénarios » se pose en effet comme une « critique de la croyance que la sexualité possède
des fonctions sociales fixes » (2003, p. 492, trad. libre) :
While the commonsensical view of sex is that it is a spontaneous and ungovernable form of
behavior that presses against social norms, in our view the sexual takes on its shape and
meaning from its social character. (loc. cit.)
15
Selon les auteurs, les relations sexuelles constituent des actes « profondément sociaux » (loc. cit.) guidés par
les usages et les significations définis par les collectivités que les acteurs intériorisent, interprètent et mettent
ensuite en pratique (« reenact »). Ces « scripts » peuvent être conçus comme des « métaphores » qui
permettent de « conceptualiser les comportements du monde social », un peu à la manière de la syntaxe pour
le langage (1998, p. 29, trad. libre). Les « instructions » que comprennent ces scripts s’acquièrent de façon
complexe et ne trouvent pas leur application aux mêmes niveaux, qui sont cependant interreliés.
Simon et Gagnon identifient trois types de scénarios (ou de « scripts ») : les « scénarios culturels », les
« scripts interpersonnels » et les « scripts intrapsychiques ». Les premiers constituent les grandes lignes qui
guident les comportements de la vie collective en général; c’est par les scénarios culturels que différents
« rôles » peuvent être appris et intériorisés, et que des « qualités désirables » (p. 31) à rechercher chez les
autres et chez soi, communes à une population, sont intériorisées. Ces scénarios comprennent aussi une
« séquence » de gestes à produire et de paroles à répéter (p. 31); mais ces scénarios sont parfois si abstraits
ou si généraux qu’il est impossible de pouvoir les appliquer en toute circonstance (p. 29). Comme l’explique
Bozon, ces scénarios « sont des prescriptions collectives qui disent le possible mais aussi ce qui ne doit pas
être fait en matière sexuelle »; ils agissent un peu comme une « toile de fond symbolique du sexuel » (Bozon,
op. cit., p. 104-105). De façon peut-être plus importante encore, estiment Simon et Gagnon, ces scénarios
enseignent des suppositions (« assumptions ») quant aux sentiments que les acteurs et les partenaires
ressentent durant les rencontres sexuelles (1998, p. 31).
Les « scripts interpersonnels », plus concrets, plus structurés que les scénarios culturels, contiennent
également des séquences d’actes ritualisés, mais plutôt que d’être une « toile de fond », ceux-ci sont
actualisés, cimentés et adaptés par les acteurs; ce sont ces scripts « qui interviennent [concrètement] dans les
rencontres » et « qui coordonnent la réalisation pratique des rapports sexuels » (Bozon, op. cit., loc. cit.). En
caractérisant les attentes d’un partenaire comme de l’autre, les scripts interpersonnels « facilitent les
échanges sexuels », « réduisent l’incertitude » des acteurs et renforcent le sentiment de « légitimité » qu’ont
les acteurs de leurs comportements (Simon et Gagnon, op. cit., p. 31). Ces scripts sont parfois si efficaces que
seule « la représentation des sentiments appropriés » est nécessaire : « virtually for all, at one time or another,
desire will follow rather than precede behaviour. » (loc. cit.) Ces scripts, les acteurs ont le pouvoir de les
adapter; c’est d’ailleurs ainsi qu’ils prennent part aux scénarios culturels du monde collectif et qu’ils
parviennent à remplir certaines de leurs attentes ou certains de leurs buts personnels (p. 29).
Enfin, les scripts intrapsychiques sont ceux par lesquels les acteurs réorganisent symboliquement leur réalité
et se créent et nourrissent des désirs et des fantasmes (loc. cit.). Ces scripts intrapsychiques, à l’instar des
scripts interpersonnels, ne sont pas indépendants des scénarios culturels : ils leur sont liés intrinsèquement,
en ce sens que le désir est construit; ce n’est pas le désir qui « crée » ou qui « oriente » l’individu, mais
16
l’inverse : le désir, non réductible à un appétit ou un instinct, prend part à la création d’une représentation de
soi (« self ») en ce qu’il est imprégné de significations sociales (p. 30).
Quand les scénarios culturels sont congruents avec les scripts intrapsychiques, estiment Simon et Gagnon,
les comportements qui en résultent sont « symboliques » et « tout à fait dépendants des significations
partagées » : « The sexual takes a natural air obscuring that virtually all the cues initiating sexual behaviour
are embedded in the external environment. » (p. 31) Une divergence entre les deux devient une occasion pour
les acteurs de développer des significations qui s’éloignent de celles plus conventionnelles, tout en pouvant
tout de même devenir partagées : « private sexual cultures grow within the heart of public sexual cultures »
(p. 31).
Enfin, les trois niveaux de scripts, en ce qu’ils sont dépendants des sociétés dans lesquelles ils agissent, sont
à même d’évoluer avec le temps. Dans les sociétés traditionnelles, que Simon et Gagnon nomment
« paradigmatiques », les scénarios culturels sont relativement restreints et ritualisés; c’est-à-dire que les
acteurs partagent un très grand nombre de significations (p. 30). Avec l’évolution des sociétés, « les scénarios
culturels ont tendu à perdre de leur homogénéité et les normes sexuelles à aller moins de soi », ce qui s’est
accompagné d’une multiplication des scénarios culturels, d’une augmentation de la complexité des liens entre
les différents niveaux de scénarios et d’une nécessité pour les acteurs d’adapter de plus en plus les scénarios
disponibles (Bozon, op. cit., p. 105).
1.3 Sexualité et genre
Toutefois, si une évolution est possible, les scripts encouragent généralement l’imprégnation des aspects
conservateurs et stéréotypés des comportements sexuels (Simon et Gagnon, op. cit., p. 33). Au sein de ces
schèmes culturels stéréotypés, des variations peuvent se produire, mais elles surviennent généralement
« within the limits of a larger, stabilized body of scripts both interpersonal and intrapsychic. » (loc. cit.) Cet
ensemble de scripts « généraux », stabilisés et stéréotypés, est imprégné d’un rapport de pouvoir symbolique
que les chercheuses féministes et d’autres groupes de chercheurs nomment « le genre2 »; des rapports de
pouvoir divisent les rôles (sexuels et autres), les qualités, les traits typiques, les désirs attendus et même le
travail des acteurs sociaux selon leur sexe (Bereni, Chauvin et al. : 2008, p. 21).
2 Le concept du genre a pris différentes acceptions selon les époques. Si, dans les débuts des luttes féministes, on
s’accordait pour considérer le genre comme les caractéristiques socialement construites qu’on associait au sexe
anatomique, on a contesté plus tard cette conception qui perpétuait une opposition binaire entre les hommes et les
femmes. On utilise plutôt aujourd’hui le concept pour désigner le rapport de pouvoir qui organise cette division (Bereni,
Chauvin et al., op. cit., p. 16-22).
17
Bref, les interactions du monde du travail, de la sphère domestique et de la société en général sont ainsi
politiquement et culturellement chargées; ainsi, les hommes, les femmes, les adolescents et les enfants
tenteraient d’agir conformément à certaines normes sociales qui prescrivent les comportements
« acceptables » pour leur sexe, et ce, dans toutes les sphères de l’activité humaine (Bereni, Chauvin et al. :
2008, p. 76)3.
Ce système, puissant, est en un de subordination : il divise les hommes et les femmes et les oppose de façon
inégale, où les femmes et les valeurs socialement associées aux femmes sont « systématiquement
déconsidérées » (Bereni, Chauvin et al., op. cit., p. 6 et 21; voir aussi Héritier : 1996 et Delphy : 2001). Il s’agit
également d’un système répandu dans presque toutes les ethnies et les civilisations à travers l’Histoire et qui
perdure encore aujourd’hui. Si ce système est si fort, c’est qu’il fait habilement passer « l’arbitraire culturel »
pour du « naturel » (Bourdieu : 1998, p. 8) :
Les apparences biologiques et les effets bien réels qu’a produits, dans les corps et dans les
cerveaux, un long travail collectif de socialisation du biologique et de biologisation du social
se conjuguent pour renverser la relation entre les causes et les effets et faire apparaître une
construction sociale naturalisée (les « genres » [sic] en tant qu’habitus sexués) comme le
fondement en nature de la division arbitraire qui est au principe et de la réalité et de la
représentation de la réalité et qui s’impose parfois à la recherche elle-même. (ibid., p. 9)
Cette division entre les sexes, cette « opposition entre le masculin et le féminin » (p. 13), prend son apparence
« naturel[le] » ou « normal[e] » (p. 14) en ce qu’elle est insérée « dans un système d’oppositions
homologues : haut/bas, dessus/dessous, devant/derrière, droit/courbe, sec/humide […], dehors
(public)/dedans (privé) », etc. (p. 13). Cette division s’insère si bien dans l’ensemble des oppositions binaires
objectives qu’elle en paraît « inévitable », « dans l’ordre des choses » (p. 14), et semble donc ainsi légitime
(p. 15).
Dans cette division, l’homme est invariablement supérieur. Cette assomption est si forte, estime Bourdieu4,
qu’elle « se passe de justification » (p. 15); ainsi, « la vision androcentrique s’impose comme neutre et n’a pas
3 Bereni, Chauvin et al. diront qu’ « [i]l y a autant de socialisations de genre qu’il y a d’instances de socialisation » (ibid.).
4 Il importe ici de souligner que malgré la « lucidité » de Bourdieu envers « la dimension structurelle » des rapports
sociaux entre les hommes et les femmes et « le poids de la division du travail entre les sexes », celui-ci a été sévèrement
critiqué par plusieurs féministes pour n’avoir fait preuve, justement, que d’une lucidité très limitée sur le plan des apports
féministes concernant la subordination féminine (Devreux, dans Chabaud-Rychter et al. : 2010, p. 91). On lui reproche
également d’avoir exclu les femmes « du rapport social qui les opprime » et dont il a pourtant explicité le mécanisme, les
réduisant ainsi au statut de simples observatrices de ce rapport de pouvoir, bref au statut de « non-act[rices] » (loc. cit.).
Bien entendu, les femmes ont été dans l’Histoire et sont toujours des actrices et des agentes de changement, et par
18
besoin de s’énoncer dans les discours visant à la légitimer » (loc. cit.), à la différence des discours féminins et
féministes qui doivent constamment lutter pour être reconnus comme légitimes.
Cette opposition entre les hommes et les femmes semble d’autant plus justifiée qu’elle repose en apparence
sur un fondement biologique, soit « la différence anatomique entre les organes sexuels » (p. 16). Organes qui,
perçus comme étant opposés et complémentaires, se présentent comme une preuve incontestable de la
« naturalité » des différences pourtant culturelles entre hommes et femmes. Cette « naturalité » présumée
a été ardemment contestée par les études féministes, et c’est ce qui a motivé la distinction initiale entre
« sexe » et « genre », le genre étant alors entendu comme la manifestation sociale d’une différencialisation
entre les sexes. Le « sexe » est alors perçu comme biologique, et le genre, comme une construction sociale
différenciée.
Or, en faisant la distinction entre « genre » et « sexe » dans une tentative de « dénaturalisation du genre »,
nous aurions fait l’erreur de nous appuyer encore sur une perception binaire et opposée des sexes, ce qui
amène des féministes comme Judith Butler à estimer que le sexe anatomique est lui-même construit
socialement :
Originally intended to dispute the biology-is-destiny formulation, the distinction between sex
and gender serves the argument that whatever biological intractability sex appears to have,
gender is culturally constructed. […] The presumption of a binary gender system implicitly
retains the belief in a mimetic relation of gender to sex whereby gender mirrors sex or is
otherwise restricted by it. (Butler : 2006 [1990], p. 8-9)
Or, si le genre est ainsi distinct du sexe anatomique, « there is no reason to assume that genders ought also
to remain as two » (loc. cit.); en poussant plus loin la distinction entre sexe et genre, le genre est conçu
comme « flottant », en ce qu’il est indépendant du sexe, alors que le sexe est perçu comme étant une entité
fixe (loc. cit.).
Là où le bât blesse, c’est dans cette dernière perception du sexe comme un « donné », comme quelque chose
de « préexistant » à la culture, et dont la nature elle-même reste incontestée. Butler pose la question : « And
what is "sex" anyway? » (p. 9); peut-on réellement faire référence au concept de « sexe » sans d’abord
différentes tactiques se sont mobilisées contre leur domination. Foucault et Giddens ont aussi subi certaines critiques des
chercheuses féministes, Foucault pour n’avoir pas considéré spécifiquement les rapports de pouvoir entre les sexes,
malgré sa théorie de l’assujettissement (Riot-Sarcey, dans Chabaud-Rychter et al., op. cit.) et Giddens, similairement,
pour ne pas avoir situé la capacité d’agir des femmes dans le contexte des rapports de pouvoir genrés, « où le pouvoir
est avant tout masculin » (Jamieson et Wajcman, dans Chabaud-Rychter et al., op. cit., p. 111-119). Cependant, l’apport
de ces trois auteurs reste considérable dans leur champ respectif : leurs théories ont inspiré et jeté les bases de
nombreux concepts utilisés en études féministes et sont toujours amplement citées aujourd’hui.
19
interroger ses origines, son histoire, son implication dans les discours (loc. cit.)? En faisant la généalogie de la
conception du sexe, ne pourrait-on pas observer qu’il est lui-même variable, et donc construit?
If the immutable character of sex is contested, perhaps this construct called "sex" is as
culturally constructed as gender; indeed, perhaps it was always already gender, with
consequence that the distinction between sex and gender turns out to be no distinction at
all. (p. 9-10)
Ainsi le genre ne serait pas « l’interprétation culturelle » du sexe, mais le sexe serait lui-même une
interprétation culturelle (p. 10); ainsi, le sexe ne serait pas une instance « neutre », sans signification,
à laquelle on juxtaposerait le genre. Au contraire, cette perception du sexe comme antérieur au genre
constitue plutôt l’effet d’une construction culturelle qui le perçoit ainsi – et cette construction culturelle, c’est le
genre (ibid).
Ainsi, la croyance persistante selon laquelle le genre serait d’une certaine manière « causé » par le sexe, et
donc lui serait postérieur, est en soi naturalisante, même si cette conception se voulait au départ anti-
naturalisante :
Ainsi toute conception qui n’est pas résolument et radicalement antinaturaliste est
naturaliste et différentialiste, différentialiste parce que naturaliste et naturaliste parce que
différentialiste. Le paradigme du genre comme fondé sur le sexe s’inscrit donc dans une
philosophie entachée d’erreurs. (Delphy : 2001, p. 29)
Sans prétendre vouloir résoudre ici le débat sur l’antériorité du sexe sur le genre, puisque cela n’est pas notre
propos, il nous semblait important de souligner, pour la suite de notre travail, l’aspect intrinsèquement construit
du sexe, mais aussi par le fait même des caractères sexuels que l’on attribue généralement aux deux sexes.
Car le discours naturalisant des différences entre les hommes et les femmes ne s’arrête pas qu’au sexe
génital; toute une série de constructions sociales a, au cours de l’Histoire, inscrit les hommes et les femmes
dans deux rôles sexuels distincts, rôles que les scénarios sexuels ont cimentés dans les pratiques, soit
l’homme comme sujet désirant, et la femme comme objet de désir (Gagon et Simon, op. cit., p. 32). Comme le
souligne également Bozon (op. cit.) :
Ainsi le primat persistant du désir des hommes et la tendance à minorer celui des femmes,
à qui on ne prête souvent que des intérêts affectifs, ne découlent pas d’une logique
intrinsèque de la sphère sexuelle, mais sont un des aspects d’une socialisation de genre
inégalitaire, qui n’affecte pas seulement la sexualité. (p. 7-8)
20
Cette construction sociale véhiculée ou encore renforcée par les scénarios culturels et les scripts sexuels
a forcément une incidence majeure sur le pouvoir et les pratiques sexuelles des hommes et des femmes.
Cependant, si « le genre est partout » (Bereni, Chauvin et al., op. cit., p. 76), il ne détermine (ou ne
prédétermine) pas tout; les êtres humains, en ce qu’ils sont capables de réfléchir et de faire des choix, ne sont
pas des machines qui réitèrent les structures en place sans jamais les remettre en question; l’acquisition
d’habitudes et l’adoption de certains comportements sociaux sont infiniment plus complexes. Anthony
Giddens, qui s’est intéressé à la reproduction de telles structures, apporte un éclairage pertinent sur la
question, notamment sur les implications du concept-clé de notre étude, celui de l’agentivité.
1.4 Agentivité et structures sociales
Si, pour Foucault, le pouvoir s’exprime par les discours et est surtout l’apanage des institutions, pour Giddens,
le pouvoir est conçu comme étant tributaire de l’action. En d’autres mots, le pouvoir s’exprime à travers les
actions de la vie courante qu’accomplissent les membres de la société en tant qu’acteurs « compétents » (p.
41), c’est-à-dire en tant qu’acteurs possédant une « capacité réflexive ».
En effet, « [l]es agents humains, ou les acteurs – [Giddens] utilise ces termes de façon interchangeable –, sont
capables de comprendre ce qu’ils font pendant qu’ils le font; cette capacité est inhérente à ce qu’ils font. »
(Giddens : 2005 [1984], p. 33). Selon le sociologue, même si les « agents » ne sont pas toujours en mesure
d’expliquer par la parole ce pourquoi ils accomplissent certaines actions, ils comprennent de façon « tacite »
les raisons les poussant à faire ce qu’ils font. Cette « capacité réflexive de l’acteur humain », est, selon
Giddens, « constamment engagée dans le flot des conduites quotidiennes, dans les divers contextes de
l’activité sociale » (loc. cit.).
Ces connaissances « de base » (qui sont plus pratiques que théoriques [p.71]) sont d’ailleurs au cœur de ce
qui motive la pensée herméneutique moderne en sciences sociales, qui vise à habiliter ou à réhabiliter le
discours des acteurs :
[I]l existe une réciprocité d’interprétation, une « double herméneutique », entre les
scientifiques des sciences sociales et les sujets qui font partie de leurs objets d’étude. D’un
côté, les théories et les « découvertes » des scientifiques des sciences sociales ne peuvent
être tenues hors de l’univers des significations et des actions de ceux et celles qui en sont
l’objet. De l’autre, ces acteurs qui font partie des objets des sciences sociales sont eux
aussi des théoriciens du social, et leurs théories contribuent à la constitution des activités et
des institutions qui sont les objets d’étude des scientifiques des sciences sociales. Aucune
ligne de démarcation claire ne sépare les acteurs « ordinaires » des spécialistes lorsqu’il
s’agit de réflexion sociologique documentée. (Giddens, ibid., p. 43)
21
Ce « point de départ herméneutique » (p. 51) de la théorie de la structuration de Giddens repose sur la
prémisse que pour entreprendre une action, il est nécessaire de comprendre les implications de cette action,
du moins celles qui sont intentionnelles : « Une personne est un agent qui se donne des buts, qui a des
raisons de faire ce qu’il fait et qui est capable, si on le lui demande, d’exprimer ces raisons de façon
discursive (y compris de mentir) » (p. 51).
D’autre part, les actions qu’entreprennent les acteurs sont inévitablement ancrées dans le contexte temporel
et spatial de leur environnement social, et ne se conçoivent qu’à travers ce contexte et « la cohérence d’un soi
agissant » (p. 52).
Ces activités quotidiennes, même les plus routinières, réactualisent les structures sociales – c’est-à-dire que
ce sont les agents qui, par leurs actions, créent les structures et permettent leur réactualisation, et non les
structures qui « agissent » de façon contraignante sur les agents. Ainsi donc, les agents, par le fait même
d’entreprendre leurs activités quotidiennes, « reproduisent les conditions qui rendent ces activités possibles »
(p. 50).
Par leurs choix quotidiens, les acteurs « contrôlent […], de façon routinière, les dimensions sociale et physique
des contextes dans lesquelles ils agissent » (p. 54). En ce sens, une action se définit par le fait qu’un acteur
aurait pu « agir autrement » : « tout ce qui s’est produit ne serait pas arrivé sans son intervention » (p. 57).
C’est par ce choix, cette capacité d’action, qu’intervient le pouvoir :
Être capable d’ « agir autrement » signifie de pouvoir intervenir dans l’univers, ou de
s’abstenir d’une telle intervention, pour influencer le cours d’un procès concret. Être un
agent, c’est pouvoir déployer continuellement, dans la vie quotidienne, une batterie de
capacités causales, y compris celle d’influencer les capacités causales déployées par
d’autres agents. L’action dépend de la capacité d’une personne de « créer une différence »
dans un procès concret, dans le cours des événements. Un agent cesse de l’être s’il perd
cette capacité de « créer une différence ». (p. 63)
Bref, le pouvoir est inhérent à l’action, et « les règles » d’un système social peuvent être transformées ou
reproduites par son exercice. Par leur savoir pratique, les acteurs connaissent les règles du système de même
que les sanctions possibles qui leur sont associées; c’est d’ailleurs pourquoi Giddens estime que les règles
possèdent des « propriétés structurantes » (p. 72).
Cependant, « le structurel n’est pas que contrainte », estime Giddens; « il est à la fois contraignant et
habilitant » (p. 75). C’est en reproduisant certaines règles que les acteurs permettent le changement; en
d’autres mots, « les propriétés structurelles des systèmes sociaux sont à la fois le médium et le résultat des
22
pratiques qu’elles organisent de façon récursive » (loc. cit.). C’est ce que Giddens nomme « la dualité du
structurel ».
Bref, selon la perception de Giddens, l’acteur, par sa liberté d’action et ses connaissances des relations
humaines et des contraintes qui y sont parfois associées, est capable de contester des normes (p. 319) et
même de contrôler les activités d’autrui par la transformation de certaines structures (p. 79). Cette conception
de la capacité d’action des agents n’en est qu’une parmi de nombreuses autres d’auteurs de traités
philosophiques sur la question, mais elle est fondatrice de toute une ligne de pensée qui conçoit le pouvoir
comme étant propre aux acteurs – et non comme étant propre à des structures sociales qui, immuables ou
« extérieures » aux agents, régiraient leurs actions. Surtout, ici, elle nous sert de base pour discuter des
conceptions récentes de la capacité d’action des acteurs, concept que l’on nomme en anglais « human
agency ».
Le concept d’ « agency »5, que l’on peut traduire en français par « agentivité », n’est pas un concept fixe; au
cours de l’Histoire, le terme a pris différentes acceptions selon les approches théoriques (Hitlin et Elder : 2007,
p. 171). On s’entend toutefois en général pour dire que l’agentivité concerne la capacité d’action des individus
dans une situation donnée, et que son exercice peut rencontrer certaines contraintes. Emibayer et Mishe
(1998) définissent l’agentivité comme :
The temporally constructed engagement by actors of different structural environments […]
which, through the interplay of habit, imagination and judgment, both reproduces and
transforms those structures in interactive response to the problems posed by changing
historical situations. (p. 970)
Pour les auteurs, l’agentivité est fortement liée au contexte à la fois social, historique et situationnel.
Cependant, si la plupart des théoriciens s’accordent pour inscrire le concept dans une relation entre structure
et contraintes et s’entendent sur son importance théorique et empirique, ce n’est pas toujours le cas; certains
d’ailleurs clament que l’agentivité est un concept qui « romanticise » la capacité d’action des individus, et
d’autres encore estiment même qu’une telle conception de cette liberté n’existe pas (Hitlin et Elder, op. cit.,
p. 171).
Puisque notre propos n’est pas ici d’entrer dans un débat sur l’existence ou la non-existence de l’agentivité,
nous nous interrogerons plutôt, à l’instar de Berger (1991) et de plusieurs microsociologues, sur les façons
dont le concept peut s’exprimer – le « comment » plutôt que le « si » (Hitlin et Elder : 2007, p. 173).
5 Pour des suggestions sur la façon de traduire le terme « agency », voir Vidal (2006).
23
Or, avant de pouvoir discuter de ses manifestations, il importe de définir un peu plus clairement les limites et
les lignes directrices du concept d’agentivité, que plusieurs auteurs estiment « floues » et même, selon les
différentes définitions, contradictoires (Hitlin et Elder : 2007, p. 171; Emibayer et Mische : 1998, p. 962).
Si Giddens définissait le concept d’agentivité comme une « capacité d’agir » des individus malgré des
structures parfois contraignantes qu’ils pouvaient ou non réifier, le concept d’agentivité tel qu’il est souvent
utilisé aujourd’hui ratisse beaucoup plus large; Giddens, tout comme Bourdieu (1977), d’ailleurs, s’est
intéressé surtout aux activités routinières. Ainsi, il concevait l’agentivité comme une expression habituelle et
répétitive de la liberté d’agir des acteurs. Or, le concept s’applique aussi lors de situations beaucoup plus
complexes et problématiques où les acteurs doivent étudier plusieurs options et faire des choix complexes
(Emibayer et Mische, op. cit., p. 971 et 963). Et si les structures qui fondent les bases de la vie sociale sont
dynamiques, l’environnement dans lequel un acteur effectue des choix ou exerce son agentivité est également
changeant – plus encore, l’acteur lui-même change, que ce soit en fonction de son passé ou encore en
fonction du futur qu’il envisage (loc. cit.; voir aussi à ce sujet Mead : 1959 [1932])
Ce rapport complexe entre l’acteur, l’action et les structures sociales rend difficile l’atteinte pour les théoriciens
d’une conception unifiée de l’agentivité. Sans avoir la prétention de pouvoir y parvenir, Steve Hitlin et Glen H.
Elder, Jr. (op. cit.) ont effectué une recension colossale des écrits sur le sujet et ont entrepris de distinguer les
orientations théoriques qui y étaient adoptées. Ils sont parvenus à discerner quatre types d’agentivité :
l’agentivité « existentielle », l’agentivité « identitaire », l’agentivité « pragmatique » et l’agentivité qui
s’intéresse au « cours de la vie »6 (« lifecourse »). (Il est à noter que ces distinctions ne sont pas tout à fait
mutuellement exclusives et chevauchent également d’autres distinctions faites en d’autres domaines, comme
en psychologie sociale [p. 171]). Nous les décrivons rapidement ici :
1) L’agentivité de type « existentielle » fait référence à la capacité des acteurs d’adopter ou non certains
comportements à un niveau fondamental, c’est-à-dire à la capacité « même » de contrôler leurs actions. Cette
capacité, selon Hiltin et Elder, est toutefois « of less interest than its social dimensions and consequences »
(p. 177). C’est que cette capacité, en tant qu’elle est le fait d’humains situés socialement, se distingue de la
perception des acteurs de leur capacité d’action. C’est pourquoi certains auteurs différencient l’agentivité d’un
autre concept cousin : l’efficacité personnelle (self-efficacy). Albert Bandura (2003 [1997]), qui en est
l’instigateur, considère l’efficacité personnelle ou l’auto-efficacité (ce sont des synonymes) comme le « facteur
clé de l’agentivité humaine » (p. 13). Ainsi, non seulement l’agentivité est-elle dépendante de l’efficacité
personnelle, mais celle-ci en fait en quelque sorte « partie ». L’agentivité, selon Bandura, est le « pouvoir
6 Trad. libre.
24
d’être à l’origine d’actes visant des objectifs définis », alors que l’efficacité personnelle fait référence aux
croyances de l’acteur face à son pouvoir :
Les gens efficaces savent rapidement se servir des structures leur fournissant des
occasions d’agir et imaginent des moyens de contourner ou de modifier les contraintes
institutionnelles par l’action collective. Inversement, les personnes inefficaces sont moins
aptes à saisir les occasions fournies par la société et sont facilement découragées par les
obstacles institutionnels. (p. 17)
Certains pourraient rapprocher le concept d’efficacité personnelle à celui de l’estime de soi, mais Bandura en
fait encore une fois une distinction : « L’efficacité personnelle perçue concerne les évaluations par l’individu de
ses aptitudes personnelles, tandis que l’estime de soi concerne les évaluations de sa valeur personnelle. »
(p. 24) Une telle distinction ramène clairement l’efficacité à l’action et à l’agentivité, alors que l’estime de soi
est plus « interne », plus psychologique. Si les deux concepts semblent en apparence entretenir des liens,
selon Bandura, ils n’agissent pas au même niveau :
Les individus ont besoin de beaucoup plus qu’une estime de soi élevée pour agir
conformément à leurs objectifs. Beaucoup de personnes performantes sont dures envers
elles-mêmes parce qu’elles se fixent des standards difficiles à atteindre, tandis que d’autres
peuvent ressentir une estime de soi élevée parce qu’elles n’exigent pas beaucoup d’elles-
mêmes ou qu’elles tirent leur estime de soi d’autres sources que les réussites personnelles.
Une bonne estime de soi ne conduit donc pas toujours à de bonnes performances. (p. 24-
25)
L’efficacité personnelle, ainsi, gère autre chose que l’estime : elle « régul[e] les aspirations, les choix de
comportement, la mobilisation et la poursuite de l’effort ainsi que les réactions émotionnelles. » (p. 14) Bref,
pour faire preuve d’agentivité, il faudrait d’abord croire en ses propres capacités d’en exercer, considérer
divers moyens pour atteindre ses objectifs et agir.
2) L’agentivité de type « lifecourse » réfère, pour sa part, à la capacité des individus de formuler des « plans
de vie », en lien avec la formation professionnelle par exemple, et de mettre ces plans en œuvre (Shanahan et
Elder : 2002, p. 147).
3) L’agentivité « pragmatique » est celle qui agit dans des situations nouvelles, problématiques, qui sortent
des habitudes. Lorsqu’une situation imprévue surgit, nous devons réagir; les actions que nous décidons
spontanément d’entreprendre sont alors guidées par nos valeurs, notre conception de nous-même, et notre
capacité à être réflexifs et créatifs :
25
We are not dispassionate, analytical actors. We make choices within the flow of situated
activity, and emotions and personality traits – along with idiosyncratic personal histories,
moral codes, and predispositions – influence the choices we make in emergent situations.
(Hitlin et Elder, op. cit., p. 178)
Le courant qui étudie ce type d’agentivité s’intéresse plus au « soi », comparativement à d’autres courants
plus centrés sur l’aspect social des interactions. Il est basé sur la prémisse que nos actions ne sont pas
complètement aléatoires – si elles l’étaient, « much social science would be untenable » (p. 178). Ce courant
met en lumière le fait qu’il se produit incessamment une interaction – ou du moins un jeu – entre l’aspect
socialisé et appris des actions, et l’aspect spontané qui traite cette construction par le biais de la personnalité
(loc. cit.). Cette interaction (que Hitlin et Elder nomment « interplay ») engage la façon dont nous nous
percevons de même que nos valeurs morales et nos émotions, qui elles-mêmes sont en partie socialement
construites (p. 178-179)7. Sur un axe temporel, cette conception de l’agentivité s’intéresse principalement aux
buts à court terme et aux choix effectués dans l’immédiat.
4) Enfin, l’agentivité « identitaire » (« identity agency ») est celle qui se rapproche le plus de la conception de
Giddens des actes routiniers. Elle fait référence aux comportements exécutés dans certaines situations
typiques et normées, voire considérées comme « acquises » : le fait d’agir comme une mère lorsqu’on est
mère, par exemple. Ce type d’action requiert un engagement de la part de l’individu envers les normes : on
agit comme on attend de nous que l’on agisse. Le fait de se conformer à une certaine identité imprégnée des
scripts sociaux bien définis (celui de l’épouse, de la mère, de la professeure, du client, par exemple) comporte
donc ainsi un choix, qui est celui d’adopter (ou non) un comportement social inhérent à certains rôles, de
participer à leur réitération et donc ainsi de leur accorder de la crédibilité (Manning : 2000; Hitlin et Elder, op.
cit., p. 181). Ainsi, même le fait de suivre la norme (ou des rôles sociaux de genre) impliquerait
nécessairement un certain degré d’agentivité et de « libre arbitre » (Hitlin et Elder, op. cit., p. 179).
Malgré l’intérêt marqué d’Hitlin et Elder pour la question de la temporalité dans la conception de l’agentivité,
les distinctions qu’ils proposent sont utiles en ce sens qu’elles parviennent à jeter les bases d’une conception
s’appuyant sur des traditions théoriques précises. Elles permettent aussi d’établir une « cartographie » des
différentes orientations que peut prendre le concept. Mais si les limites du concept d’agentivité semblent
toujours grandissantes ou variables (nous verrons qu’il peut s’appliquer en de nombreux contextes), c’est
d’ailleurs parce qu’il est justement hautement complexe, dynamique et interdisciplinaire : on le retrouve
exprimé ou réprimé en toute forme d’action sociale, et se manifeste pour chacune d’elle à plusieurs niveaux.
7 Pour des lectures plus ciblées sur le concept de « soi », voir Mead (1959 [1932] et 1938) ou Hewitt (1989).
26
Par ailleurs, l’agentivité peut être étudiée selon deux approches qui, bien que différentes, auraient intérêt,
selon Hitlin et Elder, à être complémentaires, soit l’approche empirique et l’approche théorique. En effet, selon
ces auteurs, les théoriciens qui se sont risqués à définir l’agentivité ont jusqu’ici trop souvent négligé de mettre
à l’épreuve empirique leurs théories, alors que certains chercheurs empiriques ont parfois eu tendance
à éluder l’aspect théorique et ainsi à dépeindre des visions un peu trop simplifiées de l’agentivité (p. 173).
C’est pourquoi ces deux auteurs mettent l’accent sur l’importance de s’ancrer à la fois dans le domaine
empirique et théorique, mais peut-être surtout dans le domaine empirique :
Discussions of agency can fail to anchor the concept in lived experience, referring to it with
a-situational abstractions. The more removed a discussion about humans is from actual
human experience, the more slippery the idea of agency becomes. (p. 175)
Hitlin et Elder rappellent par ailleurs que la définition du concept pourrait bénéficier également de la richesse
théorique d’autres domaines, comme celle de la psychologie sociale sur le « self », car elle permet alors
d’ancrer la théorie du social et des structures dans une tradition solide et utile sur la façon dont les humains
interagissent avec leur environnement (p. 185).
1.5 Agentivité et genre
Nous avons mentionné, à la section précédente, que même le fait de suivre la norme implique un choix
agentique. Ce point nous semble important, car il se rapproche de ce que Butler appelle « la performativité du
genre ». Lorsque Butler s’appuie sur la citation désormais célèbre de Simone de Beauvoir, « on ne naît pas
femme, on le devient », elle estime que dans sa formulation se trouve de façon implicite la manifestation d’un
agent, « who somehow takes on or appropriates that gender and could, in principle, take on some other
gender » (2006 [1990], p. 11). Une appropriation qui, nécessairement, implique un choix. Mais un choix qui,
par la socialisation différenciée par exemple, semble être fortement contraint : « Is gender as variable and
volitional as Beauvoir’s account seem to suggest? Can "construction" in such a case be reduced to a form of
choice? » (loc. cit.)
C’est que le débat, dit-elle plus loin, sur la signification du terme « construction » est ancré solidement dans
une polarité philosophique entre « libre arbitre » et « déterminisme »; un débat qui sous-tend d’ailleurs les
approches théoriques que nous avons présentées jusqu’ici. Si (ou même si) le genre est construit, et même le
corps, comme on l’a vu, comment quelqu’un peut-il « choisir » un genre, et s’approprier les structures en place
d’une façon qui lui convienne alors que la socialisation des parents, de l’école, des médias, et de la société en
général tendent à contraindre ce choix à une division binaire? Y a-t-il alors vraiment un choix, une agentivité
de genre?
27
Butler répond à cette question en pensant le genre comme une performance (un « agir », et donc un choix),
mais une performance « réitérée » qui est traversée par les normes, voire qui en est constituée :
[T]he social norms that constitute our existence carry desires that do not originate with our
individual personhood. This matter is made more complex by the fact that the viability of our
individual personhood is fundamentally dependent on these norms. (ibid., p. 1-2)
Cependant, cette appropriation d’un genre n’est pas prédéterminée, ni simplement mécanique :
If gender is a kind of doing, an incessant activity performed, in part, without one’s knowing
and without one’s willing, it is not for that reason automatic or mechanical. On the contrary,
it is a practice of improvisation within a scene of constraint. (2004, p. 1)
Cette improvisation, c’est le lieu de libre arbitre de l’acteur, qui joue un rôle à l’intérieur des structures en
place. Si on ne peut nier la force des normes ni le pouvoir d’action des individus, on ne peut que constater la
complexité du jeu dynamique entre les deux, que seules des études ancrées autant dans la philosophie du
social que dans des approches plus pratiques semblent avoir le potentiel d’éclairer.
L’apport de Butler vient ici compléter et complexifier la question de l’agentivité définie par Giddens, car comme
l’indique la critique féministe qui lui a été adressée, la relation n'est pas entre deux égaux : « la capacité d'agir
des femmes dans la négociation des rapports hétérosexuels est toujours restreinte par les continuités de la
masculinité contemporaine. » (Jamieson et Wajcman, dans Chabaud-Rychter et al., op. cit., p. 113) En
d’autres termes, comme la capacité d’agir des femmes est nécessairement soumise aux contraintes sociales
du patriarcat, les deux sexes ne développent et n’exercent pas leur agentivité selon les mêmes modalités.
1.6 Rappel des points importants
Nous avons vu jusqu’ici plusieurs éléments qui constituent la pierre d’angle de notre posture théorique. Il peut
être utile de les résumer ici :
La sexualité est constituée par les discours. Hors discours, elle n’existe pas (Foucault : 1994 [1976]).
En d’autres termes, il n’existe pas de sexualité « tout court » (Padgug : 1979, dans Parker et
Aggleton : 2007 [1999], p. 18).
La sexualité, le sexe comme le genre sont construits socialement (Bourdieu : 1998; Butler : 2006
[1990], Delphy : 2001, Simon et Gagnon: 1998, 2003; Bozon : 2009).
28
Les structures sociales n’agissent pas « sur » les individus, mais ce sont eux qui créent ces
structures et qui agissent contre elles (Giddens : 2005 [1984]). Une telle conception permet de
prendre en compte la liberté des acteurs : « Certes, le soi est socialement constitué mais, exerçant
une influence sur eux-mêmes, les individus contribuent partiellement à ce qu’ils font et à ce qu’ils
deviennent. » (Bandura, 2003 [1997], p. 18).
Le concept d’« agentivité personnelle » fait référence à cette influence qu’ils peuvent exercer, cette
capacité d’action.
Il s’instaure un rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes, et ce rapport vient teinter
l’acquisition, le développement et l’exercice de l’agentivité des deux sexes.
L’agentivité peut prendre différentes orientations sémantiques et s’appliquer dans différents domaines,
dont la sexualité. Elle prend alors l’appellation d’ « agentivité sexuelle », un concept que nous définissons
au prochain chapitre. Nous nous intéresserons particulièrement à l’agentivité sexuelle des jeunes femmes
et des adolescentes, et nous montrerons comment celle-ci peut être contrainte par les structures sociales,
notamment celles des rapports sociaux de sexe qu’exprime le concept de genre. Nous situerons ensuite
le concept d’agentivité dans les nombreux débats qui ont cours sur son utilisation. Nous discuterons des
différentes façons de l’opérationnaliser, notamment dans les études empiriques récentes sur la sexualité,
et nous fournirons quelques pistes de réflexion en vue de son opérationnalisation dans notre propre
étude.
2 Agentivité sexuelle8
Nous avons vu que le concept d’agentivité peut prendre plusieurs orientations. Mais au-delà de ces différentes
dimensions, le concept d’agentivité peut servir dans une multitude de domaines de recherche, du plus large au
plus précis. Bandura (op. cit.), par exemple, a appliqué son concept d’efficacité personnelle à plusieurs
domaines : la santé (dépression, obésité, toxicomanie, anxiété), le sport (gestion du stress chez les sportifs,
perception des performances sportives), la profession, etc. Il a aussi développé le concept « d’agentivité
morale » (1986, 2002), entendu comme la capacité d’agir et de prendre des décisions de façon raisonnée et
responsable envers son prochain. Le concept d’agentivité morale fait ainsi référence à la capacité d’intégrer
certaines valeurs morales et d’agir en concordance avec celles-ci, et donc de prendre une certaine forme
d’engagement. Le concept, utile, peut s’appliquer en différents domaines; il a servi notamment dans
l’élaboration du cadre théorique d’une recherche portant sur les comportements des personnes atteintes du
VIH (O’Leary et Wolitski : 2009).
Toutefois, le domaine où participe le concept d’agentivité qui nous intéresse ici est celui de la sexualité, et
particulièrement celui de la sexualité des filles. L’orientation que prend le concept – l’agentivité sexuelle
(sexual agency) – peut parfois prendre alors une posture quelque peu militante. En ce sens que puisque la
sexualité constitue un lieu social fortement imprégné du rapport de pouvoir qu’est le genre, ceux qui jusqu’ici
ont utilisé et développé le concept d’agentivité sexuelle se sont attardés à la façon dont les hommes et les
femmes sont capables d’exprimer des désirs et d’entreprendre des actions qui les rapprochent un peu plus
d’un rapport égalitaire entre les sexes. Non pas « militante » dans le sens d’un parti-pris envers les filles ou
d’une posture théorique ou méthodologique qui les considère d’emblée comme des victimes, mais
« militante » dans un sens qui se rapproche d’un souhait – un meilleur équilibre – et qui vise à décrire et
observer le positionnement d’acteurs contemporains dans – pour emprunter l’expression de Lise Payette –
« le chemin de l’égalité » (1996). Le but est d’observer les points forts de la nouvelle génération et de décrire
les zones responsables de certaines difficultés, le tout dans une perspective éclairée par les études sur le
genre.
Car si, par le fait du patriarcat, les hommes profitent traditionnellement d’un pouvoir qui leur est attribué
d’office, et ce, dans toutes les sphères sociales, y compris celle de la sexualité, ce pouvoir a un effet sur
l’agentivité personnelle et sexuelle des femmes, et même sur sa reconnaissance. Les filles, par exemple, sont
souvent victimes d’un double standard qui fait qu’elles sont souvent perçues comme étant plus naïves ou plus
8 Une partie de ce chapitre est déjà parue dans Lang, Marie-Eve, 2011, « L’agentivité sexuelle des adolescentes et des
jeunes femmes : une définition », Recherches féministes, vol. 24, n° 2, p. 189-209.
30
innocentes que leurs confrères masculins et que leurs décisions sont considérées comme « plus à risque » ou
« problématiques » que celles des garçons (Philips : 2000, p. 21).
Il en va de même pour les adolescents en général : à cause de leur âge, les jeunes se voient parfois dérobés
de la reconnaissance de leur agentivité (personnelle), alors qu’eux-mêmes reconnaissent en avoir une
certaine part, et qu’ils font une distinction nette entre leur capacité d’agentivité et celle des enfants, bien qu’on
place trop souvent les deux groupes d’âge dans le même panier (Smette et al., op. cit.). De nombreux auteurs
s’accordent pour dire qu’il est pourtant « essentiel » de reconnaître les jeunes comme une catégorie en elle-
même, puisqu’ils sont contraints par des structures sociales particulières différentes de celles des adultes, et
parce qu’ils sont aussi des agents agissant à la fois contre ces structures et à l’intérieur d’elles (Barter : 2009,
p. 214, James et al.: 1998 et Mullender et al.: 2002). Plus encore, la recherche de Smette et al. (2009) indique
qu’il est même préférable de faire la distinction entre des adolescents « plus âgés » (16-17 ans) et des
adolescents plus jeunes (12-13 ans), puisqu’eux-mêmes y voient une nette différence (p. 360-361).
Pour bien comprendre comment l’agentivité des jeunes femmes et des adolescentes peut s’exprimer dans le
contexte de leur sexualité, il importe d’abord de définir ce qu’est l’agentivité sexuelle, et de montrer ce
qu’implique cette définition pour les filles et les femmes. Ce chapitre vise à fournir des pistes d’une telle
définition. Nous allons voir que le concept d’agentivité sexuelle n’est pas fixe, et qu’ainsi il est difficile de le
rendre opérationnel en déterminant à l’avance les comportements qui témoignent de son expression. Nous
ferons aussi le portrait de différents débats qui ont présentement cours quant à son utilisation, et nous
tenterons de prendre position.
2.1 Agentivité sexuelle : lignes directrices d’une définition
Comme nous l’avons vu, le concept d’agentivité réfère à la capacité d’agir de façon compétente, raisonnée,
consciencieuse et réfléchie (Smette et al.: 2009, p. 370). Bref, il renvoie, d’une part, à l’idée d’action, et à l’idée
de responsabilité, d’autre part – on démontre donc une part d’agentivité lorsqu’on se sent « agent » de ses
propres actions (Bulot et Delevoy-Turrelu : 2007, p. 603). Le concept d’agentivité sexuelle – relativement
récent et de plus en plus utilisé dans les études sur le genre et sur les jeunes – fait référence à la capacité des
hommes et des femmes de prendre en charge leur propre sexualité et de l’exprimer de façon positive. Plutôt
que de porter sur la responsabilité envers autrui, comme dans le cas de l’agentivité morale, le concept
d’agentivité sexuelle fait référence au respect de soi-même, de ses valeurs et de ses désirs; donc au respect
de sa propre intégrité.
L’agentivité sexuelle renvoie aussi aux idées de « possession » de son propre corps et de l’expression de sa
sexualité – en termes simples, se sentir « agent » de sa sexualité (Slavin et al.: 2006, p. 267). Elle réfère à la
prise d’initiative, à la conscience du désir et au sentiment de confiance et de liberté dans l’expression de sa
31
sexualité (Averett et al. : 2008, p. 332). Les notions de « contrôle » ainsi que du sentiment d’avoir « droit »
(« to feel entitled ») au désir et au plaisir sont également centrales; dans une recherche sur le comportement
des femmes homosexuelles dans un « bath house » gai (lieu où on peut avoir des relations sexuelles avec
des inconnus), Hammers (2009) discute avec ses participantes de sexual agency, et ce sont ces termes qui
reviennent le plus souvent. « The women are […] taking control of their bodies more. It seems to be more
[…] "I am in charge of me, myself and my body and what I want and don’t want," » explique l’une des
répondantes (p. 168).
L’idée de contrôle de son corps est une revendication fondamentale du mouvement féministe, non seulement
en ce qui a trait à la contraception et à l’avortement, mais aussi en ce qui a trait à la sexualité. Dans les
années 70 est d’ailleurs paru Notre corps nous-mêmes (1977), un collectif de Boston rapidement traduit en
français, qui a marqué les femmes québécoises durant ces années en proposant une critique radicale des
normes sexuelles. Comme le mentionne Alisa Del Re dans Hirata, Laborie et al. (2000) :
La reconnaissance du droit à disposer de son corps a constitué un événement majeur pour
les femmes du XXe siècle. Depuis la grève des ventres du XIXe siècle, cette revendication
a fait l’objet de nombreuses batailles, perdues ou partiellement gagnées. Elle est
unanimement portée, à l’échelle internationale, par les mouvements féministes des années
1970. Qui a le pouvoir de contrôler le corps féminin : l’État, les autorités religieuses, les
corporations de médecins, le chef de famille (mari ou père), ou les intéressées? Il s’agit là
d’un point décisif, car il y va de l’autonomie des femmes. En exigeant que ces dernières
aient la maîtrise de leur sexualité et en refusant que le débat ne soit renvoyé à la sphère
privée – qui tend à culpabiliser les rapports interindividuels –, le mouvement féministe
a conféré une dimension politique à cette question. (p. 1)
Cette prise en charge de son propre corps et de son propre plaisir donnerait l’occasion d’apprécier une
sensation de pouvoir (« to feel empowered ») sur la situation de même que sur son corps (« body
ownership »), et ce, sans sentiment de honte ni impression de devoir s’excuser (p. 781). Il y a donc une notion
de confort et d’aisance dans l’idéal visé par le concept d’agentivité sexuelle (« [the feeling of being]
comfortable in [your] skin ») (Hammers, op. cit., p. 781).
La notion de pouvoir telle que l’a définie Giddens y est également intrinsèque. Albanesi (2009 et 2010), dans
son étude sur la façon dont certains hommes et certaines femmes font preuve ou évitent de faire preuve
d’agentivité sexuelle, définit celle-ci par « la volonté d’exercer du pouvoir dans le cadre d’une relation
sexuelle » :
I define sexual agency as the willingness to exert power within a sexual encounter in an
attempt to sway the outcomes of events (2010, p. 10).
32
Albanesi distingue donc très clairement le fait d’exercer réellement du pouvoir de la capacité seule d’exercer
du pouvoir. Selon l’auteure :
While all individuals have the capacity to exert power – if an individual desires a specific
outcome but she or he makes no attempt to affect that outcome – I do not define the
capacity alone, as agentic. (loc. cit.)
Il y a donc l’idée d’action dans la définition de l’agentivité sexuelle; c’est d’ailleurs ce qui différencie le concept
de son très proche cousin, le fait de se sentir « sujet » sexuel (par opposition à « objet » sexuel). Tolman
définit la « subjectivité sexuelle » par le fait de se sentir « sujet » sexuel, d’avoir l’impression d’avoir droit au
plaisir sexuel et de faire des choix en matière de sexualité; bref d’avoir une identité en tant qu’être sexuel
(2002, p. 5-6). Les deux concepts sont donc très proches. Ils ne sont par ailleurs pas exclusifs : celui de
« sujet sexuel » comprend, par exemple, l’idée d’empowerment9, mais il nous semble que le concept
d’agentivité ratisse plus large : il fait référence au fait de « régir » sa propre sexualité et de s’en sentir
« responsable », élément important à la fois pour définir ses désirs et ses limites :
Sexual agency is not simply about expanding sexual boundaries and saying "yes" to desire;
rather, it is also about shaping your boundaries as you see fit so that to not act, to say "no",
or to be able to negotiate the terms while in the encounter are possible. (Hammers : 2009,
p. 782)
Car l’agentivité sexuelle ne se limite pas à l’agir, mais renvoie également à l’idée de se sentir et se savoir
auteur de ses actes : ainsi, le fait d’adopter une attitude passive ou soumise ou encore de rejeter le blâme et
la responsabilité de sa participation sexuelle sur son partenaire sont tous deux signes de comportements non
agentiques (Albanesi : 2009)10.
2.1.1 Agentivité et le courant « Just Say No »
Selon Averett et al. (2008), l’agentivité sexuelle peut s’exprimer dans le fait de refuser de participer à des
actes sexuels. Or, pour qu’un comportement soit qualifié d’agentique, il est doit être exercé sur des bases de
9 Le concept d’empowerment est ambivalent et on ne s’entend pas sur sa définition. Il fait généralement référence au fait
de se sentir investi ou investie d’un certain pouvoir décisionnel et, en même temps, de l’être réellement. Pour différentes
interprétations du concept d’empowerment et pour une discussion sur ses liens avec les autres concepts proches
(agentivité sexuelle, subjectivité sexuelle, sexual self-efficacy, etc.), voir Peterson (2010).
10 Dans le cadre d’une sexualité saine et libre d’abus.
33
confiance et de liberté. Si une personne refuse certains actes parce qu’elle sent une pression sociale de dire
« non », le refus est loin d’être agentique. Le courant américain qui incite les jeunes filles à « simplement dire
non » (« Just Say No ») n’encourage pas les adolescentes à baser leur décision sur leur intention, leur désir,
leur volonté ou leur intuition, mais tente d’induire chez elles le réflexe d’une réponse qui serait toujours
négative, que ce soit pour les protéger ou parce qu’il est mal vu qu’une fille de leur âge soit active
sexuellement (p. 332). Ainsi, selon Averett et al., si l’abstinence peut être une forme d’agentivité sexuelle, le
simple fait de dire « non » ne l’est pas. Il y a donc une distinction à faire entre le comportement en tant que tel
et les motifs qui justifient et guident la décision d’adopter le comportement en question (p. 332; voir aussi
Albanesi : 2009).
À cet égard, l’exercice de l’agentivité sexuelle s’oppose, pour les femmes et les filles, au rôle social qui leur est
traditionnellement associé, soit celui de l’asexualité (Averett et al.: 2008, p. 336). Les femmes et les filles
ressentent en effet une forte pression sociale qui leur prescrit « d’éviter à tout prix d’être perçues comme des
putes » (Averett et al.: 2008, p. 336), sans quoi elles risquent de perdre le respect social (p. 340). Elles sont en
effet victimes d’un double standard qui s’avère être beaucoup plus permissif pour les garçons et pour les
hommes. Ce double standard se manifeste entre autres dans les attentes parentales entre frères et sœurs
(Averett et al.: 2008, p. 336) et dans le discours social qui prescrit aux filles de rester vierges le plus longtemps
possible et de contrôler et restreindre l’appétit sexuel des hommes.
L’idée que la sexualité devrait être restreinte au contexte d’une relation amoureuse stable et sérieuse est
d’ailleurs fortement associée aux femmes et aux filles, comme si les hommes n’avaient pas autant à s’en
soucier (Averett et al.: 2008, p. 336; Gilmartin : 2006, p. 430). Plus encore, les filles sont élevées avec l’idée
que la sexualité est quelque chose qu’il faut craindre et qu’ainsi il ne faut ni vouloir, ni avoir, ni apprécier les
relations sexuelles (p. 340).
L’agentivité sexuelle est donc un concept qui est intrinsèquement lié au concept de genre, tel que défini en
sciences sociales, et aux rapports de pouvoir qu’il sous-tend. La section qui suit tente d’apporter un certain
éclairage sur l’implication de ces rapports dans le développement de l’agentivité sexuelle des adolescents et
des adolescentes.
34
2.1.2 Agentivité et le discours sur la dangerosité et la vulnérabilité
« There were times when my boyfriend and I were having
sex and I was thinking "I shouldn’t be doing this." …
It really made it hard to distinguish what felt right. »
(Susanna, dans Gilmartin : 2006, p. 446)
La sexualité adolescente est souvent pathologisée en recherche et dans la vie courante. On la considère
d’emblée comme étant problématique et comme un élément incontournable du développement qu’il importe
de contrôler (Averett et al.: 2008, p. 331, Chilman : 1990, p. 123, Caron : 2009). La sexualité des filles,
particulièrement, suscite beaucoup d’inquiétude de la part des parents, des chercheurs et de la société.
Souvent perçues comme étant « vulnérables » devant le désir masculin, considéré comme inévitable et
naturel, les filles sont élevées avec la mentalité que ce sont elles qui doivent contrôler des relations sexuelles,
et donc restreindre leur avènement en repoussant le jour où le couple aura des relations sexuelles. Elles
apprennent à être passives. Or, la passivité sexuelle est l’opposé de l’agentivité sexuelle (Averett et al.: 2008,
p. 336).
Selon la pensée féministe, si les discours nous constituent, les discours de genre et de différenciation
sexuelle, eux, nous constituent en êtres « sexués » (Finney : 2001, p. 22). Les discours phallocentriques et
hétérosexistes, quant à eux, renforcent l’idée que le genre est binaire, et, partant, composé d’attributs qui
seraient complémentaires (p. 22 et 23; l’auteure se base entre autres sur des réflexions de Scott : 1988 et de
McNay : 1993).
Or, comme on l’a vu, en plus d’être opposés, les attributs de sexe (ou de genre) sont inégalitaires et
hiérarchisés; c’est d’ailleurs le sexe féminin qui est considéré comme inférieur et faible (loc. cit.).
En ce qui concerne la sexualité, le discours hégémonique poserait les jeunes filles comme des objets sexuels,
et les hommes en « objets d’amour » (love objects), en ce sens qu’ils nécessitent une conquête – conquête
qui s’organise en fonction de l’attirance corporelle des filles (Finney : 2001). Le désir est ainsi unidirectionnel :
il est l’apanage des hommes, ce qui place les filles et les femmes dans une situation où elles doivent
« marchander » leur corps et leur sexualité en échange d’amour ou de l’engagement de l’homme.
Déjà en 1988, Michelle Fine observait que le discours sur le désir des adolescentes était absent dans les
écoles et les curriculums de cours. À la place, on promouvait un discours qui encourageait la victimisation des
filles et qui, paradoxalement, les considérait comme responsables de contrôler et de restreindre les relations
sexuelles de par l’insistance sur l’abstinence et la mentalité du Just say no. Plus encore, un discours de
moralité sexuelle ajoutait une dimension propice au regret et au jugement, encourageant les décisions des
filles que si elles repoussaient la sexualité dans les limites du mariage (p. 29-32).
35
Selon Teitelman et al. (2008), les jeunes filles seraient encore plus sensibles à ce rapport de genre inégal,
puisque, comme l’a trouvé Martin (1996), les adolescents et les adolescentes édictent des rôles de genre très
rigides lorsqu’ils entrent dans le processus du développement de leur identité (Teitelman et al.: 2008, p. 1697).
Les scripts qui dictent que les filles sont tenues de se conformer aux normes de l’hétérosexualité et du
patriarcat – donc de rester passives et objets sexuels, ne sont pas sans conséquence. D’abord, ils placent les
filles et les jeunes femmes dans une position ambivalente où elles anticipent positivement la sexualité mais où
elles sont rongées par l’anxiété et le remords (Fine : 1988, p. 35). En ne permettant aux filles qu’un seul type
de décision dans l’acte sexuel, soit de dire « non » ou « oui » aux relations sexuelles (p. 34), on les place dans
une position de réception – une position passive et où le plaisir et le désir sont absents (p. 33).11
De plus, à cause de la pression sociale que créent les scripts, les filles trouveraient difficile de parler de leur
désir sexuel et même de nommer les sentiments sexuels qu’elles éprouvent (Tolman : 2002). Et comme ces
« paramètres invisibles » leur sont rarement expliqués, elles tendraient à croire que leur désir « est
dangereux » ou encore en viendraient à ignorer leur désir sexuel – c’est-à-dire ignorer qu’elles en ont et
qu’elles y ont droit, ou encore s’abstenir d’agir en concordance avec ce désir.
Dans des études visant à observer comment de jeunes femmes et des adolescentes se sentaient par rapport
à leur vie sexuelle, Gilmartin (2006) et Tolman (1999) ont observé que le double standard laisse les jeunes
femmes perplexes et confuses. Il s’agit de l’une des conséquences néfastes du double standard, que Tolman
(paraphrasée ici par Gilmartin) déplore : « Denying that women have sexual feelings or insisting that they can
never act on their desire only leads to confusion; with so much confusion, how can young women make good
choices about sex? » (2006, p. 431)
Comme le discours social leur interdit d’avoir une sexualité en dehors d’une relation stable ou encore pour le
plaisir, elles s’en dissocient; ainsi, pour éviter l’étiquette de « putes » ou de « filles faciles »12, elles auraient
11 Par ailleurs, non seulement attend-on des femmes qu’elles « contrôlent » le degré d’intimité d’une relation (par le fait
consentir ou non), mais cette responsabilité attendue apporte parfois, insidieusement, des conséquences
juridiques injustifiées : le viol dans le contexte d’un rendez-vous amoureux (date rape), par exemple, a souvent été justifié
par le fait que la partenaire féminine n’exprimait pas assez clairement son refus de consentir. Le comportement passé ou
présent de la partenaire (ne pas être vierge, avoir accepté l’invitation de monter dans la chambre, la façon de réagir
à certaines avances, etc.) pouvait alors constituer des « preuves » de son consentement. Plus encore, cette notion de
consentement n’était pas reconnue, il n’y a pas si longtemps, aux femmes mariées : la sexualité constituait souvent pour
elles un « devoir conjugal » envers leur mari qu’elles ne pouvaient légalement leur refuser (Johnson et Sigler : 1997,
p. 19-25).
12 C’est ce que Gail Pheterson (2001 [1996]) nomme le « stigmate de la putain ». Selon l’auteure, dès qu’une femme
s’adonne à des rapports sexuels jugés immoraux par la société, elle s’expose à ce « stigmate de genre spécifique aux
femmes » (p. 95-96). Même « prendre l’initiative des rapports sexuels, posséder une connaissance du sujet et des
compétences en la matière sont autant de signes d’un comportement sexuel impudique ou d’expérience », bref, de
36
tendance à attribuer leurs activités sexuelles hors couple à des coïncidences, se disant « C’est juste arrivé »
(It just happened), et donc s’en détachant pour éviter de devoir porter le stigmate social relié à la promiscuité :
Having sex "just happen" or being drunk and therefore somehow not responsible for sexual
decisions and actions are what I call "cover stories" – that is, sanctioned ways that girls can
speak about their sexual experiences, in which they are not blameworthy or even active
participants. By saying "it just happenned" or by being drunk, they have recourse from
emotional, social and in some cases physical repercussions within a system that denies
them their sexuality. (Tolman : 1999, en ligne; voir aussi Phillips : 2000, p. 116)
De plus, comme on leur interdit le désir, elles ont tendance à voir le sexe comme quelque chose à pratiquer
« pour la forme », ou encore qu’elles instrumentalisent pour obtenir ce qu’elles désirent – la fin d’une dispute,
la sensation de se sentir proche de son partenaire, l’intimité (Gilmartin, op. cit., p. 440-441). Plus encore, ne
sachant pas faire le lien entre leur situation et le contexte social plus large, elles vivent difficilement leur
sexualité et se questionnent en privé, sans savoir que leurs pairs vivent la même chose (p. 430).
Ces considérations les amènent à préférer l’intimité à la sexualité, ou encore à reporter le jour où elles
commenceront leur vie sexuelle. Il s’agit d’un espace confortable pour elles, puisqu’elles peuvent alors
échapper aux risques reliés au non-respect des diktats sociaux tout en restant dans les « limites de la
sexualité normative » (expression empruntée à Debold, Tolman et Brown : 1996, p. 113) (Gilmartin : 2006,
p. 441).
Heureusement, la situation semble s’améliorer avec les années et l’expérience. Un an plus tard, les
participantes interrogées par Gilmartin – qui avaient initialement 18 ou 19 ans – avaient gagné en confiance et
considéraient moins la sexualité comme quelque chose d’effrayant ou d’inaccessible pour elles (p. 443).
Mais la charge « morale » liée à la sexualité des filles étant toujours présente, les participantes adoptaient
diverses stratégies pour éviter de se sentir dévastée après une expérience sexuelle hors des limites de la
sexualité féminine normative. La dissociation qu’elles adoptent alors – le haussement d’épaules du « It just
happenned », la séparation du sexe et des sentiments lors de relations hors couple pour éviter la frustration de
ne pas avoir fait ce qu’elles « auraient dû faire » – leur permet de garder intacte la partie non sexuelle de leur
vie, soit leur côté féminin, car elles placent la sexualité « de côté », la rendent secondaire, « comme le feraient
de bonnes petites filles » (p. 445).
comportements qui, selon un raisonnement traditionnel mais dont on trouve encore les effets aujourd’hui, « dégradent »
les femmes (p. 97).
37
Le recours à cette dissociation ne les rend pas plus libres – au contraire. Tolman (2002) et Gilmartin (op. cit.)
ont insisté sur le fait que ce recours ne concorde pas réellement avec la définition de l’agentivité sexuelle ou
de la subjectivité sexuelle :
When sex "just happens", women deny the role of their desire and absolve themselves
from responsability for the very thing they are not supposed to do as "good girls." […]
These young women were having sex, but this was not the same as making confident
sexual choices or being sexual agents. (Gilmartin, p. 445-446)
En raison de la peur d’être étiquetée ou tout simplement d’une ambivalence face au désir – Tolman (2002),
Gilmartin (2006) et Caron (2009) ont toutes discuté du double message lancé aux filles de type « Sois sexy,
mais tais-toi » – elles perdent le véritable contrôle de leur sexualité. Elles adopteraient, en réaction, une
attitude libertine détachée : « So get used to it. Have "fun" with it. Have sex "with a friend". It’s not important
anyway. » (Gilmartin, p. 448) Ce n’est pas sans raison : « This kind of attitude may [be] far less threatening to
women’s feminine identities than would be an active appropriation of sexual desire and confident
discrimination between sex feeling "right" or "wrong." » (loc. cit.)
Selon Gilmartin, l’adoption d’une telle attitude n’est ni un pas en arrière ni une progression : « it[’s] a step to
the side. » (p. 450) Et qui bénéficie d’une telle dissociation, d’une telle déresponsabilisation ou encore de la
dévaluation de la sexualité? Ce ne sont certainement pas les filles. Pour l’instant, selon Gilmartin, ce serait
leurs partenaires :
[I]t is masculinity that gains the advantage when women cast aside their fears about sex.
Once women decide that sex is "not a big deal" and "just happens", men are that much
closer to appropriating those dominant forms of masculinity that place a premium on playing
active subject to women’s passive object and enjoying sex in the absence of emotional
attachment (Bird, 1996; Connell, 1995) (Gilmartin : 2006, p. 450)
La crainte de la grossesse, la peur d’être quittée par son partenaire et la peur d’être étiquetée (toutes des
contraintes que n’auraient pas à subir les hommes) ajoutent à la charge et au stress que subissent les filles
(Gilmartin, op. cit., p. 441). En raison de ces différentes conséquences possibles à la sexualité des filles, celle-
ci (vécue librement et entièrement) est crainte et perçue comme étant « naturellement plus dangereuse13 et
suspecte » (Averett et al.: 2008, p. 331, notre insertion) que celle des hommes, qui serait plus « naturelle » et
13 Dangereuse pour elles, cela va de soi.
38
attendue, voire « saine » (loc. cit.). Cette crainte se trouve au cœur d’un autre type de discours, tout aussi
insidieux, qu’Egan et Hawkes (2009) appellent « le discours de la protection ».
2.1.3 Agentivité et le discours de la protection
L’une des causes de la répression sociale du désir féminin (et plus particulièrement adolescent) trouve son
origine dans le « discours de protection » qui prévaut souvent à l’heure actuelle et qui vise à protéger les filles
et les enfants du désir masculin, perçu comme dangereux14 et irrépressible. Les tenants de ce discours
estiment que les jeunes filles sont exposées à trop de messages médiatiques et sociaux hypersexualisés, que
cette exposition a une influence sur le développement et le bien-être des filles et qu’il faudrait restreindre cette
exposition par le biais de mesures sociales préventives élaborées entre autres choses pour contrer la violence
et l’abus (APA : 2007, voir aussi Smith : 2010, p. 117). Ce discours, que d’autres théoriciennes féministes ont
nommé « de protection »15, entretient des liens avec le débat que suscite l’hypersexualisation (ou la
sexualisation) au Québec, qui est vue d’emblée comme un problème.
Mais en est-elle vraiment un? Plusieurs chercheurs estiment que les jeunes ne seraient d’ailleurs pas si
hypersexualisés qu’on le croit (Blais et al. : 2009, Symposium-débat : 2010). Outre une augmentation de la
« permissivité » entourant les actes sexuels (soit une plus grande tolérance envers l’homosexualité et la
sexualité hors mariage), au Québec, les valeurs n’auraient pas beaucoup changé, et l’âge premier des
rapports sexuels n’aurait pas significativement diminué (ibid.).
Or, malgré cette relative immobilité, nous serions, au Québec comme ailleurs, partis en « croisade morale
pour empêcher l’autonomie sexuelle des jeunes » (ibid.) – la « panique morale » à laquelle fait aussi référence
Caron (2009; 2012).
C’est en partie de ce « discours scandalisant » (Symposium-débat : 2010) dont on fait référence lorsqu’on
parle du discours de protection. En plus de s’offusquer de ladite « hypersexualisation » des jeunes, et en
particulier des jeunes filles, le discours de la protection comporte une dimension normative, d’intervention et
de réforme (Egan et Hawkes : 2008, p. 391). Les deux discours16 partagent toutefois la même origine, soit la
crainte des dangers de la sexualisation. On craint par exemple que des images sexualisées puissent
« catalyser » la maturation sexuelle des filles, comme si le danger résidait dans le corps et l’imagination des
filles (loc. cit.).
14 Toujours pour elles, et non pour eux. Autre conséquence pernicieuse du double standard?
15 Voir par exemple Egan et Hawkes : 2008 et 2009.
16 Nous faisons ici la distinction entre le discours de la protection et le discours sur l’hypersexualisation, mais comme ces
discours ne sont ni uniformes ni organisés (voir Egan et Hawkes : 2008, p. 391), elle n’est pas absolument nécessaire.
39
Le problème, avec ce type de discours, se situe dans la perception même des enfants et des adolescents, et
dans la construction et les représentations de leur sexualité :
Childhood sexuality is conceptualized as the result of an outside or deviant stimulus
inevitably condensed into an exosomatic response. It becomes the outcome of something
done to children and not as something that can take place within a larger constellation of
a child’s sexuality. Moreover, once sexuality is realized in the body of a child it becomes
cause for concern and adult intervention. (Egan et Hawkes : 2008, p. 391)
Ces discours ont des implications sociales et politiques qui, selon les auteures, s’avèrent néfastes : ils
procurent le sentiment que les adultes doivent se mobiliser pour entreprendre des actions visant à protéger les
enfants des conséquences néfastes de la sexualité au nom de leurs enfants, et donc maintiennent la croyance
que la sexualité des enfants et des adolescents dépend et a besoin de l’intervention parentale (loc. cit.).
L’adolescence est alors conçue comme une période où l’individu est incapable de jugement et de discussion
raisonnable et raisonnée – celui-ci est, partant, exclu des débats qui le concernent (p. 392). Dès lors, la
conception de l’agentivité sexuelle des enfants, des adolescents et des adolescentes est impossible (loc. cit.).
Sur la prémisse que l’enfant est un être asexuel et innocent – prémisse qui relèverait d’une véritable
« mystification » de l’innocence des jeunes, selon les auteures17 – la sexualité adolescente est marginalisée et
« pathologisée », et ce, par rapport à ce que les adultes évaluent être acceptable socialement (ibid., p. 392-
393).
Ultimement, cette construction de l’enfance et de l’adolescent justifie les modèles éducatifs comme ceux
prônant « l’abstinence seulement » qui, on l’a vu, sont inadéquats pour rendre compte de toutes les
dimensions de la sexualité des adolescents, particulièrement des filles.
Sans prétendre qu’il faille laisser les enfants à eux-mêmes en ce qui concerne la sexualité, Egan et Hawkes
estiment que le discours de la protection est déficient et injuste, puisqu’il ne laisse aucune place pour la
reconnaissance de la subjectivité et de l’agentivité sexuelles des jeunes, et parce qu’on tente de normaliser et
de réguler la sexualité adolescente (p. 393 et 397).
Afin de relancer le débat sur de meilleures bases, Egan et Hawkes proposent de « reconceptualiser les
discours sur la sexualité des enfants et des adolescents grâce à un cadre théorique qui permet la
reconnaissance des enfants comme sujets sexuels » (p. 393-394, trad. libre). Socialement, cette
reconnaissance est importante, puisque ce ne serait que par la reconnaissance et la promotion de l’agentivité
17 Voir aussi Seaton, p. 36-37, dans Mitchell et Reid-Walsh (2005).
40
que les individus arriveraient, selon elles, à se déterminer eux-mêmes (self-determination), un élément
nécessaire au développement (p. 394).
Pour arriver à reconnaître cette agentivité sexuelle des jeunes, il importe de reconnaître, comme l’a souligné
Caron (2009) et de nombreux auteurs avant elle18, la « voix » des jeunes, puisque ce sont eux qui sont le
mieux placés pour connaître leur propre réalité. Il importe aussi de reconnaître que la sexualité des jeunes est
différente de celle des adultes. Dès lors, il devient inadéquat de l’interpréter d’un point de vue adulte
seulement, surtout si les critères utilisés sont normatifs – ce qui est considéré « normal », « adéquat »,
« sain » ou « malsain » (Egan et Hawkes, op. cit., p. 396) – puisqu’il s’agit de construits idéologiques étroits et
propices à des dérapages (comme de considérer qu’une jeune fille n’a de pratiques saines que si elle est
asexuelle) (loc. cit.). Comme Egan et Hawkes le précisent : « The shape of children’s sexuality cannot be
known, defined or supposed in advance. » (ibid., p. 397)
Il peut sembler malaisé d’adopter un point de vue qui s’oppose ainsi au discours de la protection. Selon ces
auteures, d’accepter l’idée que des enfants puissent vivre une sexualité par eux-mêmes et, qui plus est, qui
soit différente de la nôtre requiert une ouverture d’esprit et la capacité d’être à l’aise avec l’ambiguïté (loc. cit.).
Cela demande également d’adopter un point de vue critique et réflexif sur la question afin d’arriver à co-créer
« a different mode of living which acknowledges difference » (loc. cit.).
Plus encore, cela exige que l’on redéfinisse la question du consentement adolescent. Car le discours de la
protection, si inadéquat qu’il puisse être, reste pertinent dans la mesure où il vise à protéger les jeunes et les
enfants de l’abus des personnes adultes (ou des autres adolescents, car il peut y avoir de l’abus avec des
jeunes du même âge).
2.1.4 Agentivité sexuelle dite par des jeunes femmes
Averett et al. (2008), par le biais d’une analyse qualitative, a étudié comment l’agentivité sexuelle s’exprimait
concrètement dans la vie de 14 jeunes femmes. Selon les auteurs, certains facteurs peuvent influencer
l’expression de l’agentivité sexuelle des femmes et des filles. Un soutien parental positif, certains détails
fournis par les pairs et des expériences sexuelles positives peuvent contribuer à établir l’agentivité sexuelle,
alors qu’au contraire, la violence, les discours victimisants et la peur associée aux expériences sexuelles, de
même que les messages parentaux contradictoires, sont tous des facteurs qui peuvent priver les femmes de
leur agentivité sexuelle (Averett et al., op. cit., p. 338).
18 Pour d’autres auteurs qui discutent de cette question, outre ceux que nous nommons au fil du texte, voir la
bibliographie d’Egan et Hawkes : 2008, p. 395.
41
Averett et al. (op. cit.) ont observé chez leurs participantes (âgées entre 18 et 22 ans) que celles-ci
considéraient la sexualité comme quelque chose à craindre et qu’elles avaient l’impression de manquer
d’assurance dans un contexte sexuel. Par contre, elles affichaient le désir de se sentir plus confiantes et
travaillaient à arriver à exercer autant d’agentivité qu’elles le souhaitaient, même si c’était pour la plupart
difficile : « To this day, in my mind, my sexual fantasies portray me as much more assertive and sexual than
I see myself now in my sexual relationship. I always wished I could be as fun in real-life experiences than just
in my dreams », confie l’une des participantes (p. 336)19.
Les participantes reliaient également leur sentiment de ne pas exercer beaucoup de contrôle dans leur vie
sexuelle avec les messages que leur envoyaient leurs parents, à savoir que les filles et les femmes ne
devraient pas être sexuelles. Des affirmations telles que « [according to my mother] A lady would never want
to have sex » et « My decision to stay a virgin [has] a lot to do with me being brought up ladylike » (p. 336)
représentent bien comment les messages parentaux qui prônent l’abstinence ne concourent pas à rendre les
jeunes filles plus agentiques.
Plus encore, la crainte de se voir accoler l’étiquette de « pute » les paralyse : « One of the strongest and
clearest messages that disempowered the women in this sample was the message to avoid at all costs being
viewed as a slut. » (loc. cit.) Cette étiquette – ou le risque de s’y voir associées – a beaucoup à voir avec le
rôle traditionnel féminin et le double standard. Il s’agit d’un « script de genre » qui exerce un réel pouvoir sur
elles, et qui, d’autre part, est tout à fait injuste. Ce message est en grande partie généré par les parents.
Même chose en ce qui concerne le discours de protection : « There is a double standard because my brother
gets to do way more. They [mes parents] are more concerned about me because of the fact that a girl can get
pregnant. It is not focused on my brother. It is focused on me. » (p. 337)
De tels discours et messages parentaux rendent difficile pour elles d’éprouver du plaisir à être sexuellement
actives. Et sans plaisir, il devient encore plus difficile d’exercer de l’agentivité. C’est d’ailleurs ce que Averett et
al. déplorent : « How are women ever to gain sexual agency if they cannot even frame sex as something
desirable and pleasurable in and of itself? How can a woman know her desires and needs if she is not even
supposed to have them? » (p. 341).
Heureusement, certaines des jeunes filles interrogées ont pu voir leur niveau d’agentivité sexuelle augmenter
avec le temps, au fil des expériences sexuelles positives. Cependant, cette augmentation était fragmentée et
19 Bien que les citations soient ici celles de jeunes femmes de 18 à 22 ans, et bien que les adolescentes puissent
présenter d’autres traits qui leur sont particuliers ou qui sont particuliers à leur cheminement, nous utilisons ces citations
autant pour illustrer les comportements d’adolescentes que de jeunes femmes. Nous sommes toutefois consciente qu’il
peut y avoir des différences.
42
variait au fil du temps20, selon le contexte : « The range of responses was not just in terms of some had it and
some did not, but rather that almost all seemed to vary, day to day, relationship to relationship, experience to
experience, thought to thought, in their ability to know and articulate their sexual desires. » (p. 339).
Ainsi, l’expérience de l’agentivité sexuelle peut se conceptualiser comme étant située sur un « continuum ».
Un comportement s’avère donc être agentique à un certain degré; « It [is] not an all-or-nothing experience »
(p. 338). Cependant, l’agentivité inhérente à un comportement particulier n’est pas nécessairement prédictible
de l’agentivité des comportements qui suivront, puisqu’elle est dépendante du contexte (p. 339). De même
que l’attribution de responsabilités et l’autonomie ne s’obtiennent pas selon un processus linéaire (Smette et
al.: 2009, p. 355), l’agentivité chez un individu s’acquiert de façon fragmentée. Il ne s’agit pas non plus d’une
progression inexorable et inévitable.
Allen et al. (2008) ont d’ailleurs démontré que l’erreur pouvait jouer un grand rôle dans l’apprentissage sexuel
et dans l’augmentation de l’agentivité sexuelle des jeunes. Cependant, les participants et les participantes qui
avouaient avoir été irresponsables dans leurs expériences sexuelles passées mais qui ne démontraient pas
de remords ne faisaient pas preuve d’agentivité sexuelle, ou du moins les récits qu’ils ont soumis aux
chercheurs n’en montraient pas la trace. À l’inverse, ceux qui considéraient ne pas encore avoir fait d’erreurs –
ou qui n’en ont pas eu l’occasion – pouvaient faire preuve d’agentivité sexuelle, si la raison pour laquelle ils
avaient repoussé la date des premières relations reposait sur leur propre décision (et non en raison des
opinions de leurs parents, par exemple). (Si les jeunes n’étaient pas encore actifs sexuellement parce que
l’occasion ne s’était simplement jamais présentée, et non par choix, les auteures21 considéraient qu’ils
n’avaient pas encore eu l’occasion de faire preuve d’agentivité.)
Chez les participants de l’étude d’Albanesi, le regret servait en certains cas de catalyseur pour l’adoption de
comportements plus agentiques. En séparant les participants en trois groupes, soit ceux qui ont déjà des
comportements agentiques, ceux qui n’en ont pas et ceux qui sont « en transition » entre l’un et l’autre de ces
groupes, elle a remarqué des différences :
Disappointment is often closely tied with the degree to which each exercises sexual agency.
Those expressing the deepest regrets about their sexual experiences tend to exercise the
least agency in negotiating for what they want. However, unlike the young people we saw in
20 Voir aussi Albanesi (2009).
21 Nous avons féminisé les noms référant majoritairement à des femmes, comme dans le cas présent, où les auteures
sont composées de trois femmes et d’un homme. En cas d’incertitude sur la composition des noms, comme c’est souvent
le cas avec le mot « participants », nous avons privilégié une formule indiquant les deux sexes (« participants et
participantes ») à la première utilisation et utilisant le masculin seulement par la suite, afin d’alléger le texte et par souci
d’y représenter correctement les femmes.
43
part III (who eschew agency), for those in part IV, the transitional group, this regret appears
to function as a catalyst for change. In such cases, the experience of regret is a powerful
factor that helps them to exercise more sexual agency when negotiating subsequent sexual
encounters. (Albanesi : 2010, p. 139)
Enfin, la sexualité leur apparaissait en certains cas décevante. La cause des déceptions, souvent, était reliée
au fait d’avoir voulu une sexualité très positive, relationnelle, romantique, voire « spirituelle » (p. 141), mais de
n’avoir pu expérimenter qu’une sexualité qui leur paraissait « laide, non relationnelle, et quelque peu "sale" »
(loc. cit., trad. libre). Ils étaient alors déçus de constater que leur sexualité, dans les faits, tranchait avec leurs
attentes.
2.1.5 Agentivité sexuelle des garçons
Si l’exercice de l’agentivité sexuelle apparaît problématique chez les femmes, en particulier chez les
adolescentes, il semble en contrepartie relativement aisé pour un homme ou un adolescent de faire preuve
d’agentivité. Le discours en place décrit en effet les hommes comme des « décideurs », peu confus quant
à leurs désirs et tout à fait aptes à démontrer de l’agentivité :
…teen boys, particularly, heterosexual teen boys, masculinist theorist point out, have been
pictured as agents, choosers, actors, ready to go, unconfused about their wants and needs,
out for pleasure, demanding, and entitled (Kimmel : 2005; Kindlon and Thompson : 2000;
Pleck : 1981). (Lamb : 2010a, p. 298)
Comme les hommes ont été de tous les temps dominants dans les sociétés patriarcales et que les relations
sociales genrées ont mis de l’avant leur pouvoir dans toutes les sphères de la société, il est tentant de
concevoir le pouvoir sexuel comme binaire et celui des hommes comme s’exprimant de façon monolithique
(Hollway : 1984). Ce serait oublier que le pouvoir « is a two-way dynamic, negotiated – reproduced or
challenged – in every interaction, however mundane » (p. 64). D’ailleurs, Albanesi (2010), qui a interrogé des
hommes et des femmes dans son étude sur l’agentivité, estime que la croyance selon laquelle les hommes
exercent systématiquement plus d’agentivité que les femmes constitue une supposition souvent erronée. Bien
que les hommes de son étude présentaient plus souvent que les femmes des comportements agentiques, elle
a trouvé que les participants ne pouvaient être séparés en deux catégories homogènes adoptant des
comportements genrés :
As dominant constructions of masculinity embrace assertiveness and (hetero)sexual
prowess, sexual agency in men is often assumed to be unproblematic. The stories shared
by the young men in this study challenge this assumption. (p. 144)
44
La distribution du pouvoir entre les sexes est, selon elle, beaucoup plus complexe :
I do not find that all the young men are agentic while all the women are passive. Both
women and men significantly represented each of the three styles [comportements
agentiques, non agentiques ou entre les deux]. Clearly, gender does not determine sexual
agency in some straightforward, dichotomous manner. (p. 140)
Allen et al. (2008) ont cependant remarqué une différence notable entre les garçons et les filles dans la façon
de concevoir l’acquisition de l’agentivité sexuelle. Les filles démontraient en effet une attitude plus critique et
réflexive envers leur processus d’acquisition de l’agentivité sexuelle, alors que les jeunes hommes semblaient
présumer qu’ils en exerçaient plus ou moins automatiquement (p. 527). Cela suggère que malgré le fait que
les hommes n’exerceraient pas systématiquement plus d’agentivité sexuelle (comme le montre Albanesi), il
pourrait toutefois être plus facile pour les hommes de faire preuve d’agentivité, puisque les scripts de genre
tout comme les discours en place les positionnent déjà en situation de pouvoir; ils auraient donc moins
à s’inquiéter à ce sujet. Les filles, en contrepartie, considéreraient moins leur agentivité comme acquise, et
donc estimeraient devoir travailler plus fort pour arriver à l’exercer (Allen et al. : loc. cit.).
Plus encore, Fagen et Anderson (2012) montrent que si le fait d’agir comme un « gatekeeper » des relations
sexuelles peut, pour les filles, sembler constituer un rôle plutôt passif (en raison des scénarios de genre qui
les placent souvent dans cette position), certains hommes auraient tendance à considérer le fait de jouer les
« gatekeeper » comme une réaction assertive et agentique aux avances insistantes et non désirées des
femmes. Si le fait de refuser une activité sexuelle non voulue constitue un comportement agentique pour les
deux sexes, il est important, selon McIntosh (1988), de situer l’expérience des deux sexes dans le contexte de
la domination masculine, où la plupart des hommes (en particulier les hommes blancs) occupent une position
privilégiée. Fagen et Anderson expliquent :
…since it is consistent with masculinity to take a proactive role in heterosexual sex, a man’s
objectification by an initiative woman can be experienced as a violation. That is, the
experience of women’s perceived sexual aggression violates every assumption of
masculinity. Since men are socialized to believe that masculinity is contingent upon the
rejection and devaluation of feminine, being put in the "feminine" position in a sexual
encounter could be perceived as a thoroughly gendered experience. In order to regain their
proactive role in the traditional sexual script, male participants set limitations on and, in
some cases, vehemently refused, women’s sexual advances. (p. 269)
45
Il est dès lors important, selon ces derniers auteurs, de concevoir et de comprendre les expériences
masculines de la sexualité (ici, de la coercition sexuelle) dans le contexte genré des normes sexuelles.
Mais comme le précise Albanesi (op. cit.), les hommes comme les femmes n’adoptent pas toujours une
attitude et des comportements en accord avec ces normes. Et comme très peu d’études se sont penchées sur
l’agentivité et le développement sexuels des garçons (Tolman, Hirschman et Impett : 2005, p. 7), et ce, surtout
de façon exclusive (Fagen et Anderson : 2012), il est difficile de parvenir à des conclusions solides sur la
question. Dans la plupart des études, les connaissances concernant les expériences sexuelles des hommes
sont extrapolées à partir de celles des femmes (Fagen et Anderson, p. 261). Le manque de données à cet
égard nous apparaît donc très clair; nous ne pouvons ainsi que souhaiter, à l’instar de ces derniers auteurs,
que des études ultérieures examinent ce thème de façon plus particulière.
2.2 Agentivité, perception du pouvoir sexuel et normativité
Ariel Levy, dans son essai Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture (2005), fait le
portrait d’une nouvelle tendance chez certaines femmes d’utiliser leur corps à la fois pour attirer l’attention,
choquer et s’amuser. Le phénomène, spécialement répandu aux États-Unis, fait référence à différents actes
comme le fait de montrer ses seins ou ses parties génitales dans le cadre d’un concours, sous le prétexte qu’il
s’agit d’un acte libre, réfléchi et « empowering ». L’émission de télé-réalité américaine Girl Gone Wild, par
exemple, présente des jeunes femmes – certaines présentées comme faisant des études doctorales – qui se
dénudent volontairement pour la caméra (sans qu’on le leur ait nécessairement demandé) et donc qui
décident de leur plein gré de participer à une émission pornographique parfois sans rémunération autre que le
fait d’être associées à la marque. Les femmes qui s’adonnent à de tels comportements disent le faire sur des
bases de liberté et d’empowerment, puisqu’elles se sentent en contrôle de leur sexualité et libres de
s’exprimer sexuellement (Averett et al. : 2008, p. 332). Certaines vont même jusqu’à qualifier ce type de
comportement de libérateur et de progressiste (Levy : 2005, p. 29). Or, selon certains auteurs, le fait de tirer
du plaisir à se présenter comme des objets sexuels ne concorde pas avec la définition d’agentivité sexuelle –
le simple fait d’agir sexuellement ne rend pas un comportement « agentique ». Et il ne s’agirait aucunement
d’une progression, mais au contraire d’une réitération d’une culture essentiellement commerciale (Levy, op.
cit., p. 29-30)22. Selon Levy et Averett et al., ces jeunes femmes ne sont pas habilitées d’un certain pouvoir; au
22 D’ailleurs, à ce sujet, Pitcher (2006) estime qu’il est difficile de ne pas soulever la question de l’exploitation des femmes
puisque l’émission Girl Gone Wild mise sur la volonté de jeunes femmes de se dénuder pour la caméra en l’échange d’un
maigre tee-shirt, alors que la compagnie empoche des millions (p. 201). Sans nier que l’émission puisse en effet
permettre à certaines participantes d’agir de façon agentique ni reprocher aux participantes de l’émission d’agir selon une
« fausse conscience » (p. 215), Pitcher montre comment le mécanisme d’exploitation de l’émission est si efficace qu’il
prend des allures d’occasion pour les participantes de démontrer leur agentivité, et ce, simplement en la mettant en
46
contraire, elles adoptent une mentalité qui soutient le patriarcat et la soumission des femmes au pouvoir des
hommes en mettant l’accent sur l’apparence physique et la désirabilité (Averett et al. : 2008, p. 332). Lamb
(2010a) fait d’ailleurs la distinction entre le fait de se « sentir » habilitée d’un pouvoir, et le fait de l’être
réellement :
Of course, performing porn acts can feel empowering to girls. The question is whether
feeling empowered and being empowered is the same thing and whether empowerment is
merely a feeling or should be connected to power and autonomy in other spheres. Feeling
emboldened sexually is not the same as empowered. (p. 301)
Le pouvoir que ressent une fille ou une femme lorsqu’elle attire l’attention par des actes calqués sur des
modèles pornographiques ou sur le marketing commercial peut constituer un pouvoir réel, mais il s’agit selon
Lamb (2010a; voir aussi Pitcher : 2006) d’un pouvoir défini de façon « étroite ». Le véritable pouvoir dont on
parlerait lorsqu’on aborde l’agentivité sexuelle des filles et des femmes serait plutôt construit sur la base de
choix faits à l’intérieur d’une sexualité vécue de façon « authentique », c’est-à-dire où la femme ou la fille agit
selon des désirs qui sont les siens, et non ceux dictés par un système patriarcal qui lui prête les siens.
Mais il existe une certaine limite à déterminer à l’avance ce qui constitue un comportement agentique et ce qui
constitue, à l’inverse, un comportement non agentique. En supposant que, par exemple, les filles dépeintes
par Levy agissent en respectant les normes patriarcales sans s’en rendre compte, et donc qu’on estime
qu’elles agissent selon une « fausse conscience », on discrédite le pouvoir décisionnel des femmes, d’une
part, et on émet un jugement sur les comportements sexuels que les jeunes femmes « sensées » voudraient
ou ne voudraient pas adopter, d’autre part. Ce faisant, on cesse de reconnaître leur agentivité sexuelle et on
juge leurs activités sexuelles en les opposant à une certaine « norme » (celle de la morale, celle du féminisme
traditionnel, celle que l’on attend des filles, etc.).
De façon semblable, les discours comme celui du « girl power », par exemple, qui misent sur les principes
d’indépendance et d’autonomie pour promouvoir en principe l’agentivité des filles, sont particulièrement
problématiques, puisqu’ils « définissent la liberté de choisir de façon limitée » (Hasinoff : 2010, p. 264, trad.
libre). En opposant l’agentivité des filles aux standards et aux attentes des autres, dit-elle, « these discourses
actually reinscribe the moral judgements about sexuality under the pretext that girls with sexual agency make
scène. En d’autres mots, le fait que l’émission montre à la caméra le processus de consentement des jeunes femmes (et
même parfois, leur refus ou les processus de négociation de leurs limites) accentue l’idée du « choix libre », d’autonomie,
d’autodétermination et d’empowerment auxquelles adhèrent les participantes, reprenant ainsi le discours du « choix
personnel » cher au féminisme postmoderne. Selon elle, le tout confère à l’émission un « effet d’agentivité », mais reste
basé sur un cadre hétéronormatif, capitaliste et bourgeois.
47
"good" sexual choices » (p. 78). Ce qui, en bout de piste, « merely reinscribe gendered sexual normativity as
the only choice mentally healthy girls can legitimately make » (p. 264).
D’autre part, en gardant en tête une image de la sexualité qui soit souhaitable et qui corresponde à la
« véritable » agentivité des filles, on ferait face à plusieurs autres problèmes. Selon Lamb (loc. cit.), l’« idéal »
de la sexualité ainsi créé serait, en plus d’être normatif, difficile à atteindre :
When we feminist theorists are done saying what good sex should not be, we can only
create an unachievable ideal of what it should be, offering up fantasies of what we hope
girls can achieve without regard to whether adult women have achieved such ideals in any
uncomplicated and longlasting way. (p. 302)
Nul doute que la sexualité est une sphère complexe de la vie, et qu’il serait utile, comme le préconise Lamb,
que les filles sachent que la sexualité est compliquée (même si nous supposons qu’elles le savent déjà). Mais
par crainte d’instaurer une nouvelle norme basée sur une vision particulière de ce que devrait être la sexualité
des filles, devrait-on pour autant considérer que toutes les pratiques sexuelles s’équivalent? Gayle Rubin,
anthropologue et théoricienne de la sexualité ayant été l’une des premières, avec Foucault, à avoir apporté
l’idée que la sexualité n’existe pas en dehors des discours et de la culture, estime que cette tendance à vouloir
catégoriser les comportements sexuels en comportements « souhaitables » ou « non souhaitables » serait
une erreur : « Une des idées les plus tenaces en matière de sexe, c’est qu’il y a une et une seule bonne façon
de faire l’amour, et que tous devraient le faire de la même manière. », écrit-elle en 1984 dans son article
« Penser le sexe », qui est désormais devenu un classique (Rubin : 2010 [article de 1984], p. 163). Elle écrit :
La plupart des gens prennent leurs préférences sexuelles pour un système à valeur
universelle qui vaut ou devrait valoir pour tout le monde. Cette notion d’une sexualité idéale
unique caractérise la plupart des systèmes de pensée du sexe. Pour la religion, l’idéal est le
mariage procréateur. Pour la psychologie, c’est l’hétérosexualité responsable, adulte.
Malgré des variations de contenu, le raisonnement avec modèle sexuel unique est
perpétuellement reconstruit à l’intérieur de cadres rhétoriques différents, y compris le
féminisme et le socialisme. Il est tout aussi discutable de dire que tout le monde devrait être
lesbienne, non monogame ou kinky que de dire que tout le monde devrait être
hétérosexuel, marié et ne pratiquer que le sexe le plus conventionnel – quoique ce dernier
modèle ait en sa faveur un pouvoir coercitif infiniment plus fort que le premier. (Rubin, ibid.,
p. 163-164)
Selon cette auteure, les positions qui tendent à stigmatiser certaines pratiques, comme le fétichisme ou la
pornographie, seraient « régressi[ve]s » (p. 133) et donc tout autant infécondes, si nous continuons la
48
réflexion, que celles qui visent à faire du désir et de la sexualité active une « norme » pour les femmes. Elle-
même a d’ailleurs ardemment défendu les pratiques sadomasochistes (S&M), et a trouvé plus difficile d’avouer
qu’elle pratiquait le sadomasochisme que de se déclarer lesbienne (2010 [1981], p. 128). Ses positions sur la
sexualité ont porté plusieurs à considérer Rubin comme une tenante « pro-sexe » dans le débat qui a opposé
les féministes « pro-sexe » et « anti-sexe » il y a quelques décennies, une supposition à laquelle Rubin aurait
répondu, quelques fois, qu’elle n’était « pas tant "pro-sexe" que "anti-anti-sexe" » (Halperin et Mesli, en
préface de Rubin : 2010, p. 18). Cette position nuancée qui sort du cadre binaire habituel « pro-sexe » et
« anti-sexe » nous semble tout à fait féconde pour considérer et appliquer le concept d’agentivité sexuelle, car
elle ouvre la voie à une compréhension de l’agentivité qui ne repose pas sur la distinction plutôt limitative entre
pratiques « souhaitables » et « non souhaitables »
Mais malgré l’apport de Rubin dans le débat, cette distinction entre pratiques « souhaitables » et « non
souhaitables » est toujours bien présente aujourd’hui. Par exemple, Amy Hasinoff (2010) a observé que les
médias et même certaines lois et dispositions légales aux États-Unis ont tendance à « démoniser » certains
actes sexuels pratiqués par les filles, sans égard à l’absence ou la présence de leur consentement, et encore
moins à leurs propres perceptions de l’acte. Son étude, qui porte sur les liens entre l’agentivité sexuelle et les
pratiques du sexting23 par les adolescentes, montre que les dispositions légales, les commentaires populaires
et même les interventions de certaines chercheuses féministes dans les médias sur ces pratiques considèrent
« invariablement » les pratiques du sexting par les adolescentes comme le résultat d’un acte impulsif, non
réfléchi, accompli par des adolescentes que l’on considère « victimes » parce qu’elles ne sont pas majeures,
et parce que selon les perceptions dominantes, les jeunes filles devraient être innocentes et asexuelles. Or,
paradoxalement, écrit-elle, les discours médiatiques blâment ces mêmes adolescentes pour leur propre
victimisation (p. 3, 12, 21, 59, 62, 241, 268 et plus) et en font ainsi des « victimes responsables ». Les filles qui
envoient une photo osée d’elles-mêmes à leur copain seraient ainsi d’une part victimes des messages
sexualisés des médias, de la pression des garçons, de leurs hormones ou encore de leur manque de
confiance en elles-mêmes et de leur besoin d’attention déplacé (p. 17) et, d’autre part, responsables parce
qu’en mettant l’accent sur un discours « d’autocontrôle » comme stratégie de prévention, l’on tient injustement
les filles en quelque sorte « responsables » de prévenir la violence sexuelle et le harcèlement des garçons (et
ce, même quand les échanges sont consensuels) (p. 47). En d’autres mots, « [t]he dominant discourse about
sexting tends to view the girl who creates an image of herself as irresponsibly inviting male sexual violence
and harassment. » (p. 18)
23 Le fait d’envoyer des messages ou des images à caractère sexuel à une connaissance par téléphone cellulaire ou par
Internet.
49
Selon Hasinoff, « [t]he continued criminalization of sexting is doubly sexist: it denies teenage girls the right to
express themselves sexually and normalizes malicious photo distribution by holding young female victims
responsible for it. » (p. 12).
Cette « panique morale » concernant le sexting proviendrait, selon Hasinoff, à la fois d’une préoccupation
exagérée des effets des médias sur les adolescents (par exemple, le Centre canadien de la protection de la
jeunesse invitait récemment, en 2010, les jeunes à s’engager à tenir la promesse : « I will enjoy all of the
technologies available to me, but I will not allow them to control me », comme si la technologie exerçait un
« pouvoir » potentiellement nuisible sur les adolescents) et d’une crainte non fondée de la sexualité
adolescente et de l’agentivité sexuelle des jeunes filles (p. 13) :
…perhaps the central feature of sexting that makes adults uncomfortable about it, is that it
provides tangible pieces of evidence that teenage girls are choosing to express themselves
sexually. Rather than revisiting the dominant models of teenage girls’ sexuality, discussions
about sexting instead tend to question sexting girl’s agency. (p. 18)
Bref, les dispositions légales états-uniennes et les constructions médiatiques et populaires du sexting font en
sorte que celle-ci devient une pratique condamnable (p. 6) et construisent les adeptes de cette pratique
comme soit victimes, soit vilaines, d’une façon profondément genrée et raciale (p. 6). Cette « démonisation »
du sexting trouverait en partie sa source dans une conception problématique de l’agentivité sexuelle issue des
discours postféministes et libéraux, puisque, selon Hasinoff, « …this early 21st century post-feminist girl-power
moment not only demands that girls live up to gendered sexual ideals but also insists that actively choosing to
follow these norms is the only way to exercice sexual agency » (p. iii-iv)24.
Comment alors concevoir l’agentivité sexuelle de façon à permettre son opérationnalisation dans les études
tout en évitant de tomber dans le piège de la normativité? Certains auteurs ont suggéré de concevoir
l’agentivité « réelle » comme une agentivité vécue de façon « authentique », c’est-à-dire le comportement
24 Amy Hasinoff en vient à ce constat après avoir analysé les représentations des pratiques du sexting des filles dans les
médias américains, dont plusieurs journaux et l’émission Dr. Phil. Mais la « démonisation » des pratiques sexuelles des
filles dans les médias américains ne se limite pas qu’au sexting; nous avons d’ailleurs pu observer nous-même cette
tendance dans l’émission du 16 novembre 2012 de Dr. Phil, où Erica, 17 ans, et sa soeur Leanna sont ardemment
critiquées pour avoir pratiqué le pole-dancing (Erica n’ayant pas à ce moment l’âge légal de danser nue, Leanna a été
accusée de contribuer à la délinquance d’une mineure; un cas qui a été très suivi par les médias américains). Dans
l’émission, chaque tentative des jeunes filles de discuter de leur agentivité et de leurs choix est décimée par l’animateur
(Dr. Phil), qui leur rappelle plutôt qu’elles créent des problèmes et qu’elles ont menti à plusieurs occasions : « It’s not
okay to bully, nor is it okay to create problems and then act like a victim », leur dit-il. Cette émission suggère en effet que
la discussion sur l’agentivité des jeunes filles dans les médias américains serait éclipsée au profit d’un discours qui les
tient à la fois responsables et victimes des actes qu’on juge condamnables.
50
serait agentique lorsque la jeune fille se « sent bien » dans sa sexualité et dans son corps; un concept auquel
on réfère lorsqu’on parle d’« embodied sexuality », ou, en français, de « sexualité incarnée » ou de « sexualité
ressentie dans son corps ». Cette sexualité « incarnée » s’oppose en principe à la « performance », où la
jeune fille agirait en quelque sorte pour se « donner en spectacle », ou en se soumettant au regard des autres
(Lamb : 2010a, p. 301).
Mais une telle conception, basée sur des critères d’authenticité, prête aussi flanc aux critiques :
Even if she [une fille qui agirait sexuellement à la façon des stéréotypes marchands] were to
be feeling sexual feelings in her body, in her genitals as well as elsewhere, these theorists
would most likely argue that it is still not embodied for to perform "sexy" means to take the
perspective of the male looking on. (Lamb : 2010a, p. 301)
Il serait alors trop facile de considérer qu’elle adopte des comportements jugés non agentiques en
argumentant qu’elle a appris à agir dans un système patriarcal qui récompense (en attention, par exemple)
ces comportements, ou encore qu’elle aurait développé une « fausse subjectivité » (loc. cit.).
À l’inverse, même si une fille adoptait des comportements en accord avec les valeurs féministes libérales, et
même si elle adoptait un discours basé sur le choix et l’authenticité, Lamb croit que l’on pourrait toujours
douter de l’authenticité de sa parole : « …who’s to say that when a girls does look within, whe won’t find
another packaged version of teen sexuality [soit celle de la "good girl" cherchant à être aimée]? » (p. 302)
Ainsi, même si le critère d’authenticité, en soi, nous semble faire réellement partie de la définition d’agentivité,
plusieurs théoriciennes doutent justement de l’authenticité de la perception d’authenticité des jeunes filles que
l’on interrogerait. Ce qui amène Lamb à trancher : « Authentic sexuality is hard to find and feminist theorists
may do best to leave that quality out of the mix. » (loc. cit.)
Mais si Lamb prône l’abandon de ce critère, nous préconisons l’inverse, parce qu’en mettant ainsi en doute la
parole des filles et des jeunes femmes, on trahit directement l’une des raisons premières pour lesquelles on
a voulu adopter le concept d’agentivité, soit de donner une légitimité de parole aux filles.
Le problème est le même lorsqu’il est question d’empowerment. Dans un débat qui a récemment opposé
Lamb (2010a, 2010b) et Peterson (2010)25, les deux chercheuses se sont penchées sur des cas
25 Les deux chercheuses se sont plus tard réunies pour coécrire un article plus nuancé sur la question, chacune estimant
ses positions peu représentatives de ses opinions réelles, moins tranchées. Il en résulte un article où les deux auteures,
cherchant à rallier leurs opinions divergentes sur l’empowerment, posent plusieurs questions pertinentes, comme celles-
ci : « If a girl is inspired by highly sexualized media representations (including explicit pornographic representations), is
she less empowered? » et « Does empowerment have something to do with the way in which she positions herself in
relation to these representations? » (Lamb et Peterson : 2012, p. 707)
51
problématiques en lien avec l’agentivité, l’empowerment et la sexualité des filles, particulièrement lorsque
celles-ci disent se sentir « empowered » en imitant des gestes ou des comportements issus du milieu
pornographique. D’un côté, Peterson estime que même l’adoption d’un comportement issu de la pornographie
peut contribuer à ce qu’une jeune fille se sente « en pouvoir » dans sa sexualité, et qu’il est important de
reconnaître cette perception comme réelle. Elle estime que :
…to dismiss girl’s subjective experiences of sexual empowerment (even if it is [sic]
influenced by pornographic media images or by male models of desire and pleasure) as a
misperception of "false consciousness" seems invalidating to girls and thus contrary to the
goals of empowerment. To invalidate girl’s experiences of sexual empowerment is to
suggest that their own perceptions of sexual control and self-efficacy are false. If we tell girls
that they cannot even trust their own perceptions of enjoyable and empowered sexuality,
then they are left with no compass to point the way toward healthier sexuality. (p. 308-309)
Plus encore, le simple fait qu’une jeune fille ait aujourd’hui le choix d’adopter des comportements issus de la
pornographie pourrait être, selon Peterson, considéré comme une forme d’empowerment (p. 309).
De son côté, Lamb (2010b) croit que l’on ne peut honorer comme véritable et authentique chaque sentiment
qu’une jeune fille peut avoir (p. 315), car, selon elle, la liberté sexuelle et la marchandisation de la sexualité
sont incompatibles; on ne peut donc réellement exercer du pouvoir ou faire des choix alors que la
pornographie et les représentations marchandes de la sexualité réduisent considérablement les options :
It represents a single pathway open rather than one of many ways to express power in
sex. And it’s exactly that overrepresentation of only one way for sexual pleasure to be
represented that makes the idea of choice so problematic. (p. 314)
De façon très semblable, dans un autre débat qui a opposé les chercheuses féministes Linda Duits et Liesbet
van Zoonen (2006, 2007) et Rosalind Gill (2007) sur le port de vêtements symboliquement marqués comme le
voile ou le G-string, Rosalind Gill, à l’instar de Lamb, conteste l’idée que l’on puisse réellement faire des choix
dans une société marquée par l’exploitation du corps des femmes. Elle va même jusqu’à mettre en doute
l’utilité même du concept d’agentivité :
…I want to problematize the terms "agency", "autonomy" and "choice" […] and to ask how
well such terms serve contemporary feminism. To what extent do these terms offer
analytical purchase on the complex lived experience of girls and young women’s lives in
postfeminist, neoliberal societies? Moreover, what kind of feminist politics follows from
a position in which all behaviour (even following fashion) is understood within a discourse of
free choice and autonomy? (Gill : 2007, p. 72)
52
De son point de vue, le concept survaloriserait l’aspect du choix libre au détriment de ce qui serait selon elle le
fait des structures sociales :
One of the problems with this focus on autonomous choices is that it remains complicit with,
rather than critical of, postfeminist and neoliberal discourses that see individuals as
entrepreneurial actors who are rational, caculating and self-regulating. The neoliberal
subject is required to bear full responsability for their life biography no matter how severe
the constraints upon their action (Walkerdine et al., 2001). Just as neoliberalism requires
individuals to narrate their life story as if it were the outcome of deliberative choices, so too
are Duits and van Zoonen’s young women constructed as unconstrained and freely
choosing. (Gill : ibid., p. 74)
Selon Duits et van Zoonen, qui font partie du camp « opposé », la conception de Gill « only accepts
subjectivity as a product of power » (2007, p. 168).
Le débat n’est pas sans rappeler l’opposition entre agentivité et structures sociales qu’a tenté de déconstruire
Giddens (2005 [1984]). La plus grande différence serait ici que l’on oppose dans le cas présent l’agentivité des
femmes aux structures patriarcales (Fraser et Bartky : 1992, p. 17) et que l’on aurait une fâcheuse habitude de
considérer trop facilement que les filles et les jeunes femmes comme étant dupes des structures en place,
alors que les chercheuses féministes ne le seraient pas ou le seraient moins (Duits et van Zoonen, op. cit.,
p. 165-166). Lamb (2010b), à ce propos, écrira d’ailleurs que « sometimes we (theorists, researchers, adults,
moms, and even dads) do see things about other people’s meanings and expressions that they do not see.
[…] In some cases we […] do know more », précisant par la suite que cela n’implique pas nécessairement que
l’on puisse dire aux filles quoi dire ou ressentir (p. 316).
Les raisons qui pourraient expliquer de tels désaccords sur le concept d’agentivité sont nombreuses. Comme
l’explique Hasinoff, le problème se situerait d’abord à deux niveaux : au niveau interne (les filles sont perçues
comme étant trop jeunes ou trop naïves pour pouvoir voir et comprendre les implications des structures en
place) et au niveau structurel (une perception exagérée des effets des médias, du consumérisme, du
marketing, de l’hétéronormativité, etc.) (p. 17 et 20).
Le débat est alors binaire et polarisé : soit l’on met l’accent sur l’empowerment et le plaisir sexuel, soit on le
porte sur les dangers de la sexualité et sur la protection des jeunes filles (Renold et Ringrose : 2011, p. 391;
voir aussi Vance [1992b]); en d’autres mots, soit on insiste sur la capacité d’action des individus, soit on
accentue l’effet contraignant des structures (Fraser et Bartky : 1992, p. 17). Mais le débat n’a pas à être si
polarisé; il peut au contraire être nuancé. D’ailleurs, comme le mentionnait Giddens, les structures permettent
les actions tout comme elles les restreignent (2005 [1984], p. 75), et cette dualité des structures ne constitue
53
pas une binarité opposée, mais une dualité, une coprésence : les acteurs ne sont ni tout à fait restreints par
les structures, ni tout à fait libres, car ils sont conçus à travers elles et à travers les discours (voir aussi
Foucault, 1994 [1976]).
Comme le précise la traductrice de l’ouvrage Le pouvoir des mots, de Judith Butler, le terme « agency »
implique nécessairement la notion de contrainte, et c’est cette notion de contrainte qui, paradoxalement,
permet la possibilité d’une puissance d’agir :
Dans le champ universitaire contemporain, notamment au sein des cultural studies, ce
terme [agency] a été conceptualisé comme une notion alternative à celle de maîtrise ou de
« liberté » (au sens de libre arbitre), et en est venu à désigner une action qui n'a pas pour
origine un sujet « souverain ». L'agency, c'est la puissance d'agir que nous pouvons tirer de
notre dépendance fondamentale à l'Autre, au langage; c'est aussi la résistance que produit
nécessairement le pouvoir. Penser la possibilité d'une agency en politique, c'est renoncer à
croire qu'on pourrait se situer hors du pouvoir, qu'il faudrait sortir entièrement des rapports
de domination pour mettre en œuvre une politique d'émancipation. Comme le dit Judith
Butler dans sa préface de 1999 à Trouble dans le genre, « il n'y a pas de position politique
purifiée du pouvoir, et c'est peut-être cette impureté qui produit la puissance d'agir comme
interruption et renversement potentiels des régimes régulateurs ». Pour ce qui est du
discours, cela signifie qu'il n'est pas possible d’utiliser des mots qui soient purifiés de tout
pouvoir, qui ne soient pas « souillés » par la domination, mais que, contrairement à ce que
d'aucuns affirment, cette situation ne nous interdit en aucune façon de développer une
puissance d'agir […]. (2004 [1997], p. 15; avertissement des traducteurs)
Le simple fait de retourner aux sources du concept fournit donc des outils pour comprendre le débat et le faire
avancer. Il en est de même en ce qui concerne le concept d’empowerment : des compréhensions différentes
de la définition du concept peuvent mener à une polarisation en apparence irréconciliable des débats qui le
concernent. Peterson soulevait déjà dans son article de 2010 que le concept était mal défini, et, se basant sur
les distinctions de Riger (1993) et de Yoder et Kahn (1992), montrait qu’il pouvait simultanément faire
référence à différents « niveaux » ou dimensions d’empowerment. Soit on conçoit l’empowerment comme un
élément nous permettant d’exercer le pouvoir de faire quelque chose (power to), soit on le définit comme le
sentiment d’exercer du pouvoir sur quelque chose (power over); sur des structures sociales, par exemple.
Si l’on conçoit l’empowerment comme le pouvoir de défier les discours dominants, un peu à la manière
suggérée par Spencer et al. (2008), comment peut-on considérer comme « empowered » une jeune fille qui
s’inspire de la pornographie pour agir sexuellement?
La réponse, selon Peterson (2010), c’est qu’une jeune fille peut être simultanément « empowered » à certains
niveaux, et « disempowered » à d’autres; une conception multidimensionnelle de l’empowerment qui permet
54
d’autre part l’ambivalence défendue par Peterson et Muehlenhard (2007) (un concept que nous aborderons un
peu peu loin).
En ce qui concerne l’agentivité, le problème est aussi dû au fait que la compréhension du concept est éclairée
d’un côté par la théorie féministe seule (dans le cas notamment de Gill), et de l’autre par la théorie doublée
d’études empiriques (dans le cas par exemple de Duits et van Zoonen). Rosalind Gill, par exemple, conçoit
exclusivement l’agentivité dans un cadre d’analyse consumériste (2007, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 2010,
2011, etc.). Elle-même précise dans son article de 2008b : « I start not from research with young women but
from constructions of female agency in the media, specifically advertising. » (p. 38). Même si elle se dit bien
consciente que les médias n’offrent pas qu’un seul modèle de féminité ou de sexualité aux filles (« there is no
single "media woman", dit-elle [2012, p. 738]) et que les recherches sur les médias ont depuis longtemps
dépassé les notions de seringue épidermique ou d’imitation directe (p. 739), son analyse reste fortement
teintée par les modèles d’agentivité « détournée » que l’on retrouve dans la pornographie, dans les publicités
et à la télévision, comme si le pouvoir de séduction n’était véritablement que la seule modalité de pouvoir
réellement exercée par les filles. Mais comme nous l’avons mentionné en problématique, cette représentation
de l’agentivité est justement mise en scène, factice, et n’implique pas nécessairement que l’exercice de
l’agentivité dans « la vraie vie » soit impossible.
En ce sens, notre conception de l’agentivité s’apparente donc plutôt à celle décrite par Hasinoff dans son
étude sur le sexting par les jeunes filles :
Even as I subscribe to the Foucaultian model of the subject whose desires and
comprehension of herself as a subject are created within discourse, I simultaneously argue
that subjects can still be said to act as agents within these parameters. […] In this project
I rely on a postcolonial feminist conjecture that agency is always constrained, contextual,
and relational. (Hasinoff : 2010, p. 20)
À l’instar d’Abu-Lughod (2002), qui s’est intéressée au port du voile dans le monde musulman et qui estime
que le port du voile lui-même ne peut être confondu ou même servir d’indicateur pour un manque d’agentivité
(p. 786), Hasinoff estime que l’agentivité « must always be understood in context, as a social relation rather
than as an absolut fact » (Hasinoff, op. cit. p. 20). Une telle conception de l’agentivité comme un élément sans
cesse soumis à des contraintes permet simultanément de concéder que l’agentivité est soumise à la culture et
aux structures sociales en place (comme celles du patriarcat) et de reconnaître l’existence ou même la
possibilité même d’existence du pouvoir d’action des individus. Cela nous apparaît essentiel pour ne pas jeter
la reconnaissance de l’agentivité des filles avec l’eau du bain des débats théoriques sur les limites de son
55
exercice. Car les études empiriques portant sur la question26 ont bel et bien démontré que les filles étaient
capables d’action raisonnée, et la reconnaissance de cette réalité ne nous apparaît pas pour autant comme
une survalorisation ou une glorification de leurs capacités (comme certains, à l’instar de Gill, le
craignent [2007, 2008b, 2012]27).
L’une des façons de rallier les deux camps serait de suspendre son jugement lorsque, en recherche, nous
écoutons la parole des filles, avant de replacer leurs actions dans un cadre d’analyse. Le fait de simplement
acquiescer et dire « I see » après que les filles se soient exprimées n’est pas suffisant, estime Gill (2007); il
est nécessaire de situer leur parole dans le contexte commercial, hétéronormatif ou consumériste de leurs
actions. « To situate an individual’s account is not to disrespect it », précise-t-elle avec raison (p. 77). Mais le
danger de discréditer la parole des filles en voulant « la situer » est grand et Gill, dans son analyse, ne semble
pas réussir à éviter cet écueil. Pourtant, il est effectivement possible de relever les forces à l’œuvre sur
l’agentivité de filles tout en respectant leur parole. L’une des façons d’y arriver est justement de laisser les
filles s’exprimer sur ce point, car, sans nécessairement toutes être des « théoriciennes féministes en pouvoir »
(Duits et van Zoonen : 2007, p. 166, notre traduction), elles sont capables de situer par elles-mêmes les
conditions de leurs expériences. Comme l’indiquent Duits et van Zoonen (op. cit.) :
If the task of the feminist intellectual, as Gill suggests, is not to say "I see" after such
reflections, but to conceptualize, situate and locate it in a wider context, look at patterns and
variability, examine silences and exclusions (p. 77), then this is exactly what the girls are
already doing themselves. This is not to suggest that all girls are feminist theorists in
disguise, […] but that it is imperative to examine which tactics girls use in their everyday
lives to "make do" (de Certeau, 1984) with all the forces that bear on them. Such analysis
can only take place by interviewing and observing girls in their own everyday surroundings,
and not by framing them from the remote shores of the kind of feminism that Gill advocates.
(Duits et van Zonnen : 2007, p. 166)
Ce dernier point nous semble important, car il comprend en son sein une réponse à une dernière critique
d’une conception de l’agentivité « authentique », qui ne serait pas basée sur des diktats sociaux marchands,
idéologiques ou sur d’autres « valeurs » (ce qui nous semble impossible). En effet, on a critiqué le modèle
libéral d’agentivité basé sur l’authenticité comme « an empowerment model that in the end makes a teen girl
26 Maxwell et Aggleton (2011) déplorent justement le fait qu’il y ait un écart entre les écrits théoriques et les écrits
empiriques qui portent sur l’agentivité (p. 306).
27 Gill craint entre autres qu’en mettant trop l’accent sur l’agentivité, la « voix » et le pouvoir des filles, l’on crée une
nouvelle « forme de régulation » de leurs corps et qu’ainsi l’on utilise cette nouvelle norme pour mieux les exploiter
(2008).
56
alarmingly, solely responsible for her own sexuality » (Lamb : 2010a, p. 302)28. Une pression perçue comme
injuste, parce que même les femmes adultes luttent contre les difficultés liées au pouvoir, à l’agentivité et
à l’empowerment (Lamb : 2010a, p. 302-303; Peterson : 2010, p. 312; Gill : 2012, p. 743-744), et d’autre part
indue, parce que le fait d’exercer de l’agentivité n’implique pas nécessairement qu’il faille obligatoirement ne
pas se conformer aux diktats commerciaux :
Women are frequently called upon to perform a normative version of commercialized
sexually attractive and sexually empowered femininity, which is portrayed as proof and
practice of a women’s self-confidence (Gill, 2008[b]; Pitcher, 2006). Purporting to protect
girls from this corrupt adult world of sex and commercializaton, commentators who have
legitimate concerns about the representations of gender and sexuality in commercial media
unfairly demand that girls completely resist the social norms such representations reflect
and produce. (Hasinoff, op. cit., p. 263)
Mahmood (2005) partage un point de vue similaire, et estime que ce discours libéral tend à considérer
l’agentivité comme « the capacity to realize one’s own interest against the weight of custom, tradition,
transcendental will, or other obstacles » (p. 8) et donc ainsi à comprendre l’agentivité sexuelle dans un cadre
binaire et restrictif basé sur les principes de la subordination (des hommes sur les femmes) et de la subversion
(des normes par les femmes), alors que les choix humains ne se font pas nécessairement selon une logique
de répression et de résistance (p. 14)29. « While acts of resistance to relations of domination constitute one
modality of action, they certainly do not exhaust the field of human action », ajoute-t-elle dans sa préface de
2012 (p. X).
On aurait donc tort d’adosser sans cesse les agissements des femmes à une grille d’analyse féministe très
libérale30, d’autant plus que cette « grille » répond à des critères occidentaux parfois mal adaptés aux
différents contextes sociaux des filles et des femmes :
The fiction of colorblind racism and of postfeminism is that everyone has the same amount
of agency; that there are no structural constraints that produce fundamentally different sets
of options for different people. Yet, this belief is in tension with normative assumptions about
28 Dans leur article commun, Lamb et Peterson précisent : « We do not want to place a burden on the newly sexually
active or merely sexually curious teen to become a super-teen with regard to sexuality (always knowing and
understanding her desires, pleasure-seeking, and strongly able to say no or yes in a myriad of positions ans situations. »
(2012, p. 705) Nous considérons aussi cette pression comme indue et laissant peu de place à l’ambivalence et à
l’indécision. 29 Voir aussi à ce sujet Maxwell et Aggleton (2010 et 2011). 30 C’est-à-dire qui considérerait l’agentivité seulement en opposition aux normes sociales. Nous sommes consciente que
le terme « féminisme libéral » peut référer à différents courants (Lamoureux : 2007), mais ici, le terme fait surtout
référence au féminisme libéral américain tel que décrit par Hasinoff (2010).
57
agency that are still connected to race, gender, class, and age. People at a structural
disadvantage are often seen as less autonomous because of their supposedly greater
susceptibility to social or biological forces. However, they are still held responsible for their
problems and trangressions, even though their agency is constructed as deficient when
compared against that of the white male liberal subject. (Hasinoff, op. cit., p. 21)31
Cette critique a aussi été maintes fois soulevée par Gill pour justifier son souhait que l’on cesse d’utiliser (ou
du moins, dit-elle, qu’on « complexifie ») les termes « agentivité » (2007, 2008a, 2008b, 2009b), « choix »
(2007, 2008a, 2009b), « autonomie » (2007, 2008a), « empowerment » (2012), « sexualisation » (2009a,
2011, 2012), et « pornification » (2011, 2012) :
The terms are too general; they are difficult to operationalize and therefore to use
analytically. More than this, they tend to homogenize, ignoring differences and obscuring the
fact that different people are "sexualised" in different ways and with different meanings.
Sexualization does not operate outside of processes of gendering, racialization and
classing, and works within a visual economy that remains profoundly ageist, (dis)ablist and
heteronormative (Gill : 2009[a et b]). (Gill : 2011 et 2012)
Mais comme nous l’avons souligné à maintes reprises, l’agentivité et la sexualité sont socialement situées; et
ce contexte social inclut les considérations de genre, de race, de classe, d’âge, de capacité corporelle et
d’hétéronormativité.
Cherchant elle aussi à éviter (ou plutôt à contourner) les difficultés à utiliser le concept d’agentivité sexuelle
dans la recherche sur la sexualité des filles, Lamb (op. cit.) suggère aussi que l’on suspende les efforts
à essayer de le définir et de l’opérationnaliser, et propose pour le remplacer un modèle basé sur la
« mutualité », c’est-à-dire un modèle où les valeurs libérales d’égalité constituent un idéal à atteindre pour les
deux partenaires, mais où cet idéal ne serait pas « perfectionniste » (p. 61-62). Elle suggère ainsi de déplacer
l’accent porté sur la sexualité vers la relation entre les partenaires :
It contextualizes their sexuality in relationship. And if it asks them to be choosers within
a context of limited choices, it’s choosing to give as well as to receive, to seek pleasure
within and from without, to love, have sex or play, with an eye towards fairness and an
underlying ethos of caring and compassion. (p. 62)
31 Voir par exemple Bell (2012) pour une illustration de comportements agentiques ou non agentiques dans le contexte
ougandais.
58
Si l’on ne peut qu’approuver un tel idéal d’égalité, d’équité et de compassion, il nous apparaît cependant
justement un peu trop idéaliste de se servir uniquement d’un tel cadre pour comprendre et décrire les activités
sexuelles des filles comme des garçons. Comme on l’a vu, les expériences sexuelles sont souvent traversées
de rapports de pouvoir auxquels il est impossible d’échapper et parfois difficile de résister, et ces expériences
ne se font pas toujours avec un partenaire disposé à être attentionné, aimant ou même avec lequel on est en
relation. D’autre part, même lorsqu’on a trouvé le partenaire « idéal », les relations sexuelles ne se font pas
nécessairement sans anicroche, même lorsque les deux partenaires sont très bien attentionnés. Comment
alors concevoir ces difficultés? Par ailleurs, un tel modèle de mutualité rendrait impossible toute analyse de la
sexualité qui sort de ce cadre relationnel : la masturbation, le rapport à son corps, l’assumation de son
orientation sexuelle, etc. Et le fait, justement, d’arriver à « bien choisir » son partenaire relève d’une sphère
sexuelle qui est antérieure à la relation, de même que le fait de se connaître, de comprendre ses désirs et de
savoir les exprimer.
L’agentivité permet de prendre en compte ces différentes dimensions de la sexualité, car elle ne se limite pas
à identifier et à décrire ce qui semble « bien » et ce qui semble « moins bien », mais englobe les notions de
confiance en soi, de réflexivité, d’action et de mise en relation.
Bref, à l’inverse de Lamb et de Gill, l’aspect infiniment complexe du libre choix et de l’agentivité ne nous
apparaît pas justifier le souhait de ces auteures (et de certaines de leurs pairs32) de le mettre de côté. Cette
complexité, au contraire, constitue sa richesse et fonde une grande partie de son intérêt. En accordant du
crédit à la capacité de décision et d’action des participantes de même qu’en accordant du crédit à leur parole
et à leurs réflexions, on réalise qu’il existe bel et bien, en effet, des situations où les jeunes participantes sont
capables d’exercer de l’agentivité, et d’autres où cet exercice est plus difficile. Ces situations où les
participantes admettent ou expriment ne pas avoir agi comme elles auraient voulu le faire, ou encore celles où
32 Corsianos (2007), par exemple, adopte une posture extrême en estimant que l’agentivité ne pourrait véritablement
s’exprimer que dans une société où la catégorie « femmes » perdrait toutes ses caractéristiques essentialisantes; bref,
dans un monde utopique où les catégories « femmes », « hommes », « gais », « hétérosexuels » et « bisexuels »
cesseraient complètement d’exister (p. 870 et 881) . Les actes sexuels des femmes sont selon elle déterminés par des
forces sociales dont elles sont inconscientes, et ces forces trouvent leur origine dans la pornographie. Ainsi, même celles
qui rejettent les conceptions dominantes de la sexualité sont affectées par la prégnance de la pornographie, qu’elles en
soient conscientes ou non ou qu’elles le reconnaissent ou non (p. 877-878). Et comme les femmes « fail to see the
manipulation of power » (p. 879), on ne peut se fier à la description qu’elles pourraient faire de leur vie sexuelle. En
d’autres mots, leur propre « vérité » est impossible (p. 880).
Bien qu’il y ait une part de « vérité utopique » dans cette position, celle-ci se base sur une définition de l’agentivité
sexuelle qui est aux antipodes de la nôtre. Corsianos définit en effet l’agentivité sexuelle comme « la capacité de faire
des choix pour soi […] sans égards aux forces extérieures dominantes et aux conséquences sociales » (p. 865, trad.
libre, nos italiques), alors que nous concevons au contraire l’agentivité comme des choix articulés à l’intérieur de ces
forces sociales.
59
elles se sont senties dépourvues de pouvoir, méritent une attention de la part des chercheurs et des
chercheuses pour en déterminer les causes, non pas dans le but de juger les jeunes femmes ou de confronter
leurs actions à une certaine norme, mais plutôt dans le but de débusquer les conditions qui permettent ou
rendent plus facile l’exercice de leur agentivité, selon leur propre interprétation, afin qu’elles puissent jouir
d’une sexualité qu’elles jugent saine et qui les rend heureuses. D’ailleurs, en observant de plus près les
études empiriques qui ont, dans les faits, utilisé le concept d’agentivité pour rendre compte des expériences
des adolescentes et des jeunes femmes, on constate très rapidement l’intérêt et l’utilité du concept (voir par
exemple Bryant et Schofield : 2007).
Ainsi, suivant les traces d’Albanesi (2009 et 2010), d’Allen et al. (2008), de Duits et van Zoonen (2006, 2007)
et des autres chercheurs et chercheuses qui se sont servis du concept, nous sommes plus intéressée
à observer « comment » l’agentivité s’exprime dans la vie sexuelle des jeunes femmes plutôt qu’à se
demander si cette agentivité est une illusion philosophique – le « comment » plutôt que le « si » auxquels
faisaient référence Berger (1991) et Hitlin et Elder (2007). Il importe de garder en tête que le concept
d’agentivité n’est pas binaire, s’exerce de façon différente par chacun, et que les choix des jeunes femmes
d’agir de telle ou telle manière sont effectués à l’intérieur de structures sociales qui, elles, peuvent être
critiquées, mais pas au détriment des filles. Le choix, par exemple, de se dénuder pour la télévision et de jouer
le rôle de femmes soumises, non pour son plaisir personnel, mais pour l’attention masculine, peut être
critiquable d’un point de vue féministe, car de tels comportements perpétuent l’inégalité de pouvoir entre les
sexes, et on devrait pouvoir le dire. Cependant, la critique devrait viser les valeurs dominantes, qui elles, sont
le fait du patriarcat (et non le comportement des filles qui en sont le reflet et la conséquence).
2.3 Opérationnaliser le concept d’agentivité sexuelle
Même au-delà des débats sur la normativité, on peut d’emblée reconnaître une certaine limite
à opérationnaliser l’agentivité sexuelle. Ce concept est très complexe, comme on vient de le voir, et sa
complexité ne s’arrête pas à ses sous-entendus idéologiques; elle est aussi présente dans son
opérationnalisation. Comment utiliser le concept de façon concrète? La démonstration de l’agentivité ne se
situant pas dans le comportement en soi, mais dans la volonté d’adopter ce comportement et de l’exercer, il
est inutile de dresser une liste a priori de comportements jugés « agentiques » ou « non agentiques ». Pour
déterminer si les participants et les participantes de diverses études exerçaient de l’agentivité sexuelle, les
auteurs ont souvent eu recours à des questionnaires et des entrevues qui ont occasionné certains problèmes.
Averett et al. (2008) ont demandé à 14 jeunes étudiantes universitaires entre 18 et 22 ans d’écrire de façon
narrative leurs expériences sexuelles au regard des thèmes spécifiques du désir et de l’agentivité sexuelle
(p. 333). On leur a aussi demandé d’écrire sur les façons dont elles croyaient que leurs parents ou leur famille
60
avaient pu influencer leurs attitudes ou leurs comportements sexuels. On les a ensuite rencontrées pour une
entrevue semi-structurée dont le guide d’entretien comportait notamment les questions suivantes : « What
aspects of your sexual development do you consider positive? Negative? », « How do you think your parents’
attitudes and or behaviors affect your sexual desire? Sexual agency? » et « Regarding your parents’
communications, attitudes and behaviors, what was beneficial for your development? What was harmful?
Why? » (p. 334).
Si cette recherche semble s’être plutôt bien déroulée, on a cependant observé chez les participantes une
tendance à confondre « agentivité personnelle » et « agentivité sexuelle », puisque presque toutes
répondaient « oui » à la question « Vous considérez-vous comme possédant de l’agentivité sexuelle? », alors
que le reste de leurs entretiens indiquait le contraire. Les auteurs ont cru qu’une telle réponse pouvait résulter
d’une confusion entre les deux concepts, ou d’une croyance qu’ils pouvaient être interchangeables (Averett et
al. : 2008, p. 339). Ils ont aussi attribué cette apparente confusion à la dissonance observée dans les discours
parentaux, qui encouragent l’expression de l’agentivité en favorisant l’empowerment (« tu peux accomplir tout
ce que tu désires ») dans toutes les sphères de la vie de leur adolescente, sauf dans celle de la sexualité
(p. 338).
Allen et al. (2008) ont aussi utilisé une méthode basée sur la narration. Les participants, garçons et filles,
devaient écrire sur leurs expériences en tant qu’agents sexuels, et devaient réfléchir aux façons dont ils
percevaient que le fait de faire des erreurs les avait aidés ou leur avait nui dans le développement de leur
agentivité. Cette demande s’intégrait dans un cours sur la sexualité que donnaient les auteurs. Avant
l’exercice de l’écriture, dans le but d’encourager la réflexivité des étudiants et étudiantes et de leur fournir un
« contexte commun » pour réfléchir aux questions demandées, on leur a fait visionner un documentaire de 45
minutes sur la façon dont certains jeunes prenaient des décisions sur le plan sexuel et les conséquences que
pouvaient avoir ces décisions dans le contexte familial (p. 520). On leur a ensuite posé trois questions, dont
l’une était :
Sometimes the best learning experiences come from a mistake. Did you make any mistakes
in regard to your sexual decision-making when you were a teen that you learned from? If so,
please describe the experience, and who or what helped you through it. (p. 521)
Les réponses ont ensuite été classées selon quatre « codes substantifs » référant à la perception de leur
exercice d’agentivité sexuelle : « I am in control », « I am experiencing and learning », « I am struggling but
growing » et « I have been irresponsible about my sexual behavior » (loc. cit.). Étaient placés dans la dernière
catégorie ceux et celles qui avaient eu des comportements sexuels risqués, et qui, au final, n’admettaient pas
éprouver de remords ou ne s’engageaient pas dans un « processus réflexif » sur leurs actions (p. 526).
61
On peut rapidement remarquer un problème dans l’opérationnalisation du concept de l’agentivité des auteurs.
En mettant l’accent sur l’ « erreur » ou le remords plutôt que sur les motivations et les désirs, et en formulant
spécifiquement l’une de leurs trois questions de façon à ce qu’on doive répondre « J’ai fait des erreurs » ou
« Je n’ai pas fait d’erreurs », le risque est grand d’induire de sérieux biais dans les résultats. Comment les
participants et participantes doivent-ils considérer ce qu’est une « erreur »? En d’autres mots, au regard de
quelles normes commet-on une erreur? Est-ce un comportement qui n’est pas en accord avec la norme
imposée par les scripts de genre ou encore avec la morale? Cette façon d’arrimer le concept d’agentivité
à quelque chose de concret, mais de forcément orienté ne nous semble pas être le moyen le plus productif ni
le plus neutre d’entamer la discussion sur l’agentivité sexuelle. D’ailleurs, les participants qui disaient avoir fait
une erreur mais qui ne montraient pas de regret étaient classés de façon plus ou moins automatique dans la
catégorie « non agentique », alors même qu’ils n’avaient que peu ou pas l’occasion d’exprimer pourquoi ils ne
ressentaient pas de remords (on peut faire une erreur, s’en rendre compte et ne pas le regretter tout en
entreprenant des actions agentiques).
D’autres auteurs encore, comme O’Sullivan et al. (2006), ont établi un instrument composé de différentes
affirmations auxquelles les participantes devaient acquiescer ou s’opposer selon une échelle de degrés. Les
chercheurs établissaient la conception de la sexualité des participantes (sexual self-concept) selon trois
facteurs, l’un d’eux étant l’agentivité sexuelle. Les deux autres référaient à une attitude négative envers la
sexualité (negative sexual affect) et à la capacité des jeunes filles d’agir sur leur désir (sexual arousability).
Les attitudes qui, selon les auteurs, reflétaient l’agentivité sexuelle étaient représentées par des affirmations
telles que : « I sometimes think about who I would want to have sex with », « When I decide to have sex with
a guy, it will be because I wanted to have sex with him and not because he really wanted me to have sex with
him », « I like to let a guy know when I like him » et « Flirting is fun, and I am good at it » (p. 144). Les
chercheurs ont trouvé que l’agentivité sexuelle était positivement corrélée avec des attitudes d’estime de soi
sexuelle positive (sexual self-esteem) et négativement corrélée avec des attitudes reliées à l’abstinence,
comme « Sex is nasty » et « I think I am way too young to have sex ».
On peut facilement reconnaître que l’instrument est discutable, puisqu’il assimile automatiquement certaines
opinions (« I think I am way too young to have sex ») à un manque d’expression d’agentivité, alors que l’on
a vu, par exemple, que le fait de reconnaître ses propres limites et même de choisir l’abstinence pouvait être
le signe de comportements agentiques, selon les motivations justifiant ce choix.
En raison de la difficulté à établir l’agentivité sexuelle d’une personne sans une bonne connaissance de ses
expériences et de ses convictions, la méthode des entretiens semi-dirigés doit être privilégiée. Smette et al.
(2009), qui ont combiné la méthode par questionnaires à celle des groupes de discussion pour leur étude, ont
62
d’ailleurs considéré que les données obtenues par leur enquête par questionnaires offraient une vision
simpliste de la difficulté avec laquelle les jeunes acquièrent de l’agentivité (p. 357-358).
Pour notre part, et comme nous le verrons plus en détail dans la section « Méthode » (p. 95), nous avons,
dans le cadre de notre étude, demandé à des adolescentes de décrire leurs expériences de la recherche
d’informations sur la sexualité dans un blogue. Leurs descriptions des circonstances de leurs recherches
d’informations (notamment par Internet) ont permis de déterminer jusqu’à un certain degré leur niveau
d’agentivité sexuelle. Mais c’est par le moyen des entretiens semi-dirigés qui ont suivi l’écriture des blogues
qu’il a été possible de poser des questions plus pointues permettant réellement de déterminer leur niveau
d’agentivité en diverses situations. Pour bien circonscrire ce « niveau », nous leur avons posé différentes
questions sur leurs expériences sexuelles et sur leur perception de la distribution du pouvoir dans leurs
couples ou avec leur(s) partenaire(s). Pour ce faire, nous avons utilisé l’image de la balance : en effectuant
des mains le geste de la balance (une main représentant la participante interviewée et l’autre, ses partenaires
sexuels), nous avons demandé aux participantes de notre recherche de nous dire si elles estimaient qu’elles
avaient eu plus, moins ou autant de pouvoir que leur partenaire sexuel dans une situation précise. L’exercice
était répété pour comparer diverses situations ou diverses relations amoureuses entre elles (ou encore
différentes périodes d’une même relation) afin de déterminer l’évolution de leur agentivité et les circonstances
permettant plus facilement l’expression de cette agentivité. Cet « outil » que nous avons utilisé pourrait être
une bonne façon d’opérationnaliser le concept d’agentivité, car il permet d’entamer la discussion sur la propre
perception du pouvoir des participantes au sein de leurs relations, mais aussi par rapport à elles-mêmes, car
comme l’ont trouvé Maxwell et Aggleton (2011), « young women view power not only as a resource that is
shared (usually unequally) between partners, but also as a capacity of the self » (p. 310).
Nous avons effectué cet exercice généralement en fin d’entrevue, une fois que la participante nous avait déjà
confié le déroulement de plusieurs de ses expériences sexuelles et se sentait plus en confiance. (Comme
nous le verrons plus loin, ce qu’elles avaient écrit sur le blogue servait généralement de base aux entrevues.
Une fois la discussion bien entamée, nous avons posé des questions sur la qualité de leurs relations avec
leurs partenaires sexuels.)
C’est donc par l’analyse du discours des participantes qu’il nous semble possible de déterminer en quelles
circonstances celles-ci font preuve d’agentivité sexuelle et en quelles circonstances l’expression de cette
agentivité est moins aisée. Quelles justifications sont mises de l’avant pour expliquer un comportement? La
participante utilise-t-elle des adjectifs positifs, neutres ou négatifs lorsqu’il est question de son propre pouvoir?
Démontre-t-elle, par l’exposé de ses expériences, la capacité de communiquer clairement ses désirs?
À l’instar d’Albanesi (2009), en déterminant a priori ce qui constitue, à notre avis, le signe d’un comportement
63
agentique et d’un comportement non agentique, il devient possible de classer certains comportements décrits
par les participants comme étant agentiques ou non.
Cependant, il est important de souligner que nous disons bien que c’est le signe qu’il est possible de
déterminer a priori, et non le comportement lui-même, car un même comportement, un même acte effectué
dans des conditions identiques, pourrait très bien être un comportement agentique pour une fille et être non
agentique pour une autre. Supposons, par exemple, qu’une jeune fille décide de dormir avec un inconnu un
soir, et qu’elle explique ensuite les raisons qui l’ont poussée à dormir avec cet inconnu par « Je ne voulais pas
décevoir. Je savais ce qu’il attendait de moi et je n’ai pas voulu refuser ses avances. » Son comportement est
beaucoup moins agentique que si elle avait dit : « J’ai toujours eu l’impression que, petite, je faisais ce qu’on
attendait de moi. J’ai toujours suivi la norme et écouté mes parents. Cette journée-là, je voulais faire quelque
chose pour moi, pour le fun, sans me soucier des qu’en-dira-t-on, et je l’ai fait. C’était ma décision, alors je ne
regrette rien. » Même si la deuxième jeune fille – fictive – adopte un comportement qui est modulé par la
norme (puisqu’opposition directe à celle-ci), on peut difficilement qualifier son comportement de non
agentique.
Supposons maintenant qu’elle ait dit, pour expliquer son geste : « J’avais eu une dure année. Mon copain
m’avait quitté quatre mois plus tôt, et je voulais penser à autre chose. Le partenaire que j’ai eu était beau,
gentil, et, en plus, j’avais la certitude qu’il ne m’embêterait pas le lendemain avec l’idée d’une relation
potentielle. J’avais envie de lui, je ne voulais pas me poser de questions, alors j’ai fait exactement ce que je
voulais, sur le coup, mais je l’ai regretté un peu le lendemain. Dans le fond, je ne voulais pas tant que ça. »
Les raisons qui poussent alors cette jeune fille à coucher avec un inconnu sont différentes de la première.
L’une ne veut pas se soucier de l’opinion des autres (ce qui est un point positif), alors que l’autre « ne veut pas
se poser de questions » et se trouve au final en contradiction avec ses désirs ou ses valeurs. Si le fait de ne
pas se poser de questions s’apparente à une légère déresponsabilisation, on ne peut pas non plus qualifier le
comportement qu’elle a eu de non agentique, puisqu’elle « fait ce qu’elle veut », et que ce qu’elle veut, c’est
précisément « ne pas se poser de questions ». S’il semble alors difficile de juger si le comportement est
agentique ou non, c’est qu’une conception binaire de l’agentivité (agentique/non agentique) est insuffisante
pour qualifier les comportements.
Toutefois, il est possible de décrire les choix faits par la participante et de les opposer, ou de les comparer,
à d’autres choix qu’elle a faits, soit de façon antérieure ou postérieure à l’événement en question. Supposons
par exemple qu’elle dise, un peu à la manière de l’une des participantes d’Allen et al. (2008, p. 525), qu’en
raison de cet acte qu’elle avait plus ou moins voulu, elle s’est sentie d’une certaine manière obligée de suivre
le même pattern avec les partenaires suivants, et ce, jusqu’à ce qu’une amie lui fasse réaliser que le fait de
faire une « erreur » une fois, ne la catégorisait d’aucune manière et qu’elle pouvait cesser son comportement
64
dès qu’elle le voulait. Le comportement (général) de la participante est alors beaucoup moins agentique que si
elle avait dit : « Je me suis sentie très mal le lendemain et les jours qui ont suivi. Je me suis demandé
pourquoi et j’en suis venue à la conclusion que c’était parce que je n’avais pas su arrêter la relation quand je
n’ai plus voulu y participer. J’ai alors décidé qu’à l’avenir, je me coucherais plus avec un garçon juste "comme
ça", parce que j’ai réalisé que ça ne me convenait pas. Je n’ai plus agi de cette manière depuis. » Le
comportement de la deuxième participante est alors plus agentique que la première, en ce qu’elle est plus
réflexive sur ses motivations et ses limites. Toutefois, le « niveau » d’agentivité de la première n’est pas non
plus fixe : la discussion qu’elle a eue avec son amie indique qu’elle pourrait bien être sur la voie vers une
amélioration de son agentivité.
Si j’ai choisi de montrer de tels exemples (fictifs, sauf pour celui tiré d’Allen), c’est pour montrer à quel point
l’exercice de la qualification d’un comportement comme « agentique » ou « non agentique » est difficile. Car
tout n’est pas blanc ou noir dans l’expression de l’agentivité, qu’elle soit sexuelle ou autre. Et l’acquisition de
l’agentivité sexuelle, tout comme l’acquisition de l’autonomie et du sens des responsabilités (Smette et al., op.
cit., p. 355), se fait de façon fragmentée et non linéaire. Plus encore, le niveau d’agentivité d’une personne
peut être situationnel et contingent à certains éléments. Par exemple, une fille qui en toutes autres situations
démontre un niveau d’agentivité élevé, pourrait perdre tous ses moyens devant un garçon (ou une fille) pour
qui elle a le béguin, ou qui se montre particulièrement manipulateur ou insistant.
Et lorsqu’on ajoute à l’équation toute la dimension de la culture – Butler (2004) estime qu’en raison des liens
intrinsèques entre l’agentivité et la culture, l’individu seul n’est pas responsable à 100 % de son agentivité,
puisqu’il est constitué à l’intérieur de sa culture –, la question se complexifie encore plus. La question de
l’agentivité devient alors véritablement « traversée de paradoxes » (p. 3, notre traduction)33.
C’est pourquoi toute activité visant à rendre compte de l’exercice de l’agentivité sexuelle des adolescents et
des adolescentes ou encore des adultes doit se baser sur une interprétation fine et nuancée du discours des
participant(e)s. Il importe de mettre en contexte, de décortiquer les situations, de nuancer les propos, mais
surtout, de faire confiance au discours des filles. À l’instar de Duits et van Zoonen (2007), « [w]e advocate
listening to girls and understanding their choices as they themselves frame them, before articulating them with
wider social forces. » (p. 166). Ne pas le faire ouvrirait la porte à une interprétation déjà biaisée qui pourrait
avoir tendance à discréditer la parole des jeunes femmes en l’opposant à une perception préexistante basée
sur le principe de fausse conscience. Cela ne veut pas dire, toutefois, que l’interprétation du chercheur ou de
la chercheuse est impossible; elle est en quelque sorte « suspendue » pour un certain temps afin de permettre
33 Pichler, par exemple, a démontré par une étude du langage sexuel d’adolescentes britanniques d’origines diverses que
leurs conceptions de la sexualité et leurs façons d’en parler étaient fortement liées à leur culture, leur classe et leur race
(p. 68-95, dans Sauntson et Kyratzis : 2007).
65
aux participantes d’expliquer par elles-mêmes leur réalité. D’ailleurs, comme on l’a vu avec Duits et van
Zoonen et comme nous allons le voir nous-même dans nos résultats, les jeunes participantes sont tout à fait
capables de discuter par elles-mêmes des cas où elles ont fait preuve d’agentivité et des cas où elles ont eu
l’impression de ne pas avoir été capables d’exercer leur agentivité.
Cette perception du pouvoir, selon certains auteurs, serait suffisante. Maxwell et Aggleton (2010, 2011)
proposent d’ailleurs de laisser une place prépondérante à l’émotion et aux sensations des participant(e)s pour
évaluer ou jauger leur accord avec leurs actions ou leurs décisions. Ils ont trouvé dans leur étude sur
l’agentivité chez de jeunes femmes que les façons dont elles concevaient leur corps, dont elles se sentaient et
dont elles interprétaient leurs sensations corporelles jouaient un grand rôle dans leur interprétation de leur
agentivité sexuelle. Comme Bell (2012) l’explique : « Young people consider their feelings, become involved in
relationships and experience enhanced feelings of self-esteem, self-confidence, peace of mind and
companionship. These feelings reinforce the decision made and help maintain the relationship » (p. 293) et
donc participent également à la conception de leur agentivité. Cette conception correspond beaucoup au
critère d’« embodied sexuality » décrit par Lamb (2010a) (qu’elle a d’ailleurs critiquée), mais à la différence
que le critère se fonde ici empiriquement sur l’interprétation des jeunes filles, et non seulement sur les
théorisations des chercheuses. Il nous semble donc d’autant plus justifié de l’utiliser.
Nous décrivons avec plus de détails la façon dont nous nous sommes prise pour analyser le discours des
participantes à la section « Analyse » (p. 114).
2.4 Quelques mots sur le consentement sexuel
La notion libérale de consentement est une construction relativement récente (Haag : 1999, p. 181; Bourke :
2007, p. 11-12). Plus tôt dans l’Histoire, les femmes étaient considérées comme une propriété des hommes;
ainsi, lorsqu’il y avait viol ou abus, l’incident était considéré comme un crime envers le père ou le mari de la
victime, et non envers la femme elle-même (Bourke, op. cit., p. 9-12; Johnson et Sigler : 1997, p. 5-13; Cocca :
2004, p. 11). Il était également crucial de prouver que la femme n’avait pas volontairement participé à l’acte
sexuel avec un autre homme, sans quoi celle-ci pouvait être punie pour le viol (Donat et D’Emilo : 1992, dans
Johnson et Sigler : op. cit., p. 7). Mais comme l’accent était porté sur la propriété, le consentement tel qu’on le
conçoit aujourd’hui n’était pas un concept ou un facteur pertinent à prendre en compte (Johnson et Sigler : op.
cit., p. 9).
Entre les années 1940 et 1970, la question du consentement s’est complexifiée, mais pas de façon tout à fait
égalitaire. La notion selon laquelle le viol pouvait être « provoqué » par la victime (par exemple si la femme ou
la fille avait été particulièrement séductrice ou ambivalente) a fait en sorte qu’on a souvent fait porter par les
victimes la responsabilité du viol (Bourke, op. cit., p. 72, citant la psychiatre Seymour Halleck : 1972). Ainsi,
66
« Rather than all women’s speech acts being treated as untrustworthy, particular types of women were singled
out for disbelief. » (Bourke, op. cit., p. 71). Le comportement antérieur des femmes pouvait alors servir de
« preuves » contre elles; par exemple, si la victime avait déjà eu des relations sexuelles avant l’incident, si elle
avait bu, ou si elle avait agi de « façon provocatrice », elle pouvait être considérée comme ayant donné, d’une
certaine manière, son consentement (Bourke, op. cit., p. 75).
Le consentement des filles est encore aujourd’hui également entravé par le fait que l’on croit souvent à tort
que leur « non » veut parfois dire « oui » (Bourke, op. cit, p. 67). Cette assomption était si répandue qu’on la
retrouvait même dans les journaux médicaux : le médecin reconnu Horatio Storer, alors vice-président de
l’Association médicale américaine, écrit en 1868 que les femmes « coquettes et dragueuses » pouvaient
donner « une apparence de refus » de façon à « augmenter la valeur des faveurs finalement accordées »
(Storer : 1868, p. 58, dans Bourke, op. cit.). Et plus récemment, le criminologue David Abrahamsen écrivait en
1960 : « Often a woman unconsciously wishes to be taken by force […] we sometimes find this seductive
inclinations even in young girls » (Abrahamsen : 1960, p. 161, dans Bourke, p. 73).
Bourke explique : « The driving force behind this myth is the belief that women generally want "it", and the
more "passionnate" the man, the better. » (Bourke, p. 67) Un mythe sexiste que l’on retrouve et qui est
propagé dans les films, les opéras, les romans Harlequin, pour n’en nommer que quelques-uns, et qui tient
pour acquis que les femmes veulent être, secrètement ou inconsciemment, « violées » (p. 68) : « Films are
equally complicit in propagating the idea that women always consent because they long for sex. » (p. 69)
Aujourd’hui, la question du consentement reste un concept complexe dont les contours sont souvent
considérés flous, mais qui pourtant comporte d’importantes implications légales (Hasinoff, op. cit., p. 86). Les
définitions légales ont entre autres pour but de protéger des abus les jeunes se trouvant sous ce qu’on nomme
« l’âge de consentement », qui peut varier entre 10 et 12 ans aux États-Unis, mais qui a été élevé à 16 ans au
Canada (ibid., p. 86-87). La loi assume que sous l’âge de consentement, les jeunes sont trop immatures
émotionnellement et intellectuellement pour fournir un consentement éclairé (ibid., p. 86).
Ce consentement « légal » a des implications dans la façon dont les cours juridiques considèrent le viol. Le fait
d’avoir des rapports sexuels avec une fille trop jeune pour fournir son consentement « éclairé » selon la loi est
punissable par la prison : on considère qu’il y a eu non-consentement au même titre que si la partenaire était
inconsciente, même si l’on peut reconnaître qu’il n’y a pas nécessairement eu viol (Cowling : 1998, p. 22). Des
zones grises apparaissent dès lors : ainsi, les rapports sexuels entre une partenaire dont l’âge se situe tout
juste sous l’âge de consentement et un homme dont l’âge se situe juste au-dessus sont souvent considérés
non problématiques, alors que les rapports sexuels entre une fille du même âge et un homme de 50 ans sont
considérés comme très graves (loc. cit.). Dans de nombreux états américains et même au Canada, l’âge de
consentement pour des actes homosexuels peut aussi différer de l’âge de consentement pour des actes
67
hétérosexuels, puisque l’âge de consentement pour des relations anales est en certains endroits plus élévé
que pour des relations vaginales (Hasinoff : 2010, p. 90 et Gotell : 2010).
Mais au-delà des lois, la définition même de consentement est problématique et parsemée de zones grises. Il
peut, par exemple, y avoir viol sans l’usage de la force; en revanche, les rapports qui ne constituent pas un
viol peuvent quand même avoir lieu sans consentement. De même, le fait d’obtenir un consentement verbal
peut ne pas être garant du consentement véritable. Mais qu’est-ce alors que le consentement?
L’une des zones grises les plus problématiques est celle des relations ou des tentatives de relations sexuelles
dans le cadre d’une rencontre romantique (et où il pourrait y avoir ce que les anglophones appellent « a date
rape »). Pour définir le date rape, ou encore le viol en général, plusieurs études se basent sur le critère « when
you didn’t want to », c’est-à-dire sur le fait pour l’un des partenaires de ne pas vouloir certains actes sexuels
(Cowling, op. cit., p. 45; Peterson et Muehlenhard : 2007, p. 73). On trouve alors dans les questionnaires des
questions comme : « Have you had a man attempt sexual intercourse (get on top of you, insert his penis)
when you didn’t want to? » (Cowling, p. 45).
Selon Cowling (1998), une telle question est très problématique, car selon lui, « not all unwanted sex is
coercive » (p. 52). La notion « when you didn’t want to », dit-il, peut être utile pour faire réfléchir aux incidents
qui pourraient inclure le viol, mais ne peut constituer à elle seule un critère pour différencier les cas de viols
des autres, car « people frequently have sex when they don’t want to in circumstances no-one would describe
as rape. » (p. 45)
En effet, le simple fait qu’il y ait eu insistance d’un des partenaires n’indique pas nécessairement qu’il y eut
tentative de viol. Prenons l’exemple d’un garçon qui, à la fin d’une soirée, embrasse une fille sur son divan, et
ensuite essaie de monter sur elle avant d’être convaincu qu’elle veut réellement dire « non », et qui arrête.
« Most people would […] see this, done in a gentle and friendly way, as akin to verbal persuasion than a rape
attempt, » explique Cowling (op. cit., p. 45).
Cowling poursuit en donnant l’exemple d’un couple dont les deux partenaires sont fatigués, mais dont l’un
d’eux doit partir le lendemain à l’étranger pour le travail, et celui d’un couple dont l’un des partenaires
préférerait regarder la télévision, mais ne veut pas non plus rater une occasion de faire l’amour avec son
partenaire lorsque c’est possible. Donner son consentement avec une certaine réticence, ou l’exercer pour
« l’autre », soit pour le réconforter ou lui faire plaisir, constituent des occasions où on peut faire l’amour
« when [we don’t] want to », mais on ne peut non plus considérer de telles situations comme des exemples de
« date rape ».
Un exemple encore plus problématique serait celui où une femme, après avoir passé une soirée agréable en
compagnie d’un homme, se sentirait en quelque sorte « obligée » de rencontrer les attentes du garçon (p. 44).
68
Si l’homme a beaucoup dépensé pour l’occasion et que la femme se sent un peu « coupable » qu’il se soit
donné tant de mal, ou si la femme a consommé de l’alcool, il peut être encore plus difficile de définir s’il y a pu
y avoir « date rape » ou non. Pourtant, ce « sentiment d’obligation » peut également être présent lorsqu’il
s’agit d’un partenaire régulier, comme on vient de le voir avec les exemples précédents. Si, en plus, l’homme
s’est montré un peu insistant, ou s’il a essayé de convaincre sa partenaire, la situation peut devenir encore
plus complexe.
S’il apparaît si difficile de trancher, c’est que le modèle dominant (en recherche ou dans la société en général)
selon lequel on cherche à déterminer s’il y a eu viol serait, selon Peterson et Muehlenhard (2007)
unidimensionnel et dichotomisant, c’est-à-dire que le sexe est conçu comme étant soit voulu et consensuel,
soit non voulu et non consensuel, ce qui ne laisse aucune place à l’ambivalence : « Sex is often
conceptualized either as wanted and consensual or as unwanted and nonconsensual, reflecting an implicit
model of wanting that is unidimensional and dichotomous and that conflates wanting and consenting. […] Real
life, however, is often more complicated. » (Peterson et Muehlenhard : 2007, p. 72).
Le principal problème d’un tel modèle, outre sa binarité, est son inadéquation avec la réalité. Dans leur article
datant de 2000, l’une de leurs participantes tenait ce discours :
I was thinking, "I really shouldn’t be doing this," but on the other hand, almost like the devil
on one shoulder and the angel on the other, I was saying, "He is so cute and I really like him
and he will probably think I was just leading him on if I don’t do it." (Peterson et
Muehlenhard : 2000)
Cette participante, comme beaucoup d’autres, exprime à la fois des raisons de vouloir des rapports avec le
garçon et des raisons de ne pas vouloir ces rapports, alors même que le reste de son discours montrait qu’elle
n’avait pas consenti à ces rapports (Peterson et Muehlenhard : 2007, p. 72).
Selon Peterson et Muehlenhard, « [t]he dominant model […] equates wanting sex with consenting to sex »
(p. 73). Cependant, en faisant équivaloir les deux, on crée des situations problématiques qui gênent toute
conception de sexualité consensuelle mais non voulue, et vice-versa. Par exemple, lorsque l’on demande
à des participants de parler d’occasions où des rapports sexuels étaient « non voulus » (unwanted), et que l’on
traite de façon équivalente « wanting » et « consenting », on traite alors trop souvent leurs réponses comme
des incidents où la sexualité n’était pas consentie, ce qui, selon les auteures, rend toute conceptualisation de
rapports non voulus, mais consensuels impossible (p. 73). Cela a pour conséquence, dans les études, que
plusieurs participantes qui ne qualifient pas leurs expériences comme un viol sont considérées comme des
victimes « non reconnues » (« unacknowledged victims », p. 74).
69
L’inverse est également vrai : le fait d’équivaloir le consentement au fait de « vouloir » implique que les
rapports sexuels doivent être « non voulus » sans aucune ambiguïté pour être qualifiés de viol (p. 73). Ainsi,
plusieurs victimes réelles qui souscrivent à cette définition pourraient être portées à croire que leur expérience
ne répond pas aux critères du viol. Pourtant, même les rapports non consentis peuvent être voulus de
certaines manières et non voulus d’autres façons (p. 74).
Selon Peterson et Muehlendard, les filles exprimeraient souvent une certaine ambivalence lorsqu’il est
question de sexualité. Elles citent à ce propos O’Sullivan et Gaines (1998), qui ont observé que l’ambivalence
dans le contexte sexuel était très courante : dans leur étude basée sur des questionnaires auxquels ont
répondu 202 hommes et femmes, plus de 80 % des répondants ont rapporté avoir déjà été ambivalents quant
à leur désir de s’engager dans une activité sexuelle. Elles citent également Tolman et Szalacha (1999), qui, de
façon similaire, ont observé que des jeunes filles pouvaient parfois ressentir une certaine ambivalence quand
elles avaient l’impression que leur corps disait « oui », mais que leur tête disait « non » (p. 31-32).
Selon Peterson et Muelhenhard, il est important que l’on reconnaisse cette ambivalence et, plus encore, que
l’on accorde aux filles le droit d’être ambivalentes (Muehlenhard et Peterson : 200534 et Peterson : 2010).
En considérant le fait de « vouloir » et de « consentir » comme deux concepts distincts, on permet cette
ambivalence, et ce, d’une façon qui ne victimise pas inutilement les filles. Peterson et Muehlenhard distinguent
les deux concepts de cette manière : « to want something is to desire it, to wish for it, to feel inclined toward it,
or to regard it or aspects of it as positively valenced; in contrast, to consent is to be willing or to agree to do
something. » (Peterson et Muehlenhard : 2007, p. 73; leurs italiques)
En distinguant les deux concepts, l’on peut clarifier la question du viol; surtout, l’on peut annihiler le
raisonnement selon lequel il n’y aurait pas viol si la victime « a voulu » la relation d’une quelconque manière :
"She wanted it" is a common rape theme (Payne et al., 1999). These rape myths claim that,
if a woman wanted sex, she must have enjoyed it, and it wasn’t really rape. In contrast, we
are saying that it doesn’t matter if she wanted sex; if she did not consent, it was rape.
Distinguishing between wanting and consenting can clarify the confusion and self-blame
that some rape victims feel. (Muehlenhard et Peterson : 2005, p. 18)
Pour illustrer les conséquences de cette distinction, les auteures ont dressé ce tableau, qui montre en quelles
circonstances la conception du viol est possible :
34 Muehlenhard et Peterson (2005) parlent même de « missing discourse of ambivalence » (p. 15).
70
a. The Dominant Model:
"Sex is either wanted and consensual or
unwanted and consensual."
Wanted Unwanted
Consensual Not rape NOT POSSIBLE
Nonconsensual NOT POSSIBLE Rape
b. The Dominant Model:
"Rape is unwanted and nonconsensual sex."
Wanted Unwanted
Consensual Not rape Not rape
Nonconsensual Not rape Rape
c. The New Model:
"Wanting and consenting are distinct concepts;
Nonconsensual sex is rape."
Wanted Unwanted
Consensual Not rape Not rape
Nonconsensual Rape Rape
Tableau 1 : Les modèles dominants de la conception du viol et le nouveau modèle proposé par Peterson et Muehlenhard (2007, p. 72)
Ce tableau, tiré de Peterson et Muehlenhard (2007), montre les modèles dominants et en propose un nouveau
pour comprendre et illustrer la différence entre des rapports voulus et des rapports consensuels, de même que
ses implications dans la définition du viol. Sous le modèle dominant, les rapports sexuels voulus mais non
consensuels sont impossibles (a) ou encore sont possibles mais ne constituent pas un viol (b). Le nouveau
modèle proposé, en ne confondant pas les principes de « vouloir » une relation et d’y « consentir », permet
une définition du viol plus englobante (c) (p. 72).
De cette façon, par exemple, une jeune fille qui montre des signes d’excitation et qui exprime du désir sexuel
envers son partenaire, mais qui refuse la relation sexuelle pour une raison quelconque (elle doit étudier pour
71
un examen le lendemain, par exemple), ne consent pas à la relation; ainsi, si le partenaire fait fi de son
absence de consentement, il y a viol. À l’inverse, par exemple, une jeune fille qui n’est pas certaine de vouloir
une relation sexuelle (elle est vierge et ne sait pas si elle désire vraiment une relation sexuelle, par exemple),
mais qui répond « oui » lorsque son partenaire lui demande si elle accepte de faire l’amour avec lui, consent
à la relation. Pour cette raison, il n’y aurait pas viol, même si elle démontre effectivement de l’ambivalence.
Plus encore, selon les deux auteures, il faudrait considérer le fait de « vouloir » et de « consentir » comme des
concepts multidimensionnels se situant sur une échelle de gradation plutôt que comme des concepts
unidimensionnels s’opposant dans une dichotomie claire (p. 74). Le fait de consentir, par exemple, peut se
conceptualiser de deux manières : de façon interne (« an internal feeling of willingness ») et de façon
comportementale (« verbal or physical expression of willingness », p. 76). De façon similaire, le fait de vouloir
certains rapports ne signifie pas nécessairement vouloir les conséquences qui s’y rattachent. À l’inverse, on
peut « vouloir » une activité sexuelle pour des raisons reliées à ses conséquences : accroître l’intimité dans le
couple, faire plaisir à son partenaire, atténuer des tensions, etc. (Muehlenhard et Peterson ; 2005, p. 17)
D’ailleurs, comme l’indiquent Basson et al. (2005), les femmes rapportent couramment une variété de raisons
pour participer à des activités sexuelles, raisons qui n’ont pas toujours un lien avec le désir : « …increasing
emotional closeness with the partner, increasing the women’s own sense of well-being, to feel more attractive,
more attracted to the partner, to conceive, and only sometimes to satisfy her own sense of sexual
desire/sexual need » (p. 292).
On peut aussi vouloir « un peu » une activité sexuelle, ou la vouloir de façon plus intense. Les participantes de
l’étude de Peterson et Muehlenhard (2007) ont par exemple utilisé l’entièreté de l’échelle de « wantedness »
que les auteures ont construite, et non pas seulement les positions extrêmes de cette échelle (p. 81).
Au final, Peterson et Muelhenhard espèrent que le fait de distinguer le désir du consentement devrait entraîner
des conséquences légales et cliniques plutôt favorables à la sexualité des filles :
The distinction between wanting sex and consenting to sex could have important
implications for rape victims, clinicians, victim advocates, and juries. When rape is
conceptualized as unwanted sex, any evidence that the victim wanted to have sex (e.g.,
flirtatious behavior prior to the rape, sexual arousal during the rape) can be interpreted to
mean that the incident was not really rape. As a result, rape victims may experience blame
or guilt for having "asked for it," even thought they did not consent to it. […] It seems
constructive to expand current thinking about rape to say that if the victim did not consent, it
is rape, even if the victim wanted to have sex. Rape is about the absence of consent, not
the absence of desire – an idea that could be liberating to many rape victims. (p. 82 et 85)
72
Au Canada, la loi sur le consentement sexuel fonctionne depuis 1992 selon un modèle affirmatif et actif. On
a remplacé l’ancienne devise selon laquelle « no is no » par un discours selon lequel « only yes is yes »
(Gotell : 2008 et 2010). Le but était de s’assurer que les hommes prennent les précautions nécessaires pour
s’assurer avoir obtenu le consentement verbal explicite de leur partenaire pour tout acte et pour toutes les
étapes d’un acte sexuel. Mais ce modèle est basé sur des principes de prévention du risque (on traite ainsi la
sexualité comme si le viol était un danger constant dans la vie des filles, où l’agentivité n’est possible que par
la prévention et la responsabilisation [2008, p. 878]). Selon Gotell, ce modèle est très problématique, puisque,
d’une part, il réitère les normes de genre selon lesquelles ce sont les hommes qui initieraient la sexualité et,
d’autre part, confirme que le consentement est l’apanage des filles, qui, selon cette approche, restent
passives. De plus, en mettant l’accent sur le consentement, on déplace insidieusement la responsabilité du
viol sur les victimes. Et si la victime n’est pas une « victime idéale », elle devient presque, en bout de ligne,
responsable de sa victimisation (Gotell : 2008, p. 879-880 et 2010; voir aussi Hasinoff : 2010).
Les liens entre l’expression du désir (« wantedness ») et du consentement sont donc complexes, et les
possibilités d’agentivité des filles sont, dans ce contexte, inextricablement liées à ces notions, car elles
agissent dans une société où les scripts de genre les positionnent dans un rôle où elles doivent sans cesse se
questionner à cet égard. Et, à l’inverse, comme elles ne vivent pas non plus dans un univers où les
comportements suivent nécessairement ces scripts, elles font face et doivent réagir à des situations
auxquelles elles peuvent ne pas s’être attendues. Comment réussissent-elles alors à exercer leur agentivité et
à négocier leur consentement? C’est en partie à ces questions que nous avons voulu répondre au chapitre 6,
et particulièrement aux sections 6.2.3 et 6.2.4 (pages 240 et 243).
2.5 Rappel des points importants
Voici un rappel des points importants vus dans ce chapitre :
L’agentivité réfère à la capacité d’agir de façon compétente, raisonnée et réfléchie (Smette et al. :
2009, p. 370).
L’agentivité sexuelle réfère de façon plus particulière à la prise d’initiative, à la conscience du désir et
au sentiment de confiance et de liberté dans l’expression de sa sexualité (Averett et al. : 2008,
p. 332). Les notions de « contrôle » ainsi que du sentiment d’avoir « droit » au désir et au plaisir y
sont également centrales (Hammers : 2009).
L’agentivité sexuelle, comme beaucoup d’autres aptitudes, s’acquiert de façon fragmentée et non
linéaire (Smette et al. : 2009, p. 355).
Même si l’agentivité sexuelle constitue en général une valeur plutôt libérale, la définition que nous
adoptons de l’agentivité sexuelle permet également aux femmes d’adopter des comportements ou
73
des attitudes en apparente contradiction avec ces valeurs libérales (par exemple, décider sciemment
de n’initier que très peu la sexualité).
Bien que nous proposions une façon de comprendre et d’opérationnaliser le concept d’agentivité, sa
définition n’est pas « fixe » : on ne peut en effet prévoir à l’avance certains comportements
à considérer « agentiques » ou « non agentiques ». Toutefois, on peut prévoir quelques signes
d’agentivité, qui portent plus sur la volonté et les motivations des agents que sur les comportements
en tant que tels (et ce, même si l’idée d’action est essentielle au concept d’agentivité; il ne suffit pas
de vouloir agir de façon agentique, mais il faut aussi pouvoir le faire [Bulot et Delevoy-Turrelu : 2007,
p. 603; Albanesi : 2010; Maxwell et Aggleton : 2010 et 2011]).
Les chercheuses féministes ne s’entendent pas sur l’utilité du concept, certaines craignant que celui-
ci, au final, instaure une « nouvelle norme » sexuelle à atteindre (Gill : 2007, 2008b; Lamb : 2010a et
2010b; Duits et van Zoonen : 2007; Hasinoff : 2010, etc.).
Les participantes, comme l’ont montré Duits et van Zoonen (2007) et comme nous le verrons aussi,
sont tout à fait aptes à discuter par elles-mêmes des situations où elles ont fait preuve d’agentivité et
des situations où, à l’inverse, son exercice s’est révélé plus difficile.
Le concept de consentement entretient des liens directs avec celui d’agentivité, puisque le fait
d’exprimer son consentement (ou son absence de consentement) fait partie des comportements
auxquels concourt l’agentivité. Mais pour bien comprendre et appliquer le concept de consentement,
il importe de faire d’importantes distinctions : on a vu que le fait de vouloir des relations sexuelles ne
signifie pas nécessairement y consentir, et vice versa (Peterson et Muehlenhard : 2007; Muehlenhard
et Peterson : 2005).
On a vu également que les filles peuvent se montrer ambivalentes quant à leur désir et leur
consentement. Cette ambivalence, selon Peterson et Muehlenhard, doit être reconnue comme valide
(op. cit.).
Ce que nous venons de voir au sujet de l’agentivité sexuelle nous mène à la deuxième partie de notre cadre
théorique, qui concerne les usages que font les jeunes femmes d’Internet en lien avec la sexualité. Pour
étudier la façon dont les jeunes femmes et les adolescentes utilisent Internet pour répondre à leurs questions
sur la sexualité, il importe de discuter des théories qui portent sur les usages d’Internet et des méthodes qui
permettent d’étudier ces usages. Après un bref portrait des résultats des études récentes sur les usages
d’Internet par les adolescents, nous discutons dans le prochain chapitre du développement du courant de la
« sociologie des usages », un champ d’études qui s’est intéressé à ce qu’on fait avec les différents outils
74
« techniques » de communication. Nous analyserons particulièrement les études des usages du Web, et nous
verrons comment les choix méthodologiques des chercheurs qui s’intéressent à ces usages influent
directement sur la qualité et la validité des résultats de leurs études.
3 Internet et la quête d’informations sexuelles
Les adolescent(e)s et les jeunes adultes d’aujourd’hui sont de très grands usagers du Web. Les étudiant(e)s
à l’université et au collège, en particulier, se trouvent parmi les plus grands utilisateurs (Jones : 2002, dans
Buhi et al.: 2009). Le Web fait partie de leur vie académique autant que de leur vie sociale (Hoffman et al. :
2004, dans Buhi et al.: 2009). Ils s’en servent pour garder contact avec leurs amis, regarder des émissions
télévisées, converser dans des chatrooms, télécharger de la musique et trouver de l’information concernant
une multitude de sujets, dont la santé et la sexualité. Selon une étude du Pew Research Center's Internet
& American Life Project (Lenhart et al. : 2010), 72 % des jeunes adultes âgés entre 18 et 29 ans auraient
utilisé Internet pour trouver de l’information relative à la santé – et les jeunes femmes chercheraient des
réponses à ce type de questions en ligne encore plus avidement que les jeunes hommes. Chez les
adolescents âgés entre 12 et 17 ans, 31 % auraient utilisé Internet pour trouver de l’information relative à la
santé (soit encore plus que ceux ayant déclaré avoir déjà cherché des paroles de chansons), et 17 % auraient
fait des recherches sur des thèmes gênants, comme sur des questions relatives à la santé sexuelle (soit plus
encore que ceux ayant déjà utilisé Twitter). Ici encore, les filles feraient un plus grand usage du Web que les
garçons pour ces questions, et cet usage augmenterait avec l’âge autant pour les garçons que pour les filles
(les proportions fournies ici augmentant respectivement à 38 % et 19 % en ne considérant que les adolescents
âgés entre 14 et 17 ans, garçons et filles confondus) (Pew Research Center's Internet & American Life
Project : 2011; Lenhart et al., op. cit.).
Internet semble constituer, d’ailleurs, le moyen de choix pour obtenir des informations sur des sujets
embarrassants ou délicats (Gray, Klein et al.: 2002; Suzuki et Calzo : 2004; Cotten et Gupta : 2004;
Borzekowski et Ricket : 2001). Cependant, très peu de recherches ont porté sur la façon dont les jeunes
comme les adultes utilisent le Web pour la recherche d’information sur de tels sujets, ou encore sur ce qu’ils y
trouvent (Buhi et al.: 2009). La plupart datent du début des années 2000 (Jones et Biddlecom : 2011, p. 113),
plusieurs se limitent aux populations nord-américaines et certaines se contredisent sur certains aspects,
notamment sur l’utilité du Web et sur sa fiabilité (Hetsroni : 2007, p. 135). D’autres encore mettent l'accent
surtout sur les effets négatifs possibles d’Internet (Döring : 2009, p. 1089) de même que sur la capacité des
jeunes à trouver l’information pertinente sur le sujet de la sexualité (Buhi et al., 2009; Boubée : 2008).
Si plusieurs études, par le moyen de sondages en particulier, ont tenté de quantifier différents aspects de la
consultation du Web dans le but d’y trouver des informations sur la santé ou la sexualité, peu d’entre elles ont
privilégié une approche qualitative de cette activité. Encore plus rares sont les études qui ont porté sur les
motivations menant les usagers à faire des recherches ou encore sur leur satisfaction des contenus trouvés;
outre quelques discussions sur l’opinion des jeunes concernant la crédibilité des sites Web consultés et
quelques commentaires sur la frustration que pouvaient ressentir les usagers lorsqu’ils n’arrivaient pas
76
à trouver une information facilement (voir Gray, Klein et al. : 2005), la question des usages reste largement
sans réponse. En fait, nous avons pu répertorier une seule étude faisant place à l’impression des utilisateurs
du Web quant à son contenu; il s’agissait d’une étude « d’observation », c’est-à-dire qu’elle visait à observer
comment de jeunes étudiants fouillaient le Net pour y trouver des informations précises relatives à la santé
sexuelle (Buhi et al.: 2009). Cette étude, cependant, comporte de nombreuses lacunes, comme nous le
verrons plus loin.
Nous n’avons donc qu’une vague idée de l’expérience concrète des adolescents, des adolescentes et des
jeunes adultes de l’utilisation du Web pour obtenir des informations sur la sexualité. Comment jugent-ils les
informations trouvées? Que recherchent-ils avec ou sans succès? Quelles sont les questions auxquelles ils
aimeraient plus facilement trouver réponse? Quel(s) type(s) de réponses souhaitent-ils obtenir? Portent-ils une
attention particulière aux images ou aux vidéos (font-ils, par exemple, une recherche d’images sur Google)?
Préfèrent-ils les portails thématiques, les blogues, les forums de discussion? Comment intègrent-ils dans leur
vie les contenus trouvés? Pour répondre à ces questions, une étude des usages du Web est nécessaire; ce
sont d’ailleurs précisément à ces questions que nous avons voulu tenter de répondre. Notre question de
recherche principale porte donc sur les usages : quels sont les usages que font les adolescentes et les jeunes
femmes du Web concernant la sexualité? Nous nous intéressons à cette question en adoptant une
perspective particulière qui est celle de l’agentivité des usagers : leur autonomie, leur empowerment et leurs
façons de s’investir dans leur sexualité en y prenant un rôle actif. De façon à ancrer ce questionnement dans
un contexte social plus large, nous nous sommes intéressée de façon plus particulière à l’agentivité sexuelle
des jeunes femmes; nous avons donc intégré, dans notre devis de recherche, une façon d’interroger les
participantes de notre étude sur leur volonté et leur capacité à exercer leur agentivité sexuelle dans diverses
situations réelles.
Avant de présenter la méthode que nous avons utilisée, le profil des participantes et les résultats que nous
avons obtenus, il importe de faire un retour sur les postures théoriques qui ont façonné les études sur les
usages depuis le début des années 1980 jusqu’à aujourd’hui. Nous discuterons également de la technologie
de la communication qu’est Internet et des choix méthodologiques de quelques études antérieures ayant porté
sur les usages d’Internet en lien avec la sexualité.
3.1 La sociologie des usages
Le courant de la sociologie des usages s’est développé en suivant l’expansion des TIC, c’est-à-dire des
technologies de l’information et de la communication. Les premières études portaient sur les usages
domestiques en France du vidéotex, un service de télécommunications qui permettait d’envoyer, de recevoir
et de visualiser sur écran cathodique des pages pouvant contenir des graphiques. En France, on désignait
souvent par Télétel ou Minitel cette technologie, mais ces noms désignaient plutôt le service lui-même et le
77
terminal. Puis, peu à peu, les études sur les usages se sont étendues à d’autres technologies comme le
cédérom, le magnétoscope, la micro-informatique domestique, puis enfin les réseaux d’entreprise, la
téléphonie mobile et Internet (Jouët : 2000; Flichy : 2008; Massit-Folléa : 2002).
Contrairement aux études anglo-saxonnes, le courant français de la sociologie des usages ne s’est pas
développé à la suite d’études sur les médias de masse (télévision, radio, etc.). Et même si elles s’attardaient
aussi aux usages des nouveaux « objets » de la communication, la question des usages ne constituait pas
l’objet principal de la discipline naissante des sciences de l’information et de la communication (Jouët : 2000,
p. 491). Dans les pays anglo-saxons, on s’intéressait en effet surtout à la réception des médias de masse; les
deux courants ont d’ailleurs connu « le même déplacement d’intérêt vers l’usager que les analyses concernant
l’audience » ou la réception (Chambat : 1994, p. 263). Par ailleurs, même si les nouveaux objets de
communication étaient effectivement des médias, « ils sort[ai]ent du modèle classique de la diffusion des
médias de masse qui bénéficiaient déjà alors d’une accumulation de savoirs théoriques et de modèles
d’analyse » (loc. cit., voir aussi Massit-Folléa : 2002).
Les premières études en France ont souvent été le fait de centres de recherches sur les technologies et ont
été financées par l’industrie ou par l’État, désireux de mettre en œuvre de « grands projets techniques »
(Jouët : 2000, p. 492). L’intention était donc d’abord d’étudier les nouveaux objets de la communication sous
l’angle du profit et de la production. Mais très tôt dans la discipline, on rejeta la perspective techniciste et et
chercha plutôt à « mett[re] au jour le rôle actif de l’usager dans le modelage des emplois de la technique » et à
« comprendre les réactions du corps social face à l’arrivée des nouveaux objets de communication » (Jouët :
2000, p. 493).
Le rôle actif de l’usager commençait déjà à être étudié, notamment en raison du courant anglo-saxon des
« usages et gratifications », qui commençait à interroger non plus « ce que les médias font aux individus »
mais ce que « les individus font des médias » (dans une perspective fonctionnaliste qui a été par la suite
critiquée en raison de son caractère réducteur) (Katz et al.: 1973; Jouët : 2000, p. 493; Proulx : 2006; Flichy :
2008)35.
La notion d’audience active était donc déjà présente, mais c’est avec les études sur la réception et les cultural
studies qu’on appréhenda la réception « comme une activité complexe » et située socialement (Jouët : 2000,
35 Jeanneret (2007) conteste en partie cette formule consacrée, qui lui semble réductrice et erronnée, comme s’il fallait
choisir impérativement entre l’une et l’autre des positions. « Il n’est pas plus juste d’étudier ce que les gens font aux
médias que de se demander ce que les médias font aux gens. Ce qui pose problème, estime-t-il, c’est l’extériorité
supposée entre deux entités que la médiatisation rend indissociable. » (p. 10). On verra un peu plus loin que la notion
d’usage, par la « double médiation » qu’elle met à jour, ramène un peu des deux axes, sans pour autant tomber dans le
piège des « effets » des médias ou du déterminisme.
78
p. 493-494). Les études de la réception ont influencé dans une certaine mesure le courant de la sociologie des
usages, mais comme les recherches de ce dernier courant ont été menées par des sociologues provenant de
diverses disciplines (Jouët : 200, p. 492), cette influence n’a été que « très relative »; ce sont surtout les
« nouvelles approches sociologiques » s’intéressant principalement aux principes d’autonomie des individus
(p. 494-495) qui ont influencé le courant de la sociologie des usages : « …les recherches vont en effet
démontrer que les individus s’approprient [les TIC] à des fins d’émancipation personnelle […],
d’accomplissement dans le travail […] ou à des fins de sociabilité […]. » (p. 495)
On observa donc comment les usagers « contournent » les usages prescrits par les concepteurs, suivant
notamment de la théorie des « arts de faire » de Michel de Certeau (1980). S’intéressant principalement au
langage et à la lecture, de Certeau a étudié l’usage que font les consommateurs des livres, de la langue et
d’autres objets culturels, plus précisément à ce qu’ils « fabriquent » de ces objets; bref, aux « manières de les
employer » (p. 11). Selon de Certeau, le lecteur n’est pas passif; au contraire, il se réapproprie le texte de
l’auteur, il y « braconne », et, par diverses « ruses », y instille du plaisir (p. 24-25) : « [La lecture] transforme la
propriété de l’autre en lieu emprunté, un moment, » à la manière d’un locataire dans un appartement (p. 25).
Par les différentes « tactiques », les lecteurs, locuteurs, et usagers de toutes sortes opèrent un changement
dans l’ordre normal du pouvoir et laissent dans l’ignorance les institutions, les industries et les producteurs
quant à ces réappropriations et ces usages. En effet, selon de Certeau, « [l]’ordre régnant sert de support
à des productions innombrables, alors qu’il rend ses producteurs aveugles sur cette créativité (ainsi de ces
"patrons" qui ne peuvent voir ce qui s’invente de différent dans leur propre entreprise » (p. 25, les italiques de
l’auteur). C’est la « réussit[e] du "faible" contre le plus "fort" » (p. 22).
Cette vision de de Certeau36 selon laquelle les tactiques des usagers n’obéissent à aucune loi (ou presque)
(p. 76) est centrale dans la sociologie des usages, qui, très tôt, a cherché à s’éloigner d’un déterminisme
technique stérile qui élude la dimension sociale de l’usage, et selon lequel « les usages découlent quasi
naturellement de l’offre des produits et techniques » (Jouët : 2000, p. 496). Mais selon cette dernière auteure,
l’écueil inverse serait également vrai, certaines études n’ayant « pas toujours résisté au piège du
déterminisme social » qui porte une attention démesurée à l’aspect « producteur du social dans la construction
des pratiques de la communication » (loc. cit.).
36 Yves Jeanneret (2007) apporte des précisions sur la revendication de l’ouvrage de de Certeau à la théorisation de
l’usage, qu’il estime « banalisée ». Bien qu’il estime que de Certeau ait vu juste en situant la notion d’usage sur l’« idée
de confrontation à des objets qui ont été institués par d’autres », Jeanneret précise que « [l’]usage n’est pas pour de
Certeau une réalité proprement médiatique » (p. 14), et que certaines notions de la pratique de la lecture devraient être
mieux comprises dans certaines études de la sociologie des usages, afin de mieux situer cette revendication. Pour plus
de détails, voir son article de 2007 de même que Proulx : 1994.
79
C’est que, explique-t-elle, « la médiation de la technique n’est pas neutre et la matérialité de l’objet infiltre les
pratiques » (loc. cit.). C’est ce que la sociologue appelle « la double médiation »; ainsi, tout comme les
usagers sont à même de pouvoir travestir les usages imaginés par les concepteurs, cette réappropriation est
limitée par les fonctions pour lesquelles les objets ont été conçus. Mais les usagers, par leur « créativité
ordinaire » (Millerand, Proulx et Rueff : 2010, p. 3-4), participeraient tout autant, sinon plus, au développement
et à l’établissement des pratiques.
Cette notion de la double médiation, mieux comprise aujourd’hui, arrive à constituer un véritable « cadre
d’analyse » des usages des outils de la communication (p. 497), bien que « le contenu et le statut théorique de
la notion » des usages soient « loin de faire consensus » (Chambat : 1994, p. 263). Et ce, si bien que sa
définition reste floue, malgré les différentes théories auxquelles elle participe :
Il serait vain de prétendre en apporter ici une définition, car sa signification résulte d’options
théoriques qui la dépassent : elle participe en effet de débats qui opposent, en sociologie,
l’agent et l’acteur [sic], les niveaux micro et macro, la technique et le social, l’empirisme et la
théorie critique. Elle constitue donc moins un point d’appui de l’analyse qu’un nœud de
difficultés, d’autant que s’ajoutent les incertitudes sur la communication comme objet
scientifique. Notion carrefour, l’usage peut cependant être l’occasion de confrontations entre
les disciplines qui se partagent le champ de la communication. (Chambat : 1994, p. 263)
Malgré tout, selon Jouët, on retrouve certains consensus dans la compréhension et l’utilisation du concept
dans les différentes études sur le sujet, le plus important étant que l’usage constitue un construit social (voir
aussi Chambat : 1994, p. 253 et Massit-Folléa : 2002) :
…la sociologie de l’innovation a bien montré qu’il n’existe pas d’extériorité de la technique
à la société, l’usage étant incorporé, entre autres dimensions du social, dans la conception
même de l’objet technique. […] La construction de l’usage ne se réduit dès lors pas aux
seules formes d’utilisation prescrites par la technique qui font certes partie de l’usage, mais
s’étend aux multiples processus d’intermédiations qui se jouent pour lui donner sa qualité
d’usage social. (Jouët : 2000, p. 499)
En d’autres mots, l’outil « Internet » ne fait sens qu’à travers ses usages, qui sont intrinsèquement sociaux, et
qui sont « indissociables » des espaces où ils prennent forme (Nifle : 2001, en ligne). Les deux dimensions
(sociale et technique, même si la dimension technique est elle-même sociale) qui forment sa double
médiation, participent l’une et l’autre pour orienter et définir les usages. Comme l’explique Chambat (1994) :
La notion d’usage ne saurait donc acquérir quelque densité et échapper à un schéma
adaptatif sans mettre à distance un économisme et un technicisme qui se renforcent
80
mutuellement dans l’oubli du social. Mais, à l’inverse, elle ne saurait faire silence sur les
contraintes techniques en adhérant à un déterminisme social tout aussi réducteur. (p. 252)
Par ailleurs, les usages ne se constituent pas dans le « vide social » (Chambat : 1994, p. 253), mais
s’insèrent dans des pratiques préexistantes, que la diffusion des TIC « prend en charge et réaménage » (loc.
cit.) :
Faut-il rappeler que le développement de nouveaux usages n’émerge pas ex nihilo, que le
bouleversement de l’espace professionnel ou domestique ne se produit pas brutalement?
L’apparition de nouvelles pratiques se greffe sur le passé, sur des routines, sur des
survivances culturelles qui perdurent et continuent à se transmettre bien au-delà de leur
apparition? (Mallein et Toussaint : 1994, dans Jouët : 2000, p. 500)
Il ne faut pas oublier, par exemple, qu’Internet n’est pas apparu en rupture avec les autres objets de la
communication, mais s’est plutôt inscrit en filiation et en complémentarité avec d’autres d’autres outils : le fax,
le vidéotex, la téléphonie mobile, etc. (Jouët : 2000, p. 501, Massit-Folléa : 2002) Ce « défaut » de replacer
l’apparition des nouvelles technologies dans le contexte des anciennes amène d’ailleurs bien des auteurs
à « tomber dans le piège de ce que Jacques Perriault appelle [avec humour] les "toujours nouvelles
technologies" » (Perriault : 1989 et 1999, dans Massit-Folléa : 2002, p. 8).
Et si les appropriations sont à la base personnelles (l’usager adopte certaines « manières de faire » sans
nécessairement savoir ce que font ses voisins), ces pratiques s’instaurent et s’implantent donc dans le social
de façon déstructurée, mais dans un « spin » social où les significations sociales et l’adoption de certaines
pratiques viennent à se stabiliser. L’appropriation est donc à la fois « subjective et collective37 » (Jouët : 2000,
p. 502, les italiques sont de l’auteure), et les pratiques s’instaurent de façon désordonnée et exploratoire
jusqu’à ce l’objet et l’usage deviennent tous deux « ordinaire[s] » (Jouët, p. 501).
Cependant, même l’usage le plus « trivial » « se greffe sur des dimensions secondaires très importantes » : il
s’inscrit notamment « dans les rapports sociaux de pouvoir qui traversent les structures sociales » (Jouët :
2000, p. 501 et 509). Ces structures, ce sont celles de la famille, de l’entreprise, du patriarcat, ou même de la
société en général (loc. cit.).
Par ailleurs, par sa double dimension technique et sociale, le développement des savoirs sur l’usage ne peut
se faire sans un double ancrage « à la fois théorique et empirique » (Chambat : 1994, p. 250; voir aussi Jouët :
2000, p. 502). Josiane Jouët déplore d’ailleurs « la montée de l’empirisme » dans les études portant sur
37 Elle est même aussi cognitive, car elle implique des savoir-faire et des connaissances (Jouët, loc. cit.).
81
l’usage, qui, trop souvent, sont « décontextualisées de toute problématique » (p. 511). Puisque chaque
nouvelle technologie constitue une mine d’objets de recherche, les études deviennent éclatées, éparpillées, et
« ne se fondent pas toujours sur une capitalisation des travaux antérieurs », mais tendent plutôt plutôt
à « "redécouvr[ir]" des acquis » (p. 512; voir aussi Champagne et Combessie : 1985 et Massit-Folléa : 2002).
Plus encore, le « défaut » le plus commun des études sur les usages est de concevoir de façon réductrice la
notion d’usage et d’échouer à ancrer leur problématique dans son cadre social plus large :
Les études se focalisent sur la collecte de quantités de données qui témoignent parfois
davantage des utilisations des produits et des services que des pratiques sociales, car
l’usage ainsi observé n’est pas analysé dans son épaisseur sociale, dans sa relation avec
d’autres pratiques de sociabilité, de travail, de loisir, et comme enjeu de pouvoir, de
transformation et de négociation au sein des structures sociales qui lui préexistent comme
la famille ou l’entreprise. (Jouët : 2000, p. 512; nos italiques)
La notion d’usage devient, sans cette inscription dans le social, purement « instrumentale », alors même que,
comme on l’a vu, « l’usage [ne] peut se suffire à lui-même » (Jouët, p. 213). Comme l’illustre Roger Nifle :
Les usages de l'automobile ne sont pas réductibles à l'utilisation des techniques de la
mécanique, à l'utilisation d'un réseau routier, au transport et à la distribution de
marchandises. [De la même façon,] [l]es usages d'Internet ne sont pas réductibles
à l'utilisation des technologies de l'informatique et de l'information, à l'utilisation des
techniques de la communication et des télécommunications, au transport et à la distribution
de données, sons et images. Les usages majeurs sont et seront des pratiques
personnelles, sociales et professionnelles rendues possibles et facilitées par Internet.
(Nifle : 2001)
Bref, la définition de l’usage dépasse « le simple niveau des déclarations des usagers concernant leur propre
pratique » (Proulx : 2006, p. 13) ou, en d’autres mots, la simple « utilisation » ou le simple « emploi » (Jouët :
2000, p. 213, Champagne et Combessie : 1985 et Massit-Folléa : 2002). Déjà de Certeau, qui utilisait le mot
« usage » pour décrire les « arts de faire », reconnaissait que le mot posait problème : « Le problème tient
dans l’ambiguïté du mot, car dans ces "usages", il s’agit précisément de reconnaître des "actions" (au sens
militaire du mot) qui ont leur formalité et leur inventivité propres et qui organisent en sourdine le travail familier
de la consommation. » (de Certeau : 1980, p. 77) C’est qu’en français, le terme « usage » est ambivalent et
plutôt peu précis. En effet, le sens qu’on donne en français au terme « usage » est très proche de ceux des
termes « use » en anglais ou « uso » en italien, mais il n’y a pas une correspondance parfaite, et cette parité
peut entraîner quelques mésinterprétations (Jeanneret : 2007, p. 8). En effet, « "use" en anglais est à la fois
82
substantif (souvent traduit en français par "usage") et verbe (souvent traduit par "utiliser", verbe auquel
correspond le substantif "utilisation") » (Jeanneret, loc. cit.). Même si le terme est ambigu dans les deux
langues, en anglais on réfère par le même mot à deux réalités distinctes, alors qu’avec le mot « usage », en
français, on peut comprendre « utilisation » souvent parfois au détriment de sa dimension plus large.
Par ailleurs, le courant de la sociologie des usages étant dès l’origine et par définition interdisciplinaire, cette
interdisciplinarité est nécessaire pour que les études soient basées sur des « problématiques solides »
(Jouët : 2000, p. 513, voir aussi Massit-Folléa : 2002).
D’autre part, la qualité des modèles théoriques développés et des résultats observés dépend en grande partie
de la méthodologie des études. Comme même les postures théoriques de l’usage se développent autant
empiriquement que théoriquement, la qualité des méthodes de recherche est cruciale et indissociable de la
qualité des théorisations qui en découlent. Pour bien comprendre le monde des usages (et éviter sa restriction
à l’utilisation), le courant privilégie une approche qualitative afin de les décrire avec « finesse » : « les formes
d’appropriation des techniques […] ne peuvent se contenter de généralisations statiques et statistiques quand
il faudrait rendre compte des processus » (Jouët : 2000, p. 514). Si « la démarche quantitative se révèle riche
pour donner à l’usage une dimension plus macrosociale », il importe de recadrer et de contextualiser ces
données pour « tenter de dégager la signification des actes de communication au niveau individuel et le sens
social des usages auprès de groupes sociaux spécifiques » (Jouët : 2000, p. 514, voir aussi Champagne et
Combessie : 1985 et Massit-Folléa : 2002).
L’usage, par ailleurs, peut être appréhendé selon différents axes de recherche, les plus populaires étant la
généalogie des usages (qui s’intéresse à l’aspect historique de la formation des usages), le processus
d’appropriation (qui met l’accent sur l’autonomie des usagers), l’élaboration du lien social (c’est-à-dire les
aspects interpersonnels de l’usage, dont les échanges en ligne et la formation de microsociétés), et
l’intégration des usages dans les rapports sociaux (l’observation de l’insertion des usages dans la matrice de
certaines structures sociales). Ces courants de recherche ne sont toutefois ni fixes ni formellement formés, et
la recherche ne se limite pas à ces quelques axes; d’ailleurs ceux-ci rassemblent un très grand nombre de
« problématiques qui se prêtent à une forte interpénétration » (Jouët : 2000, p. 499; pour d’autres découpages
des différents axes de recherche, voir Proulx : 2006 et Chambat : 1994).
Tout cela complique la théorisation. Car il n’y a pas « une » théorie des usages (même si Proulx [2006, p. 13]
vise à en faire son projet), mais autant de théories qu’il y a de pratiques ou d’objets à étudier. Et comme les
usages d’Internet, en particulier, sont multiples et immensément variés, le projet d’une théorisation se révèle
dès lors complexe.
83
3.2 Les usages du Web : aspects théoriques et méthodologiques
La deuxième partie des années 1990 voit l’émergence du phénomène Internet avec la diffusion grand public et
la commercialisation du « réseau des réseaux » : le World Wide Web (Proulx : 2006, p. 11). Longtemps, on
a cru qu’Internet mettrait en place une « utopie » médiatique de collaboration, d’échange et d’accès au savoir
(Flichy : 1999), où l’utilisateur, dans un changement révolutionnaire de la réception et de la création, devient
à la fois récepteur et créateur (Weissberg : 2001). Plusieurs y ont vu la possibilité de la réalisation du
« discours prophétique » de Marshall McLuhan (1967) « annonçant l’instauration du "village planétaire" »
(Proulx : 2004, p. 8). Cependant, très tôt, on a mis des bémols aux discours trop « euphoriques » (Millerand,
Proulx et Rueff : 2010, p. 4) sur l’aspect « révolutionnaire » de la société de l’information basée sur le mode
relationnel (voir Elmer : 2002).
Les théoriciens du Web se sont demandé, entre autres, si Internet constitue « vraiment » un « nouveau
média » (Proulx : 2004, p. 50) et si l’arrivée d’Internet marque réellement « une rupture significative dans
l’informatisation et dans nos manières de faire usage des TIC » (Proulx : 2006, p. 11). Selon Proulx, « Internet
est plus qu’un nouveau média [car il] peut produire un "effet de levier" dans la réorganisation sociale et
économique des sociétés industrielles ». Mais, selon l’auteur, il importe de situer l’avènement d’Internet « dans
un contexte sociohistorique plus vaste que le seul développement des machines à communiquer » (loc. cit.).
En effet, « la diffusion sociale d’Internet participe – en conjonction avec d’autres aspects importants comme la
réorganisation sociale du travail – aux processus complexes de transformation des modes de production, de
consommation, de communication et d’acquisition des connaissances qui caractérisent les sociétés
contemporaines » (2004, p. 50). Bref, d’autres facteurs sociaux sont déterminants dans les changements qui
ont eu lieu à la suite des transformations permises par Internet.
Le Web social, par exemple (ou le « Web 2.0 », un terme introduit par Tim O’Reilly en 2004 pour illustrer les
nouveaux modes de création et de partage des contenus), « coïncide ainsi avec l’avènement d’un vaste
ensemble de pratiques orientées vers une figure de l’usager qui apparaît situé au centre de la production et de
la diffusion de "contenus générés par l’utilisateur" (User Generated Content) » (Millerand, Proulx et Rueff :
2010, p. 2), et donc ainsi ne s’impose pas non plus en « rupture avec un "premier" Internet rendu désormais
obsolète » (p. 4). Il s’agit beaucoup plus d’une « évolution graduelle et progressive » que d’une « révolution »
(Millerand, Proulx, et Rueff : 2010, p. 4).
D’ailleurs, même si certains usagers « confirmés » utilisent les outils de l’information à un niveau relativement
élevé de leur potentiel, la très grande majorité des usagers des TIC, toutefois, « se contentent le plus souvent
d’une maîtrise partielle des fonctionnalités » (Jouët : 2000, p. 503; voir aussi Kennedy et al. : 2007). C’est
particulièrement le cas avec Internet, et surtout avec les filles, qui comparativement aux garçons, possèdent
souvent une culture technique moins développée (Mazzarella : 2005). Cependant, à en croire les résultats des
84
différents sondages du PEW Internet & American Life Project effectués entre 2000 et 2006 et examinés par
Fallows (2005), elles seraient déjà en voie de les rattraper. Mais au-delà des observations sur le sujet, « [l]es
écarts observés entre les pratiques masculines et féminines des objets de la communication attestent de
l’empreinte de la culture dans la construction des usages » et montrent que les TIC constituent des « objets
symboliques » sur lesquels se fixent des « enjeux de pouvoir » (Jouët, op. cit., p. 504 et 508).
En ce qui concerne la recherche, le Web social, tout comme les usages du Web en général, « reste peu connu
du point de vue d’une analyse fine de ses pratiques » et son étude présente des défis méthodologiques
considérables (Millerand, Proulx et Rueff : 2010, p. 5). « Il est souvent tentant de déduire les comportements
d’usagers à partir des propriétés techniques des technologies utilisées » (loc. cit.), mais comme on l’a vu, de
telles déductions sont fort souvent trompeuses, puisque les usagers sont à la fois actifs et créatifs.
Les recherches menées sur les usages d’Internet, par ailleurs, se butent à plusieurs difficultés, dont la
première concerne « l’incontournable diversité des requêtes et des parcours de navigation » (Rouquette :
2008, p. 3). En effet, « le Web se caractérise avant tout par une diversité maximale des requêtes » (loc. cit.).
L’auteur cite à cet effet une étude de Jacques Lajoie (2002), qui a analysé 50 000 requêtes soumises à des
moteurs de recherche, et qui a observé que le mot le plus demandé (« sexe ») ne revient au bout du compte
que 954 fois sur 93 000 mots, et qu’à l’inverse 14 000 de ces mots ne sont demandés qu’une fois. Par ailleurs,
la moitié des 50 000 mots « ne reviennent qu’entre une et neuf fois », ce qui montre que « même les requêtes
les plus populaires ne représentent qu’une toute petite partie des demandes » (Rouquette : 2008, p. 3). Dans
une étude semblable de Jansen, Spink et Pedersen (2005), le mot le plus populaire, « free », ne représente
qu’un infime 0,6 % des requêtes analysées.
Plus encore, les études se butent à « la multiplicité de variables qui pèsent sur l’usage des médias et des
outils de communication : variables sociales, culturelles, générationnelles, mais aussi politiques, religieuses,
géographiques » (Rouquette : 2008, p. 3). L’établissement d’un « profil type » d’usager est donc
« improbable » (p. 2). Et lorsqu’on ajoute à l’équation la multiplicité des façons de naviguer sur la toile, la
question des usages du Web devient éminemment complexe.
Deux tendances dans les études sociologiques des usages du Web se dessinent : l’une se fondant sur les
analyses statistiques des bases de données de moteurs de recherche, et l’autre, sur des questionnaires
misant sur les déclarations des usagers. L’avantage de la première, c’est que « la précision de ces données
ne dépend pas de la mémoire » ni « de la neutralité des questions », car les études menées par
questionnaires peuvent en effet être biaisées par la formulation de leurs questions, qui peuvent refléter les
intérêts des organismes privés ou publics qui les mènent (p. 3-4). Cependant, l’hétérogénéité des requêtes (un
mélange hétéroclite de lieux, d’objets, d’informations scientifiques, de requêtes culturelles, de recherches plus
pratiques comme des recherches d’adresses, etc.) fait que le classement est très difficile, étant donné
85
également le grand nombre d’entrées à analyser. Le classement de requêtes, de plus, ne reflète pas
nécessairement le profil des usages de tous les internautes. Rouquette illustre cette difficulté par l’exemple
des jeux sur Internet. Si le mot « jeu » atteint 5 % des requêtes classées, cela veut-il dire pour autant que le
jeu correspond « à 5 % des visites standards des internautes? » (p. 5). C’est peu probable, estime-t-il, car « [i]l
suffit […] qu’une partie des internautes (9,4 %) – minoritaire mais particulièrement active – joue fréquemment
pour que les statistiques globales surévaluent la visite de sites de "jeux" » (loc. cit.). À l’inverse, même les
activités qui n’apparaissent que peu ou pas dans les statistiques peuvent être « perçu[e]s comme réellement
important[e]s par les internautes : par exemple, le fait de télécharger des documents administratifs en ligne
[…], une démarche invisible dans les mots clés mais réalisée par 33 % des internautes interrogés en 2005 »
(Rouquette : 2008, p. 7).
L’autre tendance s’appuie sur des enquêtes par questionnaires auprès de communautés d’internautes. Plutôt
que de se fier à des logs ou des cookies, on soumet les répondants à un questionnaire que l’on espère neutre,
et dont les questions sont le plus souvent orientées sur les pratiques imaginées par les enquêteurs. Les
questions sont alors souvent une énumération d’interrogations sur les pratiques, à savoir par exemple :
« Utilisez-vous le Web pour... (télécharger de la musique, accéder à votre compte bancaire, lire des journaux,
etc.). Les enquêtes par questionnaires peuvent être relativement utiles pour brosser un portrait des usages
quotidiens d’Internet; mais le problème, c’est que ces résultats sont souvent partiels, puisque lorsque l’on
compare les résultats des enquêtes par questionnaires à ceux des compilations de logs ou de requêtes, on
constate que certaines activités sont soit oubliées ou occultées. Et si les enquêtes déclaratives permettent de
montrer l’importance accordée à une activité ou à une pratique (en temps ou en valeur) par les internautes, les
résultats obtenus peuvent être limités par les intérêts des enquêteurs (l’État, les organismes, etc.) qui peuvent
poser plusieurs questions liées à une activité (les usages d’Internet liés à l’économie, par exemple) et
rassembler les autres grossièrement sous des thèmes larges et peu précis (par exemple, les loisirs) (p. 5-7).
Comme le rappelle Rouquette, « dans un sondage, la question compte et informe souvent plus que la
réponse » (p. 10); et lorsque l’on confronte les deux types d’études, estime-t-il, cette limite « appara[ît] […]
clairement. » (p. 6).
Malgré toutes ces difficultés, Rouquette soutient qu’il est possible de dessiner à partir des diverses études
deux grandes tendances des usages du Web : l’une pour ses aspects « pratiques », et l’autre pour le
« divertissement ». D’autre part, la recherche d’informations en tant que pratique constitue également une
grande tendance, « qui concerne 68 % des internautes interrogés » (p. 8), et ce, si bien que des courants de
recherche étudient spécifiquement cette pratique, comme ceux de l’ « information search » ou de l’ « everyday
life information search », c’est-à-dire « la quête d’information par les usagers » ou la « quête d’informations de
tous les jours » (Simonnot : 2008, p. 9; Spink, Ozmutlu et Lorence : 2004, p. 113). Si les études qui se
86
réclament de ce courant cherchent toutes à « mieux comprendre l’activité informationnelle humaine », les
travaux, cependant, restent disparates et « parcellaires » (Simonnot : 2008, p. 10; Ihadjadene et Chaudiron :
2008, p. 27). Certains tentent de « mettre en évidence, d’un côté, les tactiques et les stratégies qu[e les
usagers] mettent en place », d’autres, de montrer « les manières dont ils lisent et évaluent les résultats », ou
encore d’établir des typologies d’utilisateurs (en comparants « experts » et « novices », par exemple)
(Simonnot : 2008, p. 10; Ihadjadene et Chaudiron : 2008). D’autres enfin s’intéressent plus particulièrement au
comportement de recherche et s’inscrivent dans un courant nommé « information behaviour ». Dans tous les
cas, que l’on s’intéresse au comportement même de recherche (utilisation des moteurs de recherche, choix
des mots utilisés, etc.), ou, de façon plus large, aux façons d’utiliser l’information trouvée et aux motifs qui
guident la quête d’information, il importe de recadrer les résultats dans leur « signification sociale » (Chambat
et Jouët : 1996, dans Jouët : 2000, p. 513).
Par ailleurs, les approches théoriques qui tentent de « modéliser le comportement informationnel des
usagers » s’avèrent jusqu’à présent très peu pertinents; en effet, selon Ihadjadene et Chaudiron (2008), « il
est souvent difficile de faire un lien opérationnel entre le cadre et les finalités méthodologiques des études et
les cadres théoriques portés par les modèles de l’usage qui sont proposés » (p. 28). En raison du
« foisonnement de l’activité de recherche d’informations sur Internet », de la très grande variabilité des sujets
cherchés et de la concurrence des sources disponibles pour obtenir ces informations (moteurs de recherche,
forums, sources informelles, etc.), mais aussi de l’importance des variables socioculturelles qui entrent en
compte dans les recherches, l’étude des comportements de quête d’information s’avère très complexe
(Ihadjadene et Chaudiron : 2008, Rouquette : 2008, Spink, Ozmutlu et Lorence : 2004). Il importe, dès lors,
non seulement de privilégier à la fois une approche « holistique » qui tienne compte des multiples dimensions
de la quête d’information (Ihadjadene et Chaudiron : 2008), mais aussi de « segmenter », en quelque sorte,
les sujets à l’étude, car une étude trop globale des usages aura pour effet de « diluer » les résultats de
recherche pertinents dans le foisonnement et l’immense diversité des requêtes (voir à ce sujet Rouquette :
2008).
En effet, on ne cherche pas sur la sexualité ou sur les ITSS comme l’on cherche le nom de son auteur préféré
ou le titre du dernier hit à la radio. L’approche méthodologique utilisée en ces cas sera par conséquent
fondamentalement différente; le cadre théorique le sera également. En de nombreux cas, cependant, le Web
lui-même pourra se poser comme « un outil particulièrement propice » (Rouquette, op. cit., p. 2) à l’analyse de
ses usages, car le Web, cet « un instrument précieux de diffusion de connaissances » (p. 8) est en ce sens
révélateur des grands questionnements ou des intérêts des internautes, questionnements que les forums, les
sites d’informations ou les études sur les requêtes peuvent dévoiler publiquement. « Dans les consultations
personnelles, les internautes vont chercher les contenus ou les informations qui les intéressent le plus,
y compris celles qu’on ne trouve pas facilement dans les médias de masse classiques » (p. 11). Puisque
87
l’internaute « a le sentiment d’être protégé par un relatif anonymat », ses requêtes sont susceptibles d’être
plus directes ou plus franches, en quelque sorte, en raison de l’effet « désinhibant » qu’exerce cette
impression d’anonymat « sur la nature des requêtes exprimées » (loc. cit.).
Et ces résultats, tout naturellement, sont porteurs d’une « signification sociale », qu’il est tout à fait pertinent,
voire nécessaire, d’étudier. De quelle réalité sociale, de quelles préoccupations quotidiennes ou ponctuelles
les requêtes à caractère sexuel par les adolescentes et les jeunes femmes sont-elles le reflet? C’est la
question à laquelle nous tentons de répondre en cherchant à cerner les usages que font les jeunes Franco-
Canadiennes d’Internet en lien avec la sexualité. Suivant le souhait de Chambat et de Jouët (1996) de situer
les résultats de recherche sur les usages dans leur « signification sociale », nous tenterons de situer ces
résultats dans le contexte plus large de l’expression d’agentivité des filles, comme nous l’avons vu au premier
chapitre.
3.3 Les usages d’Internet par les adolescents en lien avec la
sexualité : choix méthodologiques, forces et limites des études
antérieures
Comme on l’a vu en autres avec de Certeau (1980), l’usager n’est pas « un simple consommateur passif de
produits et services qui lui sont offerts », mais un véritable « acteur » (Jouët : 2000, p. 502). Cependant, très
peu d’études sur les usages du Web misent sur l’idée d’empowerment ou d’agentivité des usagers. Une étude
qui l’a fait, toutefois, est celle de Lemire, Sicotte et Paré (2008) sur les usages par une population adulte du
site Web sur la santé PasseportSanté. Les auteurs ont trouvé qu’Internet pouvait devenir un outil important
d’empowerment pour les usagers en ce qu’ils pouvaient, en consultant le Web, se percevoir comme plus
compétents et plus en contrôle de leur santé. En contrepartie, si la participation à des forums et des
discussions en ligne pouvait concourir à cet empowerment, ils ont trouvé que la dimension « communautaire »
d’Internet comme source d’empowerment en lien avec la santé était plus limitée.
On a également vu que la qualité de la théorisation des usages des TIC dépend grandement de la qualité des
méthodes qui permettent de concevoir ces usages. Or, en ce qui concerne les usages d’Internet par les
adolescents en lien avec la santé et la sexualité, peu d’études sortent de la dimension macrosociale pour
observer les significations sociales et personnelles que prennent ces usages dans leur vie quotidienne.
Plus encore, très peu d’études ont adopté une perspective qualitative de ces usages, se limitant le plus
souvent à des sondages ou des questionnaires qui, comme nous l’avons vu, se contredisent et deviennent
rapidement obsolètes (Jones et Biddlecom : 2011; Hetsroni : 2007). Le petit nombre de recherches qui
a étudié qualitativement les usages du Web des adolescents concernant la sexualité présente souvent par
ailleurs plusieurs lacunes importantes qui minent la fiabilité, l’étendue ou la finesse de leurs résultats. Or on
88
sait que dans les études sur les usages, « la grande variabilité méthodologique influe directement sur les
résultats de l’analyse des données et pose des problèmes d’interprétation » (Ihadjadene et Chaudiron : 2008).
Il est donc d’autant plus important de s’assurer de la qualité et de la neutralité du devis de recherche, dont
dépend la qualité des résultats obtenus.
La suite du présent chapitre vise à présenter des exemples d’études clés qui ont porté sur la recherche
d’information sur Internet par les adolescents ou les jeunes adultes au sujet de la santé ou de la sexualité et
à montrer les conséquences de leurs choix méthodologiques. Pour chacune d’elles, nous offrons une vue
d’ensemble succincte de leurs observations et des nouvelles connaissances qu’elles apportent sur la
consultation du Web par les jeunes. Nous discutons ensuite de leur devis de recherche en portant une
attention particulière sur leurs forces et leurs lacunes. Si Rouquette (2008) préconise la « conjugaison d’une
analyse des requêtes et des enquêtes par questionnaires » pour fournir « le meilleur éclairage » sur les
usages du Web (p. 15), nous nous posons plutôt en faveur d’une démarche plus créative qui met à profit l’outil
même du Web pour obtenir des données voulues le plus fiables possible. Nous verrons au chapitre 4
comment nous avons intégré cet outil à notre devis méthodologique en vue de tenter d’éviter les lacunes des
études précédentes sur le sujet.
3.3.1 L’étude de Gray, Klein et al. (2005)
Gray, Klein et al. (2005) ont été parmi les premiers chercheurs à utiliser des méthodes qualitatives pour
étudier la recherche d’informations sur le Web au sujet de la santé par les adolescents. Les deux chercheurs
ont rencontré 156 adolescents et adolescentes américains et anglais âgés de 11 à 19 ans et provenant
d’écoles publiques et privées pour discuter de la place qu’occupait Internet dans leur recherche d’informations
sur la santé.
Par le moyen de groupes de discussion, ils ont observé, chez leurs participants, que la recherche
d’informations sur la santé sur Internet constituait un comportement déjà acquis chez la majorité d’entre eux,
et que le Web leur permettait d’accéder à des informations qui allaient souvent « au-delà » de leur propre
expérience (p. 1471). Il s’agissait également d’un comportement qui s’insérait facilement dans le contexte de
leur vie de tous les jours et qui leur permettait de trouver une grande quantité d’informations diversifiées,
pertinentes et actuelles facilement et promptement. L’étude a également montré que les participants vérifiaient
la crédibilité des sites Web qu’ils utilisaient lors d’une recherche.
Si l’étude de Gray et Klein – une référence très importante dans les études sur le sujet – a ceci d’intéressant
qu’elle montre pourquoi les jeunes utilisent Internet pour trouver des informations sur la santé, elle ne montre
pas comment ils cherchent des informations, ni ce qu’ils y cherchent exactement. Elle ne discute par ailleurs
que très peu du cas de la sexualité.
89
La plupart des études qui s’intéressent à la recherche d’informations sur la sexualité ou la santé sur Internet
se basent sur des sondages téléphoniques, mais comme l’indiquent Gray, Klein et al. (2002), il est difficile
d’expliquer par des sondages quantitatifs les raisons qui motivent les jeunes à chercher sur Internet. Pourtant,
il s’agit d’une question cruciale, que ce soit simplement pour mieux comprendre leurs comportements ou leurs
inquiétudes ou encore pour mieux combler leurs besoins d’information (p. 456).
3.3.2 L’étude de Smith, Gertz et al. (2000)
D’autres études encore ont utilisé des méthodes dites « d’observation ». Smith, Gertz et al. (2000), par
exemple, ont voulu quantifier la qualité et l’accessibilité de l’information sur la sexualité disponible sur Internet.
Elles ont demandé à des étudiants et étudiantes collégiaux de répondre à deux questions au moyen d’un
navigateur Web. Elles leur ont demandé, dans un premier temps, de trouver la bonne façon de porter un
condom, et, dans un deuxième temps, de trouver un site qui décrit les symptômes d’une infection transmise
sexuellement (ITS). La 2e question, par exemple, était formulée ainsi : « You have symptoms which make you
suspect that you have a sexually transmitted disease. Find a Web page that describes the symptoms of
STDs » (p. 687). Le nombre de tentatives des participants pour trouver l’information désirée était alors
enregistré pour déterminer l’accessibilité de l’information. Le temps était également compté.
Elles ont ensuite développé une méthode visant à donner un « score » aux sites Internet trouvés par les
participants. Des points étaient accordés selon la présence ou l’absence d’un thème déterminé à l’avance, tels
« condoms », « homosexualité » ou « contraceptifs », sans trop d’égard au degré de pertinence du texte lui-
même. Les sites étaient ensuite classés par catégories représentant l’origine de l’information trouvée (sites
personnels, pornographie, actualités, etc.) (p. 686).
Cette étude présente d’emblée certaines limites et lacunes. D’abord, elle se restreint aux sites anglophones et
à la recherche d’informations sur Internet par des étudiants également anglophones. Ensuite, elle date
considérablement. Compte tenu de la vitesse à laquelle Internet évolue, une étude qui date 2000 peut
apporter des observations intéressantes, mais comme le soulignent les auteures, qui en sont conscientes, elle
gagnerait à être répétée éventuellement pour vérifier si les conclusions qu’elle tire sont toujours pertinentes
(p. 692). La méthode était également, à notre avis, déficiente : les catégories, beaucoup trop floues, ne
permettaient qu’une catégorisation sommaire; le « score », lui, ne tenait pas compte de la pertinence, de la
qualité ou de l’exactitude des informations trouvées. De plus, certaines questions étaient mal formulées : la
question deux, par exemple, citée plus haut, ne s’intéressait pas à un symptôme en particulier, rendant
l’exercice relativement futile. Enfin, la seule mention d’un thème en particulier ne signifie nullement qu’un site
satisfait les besoins en information précis des étudiants dans une situation donnée et réelle. Par exemple, il se
peut très bien que l’on recherche autant sinon plus de soutien moral dans sa quête d’information que de
détails biologiques ou médicaux. Les chercheuses sont d’ailleurs venues à la conclusion qu’Internet « is more
90
efficiently used when searching for specific information concerning sexual health » (p. 690) que lorsqu’il est
utilisé pour répondre à des questions « générales ».
Enfin, quelques-unes des conclusions que les auteures tirent ne concourent pas à expliquer certaines
différences de sexe qu’ils ont pu observer. Ainsi, en observant que « For both questions, men found the
answers more quickly than women » (p. 689), il est impossible de déterminer si cette différence tient dans le
fait que les hommes passent moins de temps sur des sites Web sur la santé sexuelle parce qu’ils sont moins
intéressés par l’exercice même ou par l’information en tant que telle. Si la situation était réelle, et si les
questions correspondaient à un véritable désir de savoir, le temps passé sur les sites serait-il le même? Les
garçons sont-ils autant préoccupés que les filles par ces questions, et sont-ils préoccupés par les mêmes
questions? Préfèrent-ils des sites différents pour obtenir ces informations (portails, forums, sites qui
contiennent des images ou des vidéos, etc.)?
Pour répondre à de telles questions, une analyse qualitative telle que celle de Gray, Klein et al. (op. cit.), qui
constituait un départ dans la bonne direction, serait nécessaire. Mais comme nous l’avons souligné plus haut,
ces derniers n’ont pas beaucoup insisté sur le « comment » de la recherche d’informations sexuelles sur
Internet, c’est-à-dire sur la façon dont les adolescents et les adolescentes s’y prennent pour trouver des
informations précises sur des sujets d’inquiétude.
3.3.3 L’étude de Buhi et al. (2009)
C’est pour palier à cette lacune que Buhi et al. (2009) ont entrepris leur « Observational Study of How Young
People Search for Online Sexual Health Information ». Déplorant le fait que très peu de données existent sur
la qualité des informations concernant la sexualité trouvées sur Internet, sur la capacité des individus de
déterminer la fiabilité des informations et sur la façon dont ils cherchent réellement ces informations, les
auteures ont utilisé une méthode de recherche qui « observe » électroniquement le comportement des jeunes
sur le Web.
À l’aide d’une équipe d’infirmières, de spécialistes de la santé et d’intervenant(e)s en santé sexuelle, elles ont
établi une liste de mises en situation « réalistes » (mais non réelles) où des jeunes pourraient vouloir chercher
des informations particulières sur le Web. En tout, 12 scénarios ont été élaborés, comme celui-ci :
Henry recently shared with his friend that he only engages in oral sex because he does not
want to have to worry about STIs. Using the Internet, find out if Henry can get an STI
through oral sex. If he can, name one STI he could get through oral sex. (situation n° 2)
ou encore celui-ci :
91
Julia was at a party this weekend and, after having only one beer, she passed out. Julia
does not remember much about that night and believes she was drugged and raped. Using
the Internet, find one place in the local metropolitan area where Julia can go for after-rape
care and support. (situation n° 12, p. 103)
Elles ont ensuite rassemblé 34 étudiants et étudiantes universitaires en première année dans des bureaux de
travail subdivisés, chacun ayant un ordinateur et une connexion Internet. On leur a demandé de s’imaginer
à la place des différents personnages dépeints par les scénarios et de trouver la solution aux difficultés
proposées en utilisant Internet. Les participants étaient de plus invités à exprimer à voix haute les raisons qui
motivaient leur choix de navigation dans un micro. Le nombre de « clics » et le temps de recherche étaient
comptabilisés, et leurs commentaires au micro étaient enregistrés.
Enfin, avant toute chose, un questionnaire était remis à chaque participant pour déterminer certaines
tendances dans ses comportements sur le Web. Ce questionnaire a révélé que les questions relatives à la
santé sexuelle constituaient le thème de recherche le plus populaire de tous les thèmes relatifs à la santé
cherchés sur Internet, et qu’une majorité de participants se disait rassurée ou soulagée par ce qu’ils avaient
trouvé en ligne.
Quant à l’analyse du nombre de clics et des bandes audio, elle a révélé que la presque totalité des
participants ne faisait que « googler » les questions à l’épreuve, se disant que « Google va certainement [leur]
trouver ça » (p. 106-107). Au final, ceux-ci arrivaient tout de même à trouver des réponses plus rapidement et
plus efficacement que les autres qui cherchaient, par exemple, directement dans les sites des institutions.
La partie orale de l’expérience (« talking out loud » data) a montré par ailleurs que certains participants avaient
un faible niveau de connaissances ou de littératie en matière de santé sexuelle. Certains participants ont
démontré cette faiblesse par les questions qu’ils se sont posées oralement au micro. Certains ont cru que les
ITS et les MTS représentaient des choses complètement différentes, d’autres pensaient que le Plan B était
abortif, et d’autres encore se sont demandé ce que voulaient dire « vaginal intercourse » (p. 108).
Heureusement, l’exercice en tant que tel – de même que le comportement qu’il voulait observer – concourait à
augmenter cette littératie.
Mais la littératie du Web et la littératie en matière de santé sexuelle ne sont parfois pas suffisantes. L’analyse
du parcours électronique des participants a démontré que pour plus des trois quarts de ceux-ci, au moins une
des réponses fournies aux questions était erronée. D’autres questions sont restées sans réponse, malgré la
volonté des participants à la trouver. Les questions concernant des services disponibles localement, comme
où trouver un test du VIH gratuit dans sa région, ou encore où trouver du soutien moral dans sa localité après
92
un viol, étaient les plus difficiles. Les participants ont d’ailleurs mis, pour cette dernière question, plus de
temps et ont utilisé plus de clics pour parvenir à un élément de réponse (p. 104-105).
La plus grande lacune de cette étude nous semble évidemment située dans le fait que les situations
à observer ne sont pas réelles. Les mises en situation soumises correspondent toutes à des questions de
connaissances et l’environnement de même que le devis de recherche font en sorte que les étudiants
réagissent plus ou moins comme s’ils étaient soumis à un examen. La vitesse à laquelle les jeunes trouvent
certaines informations n’est donc que relativement pertinente; en cas de réel tracas ou inquiétude, un
adolescent pourrait par exemple consulter plusieurs sites Web différents pour vérifier la crédibilité des
informations recueillies, ou encore repasser plusieurs fois sur le même site pour se rassurer. Il pourrait
également utiliser d’autres moyens (seuls ou en combinaison) que le moteur de recherche Google.
Le niveau de frustration parfois évoqué à l’oral pourrait également être différent : il pourrait être moindre (les
participants pourraient faire preuve de plus de patience si la situation les concernait vraiment) ou encore plus
élevé (en raison de l’inquiétude liée à une situation réelle). Certains n’auraient peut-être pas lâché prise sur un
problème difficile à trouver, comme ce participant : « After 37 clicks and 6 minutes, 43 seconds of searching,
a frustrated and even angry male student resigned himself and stated : "I give up. I quit. My friend will just
have to be raped and get over it." » Il est tout à fait raisonnable de supposer que ce participant n’aurait pas eu
la même réaction si la situation proposée avait été réelle. Cette citation montre bien que les résultats peuvent
différer selon le contexte et le devis d’une recherche.
Ultimement, enfin, l’étude laisse la question « Qu’est-ce que les jeunes cherchent sur Internet? » sans
réponse.
3.3.4 L’étude de Suzuki et Calzo (2004)
Enfin, l’étude Suzuki et Calzo (2004) a porté sur les messages affichés sur deux forums de discussion, dont
un concernant spécifiquement la sexualité. L’autre, portant sur des préoccupations « adolescentes », abordait
principalement les relations amoureuses. L’objectif était double; il s’agissait d’abord d’observer les thèmes et
les questions que les adolescents et adolescentes décidaient d’afficher sur le Web et ensuite de déterminer le
niveau d’intérêt des usagers pour chaque thème par le nombre de clics obtenu pour chacune des questions.
L’étude a montré que le forum de discussion portant sur la sexualité était nettement plus populaire. Le thème
qui y revenait le plus fréquemment concernait la santé sexuelle, même si nombre d’études précédentes
avaient souligné qu’il s’agissait du type de questionnement qui gênait le plus les adolescents et qui les rendait
le plus réticents à demander de l’aide auprès de professionnels de la santé ou de parents (p. 695). Cela
corrobore donc la présomption souvent exprimée qu’Internet et les forums de discussion « circumvent the
awkwardness associated with asking sexual and relationship questions » (loc. cit.).
93
Par ailleurs, selon les auteurs, « [t]he boards also seem to satisfy adolescent needs by allowing teens to
candidly discuss issues about relationships and sexuality in their replies to one another » (loc. cit.).
Cependant, pour prouver une telle supposition, les études qui portent seulement sur les commentaires
affichés sur le Web se révèlent insuffisantes. Par exemple, il est possible que les « affichages » (posts) ne
reflètent pas nécessairement ce que les jeunes veulent réellement savoir, puisque ce ne sont pas tous les
usagers qui affichent des questions, et que par ailleurs ceux qui consultent les forums et ceux qui y écrivent
des questions correspondent à deux groupes distincts de personnes (p. 696).
Également, une étude ayant porté sur les questions que les jeunes souhaiteraient secrètement poser à leurs
parents a démontré que les jeunes, lorsqu’ils se posent des questions concernant la sexualité, ne sont pas
nécessairement préoccupés par les questions auxquelles on pourrait s’attendre, comme les infections
transmises sexuellement, qui pourtant occupent une place de choix dans les forums de discussion
(Richardson : 2004). Il se pourrait donc qu’il y ait une différence entre les questions affichées et les questions
que les jeunes se posent vraiment.
Bref, les études qualitatives sur les usages du Web en lien avec la sexualité ou la santé sexuelle par des
adolescents ou de jeunes adultes présentent jusqu’à présent de nombreuses lacunes. L’approche
« observationnelle » peut créer chez les participants l’impression de se soumettre à un examen, et les
situations étudiées, qui ne sont pas réelles, informent peu au final sur les véritables usages du Web des
jeunes, de même que sur leurs réels intérêts ou inquiétudes en lien avec la sexualité. Comme la qualité des
résultats sur les usages du Web est très dépendante de la méthode utilisée, il importe que les études à venir
privilégient un devis de recherche qui délaisse l’aspect de la capacité des jeunes à chercher sur Internet, et
choisissent plutôt un devis qui permet d’intégrer des situations réelles de même que la signification
personnelle que les participants associent à ces véritables usages.
3.4 Rappel des points importants et de la question de recherche
Voici un dernier rappel des points théoriques importants à retenir :
L’usage est un construit social; c’est-à-dire que l’outil « Internet » ne fait sens qu’à travers ses usages
(Nifle : 2001; Jouët : 2000; Chambat : 1994; etc.).
Les usagers peuvent « contourner » les usages prescrits par les concepteurs et se les approprier (de
Certeau : 1980; Jouët : 2000; Millerand, Proulx et Rueff : 2010, etc.).
Ces usages sont modulés par une « double médiation » technique et sociale (Jouët : 2000,
Chambat : 1994).
94
Les usages des TIC ne se construisent pas dans le « vide social », mais s’insèrent « en filiation »
avec des pratiques préexistantes (Chambat : 1994; Jouët : 2000).
Le développement des savoirs sur l’usage, par sa double dimension technique et sociale, ne peut se
faire sans un double ancrage « à la fois théorique et empirique » (Chambat : 1994; Jouët : 2000).
Il importe de distinguer les usages de la simple utilisation, et d’ancrer les problématiques de
recherche dans leur cadre social plus large, bref, dans leur « épaisseur sociale » (Jouët : 2000; Nifle :
2001; Proulx : 2006; de Certeau : 1980; etc.).
Les études sur les usages du Web par les adolescents et les adolescentes ne sont pas étrangères
à cet écueil, puisque plusieurs tendent à observer principalement la capacité des jeunes à chercher
de l’information, plutôt que leurs véritables inquiétudes, intérêts ou usages. Il importe, dès lors,
d’intégrer à la recherche la dimension sociale de leurs usages du Web, de même que la signification
qu’eux-mêmes accordent à ces usages.
C’est pourquoi nous avons voulu porter une attention particulière, dans notre étude, aux significations que les
jeunes femmes elles-mêmes accordent à leurs quêtes d’information sur la sexualité, de même qu’au contexte
dans lequel apparaissent ces questions. Pour ce faire, nous avons tenté d’élaborer une méthode qui tienne
à la fois compte des écueils et des aspects positifs des études antérieures sur la question. Le chapitre qui suit
décrit la méthode que nous avons développée et explique pourquoi cette méthode s’avère non seulement
pertinente pour une étude sur les usages du Web, mais également pour toute étude qui traite d’un sujet délicat
comme la sexualité.
4 Méthode
Inspirée par les aspects positifs et les lacunes des méthodes que nous avons décrites au chapitre précédent,
nous avons élaboré une approche tirant profit d’un nouvel outil disponible pour obtenir des données
qualitatives sur la recherche d’informations sur la sexualité sur le Web : le blogue. Par le biais d’un site
Internet que nous avons construit avec l’aide d’un informaticien, nous avons demandé à trente jeunes femmes
âgées de 17 à 21 ans de rendre compte de leur expérience (présente ou passée) de leur utilisation du Web
concernant de la sexualité en tenant chacune un blogue.
Les blogues consistent habituellement en un site Web où des entrées, mises à jour régulièrement,
apparaissent dans un ordre chronologique inversé (Walker : 2005). Ces entrées, rédigées normalement par un
seul auteur, portent sur un sujet circonscrit et souvent personnel. Car ce qui caractérise les blogues n’est pas
tant le contenu de ceux-ci en soi, mais bien la personnalité des auteurs qui les tiennent (Efimova : 2009, p. 3).
En effet, les blogues permettent l’expression des auteurs en ce qu’ils constituent souvent la narration de leurs
pensées et de leurs émotions (Herring et al. : 2004; Walker : 2005; Efimova : 2009, p. 3). Même les blogues
les plus épurés, qui ne constituent qu’une sélection de liens que l’auteur trouve intéressants ou de
commentaires courts, « say something about their authors » (Efimova, loc. cit.).
Dans notre étude, les participantes ont été encouragées à décrire dans leur blogue leurs expériences récentes
et passées de l’utilisation du Web en lien avec la sexualité. Nous leur avons demandé de mettre l’accent sur la
façon dont elles se sont senties en recherchant des informations sur la sexualité et sur le contexte dans
lesquels leurs questions sont apparues. Elles ont été invitées à répondre à des questions telles que : « Que
recherches-tu en ce moment? », « Comment te sens-tu par rapport aux informations trouvées et non
trouvées? », « Qu’as-tu lu ou trouvé? » et « De quelle manière ce contenu répondait-il ou non à tes besoins? »
Plusieurs moyens ont été mis à leur disposition pour s’exprimer : elles pouvaient le faire en utilisant divers
outils informatiques (entrée de texte, enregistrement vidéo ou enregistrement audio) et avaient la possibilité
d’enrichir leur blogue et d’illustrer leur pensée par des liens URL et des photos trouvées sur le Web.
Afin de respecter la vie privée des participantes et d’encourager la confidence (d’autant plus qu’il s’agit d’un
sujet délicat), nous avons choisi de faire en sorte que le blogue soit privé – c’est-à-dire que seuls la
chercheuse et son informaticien y avaient accès, et que toutes les entrées étaient protégées par un mot de
passe. Notre souhait était que les participantes aient l’occasion de s’exprimer librement, un peu à la manière
d’un journal intime. Nous souhaitions également diminuer l’effet de la gêne qui aurait pu survenir lors
d’entrevues individuelles, par exemple (notamment en raison du sujet), de façon à favoriser l’obtention de
données plus complètes. Nous voulions enfin limiter les biais qu’aurait pu induire une grille de questions trop
96
dirigées – avec le blogue, les participantes pouvaient écrire ce qu’elles voulaient, lorsqu’elles le voulaient, et
avaient le loisir de développer les aspects qu’elles jugeaient les plus importants ou pertinents.
Figure 1 : Page d'entrée du blogue38
Évidemment, la méthode du blogue privé peut être utilisée seule, mais le blogue peut également servir d’outil
lorsqu’utilisé conjointement à d’autres méthodes, comme celles de l’entrevue semi-dirigée ou des groupes de
discussion. Dans notre cas, le blogue remplissait les deux rôles : celui de méthode principale pour le premier
aspect de notre étude, et celui d’outil servant de départ aux entrevues individuelles, qui allaient suivre et qui
allaient aborder de façon plus particulière leur agentivité sexuelle et la distribution du pouvoir dans leur(s)
couple(s) ou leurs relations.
Ainsi, la méthode du blogue a surtout été utilisée pour répondre au premier aspect de notre étude, soit tout ce
qui touche de près ou de loin leur usage d’Internet pour répondre à leurs questions d’ordre sexuel. Car s’il est
possible, avec le blogue, de recueillir un certain nombre de données sur l’expression de l’agentivité sexuelle
des participantes, le portrait à ce sujet reste incomplet; il est difficile, en effet, de demander aux participantes
de « décrire » leur niveau d’agentivité sexuelle alors qu’elles ne sont pas familières avec le concept, qui est,
comme nous l’avons vu, très complexe. Les données sur cette partie de la recherche ont plutôt été fournies
par les entrevues, où la chercheuse a eu l’occasion de discuter longuement des comportements et des
attitudes des participantes en matière de sexualité afin de déterminer les façons dont elles expriment leur
agentivité sexuelle dans diverses situations.
38 Le blogue, construit expressément pour la cueillette de données, a l’avantage d’imiter l’interface des blogues « réels »
et des sites de réseautage sociaux tels que Facebook et MySpace. Le blogue est accessible partout au moyen d’une
véritable adresse URL, soit « www.marie-eve.me/blog ».
97
En revanche, comme le thème des usages du Web en lien avec la sexualité est relativement facile
à comprendre, le blogue à ce sujet se révèle un outil extrêmement efficace, comme on va le voir dans les
sections qui suivent.
4.1 Le blogue « privé » et ses avantages39
Le fait d’utiliser le blogue comme méthode de collecte de données est tout récent dans la recherche en
sciences sociales (Snee : 2008; Hookway : 2008). Les rares recherches ayant eu recours au blogue l’ont
surtout utilisé pour étudier les différentes communautés s’étant constituées sur le Web au cours des dernières
années. Dans ces cas, le blogue était moins un outil qu’un terrain à explorer d’une communauté déjà
blogueuse et déjà intéressée à divulguer et à rapporter des éléments de sa vie privée sur le Net. Des
questions reliées à l’éthique et au consentement étaient alors soulevées – les publications sur le Web sont-
elles privées, publiques, ou un peu des deux? Les participants sont-ils réellement des sujets, ou sont-ils des
auteurs? (Snee : 2008, Hookway : 2008)
Très peu d’études ont en fait recruté les participants dans un contexte « réel » (par opposition au laboratoire)
et leur ont demandé de tenir un blogue sur le Web concernant un sujet précis. Un champ d’études où on l’a
fait, cependant, est celui de l’enseignement, et plus particulièrement de l’enseignement des langues secondes
(voir Yang : 2009, par exemple). La tenue du blogue était alors intégrée au curriculum et constituait plus un
devoir qu’une méthode de collecte de données (les blogues n’étaient pas étudiés). Le but était d’encourager
les étudiants à écrire dans une nouvelle langue et de réaliser son utilité sur la scène internationale.
L’utilisation du blogue pour obtenir des informations sur un sujet précis, et plus encore délicat, par le biais
d’une communauté non constituée et non déjà blogueuse est donc très rare. En fait, nous n’avons
connaissance d’aucune recherche antérieure qui a appliqué l’outil du blogue de la façon dont nous l’avons fait,
et ce, malgré l’immense avantage que procurent le Web et une méthode centrée sur le blogging (Snee : 2008,
Hookway : 2008). La méthode qui s’y rapproche le plus serait celle du « web diary ». Le « diary » traditionnel
est un journal de bord ou un journal intime sollicité par un chercheur dans le cadre d’une recherche (Elliot :
1997, p. 22). La variante « web » du diary présente l’avantage d’être accessible partout (ou presque) et
d’obtenir une variété d’informations en temps réel, puisque les entrées sont datées électroniquement et
disponibles instantanément.
Le web diary sert, dans la plupart des cas, à tenir le rapport de comportements précis et ponctuels, comme
cela a été le cas pour Horvath, Beadnell et Bowen (2007). Ceux-ci voulaient obtenir un relevé détaillé des
39 Une partie abrégée de cette section est déjà parue dans Lang, Marie-Eve, 2012, « Entre blogues et web diaries : le
blogue "privé" comme méthode pour obtenir des données qualitatives sur la sexualité », Communication, vol. 30, n° 2.
98
activités sexuelles d’hommes homosexuels, et désiraient du même coup évaluer la précision et la fiabilité des
entrées fournies par le biais de la méthode (comparativement à celle des sondages), de même que
l’appréciation générale des participants envers cette nouvelle méthode.
S’il pouvait arriver que les participants surévaluent ou sous-évaluent occasionnellement la prévalence de
certains comportements sexuels avec la méthode des web diaries, l’efficacité de la méthode au regard de
l’assiduité s’est révélée fort intéressante. À l’exception de quatre entrées journalières manquantes de la part
d’un participant, tous les participants ont complété de la façon demandée les 28 entrées du journal de
bord (p. 543). Par ailleurs, les participants ont évalué positivement la méthode en raison de la facilité de son
utilisation, de la protection de la confidentialité qu’elle permettait et de sa valeur scientifique perçue (p. 544).
Figure 2 : Page d'insertion des entrées
La méthode du blogue « privé » constitue une variante des diverses méthodes citées plus haut (web diary,
blogue d’apprentissage). Elle introduit le concept d’une interface Web inspirée des sites de réseautage
populaires et permettant, comme ceux-ci, l’utilisation de plusieurs formats électroniques. Ainsi, le blogue privé
99
tire profit des nombreux avantages du Web et des méthodes qui y sont reliées tout autant qu’il outrepasse
plusieurs des écueils et des défauts de ces dernières.
Cette méthode évite, par exemple, les difficultés éthiques reliées au fait d’utiliser un contenu Web sans le
consentement des auteurs. Elle contourne également les possibles biais d’une surévaluation de
comportements précis, puisqu’il ne s’agit pas pour nous de recueillir un rapport d’épisodes précis et
comptabilisés, mais d’obtenir des données qualitatives de l’appréciation et de l’utilisation des sites Web sur la
sexualité. La fiabilité des données recueillies dépend donc de la volonté des participantes d’être ouvertes et
franches, et n’est en aucun cas moindre que celle des données obtenues par le biais d’entrevues. De plus,
comme les participantes peuvent remplir leur blogue au moment opportun pour elles dans le confort et
l’intimité de leur foyer, la méthode contribue à réduire la peur reliée au fait de se sentir jugées par la
chercheuse ou la gêne causée par le sujet délicat étudié. D’ailleurs, selon Hookway (2008), l’un des principaux
avantages de l’utilisation du blogue comme méthode tient dans le fait qu’il permet de recueillir des
informations sur des sujets sensibles beaucoup mieux que par le seul moyen de sondages ou d’entrevues
(p. 95).
Figure 3 : Profil de la participante (page présentant les entrées antérieures)
100
Puisque notre devis de recherche prévoyait que la méthode du blogue soit suivie d’entrevues individuelles
avec les participantes, celui-ci présente l’avantage de permettre, dans le cas où les données obtenues par le
blogue se révèlent insuffisantes, de pallier les éventuelles lacunes de l’utilisation seule du blogue privé en
posant diverses questions aux participantes. Plus encore, le fait de faire suivre la période de carnetage par
des entrevues fournit l’occasion d’évaluer la méthode du blogue auprès des participantes, en fin d’entrevue,
en recueillant leurs commentaires en vue de son amélioration. Enfin, puisque les rencontres individuelles et de
groupes sont précédées de la période de carnetage, les échanges « en personne » sont grandement facilités.
Comme les informations inscrites au blogue servaient généralement de départ à la conversation, nous allons
voir que les participantes ont eu l’impression que « la glace était déjà brisée », puisqu’elles savaient que la
chercheuse avait déjà lu leurs entrées de blogue (« posts »), parfois à caractère très intime, et donc qu’elle
avait déjà une idée relativement précise de leurs expériences.
Mais le fait de favoriser les échanges subséquents et la divulgation de données sur un sujet délicat ne
constituent pas le seul avantage de la méthode, qui présente plusieurs points d’intérêt; nous en présentons
sept40 :
1. Le blogue privé permet l’expression de l’agentivité personnelle et politique des participantes
Le concept d’ « agentivité personnelle » réfère à la capacité d’agir de façon compétente, raisonnée,
consciencieuse et réfléchie (Smette et al.: 2009, p. 370). Bref, il renvoie, d’une part, à l’idée d’action, et à l’idée
de responsabilité, d’autre part – on démontre donc une part d’agentivité lorsqu’on se sent « agent » de ses
propres actions (Bulot et Delevoy-Turrelu : 2007, p. 603). D’autres méthodes permettent aux participants
d’exercer leur agentivité personnelle en leur fournissant l’occasion d’interpréter eux-mêmes certains concepts.
Cela a été le cas dans l’étude d’Allen (2008), qui, par la méthode des photo diaries, a voulu savoir comment
des élèves d’une école postsecondaire apprenaient au sujet de la sexualité à l’école (p. 368). Elle a fourni aux
participants des caméras pour qu’ils prennent en photo leur quotidien « sexualisé » et pour que ces images
puissent encourager un dialogue réflexif lors des entrevues et des groupes de discussion.
40 Quelques auteurs remettent en question la réclamation d’innovation faites par plusieurs recherches qualitatives,
estimant que ces prétentions constituent principalement des améliorations de méthodes déjà existantes et non de réelles
innovations (Wiles, Crow et Pain : 2011; Travers : 2009). C’est pourquoi nous évitons d’utiliser trop ce terme et parlons
plutôt des avantages que la méthode proposée présente. Malgré le fait que ces auteurs concèdent que certaines
réclamations d’innovations soient justifiées, ils déplorent le fait que peu d’études se réclamant d’une innovation ont dans
les faits évalué leur méthode en la comparant avec celles plus traditionnelles et en la situant dans des débats
méthodologiques, ce que nous faisons précisément ici. Nous partageons donc peu leur manque d’enthousiasme envers
les nouvelles méthodes inspirées des nouvelles technologies, car comme nous le verrons, celles-ci présentent plusieurs
points d’intérêt et permettent d’éviter de nombreux écueils.
101
Cette méthode, estime-t-elle, « enables young people to actively participate in the meaning made of these
images » (p. 368), puisque les participants ont la liberté de déterminer le contenu et la composition des
images (p. 569). Elle leur permet aussi d’interpréter la tâche à accomplir « in ways that serve their own
agendas » (p. 571). Ainsi, le devis de recherche permet l’expression, à un certain degré, de l’agentivité
personnelle des participants. Plus encore, dans le cas de la recherche d’Allen, ceux-ci ont entrepris
d’interpréter librement certains concepts, dont celui, pourtant primaire, de la sexualité : « Despite being primed
that the focus of the research was "sexuality", participants chose to capture moments of school life that they
explicitly characterised as non-sexual. » (p. 572) Les participants, lorsqu’ils ont dû expliquer pourquoi ils
avaient inclus de telles images, ont dit que leur vie à l’école n’était pas aussi sexualisée qu’on le laisse trop
souvent croire. Pour eux, la vie à l’école et leur apprentissage de la sexualité se traduisaient aussi par des
situations non sexuelles : l’amitié, la tendresse, le fait de se fréquenter sans relation physique, etc. Se sentant
libres d’interpréter certains concepts (alliant ici la « non-sexualité » à la sexualité), les participants ont ainsi pu
rendre compte plus fidèlement de la réalité à observer. Ces derniers sont alors à la fois « actifs » et
« conciliants » (loc. cit.) : les participants suivent les consignes, mais se permettent une liberté d’interprétation.
Plus encore, selon Allen, la méthode a permis de diminuer drastiquement la perspective « top-down » qui
existe la plupart du temps entre chercheurs et participants. Elle a également permis d’augmenter l’expression
de l’agentivité personnelle des participants. Ceux-ci ne sont plus passifs (p. 574), mais ont le pouvoir de
négocier les interprétations et les significations, voire l’orientation de la recherche, le tout dans une entreprise
d’autodétermination.
Cette situation a amené Allen à réfléchir sur la possibilité de certaines méthodes de recherche de permettre et
d’encourager cette expression. Au terme de son article, elle écrit :
What this paper proposes is a different conceptualisation of power’s operation that
recognises the complexity inherent in young people’s expressions of agency. For those [...]
seeking to empower young people, the question is not how might power relations be evened
out – but how can research be designed in ways that offer young people more opportunities
to critically examine their conditions of possibility? (p. 575)
Ainsi, la méthode que nous préconisons, à l’instar de celle d’Allen, permet l’expression de l’agentivité
personnelle des participants, notamment en ce qui concerne, comme c’était le cas avec Allen, l’interprétation
du concept de sexualité. Le fait que le concept de sexualité n’est pas déterminé à l’avance (et surtout pas
« préscénarisé », comme dans certaines études qui précèdent la nôtre), permet aux participantes de décider
par elles-mêmes si, pour elles, la sexualité inclut, par exemple, les relations interpersonnelles (avec leurs
copains ou copines, avec leurs parents, avec leur[s] partenaire[s]). Elle leur permet également de déterminer
102
ce qui constitue, pour elles, un apprentissage – et donc leur laisse le soin de faire ou non la distinction entre
divertissement et information.
Cette liberté nous semble indispensable, d’autant plus que l’on sait que les questions que se posent les
adolescents (et donc sûrement aussi les jeunes adultes) diffèrent grandement de ce à quoi on pourrait
s’attendre (Richardson : 2004).
Par ailleurs, selon Zukic (2008), qui a étudié les écrits autobiographiques de jeunes femmes musulmanes
lesbiennes, le fait d’écrire sur sa propre condition permet plus facilement la confidence et l’expression de
discours contre-hégémoniques. S’il se peut très bien qu’un sujet se « construise » une identité qui correspond
à ce qui est « disponible » pour lui dans les discours sociaux hégémoniques, dans le cas contraire, le récit
autobiographique facilite l’expression de ce que Zukic appelle « l’agentivité politique » (p. 403). Elle définit le
concept comme « the reworking and the reappropriating of [...] culturally organized spaces », ce qui renverse
ou du moins transforme les relations de pouvoir (loc. cit.). Comme la méthode proposée exige des
participantes qu’elles écrivent sur leur propre vie et sur leur propre situation, nous pensons pouvoir profiter, du
moins à un certain degré, de cet avantage de l’écriture autobiographique41.
2. Le blogue privé permet l’expression de soi et les confidences auprès d’une population propice
Nous avons personnellement observé, par le biais du site de réseautage social Facebook, que de jeunes filles
ayant l’âge et le profil social de nos participantes répondaient volontairement à des quiz publics sur Facebook,
appelés « Notes ». Ces quiz se transmettent d’une personne à une autre dans le réseau et sont ensuite
remplis et affichés par des usagers (le plus souvent des filles) sur leur profil. Ils comportent des questions
parfois très personnelles (par exemple : Aimais-tu la dernière personne que tu as embrassée? Qui est la
dernière personne à t’avoir envoyé un message texte? As-tu pleuré aujourd’hui? Es-tu en amour en ce
moment?) et sont conçus de façon à ce que les usagères répondent succinctement, en contrôlant le degré de
confidence et de révélations des réponses (elles peuvent décider d’éluder certaines questions). Par ailleurs,
ces quiz sont remplis par temps libre, et visent principalement à tuer l’ennui.
Il semble que ces « quiz » répondent à un certain besoin de confidence et d’expression chez les usagères,
surtout en matière de relations interpersonnelles et amoureuses. Bien que des recherches plus poussées
restent à faire pour le confirmer, notre méthode semble permettre de répondre, en quelque sorte, à ce besoin
« naturel » d’écoute et d’expression exprimé par l’existence et la popularité de ces quiz. Plus encore, parce
41 Pour un autre exemple de l’écriture comme outil de recherche permettant aux participants (et surtout participantes)
d’être réflexifs et de fournir des représentations « authentiques » de leur réalité, voir Moletsane, p. 148-161, dans Mitchell
et Reid-Walsh (2005).
103
que le site Web que nous avons construit reprend la navigation dans une forme très près du mouvement
habituel adopté par les participantes sur les sites de réseaux sociaux, les participantes acceptent relativement
facilement les exigences de la méthode, malgré l’effort qu’elles représentent (Hookway : 2008, p. 95-96).
D’ailleurs, dans une étude sur les motifs qui poussaient les gens à tenir ou à lire des blogues, il a été trouvé
que le plaisir associé à la tenue et à la lecture de blogues constituait le facteur le plus significatif motivant cette
activité (avant même la perception de l’utilité) (Hsu et Lin : 2008, p. 71).
Bien que le blogue soit imposé aux participantes, plusieurs d’entre elles ont spontanément avoué avoir trouvé
du plaisir à le remplir. Par ailleurs, pour certaines d’entre elles, la méthode a encouragé d’autant plus les
confidences qu’elles étaient conscientes que le blogue était confidentiel et que la chercheuse « n’était pas là
pour [les] juger ». Nous supposons donc que l’autocensure des déclarations a considérablement été diminuée.
Par ailleurs, selon Stern (1999), Internet constitue « a safe place » (p. 5-6) où les filles peuvent s’exprimer
librement « without fear of endangering themselves, their relationships, or their "realities" » (p. 39). Un endroit
sûr où elles peuvent également construire leur identité et leur réalité sociale de façon active – en utilisant leurs
propres mots et leurs propres moyens sur le Web (Grisso et Weiss, p. 31-49, dans Mazzarella : 2005).
Les sites Internet pour jeunes filles qui incluent une partie composée de forums où elles peuvent poser des
questions et offrir des conseils constituent un exemple de cet endroit « sûr » :
[T]he girls who avail themselves of these boards are talking about, constructing, and
performing sexuality. […] [They] are doing more than merely describing their sexual
experiences. In sharing their feelings and stories, they are bringing their sexual identities
into being. (Grisso et Weiss : 2005, dans Mazzarella, op. cit., p. 38)
3. Le blogue privé encourage l’apprentissage et la réflexivité chez les participantes
On pourrait déjà avancer que l’exercice seul des entrevues et des groupes de discussion sur la sexualité
permet d’enrichir la pensée et la réflexion des participantes sur le sujet. Cependant, comme l’indique Yang
(2009), l’utilisation de blogues dans le processus permet une réflexion encore plus critique. Dans son étude
sur l’utilisation de blogues dans un curriculum universitaire chez des étudiants en éducation de langues
secondes, les deux tiers des participants ont déclaré « that it was easy and comfortable to post comments and
challenge their peers on the blog instead of discussing the issues in a face-to-face context, allowing comments
to be more critical. » (Yang : 2009, p. 17)
Si le blogue privé ne permet pas l’affichage de commentaires entre les participantes (puisqu’il est justement
privé), il exige néanmoins que les réflexions de celles-ci soient mises par écrit, ce qui apporte sensiblement
104
les mêmes avantages. Par ailleurs, le fait qu’il soit possible, pour la chercheuse, d’interagir avec les
participantes pendant la période des blogues (notamment par courriel) permet d’améliorer grandement la
réflexion critique. Dans l’étude de Yang, les professeurs affichaient des questions sur les blogues des
participants, et leur demandaient d’approfondir certains points. Cette interactivité s’est avérée bénéfique :
« [Participants] reported that due to such challenges set by the instructors their thinking went deeper and
became more critical. » (Yang : 2009, p. 17)
Plus encore, selon Yang, le carnetage en lui-même est une activité avantageuse en général :
[T]hrough blogging, people are able to document their reflections about things relevant to
their daily life experiences […]. [...] In other words, blogs allow people to exchange
information without space and time constraints, to broaden their knowledge, and to meet
personal needs and interests at the same time (Yang : 2009, p. 13, s’appuyant sur les
réflexions de Godwin-Jones [2003 et 2008]).
Selon Burgess (2006), le carnetage permet par ailleurs aux blogueurs de développer un regard critique sur le
monde social qui entoure et sur les sujets développés dans leur blogue, ce qui rend leur apprentissage encore
plus personnel, engagé et significatif.
4. Le blogue privé est susceptible d’augmenter la littératie du Web auprès des filles
Selon Farmer (2008), toute activité qui inclut une composante Web permet aux adolescentes et aux jeunes
femmes d’augmenter leur compréhension et leurs connaissances du médium, un avantage important qui peut
leur permettre notamment d’être plus compétitives lors de l’entrée sur le marché du travail. Farmer estime
qu’en raison du fait que les technologies sont socialement associées aux garçons et que les filles peuvent être
plus sensibles aux rôles sociaux de genre, celles-ci seraient réticentes à franchir ces « barrières normatives »
et à explorer plus activement les technologies (p. 17-18).
Dans son ouvrage, Girl Wide Web, elle propose diverses activités à intégrer dans les curriculums scolaires ou
à l’apprentissage fourni par les parents à la maison. Le blogue privé, qui nous a d’ailleurs été inspiré par les
conseils de cette auteure, peut aussi contribuer à l’augmentation de la littératie du Web chez les filles. Nos
participantes peuvent donc tirer profit de leur participation à la recherche de multiples façons. Certaines
d’entre elles pourraient, par exemple, décider de commencer leur propre blogue au terme de la recherche,
ayant obtenu des outils nécessaires et réalisé qu’elles avaient les compétences pour le faire.
D’ailleurs, les blogueurs qui ont participé à une étude d’Efimova (2009) ont constaté que le fait de tenir un
blogue leur a permis d’améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes liées non seulement à la technologie,
105
mais aussi à l’écriture, à l’organisation du travail et à la discipline personnelle (p. 4) – des connaissances et
des aptitudes dont pourront aussi profiter nos participantes.
5. Le blogue privé est susceptible d’augmenter la fiabilité du souvenir d’expériences récentes et
passées
Comme le résume Hookway (2008), la méthode du blogue privé, qui se rapproche de celle des web diaries,
apporte l’avantage de permettre aux participantes de rapporter certaines expériences du Web en temps réel,
au jour le jour :
Another benefit [of diary research] is that they capture an "ever-changing present" (Elliott,
1997: 3) where there is a tight union between everyday experience and the record of that
experience (Toms and Duff, 2002). This proximity between event and record means that
diaries are less susceptible to problems of memory impairment and retrospective
reconstruction than interviews and focus groups (Verbrugge, 1980). (Hookway : 2008,
p. 95).
Quant au rapport des expériences passées, celui-ci peut être grandement facilité par le recours aux « objets »,
notamment dans les cas où des sujets doivent se souvenir d’expériences difficiles, comme d’un abus sexuel
(Reavey et Brown : 2009). Pour faciliter la mémoire lors de rencontres thérapeutiques, les chercheuses
Reavey et Brown ont mis l’accent sur un objet qui était présent dans la pièce lors de l’abus de leurs
participantes; celles-ci pouvaient alors se concentrer sur cet élément pour mieux préciser leur pensée. Bien
que notre situation de recherche diffère grandement de celle de ces chercheuses, le fait que les participantes
devaient garder le focus sur un élément concret (les sites Web visités, les images vues), il est possible
qu’elles aient été plus à même de rendre un portrait précis de leurs expériences passées de la recherche
d’informations sexuelles sur le Web.
6. Le blogue privé permet d’inclure l’étude des images dans le devis de recherche
Le fait d’utiliser une méthode qui permet d’intégrer, par le moyen d’hyperliens, des images, des sites Web et
des vidéos comporte de nombreux avantages. D’abord, cela nous permet d’obtenir des données plus riches,
et pas seulement parce que les hyperliens permettent aux participants d’illustrer leur pensée. Liebenderg
(2009) estime que le fait de demander aux participants de prendre en photo des scènes de leur vie
personnelle (ou, dans notre cas, d’en sélectionner sur Internet) dans une approche basée sur l’image leur
fournit l’occasion d’être réflexifs, et donc les encourage à interroger les raisons pour lesquelles une image
choisie est significative pour eux (p. 441-442). Au moment de l’entrevue, leur pensée et leur expérience
seraient mieux articulées, et leur discours deviendrait plus représentatif de la façon dont ils interprètent eux-
mêmes leur réalité (p. 442).
106
Par ailleurs, « [a] reflective method such as elicitation, where researcher and participant discuss images
created by participants, situates participants as authorities on their lives, better controlling research content »
(p. 444). L’expression de l’agentivité personnelle est donc dès lors encouragée, ce qui amène les avantages
que l’on sait (voir point 1).
Enfin, selon Yang (2009), le fait d’intégrer des images et du son à un blogue augmente le plaisir associé à son
usage et facilite l’apprentissage et l’exploration (p. 14), avantages que nous avons aussi observés (voir
point 2).
7. Le blogue privé (et à plus forte raison lorsqu’il est suivi d’une entrevue) permet de pallier les
écueils des études précédentes sur le sujet
Comme nous l’avons mentionné au chapitre 3, il existe très peu d’études qui ont intégré à leur devis une
analyse qualitative de la recherche d’informations sur la sexualité sur Internet. Nous avons vu que plusieurs de
ces études présentaient par ailleurs de nombreuses lacunes. L’étude de Buhi et al. (2009), par exemple,
soumettait aux participants des scénarios présélectionnés qui pouvaient ne pas correspondre aux véritables
inquiétudes ou préoccupations des participants. Cette étude mettait également l’accent sur la vitesse avec
laquelle ceux-ci trouvaient les informations demandées, comme s’ils étaient soumis à un examen. Il était ainsi
difficile de statuer sur la véritable façon dont les jeunes adultes ou les adolescents utilisent Internet pour
s’informer au sujet de la sexualité.
La méthode du blogue privé utilise une approche originale qui valorise la mémoire, l’opinion et la manifestation
des comportements habituels de recherche sur le Web plutôt que la capacité des participantes à fouiller sur le
Net ou le nombre de minutes qu’elles passent à naviguer.
Lorsqu’elle est suivie d’entrevues, la méthode du blogue est encore plus efficace; non seulement les
entrevues permettent-elles de discuter plus longuement avec les participantes qui auraient moins écrit sur le
blogue et d’aller plus loin sur certains points développés par les autres, mais elles permettent également
d’évaluer l’approche utilisée lors du blogue.
D’autres auteurs ont constaté les bienfaits reliés au fait d’utiliser une méthode conjuguant l’écriture à des
entretiens personnels. Averett et al. (2008), par exemple, ont demandé à 14 participantes d’écrire
« a retrospective narrative » de leur expérience de leur sexualité au regard des thèmes du désir et de
l’agentivité sexuels et de l’influence parentale : « They were to consider topics such as masturbation, initiation
of sex, if it was normal to have sex, to want sex, to be sexual. They were also to discuss how they believed the
messages, attitudes, and behaviors on their parent’s part affect them in the present. » (p. 333). Une fois les
textes écrits et soumis, les participantes étaient invitées à prendre part à une entrevue semi-dirigée. Selon les
107
auteurs, « it gave the participants an opportunity to reflect, refute and add layers of meaning to the analysis
and resulting themes » (p. 334), comme le suggèrent Guba et Lincoln (1982).
Enfin, comme on l’a déjà mentionné, le blogue présente l’avantage de briser la glace lorsqu’il précède les
entrevues individuelles. Les participantes connaissent déjà le sujet abordé en entrevue et ont déjà, par le
moyen du blogue, raconté leurs « situations gênantes ». Il s’agit donc d’un devis de recherche idéal pour
observer les usages du Web en lien avec le sujet tabou de la sexualité.
4.2 Profil des participantes
Trente jeunes filles âgées de 17 à 21 ans ont accepté de participer à notre recherche. Par « participante »,
nous entendons toute fille ayant écrit au moins une entrée (« post ») sur le blogue. Celles qui n’ont rien écrit,
même après avoir été encouragées à le faire par courriel, ont été écartées de l’étude (25 participantes
écartées). Parmi les trente participantes ayant écrit au moins une entrée, 25 ont accepté de se rendre en
entrevue. Les autres ont abandonné soit en laissant un avis après le premier ou la 2e entrée, tout en acceptant
que ces entrées soient gardées pour analyse, soit en déclinant l’entrevue une fois la période de carnetage
terminée. La majorité des participantes, toutefois, ont présenté un blogue très complet, le nombre d’entrées
par participantes pouvant aller jusqu’à 34 (la moyenne est d’environ 10 entrées).
Les participantes ayant été recrutées à l’Université Laval, à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston et
à la polyvalente A.-M.-Sormany d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, elles sont généralement originaires
des régions environnantes, soit des régions de l’est du Québec et du nord-ouest du Nouveau-Brunswick (sauf
pour une participante, originaire du Bénin, en Afrique). Aucune ne provient de grands centres tels que
Montréal (Québec étant la ville la plus grande dont certaines sont originaires). Elles sont également toutes
citoyennes canadiennes, et sont toutes francophones.
Nous avons effectué le recrutement dans des cours universitaires de communication (en majorité), mais aussi
dans des cours de psychologie du 1er cycle, de même qu’au secondaire dans des cours de biologie et de
français, ce qui fait que les intérêts et les horizons des participantes de même que leur âge sont variés. Elles
sont cependant toutes éduquées (du moins jusqu’en fin secondaire) et plusieurs d’entre elles ont entrepris un
baccalauréat. Leurs parents sont généralement éduqués également, mais leur occupation varie beaucoup,
allant de commis à l’entretien ménager à médecin spécialiste. Enfin, elles ont pour la plupart de bonnes notes
à l’école, et seule une participante qui avait terminé le secondaire n’avait pas entrepris d’études
postsecondaires.
Selon le préquestionnaire qu’elles ont rempli en ligne, elles ont en général parfois ou rarement des
discussions sur la sexualité avec leurs parents, et ces discussions ne vont pas toujours en profondeur dans le
108
sujet. De plus, beaucoup de parents ne donnent pas d’opinions particulièrement pour ou contre la sexualité de
leur fille dans ces discussions. Les participantes sont pour la plupart actives sexuellement (mais quelques-
unes sont toujours vierges) et ont eu leur première relation sexuelle en moyenne vers l’âge de 16 ans42.
Le tableau suivant indique le nom fictif attribué à chaque participante ainsi que son âge au moment du
carnetage et sa décision relative à sa participation à l’entrevue :
Nom fictif Âge Participation à
l’entrevue
Nom fictif Âge Participation à
l’entrevue
Amélie 19 Oui Marianne 17 Non
Audrey 17 Oui Émy 17 Oui
Sarah 17 Oui Rosalie 17 Oui
Camille 20 Oui Léa 18 Non
Maude 19 Oui Jade 19 Oui
Alexandra 19 Oui Alison 18 Oui
Noémie 19 Oui Florence 18 Oui
Sabrina 19 Oui Laurieanne 19 Non
Gabrielle 20 Oui Océanne 19 Oui
Jessica 20 Oui Coralie 21 Non
Laurence 19 Oui Alicia 21 Oui
Laurie 20 Oui Annabelle 20 Oui
Roxanne 20 Oui Mia 20 Oui
Mégane 20 Oui Juliette 20 Oui
Marie-Pier 20 Non Maëlie 20 Oui
Tableau 2 : Nom fictif et âge des participantes et indication de leur participation aux entrevues
42 À noter que certaines répondantes ont choisi de ne pas répondre à cette question (une case du questionnaire le leur
permettait).
109
Si nous avons choisi de limiter l’âge des participantes entre 17 et 21 ans, c’est que nous voulions, d’une part,
nous assurer d’avoir une bonne proportion de participantes actives sexuellement (puisque nous voulions avoir
l’occasion d’examiner les pratiques sexuelles telles qu’elles se vivent à la fin de l’adolescence et au début de
l’âge adulte). D’autre part, comme notre méthode permet aux participantes d’être réflexives et de revenir sur
leurs expériences passées, le fait d’incorporer quelques participantes plus vieilles (21 ans) nous permettait de
varier les « étapes » des expériences et d’observer des différences situationnelles ou évolutives dans
l’acquisition de leur agentivité sexuelle. De plus, comme nos participantes sont plus âgées (fin
adolescence/début de l’âge adulte), et que notre méthode leur donne l’occasion de réfléchir sur leurs
premières expériences sexuelles, elles pourraient être plus en mesure de constater par elles-mêmes leur
évolution ou les situations qui permettent ou contraignent l’exercice de leur agentivité – donc d’avoir une
pensée critique plus poussée de leur expérience. Enfin, notre expérience en tant que chercheuse nous
a permis de constater que les participantes plus âgées sont souvent moins intimidées par le processus de
recherche, et sont donc plus à même de vouloir partager leur expérience. Pour toutes ces raisons, nous avons
voulu privilégier des participantes plus âgées que plus jeunes, et ce même si notre méthode de recherche
devait réduire de beaucoup déjà l’effet « top-down » que nous avons voulu éviter.
Par ailleurs, le choix de baser les limites de l’âge des participantes sur des critères biologiques,
physiologiques ou encore sur une définition « canonique » de l’adolescence ou de certaines périodes de l’âge
adulte ne nous semblait pas justifié, en raison principalement du fait que l’adolescence est un concept
construit et récent, contesté par plusieurs théoriciennes (Lesko : 1996; Lehr : 2008). En effet, selon Lesko
(1996) :
Adolescents […] are a familiar and seemingly fixed element of the social, cultural, and
economic landscape. Similarly, the knowledge about adolescents’ characteristics – that they
are hormonally driven, peer-oriented, and identity seeking – is accepted as a fact
established by empirical research. Even the idea that a population can be identified by age,
massed together as distinctive on that single criterion, is unremarkable. Adolescence is
natural and naturally occurring. However, historians of childhood and youth argue that
conceptions of young people are social categories and, therefore, subject to historical
change. (p. 140)
Selon l’auteure, l’adolescence ne doit pas être perçue comme une « phase immuable » de la vie, mais comme
l’effet de pratiques sociales – liées à la loi, à l’éducation, à la famille et au domaine médical (Lesko, loc. cit.,
s’appuyant sur Hawes et Hiner : 1985 et sur Walkerdine : 1990). La création d’une définition « type »
d’adolescent participe à la création, selon les auteurs, de lignes directrices servant ultimement à délimiter ce
qui est « normal » et ce qui est « déviant » chez les adolescents, et à définir leurs besoins, leurs problèmes et
110
leurs caractéristiques comme s’ils étaient en constant besoin de protection, alors que les « adultes », en
contrepartie, sont considérés comme étant en contrôle de leur vie et de leur identité, alors que ce n’est pas
nécessairement le cas (p. 142-143).
Pour toutes ces raisons, nous avons préféré nous abstenir de baser la tranche d’âge de nos participantes sur
une définition « scientifique » de l’adolescence qui, au final, informerait plus sur les assomptions du discours
sur lequel elle se base que sur les adolescentes elles-mêmes.
4.3 Entrevue et questionnaire
Nous avons aussi voulu donner aux participantes le plus de liberté possible, dans les limites imposées par la
recherche. Les filles étaient donc libres de participer ou non aux entrevues (bien qu’elles furent encouragées
à le faire) et pouvaient ne pas répondre aux questions si elles les gênaient trop. Les entrevues avaient lieu
dans un local privé ou dans un endroit public tranquille auquel elles avaient consenti de participer à l’entrevue.
Malgré la possibilité offerte aux participantes de se soustraire à toute question, une seule participante l’a fait;
elle a refusé, à une occasion, de répondre à une question qui la rendait mal à l’aise et qui concernait le corps
(Cette question était : « Quand tu dis que certaines parties de ton corps te gênent trop, de quelles parties
parles-tu? »). Cependant, elle a acquiescé à certains éléments lorsque nous lui avons offert certains choix de
réponse. Bien que le cours de l’entrevue pouvait changer selon les thèmes abordés par les participantes dans
le blogue ou au cours de l’entrevue elle-même, celle-ci suivait généralement le plan suivant :
1. Quand tu te lèves le matin, et que tu ouvres l’ordinateur, que fais-tu?
2. Si je te suivais toute une journée, une semaine ou un mois, qu’est-ce que j’observerais?
3. Est-ce que tu blogues?
4. À quel âge as-tu reçu Internet chez toi?
5. À quel âge as-tu commencé à avoir des questions sur la sexualité, et à utiliser Internet pour
répondre à tes questions?
6. Quand tu cherches une question sur la sexualité, où es-tu? Chez toi? Dans un endroit privé?
7. Quelles questions sur la sexualité avais-tu quand tu étais plus jeune? Comment ce
questionnement s’est-il présenté? Comment as-tu cherché sur Internet pour trouver des
éléments de réponse? Quel genre de site as-tu trouvé? Quel genre de site espérais-tu trouver?
Qu’est-ce que ça disait sur le site? As-tu été satisfaite de la réponse? Pourquoi c’était important
pour toi de trouver des réponses à cette question? Comment te sentais-tu en cherchant là-
dessus? As-tu arrêté de chercher après avoir obtenu une réponse, ou as-tu continué de
111
chercher? Comment te sentais-tu après avoir obtenu un élément de réponse? En as-tu parlé
à tes parents ou à d’autres intervenants? Pourquoi? Etc.
8. Aujourd’hui, quel genre de questions cherches-tu sur Internet? En quoi est-ce différent des
questions que tu te posais plus jeune? (reprise des questions plus haut pour chaque sujet)
9. Si on regardait un peu les sujets dont tu as parlé dans le blogue… Comment ce questionnement
s’est-il présenté? Tu avais quel âge? (reprise des questions pour chaque sujet)
10. En ce qui concerne la sexualité, utilises-tu Internet seulement quand tu as des questions? Par
exemple, lorsque tu n’as rien à faire?
11. As-tu déjà regardé de la pornographie sur Internet? (Si oui : était-ce pour le plaisir, pour
apprendre, ou pour autre chose?) (Si non : pourquoi?)
12. As-tu déjà trouvé des conseils sur Internet que tu as essayé d’appliquer? Lesquels? Comment
t’es-tu sentie en appliquant ces conseils? Comment cela s’est-il passé?
13. Le dis-tu à ton partenaire que tu cherches (tel ou tel sujet) sur Internet? Pourquoi? Crois-tu que
lui va chercher des réponses à certains questionnements sur Internet? En parlez-vous
ensemble?
14. Y a-t-il des questions que tu n’oserais jamais chercher sur Internet? Selon toi, quelle est la limite
d’Internet pour trouver de l’information sur la sexualité?
15. Si Internet n’avait pas existé, qu’est-ce que ça aurait changé dans ta vie sexuelle?
16. Avec ton chum (ou ta blonde, ou un partenaire éventuel), si je faisais le signe d’une balance
avec mes mains, l’une représentant ton pouvoir décisionnel dans le couple, et l’autre, son
pouvoir à lui, à quoi ressemblerait la balance? Et en ce qui concerne le fait d’initier la sexualité,
est-ce que ce serait différent?
17. D’écrire un blogue sur la sexualité, comme tu l’as fait, t’a sûrement forcée à penser à toute ton
expérience sexuelle, ton historique. Quand tu repenses à tout ça, qu’est-ce que tu te dis?
À quelles conclusions arrives-tu?
18. Si tu avais à te donner une note sur 10 concernant le pouvoir ou le contrôle de la sexualité dans
ton couple, quelle note te donnerais-tu?
19. Si j’ai bien compris… (résumé de l’expérience de la participante). Est-ce que c’est bien ça? Est-
ce qu’on oublie quelque chose?
112
20. Comment as-tu trouvé le fait d’écrire un blogue sur la sexualité comme je t’ai demandé de faire?
Était-ce pour toi un devoir, ou cela te faisait-il du bien? Le referais-tu si tu en avais l’occasion?
21. Enfin, si j’avais à refaire ma recherche à zéro, qu’est-ce que tu changerais?
Ces questions ont été élaborées selon une logique qui part des questions sur les pratiques « de base »
(usages d’Internet en général, lieu où était situé l’ordinateur, etc.) pour aborder les questions plus gênantes,
qui sont en fait les questions clés de l’étude (thèmes cherchés sur Internet, sexualité du couple, distribution du
pouvoir, etc.). L’entrevue se termine ensuite par une section évaluative qui permet de faire un retour sur
l’appréciation des participantes de la méthode. Une telle organisation suit les recommandations de Krueger
(1998), qui, bien qu’elles concernent l’organisation d’entretiens en vue de groupes de discussion « focalisés »
(focus groups), nous ont semblé tout à fait pertinentes pour des entretiens individuels. Krueger recommande
de commencer l’entretien par des questions « d’ouverture », c’est-à-dire des questions dont les réponses ne
seront pas nécessairement étudiées par la suite, mais qui servent à rendre les participants à l’aise. Ces
questions invitent à une réponse rapide et portent sur des pratiques, des intérêts, des hobbies que les
participants, lors des entretiens focalisés, pourraient avoir en commun. Dans notre cas, bien que les
répondants soient seuls, les questions d’ouverture leur permettent de répondre à des questions simples, non
menaçantes, qui instaurent un climat de confiance et d’aisance entre la chercheuse et la participante43.
Les questions d’ouverture sont suivies par des questions « introductives » qui permettent au chercheur d’avoir
une idée de l’expérience des participants (par exemple : « À quel âge as-tu reçu Internet chez toi? ») et
d’adapter, au besoin, ses questions en conséquence. Viennent ensuite les questions « de transition », qui
permettent aux participants de saisir, en quelque sorte, la portée et l’objet de l’étude et de se préparer aux
questions clés qui vont suivre (qui portent alors sur les enjeux importants de l’étude, soit dans notre cas les
thèmes cherchés, les occasions d’expression de l’agentivité sexuelle, etc.). La question « À quel âge as-tu
commencé à te poser des questions sur la sexualité? » est un bon exemple de question de transition (on peut
répéter les questions de transition pour chacun des groupes de questions clés).
L’entrevue se termine sur des questions qui permettent de faire le résumé de ce qui a été dit, de vérifier avec
le participant que son expérience a bien été comprise par le chercheur et de s’assurer que l’entrevue a fait le
tour de la question. C’est ce que nous avons fait : après avoir résumé en quelques phrases ce que nous
avions compris des réponses des participantes, nous leur avons demandé si notre sommaire correspondait
bien à leur vision de leurs expériences, et si elle croyait que nous avions couvert toutes les questions liées au
43 Patton (1990) souligne aussi l’importance de poser les questions liées aux comportements avant les questions liées
aux opinions, aux valeurs ou aux sentiments. Il recommande aussi de poser les questions liées au passé avant celles qui
concernent le présent ou le futur (p. 292-295). C’est donc ce que nous avons fait.
113
sujet à l’étude. Pour encourager la divulgation de tous les thèmes qui ont pu être cherchés, nous leur avons
donné des exemples fournis par d’autres participantes ou par nous-même, et leur avons demandé si elles
avaient déjà cherché de tels thèmes. Il est arrivé à deux reprises que des participantes divulguent alors de
l’information sur des sujets qu’elles n’avaient pas abordés plus en amont dans l’entrevue ou sur le blogue (l’un
des thèmes concernait le vaginisme et l’autre, le fait de faire l’amour sous l’influence de drogues). De telles
vérifications systématiques nous ont donc paru efficaces pour obtenir un portrait complet des expériences des
participantes.
De façon semblable, pour nous assurer une meilleure couverture lors de l’entrevue de tous les thèmes
abordés (ou non) par les participantes dans le blogue, nous avons demandé à chaque participante qui estimait
avoir terminé son blogue d’écrire une dernière entrée de blogue. Ce dernier post devait alors constituer une
liste de tous les thèmes à caractère sexuel cherchés sur Internet dont elle pouvait se souvenir. Nous leur
demandions également d’écrire entre parenthèses la ou les façon(s) dont elles se sont senties lorsqu’elles ont
fait des recherches sur ce thème. Par exemple :
- préliminaires (honte, curiosité);
- masturbation (honte, curiosité);
- douleur (honte, questionnement);
- petits seins (peur, gêne, curiosité);
- etc.
(début de la liste d’Amélie)
Cette façon de procéder nous permettait de nous assurer que le blogue était complet (si la liste comprenait
des éléments non discutés dans le blogue, nous les retenions pour les aborder en entrevue) et permettait aux
participantes d’être une dernière fois réflexives quant à leurs recherches sur Internet au sujet de la sexualité,
en préparation de l’entrevue. Cette façon de procéder nous permettait aussi d’organiser l’entretien autour de
cette liste en plus qu’autour du contenu du blogue (à partir de la question 9 du plan d’entretien). Cela était
particulièrement utile lorsque le blogue était court.
Ainsi, même si l’entretien était basé sur un plan (comportant des questions posées à toutes les participantes),
l’entrevue prenait une forme plus conversationnelle lorsque venait le temps de discuter des thèmes
apparaissant dans le blogue, soit un peu à la manière des entrevues informelles décrites par Patton (1990).
L’entrevue conversationnelle informelle, selon Patton, n’est pas guidée par un plan prédéfini de questions, ce
qui fait que chacun des participants peut se voir poser des questions différentes selon l’orientation que prend
l’entretien en vertu de leurs réponses et du contexte. La prépondérance ou l’importance que prennent certains
114
types de questions dépendent alors des circonstances et des expériences des individus (p. 281 et plus).
Puisque nos entrevues combinaient les deux formes d’entretiens (formel et informel), nous avons pu profiter
à la fois de la flexibilité qu’offrent les entretiens informels et de la conformité de l’approche basée sur un guide
d’entretien, ce qui a pu ainsi réduire le risque que certains thèmes importants soient omis.
4.4 Analyse
Une fois la période de carnetage et les entrevues complétées et enregistrées, nous avons procédé à la
retranscription verbatim des entretiens au moyen du logiciel HyperTranscribe (compatible avec
HyperResearch). Nous avons ensuite transposé à la fois le contenu des blogues et des entrevues dans le
logiciel d’analyse qualitative HyperResearch. Au moyen de ce logiciel, nous avons codé les passages
significatifs selon le thème abordé ou le comportement décrit par la participante, de même que selon leur
orientation, s’il y avait lieu (avant/après, positif/négatif, amélioration/dégradation, etc.). Pour permettre une
analyse très fine, dès qu’un code préexistant n’arrivait pas à décrire la particularité d’une situation, un nouveau
code a été créé, sans limites. Le but était de décrire la multitude de situations possibles plutôt que de créer
des codes « catégoriels » dans lesquels plusieurs situations pourraient se conformer. Les codes44 ainsi
construits (au nombre de 590) ont été réunis en groupes selon leur thème (agentivité sexuelle, blogue, sujet
cherché, etc.). Le résultat constitue une arborescence de codes (auxquels sont annexées les citations
concernées45) qui témoignent des variations rencontrées selon les thèmes interrogés ou observés.
Pour analyser ces citations et ces codes, nous avons privilégié la méthode de « l’écriture comme praxis
d’analyse» (en d’autres mots, « l’analyse à travers l’écriture directe »), décrite par Paillé et Mucchielli (2008,
p. 101-108). Par ce procédé, l’analyste s’engage « dans un travail délibéré d’écriture et de réécriture, sans
autre moyen technique […]. L’écriture devient ainsi le champ de l’exercice analytique en action, à la fois le
moyen et la fin de l’analyse. » (p. 101)
Cette technique, qui est dans notre cas jumelée à un travail de codage et de classification (p. 30), permet une
reconstitution fine et détaillée du discours des participantes. Le but est de faire « ressortir les aspects plus
significatifs (mise en évidence) » (p. 106), tout en contextualisant les propos des participantes, en les
« mett[ant] en rapport complexe et multiple avec ses propres ressorts, contextes, logiques, processus
44 La liste des codes utilisés pour l’analyse est disponible à l’annexe 1. Un coup d’oeil à la liste permet comprendre la
logique appliquée lors de l’analyse et de prendre connaissance des observations qui sont survenues. La liste pourrait
également servir à coder le corpus d’une étude ultérieure. 45 Près de 2 600 citations pertinentes ont ainsi été annexées aux codes de l’analyse. Parce qu’une même citation pouvait
être annexée plus d’une fois, ce chiffre comprend souvent des doublons.
115
(théorisation) » (p. 106). Bref, de répondre à la question : « qu’y a-t-il à décrire, rapporter, constater, mettre de
l’avant, articuler relativement au matériau à l’étude ? » (loc. cit.)
L’écriture est alors à la fois descriptive et analytique, c’est-à-dire qu’elle « déborde de la stricte description
pour prendre la forme d’essais plus conceptuels, se situant à une certaine distance du corpus analysé »
(p. 105). Elle peut aussi être évaluative, notamment « lorsqu’elle s’exerce sur le mode du jugement de la
présence ou de l’absence d’éléments souhaités ou souhaitables » (loc. cit.), soit ici, les signes d’un
comportement agentique.
Par le regroupement en codes et en groupes de codes, par la lecture et la relecture des verbatim et des
citations codées, cette méthode permet d’en venir à des constats, des observations et des hypothèses, que
l’on vérifie et couche sur papier au fur et à mesure : « l’écriture est ici tentative d’interprétation, de mise en
relation et d’explication. Elle se pose comme discours signifiant par rapport à une volonté de faire surgir le
sens, de donner à voir ce qui peut être vu, de débusquer le non-dit ou l’implicite, de rapprocher ou d’opposer
des logiques, de retracer des lignes de force. » Le texte qui suit et permet ce rapprochement a pour but de
« détailler, expliciter, illustrer » ces constats (p. 107).
Bref, il s’agit d’une technique de réécriture, de mise en relation fine et complexe des observations : « Il peut
s’agir de l’amalgame ou du "collage" des extraits pertinents ou d’une synthèse nouvelle, lesquels sont à leur
tour fondus dans un récit encore plus englobant, et ainsi de suite. » (p. 108) Cette technique permet une
précision remarquable, et toute la place nécessaire à la nuance :
…le texte est l’expérience par excellence de l’articulation de la pensée. Il offre tout l’espace
voulu à l’élaboration analytique et au raffinement théorique. Là où l’utilisation de mots-clés,
de codes ou de catégories, et même de constats, apparaît limitative, le texte s’avère une
ressource inépuisable. (p. 107)
Si, dans notre analyse, nous prêtons attention à la récurrence, le dénombrement « quantitatif » des codes,
même utilisé dans une perspective qualitative, n’a pas sa place ici, et ce pour trois raisons : d’abord, il est tout
à fait possible qu’un code apparaisse plusieurs fois dans l’analyse d’une entrevue ou d’un blogue, notamment
lorsque, dans la discussion, l’on s’est intéressées à un sujet particulier que l’on a voulu développer en
profondeur. À l’inverse, il est possible qu’en raison justement d’une attention particulière portée à un sujet lors
d’une entrevue, un autre sujet (tout autant d’importance) n’ait été que peu ou pas développé. La comparaison
entre participantes du degré d’apparition d’un code ou du nombre d’occurrences d’un code en général n’est
donc pas pertinente.
116
Ensuite, le nombre de participantes (30 au total, 25 en entrevue) n’est pas suffisamment élevé pour justifier
une généralisation basée uniquement sur un dénombrement. D’ailleurs, l’analyse qualitative n’a pas tant
comme but la généralisation des résultats, que la description des particularités d’une situation donnée pour
comprendre les dynamiques et les processus sociaux qui la sous-tendent et l’expliquent (Geertz : 1973;
Glaser : 1978; Laperrière : 1997).
Enfin, il nous semble tout autant important de se pencher sur les absences, les exceptions, ou les cas
particuliers, qui sont autant significatifs (et même plus pertinents, dans certains cas) que tout résultat basé sur
la « présence » d’un code en grand nombre. Comme l’expliquent Paillé et Mucchielli, « le singulier, le cas
négatif, le phénomène incompris, énigmatique ou isolé [bref, l’exceptionnel] ont tous leur importance au sein
de la théorisation » (p. 177).
La perspective émique et celle de la chercheuse
On définit par « perspective émique » celle qui se rapporte aux personnes étudiées. C’est le linguiste et
anthropologue Kenneth Lee Pike qui a d’abord utilisé le terme pour rendre compte de la compréhension
subjective du langage par les usagers d’une langue, par opposition à la perspective « étique », soit celle de
celui qui observe (Pike : 1967 [1954]). L’utilisation de la dichotomie s’est ensuite étendue à d’autres disciplines
pour désigner les deux types de perspectives sur les comportements sociaux (Headland, Pike et Harris :
1990). Comme pour toute analyse qualitative, notre étude n’a pas pour but de substituer une parole à une
autre, mais plutôt de se faire « observation du changement, description attentive des proximités, reconstitution
des trajectoires, [et] articulation des interrelations » pour mieux comprendre la perspective de l’acteur (Paillé et
Mucchielli, op. cit., p. 35 et 75) :
Ceci signifie qu’il importe non seulement d’écouter l’autre mais aussi de lui accorder du
crédit, c'est-à-dire accorder de la valeur à son expérience. Il s’agit en fait de reconnaître la
souveraineté première de l’acteur. (p. 70)
Pour accorder cette valeur à son expérience, on privilégie d’abord une attitude empathique (p. 69) et une
écoute qui suspend, en quelque sorte, le jugement, les attentes et les perspectives théoriques du chercheur
ou de la chercheuse pour mieux comprendre une réalité qui lui est nécessairement « autre » :
La réalité humaine dans laquelle va plonger le chercheur n’est fondamentalement pas la
sienne. C’est une construction sociale qui appartient aux acteurs de la situation en question.
[…] [L]’examen phénoménologique des données, c’est l’écoute initiale complète et totale
des témoignages pour ce qu’ils ont à nous apprendre, avant que nous soyons tentés de les
"faire parler". Cet examen consiste ainsi à donner la parole avant de la prendre soi-même.
(p. 70)
117
L’essentiel est donc de « dégag[er] le plus fidèlement possible » « la logique essentielle mise de l’avant par
l’acteur » (p. 75) de façon à ce que le résultat reflète d’abord la perspective de l’acteur avant qu’elle soit mise
en contexte dans les cadres d’analyse des chercheurs. En effet, bien que la perspective émique ne soit « plus
totalement émique à partir du moment où le chercheur se l’approprie, en partie ou en totalité » (p. 175), ce
« dégagement » de la logique de l’acteur basé sur le respect de sa pensée et de la construction sociale de son
expérience n’exclut pas que le chercheur puisse situer, contextualiser, mettre en lumière et contraster certains
points. Si cette mise en contexte ne signifie par pour autant que la parole de la chercheuse soit en
remplacement de celle des participantes, elle n’est d’autre part pas toujours nécessaire. Nous reprenons une
deuxième fois la citation de Duits et van Zoonen (2007) dans leur réponse à Rosalind Gill :
If the task of the feminist intellectual, as Gill suggests, is not to say "I see" after such
reflections, but to conceptualize, situate and locate it in a wider context, look at patterns and
variability, examine silences and exclusions (p. 77), then this is exactly what the girls are
already doing themselves. This is not to suggest that all girls are feminist theorists in
disguise, […] but that it is imperative to examine which tactics girls use in their everyday
lives to "make do" (de Certeau, 1984) with all the forces that bear on them. Such analysis
can only take place by interviewing and observing girls in their own everyday surroundings,
and not by framing them from the remote shores of the kind of feminism that Gill advocates.
(Duits et van Zonnen : 2007, p. 166)
Nous verrons, dans la partie « Résulats », que nos participantes, tout comme celles de Duits et van Zoonen,
sont tout à fait capables de discuter elles-mêmes des situations où elles avaient fait preuve (ou non)
d’agentivité, de les mettre en contexte et de les expliquer. Nous n’avons donc pas à mettre en doute la validité
ou la sincérité de leur description de leur vécu, ou encore d’attribuer leurs expériences et leurs impressions
à une « fausse conscience » de jeunes filles manquant d’éclairage quant à la culture dans laquelle elles ont
grandi, car elles en sont très conscientes de cette culture et en sont même très souvent critiques.
Bref, à la manière de Duits et van Zoonen (2009, 2006, 2007), nous avons privilégié une méthode basée sur
l’écoute des filles et sur la compréhension de leurs choix (sexuels, dans notre cas) comme elles les conçoivent
elles-mêmes, avant de les articuler à l’intérieur des forces sociales que nous aurions pu percevoir en tant que
chercheuse (loc. cit., trad. libre), tout cela pour « en arriver à une analyse la plus juste possible » (Paillé et
Mucchielli, p. 29; voir aussi à ce sujet Ollivier et Tremblay : 2000, p. 49-50).
Par ailleurs, si certains seraient tentés de croire que les participants d’une recherche pourraient modifier leur
discours en raison d’une relation de pouvoir que l’on suppose inégalitaire lors des entretiens et du recrutement
118
(« top-down effect »), Allen (op. cit., 2008) estime que ce serait méprendre la relation complexe qui s’installe
entre intervieweur et interviewé :
In each case, the researcher is seen to weild greater authority while the interests of the
researched are subordinated. Integral to these critiques is a binary notion of power whereby
the researched are constructed as powerless and the researcher powerful. This rigid
demarcation between "oppressor" and "oppressed" fails to take account of the shifting and
often complex nature of power relations within research contexts. (Allen : 2008, p. 573)
D’ailleurs, comme les entrevues sont omniprésentes dans la société actuelle (à la télévision entres autres), les
participants sont moins intimidés par les entrevues qu’on pourrait le croire. Et comme plusieurs moyens sont
disponibles aux chercheurs pour valider leurs impressions (questionnement perspicace mais respectueux,
récapitulation à la fin des entrevues en vue de l’approbation ou de la rectification, etc.), les données obtenues
par entrevue peuvent être considérées comme fiables.
Enfin, et cette observation s’applique particulièrement à notre cas, l’on pourrait être tenté de croire que
certains participants choisissent de garder pour eux certaines informations, et donc d’exercer leur agentivité
personnelle en reconnaissant leurs limites. On pourrait donner comme exemple le cas de Mégane, que nous
verrons plus en détail plus loin dans l’analyse. Lorsque nous avons posé à Mégane la question à savoir si elle
appréciait la pornographie, Mégane a d’abord répondu non. Lorsque nous lui avons lancé à la blague « Tu
peux me le dire! », Mégane a souri puis a changé de réponse et nous a expliqué pourquoi elle aimait la
pornographie. S’il est vrai que nous avons réussi à obtenir plus d’information (voire une information différente)
en sourcillant à la blague au commentaire de Mégane, celle-ci était toujours en position de divulguer ou de
garder pour elles certaines informations. D’ailleurs, toutes les participantes ont été avisées en début
d’entrevue qu’elles avaient la liberté de répondre ou non à chaque question qui lui serait posée. (Une
participante, par exemple, n’a pas voulu préciser la partie du corps dont elle était gênée de l’apparence, même
si plus tard dans l’entrevue elle a avoué à mots couverts qu’il s’agissait de ses parties génitales). Le fait que
Mégane ait choisi de divulguer qu’elle aime la pornographie peut être considéré comme un comportement
agentique (agentivité personnelle), tout comme le fait qu’elle décide de garder pour elle certaines infos. Si le
devoir de la chercheuse n’est pas de mettre en doute la parole des participantes, comme Gill (2007) l’a
souligné, mais de la situer, de relever les contradictions et les silences, de mettre en contexte et de comparer
les différences s’il y a lieu, il est aussi, dans les limites du respect de l’autre et de l’éthique, de poser des
questions perspicaces quand la situation s’y prête.
Et comme l’ont observé Duits et van Zonnen (2007), ce type de « perspicacité » de la part du chercheur est
loin d’être nécessaire, car comme on va le voir, les participantes sont capables de discuter par elles-mêmes
119
des occasions où elles ont exercé ou non du pouvoir. L’important, dès lors, n’est pas tant d’émettre un
jugement sur les expériences des participantes (« ici elles exercent du pouvoir »; ou « ici non »), mais bien
d’interroger les occasions où les participantes ont elles-mêmes cette impression d’avoir pu exercer ou non du
contrôle ou du pouvoir46 dans telle ou telle situation – et ce même si le fait de le constater par le biais de
l’analyse reste toujours possible pour la chercheuse. (Par ailleurs, comme on va le voir, le cas de Mégane est
peu fréquent. Plus nombreuses sont les occasions où les participantes ont discuté de sexualité sans gêne et
sans censure lors des entrevues et dans leur blogue.)
Le fait de mettre d’abord la parole des participantes avant la sienne n’exclut pas, pour le chercheur, une
possibilité d’analyse. Par exemple, on peut difficilement affirmer que les comportements décrits par Levy
(2005) ou le haussement d’épaules de Tolman (1994, 1999) et de Gilmartin (2006) sont agentiques, et nous
croyons qu’il faut pouvoir le dire. Nous pensons toutefois que l’attitude du chercheur que nous préconisons (de
même que la réalité des entrevues décrite ici) permet d’éviter l’écueil de la normativité évoqué en chapitre 3.
D’autre part, le danger de la normativité ne justifie pas, il nous semble, l’exclusion du concept d’agentivité
sexuelle dans la recherche, vu sa pertinence et son utilité indéniables. Il n’en constitue qu’une limite – dont il
faut toutefois être conscient et qu’il importe de reconnaître – comme peut en avoir tout concept en sciences
sociales.
Le but du chercheur n’est pas d’extorquer de l’information contre le gré des participants, mais de tenter
d’obtenir, dans les limites du respect et sur une base de confiance, des données valides, pertinentes et le plus
près de la réalité possible (voir Ollivier et Tremblay, op. cit., p. 48-51). Les propos des participantes sont
d’abord une appropriation par elles-mêmes de leur vie sexuelle et de leurs expériences – avant d’être
interprétées par la chercheuse. En ce sens, les résultats de la méthode et de l’analyse – que nous montrons
au chapitre suivant – sont une conceptualisation particulière de la réalité des participantes, qui est
doublement, voire triplement soumise aux discours sociaux : les comportements des participantes sont
soumis, comme on l’a vu, aux contraintes des structures sociales en place, leurs discours et leur interprétation
le sont également, et finalement l’interprétation de la chercheuse de leurs comportements et interprétations est
elle-même soumise à des discours sociaux, intellectuels et à ses cadres d’analyse. Cette appropriation des
participantes, pourtant, est tout autant intéressante pour les chercheurs que pourraient l’être, par exemple, des
informations recueillies selon une méthode directe ou invasive de leur réalité. D’ailleurs, comme le dira Patton
(op. cit.) :
The issue is not whether observational data is more desirable, valid, or meaningful than self-
report data. The fact of the matter is that we cannot observe everything. […] We cannot
46 J’utilise les deux mots de façon sensiblement équivalente.
120
observe situations that preclude the presence of an observer. […] The purpose of
interviewing, then, is to allow us to enter into the other person’s perspective. Qualitative
interviewing begins with the assumption that the perspective of others is meaningful,
knowable, and able to be made explicit. (p. 278)
Par ailleurs, dans les études qui, comme la nôtre, se situent dans un paradigme constructiviste où le rapport
entre le chercheur et le participant est crucial et où s’effectue une coconstruction de sens avec les personnes
interviewées, la subjectivité des chercheurs prend une place importante. L’intégration de la subjectivité du
chercheur ou de la chercheuse est particulièrement valorisée en recherche féministe :
…l’intégration de la subjectivité à la recherche ouvre la voie à des connaissances plus
riches. Dans cette perspective, il ne s’agit pas de polariser objectivité et subjectivité en
postulant leur caractère antinomique, mais de les penser comme complémentaires à une
démarche unifiée de recherche : l’objectivité suggère des façons de faire (qui ne sont
évidemment pas au-dessus de toute critique), alors que la subjectivité, qui elle aussi doit
être utilisée avec rigueur, contribue à des façons d’être, de penser et de dire en recherche.
À cet égard, les expériences personnelles de la chercheuse (et ses émotions aussi) jouent
un rôle fondamental dans le processus de recherche féministe : entre autres, elles sont
souvent le lieu d’où émergent les questionnements de départ et les questions de la
recherche et continuent de les alimenter, elles suggèrent un regard critique sur un
processus formalisé de recherche disciplinaire, elles sont des sources d’où partir pour
identifier des participantes à la recherche et guident les interactions avec elles, elles
inspirent un sens à l’interprétation des résultats. […] La recherche féministe se distingue
des démarches plus « conventionnelles » de recherche en ce qu’elle reconnaît, accepte et
intègre le rôle des expériences personnelles dans le processus de la recherche, alors que le
point de vue objectiviste les nie. (Ollivier et Tremblay, op. cit., p. 46)
Dans notre recherche, nous avons choisi de laisser une place importante à notre propre subjectivité lors des
entrevues avec les participantes. Nous avons pu, par exemple, parler de nos expériences personnelles avec
elles, ce qui a pu favoriser l’échange et contribué à instaurer un contexte de proximité avec elles, deux
conditions sine qua non pour obtenir des données de qualité sur un sujet si délicat. Si les résultats ne
montrent pas de traces de cette subjectivité, c’est d’abord et avant tout parce qu’en tant que chercheuse, nous
ne profitons pas de l’anonymat que nous avons assuré à nos participantes. D’autre part, nos expériences en
matière de sexualité n’engageant pas que nous-même, nous ne souhaitions pas divulguer des informations
personnelles qui auraient pu concerner, par exemple, notre conjoint ou notre famille. Les questionnements
éthiques ayant trait à l’exigence de coconstruction de sens dans un contexte de recherche sur des questions
« privées » sont discutés plus en détail, par exemple, dans Ellis : 2007, p. 17 et plus.
5 Résultats relatifs à Internet, à la quête
d’information et à l’agentivité sexuelle
Les résultats que nous présentons ici sont divisés en trois grandes catégories. D’abord, dans la section 5.1, on
trouvera les résultats qui concernent la quête d’information sur Internet. Il sera question de l’efficacité
d’Internet en diverses situations précises et des usages d’Internet par les participantes selon les différents
thèmes qu’elles ont cherchés. Dans la section 5.2, nous discuterons de la manifestation de leur agentivité
dans leur vie sexuelle. Enfin, dans la section 5.3, nous discuterons de leur appréciation d’Internet comme outil
de recherche sur la sexualité. De façon très générale, les résultats de la méthode du blogue ont surtout
contribué à déterminer les thèmes cherchés et l’efficacité d’Internet en différentes situations, tandis que les
résultats issus des entrevues ont surtout servi à discuter d’agentivité. Toutefois, les deux méthodes se croisent
et se rencontrent pour enrichir les résultats des trois sections. De plus, puisque les blogues ont servi de base
aux entrevues, ce qui a été écrit dans les blogues a souvent été répété, précisé et mis en contexte dans les
entrevues.
Les citations qui viennent appuyer nos propos sont présentées ici sans égard à la source (blogue ou
entrevue). Elles sont reprises autant que possible dans les mots des participantes. Toutefois, certaines
modifications mineures y ont été apportées pour faciliter la compréhension. Ces modifications concernent en
général la syntaxe et la grammaire : on a accordé des verbes, ajouté des signes de négation, supprimé les
hésitations ou les répétitions, ou synthétisé entre crochets certains passages longs ou redondants. Il est
à noter enfin que les prénoms des participantes ont été changés pour préserver leur anonymat.
5.1 Thèmes cherchés
Les thèmes cherchés par les participantes sont très nombreux et très variés; ils vont de la première relation
sexuelle aux trucs pour apprendre à faire une fellation en passant par les maladies transmissibles
sexuellement. Si certaines études présument que ce dernier thème occupe une place prépondérante dans les
requêtes des jeunes femmes, nous allons voir que pour nos participantes, ce n’est pas réellement le cas. Les
thèmes cherchés ne se limitent pas qu’aux ITSS ou à la question de l’avortement, comme les études basées
sur des scénarios prédéterminés peuvent le suggérer. Au contraire, on constate dès les premières
observations que les participantes ont cherché sur Internet une diversité étonnante de thèmes.
Cette diversité dépasse largement la liste d’idées que nous leur avions fournie sur le site Web leur permettant
d’accéder à leur blogue. Cela, d’une part, permet de supposer qu’elles ne se sont pas limitées à cette liste
pour faire part de leurs expériences du Web et de la sexualité (ce qui aurait affecté la fiabilité de nos résultats),
122
et démontre, d’autre part, que le Web leur sert pour répondre à une variété de questions, qui vont des plus
simples aux plus complexes. Voici, avant d’aller plus loin, la liste47 complète des thèmes cherchés :
1re fois
accouchement
acronymes sexuels
agentivité sexuelle48
amour
anorgasmie
art érotique
avortement
cancer du sein ou autoexamen
caudalisme49
ce que les hommes aiment ou pensent
choc toxique ou tampons
circoncision
comment embrasser
comment séduire
communication concernant la sexualité
condom
contraception
crainte de grossesse
cybersexe
désir sexuel
déviances sexuelles
différences hommes femmes
douleur
durée d'une relation sexuelle
dysfonctions érectiles
échangisme
ecstasy
éjaculation lente
éjaculation précoce
érection
érotisme ou art sexy
examen gynécologique
hypersexualisation
implants mammaires
infections urinaires
infertilité
jouets sexuels
masturbation
menstruations
ITSS
orgasme
orientation sexuelle
panne de désir
pénétration anale
pénis ou grosseur du pénis
pH vaginal
physique en général
pilosité
pilule du lendemain
point G
pornographie
positions sexuelles
pratiques sexuelles hors normes
pratiques sexuelles ou norme
préliminaires
pub sexuelle
quiz
relations amoureuses
rupture du frein
saignements après relation
secrétions vaginales
seins
sensualité
sexe et alcool
sexe oral
47 Si certaines catégories semblent se recouper (ex. : caudalisme/pratiques sexuelles hors normes), c’est que nous avons
voulu, dès cette première étape, atteindre un niveau de précision élevé. Puisque certaines recherches étaient très
précises, et d’autres très vastes, nous avons utilisé tantôt une description thématique ciblée (ex. : caudalisme), tantôt une
description plus élargie (ex. : pratiques sexuelles hors normes). 48 Cette étiquette est bien évidemment la nôtre. Les participantes ne connaissaient pas cette expression, mais comme
certaines de leurs recherches (toutefois rares) portaient sur le désir d’en savoir plus sur les façons d’exercer du pouvoir
dans le couple, nous avons créé celle-ci. 49 Pratique sexuelle où l’un des partenaires prend plaisir à observer son partenaire faire l’amour avec une autre personne.
123
excision
fellation
femme fontaine
fétiches
forme de l'utérus
frigidité
grossesse
grossesse adolescente
grosseur des seins
histoire de la sexualité
histoires érotiques
humour (sur la sexualité)
sites de rencontre
sperme
trucs pour mettre piquant
vagin ou vulve
vaginisme
vaginite
vasectomie
vidéo explicative
vidéoclips sexy
virginité
VPH (vaccin)
Cependant, les thèmes listés ici n’occupent pas une importance égale dans la recherche d’information sur la
sexualité chez nos participantes. De même, les raisons ou les sentiments qui ont motivé la recherche de ces
thèmes ne sont pas non plus les mêmes. Alors que certains thèmes sont cherchés une fois puis oubliés,
d’autres font l’objet de recherches plus intenses qui sont motivées par une crainte récurrente ou une volonté
plus prégnante de savoir. Pour offrir au lecteur une vision globale mais également nuancée des différentes
façons par lesquelles la quête d’informations sexuelles prend une place dans la vie des participantes, nous
avons divisé les thèmes en dix catégories, selon le degré d’inquiétude ou d’investissement que manifestent les
participantes dans leurs recherches. On a indiqué pour chacune de ces catégories l’usage ou le thème
principal qui motive la recherche de ces thèmes. Ces catégories sont les suivantes :
124
Usage/thème principal Catégories de thèmes
Curiosité
1) Thèmes à curiosité « simple »
2) Thèmes à curiosité « concernée »
Craintes
3) Thèmes relatifs à la norme
4) Thèmes relatifs aux craintes « centrales »
5) Craintes vives mais passagères
Prise en charge
des pratiques et des relations
6) Thèmes visant « l’amélioration » des relations de
couple
7) Thèmes montrant le « comment »
Réflexion 8) Thèmes suscitant une prise de position
Plaisir/Exploration
9) Thèmes pour s’amuser
10) Thèmes « traumatisants » et thèmes leur
permettant d’ « explorer »
Tableau 3 : Catégorisation des thèmes cherchés
5.1.1 Thèmes à curiosité « simple » : des mots et des significations
Certains thèmes ont été cherchés dans le simple but de connaître la signification des mots, de se mettre au
courant de certaines pratiques ou d’en apprendre plus sur la réalité des autres. C’est le cas, par exemple, des
thèmes « caudalisme », « circoncision », « échangisme », « érection », « fétiches », « histoire de la
sexualité », « pénétration anale », « pénis ou grosseur du pénis », « vasectomie »50, etc. Parmi ces thèmes,
50 Il est possible de repérer, à l’annexe A, les thèmes à curiosité « simple » dans la liste des codes utilisés pour l’analyse.
Ceux-ci sont en principe suivis de l’extension « curiosité ». Toutefois, certains thèmes sont suivis de plusieurs extensions
(curiosité, honte, etc.) qui témoignent des différentes modalités de recherches entreprises par les participantes. Il est
à noter également que l’apparition d’un thème ou d’une extension ne témoigne pas nécessairement d’un cas d’espèce ou
125
on trouve des recherches sur les termes « de base », c’est-à-dire les premiers mots que les participantes ont
entendus, très jeunes, sur la sexualité, et dont elles ont été curieuses : vulve, vagin, pénis, etc. Pour certaines,
c’est le mot « orgasme »51 qui éveillait leur curiosité :
Je me suis déjà posé la question : « Est-ce que les femmes ont un orgasme? » Pour trouver
ma réponse, j'ai fait des recherches sur Internet et ça m’a tout dit. Je peux avouer que je ne
savais pas qu'une femme pouvait atteindre ça. J’étais vraiment étonnée. (Rosalie)
Pour d’autres, c’est le mot « pénis » :
Première question venant à l'idée d'une jeune ado allumée sur les garçons, mais qui n'a
jamais eu de « chum » (on s'entend pour la définition de « chum » quand on est en
secondaire 1) […] : à quoi ça ressemble un pénis? Non mais, un vrai là, pas un dessin dans
un livre! GOOGLE IMAGE est donc venu à ma rescousse. En premier lieu gênée et
nerveuse de chercher des images de ÇA (si mon père m'avait pognée... ouh la la),
l'important se situe dans la découverte que j'y ai faite : Ark, c'est vraiment laid un pénis
quand on a 11 ans. Avec le temps les intérêts changent (...)52, mais quand même!
(Gabrielle)
Bref, ce sont souvent des termes qui renvoient au corps (masculin ou féminin) et à son fonctionnement. Ou
encore, ce sont des thèmes qui témoignent d’une curiosité envers des pratiques sexuelles peu courantes sur
lequelles elles veulent obtenir plus d’information, comme « échangisme », « caudalisme », etc. Dans ce cas
précis, ces thèmes ne sont ni les thèmes les plus couramment cherchés, ni les thèmes qui s’appliquent à leur
réalité directe ou immédiate. Ce type de recherches n’est donc pas la manifestation d’une inquiétude ou d’une
angoisse. C’est le cas par exemple des recherches sur les pratiques sexuelles des couples homosexuels
(dans les cas des filles hétérosexuelles) ou des recherches sur un terme dont la définition peut paraître
obscure, comme « caudalisme » :
Aujourd'hui, sur le site aufeminin.ca, j'ai découvert ce que voulait dire « caudalisme ». Je
ne savais même pas que ce phénomène existait... Il s'agit de « l'excitation ressentie par un
homme de voir sa femme faire l'amour avec un autre homme sans participation de sa
part »… ....Eh bien. Moi, j'aurais plutôt appelé ça du voyeurisme, mais bon... Je suis assez
surprise. Ça prend des couples ouverts j'imagine... (Fin de la tranche de vie) (Camille)
d’un résultat généralisé chez elles, mais bien de l’occurrence simple (et peut-être unique) d’une situation ou d’un résultat
précis. 51 Les catégories ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. Ainsi, un thème peut se retrouver dans plusieurs
catégories, selon les usages faits par les participantes, qui peuvent être différents de l’une à l’autre. 52 Les parenthèses et les points de suspension sont de la participante.
126
Ou encore :
C'est par curiosité qu'on est allées [entre filles] visiter les forums sur la sexualité. On
a commencé par un forum sur la taille des pénis. Même en discutant de ça entre filles, ça
reste un tabou. Parce que dans le fond on se rend compte qu'à une certaine limite ça n'a
pas d'importance. […] [Q]ui est-ce qui sort son gallon à mesurer avant une relation? […]
Bref, quand il est question de grosseur, de longueur, de texture, de couleur ou de tout ce
que vous voudrez, eh bien les gars ne devraient pas trop stresser là-dessus (sauf certaines
exceptions...) parce que finalement entre nous on ne s'en parle pas trop, trop. Peut-être
davantage autour d'une table avec une bouteille de vin. Mais sinon, on ne se demande pas
quelle est la grosseur du pénis. […] C'est un peu la même chose que pour la taille des
seins. Les femmes s'en font probablement un peu trop. Parce qu'à la fin, ça reste une
question de goût. (Camille)
Si certains thèmes très précis peuvent n’apparaître qu’une fois (ex. : caudalisme), certains sont un peu plus
partagés. Par exemple, cette question de l’apparence ou de la grosseur des organes génitaux masculins
apparaît souvent pour certaines comme l’attestation d’un coming of age, bref comme un passage obligé qui
marque le passage de la fin de l’enfance vers le début de l’adolescence. La recherche d’information sur le
sujet, qui prend parfois la forme de recherches d’images, est souvent ritualisée entre amies. Quelques amies
se retrouvent sans la surveillance des parents un certain soir, et se mettent à chercher des images pour
s’informer, pour rigoler, ou pour s’en « traumatiser » :
Intervieweuse : Ici, tu as indiqué : « pénis – curieuse ».
Gabrielle : Ça c'était vraiment le début-début, la passe... [où je cherchais de l’information de
base]. C'est du genre : ça ressemble à quoi? […] J'étais avec mon amie, on regardait ça.
Sur mon ordi, sur Google […]. On allait checker ça.
Intervieweuse : Alors c'est devenu quasiment un jeu, Internet...
Gabrielle : Presque, mais c’était full traumatisant. J'étais là : Oh, mon Dieu! Non!
Il s’agit donc pour certaines d’une recherche moins intime que beaucoup d’autres; pour elles, ce type de
recherche n’expose pas leurs craintes de façon aussi personnelle que, par exemple, une recherche sur le
vaginisme (nous y reviendrons). Pour d’autres, toutefois, la gêne associée au fait d’être curieuse envers ce
type de questionnements demeure parfois trop grande pour être partagée. C’est le cas d’Alicia :
127
Quand j'étais au primaire, vers l'âge de 10-11 ans environ, j'entendais souvent des choses
à l'école concernant la sexualité. Il me venait alors plusieurs questionnements, mais je n'ai
jamais osé en parler avec ma mère. Elle a toujours évité le sujet. Je me suis alors tournée
vers Internet, mais comme l'ordinateur était posté dans un lieu « public » de la maison (le
bureau), j'ai toujours été discrète et rapide dans mes recherches! Les questions que je me
posais étaient diversifiées. Au début, je crois qu'elles ont surtout tourné autour de l'acte
sexuel en tant que tel. Je voulais savoir : est-ce que ça fait mal? Comment on fait? Ça
ressemble à quoi un pénis? Des questions plus en « surface », disons. (Alicia)
Le corps des femmes leur est également intriguant, surtout lorsqu’elles sont encore petites :
[J]e me rappelle très bien être tombée sur un site parlant de pornographie. Il y avait des
images explicites de femmes nues. Pour arriver sur ce site, j'avais écrit un mot à double
sens (ignorant certainement qu'il y avait un deuxième sens « cochon » à ce mot). Sur le
coup, cela m'avait beaucoup gênée. J'avais peur que ma mère, jamais bien loin, ne voie le
site sur lequel j'étais allée. Après coup, cela m'a intriguée. À l'époque, mon corps se
transformait, je devenais femme. Alors, le corps de ces femmes me rendait curieuse. Allais-
je ressembler à ça plus tard? Que faisaient-elles au juste?
Je ne me rappelle pas avoir été choquée par ces images; mon intrigue prenait le dessus.
Beaucoup de questions auxquelles je n’ai eu des réponses que beaucoup plus tard, car
j'étais encore très jeune. Après quelques minutes, je me suis dépêchée à quitter ce site et je
suis retournée à mes occupations d'enfant. (Roxanne)
Quelques participantes attribuent à de telles recherches, en apparence toutes simples et sans conséquence,
le « coup d’envoi » à une meilleure connaissance de leur corps et à leurs premières expériences sexuelles
« physiques » :
[E]n deuxième année, j'ai découvert les plaisirs du toucher, en me tripotant moi-même par
simple curiosité. […] Sur Internet, je regardais simplement des photos de « stars » que
j'admirais et je suis tombée par pur hasard sur [des] photos [où des femmes se touchaient].
Alors, en 3e ou 4e année, c'est le moment où j'ai vraiment réalisé que je pouvais introduire
mon doigt dans mon vagin. […] À partir de ce moment, à peu près, j'ai commencé
à vraiment utiliser Internet pour mieux comprendre mon corps et mes attouchements.
(Laurieanne)
Alicia tient à quelques nuances près le même discours :
Je suis un jour tombée [par hasard] sur un article traitant des orgasmes. […] [L]'article
mentionnait notamment que ce n'était pas toutes les femmes qui avaient des orgasmes,
128
que certaines étaient clitoridiennes et d'autres vaginales, etc. […] [À] partir de ce moment-
là, j'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité. Qu'est-ce j'aimais le plus?
Pourquoi? Quel type de femme étais-je? […] Je ne peux pas dire qu'Internet m'a aidée
à savoir ce que j'aimais, mais je peux dire qu'il m'a éclairée un peu dans mes désirs! Oui,
parce que l'article mentionnait quelques mots sur ce qu'aimaient les femmes de tel ou tel
type. (Alicia)
Si toutes les participantes n’attribuent pas d’emblée à Internet le coup d’envoi d’une curiosité de plus en plus
grande envers certaines pratiques sexuelles ou certains désirs, toutes, cependant, ont pu constater la
nécessaire évolution de leurs questionnements au fil de leurs expériences et de leurs découvertes. Gabrielle,
Jessica et Alicia, citées ici, en témoignent de façon éloquente :
Intervieweuse : Quand tu étais jeune, à quoi ressemblaient les questions que tu posais sur
Google?
Gabrielle : Je te dirais que c'était le plus basic, c'était genre, ça ressemble à quoi, ça fait
quoi comme effet... Plein de questions, vraiment, pas « de base », mais tu ne connais rien,
tu veux juste te faire une base de connaissances. […] Maintenant, ce sont plus des
questions approfondies : qu'est-ce qui peut t'arriver, mettons... Dans le fond, tu as comme
fait ta base avant, et c'est maintenant que tu veux plus approfondir le sujet, alors ce sont
plus des questions pointues. Des choses qui te sont arrivées et que tu veux savoir pourquoi,
des conséquences qui pourraient arriver, des trucs plus informatifs, mettons... […] Plus
spécifiques.
Jessica évoque le fait que ses questions sont devenues plus sérieuses avec le temps :
Je me rappelle que, des fois, avec mes amies, je m'amusais à taper… J’avais marqué des
noms de maladies un peu dégueu, des choses comme ça, et je regardais ça. […] Des
choses comme ça, un peu banales, je dirais. Ce n'était pas de grosses questions. […] Je
prenais ça un peu plus à la légère et à la blague quand j'étais jeune. Aujourd’hui, je me dis
que c'est peut-être intéressant de regarder ça un peu plus en profondeur. (Jessica)
Les questions deviennent, en quelque sorte, plus appliquées, et les participantes se sentent alors plus
« concernées » par les réponses :
Le type de questions a changé après que j'ai eu mon premier chum, évidemment, parce
que là ce n'était plus juste le questionnement, c'était vraiment la mise en pratique. Je pense
qu'après une première relation sexuelle, les questions évoluent. Ce n’est plus « comment
129
ça fonctionne », mais « qu'est-ce que ça fait » et « comment tu fais pour avoir plus de
plaisir » ou « comment tu fais pour te protéger ». (Alicia)
Nous discutons de ce type de questionnements dans la section qui suit.
5.1.2 Thèmes à curiosité « concernée »
Les thèmes que nous avons classés « à curiosité "concernée" » se distinguent des thèmes classés dans la
première catégorie par un intérêt plus prononcé de la participante. Ce peut être qu’ils concernent directement
le corps de la participante, ses modifications, ou les effets « physiques » que celui-ci subira lors de la première
expérience sexuelle, ou lors de l’accouchement :
Noémie : J'ai vu que quand tu accouchais, tu pouvais déchirer… […]
Intervieweuse : Pour quelle raison te posais-tu cette question?
Noémie : […] J'ai entendu dire que ça arrivait à pratiquement tout le monde, alors là j'étais
vraiment traumatisée! Parce que ça [me] fait vraiment peur! Alors là, je suis allée m'informer
un peu. […] Est-ce qu’il retrouvait sa forme initiale? Est-ce que les sensations étaient les
mêmes?
Les thèmes que nous avons classés dans cette catégorie ne se limitent pas au corps des filles, mais
s’appliquent aussi à celui de leur(s) partenaire(s). Noémie, par exemple, s’inquiète au sujet de l’éjaculation
précoce de son copain :
Noémie : Au début, quand j'ai commencé à faire l'amour, tsé supposons que ça durait deux
minutes, je me disais : « Est-ce que c'est normal? » Je me suis informée là-dessus.
Intervieweuse : Est-ce que tu lui as dit que tu te demandais si c’était normal?
Noémie : Non. Je ne le lui ai pas dit. Je trouvais ça méchant! [Mais] j'en ai parlé à mes
amies, [et je me suis rendu compte que] ça a bien l'air que c'est normal quand les gars
commencent. […] Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il est capable de le faire plusieurs fois
de suite. Et ça, je trouve ça bizarre.
Les thèmes de cette catégorie suscitent une inquiétude qui se rapproche plus du sentiment d’être intriguée,
mais de façon particulièrement concernée : la première fois, les menstruations, le pH vaginal (Gabrielle et
Amélie), la forme de l’utérus (Gabrielle), et, pour plus tard, l’accouchement; le corps et le fonctionnement du
corps du copain, etc. Surtout, et l’on va voir que ce questionnement est commun à plusieurs catégories, la
130
participante se demande si elle (ou son copain) est « normale ». Une question à laquelle Internet permet
parfois de donner des pistes de réponse, et donc permet de rassurer :
[Concernant les menstruations,] ça a été la première question, je pense, que je me suis
posée : « Est-ce que je suis normale? [Est-ce que c’est normal] que ça m'arrive à moi, ça?
Est-ce que c'est normal que ça m'arrive si jeune? » Je n'avais pas d'amies à qui c'était
arrivé encore... […] Et finalement, sur Internet, [ça dit que] oui, c'est normal […]. Il y en
a à qui ça arrive aux 8 jours, d’autres que c’est aux 37 jours… Tsé, ça rassure. (Sabrina)
Comme les thèmes qui reflètent une curiosité « concernée » sont nombreux, nous présentons comment cette
curiosité s’exprime à travers les thèmes les plus particuliers ou les plus fréquents.
La première fois
Le thème de la première fois, sans grande surprise, revient fréquemment dans les discussions. Mégane, qui
n’en pas encore eu de relations sexuelles, se demande comment ses premières relations vont se passer :
La plupart du temps c'était des questions comme : « Que ressent-on quand on fait l'amour?
», « Comment atteindre l'orgasme pour une femme? », « Est-ce que c'est douloureux la
première fois? », « Est-ce qu'on saigne nécessairement? »… Puis, récemment, j'ai
commencé à m'intéresser plutôt à des questions telles que : « Peut-on être vierge à 20
ans? », « Comment savoir si c'est le bon? » et des choses du genre! (Mégane)
Sarah, qui, comme Mégane, est vierge, cherche souvent sur le portail Auféminin.com, qui répond à beaucoup
de ses questions :
C'est sûr que ça m'a amenée à chercher « vierge à 18 ans ». Je n'avais jamais cherché [ça,
car avant, je me disais :] « Non, je ne chercherai pas ça. » [Mais plus tard, j’ai voulu] me
renseigner. […] Ça m'a rassurée sur comment va se passer la première fois, surtout. […]
[J]'ai peur, j'ai des craintes... mais j'ai trouvé un site qui me rassure davantage. (Sarah)
Même si Noémie a déjà vécu ses premières expériences sexuelles, elle se souvient de l’anxiété que l’idée de
la première fois pouvait générer :
Ah, je m'en posais des questions. C'était comment, qu'est-ce que tu ressentais… J'avais lu
que je pouvais saigner. Ça, j'étais traumatisée. [Je me disais :] « Là, il ne faut pas que je
saigne, il ne faut pas que je saigne! » […] C'était vraiment savoir comment ça se passait,
comment le monde vivait ça. J'allais lire sur des blogues. (Noémie)
131
Internet lui permet alors de compléter ses besoins en information avant le « grand jour », de se préparer
mentalement et même de réduire son anxiété. Une expérience que partage Sabrina :
En secondaire un, j'avais environ 13 ans... […] [S]i je me souviens bien, c'est à ce moment
que je suis allée sur Internet pour en savoir plus sur les premières menstruations et, surtout,
en savoir plus sur comment c'était de faire l'amour pour la première fois! J'ai tapé quelques
mots clés sur Google et j'ai visité quelques sites d'information, des forums et des blogues.
Je me rappelle aussi que j'allais souvent sur le site du magazine pour adolescentes
« COOL ! ». [Ces sites] m'ont beaucoup aidée concernant mes craintes pour faire l'amour la
première fois. Internet complétait alors les informations que je recevais dans mon cours de
FPS. Je savais maintenant pourquoi on disait que ça fait mal la première fois, on
m'expliquait comment dérouler le condom et aussi l'importance d'avoir confiance en son
partenaire (puisque c'est gênant de se mettre nu pour la première fois devant quelqu'un!).
[via le blogue]
[En entrevue] [Ces sites disaient] tsé, « sens-toi prête », et « ne t’inquiète pas avec le
condom », et « il ne faut pas que tu te sentes gênée d'être nue si tu sais que ton chum
t'aime ». Des choses comme ça. (Sabrina)
Si l’expérience décrite par Noémie, Mégane, Sarah et Sabrina ressemble à celle de la majorité des
participantes, on trouve tout de même des exceptions. C’est le cas de Jessica, qui ne s’est pas inquiétée
quant à sa première expérience, et qui n’a pas ressenti le besoin de consulter Internet :
Ben la première fois, […] je n’avais pas vraiment beaucoup de questions, parce qu’Internet,
je ne m'en suis jamais énormément servi pour régler ce genre de questions là. C'était plus
mes amies, j’en avais parlé avec elles, et elles m'avaient dit [ce que je voulais savoir].
J'avais des questions, c’est sûr, mais […] je n’avais pas vraiment utilisé Internet pour ça,
c'était plus, mettons… Bon, ça avait fait mal et des choses comme ça, je me demandais
[après] combien de fois ça pouvait arrêter de faire mal, et je ne m'étais pas vraiment servie
d’Internet à ce moment-là pour régler mes questions, c’était plus mes amies. Je leur
demandais : « Toi, ça t'a pris combien de temps, est-ce que ça s'est passé comme ça, ou
comme ça, c’était plus... [comme ça]? » (Jessica)
On va voir plus loin quelles sont les limites d’Internet selon divers sujets et comment celles-ci se manifestent.
La contraception
La première fois passée, ou même avant pour certaines, les participantes utilisent Internet pour répondre
à leurs questions sur la contraception. Sabrina, par exemple, qui avait une relation exclusive et à long terme
132
avec son copain, s’est demandé si « c'était encore nécessaire de mettre le condom ». Elle voulait ainsi
connaître « les arguments pour et contre, [et] les conséquences ». Gabrielle, de son côté, cherche un moyen
contraceptif alternatif à la pilule anticonceptionnelle. Comme son médecin l’a informée qu’elle a l’utérus
renversé [basculé vers l’arrière plutôt que couché sur la vessie], elle cherche activement un moyen qui lui
convienne :
Je suis tannée d'avoir à me rappeler tous les soirs de prendre [la pilule], de l'oublier, de
prendre des chances. Alors je suis allée sur Google et j'ai tapé « stérilet ». Je suis tombée
sur le site de Santé AZ, site quand même intéressant mais sans information nouvelle à mes
yeux.
Ayant l'utérus renversé, je crains un peu pour la pose du stérilet en question. Sur tout plein
de forums, les femmes disent que la pose est affreuse, douloureuse, [que le corps] le rejette
dû à la position de leur utérus. Dans ce cas précis, Internet ne m'a pas aidée, mais plutôt
inquiétée. J'avais toutes sortes d'idées véhiculées par ces femmes sur des blogues comme
auféminin.com, etc. Elles mentionnaient que le stérilet Mirena créait des kystes et des
fibromes, que l'utérus renversé était signification de fausses couches, de pertes d'air
vaginales, etc. Rien de très rassurant.
Alors, je suis allée consulter ma pharmacienne et finalement il existe un petit comprimé
qu'on insère une journée avant la pose du stérilet et qui facilite son entrée. L'utérus
renversé n'a pas l'air d'être un facteur influent pour la pose et la garde du stérilet. Les
fausses couches sont très rares mais plus fréquentes chez les femmes avec l'utérus
inversé, et l'apparition de kystes et de fibromes causée par le stérilet ne représente qu'un
infime pourcentage d'effets secondaires.
Comme quoi Internet n'est pas toujours la meilleure source d'information! ;) (Gabrielle)
Si Internet ne s’est pas révélé être le moyen de choix pour obtenir une information adaptée à ses besoins,
Gabrielle y a quand même eu recours; elle s’est servie d’Internet pour s’informer, soupeser différentes options,
et comme elle n’y trouvait pas la solution qui lui convenait parfaitement, elle s’est finalement tournée vers une
professionnelle de la santé pour faire son choix final. Internet, même s’il s’est avéré dans le cas de Gabrielle
insuffisant, a quand même contribué à combler certains de ses besoins en information, notamment en lui
fournissant une « base » d’information sur les options les plus courantes.
Si dans les cas les plus particuliers, Internet fait défaut, il est grandement utile pour les participantes sans
condition particulière. Pour Laurence, il permet de combler les déficits en information reçue par ses parents ou
par l’école :
133
Vers 15-16 ans, mes parents m'en avaient parlé [de la contraception]. J'étais déjà un peu
informée. Tsé, « protège-toi »... Mais je ne savais pas exactement comment ça fonctionnait.
Je connaissais le condom, à l'école, ils nous l'avaient montré, mais la pilule, je n'étais pas
informée. Je suis allée chercher vraiment [là-dessus]. J’ai découvert qu'il y avait plusieurs
méthodes, pas juste le condom. (Laurence)
De façon semblable, Émy montre qu’Internet a constitué le moyen de choix pour obtenir de l’information sur la
contraception, surtout au regard du fait qu’il lui semblait difficile d’en parler à ses parents :
Il y a environ un an, lorsque j'avais 16 ans, mon copain et moi nous sentions prêts à avoir
des relations sexuelles, mais je me posais tout plein de questions sur les contraceptifs.
Comment ça marche? Où est-ce que je peux me les procurer? En parler avec mes parents,
c'était hors de question (nous ne sommes pas très ouverts)! Je me suis donc tournée vers
le moyen le plus facile, Internet! Je dois avouer qu'Internet a répondu à toutes mes
questions. J'ai même pu voir des images détaillées qui m'expliquaient comment mettre un
condom et j'avoue que j'ai été soulagée de savoir comment ça fonctionnait en temps et lieu.
(Émy)
Or l’un des désavantages de certains sites Internet, explique Émy, est qu’ils mettent l’accent sur l’importance
de se protéger, alors que cette notion est déjà acquise par les participantes. Ce qui leur importe, c’est le
« comment » :
Les sites que j'ai visités ont plus mis l’accent sur combien se protéger était important, plutôt
que d'expliquer comment se protéger. J'en conclus donc qu'Internet a pu m'être utile et qu'il
y a de tout en matière de contraception sur Internet, il suffit juste de trouver les bons sites.
(Émy)
Parfois, l’intérêt pour la contraception peut survenir après des cours sur le sujet à l’école :
Oui, on avait eu un truc [à l’école], et ils nous parlaient des moyens de contraception. Ils
parlaient des moyens d'efficacité, un pourcentage d'efficacité, les inconvénients et les
avantages, et là j'étais... [intriguée]. J'avais décidé de retourner voir. (Annabelle)
Mais le plus souvent, cet intérêt se manifeste quand la participante veut être active sexuellement, comme c’est
le cas de Roxanne :
134
Un jour, j'étais tannée d'attendre que la pilule fasse effet et je décidai de m'informer
combien de temps il fallait attendre. Trop timide pour demander, j'ai dû chercher sur
Internet. (Roxanne)
…ou encore lorsque, en situation d’inquiétude, la participante a besoin d’informations factuelles, de façon
ponctuelle, afin de mieux contrôler sa fécondité à l’avenir :
Oui, [j’ai utilisé Internet au sujet de la contraception], et c’était positif. Justement, les
maladies, le condom, les moyens de contraception, la pilule, comment ça marche… Je
l'apprenais, mais on ne sait pas trop au début comment ça marche, quels jours sont
importants, quels jours le sont moins, [c’est] ça que je voulais savoir, ça m'intéressait, et
[ce,] tout de façon positive. […] Je dirais que j'ai cherché quelques fois là-dessus, […],
parce que c'est arrivé [de faire l’amour avec mon copain sans protection], et là, j'étais
inquiète. Je me demandais les conséquences, dans le fond, les journées, quelles journées
pour nous, pour une fille, sont importantes ou pas, la pilule du lendemain, c’est où, est-ce ça
prend un rendez-vous, une prescription… Inquiétude, vite, je voulais savoir et je voulais
régler ça au plus vite. Je voulais la meilleure solution, quoi faire, vu que c'était arrivé.
(Juliette)
Lorsqu’elles sont à la recherche d’informations factuelles pour un cas précis de leur vie sexuelle, la fiabilité de
la source leur est importante :
Justement, récemment, j'ai fait une recherche sur Yasmine, la pilule contraceptive. [Je
l'utilisais et j'avais entendu qu'il pouvait y avoir des effets à long terme graves ou je ne sais
pas trop, alors j’avais essayé d'en trouver là-dessus.] Je me suis mise à chercher sur ses
effets à long terme. Justement, je n’ai rien trouvé de très... [concluant]. J'avais juste vu un
truc sur Facebook, des chiffres, des choses comme ça. Je me suis dit, bon, OK, ce n'est
pas très scientifique, ce n’est pas très... [sûr]. Alors justement, je pense que je suis capable
de ne pas prendre tout ça pour acquis. (Jessica)
Elles se tournent alors vers des sites officiels, comme le site de la pilule anticonceptionnelle Yasmine, ou vers
une infirmière ou un médecin.
PH vaginal, sécrétions et infections urinaires
D’autres thèmes qui suscitent de la curiosité « concernée » chez les participantes concernent leur corps et ses
manifestations, problématiques ou tout à fait normales, notamment les sécrétions vaginales :
Lorsque j’étais plus jeune (environ 8e ou 9e) je me demandais si mes sécrétions (la couleur,
la texture et la senteur) étaient normales. J’étais trop gênée pour demander à ma mère
135
donc j’avais décidé d’aller me renseigner sur Internet. Je me souviens m’être sentie
soulagée de la réponse mais de rien d’autre. (Amélie)
…ou le pH vaginal :
Mon chum faisait comme des mini-boutons rouges. […] On ne savait pas c'était quoi, […] et
ça nous avait stressé un peu à savoir c'était quoi. Finalement, on est allés voir le médecin,
et le médecin nous a dit dans le fond qu’il n’avait rien... […] Mon médecin a juste découvert
que j’avais le pH [vaginal] plus élevé que la normale, alors dans le fond, c'est ça qui créait
[les boutons rouges]. Je suis sûrement allée chercher sur Internet […] sur les blogues pour
savoir si quelqu’un en avait déjà parlé, qui avait déjà vécu la même chose, et après que je
sois revenue de chez le médecin, [pour] voir si c'était vrai ce qu'elle avait dit, [et] pour me
rassurer par rapport à ce qu'elle avait dit. (Gabrielle)
Gabrielle a également fait des infections urinaires à répétition, un problème qu’elle a voulu régler au plus vite,
en raison des douleurs qu’il occasionnait :
Intervieweuse : Quels sont les sujets les plus inquiétants que tu as rencontrés?
Gabrielle : C'est sûr que là, les premières infections urinaires, c'était comme, au secours!
Elle a alors cherché des conseils sur le Web (boire du jus de canneberges, prendre un bain avec du soda
dans l’eau, etc.) et a tenté de les appliquer dans le but de régler les infections et de les prévenir :
…des conseils comme ça que j'avais trouvés sur Internet et que j'ai fait comme, check, il
faut vraiment que je règle ça, parce que […] là j'ai souffert pendant une semaine. […] Ça
brûle... (Gabrielle)
Discussion
De tels thèmes suscitent des craintes, mais des craintes de relativement courte durée, ou des craintes qui ne
suscitent nullement le même niveau d’insécurité, d’isolement ou de « mise au silence » que nous observerons
dans la catégorie des « craintes centrales » ou des « craintes vives ». En cherchant ces thèmes, les
participantes sont inquiètes, il va de soi, mais cette inquiétude de niveau relativement « moyen » témoigne en
quelque sorte du fait qu’elles sont conscientes que leurs inquiétudes sont communes à plusieurs :
contraception, infections urinaires, premières expériences sexuelles, etc. Ces thèmes, en d’autres mots,
n’entraînent pas le poids des tabous sexuels comme les prochaines catégories que nous allons voir.
136
Cependant, en observant comment se présentent les recherches sur les thèmes que nous avons classés
« à curiosité concernée », on constate que les participantes, d’une part, s’intéressent à leur sexualité, aux
transformations biologiques de leur corps et aux moyens qu’elles ont à leur disposition pour contrôler leur
fécondité. Elles utilisent Internet évidemment comme moyen d’information pour mieux comprendre leur
sexualité, mais aussi pour « prendre en charge » cette sexualité : avec l’aide d’Internet, elles s’informent sur
les choix dont elles disposent pour prévenir une grossesse, vérifient la crédibilité des sources, utilisent
d’autres sources d’information au besoin, choisissent le moyen de contraception approprié pour elles, et
s’informent des moyens pour régler des infections. Mais leur utilisation d’Internet ne se limite pas au fait de
rassembler de l’information sur des sujets envers lesquels elles se sentent concernées. Elles se sentent aussi
préoccupées par les pratiques « des autres » et se demandent « si elles sont normales ». Nous discutons de
ces cas particuliers dans la section qui suit.
5.1.3 Thèmes relatifs à la norme
Internet comble un besoin particulièrement frappant chez quelques-unes de nos participantes : se comparer
à la norme, ou du moins s’informer de ce que constitue cette « norme » ou encore vérifier si elle existe. Leur
préoccupation envers la norme s’exprime dans des thèmes liés aux pratiques, mais aussi (et particulièrement)
au corps. L’apparence de leur corps génère en effet souvent des craintes, ou du moins un certain inconfort.
Elles cherchent alors activement à voir le corps des autres, pour se comparer, s’informer, et si possible, se
rassurer.
Apparence du corps et conformité
Amélie, 19 ans, est l’une des participantes qui s’inquiètent le plus de son apparence, notamment en ce qui
concerne la grosseur de ses seins. Elle utilise alors Internet pour voir le corps d’autres femmes (mannequins
ou autres) et pour trouver l’opinion des hommes sur les petits seins :
Au cours de cette année, je suis allée lire un site de discussion qui traitait de ce que
pensent les hommes des petits seins. Je me demandais s’il était rare ou fréquent que les
hommes les aiment, si parfois ils les préféraient ou si cela n’avait pas d’importance pour
eux. J’ai été surprise de voir que plusieurs d’entre eux ne se souciaient pas de quelle
grosseur ils pouvaient être et que les petits seins pouvaient être aussi excitants que les
gros. Certains ont aussi affirmé qu’ils préféraient les petits. C’est intéressant de pouvoir lire
à ce sujet sur Internet, car les hommes n’osent pas en parler régulièrement et je ne pouvais
jamais savoir ce qu’ils en pensaient réellement. Comme j’ai des petits seins, ce site m’a
rassurée et m’a donné une certaine confiance en moi que je n’avais pas du tout avant.
Avant de lire ces commentaires, j’avais en tête que c’était un gros défaut et que très peu
d’hommes aimaient les petits seins. Je suis contente qu’il existe ce genre de sites, car la
confidentialité permet aux gens de dire ce qu’ils pensent réellement sans en être gênés.
(Amélie)
137
Rassurée par ce site, mais réellement insécurisée par la grosseur de ses seins auparavant, Amélie
a considéré la chirurgie pour l’augmentation mammaire (la seule parmi nos participantes) :
Amélie : Il y a aussi toutes les affaires d'augmentation mammaire. Ça, je suis souvent allée
regarder ça, pour voir de quoi ça avait l'air, mais j'ai fini avec l'idée que je ne m'en ferais pas
faire. Je m'étais déjà questionnée là-dessus, si c'était une possibilité plus tard de me [les]
faire augmenter, et c'était mon but [quand je suis allée] regarder là-dessus, mais finalement,
non. La peur, c'était plus au niveau, j'avais peur de voir que j'étais une des seules comme
ça. Tsé, quand tu vas voir des photos de ça, t'as peur de ne rien trouver comme toi, d'être
toute seule.
Intervieweuse : Qu'est-ce que tu penses que ton chum, lui, pense, des petits seins?
Amélie : Mon ex, lui, toutes les fois qu'on le faisait, il enlevait ma brassière, il les prenait tout
le temps et il me disait tout le temps qu'il les aimait, il leur donnait des becs, il aimait ça et il
me disait tout le temps que c'était beau des petits seins, et moi j'aimais ça, je me sentais
à l'aise. Mais lui tout de suite (mon chum actuel), il ne m'enlève jamais ma brassière, il les
touche des fois, mais pas souvent, alors, ça, je ne me sens pas bien de ça. En même
temps, il me le dit, tsé, des fois ça m'arrivait de dire que j'avais trop des petits seins en
lâchant des commentaires en voyant une autre fille et il me dit tout le temps : « Ben non,
voyons, ils sont ben corrects de même », il me le dit souvent, mais les gestes ne sont pas là
par exemple.
Intervieweuse : Lui as-tu déjà dit que ça t'inquiétait ou que ça te faisait quelque chose?
Amélie : Non, je ne lui ai jamais dit encore.
On va voir plus loin qu’Amélie entretient un rapport ambivalent avec son corps, avec son copain et avec le fait
qu’Internet aide ou nuise à l’acceptation de son corps. D’ailleurs, selon elle, Internet présente de bons et de
mauvais côtés à ce sujet :
Tsé, ça va des deux côtés. Des fois, [puisque] j'ai des petits seins, tsé je n’en ai pas vu
souvent, mais des fois j'allais voir, par exemple des top modèles, et je voyais qu'elles
étaient pareilles à moi, donc ça me réconfortait. (Amélie)
En même temps, dit-elle :
[Si Internet n’avait pas existé], j'aurais moins vu de corps de femmes et d'hommes nus,
alors j'aurais moins [en tête] un certain idéal de la femme, parce que c'est rare qu'on voit
des femmes nues à la télévision, c'est plus sur Internet. Probablement que je serais plus
138
confiante par rapport à mon corps […]. À force [de voir des filles « bien faites » sur Internet]
voir, à un moment donné, tu te mets dans la catégorie des anormales, alors ça m'a fait ça
assez souvent de me sentir... [pas belle], et quand tu en vois plein, plein, plein, un moment
donné, tu te dis que toi tu n'es pas faite [comme elles]. (Amélie)
On va voir plus en détail à la section 5.3.1 (p. 269) les avantages et les désavantages que présentent Internet
sur différents sujets pour les participantes, et en particulier l’ambivalence d’Amélie par rapport aux avantages
et aux désavantages d’Internet envers la confiance en soi.
On retiendra pour l’instant ici qu’Internet joue un rôle dans la perception de leur corps, en ce qu’il leur permet
« d’observer » la « conformité » ou la norme, de la cerner, et de s’y comparer.
Internet, en ce sens, ne s’impose pas comme un « nouveau moyen » d’observation de la norme, mais s’insère
dans les pratiques préexistantes de lecture de revues (pornographiques ou autres), d’émissions télévisuelles
ou de réception de publicité, pour n’en nommer que quelques-unes. Océanne, par exemple, a été étonnée,
puis très déçue de l’apparence des femmes dans les magazines pornographiques sur lesquels elle est tombée
plus jeune :
J'avais regardé les magazines [porno] de mon frère, je suis tombée là-dessus. J'étais plus
jeune, [et je me suis dit :] « Je vais checker ça, de quoi ça a l’air! » Et là j’ai vu une femme
qui était toute nue, et j'ai vu son vagin et là j’étais comme : « Le mien ne ressemble pas
à ça. » Ça m’avait vraiment... ça me stressait, ça. Pendant longtemps, j'ai eu peur d'avoir
une relation, parce que j'avais peur que le gars ne veuille pas de moi à cause de ça, ou qu'il
ne me trouve pas belle à cause de ça. […] Je suis allée lire sur Internet là-dessus. J'étais
vraiment démoralisée. (Océanne)
Toutefois, grâce à Internet, Océanne a été rassurée, notamment après avoir envoyé une question sur le sujet
au site Web Tel-Jeunes et avoir consulté des forums sur la question :
J’ai pu comprendre que beaucoup de femmes étaient comme ça et que je n’avais pas
d’anomalie. J’ai pu lire aussi que beaucoup d’hommes aimaient mieux ce type de vagin
pour les rapports buccaux. Il y avait aussi des femmes qui disaient de ne pas se stresser
à ce sujet et que leurs partenaires sexuels ne s’étaient jamais plaints de cela ni fait de
remarques blessantes. C’était comme si rien n’était. Cela m’a beaucoup rassurée.
(Océanne)
Cette recherche de la normalité de l’apparence et du corps semble très prégnante chez nos participantes,
surtout lorsqu’elles sont plus jeunes. Audrey s’est inquiétée, tout comme Océanne, de l’apparence de ses
139
parties génitales, et Maëlie s’est posé plusieurs questions, liées notamment à l’épilation. Elle fait la liste ici de
quelques-unes des questions qu’elle s’est posées :
- Est-ce qu'il faut que je me rase partout?
- J'ai un sein plus gros que l'autre... Est-ce que c'est normal?
- J'ai des poils... Au secours!!!!!!! (Maëlie)
Camille consacre aussi un post à la question de l’épilation, et, consciente du fait de l’évolution des normes, se
questionne sur l’origine de cette pression sociale de supprimer les poils :
TRIMÉ OU PAS TRIMÉ? – LE POIL.
Le poil. Sujet un peu tabou dans notre société. Comme les animaux, on en a tous, mais on
ne sait pas trop quoi en faire. La perception de la pilosité a évolué au cours de l'histoire.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est acceptable ou non? Qu'est-ce qui est à la mode?
Ma dernière recherche sur Internet sur la sexualité était justement là-dessus. J'étais
curieuse de savoir ce qui se passait à ce niveau. En fait, la grosse mode, c'est l'épilation
intégrale. Il y a le « ticket de métro » aussi qui est assez répandu.
Je me demandais si cette mode-là ne viendrait pas du monde de la pornographie? Parce
qu'il y a quelques décennies, le poil n'était pas vraiment un problème. Aujourd'hui c'est
maintenant complexant. À la piscine, pas question qu'un poil dépasse du bikini, non non
non.
Tout ça pour dire que ça met une certaine pression sur les femmes. C'est juste un exemple
parmi tant d'autres de tout ce qu'on doit faire pour être socialement acceptables
physiquement (entraînement, bronzage, coiffure, etc.). Si je me fie à Internet, je devrais
toujours être à mon top côté « trimage ». Mais honnêtement, à part les top modèles de
Victoria's Secret, quelle fille ayant un emploi, allant aux études à temps plein, ayant un
chum et une vie sociale, est toujours parfaitement « trimée », bronzée à la perfection et les
cheveux toujours parfaits? Ça existe sûrement, mais j'aimerais bien la rencontrer pour lui
demander ses trucs... (Camille)
Orgasme
Au-delà de l’apparence du corps, les participantes s’inquiètent au sujet de l’orgasme. « Qu’est-ce qu’un
orgasme, pour une fille? », « En ai-je déjà eu un ? », et « Est-ce normal de n’en avoir jamais eu? » constituent
certaines des questions sur le sujet. Maude, par exemple, s’inquiète du fait de n’être pas certaine d’en avoir
déjà eu un :
Intervieweuse : Comment te sentais-tu avant de savoir, avant de même chercher pour la
première fois sur Internet, par rapport au fait de ne pas être certaine d'en avoir déjà eu un?
140
Maude : C'est de l'inquiétude. [Je me demandais :] « Est-ce que je suis normale? » C'est
plus, oui, la crainte de ne pas être normale, la normalité… de ne pas être dans le moule, si
on peut dire.
Intervieweuse : Est-ce que c'est quelque chose dont tu aurais voulu parler avec ton chum?
Maude : Ah ça, il y a quand même longtemps de ça. Quand j'avais 16 ans environ, ce n'était
pas avec le chum avec qui je suis présentement. Je trouve qu'à 16 ans, il y a certains,
à certains stades de la vie d'une femme, il y a des sujets que je peux aborder. Avant ça, tu
te dis, oui, tu fais l'amour, mais jusqu'à un tel point. Avant, pour être franche, je ne savais
pas si c'était vraiment important d'avoir un orgasme. C'était bon, ben, let's go, on le fait, et
c'est ça. Et après tu comprends, tu te dis, ben coudonc, est-ce que ça m'est vraiment
arrivé? Et tu veux te renseigner par rapport à ça.
Cette inquiétude dont témoigne Maude, même si elle l’a accompagnée longtemps, n’a toutefois pas atteint sa
confiance ou son assurance :
Intervieweuse : Quand tu me disais que tu n'étais pas certaine d'avoir eu un orgasme, te
sentais-tu moins femme? Avais-tu honte?
Maude : Non, pas vraiment, mais je voulais savoir : « Est-ce que je suis normale? Est-ce
que je suis dans la norme? » Je n'étais pas là à me détester, c'était vraiment par curiosité
que je voulais vérifier.
Laurie, toutefois, montre que cette inquiétude peut être plus prégnante, voire angoissante :
Intervieweuse : Dans la colonne « sentiments reliés à la recherche » tu disais « angoisse »
pour « orgasme », pourquoi?
Laurie : Parce qu'on dirait que ça a été long pour moi d’avoir un orgasme, et je ne savais
pas c'était quoi, et en même temps, je sais qu'avec mon premier copain, ce n'est pas arrivé,
et mon 2e copain, il me demandait tout le temps : « Et puis, et puis, et puis? » J'étais là :
« Non, non, non... » On dirait que ça me mettait....
Intervieweuse : …de la pression?
Laurie : Oui, c'est ça. Oui. Et on dirait que je ne savais pas c'était quoi, alors j’allais voir
c'était quoi un orgasme, comment on savait que c'était ça.
Intervieweuse : Quand tu cherchais là-dessus, comment tu te sentais?
Laurie : […] C’est sûr que c'était un peu stressant, je ne savais pas à quoi m'attendre…
Ben, je savais un peu à quoi m'attendre, mais je veux dire... ce n'était pas concret, encore.
Intervieweuse : Avais-tu l'impression d’être incapable d’en avoir un?
Laurie : Oui, peut-être un peu. On dirait que ça n’allait jamais m'arriver, quand je lisais ça.
141
Malgré le découragement que semble avoir causé Internet pour Laurie, elle mentionne apprécier les articles
sur le Web qui parlent de l’atteinte de l’orgasme vaginal :
Au début de mes relations sexuelles, je n’étais pas certaine de savoir si j’avais déjà eu un
orgasme vaginal et même en y réfléchissant, je ne crois pas avoir déjà vécu cela. Si je
compare à la stimulation du clitoris, je ne peux pas dire avoir déjà atteint l’orgasme vaginal.
Dans l’article, l’auteur précise ceci : « Le but semble souvent d'avoir des orgasmes plus
forts, dit-elle. Or, rien ne prouve qu'un orgasme vaginal soit plus puissant qu'un orgasme
clitoridien. La satisfaction est une question très personnelle, et chaque femme est différente.
Vous seule pouvez déterminer ce qui vous stimule sexuellement. » Elle nous donne aussi
des conseils pour découvrir ce qui nous procure du plaisir. C’est ce que j’aime à propos de
ce genre d’articles. Ils sont simples, courts et intéressants. (Laurie)
Les articles sur le Web sur l’orgasme ont souvent tendance à vouloir « classer » les jeunes lectrices en deux
catégories : vaginale, ou clitoridienne. Si, à l’origine, le fait de découvrir dans quelle « catégorie » se trouve les
participantes peut sembler un jeu, la question reste souvent en suspens, et peut finir par créer une certaine
inquiétude chez les participantes, un certain doute par rapport à soi-même :
Intervieweuse : Ici, tu parles de l'orgasme féminin, et ici, des jeunes filles dans un souper de
fille qui se demandaient si elles étaient vaginales ou clitoridiennes.
Roxanne : Ben ça, c’est une question qui revient souvent. Chaque fois qu'on parle de sexe,
ça revient là-dessus : toi, as-tu réussi? C’est une question qui vient beaucoup, ça vient que
tu te poses la question quand tu es toute seule. […] La première fois, tu t'imagines toutes
sortes d'affaires, tu te mets à te demander, suis-je normale? Quand je suis toute seule, je
n'ai pas plus de fun, mais j'ai un plus gros orgasme que si j'étais... [avec un partenaire]. J'ai
une de mes amies, la première fois qu'elle l'a fait, de ce qu'elle a dit, c'était des feux
d'artifice. […]
Intervieweuse : Sur Internet, qu’est-ce que tu voulais savoir par rapport à ça?
Roxanne : Il y en a qui disaient, soit que tu es clitoridienne ou soit t’es vaginale, ou non, t’es
les deux, alors c'était plus de savoir comment, ce qui était vrai. C’est par curiosité et en
même temps pour valider, parce que là il n’y avait personne qui avait la vérité.
Les « normes » concernant les pratiques
Au-delà des questions d’apparence et d’orgasme, plusieurs participantes se sont interrogées sur les pratiques
des autres, ou sur la durée, par exemple, d’une relation sexuelle « normale » ou « idéale ». Bien qu’elles
sachent que les pratiques, dans leur durée, leur forme ou leur fréquence, sont différentes pour tous, elles ont
tout de même cherché des informations en ce sens, qui pourraient leur donner une meilleure idée de ce qui se
passe en général chez les « autres ». Souvent, à défaut d’en trouver, elles se trouvent « déçues ». C’est le
cas de Maude et de Juliette :
142
[Je voulais de l’information sur] les pratiques sexuelles, plus genre vie sexuelle, les
fréquences que les personnes ont. Quand j'étais un petit peu plus jeune, je voulais savoir la
norme. Il y en a pour qui ça pourrait être 20 fois par jour, c'est tant mieux pour eux, mais ça
peut varier. […] Je voulais vraiment des informations, genre, « les 18-25 ans préfèrent telle
position », ou « les femmes de 18 à 25 ans sont peu confiantes à tant de pourcentage »…
J'aurais aimé ça des statistiques, des faits [mais je n’en ai pas trouvé]. (Maude)
-
Juliette : Pour un travail de recherche au Cégep, j'ai dû chercher des informations
concernant la sexualité des 18-25 ans.
Il fut décevant de ne trouver que très peu d'information.
On me suggérait des sites sur le cancer du col de l'utérus ou des forums mais pas
d'informations concrètes.
Il est surprenant de constater qu'Internet ne contient pas ce genre d'informations. J'aurais
aimé connaître amplement les craintes, les désirs, les expériences, les pratiques et les
habitudes de séduction de cette catégorie de jeunes (20 à 25 ans). (Juliette)
De façon semblable, Florence a voulu chercher, plus jeune, des informations générales sur la « durée
normale » des relations sexuelles, mais avait peur que ses parents s’en rendent compte :
Quand j'étais jeune, je me posais des questions sur le sexe. Mes parents m'avaient dit ce
que c’était et tout, mais je me demandais souvent comment ça commençait... si c'était
planifié, genre.... mais surtout combien de temps ça durait. Si ça durait toute la nuit ou juste
quelques minutes... J'avais pensé à aller voir sur Internet, mais j'ai toujours eu peur que
mes parents voient que je sois allée sur des sites de sexe et ils auraient sûrement pensé
que je pensais le faire bientôt […], mais c'était juste pour savoir. […] Mais dans le fond... il
n'y a pas de temps exact, donc je ne pense pas que je l'aurais trouvé même si j'avais
cherché. (Florence)
Si Maude n’est plus inquiète par rapport à la norme (elle se sentait « inférieure » par rapport à la norme étant
plus jeune), elle estime qu’elle n’a néanmoins pas éprouvé de pression pour « accoter » cette norme. Elle
s’inquiète beaucoup plus de la norme des plus jeunes qu’elle, qu’elle juge trop élevée :
Intervieweuse : Comment te sentais-tu par rapport à la norme?
Maude : À la norme, je me trouve normale, mais avant ça, je me trouvais inférieure. Parce
que ça dépend, il y a des jeunes pour qui ce n’est pas normal ce qu'ils font, mais tsé, je
trouvais ça correct. Pour mon âge, je trouvais ça correct.
Intervieweuse : Est-ce que ça te dérangeait?
Maude : Non. Je n'ai pas vraiment eu de pressions par rapport à ça.
143
Intervieweuse : Et maintenant, que penses-tu de la norme?
Maude : Moi, je trouve que la norme est encore plus élevée que quand j'étais plus jeune!
Parce que j'entends plein, mettons, de filles de 13, 14 ans, que tsé, ça fait leur 6e, 7e
partenaire sexuel qu'ils ont. Tsé, c'est ordinaire. T'es comme « Mon Dieu, t'as 14 ans ! » Je
trouve qu'elle a vraiment changé. Moi, je me trouve normale, mais tsé pour les plus jeunes,
calmez-vous la cadence un peu.
Intervieweuse : Donc tu ne t'en fais pas avec la norme pour toi-même.
Maude : Non, pas pour moi.
En ce qui concerne les pratiques des autres, Maëlie est surtout intriguée par les pratiques des personnes
âgées :
À plusieurs reprises, surtout lorsque j'étais plus jeune, mais encore aujourd'hui... je me
demande comment est la sexualité des personnes plus âgées. J'entends par là, mes
parents, mes grand-parents. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais un sujet qui
m'intrigue. Comment vais-je être plus tard, à cet âge? J'ai jeté un coup d'oeil sur le web
dans les forums de discussion et je ne sais pas si c'est parce que je ne regarde pas aux
bons endroits, mais les gens ne parlent pas vraiment de ces choses-là (activités sexuelles,
intimité, etc.). […] C'est probablement un sujet qui serait intéressant pour ces gens de parler
ouvertement tout en restant anonymes. Quelquefois, lorsqu'on voit qu'il y a des gens
comme nous, ça nous rassure et nous aide à nous comprendre nous-même. (Maëlie)
Maëlie et Juliette se sont demandé, plus jeunes, si elles étaient « normales » en comparaison avec les
pratiques des autres :
Je pense que c’était […] en secondaire 1 ou 2. Il y avait beaucoup des filles de mon âge qui
avaient des chums, tsé, on le voyait qu'elles étaient… que c’était vraiment important pour
elles et que ça prenait beaucoup de place. […] Moi [je me suis demandé :] si c’est normal
que ce ne soit pas une priorité pour moi et que je ne pense pas encore à ça. Tsé, j’étais à
l'école, et je faisais du sport, et c'était vraiment autre chose. Alors je me demandais, est-ce
que c’est vraiment normal que je sois comme ça, et à quel âge que l’on commence
à vouloir, admettons, avoir un chum ou peu importe? (Maëlie)
Lorsque Maëlie a commencé à ressentir du désir sexuel pour quelqu’un, elle s’est à nouveau interrogée sur le
commencement du désir, son expression :
Je ne savais pas trop, tsé, tu te demandes, quand tu n'es pas... c'est la première fois que ça
t'arrive, tu te demandes, pourquoi je veux tout le temps être avec ce gars-là, pourquoi je
veux faire des activités avec, pourquoi j'ai le goût, mettons, de me coller. (Maëlie)
144
Pour « jauger » en quelque sorte son attrait sexuel, mais aussi pour en apprendre sur le désir des autres, elle
s’était inscrite à un site qui compare les looks des internautes :
Mettons sur DoYouLookGood, des fois il y a [des gens qui écrivent] « recherche fille qui
veut en apprendre sur la sexualité » ou « qui veut faire des essais » ou peu importe, « qui
veut tester ses limites », ou... Tsé des trucs comme ça, tu es comme : « OK, c’est bizarre. »
Ça va jusque-là, du monde qui écrit des trucs comme ça sur un site de rencontre, mettons.
[...] Je me suis déjà inscrite sur DoYouLookGood et je ne sais pas pourquoi... Pour le fun.
Pour voir ce qui se passait... (Maëlie)
Gabrielle a aussi utilisé des sites (cette fois, des sites de rencontre) pour se comparer aux autres. Elle
explique dans son blogue son expérience :
Alors, dès l'âge de 16 ans, quand je suis entrée au Cégep, je me suis inscrite sur
TagQuébec.com pour aller chercher de simples photos. Mais que c'est intéressant… c'est
un site de rencontre où l'on peut voter pour les autres membres! Alors j'ai commencé
à passer vraiment beaucoup de temps à consulter des profils de garçons à la recherche du
prince charmant, et oh oui, j'étais convaincue que c'était là que j'allais le trouver!
Après quelques mois et semaines, j'ai réalisé que j'allais plus souvent voir les profils de
belles filles que d'hommes en général. Pourquoi cela? Je suppose que pour ma croissance
personnelle et que pour ma curiosité de comparaison j'allais voir des profils de filles très
sexy.
Quelque part dans notre for intérieur, on est tous et toutes attirés vers la comparaison avec
les êtres du même sexe. Suis-je plus belle qu'elle? Comment fait-elle pour avoir d'aussi
beaux abdos?! Pourquoi a-t-elle un chum et pas moi!? Si j'étais comme elle… je réussirais
sûrement! […] Mais j'ai réalisé à mon grand désespoir (moi qui pensais avoir trouvé la
recette miracle!) que ça n'attire que le reflet masculin de ce qu'on projette: des players, des
gentils garçons qui ne veulent que des histoires d'un soir ou encore une simple branlette sur
webcam.
C'est avec le recul qu'on constate à quel point on est influençable à cet âge par ces médias
qui nous font croire ou qui nous créent une vie parfaite, si irréelle soit-elle, mais si
accessible.
Mon copain est l'homme parfait pour moi, et je l'ai trouvé dans le monde bien réel de la
vraie vie fort heureusement! (Gabrielle)
145
Virginité
Lorsque Maëlie, Juliette, Maude ou Gabrielle cherchent de l’information sur les « normes » ou les pratiques
sexuelles, elles le font par curiosité, pour vérifier leur « positionnement » par rapport à la norme, mais elles
semblent le faire avec une certaine distance, de façon un peu détachée. Si elles peuvent ressentir une
certaine pression en raison de ces normes, lorsqu’il est question de virginité, cette pression semble un peu
plus palpable. Sarah, qui dit avoir beaucoup cherché sur Internet sur le thème « vierge à 18 ans », écrit :
[J]'ai beaucoup d'amies qui ne sont plus vierges et qui ont le même amoureux depuis
plusieurs mois et même années, mais la question que je ne cesse de faire tourner dans ma
tête c'est : suis-je normale, vu que je suis encore vierge?
J'ai donc été faire un tour sur Internet concernant les jeunes filles de 17 ans encore vierges.
J'ai trouvé plusieurs réponses à mes questions, [qui disaient] que c'est tout à fait normal
d'être vierge à mon âge et que je devrais être fière de moi et que je ne devrais pas sauter
sur le premier venu juste pour être comme les autres.
Mais c'est difficile à vivre ça quand mes amies n'arrêtent pas de parler de leurs histoires
avec leurs amoureux, tandis que moi, je suis là, sans rien dire parce que je n'ai pas rien
à raconter.
Alors, j'ai parlé à mes amies et elles m'ont vraiment aidée. Elles m'ont surtout dit d'attendre
et de ne pas me presser pour faire comme les autres. :)
(Sarah)
En entrevue, elle explique qu’Internet lui a permis de se rassurer sur cette question :
Parce que [avec Internet] je vois que je ne suis pas toute seule là-dedans, [parce] que des
fois, je me pose la question : est-ce que je suis toute seule là-dedans? Quand je vois qu'il
y a des filles qui sont [vierges à 18 ans], ça me décourage moins. (Sarah)
Mais les participantes ne s’inquiètent pas seulement du fait qu’elles-mêmes puissent être « anormales »; elles
s’inquiètent aussi de la « normalité » de leur copain. Amélie, par exemple, s’est inquiétée du temps que
pouvait prendre son deuxième copain avant d’éjaculer. En comparaison avec le premier, son deuxième copain
lui a semblé pour un certain temps anormal, et elle s’est inquiétée :
Mon ex venait quand même assez vite. Je ne sais pas s'il venait plus vite que la normale ou
non, mais quand je suis arrivée avec l'autre, je ne sais pas s'il était gêné, ça avait tellement
pris du temps, les deux premières fois, que je pensais qu'il avait un problème. Finalement,
je pense même que c'est ça la normale, et j'aime ça que ça prenne du temps. Mais au
146
début, je voulais régler le problème, mais finalement c'est moi, je pense, qui voyais mal ça.
(Amélie)
Le temps avant l’éjaculation a également inquiété Roxanne :
La première fois avec mon (ex-) chum fut vraiment décevante pour lui. Nous avons fait
l'amour sans arrêt durant 45 minutes et il n'a jamais réussi à « venir ». J'ai eu beau essayer
toutes sortes de choses, ça ne s'est jamais produit.
Il était vraiment désespéré et son orgueil en avait pris un gros coup. Il pensait qu'il n'était
pas normal, et bien sûr il ne voulait pas qu'on en parle. […]
Nous avons finalement lu sur un site que tout cela était probablement dû à un stress et que
tout se replacerait (en cas contraire nous devions consulter). En fin de compte, après
quelques fois, les choses se sont mises en place et nous avons pu découvrir pleinement et
sainement notre sexualité. (Roxanne)
Océanne, elle, s’inquiétait des difficultés d’érection de son copain. Elle a voulu avoir recours à Internet pour
« connaître les causes de ce problème et comment remédier à la situation », mais elle a été « très déçue »
des informations trouvées par Google sur un site de clavardage, informations qui, selon elle, étaient de
« piètre qualité » :
On lui conseillait de ne pas se stresser ou encore de regarder une vidéo porno avec sa
blonde pour s’exciter. Ce n’est pas très rassurant ni excitant pour la femme quand son
chum a des problèmes d’érection et qu’il doive s’exciter sur les autres putes de porn stars
pour [faire l’amour avec] sa femme, tsé veux dire!!! (Océanne)
Contrairement à Roxanne, qui voulait aider son copain pour les bienfaits du couple et pour le rassurer,
Océanne a pris ces difficultés de façon personnelle :
C’est parce qu'il n’avait pas ça avant, je l'ai pris mal. C'est quoi… il ne me trouve pas à son
goût? Des affaires de même. […] Ça me tannait. Ça venait que je ne voulais quasiment plus
avoir de relations. Ça devenait choquant.
Elle aurait aimé pouvoir trouver de l’information qui concerne les jeunes ou les jeunes adultes, bref de
l’information pertinente à son cas :
147
J’étais allée lire sur Internet, mais je n’avais rien trouvé, c’était plus des affaires […]
d’andropause, ça parlait plus de ça. Ça ne parlait pas des jeunes, à part du fait que ça
pouvait être relié à un stress. […] [Sur un forum, un garçon recommandait] des affaires
comme checker des vues de porn ensemble. […] Là j'étais comme : c’est encore plus
insultant!
Son cas, pourtant, ne semble pas unique. Maëlie a vécu une situation très semblable. Elle se demandait s’il
était normal que son partenaire éjacule rapidement, et n’osait pas en parler à ses amis par crainte qu’ils la
jugent ou qu’ils jugent son copain. Elle a donc eu recours à Internet :
Je ne voulais pas qu'ils se disent : ton chum est comme ça... Et finalement, j'ai vu que ce
n'était pas [une dysfonction érectile], que ça pouvait arriver, au début des relations, quand
tu es stressé, quand tu es fatigué, que ça pouvait arriver à un garçon que ce ne soit pas
long. J'avais cherché sur Internet. C'était écrit […] que ça peut ne pas nécessairement
s'appeler dysfonction érectile, mais que ça peut être juste que le garçon est fatigué, qu’il est
stressé, […] ces affaires-là. (Maëlie)
Discussion
On se rend compte ici que le rapport à la norme occupe une place très importante dans les préoccupations
des participantes en ce qui concerne la sexualité. Elles cherchent activement à se comparer et à s’assurer de
leur « conformité » à la norme : Amélie craint d’être la seule à avoir de petits seins, Océanne est
« démoralisée » quand elle réalise que ses parties génitales ne ressemblent pas à celles qu’elle a pu voir dans
les magazines pornos et sur le Net, Maude, Florence et Juliette cherchent la fréquence et la durée
« normales » des relations sexuelles, et Sarah s’inquiète du fait qu’elle soit encore vierge à 18 ans.
Cet intérêt marqué envers la normalité que l’on remarque chez les participantes est congruent avec ce que
l’on trouve dans la littérature, même si celle-ci est peu abondante sur le sujet. Dans une étude parue en 2007,
une équipe de chercheurs s’est intéressée aux questions envoyées par les usagers à un site sur la santé
s’adressant aux adolescents. Ce site, Teenage Health Freak (teenagehealthfreak.org), qui ne semble plus en
service, permettait à des adolescents et des adolescentes d’envoyer des questions par courriel à des
médecins qui y répondaient en publiant les questions et leurs réponses (Harvey et al. : 2007). Les chercheurs
ont entrepris une analyse linguistique des questions envoyées (avant qu’elles ne soient modifiées par le site)
et ont remarqué l’immense prévalence des termes « normal » et « worried ». En raison de la polysémie du
terme « normal », les chercheurs ont examiné les phrases où les termes « normal » ou « inquiet »
apparaissaient. Ils ont découvert que l’anxiété reliée à la normalité s’exprimait surtout dans un contexte où
l’adolescent craignait qu’il puisse y avoir quelque chose d’ « anormal » chez lui, et non pas nécessairement
148
dans un contexte où celui-ci se montrait curieux de prévalences ou de statistiques sur les pratiques. Or, dans
notre étude, on remarque les deux : Maude, Juliette, Florence et Amélie ont toutes, par exemple, cherché
activement des statistiques sur la « norme » entourant les pratiques (particulièrement selon l’âge), et ont été
déçues de ne pas en trouver.
Suzuki et Calzo (2004), sans discuter directement de norme ou d’inquiétudes, ont aussi remarqué qu’une part
considérable des questions affichées sur les forums analysés portait sur les thèmes de l’image corporelle et
de l’épilation, deux thèmes qui entretiennent des liens très forts avec la norme.
Ce qu’elles cherchent est une chose; ce qu’elles trouvent lors de leurs recherches en est une autre. Dans le
cas de nos participantes, on remarque rapidement qu’Internet, comme le dit si bien Camille dans son blogue
(dont l’extrait sera présenté un peu plus loin), « a le pouvoir de nous rendre normal ou anormal ».
Effectivement, la résolution de leurs inquiétudes ou angoisses semble dépendre de ce qu’elles arrivent
à trouver sur le Web : Amélie, par exemple, dira qu’à force de voir des filles aux seins plus gros que les siens
sur Internet, elle finissait par se dire qu’elle n’était pas faite « comme elles », et donc que forcément, avec le
temps, elle s’imaginait « dans la catégorie des anormales ». À l’inverse, le fait de voir que d’autres filles
avaient des corps semblables au sien était rassurant pour elle; de façon similaire, le site de Tel-Jeunes a été
très rassurant pour Océanne. Nous allons voir plus loin comment ce rapport ambivalent avec ce qu’on trouve
sur Internet s’exprime chez les participantes (particulièrement à la section 5.3.1).
Mais d’abord, nous discutons d’autres thèmes au sujet desquels les participantes disent se sentir
« anormales ». Même si, dans les cas que nous venons de voir, la crainte d’être anormale ou de vivre une
situation anormale est manifeste, d’autres thèmes abordés par les participantes témoignent d’une angoisse
encore plus grande et d’un rapport encore plus complexe avec les normes, les attentes sociales et les
représentations médiatiques de la sexualité. C’est ce que nous allons voir dans les prochaines sections.
5.1.4 Thèmes relatifs aux craintes « centrales »
Nous avons rassemblé dans la catégorie des thèmes relatifs aux craintes « centrales » rassemblent les
craintes les plus importantes exprimées par les participantes. Ces thèmes créent de l’inquiétude qui est
toujours manifeste ou encore qui se rapporte à un passé proche, ce qui fait alors dire aux participantes que
leur « problème » est « réglé ». D’une certaine manière, ces thèmes sont semblables aux thèmes classés
« relatifs à la norme », car ultimement ces craintes créent chez elles le sentiment d’être anormales.
Cependant, ce sont des craintes plus prégnantes encore : les participantes estiment avoir un « problème »
qu’il faut absolument régler, et qui en certains cas doit rester secret. Car pour plusieurs, le fait d’avoir ce
« problème » inspire de la honte; et dans la plupart des cas, les participantes ont l’impression d’être « seules
à avoir ce problème ».
149
De tels problèmes réfèrent souvent à ce que la médecine nomme des « dysfonctions sexuelles » : douleurs
à la pénétration, vaginisme53, absence de plaisir lors des préliminaires et de la masturbation, pannes de désir,
etc. Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de prime abord d’une inquiétude liée à la performance
(dans son sens restreint) : ces jeunes filles ne veulent pas « mieux » performer, mais veulent qu’une relation
avec pénétration et sans douleur puisse avoir lieu. En d’autres mots, et selon leur expression, la relation
sexuelle « ne marche pas ». Leurs inquiétudes ne sont pas non plus dirigées strictement vers leur(s)
partenaire(s); elles tiennent à régler leur difficulté d’abord pour elles-mêmes, afin de profiter pleinement de leur
sexualité. Le sentiment d’être « anormales » est toutefois très présent, et constitue parfois une motivation
extrinsèque pour « régler leur problème » et donc ainsi ne plus avoir à s’en soucier.
Parmi les participantes qui ont discuté de tels thèmes, on trouve Amélie, 19 ans. Amélie ressent de la honte
parce qu’elle n’éprouve aucun plaisir à se toucher, ni lors des préliminaires. En fouillant sur Internet (pour un
autre sujet), elle est tombée sur ce passage du site Auféminin.com, qu’elle a cité sur son blogue :
« L’important est de ne pas considérer les préliminaires comme un passage obligatoire,
mais une source de plaisir à part entière. Les préliminaires sont l’ingrédient indispensable
pour que la vie du couple échappe à la routine. Parfois même, ils suffisent; des
préliminaires bien menés ne déboucheront pas forcément sur la pénétration. » [http://sante-
az.aufeminin.com/ w/sante/s365/sexualite/preliminaires.html] (Amélie)
Elle attribue à ce paragraphe l’origine de son inquiétude :
En lisant ce paragraphe, je me suis rendu compte que les préliminaires sont pour moi
effectivement un passage obligatoire avant la pénétration. C’est exactement de cette façon
que je me sens lorsque je le fais, car je sais que tout le monde procède ainsi et c’est un peu
comme la routine normale, mais je ne ressens aucun plaisir physique lors des préliminaires,
même parfois de la douleur. Ce paragraphe (sur le site) m’a démontré qu’il y a là un
problème que je dois régler. (Amélie)
Par ce passage, on voit que les informations trouvées sur Internet l’invitent à conférer aux préliminaires un
statut de « norme » du déroulement de la relation sexuelle, et qu’elle désire s’y conformer. Cependant, ce
53 Le vaginisme est considéré en médecine comme une dysfonction sexuelle et réfère à une contraction involontaire des
muscles du plancher pelvien entourant le vagin. Il s’agit d’une réflexe involontaire associé à la peur de la pénétration qui
intervient de façon récurrente et persistante et qui empêche ou rend difficile la pénétration vaginale. Le vaginisme peut
être total, partiel ou situationnel et peut engendrer des douleurs lors des tentatives de pénétration de même que des
sentiments de culpabilité et de détresse psychologique (DSM-IV-TR; Basson et al. : 2010; Crowley et al. : 2009; Ward et
Ogden : 2010a et 2010b [1994]; etc.).
150
n’est pas le fait de prendre part ou non aux préliminaires qui pose problème, mais le fait de ne pas les
apprécier :
[La] honte, ce n'était pas la honte d'aller regarder [cette information] sur Internet, c'est la
honte de ne pas aimer ça. Je me rappelle que les préliminaires avec mon premier chum, je
n'aimais même pas ça, ça ne me faisait absolument rien, aucun plaisir sexuel, c'est comme
s’il me touchait [les genoux]. Ça ne me faisait absolument rien, alors ça me rendait
honteuse de ne pas avoir le même plaisir que tout le monde. (Amélie)
Internet, dans son cas, (et on va voir que c’est récurrent chez Amélie), n’a pas contribué à la rassurer :
Intervieweuse : Dirais-tu qu'Internet a fait baisser ta honte?
Amélie : Ça n’a pas changé.
Intervieweuse : Dans le fond, ça t'a juste aidée à comprendre?
Amélie : Ça m'a juste fait voir que c'est supposé faire tout le temps du bien. Je n'ai vu nulle
part qu'il y avait des filles que ça ne leur faisait rien, je n'en ai pas trouvé. Je regardais des
techniques [qui disaient] comment bouger les doigts et tout. Je voulais juste me renseigner
là-dessus pour rendre [les préliminaires] plus le fun. Ça ne m'a pas aidée, c'est juste en
changeant de gars que ça a aidé.
Ce sentiment d’être anormale en raison d’une absence de plaisir a également motivé des recherches sur
Internet sur la masturbation :
J’ai souvent été lire des choses sur Internet en rapport à la masturbation (surtout à l’âge de
18 ans), car je n’ai jamais réussi à ressentir du plaisir en la faisant. Certaines de mes amies
me parlaient à quel point ça leur faisait du bien et que je devrais le faire aussi. J’ai essayé
à plusieurs reprises et de toutes les manières possibles, mais sans succès. Je me suis donc
renseignée sur Internet pour avoir des trucs plus précis, mais rien ne m’a aidée. Ces sites
expliquaient comment bouger les doigts et donnaient des exemples de situations excitantes
que l’ont pouvait s’imaginer en la faisant. Rien n’a fonctionné pour moi. J’ai l’impression
d’être anormale, car je ne connais personne d’autre ayant le même problème que moi. Je
crois que le problème est peut-être plus psychologique que physique, et je compte me
renseigner davantage sur le sujet. Peut-être que je ne suis tout simplement pas capable de
me laisser aller… Internet ne m’a pas du tout aidée pour ce problème. Au début, j’étais
incapable d’en parler avec ma mère, mais puisque je n’avais pas trouvé réponse sur
Internet, j’ai fini par en discuter avec elle, mais mon problème ne s’est jamais arrangé.
(Amélie)
151
Amélie croit qu’elle est « inhibée », et ceci l’inquiète :
[…] ...encore le mot « inhibée »... je me sens quasiment niaiseuse de faire ça, on dirait que
je ne peux pas me laisser aller, on dirait que je me bloque. Alors quand j'allais voir [sur
Internet], je me sentais honteuse de ne pas en être capable, mais finalement ça n'a rien
changé. C'est la même chose que les préliminaires, dans le fond, mais c’est moi-même qui
me les faisais.
Intervieweuse : Internet a-t-il aidé à réduire tes inhibitions d'aucune manière?
Amélie : Non, et c'est le genre de sujet que je n'aurais jamais recherché sur Internet, parce
que je me serais dit que je ne trouverais pas de réponses à mes questions. Peut-être que
dans le fond, il y aurait quelque chose, mais ça ne me tente pas de commencer à regarder
des millions de pages, je me dis que ça va être long avant de trouver quelque chose qui
corresponde à mon problème.
Amélie ressent également des douleurs lorsqu’elle a des relations sexuelles :
Ça fait depuis que j’ai 16 ans que je sors avec le même garçon et que nous sommes actifs
sexuellement, mais je ne me souviens que d’une seule fois où la pénétration n’a pas été
douloureuse. Depuis la première fois, j’ai toujours très mal à toutes les fois qu’il me pénètre,
comme s’il me « déviergeait » à chaque fois. C’est donc une autre question que j’ai voulu
aller regarder sur Internet pour voir si d’autres filles vivaient la même douleur que moi.
(Amélie)
Et cette situation crée également chez elle le sentiment d’être anormale :
Quand j'en parlais avec mes amies, personne n'avait ce problème-là, c'est de là que venait
la honte, du fait que j'étais la seule à être comme ça. C'était plate. (Amélie)
Elle trouve cette situation dommage pour elle, mais aussi pour son copain :
C'était plate pour mon chum aussi de savoir qu'il me faisait mal et qu'il... tsé lui aussi
a besoin d'avoir du fun là-dedans, alors ça me faisait honte de ne pas pouvoir être toute
satisfaite comme d'autres filles le sont avec leur chum. Tsé un gars aime ça que la fille soit
satisfaite, tandis que moi j'avais mal. Je sais que ce n'était pas de sa faute à lui, il ne faisait
rien de mal, […] il n'était pas trop brusque et il faisait toujours attention. J'allais me
renseigner s'il y avait d'autres gens comme ça et oui, il y en d'autres. J'allais voir à quoi ça
peut être relié et ils disent, souvent, quand tu prends la pilule trop jeune, tes hormones sont
comme débalancées, et ça peut faire ça. Ça peut être psychologique aussi. Si t'as peur
152
d'avoir mal, souvent ça engendre le mal encore, parce que ça bloque. C'était des affaires
comme ça que j'allais voir pour m'aider à avoir moins mal. (Amélie)
Visiblement découragée par la situation, Amélie a consulté des sites de discussions sur la question, des sites
d’information et des sites qui fournissaient des trucs, mais nul ne semble répondre parfaitement à ses besoins,
et surtout nul n’a réussi à la convaincre de voir un psychologue ou un sexologue. Voici ce qu’elle écrit :
Aujourd’hui, je suis tombée sur un site de discussion à ce sujet et j’ai pu voir que plusieurs
autres filles en souffrent aussi et qu’elles n’ont trouvé aucune solution elles non plus. Je
trouve ça très dommage... J’aurais espéré que ce soit des commentaires plus positifs
comme des trucs qui ont fonctionné au lieu de femmes qui en souffrent depuis des dizaines
d’années et n’ont rien pu solutionner. Au cours des deux dernières années, je voulais aussi
trouver les causes et les solutions à ce problème. J’en avais déjà beaucoup parlé avec ma
mère et elle m’avait nommé plusieurs facteurs qui pouvaient être la cause du problème,
mais je me suis aussi renseignée sur Internet pour avoir plus d’informations. Puisque ma
mère est médecin et très bien informée sur la sexualité, elle m’avait déjà informée de tout
ce que j’ai trouvé sur Internet qui pourrait être la cause de mon problème. Cependant, j’ai lu
des choses qui décrivaient vraiment mes sentiments par rapport à moi-même et ceux de
mon partenaire. Ça me faisait tout drôle de voir mes pensées à l’écrit, mais rédigées par
quelqu’un d’autre. Je crois que mon problème est surtout psychologique et plusieurs sites
mentionnaient qu'il pouvait être bénéfique de consulter un psychologue. En approfondissant
mes recherches, j'ai aussi trouvé que la pilule contraceptive peut jouer un rôle important
dans le manque de désirs sexuels. (Amélie)
Malgré les sites de discussion sur la question, Amélie reste avec l’impression qu’elle est « la seule » à vivre
cette situation :
Intervieweuse : Comment penses-tu qu'est le pourcentage de monde en dehors de toi qui
aurais mal aussi?
Amélie : Ben moi je dirais peut-être... en plus dans mon cours de socio, on avait vu ça, les
gens qui ont des problèmes, ils disaient que c'était 3 %, je pense. Ils parlaient d'avoir mal et
que genre ça ne marchait pas. Pas des problèmes dans le sens qu'ils n'en font plus.
Intervieweuse : Et si je te disais qu'il y en avait d’autres parmi les participantes qui disent
avoir mal ou ne pas être capables, ça te fait quoi de savoir ça?
Amélie : Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait d'autres, je pensais être la seule. C'est
rassurant d'une certaine façon, mais plate en même temps [pour elles]. […] J'aimerais
qu'elles sachent qu'elles ne seront pas comme ça toute leur vie.
153
Douleurs, pannes de désir et vaginisme : autres cas
D’autres participantes ont parlé du fait de vivre du vaginisme ou des douleurs à la pénétration. C’est le cas de
Camille, de Gabrielle, de Laurence et de Jade.
Commençons par discuter du cas de Gabrielle. Celle-ci a eu trois copains. Elle a essayé d’avoir des relations
sexuelles complètes avec les trois, mais n’y est pas arrivée avec les deux premiers. À première vue, ceux-ci
semblaient compréhensifs, en ce sens qu’ils n’ont jamais mis de pression sur Gabrielle, et qu’ils étaient
patients. Mais selon Gabrielle, leur compréhension était plutôt limitée, en ce sens que leur apparente
compréhension cachait peut-être un manque d’implication ou un manque de volonté à vouloir réellement
comprendre la situation que vivait Gabrielle :
Gabrielle : Les garçons étaient quand même assez compréhensifs. Des fois, ils ne
comprenaient pas pourquoi, mais ils disaient : « Check, ça se peut, ce sont tes premières
fois, nananan. » Ils étaient quand même compréhensifs. Je dirais que c'était un peu comme
de l'incompréhension, et ils faisaient comme « Check, c’est correct dans le fond, ce n'est
pas ce qui est le plus important dans la vie. » [Mais] au lieu de poser des questions et
d'essayer vraiment de comprendre, j’essayais de leur expliquer, ils me disaient juste genre :
« C’est correct, laisse faire, au pire ce n’est pas grave. » Alors pour eux, je ne sais pas s'ils
le prenaient mal, [ou s’] ils se disaient, je ne sais pas, elle n’a pas le goût, ou des affaires de
même. Je ne sais pas comment ils le prenaient parce qu'ils n’en parlaient pas vraiment. […]
Intervieweuse : Ils évitaient un peu le sujet.
Gabrielle : Oui.
À la question à savoir si elle croit que ses partenaires la jugeaient, elle précise :
S'ils l'ont fait, ce n'était pas volontaire. C'était plus justement : « Ce n'est pas grave, tu ne le
contrôles pas vraiment », mais moi, je voyais qu'ils étaient déçus, et ça, ça me faisait sentir
plus mal à l'aise, mais ce n'était pas à cause d'eux, volontairement. Ce n’était pas, genre :
« Ben là, c'est ben plate ton affaire, pourquoi tu fais ça, force-toi un peu. » Ce n’était pas ça
du tout. (Gabrielle)
Avec son troisième partenaire, qui est son copain actuel, Gabrielle a pu avoir des relations sexuelles
complètes. Même si la pénétration est toujours un peu difficile, elle apprécie grandement leurs relations :
Encore aujourd'hui, quand je fais l'amour avec mon copain, la pénétration s'avère ardue et
souvent douloureuse, mais en sachant pourquoi, on peut facilement réussir à le contourner
et vivre pleinement ces moments de pur bonheur! (Gabrielle)
154
Si elle a réussi à vivre « pleinement ces moments », comme elle l’écrit, c’est en grande partie grâce au fait que
la communication avec son copain actuel est beaucoup plus présente, et surtout plus sincère :
Je te dirais que côté communication, c'est un peu ça qui faisait que ça « buggait » un peu
avec les autres garçons, jusqu'à ce que je trouve vraiment mon chum, qui est l'homme de
ma vie. […] Avant, c'était plus un respect pour la forme. Maintenant, c'est vraiment du
respect. (Gabrielle)
C’est aussi en partie grâce à Internet, car c’est par les moteurs de recherche et les sites de santé que
Gabrielle a pu mettre un mot sur ce qu’elle vivait :
Même si sans le vouloir quelque chose qui s'appelle le « vaginisme » ruine ma vie! Vers
l'âge de 18 ans, avec une relation qu'on peut qualifier de sérieuse, je voulais passer
à l'étape suivante, qui est de « faire l'amour ». Malheureusement, après plusieurs essais,
rien à faire, la pénétration était tellement douloureuse qu'essayer plus de 4 ou 5 fois me
faisait presque pleurer!
Google toujours à ma rescousse, j'ai cherché « pénétration difficile » et appuyé
sur « Enter » sans vraiment m'attendre à une réponse. Plusieurs blogues en tête de liste,
tous sur ce sujet, mais aucun avec une solution à ce problème… sauf un, quelqu'un avait
ajouté un commentaire du genre : « Va sur Google, et tape "VAGINISME", c'est de ça dont
tu souffres. »
L'étape suivante va de soi : je suis allée sur Google et j'ai tapé « vaginisme » et je me suis
retrouvée sur le site Internet de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
(SOGC), qui décrit clairement le problème. On y trouve les réponses aux questions les plus
fréquentes à propos du problème et ce qu'on y apprend a été, à ma grande suprise, très
apprécié.
Malheureusement, il faut vivre avec et apprendre à contrôler ses muscles tout simplement,
même si ce n'est pas si simple que ça! (Gabrielle)
Gabrielle a aussi pu trouver du soutien auprès de ses proches, ce qui l’a grandement aidée. Comme elle
a une sœur et une cousine qui ont vécu la même chose qu’elle, elles ont pu parler ensemble sans tabous. Les
discussions familiales l’ont ainsi aidée à se sentir plus « normale », même si certains symptômes du
vaginisme perdurent. Elle demeure toutefois consciente qu’une telle situation est exceptionnelle, et que sans
ce soutien familial, elle aurait pu être beaucoup plus affectée par sa situation :
155
Gabrielle : Même qu’une fois on en parlait au party de Noël. Ma grand-mère, ma mère, ma
tante et mon grand-père jouaient aux cartes dans la cuisine et on était juste à côté dans le
salon et on parlait ouvertement de ça. Ma cousine, ma soeur, moi, mon autre soeur étions
là. […]
Intervieweuse : Et vous parliez ouvertement de ça?
Gabrielle : Oui, dans le salon. […] Dans le fond, je dirais qu'on pouvait en parler parce qu'on
avait toutes le même problème. Ma sœur, ma cousine et moi. C'est pour ça qu'on n’était
pas gênées d'en parler et aussi parce que maintenant on est toutes passées par-dessus ça.
Ça aurait peut-être été différent s’il y en avait encore une qui était encore à l'étape du
blocage, vraiment pas capable, peut-être que ça, ça aurait été vraiment difficile. Parce que
ma sœur, à un moment donné, était devenue vraiment négative à propos de ça, et je pense
qu'elle, regarder sur Internet, ça l'avait vraiment [découragée] et ça lui avait vraiment dit
qu'elle allait passer sa vie sans être capable de faire l'amour. Sauf après avoir eu un enfant.
Parce qu’elle était rendue à chercher des solutions pour avoir un enfant, genre où le gars
[…] t'insémine. Elle était rendue à ça. Alors elle, ça l'avait vraiment [découragée].
Finalement, ils ont réussi à faire l'amour, et là maintenant c’est bien correct.
Elle n’aurait peut-être pas eu le courage, par exemple, d’en parler à ses amies :
Gabrielle : Dans le fond, on le savait toutes [sa sœur, sa cousine et elle] qu'on avait ce
problème-là, alors ça ne me dérangeait pas d’en parler, mais je n'en aurais pas parlé [à
mes autres amies]. [Celles-ci] n’ont pas de chum stable ou n'ont jamais fait l’amour, alors ce
n'était pas quelque chose qui les concernait vraiment ou qu'elles auraient fait : « Oh, pauvre
toi, nananan. » Elles n’ont jamais su c'était quoi encore.
Intervieweuse : Toi, as-tu fouillé sur Internet par rapport à ça?
Gabrielle : J'ai été chanceuse, les blogues que j'ai trouvés [disaient] tous qu'elles avaient
passé par-dessus ça, qu'ils avaient réussi.
Leur expérience positive devient alors un encouragement pour Gabrielle :
C’était de savoir que c'était le vaginisme et qu'il y avait des solutions et qu'il y avait des filles
qui s'en étaient sorties. C’était comme de trouver pourquoi, parce que quand tu ne sais pas
ce que tu as, c'est comme inquiétant. En sachant c'est quoi... [ça aide]. (Gabrielle)
Camille, 20 ans, a également souffert de vaginisme, et a vécu une situation semblable à Gabrielle, mais
contrairement à Gabrielle, Camille n’a pas parlé de vaginisme sur le blogue. C’est au moment de quitter
156
l’entrevue, après que nous lui ayons demandé si l’entrevue avait couvert tous les sujets d’intérêt de son
expérience et que nous lui ayons mentionné des exemples de situations vécues par d’autres participantes,
que Camille a montré une certaine hésitation et a commencé à discuter de vaginisme. Une situation qui lui
a créé de l’insécurité et bien du découragement :
On dirait qu'il n'y avait rien qui pouvait rentrer là. Je ne mettais pas de doigt. Dans ma tête,
j'avais déjà vraiment essayé, je me suis dit : « On va voir si ça peut... [rentrer]. » Un pénis,
c'est quand même gros. Je me disais : « Mais comment ça fait pour [rentrer]? » [rires]
(Camille)
Elle décrit ici comment elle s’est sentie et comment Internet a pu lui apporter un certain réconfort :
Tsé, la première fois que je l'ai fait, on dirait que t'es toute seule au monde... La première
fois que je l'ai fait, ça a fait mal. Et je me disais : « Ah mon Dieu, ça ne passera jamais! »
[…] Je suis allée voir [sur Internet], il y avait plein d'histoires de filles à qui il était arrivé la
même chose. […] J'en avais parlé à mes chums de fille, mais à un moment donné, elles ont
juste leur expérience. Et elles, si ça ne leur a pas fait mal, elles ne peuvent pas dire : « Toi,
non, t'es correcte, ce n'est pas grave. » C'est ça que je disais tantôt, dans les limites que les
amis peuvent avoir. Si j'en parle à ma chum de fille […], ça arrête là, ça ne me réconforte
pas nécessairement. Ça ne me dit pas si c'est normal. C'est pour ça qu'Internet, des fois...
[est utile]. (Camille)
Malgré les limites que Camille attribue aux amis comme source d’information, elle a quand même parlé
ouvertement à ses amies concernant le vaginisme :
Moi, je suis sûre qu'il y en a vraiment plus qu'on [pense, de filles qui souffrent de
vaginisme]. Mes amies viennent me parler parce qu'elles ne sont pas gênées. Une de mes
amies m'a dit : « J'ai un blocage, ça ne rentre pas! » Pis là, quand elle a vu que je l'avais
fait, ça lui a fait de quoi. Elle a dit : « Ah, je suis toute seule! Je suis vraiment toute seule! Je
t'envie! » Mais avec [mon chum], ça a comme pris un mois. (Camille)
Cela ne veut pas dire qu’elle ne ressentait pas de honte ni l’impression d’être « anormale » :
Intervieweuse : Comment tu te sentais dans ce mois-là?
Camille : C'est la première fois... Je ne me sentais pas bien. Comme tu dis, c'est de la
honte. Je me sentais : « Ah... [découragement] je ne vais pas être comme ça toute ma vie,
là... » La deuxième fois: « Encore! » La troisième fois : « Ah là là… » Je capotais. Je disais :
je vais le laisser. J'avais dit à mes amies que j'allais devenir une soeur! [rires]
157
Intervieweuse : Et lui, comment il prenait ça?
Camille : Ben, tsé, il a dit : « Je vais être franc. Ça m'est déjà arrivé une fois de dévierger
une fille, et ça avait été plus simple que ça. » Je ne suis pas « slack »! [rires] Maintenant, il
n'y a plus de problème. C'était juste dans ma tête. J'étais là : « Je ne suis peut-être pas
normale. » Je disais ça... c'était rendu une joke pour moi, mais il m'a dit : « Ben non, tu es
bien normale. C'est juste que c'est plus [difficile] ».
Elle précise qu’elle a l’impression le problème n’est pas tant physique que mental :
[C]'est psychologique. C'est vraiment mental. Aussitôt que tu te dis : « Ah, c'est correct, il
peut y aller », [ça fonctionne]. […] En vieillissant, […] on grandit et on a encore notre corps
de petite fille. Et je suis encore comme ça. J'habite encore chez mes parents. Tsé, il
y a encore ma petite fille qui est en dedans de moi. Et je me disais : « Comment ça va
rentrer? » […] Je me disais : « Ça ne pourra jamais [rentrer] »; ça me faisait [trop] mal. [Sur
Internet, j’allais voir] de la porno, […] des photos d'hymens et de vagins... qui disaient, bien
[que c’était] normal. (Camille)
Laurence, 19 ans, a aussi eu de la difficulté à faire l’amour les premières fois, mais elle n’a jamais vraiment su
si elle avait réellement fait du vaginisme. Toutefois, le fait qu’elle puisse en faire l’inquiétait :
Quand j'ai fait l'amour les premières fois, j'ai trouvé ça moins plaisant qu'on m'avait dit,
haha. La première fois, je me suis dit que c'était normal que cela soit douloureux, mais plus
je le faisais, moins j'en étais convaincue. J'ai pris peur, car j'avais lu un article dans le
journal qui parlait d'un problème qu'avaient certaines femmes à faire l'amour. Je crois que
ça s'appelait le vaginisme. J'ai vraiment eu peur que ce soit mon cas, mais je crois que le
problème était plutôt la personne... je n'ai jamais vraiment su si j'en faisais, mais je crois
que c'était plutôt psychologique! (Laurence)
Avec son premier partenaire, les premières relations ont été difficiles, et elles le sont restées. La pénétration
est encore aujourd’hui difficile, même avec son 3e partenaire :
Intervieweuse : Comment s’est passée la première fois? Tu m'as parlé du vaginisme. […]
Laurence : Je ne sais pas si c'était vraiment ça. Tsé, la première fois, c'est normal que ça
fasse mal, c'est stressant. Ben tsé, je l'avais fait après, mais je ne sais pas, je n'étais pas
à l'aise, j'étais vraiment stressée, je pense que c'est plus ça qui n’a pas aidé.
Intervieweuse : Pour toi, est-ce que la pénétration était possible?
158
Laurence : Quasiment. Oui, vraiment la 2e fois, ça a plus ou moins marché.
Intervieweuse : Et après, ça s'est réglé?
Laurence : Après, ce n'était pas si pire. Ça s'est... [amélioré]. Je ne sais pas si c'est dans le
fond ton corps qui s'habitue, mais...
Contrairement à Gabrielle ou à Camille, Laurence a gardé pour elle ses inquiétudes. Elle n’en a ni parlé à ses
amis, ni à son médecin. Elle dira aussi que la question ne l’inquiète pas trop :
Intervieweuse : Est-ce que tu te sentais toute seule par rapport à ça? Au fait que ça ne
marchait pas? Ou sentais-tu que tu pouvais en parler?
Laurence : Euh... non, non. Ben je n'en ai pas parlé à personne. C'est pour ça que j'ai
cherché sur Internet, ou je me disais que ça allait passer. J'ai vu que je n'étais pas toute
seule, mais je me disais que ça ne devait pas être si grave, et que si ça ne passait pas, là,
j'allais en parler. Mais ça ne m'inquiétait pas trop.
Intervieweuse : Ce n'était pas un enjeu énorme dans ta sexualité?
Laurence : Non.
Nous allons voir plus loin, cependant, que Laurence éprouve certaines difficultés à véritablement prendre en
charge sa sexualité, et qu’elle adopte parfois l’attitude du « haussement d’épaules » que nous avons décrite
préalablement. Pour l’instant, nous nous contenterons de souligner que Laurence s’est servie uniquement
d’Internet pour s’informer sur sa situation (sans avoir recours à d’autres sources parallèles), et que faire ses
recherches ne la rendait pas particulièrement anxieuse :
Intervieweuse : Quand tu cherches sur Internet au sujet du vaginisme, est-ce que ça
augmente ou diminue l'anxiété?
Laurence : Ben c'est juste neutre, mettons, parce que ça me renseigne, mais ce n'est pas...
[une vive inquiétude].
Voyons enfin le cas de Jade, 19 ans. Même sans avoir eu de relations sexuelles, Jade craint de faire du
vaginisme. Comme Laurence, Camille ou Gabrielle, elle a l’impression que son vagin est « fermé » et qu’une
relation sexuelle éventuelle serait impossible. Sans trop pouvoir nommer sa crainte, elle a cherché sur Internet
à plusieurs reprises, mais les termes sur lesquels elle tombait ne lui semblaient pas tout à fait appropriés :
159
J'ai cherché de l'information sur l'anorgasmie [et sur la frigidité], un sujet qui me préoccupe
de façon réelle. Cependant, je n'ai pas été très satisfaite par ce que j'ai trouvé : aucun
traitement n’était mentionné et on ne parlait pas non plus de la fermeture du vagin ni de
douleurs. Il y a très peu d'information à ce sujet qui est pourtant très important! J'aimerais
pouvoir régler ce problème moi-même avant d'avoir un amoureux. Peut-être aussi que je ne
connais pas le bon nom du problème que j'ai. (Jade)
Plus tard, en entrevue, elle nous dira :
J'ai fini par trouver que le vrai mot, c’était « vaginisme ». (Jade)
C’est en suivant un cours sur la sexualité à l’université qu’elle entend parler de vaginisme pour la première fois
et qu’elle commence à réaliser ou à croire que c’est peut-être de cette « dysfonction » dont elle souffre. Elle se
rend ensuite sur Internet pour obtenir plus d’information, notamment sur les façons de traiter le problème, mais
elle est vite déçue :
Jade : À la fin du compte, il n’y a pas grand information. Ils disent juste d’aller voir un
sexologue, et c’est ça surtout.
Intervieweuse : Qu'aurais-tu aimé avoir comme information?
Jade : Peut-être comment faire un traitement sans nécessairement avoir de soutien
psychologique, parce que tu ne peux pas te payer de psychologue quand t’es étudiante.
Jade a l’impression que le vaginisme est un tabou, puisqu’on n’en parle pas, par exemple, à la télévision, où
tous les personnages féminins semblent éprouver du plaisir à tout coup. Cela fait que de ne pas en éprouver
devient gênant, et que de ne pas être « capable » de faire l’amour avec pénétration peut le devenir encore
plus54.
Intervieweuse : As-tu l'impression que le vaginisme, c’est le dernier tabou?
Jade : J'ai l'impression que oui, parce que je regarde comme souvent les émissions
québécoises, la femme dit : « Ah, je fais semblant d'avoir du plaisir », mais je pense que
c’est quelque chose de grave de faire semblant. Je pense que c’est quelque chose qu'ils
54 Le « vaginisme » leur apparaît à ce point tabou que même les filles qui n’en font pas l’expérience semblent gênées
d’en parler à leurs amies : « Ben je pourrais [en parler à mes amies], mentionne Audrey, parce que mes chums me
connaissent assez pour savoir que je suis pas mal ouverte [sur la sexualité], mais j'aurais quasiment peur que quelqu'un
ait ça, et qu'elle fasse, comme : "Wo..." ».
160
devaient montrer aussi. Je pense que tu ne devrais jamais faire semblant. Si tu n'aimes pas
ça, tu as le droit autant d'avoir du plaisir que le gars, alors tu ne fais pas semblant d'avoir du
fun. (Jade)
Heureusement, Jade entretient une relation très ouverte avec sa mère, ce qui fait qu’elle a pu lui parler de
vaginisme sans gêne, mais elle estime que les recherches comme telles sur le sujet sont gênantes :
J'étais gênée de faire cette recherche et déçue des traitements [proposés]. (Jade)
Discussion
Ce que rapportent Camille, Gabrielle, Amélie, Jade et Laurence concorde avec ce que l’on peut trouver dans
certains textes scientifiques sur ce qu’on appelle le « vaginisme » et sur les autres « dysfonctions » sexuelles.
Ward et Odgen, qui ont publié en 1994 (et republié en 2010) un texte fondamental sur les causes perçues et
les effets du « vaginisme » sur la vie sociale et personnelle des femmes qui en souffrent, montrent par une
étude à la fois qualitative et quantitative que les femmes qui disent en souffrir se sentent souvent seules avec
ce problème, « anormales », découragées et incapables de pouvoir discuter de leur condition avec leur famille
ou leurs amis en raison du tabou entourant la condition. Et comme Camille, certaines répondantes de Ward et
Odgen ont signifié se sentir encore comme une « petite fille » à l’intérieur, alors que d’autres se sentaient
dévaluées par rapport aux autres femmes en raison de leur incapacité à réussir la pénétration. D’autres
encore avaient simplement l’impression d’être physiquement trop « petites » pour pouvoir permettre la
pénétration et voyaient difficilement comment celle-ci pouvait être possible. De plus, comme nos participantes,
plusieurs ont rapporté avoir rencontré des difficultés avec leur partenaire, qui ne leur offrait pas toujours un
soutien total dans cette difficulté. Certaines participantes de l’étude de Ward et Odgen auraient même vu leur
mariage cesser en raison de la « dysfonction » (p. 441-443).
Du côté de nos participantes, certaines, dont Camille et Gabrielle, ont eu la chance, contrairement à la
majorité des femmes qui disent souffrir de « vaginisme », d’être entourées d’autres filles vivant ou ayant vécu
la même condition, ce qui a pu dès lors faciliter la communication sur le sujet et réduire l’incidence de faible
estime de soi généralement associée à ce qu’elles voient comme un problème. Mais même lorsqu’elles
peuvent se confier, les participantes restent avec l’impression d’être « seules » avec ce problème : Amélie et
Camille, par exemple, qui pourtant avaient pu en parler avec leur mère, leurs amies ou leur famille, ont toutes
deux dit ressentir de la honte du fait que la pénétration leur soit difficile ou douloureuse, et l’amie de Camille
s’est montrée découragée lorsqu’elle a appris que Camille avait réussi à surmonter son « problème ».
161
Internet peut alors les aider à « réaliser » que d’autres femmes vivent une situation semblable; bref, que le fait
existe. Comme le dit Gabrielle, « en sachant c’est quoi… [ça aide.] » Mais selon ce qu’elles réussissent
à trouver comme information, Internet peut tout autant les rassurer que les décourager. Pire encore,
l’information peut être très difficile à trouver, surtout lorsqu’elles ne savent pas comment exprimer ce qu’elles
vivent, comme dans le cas de Jade.
Il est surprenant de constater à quel point les « problèmes sexuels » que peuvent rencontrer les filles sont si
méconnus, alors que ceux-ci sont si fréquents : ils affecteraient entre 20 et 50 % des femmes, selon Basson et
al. (2000; voir aussi Luftey et al. : 2009, qui évaluent cette prévalence à 38,4 %). Le vaginisme seul affecterait
entre 1 % et 6 % de la population générale (Meston et Bradford : 2007, p. 247). D’autres vont jusqu’à évaluer
cette prévalence à entre 4,2 et 42 % (Crowley et al. : 2009). De plus, selon Anastasiadis et al. (2002), de tous
les patient(e)s qui se présentent en thérapie dans les cliniques de sexologues, environ 15 à 17 % se
plaindraient de vaginisme.
La grande variation dans les pourcentages peut s’expliquer par des différences dans la conception du
« problème » même ou dans les critères qui le distinguent d’autres difficultés (dans de telles recherches, les
critères sont souvent établis par des questionnaires, et ceux-ci varient). Mais ce qu’il est à la fois inquiétant et
intéressant de constater, outre le fait que les définitions sur lesquelles se basent les études pour définir les
« dysfonctions » sexuelles féminines soient inconstantes (Brotto et al. : 2006), c’est que les définitions des
« dysfonctions » considérées comme des « références » dans le domaine médical sont abondamment
critiquées, autant par la communauté médicale elle-même que par des commentateurs « externes », telle la
psychologue, chercheuse et militante féministe Leonore Tiefer (2012, 2010a, 2010b, 2006, 2005, 2002,
2001a, 2001b, 2000).
Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (habituellement désigné par le sigle DSM, pour
Diagnotic and Statistical Manual, suivi du chiffre romain de sa dernière version), édité par l’Association
américaine de psychiatrie (APA), de même que l’International Statistical Classification of Disease and Related
Health Problems (ICD) de l’Organisation mondiale de la Santé constituent les deux références les plus
reconnues en matière de classification des diagnostics médicaux. Au Canada, c’est le DSM qui est le plus
utilisé (l’ICD étant plus populaire en Europe).
Or, la définition que font ces deux ouvrages des dysfonctions sexuelles féminines tend, selon plusieurs
auteurs, à ignorer leurs causes sociales, psychologiques et relationnelles au profit d’une vision purement
physique, organique ou biologique de la sexualité humaine (voir par exemple Tiefer : 2010b, 2006 et 2002).
D’une part, la définition « organique » des dysfonctions a souvent peu à voir avec la réalité. Dans le cas du
vaginisme, par exemple, le DSM-IV-TR (« TR » pour « édition révisée ») le définit comme un « spasme »
musculaire du vagin (p. 246 de la version française abrégée), alors que la majorité des auteurs s’accordent
162
pour dire qu’il s’agit beaucoup plus précisément d’un « réflexe » musculaire engendré par la peur de la
pénétration, la présence d’un tel « spasme » n’ayant jamais été documentée par la recherche (Basson et al. :
2003, p. 226; Binik et al. : 1999 et 2002, p. 426).
Les différentes « dysfonctions » sexuelles féminines sont également conçues comme étant distinctes les unes
des autres, alors que la recherche montre au contraire une très grande cooccurrence des différentes
« dysfonctions » définies (Basson et al. : 2003, p. 225; Brotto et al. : 2010). L’ICD-10 distingue même le
vaginisme « physique » du vaginisme « psychologique », alors que les causes du vaginisme sont souvent
multiples et que rien n’indique qu’il faille en distinguer deux types (Basson et al. : 2003, p. 222).
D’autre part, la conception de la « dysfonction » sexuelle féminine de ces deux ouvrages se base sur la
conception du « cycle de réponse sexuelle humaine » (human sexual response cycle) établie par Kaplan
(1979) et Masters et Johnson (1966, 1970). Le fait que le DSM et l’ICD se basent sur ce modèle pour
comprendre la sexualité féminine est très problématique, puisque non seulement ce modèle date de plusieurs
décennies, mais aussi parce qu’il avait pour but à l’origine de décrire le cycle de réponse sexuelle des
hommes. La conception de la « réponse sexuelle » des femmes est donc directement calquée sur ce modèle
masculin, où les « stades » de désir, d’excitation et d’orgasme se succèdent de façon linéaire et distincte, et
où ces « stades » sont évalués selon des critères exclusivement physiques (Bancroft : 2002, Basson et al. :
2003 et 2005, Meston et Bradford : 2007; Tiefer : 2002, p. 76-78).
Or, la recherche montre, chez les femmes particulièrement, que les stades de « désir » et « d’excitation »
peuvent se chevaucher et se renforcer mutuellement; ainsi, le désir ne précède pas nécessairement
l’excitation. Par ailleurs, la réponse « réflexive » de la stimulation sexuelle (la lubrification), qui sert
généralement dans ces définitions comme « marqueur » de désir et d’excitation, peut apparaître sans qu’il
y ait nécessairement de désir subjectif, en d’autres mots sans que cette réponse soit désirée ou que la
stimulation soit nécessairement appréciée. L’inverse est également vrai : une femme qui ressent
subjectivement de l’excitation peut ne pas montrer de signes physiques de cette excitation. Les stades ne sont
donc pas distincts, et la « réponse physique » de l’excitation n’est donc pas nécessairement corrélée avec les
facteurs subjectifs de celle-ci (Basson et al. : 2003, p. 222-224).
La sexualité féminine est autrement plus complexe : le désir, l’excitation et même la détresse ressentie lorsque
des problèmes surgissent dépendent d’une multitude de facteurs, dont plusieurs sont contextuels (voir par
exemple Basson et al. : 2005 et Brotto et al. : 2010). Ces facteurs, pourtant, sont cruellement absents des
définitions du DSM et de l’ICD. Une faille qui, par son accent porté sur les aspects physiques et hormonaux
des dysfonctions, amènent selon Tiefer à une « surmédicalisation » des problèmes sexuels féminins, c’est-à-
dire à l’implantation d’une approche institutionnalisée et normative de la sexualité qui privilégie les aspects
biologiques de celle-ci et ses traitements au détriment des discours qui visent à discuter de ses aspects
163
politiques, culturels et subjectifs (2012, p. 312-314; 2002, p. 75; 2001b; voir aussi Guyard : 2010). En d’autres
mots :
Medicalization is a complex process of transforming a social situation or personal
experience, especially one that is culturally abnormal or "deviant", into a medical problem
that requires treatment by medical experts (Conrad & Scheider : 1980). (Tiefer : 2010b,
p. 198)
D’ailleurs, l’examen poussé qu’a produit Tiefer du contexte dans lequel sont apparues les dernières définitions
des dysfonctions sexuelles féminines du DSM montre que les récentes préoccupations médicales concernant
ces problèmes se sont d’abord formées et organisées sous l’impulsion de l’industrie pharmaceutique, après
que le Viagra ait été découvert et commercialisé (Tiefer : 2010a, 2006, 2002). Vers la fin des années 1990, en
effet, dès que le Viagra fut approuvé par la US Food and Drug Administration, des urologues se sont
empressés de tenter de mettre au point un « viagra rose », avec l’idée « that is must work for women » (2006,
p. 0438). C’est ce qui aurait poussé la communauté médicale à examiner et à « définir » les dysfonctions
sexuelles féminines par le biais de recherches menées par des urologues et financées en grande partie par
Pfizer, la plus importante compagnie pharmaceutique au monde (ibid.). L’on a alors cherché des signes de
physiopathologies qui représenteraient l’équivalent féminin des dysfonctions érectiles (ibid.), et l’on s’est doté
de journaux scientifiques et d’une conférence annuelle dont le rapport (Basson et al. : 2000) allait servir
à chercher un consensus sur la définition des dysfonctions au sein du milieu médical (Tiefer : 2001, 2002)55.
Jusqu’à ces années charnières, mise à part la période où elle s’est efforcée de mettre au point la pilule
anticonceptionnelle (qui a permis aux femmes de contrôler leur fertilité et ainsi de réduire considérablement
leurs craintes de tomber enceintes), la communauté médicale avait pourtant largement ignoré le
fonctionnement et les problèmes de la sexualité féminine (Bancroft : 2002, p. 452). Selon Tiefer, il s’agirait
d’une volonté évidente de l’industrie pharmaceutique d’exploiter la détresse des femmes.
Le problème principal des définitions proposées durant le sommet réside dans le fait qu’elles ignorent
cruellement la dimension sociale de la sexualité et ses aspects normatifs. La conception de la sexualité des
deux manuels repose en effet sur des normes culturelles prises pour universelles, soit celles de la sexualité
basée sur le coït (la pénétration vaginale « réussie » constituant le critère distinguant la dysfonction de la
« fonction normale ») et de la sexualité hétérosexuelle, discréditant ainsi les pratiques sexuelles non axées sur
le plaisir génital et l’orgasme (2010b, p. 1999; voir aussi 2002, p. 82 et plus). Selon Tiefer, la médicalisation de
55 Ce rapport a été abondamment critiqué par Tiefer (2001, 2002), qui lui reproche d’avoir été créé à l’issue d’une
conférence fermée au public et à certains experts et dans le but unique de servir les intérêts de l’industrie
pharmaceutique. Elle reproche également aux auteurs leurs conflits d’intérêts en raison de leurs liens avec l’industrie
pharmaceutique.
164
la sexualité des femmes et son accent porté sur la performance ne peuvent servir l’intérêt des femmes et des
filles.
Le discours médical, comme tout discours, constitue un pouvoir (Foucault : 1994 [1976]). L’un des pouvoirs
que détiennent les institutions médicales est celui de nommer les « dysfonctions » du corps, les classifier, les
définir et délimiter leurs contours afin de permettre le diagnostic. Foucault (2009 [1963]) montre, dans La
naissance de la clinique, que la médecine, dès le XIXe siècle, se trouve ainsi peu à peu investie du pouvoir de
déterminer ce qui est « normal » et ce qui est « anormal » :
[À partir du XIXe siècle, la] médecine ne doit plus être seulement le corpus des techniques
de la guérison et du savoir qu’elles requièrent; elle enveloppera aussi une connaissance de
l’homme en santé c’est-à-dire à la fois une expérience de l’homme non malade, et une
définition de l’homme modèle. Dans la gestion de l’existence humaine, elle prend une
posture normative, qui ne l’autorise pas simplement à distribuer des conseils de vie sage,
mais la fonde à régenter les rapports physiques et moraux de la société où il vit. […] D’une
façon très globale, on peut dire que jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la médecine s’est référée
beaucoup plus à la santé qu’à la normalité; elle ne prenait pas appui sur l’analyse d’un
fonctionnement « régulier » de l’organisme pour chercher où il est dévié, par quoi il est
perturbé, comment on peut le rétablir […]. […] La médecine du XIXe siècle s’ordonne plus,
en revanche, à la normalité qu’à la santé; c’est par rapport à un type de fonctionnement ou
de structure organique qu’elle forme ses concepts et prescrit ses interventions […]. (p. 35;
les italiques sont de l’auteur)
Or, dans le cas de la définition des « dysfonctions » sexuelles, il est possible d’arguer que s’il est si fréquent
de rencontrer, par exemple, des cas de vaginisme chez les filles, c’est peut-être parce que le réflexe de
contraction du plancher pelvien dû à la peur de la pénétration constitue une réaction « normale » du corps
plutôt qu’une réaction anormale – et donc ainsi une « fonction » plutôt qu’une « dysfonction ». En définissant
les dysfonctions, non seulement la médecine distingue-t-elle la « normalité » de l’ « anormalité », mais plus
encore, ce faisant, elle crée et impose des normes de fonctionnement qui dépassent le simple cadre de la
biologie et qui s’inscrivent dans le social. Dans le cas des « dysfonctions » sexuelles de femmes, en particulier
du vaginisme, le modèle de « normalité » sur lequel se fonde la classification repose non seulement sur une
conception hétérosexiste de la sexualité, mais aussi sur une norme de sexualité pénétrative; le « succès » de
la relation sexuelle est conçu comme la réussite de la pénétration, sans égard au fait que la partenaire ait du
plaisir ou non, ou que l’inconfort ou la peur de la pénétration soient toujours présents (Ward et Odgen : 2010b
[1994] et 2010a; Crowley et al. : 2009; Meston et Bradford : 2007, p. 250).
Selon plusieurs auteurs, en raison des connotations médicales du terme « dysfonction », il faudrait plutôt
qualifier les dysfonctions féminines de « problèmes » sexuels; un terme qui permet une meilleure implication
des causes sociales et relationnelles dans l’évaluation et dans la compréhension de celles-ci (Basson et al. :
165
2003; Bancroft : 2002; Bancroft et al. : 2005). Il faudrait par ailleurs considérer ces « problèmes » comme des
réactions normales à l’environnement, à la situation ou au partenaire :
This takes us to the final point: when is it reasonable to describe a lack of sexual response
or enjoyment as a dysfunction? This translation of "sexual problem" into "sexual
dysfunction," with all the medical connotations of that term, while problematic with men is
much more so with women. […] ….we should consider the circumstances where the
behavior of the male partner, or the context of the sexual interaction is less than exciting, or
may actually be invoking inhibition in the woman. This may be an understandable and
adaptive inhibition of sexual responsiveness in the presence of stress, depression, or
marked tiredness, or the continuing presence of negative or threatening patterns of behavior
in the partner. The woman may not be responding sexually because it is adaptive for her to
do so. Such lack of response should not be regarded as a "dysfunction." (Bancroft : 2002,
p. 454)
Ward et Odgen montraient déjà en 1994 que le vaginisme, entre autres « dysfonctions », était un problème
multidimensionnel qui trouve des implications à la fois psychologiques, sociales et (parfois) physiques, et qu’il
s’insérerait dans une problématique sociale plus large auquel concourent des questions de confiance (en soi
et aux autres), de rapports de pouvoir et de genre, et de normes sociales de la sexualité pénétrative (p. 444-
445). Ainsi les définitions du vaginisme ne devraient pas se limiter aux dimensions physiques ou même
psychologiques de l’expérience du vaginisme, mais devraient plutôt prendre en compte tous les aspects de la
vie de ceux qui en souffrent, c’est-à-dire leurs sentiments56, leurs expériences générales qui puissent y être
reliées et leurs perceptions du problème, de même que leur relation de couple (Bancroft : 2002; Basson et al. :
2003; Kabakçi et Batur : 2003; Tiefer : op. cit.; Ward et Odgen : 2010b [1994]; etc.57).
La part sociale des problèmes sexuels des femmes est telle, selon Tiefer, que les définitions des dysfonctions
comme celles du DSM devraient tout simplement disparaître, ou encore être remplacées par une classification
qui permette aux femmes d’identifier elles-mêmes leurs problèmes sexuels et qui situent ceux-ci dans un
cadre principalement culturel et relationnel (2002, p. 86). Selon Teifer (2005), seule la dyspareunie (présence
56 Des études montrent que l’anxiété, la honte, la timidité, une faible estime de soi ou une piètre image de son corps
(body image) peuvent affecter le désir des femmes, leur relation de couple ou leurs relations sexuelles (Bancroft et al. :
2005; Meston et Bradford : 2007, p. 238-239; Dove et Wiederman : 2000; Nobre et Pinto-Gouveia : 2008; et Wiederman :
2000). 57 La littérature concernant le débat sur la définition des dysfonctions sexuelles est abondante; nous n'en citons ici qu'une
partie. Pour d'autres textes sur la question, voir notamment : Basson, Black et al. : 2005; Davis : 2001, de Kruiff et al. :
2000; Drescher : 2010; Gabbard : 2001, Graham : 2010; Reissing et al. : 1999; Reissing et al. : 2004; Tolman : 2001; et
Wakefield : 2012.
166
de douleur lors des relations sexuelles) devrait être conçue comme une dysfonction; toutes les autres faisant
référence exclusivement à des problématiques sociales (p. 50)58.
Mais comme le précise Foucault dans son étude du fonctionnement normatif de la médecine, le but d’une telle
analyse n’est pas de remplacer la médecine pour une autre, ni de prôner son absence, mais de dégager les
implications de son exercice (p. XV). De façon semblable, nous ne recommandons pas nécessairement que la
médecine cesse de s’intéresser aux problèmes sexuels auxquels font face les femmes et les filles. Au
contraire, le récent intérêt de la médecine envers la sexualité des femmes et des filles, malgré la controverse
qui l’entoure (ou même en raison de cette controverse), pourraient amener quelques points positifs.
Tiefer elle-même elle concède que la classification des dysfonctions en son sens large permet non seulement
une meilleure sensibilisation sociale au problème (public awareness), mais aussi une plus grande légitimité du
plaisir sexuel des femmes, de meilleurs fonds de recherche, un meilleur traitement médical de la douleur et
une plus grande couverture du problème par les assurances (Tiefer : 2005, p. 50). Conaglen (2001) estime
également que la sortie du rapport Basson et al. (2001), bien que problématique sur plusieurs plans, permet
de porter une attention plus que bienvenue sur les problèmes sexuels féminins (p. 127).
Avec la sortie prévue en 2013 d’une nouvelle version du DSM59, Basson et al. (2003) considèrent enfin que les
nouvelles définitions des dysfonctions sexuelles féminines, si elles mettent l’accent sur une approche
biopsychosociale de la sexualité et évitent de pathologiser les femmes, pourraient permettre une meilleure
prise en charge médicale des difficultés que vivent les filles et les femmes, et donc de les aider à diminuer la
détresse psychologique associée à leurs problèmes sexuels (p. 227).
En ce sens, le fait de rayer les dysfonctions sexuelles des ouvrages de référence médicaux pourrait amener
des conséquences perverses : même si le but, légitime, serait de dire aux femmes qu’elles sont normales, le
danger serait grand que l’abolition des définitions (si même elle est possible) nous mène involontairement
à nier l’existence de leur problème, et donc ainsi à nier leurs expériences subjectives de ces « dysfonctions »,
et ce même si ces expériences sont situées dans un cadre social normatif. Certaines auteures craignent en
effet que l’on jette les aspects positifs des définitions avec l’eau du bain de la controverse :
Although [the medicalization of female sexuality] is a valid concern for women with sexual
problems that are not clinically diagnosable, on the opposite end of the spectrum is the
percentage of women in that figure who would meet clinical diagnosis for sexual
dysfonction. For those women, the NHSLS [le National Health and Social Life Survey, un
sondage américain selon lequel 43 % des femmes rencontreraient des problèmes de nature
58 Il est surprenant que Tiefer fasse cette distinction, car comme on l’a vu, la douleur causée par exemple par le
vaginisme peut avoir des causes sociales et relationnelles. 59 Lors de la rédaction de la thèse, le DSM-V n’était pas encore publié.
167
sexuelle] proved beneficial in spreading the word about women’s sexual concerns. The
increased discourse and awareness of the extent of women’s sexual dysfunctions has
undoubtedly helped many women with sexual concerns feel more comfortable talking about
their sexual concerns, and, perhaps, justified and/or motivated them to seek help. (Meston
et Bradford : 2007, p. 234)
Il est donc probable qu’il soit plus productif de mieux définir les problèmes sexuels que d’éliminer
complètement leur description des ouvrages médicaux (p. 251).
D’ailleurs, en observant de plus près le discours des participantes, il semble effectivement que celles-ci aient
surtout besoin que l’on puisse reconnaître leur condition ou leur expérience, bref qu’elle soit valide, connue,
reconnue. Il est certain que le fait que les problèmes qu’elles rencontrent soient catégorisés comme des
« dysfonctions » puisse contribuer au fait qu’elles se sentent anormales, mais il reste que c’est aussi en
reconnaissant leur expérience comme valide qu’elles arrivent, justement, à se sentir « normales ». Le simple
fait de pouvoir « nommer » leur condition a d’ailleurs été pour plusieurs synonyme d’un grand soulagement :
Jade, par exemple, cherchait en vain un « nom » pour sa condition, et s’est mieux sentie quand elle a enfin pu
identifier son problème, et Gabrielle s’est trouvée très chanceuse d’être tombée sur le site des obstétriciens et
gynécologues du Canada (SOGC), qui lui a « très bien décrit le problème ». Jade déplorait pour sa part que sa
condition soit si peu connue du grand public (ce qui a gêné ses recherches d’information) et, d’autre part, que
les représentations de la sexualité dans les médias, où les femmes sont toujours prêtes et où le rapport sexuel
se déroule toujours sans problème, ne reflètent pas la réalité, et encore moins sa réalité.
Le fait de « nommer » leur expérience, même s’il s’agit de la nommer comme « dysfonction », leur fournit donc
d’une certaine manière de meilleurs outils pour prendre en charge leur sexualité et facilite leur quête d’une
sexualité plus épanouie. Sans cette option de pouvoir « googler » les mots « vaginisme » ou « panne de
désir », et donc de trouver des blogues, des forums et des sites sur la question, elles resteraient fort
probablement seules avec leur détresse.
Cela ne signifie pas, toutefois, que cet « outil » soit sans failles. Jade a déploré que les techniques enseignées
par les sexologues pour aider les femmes souffrant de vaginisme à « s’approprier » leur corps soient absents
du Net, et la sœur de Gabrielle a été découragée par ce qu’elle a trouvé sur les blogues. Comme le fait
remarquer Gabrielle, Internet peut aider les filles tout autant qu’il peut les décourager, selon ce qu’elles
y trouvent.
Pire encore, le discours selon lequel le vaginisme trouve des causes sociales et relationnelles est très peu
présent sur le Web. Ce discours semble jusqu’à maintenant exclusif aux textes scientifiques qui décrivent ou
critiquent les définitions usuelles des dysfonctions, et ces textes peuvent être difficiles à trouver pour la
168
population générale. Ce qui fait que les participantes de notre étude, tout comme celles de Ward et Odgen,
continuent de percevoir leur situation comme un problème dont elles seules sont responsables60, et qu’il faut
impérativement régler.
Il nous semble dès lors important, en observant les expériences vécues par Jade, Gabrielle, Laurence,
Camille et Amélie, que les problèmes sexuels des femmes soient, d’une part, mieux connus de la société en
général, et d’autre part que leurs dimensions psychologiques, sociales et relationnelles soient mieux affirmées
dans les discussions qui les concernent. La discussion sociale sur les « dysfonctions » nous semble donc tout
à fait cruciale, autant dans la société en général que dans le curriculum scolaire sur la sexualité, pour que l’on
puisse arriver à discuter des problèmes sexuels des filles sans tabous, et pour que les filles qui rencontrent de
tels problèmes cessent de porter le poids de l’isolement et de la détresse psychologique qui lui sont
généralement associés. Il pourrait enfin être utile, comme le suggère Jade, que les étapes que suggèrent les
sexologues pour « guérir » du vaginisme soient mieux accessibles sur le Web.
5.1.5 Craintes vives mais passagères
Plusieurs participantes ont témoigné avoir déjà rencontré d’autres situations très angoissantes qui les ont
poussées à consulter le Web pour trouver de l’information. Toutefois, contrairement aux « dysfonctions »
sexuelles, ces craintes ne se sont pas inscrites à long terme, c’est-à-dire qu’une fois certaines informations
obtenues et un certain nombre de jours passés, la crainte disparaît souvent rapidement et le problème se
révèle relativement oublié.
Nous avons regroupé dans cette section les thèmes de recherche où les participantes ont témoigné avoir
ressenti une grande angoisse, mais à moins long terme que ceux placés sous « craintes centrales ». Les
« craintes vives mais passagères » créent chez elles de l’anxiété et un besoin vif et intense d’information, mais
se présentent de façon ponctuelle, puis sont ensuite relativement oubliées. Les participantes sont dans ces
cas précis confrontées à une situation particulière : une crainte de grossesse après une relation (même
protégée), une crainte d’avoir développé une ITSS après avoir entendu des informations sur la transmission
(parfois erronées), par exemple, mais aussi le fait de vivre les symptômes douloureux d’une infection urinaire,
ou encore le fait d’être confrontée à une situation stressante et non anticipée (comme la rupture du frein du
partenaire). Gabrielle évoque comment elle se sent lorsqu’elle vit de tels moments angoissants (même lorsque
ses craintes s’avèrent non fondées) :
60 Thompson (1990) avait d’ailleurs déjà remarqué que lorsque les jeunes filles de son étude ressentaient de la douleur
lors de leurs premières expériences sexuelles, elles avaient tendance à blâmer leur propre corps (leur pelvis trop petit,
par exemple) plutôt que leur partenaire ou le contexte de leurs expériences.
169
Moi, c'est tout ou rien. Alors si, à un moment donné, il me vient en tête une affaire, je fais :
« Oh my God. » Là, genre, je freak, je vais sur Internet, et là je check tout de suite. Que j’aie
un examen le lendemain, je m’en fous. Je check ça, et ça, c'est important. C'est l'affaire la
plus importante au monde présentement. Alors, je check ça, je check quelques sites parce
qu’au début, tu arrives sur des blogues, et là le monde met le pire [des symptômes ou des
détails], parce que quand ça va bien, tu ne vas pas poster un blogue, genre : « Ah, moi
j’écris telle affaire, mais ça va super bien. » Tu le mets juste si ça ne va pas bien. Alors là, je
check plusieurs affaires, et je tombe sur quelques sites qui sont plus, mettons, sérieux, tsé
des médecins qui écrivent sur un site. Après ça, c'est fini ma crise, c'est correct. J'ai comme
eu de l'information. Mais […] si, après plusieurs [sites], je ne trouve pas encore ce que je
veux, je finis par me dire : je ne trouverai pas; ce qu'on trouve, c'est toujours la même
information. Donc, je ne suis encore pas rassurée; je suis encore incertaine et inquiète.
(Gabrielle)
Les deux principaux cas où Gabrielle a utilisé le Web de cette façon un peu paniquée, c’est lorsqu’elle a vécu
une première infection urinaire et lorsqu’elle a cru avoir développé une ITSS :
Gabrielle : C'est sûr que là, les premières infections urinaires, c'était comme : au secours!
Après ça, il y a eu un truc un moment donné, c'était genre, dans le coin de ma bouche;
c'était vraiment vraiment sec, et je me demandais c'était quoi. Ça m'avait full inquiétée,
parce que tsé, le gars, je le trouvais pas super trustable; je me disais, ah, l'o***! Alors là, je
suis allée checker si ce n'était pas de l'herpès ou quelque chose de même. Finalement,
c'est parti et ce n’est jamais revenu, mais ça ne m'a pas plus rassurée d'aller voir sur
Internet, parce que j'essayais de voir quelque chose qui ressemblait à [ce que j’avais], et la
seule affaire que je trouvais, c'était les affaires les plus dégueulasses.
Intervieweuse : Donc t'aurais aimé avoir des cas d'herpès de base?
Gabrielle : Oui, genre, quand ça commence, pour savoir c’est quoi. J'avais juste les gros
cas extrêmes, genre : Check, tu vas devenir de même. Au secours!
Intervieweuse : Dirais-tu alors qu'Internet aide ou non?
Gabrielle : Il était plus nuisible sur ce sujet-là, parce que ça m'avait plus inquiétée, et parce
que je n'avais pas trouvé de réponse. Ça amplifie la peur, [parce que] tu n'es pas capable
finalement d'identifier pour toi, c'est quoi ta situation, alors tu ne peux pas te catégoriser là-
dedans. Alors tu es juste plus dans le néant encore, parce que tu as juste vu qu'il y a plus
d'affaires.
Une situation que Gabrielle estime être une des limites d’Internet :
170
Sur certains sujets trop précis ou trop personnels, des fois, tu ne peux pas trouver de
l'information précise, donc tu tombes seulement sur de l'information super vaste, c'est le
néant, et tu ne peux pas vraiment t'orienter. (Gabrielle)
La situation s’est représentée une fois après qu’elle eut rencontré le médecin pour la pose de son stérilet.
Choisir le stérilet comme mode de contraception se voulait pour elle un choix éclairé, et elle voulait être au
courant de toutes les conséquences possibles. Mais en regardant les symptômes sur Internet, elle est
devenue anxieuse :
On aurait dit que dans les deux jours qui ont suivi, [je paniquais]. Je me disais : Oh mon
Dieu, je peux avoir mal au coeur, Oh mon Dieu, je peux avoir telle affaire, alors là je me suis
mise à avoir mal au coeur, je me suis mise à avoir mal au ventre, je me suis mise à avoir
plein d'affaires. […] C'était juste vraiment dans ma tête. Je me suis dit : ça se peut que ça
ne me le fasse pas… (Gabrielle)
De façon semblable, Sabrina s’est inquiétée des conséquences de ne pas se faire vacciner pour le VPH après
que son médecin lui en ait parlé :
Intervieweuse : Tu as parlé du VPH sur ton blogue...
Sabrina : Oui. [Ma gynécologue m’a dit que j’étais] dans la période de gratuité pour le VPH
jusqu'au mois de septembre […] Ça m'a full inquiétée ! […] J’ai lu les papiers […] et
finalement je suis allée voir sur Internet combien le vaccin coûtait, c’était pour qui et où [il se
donnait], c’était pour quoi, [etc.].
Intervieweuse : Tu es allée voir sur Internet pour savoir?
Sabrina : Oui, oui, toutes les questions. […] Je suis allée voir sur Internet. […] J'ai checké
tout de suite après mon rendez-vous, et les médecins prennent ça à coeur, hein : « Là, il
faut que tu l'aies, le vaccin! » Eh oui, j'étais vraiment, genre : Ah mon Dieu, faut que je
[l’aie]! Mais finalement [ça va], et non, je n'ai pas eu le vaccin jusqu'à maintenant et je
survis.
Craintes de grossesse
De façon similaire, la crainte d’être enceinte, lorsqu’elle se présente, est également très intense. Toutefois,
contrairement par exemple aux « dysfonctions » dont on a parlé précédemment, la crainte de grossesse
n’entraîne pas l’impression d’être anormale. Lorsque les participantes concernées anticipent avec angoisse
les conséquences d’une possible grossesse, elles se servent d’Internet pour obtenir une multitude de détails
171
sur les symptômes. Toutefois, comme pour le VPH ou le stérilet, avoir accès à une liste importante (et parfois
contradictoire) de symptômes possibles peut augmenter leurs craintes plutôt que les apaiser :
Amélie : Ça m'est arrivé souvent d'avoir peur d'être enceinte. […] [Internet,] c'était pour me
rassurer de voir que je n'avais pas les symptômes.
Intervieweuse : Internet t'a-t-il rassurée?
Amélie : Non, des fois, il m'a fait avoir plus peur encore. La plupart des symptômes, je ne
les avais pas, [alors Internet] me rass[urait]... C'est juste que dès qu'il y en avait un : « Ah...
j'ai ça… » Mais tsé, il va y en avoir sept que tu n'as pas, mais juste le un [que tu as] qui te
fait peur. Dans le fond, j'aurais dû être rassurée, [mais] je suis trop une fille stressée.
Cette crainte de tomber enceinte est souvent si forte chez les participantes qu’elle se présente même au tout
début des expériences sexuelles. Heureusement, dans le cas de Maude, le fait d’avoir pu trouver un site fiable
sur l’utilisation de la pilule et les risques de grossesse a apaisé ses craintes et lui a permis de relativiser les
risques :
C'est environ vers l'âge de 15 ans que j'ai commencé à être active sexuellement. Mes
premières expériences n'étaient peut-être pas les meilleures, puisque j'avais très peur de
tomber enceinte même si je prenais la pilule contraceptive et que j'utilisais le condom. Un
jour, j'ai oublié de prendre ma pilule. Le soir suivant, j'ai eu une relation sexuelle. J'étais très
inquiète et angoissée par le fait que j'avais oublié un comprimé. Étant très gênée d’en parler
avec mes parents, je suis allée sur le site Internet de la pilule que je prenais et, à ma grande
surprise, j’ai trouvé une multitude de réponses à mes questions. Le site Internet
www.alesse.ca m’a été d’une aide importante durant mon adolescence lorsque j’avais des
craintes. (Maude)
Pour Roxanne, c’est le médecin qui lui a permis de calmer ses craintes. Elle raconte son histoire dans son
blogue :
Dans un article précédent, je vous avais mentionné que le jour où j'ai fait l'amour pour la
première fois ne fut pas sans péripéties. En plus d'être horriblement stressée, j'avais peur
d'avoir mal et de ne pas savoir ce que je faisais. Mais malgré cela, j'avais aussi
incroyablement hâte de vivre ce grand moment avec mon amoureux du temps, qui à cette
époque était pour moi l'homme de ma vie. Mes recherches avaient démontré que la pilule
prenait effet après une semaine, mais que pour être certaine qu'elle soit vraiment efficace,
une durée d’un mois était conseillée. Mais un mois, c'est long quand le désir se fait de plus
en plus fort. C'est pourquoi, une certaine nuit, les embrassades n'ont plus suffi. On s'est
laissé aller et on a enfin fait le « geste ultime ».
172
Par contre, puisque cela ne faisait pas encore un mois que je prenais la pilule, mon copain
et moi étions vraiment stressés et avons décidé de changer le condom plusieurs fois durant
l'acte. J'avais peur à chaque fois qu'il ne soit plus efficace ou qu'il se perce ou je ne sais
quoi... Le lendemain en revenant chez moi, je me suis mise à paniquer et à imaginer le
pire : et si j'étais enceinte malgré tout? J'avais utilisé un (plusieurs) condom(s), mais peut-
être que j'étais enceinte?! Je me suis mise à pleurer et j'ai téléphoné ma meilleure amie.
Ensemble, nous avons fait des recherches sur les probabilités de tomber enceinte, mais
pour être honnête, nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchions et les sites (à l'époque
du moins) n'étaient pas complets. Nous avons cherché une bonne heure pour nous
retrouver à notre point de départ. J'étais vraiment horrifiée et paniquée.
Puisqu’Internet ne fournissait pas la réponse désirée, j’ai dû voir mon médecin. Celle-ci a eu
l'air de trouver la situation comique (même si elle essayait de le cacher), et m’a prescrit la
pilule du lendemain (même si elle m’a précisé de nombreuses fois qu'elle était persuadée
du faible risque que je puisse être enceinte).
Aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je ne peux m'empêcher d'en rire! Mais je suis
tout de même déçue de n'avoir pas avoir pu trouver de réponses à ma question sur le Net.
(Roxanne)
Roxanne dira en entrevue que plus le temps passait, plus elle était convaincue d’être enceinte. Même si elle
estime maintenant qu’elle a « un peu paniqué pour rien », ses craintes étaient pourtant réelles. Elle aurait
alors souhaité à ce moment trouver un site qui puisse lui dire avec certitude : « Tu es enceinte » ou « Tu ne
l’es pas », même si elle est bien consciente que c’est impossible. Un souhait partagé par Océanne, qui avait
alors consulté plusieurs sites de discussions sur les symptômes de grossesse :
Océanne : J’étais vraiment stressée… [Je me disais] : non, je suis trop jeune pour avoir un
bébé! J'ai suis allée lire là-dessus, mais je ne sais pas si ça m'avait vraiment aidée. Je
n’avais pas vraiment d’information, tsé, ça disait [toujours] la même affaire. […]
Intervieweuse : Et Internet ne t'a pas aidée parce que ça ne disait pas : « Tu es enceinte. »
C’est ça?
Océanne : Oui, c’est ça que c’est! J'étais stressée…
Même si, comme Roxanne, Océanne prenait la pilule contraceptive et ne présentait aucun symptôme (elle
a été menstruée quelques jours après), ses craintes étaient très vives. Elles expriment alors le besoin de
pouvoir compter sur quelqu’un pour relativiser leurs craintes, mais, comme le décrit enfin Alicia, il n’est pas
toujours facile d’en parler à ses amies ou à ses parents :
173
Une des premières questions que je me suis posées sérieusement et sur lesquelles j'ai fait
de longues recherches est [la grossesse]. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai
tellement eu peur de tomber enceinte quand j'ai commencé à faire l'amour (vers 16 ans)
que j'ai cherché le maximum d'informations sur le sujet. Quels sont les symptômes?
Comment cela prend de temps avant de le savoir? etc. Je ne me voyais pas demander cela
à mes parents ou ma soeur et encore moins mes amies. Je ne sais pas, mais il y a un âge
où c'est gênant de parler de sexe, et ce, même avec ses amies! Internet est une issue
favorable!
Quand ma soeur est tombée enceinte l'an passé, j'ai été contente d'en savoir plus sur le
sujet et plusieurs des choses qu'elle me disait confirmaient mes lectures! (Alicia)
Parmi nos participantes, aucune n’a eu à chercher de l’information sur l’avortement pour elles-mêmes (lorsque
le thème s’est présenté dans l’étude, c’était pour une de leurs amies, alors l’inquiétude était relativement
faible). Cependant, si l’une d’elles avait eu à chercher de l’information sur le sujet pour elle-même, on peut
supposer que ce thème aurait fait partie de cette catégorie de craintes « centrales ». Ce pourrait être la même
chose pour une grossesse réelle (les participantes qui ont craint être enceintes ne l’étaient finalement pas).
Cette crainte de tomber enceinte est si répandue que d’autres participantes ont cherché activement sur la
grossesse, et ce, même sans vivre une situation où elles pourraient croire qu’elles sont enceintes. Les
participantes, en ce sens, démontrent clairement le besoin de s’informer sur les risques et les symptômes :
J'ai souvent cherché sur la grossesse aussi. Un sujet qui me préoccupe de plus en plus
depuis que j'ai un partenaire stable. Dans le sens où j'ai peur d'être enceinte! Je connais
une fille qui a eu un enfant et elle n’était pas au courant avant 27 semaines, car elle avait
encore ses règles et pas de symptômes! J'ai si peur que ça m'arrive! (Laurence)
La situation se présente de façon très semblable lorsqu’il est question des ITSS, même si cette crainte a été
moins fréquente (probablement en raison du fait que beaucoup de nos participantes ont un partenaire stable).
Par exemple, vers 16 ans, Laurie estime avoir développé cette crainte qui, sans savoir pourquoi,
« l’obsédait ».
Plusieurs exposants venaient dans nos classes pendant une heure, et disaient : « Faites
attention... vous pouvez attraper telle maladie. » Et en sciences, au secondaire, on faisait
des projets sur les maladies transmises sexuellement. On dirait que ça m'a tellement
accrochée, parce qu'ils en ont tellement parlé, que ça me faisait comme peur. […] On dirait
que ça m'obsédait, je ne sais pas pourquoi. Ils en parlaient tellement… […], on dirait que ça
m’a vraiment accrochée.
174
Elle allait alors consulter la liste des symptômes sur Internet, les conséquences, et le fait de chercher sur le
sujet augmentait son anxiété.
Laurie : Oui, on dirait que c'était pire.
Intervieweuse : OK, alors ça ne t'a pas aidée du tout.
Laurie : Ben pas vraiment, non. […] Tsé, je ne connaissais pas vraiment ça, et ça me faisait
peur. [Je me disais :] « Ah.... il me semble... je ne peux pas faire l’amour, parce que je ne
veux pas attraper ça. »
Discussion
On remarque que lorsqu’il est question de craintes vives mais passagères, Internet rend plus souvent
qu’autrement les participantes confuses : les éléments d’information qu’elles trouvent se contredisent souvent
et elles doivent souvent avoir recours à une source externe (par exemple un médecin) pour y voir plus clair.
Mais même le médecin peut participer à la confusion, en insistant, par exemple, sur le vaccin du VPH, comme
dans le cas de Sabrina. Le discours impératif du médecin est alors la source d’une nouvelle inquiétude : est-il
vrai qu’il est nécessaire d’être vacciné contre le VPH, se demande Sabrina, ou est-ce une autre norme
médicale à but strictement préventif que l’on essaie d’imposer aux filles? Pour mieux situer le discours du
médecin parmi les scénarios possibles, Sabrina a recours à Internet : elle consulte les sites des producteurs
du médicament, lit les dépliants fournis par le médecin en parallèle, s’informe sur les avantages du
médicament, ses inconvénients et ses coûts, et cherche, à partir de tout ça, à prendre une décision informée
avec laquelle elle est à l’aise. Le fait qu’elle dise « Je n’ai pas eu le vaccin jusqu’à maintenant et je survis »
montre qu’elle a réussi à déconstruire les différents discours sur le médicament et à relativiser les risques.
Mais toutes n’ont pas cette chance. Dans le cas de Gabrielle, qui cherchait des photos d’herpès « de base »,
Internet a « amplifié la peur ». C’est que les blogues et les forums qu’elle consulte, comme elle l’explique très
bien, sont habituellement alimentés par des gens qui ont vécu une expérience négative, et non des usagers
pour qui tout va bien. Et en ce qui concerne la grossesse, Internet ne peut tout simplement pas fournir de
réponse claire à la question : « Suis-je enceinte? » Comme il s’agit d’un sujet tabou, en particulier pour les très
jeunes filles, elles ont l’impression de ne pas pouvoir en parler à leur entourage. Elles se tournent alors vers
Internet, qui ne calme en rien leurs angoisses. Il s’agit donc pour elles d’une limite très claire d’Internet : celui-
ci permet de trouver des éléments de réponse, mais ne peut fournir avec certitude de réponse précise à leurs
questions en lien avec les infections ou la grossesse; elles doivent alors consulter leur médecin, ou attendre
que leur angoisse (qu’elles savent souvent démesurée) s’apaise d’elle-même.
175
5.1.6 Thèmes visant l’amélioration des relations de couple
Les recherches que font les participantes sur Internet ne découlent pas toutes d’une crainte un peu
« envahissante », mais parfois aussi d’un désir d’améliorer, par exemple, la communication dans leur couple,
ou de trouver les mots pour parler de sexualité à leur copain. À titre d’exemple, Rosalie a tapé « Comment se
sentir à l’aise dans une relation » directement dans un moteur de recherche Web, et Sabrina a tapé :
« Comment parler de sexualité » :
Ben c'était plus au début, tsé, je le connaissais, mais je ne savais pas s'il avait eu d'autres
blondes avant, alors tsé je lui en ai parlé, mais je ne savais pas comment lui en parler. J'ai
tapé [« comment parler de sexualité »] sur des sites, mais [c’était toujours] les mêmes
conseils : « Prenez votre temps, c'est important de communiquer, et toutes vos inquiétudes
c'est important que vous posiez des questions, inquiétez-vous pas, d'habitude, les gens
sont ouverts… » Alors [un] soir, on était couchés, mais pas encore endormis, j’ai commencé
à parler de plein d'affaires, et là j’ai dit : « Toi, as-tu eu d'autres blondes? » [et on s’est
parlé]. (Sabrina)
Noémie et Laurie ont également cherché sur la communication dans le couple. Noémie n’avait pas un but
particulier en tête lorsqu’elle a fait ses recherches :
Ce n'est pas tant moi qui me suis posé la question, ce sujet est venu à moi et je l'ai lu, et j'ai
trouvé ça intéressant. Justement, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise... ils n'en parlent
pas assez clairement parce que c'est un sujet délicat, on veut prendre trop des gants de
velours... Je trouvais ça intéressant, et je l'ai appris et justement quand je communique
avec mon copain par rapport à ça j'essaie de faire attention pour que justement ce soit clair
et qu'il n'y ait pas d'ambiguïtés. (Noémie)
Cependant, comme Laurie commençait à trouver qu’elle et son partenaire s’éloignaient (elle et son copain ont
d’ailleurs connu des conflits sur la question), ce thème l’a particulièrement intriguée. Elle s’est alors tournée
vers le site Web d’un magazine61 (axé sur la sexualité) pour comprendre les changements qui survenaient
dans sa relation :
J’ai récemment lu un article sur le site du magazine Cosmopolitan sur comment faire pour
que notre homme s’occupe de nous comme au début de notre relation. En fait, l’auteur
précise que rares sont les hommes qui continuent à nous porter des petites attentions
comme au début, car ils nous (femmes) ont déjà acquis sentimentalement. Bref, ils
61 Les sites Web de revues ont d’ailleurs été très populaires pour trouver de l’information sur les relations de couple :
Châtelaine Spécial St-Valentin, le site Web style revue de MSN, etc.
176
voulaient simplement nous impressionner au début de la relation. Cependant, nous pouvons
leur rappeler subtilement de nous faire des petites surprises, etc. Et s’ils font un petit geste
en retour, il faut s’assurer que l’homme a bien compris à quel point cela nous rend
heureuses. Mais il est important de ne pas brusquer notre homme par faute de le rendre
impatient et « écoeuré ». Je me retrouve très bien dans cette situation, car j’aimerais que
mon copain me porte plus de petites attentions, comme un massage, une petite surprise me
prouvant qu’il pense à moi. Je pense malgré moi que j’y suis allée un peu trop fort, car la
plupart des hommes sont comme cela. Malgré tout, je sais qu’il tient à moi et j’ai peut-être
trop réagi à ce sujet. (Laurie)
Les positions sexuelles : pour « casser la routine » et « mettre du piquant »
Si les recherches d’information sur la communication sont plutôt rares, un thème particulier revient très
souvent : celui des positions sexuelles. Ce thème presque toujours présenté par les participantes comme un
sujet ayant été cherché dans le but de « mettre du piquant » dans leur relation, une expression qui d’ailleurs
revient elle aussi très souvent :
Ça fait deux ans et demi que j'ai un amoureux […]. Après tout ce temps à faire l'amour avec
la même personne, ça devient un peu redondant! C'est pourquoi j'ai fait des recherches sur
de nouvelles positions sexuelles à adopter ou de nouveaux rituels à essayer pour briser la
routine. Quelques bons trucs sont mentionnés sur des forums ou des sites pour les
femmes... Parfois, il y a des petits schémas pour expliquer la position... Je suis tombée sur
beaucoup de sites en rapport avec la St-Valentin, puisqu'il semble que cette période de
l'année attire plus de gens pour ce sujet. (Sabrina)
Ce qu’il nous semble important de souligner, c’est que de prime abord, contrairement à ce qu’on pourrait
croire (ou à ce que les scripts sexuels pourraient nous laisser penser), les participantes semblent être
réellement les instigatrices de ces recherches : elles disent le faire ni particulièrement pour plaire à leur
copain, ni parce que celui-ci aurait tenté de les convaincre, mais plutôt principalement pour elles et pour le
« bien commun » du couple. Par exemple, Sabrina a même tenté de convaincre son copain d’essayer les
positions trouvées :
Intervieweuse : Comment ton chum a réagi quand tu lui as dit que tu avais lu ça?
Sabrina : [Il a dit] : « Ah, on n'a pas besoin de ça! Mais OK, on va essayer » et il
a embarqué. [En essayant,] il a dit : « Ben là, c’est pas faisable! » Et là finalement, ça a [fini
qu’on a fait l’amour] comme d'habitude, mais c’est juste drôle.
Même chose ici pour Laurie, qui visite fréquemment les sites montrant de nouvelles positions sexuelles :
177
Comme pour mon dernier texte publié, j’aborderai ici le site Cosmopolitan, car je navigue
souvent sur cette page. Je l’aime parce que bien sûr, il y a plusieurs articles sur le sexe,
sujet dont les filles adorent en savoir plus. Il y a même la position sexuelle du jour sur la
page d’accueil. Des fois, lorsque je me sens inspirée et que la position m’excite, j’essaie de
la réaliser avec mon copain. Évidemment, il ne sait pas que j’ai vu ça sur Internet. Je lui dis
simplement que ça me vient à l’esprit comme ça. Cependant, quelques fois, je dois lui
avouer que j’ai trouvé l’idée sur Internet. De plus, il y a une section sur la mode, la beauté,
les jeux-questionnaires et les conseils. Donc, je peux retrouver de tout sur ce site Internet.
(Laurie)
Mia et Océanne, par exemple, un peu lassées par les positions toujours adoptées par le couple, prennent
elles-mêmes la décision de s’informer sur les alternatives possibles :
Où je veux en venir, c'est que je trouvais que moi et mon chum on prenait toujours les
mêmes positions, donc je me suis dit que ça pourrait me donner des idées. (Mia)
Il manquait de piquant de ma relation sexuelle avec mon ex et j’étais tannée de toujours
faire l’amour dans les mêmes positions. Je suis allée voir sur Google, j’ai trouvé un
excellent site avec des images et des descriptions. Il décrivait comment s’y prendre dans
cette telle position et l’avantage qu’elle avait pour la femme, puis pour l’homme; le plaisir
qu’elle procurait à chacun d’eux. C’était vraiment intéressant. J’en ai essayé quelques-unes
et le site était vraiment complet. Il avait raison. (Océanne)
Même Mégane et Florence, qui n’ont pas encore de partenaire sexuel, désirent en apprendre plus sur les
positions sexuelles. Elles gardent alors « en tête » les informations trouvées et estiment que celles-ci leur
seront être utiles « plus tard » :
Intervieweuse : Est-ce que c'est aussi une façon d'apprendre pour toi? De voir comment ça
se fait?
Mégane : Oui, j'avoue. C’est plus aussi une façon de… tsé, oui, je regarde et tout. Ce que
j'ai tendance à faire : je suis là, je regarde, et je vais genre taper « la position du
missionnaire », pour voir un peu toutes les informations. On dit : « C'est plus stimulant pour
la femme » ou non... Il y a des variantes, des choses comme ça. Ça, je le fais. (Mégane)
-
Le lien que je viens d'envoyer, c'est une amie qui savait que je faisais ce blogue qui me l’a
suggéré. Je l’ai trouvé très intéressant et pertinent, car il nous informait de plusieurs
positions sexuelles ainsi que de leurs avantages et désavantages. De plus, il donnait des
conseils pour l'homme ou pour la femme. Je ne pense pas y retourner pour l'instant, mais
peut-être plus tard, lorsque j'aurais des relations sexuelles et un chum. (Florence)
178
De façon semblable, même avant d’être active sexuellement, Audrey était fascinée par les différentes
positions :
Comme à peu près tout le monde (j’en suis sûre :P), vers l’âge de treize ans, je me suis
intéressée aux fameuses positions! J’ai été dépassée par la quantité et la variété, mais je
tiens surtout à préciser que l’information fournie avec les schémas est bien plus que
simplement satisfaisante! (Audrey)
D’autres participantes ont fait cette recherche à deux, comme Roxanne ou Marie-Pier. C’est avec leur copain
qu’elles ont choisi de faire ces recherches :
On avait parlé [du Kamasutra], et je me demandais c'était quoi, alors j’avais cherché là-
dessus. Et souvent avec ton partenaire tu cherches à renouveler, pas tout le temps la
même position, alors on cherchait des idées. Pour mettre du piquant un peu. (à 17 ans)
(Roxanne)
-
Eh oui, premier blogue! J'ai longtemps hésité sur le sujet de celui-ci, mais bon, voilà ce que
ça donne...
Missionnaire, 69, « doggy style »... il y en a tellement qu'on ne sait plus trop quoi en penser.
Mais avouons qu'on ne reste pas indifférent à cet univers si intrigant.
C'est pourquoi, un soir, il n’y a pas si longtemps, mon partenaire actuel et moi avons décidé
de briser la routine et d'aller sur le Web chercher des positions sexuelles qui pourraient
mettre un peu de piquant dans le lit.
J'ai été surprise de voir à quel point les sites concernant ce sujet on été nombreux
à apparaître à mon écran. Après en avoir regardé quelques-uns, nous avons arrêté notre
choix sur le site proposé en lien : http://education.sexuelle.free.fr/les-positions-p1.php.
Pourquoi ce site? Parce que comme nous voulions quelque chose de rapide, ce site était
parfait. Très simple, allant droit au but et en plus d'avoir des images qui nous montrent plus
concrètement la chose, il y a une petite description de la position ainsi que les points positifs
de celle-ci.
En somme, je dirais que oui, ce site nous a aidés, mais il faut quand même avouer que
nous avons tous un corps différent et que certaines positions ne sont pas faites pour
certaines personnes. (Marie-Pier)
179
Cependant, certaines participantes estiment que ces « trucs » glanés sur le Web ne leur semblent pas
toujours intéressants ou même pertinents; elles s’en désintéressent alors et prennent conscience de leurs
« limites ». Noémie explique ici les siennes :
J'ai déjà fait des recherches Internet [sur le site Web masanté.ca] dans le but d'avoir des
trucs pour stimuler davantage mes relations sexuelles. J'ai lu qu'ils conseillaient d'avoir un
glaçon dans la bouche lorsque l'on fait une fellation, d'insérer un doigt dans l'anus de
l'homme avant qu'il jouisse. Je n'ai toutefois pas essayé ces « trucs ». Par lâcheté pour le
glaçon, et pour le doigt… je n'en ai pas vraiment envie et je crois que mon copain non plus.
(Noémie)
Juliette également :
Intervieweuse : Tu dis avoir cherché des « positions sexuelles qui sortent de l'ordinaire ».
Dans quel contexte as-tu voulu chercher ça?
Juliette : Plaisir. Par curiosité totalement. Pourquoi ça m'est venu en tête, je ne le sais pas,
mais j’ai cherché ça, peut-être pour donner des idées aussi. Pour alimenter un peu la vie
sexuelle, mais encore là, ce sont toutes des choses que je me suis dit : « Ah, OK, ouais,
non. » Ce n'est pas venu me rejoindre, moi je ne me suis pas [vue] là-dedans.
Intervieweuse : Ça n'a pas fait l'affaire?
Juliette : Non, ça n'a pas fait mon affaire. Mais je me suis dit : peut-être que je vais pouvoir
trouver quelque chose d'intéressant là-dedans pour pimenter un peu, et finalement, [je me
suis dit :] « OK, non ».
Intervieweuse : Il n'y en a pas une que tu es allée voir avec ton chum....
Juliette : Non, non. Je n'ai pas été capable de me voir là-dedans. Je me suis dit : « Ah non.
Non. Ce n’est pas pour moi, ce n’est pas mon genre. »
Pour plusieurs, la limite, c’est le sexe anal :
Intervieweuse : Concernant la pénétration anale, tu t’es dite « curieuse », « dégoûtée », et
« perplexe ». […]
Alexandra : […] [Je me suis demandé] : « Est-ce que mes amis font ça? » Ils n’en parlent
pas nécessairement, mais tsé...
Intervieweuse : Alors, c'est plus pour savoir si les autres en font?
180
Alexandra : Et comment ça se passe aussi, s'ils en font. Ça confirme que je ne veux pas
faire ça non plus. [rires]
Gabrielle a aussi déjà cherché sur les relations anales, et elle aussi s’en est dit « dégoûtée » :
Gabrielle : [J’ai cherché] des photos, des vidéos [sur le sujet].
Intervieweuse : Est-ce que c'est un de tes copains qui t’a dit : « J’aimerais ça essayer... »
Gabrielle : Non, c'était encore une fois ma curiosité de regarder tout ce qui passe... tout ce
qui concerne le sexe. Et en regardant ça, j’ai fait comme : « Non, ça ne me tente pas. » Ça
ne me tente toujours pas, et mon chum aimerait qu'on essaie, mais non, ça... ce n'est pas
quelque chose qui... [m’attire]. J'ai dit non, et il me respecte.
Même chose pour Roxanne. Elle exprime ici ses limites concernant les relations anales, le masochisme et
l’échangisme :
Parce que moi, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait nécessairement, mais j’avais
des amies qui faisaient ça avec leur chum. Je ne savais pas trop... […] Je voulais plus
savoir ce que c'était exactement. Et c'est plus tabou aussi on dirait, alors je me disais :
« Bon, je vais vérifier c’est quoi exactement. » […] Je n'étais pas tellement attirée par ça,
mais je voulais juste savoir comment les gens s'y prenaient et comment ça fonctionnait.
(Roxanne)
Par exemple, sur le masochisme, elle dit :
…j'ai trouvé cela enrichissant d'en apprendre davantage sur le sujet. Même si en faisant la
recherche j'ai confirmé que cette pratique ne m'attire pas, je trouve cela intéressant de
m'informer sur ce qui se fait chez certaines personnes ou certains couples. (Roxanne)
Leurs raisons pour effectuer des recherches dans le but de s’informer de pratiques qui constituent pourtant
leurs « limites » rejoignent alors le discours qu’elles tenaient concernant la curiosité qu’elles ont éprouvée,
plus jeunes, concernant certains mots ou certaines pratiques. Comme le disait Marianne à ce sujet :
En gros, lorsque vous avez 10 ans, des termes comme ceux-là montent votre taux de
curiosité. J'ai donc à 10 ans appris ce qu'était la sodomie, le cunnilingus, etc. […] En gros,
je ne regrette pas vraiment ma curiosité de l'époque, puisque, en un sens, c'est ce qui m’a
vraiment ouvert les yeux sur la sexualité. (Marianne)
181
Sensualité
Si beaucoup de participantes ont parlé de « mettre du piquant » dans leur couple, peu d’entre elles ont évoqué
directement la sensualité, même si certaines ont mentionné préférer l’intimité à la sexualité pénétrative.
Toutefois, quelques participantes ont accompagné leur blogue de photos qu’elles trouvaient belles et qu’elles
décrivaient comme « sensuelles »62. Maëlie, par exemple, a choisi d’illustrer son blogue de photos où, écrit-
elle, la sexualité y est suggérée plutôt que démontrée. Elle explique ici son choix :
C'est une photo qui en dit long! Je trouve que c'est un bel exemple que ce qu'est la
sensualité. Sur le Web, on entend souvent que les gens regardent des photos « pornos »,
mais on peut aussi trouver de BELLES photos qui ne sont pas trop osées. […] Même en ne
dévoilant rien de trop, il est possible d'avoir une photo magnifique qui en dit long sur ce
qu'elle est. […] [On peut trouver sur le Net des] photos et [des] images qui peuvent
représenter l'amour, la sexualité, la sensualité, etc. [J’en joins ici] quelques-unes qui m'ont
fait réfléchir, que je trouve belles ou qui valent tout simplement la peine d'être vues. (Maëlie)
Maëlie est d’abord tombée par hasard sur des photos de ce type alors qu’elle cherchait d’autres termes, mais
elle trouvait intéressant de montrer cette version de la sexualité :
Je les trouvais quand même belles, et je me dis que, justement, tsé on ne voit pas toute la
personne nue, ça en dit quand même long [et ça montre] que le mot est quand même
associé à la sexualité. Et [ça montre] un couple, si on veut; un gars et une fille, deux
personnes. (Maëlie)
Dans le blogue, quelques participantes ont mentionné aimer les actes plus sensuels, comme Camille :
Je m'intéresse non seulement à la sexualité génitale, mais aussi, et surtout, à la sexualité
qui « entoure » la première évoquée. Autrement dit, tout ce qui a trait à la relation entre
deux personnes avant d'en arriver à « l'acte ». (Camille)
Quelques-unes ont parlé également de la « magie de faire l’amour » (Sarah).
En entrevue, même si la question de la sensualité a été en général peu discutée, Juliette en
a exceptionnellement beaucoup parlé. Elle a particulièrement discuté des émotions qu’elle ressent lorsqu’elle
fait l’amour avec son copain; émotions dont elle ne soupçonnait pas l’existence avant ses premières
62 Il est important de souligner que les participantes n’ont pas toutes inclus des photos dans leur blogue. Celles qui l’ont
fait ont généralement ajouté des photos à titre illustratif seulement (par exemple, la photo du Dico des filles lorsqu’il était
question du Dico des filles ou encore une capture d’écran des sites consultés). De plus, même si elles en avaient
l’occasion, aucune n’a utilisé la fonction audio du blogue.
182
expériences. Elle a raconté qu’entre 13 et 17 ans, en voyant des images à la télé, dans un film ou sur Internet,
elle s’était fait une « idée » de ce qu’était la sexualité, mais qu’avec le temps et les expériences, elle s’est
rendu compte que ces idées étaient « fausses ». Surtout, qu’elles étaient partielles :
Juliette : …Ce n'est évidemment pas pareil. Sur Internet, tu n'as pas les sentiments, les
émotions que ça peut faire ou peu importe […].
Intervieweuse : Une fois active sexuellement, qu'est-ce qui t’a surpris?
Juliette : Le côté amour, le côté émotion, justement, ça m'a surprise [de voir] que c'était...
[aussi présent]. Tsé, quand les parents disent : « Ah, quand un homme et une femme
s'aiment, ils se le montrent de façon différente », bien c'est ça que j'ai trouvé; que c'est les
émotions, en gros, [qui rendent la sexualité spéciale]. Ça n’avait rien à voir avec ce que
j'avais vu, ça a changé complètement l’opinion que je m'étais faite il y a peut-être 3 ou 4
ans. Je me suis dit : « Oh mon Dieu... »
Intervieweuse : Qu'est-ce qui était différent? C'était plus fort?
Juliette : […] Bien oui, parce que quand tu ne l’as jamais fait, tu n'as pas d'émotion face
à ça […]. Moi, j’avais l'idée que c'était du plaisir, c'était une « activité », quasiment, si on
veut. [Quelque chose de] fun. Mais ce n'est pas juste ça, c'est montrer à quelqu’un que tu
es bien avec, que tu veux continuer avec, que tu l'aimes, que tu l'apprécies... […] Ce qui
m'a surprise, [la première fois], c'est que c'est tellement venu naturellement, avec ce gars-
là, tout s'est fait naturellement, la rencontre, on s’est parlé, les premiers petits pas…
« Naturellement », c'est le seul mot qui me vient en tête. Ça s'est passé sans que je me
dise : « Oh, mon Dieu, on va faire l’amour. » Ça s'est fait comme tout seul […].
Juliette s’est dite « déçue » des sites de positions sexuelles, car elle les a consultés avant d’être active
sexuellement et donc avant d’avoir une idée de la sexualité qui inclut les sentiments et les émotions.
Cependant, elle apprécie grandement les forums et les blogues sur la sexualité, particulièrement celui de
Mélodie Nelson :
Elle raconte, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais elle raconte des histoires, parfois
à caractère sexuel, parfois non, de sa vie. C'est un blogue qu’elle tient chaque semaine [et
que je consulte] deux ou trois fois par semaine. (Juliette)
Un site qu’elle trouve divertissant et qu’elle consulte « pour le plaisir, sans avoir de questions ». Mais même si
elle n’a jamais trop cherché sur Internet à propos des positions sexuelles, cela n’exclut pas que, comme
beaucoup d’autres, elle aurait souhaité « mettre du piquant » dans sa vie sexuelle en changeant un peu la
routine. Seulement, elle n’arrivait que difficilement à le dire à son copain :
183
Intervieweuse : Y a-t-il quelque chose que tu aurais voulu dire à ton copain, mais que tu
n'as pas osé?
Juliette : Oui. Par exemple, diversifier nos positions sexuelles. Souvent, j'avais en tête...
Tsé, je n’ai jamais eu le goût de dire : « Ah, est-ce qu’on peut faire quelque chose de
différent? », mais je ne le lui disais pas parce que je me disais : « Bien, c'est correct comme
ça aussi ». Je ne considérais pas ça important, mais dans ma tête, parfois, je me disais
« Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire changement, là », mais je ne l'ai jamais... [dit]. Je sais
qu'il aurait dit : « Bien quoi, qu'est-ce qu'on fait? Trouve-la, l'idée. » Alors là, [j’aurais été
comme :] « Oups, qu’est-ce qu'on fait? »
Intervieweuse : Te sentais-tu mal par rapport au fait de ne pas être capable de le lui dire?
Juliette : Oui, un peu. Je me disais : « Mon Dieu, tu devrais être capable de le [dire], peu
importe la façon, en joke ou peu importe. » Oui, un peu mal. Je me disais : « Peut-être qu'il
perçoit que je suis comme blasée, et là moi, je ne lui dis pas pourquoi. » Oui, un peu de
malaise. Je ne me sentais pas hypocrite, mais je... Je ne sais pas si tu comprends... Un
petit malaise de cacher ça, que moi, j'étais tannée, et que je ne le disais pas, peut-être. Un
petit malaise.
Discussion
On remarque d’abord ici que les participantes, qu’elles en parlent ou non à leur copain, désirent injecter du
changement dans leur routine sexuelle. Contrairement à l’échange sur la sensualité, peu présent, les
participantes parlent amplement de « piquant » et de nouveauté en matière de sexualité. Un désir qui,
à première vue, semble venir d’elles, puisqu’elles s’ennuient et puisque ce sont généralement elles qui
proposent de nouvelles positions à leur partenaire. Toutefois, selon Rosalind Gill, l’expression de ce désir de
nouveauté serait aussi l’effet d’une nouvelle « norme » de variété imposée entre autres par les magazines.
Dans son étude de 2010, Gill a analysé le discours du magazine Glamour sur la sexualité et sur les relations
de couple, un magazine très semblable au Cosmopolitan que Laurie cite, puisque la sexualité y occupe dans
les deux cas une place très importante, en couverture (comme axe de vente) et en contenu. Selon Gill (2010),
de tels magazines utilisent trois types de « répertoires » discursifs en matière de sexualité : le répertoire de la
femme « entrepreneure sexuelle » (intimate entrepreneur), axé sur les stratégies et les « trucs » pour attirer et
garder un homme; celui de la « men-ology », destiné à « étudier » et à comprendre les hommes; et enfin celui
de la transformation de soi (transformation of the self), qui pousse les femmes à se réinventer constamment,
dans leur corps et leurs pratiques sexuelles (p. 351).
Dans le premier répertoire, les relations de couple sont conçues comme un domaine exigeant un travail
constant; les émotions n’y occupent qu’une place mineure, alors que la stratégie, l’élaboration de buts (trouver
184
un homme, se marier, etc.) et la quête constante d’un partenaire y sont centrales. Les femmes sont alors
conçues comme agentiques, en contrôle de leur vie et autonomes (p. 351-354).
Dans le second répertoire, on « enseigne » aux femmes ce que les hommes « aiment ». À l’inverse du premier
répertoire, les femmes sont ici conçues comme étant incertaines d’elles-mêmes, naïves et vulnérables; on les
traite comme si elles étaient en constant besoin d’instructions pour plaire aux hommes, les rencontrer, leur
parler et les maintenir intéressés. Pour les aider à y parvenir, on leur propose un discours « d’experts »,
provenant de chroniqueurs « sexe » ou même d’hommes rencontrés dans la rue, qui enseigne par exemple ce
qui est « hot » et ce qui ne l’est pas en matière de sexualité, quels compliments adresser aux hommes et
même comment se comporter devant eux. On incite donc les femmes à se comporter comme de parfaites
partenaires potentielles, et ce, d’une façon qui essentialise les différences sexuelles et qui décrit les femmes
comme les hommes de manière monolithique et stéréotypée (p. 354-357).
Dans ce répertoire, l’accent est également porté sur le travail de soi : les femmes sont en quelque sorte
tenues « responsables » du fonctionnement de la relation ou de la réussite de la rencontre. Par contre, précise
Gill, « …the emphasis is not on women’s satisfaction (except in so far as this may help with "getting the guy")
but on men’s: the man must feel affirmed, understood, complimented and reassured that you find him
attractive and would like to see him again » (p. 355).
Enfin, le dernier répertoire exhorterait les femmes à changer les perceptions qu’elles ont de leur corps et de la
sexualité de façon à obéir à une injonction nouvelle : elles doivent aimer le sexe, vivre une vie sexuelle
épanouie, aimer leur corps, être confiantes et « explorer » les limites de leur sexualité. Ici, le travail n’est pas
seulement sur les comportements ou la relation, mais sur soi, et plus encore sur les perceptions de soi, le
prérequis étant de se sentir « empowered » (p. 357-361).
Ultimement, estime Gill, dans les trois répertoires, le message est le même : « "push yourself", "do something
new", "spice up" sex » (p. 361). La norme de variété et d’expérimentation est alors présentée comme un
travail sur soi et pour soi; bref comme un choix personnel effectué dans son propre intérêt. Comment, dans ce
contexte, peut-on alors distinguer les choix réellement « authentiques »63 que feraient les filles en matière de
sexualité, et ceux qui seraient effectués sous l’impulsion de cette nouvelle norme décrite par Gill? Il est
possible, en effet, que les recherches menées par les participantes sur les positions sexuelles soient le reflet
cette nouvelle injonction de variété dans la vie sexuelle, mais de comprendre le désir de variété des filles sous
cet angle seul nous semble réducteur.
63 Nous maintenons toutefois que les choix, tout comme l’expression de l’agentivité sexuelle en général, ne sont jamais
effectués dans un contexte libre à 100 %, mais sont opérés et construits à l’intérieur des structures sociales en place.
185
La capacité des récepteurs de détourner les contenus et de faire des lectures négociées, voire opposées, des
productions médiatiques est depuis longtemps connue dans les études en communication (voir par exemple
les textes de Stuart Hall : 1973, Janice Radway : 1984, Ien Ang : 1985, bell hooks : 1990 et David Morley :
1992). Nous avons d’ailleurs nous-même montré, en 2009, que les jeunes lectrices de magazines féminins
sont capables de se montrer très critiques des discours trouvés dans les magazines64.
Comment comprendre alors les choix des filles d’une façon qui ne minimise pas leur capacité de réflexion
critique et de distanciation médiatique tout en n’ignorant pas le contexte social et médiatique dans lequel
s’opèrent ces choix? Comme l’expriment McClelland et Fine (2008) :
…how do we read these performances of desire by young women, even as we recognize
that sales, as well as heteronormativity, racism, and male gaze, are central to these scripts?
How are young women engaging dominant scripts? To what extent are they resisting and
internalizing them […]? (p. 235)
Selon Harvey et Gill (2011), pour comprendre ces choix et ces comportements, il importe de complexifier la
question du désir féminin en l’extrayant des oppositions binaires qui l’encombrent. Le fait de montrer comment
les sujets « deviennent » des idéaux normés à travers les discours et les images ne constituerait pas, selon
elles, un déni de leur agentivité, mais plutôt ouvre la voie à une compréhension des actions où les oppositions
traditionnelles (sujet – objet, pouvoir – plaisir, discipline – agentivité) ne sont plus posées comme des
oppositions antithétiques et binaires :
To argue this [le fait que les femmes doivent répondre à une injonction de variété et
d’expérimentation], is not to suggest a process of imposition, domination or false
consciousness. Nor is it to deny the agency and creativity of those who may take up or
choose to inhabit this "new femininity". Nor is it to doubt the pleasures which that may
involve. (Harvey et Gill : 2011)
Elles citent alors Coleman (2008), pour souligner l’importance de considérer « l’effet » des images sur les
comportements des filles, particulièrement dans les études féministes :
64 Ce qui n’empêche pas qu’elles puissent, en certaines occasions, faire une lecture dominante des textes, comme le
montre ici Laurie, que nous citons plus haut. En acceptant le discours du magazine Cosmopolitan selon lequel « les
hommes sont comme ça » sans en critiquer l’aspect sexiste et stéréotypé, Laurie fait manifestement une lecture
dominante des différences hommes-femmes décrites par le magazine. On va voir toutefois un peu plus loin que Laurie
demeure capable de critiquer d’autres types de discours, notamment en ce qui concerne la pornographie.
186
As Coleman [2008] notes, "if feminist research take seriously this conception of bodies as
becoming, its task is to account for how bodies become through their relation with images;
what becomings of bodies do images limit or extend?" (2008 : 163) (Harvey et Gill : 2011)
Selon ces auteures, la profusion des images somme toute très semblables (et phallocentrées) que l’on trouve
sur Internet et dans les médias ciblant les femmes « créent » en quelque sorte la « réalité », la « norme » pour
les femmes, et limitent ainsi les possibilités d’agir. Mais de la même façon que l’on ne peut considérer comme
absolument et entièrement « authentiques » les choix effectués à l’intérieur de structures sociales
particulières, l’on ne peut pour autant délégitimer le désir sexuel des filles sous prétexte que ce « désir »
semble être imposé par les médias ou être régulé par les normes sociales qu’ils véhiculent. L’important n’est
donc pas de trancher quant à « l’authenticité » des désirs des femmes, mais plutôt de montrer que certains
désirs peuvent être encouragés par certains discours médiatiques, et de déconstruire ces discours.
Empiriquement, il s’agit également de comprendre ce que disent les femmes et les filles d’une façon qui ne
délégitime par leur discours et qui évite de les traiter comme des sujets peu aptes à comprendre leurs propres
sentiments et leurs propres requêtes – et qui n’exclut pas la reconnaissance de leur agentivité. Bryant et
Schofield (2007) écrivent d’ailleurs que si les pratiques des filles sont socialement situées, et que si les
discours sociaux jouent un rôle symbolique important dans la construction de ces pratiques, « it d[oes] not
wholly determine their sexual practices » (p. 324 et 322) – rappelons-nous l’importante « dualité du structurel »
décrite par Giddens (2005 [1984]) et le souhait de Duits et van Zoonen (2007) de faire confiance au discours
des filles.
Malgré la très grande quantité de sites proposant des positions qu’a constatée Marie-Pier et malgré le désir
évident de trouver des informations en sens de plusieurs participantes, la négociation des contenus et
l’opposition n’en sont pas moins présentes. Par exemple, Juliette note que de tels sites « ne sont pas pour
elle », et plusieurs participantes ont parlé de leurs « limites » en matière d’expérimentation, ce qui témoigne de
leur « lutte » contre les discours dominants issus des certains sites Web. Ce que l’on constate également du
discours de nos participantes, ce n’est ni qu’elles se sentent « obligées » de performer différents actes
sexuels, ni qu’elles ressentent une pression sociale pour plaire à leur partenaire, mais qu’au contraire, elles
s’ennuient. Océanne, par exemple, se dit « tannée de toujours faire l’amour dans les mêmes positions » et
Sabrina trouve sa sexualité « redondante ». Aucune d’entre elles n’a parlé du fait qu’il puisse être
« important » pour son partenaire que la sexualité soit variée, et qu’ainsi il « faudrait » qu’elles essaient de
nouvelles positions, pour lui ou parce qu’il « faut » expérimenter sexuellement. Cette pression nous a semblé
totalement absente. Elles semblent plutôt chercher à vivre une sexualité qui leur semble satisfaisante.
S’il semble si difficile d’admettre que les femmes et les filles puissent exprimer du désir et agir sur ce désir,
c’est en partie en raison de l’ambivalence sociale envers le désir féminin : comme le mentionnait Fine (1988)
et plus récemment Hasinoff (2010), le désir des femmes et des filles est trop souvent ignoré, délégitimé et
187
discrédité dans les discours médiatiques et scolaires, et ce, de multiples façons. Et comme le mentionne aussi
Gill (2008b), les études sur la sexualité accordent souvent trop peu d’importance aux raisons qui poussent les
filles à s’engager dans une activité sexuelle alors qu’elles mettent simultanément l’accent sur la pression
qu’elles peuvent ressentir de la part des hommes et de leurs amis (p. 37). Une injustice qui témoigne d’une
tendance générale à concevoir la sexualité féminine comme un « projet » où les filles seraient plus
préoccupées par le fait d’être désirables que par leurs propres désirs et sentiments (p. 37, citant Tolman :
2002).
Paradoxalement, dans les représentations publicitaires, le désir sexuel des femmes est montré et accentué,
mais dans ce cas, non pas dans leur propre intérêt (pour qu’elles puissent, par exemple, s’approprier leur
désir), mais plutôt pour faire vendre des produits et pour servir le désir masculin :
…rather than being repressed, sex has become "the big story" (Plummer, 1995) and female
sexual desire plays a large part in it. Discourses of women’s desire, far from being silenced,
seem to be everywhere: in magazines promising better, hotter sex, in the proliferation of
self-help guides and memoirs […]; in the figures of raunchy female pop stars who borrow
from the codes of pornography in their self-presentation, […] and at the heart of celebrity
culture in which tales of sexy secrets and "filthy" fantasies are everywhere. Advertising,
then, is one of a number of sites in which sexualized representations of (young) women are
ubiquitous. (Gill : 2008b, p. 39; voir aussi Fine et McClelland : 2006, p. 300)
Cette « matérialisation » et cette reconstruction du désir et de l’agentivité sexuels féminins dans la publicité et
dans certains médias auraient pour conséquence, selon Gill, de mener à la « régulation » du désir des
femmes, et donc contribueraient à masquer les contraintes sociales qu’elles subissent et à instaurer de
nouvelles normes d’agentivité sexuelle (compulsory sexual agency) (2008b, p. 40) :
One of the most significant shifts in advertising in the last decade or more has been the
construction of a new figure: a young, attractive, heterosexual woman who knowingly and
deliberately plays with her sexual power and is always "up for it" (that is, sex). (2008b, p. 41;
voir aussi Guillebaud : 1998, p. 108-109)
Si ce changement en publicité apparaît évident, ce qu’on constate dans le discours de nos participantes ne
correspond pas à cette figure de la sexualité féminine que Gill a nommée de façon flamboyante « the
midriffs » (« midriff » signifiant « abdomen » ou « ventre », l’expression faisant référence aux femmes
montrant leur ventre dans la pub). Les participantes expriment un désir qui correspond peu aux
représentations publicitaires décrites par Gill. Si elles cherchent de la variété et veulent expérimenter, elles
s’interrogent aussi sur leurs limites; si elles cherchent à changer leur routine sexuelle, cela ne semble pas être
188
dans le but « d’impressionner » leur(s) partenaire(s) par leurs prouesses, mais dans le but « d’enrichir » leur
sexualité et de vivre celle-ci de façon plus satisfaisante. Même si ce désir apparaît « englué » dans le cadre
social où sont prescrites des normes de variété et de performance, il n’en est pas moins réel, et on devrait
pouvoir le reconnaître.
Le danger avec la description de Gill (2008b et 2010), comme on l’a vu en introduction, c’est qu’elle semble
prendre les représentations de la sexualité féminine comme une « preuve » des normes et des contraintes
sociales dont les filles ne pourraient échapper. Certes, l’agentivité sexuelle des filles, comme on l’a vu, est
socialement située, et ce cadre social contraint très certainement leur agentivité, mais il permet aussi d’agir
contre les contraintes, de les transgresser ou d’agir autrement : c’est ce que permet justement de mettre en
évidence le concept d’agentivité. Si, comme nous l’avons vu précédemment, les participantes ont exprimé
ressentir les pressions de la norme (elles veulent être « normales »), elles ne souhaitent pas toutes
nécessairement s’y conformer, et certaines rejettent très clairement des contenus qui ne leur conviennent pas.
Les actions sociales des filles ne sont donc pas condamnées en tous points par ces structures – ni par les
prétendus « effets » des médias auxquels Gill semble donner beaucoup d’importance.
Comme le précise Foucault (1994 [1976]) :
Ce qui se dit sur le sexe ne doit pas être analysé comme la simple surface de projection
[des] mécanismes de pouvoir. C’est bien dans le discours que pouvoir et savoir viennent
s’articuler. Et pour cette raison même, il faut concevoir le discours comme une série de
segments discontinus, dont la fonction tactique n’est ni uniforme ni stable. Plus
précisément, il ne faut pas imaginer un monde du discours partagé entre le discours reçu et
le discours exclu ou entre le discours dominant et celui qui est dominé; mais comme une
multiplicité d’éléments discursifs qui peuvent jouer dans des stratégies diverses. C’est cette
distribution qu’il faut restituer, avec ce qu’elle comporte de choses dites et de choses
cachées […]. Il faut admettre un jeu complexe et instable où le discours peut être à la fois
instrument et effet de pouvoir, mais aussi obstacle, butée, point de résistance et départ
pour une stratégie opposée. (p. 132-133)
Ariel Levy, dans son essai sur ce qu’elle appelle la « raunch culture » (en traduction littérale : « culture
grossière »), écrit :
Raunch culture is not essentially progressive, it is essentially commercial. […] Raunch
culture isn’t about opening our minds to the possibilities and mysteries of sexuality. It’s
about endlessly reiterating one particular – and particularly commercial – shorthand for
sexiness. (p. 29-30).
189
Cette réflexion nous pousse à constater que si la sexualité plus « authentique » (bien que nous ayons vu
qu’une sexualité parfaitement authentique n’existe pas) se manifeste par une ouverture aux possibilités et aux
mystères de la sexualité, alors c’est exactement ce que font les filles de notre étude. Ainsi, si nous sommes
d’accord avec la description de Levy de la culture publicitaire (qui fait une caricature très stéréotypée de la
sexualité), nos résultats permettent de nuancer les « effets » de cette culture, car si nos participantes en
manifestent certains éléments, elles sont loin d’être caricaturales.
Cette « ouverture aux possibilités », les participantes la manifestent de plusieurs façons. Par exemple,
Roxanne explique qu’elle et son copain cherchent à vivre une sexualité « qui se veut saine et enrichissante »,
et que c’est la raison pour laquelle ils ont cherché ensemble de nouvelles positions sexuelles sur le Web. De
façon semblable, Sabrina a expliqué que pour elle, le fait d’essayer de nouvelles positions constituait d’abord
un jeu. Lorsqu’elle et son copain se sont rendu compte que certaines positions étaient trop difficiles
à dupliquer, celui-ci s’est exclamé « Ben là, c’est pas faisable! ». Sabrina a alors précisé en riant que c’était
« juste drôle ». Elle montre ainsi que pour elle, ce n’est pas « grave » s’ils n’ont pu réussir les positions, car le
but principal était d’explorer et de s’amuser, même si elle « tenait », en quelque sorte, à connaître ces
positions. Lorsque je lui ai demandé à quel point le fait de trouver des positions sexuelles était important pour
elle, elle a répondu en montrant bien la co-présence de légèreté et de sérieux dans le contexte de ses
recherches sur Internet :
Par exemple, [quand je tape] « comment mettre du piquant dans la vie [sexuelle] », je vais
sur un lien qui montre des positions sexuelles, j'en vois une, je me dis : « Voyons, est-ce
que le corps humain est capable de faire ça? » Je prends ça à la légère et je trouve ça
drôle. C’est un peu plus dans ce sens-là. [Mais] oui, il y a des réponses qu'on trouve sur
Internet. Eh oui, je suis intéressée, ça me touche, crime, c'est ça que je cherchais, c’est ça
que je voulais savoir. (Sabrina)
Par ailleurs, le copain de Sabrina, comme plusieurs des partenaires décrits par les participantes, ne
correspond pas au stéréotype masculin que l’on retrouve dans la publicité : peu certain au début de vouloir
essayer de nouvelles positions sexuelles, il se laisse convaincre par Sabrina et participe à ce qu’elle
a imaginé. Ce que ces résultats semblent mettre en évidence, c’est qu’une analyse qui mettrait exclusivement
ou démesurément l’accent sur les discours « subis » par les jeunes filles plutôt que sur ce qu’elles en font
réduirait non seulement la perception de l’agentivité des filles, mais aussi les dépeindrait et dépeindrait leurs
partenaires de façon stéréotypée. Elle réduirait aussi à sa plus simple expression (stéréotypée) l’interaction du
couple : dans le cas, par exemple, de Roxanne et Marie-Pier, la décision de chercher sur Internet de nouvelles
positions sexuelles s’est prise en couple, et ce, de façon conjointe et consensuelle. De plus, Marie-Pier et son
190
copain ont observé ensemble les différentes positions et ont convenu à deux de celles qu’ils aimeraient
essayer.
Dans les cas que nous avons vus jusqu’à maintenant, et plus particulièrement ceux de Marie-Pier, de
Roxanne et de Sabrina, les participantes ne correspondent pas au stéréotype publicitaire actuel des femmes
présentées comme « active, desiring sexual subjects […] who knowingly pla[y] with [their] sexual power » de
façon à gagner l’admiration des hommes (Gill : 2008b, p. 42), mais plutôt à de jeunes femmes agentiques qui
cherchent à vivre une sexualité épanouie et satisfaisante.
Cependant, là où ce « jeu de pouvoir » et de « projection » d’une agentivité factice semble opérer, c’est dans
un lieu bien précis : les bars. Camille nous a raconté s’être déjà prêtée à ce « jeu de la séduction » avec ses
copines. Elle décrit ici à quel point la négociation du pouvoir dans les bars reprend de très près les scripts et
les codes publicitaires décrits par Gill :
J'ai commencé à sortir dans les bars, j'avais 16 ans. Je pense sérieusement que ça
a vraiment influencé la relation que j'ai avec les hommes. De sortir si jeune dans les bars…
parce que dans les bars, ce n'est juste une question de relations hommes – femmes, de
séduction. Il se joue une game. Ce n'est pas sain. Je m'en rends compte [par] après. J'étais
en secondaire 4 ou 5, on allait au Palladium. C'était vraiment le fun. Mais mes relations
avec les hommes, tsé, ça part avec la séduction. On n'arrivait pas là en jogging pants. On
se préparait un peu. L'apparence compte. La première chose que tu vois... [c’est
l’apparence]. Il y a une game qui se joue. […] C'est de plaire. À 16 ans, c’est justement l'âge
où tu te cherches, tu essaies d'avoir l'attention des gars de n'importe quelle façon. J'étais
bien correcte, j'étais avec mes chums de fille, je faisais juste danser, mais ça a quand
même changé de quoi. […] Les bars, tout le monde rentre là en voulant être le plus beau, la
plus fine, en voulant avoir de l'attention. […] Si un gars te remarque, c'est parce que t'es
belle, pas parce que t'es intelligente. On dirait que c'est à l'envers. Après ça, il faut que tu
prouves au gars que tu es plus que belle. Tandis que normalement, comme à l'université, tu
commences à jaser avant de l'embrasser ou de danser avec. Il y a quelque chose de plus
sain. […] Dans les bars, tu commences par la fin, [le plus sexuel] et après tu connais la
personne. […] Ça ne fait pas des relations super stables. (Camille)
Camille montre ici qu’elle est bien consciente du jeu sexualisé et normé qui se passe dans les bars, et avoue y
avoir participé de plein gré. Elle le faisait pour avoir de l’attention, dit-elle, et pas nécessairement parce qu’elle
voulait développer une relation :
[Un gars dans un bar] prenait mon numéro de téléphone. Il me rappelait : « Veux-tu prendre
un café? Veux-tu souper? » « Non. » Non. Là, j'ai eu mon attention, je ne veux pas plus.
Dans ma tête, vu que [j’étais vierge, c’était encore plus clair :] « Non, je ne le ferai pas avec
191
toi ». On le sait d'avance. C'est dommage. Je veux dire... […] Je m'en foutais du gars. Il ne
m'attirait pas, rien, mais j'avais quand même besoin d'avoir l'attention. (Camille)
Elle montre par ailleurs qu’elle a été amèrement déçue de ce type d’échange, et dit préférer de loin le
développement des relations de couple non basées sur l’apparence et sur l’attention sexuelle. Cependant, elle
précise du même coup que ce jeu imitant les représentations commerciales de la sexualité semble limité à ce
type de lieu, qui permet et même encourage son opération. Elle estime aussi qu’il s’agit d’un lieu permettant la
mise en scène d’une agentivité factice, et qui ne montre l’exercice « réel » de l’agentivité (comme dans un
couple, par exemple). La dynamique n’est pas la même. Elle donne en exemple certaines de ses amies
vierges et plutôt timides, mais qui pourtant, dans les bars, projettent une autre image d’elles, tout à l’opposé :
C'est drôle, parce que je ne suis pas la seule fille : je connais des filles de 20 ans qui ne
l'ont jamais fait, et ça ne paraît pas. Ce sont des filles, belles grandes, bronzées, qui vont
dans les bars et qui ont l'air de... [coucher avec plein de gars]. […] C'est vraiment drôle
parce que moi je les connais, ces filles-là, et des fois tu les vois agir et tu te dis : « Mon
Dieu, pourtant, cette fille-là [n’est pas comme ça]. » (Camille)
Ces propos nous invitent à penser qu’il serait intéressant de comparer, dans une étude ultérieure, l’exercice
de l’agentivité des filles dans leurs couples et leur participation (parfois simultanée) à de tels jeux de la
séduction. Mais comme il n’est pas notre propos ici d’analyser précisément ce type d’interactions (qui, selon
Camille, serait particulièrement présent dans les bars), notre attention portera sur l’exercice de l’agentivité de
nos participantes au sein de leurs couples (si échéant). Il nous semble simplement ici important de distinguer
les deux contextes, qui peuvent être très différents.
Nous allons étudier plus en détail la relation que les participantes entretiennent avec leur(s) partenaire(s) au
chapitre 5.2, qui discute spécifiquement des résultats concernant l’agentivité sexuelle (p. 225). Mais d’abord,
nous discutons des derniers thèmes qu’elles cherchent sur Internet, soit les thèmes montrant le « comment »,
ceux qui leur permettent de prendre position sur des sujets controversés, et enfin ceux qui leur permettent de
s’amuser et d’explorer. Nous allons nous pencher de façon plus particulière sur les situations où les « trucs »
utilisés par les filles pour mieux « performer » sont directement puisés dans des sources pornographiques, un
thème qui, comme on peut s’y attendre, crée de nombreux malaises dans les recherches féministes sur la
question (Peterson : 2010; Plante : 2004).
5.1.7 Thèmes montrant le « comment »
Outre les positions sexuelles, plusieurs thèmes cherchés par les participantes expriment leur désir de savoir
« comment » exécuter tel ou tel acte, ou telle pratique sexuelle. La fellation, à ce propos, constitue de loin le
192
sujet qui les intrigue le plus. Elles ont alors recours à des vidéos pornos, du texte ou des trucs glanés ici et là
pour « bien » la faire, et surtout ne pas paraître « incultes » en la matière :
Une autre de mes expériences Web concernant ma sexualité a été d'aller tester des sites
pornos. J'avais un amoureux pour la première fois (16 ans) et je voulais savoir comment
faire pour bien sucer... Ça a l'air niaiseux dit comme ça, mais c'est vrai!! Personne à l'école
ou dans la gang d'amies ne parle de ça! Alors je voulais faire bonne impression à mon tout
nouveau et premier chum […]. Je suis donc allée sur un site de vidéos XXX et j'ai regardé
une fille qui suçait un gars. Ça m'a permis d'être moins nerveuse lorsque je l'ai fait parce
que je savais que c'était ça qu'il fallait faire!! […] [J’ai aussi] consulté un site du genre : Les
10 trucs à retenir pour faire une bonne fellation!! Lol. La vidéo a été plus efficace! ;)
(Sabrina)
Quand j’étais plus jeune et sans expérience sexuelle, je lisais dans des articles le mot
« fellation » ou entendais des gens le mentionner et je savais que cela avait trait à la
sexualité. Mon manque d’expérience dû à mon assez jeune âge m’a fait rechercher de
l’information sur le sujet sur « Google » et j’ai été assez satisfaite des résultats trouvés. J’ai
trouvé plusieurs sites qui décrivaient ce qu’était la fellation. Plus tard, quand j’ai eu mon
premier petit copain, j’ai fait une nouvelle recherche sur « Google » pour apprendre des
trucs pour donner une meilleure fellation. Encore une fois, j’ai été satisfaite des nombreux
résultats de ma recherche et je les ai même trouvés efficaces aussi. Haha! (Océanne)
Ces derniers temps, j'ai pas mal cherché d'informations sur la sexualité, car j'ai
nouvellement un jeune homme dans ma vie, et j'avais certaines interrogations. Les sujets
de ma recherche :
- La fellation
- Les positions sexuelles
- L'amour oral
- La pilule contraceptive
J'ai cherché tous ces sujets sur des blogues et des sites d'information, car j'étais curieuse et
j'avais besoin d'un peu d'idées et d'inspiration. Ça a relativement répondu à mes questions,
[car] j'imagine que la théorie ne remplace pas la pratique. (Camille)
Internet leur semble alors le seul recours pour trouver des informations pratiques sur des sujets un peu
tabous, mais qui les stresse beaucoup, comme la fellation et la première pénétration vaginale :
Sabrina : C'était mon premier chum, ça faisait peut-être 4 à 6 mois qu'on était ensemble, on
n’avait jamais rien fait encore. […] On était gênés un petit peu. Je me suis dit, si ça vient
à arriver, qu'est-ce que je fais? Je n'ai jamais vu ça, je n’en ai jamais entendu parler, ça ne
me tente pas de tout de parler de ça à ma mère, et les autres amies de mon âge sont
célibataires. […] Je suis donc allée sur Internet. […] J'ai marqué « XXX » sur Google, j'ai
193
pris le premier site […]. Il y avait vraiment des images qui m'ont traumatisée […]. Je me suis
dit : « Euh… OK, si c'est vraiment de même qu'il faut faire, je ne sais pas! » Et finalement,
quand on est arrivés pour le faire, je n'ai pas vraiment imité la vidéo. Oui, ça a été utile,
mais je ne me suis pas donnée, tsé, comme la fille dans la vidéo. C'était plus pour vraiment
savoir, premièrement, est-ce qu'on met un condom quand on fait ça? […] Ça m'a donné une
bonne idée, mais […] je savais [que la fille dans la vidéo] exagérait aussi.
Intervieweuse : Comment as-tu trouvé ce genre de vidéo?
Sabrina : […] C'est sûr que si j'ai une fille qui veut savoir comment faire une fellation, je ne
la référerais pas là du tout. Mais en même temps, c'est dur de décrire ça avec des mots,
[…] c'est dur pour une fille de 16 ans qui a son premier chum, tu ne peux pas le savoir.
C'est sûr que ça a augmenté ma confiance, comment savoir faire une fellation. T'en
as jamais fait, tsé je me sentais : « OK, go, je suis prête. » Je sentais que ce que j’allais
faire, ça allait être correct, que je me tromperais pas trop. [Je me disais :] « Et si je me
trompe, ce n'est pas grave, il m'aime et on va prendre ça à la légère. » Je savais comment il
allait agir, alors oui, ça a augmenté ma confiance en moi, que lui me rassure en me disant
« je t'aime », mais en sachant par Internet quoi faire, c’est certain que j'avais un p’tit go, une
p’tite tape dans le dos.
-
Roxanne : La première chose qui me stressait beaucoup, c'était la première pénétration.
Tsé, si ça allait faire mal, si ça fonctionnait... Je savais que ça allait faire mal, mais je ne
savais pas... J’avais lu qu'il fallait ne pas être trop stressée, parce que ça pouvait être plus
difficile. J'essayais d'être plus calme. Je me donnais des trucs comme ça que j'avais vus sur
Internet, des trucs pour que ce soit moins difficile. Concernant la fellation aussi, dans le
sens... de trucs! [rires] Des petits trucs pour avoir l’air moins... parce que c’était toutes des
premières fois avec ce gars-là, je ne voulais pas avoir l’air trop... […] trop niaiseuse.
Maintenant, avec du recul, je sais que... [ridicule]. C'est sur le coup.
Intervieweuse : C’était important pour toi de ne pas avoir l'air de ne pas connaître ça?
Roxanne : Ben tsé, je ne voulais pas avoir l'air d'une experte, il savait que je n’avais pas [eu
d’expériences avant, mais] je ne voulais pas avoir l’air trop... pas inculte, mais... je ne
voulais pas arriver là et [me dire] : « Qu’est-ce que je fais? » Je voulais avoir une certaine
base. (Roxanne)
Le Web leur permettrait aussi d’apprendre différentes techniques pour embrasser :
J'ai déjà essayé de reproduire quelque chose que j'avais vu sur le Web... J'avais toujours
été stressée et mal à l'aise à penser à la première fois que j'embrasserais un gars. Bien sûr,
j'avais hâte que ce moment-là arrive, mais j'avais peur de ne pas être très douée. Quelques
jours avant que ça se produise, j'ai commencé à chercher sur YouTube des vidéos qui
194
pourraient apprendre ou montrer des techniques et différentes façons d'embrasser pour un
peu de variété. Je ne me rappelle plus de la vidéo que j'ai trouvée et que j'ai aimée, mais
grâce à elle je me suis sentie beaucoup plus confiante quand ce moment est arrivé. Dans
mon cas, j'ai trouvé ça utile. :) J'ai reproduit quelques techniques et trucs de la vidéo et ça
a été très agréable et réussi! Ça m'a donné la confiance nécessaire pour enfin foncer et
aujourd'hui ce que j'y ai appris m'est encore utile! (Léa)
Il leur permettrait aussi de connaître différents actes sexuels sans pénétration :
Le seul sujet dont je me rappelle avoir cherché directement sur Google est la masturbation.
Je cherchais à ce moment-là à comprendre mieux les gars et à apprendre des trucs sur
comment leur faire plaisir. Je fréquentais un gars dans ce temps-là, mais je n'étais pas
prête à faire l'amour avec lui. L'information que j'ai trouvée m'a été utile pour quand même
répondre à nos besoins sexuels ensemble sans passer directement à l'acte. (Léa)
Enfin, lorsqu’elles sont plus jeunes, Internet peut leur apprendre à « séduire » un partenaire :
Noémie : Ah oui! [rires] Mais surtout quand on était plus jeunes, tsé c'était : « Comment se
faire un chum », des affaires inspirées de ce qu'on trouvait dans les revues Cool!, Filles
d'aujourd’hui, genre « Les 10 trucs pour séduire les footballeurs », des affaires de même!
(rires)
Intervieweuse : Comparé aux revues, qu'est-ce qui était meilleur?
Noémie : Ben tu avais une plus grande ouverture… Dans ta revue tu as comme un article
là-dessus, et sur Internet, tu en as soixante. Tu as un plus grand choix.
Discussion
Les participantes montrent ici qu’elles utilisent le Web pour apprendre à exécuter certains actes
« normés » (embrasser, séduire un garçon, faire une fellation), pour calmer leurs angoisses (face à la
première pénétration et aux premières fellations) et pour trouver des activités sexuelles leur permettant de
mieux contrôler la vitesse à laquelle évolue la relation (masturbation mutuelle, etc.). Ces résultats sont
congruents avec ce qu’avaient observé Suzuki et Calzo (2004) dans leur étude sur les forums pour
adolescents, puisqu’ils avaient remarqué que les questions liées aux « techniques sexuelles » soulevaient
beaucoup d’intérêt chez les visiteurs et les participants des forums sur la sexualité (p. 695). Cependant, le cas
de la fellation est particulier : les participantes se servent alors de la pornographie – un secteur d’activité
considéré par plusieurs comme « un cas extrême de l’asservissement des femmes » (Plante : 2004, p. 121) –
195
pour apprendre à performer une activité sexuelle qui vise d’abord le plaisir sexuel masculin. Selon Plante
(2004), qui a rencontré en entrevue 35 femmes québécoises amatrices de pornographie, cette situation peut
être malaisante, en particulier pour les chercheuses féministe moins libérales, puisque plusieurs estiment
« aliénant » ce type de consommation médiatique (p. 118)65.
Cette situation peut sembler d’autant plus paradoxale que, dans notre cas, les participantes, plutôt que de
parler du plaisir à regarder la pornographie (un cas précis que nous allons aborder à la prochaine section),
estiment se sentir « empowered » par le fait d’apprendre à faire une fellation au moyen de la pornographie.
Noémie, par exemple, raconte que les trucs qu’elle a tirés des vidéos pornos lui ont « permis d’être moins
nerveuse » parce qu’elle a ainsi su ce qu’il « fallait faire ». Plusieurs autres ont aussi dit se sentir plus en
confiance grâce à de telles vidéos. Ici, le malaise ne vient pas tant du fait que les filles disent apprécier la
pornographie, mais du fait qu’elles s’en servent pour augmenter leur sentiment d’empowerment à performer
un acte qui semble directement profiter au garçon – et donc qui a le potentiel de les « asservir » encore plus
par le biais de ces contenus « aliénants ».
Si, d’une part, on condamne la fellation comme une pratique aliénante issue du milieu pornographique, doit-on
aussi condamner le fait que de jeunes femmes disent se sentir « empowered » en la pratiquant ou en
apprenant à la pratiquer? Doit-on forcément considérer comme « invalide » cette forme d’empowerment?
Dans le débat qui a opposé Lamb (2010) et Peterson (2010) sur la question, Peterson a montré qu’il pouvait
y avoir de multiples dimensions à l’empowerement : des dimensions internes (« internal, subjective
perceptions of sexual self-efficacy and power […] closely tied to sexual desire and pleasure » [p. 308]), et des
dimensions plus externes, liées à la distribution « réelle » du pouvoir et des ressources. Cette conception
multidimensionnelle de l’empowerment permet, selon Peterson, de concevoir les filles comme empowered en
certains sens, et disempowered en d’autres; une observation qui ne doit pas pour autant permettre,
cependant, que l’on « dismiss girl’s sexual experiences of sexual empowerment (even if it is [sic] influenced by
pornographic media images or by male models of desire and pleasure) » (p. 308).
65 Les positions qu’ont adoptées les féministes sur la pornographie dans les débats publics ont été très variées, et
surtout, même, très polarisées : de nombreux débats ont opposé, d’un côté, les féministes « anti-pornographie », dont
Andrea Dworkin (1981) et Catherine MacKinnon (1993, 1995), selon lesquelles la pornographie mine les objectifs
d’égalité des femmes en institutionnalisant leur subordination et leur exploitation, et de l’autre, les féministes se disant
« pro-sexe », pour qui, à la suite entre autres de Carole Vance (1992a), la pornographie pourrait avoir un aspect
libérateur et permettre l’autonomie des usagers.
Les féministes « pro-sexe » ont par ailleurs soulevé les avantages possibles que pourrait avoir la pornographie sur
Internet, dont la possibilité pour les usagers d’ « essayer » de nouvelles identités de genre et d’explorer d’autres
orientations sexuelles et la possibilité de produire et de distribuer du matériel pornographique selon leurs propres
représentations (Clicitara : 2004, p. 284, Ciclitara : 1998, Williams : 1989).
196
Lamb a répliqué qu’elle soutient l’expérimentation sexuelle comme façon pour les filles de se développer
sexuellement, mais que d’un autre côté, elle cherche à constater d’où provient « l’influence » que subissent
ces mêmes filles à performer des actes « avilissants » : « …I am interested in exploring where girls get their
ideas for what counts as sexual experimentation and how these ideas are marketed and influenced by
a multibillion dollar industry » (p. 315). Selon elle, le fait de critiquer la source d’empowerment des filles « is
not to argue against sexual freedom and experimentation for girls but to say that the avenues for
experimentation that are open to the majority of teen girls come from the porn industry, are sold to them as
empowerment, and reflects the codes and conventions of pornographic media » (p. 316).
Même si Peterson (2010) reconnaît que la pratique de la fellation puisse être considérée comme une norme,
elle estime en contrepartie que le fait de choisir de performer un acte sexuel encouragé par la norme ne rend
pas nécessairement cette décision moins agentique, comme on l’a vu précédemment :
We may not feel comfortable with the fact that some adolescent girls choose to enact
a "pornified" version of sexuality; yet, if girls tell us that they feel pleasure and empowerment
by embracing an overt and exhibitionist version of sexual expression, should we assume
that we know better than they do about the underlying meaning of that expression? Further,
one could argue that merely the fact that girls have the option to choose a "pornified"
version of sexuality can be viewed as a form of empowerment […]. This is especially true
given that […] expressions of women’s sexual desire and pleasure have been largely
restricted in our society. (p. 309)
Plusieurs auteures ont d’ailleurs argué qu’on ne peut condamner à l’avance un acte en soi, comme Gayle
Rubin (2010). Elle écrit dans « Le péril Cuir » [1981] :
Quand on réfléchit sur le sexe, on a la fâcheuse habitude de penser un peu trop facilement
que quelque chose que l’on n’aime pas déplaira également à quelqu’un d’autre. Je déteste
courir. Je peux changer d’opinion un jour mais, à cet instant, il n’y a que sous la contrainte
que je me mettrais à courir autour du block – et je ne parle pas de courir cinq miles. Cela ne
veut pas dire que mes amis qui courent le marathon sont des gens malades, qu’on leur
a lavé le cerveau ou qu’ils agissent le pistolet sur la tempe.
Les gens qui ne sont pas intéressés par la sexualité anale ne comprennent pas qu’on
puisse y trouver du plaisir. Les gens que révulse la sexualité oro-génitale restent interdits
quand ils apprennent qu’on peut éprouver du plaisir à sucer des queues ou à bouffer des
chattes. Le fait demeure pourtant : des hordes tout entières de gens trouvent la sexualité
oro-génitale ou anale délicieusement plaisante. La diversité sexuelle existe, tout le monde
n’a pas à faire les mêmes choses, et ceux qui ont des préférences sexuelles différentes ne
sont pas des gens malades, des abrutis, des gens pervertis, des gens qui se sont fait laver
le cerveau, des gens sous la contrainte, les suppôts du patriarcat, les produits de la
197
décadence bourgeoise ou les rescapés de mauvaises méthodes éducatives. Il faut en finir
avec l’usage qui veut qu’on explique la diversité sexuelle en la dénigrant. (p. 128-129)66
On n’a donc pas à approuver ou à juger les pratiques sexuelles des filles en soi (et c’est d’ailleurs ce que
disent les filles au sujet de la porno, comme nous le verrons à la section suivante). Le problème réside plutôt
dans le fait que des pratiques soient présentées (sur le Web et dans les médias) et reçues comme la norme
pour toutes.
Par ailleurs, il demeure qu’il peut effectivement y avoir dans la pratique de la fellation (ou autres actes sexuels)
l’opération d’une forme de pouvoir – entre les partenaires ou, de façon plus large, entre les hommes et les
femmes. Le fait que des participantes disent prendre plaisir à pratiquer la fellation n’exclut pas la possibilité
d’exercice de ce jeu de pouvoir, mais en contrepartie, l’opération du système de genre ne rend pas leur plaisir
pour autant illégitime. Gayle Rubin écrit : « …la sexualité est politique. Elle est organisée en systèmes de
pouvoir qui récompensent et encouragent certains individus et activités, en punissent et en suppriment
66 De ce point de vue, les sources qu’accepte Lamb comme inspiration sexuelle « correcte » semble dès lors limitées –
et, selon Peterson, plutôt restreignantes :
Restrincting and demonizing girls’ expression of sexuality – even "pornified" sexual expressions that are
influenced by misogynistic media images or stereotypical cultural standards – limits girl’s freedom to try on new
ways of being sexual (Vanwesenbeeck 2009). (Peterson : 2010, p. 309)
D’ailleurs, Bay-Cheng, Robinson et Zucker (2011) ont montré que les filles peuvent en effet tirer du plaisir à faire une
fellation. Même si la fellation constituait la pratique sexuelle à laquelle les jeunes femmes associaient le moins de plaisir,
de désir et de volonté à la performer (« wanting »), comparativement, par exemple, au coït ou au cunnilingus, elle restait
tout de même désirée, voulue et associée au plaisir (p. 520). Le cunnilingus se situait en tête de liste pour le désir et le
plaisir alors que le coït était au premier plan en ce qui avait trait à la « volonté » de performer un acte ou un autre
(« wanting »).
S’il y a peu de discussion sur le cunnilingus dans le discours de nos participantes, c’est probablement qu’étant femmes et
en majorité hétérosexuelles, elles ne ressentent pas le poids ni le stress relié à sa performance. Dans notre étude, les
participantes ont surtout mentionné avoir été, plus jeunes, « curieuses » et « intriguées » par le terme « cunnilingus »;
elles ont fait des recherches principalement pour « savoir ce que c’était », mais ont peu parlé du fait de le pratiquer. Ce
peut aussi être en raison de la stigmatisation persistente des parties génitales féminines dans le discours social et dans
les représentations médiatiques (Bay-Cheng et Fava : 2011, p. 532). Dans les films, par exemple, on perçoit
constamment du dédain envers les organes génitaux des filles, et la pratique du cunnilingus par les hommes y est
couramment montrée comme une « preuve » ou une démonstration de leurs prouesses sexuelles, ou encore comme
une étape nécessaire leur permettant d’obtenir leurs propres faveurs sexuelles (loc. cit.). Ces représentations tendent
donc à dépeindre le plaisir sexuel féminin et les pratiques sexuelles qui lui sont liées comme « an optional component
and occasional by-product of sexual interactions that are aimed at producing male orgasm » (loc. cit.). Les études
empiriques sur la question, cependant, indiquent que la stigmatisation des organes génitaux féminins pourrait être en
déclin (p. 539). Et si plusieurs études démontrent que la prévalence de la fellation et du cunnilingus seraient relativement
équivalentes, il reste que les « obstacles culturels » reliés au cunnilingus sont plus nombreux, les jeunes femmes
ouvertes, confiantes et assertives étant plus susceptibles de la pratiquer (p. 531).
198
d’autres. » (2010 [1984], p. 206) Mais il importe, selon elle, de distinguer l’exercice du genre et d’autres types
de pouvoir à la pratique d’activités sexuelles en elles-mêmes. Par exemple, le fait que certaines personnes
adoptent un rôle de soumis ou de dominés dans la pratique du sadomasochisme ne signifie pas pour autant
qu’ils le sont vraiment; selon Rubin, on peut prendre du plaisir à jouer les soumis : « Les sadiques n’oppriment
pas systématiquement les masochistes. » (2010 [1981], p. 129) En contrepartie, « …les privilèges de classe,
de race et de genre ne s’évanouissent pas quand on entre dans le monde SM » (loc. cit.).
La pornographie étant toujours médiatisée, on ne peut ignorer que la réception est toujours aussi une
négociation. De façon similaire, Lamb et Peterson (2010) et Renold et Ringrose (2011) montrent que l’on ne
peut réduire la reproduction d’un comportement issu du milieu pornographique à de l’imitation pure et simple,
non réfléchie :
A girl may imitate sexualized media thinking this is the norm for teen sexuality and simply
that she is conforming to what "all the kids" do. She may imitate it because she has learned
"boys like this." She may also imitate it in a more conscious or deliberate way,
experimenting, playing around with how it feels and finding that it’s pretty exciting to imitate
these sexualized moves and ways of expression. […] If a girl sees herself as a sexual object
who must perform to get or keep a boy’s attention, arent’t the consequences likely to be
different than if she sees herself as engaging in fun, playful experimentation? (Lamb et
Peterson : 2011, p. 708)
C’est pourquoi il nous semble si important d’observer et de comprendre les motivations qui poussent les filles
à performer des actes sexuels en particulier, plutôt que de « démoniser » ou d’invalider certains de ces actes
(voir Hasinoff : 2010), même s’il s’agit d’imitation de scènes issues de la pornographie.
D’ailleurs, dans notre étude, outre les positions sexuelles trouvées sur des sites Web (non pornographiques)
qu’elles ont tenté de reproduire (en jouant), les participantes ne semblent pas imiter directement la
pornographie, mais plutôt s’en servir pour y puiser des « trucs » afin de ne pas paraître « trop naiseuse[s] »,
comme le dit Roxanne. Elles s’en servent donc pour « contrôler », en quelque sorte, le niveau de
connaissances qu’elles projettent, puisqu’elles ne veulent pas non plus passer pour des « expertes ». La
pression de se trouver quelque part entre les deux provient probablement des attentes sociales genrées, qui
exhortent les filles à être ni vierges, ni putains (Pheterson : 2001 [1996]).
Chose certaine, l’influence provenant strictement de la pornographie semble limitée, car comme on le verra
plus loin, les filles peuvent se montrer très critiques face à la pornographie et expriment très clairement leurs
limites : aucune participante ne s’est dite intéressée par la pénétration anale, pourtant très fréquente dans la
porno, et aucune n’a mentionné pratiquer certains actes en apparence plutôt avilissants trouvés de façon
régulière dans la pornographie, comme l’éjaculation au visage. La plupart ont mentionné qu’elles
199
n’appréciaient pas le fait que la pornographie réduisent presque invariablement les femmes à un rôle de
soumises, et ce, même celles qui disaient pourtant apprécier la pornographie de façon générale.
Nous étudions plus en détail à la section qui suit le rapport (plutôt polarisé) qu’elles entretiennent avec la
pornographie.
5.1.8 Thèmes suscitant une prise de position
Les participantes ont utilisé Internet pour s’informer sur des sujets controversés, comme par exemple
l’avortement et l’hypersexualisation. Mais s’il est un sujet controversé sur lesquelles elles se sont presque
toutes positionnées, c’est la pornographie.
La pornographie : les « pour » et les « contre »
Les participantes ont abondamment parlé de pornographie. Certaines ont mentionné d’emblée dans leur
blogue leur appréciation de la porno ou leur aversion envers elle, alors que d’autres n’en ont parlé qu’en
entrevue lorsque nous leur avons posé directement la question : « Regardes-tu de la porno? » ou « Que
penses-tu de la porno? ». Néanmoins, elles ont dans la plupart des cas fait preuve d’une opinion développée
sur la question, peu importe leur position. Plusieurs se sont dit être « contre » la pornographie, estimant que
celle-ci mettait en scène des pratiques dégradantes pour les femmes et qu’elle pouvait être trompeuse pour
les hommes, puisqu’elle « ne reflète pas la réalité ».
Sarah fait partie de celles qui ont exprimé des réserves quant à la pornographie dans leur blogue. Elle trouve
notamment que la porno déforme la sexualité. Pour mieux comprendre et exprimer son aversion naturelle pour
la chose, elle a cherché des sites qui exprimaient les bons et les mauvais côtés de la pornographie, et a
trouvé un site Web nommé Make Love Not Porn (http://www.makelovenotporn.com/main.php), un site qui,
sans condamner la pornographie, se présente comme un lieu de discussion sur les éléments qui opposent la
« vraie vie » et le « Porn World »67. Le site entame la discussion par la comparaison sur un thème précis entre
les pratiques vues en pornographie et les pratiques « réelles ». Il préconise un discours qui ressemble souvent
à ce paragraphe, trouvé sur le site :
67 La société MakeLoveNotPorn a été fondée par Cindy Gallop, une consultante en publicité d’origine britannique
soucieuse de promouvoir un discours plus réaliste sur la sexualité et sur la pornographie (Gallop : 2009).
200
Porn World : Real World :
Men love coming on women’s faces, and women
love having men come on their faces.
Some women like this, some women don’t. Some
guys like to do this, some guys don’t. Entirely up to
personnal choice.
Tableau 4. Exemple de comparaison que l'on peut trouver sur le site MakeLoveNotPorn.com
Les usagers peuvent ensuite commenter.
Après avoir regardé un peu de porno par curiosité, Sarah a décidé que la pornographie n’était pas pour elle.
Voici ce qu’elle écrit :
Je trouve qu'en regardant ce genre de film cela brise ce qu'est vraiment la sexualité.
D'après ces films nous pouvons faire l'amour n'importe où, n'importe quand, quand bon
nous semble, mais en réalité ce n'est pas le cas. Les films pornographiques gâchent ce
qu'est la magie d'être en amour et de faire l'amour. Si nous comparons les deux (porno et
vraie vie), il y a tellement de choses qui sont différentes, tellement de choses qui sont
irréelles. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'arrêtent pour regarder ce genre de
niaiseries. Selon moi, les films pornos ne devraient même pas exister. (Sarah)
Rosalie, 17 ans, exprime un point de vue semblable :
La pornographie, je vais dire vraiment que ce n'est pas utile du tout, que c'est vraiment une
chose que les jeunes pourraient laisser de côté, car pour moi ce n'est rien d’intéressant, et
que faire l'amour, je trouve que c'est fait pour deux personnes qui s'aiment vraiment. Parce
que [ceux qu’on voit dans la pornographie], ça n’a juste pas de sens que ça puisse durer
comme trois heures. J'avoue avoir déjà regardé une vidéo de pornographie mais ça
m’écoeurait vraiment gros. Je trouve que ça ne fait juste pas de sens tout ce qu’ils peuvent
faire… [la pénétration anale, les trips à 3, 4 ou plus]. J'avoue que ça me choque
énormément. Ça me choque parce que je trouve qu’avoir une relation sexuelle avec
quelqu'un, c'est intime et ça regarde les deux personnes concernées. […] Je trouve
sincèrement que ce n'est pas correct. On a tous une opinion, mais sincèrement ça
m'écoeure. (Rosalie)
Camille, comme Rosalie, est dégoûtée par ce qu’elle voit dans la pornographie. Elle explique ici la raison de
son dégoût :
Intervieweuse : Es-tu allée voir de la porno pour voir comment ça se fait?
201
Camille : Oui, oui, oui. Pas beaucoup, parce que ça m'écoeurait vraiment. Il y a des pop-
ups... Pas que ça m'écoeure, mais on dirait qu'il y a quelque chose de vraiment... de super
animal. Tu restes avec les images après ça... [rires] […] Moi, je me suis limitée à YouPorn68.
Je me suis dit, ça ressemble à YouTube... [rires] […] Il se fait des trucs assez... des affaires
qui me donnent mal au coeur.
Intervieweuse : Y a-t-il des choses qui sont hors limites [pour toi]?
Camille : C'est surtout la façon dont c'est fait. Je ne trouve pas ça super cute. Tsé, genre,
t'en as 3-4 autour de toi... Non.
Si elle regarde toutefois parfois des vidéos pornographiques amateures sur YouPorn.com, c’est qu’elle peut
sélectionner ce qu’elle regarde et ainsi écarter ce qu’elle juge de mauvais goût :
Camille : …quand je vois trois, quatre gars (dans la description de la vidéo), je ne veux pas
le voir. Moi, ça va être plus des scénarios, quand il y a une histoire autour. À peu près
comme Bleue Nuit! [rires]
Car comme elle le précise dans son blogue, le fait de ne pas apprécier certaines scènes pornographiques ne
veut pas dire qu’elle ne s’intéresse pas à la sexualité, au contraire. Seulement, elle fait la distinction entre ce
qui semble pour elle réalité et fiction et décide d’écarter les représentations extrêmes :
Cependant, je m'intéressais et je m'intéresse toujours à la sexualité en général (qui met en
scène des êtres humains au quotidien, et non des Machines-du-Sex-Hard. Machines avec
un grand M, Sex avec un grand S et Hard avec un grand H). Je m'intéresse non seulement
à la sexualité génitale, mais aussi, et surtout, à la sexualité qui « entoure » la première
évoquée. Autrement dit, tout ce qui a trait à la relation entre deux personnes avant d'en
arriver à « l'acte ». (Camille)
Maude, qui est contre la porno, estime que celle-ci est « le mauvais côté de la sexualité », le « côté dark » :
Intervieweuse : Tu disais dans ton blogue qu'on ne parle pas assez de porno?
Maude : On n'en parle pas assez, et les sites... Je suis allée par curiosité, les sites, c'était...
Moi, j'ai été très surprise, je ne m'attendais pas à ça, parce que justement il n’y a jamais
personne qui nous a dit c'était quoi. La première fois que tu tombes sur ça, ce n'est pas
rose, disons. Sur certains sites, je pourrais te dire, peut-être que ceux sur lesquels je suis
tombée, j'ai été malchanceuse, mais ce n’est pas rose. Quand t’es jeune, 14-15 ans, et que
tu tombes là-dessus…
68 YouPorn est site pornographique qui imite la mise en page et le fonctionnement de Youtube.
202
Intervieweuse : Et maintenant que tu es plus vieille, vas-tu en voir? Est-ce que ça
t’intéresse?
Maude : Non, ça ne m'intéresse pas. C'était juste par curiosité, et des fois, ce qui est interdit
et dont on ne parle pas, c'est ça qui pique au contraire plus la curiosité. Je pense, sans
vouloir trop généraliser, en tant que fille, je pense que les filles, on est moins curieuses
d'aller sur Internet voir de la pornographie que les hommes, je crois.
Elle attribue son opinion au fait de la qualité très variable des sites Web qui présentent de la porno, qui, selon
elle, présente différents « degrés » de dégradation pour les femmes. Voici les nuances qu’elle apporte :
Maude : Ceux sur lesquels je suis allée, c'était les sites qui étaient gratuits, c'est de la
pornographie qui est plus de basse qualité, mais je suis sûre que si j'étais allée sur un site
qui était payant, mon opinion serait peut-être différente. Moi, je vois ça de même... Ce n'est
pas la même qualité.
Intervieweuse : Qu'est-ce que tu t'attends de voir dans un site payant?
Maude : Premièrement que la femme ne soit pas une femme-objet, et qu'il y ait un peu plus
de respect en terme de sexualité quand tu paies.
Intervieweuse : As-tu un exemple de situation où la femme serait plus respectée dans la
porno?
Maude : Je ne sais pas.
Intervieweuse : Au contraire, qu'est-ce qui fait que la femme devient une femme-objet?
Maude : Elle est soumise. Souvent, les positions qu'ils lui attribuent, c'est vraiment de
femme soumise, dominée, et...
Intervieweuse : Est-ce que c'est quelque chose que tu essayerais?
Maude : Ben pas vraiment, ce que j'ai vu, c'était, mettons, je vais te donner un exemple. La
fille était enchaînée, et c'était comme avec un collier à chien, c'est vraiment le gros kit
extrême. C'est vraiment « femme dominée ». Elle était comme un chien à terre. […]
Intervieweuse : Et s'il y avait un site dont on te garantissait qu'il n'y avait pas ça, irais-tu le
voir?
Maude : Oui, peut-être par curiosité.
203
Plusieurs ont tendance à se sentir blessées de l’utilisation de la pornographie par leur partenaire. Gabrielle,
par exemple, dit regarder parfois de la porno avec son copain pour « mettre du piquant » dans sa vie sexuelle,
mais précise qu’elle ne participe pas tant que ça à l’activité, car, dit-elle, elle en voit peu « la pertinence » :
Gabrielle : La première fois, mon chum a parti la vidéo et on a fait l’amour pendant. Lui, ça
l'excitait, de regarder ça en arrière.
Intervieweuse : Pas toi?
Gabrielle : Non, moi je ne la regardais juste pas.
Intervieweuse : Et est-ce que ça te dérangeait qu’il ait recours à ça?
Gabrielle : Ben un peu. Je me disais : « C'est quoi, je ne t'excite pas assez? » Mais à un
moment donné, je le lui ai dit, et il a dit : « Non, c'est pas ça, dans le fond, ça fait juste
différent de d'habitude. »
Intervieweuse : Et là tu as été d'accord avec ça?
Gabrielle : […] Lui, ça le turn on [de regarder ça] pendant qu'on fait l'amour, [mais] moi,
dans le fond, je ne me dis pas : « Il aime plus regarder la fille se faire fourrer que moi. »
Si son blogue montre son enthousiasme du début, elle raconte qu’au fil du temps, elle perd l’intérêt :
Tu te tannes vite, tu fais genre, il n’y a pas d'intérêt. Quand je le regarde avec mon chum, je
trouve ça plus le fun, mais mettons genre, toute seule à le regarder sur Internet, là, non.
T'en regardes un, et deux, et après ça, tu te tannes. (Gabrielle)
Laurie, de façon un peu semblable à Gabrielle, voit d’un mauvais œil que son copain apprécie tant la
pornographie. Comme ils font peu l’amour dernièrement, cette situation l’inquiète :
Laurie : Et… tsé j'ai su que... j’en avais parlé, qu'il allait sur des sites pornos, et là je
n'aimais pas trop ça.
Intervieweuse : OK, alors il ne faisait rien avec toi, mais en même temps...
Laurie : Oui, c’est ça. Parce qu'il disait que ça lui arrivait tout d'un coup et il fallait que ça se
passe quand lui voulait, genre. Que lui... c'est ça.
Intervieweuse : Lui en as-tu parlé?
Laurie : Oui. On s'en est beaucoup parlé, et c'est toujours la même chose qu'il me dit. C'est
sûr que là, ça va un peu mieux, mais ce n'est plus comme avant.
204
Intervieweuse : As-tu l’impression que ton couple fonctionne mal tout de suite?
Laurie : Ben non, c'est juste sexuellement. C'est comme, on s'aime vraiment, on se colle,
tout, on s'entend super bien ensemble… C'est juste que sexuellement, ce n'est plus comme
avant. Tsé, ça pourrait se produire deux fois par mois. Ce n'est pas beaucoup. […]
Intervieweuse : Lui en as-tu parlé? Est-ce qu’il y a eu des actions qui ont été faites
concrètement?
Laurie : Ah, c'est sûr que là, on s'est chicanés et tout, mais côté action, c'est sûr que là, on
s'en est vraiment parlé. […] Il m’a expliqué que tous les gars faisaient ça, nananan... Tsé, je
sais que c'est vrai, mais en même temps, moi, je me sens mal là-dedans. Mais sinon...
action, non pas vraiment. Tsé, je comprends sa situation, qu'il est vraiment stressé, et tsé je
le vois, qu'il est vraiment, vraiment occupé. Moi, je le crois vraiment, c'est sûr qu'au début,
ça a été plus difficile, mais je pense qu'en laissant le temps aller, ça devrait s'arranger. En
tous cas, j'espère.
Blessée par le comportement de son copain, Laurie se dit « tout à fait contre » la pornographie :
Laurie : À un moment donné, je suis allée voir sur le site sur lequel mon copain allait. Juste
pour voir c'était quoi, et je trouvais ça dégueulasse, je trouvais ça quétaine, et ça ne m'attire
vraiment pas. Je voulais juste voir c’était quoi.
Intervieweuse : C'était plus pour t’informer.
Laurie : Oui, c'est ça.
Océanne, également, a exprimé qu’elle se sentirait blessée et inquiète si son copain était excité par d’autres
femmes qu’elle. Elle s’est d’ailleurs sentie mal à l’aise lorsqu’elle a regardé de la pornographie avec son
ancien copain. Même si elle a déjà regardé de la porno pour apprendre, elle se dit « déçue » par la
pornographie, qui ne montre pas la sexualité comme elle s’y attendait, et n’arrive pas à se reconnaître dans
ces représentations.
Toutefois, bon nombre de participantes expliquent qu’elles ont regardé de la pornographie à quelques reprises
par curiosité, mais que celle-ci ne vient tout simplement pas « les chercher » :
C'était juste vraiment par curiosité, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Je me suis rendu
compte que ça ne m'intéressait pas. (Alexandra)
Ça ne m'attire pas, simplement! Je n'en ai juste pas besoin pour mettre du piquant ou pour
apprendre quoi que ce soit, non. Ça ne m'a jamais attirée. (Jessica)
205
C'était pour savoir comment ça se fait, et je trouvais ça intéressant de voir comment ça
marche cette industrie-là. […] Si le monde aime ça, tant mieux pour eux! Moi, je n'écoute
pas ça avec mon chum pour mettre du piquant, non. Je ne sais pas, moi, je regarde, mais
ça ne me donne pas tant le goût. [rires] (Noémie)
Le rejet de la pornographie prend aussi les allures d’un choix qu’elles considèrent personnel : elles n’étendent
pas, pour la grande majorité, leur rejet de la pornographie à ce que devraient faire les autres (y compris même
parfois le partenaire), mais estiment que « ce n’est pas pour elles » :
Moi, il faut que je me fasse toucher, il faut que je me fasse coller, pour que ça me tente. Voir
des affaires, tsé, oui, c'est un peu excitant, mais ça ne me donnera pas le goût de, envoye,
let’s go, tsé. (Noémie)
Moi, la porno, ça ne me dérange pas d'en voir, ça ne me dérange pas que le monde en
parle, ça ne me dérange pas que le monde en fasse, ça ne me choque pas en tant que tel,
mais moi, ça ne m'intéresse pas. En même temps, le monde qui le fait, je n’ai pas... [de
jugement là-dessus]. (Mia)
Ben moi, [quand j’en ai regardé], j’étais plus jeune aussi. Je pense que je n'avais jamais eu
de relation, rien. Mais maintenant, je te dirais que je trouve ça plate. Tu checkes ça, et c’est
comme, on dirait que je ne peux pas m'exciter par rapport à ça, parce que ça n’a pas
rapport à moi, tsé. (Océanne)
-
Maëlie : Ben tsé, je ne suis pas de ceux qui en font et qui aiment ça, [mais] moi, ça ne
m'intéresse pas.
Intervieweuse : Ni pour pimenter, ni pour apprendre?
Maëlie : Ben, pour apprendre, il y a d'autres façons [de faire], je pense, que ça. Ceux qui
aiment ça et ceux que ça divertit, c'est leur affaire.
Intervieweuse : Tu ne t'es jamais mise là avec ton chum pour regarder de la porno?
Maëlie : Non. Mais tsé, s'il en regardait...
Intervieweuse : ...ce ne serait pas la fin du monde?
Maëlie : Non! Pour moi, moi, je n'aime pas ça et je ne trouve pas l'utilité de ça, mais s'il en
regardait ou même mes amis, ou peu importe, ça ne me dérangerait pas. Je n'ai pas de
jugement là-dessus.
206
Même chose pour Rosalie, que pourtant la porno « écoeure » :
Intervieweuse : Penses-tu que ton chum va regarder de la porno sur Internet?
Rosalie : Moi je dis que oui. Ben il regarde des fois des affaires pornos, mais ça, c'est lui
[NDC : dans le sens « c’est son affaire »]. Moi, je n'aime pas ça regarder ça.
Intervieweuse : Est-ce que ça te dérange que lui regarde ça?
Rosalie : Non, moi ça ne me dérange pas.
Toutefois, si certaines participantes se positionnent « tout à fait contre » la pornographie, et que d’autres
affirment simplement ne pas s’y intéresser, quelques-unes pourtant expriment ouvertement leur goût pour la
pornographie et expliquent s’en servir pour « mettre du piquant » dans leur sexualité. C’est le cas, par
exemple, de Roxanne, qui s’amuse avec la porno. Elle lisait déjà de la littérature érotique dans les livres et sur
Internet quand son copain l’a initiée au site YouPorn. Celui-ci est par la suite devenu son site pornographique
préféré. Elle décrit amplement son expérience et son intérêt pour la pornographie dans son blogue :
Un an après que mon copain de l’époque et moi ayons commencé à nous fréquenter, la
passion était toujours au rendez-vous. Malgré tout, nous avions peur de tomber dans la
monotonie et cherchions constamment à mettre du piquant dans notre vie sexuelle. Nous
aimions essayer et expérimenter de nouvelles choses.
Un jour, mon copain proposa de regarder un film à nature pornographique, ce que je n’avais
jamais fait. Au début, j’étais un peu réticente, car pour moi ce genre de film était de nature
vulgaire… En fait, je n’avais vu que quelques extraits (dans des films ou autres) et je n’avais
jamais entendu de bons commentaires à ce sujet.
J’ai quand même décidé de passer outre cela et de me faire ma propre opinion de la
chose : après tout, ça ne pouvait qu’être une nouveauté pour notre couple!
Mon copain connaissait un site (!) et me le proposa. Je réalisai que malgré tout ce que
j’avais entendu, certaines vidéos pour adultes pouvaient s’avérer très excitantes. À partir de
ce jour, [j’estime que] oui, il existe de la mauvaise et dégradante pornographie, mais il
existe aussi certains films qui peuvent ajouter du piquant à une relation sexuelle. J’essaie
de penser aux gens qui jouent dans ce genre de vidéos et c’est bien certain qu’à mon sens
ils ne se respectent pas. Mais si je pense au côté plus « pratique » (je ne sais pas comment
appeler ça) de la pornographie, je dois avouer qu’avec mon copain ce fut une expérience
très agréable pour les deux. Faire l’amour en même temps qu’un autre couple virtuel ajoute
une sensation particulière : le fait que ce soit sur Internet enlève la « honte » que je pourrais
avoir à en louer un [un film] en club vidéo… Cela nous donne un certain anonymat.
(Roxanne)
207
Bref, Roxanne aime la « soft porn », et ne cache pas son plaisir pour la chose. De façon semblable, Mégane
apprécie aussi regarder la porno. Il s’agit surtout pour elle d’une occasion de rigoler avec ses copines, mais,
contrairement à Roxanne qui discuta d’emblée de son plaisir à regarder de la porno sur son blogue, Mégane
n’avoue qu’à demi-mot son plaisir :
Mégane : Mais moi seule devant un site porno, je ne suis pas vraiment intéressée.
Intervieweuse : Ce n'est pas quelque chose qui t’allume?
Mégane : Non. Non, pas vraiment. Ben... [hésitation] Non.
Intervieweuse : Ah! Tu sais, tu peux me le dire!
Mégane : J'hésite et je ne sais pas. Non... [rires].
Intervieweuse : Tu n’a pas à être gênée, j'ai tout entendu.
Mégane : [rires] Non, y a aucun problème. Mais non, je crois, non, pas du tout. C'est
vraiment plus avec des copines, c'est vraiment [le] fun, de commenter les performances du
garçon.
Intervieweuse : Pour le plaisir.
Mégane : Oui, c'est ça. […] Je pourrais dire qu'il y a UN PEU de vice. [rires] C’est un peu
pour le vice. [sourire en coin]
Intervieweuse : Qu'est-ce que tu veux dire par le vice?
Mégane : Je veux dire, bon, pour le plaisir. C'est genre : « Hum hum… OK… », tsé. Et
après, ben d'accord. Je mets la vidéo pour voir. Pour le fun.
Pour Mégane, la porno peut servir à trois choses différentes, selon les contextes. D’une part, pour socialiser et
rigoler entre amies, d’autre part, pour le plaisir de regarder, une fois seule (ou même entre amies, comme un
usage non explicite entre elles), et enfin pour apprendre, car elle se pose beaucoup de questions sur le
déroulement d’une relation sexuelle, surtout les premières fois (puisqu’elle est toujours vierge).
D’ailleurs, l’utilisation de la pornographie pour apprendre est très présente chez les participantes (comme on
a pu le voir brièvement dans la section sur la fellation). Au-delà même des divergences d’opinions des
participantes sur la pornographie, plusieurs disent s’en être servi dans ce but précis, même parmi celles disant
ne pas l’apprécier. L’utilisation de la pornographie pour apprendre semble pour elles dissociable de son
utilisation pour le plaisir, l’intérêt (ou le désintérêt) pour l’une n’empêchant pas l’autre.
208
Par exemple, Camille, qui, comme on l’a vu, n’apprécie pas la pornographie trop « hard », s’en est cependant
servie pour apprendre, notamment en raison de ce qu’elle nomme son « vaginisme » :
Intervieweuse : La porno t'a-t-elle aidée finalement?
Camille : On va dire, oui. […]
Intervieweuse : En quoi t’a-t-elle aidée?
Camille : C'est une visualisation de comment ça marche.
Intervieweuse : Plus qu'un texte?
Camille : Oui, ben un texte peut aider aussi, mais tsé c'est plus l'imagination... [La porno],
c'est plus de la visualisation. C'est sûr qu'un amateur de porno ne va pas analyser ça
comme ça, mais moi c'était plus pour ça.
Intervieweuse : Pour apprendre un peu comment faire?
Camille : Oui.
Océanne s’en est servie très jeune pour confirmer le côté « normal » de certaines pratiques qu’elle avait déjà,
ce qu’elle a trouvé rassurant :
Quand tu es plus jeune et tu commences à te toucher, on dirait [que] tu ne sais pas ce que
tu fais. Tu ne sais pas, tu te masturbes, tsé. J'avais été lire là-dessus, et j’avais trouvé des
vidéos aussi, de la porno, et j'étais intriguée à cause des « dildos » [godemichés]. […]
C’était toutes des affaires que je n'avais jamais vues, et je ne savais pas c’était quoi. En
même temps, j'étais contente, parce que je [venais d’apprendre] ce que je faisais, et j'ai pu
voir, [par exemple,] j'ai remarqué qu'elles jouaient plus avec leur clitoris, et là j'étais
comme : « Ah... OK... Je vais essayer ça », tsé! Là, ça m'a intriguée, à cause de ça, des
dildos et tout.
Intervieweuse : Alors tu as appris ce que tu faisais dans le fond, et comment faire plus?
Océanne : Oui, c’est ça! [rires]
Elle s’en est aussi servie pour savoir comment se déroule une relation sexuelle et à quoi ressemble le corps
des hommes et des femmes. Bref, les images lui ont servi à se « préparer » à ses premières expériences par
anticipation :
Intervieweuse : Quand tu disais que c’était pour apprendre, tu apprenais quoi, exactement?
209
Océanne : Ben je n’avais jamais fait l'amour dans ce temps-là, et là je voyais comment ça
se passait, comme les fellations aussi, j'ai vu comment elle faisait ça. Des affaires de
même, je n'avais jamais vu, comme, de pénis, de corps d'un homme en vrai. Alors là, je
voyais ça et je savais à quoi ça ressemblait, des affaires [comme ça].
Intervieweuse : Penses-tu que ça t'a aidée?
Océanne : Oui, je pense que oui, je pense que ça m'a aidée parce que je n'étais pas
stressée la première fois.
Parfois, la pornographie sert à répondre à un questionnement simple, comme la signification d’un mot :
Intervieweuse : Es-tu déjà allée voir une vidéo porno?
Annabelle : Ouais, […] j'étais allée voir un moment donné, je me posais une question...
Intervieweuse : C'était quoi ta question?
Annabelle : Ben c'était quoi une MILF69? J'avais tapé ça et ça m'avait sorti... [du contenu
explicite]. Et là j'avais compris tout de suite.
Et bien sûr, comme on l’a vu, l’idée d’utiliser la porno pour apprendre à faire une fellation revient souvent.
C’était le cas, par exemple, de Gabrielle et de Sabrina, qui reconnaissent le côté un peu anti-politically correct
de la chose, mais qui ne s’en formalisent pas :
Je voulais faire bonne impression à mon tout nouveau et premier chum […]. Je suis donc
allée sur un site de vidéos XXX et j'ai regardé une fille qui suçait un gars. Ça m'a permis
d'être moins nerveuse lorsque je l'ai fait parce que je savais que c'était ça qu'il fallait faire!
C'est certain que ce n'est pas un moyen très « pédagogique » d'apprendre quelque chose,
mettons… mais ça a été très efficace, car essayer de décrire cela avec des mots, c'est
plutôt difficile. (Sabrina)
À l'occasion encore, mais plus fréquemment entre 17 et 19 ans, j'atterrissais sur des sites
comme YouPorn.com. Bien évidemment, je le faisais sans que personne ne le sache,
voyons, ça ne se fait pas ça! Mais ma curiosité pouvait me garder des heures et des heures
sur ce site! […] Ils proposent toujours des petites vidéos sur les côtés qui peuvent être reliés
ou bien être sur le même sujet, alors j'ai cliqué sur un [lien], puis un autre... Je crois que ça
alimentait ma curiosité et que ça « ajoutait » à mes connaissances de diverses idées,
positions et techniques. C'est de la fiction bien évidemment, mais tout de même, quelque
chose au fond de moi aimait bien ça. Avec un chum, par-ci, par-là, de temps en temps, je
69 Acronyme (vulgaire) issu de la pornographie, qui signifie « Mother I like to fuck ».
210
pratiquais ce que j'avais vu (sans leur dire que j'avais visité YouPorn.com). Des
commentaires que j'en ai eus... ça m'a bien servie! (Gabrielle)
Discussion
Bref, dans l’ensemble, les participantes semblent donc entretenir un rapport ambivalent envers la
pornographie. Si, chez plusieurs, on constate un rejet clair et définitif de la chose, certaines avouent, parfois
un peu à demi-mot, éprouver du plaisir à en regarder, et vont parfois jusqu’à intégrer la pornographie à leur vie
de couple. Pour d’autres, toutefois, le fait que le copain veule intégrer la consommation de pornographie aux
pratiques sexuelles du couple instaure un certain malaise; elles peuvent alors se poser des questions quant
à leur désirabilité, en principe au regard du partenaire seulement. Ce questionnement prend alors des allures
d’un questionnement « éthique » qui met en doute la légitimité du raisonnement du partenaire :
Je suis tout à fait contre la pornographie, donc je ne consulte pas ces sites. Par contre, mon
copain se permet d’y fait un tour de temps en temps. En fait, il me mentionne qu’il a le droit
d’y aller autant de fois qu’il le désire sans que je sois obligée de le savoir. De plus, il pense
que cela ne peut pas nuire à notre couple. Je crois évidemment le contraire. Pourquoi va-t-il
sur ces sites? Peut-être ne suis-je pas assez bien et belle pour lui. Pour lui, ce n’est pas la
question. Il m’a mentionné que c’est une sensation qu’il ne contrôle pas, soit le goût de se
masturber. Donc, dans ces moments, il va consulter les sites pornographiques. Je me suis
absentée plusieurs mois cet hiver et un mois cet été pour voyager donc je suis consciente
de ses besoins et je préfère qu’il consulte ces sites que d’aller voir d’autres filles. Mais
lorsque je suis ici, à Québec, a-t-il vraiment besoin de se soulager devant ces photos de
filles parfaites et REFAITES? On en a discuté à plusieurs reprises et je crois qu’il fera
attention à l’avenir. Dans un sens, je dois le respecter là-dedans, car je sais qu’il n’est pas
le seul gars à faire cela. J’ai appris qu’il allait sur des sites pornos étant sur son ordinateur.
J’ai donc consulté le site pour la première fois et j’ai trouvé ça « quétaine », offensant et pas
de classe! (Laurie)
Ces résultats sont congruents avec ce qu’a trouvé Ciclitara (2004) dans son étude qualitative sur les opinions
et les expériences des femmes envers la pornographie. Elle a trouvé que ces expériences et ces opinions
étaient éminemment variées, personnelles et complexes, et qu’on ne pouvait « réduire » ces expériences et
ces opinions à un seul « profil féminin » monolithique, selon lequel les femmes aimeraient ou n’aimeraient pas
la pornographie.
Malgré l’étendue et la force des débats qui ont eu cours sur la pornographie (voir par exemple Dworkin : 1981,
MacKinnon : 1993 et 1995, Vance : 1992a, Clicitara : 2004 et 1998 et Williams : 1989), peu de recherches ont
étudié de façon empirique les façons dont les gens font usage ou font l’expérience de la pornographie, ou
211
encore comment ils la perçoivent (Attwood : 2005). La grande majorité des études, en particulier dans les
années 1970 et 1980, ont constitué en des études de contenu où les chercheuses, « outrées, voire révoltées »
par ce qu’elles y trouvaient, ont « accus[é] les médias d’être une source d’exploitation des femmes » (Plante :
2004, p. 119). D’autres encore ont cherché à identifier des « effets » de la pornographie (de violence,
d’attitudes objectifiantes des femmes, etc.); elles se sont d’ailleurs pour la plupart révélées inconcluantes,
comme bien des études portant sur les effets en communication, qui ont tendance à concevoir de manière un
peu trop simpliste les procédés de réception et d’appropriation des objets médiatiques (Attwood : 2005, p. 67;
Plante : 2004, p. 119).
Et si plusieurs études ont tenté d’établir un peu gauchement le caractère « nuisible » ou non de la
pornographie, celles qui ont à l’inverse tenté de mesurer les attitudes de la population envers la pornographie
se sont bien souvent basées sur des sondages qui, par la formulation close de leurs questions, échouaient à
rendre compte de la complexité et de l’ambivalence des positions des interviewés (loc. cit.).
Selon Plante (2004), l’objectif des études sur la pornographie est « désormais de comprendre – et non plus de
dénoncer et de juger – pourquoi les femmes privilégient des contenus médiatiques spécifiques » (p. 119).
Selon Attwood, pour réellement offrir un portrait fiable et authentique de l’expérience des gens de la
pornographie, il est nécessaire de miser sur des études qualitatives. Or, selon l’auteure, qui a fait la synthèse
critique des recherches qualitatives sur le sujet, les recherches qui interrogent les femmes en tant qu’usagères
actives de la pornographie sont pratiquement inexistantes (p. 72). Dans les rares études sur le sujet, par
contre, on remarque une chose : celles-ci entretiennent un rapport très ambivalent avec la pornographie
notamment en raison du crédit que plusieurs d’entre elles accordent aux discours anti-porno (Loach : 1992;
Ciclitara : 2004). Partagées entre des discours qui associent la pornographie à la violence et la
« dégradation » des femmes, d’une part, et leurs propres expériences (souvent positives) avec la
pornographie, certaines femmes se trouveraient face à un dilemme idéologique, pratique et politique empreint
de contradictions et de culpabilité. Elles adopteraient alors souvent la perception féministe anti-porno selon
laquelle la pornographie est dégradante et humiliante pour les femmes, mais certaines continueraient tout de
même à en consommer.
Nos participantes n’ont pas soulevé la question du discours féministe, mais on retrouve dans leur discours les
deux pôles qui caractérisent les débats sur la porno. D’un côté, Sarah, Rosalie, Maude et Camille estiment
que la porno montre la sexualité de façon avilissante, voire dégueulasse. Maude, surtout, déplore le fait que
les femmes dans ces vidéos soient objectifiées et jouent presque invariablement un rôle de soumises et de
dominées. Dans des cas extrêmes, elle estime que la femme est montrée « comme un chien à terre », ce qui
la frustre et la répugne.
212
Celles qui, à l’inverse, disaient apprécier la pornographie, ont plutôt misé sur l’aspect « plaisir » lié à la
consommation pornographique. Dans le cas de Roxanne, la pornographie permettait d’essayer « de nouvelles
choses » et « d’expérimenter », et dans le cas de Mégane, de rigoler avec les copines et de ressentir du désir,
une fois seule. Les participantes de l’étude de Plante (2004) avaient aussi mentionné que les films pornos leur
avaient permis « de s’ouvrir, de s’épanouir, voire de s’émanciper en matière de sexualité », de « se
"renouveler" », de trouver des idées et de briser certains de leurs « tabous, préjugés et inhibitions » (p. 124) :
La consommation de ce type de film[s] semble avoir donné à plusieurs le droit au désir et au
plaisir. Les films pornos sont, à leurs yeux, un outil d’exploration sexuelle qui leur a permis
de prendre contact avec leurs sens et avec leur sensualité, d’autant plus qu’il n’y
a personne pour les juger puisque cette activité se déroule strictement en privé. (p. 124-
125)
Et comme les participantes de Plante, nos participantes qui apprécient la pornographie « reconnaissent que
certaines images des femmes peuvent être dégradantes, selon le film » (p. 122) et sont également
conscientes que la consommation pornographique par des femmes est sujette à la réprobation sociale (loc.
cit.)70.
C’est peut-être cette conscience de réprobation sociale, doublée, d’une part, de la reconnaissance du plaisir
que la consommation pornographique peut apporter à certaines, et d’autre part, du choc de voir des femmes
présentées de façon « avilissante », qui portent les participantes de Plante de même que plusieurs des nôtres
à se montrer prudentes dans leurs jugements des pratiques des autres. Rosalie, Maëlie, Mia et Noémie
considèrent par exemple que la consommation pornographique est un choix personnel, et disent ne pas juger
ceux et celles qui en consomment, estimant que c’est « leur affaire ».
D’ailleurs, à l’instar des participantes de Plante (2004), les participantes de notre étude qui disent apprécier la
pornographie montrent qu’elles ont choisi de façon « réfléchie » de regarder de la porno sur le Web, pesant le
pour et le contre de cet usage et s’interrogeant sur ce qui leur convient personnellement. Ainsi, même si
Roxanne et Mégane ont été initiées à la pornographie par leur copain ou leurs amies, elles disent s’être fait
leur « propre opinion de la chose » (Roxanne) et avoir choisi par elles-mêmes d’en consommer, sans ressentir
de pression de la part du partenaire.
70 C’est d’ailleurs l’intérêt, selon Roxanne, de regarder de la porno sur Internet, car ainsi elle n’a pas à subir directement
le poids de cette réprobation sociale en louant un film pornographique en personne dans un club vidéo. Si elle avait dû
louer de tels films en personne, elle estime qu’elle se serait sentie « honteuse ».
213
D’autres études ayant étudié la consommation pornographique par des femmes ont relevé que celle-ci
amenait souvent les femmes à porter un jugement sur leur désirabilité (Eck : 2003, p. 697-698; Shaw : 1999;
Boynton : 1999). Eck (2003), par exemple, a trouvé que les hommes autant que les femmes avaient tendance,
en observant des nus d’hommes et de femmes, à juger de la désirabilité des femmes (plus que des hommes),
mais que les femmes, à la différence des hommes, portaient du même coup un jugement sur leur propre
désirabilité. Shaw (1998) a pour sa part observé que les femmes avaient tendance à se sentir inadéquates,
embarrassées, complexées ou insatisfaites de leur corps en observant du matériel sexuel explicite. Elles
pouvaient par ailleurs se sentir anxieuses des effets que pouvait avoir la porno sur les attitudes des hommes
envers les femmes (p. 206; pour un portrait rapide, voir Attwood, op. cit.).
Cette anxiété, on la retrouve chez plusieurs de nos participantes, entre autres chez Amélie, qui compare son
corps à celui des actrices pornos, et chez Laurie, que l’utilisation de la porno par le copain blesse et
insécurise. Pour Alicia, c’est même précisément le fait que la pornographie montre des femmes dont le niveau
d’agentivité (apparent) lui semble éloigné de sa réalité qui, sans nécessairement l’insécuriser, mine son intérêt
pour la chose :
Parce que dans le fond, sur Internet, ce que tu vois, c'est vraiment... des filles qui ont le
contrôle ou qui se laissent contrôler, et en même temps, ça t'intimide, parce que, je ne sais
pas, moi, si je vois des images [… ] d'une fille qui fait une danse ou peu importe, ben là, je
veux dire, je ne me situe pas du tout par rapport à elle, je la prends pas comme modèle, et
si je la vois se faire attacher ou peu importe, je ne me situe pas non plus [par rapport à elle],
et [je me dis :] « Ben voyons, c'est-tu vraiment ça la sexualité? » Alors on dirait que je ne
me sens pas concernée par ce que je vois sur Internet, par la porno ou peu importe, ça ne
vient pas me chercher. (Alicia)
Il semble clair pour la plupart de nos participantes que la pornographie qu’elles voient sur Internet est une
production médiatisée. Si, lorsqu’elles étaient très jeunes, certaines se sont demandé si la pornographie
représentait la réalité, et si, encore aujourd’hui, certaines ont tendance à s’y comparer, elles réalisent qu’il
s’agit d’une représentation particulière de la sexualité qui ne correspond pas aux pratiques dominantes (un
résultat qu’avait également obtenu Plante : 2004) :
Je trouve que […] la plupart du temps, ce n'est pas trop représentatif de la réalité. Et moi,
ce n'est pas comme ça que je vois la sexualité, je vois plus ça comme un moment intime
entre deux personnes, pas... je ne sais pas comment expliquer ça. Je trouve que la porno,
ça ne représente pas ça. (Mia)
214
Certaines, lorsqu’elles étaient plus jeunes, ont été très déçues de cette représentation, où l’amour et les
sentiments sont absents :
Dans la porno, il n'y a pas de « faire l'amour », c'est vraiment « fourrer ». Moi qui n’avais
jamais fait l'amour, rien, j'étais déçue, parce que j'étais comme : « […] ce n’est pas comme
dans les films ». Dans les films, c'est toute cute. Ça m'avait déçue. (Océanne)
Cependant, malgré cette déception, Océanne raconte qu’elle consomme malgré tout de la pornographie pour
apprendre. Cet usage de la porno pour apprendre, surtout en ce qui concerne la fellation, est en effet si
répandu qu’on le retrouve même chez certaines participantes qui sont « contre » la porno. La pornographie
constitue pour elles une source rapide, facile à utiliser et claire (en ce qu’elle est visuelle) pour répondre
à certains questionnements et à un désir de « bien » performer.
Ce que l’on constate, c’est que les recherches faites en ce sens sur Internet sont effectuées de leur propre
chef et qu’elles semblent les faire principalement pour pouvoir exercer du contrôle sur leurs activités (anticiper,
se préparer mentalement) et sur leur propre projection (ne pas paraître incompétentes).
On verra par ailleurs un peu plus loin que les participantes semblent en général très bien capables de dire
« non » à leur partenaire lorsqu’une activité sexuelle ne les intéresse pas. Le fait d’utiliser la pornographie
pour trouver des réponses à leurs questions afin de mieux contrôler leur vie sexuelle ou pour l’enrichir de
nouvelles activités (nous avons vu plus haut que les participantes avaient tendance à s’ennuyer) nous semble
bien agentique, compte tenu du contexte social et de la pensée dominante sur la sexualité qui leur est
proposée71.
71 Cette utilisation de la porno pour apprendre, d’ailleurs, on la retrouve aussi dans la littérature : certaines participantes
de l’étude de Shaw (op. cit.) avaient mentionné avoir utilisé de la pornographie pour apprendre de nouvelles techniques
et pour augmenter leur propre plaisir sexuel, et les participants de Weinberg et al. (2010) ont aussi estimé que la
pornographie leur permettait non seulement d’apprendre, mais aussi de trouver la motivation, le courage et
l’empowerment nécessaires pour essayer de nouvelles techniques. Les rapports buccaux-génitaux étaient les plus
souvent cités en ce sens, et ce autant chez les hommes que chez les femmes. Un homme de l’étude exprime d’ailleurs
ceci :
Because I watch so much porn, I have confidence when I give oral sex to my female partner. If anything, it’s made
me more confident in my decision making in a sexual situation… Without porn, I probably never would have been
confident enough to perform cunnilingus on a female. (p. 1396)
Un discours qu’émettent aussi les femmes de l’étude :
« Everything I know about oral sex I learned from porn. »
« It allowed me to be more open to try new things. I am more willing to try something to see if I like it, instead of
being scared of trying and never doing it. »
215
Avortement
Les participantes ont exprimé leur opinion sur d’autres sujets controversés, comme l’avortement et
l’hypersexualisation. Comme aucune de nos participantes n’est jamais tombée enceinte, elles ont
principalement cherché sur l’avortement par intérêt personnel pour la question, parce qu’une amie était
tombée enceinte, ou encore parce qu’elles avaient un projet à faire pour l’école sur la question. C’est le cas de
Sarah, qui a fait ses recherches pour l’école, mais qui prend réellement à cœur la question et qui avait discuté
de sa position dans son blogue et en entrevue :
J'avais fait un projet là-dessus, j'avais fait un débat. Il a fallu que je débatte mon sujet, moi
j'étais contre. J'avais été cherché sur Internet et il n'y avait vraiment pas grand-chose
contre, c'était toute pour. Il y avait des raisons, tsé, elle est tombée enceinte parce qu'elle
s'est fait violée, et tout. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont le droit de vivre (les fœtus), tsé, c'est pas
une erreur, ils l'ont fait, il faut qu'ils l'aient. J'avais débattu là-dessus. (Sarah)
Alexandra a cherché sur l’avortement pour mieux comprendre le débat social entourant l’avortement et de
façon à préciser sa position :
Intervieweuse : « Avortement », tu dis : « curieuse, stressée, espérait ne jamais avoir à le
faire... »
Alexandra : [la participante devient très sérieuse] Je trouve ça plate. C’est sûr qu'ils en
parlent quand même à l'école encore, c'est sûr de voir des expériences d'autres filles qui
ont fait ça, ce n’est pas cool.
Intervieweuse : Toi, est-ce que ça t’est arrivé?
Alexandra : Non.
Intervieweuse : Tu ne veux pas que ça t'arrive?
Alexandra : Je ne veux pas que ça m'arrive.
Intervieweuse : Trouves-tu que c'est un sujet plus sérieux que les autres?
« Watching porn [led me to be] less afraid to be loud, made me feel less guilty about wanting sex, wanting
pleasure, and directly asking for it. » (loc. cit.)
Pour une description plus personnelle de la façon dont la pornographie peut permettre l’agentivité, la découverte et le
plaisir sexuels des femmes, voir le texte de Palac (1995), « How Dirty Pictures Changed My Life ». Enfin, pour une
description des façons de lire et d’apprécier la pornographie issue de magazines, voir aussi Smith : 2007.
216
Alexandra : Je pense que oui. Tsé, il y a plein de débats là-dessus, avec la prof
d'argumentation, elle faisait comme un schéma, avec un fœtus et tout, [pour montrer] c'est
quand que tu tues vraiment quelqu'un… Tsé, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui prend ça
de la même manière, et c'est sûr qu'il y a des filles dans la vie qui se sont fait avorter et qui
se sont dit : « Ah, je vais vraiment tuer un bébé », et que d’autres s'en foutent, et tsé, tu te
dis, comment peux-tu vraiment arriver à t'en sacrer solide? En tous cas… Ça dépend aussi
de tes valeurs.
Intervieweuse : Qu’est-ce que tu cherchais sur Internet par rapport à ça?
Alexandra : Peut-être plus comment ça se passait. Ça n’a pas l'air le fun.
Intervieweuse : As-tu déjà eu des amies qui...
Alexandra : Pas à ma connaissance. J'ai juste vraiment effleuré le sujet juste pour savoir.
C'est sûr que des trucs de même, tu es plus portée à savoir vraiment comment ça marche
quand c'est vraiment plus direct, en tous cas moi c'est mon cas. C'est sûr que si j'avais eu
une amie qui [s’était fait avorter], peut-être que j'aurais cherché plus en profondeur à ce
moment-là.
Même chose pour Noémie, qui, pour combler le manque d’information sur la question à l’école, a voulu en
savoir plus ;
Intervieweuse : Tu as parlé d’avortement…
Noémie : Ce n'était pas pour moi, mais je voulais savoir. Moi, ça pourrait être la pire affaire
qui pourrait m'arriver. Ça m'intriguait, comment le monde vivait ça, ce qui se passait, ce
qu’ils font avec... Parce que moi, j'étais dans un programme international au secondaire et
je n'ai pas eu de cours sur la sexualité. […] Alors il y a des trucs qu'on n’a pas abordés,
comme l'avortement.
Émy, quant à elle, a cherché pour aider une de ses amies qui était tombée enceinte :
Un jour ou l'autre, toute jeune femme se pose la question « et si je tombais enceinte? » Une
de mes amies s'est posé la question un peu trop tard. Un de ses petits ovules avait été
fécondé. Dans sa tête, tout était clair, pas question d'avorter cet enfant! Mais à bien
y penser, elle s'est rendu compte qu'élever un enfant lorsque nous en sommes toujours un
n'est pas si facile. Elle s'est donc tournée vers l'avortement.
Pour l'aider, j'ai fait quelques recherches sur Internet, pour trouver les hôpitaux les plus près
qui pratiquaient les avortements. J'en ai trouvé quelques-uns. Elle a donc pu s'informer
davantage auprès de ces établissements.
217
Il est donc évident que sans Internet, il nous aurait fallu chercher beaucoup plus longtemps.
Alors que là, un clic et puis VOILÀ! (Émy)
Discussion
On remarque que les participantes se sentent concernées par l’avortement, qu’elles manquent d’information
à ce sujet, et, évidemment, qu’elles souhaitent ne jamais avoir à faire face à une situation où elles devraient
considérer la chose. Elles prennent le sujet au sérieux et cherchent à mieux comprendre les différentes
positions sur la question. De façon plus générale, la question de l’avortement s’insère dans la problématique
plus large de la crainte de grossesse, que nous avons vue plus haut, qui peut être due au fait qu’elles se
sentent responsables, en raison des scripts de genre, de la contraception ou, à tout le moins, des
conséquences qui lui sont liées. D’autre part, on peut constater qu’elles manquent d’information; sans Internet,
elles n’auraient pas pu approfondir leurs connaissances sur la question, ou du moins leur quête d’information
aurait été largement plus difficile.
Hypersexualisation
Quelques-unes des participantes ont cherché sur Internet de l’information sur l’hypersexualisation. C’est le
cas, par exemple, d’Alicia, de Juliette, de Laurie, de Jessica et de quelques autres. Le fait de voir de
l’hypersexualisation, soit en images, en statistiques ou en vidéoclip, les rend mal à l’aise et elles se
questionnent sur le sujet. En général, elles semblent se demander : « Hypersexualisation : réalité ou fiction? »
et sont ambivalentes quant à la réponse. Plusieurs cherchent des statistiques ou de l’information factuelle leur
permettant de faire le point. Parfois, cet intérêt pour la question fait qu’elles ont choisi l’hypersexualisation
comme sujet de recherche pour un projet scolaire. D’autres encore cherchent de l’information pour elles-
mêmes. Par le biais de cet intérêt, elles questionnent leur propre relation avec Internet et avec la sexualité :
L'hypersexualisation est un phénomène vraiment complexe mais personnellement je sais
qu'Internet a influencé – et influence toujours – le regard que j'ai de moi-même et donc de
ma sexualité, car Internet a le pouvoir de nous rendre normal ou anormal, même si on
retrouve vraiment de tout parce qu'il existe quand même une vague de ce qui doit être
« normal ». Comment être avec un gars, comment séduire les hommes, comment avoir le
corps parfait pour tous les attirer, etc. Tous des titres de chroniques et d'articles qu'on peut
retrouver sur Internet qui amènent parfois à s'autoanalyser et à se remettre en question.
(Camille)
Elle se livre dans son blogue à une réflexion sur le sujet et à une remise en question de la « panique morale »
dont on a parlé au chapitre 3. Elle fait même une différence entre les pratiques extrêmes véhiculées par les
médias et l’hypersexualisation dans son sens large :
218
On a tous déjà entendu parler d'un de ces partys mythiques où les jeux de bouteille sont
devenus un peu trop horny, où les chambres à coucher étaient toutes o-CUL-pées [sic].
C'est toujours déjà arrivé à l'ami d'un cousin, et surtout à une amie de la cousine du voisin...
Bien oui, il s'en passe des choses pas vraiment catholiques dans les partys, mais ce n'est
pas nouveau. […] Il y a de quoi en prendre et en laisser dans [la description qu’en font] les
médias. Je ne dis pas que ça n’existe pas, mais est-ce qu’il y a de quoi faire une manchette
là-dessus, je n'y crois pas. PAR CONTRE, l'hypersexualisation c'est autre chose, et ça se
passe à bien d'autres niveaux dans la vie de la plupart des jeunes filles. Avant même d’en
arriver aux concours de fellation dans un sous-sol... (Camille)
Jessica, quant à elle, a trouvé de l’information sur Internet l’informant que la description que l’on faisait de
l’hypersexualisation dans les médias était parfois exagérée. D’abord surprise par les données, elle a par la
suite réalisé que le discours sur l’hypersexualisation est effectivement souvent sensationnaliste :
J'ai fait beaucoup de recherche sur ce sujet [pour un cours au Cégep]. Je suis allée voir sur
le site de Statistique Canada et j'ai pu voir que l'âge des premières relations sexuelles
diminuait avec les années. […] On disait [ailleurs] qu'il était bien vrai que toutes ces
histoires de « pipes arc-en-ciel » dans les partys, ou bien de fellation dans un bus scolaire,
avaient existé. Par contre, que c'était des cas isolés et qu'aujourd'hui avec les médias on en
faisait une surexposition. On prenait un cas et on l'appliquait à toute une génération. […] Ce
que j'avais trouvé intéressant, c'est que oui, peut-être que les jeunes sont plus sexualisés
de nos jours (j'ai pu le voir avec des chiffres), mais qu'il ne faut pas dramatiser et dire que
tous les jeunes ont une sexualité débridée. Que les histoires extrêmes sont plus mises de
l'avant alors que ce n'est pas le reflet de la réalité. (Jessica)
Elle se dit par contre à la fois « choquée » et « subjuguée » par certains vidéoclips à caractère très sexuel
qu’on trouve sur le Web et à la télé. Elle cite en exemple le cas d’un clip de Christina Aguilera (« Not Myself
Tonight ») qu’elle trouve très déplacé :
Bref, pour provoquer sexuellement, Christina a bien réussi son coup, mais ce n'est pas
vraiment le but d'un vidéoclip. La place de la sexualité dans les clips est aujourd'hui
démesurée; s'il n'y en a pas, on ne trouve pas le clip intéressant. C'est bien sûr un
problème plus grand. Tout de même, après « Not Myself Tonight », j'ai eu de la difficulté
à regarder Burlesque (film dans lequel elle tient la vedette), sans m'enlever de l'esprit
[l’image de] l'actrice porno. (Jessica)
De façon semblable, Alicia, qui a pu profiter d’une certaine confiance et ouverture d’esprit de la part de ses
parents, en comparaison avec ses frères plus âgés, s’inquiète quant au sujet large de la sexualité et des
adolescents, en particulier lorsqu’il sera temps d’en discuter avec ses « futurs enfants » :
219
Quand je pense au futur et à une question que je pourrais avoir sur le Web, je pense à mes
futurs enfants et à leur sexualité. Exemple : quand devrais-je commencer à parler de
sexualité avec ma fille ou mon garçon? Comment devrais-je aborder le sujet? Est-ce que je
devrais laisser l'école le faire pour moi? Comment fonctionnent les cours d'éthique qui
parlent de sexualité aux jeunes? On dit que la sexualité arrive très jeune, à quel âge et
comment prendre ses précautions? (Alicia)
Des exemples qui montrent que les participantes de l’étude prennent au sérieux la question de la sexualité et
des jeunes. Roxanne, par exemple, privilégie une approche ouverte, sans tabous, de la sexualité :
Que les jeunes soient maintenant au courant de tout ne me pose aucun problème :
pourquoi devrait-on leur cacher les vraies affaires? Ne vaut-il pas mieux qu'ils puissent être
au courant de tout sans tabou... ou qu'ils se sentent mal avec leur sexualité... qui est une
chose tout à faire normale et naturelle! (Roxanne)
Sarah, 17 ans, se désole du fait que les jeunes de son école ne prennent pas la sexualité au sérieux et qui
profane celle-ci en tournant le sexe à la blague, ou en disait débonnairement et vulgairement « qu’ils vont
avoir du "cul" le soir ». « Je ne suis pas capable d'endurer ces gens-là, je les trouve irrespectueux, non
seulement envers les autres, mais envers eux-mêmes », écrit-elle.
Discussion
Bref, pour les participantes, la sexualité, c’est sérieux et important; elles se sentent concernées par le sujet de
même que par la façon dont on en parle dans la société et dans les médias. L’hypersexualisation les inquiète
réellement; il s’agit d’un enjeu social qui les interpelle, directement mais aussi pour les « autres » : les
générations à venir, leurs éventuels enfants, etc. Certaines trouvent que les descriptions à caractère
sensationnaliste qu’on en fait parfois dans les médias déforment la réalité et font dévier la discussion des vrais
enjeux. Elles cherchent donc à se former une opinion réellement informée sur la question, ce qui fait que pour
certaines, le fait de chercher sur la controverse liée à l’hypersexualisation constitue un véritable exercice de
critique médiatique.
D’autre part, on peut remarquer ici, à l’instar de Gill, que le discours que l’on trouve dans les médias sur la
sexualité n’est ni toujours inquiétant, ni homogène ou monolithique :
Thus the media might be said to be a key site of sexualization, a key site of concerns about
sexualization, and furthermore, a key site of concerns about concerns about "sexualization".
All this is to highlight the fact that the relationship between the media and "sexualization" is
not uncomplicated. (Gill : 2012, p. 738; les italiques sont de l’auteure)
220
Les façons dont les jeunes femmes utilisent le Web sont en ce sens également complexes et variées (p. 739).
Ce qui apparaît important de soulever ici, c’est que les participantes ne se dissocient pas de la sexualité en
général, mais qu’au contraire elles se sentent directement concernées par le sujet. Puisque le fait de
considérer la sexualité comme un sujet sérieux et important constitue, selon nous, l’un des premiers signes
d’agentivité sexuelle, et puisqu’il est par ailleurs nécessaire de d’abord considérer la sexualité comme
importante pour pouvoir réfléchir sur son droit au plaisir et sur la distribution du pouvoir sexuel dans son
couple, on peut déjà observer que les participantes sont agentiques sur ce plan. Le discours sur
l’hypersexualisation, malgré ses dérapages, permet ici d’éveiller leur sens critique et de réfléchir sur les tabous
et les excès de certaines représentations médiatiques de la sexualité. Nous allons voir, dans la section 5.2,
comment ce sentiment que la sexualité est importante s’exprime concrètement chez elles et comment elles
arrivent (ou, dans certaines situations particulières, tentent d’arriver) à avoir une sexualité égalitaire au sein de
leur(s) couple(s). Mais d’abord, nous allons aborder rapidement deux derniers thèmes liés à leurs recherches
sur Internet, soit les thèmes pour s’amuser et pour « explorer ».
5.1.9 Thèmes pour s’amuser
Même si la majorité des discussions et des entrées de blogue des participantes concernent leur besoin en
information, elles ont également utilisé le Web pour s’amuser et se distraire. Plusieurs ont mentionné avoir
rempli, par exemple, de petits « quiz » sur le Net (souvent sur Facebook). Sans toutefois accorder de la
crédibilité aux résultats, elles les remplissent par curiosité, pour le « fun ». Souvent, certaines en ont déjà
remplis, mais ne voient pas l’utilité d’en faire plus, car elles les trouvent « stupides » ou « ridicules » :
Même qu'entre amies on se faisait des soirées de filles dans lesquelles on faisait des tests
du genre « Quel genre de cochonne es-tu? » avant même d'avoir eu de rapports sexuels.
C'est ridicule quand j'y pense. (Noémie)
Oui, j'ai essayé [un quiz], et je ne l’avais pas publié [sur Facebook], mais je voyais que
quelques personnes l'avaient fait, et je trouvais ça un peu n'importe quoi. […] C'était un peu
niaiseux, j’avais trouvé ça un peu stupide de poster ça [sur Facebook]. (Jessica)
Les quiz, j’en avais fait quelques-uns, comme : « C’est quoi ta position préférée? », [etc.] Je
m’ennuyais juste, j'étais chez nous et je n’avais rien à faire. [...] C'était le fun, c’était drôle.
(Océanne)
De façon semblable, quelques-unes ont mentionné lire des histoires érotiques sur le Web (ou sur papier) pour
se distraire, pour le « fun ».
221
Noémie : Je trouve ça le fun lire ça, c'est drôle. C’est tout le temps des affaires vraiment
intenses. […]
Intervieweuse : Dans quel but lis-tu ces histoires? Juste comme ça, pour te distraire, ou
pour apprendre, ou pour le fun?
Noémie : Pas pour apprendre. Un peu pour me distraire. Je trouvais ça le fun.
Nous observons donc ici que lorsque la participante n’est pas en situation d’inquiétude, il arrive qu’elle navigue
sur le Web en cherchant des trucs sur la sexualité simplement pour chasser l’ennui et se distraire. Nous
notons également que lorsqu’elles tombent sur une occasion de remplir un quiz sur Internet, si elles acceptent
de le remplir, elles n’y accordent pas une grande importance, ce qui témoigne de leur capacité à discréditer
certaines sources ou certains discours.
5.1.10 Thèmes « traumatisants » et thèmes pour « explorer »
Il est arrivé à plusieurs participantes d’être confrontées à du contenu sexuel sur le Net sans que ce contenu ait
été sollicité, du moins pas directement. Si, dans quelques cas, il s’agissait de pop-ups qu’elles regardaient
parfois avec curiosité avant de fermer l’écran, dans la plupart des cas mentionnés, les participantes ont été
confrontées de façon un peu plus intense à des images « live », où un homme se masturbait, alors qu’elles
croyaient qu’elles allaient simplement clavarder avec lui. Elles sont alors tout à fait surprises et ne savent pas
trop comment réagir, prises entre le dégoût et la curiosité. Océanne raconte son expérience :
Océanne : Je chattais avec un gars. Je ne le connaissais pas, il m’avait juste ajoutée, et
j’étais comme : « T’es qui? » Et là, il ouvre sa webcam et il était en train de se [masturber].
Moi, j'étais jeune, je n'avais jamais vu de pénis pour vrai, et au début, ça a fait : « C’est quoi
ça? » et après j'étais comme : « Olé72, qu’est-ce qu’il fait là?! », et là, je n'avais pas aimé ça.
Ça m'avait [traumatisée], j’étais comme : « Yark, man. »
Intervieweuse : Tu ne t'attendais pas à ça.
Océanne : Non...!
Plusieurs ont vécu une expérience semblable, dont Mia, Jessica et Gabrielle. Gabrielle, toutefois, a apprécié
cette expérience, et a ouvert sa caméra vidéo à ce moment en sachant « pertinemment » ce qui l’attendait.
Voici comment cette dernière décrit son expérience :
72 Expression acadienne dérivée de « Holy », marquant la surprise.
222
J'avais 16 ou 17 ans, première année de Cégep, je cherchais l'homme parfait et j'allais sur
des sites de rencontres comme TagQuébec.com et j'ajoutais des garçons sur mon MSN
pour qu'on puisse discuter, et pas simplement pour regarder nos photos.
Alors après plusieurs mois, un garçon après l'autre, j'avais encore espoir d'en trouver un
bon malgré toutes les déceptions. Est arrivé un jour un garçon différent des autres. Il venait
de l'Ouest, je m'en rappelle encore. Après seulement quelques minutes de conversation
MSN, il me demande d'ouvrir ma webcam. Bon ben pourquoi pas... Il est à l'autre bout du
pays, qu'est-ce que ça peut bien faire, je ne le croiserai jamais à l'épicerie. Je savais
pertinemment ce qui m'attendait de l'autre côté de sa webcam parce que le sujet préféré
des deux premières minutes de notre conversation avait été le sexe. Mais par curiosité, je
voulais accepter.
Alors j'ai allumé la webcam et WOWWWW le gars en question se masturbait devant sa
webcam. Pour une fille qui n'a jamais eu de chum... c'est quelque chose à voir…! Dans
l'écran, je ne voyais que son engin et sa main qui le caressait. Mes yeux étaient rivés
à l'écran. Au lieu de fermer la webcam, j'ai continué à le regarder, et ce, jusqu'à la fin
lorsqu'il m'a fièrement exhibé sa main reluisante. Il m'a ensuite remercié. J'étais un peu
traumatisée qu'un pur inconnu se masturbe devant moi par webcam, mais ça me faisait
plaisir. En même temps, ma curiosité a été pleinement satisfaite et même que j'en aurais
redemandé encore par ce moyen Internet fascinant.
L'expérience ne s'est pas reproduite, par peur de me faire pogner, mais cette fois-là, aussi
bizarre et surprenante qu'elle ait été, m'a énormément plu.
Maintenant je n'ai plus besoin de webcam, j'ai mon homme avec moi, mais pour vivre des
premières expériences comme ça, Internet est bien pratique! (Gabrielle)
Si Gabrielle a, d’une certaine manière, recherché activement une telle activité, Jessica, de son côté, a éprouvé
des sentiments partagés envers les usages qu’elle et son amie avaient de Caramail, un site de clavardage qui
n’existe plus aujourd’hui. Elle y participait volontairement, mais était un peu réticente à y prendre part au
départ. Elle qualifie son activité d’à la fois « intense », « amusante » et « épeurante » :
Je me rappelle d'un site de chat lorsque j'étais jeune… Caramail. Lorsqu'on prononce ce
nom, tous les jeunes de mon âge ont la même réaction : « Oh mon Dieu, oui, Caramail! ».
C'était un des premiers sites de chat dont j'ai entendu parler et plusieurs de mes amis
avaient un compte sur ce site. On savait tous la réputation qu'avait ce site; on y allait pour
raconter des cochonneries au premier venu. C'était à la base un site de rencontre, mais dès
les premiers échanges avec une personne, des propositions sexuelles se faisaient déjà voir.
Je me rappelle de la première fois où je suis allée sur ce site. Je devais avoir 11 ou 12 ans
et une de mes amies avait un compte. Elle était allée parler à un gars en se présentant
comme une fille de 16 ans, pesant 110 livres et portant du 36C (je m'en rappelle encore).
J'avais été subjuguée de voir à quel point elle mentait sur la personne qu'elle était et je ne
223
comprenais pas trop quel était l'intérêt de se faire passer pour une fille incroyablement
séduisante alors qu'elle ne parlait à ce gars que pour quelques minutes de sa vie. Ce fut
mon premier contact avec Caramail. Avec le temps, je me suis vite rendu compte que tout
le monde mentait sur la personne qu'elle était et n'allait là que pour raconter n'importe
quelle cochonnerie qui lui passait par la tête, et c'était divertissant. Les gens s'amusaient
à en niaiser d'autres, à faire croire qu'ils feraient les pires prouesses sexuelles avec eux ou
encore à donner de faux rendez-vous pour mettre en pratique ces prouesses. Je dois
avouer que ça m'amusait par moments, mais je ne me suis jamais créé de compte. Par
gêne peut-être, et parce que je n'aurais pas su quoi dire à quelqu'un qui vient me parler en
commençant sa conversation avec : « Veux-tu coucher avec moi? » Je crois que je n'avais
pas, à cette époque, assez de distance face à la sexualité pour prendre tout ça à la blague.
Pour moi le sexe à 12 ans était un sujet controversé et je ne me voyais vraiment pas en être
sexuée qui pouvait attirer l'autre sexe. Au contraire, cela me rendait plutôt mal à l'aise. Mais
bon, personne n'évolue au même rythme, surtout lorsqu'il est question de sexualité.
(Jessica)
Annabelle a aussi été intriguée par le cybersexe ou une cyberconversation sur la sexualité avec des inconnus.
Intriguée au début, puis non consentante par la suite, elle a décidé de couper court à l’activité avant d’ouvrir sa
webcam :
Annabelle : Je suis allée voir, oui! Mais je n’avais vraiment pas tripé.
Intervieweuse : Comment ça s'est présenté?
Annabelle : […] Il y avait comme six personnes qui étaient venues me parler en même
temps et qui me proposaient d'allumer ma webcam et là, ça m'avait comme vraiment fait
peur. J'avais tout abandonné, je n'étais pas capable. Non non non. Non. Non.
Toutefois, à l’inverse, par exemple, d’Annabelle ou de Jessica, Océanne a aussi utilisé la webcam
volontairement, de façon à pouvoir avoir une vie sexuelle active avec son copain même s’il habitait dans une
autre province :
Intervieweuse : Tu as dit que tu étais « en un sens, contentée, avec les photos, les
webcams ». Vous vous parliez sur webcam?
Océanne : Oui. Oui, on pouvait faire des shows. Moi, je lui en faisais. On aimait tous les
deux vraiment le [sexe], alors là, de temps en temps, ça contentait. Parce qu'on se voyait
[rarement]. On pouvait laisser passer comme un mois avant de se voir...
224
Mais pour les autres, toutefois, la webcam reste associée à une expérience traumatisante qui « force », en
quelque sorte, les apprentissages, et en particulier de la masturbation des hommes :
Je devais avoir environ 12 ans. Je parlais sur MSN avec un gars que je ne connaissais pas
et il voulait mettre sa webcam, alors j'ai accepté. J'ai fait le saut quand j'ai vu qu'il était en
train de se masturber. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait et quand j'ai compris ce qu'il
faisait, je me suis demandé pourquoi il faisait ça (surtout que moi je n'avais pas de webcam,
je ne comprenais pas ce qu'il y avait d'excitant là-dedans). […] Bref, avec Caramail, j'ai
comme découvert que certaines personnes avaient des pratiques sexuelles que je ne
connaissais pas encore à cet âge, qui ne font pas partie de mes valeurs à moi, de ma façon
de voir la sexualité et qui m'ont un peu dégoûtée. (Mia)
Discussion
Outre le fait que l’on remarque qu’une grande majorité des participantes ont fait l’expérience, par les
techniques du chat ou de la webcam, de devenir des « témoins » malgré elles de pratiques exhibitionnistes
d’hommes inconnus – expérience qu’elles qualifient généralement de traumatisante, dégoûtante et intrigante
à la fois –, on remarque à l’inverse que très peu de participantes ont de leur propre chef utilisé la webcam ou
le chat pour leurs propres pratiques sexuelles. Seule Océanne nous a signifié avoir intégré cet outil à sa vie
sexuelle. Ce résultat est congruent avec ce qu’ont trouvé Shaughnessy, Byers et Walsh (2011), qui ont
comparé les expériences sexuelles en ligne de jeunes hommes et femmes hétérosexuels étudiants
à l’université. Beaucoup plus d’hommes que de femmes ont indiqué s’être déjà livrés à des expériences
sexuelles en lignes, qu’elles soient solitaires (c.-à-d. la masturbation) ou avec un ou une partenaire (p. 419).
Malgré les différences de sexe, ces activités n’étaient au final pratiquées que par une minorité d’hommes et de
femmes, et ceux qui ont déclaré ces pratiques ont indiqué ne les pratiquer que de façon peu fréquente. Par
ailleurs, ces chercheurs ont trouvé qu’une fois initiées aux activités sexuelles en ligne avec un partenaire, les
jeunes femmes les pratiquaient de façon aussi fréquente que les jeunes hommes. Cette initiation était souvent
favorisée ou provoquée par leur partenaire masculin (p. 419 et 425). Nous avons vu, dans la section 5.1.7,
que cette initiation du partenaire masculin peut aussi concerner l’utilisation et l’appréciation de la
pornographie.
Mais pour bien comprendre comment le rapport des participantes avec leur partenaire s’exprime et s’actualise,
il est nécessaire d’étudier les façons dont les celles-ci s’affirment, manifestent de l’agentivité et négocient la
distribution du pouvoir dans leur(s) couple(s). C’est ce que nous voyons dans la section qui suit.
225
5.2 Agentivité sexuelle et distribution du pouvoir dans le couple
Comme nous l’avons vu, pour les participantes, la sexualité est une affaire sérieuse. À la lecture des
entrevues et des blogues, on constate d’une part qu’elles s’intéressent à la sexualité, ensuite qu’elles aiment
la sexualité, et enfin que le fait que la sexualité soit vécue pleinement et sainement est pour elles important :
Depuis que je suis toute jeune que la sexualité m'intéresse. […] Dès la maternelle, j'étais
fascinée par le contact des corps. (Laurieanne)
[Moi et mon copain] aimions tous les deux vraiment le [sexe]. […] Je n’ai jamais été gênée
avec ça. (Océanne)
Pour moi, c'est important de comprendre le pourquoi, [le fonctionnement de notre corps].
C'est important d'être au courant de nous-mêmes et ce qui se passe avec nous. (Maude)
Je me rends compte que… si ça fait deux semaines que [mon copain et moi] n'avons pas
fait l'amour, moi, ça n’ira pas mentalement, […] je vais être maussade. […] Je me suis
rendu compte avec le temps, que pour que ça aille bien dans notre vie, avec la personne
que tu aimes, il faut que tu aies une relation sexuelle une fois de temps en temps. Je pense
que ça enlève de la pression, […] ça va mieux partout dans ta vie. Je ne sais pas comment
dire ça, mais c'est un p’tit up, et ça repart à zéro si tu as des petites embrouilles avec ton
conjoint. (Juliette)
Je suis bien avec ce que je suis et tsé, je n'ai pas de misère à le dire, j'aime ça la sexualité
et je suis quand même active. J'ai juste un partenaire, et c'est mon chum, et tsé, je l'aime, et
ça se passe bien comme ça. […] Je ne dirais pas que je suis accro, mais tsé, c'est le fun
quand c'est régulier, quand même. (Maëlie)
Je ne prends pas ça à la légère, mettons. Pas du tout. (Mia)
Bref, pour reprendre l’expression de Roxanne, 20 ans, il est important pour les participantes que leur vie
sexuelle soit vécue d’une façon « qui se veut saine et enrichissante ». Cet aspect « sain » exclut, par exemple,
le fait de faire semblant ou de favoriser le plaisir du garçon à son détriment :
Je pense que c’est quelque chose de grave de faire semblant. […] Je pense que tu ne
devrais jamais faire semblant. […] Tu as le droit autant d'avoir du plaisir que le gars, alors tu
ne fais pas semblant d'avoir du fun. (Jade)
À l’inverse, il inclut le fait de « vivre des expériences » de façon libre et ouverte :
Je pense que dans ma première relation, il n'y a rien qu'on n'a jamais abordé. Je pense
que, vraiment, et en plus on a essayé, on a fait comme plein d'expériences, on a essayé
226
des drogues, on a essayé... Tsé, j'étais jeune et on a comme essayé plein de choses. Et,
c'est pour ça que je trouve ça le fun d'avoir eu une relation [saine avec un partenaire à qui
je pouvais faire confiance], je trouve que chaque jeune devrait avoir une relation quand
même à long terme au début pour partir une bonne expérience. (Alicia)
Et lorsqu’elle est vécue dans une relation de couple, celle-ci doit être basée sur « le respect, la patience et la
compréhension », mentionne Juliette, qui d’ailleurs a publié le lien d’un article sur « les bienfaits du sexe
autant au niveau physique que psychologique » sur son blogue.
La vie de couple et la sexualité forment un tout, selon moi, et si un élément cloche dans un
des deux côtés, le couple ne peut fonctionner à 100 %. […] Je crois que le respect, la
patience et la compréhension sont des clefs importantes pour une vie de couple saine.
(Juliette)
Le fait de vivre la sexualité hors du couple est également présent dans leur description d’une sexualité
« saine ». À titre d’exemple, Alicia explique ici qu’elle a profité du fait d’être célibataire pour vivre des
expériences avec d’autres partenaires, une situation qu’elle a voulu et qu’elle ne regrette pas :
Alicia : C'est moi qui ai décidé de mettre un terme à la relation. On dirait que là, là, je
voulais vivre autre chose, alors tsé, j'en ai un peu profité, et après ça, je me suis refait un
chum. Ça a toujours été des personnes que je connaissais, mais que tsé, ils me
connaissaient de vue ou étaient vraiment des amis. C'était une fois ou deux, mais pas...
[régulièrement].
Intervieweuse : Est-ce que c'était comme des garçons qui t'attiraient sexuellement, mais
que tu ne voulais pas avoir comme couple, ou que tu aurais aimé avoir comme couple, mais
que finalement ça ne marchait pas? Y avait-il un intérêt autre que sexuel?
Alicia : Je dirais que c'est divisé. Il y en a que je pense que c'était parce que je voulais plus,
et les autres, c'est juste parce qu'ils m'attiraient sexuellement. (Alicia)
Bien que l’expérience d’Alicia n’est pas répandue chez les participantes, la part d’une décision « active »,
qu’elle exprime ici est partagée et fait partie de leur vision générale d’une sexualité saine. Mégane, 20 ans,
explique que la raison pour laquelle elle est toujours vierge est que justement, puisqu’elle prend au sérieux la
sexualité, elle n’a pas voulu faire l’amour avec le premier venu. Une décision qui, selon ses explications, nous
semble tout à fait agentique :
J'ai eu un seul petit ami, et je n'ai jamais couché avec lui!!! Il ne m'en donnait pas vraiment
envie!!! Mes copines me disent que c’est parce que je lis trop de Harlequin, c'est possible!!!
227
Mais pour moi le sexe, c'est quelque chose d'assez sérieux. Je n'ai pas envie d'avoir des
rapports pour le regretter après. J'ai vu beaucoup trop d'amies pleurer ou regretter leur
première fois! Ce qui fait qu'à 20 ans je suis encore vierge. C'est un peu bizarre, mais c'est
comme ça. Cela ne m'empêche cependant pas d'être très curieuse des choses qui s'y
rattachent. (Mégane)
Pour Mégane, il est important de pouvoir choisir le moment où elle fera l’amour pour la première fois. Elle
n’hésite pas à nous corriger quand nous saisissons mal la véritable raison de son attente :
Intervieweuse : Si je comprends bien, toi, c’est clair dans ta tête que tu n’es pas prête.
Mégane : Oui. Enfin, non, ce n’est pas ça. Je dirais juste que tsé, mes copines trouvent que
j'ai attendu trop longtemps. Et maintenant, ce serait bête de juste coucher avec quelqu’un,
tu vois. Donc, c'est sûr que quand je rencontre la personne, j’aimerais qu'on fasse un bout
de temps d'abord ensemble avant de coucher ensemble, tsé. Je n'ai pas envie de faire un
jour ou une semaine, et hop!
Intervieweuse : Tu veux que ce soit significatif?
Mégane : C'est ça. Voilà, oui. Je me dis, autant se connaître un peu, tsé, je ne dis pas
d'attendre six mois ou quelque chose, mais juste qu'on se connaisse, quoi.
Discussion
Bref, toutes les participantes semblent savoir ce qu’elles veulent : vivre une sexualité « saine » et
« enrichissante » dans une relation « basée sur le respect » où elles pourraient exercer leur pouvoir
décisionnel de façon active. Toutefois, leurs expériences de la sexualité ne se font pas toujours sans heurts, et
l’exercice de leur pouvoir rencontre parfois certaines embûches. Nous examinons dans cette section comment
elles considèrent que leur sexualité se vit dans leurs pratiques, ce qu’elles souhaitent modifier et le niveau de
pouvoir qu’elles souhaiteraient atteindre, le cas échéant. Nous soulevons également les points communs des
situations où certaines d’entre elles estiment ne pas avoir su ou pu exercer le niveau de pouvoir qu’elles
souhaitaient.
À la manière d’Albanesi (2010), pour évaluer la distribution du pouvoir dans le couple, nous avons posé aux
participantes la question suivante : qui, de ton partenaire ou de toi-même, contrôle les activités sexuelles du
couple? Pour les aider à exprimer leur conception de la distribution du pouvoir, nous leur avons demandé
d’imaginer une balance et de nous indiquer comment le pouvoir se distribuait entre elles et leur partenaire.
Nous leur demandions ensuite de répéter l’exercice de la balance pour montrer comment elles aimeraient que
le pouvoir soit ou ait été distribué.
228
Cet exercice était répété pour chacun des partenaires qu’elles avaient eus; dans le cas d’une participante
n’ayant jamais eu de partenaire, nous demandions alors comment elle croyait que, compte tenu de sa
personnalité ou de la perception de son propre pouvoir, celui-ci se distribuerait si elle avait un ou une
partenaire en ce moment.
Les réponses que nous avons obtenues sont étonnamment similaires à celles qu’a obtenues Albanesi (2010),
qui avait observé que les perceptions de la définition même du pouvoir étaient différentes selon que le
répondant était un homme ou une femme :
When I ask in the interviews who is more in control of the sexual encounter, the man or the
woman, responses fall almost uniformly along gender lines. Men fairly consistently respond
that they think the women are the ones in control while the women think the men are. [...]
When I press them to elaborate, women point to the expectation that the man would initiate
the encounter and be the one to escalate to each new stage of sexual activity. Thus, control
for the women is about who is the one orchestrating events [...]. The men, on the other hand
[...] identify the woman’s role as a potential gatekeeper as the most apparent assertion of
control. Thus, control for the men is in the hands of the one who might stop the encounter.
(Albanesi : 2010, p. 146)
Cette observation laissait croire à la chercheuse que la perception du pouvoir dans le cadre de relations
sexuelles était une conception tout à fait genrée. Or, si nos résultats et le cadre même de notre étude ne
permettent pas une telle observation (puisque nous n’avons interrogé que des femmes), nous obtenons les
mêmes types de raisonnement dans la conception du pouvoir chez les participantes, ce qui laisse penser que
pour elles, le pouvoir se résume, de façon plutôt caricaturale, à deux éléments : qui initie les relations
sexuelles, et qui se permet de les refuser. Nous observons ces deux dimensions en détail dans les deux
prochaines sections.
5.2.1 Une initiation difficile
La plupart des participantes qui sont en couple estiment avoir une relation plutôt égalitaire avec leur
partenaire. Si elles se sentent bien dans leur relation, expliquent-elles, c’est que leur partenaire les écoute, les
estime et les comprend. L’échange entre les partenaires et une bonne communication semblent être pour elles
la clé d’une relation réussie. Cependant, malgré une très bonne relation avec leur copain (ou copine), elles
estiment qu’un aspect de la relation est inégal, et cet aspect concerne l’initiation des relations sexuelles.
Comme elles ont souvent un peu moins d’expérience que leur partenaire (et même lorsqu’elles en ont autant),
elles se laissent « guider » par lui, et évitent ainsi de prendre les devants dans leur sexualité, surtout au début
de la relation :
229
Au début, tsé, je n'avais jamais fait ça, j'étais plus du genre à me laisser guider. Lui, c'était
sa première fois à lui aussi, mais je ne savais pas s'il connaissait plus ça, mais on dirait qu'il
savait plus quoi faire. Au début, il me disait plus quoi faire, et je le faisais, mais après ça,
c'était plus égal à égal, je dirais. En même temps, j'étais gênée aussi dans la relation. Tsé,
tu commences, ce sont les débuts, alors j'étais peut-être plus gênée de proposer des
choses, mais après je dirais que c'était plus égal à égal. (Roxanne)
Progressivement, elles arrivent à parler de leurs désirs à leur copain ou à prendre l’initiative, mais l’initiation
semble rester problématique, même lorsqu’elles désirent vraiment une relation sexuelle :
Maëlie : Au début de mon couple, quand on a commencé à sortir ensemble, tsé, tu dis : est-
ce que c’est normal que... tsé, ça fait longtemps on dirait qu'on n’a pas fait l’amour, et là...
pas que je m'ennuie, mais j'ai comme hâte que ça se refasse, et au début, j’étais comme...
voyons, tsé, je ne suis pas normale... Tsé, je ne dirais pas que je suis accro, mais tsé, c'est
le fun quand c'est régulier quand même.
Intervieweuse : À ce moment-là, le disais-tu à ton chum?
Maëlie : Euh... non. [rires] Non, non, non. Parce qu'on ne se voit pas non plus chaque jour,
on n'habite pas ensemble, mais tsé... j’avais juste comme hâte de le revoir, pas juste pour
ça, mais c'était une des raisons.
Intervieweuse : Est-ce qu’il y a une raison pour laquelle tu ne le lui disais pas?
Maëlie : Non. […] Ben peut-être oui, peut-être qu'il y avait une raison, peut-être justement
parce que je me demandais : est-ce que je suis... ben pas, est-ce que je suis normale, mais
j’étais moins ouverte à en parler avec lui justement à cause de la gêne.
Intervieweuse : Et là, maintenant?
Maëlie : Ben on est comme sur la même longueur d'onde là-dessus, alors... […] Ça arrive
quand ça arrive.
Maëlie estime qu’elle a beaucoup moins de difficultés à présent à discuter de sexualité avec son copain :
Je suis bien avec ce que je suis et tsé, je n'ai pas de misère à dire, tsé, j'aime ça la
sexualité et tsé, je suis quand même active. J'ai juste un partenaire, et c'est avec mon
chum, et tsé, je l'aime, et ça se passe bien comme ça. (Maëlie)73
73 Il est à souligner que cette citation a déjà été rapportée plus haut. Il est possible, en effet, que tout au long de la
présentation des résultats, nous répétions certaines citations pertinentes dans différents contextes d’analyse.
230
Toutefois, le fait qu’elle dise « ça arrive quand ça arrive » montre qu’elle évite encore d’initier ouvertement les
relations sexuelles, même si elle réussit à parler de sexualité avec son copain.
Pour Jessica et Rosalie, le fait de « demander » leur apparaissait aussi gênant :
Intervieweuse : [Concernant la balance du pouvoir], avec ton deuxième chum, comment ça
se présente?
Rosalie : C'est égal, vraiment. On se parle, chacun… C'est vraiment comme égal. Il n’y en
a pas un qui est plus haut que l'autre.
Intervieweuse : Est-ce que c’est égal aussi si on considère la balance plus selon le fait
d'initier la sexualité?
Rosalie : C'est encore dans le milieu. Pas mal égal.
Intervieweuse : Et avec ton premier chum, est-ce que c’était la même chose?
Rosalie : Non. C'était pas mal plus lui en haut.
Intervieweuse : Avec ton premier chum, si lui était comme ça, aurais-tu aimé que ce soit un
peu plus...
Rosalie : Égal, là.
Intervieweuse : Qu'est-ce qui fait que tu ne pouvais pas te rendre jusque là?
Rosalie : Je ne sais pas, sûrement parce que je suis vraiment une fille gênée, mais là
maintenant je suis moins gênée, mais j'étais vraiment une fille gênée [avant], je ne pouvais
pas m'assumer, dire : « OK, ce n'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. » Ce n'était
pas de même que j'étais avant.
Pour Jessica, le fait d’initier ne lui semble pas, à la limite, si important :
Jessica : C'est sûr que si je n’aime pas [ce qu’il fait], je vais lui dire : « Non, arrête! » Mais je
ne demande pas beaucoup, je l'avoue. Je ne demande pas beaucoup : « On peut-tu
essayer ça? », ou « Peux-tu faire ça? » […] Je pense que je ça, je suis un peu gênée de le
faire, d'exprimer mon désir et de lui demander d'essayer. […] Des fois, j'ai une idée qui me
traverse l’esprit, mais je n'ose pas le lui demander et je me dis : « Bah, ce n’est pas si
important de le faire non plus…» Ça m'a juste traversé l'esprit, alors ce n'est pas... [si
grave]. Je ne sais pas. On n’en parle pas beaucoup en effet. C'est plus vraiment : ça arrive
ou ça n’arrive pas.
Intervieweuse : Aimerais-tu avoir le courage de demander plus de choses?
231
Jessica : Ben oui pis non, parce que je ne me sens pas mal là-dedans en tant que tel. Je
trouve qu'on s'en sort quand même bien. Ce ne sont pas des choses qui me trottent [dans
la tête] et que je me dis : « Ah, j'aimerais vraiment, vraiment essayer ça. » Parce que c'est
sûr que si j'aimerais vraiment vraiment ça l’essayer, ben je vais lui en parler. Ce sont plus
de petites choses que je me dis : « Ah, ben, ça aurait peut-être pu être le fun de le faire,
mais si je ne le fais pas, bah, ben ça ne me dérange pas, je trouve que ça a quand même
été bien, et que ça a quand même été le fun. » Ce n'est pas vraiment en tant que tel le
courage, mais c'est juste, je pense que je lui accorde pas tant d'importance que ça, et je ne
me sens pas mal non plus par rapport à ça. […] C'est sûr que si j'avais un jour vraiment
envie d'essayer de quoi, je pense que je serais capable de le lui dire, mais c'est juste que je
crois que je n'en ressens pas assez le besoin.
De façon semblable, Juliette, qui estime exercer environ 75 % du pouvoir dans le couple dans la vie en
général, estime que c’est inversé dans le domaine de la sexualité :
Juliette : En général, je dirais que si je regarde ça durant une année, 75 % du temps, c'est
lui, durant l'acte sexuel, qui aurait plus le contrôle que moi, à 75 %. Mais c'est drôle, parce
qu'en dehors de ça, dans notre vie de couple en général, je dirais que moi, j'ai le contrôle
à 75 % et lui, à 25 %.
Intervieweuse : Qu'est-ce qui fait la différence?
Juliette : Ben comme j'ai dit tantôt, juste prendre des initiatives de la vie en appartement.
[…] Dans la vie en général, je pense que je prends plus le contrôle, et je pense que lui, il me
laisse prendre ce contrôle, et ça ne l'embête pas.
Pourtant, comme Jessica, Juliette ne souhaite pas nécessairement que la situation change :
Intervieweuse : Qu’est-ce que tu aimerais que ce soit, dans un monde idéal?
Juliette : […] Je dirais 90 % pour lui et 10 % pour moi. Justement, je prends tellement le
contrôle et la place ailleurs que dans la sexualité, ben dans la sexualité, vas-y, prends toute
la place et décide. Ce côté-là, ça ne me dérangera pas.
Si elle ne souhaite pas un changement, dit-elle, c’est qu’elle lui fait confiance, et qu’elle se sent un peu
coupable de tant gérer la vie quotidienne :
Intervieweuse : Pourquoi ça ne te dérangera pas, est-ce parce que c'est moins important le
sexe, pour toi? […]
232
Juliette : Je te dirais [que] j’aime ça comme ça. Moi, je suis peut-être meilleure pour savoir
que les fenêtres sont sales, ou peu importe, mais lui, côté sexe, je trouve qu'il est habile,
et… il fait ça d'un air assuré, et je le connais depuis longtemps, moi ça ne me dérange
pas... pas de lui laisser mon corps, mais tsé, « vas-y, moi je te fais tellement confiance, que
tu peux tout décider ». Mais tsé, le 10 %, j'ai mon mot à dire, mais je lui fais confiance. Et je
pense qu'on se connaît assez bien, il n’exagérerait pas quand même. […]
Intervieweuse : Ça m'étonne que tu veuilles lui céder tout ça, mais qu'est-ce qui fait que ça
ne te dérange pas, à part le fait que lui, il faille bien qu'il décide quelque chose. Comment
vois-tu ta sexualité, est-ce que c’est quelque chose de nécessaire dans ta vie, ou pas du
tout? Quelle est la place, l'importance que tu accordes à la sexualité?
Juliette : Ben je dirais qu'avec le temps, j'en accorde plus. Je me rends compte que... tsé,
moi, je vis avec mon chum, si ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait l'amour, moi, ça n’ira
pas mentalement, […] je vais être maussade. On dirait que je ne voulais pas voir que c'était
ça, mais je me suis rendu compte avec le temps, pour que ça aille bien dans notre vie, avec
la personne que tu aimes, il faut que tu aies une relation sexuelle une fois de temps en
temps. Je pense que ça enlève de la pression, ça enlève toutes les... [petites embrouilles].
Ça fait comme repartir à neuf un petit peu toutes les fois.
Elle précise ici pourquoi elle le laisse guider :
Juliette : Je le connais, tsé, je SAIS qu'il ne fera pas des choses qui vont me déranger. J'ai
le sentiment... C'est juste, je suis certaine de ça, je le sais qu'il ne fera pas des choses que
moi, je ne voudrai pas. Et tsé, ce n'est pas un garçon dans le genre extrême, alors je le
connais bien, c'est pour ça que je dis que je suis à l'aise à 80 %, mais parfois, comme j'ai dit
tantôt, des petites inquiétudes, comme dans le sens, « Ah, ça me tente moins aujourd'hui,
je ne le lui ai pas dit, est-ce que j’aurais dû lui dire? »
Intervieweuse : Dans le sens éthique un peu?
Juliette : Oui.
Intervieweuse : Tu dis que tu as confiance en lui. Ma question, c'est : est-ce que tu as
confiance en toi aussi?
Juliette : Oui, ben si... Oui, je pense que oui, si je mets ça en pourcentage, ben peut-être un
peu moins que l'autre, 75 %, 70 %. Oui. Parce que j'ai... tsé, moi, je trouve que je ne suis
pas très... comment on dit ça... Je n'ai pas beaucoup d'expérience, ça fait juste trois ans
que je fais l'amour, lui a 26-27 ans, donc tsé, j'ai vraiment l'impression qu'il m'en reste
à apprendre et j’aime ça comme ça. J'aime ça être certaine de moi, mais pas trop, je pense
que c'est correct avoir des doutes, et justement, ça permet de poser des questions.
233
Elle note qu’il y a eu une évolution dans sa façon de voir la sexualité :
Juliette : Je dirais que la plus grande évolution, c’est plus du côté que moi, je me sentais
à l'aise. Plus ça avance, même après trois ans, mieux je me sens, et ça se fait ressentir
même dans la vie de tous les jours, pas nécessairement juste dans cet acte-là. Ça a fait
que, côté sexualité, je me sentais plus une femme, mentalement tu réalises des choses, tu
réalises que dans la vie, c'est important de s'aimer, plein de choses quand même assez
grandes. […] Juste une évolution mentale depuis trois ans.
Discussion
Même si on peut trouver dommage que Juliette laisse ainsi à son copain une grande part décisionnelle de sa
sexualité, il faut souligner la très grande conscience qu’elle a de la distribution du pouvoir dans son couple, de
même que la relation de confiance qu’elle a réussi à établir avec son copain. Décider de ne pas s’ingérer plus
dans sa vie sexuelle constitue, de son point de vue, une décision qui correspond à la définition de l’agentivité
(savoir ce que l’on veut, gérer la sexualité de façon à être à l’aise avec ses choix), mais qui ne correspond pas
nécessairement aux attentes idéalistes telles que décrites (et critiquées) par Lamb (2010) :
A healthy sexuality for the adolescent female thus must combat objectification, victimization,
and the stereotype of passivity. She ought to learn about, understand, and identify desires,
feel sexual feelings in her genitals, use full reasoning ability in making choices, be
uninfluenced by romance narratives and beauty ideals from TV, books, or movies, pursue
her own pleasure as much or even more than her partner’s, and exist always as a subject
and never as an object. She can not be passive, and must be an agent; she ought to know
both how to consent and how to refuse sex; and perhaps more importantly, unambivalently
know if she wants to consent or refuse (see Muehlenhard and Peterson 2005 […]). Beyond
her personal sexuality, her desire also ought to be connected to political issues she needs
to be aware of. […] Does it not sound too idealistic? (p. 299)
Selon Lamb, on demande beaucoup aux filles, et sûrement beaucoup trop. Cet idéal de la sexualité agentique
sur tous les plans, Lamb l’estime difficile à atteindre pour les femmes adultes et encore plus pour les filles.
Cette pression d’être agentiques (dans le sens décrit ci-haut) en tout lieu et en tout temps lui apparaît
excessive, et nous partageons ce point de vue. D’ailleurs, le cas de Juliette peut être perçu comme n’étant pas
très problématique, puisqu’elle considère que la sexualité est importante (et le réalise de plus en plus), et dit
« se sentir femme ». Si elle ne ressent pas le besoin de prendre plus de décisions sur le plan de sa sexualité,
c’est en grande partie, dit-elle, parce que sa sexualité actuelle – vécue avec un copain aimant et compréhensif
– lui convient et répond à ses besoins. Bref, elle est ainsi d’accord avec les pratiques et les attitudes de son
copain, et à l’aise avec sa décision. Sa situation est ainsi tout à fait différente de celle d’Amélie, par exemple,
234
qui souhaiterait exercer beaucoup plus de pouvoir dans sa sexualité, mais qui, selon sa propre interprétation,
n’y arrive pas.
Entre autres aspects, Amélie a vu son pouvoir décisionnel baisser de plusieurs crans après que son copain
l’ait laissée et qu’elle s’en soit fait un nouveau. Le fait d’avoir été quittée a miné sa confiance en elle-même.
Elle attribue la baisse de son pouvoir décisionnel à une nouvelle peur de décevoir et d’être à nouveau laissée :
Intervieweuse : Entre toi et lui, qui est le plus entreprenant, qui prend le plus l'initiative?
Amélie : C'est ça qui est bizarre, on dirait que tout mon contrôle, que ce soit sur la sexualité
ou autre chose, a comme renversé. Quand j'étais avec mon ex, on dirait que c'était plus moi
qui avais le contrôle. […] On dirait que c'était plus souvent moi qui lui en parlais, tsé qui
faisais des avances et qui commençais des choses, malgré que lui aussi en faisait, c'était
peut-être plus égal. Dans [mon ancienne] relation, quand [on faisait les magasins], c'était
moi qui étais en avant souvent, et lui suivait, tandis que là quand je marche dans un
magasin avec mon chum actuel, c'est tout le temps lui qui est en avant et c'est moi qui suis.
Lui, on dirait que je le laisse contrôler tout. On dirait qu'avant, avec mon ex, souvent, je
faisais les avances, tandis que là, je n'ose pas les faire. C'est bizarre un peu, tsé souvent
j'ai vraiment envie [de faire l’amour], mais je ne fais rien, parce que je me dis, s'il en avait
envie, il me ferait des avances. On dirait que j'attends tout le temps que ce soit lui, et quand
on le fait aussi, c'est tout le temps lui qui décide comment on se place. Je ne prends aucun
pouvoir on dirait.
Intervieweuse : Aimerais-tu ça en avoir plus?
Amélie : Oh oui. Comme souvent, on dirait que j'ai des envies, et que je ne fais rien. Tandis
que peut-être, si je faisais des avances, j'aurais ce que [je veux].
Intervieweuse : Tu dis que tu n'as aucun pouvoir. Est-ce que c'est vraiment 0 % pour toi, et
lui 100 % du pouvoir?
Amélie : Ben ce n'est pas... il me laisserait en avoir, tsé, c'est sûr, si je me mettais là [et que
je démontrais du pouvoir], ça ne le dérangerait vraiment pas, et peut-être même qu'il
aimerait mieux ça, mais là tout de suite on dirait que je ne m'en donne vraiment pas. Je
pense que j'en ai zéro. On dirait que c'est tout le temps tout lui qui décide. Mais j'aime ça
pareil, tsé, c'est juste des fois, il y a d'autres choses que j'aimerais essayer, mais je ne
prends pas ma place là-dedans... J'ai trop peur de déplaire depuis que l'autre m'a laissée.
On dirait qu'il y a plein de choses de moi qui ont comme changé. On dirait que je ne veux
plus rien faire de mal, et je veux tellement qu'il soit bien, parce que l'autre n'était plus bien,
je veux tellement qu'il soit bien, que je ne prends plus vraiment ma place. Je pense que ça
vient de là.
Intervieweuse : C'est la peur de décevoir.
235
Amélie : Oui, c'est ça.
Toutefois, Amélie sait que l’atteinte de ce pouvoir est à sa portée, mais sa peur d’être à nouveau laissée la
paralyse :
Intervieweuse : Comment tu penses pouvoir te rendre à ce niveau idéal de partage de
contrôle? Et comment tu penses que tu pourrais te rendre là? Te sens-tu capable?
Amélie : Je serais capable certain. C'est dans ma personnalité; avant, avec mon ex, je
disais ce que j'avais à dire, et quand il y avait quelque chose qui ne faisait pas mon affaire,
je lui en parlais, tsé, je me respectais, je donnais mon point de vue et je voulais que les
choses s'arrangent, mais c'est le fait de m'être fait laisser qui m'a fait changer ça. C'est tout
de suite que je ne me sens pas moi-même. En même temps, des fois, je me dis, j'ai peur
que là tout de suite ça aille tout bien et que quand je me mettre à être moi-même, que là ça
fasse que lui n'aime pas ça […] Je me dis que ce serait facile de juste reprendre ce
contrôle-là, j'ai ça en moi, mais c'est juste que tout de suite, je ne le fais pas.
Intervieweuse : Pourquoi?
Amélie : Je ne veux pas me refaire laisser. Mais je serais capable de le reprendre [le
contrôle], mais je me dis... J'ai envie que l'autre soit plus heureux que moi, quasiment. On
dirait que je préfère que lui soit bien, et [et que même s’il y a des choses qui me dérangent],
[je vais] juste laisser ça comme ça pour ne pas être blessée de nouveau. J'aimerais mieux
être à la place de la personne qui subit, mais qui ne se fait pas [laisser]... Je ne veux pas
me refaire laisser.
Intervieweuse : Tu fais quasiment un sacrifice tout de suite?
Amélie : Oui, c'est ça.
Pour l’instant, Amélie n’arrive pas à avoir un comportement agentique au sein de son couple, et cette situation
l’attriste. Elle en est toutefois très consciente, et attribue son comportement à un manque de confiance en soi
et à un problème de timidité. On a vu aussi qu’elle craint l’opinion de son copain quant à la grosseur de ses
seins et à l’apparence générale de son corps. Elle s’inquiète également de son incapacité à « se laisser aller »
lors des rapports sexuels, même lorsqu’elle se masturbe. Clairement, Amélie présente un niveau d’agentivité
faible, qui semble lié à sa personnalité à tendance inquiète et peu confiante dans le contexte des normes
sociales.
La situation d’Amélie est donc aux antipodes de celle de Juliette, qui se sent plutôt « bien » dans sa sexualité.
Elle est aussi différente de celle de Gabrielle, qui démontre généralement un comportement agentique, mais
236
qui déplore le fait qu’elle soit devenue en quelque sorte la « gatekeeper » des rapports sexuels. Elle qui avait
presque toujours initié les rapports sexuels trouve difficile que ce soit son copain qui, dernièrement, lui
« demande » de faire l’amour. Surtout, elle déplore la routine qui s’est installée dans son couple et la façon
plutôt maladroite qu’a son copain de lui montrer son désir :
Intervieweuse : Certaines participantes m'ont dit : « Avec mon chum, c’est toujours comme
si mon rôle à moi était de dire oui ou non aux relations sexuelles, comme si c’était à moi de
réguler le fait qu’on le fasse ou non, alors qu’eux ont le beau rôle : ils décident quand et
comment; ce sont eux qui initient. » Est-ce que c’est ton cas?
Gabrielle : Ben je dirais que ça ne l’était pas avant, mais que de plus en plus, tsé, la routine
s'installe, on dirait qu’il y a comme, pas moins de passion, mais on dirait que, par exemple,
si je le vois sur le lit, je ne vais pas faire : « Ah! Go, on fait l'amour! » Sauf que lui fait genre :
« Ça te tente-tu? » Le pire, c’est que d'habitude, c’est tout le temps moi qui lui demande
pour qu'on le fasse, mais depuis un bout, en fait depuis que je me suis fait poser mon
stérilet, mais il paraît que c'est une conséquence qui vient avec, avant c'était toujours moi
qui le lui demandais [qui essuyait un refus] et qui disait : « Ah, c’est correct d’abord… » Tsé,
ce n’était pas grave. J'acceptais son consentement. Mais maintenant c’est plus lui qui me
demande tout le temps : « Tu veux-tu? » C'est oui ou non. Un moment donné, je lui ai dit :
« Je trouve ça plate. C'est rendu qu’on planifie nos affaires. » [On se dit qu’on va écouter
une émission de télévision et qu’ensuite] on va faire l'amour et après on va se coucher.
Mais tsé, ça ne me tente plus après l'émission […], on a comme planifié de faire l’amour,
alors ça ne me tente pas. À un moment donné, je le lui ai dit : « À un moment donné, arrive-
moi et mets-toi à m'embrasser et à m'allumer, et là on va le faire. Ne me demande pas,
genre, "Ça te tente-tu?" ou "Tantôt on le fait-tu?" Plus capable la planification, là... » C'était
comme trop routinier.
Même si elle initie moins qu’avant (une baisse de désir qu’elle attribue à la pose de son stérilet), Gabrielle
démontre cependant un comportement agentique en discutant avec son copain et en faisait valoir ses désirs :
[Je le lui ai dit et] au début il a fait : « Ben là, ce n’est pas si planifié que ça. » Ben oui, c’est
planifié. Lui, quant à lui, on fait l'amour, lui il est content qu'on l'ait planifié ou pas. J'étais : «
Non, moi, ça me turn off quand tu le planifies. » Il a fait comme : « Bon. C’est correct. »
Mettons qu’il ne me le dit plus à l’avance. (Gabrielle)
Bref, elle veille activement à ce que sa sexualité lui convienne, et est capable d’initier, contrairement à Amélie
ou à Juliette, pour qui l’initiation est certainement plus difficile, en particulier pour Amélie.
237
5.2.2 Un pouvoir difficile à atteindre pour certaines
Si ces dernières participantes, comme Gabrielle ou Jessica, estiment qu’il leur semble difficile d’initier les
rapports sexuels, même lorsqu’elles s’entendent bien avec leur partenaire et arrivent à discuter de sexualité
avec lui, d’autres témoignent du fait que l’atteinte d’un certain pouvoir sexuel (allant au-delà du simple fait
d’initier) au sein de leur couple leur semble très difficile. C’est le cas, par exemple, de Laurence, 19 ans. Avec
Amélie, Laurence est l’une des seules participantes à ne pas vraiment faire preuve d’agentivité sexuelle,
surtout dans ses relations antérieures. Cependant, à l’inverse d’Amélie, elle ne semble pas totalement
consciente de son manque d’agentivité. En entrevue, elle discute peu, et se montre relativement timide.
Ici, elle parle d’un garçon avec qui elle était en couple, mais avec qui elle n’avait pourtant pas l’impression de
l’être : il ne lui démontrait pas son affection, ni ne lui disait « Je t’aime ». Avec le recul, elle réalise que tout ce
que son partenaire voulait était axé sur la sexualité, et non sur la relation, alors que ce n’était pas son cas.
Son pouvoir de décision, tout comme sa capacité d’initiation, est à ce moment très faible :
Intervieweuse : De quoi avait l’air la balance, à ce moment-là?
Laurence : Sur le plan de la sexualité? Ben c'était plus tout le temps lui qui, pas qu'il avait le
pouvoir, mais tsé...
Intervieweuse : Qui initiait?
Laurence : Oui. Et moi je ne dis rien, faique.
Intervieweuse : Alors même quand ça ne te tentait pas, tu finissais par faire l'amour parce
qu'il l'avait initié?
Laurence : Oui.
Intervieweuse : Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu te disais dans ta tête?
Laurence : Je me disais... je ne sais pas trop. Ben ça ne me tentait pas tant, alors je me
disais : « Si ça peut finir... » Ce n'est pas smart, mais...
Intervieweuse : Avais-tu l'impression que tu faisais ça pour lui?
Laurence : Ouais. C’est plus ça. Moi, je n’avais pas vraiment de plaisir, mettons.
Intervieweuse : Est-ce que tu avais du désir?
Laurence : Oui... (hésitation) Oui...
238
Ce n’était pourtant pas sa première expérience sexuelle. Avant son premier copain, elle a connu un garçon
avec qui elle avait des rapports sexuels de temps en temps, mais avec qui elle n’était pas en couple. Avec le
recul, Laurence se demande pourquoi elle a accepté ou même pourquoi elle a voulu coucher avec lui :
Laurence : Ben je ne sais pas, on dirait que j’avais plus quelque chose à me prouver à moi-
même. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. […] Il ne m'attirait pas tant que ça.
Intervieweuse : Et là comment tu te sentais quand tu le faisais? Te disais-tu des choses
dans ta tête, du genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? » Ou est-ce que c’est venu
après, ou jamais?
Laurence : Oui, après. Je me disais, bof, ça m'amène quoi?
Intervieweuse : Et là as-tu continué de coucher avec?
Laurence : Oui, mettons. Trois, quatre fois.
Intervieweuse : Qu'est-ce que tu lui as dit après trois, quatre fois?
Laurence : Ben c'est là que j’ai appris qu'il couchait avec d'autres filles. Alors là, j'ai fait :
« Bof. »
Intervieweuse : Étais-tu vraiment fâchée ou pas tellement?
Laurence : Ben j'étais fâchée, mais en même temps, tsé, il ne me devait rien. Ce n'était pas
mon chum non plus. Je trouvais ça quand même un peu sale de sa part. Alors [je me suis]
dit : « Bof… » Je ne lui parlais juste plus.
Laurence s’explique mal son comportement. Lorsqu’elle affirme qu’elle « ne sait pas pourquoi [elle a] fait ça »,
elle semble s’accorder peu de responsabilité – une attitude qui s’apparente vaguement à la
déresponsabilisation du « It just happened » de l’étude de Tolman (1994, 1999) et Gilmartin (2006). Comme si
le fait d’avoir couché avec son partenaire lui échappait – ou comme si son geste n’était ni vraiment volontaire,
ni vraiment involontaire.
Laurence ne s’approprie ainsi que très peu le pouvoir décisionnel relié à sa sexualité – même si c’est elle qui,
finalement, a mis fin à la relation. Cette déresponsabilisation, on la retrouve aussi chez Émy, plus jeune (17
ans) :
Intervieweuse : As-tu des exemples de fois où tu as dû dire : « Ah ben là, ça... [c’est non]? »
Émy : Non, pas vraiment.
239
Intervieweuse : Tout ce qu'il a proposé, tu as dit oui?
Émy : Ben il ne propose pas vraiment des affaires extravagantes, non.
Intervieweuse : Toi, en proposes-tu [des choses]?
Émy : Non.
Intervieweuse : Si tu veux essayer quelque chose, ça ne t’est jamais arrivé [de le
demander]?
Émy : Ça vient comme ça vient.
Même si Émy, comme on va le voir un peu plus loin, se dit tout à fait capable de refuser les avances sexuelles
qu’elle ne désire pas, elle semble considérer, un peu à la manière de Juliette et Jessica, que la sexualité est
du domaine du copain. Elle initie très peu et, comme elle est très timide, elle ne répond que très vaguement
aux questions. Il est donc difficile de déterminer comment elle négocie la sexualité avec ses partenaires.
Laurence, aujourd’hui, a quitté son copain et a cessé toute activité avec son premier partenaire sexuel.
Maintenant en couple, elle estime aujourd’hui éprouver du plaisir à faire l’amour et du désir, même si à ce
sujet elle reste relativement muette. Elle estime que le plaisir est partagé également entre les deux
partenaires, et que la communication entre eux est assez bonne :
On se dit pas mal tout. […] C'est à deux. (Laurence)
Cependant, là où Laurence démontre une certaine maturité par rapport aux autres participantes, c’est dans
son explication de l’amélioration de son niveau d’agentivité. Là où plusieurs estiment que l’amélioration est
due strictement à la personnalité du partenaire, comme on va le voir plus loin, Laurence s’approprie son
évolution, qu’elle associe à la maturité :
Je pense que le choix des gars va avec mon évolution. Je veux dire, dans le fond, les
expériences de vie, et tout, ça a fait que j'étais plus mature, et j'ai pu choisir quelqu'un qui
m'aimait vraiment et qui me respectait, et tout. (Laurence)
Ce choix du partenaire, estime-t-elle, c’est le sien, et donc le résultat de sa propre action. On va voir plus loin
comment la personnalité du partenaire semble avoir une influence majeure sur le développement de leur
agentivité.
240
5.2.3 « Non, c’est non. »
Si l’initiation semble difficile pour plusieurs participantes, et si quelques-unes d’entre elles éprouvent de la
difficulté à s’approprier du pouvoir, la grande majorité des participantes semblent toutefois réussir à démontrer
de l’agentivité dans une sphère précise de la sexualité : dire « non » lorsqu’elles ne désirent pas de relations.
Le fait de « dire non quand c’est non » est un discours que l’on retrouve dans plusieurs curriculums scolaires
et que l’on enseigne généralement aux adolescents très jeunes, même lorsqu’ils sont enfants. Ce discours, les
participantes semblent l’avoir très bien intégré dans leurs représentations de ce que devrait être la sexualité.
Ce point de vue selon lequel on ne peut forcer quelqu’un à faire quelque chose auquel il ne consent pas est
non seulement acquis, mais aussi appliqué par les participantes, et elles le répètent souvent :
Si ça ne me tente pas, ça ne me tente pas. C’est correct pour lui aussi. Il ne peut rien me
forcer à faire, et je ne peux pas le forcer non plus. (Alexandra)
Mettons que mon chum me demandait de faire une position et que je ne voudrais pas, c'est
sûr que je le lui ferais savoir et que ce serait non négociable. (Maude)
La majorité des participantes, comme Maude et Alexandra, connaissent leurs limites et savent les faire
appliquer. La position 69, par exemple, trop apparentée à la pornographie selon Maude, la dégoûte; elle
refuserait donc systématiquement toute tentative en sens, et ferait connaître sa position à son partenaire :
Maude : Ben moi, je trouve ça vulgaire. Moi, personnellement, tsé c'est une opinion, je suis
sûre [que certains gars] doivent triper, mais moi je trouve ça vulgaire.
Intervieweuse : Et le fait que ce soit vulgaire, est-ce que ça va t'empêcher de le faire?
Maude : Ben moi je sais que je le ferai pas. Parce que je trouve que c'est plus, tsé tu ne fais
plus l'amour, c'est vraiment rendu, pas sado, là... mais tsé, c'en est rendu que c'est
dégueulasse, c'est non, c'est... En tous cas, moi, c'est vraiment mon opinion, là, c'est la
femme-objet, ou l'homme-objet, mais j'appelle plus ça de l'amour. Non.
Intervieweuse : Et si, par exemple, tu avais l'impression qu'une position mettait la femme de
façon soumise ou comme une femme objet? Qu'est-ce que tu ferais, si ton chum
commençait...
Maude : Non, non, tsé, arrête. Puis, tsé, il... je lui en parlerais [et je dirais :] « Non, je n'aime
pas ça, et on arrête ça là, puis… Non. »
Même chose pour Noémie :
241
Noémie : Dans ma perception, c'est que mon chum, il a plus souvent envie que moi, tsé
mon chum il le ferait cinq fois par jour, et moi, quand ça me tente, je vais dire oui, et quand
ça me tente pas, ben je vais dire non.
Intervieweuse : Est-ce que tu te sens prisonnière de ça?
Noémie : Non, vraiment pas.
Dans une situation hypothétique, Alexandra n’hésiterait pas non plus à faire respecter son choix :
Intervieweuse : Si tu avais eu dans ta vie un gars qui mettait de la pression ou qui ne
t'écoutait pas quand tu disais non, comment tu penses que tu aurais réagi?
Alexandra : Je ne sais pas. Idéalement, j'aimerais mieux réagir, à la limite de le « cr… » là,
sérieusement. « Cr… », c'est le bon mot. C'est ton corps, faut que tu le respectes. Et si
quelqu’un ne veut pas le respecter, ben tsé, f… you. Sûrement que j'en aurais parlé aussi
avant avec mes amis, c'est quand même un cas grave. On ne sait pas où ça peut mener
[…]. Je suis quand même assez forte là-dessus pour faire « non ». Moi, quand ça ne
marche pas, je le dis. Je ne suis pas gênée là-dessus.
En couple, en général, les partenaires respectent le choix des participantes de refuser certains actes. Se faire
dire « non », pour le partenaire d’un couple solide, n’est pas si grave. Maude montre bien ici la dynamique de
ses refus :
Intervieweuse : Y a-t-il déjà eu une occasion où il t'a demandé de faire quelque chose et
que tu n’as pas voulu?
Noémie : Ah oui, ça oui.
Intervieweuse : Comment ça se passe dans ce temps-là?
Noémie : On est assez directs. Tsé, supposons, on commence à s'embrasser, il va me faire
sa proposition, et si jamais ça ne m'intéresse pas, je lui dis non. Et il fait : « T'es plate. » Et
là on continue à s'embrasser et on fait nos affaires normalement, de la façon dont on est
habitués de faire.
Intervieweuse : Sur une échelle de 0 à 10, est-ce que tu te sens obligée de faire ce qu'il te
demande?
Noémie : Non, vraiment pas. Je me sens zéro obligée de faire... Non, pour ça, je ne suis
vraiment pas « barrée »!
242
Camille, elle, a attendu longtemps avant d’accepter de faire l’amour à son chum, et ce tellement qu’il s’est
impatienté et qu’il l’a quittée. Même si cette situation l’a blessée, elle s’en est plutôt bien remise, car le fait de
devoir toujours refuser et s’expliquer la lassait. Surtout, elle avait l’impression de « payer les frais » d’une
croyance populaire résistante, mais persistait à refuser ses avances :
Camille : Tu te fais tout le temps dire, si le gars t'aime, il va t'attendre, et moi, chaque fois...
[je me préparais mentalement.] Je me disais : « Ah, je pourrais le faire... » Parce que moi,
c'est juste une question de me minder, il faut que ce soit moi qui... il faut que ça vienne de
moi. À chaque fois que je commençais [à être prête mentalement], il me poussait, il revenait
sur le sujet, tsé, et là ça me bloquait.
Intervieweuse : Dans le sens : « Pourquoi tu ne veux pas? »
Camille : Oui. « Heille, wo, là. Je suis en train de commencer à être prête. »
Intervieweuse : « Attends donc un peu? »
Camille : « Attends donc un peu. » Lui, on dirait que c'était vraiment la fin du monde,
d'attendre. C'est comme, là, j'étais en train de me demander : « Je le fais-tu parce que je le
veux, ou parce que lui est écœuré d'attendre? »
Intervieweuse : Là, finalement, est-ce que tu l’as fait?
Camille : Non, je ne l'ai pas fait avec, il m'a laissée. Ben tsé, lui, je pense qu'il prenait ça
comme un rejet. Il ne savait pas pourquoi, il s’est dit « parce qu'elle ne m'aime pas? » Il
n'était plus capable. Il me l'a dit : « Je ne suis plus capable d'endurer ton indécision. » Et je
ne lui avais jamais dit « je t'aime ». Alors il a vraiment pris ça personnel. Ça a fini comme
ça. Ce n'est pas grave.
Intervieweuse : Et toi, ça ne t'a pas dérangé?
Camille : Non, parce que c'était rendu lourd, pour moi. Ça me prenait de l'énergie. Tsé,
quand c'est rendu un poids... « Ben là, il va s'essayer encore, et je vais lui dire non encore,
et il va me reposer la question... » T'as quasiment plus le goût de voir la personne.
De façon semblable, Gabrielle a connu quelques copains dont elle avait l’impression qu’ils ne la respectaient
pas vraiment. Elle aussi, comme Camille, ne laissait pas cette situation affecter son consentement.
Cependant, cela affectait son désir d’initier :
Intervieweuse : Est-ce que les chums que tu as eus avant, le fait qu'ils te respectaient
moins, est-ce que ça affectait la valeur de ton consentement? Je veux dire, tu dis « Quand
je dis non, c’est non, et ça finit là. » Est-ce que là, ça avait moins de poids, cette affaire-là?
243
Gabrielle : Ben... non, parce que si je te dis non, ça va être non, et c'est mieux d'être non,
parce que sinon, ça va brasser. […]
Intervieweuse : À l'inverse, est-ce que ça affecte le fait que tu puisses initier?
Gabrielle : Oui, parce qu'ils me respectaient moins, et j'étais plus, mettons, j'avais plus
tendance à dire non, tout le temps. Ou bien de dire non beaucoup plus souvent que je
disais oui. À cause de ça, à cause qu'ils me respectaient moins, à cause de tout ça.
5.2.4 Le « point de non-retour »
S’il semble aisé pour plusieurs participantes de dire « non » lorsqu’elles ne consentent pas aux avances de
leur partenaire, le refus se complique pour certaines participantes en deux situations : quand la participante a
l’impression de s’être trop « avancée » dans les préliminaires, et quand son partenaire se montre très
insistant.
Pour les participantes qui ont une sexualité où le rapport de pouvoir est plutôt égalitaire et qui sont en couple
avec un partenaire stable et compréhensif (bref qui se soucie du bien-être de sa partenaire), le fait de
consentir aux rapports sans nécessairement les vouloir se limite à faire l’amour alors que ça ne leur tente pas
nécessairement. Elles acceptent alors pour faire plaisir à leur partenaire, ou encore finissent par être tentées
plus ou moins par la proposition. Ce cas, qui nous semble peu problématique, est relaté par exemple par
Maëlie :
Intervieweuse : Y a-t-il eu une fois où tu as eu l'impression que ton partenaire t'a comme
poussée un peu, forcée?
Maëlie : Hum... Je pense que oui, si je comprends bien ce que tu veux dire. Oui, peut-être
que tsé, mettons, par exemple, au début de la soirée, tu te dis : « Ah non, tsé, pas ce soir,
je ne suis pas prête, ça ne me tente pas. » Mais bon, à force d'être avec lui, de se parler, il
continue, il continue, et puis, ah, finalement, OK. Tu as comme une arrière-pensée qui dit
non, mais tu le fais pareil, puis... Mais je ne dirais pas que c'est forcé, c'est plus… Ça se fait
comme ça.
Intervieweuse : Tu dirais que tu es alors consentante à quel pourcentage?
Maëlie : Mettons 90 %. Oui.
Intervieweuse : Parce que c'est quand même ton chum.
Maëlie : Oui. C’est ça.
244
Même si Maëlie finit par acquiescer aux demandes de son copain, elle a toujours été capable de refuser les
avances des autres garçons qu’elle a fréquentés avant lui :
Intervieweuse : Avant d'avoir ce copain-là, est-ce que c'est déjà arrivé des situations pas
tout à fait sexuelles, mais quand même un peu sensuelles [le copain actuel de Maëlie ayant
été son seul partenaire sexuel], où tu ne voulais pas trop et que tu as dû dire non?
Maëlie : Oui, c’est arrivé. Parce que j'ai fréquenté un gars avant, peut-être quelques mois
avant d'être avec celui avec qui je suis présentement, et oui, c'est arrivé. Admettons, il
venait coucher à mon appartement, il était un ami, mais un peu plus, mettons. Et tsé oui, il
me l'a clairement dit : « Ça te tente-tu ce soir? » Et [j’ai répondu] : « Non. » Et là, tsé, il
s'essayait, il s'essayait, puis finalement [j’ai répété] : « Non », et c'est resté comme ça.
Intervieweuse : Quand tu lui disais « non », avais-tu l'impression qu'il t'écoutait?
Maëlie : Non, je pense qu'il comprenait. Oui, je suis assez directe et tsé, s'il le fallait, tsé, je
le répétais et je le disais, mais non, je pense qu'il comprenait.
Maëlie, donc, réussit relativement bien à faire respecter ses décisions, même si elle peut se laisser tenter par
son copain quand elle n’a pas initialement envie de faire l’amour. La situation est donc beaucoup moins
problématique que celle que l’on a appelée, pour l’expliquer aux participantes, le « point de non-retour ». Nous
avons utilisé cette expression pour désigner les situations où elles croyaient s’être trop avancées dans les
préliminaires pour changer d’idée et refuser l’acte sexuel. Il pouvait également s’agir d’une situation où leur
consentement « physique » et « psychologique » ne concordaient pas, et où elles avaient de la difficulté
à décider de consentir ou non aux relations sexuelles (ou à tout acte de nature sexuelle). Nous avons
particulièrement discuté du point de non-retour avec Alicia, 21 ans, qui l’a vécu souvent avec un partenaire en
particulier, et qui en a très bien expliqué les implications, les effets et le contexte dans lequel cette situation se
présentait.
Pour mieux comprendre le contexte dans lequel cette situation s’est présentée, il importe de faire un retour sur
les expériences d’Alicia. Celle-ci a eu deux ou trois copains, mais aussi quelques histoires d’un soir, histoires
qui sont survenues après son premier copain et qu’elle avait entièrement voulues :
On dirait que là, je voulais vivre d'autre chose, alors... j'en ai un peu profité, et après ça, je
me suis refait un chum. Ça a toujours été des personnes que je connaissais, mais tsé, qui
me connaissaient de vue ou qui étaient vraiment des amis, c'était une fois ou deux, mais
pas... [des inconnus]. (Alicia)
245
Même si, avec son premier copain, elle était un peu gênée les premières fois (de se montrer nue, d’avouer
qu’elle était vierge), Alicia estime avoir développé avec lui une relation de confiance, qui lui a fourni selon elle
une base solide pour sa vie sexuelle :
Je pense que ma première relation, je pense qu'il n'y a rien qu'on n'a jamais abordé. Je
pense que, vraiment, et en plus on a fait comme plein d'expériences, on a essayé des
drogues74, on a essayé... Tsé, j'étais jeune et on a comme essayé plein de choses. Et c'est
pour ça que je trouve ça le fun d'avoir eu une relation [saine], je trouve que chaque jeune
devrait avoir une relation quand même à long terme au début pour partir une bonne
expérience. (Alicia)
Avec lui, elle était capable d’initier les relations (chose qu’elle faisait souvent d’ailleurs), et capable également
de les refuser quand ça ne lui tentait pas. Elle estime avoir un caractère fort, et ira même jusqu’à dire, en riant,
que lorsque son copain refusait ses avances, elle se sentait « brimée dans [ses] droits »!
Bref, elle semble adopter un comportement tout à fait agentique, mais lorsqu’elle fait la connaissance d’un
garçon au tempérament particulièrement insistant et sournois, Alicia perd tous ses repères. La relation avec ce
garçon a commencé par ce qui devait être un one-night stand, mais s’est transformée en quelque sorte en une
relation « d’ami pour le lit ». Avec ce partenaire, toutefois, le consentement d’Alicia n’est pas complet : elle
comprend qu’il ne veut que coucher avec elle, et sait surtout que sa façon de se présenter à son appartement
le soir n’est en fait qu’une façon un peu sournoise d’arriver à ses fins :
Alicia : Ce soir-là qu'il est venu chez moi, moi je ne voulais pas du tout qu'il dorme chez moi,
mais il a comme insisté.
Intervieweuse : Finalement, il a couché chez toi?
Alicia : Oui.
Intervieweuse : Et comment te sentais-tu là-dedans? Comment ça s'est passé?
Alicia : En fait, je ne veux pas qu'il vienne chez nous, mais il réussit comme à me dire que
finalement, il veut juste venir boire un verre d'eau chez moi, tsé, et rendu là, il ne veut pas
s'en aller, alors, c'est vraiment... Ça part vraiment de tsé, il n’est même pas encore là et je
ne veux pas qu'il reste, mais... En tous cas, c'est vraiment spécial, mais finalement, il me dit
qu'il veut dormir chez moi, mais qu’il ne veut pas qu'il ne se passe rien. OK, mais tsé, on
sait très bien que c'est faux. Toutes les filles sont tellement naïves, moi la première, [de
dire] « Ah ben tu peux dormir chez moi », mais c'est sûr qu'un gars dans un lit avec une fille
74 Alicia et son copain ont essayé de l’ecstasy, une drogue qui augmente le rythme cardiaque et les sensations
corporelles. Elle est parfois utilisée (illégalement) pendant l’acte sexuel pour amplifier les sensations.
246
qui l'attire, il ne dormira pas de son côté. Un gars comme lui, particulièrement, je veux dire
vraiment égocentrique et vraiment masculin, à fond.
Intervieweuse : Et toi, le croyais-tu quand il disait qu'il n’allait que dormir?
Alicia : Ben je savais... En fait, je le savais, dans le fond, qu'il voulait juste venir dormir chez
moi [pour coucher avec moi], mais moi, la plupart du temps, je crois ce qu'on me dit. Je suis
naïve, dans le fond, parce que j'ai cru qu'il voulait juste passer par chez moi parce que
c'était une tempête de neige et qu'il voulait directement retourner chez lui, mais je suis
vraiment naïve. Peut-être que dans cette situation-là, tsé, je le savais au fond de moi que ce
qu'il voulait, c’était de coucher avec moi. Mais c’est avec d'autres expériences après cette
personne-là que je peux dire que j'étais naïve de croire tout ce qu'il me disait.
Intervieweuse : Tu dis qu'il a réussi quand même à coucher avec toi et ça a l'air un peu
contre ta volonté. Est-ce que tu lui as dit « je ne veux pas »? Ou est-ce que tu ne lui as pas
dit, mais que tu sentais que tu ne voulais pas, mais que dans le fond tu avais l'impression
que tu n’avais quasiment pas le choix?
Alicia : Hum… Ben je le lui ai dit, mais je ne crois pas qu'il s'en souvienne. Mais je le lui ai
dit, dans le fond, quand il est embarqué sur moi, mais comme, tsé, juste embrasser, tsé il
commençait à m'embrasser et tout… […] J'ai essayé de lui dire [quelque chose] comme :
« Je ne pensais pas qu'on allait coucher ensemble ce soir, là. » Tsé, j'ai essayé de lui dire
ça, mais... je ne crois pas qu'il ait tenu compte de ça.
Alicia explique alors comment son consentement était peu pris en compte, mais aussi comment, en raison de
la personnalité du partenaire, elle n’arrivait pas à s’affirmer, à « mettre ses culottes », comme elle le dit :
Alicia : C'est sûr qu'il m'attirait. Tsé, s'il est venu chez moi, juste le laisser rentrer, parce que
c'est sûr que quand tu ne veux pas quelque chose, une personne va vraiment s'affirmer.
Mais moi, je manque, je suis un peu naïve et je manque de colonne [vertébrale]. Je manque
de... je ne mets pas mes culottes et je ne lui dis pas : « OK, je veux vraiment que tu t'en
ailles, là. » Donc je n'ai pas fait ça et je suis un peu influençable, mais de son côté, il est
vraiment manipulateur aussi, donc c'est vraiment ça qui est arrivé, [c’est comme si je lui
disais] : « Ça ne me tente pas vraiment que tu dormes chez moi, mais on dirait que je ne
sais pas comment te mettre dehors, alors dors chez moi. Ça me tente aussi de faire
l'amour, mais je ne pensais pas le faire... » Je trouve que les filles, quand on sort dans un
bar ou quelque part, ou quand notre copain dort chez nous, on le sait si on le veut ou pas,
on pense à ça avant. On dirait que quand c'est comme spontané, ça nous... tsé, sûrement
que lui a pensé à ça toute la soirée, mais moi, je n'ai pas pensé à ça toute la soirée.
Intervieweuse : Ça confronte...
247
Alicia : Oui, ça vient comme me surprendre, et [je me dis :] « Ben voyons, je ne pensais pas
que j'allais faire l'amour ce soir. » Mais lui, probablement qu’en me voyant, il a pensé à ça
toute la soirée, parce que ça lui tentait.
Intervieweuse : Quand tu dis que ça te surprend, est-ce que tu as l'impression d'avoir plus
de difficulté à faire comprendre ton consentement ou ton non-consentement?
Alicia : Oui, parce que tu n'as comme pas de raison, dans le fond. Il est là, il est dans ton lit,
et ça fait plusieurs semaines que tu es toute seule, et là dans le fond, ton physique, ça te
tente, mais on dirait que tu n'as pas pensé à ça avant, alors moi je manquais juste
d'arguments, je ne pouvais juste pas dire « Ben ça ne me tente pas », il m'aurait
probablement dit : « Ben pourquoi je dors ici d'abord? Pourquoi tu me laisses rentrer chez
vous si ça ne te tente pas? »
Elle se sent alors « prise au piège », et attribue une bonne partie de sa difficulté à faire comprendre son
absence de consentement ou son consentement partiel à la personnalité du garçon. Car, dit-elle, même si elle
ne voulait pas ces relations sexuelles, elle y était pourtant relativement consentante :
C’est sûr qu'au début, j'étais vraiment réticente à le refaire, mais disons que j'étais
consentante quand même, mais c'est juste que j'aurais peut-être attendu ou j'en aurais
peut-être plus parlé, mais il n’y avait pas beaucoup de communication. (Alicia)
Lorsqu’on discute avec elle de la balance du pouvoir et qu’on lui demande si elle croit qu’avec ce partenaire
particulier, il serait possible d’avoir éventuellement tout le contrôle, elle répond catégoriquement :
Alicia : Avec ce partenaire-là, impossible. […] Dans sa logique à lui, si tu dors dans le même
lit que moi, c'est parce que je peux te faire l'amour, dans sa logique.
Intervieweuse : Et sa logique, finalement, a un côté supérieur à la tienne, parce qu'elle
prend le dessus?
Alicia : Oui, c’est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de logique à ça. Les arguments que moi,
j'invoquais, c'était : « Ben là, on ne se connaît pas. » Mais [comme] je le connaissais
quand même de vue, [et que] ce n’était pas la première fois, je n’avais comme aucun
argument pour calmer ma conscience, alors j'ai juste adhéré à ça.
Alicia sent alors que son partenaire a « le beau rôle », c’est-à-dire d’imposer ou de proposer ses choix, alors
qu’elle doit se contenter de consentir ou non, de se taire, bref de contrôler et de réguler la sexualité. Et
qu’avec lui, le consentement passe, mais le non-consentement, beaucoup moins. Une situation
248
particulièrement complexe et difficile qu’elle attribue aussi à sa naïveté et sa souplesse – mais l’emprise que
démontre le partenaire sur elle la dérange beaucoup :
Alicia : Moi, je suis facilement convaincable. Je pense, dans le fond, qu’avec un partenaire
fort comme ça, tsé, idéalement, j'essaie de ne pas revivre ça, quelqu’un comme ça, mais
avec un partenaire fort comme ça... [c’est encore plus difficile]. C'est déjà arrivé que moi, je
veuille, et que lui ne veuille pas. Je trouve que c'est encore une manifestation de son
contrôle, parce qu’encore là il décide, « moi, ça ne me tente pas ».
Intervieweuse : Alors ça finit là.
Alicia : Oui.
Il est déjà arrivé que ce soit Alicia qui refuse catégoriquement ses avances, mais, dit-elle :
Alicia : …il a fini par respecter mon « non » à quatre heures du matin quand il m'a gossée
toute la nuit.
Intervieweuse : Insistant au coton.
Alicia : Oui.
Si Alicia avait autant de difficulté à refuser ses avances, c’est un peu aussi parce qu’elle espérait que sa
relation avec lui aboutisse à une relation amoureuse :
Intervieweuse : As-tu l'impression que tu aurais pu imposer ton opinion, mais que c'est juste
qu'à ce moment-là de ton évolution, c'était impossible parce que tu ne savais pas comment
t'y prendre?
Alicia : Oui, bien en fait, quand je parle de naïveté et tout, c'est que moi, je me disais : « Si
je le voulais, cette personne-là… », je voulais essayer de faire une relation plus sérieuse
avec, et je me disais : « Si je ne lui dis pas non, peut-être que ça va... [se développer en
relation]. Je ne veux pas gâcher la relation en me chicanant, alors je vais essayer de faire
comme il veut, et ça va peut-être donner quelque chose. » Mais tsé, je me rends compte
aujourd'hui que ça ne donne absolument rien de faire ça, de se priver et de brimer ses
droits et ses valeurs, parce que tu te sens un peu comme un morceau de viande dans un...
En tous cas, dans le fond, aujourd'hui je me dis que je n’essayerai pas de conquérir
quelqu'un comme ça. Tsé, ça ne fonctionne pas de pas mettre ses culottes juste pour
quelqu'un qui ne te respecte pas à la fin. Ça n’en vaut pas la peine.
249
Aujourd’hui, si une telle situation devait se représenter, Alicia estime trouverait les moyens de faire
comprendre son absence de consentement, de s’affirmer. :
Aujourd'hui, je me dis plus que, dans la vie, il faut vraiment faire ce qu'on veut, et qu’on
a toujours le choix de faire quelque chose. [Si la situation devait se représenter,] je
donnerais plus mon opinion et je dirais plus ce que je pense de tout ça. Ça ne fonctionnerait
pas si je ne voulais pas, et si je ne veux pas qu'il dorme chez moi, il ne dormirait pas chez
moi. Ce serait vraiment catégorique. (Alicia)
Elle avoue toutefois qu’il y a tout de même un certain risque que la situation se reproduise :
Intervieweuse : Et malgré cette résolution-là que tu prends en ce moment, quel serait le
pourcentage de risque que ça arrive à nouveau quand même?
Alicia : Ben [il y a] quand même [un risque de] 25 % que je retombe là-dedans, parce que
tsé, si je tombe sur quelqu’un, tsé un beau parleur, il y a des chances… Parce qu’en fait, il
n’essayait pas de m'avoir par de belles paroles […], il n’essayait pas comme ça, c'est juste
sa façon d'être qui imposait des choix auxquels moi j'adhérais. J’adhérais à ça et je ne
disais rien. Mais si je tombe sur quelqu’un qui est capable de me dire ce que je veux
entendre et de me dire les bonnes choses, peut-être que je retomberais là-dedans. C'est
sûr qu'il ne m'approcherait pas de la même façon, mais ça arriverait quand même au même.
Lorsque nous discutons avec Alicia du degré de responsabilité qu’elle s’accorde dans le fait de ne pas réussir
à s’affirmer, elle affirme d’emblée qu’elle en est en partie responsable, et ce n’est pas seulement parce qu’au
début, dit-elle, elle avait « la p’tite vision rose [selon laquelle] ''on va dormir, on va se coller et ça va être
cute'' » :
Alicia : Après la première fois, je n'avais plus cette vision-là, et pas du tout. En fait, moi,
j'étais tellement fâchée que je ne voulais vraiment plus le revoir, et c'est lui qui voulait
revenir. Et j'ai appris, dans le fond, que chaque fois qu'on se voyait et qu'on dormait
ensemble, ben c'était sûr qu'on allait faire l'amour. Je le savais quand j'allais dormir chez lui
que j'allais faire l'amour. Ce n'était pas une question d’être tentée ou pas, parce que c'était
évident. C'était sûr. [Mais c’est déjà arrivé aussi que je me présente chez lui le soir après
avoir trop bu, et que j’aille] me coucher à côté de lui et je commence à lui parler. Ben ça,
c'est tenter le diable. Là, que lui soit réveillé à force d’y parler et que ça lui tente, et que je
dise : « Ben non, je voulais juste te parler! », ça, c'est tenter le diable. Ça, je le sais. […]
Alors, oui, il y a comme les deux, mais pas...
Intervieweuse : ...pas au même moment.
Alicia : C'est ça […]. [Après,] je faisais exprès un peu, tsé.
250
Cette fois-là, toutefois, Alicia ne couche pas avec lui. Elle lui dit non et le laisse en plan. En quelque sorte,
avoue-t-elle, pour prendre sa revanche :
Intervieweuse : Là, comment te sentais-tu?
Alicia : Là, je me sentais bien. [rires] Là, oui, je me sentais bien parce que c'était une
revanche un peu, parce que lui, souvent, quand il revenait de veiller, il me textait, « Hey,
ouvre-moi la porte, j'ai le goût de venir te voir », et là, il arrivait dans la chambre, et moi
j’étais comme « Qu'est-ce que tu veux? » Dans le fond, je le savais, ce qu'il voulait, mais je
trouvais ça comme mignon qu'il veuille venir me voir dans le milieu de la nuit, [même si]
dans le fond, ce l'était pas tant que ça. [C’est arrivé très rarement que je lui dise] : « Non, ça
ne me tente pas » et que je lui referme la porte dans la face. C'était vraiment une drôle de
relation.
Alicia trouve dommage la relation qui s’est installée entre ce partenaire et elle. Elle avait l’impression qu’il lui
enlevait quelque chose, et, surtout, trouve dommage que de telles situations soient l’apanage des filles :
[O]n dirait qu'il y a comme un point de non-retour quand tu embarques là-dedans. Quand tu
es en train de te déshabiller ou de te faire déshabiller, on dirait que les filles, on ne sait
jamais où est-ce que là, tu vas leur dire, ben... ça me tente plus, et qu'ils ne vont pas être
fâchés à cause de ça. On dirait que ça te tente, et qu’après, ça ne te tente plus. (Alicia)
Cette expérience du « point de non-retour », comme Alicia elle-même l’appelle75, n’est pas exclusive à Alicia,
même si elle l’a vécue plus longtemps et de façon plus intense. Voyons rapidement les cas de Jessica, de
Florence et d’Alison. Jessica, 20 ans, nous a aussi parlé des occasions où, avec son premier copain, elle avait
l’impression de ne « plus avoir le choix » de reculer :
C'est plus au début [de la relation que ça arrive]. Bon, tu t'embrasses, tu te « taponnes » un
peu, et là il y a un morceau qui part, et tu te dis : « Bon, ça ne me tente pas tant que ça »,
c’est le fun de juste s'embrasser et se toucher, mais à un moment donné, il y a moins de
linge, ou vous êtes plus collés ou des choses comme ça. [Et vous vous trouvez rendus
à l’étape de] mettre un condom. C'est sûr que là, dire non, tu as l’air un peu agace parce
que tu as dit oui à tout ce qui allait avant. Mais ce n'était pas…[prévu]. C'est sûr que tu peux
toujours dire non, mais ce n'était pas... je ne sais pas, je n'ai jamais senti trop de contrôle là-
dessus. [Alors] oui, j'ai déjà dit une ou deux fois « oui » alors que ma tête disait « non ». […]
Oui. (Jessica)
75 Et de qui nous avons d’ailleurs tiré le titre de la section.
251
Son premier copain, dit-elle, était justement un peu insistant. Il disait même, un peu à la blague, « J’en ai
envie, je peux te forcer un petit peu. » « Il ne le disait pas verbalement », dit-elle, « mais ça sentait que…
[c’était ce qu’il voulait] ». Elle finissait donc par consentir, par sentiment de culpabilité :
Peut-être aussi que je me sentais un peu coupable, parce que je n’ai jamais beaucoup vu
mes chums, on ne se voyait qu’une fois par semaine, alors je me disais : « Bah, je le vois
juste une fois par semaine, c'est sûr que ça me tente, en même temps, je suis fatiguée, ça
me tente moins. [Je ne le vois que] dans une semaine, alors tant qu'à être rendus là, allons-
y. » (Jessica)
Pour Laurence, le « point de non-retour » se présente de façon un peu différente. Comme on l’a vu, Laurence
a de la difficulté à exercer du pouvoir dans ses relations, surtout les premières. Avec son deuxième partenaire,
qui était un ami, Laurence dit avoir expérimenté le point de non-retour, et attribue en quelque sorte son
manque de fermeté à son manque d’expérience, de même qu’à son désir que son partenaire n’ait plus de
raisons d’insister. Bref, que ça « finisse » :
Laurence : Ben tsé, je ne voulais pas, pas au point de faire : « Ah non, arrête », mais ça me
tentait [juste] « bof »... Lui était « starté », alors...
Intervieweuse : Alors c’est lui qui a gagné, et toi, tu ne l'as juste, pas nécessairement
bloqué, mais tu n'as pas agi, c’est ça?
Laurence : C'est ça. J'étais fatiguée, ça ne me tentait pas, mais en même temps, je me
disais : « Si ça peut le calmer... »
Ce « haussement d’épaules », qui permet en quelque sorte à la participante de continuer pour que « ça
finisse », on le retrouve également chez Alison. Cependant, avec elle, l’engagement qu’elle démontre envers
son propre consentement dépend du sexe du partenaire :
[L’intervieweuse explique ce que pourrait être, selon elle, une situation de point de non-
retour, et lui demande si une situation semblable lui est déjà arrivée.]
Alison : Il est trop tard! Oui.
Intervieweuse : C’était avec lequel des partenaires?
Alison : C’était avec un autre gars, juste ami. Et avec une fille aussi.
Intervieweuse : Quand c’est arrivé, comment ça s'est présenté? Tu avais l'impression que tu
ne pouvais plus lui dire « non »?
252
Alison : Ben avec le gars, j'ai continué pareil. Avec la fille, je lui ai dit d’arrêter.
Intervieweuse : Pourquoi avec le gars, tu n'as pas été capable de lui dire « non » et la fille...
[tu en as été capable]?
Alison : Parce qu’avec la fille, je n’avais jamais rien fait avec une fille avant, et je voulais que
ça soit spécial, et je ne « filais » pas, [alors] j'ai fait comme : « Non, pas tout de suite ».
Mais avec un gars, je l'avais déjà fait, et avec un gars, je ne care pas. Alors j'ai juste
continué.
Intervieweuse : C’est juste arrivé?
Alison : Ouais. [haussement d’épaules]
Enfin, pour Florence, le fait d’arriver à un point de non-retour et d’avoir à décider de son consentement est
difficile, et ce particulièrement en raison des conséquences qu’elle envisage. Florence n’a eu qu’un seul
partenaire – son copain – un garçon, dit-elle, qu’elle aimait plus ou moins. Sans pourtant avoir eu l’impression
de perdre le contrôle, Florence regrette ses gestes parce qu’elle a pu lui donner de faux espoirs :
Florence : Je ne sais pas, c'est dur à dire, je savais ce que je faisais, mais dans ma tête, [je
me disais :] « Ah non, fallait pas, parce que ça va lui donner de faux espoirs et tout », mais
je l'ai fait pareil… […] Je le savais qu'il allait tout le temps être avec moi après, et il était
tannant, il me collait, et ça me tentait juste de le faire à ce moment-là.
Intervieweuse : Voulais-tu faire ça pour lui faire plaisir à lui ou à toi?
Florence : Non, à moi.
Intervieweuse : Je comprends. Donc il faut que tu deales avec les conséquences, mais en
même temps, c’est ce que tu veux...
Florence : Oui. [rires] Je sais que c'est mêlant!
Elle ne savait donc pas trop si elle devait lui dire « non » ou continuer. Elle a décidé de continuer. Avec les
autres gars qu’elle a fréquentés, Florence a pourtant toujours su dire « non », mais elle voulait, avec son
copain, « profiter du moment » au bal de finissants pour avoir sa première expérience :
[Je ne l’ai pas fait] pour me débarrasser, mais genre, toutes mes chums [l'avaient fait et en
parlaient]. Je ne pouvais jamais parler de mes aventures à moi. Ça sonne comme si j’avais
de la pression, je n’avais pas de pression, c'est moi qui me disais « Ah, faudrait peut-être
253
que je le fasse ». Là, en plus, c'était après le prom76, je me suis dit, je vais profiter du
moment. (Florence)
Elle ne regrette en fait que parce qu’elle aurait aimé le faire avec un gars différent, qu’elle aurait plus apprécié
et qui aurait mis plus d’accent sur les préliminaires; mais elle ne regrette pas d’avoir fait l’amour. Dans une
autre situation semblable, avec un autre garçon qu’elle a fréquenté, Florence a pu exprimer son consentement
pour certains actes, et son absence de consentement pour d’autres assez fermement :
Florence : On se « chumait »77, et ça s'en venait un peu trop osé. Ben peut-être qu'il voulait
coucher avec moi, je ne sais pas, je ne le lui ai pas vraiment demandé, mais ça venait
trop... trop pour ce que je m'attendais.
Intervieweuse : Tu as été surprise.
Florence : Oui. Là, j'ai réalisé que non, finalement, je ne voulais pas de chum.
Intervieweuse : C’était quoi exactement qu'il faisait?
Florence : Il partait pour ôter, ben je n'avais plus mon chandail, il partait pour ôter ma
brassière.
Intervieweuse : Comment tu as fait pour l’arrêter? Est-ce qu'il t'a écouté tout de suite?
Florence : Ben je me suis reculée un peu, pas tant que ça, mais je me suis reculée et là je
lui ai dit que je ne voulais pas de chum. Là il a fait : « Euh… OK... » Il a dit : « Ben c'était
quoi d'abord? » Là j’étais comme « Ben je ne sais pas, ça m’a juste pognée comme ça. »
Cependant, elle reste ambivalente quant à l’expression de son désir, même si elle a refusé l’acte sexuel, et
qu’elle a agi exactement comme elle le voulait. De façon surprenante, voici ce qu’elle répond à la question
suivante :
Intervieweuse : Si c'était à refaire complètement, la situation idéale, dirais-tu non un petit
peu avant ou un petit peu après?
Florence : Non, je resterais ça comme ça. Je parais une plotte78, hein?
Surprise par son commentaire, nous lui avons assuré que non, pas du tout. Elle répète alors :
76 Bal de finissants. 77 S’embrasser, se coller... Un peu l’équivalent de l’expresion anglophone « making out ». 78 Mot vulgaire faisant référence aux parties génitales de la femme, utilisé ici dans le sens de « pute ».
254
OK! Je ne voulais pas paraître plotte. (Florence)
Elle explique :
Florence : [O]n dirait que ça me tentait juste de [faire ça], je ne voulais pas faire plus, mais
ça me tentait juste [de faire les préliminaires]. Tsé, je le regrette, mais pas à cause qu’il
a continué et qu’il voulait plus, je le regrette juste parce qu'il me colle maintenant quand je
sors.
Intervieweuse : Ça veut dire que... tu n’aurais rien fait de plus ou de moins? Selon ta
volonté, toi, c’est exactement ce que tu as fait?
Florence : Oui, c'était ça.
Intervieweuse : Il n’y a pas de mal!
Florence : [rires] Je n’aurais peut-être pas dû, mais c'est ça que je voulais.
Discussion
En observant le cas de Florence, on réalise toute l’ampleur que peut prendre pour elle le « stigmate de la
putain », comme l’a expliqué Pheterson (2001 [1996]), et comment les représentations dominantes des
rapports sociaux de sexe concourent à complexifier l’exercice du consentement chez les participantes.
Florence, par exemple, craint les implications sociales que pourrait avoir son consentement, alors même
qu’elle refuse l’acte sexuel avec le deuxième garçon et qu’elle n’ait eu qu’un seul partenaire avec qui elle n’a
fait qu’une seule fois l’amour. Alicia, pour sa part, déplore le fait qu’elle soit devenue, bien malgré elle, la
« gatekeeper » de la sexualité avec son partenaire insistant – une gatekeeper toutefois sans grand pouvoir.
Elle trouve aussi injuste le fait que le poids de son refus soit si minime en comparaison avec celui du
partenaire. Elle déplore, surtout, le fait qu’elle continuait d’espérer développer une relation avec celui-ci, alors
même qu’il ne lui montrait clairement que peu de respect et de considération. Si Alicia a eu autant de difficulté
à refuser ses avances et à « déjouer » ses tactiques, c’est un peu qu’elle le mettait en quelque sorte sur un
piédestal, c’est-à-dire qu’elle continuait de vouloir croire en son potentiel même s’il ne s’en montrait pas digne.
Bref, ce partenaire a réellement une emprise sur Alicia, une emprise que n’avaient pas les autres hommes
qu’elle a fréquentés, ni même son premier partenaire, avec qui elle avait développé une relation de confiance
alors même qu’elle n’avait que très peu d’expérience sexuelle.
Alison montre aussi très bien que sa capacité d’expression d’agentivité peut dépendre du partenaire : avec le
partenaire masculin, elle ne semble pas considérer avoir « d’honneur » à défendre, en quelque sorte, ni ne
ressent le besoin de faire en sorte que l’expérience « compte » ou soit le moindrement spécial. De façon
255
évidente, elle ne s’investit pas au même degré avec les garçons qu’avec une partenaire féminine et adopte
avec eux une attitude semblable au « it just happened » de Tolman (1994) et de Gilmartin (2006). On constate
donc que l’expression de son agentivité est intimement liée, comme Alicia et les autres, au partenaire.
Ces résultats sont congruents avec ce qu’avaient observé Smette et al. (2009), selon qui l’agentivité sexuelle
pouvait être conditionnelle au contexte, de même qu’avec ce qu’ont décrit Peterson et Muehlenhard (2007),
Tolman et Szalacha (1999) et O’Sullivan et Gaines (1998), selon qui les filles pouvaient parfois démontrer
l’ambivalence face à leur désir. Plus encore, ces résultats nous amènent à penser que la personnalité du
garçon puisse réellement avoir une influence sur la façon ou l’étendue avec laquelle les participantes soient en
mesure de manifester de l’agentivité. Il est facile de comprendre que les participantes attribuent à la
personnalité d’autrui la condition de l’expression de leur propre agentivité, même si l’on définit l’agentivité
sexuelle comme la capacité d’exprimer ses propres désirs et ses propres limites, car, selon leur perspective,
ce serait bien le cas : quand leur partenaire est aimant et compréhensif, elles semblent se sentir plus aisément
libres de faire des choix et de même d’initier la sexualité. À l’inverse, elles semblent être plus facilement
ambivalentes ou faire plus souvent l’expérience du « point de non-retour » quand le partenaire est insistant.
Toutefois, comme on va le voir plus loin avec entre autres Alison, ce ne serait pas toujours le partenaire « en
soi » qui soit le véritable déterminant, mais « comment tu te sens » avec lui (ou elle) et à propos de lui (ou
d’elle). Thompson (1990) avait déjà remarqué qu’il était plus difficile pour les filles de reconnaître la coercition
lorsqu’elles ressentaient de l’affection pour leur partenaire (« someone they really cared about ») ou
lorsqu’elles étaient engagées dans une relation stable avec lui (p. 345). Notre étude ici va dans le même
sens : Alicia, par exemple, disait qu’il lui était plus difficile de refuser les relations sexuelles avec son
partenaire parce qu’elle les avait acceptées plusieurs fois auparavant, établissant ainsi une attente, et parce
qu’elle espérait lui plaire.
Comme le fait de choisir un (bon) partenaire fait partie des choix qu’elles doivent faire dans leur vie sexuelle
(ce choix étant le leur), il fait partie des indicateurs de l’expression de l’agentivité sexuelle – autant que du
contexte dans lequel ces choix interviennent.
Ce contexte est également teinté par les attentes sociales. Comme on a vu précédemment, les scripts sociaux
et les discours culturels sous-entendent que la sexualité des hommes soit par définition naturelle, puissante et
incontrôlable – et qu’ainsi les hommes soient toujours « prêts » à la sexualité –, et il peut être mal vu pour une
fille de « vouloir » des relations sexuelles. Ces attentes sociales des deux sexes rendent complexe la question
du consentement et de l’expression de ce consentement.
256
Même s’il apparaît évident dans plusieurs études récentes que l’initiation, bien que toujours genrée, est plus
« fluide » que ne le laissent croire les scripts sociaux (les femmes étant de plus en plus assurées dans leurs
rapports sociaux sexuels), une récente étude de O’Dougherty Wright, Norton et Matusek (2010) montre que
les jeunes femmes sont beaucoup moins portées que les garçons à se trouver dans une situation où elles
mettent de la pression sur le partenaire pour l’inciter à accepter leurs avances sexuelles (p. 648-649 et 657).
La situation étant inverse pour les garçons, les hommes seraient plus « habitués » à recevoir des refus; les
femmes de cette étude, d’ailleurs, auraient réagi de façon beaucoup plus émotive aux refus qu’elles disent
avoir essuyés que les garçons. Le résultat le plus surprenant de l’étude, selon les auteurs, est que les
hommes avaient significativement moins tendance à insister lorsqu’ils se sentaient rejetés, alors que les
femmes avaient au contraire plus tendance à contraindre lorsqu’elles se sentaient rejetées, ce qui contredit le
présupposé que les hommes auraient tendance à réagir fortement aux refus (p. 657). Ce peut être qu’en
raison des scripts de genre, « sexual refusal may have been more expected and less ego threatening for
men » (loc. cit.). Cependant, les hommes auraient plus tendance à insister lorsqu’ils se sentent confus, c’est-
à-dire lorsqu’ils n’arrivent pas à bien décoder les signes relatifs au consentement que leur adresse leur
partenaire (loc. cit.). Cela soulève l’importance, pour les partenaires féminines, de bien faire comprendre leur
consentement ou leur absence de consentement, et pour les partenaires masculins, de s’assurer de bien le
comprendre – mais montre du même coup à quel point les scripts sociaux ne permettent pas l’ambivalence en
matière de sexualité, que pourtant les filles ressentent souvent, et à quel point ces scripts sont genrés.
Cependant, les jeux de pouvoir ne sont pas exclusifs aux relations hétérosexuelles et à l’effet des rapports de
genre. On va d’ailleurs voir plus loin comment les jeux de pouvoir et le point de non-retour interviennent dans
la sexualité d’une participante homosexuelle qui a fréquenté deux partenaires féminines au caractère fort
différent (section 6.2.6). Nous verrons aussi, dans la section qui suit, que la capacité d’expression d’agentivité
sexuelle peut être très difficile quand le partenaire se montre violent.
5.2.5 Quand la violence s’invite…
Outre l’insistance démesurée de certains copains, une seule participante a témoigné avoir déjà dû faire face
à une certaine violence de la part du partenaire. Océanne, 19 ans, a déjà eu un copain qui, selon elle, l’a
« forcée » à avoir des relations auxquelles elle ne consentait pas :
Intervieweuse : Est-ce que c’est arrivé qu'il te force?
Océanne : Ça m'est déjà arrivé avant, avec mon deuxième chum.
Intervieweuse : Tu avais quel âge?
Océanne : 17-18 ans.
257
Intervieweuse : Tu t’es sentie forcée dans quel sens?
Océanne : Ben des fois, ça ne me tentait pas, et là mettons il voulait se faire sucer, comme
[il me mettait] quasiment [son pénis] dans la [bouche], ou [encore, il voulait des relations
sexuelles et] ça ne me tentait pas, mais tsé, il était plus gros que moi et plus fort, et on dirait
qu'il me pognait pareil, tsé, je ne sais pas, on dirait, je ne me sentais pas bien.
Intervieweuse : Tu n’arrivais pas à t'affirmer et à avoir le pouvoir?
Océanne : Même si je lui disais que ça ne me tentait pas, lui ça lui tentait, alors on le faisait.
Intervieweuse : Toi, aurais-tu aimé avoir plus de pouvoir?
Océanne : Oui.
Selon Océanne, si elle n’arrivait pas à avoir plus de pouvoir avec ce partenaire, c’est en raison de sa
personnalité :
Il était comme égoïste. Il ne prenait pas la peine de carer pour ce que toi, tu sentais.
(Océanne)
Lorsqu’on lui demande comment elle réagirait si elle rencontrait à nouveau un garçon aussi insistant ou
égoïste, elle répond :
Ah! je pense que je le laisserais quasiment. Je ne veux pas vivre ça à nouveau. Ça ne
marchait pas du tout. Je pense que je m'affirmerais plus, c'est sûr. Je me tasserais.
(Océanne)
Bref, avec un partenaire le moindrement compréhensif ou qui fait montre d’un tant soit peu d’attachement ou
de respect envers sa partenaire, les participantes semblent être capables de refuser les avances qu’on leur
fait quand elles n’y consentent pas. Toutefois, l’expression de l’absence de consentement devient plus difficile
quand le partenaire est insistant ou plus « macho ».
5.2.6 Le cas des participantes homosexuelles
Nous n’avons rencontré que deux homosexuelles parmi les trente participantes – Audrey et Alison – mais
nous avons tout de même été en mesure de constater que dans leur cas, le jeu de pouvoir est autant présent
que chez les participantes hétérosexuelles. Pour bien comprendre leur situation, il importe de la mettre en
contexte.
258
Voyons d’abord le cas d’Audrey. Celle-ci a 17 ans et se sait déjà homosexuelle. « Peut-être que je ne suis pas
totalement homosexuelle », dit-elle, mais elle préfère tout de même être avec une fille. Sur Internet et dans les
livres de sexualité de sa mère (celle-ci est sexologue), elle s’est informée sur l’homosexualité, et a été
intriguée notamment par l’échelle de Kinsey :
Il y l'échelle de 0 à 6, et dans le milieu il y a la bisexualité, [et à chaque extrême]
l'homosexualité et l'hétérosexualité. Je ne suis pas complètement dans un bout […].
(Audrey)
Ses parents savent qu’elle est homosexuelle, et prennent bien la situation. Audrey a eu trois relations de
couple : d’abord une fille, ensuite un garçon, puis finalement une autre fille, avec qui elle était encore au
moment de l’entrevue. Elle a réalisé très tôt qu’elle était attirée par une fille, même si, dit-elle, elle « ne voulait
pas » être homosexuelle :
J'ai réalisé que j'étais pas mal attachée à cette fille-là et j'étais comme, « OK, c'est quoi
ça... » Je ne voulais pas dans le fond [être homosexuelle]. J'ai réalisé que j'étais en amour
et je voulais savoir si c'était vraiment ça, alors je suis allée voir si ça se pouvait telle ou telle
affaire... Je suis beaucoup allée checker sur l'homosexualité. (Audrey)
Elle cherche alors à se rassurer par le biais d’Internet :
Audrey : Je voulais être rassurée d'une manière... […] [Quand j’ai réalisé que j'étais
homosexuelle], j’étais comme, « OK, qu'est-ce que je fais? » Mais pour apprendre aussi.
Intervieweuse : Apprendre quoi exactement?
Audrey : Pas vraiment les pratiques, mais plus, comment tu vis avec ça?
Intervieweuse : Pas l'acte sexuel comme tel, mais plus ce qui l'entoure?
Audrey : Oui.
Lorsqu’on fait l’exercice de la balance avec Audrey, elle admet d’emblée qu’elle avait peu de pouvoir avec sa
première copine. Et comme les participantes hétérosexuelles, elle évoque la personnalité de sa partenaire
pour expliquer sa difficulté à s’affirmer :
Audrey : Avec la première, j'étais vraiment en dessous. La gêne, le malaise... je ne savais
juste pas quoi faire, alors je me laissais faire. Avec le chum, c'était pas mal dans le milieu.
Et avec la blonde actuelle aussi, j'ai appris à m'affirmer.
259
Intervieweuse : Qu'est-ce qui faisait qu'avec la première, c'était comme ça?
Audrey : Ben, elle avait une personnalité aussi, qui la mettait pas mal de même [elle fait le
geste de la balance, plaçant sa partenaire nettement au-dessus]. C'était pas mal tout le
temps elle [qui décidait]. J'étais comme, « OK, c'est correct. » J'étais quasiment en
admiration!
Intervieweuse : C'était quoi sa personnalité?
Audrey : Elle était beaucoup leader. Quand il y avait quelque chose qu'elle n'aimait pas,
c'était non, c'est pas ça, c'est fini, ça arrête là. Elle s'affirmait beaucoup, quasiment trop.
Elle avait tendance à manipuler les gens aussi, et je me suis laissé embarquer là-dedans, je
n'ai rien vu du tout. Mais là, je m'en rends compte.
Intervieweuse : Avec elle, s'il y avait quelque chose que tu ne voulais pas faire, est-ce que
tu te sentais apte à dire non?
Audrey : Je n'y pensais même pas. Je ne pensais même pas à dire non.
Intervieweuse : Tu suivais le courant?
Audrey : Oui.
Intervieweuse : Te rendais-tu compte parfois que ce n'était pas exactement ce que tu
voulais?
Audrey : Ah ça, c'est sûr. Mais je me fermais les yeux.
Avec cette partenaire, Audrey fait plusieurs fois l’expérience du « point de non-retour », ce qui montre encore
ici qu’Audrey avait beaucoup de difficulté à exercer du pouvoir dans cette relation :
Audrey : Ah plusieurs fois, oui. Avec la première, c'était pas mal tout le temps ça. Dans ma
tête, ça n'allait pas du tout, mais on le faisait pareil. Je ne le disais pas.
Intervieweuse : Qu'est-ce que qui a fait que maintenant, ça a changé?
Audrey : Ben j'ai filé surtout qu'elle m'utilisait, que j'étais comme plus une expérience que
d'autre chose. Ça m'a blessée, et je me suis dit : « OK, il ne faut plus que je fasse ça, parce
que ça a vraiment atteint plus profond que je pensais. »
D’ailleurs, sa partenaire avait tendance à se moquer de l’apparence du corps d’Audrey, particulièrement en ce
qui concerne ses parties génitales. Une moquerie qui a eu un effet sur la confiance d’Audrey :
Intervieweuse : Tu disais que tu te demandais si ton corps était normalement constitué...
260
Audrey : […] C'est survenu à peu près vers 15 ans. C'est surtout [la première partenaire] qui
pouvait faire de petits commentaires ou rire de moi. Ça ne m'avait jamais dérangée avant,
mais là tu fais comme : « OK, peut-être que je ne suis pas normale. »
Intervieweuse : Elle riait de toi, ta blonde?
Audrey : Ben c'était plus des petits commentaires, des moqueries.
Intervieweuse : Est-ce que ça a fait baisser ta confiance en toi?
Audrey : Oui, beaucoup!
Lorsqu’on lui demande de se donner une « note » sur sa confiance en soi lorsqu’elle était avec sa première
partenaire, Audrey la place très bas : moins que 10 %. Maintenant qu’elle n’est plus avec elle, elle se
donnerait une note de 80, 90 %. Elle se dit capable de dire « non » à sa partenaire actuelle, qui, selon elle, est
très « ouverte ». La communication règne et les relations se font sur une base consensuelle pour les deux
partis : « Si elle ne veut pas, elle ne veut pas, et c'est correct », dira Audrey.
Si elle a réussi à « remonter la pente » de la confiance en soi, Audrey estime que c’est aussi en partie grâce
à Internet :
Ça aide beaucoup quand tu sais que tu n'es pas toute seule et que c'est très fréquent. Tu
fais comme, ah, OK, c'est correct, mais l'autre... c'est peut-être elle qui était ignorante et ça
la dérangeait. En tout cas. Maintenant, ça ne me dérange plus. (Audrey)
Comme Audrey, Alison a aussi eu des relations avec des garçons et des filles79. Mais contrairement à Audrey,
Alison n’a pas réalisé tout de suite qu’elle était homosexuelle. Elle n’a pas apprécié sa première relation
sexuelle, qui s’est passée avec un garçon (« c’était comme bizarre », dira-t-elle). Avec sa partenaire féminine,
les relations sexuelles se sont beaucoup mieux passées. Alison était plus vieille, et donc, dit-elle, plus
« ouverte ». Elle estime que la distribution du pouvoir dans ses relations était relativement égale, même si elle
exerce plus de pouvoir avec sa partenaire actuelle (une amie et non sa blonde) qu’avec le copain qu’elle a eu.
Si elle a moins aimé ses relations sexuelles avec le garçon, c’est aussi, dit-elle, « parce que je ne voulais pas
comme me dire que j'étais homo ». Elle avait peur de la réaction de son entourage.
Comme on l’a vu un peu plus haut, Alison n’accorde pas le même degré d’importance à ses relations avec un
homme qu’à celles avec une femme : avec un homme, a-t-elle dit, « je ne care pas ». Si on lui demande si
79 Il faut toutefois noter qu’Audrey n’a pas couché avec son copain masculin.
261
« c’est juste arrivé? », elle répond « Ouais » avec l’attitude du haussement d’épaules que l’on a vue. C’est
que, dit-elle, elle « ne savai[t] pas trop quoi faire », et donc, un peu mal à l’aise, elle a décidé de le laisser,
justement, « décider » :
Alison : Avec une fille, je suis pas mal plus à l'aise, je suis plus confiante […], donc je
contrôle plus la situation.
Intervieweuse : Dirais-tu que dans ton cas, le fait d’être plus à l’aise dépend du partenaire
ou même du sexe du partenaire?
Alison : Oui, moi je trouve que oui.
Intervieweuse : Ça ne dépend pas nécessairement de toi?
Alison : Bien, oui, mais de comment tu « files » à propos du partenaire.
Comme pour la majorité des autres participantes, Alison a consulté le Web pour savoir à quoi s’attendre de
ses premières expériences sexuelles, surtout avec une partenaire du même sexe :
Alison : J’ai été voir des sites pour les gais [où l’on discutait], genre, des premières fois, et
tout ça. Ça disait un peu, « stresse-toi pas », bla bla bla… […] Ça m'a aidée.
Elle n’a toutefois pas beaucoup utilisé le Web pour répondre à ses questions, même si celles-ci la stressaient,
car, dit-elle, elle ne voulait pas « que le monde sache [qu’elle allait] là-dessus », même s’il s’agissait de son
ordinateur personnel.
L’autre différence, c’est qu’Alison ne se sent pas à l’aise de discuter de sa sexualité avec son entourage, et
particulièrement sa famille élargie : « Les cousines, et ça, je ne ferais jamais ça. » Internet, en ce sens, l’a
aidée à mieux comprendre son orientation sexuelle, mais surtout à se rassurer sur les conséquences de son
orientation :
Alison : Internet a aidé. Je checkais comme, je ne sais pas, juste des affaires à propos des
gais, et j'ai comme catché. C’est compliqué à expliquer.
Intervieweuse : As-tu posé des questions sur Google comme : « Est-ce que je suis
lesbienne? »
Alison : Non, plus comme, je ne sais pas, […] comme quand je pensais que je l'étais, mais
que je ne voulais pas le dire, j'ai fait des recherches sur les droits [des gais], des affaires de
même. Parce que tsé, les gais ont de la misère des fois, à cause des homophobes et tout,
c'était plus dans ce sens-là [que j’ai fait mes recherches,] parce que c'était de ça dont
262
j’avais peur. Tsé, je suis allée sur Internet et j'ai vu que c'était pas mal moins pire
maintenant, et ça, ça m'a aidée.
Elle avait peur, notamment, qu’on l’empêche de faire des choses parce qu’elle était gaie :
[C]'est toujours ça qui me faisait peur, que je ne puisse pas faire telle affaire, parce que
j'étais aux femmes. Comme aux États-Unis, tu peux te faire renvoyer d'une job parce que tu
es gai, comme genre l'armée, tu ne peux pas y aller si t'es gai. Là, ça a changé, mais avant
tu ne pouvais pas... (Alison)
Comme elle vient d’une petite région, Alison se sentait aussi un peu isolée, « exclue ». Il n’y a pas non plus
très longtemps qu’elle vit bien avec le fait d’être homosexuelle. Sur le blogue, elle n’en a pas parlé, parce
qu’elle était « moins ouverte » avec ça, dit-elle. Lors de l’entrevue (qui s’est déroulée plusieurs mois après le
blogue), elle se disait déjà plus à l’aise avec son orientation. Elle avait consulté un psychologue entre-temps,
ce qui l’avait aussi aidée.
Discussion
Bref, les participantes homosexuelles montrent ici que des jeux de pouvoir s’exercent entre les partenaires, et
que les normes et les scripts sexuels ne s’évanouissent pas lorsqu’il est question de relations de couple entre
partenaires de même sexe. Lorsqu’elles sont confrontées à des partenaires plus autoritaires, contrôlantes ou
manipulatrices, elles peuvent, comme les participantes hétérosexuelles, éprouver de la difficulté à exercer leur
pouvoir ou à exprimer leurs limites. Les quelques études ayant comparé la relation de couples homosexuels et
hétérosexuels ont également montré que les partenaires des deux types de couple rencontraient des
difficultés similaires en terme d’engagement et de satisfaction personnelle (Otis et al. : 2006, p. 82).
Cependant, les partenaires de couples homosexuels devaient aussi faire face à des facteurs de stress
supplémentaires en lien avec l’homophobie, leurs craintes de discrimination, et la perception « internalisée »
des partenaires envers leur propre discrimination (p. 93). On remarque cette crainte de discrimination chez
Alison, mais en raison du nombre restreint de participantes homosexuelles, il est difficile de tirer des
conclusions dépassant cette simple constatation.
Cependant, si le cas d’Alison peut être indicatif d’autres situations vécues par les jeunes femmes
homosexuelles, on peut remarquer qu’il peut être tentant pour les filles homosexuelles de considérer les
relations sexuelles avec leurs partenaires masculins comme « peu significatives », alors qu’elles accordent
beaucoup d’importance aux relations sexuelles avec leurs partenaires féminines; un « haussement
d’épaules » spécifique au sexe du partenaire que Thompson (1990, p. 347 et 355) avait aussi remarqué. Si ce
détachement peut ne pas être un problème en soi (il pourrait par exemple faire partie du processus
263
d’acceptation ou de découverte de leur orientation sexuelle), il pourrait cacher d’autres implications dépassant
le cadre de notre étude. Comme peu de recherches portent sur le concept d’agentivité sexuelle, et qu’encore
moins portent sur l’agentivité sexuelle de jeunes homosexuelles ou bisexuelles, il pourrait s’avérer intéressant
et éclairant d’étudier spécifiquement le cas des jeunes femmes non-hétérosexuelles. Que cache leur
détachement, leur « haussement d’épaules », dans leur situation? Comment s’exprime, au-delà de ce que
nous avons pu observer avec nos deux participantes homosexuelles ou bisexuelles, leur agentivité dans leurs
relations avec les autres et dans leur rapport à la sexualité?
Enfin, nous avons pu observer que le Web (combiné à d’autres sources dans le cas d’Audrey) permet aux
participantes homosexuelles de mieux comprendre leur orientation et ses implications sociales, et peut même
contribuer à leur permettre de s’engager dans un processus d’acceptation d’elles-mêmes et de leur
orientation. Mais ici encore, des recherches plus approfondies sur ce sujet seraient également nécessaires
pour bien comprendre leurs expériences du Web et de l’agentivité80.
5.2.7 Conditions permettant une meilleure agentivité
Dans son étude sur l’expression de l’agentivité des femmes et des hommes, Albanesi pose la question :
« What […] is the strongest determinant on whether a person approaches a sexual encounter with agency or
passively submits within it? » (2010, p. 141). Comme elle n’a pas trouvé de réponse claire, elle suppose que
les valeurs morales, les valeurs religieuses et l’importance accordée par les jeunes filles aux normes
« romantiques » puissent jouer un rôle important dans l’expression de leur agentivité. Or, nulle participante de
notre étude n’a soulevé la question de la religion ou de la morale; et nulle n’a mentionné qu’il leur semblait
« mal » de faire une chose ou une autre, ou que encore que c’était « romantique » de suivre les normes de tel
scénario ou autre, ou encore qu’elle devait se « préserver » pour le bien d’un éventuel mari (sauf peut-être
Florence, qui avait peur qu’on la trouve « pute », et dont on peut prudemment estimer qu’elle trouvait qu’il
n’était pas de l’ordre d’une fille « sage » de désirer faire les gestes qu’elle a faits).
Si de tels discours revenaient souvent dans les justifications des participantes d’Albanesi, c’est peut-être une
question de lieu et de contexte social. On peut supposer, par exemple, qu’au Québec et au Canada
francophone, les valeurs libérales sont mises un peu plus de l’avant que dans certains États américains, où
s’est déroulée l’étude d’Albanesi et où la religion peut être très présente dans les mœurs et les discours
sociaux, alors qu’au Québec, au contraire, le discours religieux régresse (Mancilla : 2011).
Dans tous les cas, les participantes de notre recherche ont attribué les conditions permettant le
développement de leur agentivité à des causes bien différentes. Dans notre étude, ce qui est frappant, c’est
80 Pour un portrait des recherches actuelles sur Internet, la santé et les minorités sexuelles, voir Lévy et al. : 2011.
264
de voir à quel point les participantes attribuent, d’une part, l’amélioration de leur pouvoir et de l’expression de
leur agentivité à la personnalité de leur partenaire. Selon leur perception, une personnalité douce et
compréhensive chez le ou la partenaire est une condition sine qua non à leur épanouissement sexuel. Les
autres conditions essentielles sont, selon elles, le temps et les expériences.
Par exemple, Maude estime que le pouvoir, dans sa relation actuelle, est partagé 50-50 avec son partenaire,
alors qu’avant, son pouvoir lui semblait à 25 ou 30 %. Elle réalise aujourd’hui que dans ses anciennes
relations, elle éprouvait moins de plaisir, d’une part parce que ses partenaires n’étaient pas de bons choix, et
d’autre part parce qu’elle n’avait pas la maturité requise pour comprendre qu’ils étaient de mauvais choix. Par
conséquent, elle exerçait moins d’agentivité :
Maude : J’avais moins de plaisir; c'était plus du plaisir en faveur de l'autre personne.
Intervieweuse : Comment as-tu fait pour te rendre à maintenant?
Maude : Je pense que c'est avec la maturité, en vieillissant tout simplement. Et aussi en
m'informant. Mais je pense que c'est vraiment avec la maturité que... ça te fait comprendre
des choses. […]
Intervieweuse : Quand tu disais que tu avais 25-30 % de contrôle [dans tes anciennes
relations], avais-tu la force de dire « non » s'il y avait des choses que tu ne voulais pas
faire?
Maude : Je ne peux pas te dire à 100 % que ça me tentait tout le temps, mais disons que
mes relations, quand j'étais jeune, ça n’a pas été les meilleures. Quand t'es jeune, […] tu
n'es tellement pas informée, que tu ne peux pas savoir ce qui est normal. Tu laisses aller
comme ça. Je ne sais pas si tu comprends...
Intervieweuse : Tu n'as pas les outils.
Maude : Tu n'as pas les outils pour le savoir.
Ces outils, elle a réussi à les avoir grâce à Internet :
Intervieweuse : Dans quelle proportion Internet t'a amenée à avoir ces outils-là? Est-ce que
c'est Internet ou autre chose?
Maude : C'est pas mal Internet qui m'a informée. Ça m'a aidée à faire : « Bon, ben, c'est
pas [tellement] normal. » [Internet est utile pour] savoir la normalité, te situer, [te dire :] «
OK, ça c'est bien, ça, ce n'est pas bien ». Pas de te le faire répéter, mais tsé, de vérifier ce
que tu veux savoir. Tu fais : « Ok, bon. Ben ça, ce n'est pas correct... »
265
Intervieweuse : As-tu un exemple concret?
Maude : [Par exemple en ce qui concerne] l'orgasme, tout ça. Parce que, tsé, à 14 ans, tu
ne peux pas bien bien dire… en tous cas moi personnellement, [quand] tu as du plaisir dans
tes relations sexuelles, et que c'est plus vis-à-vis des gars… [ce n’est pas normal]. Tsé j'ai
très bien compris que c'est [supposé être] kif-kif, c'est les deux.
Amélie, qui disait se sentir « inhibée » et avoir peu de plaisir lors des relations sexuelles, dit s’être améliorée,
et estime que le temps et les expériences vont l’aider en ce sens :
[J]e sens déjà une amélioration. Je ne sais pas pourquoi ça ne me faisait rien [me toucher],
mais maintenant, ça me fait du bien […]. Peut-être que je me laisse plus aller, je le sens.
Mais d'autres fois non, ça dépend vraiment de la situation. Mais j'imagine que c'est juste le
temps et l'expérience et qu’à force de faire, ça va s'arranger. Je ne crois pas qu'un
psychologue pourrait vraiment m'aider là-dedans. Peut-être... (Amélie)
Sarah, qui se posait beaucoup de questions sur le fait d’être vierge à son âge, estime pour sa part qu’en
vieillissant, elle assume mieux sa virginité et se sent plus à l’aise de s’informer sur la sexualité :
Tout de suite, je me pose vraiment moins de questions, je me dis que ça va arriver quand
ça va arriver. Quand j'étais jeune, on dirait que je voulais me précipiter. Maintenant, je me
pose moins de questions et si j'ai des questions, je vais faire mes recherches, surtout
comme les positions sexuelles, je vais voir. (Sarah)
Pour Camille, qui avait de la difficulté avec la pénétration, le choix d’un partenaire avec qui elle se sentait bien
était une condition essentielle pour surmonter cet obstacle :
Camille : Avec les gars, j'étais vraiment... j'avais comme pas un blocage, mais j'avais de la
misère à faire confiance, vraiment beaucoup, et lui c'est comme un des premiers gars [avec
qui je me sentais bien]...
Intervieweuse : C'était le bon?
Camille : C'était le bon et... j'étais vraiment en confiance. Je n'avais aucune gêne avec et ça
c'est fait... [naturellement].
Même chose pour Gabrielle :
266
Gabrielle : Je te dirais que ma sexualité s'est très très grandement améliorée avec mon
chum de présentement, qui est l'homme de ma vie aussi, d'ailleurs.
Intervieweuse : Et pourquoi ça s'est amélioré avec lui?
Gabrielle : Je dirais à cause du respect mutuel et de la communication. On dirait que ça
joue un rôle méga-important. Tsé, des fois il y a du monde qui fait : « Check, on ne s'entend
pas full bien, mais on fourre pis c'est fini là. » Ben ça, je n'y crois pas. Parce que j'ai vécu
[des relations avec] d'autres chums que, sûrement, j’aimais plus ou moins. Parce que
maintenant, je sais c'est quoi aimer pour vrai, et je me dis [qu’avant, les autres relations,] ça
ne pouvait pas vraiment marcher, parce qu'il n'y avait pas autant de respect, pas autant de
communication. On ne pouvait pas autant se comprendre. Et là on est comme vraiment
dans un état, genre, fusionnel. Il dit quelque chose et je le comprends tout de suite. Ça
améliore grandement toutes les relations, ainsi que les relations sexuelles.
Les participantes qui sont en couple avec un ou une partenaire en qui elles disent avoir confiance ont
d’ailleurs effectivement tendance à démontrer plus d’agentivité. Et comme l’a précisé Alison, ce n’est pas tant
le partenaire « en soi » qui est le véritable déterminant, mais « comment tu te sens » avec lui (ou elle) et
à propos de lui (ou d’elle). Ainsi, pour Alison, le fait d’être passée d’un partenaire de sexe masculin à une
partenaire de même sexe lui a permis de se sentir plus en contrôle d’elle-même, plus à l’aise d’initier :
Intervieweuse : Qu’est-ce qui fait que tu sois plus ouverte, maintenant, avec la sexualité?
Parce qu'avec le gars... [tu semblais moins à l’aise].
Alison : Ben je pense que c'est parce que je ne savais pas trop quoi faire. Je n'étais pas
[complètement mal] à l'aise, j'étais comme, bon, je vais le laisser... décider. Avec une fille, je
suis pas mal plus à l'aise, je suis plus confiante. […] Alors là, je contrôle plus la situation.
Et Audrey, une amélioration s’est aussi sentie au fil du temps, en partie parce qu’elle a choisi de meilleurs
partenaires (sa première copine ayant été insistante et manipulatrice) :
Avec la première, j'étais vraiment en dessous [balance du pouvoir]. La gêne, le malaise... je
ne savais juste pas quoi faire, alors je me laissais faire. Avec le chum [sa deuxième
fréquentation], c'était pas mal dans le milieu. Et avec la blonde actuelle aussi, j'ai appris
à m'affirmer. (Audrey)
À l’inverse, Alicia, avec qui l’on a discuté du point de « non-retour », a soudainement eu beaucoup de difficulté
à s’affirmer et à faire comprendre son consentement quand elle a rencontré un garçon insistant, un peu
sournois et surtout très « macho », alors même qu’elle était capable de bien gérer sa sexualité quand elle était
267
en couple avec un partenaire l’écoutait et la considérait. On a aussi vu une situation semblable avec Océanne
(dont l’un des partenaires était violent), qui ne savait pas comment exprimer son désaccord avec ce
partenaire, qui était, selon elle, « égoïste », macho et peu attentionné.
Il semble donc en effet que la personnalité du partenaire joue un rôle d’aidant majeur dans l’acquisition et
l’exercice de l’agentivité sexuelle des participantes, tandis que le temps et les expériences (même négatives)
permettent un apprentissage et une réflexivité quant à leurs capacités à exprimer cette agentivité, de même
qu’à leurs limites et leurs difficultés.
Le fait d’être avec un partenaire digne de confiance leur permet de s’épanouir et d’apprécier la sexualité, et ce,
même quand elles disent initier peu en comparaison avec leur partenaire, ce qui était le cas par exemple de
Juliette :
Le fait qu'il me guide là-dedans, soit autant le lieu, le quand et le comment, je ne sais pas,
j'aime ça comme ça, je lui fais confiance, je sais qu'il va avoir de bonnes idées, […] c'est
correct, et j'aime ça comme ça. C'est pas... ben tu me donnais des exemples, je ne sais pas
si on comprend la même chose, mais le contrôle, moi, c'est vraiment plus côté pratique, là,
comment, où, quand, dans le sens que j'aime ça tout simplement, pas dans le sens : « Ah,
je suis blasée, je n'aime pas ça, décide, ça ne me dérange pas ». Dans le sens : « C'est le
fun, je te fais confiance, vas-y, on s'amuse. » (Juliette)
On voit ici que Juliette s’approprie quand même l’évolution de sa façon de voir la sexualité, même si son
copain a joué le rôle « d’aidant » :
Je dirais que la plus grande évolution, c’est plus du côté que moi, je me sentais à l'aise.
Plus ça avance, même après trois ans, mieux je me sens, et ça se fait ressentir même dans
la vie de tous les jours, pas nécessairement juste dans cet acte-là. Ça a fait que, côté
sexualité, je me sentais plus une femme, mentalement tu réalises des choses, tu réalises
que dans la vie, c'est important de s'aimer, plein de choses quand même assez grandes.
[…] Juste une évolution mentale depuis trois ans. (Juliette)
Rosalie s’approprie également la raison de son amélioration, surtout en raison d’un changement dans sa
personnalité :
Intervieweuse : Qu'est-ce qui fait que [le pouvoir, avec ton premier chum, n’était pas
distribué de façon égale?]
Rosalie : Je ne sais pas, sûrement parce que je suis vraiment une fille gênée, mais là
maintenant je suis moins gênée, mais j'étais vraiment une fille gênée, je ne pouvais pas
268
m'assumer, dire : « OK, ce n'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. » Ce n'était pas
[comme ça] que j'étais avant.
Bref, dans l’ensemble, on sent une amélioration générale chez les participantes, qui apprennent par l’erreur,
avec l’expérience, et qui notent une évolution dans leur vie sexuelle. Océanne, par exemple, ne veut plus avoir
de copain violent, et Alicia est maintenant aux aguets quant au trait de caractère insistant des éventuels
copains. Audrey, qui était inquiète concernant l’apparence de son corps, apprend à l’apprécier :
Il y a quelques détails physiques qui me dérangent, mais je m'en viens mieux. Je
m'accepte. (Audrey)
Même Laurence, qui ne démontrait que très peu d’agentivité, estime qu’elle s’est améliorée avec son copain
actuel :
Intervieweuse : Et là, maintenant, est-ce que c'est mieux ou tu te sens encore un peu mal
à l'aise?
Laurence : Ben là c'est correct, j'ai un chum, et ça fait longtemps qu'on est ensemble. Il n’y
a plus de gêne, mais... quand j'étais plus jeune, j'étais gênée. Je n'étais pas sûre si c'était
correct, et si tout le monde faisait ça [du « vaginisme »]. […] Je pense que le choix des gars
va avec mon évolution. Je veux dire, dans le fond, les expériences de vie, et tout, ça a fait
que j'étais plus mature, et j'ai pu choisir quelqu'un qui m'aimait vraiment et qui me
respectait, et tout.
Discussion
Même si l’agentivité sexuelle qu’elles démontrent peut être très situationnelle (comme avec Alicia ou
Océanne), et donc même si l’acquisition ne fait pas de façon parfaitement linéaire, on remarque tout de même
une évolution générale. On remarque effectivement souvent qu’il leur était plus difficile lorsqu’elles étaient plus
jeunes de faire preuve d’agentivité. Cette évolution, elles l’attribuent au développement de leur maturité,
à leurs apprentissages, et en grande partie, comme on l’a vu, à leurs partenaires, qui doivent être aimants,
compréhensifs et doux pour qu’elles puissent véritablement développer leur agentivité et leur confiance.
Comme le dit Gabrielle, le respect mutuel « joue un rôle méga-important ». Le temps et les expériences leur
sont également très formateurs; elles apprennent de leurs erreurs et se laissent aussi guider, en partie, par
Internet. Celui-ci « a le pouvoir de [les] rendre normale[s] ou anormale[s] », comme le dit Camille dans la
section suivante, puisqu’on trouve sur Internet de nombreux discours normatifs. Cependant, on remarque que
les discours normatifs ne leur sont pas toujours nuisibles. Maude raconte : « Quand t’es jeune, […] t’es
269
tellement pas informée, que tu ne peux pas savoir ce qui est normal. » Internet, en ce sens, l’a aidée
à comprendre que dans une relation, c’est idéalement « kif-kif », comme elle le dit : les deux partenaires
doivent avoir du plaisir. Même les discours issus de sites Web de magazines comme Cosmopolitan peuvent
aider les jeunes femmes à réaliser que leur plaisir est également important que celui de leur partenaire (faute
peut-être de leur en montrer l’importance pour elles-mêmes principalement).
Internet leur est à ce point utile qu’elles préfèrent recourir au temps, aux expériences et à Internet pour les
aider à solutionner des problèmes, plutôt que de consulter un ou une spécialiste. Par exemple, Amélie dit, au
sujet de son « problème » d’inhibition, qu’elle ne croit pas « qu’un psychologue pourrait vraiment [l’]aider là-
dedans », et on va voir à la prochaine section que Juliette estime que c’est « toute seule » qu’elle a réglé
certaines de ses inquiétudes.
Pour bien cerner la part d’Internet dans cette évolution, nous présentons dans la section qui suit les avantages
et les désavantages perçus d’Internet, de même que les façons dont les participantes modifieraient le Web
pour mieux répondre à leurs besoins. Internet est aussi comparé à d’autres sources d’information, en
particulier aux cours de « Formation personnelle et sociale » suivis au secondaire (maintenant retirés du
curriculum scolaire).
5.3 Appréciation d’Internet
Tout au long de l’entrevue, et en particulier à la fin, nous avons eu l’occasion de discuter avec les participantes
des avantages et des désavantages qu’elles percevaient d’Internet comme source d’information sur la
sexualité. Si, par le blogue et les entrevues, on a pu constater qu’elles utilisaient le Web pour une variété de
sujets, qui vont des plus sérieux aux plus légers, on a également pu observer que certains thèmes étaient
absents, notamment en ce qui concerne la confiance des participantes en elles-mêmes et leur capacité perçue
ou réelle de pouvoir exercer du pouvoir dans leurs relations. Nous leur avons donc demandé si Internet
pouvait contribuer indirectement au développement de leur confiance en leur permettant d’être plus informées.
Les prochaines sections présentent leurs réponses.
5.3.1 Internet : ses avantages, ses désavantages, ses limites
Sans grande surprise, selon les participantes, l’intérêt principal d’Internet réside dans son accessibilité, dans
l’étendue des sujets qui y sont développés, dans le fait qu’il rend disponibles certaines informations sous
forme de vidéos, et dans l’anonymat qu’il permet. Justement parce qu’il est anonyme, Internet permet aux
participantes de s’informer sur des sujets qui leur paraissent tabous ou gênants :
L'anonymat que donne cet espace infini permet aux gens qui discutent sur des forums (par
exemple) de laisser leurs tabous de côté et de parler comme bon leur semble de leurs
270
expériences. Chose qui parfois serait beaucoup plus délicate devant des amis ou la famille.
C'est ce que permet Internet, la chute des tabous et des inhibitions. Je crois en somme qu'il
s'agit d'un outil beaucoup plus important qu'on le pense, il s'agit maintenant de l'utiliser de la
bonne façon. (Camille)
Il y a, estime Camille, « des choses qu'on n'ose pas exposer ou dire ouvertement, même entre amis, à moins
d'être vraiment vraiment proches », par crainte de leur réaction ou simplement parce que leur opinion pourrait
être biaisée. Ils pourraient, par exemple, répondre de façon plus ou moins honnête pour ne pas paraître de
telle ou telle façon. Internet, en ce sens, vient à la rescousse et permet de chercher sans gêne sur ces sujets.
Par exemple, Laurence était heureuse de pouvoir trouver de l’information sur le « vaginisme » sans avoir
à consulter ses parents ou ses amis :
Ben sur le vaginisme, mettons, est-ce que c’est normal que ça fasse mal? Ça fait 3-4 fois et
ça fait encore mal? Tsé, je n'aurais pas dit à mes amis: « Ah, je ne me sentais pas prête, et
je n'étais pas bien là-dedans. » Ça, j'étais plus gênée d'en parler. (Laurence)
S'il y a un sujet qui m'intrigue en ce moment, c'est bien celui des maladies transmises
sexuellement. Je trouve que c'est un sujet très tabou et qu'Internet reste la seule source
d'information où l'on peut être absolument anonyme. Parfois il y a des symptômes qu'on ne
réussit pas à identifier et appeler au 811 reste parfois difficile! Étonnamment, les sites sur
ce sujet sont très abondants et précis. J'y ai trouvé des réponses qui m'ont rassurée. (Alicia)
Par ailleurs, Internet leur apparaît efficace :
[Grâce à Internet], j'ai toujours pu trouver le moyen d'avoir des réponses à ce que j'avais
comme questionnements. Je n'ai jamais été vraiment déçue des réponses. (Audrey)
…rapide :
Je veux m'informer, mais je veux l'information LÀ. Et c'est ça que je trouve le fun avec
Internet, tu as la réponse LÀ. (Maude)
…et utile pour une multitude de sujets, en particulier en ce qui concerne les « grandes étapes », soit les
premières relations sexuelles, mais aussi les premières grossesses et premiers accouchements, infos qu’elles
cumulent pour « plus tard » :
Évidement, lorsque ma vie sexuelle changera, sûrement que certaines questions me
viendront à l'esprit et que je chercherai des réponses sur le Net, puisque je trouve que c'est
271
le moyen le plus rapide pour obtenir de l'info et qu'on peut souvent y trouver bien plus que
ce que l'on cherchait au départ! (Alexandra)
Les premières menstruations, quand tu es enceinte, quand tu as la ménopause, je pense
que ce sont les grands changements. Sinon, entre deux, je pense que c’est les affaires de
couple, mais oui, là être enceinte, je pense que ça va être la prochaine grosse étape. Je
sais qu'il y a beaucoup de livres sur être enceinte, donc là, Internet ne sera plus ma source
[principale]. (Sabrina)
Elles trouvent aussi pratique de pouvoir trouver sur Internet un discours autre que celui qu’on leur adresse
généralement à l’école ou dans les manuels qui leur sont dédiés :
C'est pratique de voir mettons de vraies images, de vraies situations, [des gens qui
racontent] comment ça s'est passé pour eux, plus [qu’un discours qui dit] : « Ça se peut que
ça t'arrive si tu fais telle ou telle affaire. » Ça aide plus à avoir des moyens pour éviter [des
situations négatives], peut-être plus que tsé, [se faire dire :] « Mettez un condom. »
(Alexandra)
Internet leur permet aussi de se préparer en vue d’une discussion avec un parent ou un ou une
professionnel(le) de la santé, bref de sentir moins « incompétentes » :
Avant de consulter quelqu’un, peut-être de savoir un peu ce que t'as, c'est quand même
intéressant. Plutôt que faire « Ah ben là, je ne sais pas pantoute ce qui se passe » et là le
médecin dit des affaires, c'est comme « Ah OK ». (Alexandra)
Par exemple, tu as une infection urinaire. Tu ne sais pas c'est quoi, alors là tu en parles
avec ta mère, mais tu vas voir sur Internet avant, comme ça, tu peux pousser plus loin le
questionnement, [te demander] : « Est-ce que c’est ça que j'ai vraiment? » au lieu de ne
juste pas savoir. […] Tu pousses plus loin les raisonnements. (Alicia)
Cette observation concorde d’ailleurs avec ce qu’a pu observer Drolet (2011) dans son étude sur les usages
d’Internet en lien avec des questions de santé par de jeunes adultes. L’une de ses participantes avait aussi
souligné qu’elle consultait le Web avant de rencontrer son médecin, afin d’éviter de paraître, disait-elle, « trop
niaiseuse » (p. 57). Internet semble donc permettre à nos participantes (et à celle de Drolet) de s’informer
incognito sur un sujet qu’elles ne maîtrisent pas pour mieux s’intégrer dans un monde où ceux et celles qui les
entourent semblent parfois « tout connaître ». Internet, en ce sens, leur sert d’outil pour exercer leur agentivité
personnelle, puisqu’elles prennent les moyens pour ne pas se sentir incompétentes ou pour d’abord s’informer
par elles-mêmes. Le seul fait de chercher des réponses à leurs questions témoigne déjà de leur agentivité :
272
quand elles cherchent des informations sur la sexualité ou sur le couple, elles démontrent non seulement un
intérêt pour la chose, mais aussi un investissement dans celle-ci, une prise en charge.
Toutefois, Internet n’a pas que de bons côtés, et les participantes en sont très conscientes. Elles posent
rapidement certains bémols sur l’efficacité ou les conséquences d’Internet. Sur le Web, disent-elles, « on
trouve de tout », et donc parfois aussi des informations erronées, exagérées, biaisées ou tout simplement
inventées de toutes pièces, que les usagers se repassent sans les vérifier :
Mettons les légendes urbaines [qui disent] que tu peux tomber enceinte quand tu t'assieds
sur le bol des toilettes. C'est vraiment niaiseux, mais toi t'as un petit doute! [rires] C'est le
genre d'affaires que je n'irais pas trop voir sur Internet, parce qu'il peut y avoir n'importe
quoi. Ça peut être sur n'importe quel sujet, tsé l'autodiagnostic sur Internet, tu penses que
tu l'as. C'est la même chose par rapport au sexe. (Camille)
On trouve beaucoup d'informations, c'est un point fort. On trouve beaucoup de points de
vue différents. […] Mais le gros point négatif, c’est la crédibilité. Est-ce que c’est vrai, tout
ça? Est-ce qu'il y en a qui écrivent juste pour faire ch… les autres, [en se disant] : « Ah, ils
vont me lire et ils vont me croire, tsé! » C'est nuancé. Mais je pense qu'aujourd’hui, je suis
capable de juger les sites auxquels je fais le plus confiance. (Sabrina)
Par exemple, Gabrielle estime qu’Internet lui a fourni des informations fausses sur l’utérus inversé :
Gabrielle : C'était juste les femmes qui avaient déduit ça, que c'était plus dur d'avoir des
enfants quand tu avais l'utérus inversé, parce que toutes les femmes pour qui c’était plus
difficile avaient l'utérus inversé. Alors elles ont toutes déduit ensemble sur plein, plein de
blogues que c'était une des conséquences.
Intervieweuse : Alors nous on lit ça et on a l'impression que c'est de l'information...
Gabrielle : ...vraie, parce que tout le monde dit ça.
Surtout, dit-elle, sur Internet, on trouve toujours le pire des situations ou des symptômes :
Sur plein de blogues, il y a plein de filles qui se sont mises à écrire : « Moi [le stérilet] m'a
donné mal au coeur, j’avais tellement mal à la tête, je ne m'endurais plus, il a fallu que
j'arrête de travailler... » […] Je te jure, il y avait au moins dix blogues qui disaient tous ça,
que […] c'était un calvaire dans leur vie et qu’elles voulaient juste s'en débarrasser. Alors là,
je me disais : « Ah, nice, je vais aller me faire poser ça! » [sarcarstique]. Mon médecin m'a
dit : « Ben non, j'en pose à plein de monde et ça va full bien... » Sauf que tsé, les gens que
ça va bien, ils ne vont pas l'écrire sur Internet, alors tout ce que t'as, c'est toujours le pire.
(Gabrielle)
273
Certains articles d’information, blogues et forums, de plus, auraient tendance à éluder certaines
options (notamment pour la contraception) et à fournir des informations qui se contredisent :
Tu ne peux pas vraiment savoir, [par exemple, ce que] les hommes aiment […] pour la
fellation, [car ils disent des trucs et] tout de suite en bas, ils disent : « Ah ben c’est différent
pour chaque homme. » Alors là, tu es toute mélangée, mais en même temps, tu veux en
savoir plus. Ça pique ta curiosité parce que ça se contredit tout le temps, alors tu essaies
de regarder ce qui revient le plus souvent. (Sabrina)
Il leur semble enfin difficile d’obtenir certaines informations, notamment des informations précises sur les
normes et les pratiques, ce que certaines cherchent pourtant activement :
Tsé, mettons, ils ne donnent pas de chiffres ou de statistiques, à part mettons une moyenne
d'âge pour ceux qui ont des menstruations. Tu ne peux pas vraiment savoir. (Sabrina)
Le pourcentage de femmes qui ne réussiront jamais à faire l'amour à cause de ça [du
« vaginisme »], à faire des enfants, c’est combien? (Gabrielle)
Ces statistiques sont recherchées surtout pour se convaincre qu’elles sont « normales », pour se comparer
à la norme et donc pour se rassurer. Ce qui les amène à s’examiner et se questionner sur leurs pratiques :
Personnellement je sais qu'Internet a influencé – et influence toujours – le regard que j'ai
de moi-même et donc de ma sexualité, car Internet a le pouvoir de nous rendre normal ou
anormal, même si on retrouve vraiment de tout parce qu'il existe quand même une vague
de ce qui doit être « normal ». Comment être avec un gars, comment séduire les hommes,
comment avoir le corps parfait pour les attirer tous, etc. Tous des titres de chroniques et
d'articles qu'on peut retrouver sur Internet et [qui] amènent parfois à s'autoanalyser et à se
remettre en question. (Camille)
Alors qu’elles cherchent à se libérer de la « tyrannie de l’apparence » (pour emprunter l’expression utilisée
entre autres par Le Breton : 2013, p. 58), elles se tournent vers Internet, mais comme le montre Camille, ce
qu’elles y trouvent ne fait que contribuer à instaurer des normes plutôt étroites.
Il arrive ainsi qu’Internet ne fournisse pas la réponse désirée ou espérée, ou encore ne puisse pas la fournir
alors qu’elles cherchent à se rassurer. Certaines, par exemple, se sont déjà empêchées de chercher certains
thèmes par crainte de ne pas se faire répondre ce qu’elles espéraient ou par crainte de tomber sans le vouloir
sur des sites pornographiques. D’autres cherchaient désespérément une réponse claire à une question
274
à laquelle elles ne pouvaient trouver la réponse sur Internet. Par exemple, Roxanne aurait voulu qu’Internet lui
dise si elle était enceinte :
Je crois que j'aurais aimé qu'ils me disent : « Non, tu ne seras pas enceinte » ou « Oui ».
[…] [rires] [J’aurais aimé qu’Internet] me dise: « Si tu as fait ça, ça ou ça, tu n'es pas
enceinte. » (Roxanne)
Océanne avait formulé le même souhait, qu’elle savait elle aussi impossible.
Alison, pour sa part, estime qu’une des limites d’Internet tient dans le fait qu’il ne puisse pas donner accès aux
expériences vécues par des proches :
Avec Internet, tu ne peux pas faire comme : « Toi, est-ce que ça t’a fait ça? » (Alison)
Ce qu’Alison montre ici, c’est que les participantes cherchent à obtenir une description du vécu de leurs
proches, à qui elles accordent plus de crédit, mais qu’elles se tournent plutôt vers Internet par gêne et par
commodité. Internet, en ce sens, ne peut que leur fournir une relation impersonnelle, alors que ce n’est pas
vraiment ce qu’elles cherchent. Ce résultat n’est pas sans rappeler la théorie du two-step flow de Katz et
Lazarsfeld (2008 [1955]) selon laquelle les proches exerceraient plus d’influence que les médias (p. 48). Mais
contrairement à la description habituelle du flux d’influence (où s’exerce l’influence intermédiaire des leaders
d’opinion), il semble qu’avec Internet et la sexualité il n’y ait pas toujours d’intermédiaire en qui elles ont
confiance, puisqu’Alison ne discute que très peu de sexualité avec sa famille, et qu’en certaines occasions,
elle est trop gênée pour poser une question précise à ses amis. Elle se tourne alors vers Internet.
En général, Internet est donc un outil de requête fortement utile, de « première ligne », en quelque sorte, mais
demeure dans la plupart des cas un complément d’information qui s’intègre dans la vie des participantes parmi
d’autres sources : médecins, amis, parents, livres, magazines81… Mais si, pour la plupart des participantes,
Internet tient lieu d’outil primaire de quête d’information (surtout si elles ne désirent pas discuter de sexualité
avec leur famille), certaines participantes ne lui laissent qu’une place très secondaire. C’est le cas, par
exemple, de Mégane, qui est très peu gênée avec ses copines, et avec qui elle parle de tout :
81 Nous avons posé la question « Quelles sont tes sources préférées pour obtenir des informations sur la sexualité? » aux
participantes, en leur demandant de faire un « Top 3 », mais nous nous sommes rendu compte que celles-ci avaient
tendance à confondre efficacité, fiabilité perçue et véritable utilisation dans leurs réponses. Nous n’avons donc pas
analysé directement les réponses à cette question précise. Nous avons toutefois conservé les explications de leur choix
pour bien comprendre leurs préférences.
275
Internet, je trouve que c’est tellement vaste, les réponses sont tellement différentes... J'aime
bien aller voir sur Internet, avoir des avis et tout, mais je dirais que je ne base pas… enfin,
ce que je veux vraiment savoir, ce n’est pas vraiment sur Internet [que je le trouve]. […]
C'est vraiment plus les copines [qui me fournissent ces informations]. Internet, j'y vais,
mais... pfff. (Mégane)
Pourtant, Mégane estime que ses copines lui fournissent des informations contradictoires et souvent partielles,
particulièrement en ce qui concerne « la première fois ». Elle réalise que ses amies ne lui disent pas tout, et
cherche à combler ce manque d’information au moyen d’Internet. Or, Internet présente la même limite : les
descriptions de la « première fois » qu’elle trouve dans les blogues et les forums lui semblent très
personnelles, donc subjectives et variables, tout autant qu’elle considère celles des sites « officiels » sont trop
« mécaniques », impersonnelles et générales.
Cependant, au final, malgré cet écueil d’Internet, malgré le fait qu’il puisse parfois nourrir leurs craintes plutôt
que de les apaiser82, ou malgré le peu de crédibilité de certaines informations trouvées, les participantes
estiment qu’Internet reste un outil pertinent pour obtenir des informations sur la sexualité :
[Il y a] des affaires qui m’ont paru énormes quand j'avais 12 ans, […] Je me suis beaucoup
stressée alors qu’il n’y avait pas [de raisons de l’être]. Quand j'étais plus jeune, pour moi
c’était normal de me poser ces questions-là, et en même temps je trouve ça bien que je sois
allée vérifier et [que je ne sois] pas restée avec les doutes que j'avais. […] Je pense que
c'était bien. (Roxanne)
Cependant, un thème précis semble généralement absent de leurs recherches : celui de la confiance en soi.
Nous discutons dans la prochaine section des raisons pour lesquelles ce thème est si peu cherché.
5.3.2 Confiance, agentivité et Internet : les grands absents
Si, par notre méthode, nous avons eu l’occasion de discuter avec les participantes des avantages et des
désavantages que présentent, selon elles, Internet, nous avons aussi été en mesure de constater que certains
thèmes faisaient peu l’objet de recherches sur le Web. Internet, en ce sens, semble être un moyen de choix
82 Drolet (2010), qui s’est penchée sur les usages d’Internet pour répondre à des questions de santé, a aussi observé
qu’Internet pouvait en certains cas nourrir les craintes plutôt que de les apaiser (p. 58). Ce phénomène pourrait être
caractéristique d’Internet, puisque certains chercheurs montrent que l’accès à un très grand nombre de données sur le
Web peut créer chez les usagers le besoin de valider les informations reçues. Paradoxalement, donc, le besoin
d’information s’intensifie au fil de la navigation (Harvey : 2004, Charest et Bédard (2009); pour une description rapide, voir
Drolet : 2010, p. 33). C’est alors qu’interviendraient les pairs : ceux-ci permettraient de valider les informations recueillies
par l’usager, un peu à la manière du two-step flow (aussi appelé Multi-Step Flow) (Charest et Bérard : 2009; Katz et
Lazarsfeld (2008 [1955]).
276
pour combler de besoins en informations factuelles et visuelles, mais est beaucoup moins utilisé pour
résoudre des problèmes liés à la distribution du pouvoir et à la confiance en soi, comme les façons d’exercer
plus d’agentivité. Quelques-unes ont cherché sur les façons d’améliorer la communication dans le couple,
mais les participantes, en général, ne semblent pas percevoir Internet comme un outil pouvant leur servir lors
de situations problématiques où elles se sentent un peu dépassées par les événements, sans contrôle ou peu
confiantes.
Elles ne croient pas non plus qu’Internet puisse répondre aux questions qui ont trait aux émotions; elles
cherchent alors à trouver une réponse par elles-mêmes :
Les questions d'ordre plus émotionnel, mettons, « est-ce que je me sens prête? », je ne
pense pas que... [ça puisse répondre]. Ça, c'est vraiment plus toi, là. (Laurence)
Prenons l’exemple de Juliette. Celle-ci, comme on l’a vu, avait tendance à se comparer aux anciennes copines
de son partenaire; elle estime à cet égard avoir déjà eu à des problèmes de confiance en soi. Internet ne lui
est pas apparu comme un outil pouvant l’aider à surmonter son problème :
Intervieweuse : Par rapport à ces inquiétudes-là, est-ce que tu as utilisé Internet pour
t'aider?
Juliette : Non, là-dessus, […] je me suis parlé à moi-même. […] Ça a été long, mais c’était
question d'être toute seule avec moi-même, il a fallu que je me parle, et il y a des journées
où je pouvais juste « focuser » là-dessus et être super fâchée par rapport à ça, sans lui en
parler. […] Ça revenait correct, mais toute seule avec moi. Souvent, si j'ai un problème côté
vie de couple ou confiance ou sexualité, je me parle, je laisse mijoter longtemps et je finis
par trouver les bons arguments et me rassurer.
Intervieweuse : Et Internet à ce moment-là vient t'aider dans quel domaine?
Juliette : Ben pas côté confiance. […] Internet m'a aidée plus [en ce qui concerne] les
questions, la protection, les maladies, mais pas côté « intérieur humain », si on veut. Pas du
tout. C'est toute seule avec moi que j'ai réglé ça, avec le temps.
Pour elle, c’est un problème que ni ses amies, ni sa mère, ni Internet ne semblaient pouvoir régler :
Juliette : J’en ai parlé avec mes amies, autour de moi, j'ai vraiment dit le problème,
comment je me sentais, des exemples, sans... Je n’ai pas le souvenir qu'elles m'aient
donné des trucs ou bien [qu’elles m’aient dit] : « Ah moi aussi, ça m'est arrivé ». Quand je
dis « côté humain », c'est plus côté en dedans, c'est avec moi-même. Moi, je me pose des
questions sur moi, je me pose des questions sur lui, sans en parler avec personne. Je
277
garde ça... Tsé, je ne me verrais pas demander à ma mère : Maman, je ne me sens pas
confiante en moi pour ci, pour ça, comment on fait pour être confiante?
Intervieweuse : C’est un travail... [sur soi].
Juliette : Oui, c’est ça, c’est un travail.
Amélie, par exemple, a l’impression de n’exercer aucun pouvoir dans son couple, et réalise que c’est un
problème qu’elle voudrait régler. Cependant, Internet ne lui semble pas une option :
Intervieweuse : As-tu déjà cherché sur Internet par rapport à ça? As-tu déjà essayé de
trouver une solution?
Amélie : Non. On dirait que c'est trop complexe comme problème, je ne pourrais pas aller
écrire sur Google quelque chose qui ressemble... tsé, « contrôle sur... ». On dirait que je ne
trouverais pas ce que je veux. J'ai cette impression-là.
Dans le cas de Rosalie, ce sont les ami(e)s qui lui permettent d’améliorer sa confiance :
Intervieweuse : As-tu déjà utilisé Internet par rapport au fait d’être plus affirmée ou de
prendre plus le contrôle?
Rosalie : Non. Ça, j'en ai plus parlé à mes ami(e)s, bien à ma meilleure amie, je lui disais la
manière [dont je me sentais] et elle [me donnait des conseils]. C’est arrivé [par exemple]
que mon premier chum [ne vienne] pas me voir souvent, et je trouvais ça vraiment bizarre.
Tsé, je ne le lui disais pas, je le laissais faire. [J’en parlais plutôt] à ma meilleure amie :
« Trouves-tu que ce n’est pas normal? » Elle a dit : « Oui, tsé, il n’a pas l'air de carer, tu
devrais lui dire que tu aimerais le voir plus souvent, et que tu aimerais plus passer du temps
avec lui » et tout ça.
Intervieweuse : Lui en as-tu parlé, à lui?
Rosalie : Un petit peu. Il a dit : « Ah, je travaille. » C'est une excuse.
Intervieweuse : Il ne t'a pas vraiment écoutée.
Rosalie : Pas vraiment, non.
Jade, qui éprouve de la difficulté à éloigner un garçon qui la colle un peu trop, n’utilise pas non plus Internet
pour régler ses difficultés « relationnelles » :
278
Jade : J'avais l'impression [qu’il était] comme un exemple une balle gluante... Je n’arrivais
pas à m’en débarrasser. […] Je pense qu’il aurait fallu que je lui dise : « Arrête de
m'achaler, je ne veux plus te voir. » Que je prenne plus d'assurance pour dire ça. […]
Intervieweuse : Est-ce qu’Internet t’a aidée à ce moment-là? À lui dire non?
Jade : Non, je n'ai pas pensé à faire ça. En général, je vais sur Internet faire des
recherches, mais je ne vais pas poser de questions [personnelles]. Je vais aller chercher
des informations [plus précises].
Et Océanne, qui a eu un copain très insistant et un peu violent, n’a pas pensé à utiliser Internet pour reprendre
le contrôle non plus.
Bref, les thèmes de la confiance en soi, de l’exercice du pouvoir dans le couple ou de tout autre problème
d’ordre plus psychologique ou relationnel demeurent les grands absents des quêtes des participantes sur
Internet. Suzuki et Calzo (2004) avaient aussi remarqué que les aspects interpersonnels de la sexualité et les
thèmes liés de façon générale à la santé mentale étaient absents des questions posées sur les forums de
discussion analysés (p. 692). Les questions liées aux abus physiques et psychologiques étaient également
fort peu présentes (loc. cit.). Comme les participants de ces forums, nos participantes ne semblent pas
considérer Internet comme une source potentielle pour acquérir plus de pouvoir et de confiance. En tous les
cas, pas de façon nette ou directe. Car lorsqu’on a demandé aux participantes ce qu’aurait été leur vie
(sexuelle) si Internet n’avait pas existé, elles ont répondu en général qu’Internet leur fournissait d’abord un
accès à des connaissances qu’elles n’auraient pas obtenues autrement, et que ces informations contribuaient
ultimement à leur donner confiance en leurs capacités.
Leurs réponses à cette question restent cependant diversifiées, et peuvent toutes êtres placés sur un axe
allant de « Internet mine la confiance en soi » à « Internet permet d’augmenter le contrôle de sa sexualité ».
Sur cet axe, les réponses pouvaient être soit : 1) Internet leur semblait avoir fourni des informations qui minent
leur confiance, 2) Internet n’a rien changé du tout, mais s’avérait un outil complémentaire, 3) Internet les ont
aidées à trouver des informations, donc elles se sentent plus confiantes, ou 4) Internet les ont tellement aidées
à mieux se sentir qu’elles ont pu, grâce (indirectement) à Internet, exercer plus de contrôle dans leur sexualité.
Rares sont les participantes qui ont répondu 1 ou 4, mais c’est le cas d’Amélie, qui a répondu à la fois 1 et 4.
Amélie, en effet, entretient un rapport ambivalent avec Internet, qui tantôt lui permet de se rassurer, mais qui
tantôt mine sa confiance. Amélie, comme on l’a vu, éprouve beaucoup de difficultés à exercer du pouvoir dans
son couple. De plus, elle a très peu confiance en elle, surtout, dit-elle, parce qu’elle a les seins petits, et parce
qu’elle n’éprouve que très peu de plaisir (voire de la douleur) lors des rapports sexuels. En ce qui a trait à la
279
taille des seins, par exemple, elle a pu constater que des mannequins (qu’elle estimait belles) avaient souvent
elles aussi de petits seins, ce qui l’a rassurée :
Tsé, ça va des deux côtés. Des fois, [puisque] j'ai des petits seins, tsé je n’en ai pas vu
souvent, mais des fois j'allais voir, par exemple des top modèles, et je voyais qu'elles
étaient pareilles à moi, donc ça me réconfortait. (Amélie)
Mais la pornographie sur Internet a tôt fait de réduire à zéro ce premier pas qu’elle avait pu franchir pour
augmenter sa confiance :
[Si Internet n’avait pas existé], j'aurais moins vu de corps de femmes et d'hommes nus,
alors j'aurais moins [en tête] un certain idéal de la femme, parce que c'est rare qu'on voie
des femmes nues à la télévision, c'est plus sur Internet. Probablement que je serais plus
confiante par rapport à mon corps […]. Parce que, justement dans la pornographie, ils
prennent tout le temps des filles qui sont, ben pas tout le temps, mais souvent ce sont des
filles qui sont bien faites, avec de gros seins, des hanches, des fesses, et tout. À force d'en
voir, à un moment donné, tu te mets dans la catégorie des anormales, alors ça m'a fait ça
assez souvent de me sentir... [pas belle], et quand tu en vois plein, plein, plein, un moment
donné, tu te dis que toi tu n'es pas faite [comme elles]. (Amélie)
Pourtant, elle ne regrette pas en avoir regardé :
Intervieweuse : Est-ce que ça aurait été positif ou négatif de ne pas en avoir vu?
Amélie : Ah, je suis contente d'en avoir vu. […] De ne pas l'avoir vu, je trouverais ça... [pire].
C'est sûr que ça peut te donner certaines envies, que ça te fait voir ce que les autres
expérimentent aussi. Même si la pornographie, ce n'est pas nécessairement réel, quand
même, je trouve ça positif d'avoir vu ça. Je ne dirais pas que c'est négatif, ça ne m'a pas
nui... (Amélie)
En ce qui concerne la douleur qu’elle ressentait lors de rapports (ce qui la faisait aussi se sentir anormale), le
fait de consulter des forums de discussion semble l’avoir aidée :
La douleur aussi, c'est sûr que j'ai pu aller sur des sites de discussion où d'autres filles qui
avaient de la douleur en parlaient, tandis [que sans Internet, puisque] toutes mes amies
n'en avaient pas [de douleur], […] je n'aurais jamais su qu'il y avait d'autres gens qui
vivaient la même chose que moi, alors ça m'a aidée sur ce côté-là aussi, les sites de
discussion. (Amélie)
280
Toutefois, au final, elle estime avoir changé un peu sa perspective des choses. Si le fait d’avoir de petits seins
la complexe encore, elle essaie d’attacher moins d’importance à son apparence. Une légère évolution dont
elle attribue le mérite à Internet :
Quand j'étais plus jeune, j'étais trop centrée là-dessus [l’apparence physique]. Je me
sentais comme si c'était juste ça qui comptait, tandis que maintenant, même si ça me gêne
encore autant, j'ai conscience que ce n'est pas juste ça qu'un gars regarde.
Intervieweuse : Internet a-t-il eu à voir avec cette évolution?
Amélie : Ben peut-être un peu quand même, parce qu'une fois je suis allée sur un site où
c'était des gars qui parlaient des petits seins, et il y en a tellement qui ont dit qu'ils aimaient
plus les petits seins. J'étais toute contente quand j'ai vu ça, alors c'est sûr qu'Internet a pu
aider.
Alicia partage le point de vue d’Amélie sur le fait qu’Internet puisse en certaines situations nuire au contrôle et
à la confiance :
Non, je ne penserais pas [qu’Internet] modifie le contrôle, et même que ça lui nuit à un
certain moment. Parce que dans le fond, sur Internet, ce que tu vois, c'est vraiment... des
filles qui ont le contrôle ou qui se laissent contrôler, et en même temps ça t'intimide, parce
que, si je vois des images, je ne sais pas, moi, d'une fille qui fait une danse ou peu importe,
ben là, je ne me situe pas du tout par rapport à elle, je ne la prends pas comme modèle, et
si je la vois comme se faire attacher ou peu importe, je ne me situe pas non plus [par
rapport à ça]. […] Alors on dirait que je ne me sens pas concernée par ce que je vois sur
Internet, par la porno ou peu importe, ça ne vient pas me chercher. Au contraire, s’il y a une
fille sur un forum ou une de mes amies qui me dit : « Ah, ben, c'est normal, de faire ça », là
je vais me sentir plus : « OK, ben d'abord, je vais le faire. » Je dirais qu'à un certain niveau,
ça m'intimide presque de voir ce qui peut se passer sur Internet et ce dont les filles ont l'air.
Ça ne me donne pas de l'estime, et des fois, je me dis : « Ben voyons, est-ce que c’est moi
qui suis encore plus poche que ça? » (Alicia)83
83 Alicia témoigne ici également du fait qu’elle accorde plus de confiance à ce que disent ses amies qu’à Internet,
confirmant encore une fois la pertinence, pour Internet, de la théorie du two-step flow de Katz et Lazarsfeld (2008 [1955])
déjà décrite plus haut. Mais pour elle, même une usagère inconnue d’un forum peut servir d’intermédiaire en qui elle
accorde de la confiance pour valider certaines informations. C’est qu’il apparaît difficile à Alicia d’engager la conversation
sur la sexualité avec ses ami(e)s, ne sachant pas trop quelle est la « limite » à respecter avec eux. Ce qui ne veut pas
dire qu’elle accorde nécessairement une très grande crédibilité aux histoires personnelles des autres internautes. Elle
précise dans son blogue qu’elle « ne veu[t] pas être informée par des gens qui ne s'y connaissent pas » et que « la seule
chose que [lui] apportent les blogues, c'est le réconfort de voir [qu’elle n’est] pas la seule à vivre telle ou telle chose »;
bref, la rassurance que ce qu’elle vit est « normal ».
281
La majorité des participantes, toutefois, ont répondu qu’Internet leur sert pour obtenir de l’information, qui
ultimement pourrait les aider à être plus en confiance (réponses 2 et 3). Pour Audrey, par exemple, dont la
mère est sexologue, le fait qu’Internet existe ne change pas beaucoup de choses; il rend simplement l’accès
plus facile :
C'est pratique, ça va plus vite pour chercher, et c'est plus facile de tomber sur ce que tu
cherches que quand tu fouilles « x » nombre de temps dans ces briques-là! […] [Internet]
m’a donné de l'information complémentaire, mais je n'étais pas dans la misère! (Audrey)
Pour Sarah, par contre, Internet permet de contourner un élément embêtant : la gêne.
Il aurait fallu que j'aille me renseigner à une infirmière, un médecin, à mes chums, il aurait
fallu que je me « dégêne » et que je pose vraiment des questions, parce que la moitié des
questions que j'ai écrites là, je les ai cherchées dans Internet. Il aurait fallu que je prenne
les devants [et] que je me dégêne dans le fond. [Si Internet n’avait pas été là,]
probablement que je serais arrivée la première fois [pour faire l’amour] et que je n'aurais
pas su quoi faire, parce que je ne me serais pas renseignée auprès de personne. J'aurais
attendu que ça se passe. (Sarah)
Alexandra aussi estime qu’il aurait été trop embarrassant de poser des questions à un adulte :
Sûrement que j'aurais cherché de l'information plus tard, parce que vraiment quand j'ai fait
mes « grosses recherches », j'étais plus jeune, j'aurais été trop gênée pour demander
à quelqu’un. Peut-être que j'aurais été plus vers les livres, cachée dans un coin de la
bibliothèque toute seule. Avec une tente! [rires] (Alexandra)
Sarah, qui dit avoir peu confiance en elle, estime qu’Internet lui permet de gagner en confiance. Par exemple,
elle envisage maintenant avec une attitude positive son premier rapport sexuel. Sans l’aide d’Internet, cela lui
aurait semblé impossible :
Oui, là, j'ai plus de confiance, je me dis que tout le monde a passé par là. Dans ma tête, ça
va bien aller. Parce que j'ai eu des réponses, on dirait que j'ai plus confiance en moi. Parce
que si je n'avais pas posé aucune question, j'aurais été nerveuse, j'aurais tremblé comme
une feuille, j'aurais eu zéro confiance en moi. (Sarah)
C’est qu’Internet, en répondant à leurs questions et en leur donnant accès à des histoires personnelles par le
biais des blogues et des forums, leur permet d’anticiper certaines situations et de s’y préparer mentalement.
Comme l’explique Noémie :
282
Ça m'a comme familiarisée à une situation que je n'avais pas vécue et que je ne
connaissais pas, un peu […], tsé, par procuration. [Alors] quand j’en suis arrivée [à faire
l’amour], j'étais moins stressée, je savais un peu comment ça fonctionnait. J'étais plus
à l'aise. (Noémie)
Lorsqu’on lui demande si elle pense qu’Internet lui a, en conséquence, permis d’exercer plus de contrôle,
Noémie met un bémol :
Je ne pense pas que ça va jusque-là, mais c’est entre les deux. (Noémie)
Cette réponse de « l’entre-deux » est la plus courante chez les participantes. Elles considèrent en général
Internet comme un moyen contribuant indirectement à acquérir de la confiance, par le fait qu’il leur donne
accès à de l’information, mais estiment le plus souvent que cette confiance ainsi acquise ne va pas jusqu’à
leur permettre d’exercer plus de contrôle :
Je pense que c'est plus dans le milieu. Tsé, ça m'a aidée parce que ça m'a donné des
informations que je n'aurais peut-être pas osé demander ailleurs. Plus confiante et tout, je
ne pense pas. C'est complémentaire, mais vraiment utile. (Laurence)
Comme on l’a vu, c’est plutôt par l’expérience et le bon choix de partenaire qu’elles estiment pouvoir gagner
en agentivité.
Discussion
Bref, on remarque dans l’ensemble qu’Internet permet d’augmenter la confiance des participantes en certaines
situations, alors qu’il peut la diminuer simultanément en d’autres. Cela montre à quel point les contenus
médiatiques et leur réception (en particulier ceux sur Internet) sont variés et contradictoires (voir Gill : 2012).
Même une source identique (par exemple, le site Web du magazine Cosmopolitan) peut être à la fois source
d’empowerment (connaître les positions, apprendre que le plaisir doit être partagé) et de disempowerment
(ressentir la pression de vivre une sexualité variée, constater qu’on ne correspond pas aux critères restreints
de la beauté commerciale).
D’autre part, si les participantes peuvent en certains cas se montrer très critiques et être capables de
déconstruire certains discours (par exemple, en ce qui concerne la pornographie), elles peuvent en même
temps être moins critiques de certaines sources (Alexandra dit que c’est pratique de voir sur Internet de
« vraies images » et de « vraies situations ») ou continuer d’être affectées par une source, même si elles sont
capables de la déconstruire. Alicia, par exemple, se dit « intimidée » par les actrices pornos qui se montrent
283
très en contrôle, même si elle est bien consciente qu’il s’agit d’une mise en scène, et Amélie est quand même
découragée par l’apparence physique des actrices pornographiques, même si elle sait que leurs seins ont
probablement été artificiellement augmentés. Elle a alors besoin pour se rassurer de trouver sur Internet un
discours masculin qui lui dit que les petits seins sont aussi attirants.
C’est en raison du fait que les médias puissent décourager même les réceptrices les plus critiques que Gill
(2012) a récemment remis en question l’apologie de la littératie des médias (c’est-à-dire l’éducation aux
médias) comme « remède » à l’influence négative des médias sur les jeunes filles :
What we have found in our research throws into question any easy celebration of media
literacy. The girls in our study show varying degrees of media literacy, with some of them
extremely critical consumers of media, even from the age of 10. They are familiar with the
language of critique and, moreover, take pleasure in "unpacking" media images to show
their artifice. In particular the girls enjoyed displaying their awareness that media images are
constructed, with many exchanges about techniques such as airbrushing, the use of
photoshop or the difference between magazines’ standard "before and after" shots in which
"everything had changed", not just the area of the body that "should" have [been] done. […]
Indeed, in many senses the girls seemed archetypal media literate subjects – knowing,
critical appraisers of adverts, magazines and a whole variety of other genres. So far, so
media literate, it would seem. And yes despite this – despite an extraordinarily sophisticated
vocabulary of critique – media representations still got at them, still had an ability to hurt
them, still […] made them "feel bad" or "feel sad" and/or made them long to look a particular
way or to own a particular product. (p. 740)
Selon Gill, le fait que les filles sachent déconstruire les représentations médiatiques ne les aiderait pas à se
sentir plus fortes, plus heureuses ou plus empowered (loc. cit.). Plus encore, elle estime que cette injonction
qu’on leur impose d’être capables de critiquer les médias est un autre des effets indésirables du
postféminisme, puisqu’il impose le travail de déconstruction aux individus, qui doivent être « responsables » et
« autonomes » (p. 741). Selon elle, il serait plus productif de lancer une campagne sociale contre le sexisme
(loc. cit.) : le sexisme, contrairement aux discours sur la littératie des médias ou sur la sexualisation, prendrait
mieux en compte les différences de classe, de genre, d’âge et d’habilité corporelle (able-bodied). Cependant,
si nous pensons qu’il est important de dénoncer le sexisme, nous ne partageons pas complètement le point de
vue de Gill, qui semble faire de ce concept le seul qui soit socialement situé.
En ce qui concerne l’éducation aux médias, même si nous remarquons, comme Gill, qu’il ne s’agit pas d’une
« panacée » (p. 740), nous ne pouvons concevoir que l’on cesse de recommander cette démarche. Comme
nous l’avons vu un peu plus haut lorsqu’il a été question d’agentivité, sans une éducation permettant de
déconstruire les normes et les discours médiatiques, il est difficile pour les jeunes filles de se sentir libres de
284
faire des choix qui leur conviennent. Comment peuvent-elles se distancier de leur condition sans une
éducation à la sexualité, aux discours et aux médias? La campagne contre le sexisme que promeut Gill nous
apparaît d’ailleurs être elle-même une déconstruction et une éducation médiatiques. Nous avons donc
beaucoup de difficulté à concevoir comment l’absence d’éducation aux médias pourrait être profitable pour les
filles. Au contraire, à l’instar de Lamb et Peterson (2010), de Tiefer (2000) ou de Russell (2005), il nous
semble impératif de poursuivre dans cette direction et d’améliorer cette éducation.
Bien sûr, l’éducation aux médias ne peut assurer un blindage parfait contre les « effets » des normes, et
certaines participantes sont en effet intimidées, gênées ou attristées par ce qu’elles trouvent sur le Web, mais
contrairement à Gill, nous estimons que l’éducation aux médias et à la sexualité peut faire une différence.
Comme la sexualité est profondément sociale, le simple de fait de discuter de sexualité constitue une
déconstruction; les jeunes femmes interrogées ont montré qu’elles s’intéressaient ardemment à ces discours,
à l’histoire de la sexualité, et aux différentes expériences de ceux qui les entourent. Elles montrent donc déjà
un certain intérêt pour cette déconstruction, et nous verrons plus loin (à la section 5.3.4) jusqu’à quel point
elles cherchent un discours non normatif sur la sexualité. Mais avant, il nous importe de présenter les
différences dans l’appréciation qu’elles font de deux sources Web : les forums et les sites officiels.
5.3.3 Les forums et les sites officiels : deux mondes
Lorsqu’elles cherchent sur Internet, la plupart des participantes ne vérifient pas d’emblée les sources des
informations qu’elles trouvent, mais se dirigent instinctivement vers les forums pour les questions d’ordre
psychologique (avec conscience que l’information qu’elles y trouveront pourra ne pas toujours être fiable) et
vers les sites plus « officiels » lorsqu’elles sont à la recherche d’informations factuelles sur un sujet précis
(comme pour les ITSS, la contraception ou les douleurs à la pénétration). L’information leur semble alors plus
crédible. Mais le recours à de tels sites semble relever d’un besoin précis et ponctuel, ce qui n’est pas toujours
le cas pour les forums. Comme l’explique Juliette :
Il faut qu'il y ait un problème. Je n'irais pas nécessairement lire [des sites gouvernementaux]
sans question, je vais avoir un but. (Juliette)
Parmi les sites gouvernementaux ou officiels qui ont été mentionnés par les participantes, on trouve le site de
TelJeunes, Masanté.com, MaSexualité.ca, PasseportSanté et le site de l’Agence de santé publique du
Canada. Par exemple, le site de TelJeunes a été utilisé par Audrey, qui aime que le vocabulaire utilisé sur le
thème de l’orientation sexuelle soit « facile à comprendre », et Émy a eu recours au site du Réseau canadien
pour la santé des femmes pour obtenir de l’information sur le test de Pap. Les sites Web des compagnies
285
pharmaceutiques qui produisent des contraceptifs (Mirena, Alesse, Plan B…) sont aussi parfois utilisés
lorsqu’elles cherchent une information précise et fiable.
Les sites « officiels » sont appréciés pour la crédibilité de leurs informations, la clarté et l’étendue des
réponses fournies, de même que pour leur facilité d’utilisation :
J'aimais ça [sur MaSanté.ca]. Je trouvais que c'était bien fait. J'y allais souvent, et il y avait
de petits quiz. J'aimais vraiment faire les quiz! (Noémie)
Je suis allée sur Google et j'ai tapé « vaginisme » et je me suis retrouvée sur le site Internet
de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) qui décrit clairement le
problème. On répond aux questions les plus fréquentes à propos du problème et ce qu'on
y apprend a été, à ma grande suprise, très apprécié. (Gabrielle)
Je me rappelle du site de Tel-Jeunes qui a un volet sur la sexualité pas pire. Ça répond
beaucoup à toutes les questions que les jeunes peuvent se poser à ce sujet. J'ai regardé
dans mon cas surtout pour la contraception, vers l'âge de 15 ans environ, quand ça
commençait à m'intriguer! Je ne connaissais presque aucune autre méthode que le
condom, alors je fus surprise. (Laurence)
Toutefois, le préjugé demeure que les sites « du gouvernement » soient peu clairs ou inintéressants, alors
même que d’autres sites « officiels » sont utilisés :
Concernant les sites que je ne consulterais jamais, les sites gouvernementaux font partie de
ceux-là. Il y a quelque chose qui est impersonnel quand ça vient du gouvernement. Par
contre, les blogues personnels ne m'inspirent pas non plus! Je ne veux pas être informée
par des gens qui ne s'y connaissent pas! La seule chose que m'apportent les blogues, c'est
le réconfort de voir que je ne suis pas la seule à vivre tel ou telle chose. Les sites que je
regarde sont des sites de psychologues ou de professionnels de la santé. J'ai confiance en
eux et je sais qu'ils ont toujours des solutions. (Alicia)
Quant aux forums et aux blogues, ils sont appréciés, à l’inverse, pour leur côté divertissant et pour le « soutien
psychologique » qu’ils peuvent offrir. Les forums leur permettent d’être témoins des expériences vécues par
les autres, bref d’avoir accès à une information plus personnalisée, plus subjective :
Les forums, c'est sûr, ce n'est pas de l'information sûre à 100 %, ce sont juste des avis. Tu
peux aller voir ce que les autres pensent et ce qu'ils vivent, mais ce n'est pas pour
m'informer en tant que tel. (Laurence)
Ça dépend de la gravité de ton sujet, tsé, comme sur le VPH, j'irais plus sur des sites qui
me donnent des statistiques que sur un forum qui me dit : « Ah, bien moi, j’ai eu le vaccin
286
contre le VPH… » […] [Si le sujet est] plus psychologique, des questions de couple,
comment vivre ensemble, ben là tu peux aller voir plus des forums, qui expliquent [ça],
justement. (Sabrina)
Ça dépend c’est pour quel sujet, si c'est des sujets justement comme sur la contraception
ou la maladie, des choses comme ça, je vais plus regarder des sites gouvernementaux,
mais si c'est plus pour les sujets comme mettons de nouveaux jouets ou des choses
comme ça, ou des positions ou des expériences à faire, ce n'est pas très gouvernemental!
Ça dépend vraiment des sujets que tu veux, parce que des fois, côté sexualité plus
sérieuse, ou un peu plus divertissante, si je peux dire ça comme ça, ça dépendamment de
ce que je cherche, j'irai voir différentes choses. (Jessica)
Discussion
Encore une fois, ces résultats concordent avec ce qu’a pu observer Drolet (2011) : « La consultation des
témoignages sur ces plateformes d’échange permet de constater que d’autres personnes ont vécu une
situation de santé similaire et peuvent donc ainsi fournir des pistes de solution au problème de santé dont il
est question. » Plus encore, estime-t-elle, « [l]es récits d’expériences qu’ils y trouvent leur permettent aussi de
se sentir moins seuls dans leur situation de santé » (p. 65), ce qui correspond également à ce qu’ont exprimé
nos participantes. Suzuki et Calzo (2004) ont d’ailleurs pu observer que les réponses fournies par les
participants des forums sur la santé sexuelle et la vie adolescente en général, en plus de fournir des avis, des
opinions personnelles et de l’information pratique et concrète, fournissaient souvent du « soutien émotionnel »
à ceux qui posaient des questions (p. 696).
Enfin, comme nos participantes, les participants de l’étude de Drolet ont également estimé se sentir plus en
confiance lorsque l’information trouvée en ligne provient « d’une source qu’ils considèrent officielle » (même
s’ils appréciaient en certaines situations consulter des forums, considérés peu fiables). Les sites
gouvernementaux ou les sites d’organismes reconnus leur apparaissent en ce sens plus « crédibles », mais
les sources des sites consultés ne sont pas systématiquement vérifiées (p. 72).
5.3.4 Internet, le sexe et les cours de formation personnelle et sociale
L’un des sujets fréquemment abordés sur le blogue concerne les cours d’éducation sexuelle à l’école
secondaire, en particulier le cours de « Formation personnelle et sociale », qu’ont suivi les participantes, mais
qui semble vraisemblablement retiré des curriculums à l’heure actuelle. Si les cours de FPS suscitaient chez
elles une curiosité et un intérêt évidents… :
Intervieweuse : Le cours de FPS, ça s'est bien passé?
287
Audrey : Oui, ça, ça m'intéressait. J'aimais assez ça quand tu pouvais aller dans ces
modules-là! J'étais tout ouïe!
… elles ont tôt fait cependant de souligner plusieurs de leurs limites, notamment l’apparente impossibilité de
poser des questions :
Et la troisième, [la source] que je ne voudrais jamais [utiliser]... les profs! [rires] Geez... Les
cours de FPS, O.K., mais je ne me verrais pas aller parler à une prof, poser des questions
juste de même. Ça, je ne me verrais pas faire ça. (Audrey)
Tsé, le prof pose des questions, mais il n’y a personne qui ose poser des questions devant
tout le monde. […] Tsé, tout le monde se connaît en plus... Si tu dis quelque chose, c’est
sûr que ça t'est arrivé, tu ne peux comme pas poser de questions et les histoires partent
vite. C’est gênant. (Roxanne)
Moi, je ne suis pas une fille qui pose des questions peu importe le cours. Je les garde pour
moi ou je les pose à mes chums. Pour ces sujets-là, je suis allée sur Internet. (Sarah)
Cependant, les cours de FPS leur ont fourni une base d’information sur certains sujets clés, comme les ITSS
et la contraception. Cette « base » a pu susciter chez certaines assez de curiosité pour qu’elles continuent de
s’informer sur le sujet sur Internet une fois à la maison, afin de combler les déficits en information des cours
donnés à l’école :
Intervieweuse : Quand tu dis « se renseigner sur les maladies », est-ce que c'était le cours
de FPS?
Sarah : Oui, le cours FPS, j'ai vraiment aimé ça, j'ai fait comme, OK, c'est normal que j'aille
chercher des affaires de même, j'avais peur d'aller chercher des affaires avant et de me dire
: OK, est-ce qu’il y a juste moi qui cherche ça? Est-ce que c’est normal que je cherche ça?
Quand j'ai suivi le cours de FPS, [l’enseignante] a expliqué toutes les maladies une par une,
elle expliquait en bref, et j'ai été voir [sur Internet], et ça me renseignait plus.
-
[Concernant les ITSS], on en entendait parler à l'école, [mais] je trouvais que ce n'était pas
clair, on avait un cours de sexualité…
Intervieweuse : FPS?
Juliette : Oui, c’est ça. Ils en parlaient, et moi ce n'était pas clair à ma façon. Je voulais des
exemples, je voulais... connaître les symptômes, c'est quoi, comment ça se guérit, je
voulais en savoir plus, juste par curiosité.
288
Intervieweuse : Internet, ça a été ta solution?
Juliette : Oui, oui. Je ne voyais pas d'autre solution. Non, je ne savais pas où... Je savais
que sur Internet, j'allais sûrement avoir ça.
Si, à l’inverse, pour quelques participantes (notamment pour Rosalie, pour qui l’information était « assez
claire »), le cours de FPS a comblé les besoins en information sur les ITSS, la très grande majorité des
participantes déplorent que ces cours ne semblent axés que sur deux thèmes : les ITSS, justement, et la
contraception :
Quand on a des cours à l'école, ils ne misent pas assez sur certains points, ça nous laisse
toujours avec des interrogations. Ils tournent autour du pot au niveau de certaines
questions, et je suis sûre que je ne suis pas la seule que ça doit interroger, et t'as peur de
poser des questions à des adultes qui doivent avoir aussi comme des préjugés envers toi.
(Maude)
Ils ne disent pas grand-chose. À part la contraception, ça s’arrête là. (Émy)
La pilule, le condom... je suis écoeurée d'entendre parler de ça. Maintenant, il y a plein de
nouveaux contraceptifs dont ils ne parlent pas. […] Ils vont juste à l'essentiel. Il y a ça et ça.
[…] Pour la pornographie... ils vont juste en surface. Ils ne nient pas que ça existe, mais
bon. « Il y a de la pornographie, point. » On passe à autre chose. (Maude)
Maude, justement, aurait aimé qu’on lui en apprenne plus sur la pornographie, et sur les différentes positions,
afin de savoir simplement « qu’elles existent ». Elle explique dans son blogue :
Quand j'étais jeune, pour moi, la pornographie, c'était une manière de faire l'amour (eh oui
un peu naïve, mais bon) et la première fois lorsque je suis tombée par erreur sur un site
Internet de pornographie j'ai été bouche bée. Premièrement parce que je n’en avais jamais
vu et deuxièmement parce que ce que mon professeur m'avait dit à ce sujet n'était pas du
tout la même chose. De plus, lorsque j'étais jeune, on me disait que ce n'était pas bien d'en
regarder. Le pourquoi de cette interdiction m'était toujours expliqué d'une façon si vague.
Dommage, car de plus en plus il y a de la pornographie sur Internet en plus d'être quasi
accessible à tout le monde. (Maude)
Elle aurait aimé qu’on lui explique à l’école « pourquoi il y en a qui regardent ça, pourquoi il y en a qui ont
besoin de ça, et pourquoi ils font ce métier-là. » Elle estime que les cours passent trop rapidement sur la
question, sur la pornographie en particulier et sur la sexualité en général :
289
Ils vont trop globalement, ou trop généraliser par rapport à la sexualité. « OK, la sexualité,
c'est ça, ça, ça. » Mais au contraire, il y a plein d'à-côtés qu'ils oublient. (Maude)
Pour les participantes, l’attitude de l’enseignant dans ces cours joue pour beaucoup. Roxanne et Noémie
décrivent leur expérience :
Honnêtement, ces cours étaient carrément incomplets. Le professeur […] était un homme
assez âgé et ne sachant pas très bien mettre les jeunes filles à l'aise. [Il] était incapable de
prononcer le mot condom ou masturbation sans rougir... Il n'était pas du tout à l'aise avec la
question de la sexualité et il devait nous l'enseigner. Il lisait ce que le manuel indiquait,
point. Mais dans les manuels, il n'y a pas tout. Il n'accordait jamais de périodes de
questions... et de toute façon nous aurions été trop gênés de le lui demander. (Roxanne)84
-
Noémie : Moi, j'étais dans un programme international au secondaire et je n'ai pas eu de
cours sur la sexualité. Ben j'en ai eu un de deux heures. Alors il y a des trucs qu'on n’a pas
abordés, comme l'avortement.
Intervieweuse : Alors, toi, le secondaire comme source d'information, c'est assez bas?
Noémie : Ah oui, on n'a rien reçu. Je pensais que les feux sauvages ça s'attrapait en faisant
des fellations parce que c'est ce que j'avais compris de ce qu'il m'avait dit! On s'est vraiment
fait expliquer ça tout croche!
Surtout, elles ne nient pas l’importance du cours, et certaines l’ont même très apprécié :
[Les cours de FPS] étaient vraiment intéressants. [Ils] étaient vraiment informatifs. [Les
enseignants] te montraient une photo de gonorrhée au tableau, vraiment dégueu, mais au
moins tsé, je pense qu'on a eu un cours sur le condom, tsé, il y en a pour tous les gars, il
y en a de telle façon, comment dérouler le condom, on a eu un cours de ça. Tsé, c'est
vraiment intéressant, surtout pour les adolescents, je pense que ça n’existe même plus en
plus, avec la réforme. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, je mettrais vraiment ce cours-là,
à place d'Éthique et culture, je pense qu'ils sont rendus avec ça, [tu apprends à] connaître
toutes les religions du monde, mais tu ne sais pas comment toi, agir en société avec ton
amoureux. Alors ça, je trouverais ça intéressant, ce cours-là […], oui. (Sabrina)
Elles auraient simplement aimé en général qu’il soit plus complet :
84 Amalgame de deux citations de Roxanne, l’une provenant du blogue, l’autre de l’entrevue.
290
Ils ne parlaient étonnamment pas assez de sexualité. […] Il y avait plus de trucs sur... […] le
suicide, la motivation, l'estime de soi… Il n’y avait qu’un seul module sur la sexualité, alors
tu te ramasses garrochée dans un environnement que tu ne connais pas, et là tout le
monde commence à avoir des chums, [à s’embrasser]… Tu fais comme : « C’est quoi
l'étape d'après? » Tu as un peu peur. Ils ne te préparent pas vraiment. Rendue au
secondaire 3 ou 4, ils font comme : « Voici comment on met un condom. » Bravo mon
grand! La moitié de la classe a déjà fait l'amour! (Gabrielle)
Dans certains cas, le cours de FPS, en mettant l’accent sur les maladies et le risque de tomber enceinte, leur
fait même « un peu peur » (Laurie) :
Tsé, je ne connaissais pas vraiment ça, et ça me faisait peur. [Je me disais :] « Ah… il me
semble… je ne peux pas faire l’amour, parce que je ne veux pas attraper ça. » (Laurie)
Dans les cours de FPS, ils parlaient de ça, la puberté, et ils disaient, ils ont commencé à
parler des maladies, et ils décrivaient les maladies et tout, ça m'avait comme fait peur. Je
n'avais pas encore eu de relation, et ça me faisait vraiment peur. Je ne voulais pas pogner
ça, tsé! On dirait que je ne voulais même plus, je ne voulais pas avoir de relation, parce que
ça me faisait peur. (Océanne)
Un dernier « défaut » du cours de FPS qui, comme on l’a vu, ne lui est toutefois pas exclusif:
J’avais [ensuite] été lire là-dessus sur Internet, et j'avais l'impression qu’ils donnaient
quasiment trop d'information, à cause des photos, c’était vraiment pas beau. Ils mettent ça
comme à la dernière phase de la maladie. (Océanne)
Discussion
Bref, comme le montrent les participantes et comme l’indique aussi Russell (2005), il apparaît tout à fait
important que les cours sur la sexualité à l’école ne soient pas qu’axés sur la prévention et les risques de
transmission des infections transmises sexuellement (ITS), mais qu’on y aborde une multitude de thèmes sur
la sexualité qui concernent autant les relations interpersonnelles, les façons d’exprimer son consentement
quand le partenaire est insistant ou manipulateur que les différentes pratiques, les normes relatives à la
sexualité et les façons de comprendre le poids et les implications de ces normes.
Notre étude, en montrant les intérêts réels des 30 jeunes filles par rapport à la sexualité, leurs inquiétudes
véritables et les situations où l’expression de leur agentivité est plus difficile, pourrait permettre de fournir des
pistes d’amélioration de ces programmes. D’autre part, les témoignages des participantes de leurs
expériences des programmes scolaires sur la sexualité montrent que ces cours devraient, d’une part,
291
continuer d’être donnés, et, d’autre part, être dispensés par des intervenants qualifiés qui soient capables
d’aborder toutes les dimensions de la sexualité sans gêne ni tabous.
Ces cours devraient également mettre l’accent, comme on l’a vu dans une section précédente, sur la
déconstruction des messages médiatiques et des normes sociales. Par exemple, Maude dit, au sujet de la
pornographie, que lorsqu’elle était jeune, on lui disait « que ce n’était pas bien d’en regarder », mais qu’on ne
lui a jamais expliqué « le pourquoi de cette interdiction ». On ne semble pas leur dire que pour la pornographie
et pour une très grande variété de pratiques et de normes, le choix est personnel. Surtout, on ne semble pas
leur donner les outils nécessaires pour déconstruire les discours dominants, ce qu’elles cherchent pourtant
à faire. La sexualité leur semble abordée « juste en surface », de façon globale et généralisante, et surtout
restrictive. « Au contraire, estime Maude, « il y a plein d’à-côtés qu’ils oublient ». Des cours sur la sexualité
à l’école devraient pouvoir répondre à ce besoin qu’elles expriment qu’on leur parle de sexualité de façon
ouverte, précise, et en tenant compte des normes sociales dominantes.
Enfin, comme l’indiquent Russell (2005) et les auteurs cités dans le chapitre sur l’agentivité, il semble
important que ces cours adoptent un discours plus positif sur la sexualité, moins normatif et plus enclin à
reconnaître l’agentivité personnelle et sexuelle des filles. Ils devraient surtout tenir un discours qui encourage
l’expression des filles et des garçons et qui évite de restreindre leurs discours aux scripts sexuels traditionnels
et genrés – tout en permettant de reconnaître l’agentivité de ceux et celles qui choisissent l’abstinence ou des
comportements conformes aux scripts de genre. Comme le dit Russell (op. cit.) :
…we must acknowledge that young people are enacting sexuality in their daily lives –
including those actively choosing abstinence, those who practice safer sex behavior, and
those whose sexual behavior places them at risk physically and emotionally. Positive
sexuality development for adolescents will include relation and sexual self-efficacy, skills,
judgement, and behavior. It will also include knowledge about the many layered realities of
contemporary intimacy and sexuality, from the personal to the cultural. (p. 9-10)
S’il faut reconnaître qu’il puisse être utopique de penser que du personnel formé en ce sens soit engagé dans
toutes les écoles secondaires, il ne nous apparaît pas moins important de faire en sorte que le problème soit
reconnu socialement et politiquement; nous pensons que nos résultats peuvent contribuer à cette
reconnaissance. Il est peut-être plus réaliste de souhaiter que des sites Internet proposent des informations et
du matériel adéquats qui puissent combler les lacunes des cours dans les écoles, et que ces sites soient
connus des jeunes. Pour que de tels sites soient appréciés et utilisés, plusieurs de nos participantes ont émis
des recommandations visant à améliorer les sites Web discutant de sexualité. La section qui suit fait le bilan
de leurs recommandations.
292
5.3.5 Vers un « meilleur » Web : suggestions des participantes
Pour améliorer l’éducation sexuelle au secondaire ou même améliorer la qualité ou l’accessibilité de
l’information sexuelle sur Internet, les participantes ont fourni plusieurs suggestions ou recommandations. La
plus populaire concerne un site Web spécialement aménagé pour les jeunes en fonction de leur âge,
vulgarisé, qui amalgame plusieurs autres ressources et même fournit une aide professionnelle (infirmiers,
médecins) directe en conversation chat :
J'aurais bien aimé, lorsque j'étais jeune, avoir accès à un site Internet style forum où des
gens de mon âge auraient pu discuter de sexualité entre eux et même avec un spécialiste
concernant toutes les petites questions qui nous trottaient dans la tête. Parler avec
quelqu'un de virtuel est toujours plus simple qu'en vrai. Je ne sais pas si ce site Web idéal
existe à ce jour, mais dans un futur simple je suis sûre que bien des jeunes filles iraient le
consulter! […] Un site Internet spécialement destiné aux jeunes adolescentes utilisant un
langage approprié pour ce groupe d'âge, ainsi qu’une multitude de références pour elles
(autres sites Internet, numéros de téléphone, groupes de discussion, etc.). (Maude)
Le site devrait répondre à d’autres questions que seules la protection contre les ITSS et la contraception, et
éviter de tenir un discours « normatif » :
Florence : Il faudrait que sur Internet, tu poses la question et qu'il y ait quelqu’un qui
réponde.
Intervieweuse : Comme un genre de chat?
Florence : Oui. Que ça dise plus d'expériences aussi.
Intervieweuse : Comme une infirmière, par exemple?
Florence : Ben une infirmière va dire ce qui est bon pour la santé, tandis que quelqu’un qui
est vraiment... qui a vécu et qui vit dans la réalité et qui ne pense pas juste à « protège-toi
et fais attention ». Quelqu’un qui va [dire] : [ton partenaire] aimerait ça, etc.
Car avec un discours normatif, les adolescentes ont tôt fait de décrocher :
Les sites gouvernementaux, je trouve ça super plate. […] Tsé, à un moment donné, j'étais
tombée sur un truc, c'était ça que j'utilisais, c’était : tu posais ta question, et il y avait comme
un docteur, une personne, un adulte, qui répondait à ta question, mais je ne sais pas, je
n'avais pas l'impression que c'était... [neutre]. Tsé, on dirait qu'ils prônaient l'abstinence en
même temps. (Annabelle)
293
Bien que de tels sites Web existent aux États-Unis et dans le monde anglophone, les versions francophones
sont rares ou très peu connues. Il pourrait donc être utile que les sites Web québécois qui offrent ce genre de
service soient mieux connus. Ils pourraient, par exemple, être présentés dans les écoles.
Enfin, même si les participantes sont conscientes du fait que ce souhait pourrait bien n’être qu’utopique, elles
modifieraient ultimement le Web de façon à ce qu’il limite l’accès à la pornographie infantile ou illégale, comme
l’exprime ici Maëlie :
Je modifierais le Web concernant la sexualité pour que ce soit plus facile de faire des
recherches ou qu'il soit plus accessible pour les jeunes. Par contre, ce serait uniquement
éducatif, des sites qui répondent aux questions sérieusement. […] J'enlèverais toute
possibilité à la pornographie infantile, c'est DÉGEULASSE! Je ne sais pas comment... mais
rien de ça! Finalement, le Web serait le meilleur endroit pour en connaître davantage sur la
sexualité. (Maëlie)
Un constat qu’avaient également exprimé les participantes de Plante (2004, p. 122).
Discussion
Bref, les participantes cherchent un discours non normatif sur la sexualité (en ce sens qu’il ne leur impose pas
l’abstinence, notamment), mais jusqu’à un certain point : Florence cherche, par exemple, quelqu’un qui va lui
dire « ton partenaire aimerait ça » (comme si tous les hommes aimaient les mêmes choses) et on a vu à la
section sur les thèmes relatifs à la norme (chapitre 6.1.3) que Maude, Juliette, Florence et Maëlie ont cherché
directement des informations « concrètes » sur les normes dans le but de se situer par rapport aux autres.
Des cours sur la sexualité et les médias leur permettraient peut-être d’adresser ce besoin tout en leur
permettant de déconstruire cette pression sociale ou le manque de confiance en elles-mêmes qui les poussent
à se comparer aux normes.
6 Évaluation de la méthode et limites de l’étude
Malgré les nombreux avantages que procure la méthode du blogue privé, celle-ci, comme toute autre
méthode, n’est pas parfaite. Nous avons pu observer, en testant cette méthode et en recueillant les
commentaires des participantes lors des entrevues, trois principaux défis reliés à l’utilisation du blogue privé :
maintenir l’intérêt des participantes pour l’écriture, recruter celles-ci en nombre suffisant et maximiser
l’interactivité du site tout en préservant leur anonymat. Toutefois, malgré ces trois difficultés, la méthode s’est
avérée très efficace pour obtenir des données précises, nuancées et contextualisées des expériences des
participantes en lien avec les usages d’Internet pour obtenir des informations sur la sexualité et sur la
manifestation de leur agentivité sexuelle.
Maintenir l’intérêt
Comme nous l’avons déjà souligné, l’interactivité du blogue permet d’augmenter la réflexivité et
l’apprentissage chez les participantes. L’interactivité fournit également l’occasion de s’assurer que les
participantes écrivent sur une base régulière. Or, comme il s’agissait de notre première expérience avec le
blogue et que nous étions préoccupée par la limitation des biais que nous pouvions inférer par notre
participation, nous avons limité nos interventions à un minimum, n’envoyant des courriels aux participantes
qu’à l’occasion et nous abstenant de fournir toute information aux participantes qui avaient des
questionnements sur la sexualité. Toutefois, plusieurs participantes nous ont indiqué qu’elles auraient aimé
une plus grande intervention de notre part, c’est-à-dire un peu plus de feedback et de réactions, notamment
par courriel. Cela les aurait encouragées à écrire et les aurait rassurées sur le fait que ce qu’elles écrivaient
était pertinent et correspondait aux buts de l’exercice. Nous aurions pu leur répondre davantage sur la
pertinence de leurs écrits sans intervenir dans les contenus, mais la distinction apparaissait difficile à maintenir
dans certains cas.
Lors de l’entrevue, nous avons demandé aux participantes si le fait de remplir un blogue avait constitué pour
elles un « devoir », c’est-à-dire si elles se sentaient « obligées » de le remplir ou si elles s’y sentaient
contraintes d’une quelconque manière. De façon générale, elles ont répondu qu’il ne s’agissait pas pour elle
d’un devoir. Si le fait de tenir le blogue s’apparentait quelques fois à une obligation, c’est qu’elles étaient
intéressées à la recherche elle-même et avaient à cœur son succès :
Ben c'était un devoir d'une certaine façon, dans le sens que je me disais qu'il fallait que je le
fasse, tsé, je n'aurais pas laissé ça tomber. Il fallait que ce soit un devoir d'une certaine
façon, sinon je n'aurais pas assez pris ça au sérieux et je n'aurais même pas été écrire
dessus. Tsé, je n'aurais pas fait ça naturellement, alors d'une certaine façon c'était un
devoir, mais en même temps je le faisais par intérêt quand même, ce n'était pas comme
une obligation. C'était un devoir fait par intérêt. (Amélie)
296
C’est aussi le cas de Gabrielle et de Laurie :
Intervieweuse : Est-ce que c'était comme un devoir?
Gabrielle : Ben mettons un peu, parce que je me disais qu'il fallait que j'en fasse deux par
semaine, c'était l'objectif que je m'étais donné. Alors là je me disais, merde, cette semaine,
mettons, je n'ai pas eu le temps d'en faire un, alors je me sentais un peu obligée d'en faire
un, mais pas parce que ça ne me tentait pas, mais juste parce que je me disais, merde, il
faut que j'en fasse un. Mais tsé quand je me mettais à l'écrire, je ne voulais plus faire autre
chose, je voulais juste faire ça.
-
C'est sûr que des fois, quand je travaillais et que j’avais beaucoup d’étude, je n’avais pas
beaucoup de temps, alors c’est pour ça que je n’ai pas écrit beaucoup. […] Mais dès que
j'avais [une idée], je lisais, j'étais dedans, et j'aimais ça. Je pouvais en écrire trois de suite.
Tsé, il fallait [simplement que je prenne le temps de le faire]. (Laurie)
Recruter des participantes
Comme l’exercice du blogue demandait aux participantes un plus grand investissement en termes de temps et
de travail qu’une simple entrevue d’une heure, nous avons dû recruter un grand nombre de participantes afin
de nous assurer qu’une bonne proportion d’entre elles soient effectivement actives sur le blogue. Pour une
trentaine de participantes qui ont effectivement tenu un blogue (une entrée de blogue et plus), nous avons dû
obtenir l’accord de plus d’une cinquantaine de jeunes femmes. Il a été plus facile de recruter des participantes
dans des classes de communication ou de français (là où se trouvent naturellement des participantes
potentielles aimant l’écriture ou s’intéressant déjà au carnetage) et dans des classes de niveau universitaire
où les participantes étaient plus âgées (des classes de 19 à 21 ans plutôt que des classes de 17 à 18 ans).
Les jeunes universitaires avaient en effet une plus grande compréhension du processus de recherche et
semblaient plus intéressées à participer. Le processus de recrutement dans les classes s’est révélé plus
efficace que le recrutement par la méthode « boule de neige » dans notre propre communauté, les
participantes potentielles qui nous étaient connues ayant eu tendance à accepter de participer à la recherche
sans vraiment toutefois remplir le blogue.
Maximiser l’interactivité tout en assurant l’anonymat
Enfin, il a été difficile de choisir entre deux degrés d’interactivité dans le blogue. Nous avions en effet l’option
de choisir entre le blogue privé et un blogue anonyme, mais plus « ouvert ». Cette dernière possibilité aurait
constitué en un blogue fermé à la communauté Web en général, mais ouvert aux participantes, qui auraient
297
alors pu voir ce que les autres participantes écrivaient, et même ajouter des commentaires sur les posts, un
peu à la manière du site de réseautage Facebook. L’anonymat aurait alors été assuré grâce à un
pseudonyme85.
Interrogées sur la méthode qu’elles auraient préférée si elles en avaient eu le choix, les participantes étaient
partagées. Certaines préféraient le blogue privé, citant ses maints avantages. D’autres ont indiqué qu’elles
auraient apprécié la forme plus ouverte du blogue :
Amélie : Pourvu que ce soit anonyme, j'irais lire ce que les autres ont dit, ce serait
intéressant.
Intervieweuse : Si tu avais à choisir entre les deux : blogue privé ou semi-ouvert, lequel
aurais-tu choisi?
Amélie : J'aurais choisi semi-ouvert, pourvu que ce soit sûr que c'est anonyme.
Elles auraient apprécié pouvoir connaître le genre de préoccupations des autres participantes et répondre
à leurs questionnements si elles le pouvaient; elles auraient peut-être pu ainsi se sentir moins « seules » dans
leur propre situation.
De plus, un blogue plus ouvert leur aurait permis de trouver des idées pour écrire et même anticiper certaines
situations, pour celles qui auraient moins d’expérience :
[Le fait de pouvoir] parler aux autres participantes [m’aurait aidée], parce que moi, je ne suis
pas rendue loin là-dedans [la sexualité], mais il y en a d'autres qui sont rendues plus loin,
alors elles ont déjà passé par là, alors ça m'aurait encore plus rassurée. Et elles ont quand
même le même âge que moi. Pas mal équivalent. J'aurais aimé ça parler aux autres
participantes sans savoir c'est qui, juste...
Intervieweuse : Alors si tu avais eu à choisir entre les deux, tu aurais pris celui ouvert?
Sarah : Oui.
Cette idée d’un blogue plus « ouvert » a même quelques fois été proposée d’emblée :
85 L’anonymat était dans notre cas déjà assuré par un pseudonyme, mais plusieurs participantes ont tout simplement
choisi leur prénom comme pseudonyme, ce qui n’était pas grave puisque nous seule (et notre informaticien) avions accès
aux blogues. Tous les prénoms ont d’ailleurs été changés par un nom fictif dans la thèse.
298
Maude : J'ai juste quelque chose à dire à propos de ton blogue. Moi, j'aurais aimé ça voir
les blogues des autres. Mais de façon anonyme, sans qu'on dise notre nom, j'aurais aimé
ça voir ce qu’écrivent les filles. Ça, j'aurais vraiment aimé ça.
Le danger de la censure aurait toutefois été plus grand, de l’aveu même des participantes. Lorsque nous leur
avons demandé si elles se seraient censurées dans leurs propres posts si le blogue avait été ouvert, une
bonne partie a répondu « oui » ou « peut-être » :
Intervieweuse : Te serais-tu censurée?
Sarah : Je ne sais pas. Probablement qu'il y aurait des choses que je n’aurais pas dites
parce que j'aurais eu peur de ce que les autres auraient pu dire, mais après un bout,
comme c'est toutes des filles sérieuses qui se sont embarquées là-dedans, elles n'ont pas
juste embarqué là-dedans de même, alors après un bout, [je me serais probablement dit :]
« Regarde, c'est du monde qui fait ça parce qu'elles sont sérieuses dans leurs affaires. »
Alors j'aurais été dégênée dans tout ça et [j’aurais] écri[t] des affaires que... [je n’aurais
peut-être pas écrit au départ]. J'aurais pu aussi poser des questions si [j’en avais eues], et
ça m'aurait comme... [rassurée]. […] Parce qu'il y a des questions que tu poses sur Internet,
tu ne sais pas vraiment qui répond, ça peut être un homme qui répond, tandis que là, ça
aurait été des participantes, et j'aurais su qu’elles savaient de quoi elles parlaient et j'aurais
vraiment aimé ça.
Intervieweuse : Ça aurait été comme un forum, mais juste nous autres?
Sarah : Oui.
Pour certaines, le blogue ouvert aurait limité leurs idées et les aurait peut-être gênées dans leur élan :
Je ne pense pas que je me serais censurée parce que je n'aurais pas pu être identifiée,
sauf que j'aurais peut-être été un peu plus gênée, des fois de parler de certaines affaires.
Juste mettons le fait de pouvoir aller lire les blogues des autres, on dirait que j'aurais
comme oublié mes idées à moi et que j'aurais lu les leurs, et que j'aurais fait : « Ah, je ne
sais plus quoi écrire. » Parce qu'elles l'auraient déjà dit, ça m'aurait un peu démotivée. […]
De pouvoir aller lire ce que les autres disaient, on aurait dit que ça aurait pu créer de
l'interférence avec la bonne qualité de mon travail. (Gabrielle)
D’autres estiment qu’au contraire, le blogue plus ouvert les aurait encouragées à se confier et à aller « plus
loin » dans les sujets :
Maude : Au contraire, [ça aurait été] le fun, parce que des fois, en lisant, je serais allée lire
les trucs des autres, tu vois quelque chose, et tu te dis : « Ben oui, cibole, il m'est arrivé la
299
même affaire », alors tu peux commenter [et la personne peut se dire :] « Ah bien, je ne suis
pas la seule... » Juste pour vérifier, pas si t'es dans la norme, mais tsé, c'est le fun à savoir
qu’il y a d'autres personnes qui ont vécu des expériences semblables à la tienne et que tu
n'es pas toute seule à vivre ça. C'est le fun.
Intervieweuse : Aurais-tu aimé pouvoir mettre des commentaires?
Maude : Oui, j'aurais aimé ça.
Intervieweuse : Même si tu aurais pu recevoir des commentaires sur tes posts à toi?
Maude : Oui. […] Tsé, en plus, il n’y a pas de gêne, tu ne sais pas à qui tu parles. Et vice-
versa. Je pense que c'est là que tu peux y aller librement.
C’est que la partie « commentaires » permet en quelque sorte de répondre de façon encore plus ciblée aux
besoins d’information, de réassurance et de conformité auxquels leur sert Internet :
Intervieweuse : Si jamais je devais recommencer, que devrais-je changer du
fonctionnement, à part les commentaires?
Maude : Non, juste rajouter des commentaires, et si on pouvait justement interagir, ce serait
vraiment le fun.
Intervieweuse : Parce que dans le fond, si tu peux lire ce que les autres écrivent, ça répond
un peu plus à la raison pour laquelle tu vas sur Internet, je pense?
Maude : Exactement.
Toutes n’ont pas exprimé l’enthousiasme de Maude pour les commentaires, cependant. Noémie, par exemple,
estime qu’il faudrait spécifier que les commentaires doivent être « constructifs » pour ne pas que ceux-ci
soient blessants ou émettent des jugements, ce que la méthode « privée », en quelque sorte, prévient.
Pour concilier les bons côtés des deux méthodes, une participante a même proposé que le site permette un
choix à chaque post : que celui-ci soit public (et donc commenté par les autres participantes), ou encore privé
(lu seulement par la chercheuse). Si cette méthode est plus complexe à réaliser, elle s’avérerait peut-être la
plus efficace des trois.
300
Cependant, comme la censure était notre principale préoccupation, nous considérons que le blogue privé
constituait dans notre cas un excellent choix. Par contre, dans une recherche éventuelle portant sur un sujet
moins délicat ou personnel, le blogue « semi-ouvert » pourrait s’avérer être le choix idéal86.
Des avantages certains
Malgré ces quelques difficultés, la méthode du blogue privé présente, comme nous l’avons vu au chapitre 5,
un lot d’avantages considérables : elle permet d’obtenir des données riches, pointues et pertinentes. Les
participantes de notre étude ont contribué à leur blogue de façon franche et enthousiaste, et ont fourni des
données qui, en raison de la nature privée et volontaire de la méthode, étaient plus près de la confidence que
du résultat d’une observation directe et invasive, ce qui constitue un gage de fiabilité.
De façon très marquée, les participantes ont exprimé avoir éprouvé du plaisir à remplir le blogue, et ce parfois
même d’emblée :
Moi, j'ai aimé ça, parce que je suis une fille qui aime vraiment écrire. Quand j'écris, je suis
dans mon élément. J'ai vraiment aimé ça. Tsé, ça a répondu à mes questions, j'ai fait des
recherches. J'ai vraiment trouvé ça le fun. (Sarah)
Cet intérêt pour le blogue en raison de l’écriture est présent chez plusieurs participantes, notamment chez
Maude, pour qui l’écriture est un moyen « d’évacuer » le stress et les angoisses. Le fait d’écrire un blogue lui
permet, en plus, de se confier :
Je trouve que c'est tellement privé, la sexualité. C'est le fun en parler avec ton copain, mais
même encore avec les amis, c'est un peu tabou. Je trouve que c'est quelque chose de
personnel, et justement en créant un blogue, tu peux t'ouvrir, et en même temps, tu parles
à la personne, tu ne la connais pas trop, mais tu sais qu'elle ne te jugera pas. Je pense que
c'est ça qui est le fun. (Maude)
Surtout, le blogue leur offre une occasion d’être réflexives quant à leur vie sexuelle et de faire le bilan de leurs
apprentissages (ce qui correspond d’ailleurs au point 3 des avantages du blogue privé que nous avons
soulevés à la section 4.1 [p. 97]) :
J'ai vraiment aimé ça. J'avais hâte quasiment à la prochaine fois que j'allais écrire ou que
j'allais trouver des idées. […] Avec l'école, le travail, on n'a tellement pas le temps de se
poser des questions sur soi-même et par rapport à sa sexualité. Ça a fait en sorte, ça m'a
86Il est cependant nécessaire de souligner qu’un blogue semi-ouvert nécessiterait un plus grand budget de recherche en
raison d’une plus grande complexité de la structure informatique qu’il exigerait.
301
fait réaliser que j'avais beaucoup de questions, et même encore aujourd'hui j'en ai encore et
je consulte encore Internet, et dans un futur proche, je vais encore le consulter. Ça m'a fait
réaliser bien des choses et je pense que ça a été vraiment dans le positif pour [moi
concernant] le blogue. (Maude)
Même chose pour Camille, Sabrina et Laurence :
Des fois, ça m'amenait à réfléchir à certaines affaires, et des fois je trouvais ça drôle! Tsé, il
y quand même de la retenue, parce que je sais qu'il y a quelqu’un qui le lit, mais en même
temps, il n'y a pas de... il n'y a personne, il n'y a pas de lecteur assidu qui va voir le blogue!
Non, j'ai trouvé ça le fun. (Camille)
Ça ne m'a pas dérangée d'aller écrire sur ton blogue. Je trouvais ça le fun justement, de
voir combien d'informations je suis allée voir sur Internet, et ça me rappelait des affaires :
« Ah, mon premier chum… » et « Oui, c’est vrai, on faisait ça, mon Dieu! » Des fois, tu te
dis : « Mon Dieu, j'étais nounoune! », mais finalement non, toutes les jeunes filles se posent
le même genre de questions. (Sabrina)
Je trouve que j'ai évolué. Ben, c'est normal, aussi, là, mais... Je trouve ça drôle de voir
MON évolution comme ça, et de regarder ça avec du recul. […] Ça m’a permis de mettre en
mots des choses que j’avais vécues et [sur lesquelles je n’avais] pas forcément... [réfléchi].
Tsé, je ne pense pas à ça tous les soirs. Alors j'ai fait : « Hey, c'est comme ça que je l'ai
vécu, et c'est ce que je pensais à ce moment-là. » (Laurence)
En plus de pouvoir lui offrir une rétrospective de son expérience, Roxanne estime que le blogue et
l’expérience de participation à la recherche en général lui ont permis de découvrir quelques pistes de réflexion
qui lui permettront d’être mieux outillée lorsque viendra le temps d’éduquer ses propres enfants :
Et en même temps, je pense que... ben, c’est peut-être cliché de dire ça, mais si j'ai des
enfants, aussi, peut-être que ça me donnerait des idées de comment aborder ça [avec eux].
Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça donne des idées, aussi, comme pour ma sœur qui
est plus jeune, pour pouvoir la guider plus. (Roxanne)
Quant à Maude, le blogue lui a permis d’être plus réflexive quant à ses usages d’Internet et à l’importance que
cet outil a pu avoir dans son apprentissage et son développement :
[Le blogue] m'a fait réaliser qu'Internet a quand même de bons et de mauvais côtés, que ça
m'a quand même permis de répondre vraiment à mes questions, que sinon j'aurais gardées
secrètes, et qui m'auraient tracassée pour un bon bout de temps. Internet m'a vraiment
aidée avec beaucoup de questions que même, pour parler à médecin, ça prend quoi, un an
et demi, deux ans avoir un rendez-vous avec un médecin de famille. Ça m'a fait réaliser que
302
la sexualité au sens large, c'est large et complexe. Quand on a des cours à l'école, ils ne
misent pas assez sur certains points, que ça nous reste toujours avec des interrogations, ils
tournent autour du pot au niveau de certaines questions, et je suis sûre que je ne suis pas
la seule que ça doit interroger, et t'as peur de poser des questions à des adultes qui doivent
avoir aussi comme des préjugés envers toi. (Maude)
Bref, de façon générale, les participantes ont exprimé avoir apprécié le processus. Camille, par exemple,
a réellement apprécié l’entrevue, qui lui a semblé bénéfique. Après qu’on lui ait posé une question quant au
rapport de pouvoir entre elle et son copain, elle s’est exclamée :
Camille : C'est drôle, c'est vraiment une bonne question. C'est comme une petite thérapie!
Intervieweuse : Gratuite!
Camille : Et payée!87 [rires]
Lors d’une autre question plus difficile ou plus personnelle, elle s’est une autre fois exclamée :
T'es pas gênante, alors c'est correct! (Camille)
De telles exclamations démontrent une aisance avec l’intervieweuse qui nous semble gage, d’une part, de la
sincérité des informations recueillies par entrevue, et, d’autre part, du succès des deux méthodes combinées
pour obtenir ces informations. D’ailleurs, dans le cas de Camille, l’interview a permis de parler d’une réalité
qu’elle n’avait pas révélée dans le blogue : son « vaginisme ».
Intervieweuse : Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne voulais pas aborder [dans le
blogue]?
Camille : [rires] Ma première fois, je n'en avais pas parlé. Parce que ça me gêne. Je ne
savais pas... [si je devais en parler]. Là, ça va, face à face.
On remarque ici la démonstration d’agentivité personnelle de Camille de décider en temps et lieu de divulguer
certaines informations personnelles, mais aussi le fait que l’entrevue a réellement permis dans son cas d’aller
chercher des informations supplémentaires (pourtant importantes) sur l’expression de son agentivité sexuelle
au quotidien.
87 Nous avons offert 30 dollars en argent comptant ou en certificat-cadeau La Senza aux participantes qui ont accepté de
se rendre jusqu’à l’étape de l’entrevue.
303
Ce « rattrapage » d’éléments importants par l’entrevue est également survenu avec Alison, qui n’avait pas
révélé son orientation sexuelle (et donc ses recherches sur le sujet) et avec Mia, qui ne nous a dévoilé avoir
déjà essayé de l’ecstasy pour faire l’amour (décision prise de son propre chef) qu’à la toute fin de l’entrevue,
quand nous lui avons demandé si elle croyait que l’on avait couvert tous les sujets d’intérêt. Ainsi, l’entrevue
permet de pallier réellement les limites que pourrait avoir la méthode du blogue pour obtenir des informations
particulièrement gênantes, comme nous l’avons anticipé lors de l’élaboration de la méthode (point 7 de la
section « Le blogue "privé" et ses avantages »).
D’autres avantages que nous avons soulevés à cette section se sont avérés, et nous avons pu l’observer
directement. Par exemple, le blogue a fait réaliser à quelques participantes qu’elles pourraient et même
qu’elles voudraient devenir blogueuses, ce qui correspond au point 4 de la section « Avantages » :
Intervieweuse : Est-ce que c’est quelque chose que tu referais?
Laurie : Oui.
Intervieweuse : Étais-tu blogueuse avant?
Laurie : Non, je n'ai jamais fait ça.
Intervieweuse : Et maintenant, est-ce que ça te tenterait de faire ton propre blogue?
Laurie : Ben peut-être. Peut-être pas à 100 % encore, mais peut-être que si j’avais le temps,
j'aimerais ça.
Intervieweuse : Et avant de faire ça, te serais-tu dit la même chose?
Laurie : Non, je ne pense pas.
-
Intervieweuse : Est-ce que tu blogues?
Roxanne : Non, mais ça m'a donné le goût d'en faire un, sauf que je n’avais pas d'idée de
ce sur quoi écrire. J'ai des amis qui tiennent des blogues, et je trouvais ça intéressant. Je
trouve ça le fun d'écrire comme ça.
Le fait que le blogue laisse place à l’expression de l’agentivité personnelle des participantes transparaît dans
l’écriture des participantes (ce qui confirme le point 1 des « Avantages ») :
304
Le Web en rapport avec cet article [sur la sexualité à la télévision] n’avait pas tant rapport,
mais je me suis permis d'élargir le cercle de l'information pour mieux comprendre ce qui se
passe sur Internet, parce que bien des choses partent de la télévision. (Camille)
La facilité de la méthode, d’autre part, a été appréciée :
Intervieweuse : Est-ce que c’est quelque chose que tu referais?
Sabrina : Certainement. […] Tu es chez vous, tu es toute seule, tu en en train de faire un
devoir… Ah, plus d'inspiration… « Bon, qu'est-ce que je fais? » […] Tu vas écrire sur le
blogue, ça te change les idées, après ça tu continues ton devoir, alors tsé c’est vraiment
quand tu veux, où tu veux, tu n’as pas besoin de te déplacer, c’est facile. Je trouve que
c’est vraiment une bonne façon.
Ce qui leur apparaissait le plus difficile était, en certains cas, de trouver des idées de sujets. À ce propos,
l’onglet « Idées de sujets » que nous avons intégré au site Web (voir Annexe 2) a aussi été fortement
apprécié :
Ce que j'ai aimé aussi, c’est la feuille [des idées]. Ça me faisait penser à des sujets. S’il n’y
avait pas eu ça, [il y aurait des choses que j’aurais oubliées]. (Roxanne)
Bref, la méthode que nous avons testée a très bien fonctionné. Parmi les trente jeunes femmes qui ont
accepté de participer à la recherche et qui ont tenu leur blogue, presque toutes y ont abordé, et avec candeur,
des sujets délicats qui, il nous semble, auraient pu ne pas être développés aussi rapidement dans une
rencontre en personne, compte tenu du niveau de gêne qu’ils peuvent provoquer. Relations sexuelles
douloureuses, fellation, masturbation, homosexualité, sécrétions vaginales, avortement, pornographie,
virginité, point G, craintes d’avoir développé une ITSS et même interrogations au sujet des « avantages » liés
au fait d’avoir des relations sexuelles sous l’influence de l’ecstasy : tous ces sujets ont été abordés sur le
blogue dès les premières semaines. Même les sujets qui leur paraissaient de leur propre aveu très gênants
(point 2 de la section des « Avantages ») :
Ma quête d'information a duré près de cinq jours pour rassembler le plus d'informations
possible connexes et ressemblantes au cas que je vivais. Trauma total, à 18 ans, quand on
lit qu'on ne se débarrasse jamais de cette ITS. Je voulais, absolument, qu'aucune personne
ne soit au courant de ce que je cherchais. Ce sujet est tabou dans notre société, mais aussi
dans mon entourage immédiat. Ces infos, pour l'apparence, sont assez gênantes merci.
(Gabrielle)
305
Plusieurs passages de blogues démontrent, pour leur part, que la méthode comporte pour elles un aspect
ludique. En effet, plusieurs posts décrivant des anecdotes drôles sont agrémentés de « haha » et de clins
d’œil loufoques empruntés à la pratique du chat, aux réseaux sociaux et à l’écriture Web plus « personnelle »
(ce qui correspond aussi au point 2 de la section des « Avantages ») :
« Vous pouvez imaginer ma gêne à l’époque lorsque j’ai compris de quoi il s’agissait! Haha.
;o) » (Roxanne)
« Je me disais que j’avais hâte d’essayer pour voir si moi aussi je pouvais "être" une femme
fontaine… hahaha. Voilà mon anecdote! » (Roxanne)
Leurs textes ont le plus souvent été construits impeccablement, et plusieurs ont été accompagnés de photos
et d’illustrations humoristiques pigées sur le Web dont la présentation était très soignée (la photo
a préalablement été rognée, par exemple). Enfin, certaines tournures de phrases indiquent que les
participantes ont pris plaisir à écrire sur le blogue. Par exemple, plusieurs participantes débutent leurs posts
avec une adresse joyeuse et enjouée :
« Bon après-midi chers curieux! » (Gabrielle)
« Bonjour et bienvenue dans mon petit monde! » (Roxanne)
…et le terminent avec une conclusion tout autant joviale :
« Longue et heureuse vie à vous, mes fidèles lectrices! :) » (Gabrielle)
« Alors voilà une autre péripétie de racontée ! @+ » (Sabrina)
Bref, les participantes semblent avoir eu une véritable occasion, lors du blogue, de réfléchir sur la place de la
sexualité dans leur vie, et, au moment des entretiens, ils ont pu poursuivre leur réflexion sur d’autres
éléments, comme la distribution du pouvoir dans leur vie de couple et leur niveau d’agentivité sexuelle. Il s’agit
pour nous d’un résultat qui va au-delà de nos espérances et que nous pouvons attribuer à divers éléments :
d’abord, comme on l’a indiqué précédemment, le blogue permet de briser la glace. Les participantes
connaissaient déjà le sujet qui allait être abordé en entrevue et avaient déjà, par le moyen du blogue, raconté
leurs « situations gênantes ». Ensuite, compte tenu de notre âge (nous n’avions qu’environ 5 à 9 ans de plus
que les participantes), celles-ci ont dû se sentir moins gênées de discuter de sexualité avec nous. D’ailleurs,
suivant les recommandations de Patton (1990), nous avons toujours tenté d’établir un rapport de confiance
avec les participantes, en riant avec elles de leurs situations cocasses et en adoptant une attitude ouverte et
306
compréhensive. Enfin, à l’instar de Gilmartin (2006), nous avons parfois raconté une anecdote personnelle afin
de rassurer les participantes sur le fait qu’elles pouvaient partager des histoires de façon honnête et que leurs
confidences seraient respectées.
Cette attitude s’est révélée efficace : une participante s’est exclamée « Moi aussi ! » au terme de notre
anecdote et a alors raconté une anecdote semblable qu’elle s’était retenue d’aborder sur le blogue, par gêne
ou par honte. L’entrevue qui suit la période de carnetage permet donc de pallier les limites que la méthode du
blogue, utilisée seule, pourrait avoir, même si le blogue lui-même s’est révélé déjà très efficace.
Surtout, la méthode propose une façon simple et efficace de pallier les diverses lacunes des études
précédentes sur la recherche d’informations sexuelles sur Internet par des jeunes. D’ailleurs, comme l’exprime
Hookway (2008) :
[B]logs offer a low-cost, global and instantaneous tool of data collection. They also provide
a very useful technique for investigating the dynamics of everyday life from an unadulterated
first-person perspective and offer a research window into understanding the contemporary
negotiation of the "project of the self" in late/post-modern times. With adequate research
parameters in place, blogs can have an important and valuable place in the qualitative
researcher’s toolkit. (p. 107)
Pour ces raisons et pour celles que nous avons élaborées tout au long de la thèse, la méthode du blogue privé
gagnerait à être mieux connue des chercheurs en sciences humaines et sociales, qui pourraient l’appliquer
à d’autres contextes de recherche, notamment ceux dont le thème est délicat et nécessite un haut degré de
confidentialité.
Limites
Notre étude présente certaines limites, qui sont pour la plupart communes aux autres études où il est question
de sexualité. D’abord, comme les participantes ont participé à notre étude sur une base volontaire, il est
possible que celles qui se savaient mal à l’aise avec la sexualité ne se soient pas proposées pour y participer,
ce qui pourrait constituer un biais considérable lié au recrutement. Cependant, tout comme ce fut le cas pour
Albanesi (2010, p. 151), ayant effectué nous-même nos entrevues, nous avons été en mesure de constater
que certaines participantes étaient, en fait, relativement gênées de discuter de sexualité; le profil des
participantes était donc relativement varié sur ce point, ce qui limite la portée que pourrait inférer ce biais.
De plus, une bonne partie de nos participantes ont été recrutées dans des cours de communication, ce qui fait
qu’elles sont probablement plus à l’aise d’écrire des blogues que la majorité des gens. Cependant, bien que
307
ce détail contribue à l’efficacité de notre méthode, il ne diminue ni la qualité ni la diversité de nos résultats, le
fait de s’intéresser à la communication n’étant pas un indicateur logique du comportement sexuel.
Cependant, il est important de tenir compte du fait que les participantes sont à peu près toutes issues de la
classe moyenne, sont presque toutes d’origine caucasienne, et sont presque toutes hétérosexuelles. Nous
n’avons donc pas la prétention d’offrir une perspective qui tienne parfaitement compte des différences de
classe, de religion, d’origine ethnique ou même d’identité sexuelle, ou encore qui puisse être généralisée
à toutes les populations, même canadiennes.
Enfin, d’autres biais ont pu affecter les résultats de notre analyse et il nous semble important de le reconnaître.
Comme toute étude qualitative se basant sur des entretiens, la qualité de nos données dépend de la fiabilité
des souvenirs des participantes, de leur précision, et de leur volonté à en discuter en détail avec une tierce
personne. Toutefois, nous estimons que la méthode du blogue combinée à des entretiens privés assure une
très grande qualité des données recueillies pour les raisons que nous avons déjà énumérées. Nous sommes
d’autant plus convaincue de la grande qualité de ces données en raison de la candeur avec laquelle les
participantes se sont exprimées et ont accepté de révéler une grande quantité de détails sur leur vie privée,
puisque les carnets comme les verbatim des entrevues révèlent une très grande générosité et une sincère
volonté de participer pleinement à notre étude.
D’ailleurs, comme nous venons de le voir, plusieurs participantes ont exprimé d’emblée avoir aimé participer
à l’étude et avoir apprécié la structure de celle-ci. Lorsque nous avons demandé de façon systématique aux
participantes si le fait d’avoir écrit un blogue sur le sujet et ainsi avoir dû réfléchir sur leur vie sexuelle leur
avait été bénéfique, plusieurs ont affirmé que oui. Par exemple, le fait d’avoir participé au blogue a fourni
à Amélie l’encouragement nécessaire pour continuer ses recherches concernant certaines questions qui la
tracassaient. Elle s’est aussi sentie moins honteuse d’avoir certains questionnements :
Ça m'a aidée dans le sens que des fois, une fois en particulier je me rappelle, je me suis
forcée à avoir des questions, je voulais écrire quelque chose sur le blogue et mettre plus
d'informations et trouver plus d'autres réponses... Souvent, j'avais des questions, mais je n'y
allais pas, tandis que là, vu que je savais que j'avais un blogue à faire, ça me faisait encore
plus aller m'informer pour pouvoir te donner plus d'informations, et je me rappelle que c'est
là que j'ai pu trouver de l'information comme de quoi qu'il y en a plein qui avaient mal et il y
en avait qui disaient que ça s'était réglé. Ça m'a aidée à avoir plus de connaissances et
à moins me sentir honteuse de mon problème et de voir que d'autres gens l'ont. Ça m'a fait
faire plus de recherches de ce que j’aurais fait habituellement, le fait d'avoir à faire ce
projet-là. (Amélie)
308
Le fait qu’Amélie ait cherché plus qu’à son habitude en raison du blogue pourrait constituer une des limites de
la méthode, puisque son comportement naturel, que l’on a tenté d’observer, est ainsi amplifié. Toutefois, ses
questions restent les mêmes, et le comportement de recherche, même s’il est augmenté, n’est pas altéré dans
son fonctionnement ni dans l’expression du questionnement à sa source. Bien que cette « amplification » soit
rare, Sarah a exprimé avoir eu le même réflexe :
Sarah : C'est sûr que ça m'a amenée à chercher « vierge à 18 ans », je n'avais jamais
cherché, j'étais comme : « Non, je ne chercherai pas ça. » Vu que je faisais [le blogue], je
me suis dit que j'allais me renseigner. Ça m'a rassurée, et j'ai trouvé d'autres choses aussi
dans Internet. Ça m'a rassurée sur la façon dont va se passer la première fois, surtout.
Intervieweuse : Si le blogue n'avait pas été là, tu n'aurais pas cherché « vierge à 18 ans »?
Sarah : Probablement que je ne me serais pas forcée à le chercher, [mais] parce que là il
fallait que je le fasse, c'était comme un devoir pour moi, il fallait que je trouve des affaires,
ça m'a comme aidée.
Il est aussi arrivé qu’une participante ne parle que très peu lors de l’entrevue. C’était le cas d’Émy, 17 ans, qui
avait tendance à répondre par « oui » ou par « non » ou encore de façon très vague à plusieurs de nos
questions. Cependant, il s’agit d’une difficulté qu’il est tout à fait normal de rencontrer lorsque l’on interroge
des participants, certains étant naturellement plus timides que d’autres.
Enfin, il nous semble important de souligner que notre discipline principale de recherche est celle des études
en communication et non pas celle de la psychologie ou de la sexologie, même si plusieurs des ouvrages cités
proviennent de ces disciplines. La quête d’information sur Internet sur un sujet délicat et la réception de cette
information de même que son contexte social – ici, la manifestation de l’agentivité des jeunes femmes en
matière de sexualité – ont représenté notre questionnement principal. Le regard que nous avons été amenée
à porter sur la sexualité des filles est donc principalement éclairé par des recherches provenant du domaine
de la communication (en sociologie des usages, notamment) et par des recherches féministes sur la question
de la sexualité des jeunes filles (girl studies et autres). Comme la grande majorité des ouvrages que nous
avons consultés, nos résultats se situent également dans un cadre d’analyse constructiviste, paradigme de
recherche qui repose sur une ontologie relativiste selon laquelle la « réalité » n’est jamais « indépendante de
l’esprit, de la conscience de celui qui l’observe ou l’expérimente » (Perret et Séville : 2003, p. 19). Ainsi, nos
résultats reposent, comme nous l’avons déjà spécifié, sur la « coconstruction » de sens entre les participantes
et nous-même, ainsi que sur l’interprétation subjective des participantes de leurs propres expériences (pour
plus de détails au sujet de la coconstruction de sens, voir la section « La perspective émique et celle de la
chercheuse », débutant à la page 116).
Conclusion
Les résultats que nous présentons dans cette thèse nous semblent importants d’abord pour fournir un
éclairage juste et nuancé des manifestations de l’agentivité des usagères d’Internet, en ce qu’ils fournissent
une information fiable, contextualisée et précise sur la façon dont de jeunes femmes utilisent Internet pour
apprendre au sujet de la sexualité, pour s’amuser et pour prendre en charge leur vie sexuelle. Au moyen d’une
méthode de recherche novatrice (blogue privé et entrevue) qui encourage l’écriture et l’expression de soi,
nous avons pu constater que les utilisations du Web par les jeunes filles étaient très variées et couvraient une
grande diversité de sujets. Si, plus jeunes, elles se servent du Web par curiosité pour apprendre la
signification de mots référant à la sexualité, l’utilisation du Web devient plus précise et plus pointue alors
qu’elles vieillissent. Elles utilisent alors le Web pour prendre en charge leur sexualité, que ce soit pour
apprendre des positions sexuelles, améliorer leurs relations de couple, ou trouver de l’information sur les
différents moyens de contraception disponibles. Elles utilisent aussi le Web pour se faire une idée de la
« norme » : taille des seins, fréquence des pratiques sexuelles par tranches d’âge, apparence des parties
génitales, etc. Elles ont enfin recours au Web pour s’informer au sujet de « dysfonctions » dont elles disent
souffrir, et ce sans avoir toutefois l’impression que le Web pourrait leur servir à diminuer leur détresse
psychologique autrement que pour leur faire réaliser qu’elles ne sont pas les seules à vivre la même situation.
Similairement, elles n’utilisent que très peu le Web pour chercher directement des moyens pour exercer plus
de pouvoir au sein de leurs couples ou de leurs relations. En accord avec les théories des médias en ce sens,
elles semblent accorder plus de crédibilité aux informations livrées par des proches (parents ou amies) qu’aux
informations trouvées sur les sites Web. Par contre, il leur semble souvent difficile de trouver un interlocuteur
fiable en la matière avec qui elles peuvent engager facilement la discussion.
Par ailleurs, lorsqu’elles cherchent sur le Web, elles ne semblent trouver que très peu d’information sur la
sensualité. Comme le dit Juliette, « sur Internet, tu n'as pas les sentiments, les émotions que ça peut faire »;
elles peuvent alors se faire, comme cette participante, une idée « fausse » de la sexualité, qui changera
toutefois avec les expériences.
Pour pousser plus loin la question de l’agentivité sexuelle et la situer dans le cadre social plus large dans
lequel elle opère, nous avons interrogé les participantes sur leurs relations de couples (ou leurs relations avec
des partenaires hors couple) pour comprendre à quel degré et en quelles situations elles sont capables de
faire preuve d’agentivité sexuelle. Si elles estimaient, au moment de la recherche, entretenir une relation
égalitaire avec leur partenaire, cela n’a pas toujours été le cas pour plusieurs : elles ont dû apprendre à se
« tailler une place » dans leur sexualité pour ainsi pouvoir vivre, comme l’exprime Roxanne, une sexualité
« saine et enrichissante » – et toutes n’y sont pas encore arrivées.
310
Ce pouvoir et cette impression de liberté semblent en effet difficiles à atteindre pour certaines, qui, comme
Amélie ou Laurence, n’arrivent pas à exercer tout le pouvoir qu’elles souhaiteraient détenir au sein de leur
relation. Cela leur donne l’impression de ne pas vivre activement leur sexualité, de s’en dissocier, et ainsi de
ne pas éprouver le plaisir et la liberté qu’elles recherchent dans leur sexualité. Cette « délégation » du pouvoir
à leur partenaire s’accompagne souvent d’un manque de confiance en soi pour lequel elles ne semblent
trouver d’aide ni dans leur entourage ni sur Internet.
Nombre de participantes éprouvent, d’autre part, de la difficulté à initier elles-mêmes les relations sexuelles,
un problème qu’elles attribuent surtout à la gêne et à l’impression de « moins connaître » la sexualité que leur
partenaire. Si certaines se laissent ainsi « guider » par choix conscient, d’autres aimeraient trouver la force ou
le courage de prendre une part plus active dans leur sexualité.
La notion inculquée par nombre de programmes scolaires à l’effet que « non, c’est non » semble toutefois
acquise chez toutes les participantes. Cependant, lorsque le partenaire est très insistant ou lorsque celui-ci est
placé sur un piédestal par les jeunes femmes, il leur semble plus difficile d’exprimer leur absence de
consentement. Elles sont alors partagées entre le désir de plaire à leur partenaire et de faire respecter leur
choix initial, ou encore deviennent confuses quant à la légitimité ou l’aspect éthique du comportement du
partenaire, et ne réagissent donc pas aussi rapidement qu’elles le souhaiteraient. Il leur faut alors plusieurs
expériences semblables de cette ambivalence quant à leur consentement pour qu’elles décident,
ultérieurement, de ne pas accepter de tels comportements. Mais entre la décision et les gestes, l’écart
demeure : même au-delà de cette prise de conscience, l’expression du consentement reste difficile avec le
même partenaire. Ce n’est que lorsqu’elles changent de partenaire qu’elles réalisent souvent pleinement le
manque d’agentivité dont elles ont fait preuve ou l’abus de pouvoir dont elles ont pu être victimes, que ce soit
par manque de confiance en elles-mêmes devant lui ou par manque d’expérience.
C’est fort probablement en partie pour cette raison que les participantes estiment que l’amélioration de
l’exercice de leur agentivité dépend de deux choses : de leur niveau d’expérience et du choix de leur
partenaire. Lorsque celui-ci les écoute et les respecte, et lorsque les participantes ont suffisamment confiance
en leurs capacités et en leur expérience pour s’exprimer, les conditions idéales sont en place pour qu’elles
puissent agir véritablement selon leurs désirs et leurs besoins et qu’elles puissent ainsi exercer pleinement de
l’agentivité sexuelle.
Si nous n’avons eu parmi nos participantes que très peu de jeunes femmes homosexuelles (deux seulement
sur trente), nous avons toutefois eu l’occasion de constater que celles-ci sont tout autant soumises à un
rapport de force et de pouvoir que leurs consœurs hétérosexuelles avec leur(s) partenaire(s). Audrey, par
exemple, a trouvé difficile d’exprimer son absence de consentement à une partenaire particulièrement
311
manipulatrice et insistante, alors qu’elle n’a pas rencontré de problèmes de la sorte avec une partenaire
ultérieure plus à l’écoute de ses besoins.
D’autre part, les résultats mettent très clairement en évidence que les participantes estiment que la sexualité
est importante dans leur vie et qu’il s’agit d’un sujet sérieux. Même si, dans certains cas, comme dans celui de
Laurence, certaines ont parfois tendance à adopter le haussement d’épaules observé par Gilmartin (2006) et
Tolman (1994) pour décrire les relations sexuelles qu’elles souhaitent oublier, toutes les participantes nous ont
semblé portées par le désir de jouir d’une sexualité saine et vécue de façon positive. Elles souhaitent
participer activement à leur sexualité et veillent à l’amélioration des situations qui, selon elles, méritent une
attention : la communication dans le couple, la diversité dans la sexualité qu’elles souhaitent préserver dans
les relations de couple de longue durée, les « dysfonctions » sexuelles de leur partenaire ou d’elles-mêmes, le
changement de moyen de contraception, etc. Par ailleurs, elles prônent la circulation d’un discours sur la
sexualité qui soit exempt des tabous sur la sexualité des femmes (pannes de désir, performance et autres) par
lesquels elles se sentent isolées.
Bref, elles sont réflexives en ce qui concerne leur sexualité, et sont disposées à prendre des décisions qui
soient éclairées et motivées par la volonté de vivre une sexualité qui soit saine et où le pouvoir est partagé
également par les partenaires. Comme le mentionne Bell (2012) : « [Y]oung people do know what they are
doing in relation to their sexual lives, as they articulate their needs and feelings and act on these. It is
important that organisations design and deliver sexual health programmes that take this into account. »
(p. 293)
Non seulement ces résultats devraient-ils être mieux intégrés dans les curriculums scolaires et les politiques
de santé publique, mais ils devraient aussi être considérés dans les études qui portent sur la sexualité des
filles en général, en ce qu’ils fournissent un éclairage riche et nécessaire à un débat théorique qui polarise
depuis plusieurs décennies les études féministes : la pertinence du concept d’agentivité sexuelle pour discuter
des comportements des femmes et des filles dans le contexte actuel genré des normes sexuelles (Fraser et
Bartky : 1992, p. 16-17; Gill : 2007 à 2012; Duits et van Zoonen : 2007; Lamb : 2010a et 2010b; Lamb et
Peterson : 2010; etc.).
Puisque nous avons pu constater, par les résultats découlant de nos discussions avec les participantes, que la
manifestation de cette agentivité n’est pas une illusion, ni un leurre, mais une condition sine qua non à leur
épanouissement, nous prônons le maintien de l’utilisation du concept dans les études sur la sexualité des filles
et des femmes. Nous préconisons par ailleurs, à l’instar de Duits et van Zoonen (2007), une conception de
l’agentivité qui fasse confiance à leur discours, puisque nous avons pu constater, comme ces auteures, que
les jeunes femmes et les adolescentes sont capables de parler par elles-mêmes des situations où elles font
312
preuve d’agentivité, et où, au contraire, elles peinent à en exercer. Les situations où elles mentionnent
éprouver de la difficulté à exercer du pouvoir (initiation des relations sexuelles, expression de l’absence de
consentement avec un partenaire insistant ou violent, etc.) pourraient ainsi bénéficier d’une plus grande
attention de la part des chercheurs et chercheuses, en ce qu’elles seraient dès lors éclairées par la
subjectivité et l’expérience des filles et des femmes – qui doivent par ailleurs être reconnues. Le fait de se
positionner contre l’utilisation du concept d’agentivité (en raison du souci d’une « deuxième » normativité qu’il
pourrait induire) ne nous semble pas rendre justice à leur subjectivité, leur voix et leurs expériences, puisque,
comme notre thèse le montre clairement (et comme d’autres chercheurs l’ont fait avant nous), l’intégration du
concept dans une grille d’analyse se révèle pertinente et utile pour rendre compte du discours des
participantes, des rapports de force qu’elles rencontrent, des façons dont elles négocient la sexualité avec
leur(s) partenaire(s) ainsi que des rapports qu’elles entretiennent avec les normes sociales.
Nous pensons de plus que l’intégration du concept est nécessaire pour contrer un discours négatif sur les
jeunes femmes. Les débats alarmistes sur l’hypersexualité – dont les perceptions sont transférées de façon
presque mécanique des médias aux jeunes femmes – peuvent avoir tendance à faire oublier une grande
partie de la réalité, soit celle de jeunes ayant une sexualité vécue la plupart du temps positivement et
souhaitée égalitaire, comme en témoignent les femmes avec qui nous avons effectué cette recherche. Un tel
discours ne rend donc pas justice à ce que semblent vivre beaucoup de jeunes femmes, qui prennent des
décisions et qui font des actes réfléchis (même si, en certains cas, l’atteinte d’un pouvoir égalitaire est difficile).
Les cas extrêmes présentés dans les médias (ou dans des essais comme celui de Levy [2005]) ne tiennent
que très peu compte du facteur décisionnel de l’agentivité des jeunes femmes, ce qui a pour effet de
« démoniser » la sexualité adolescente plutôt que d’accorder aux jeunes femmes la crédibilité nécessaire à la
reconnaissance de leur agentivité et de leurs désirs sexuels (Hassinoff : 2010).
Enfin, le discours sur l’hypersexualisation laisse de côté les jeunes femmes qui rencontrent des problèmes
(« dysfonctions ») et qui veulent vivre une sexualité qui leur semble « normale » et saine, mais qui éprouvent
de la difficulté à y parvenir, notamment par manque de ressources, et par le fait d’un discours social qui
occulte cette partie pourtant bien présente de la réalité et qui la rend taboue. Les femmes qui vivent un
problème sexuel comme celui, très fréquent, que la médecine actuelle nomme le « vaginisme » bénéficieraient
sûrement d’un discours (scolaire, social et médical) qui soit à l’écoute de leur vécu et en phase avec les
conséquences d’une normalité sexuelle basée sur la pénétration (Tiefer : 2000 à 2012; Anastasiadis et al. :
2002, LoFrisco : 2011, etc.; voir aussi Andro, Bachmann et al. : 2010). Si nous estimons qu’il faille éduquer les
jeunes filles à débusquer les effets du « culte de la performance » largement véhiculé par les médias
(notamment les sites des magazines pour adolescentes), où, comme l’a soulevé Jade, les femmes sont
représentées comme étant toujours prêtes et consentantes, nous croyons aussi que la question des dites
313
« dysfonctions » ne devrait pas être éludée, mais au contraire examinée attentivement dans le contexte actuel
des rapports sociaux de sexe. Ces deux quêtes nous semblent même complémentaires : le fait de débusquer
le mythe de la performance et de reconnaître les problèmes d’ordre sexuel que rencontrent fréquemment les
femmes démontrent tous deux que le discours social actuel sur la sexualité ne contribue pas
à l’épanouissement des femmes. Par ailleurs, le fait de reconnaître l’existence des problèmes sexuels ne
semble pas amener aux femmes une pression supplémentaire de performer, mais, au contraire, semble
permettre de diminuer cette pression en leur « accordant » le « droit » de ne pas égaler les attentes sociales
de la performance; bref, en leur permettant enfin de se considérer « normales », à défaut de pouvoir
déconstruire ce discours de la normalité qu’elles semblent avoir intégré et qui semble important dans leur
démarche.
Comme quelques participantes ont mentionné s’être intéressées plus particulièrement à certains problèmes
sexuels après avoir suivi un cours universitaire de psychosexualité, et comme plusieurs autres encore ont
mentionné que les cours de « Formation personnelle et sociale » (maintenant retirés des curriculums
scolaires) étaient déficients, il nous semble important que soient maintenus et reformulés les programmes
scolaires d’éducation sexuelle de façon à encourager l’agentivité sexuelle des jeunes filles et à leur fournir des
repères sur d’autres sujets que seules les ITSS : les relations de couple, la distribution du pouvoir et le désir
devraient être abordés sans gêne et dans une optique permettant d’exposer et de comprendre les enjeux de la
sexualité vécus par les jeunes. De plus, l’inclusion d’une discussion sur les dites « dysfonctions » sexuelles
dans le curriculum scolaire nous semble nécessaire, d’une part, pour réduire la honte et la détresse
psychologique qui y sont associées, et, d’autre part, pour permettre aux garçons de prendre conscience de
ces problèmes en apparence « dysfonctionnels ».
Ces cours, pour prévenir les écueils soulevés par les participantes, devraient idéalement être dispensés par
des professionnels de la santé (infirmiers, sexologues, intervenants…) à l’aise avec les notions de sexualité et
de respect, qui pourraient tenter de mieux répondre aux besoins d’information spécifiques des adolescents et
adolescentes, et viser à faire tomber certains des tabous les plus tenaces de la sexualité des filles en lien
notamment avec la performance, le consentement, les « dysfonctions », les pannes de désir et les relations
interpersonnelles entre partenaires, entre autres thèmes. Ils devraient par ailleurs faire la critique de
l’instrumentalisation commerciale de la sexualité que l’on trouve dans certains sites Web, magazines pour
adolescentes, et autres médias (comme par exemple les émissions de téléréalité pornographique de type Girls
Gone Wild) – et même par l’industrie pharmaceutique.
Il nous semble également important d’enseigner aux jeunes à bien choisir leur(s) partenaire(s) : comment
peut-on reconnaître les signes d’un partenaire abusif, égocentrique ou macho? Comment réagir à des
314
pratiques manipulatrices? Lamb (2010a) et même Bourdieu (1990) estiment que l’on devrait prendre en
compte « l’autre » et les sentiments amoureux dans l’explication, la description et l’apprentissage de la
sexualité et des rapports sociaux de genre. Un discours qui peut sembler, à certains, utopique, mais dont les
prémisses semblent effectivement faire partie de l’équation. Même si l’agentivité peut s’exprimer « en soi »,
dans le rapport à son corps ou dans la façon de percevoir ou de s’autoriser la sexualité, le ou la partenaire
aimant(e), attentif(ve) ou respectueux(se) semble en effet être conditionnel à l’expression de l’agentivité
sexuelle des filles. Il semble dès lors capital, en plus d’aider les jeunes filles à déconstruire certains discours
dominants, de leur montrer à choisir un ou une partenaire à l’écoute et réellement bienveillant(e). Pour les
mêmes raisons, il semble tout autant important de complexifier le concept d’agentivité sexuelle de
façon à y intégrer la dimension relationnelle, puisque l’agentivité sexuelle n’est ni déterminée socialement, ni
complètement personnelle, et ni simplement subjective.
Cette approche, de même que les thèmes présentés dans les résultats de notre recherche, devraient servir
à outiller les jeunes filles du concept même d’agentivité, qui implique une démarche réflexive sur elles-mêmes,
sur le pouvoir et sur la sexualité vécue et construite socialement.
Si la présence de tels cours dans toutes les écoles secondaires peut apparaître utopique, des sites Web
conçus par des professionnels (qui mentionnent leurs sources et qui ne cherchent pas à imposer un
comportement normé) pour répondre aux besoins des jeunes devraient être disponibles et publicisés auprès
des enseignants et des jeunes.
De la même façon que les études en communication ont montré qu’il n’y avait pas « un » public des médias
mais bien des publics différents, les études féministes ont montré qu’il n’y avait pas une réalité de femme,
mais bien des réalités différentes de femmes. Celle exposée ici – la manifestation de l’agentivité
d’adolescentes et de jeunes femmes franco-canadiennes issues de la classe moyenne et éduquées – a été
prise en compte et étudiée pour montrer comment elle se vit, dans ses choix quotidiens, ses négociations, ses
réussites, ses difficultés, et dans les façons dont Internet y participe. Bref, pour montrer comment elle
s’exprime dans son cadre social, où opèrent des discours dominants et normatifs sur la sexualité.
Nos résultats, en ce sens, viennent nuancer la présupposition populaire selon laquelle les jeunes filles sont
invariablement « victimes » du pouvoir masculin, puisque la majorité des participantes rencontrées ont
témoigné d’une relation satisfaisante avec leur partenaire, s’investissent dans leur sexualité, cherchent des
moyens de s’informer et prennent une part active dans les décisions sexuelles prises dans leur(s) couple(s).
Leurs paroles nous portent à trouver désolants les discours qui comparent d’une part leurs comportements
à une norme d’agentivité difficile à atteindre (Lamb : 2010, p. 299) dans le contexte des discours sociaux
315
actuels sur la sexualité, et qui d’autre part les accote simultanément à des présupposés exagérés et
sensationnalistes des comportements sexuels adolescents (Blais, Raymond, Manseau et Otis : 2009)88.
Internet et la « normalité »
L’un des résultats les plus probants de notre recherche – pour les études en communication et notamment en
communication pour la santé – concerne très certainement le rapport à la « normalité » qu’entretiennent les
participantes par leurs requêtes sur le Web. Force est de constater que cette inquiétude par rapport à la
norme (« suis-je normal(e)? ») pourrait très bien se révéler une constante de la recherche sur Internet. En
effet, comme l’ont constaté entre autres Drolet (2010), Harvey (2004), Charest et Bédard (2009) et Harvey et
al. (2007), l’outil Internet et la conception des moteurs de recherche pourraient susciter ce réflexe de
recherche de validation des informations (auprès des pairs, notamment) afin de réduire l’incertitude des
usagers, qui peut augmenter au fil de la cueillette d’informations. Ce réflexe serait d’autant plus caractéristique
de la recherche d’informations sur la santé (et donc sur la sexualité), si l’on en croit les participants de Drolet
(2010), qui ont cherché, comme les nôtres, à « se sentir moins seuls » dans leurs situations respectives
(p. 65). Il nous semble donc important de poursuivre les recherches dans ce domaine de façon à mieux
comprendre les liens qui se tissent entre Internet, recherche d’informations, normalité et agentivité des
usagers.
88 Il faut rappeler ici que nos participantes étaient âgées de 17 à 21 ans. Même si elles ont été amenées à discuter de
leur agentivité lorsqu’elles étaient plus jeunes, on ne peut pour autant considérer que nos résultats reflètent la réalité des
adolescentes franco-canadiennes plus jeunes, auxquelles s’est adressée plus particulièrement la « panique morale »
soulevée par plusieurs auteures (voir par exemple Caron : 2009; 2012).
Bibliographie
Abrahamsen, David. 1960. The Psychology of Crime. New York : Columbia University Press, 358 p.
Abu-Lughod, L. 2002. « Do Muslim Women Really Need Saving? » Anthropological Relativism and Its
Others », dans American Anthropologist, vol. 104, p. 783-790.
Albanesi, Heather Powers. 2010. Gender and Sexual Agency: How Young People Make Choices about Sex.
Lanham, Md : Lexington Books, 161 p.
Albanesi, Heather Powers. 2009. « Eschewing Sexual Agency: A Gender Subjectivity Approach », dans Race,
Gender & Class, vol. 16, n° 1-2, p. 102-132.
Allen, Louisa. 2008. « Young People’s “Agency” in Sexuality Research Using Visual Methods », dans Journal
of Youth Studies, vol. 11, n° 6, p. 565-577.
Allen, Katherine R., Erica K. Husser, Dana J. Stone et Christian E. Jordal. 2008. « Agency and Error in Young
Adults’ Stories of Sexual Decision Making », dans Family Relations, vol. 57, p. 517-529.
American Psychiatric Association (APA). 2000 [1994]. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
4e édition révisée (DSM-IV-TR). Washington (D.C.) : American Psychiatric Association, 943 p.
American Psychiatric Association (APA). 2000 [1994]. Mini Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders : Critères diagnostiques, 4e édition française révisée (Mini DSM-IV-TR). Washington
(D.C.) : American Psychiatric Association, 384 p.
American Psychiatric Association (APA), Task Force on the Sexualization of Girls. 2007. Report of the APA
Task Force on the Sexualisation of Girls. Washington (D.C.) : American Psychological Association.
En ligne [janvier 2013]. http://www.apa.org.
Anastasiadis, Aristotelis G., Anne R. Davis, Mohamed A. Ghafar, Martin Burchardt et Ridwan Shabsigh. 2002.
« The Epidemiology and Definition of Female Sexual Disorders », dans World Journal of Urology, vol.
20, p. 74-78.
Andro, Armelle, Laurence Bachmann, Nathalie Bajos et Christine Hamel. 2010. « Le plaisir contraint », dans
Nouvelles questions féministes, vol. 29, n° 3, p. 1-12.
Ang, Ien. 1985. Watching Dallas : Soap Opera and the Melodramatic Imagination. London : Methuen, 148 p.
Attwood, Feona. 2005. « What Do People Do With Porn? Qualitative Research Into the Consumption, Use and
Experience of Pornography and Other Sexually Explicit Media », dans Sexuality and Culture, vol. 9,
n° 2, p. 65-86.
318
Averett, Paige, Mark Benson et Kourtney Vaillancourt. 2008. « Young Women’s Struggle for Sexual Agency:
the Role of Parental Messages », dans Journal of Gender Studies, vol. 17, n° 4, p. 331-344.
Bancroft, John. 2002. « The Medicalization of Female Sexual Dysfunctions: The Need for Caution », dans
Archives of Sexual Behavior, vol. 31, n° 5, p. 451-455.
Bandura, Albert. 2003 [1997]. Auto-efficacité : le sentiment d'efficacité personnelle. Paris; Bruxelles : De
Boeck, 859 p.
Bandura, Albert. 2002. « Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency », dans Journal of
Moral Education, vol. 31, n° 2, p. 101- 119.
Bandura, Albert. 1986. Social Foundations of Thought and Action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs,
NJ, Prentice-Hall.
Barter, Christine. 2009. « In the Name of Love: Partner Abuse and Violence in Teenage Relationships », dans
British Journal of Social Work, Oxford University Press, n° 39, p. 211-233.
Basson, Rosemary, Jennifer Berman, Arthur Burnett, Leonard Derogatis et al. 2000. « Report of the
International Consensus Development Conference on Female Sexual Dysfunction: Definitions and
Classifications », dans The Journal of Urology, vol. 163, p. 888-893.
Basson, Rosemary, Jules S. Black et al. 2005. « Peer Commentaries on Binik (2005) » (section spéciale),
dans Archives of Sexual Behavior, vol. 34, n° 1, p. 23-61.
Basson, Rosemary, Lori A. Brotto, Ellen Laan, Geoffrey Redmond et Wulf H. Utian. 2005. « Assessment and
Management of Women’s Sexual Dysfunctions: Problematic Desire and Arousal », dans The Journal
of Sexual Medicine, vol. 2, p. 291-300.
Basson, Rosemary, Margaret E. Wierman, Jacques van Lankveld et Lori Brotto. 2010. « Summary of the
Recommendations on Sexual Dysfonctions in Women », dans Journal of Sexual Medicine, vol. 7,
p. 314-326.
Basson, Rosemary, Sandra Leiblum, Lori Brotto, Leonard Derogatis, Jean Fourcroy, K. Fugl-Meyer, A.
Graziottin, Julia R. Heiman, Ellen Laan, Cindy Meston, L. Shover, J. van Lankveld et W. Weijmar
Schultz. 2003. « Definitions of Women’s Sexual Dysfunction Reconsidered: Advocating Expansion
and Revision », dans Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, vol. 24, p. 221-229.
Bay-Cheng, Laina Y, Adjoa D. Robinson et Alyssa N. Zucker. 2009. « Behavioral and Relational Contexts of
Adolescent Desire, Wanting, and Pleasure: Undergraduate Women’s Retrospective Accounts », dans
Journal of Sex Research, vol. 46, n° 6, p. 511-524.
Bay-Cheng, Laina Y. et Nicole M. Fava. 2011. « Young Women’s Experiences and Perceptions of
Cunninlingus during Adolescence », dans Journal of Sex Research, vol. 48, n° 6, p. 531-542.
319
Bell, Stephen A. 2012. « Young People and Sexual Agency in Rural Uganda », dans Culture, Health &
Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care, vol. 14, n° 3, p. 283-296.
Berger, B. M. 1991. « Structure and Choice in the Sociology of Culture », dans Theory and Society, vol. 20,
n° 1, p. 1-19.
Bereni, Laure, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard. 2008. Introduction aux Gender
Studies : Manuel des études sur le genre. Bruxelles : de Boeck, 247 p.
Binik, Yitzchak, Elke Reissing, Caroline Pukall, Nicole Flory, Kimberley A. Payne, Samir Khalifé. 2002. « The
Female Sexual Pain Disorders: Genital Pain or Sexual Dysfunction? », dans Archives of Sexual
Behavior, vol. 31, n° 5, p. 425-429.
Binik, Yitzchak, Marta Meana, Karen Berkley et Samir Khalife. 1999. « The Sexual Pain Disorders: Is the Pain
Sexual or the Sex Painful? », dans Annual Review of Sex Research, vol. 10, p. 210-236.
Bird, S. R. 1996. « Welcome to the Men’s Club: Homosociality and the Maintenance of Hegemonic
Masculinity », dans Gender and Society, vol. 10, p. 120-132.
Blais, Martin, Sarah Raymond, Hélène Manseau et Joanne Otis. 2009. « La sexualité des jeunes Québécois et
Canadiens. Regard critique sur le concept d’ "hyper-sexualisation" », dans Globe. Revue
internationale d’études québécoises, vol. 12, n° 2, p. 23-46.
Brotto, Lori A., Johannes Bitzer, Ellen Laan, Sandra Leiblum et Mijal Luria. 2010. « Women’s Sexual Desire
and Arousal Disorders », dans The Journal of Sexual Medicine, vol. 7, p. 586-614.
Bryant, Joann et Toni Schofield. 2007. « Feminine Sexual Subjectivites : Bodies, Agency and Life History »,
dans Sexualities, vol. 10, n° 3, p. 321-340.
Borzekowski, Dina L. G. et Vaughn I. Rickert. 2001. « Adolescent Cybersurfing fo Health Information », dans
Archives of Pedriatrics & Adolescent Medicine, vol. 155, p. 813-817.
Boubée, Nicole. 2008. « Les stratégies des jeunes chercheurs d’informations en ligne », dans Questions de
communication, vol. 14, p. 33-48.
Bourdieu, Pierre. 1998. La domination masculine. Paris : Éditions du Seuil, 142 p.
Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice, traduction de Richard Nice, Cambridge : Cambridge
University Press, 224 p.
Bourke, Joanna. 2007. Rape : Sex, Violence, History. Grande Bretagne : Shoemaker Hoard, 565 p.
Boynton, P. 1999. « "Is That Supposed to be Sexy?" Women Discuss Women in "Top Shelf" Magazines »,
dans Journal of Community & Applied Social Psychology, vol. 9, p. 449-461.
320
Bozon, Michel. 2009. Sociologie de la sexualité. Paris : Éditions Armand Colin, 127 p.
Bulot, V., P. Thomas et Y. Delevoy-Turrelu. 2007. « Agentivité : se vivre ou se juger agent? », dans
L’Encéphale, vol. 33, no4, p. 603-608.
Buhi, Eric R., Ellen M. Daley, Hollie J. Furhmann et Sarah A. Smith. 2009. « An Observational Study of How
Young People Search for Online Sexual Health Information », dans Journal of American College
Health, vol. 58, n° 2, p. 101-111.
Burgess, Jean. 2006. « Blogging to Learn, Learning to Blog », dans Bruns et Jacob (éd.), Uses of Blogs, New
York : Peter Lang, p. 105-114.
Butler, Judith. 2006 [1990]. Gender Trouble. New York et London : Routledge, 236 p.
Butler, Judith. 2004. Undoing gender. New York : Routledge, 267 p.
Butler, Judith. 2004 [1997]. Le pouvoir des mots : discours de haine et pouvoir du performatif. Paris : Éditions
Amsterdam, 220 p.
Caron, Caroline. 2012. « Filles et hypersexualisation : des points de vue (et des corps) situés qui comptent »,
dans Denis Jeffrey et Jocelyn Lachance (dir.), Codes, corps et rituels dans la culture jeune, Québec :
Presses de l’Université Laval, p. 119-138.
Caron, Caroline. 2009. Vues, mais non entendues. Les adolescentes québécoises face à l'hypersexualisation
de la mode et des médias. Thèse de doctorat (Ph.D.) : Département de communication, Université
Concordia, 319 p.
Chabaud-Rychter, Danielle, Virginie Descoutures, Anne-Marie Devreux et Eleni Varikas. 2010. Sous les
sciences sociales, le genre. Paris : La Découverte, 512 p.
Chambat, Pierre. 1994. « Usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) : Évolution
des problématiques », dans TIS, vol. 6, n° 3, p. 249-270.
Chambat, Pierre et Josiane Jouët. 1996. « Rapport introductif, Machines à communiquer : acquis et
interrogations », 10e Congrès international des sciences de l’information et de la communication,
Grenobles-Echirolles, p. 209-214.
Champagne, Patrick, Jean-Claude Combessie et Abdelmalek Sayad. 1985. « Usages privés et usages
politiques des moyens de communication », dans Réseaux, vol. 3, n° 13, p. 39-73.
Charest, Francine et François Bédard. 2009. Les racines communicationnelles du Web. Québec (Québec) :
Presses de l’Université du Québec, 126 p.
321
Chilman, C., 1990. « Promoting healthy adolescent sexuality », dans Family relations, n° 39, p. 123–131.
Ciclitara, Karen. 2004. « Pornography, Women and Feminism: Between Pleasure and Politics », dans
Sexualities, vol. 7, n° 3, p. 281-301.
Ciclitara, Karen. 1998. What Does Pornography Mean to Women? Thèse de doctorat (non publiée).
Manchester Metropolitan University.
Cocca, Carolyn E. 2004. Jailbait: The Politics of Statutory Rape Laws in the United States. Albany, NY : State
University of New York Press, 228 p.
Collectif de Boston pour la santé des femmes. 1977. Notre corps, nous-mêmes. Paris : Albin Michel, 240 p.
Coleman, Rebecca. 2008. « Girls, Media Effects and Body Image », dans Feminist Media Studies, vol. 8, n° 2,
p. 163-179.
Conaglen, Helen M. 2001. « Report of the International Consensus Development Conference on Female
Sexual Dysfunction: A View from Down Under », dans Journal of Sex & Marital Therapy, vol. 27,
p. 127-130.
Connell, Raewyn W. 1995. Masculinities. Berkeley : University of California Press, 295 p.
Conrad, P. et J. W. Schneider. 1980. « Healthism and the Medicalization of Everyday Life », dans International
Journal of Health Services, vol. 10, p. 365-388.
Corsianos, Marilyn. 2007. « Mainstream Pornography and "Women": Questioning Sexual Agency », dans
Critical Sociology, vol. 33, p. 863-885.
Cotten, Shelia R. et Sipi S. Gupta. 2004. « Characteristics of Online and Offline Health Information Seekers
and Factors that Discriminate Between Them », dans Social Science & Medicine, vol. 59, p. 1795-
1806.
Cowling, Mark. 1998. Date Rape and Consent. Aldershot (England) : Ashgate Publishing Ltd, 154 p.
Crowley, Tessa, David Goldmeier et Janice Hiller. 2009. « Diagnosing and Managing Vaginismus », dans
British Medical Journal, vol. 339, p. 225-229.
Davis, Susan R. 2001. « An External Perspective on the Report of the International Consensus Development
Conference on Female Sexual Dysfunction: More Work to Be Done », dans Journal of Sex & Marital
Therapy, vol. 27, p. 131-133.
De Certeau, Michel. 1984 [1980]. L’invention du quotidien [The practice of Everyday Life]. Berkeley : University
of California Press, 229 p.
322
De Certeau, Michel. 1980. L’invention du quotidien. Tome 1 : Arts de faire. Paris : Union générale d’éditions,
375 p.
De Kruiff, M. E., M. M. ter Kuile, P. T. M. Weijenborg et J. J. D. M. van Lankveld. 2000. « Vaginismus and
Dyspareunia: Is There a Difference in Clinical Presentation? », dans Journal of Psychosomatic
Obstetrics and Gynecology, vol. 21, p. 149-155.
Debold, E., Deborah Tolman, L. M. Brown. 1996. « Embodying knowledge, knowing desire: Authority and Split
Subjectivities in Girls’ Epistemological Development », dans N. R. Goldberger, J. M. Tarule, B. M.
Clinchy et M. F. Belenky (éd.), Knowledge, Difference, and Power: Essays Inspired by Women’s
Ways of Knowing, New York : Basic Books, p. 85-125.
Delphy, Christine. 2001. L’ennemi principal. Tome 2 : Penser le genre. Paris : Éditions Syllepse, 389 p.
Deschamps, Catherine. 2009. « GAGNON John, Les Scripts de la sexualité. Essais sur les origines culturelles
du désir », dans Genre, sexualité & société, printemps 2009. En ligne [23 juin 2012].
http://gss.revues.org/index321.html.
Döring, Nicola M. 2009. « The Internet’s Impact on Sexuality: A Critical Review of 15 Years of Research »,
dans Computers in Human Behavior, vol. 25, n° 5, p. 1089-1101.
Dove, Natalie L. et Michael W. Wiederman. 2000. « Cognitive Distraction and Women’s Sexual Functioning »,
dans Journal of Sex & Marital Therapy, vol. 26, p.67-78.
Dr. Phil. 2012. « Little Liars? », émission du 16 novembre.
Drescher, Jack. 2010. « Queer Diagnoses: Parallels and Contrasts in the History of Homosexuality, Gender
Variance, and the Diagnostic and Statistical Manual », dans Archives of Sexual Behavior, vol. 39,
p. 427-460.
Drolet, Marie-Ève. 2011. Usages et appropriation de l’Internet par les jeunes adultes qui recherchent des
informations sur la santé. Mémoire (M.A.) : Université du Québec à Montréal, 122 p.
Duits, Linda et Liesbet van Zoonen. 2009. « Coming to terms with sexualization ». Conference of the
International Communication Association, Session « Sex and Sexuality in Media Culture: Theory and
Performance », Singapour, 20-25 mai, 22 p.
Duits, Linda et Liesbet van Zoonen. 2007. « Who’s afraid of Female Agency?: A Rejoinder to Gill », dans
European Journal of Women’s Studies, vol. 14, n° 2, p. 161-170.
Duits, Linda et Liesbet van Zoonen. 2006. « Headscarves and Porno-Chic: Disciplining Girls’ Bodies in the
European Multicultural Society », dans European Journal of Women’s Studies, vo. 13, n° 2, p. 103-
117.
323
Dworkin, Andrea. 1981. Pornography: Men Possessing Women. New York : Perigee Books, 300 p.
Eck, B. A. 2003. « Men Are Much Harder: Gendered Viewing of Nude Images », dans Gender & Society,
vol. 17, n° 5, p. 691-710.
Efimova, Lilia. 2009. Passion at work: blogging practices of knowledge workers. Thèse de doctorat. Novay
PhD Research Series, vol. 24, 257 p.
Egan, Danielle et Gail Hawkes. 2009. « The Problem with Protection: Or, Why we Need to Move Towards
Recognition and the Sexual Agency of Children », dans Gender et Sexuality Studies. London :
Continuum, vol. 23, n° 3, p. 389-400.
Egan, Danielle et Gail Hawkes. 2008. « Imperiled and Perilous: Exploring the History of Childhood Sexuality »,
dans Journal of Historical Sociology, Oxford et Malden : Blackwell Publishing Ltd., vol. 21, n° 4,
Décembre, p. 355-367.
Elliot, H. 1997. « The Use of Diaries in Sociological Research on Health Experience », dans Sociological
Research Online, vol. 2, n° 2, http://www.socresonline.org.uk/ 2/2/7 [4 mai 2010] .
Ellis, Carolyn. 2007. « Telling Secrets, Revealing Lives : Relational Ethics in Research With Intimate Others »,
dans Qualitative Inquiry, vol. 13, n° 1, p. 3-29.
Elmer, Greg (éd.). 2002. Critical Perspectives on the Internet. Lanham, Boulder, New York, Oxford : Rowman
& Littlefield Publishers, Inc., 217 p.
Emirbayer, Mustafa et Ann Mische. 1998. « What Is Agency? », dans American Journal of Sociology, vol. 103,
n° 4, p. 962-1023.
Fagen, Jennifer Lara et Peter B. Anderson. 2012. « Constructing Masculinity in Response to Women’s Sexual
Advances », dans Archives of Sexual Behavior, vol. 41, p. 261-270.
Fallows, Deborah. 2005. « How Women and Men Use Internet ». PEW Internet & American Life Project. En
ligne [septembre 2012]. http://www.pewinternet.org.
Farmer, Lesley. 2008. Teen Girls and Technology: What’s the Problem, What’s the Solution? New York et
London : Teachers College Press et ALA Editions, 180 p.
Fine, Michelle. 1988. « Sexuality, Schooling, and the Adolescent Female: The Missing Discourse of Desire »,
dans Harvard Educational Review, vol. 58, p. 29-53.
Fine, Michelle et Sara I. McClelland. 2006. « Sexuality Education and Desire: Still Missing after All These
Years », dans Harvard Educational Review, vol. 76, n° 3, p. 297-338.
324
Finney, Danielle. 2001. Sexing Desire: The Construction and Treatment of Female Sexuality in Popular
Women’s Magazines. Mémoire (M. Women’s Studies) Memorial University of Newfoundland, 97 p.
Flichy, Patrice. 2008. « Technique, usage et représentations », dans Réseaux, n° 148-149, p. 147-174.
Flichy, Patrice. 1999. « Internet ou la communauté scientifique idéale », dans Réseaux, vol. 17, n° 97, p. 77-
120.
Foucault, Michel. 2009 [1963]. Naissance de la clinique. Paris : Quadrige/PUF, 214 p.
Foucault, Michel. 1994 [1976]. Histoire de la sexualité : La volonté de savoir. Paris : Éditions Gallimard, 211 p.
Fraser, Nancy et Sandra Lee Bartky (Éd.). 1992. Revaluing French Feminism: Critical Essays on Difference,
Agency, and Culture. Bloomington : Indiana University Press, 201 p.
Gabbard, Glen O. 2001. « Musings on the Report of the International Consensus Development Conference on
Female Sexual Dysfunction: Definitions and Classifications », dans Journal of Sex & Marital Therapy,
vol. 27, p. 145-147.
Gallop, Cindy. 2009. « Make Love, Not Porn ». TED Talks. En ligne [avril 2013].
http://blog.ted.com/2009/02/04/twitter_snapsho_3.
Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York : Basic Books, 470 p.
Glaser, Barney G. 1978. Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley
(Calif.) : Sociology Press, 164 p.
Giddens, Anthony. 2005 [1984]. La constitution de la société. Paris : Presses universitaires de France, 474 p.
Gill, Rosalind. 2012. « Media, Empowerment and the "Sexualization" Debates », dans Sex Roles, vol. 66,
p. 636-745.
Gill, Rosalind. 2011. « Sexism Reloaded, or, It’s Time to Get Angry Again », dans Feminist Media Studies,
vol. 11, n° 1, p. 61-71.
Gill, Rosalind. 2010. « Mediated Intimacy and Postfeminism: A Discourse Analytic Examination of Sex and
Relationships Advice in a Women’s Magazine », dans Discourse and Communication, vol. 3, p. 345-
369.
Gill, Rosalind. 2009a. « Beyond the "Sexualization of Culture" Thesis: An Intersectional Analysis of "Sixpacks",
"Midriffs" and "Hot Lesbians" in Advertising », dans Sexualities, vol. 12, n° 2, p. 137-160.
Gill, Rosalind. 2009b. « Supersexualize me! Advertising and the Midriffs », dans Feona Attwood (éd.),
Mainstreaming Sex: The Sexualization of Culture, London et New York : I. B. Tauris, p. 93-110.
325
Gill, Rosalind. 2008a. « Culture and Subjectivity in Neoliberal and Postfeminist Times », dans Subjectivity,
vol. 25, p. 432-445.
Gill, Rosalind. 2008b. « Empowerment/Sexism: Figuring Female Sexual Agency in Contemporary
Advertising », dans Feminism & Psychology, vol. 18, n° 1, p. 35-60.
Gill, Rosalind. 2007. « Critical Respect: The Difficulties and Dilemmas of Agency and "Choice" for Feminism:
A Reply to Duits and van Zoneen », dans European Journal of Women’s Studies, vol. 14, n° 1, p. 69-
80.
Gill, Rosalind et Christina Scharff. 2011. « Introduction », dans Rosalind Gill et Christina Scharff (éd.), New
Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity, Basingstoke : Palgrave Macmillan, p. 1-
20.
Gilmartin, Shannon K. 2006. « Changes in College Women’s Attitudes Toward Sexual Intimacy », dans
Journal of Research on Adolescence, vol. 16, n° 3, p. 429-454.
Godwin-Jones, B. 2008. « Emerging Technologies: Web-writing 2.0: Enabling, Documenting, and Assessing
Writing Online », dans Language Learning & Technology, vol. 12, n° 2, p. 7–13.
Godwin-Jones, B. 2003. « Emerging Technologies: Blogs and Wikis: Environments for On-line Collaboration »,
dans Language Learning & Technology, vol. 7, n° 2, p. 12–16.
Gotell, Lise. 2010. « Canadian Sexual Assault Law: Neoliberalism and the Erosion of Feminist-Inspired Law
Reforms », dans C. McGlynn et V. E. Munro, éd., Rethinking Rape Laws: International and
Comparative Perspectives. New York : Routledge, p. 209-223.
Gotell, Lise. 2008. « Rethinking Affirmative Consent in Canadian Sexual Assault Law: Neoliberal Sexual
Subjects and Risky Women », dans Akron Law Review, vol. 41, p. 865-898.
Graham, Cynthia A. 2010. « The DSM Diagnostic Criteria for Female Sexual Arousal Disorder », dans
Archives of Sexual Behavior, vol. 39, p. 240-255.
Gray, Nicola J., Jonathan D. Klein, Judith A. Cantrill et Peter R. Noyce. 2002. « Adolescent Girls’ Use of the
Internet for Health Information: Issues Beyond Access », dans Journal of Medical Systems, vol. 26,
n° 6, p. 545-553.
Gray, Nicola J., Jonathan D. Klein, Peter R. Noyce, Tracy S. Sesselberg et Judith A. Cantrill. 2005. « Health
Information Seeking Behaviour in Adolescence: The Place of the Internet », dans Social Science &
Medicine, vol. 60, p. 1467-1478.
Guba, Egon G. and Lincoln, Yvonna S. 1982. « The Epistemological and Methodological Bases of Naturalistic
Inquiry », dans Educational Communications and Technology Journal, vol. 31, p. 233–252.
326
Guillebaud, Jean-Claude. 1998. La tyrannie du plaisir. Paris : Éditions du Seuil, 392 p.
Guyard, Laurence. 2010. « Sexualité féminine et consultation gynécologique : la part évincée du plaisir », dans
Nouvelles questions féministes, vol. 29, n° 3, p. 44-57.
Haag, Pamela. 1999. Consent : Sexual Rights and Transformation of American Culture, Ithaca (New York) :
Cornell University Press, 256 p.
Hall, Stuart. 1973. « Codage/Décodage », dans Réseaux, n° 68, p. 27-39.
Halleck, Seymour. 1972. « The Therapeutic Encounter », dans H. L. P. Resnik et Marvin E. Wolfgang, éd.,
Sexual Behaviors. Social, Clinical, and Legal Aspects, Boston : Little, Brown and Co., 448 p.
Hammers, Corie. 2009. « Space, Agency, and the Transfiguring of Lesbian/Queer Desire », dans Journal of
Homosexuality, n° 56, p. 757-785.
Harvey, Kevin James, Brian Brown, Paul Crawford, Aidan Macfarlane et Ann McPherson. 2007. « "Am I
Normal?" Teenagers, Sexual Health and the Internet », dans Social Sciences & Medicine, vol. 65,
p. 771-781.
Harvey, Laura et Rosalind Gill. 2011. « Spicing It Up: Sexual Entrepreneurs and The Sex Inspectors », dans
Rosalind Gill et Christina Scharff (éd.), New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and
Subjectivity, Basingstoke : Palgrave Macmillan, p. 52-67.
Harvey, Pierre-Léonard. 2004 [1995]. Cyberespace et communautique : appropriation, réseaux, groupes
virtuels. Québec (Québec) : Presses de l’Université Laval, 240 p.
Hasinoff, Amy Adele. 2010. No Right to Sext? A Critical Examination of Media and Legal Debates About
Teenage Girls’ Sexual Agency in the Digital Age. Thèse de doctorat (Ph.D. Communication),
University of Illinois at Urbana-Champaign, 316 p.
Hawes, Joseph M. et N. Ray Hiner (éd.). 1985. American Childhood: A Research Guide and Historical
Handbook. Westport, CT : Greenwood, 711 p.
Headland, Thomas N., Kenneth Lee Pike et Marvin Harris. 1990. Emics and Etics : The Insider/Outsider
Debate. Newbury Park (Calif.) : Sage Publications, 226 p.
Hering, S. C., L. A. Scheidt, S. Bonus et E. Wright. 2004. « Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs »,
dans Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer
Society, p. 40101b.
Héritier, Françoise. 1996. Masculin/Féminin I. La pensée de la différence. Paris : Odile Jacob, 332 p.
327
Hetsroni, Amir. 2007. « Adolescents’ Perceived Usefulness of Information on Sexuality: A Cross-Cultural
Comparison of Interpersonal Sources, Professional Sources and the Mass Media », dans Atlantic
Journal of Communication, vol. 15, n° 2, p. 134-152.
Hewitt, J. P. 1989. Dilemmas of the American Self. Philadelphie : Temple University Press, 274 p.
Hirata, Helena, Françoise Laborie, Hélène Le Doaré et Danièle Sénotier (coord.). 2000. Dictionnaire critique
du féminisme. Paris : Presses universitaires de France, 299 p.
Hitlin, Steven et Glen H. Elder, Jr. 2007. « Time, Self, and the Curiously Abstract Concept of Agency », dans
Sociological Theory, vol. 25, n° 2, p. 170-191.
Hoffman, D. L., T. P. Novak et A. Venkatesh. 2004. « Has the Internet Become Indispensable? », dans
Communications of the ACM, vol. 47, p. 37–42.
Hollway, Wendy. 1984. « Women’s Power in Heterosexual Sex », dans Women’s Studies International Forum,
vol. 7, n° 1, p. 63-68.
hooks, bell. 1990. Yearning : Race, Gender, and Cultural Politics. Boston : South End Press, 236 p.
Hookway, Nicholas. 2008. « "Entering the Blogosphere": Some Strategies for Using Blogs in Social
Research », dans Qualitative Research, vol. 8, n° 1, p. 91-113.
Horvath, Keith J., Blair Beadnell et Anne M. Bowen. 2007. « A Daily Web Diary of the Sexual Experiences of
Men who have Sex with Men: Comparisons with a Retrospective Recall Survey », dans AIDS
Behavior, vol. 11, p. 537-548.
Hsu, Chin-Lung et Judy Chuan-Chuan Lin. 2008. « Acceptance of Blog Usage: The Roles of Technology
Acceptance, Social Influence and Knowledge Sharing Motivation », dans Information & Management,
vol. 45, p. 65-74.
Ihadjadene, Madjid et Stéphane Chaudiron. 2008. « Quelles analyses de l’usage des moteurs de recherche?
Questions méthodologiques », dans Questions de communication, vol. 14, p. 17-32.
James, Allison, Chris Jenks et Alan Prout. 1998. Theorizing Childhood. Cambridge, UK : Polity Press, 247 p.
Janson, Bernard, Amanda Spink et Jan Pedersen. 2005. « A Temporal Comparison of Alta Vista Web
Searching », dans Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 56,
n° 6, p. 559-570.
Jeanneret, Yves. 2007. « Usages de l’usage, figures de la médiation », dans Communication et langages,
n° 151, p. 3-19.
328
Johnson, Ida M. et Robert T. Sigler. 1997. Forced Sexual Intercourse in Intimate Relationships. Aldershot,
Brookfield, Singapore et Sydney : Ashgate/Dartmouth, 189 p.
Jones S. 2002. The Internet Goes to College. Washington, DC : Pew Internet & American Life Project. En ligne
[novembre 2012]. http://www.pewinternet.org.
Jones, Rachel K. et Ann E. Biddlecom. 2011. « Is the Internet Filling the Sexual Health Information Gap for
Teens? An Exploratory Study », dans Journal of Health Communication, vol. 16, n° 2, p. 112-123.
Jouët, Josiane. 2000. « Retour critique sur la sociologie des usages », dans Réseaux, vol. 18, n° 100, p. 487-
521.
Kabakçi, Elif et Senar Batur. 2003. « Who Benefits from Cognitive Behavioral Therapy for Vaginismus? »,
dans Journal of Sex & Marital Therapy, vol. 29, n° 4, p. 277-288.
Kaplan, H. S. 1977. « Hypoactive Sexual Desire », dans Journal of Sex and Marital Therapy, vol. 3, n° 1, p. 3-
9.
Katz, Elihu, H. Haas et M. Gurevitch. 1973. « On the Use of the Mass Media for Important Things », dans
American Sociological Review, vol. 38, n° 2, p. 164-181.
Kennedy, Gregor, Barney Dalgarno, Kathleen Gray et al. 2007. « The Net Generation Are Not Big Users of
Web 2.0 Technologies: Preliminary Findings », dans Proceedings ascilite Singapore 2007, p. 517-
525.
Kimmel, Michael S. 2005. The Gender of Desire: Essays on Male Sexuality. Albany : State University of New
York Press, 272 p.
Kindlon, Daniel James et Michael Thompson. 2000. Raising Cain: Protecting the Emotional Life of Boys. New
York : Ballantine, 298 p.
Krueger, Richard A. 1998. Developing Questions for Focus Groups. Focus Group Kit n° 3. Thousand Oaks :
Sage Publications, 107 p.
Lajoie, Jacques. 2002. « Internet et activité exploratoire », dans J. Lajoie et É. Guichard, dir., Odyssée
Internet : Enjeux sociaux, Québec : Presses de l’Université du Québec, p. 164-178.
Lamb, Sharon. 2010a. « Feminist Ideals for a Healthy Female Adolescent Sexuality: A Critique », dans Sex
Roles, n° 62, p. 294-306.
Lamb, Sharon. 2010b. « Porn as a Pathway to Empowerment? A Response to Peterson’s Commentary »,
dans Sex Roles, n° 62, p. 314-317.
329
Lamb, Sharon et Zoë D. Peterson. 2010. « Adolescent Girls’ Sexual Empowerment: Two Feminists Explore
the Concept », dans Sex Roles, n° 66, p. 703-712.
Lamoureux, Diane. 2007. « Les féminismes : histoires, acquis et nouveaux défis », dans Recherches
féministes, vol. 20, n° 2, p. 1-5.
Lang, Marie-Eve. 2012. « Entre blogues et web diaries : le blogue "privé" comme méthode pour obtenir des
données qualitatives sur la sexualité », Communication, vol. 30, n° 2. En ligne [mars 2013].
communication.revues.org.
Lang, Marie-Eve. 2011. « L’agentivité sexuelle des adolescentes et des jeunes femmes : une définition », dans
Recherches féministes, vol. 24, n° 2, p. 189-209.
Lang, Marie-Eve. 2009. La réception des textes de magazines à caractère sexuel chez les adolescentes au
Québec et au Nouveau-Brunswick : adhésion, ignorance ou contestation? Mémoire (M.A.) :
Université Laval, 170 p.
Laperrière, Anne. 1997. « Les critères de scientificité des méthodes qualitatives », dans Poupart, Deslauriers,
Groulx, Laperrière, Mayer, Pires (Groupe de recherche interdisciplinaire sur les méthodes
qualitatives), La recherche qualitative : Enjeux épistémologiques et méthodologiques, Montréal :
Gaëtan Morin Éditeur, p. 365-389.
Le Breton, David. 2013. « Au risque de la beauté », dans Bernard Cadet et Gérard Chasseigne, dir., Quêtes
de beauté, pratiques culturelles et risques, Paris : Éditions Publibook, p. 53-63.
Lehr, Valerie D. 2008. « Developing Sexual Agency: Rethinking Late Nineteenth and Early Twentieth Century
Theories for the Twenty-First Century », dans Sexuality & Culture, vol. 12, p. 204-220.
Lemire, Marc, Claude Sicotte et Guy Paré. 2008. « Internet Use and the Logics of Personal Empowerment in
Health », dans Health Policy, vol. 88, p. 130-140.
Lenhart, Amanda, Kristen Purcell, Aaron Smith et Kathryn Zickuhr. 2010. Social Media & Mobile Internet Use
Among Teens and Young Adults. Pew Internet & Amercian Life Project, 38 p.
Lesko, Nancy. 1996. « Denaturalizing Adolescence: The Politics of Contemporary Representations », dans
Youth & Society, vol. 28, n° 2, p. 139-161.
Levy, Ariel. 2005. Women Chauvinist Pigs: Female and the Rise of Raunch Culture. New York : Free Press,
240 p.
Lévy, Joseph J., Jean Dumas, Bill Ryan et Christine Thoër (dir.). 2011. Minorités sexuelles, Internet et santé.
Québec : Presses de l’Université du Québec, 260 p.
330
Liebenberg, Linda. 2009. « The Visual Image as Discussion Point: Increasing Validity in Boundary Crossing
Research », dans Qualitative Research. Los Angeles : Sage Publications, vol. 9, n° 4, p. 441-467.
Loach, L. 1992. « Bad Girls: Women Who Use Pornography », dans Lynne Segal et Mary MacIntosh, éd., Sex
Exposed: Sexuality and the Pornography Debate, London : Virago, p. 266-274.
LoFrisco, Barbara M. 2011. « Female Sexual Pain Disorders and Cognitive Behavioral Therapy », dans
Journal of Sex Research, vol. 48, n° 6, p. 573-579.
Luftey, Karen E., Carol L. Link, Raymond C. Rosen, Markus Wiegel et John B. McKinlay. 2009. « Prevalence
and Correlates of Sexual Activity and Function in Women: Results from the Boston Area Community
Health (BACH) Survey », dans Archives of Sexual Behavior, vol. 38, p. 514-527.
McClelland, Sara I. et Michelle Fine. 2008. « Writing on Cellophane: Studying Teen Women’s Sexual Desires:
Inventing Methodological Release Points », dans K. Gallagher (éd.), The Methodological Dilemma:
Critical and Creative Approaches to Qualitative Research, London : Routledge, p. 232-260.
MacKinnon, Catherine. 1995. « Vindication and Resistance: A Response to the Carnegie Mellon Study of
Pornography in Cyberspace », dans Georgetown Law Journal, vol. 83, p. 1959-1967.
MacKinnon, Catherine. 1993. Only Words. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 152 p.
Mahmood, Saba. 2005. Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton, NJ :
Princeton University Press, 233 p. [voir aussi version de 2012]
Mallein, P. et Y. Toussaint. 1994. « L’intégration sociale des technologies d’information et de communication :
une sociologie des usages », dans Technologies de l’information et société TIS, vol. 6, n° 4, p. 315-
336.
Mancilla, Alma. « Religion dans l’espace public et régulation politique : le parcours de la notion de laïcité dans
le discours étatique québécois », dans Recherches sociographiques, vol. 52, n° 3, p. 789-810.
Manning, P. 2000 « Credibility, Agency, and the Interaction Order », dans Symbolic Interaction, vol. 23, n° 3,
p. 283-297.
Martin, Karin A. 1996. Puberty, Sexuality and the Self: Girls and Boys and Adolescence. New York :
Routledge, 166 p.
Massit-Folléa, Françoise. 2002. « Usages des Technologies de l’Information et de la Communication : Acquis
et perspectives de la recherche », dans Le Français dans le Monde, numéro spécial de janvier 2002,
10 p.
Masters, William H. et Virginia E. Johnson. 1970. Human Sexual Inadequacy. Boston : Little, Brown & Co.,
467 p.
331
Masters, William H. et Virginia E. Johnson. 1966. Human Sexual Response. Boston : Little, Brown & Co.,
366 p.
Maxwell, Claire et Peter Aggleton. 2011. « Bodies and Agentic Practice in Young Women’s Sexual and
Intimate Relationships », dans Sociology, vol. 46, n° 2, p. 306-321.
Maxwell, Claire et Peter Aggleton. 2010. « Agency in Action – Young Women and Their Sexual Relationships
in a Private School », dans Gender and Education, vol. 22, n° 3, p. 327-343.
Mazzarella, Sharon R. 2005. Girl Wide Web: Girls, the Internet, and the Negotiation of Identity. New York :
Peter Lang, 225 p.
McLuhan, Marshall. 1967. The Medium is the Massage. New York : Random House, 157 p.
McNay, Lois. 1993. Foucault and Feminism: Power, Gender and the Self. Boston : Northeastern University
Press, 224 p.
Mead, G. H. 1959 [1932]. The Philosophy of the Present. La Salle : Open Court Publising, 199 p.
Mead, G. H. 1938. The Philosophy of the Act. Chicago, Il : University of Chicago Press, 696 p.
Meston, Cindy M. et Andrea Bradford. 2007. « Sexual Dysfunctions in Women », dans Annual Review of
Clinical Pyschology, vol. 3, p. 233-256.
Millerand, Florence, Serge Proulx et Julien Rueff (dir.). 2010. Web social : Mutation de la communication.
Québec : Presses de l’Université du Québec, 396 p.
Mitchell, Claudia et Jacqueline Reid-Walsh. 2005. Seven Going on Seventeen. New York : Peter Lang, 359 p.
Morley, David. 1992. Television, Audiences and Cultural Studies. Londres : Routledge, 325 p.
Muehlenhard, Charlene et Zoë D. Peterson. 2005. « Wanting and Not Wanting Sex: The Missing Discourse of
Ambivalence », dans Feminism & Psychology, vol. 15, n°1, p. 15-20.
Mullender, Audrey, Gilles Hague, Umme F. Imam, Liz Kelly, Ellen Malos et Linda Regan. 2002. Children’s
Perspectives on Domestic Violence. London : Sage, 258 p.
Nifle, Roger. 2001. Internet : Élements d’une théorie des usages. Propositions pour l'action. En ligne [juillet
2012]. www.coherences.com.
Nobre, Pedro J. et José Pinto-Gouveia. 2008. « Cognitive and Emotional Predictors of Female Sexual
Dysfunctions: Preliminary Findings », dans Journal of Sex & Marital Therapy, vol. 34, p. 325-342.
332
O’Dougherty Wright, Margaret, Dana L. Norton et Jill Anne Matusek. 2010. « Predicting Verbal Coercion
Following Sexual Refusal During a Hookup: Diverging Gender Patterns », dans Sex Roles, vol. 62,
p. 647-660.
O’Leary et Wolitski. 2009. « Moral Agency and the Sexual Transmission of HIV », dans Psychological Bulletin,
vol. 135, n° 3, p. 478-494.
O’Reilly, Tim. 2004. « What Is Web 2.0 » En ligne [novembre 2012]. http://oreilly.com.
O’Sulliva, Lucia F. et Michelle E. Gaines. 1998. « Decision-Making in College Student’s Heterosexual Dating
Relationships: Ambivalence about Engaging in Sexual Activity », dans Journal of Social and Personal
Relationships, vol. 15, n° 3, p. 347-363.
O’Sullivan, Lucia F., Heino F. L. Meyer-Bahlburg et Ian W. McKeague, 2006. « The Development of the Sexual
Self-Concept Inventory for Early Adolescent Girls », dans Psychology of Women Quarterly, vol. 30,
p. 139-149.
Ollivier, Michèle et Manon Tremblay. 2000. Questionnements féministes et méthodologie de la recherche.
Paris : L’Harmattan, 256 p.
Organisation mondiale de la santé. 2010 [1992]. Manual of the International Statistical Classification of
Diseases, Injuries, and Causes of Death, 10e éd. (ICD-10). Genève : Organisation mondiale de la
santé, 3 vol.
Otis, Melanie D., Sharon S. Rotosky, Ellen D. B. Riggle et Rebecca Hamrin. 2006. « Stress and Relationship
Quality in Same-Sex Couples », dans Journal of Social and Personal Relationships, vol. 23, n° 1,
p. 81-99.
Padgug, Robert. 1979. « Sexual Matters : On Conceptualizing Sexuality in History », dans Richard Parker et
Peter Aggleton, éd., Culture, Society & Sexuality : A reader, 2007 [1999], London : Routledge, 2e
édition, p. 17-30.
Paillé, Pierre et Alex Mucchielli. 2008. L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris : Armand
Collin, 2e édition, 315 p.
Palac, Lisa. 1995. « How Dirty Pictures Changed My Life », dans A. M. Stan, éd., Debating Sexual
Correctness, New York : Dell Publishing, p. 236-252.
Parker, Richard et Peter Aggleton, éd., Culture, Society & Sexuality : A reader, 2007 [1999], 2e édition, 490 p.
Patton, Michael Quinn. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. 2e édition. Newbury Park (Calif.) :
Sage Publications, 532 p.
333
Payette, Lise. 1996. Le chemin de l’égalité. Montréal : Éditions Fides et Québec : Musée de la civilisation,
série « Les grandes conférences », 30 p.
Payne, D. L., K. A. Lonsway et L. F. Fitzgerald. 1999. « Rape Myth Acceptance: Exploration of its Structure
and its Measurement using the Illinois Rape Myth Acceptance Scale », dans Journal of Research in
Personality, vol. 33, n° 1, p. 27-68.
Perret, Véronique et Martine Séville. 2003. « Fondements épistémologiques de la recherche », dans
Raymond-Alain Thiétart, Méthodes de recherche en management, Paris : Dunod, p. 13-33.
Perriault, Jacques, 1998. « Le temps dans la construction des savoirs à l'aide des médias », dans Revue
européenne des sciences sociales, vol. 36, n° 111, p. 109-118.
Perriault, Jacques. 1989. La logique de l’usage, essai sur les machines à communiquer. Paris : Flammarion,
253 p.
Peterson, Zoë D. 2010. « What is Sexual Empowerment? A Multidimensional and Process-Oriented Approach
to Adolescent Girls’ Sexual Empowerment », dans Sex Roles, n° 62, p. 307-313.
Peterson, Zoë D. et Charlene L. Muehlenhard. 2007. « Conceptualizing the "Wantedness" of Women’s
Consensual and Nonconsensual Sexual Experiences: Implications for How Women Label Their
Experiences With Rape », dans Journal of Sex Research, vol. 44, n° 1, p. 72-88.
Peterson, Zoë D. et Charlene L. Muehlenhard. 2000. Rape Myth Acceptance and Situational Characteristics
as Predictors of Rape Acknowledgment. [données brutes non publiées; voir Peterson et
Muehlenhard : 2007].
Pew Research Center's Internet & American Life Project. 2011. 2011 Teen/Parent Survey. En ligne [mai
2012]. www.pewinternet.org/Static-Pages/Trend-Data-(Teens)/Online-Activites-Total.aspx.
Pheterson, Gail. 2001 [1996]. Le prisme de la prostitution. Paris : L’Harmattan, 211 p.
Phillips, Lynn M. 2000. Flirting with Danger: Young Women’s Reflections on Sexuality and Domination. New
York : New York University Press, 253 p.
Pike, Kenneth Lee. 1967 [1954]. Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior.
The Hague : Mouton, 762 p.
Pitcher, Karen C. 2006. « The Staging of Agency in Girls Gone Wild », dans Critical Studies in Media
Communication, vol. 23, n° 3, p. 200-218.
Plante, Judith. 2004. « Le public féminin, victime des médias? Le cas des consommatrices de films
pornographiques », dans Médiation et Information (MEI), vol. 20, « Sexe & Communication », p. 117-
126.
334
Pleck, Joseph H. 1981. The Myth of Masculinity. Cambridge : MIT, 229 p.
Plummer, Kenneth. 1995. Telling Sexual Stories: Power, Change, and Social Worlds. London : Routledge,
244 p.
Proulx, Serge. 2006. « Penser les usages des technologies de l’information et de la communication
aujourd’hui : enjeux – modèles – tendances », dans Lise Vieira et Nathalie Pinède, éd., Enjeux et
usages des TIC : Aspects sociaux et culturels, tome 1, Bordeaux : Presses universitaires de
Bordeaux, p. 7-20.
Proulx, Serge. 2004. La Révolution Internet en question. Montréal : Québec Amérique, 143 p.
Proulx, Serge. 1994. « Une lecture de l’œuvre de Michel de Certeau : l’invention du quotidien, paradigme de
l’activité des usagers », dans Communication, vol. 15, n° 2, p. 171-197.
Radway, Janice. 1984. Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. Chapel Hill et
London : The University of North Carolina Press, 274 p.
Reavey, Paula et Steven D. Brown. 2009. « The Mediating Role of Objects in Recollections of Adult Women
Survivors of Child Sexual Abuse », dans Culture & Psychology, vol. 15, n° 4, p. 463-484.
Reissing, Elke D., Yitzchak M. Binik et Samir Khalifé. 1999. « Does Vaginismus Exist?: A Critical Review of the
Literature », dans The Journal of Nervous & Mental Disease, vol. 187, n° 5, p. 261-274.
Reissing, Elke D., Yitzchak M. Binik, Samir Khalifé, Deborah Cohen et Rhonda Amsel. 2004. « Vaginal
Spasm, Pain, and Behavior: An Empirical Investigation of the Diagnosis of Vaginismus », dans
Archives of Sexual Behavior, vol. 33, n° 1, p. 5-17.
Renold, Emma et Jessica Ringrose. 2011. « Schizoid Subjectivities? Re-Theorizing Teen Girls’ Sexual
Cultures in an Era of "Sexualization" », dans Journal of Sociology, vol. 47, n° 4, p. 389-409.
Richardson, Rhonda A. 2004. « Early Adolescence Talking Points: Questions that Middle School Students
Want to Ask Their Parents », dans Family Relations, vol. 53, p. 87-94.
Riger, Stephanie. 1993. « What’s Wrong With Empowerment », dans American Journal of Community
Psychology, vol. 21, n° 3, p. 279-292.
Rouquette, Sébastien. 2008. « Le Web des internautes. Trois relectures sociologiques des études d’usages du
Web », dans Communication, vol. 26, n° 2, 23 p.
Rubin, Gayle. 2010. Surveiller et jouir : Anthropologie politique du sexe. Paris : Epel, 485 p.
335
Russell, Stephen T. 2005. « Conceptualizing Positive Adolesccent Sexuality Development », dans Sexuality
Research and Social Policy: Journal of NSRC, vol. 2, n° 3, p. 4-12.
Sauntson, Helen et Sakis Kyratzis. 2007. Language, Sexualities and Desires : Cross-Cultural Perspetives.
Hampshire : Palgrave Macmillan, 248 p.
Scott, Joan. 1988. « Deconstucting Equality – Versus – Difference: Or, the Uses of Poststructuralist Theory for
Feminism », dans Feminist Studies, vol. 14, n° 1, p. 33-51.
Slavin, Jonathan H., Jody Messler Davies, Noelle Oxenhandler, Stephen Seligman etRuth Stein. 2006.
« Roundtable Discussion on Sexuality in Development and Treatment II: Clinical Application », dans
Studies in Gender and Sexuality, vol. 7, n° 3, p. 259-289.
Shanahan, M. J. et Glen H. Elder Jr. 2002. « History, Agency, and the Life Course », dans R. A. Dienstbier et
L. J. Crockett, éd., Agency, Motivation, and the Life Course, vol. 48, Lincoln : University of Nebraska,
p. 145-186.
Shaughnessy, Krystelle, E. Sandra Byers et Lindsay Walsh. 2011. « Online Sexual Activity Experience of
Heterosexual Students: Gender Similarities and Differences », dans Archives of Sexual Behavior,
vol. 40, p. 419-427.
Shaw, S. M. 1999. « Men’s Leisure and Women’s Lives: The Impact of Pornography on Women », dans
Leisure Studies, vol. 18, p. 197-212.
Simon, William et John H. Gagnon. 2003. « Sexual Scripts: Origins, Influences and Changes », dans
Qualitative Sociology, vol. 26, n° 4, p. 491-497.
Simon, William et John H. Gagnon. 1998. « Sexual Scripts », dans Aggleton, Peter et Richard Parker, éd.,
Culture, Society & Sexuality, London : UCL Press, p. 29-38.
Simonnot, Brigitte. 2008. « Moteurs de recherche. Usages et Enjeux », dans Questions de communication,
vol. 14, p. 7-17.
Smette, Ingrid, Kari Stefansen et Svein Mossige. 2009. « Responsible Victims? Young People’s
Understandings of Agency and Responsability in Sexual Situations Involving Underage Girls », dans
Young : Nordic Journal of Youth Research, Los Angeles, London, New Dlhi, Singapore et
Washington, DC : Sage Publications, vol. 17, n° 4, p. 351-373.
Smith, Clarissa. 2007. One for the Girls! The Pleasures and Practices of Reading Women’s Porn. Chicago :
The University of Chicago Press, 263 p.
Smith, Meghan, Emily Gertz, Sarah Alvarez et Peter Lurie. 2000. « The Content and Accessibility of Sex
Education Information on the Internet », dans Health Education & Behavior, vol. 27, n° 6, p. 684-694.
336
Smith, Raymond. A. 2010. The Politics of Sexuality: A Documentary and Reference Guide. Santa Barbara,
Denver et Oxford : Greenwood, 292 p.
Snee, Helene. 2008. Web 2.0 as a Social Science Research Tool, Social Sciences Collections and Research,
ESRC Government Placement Scheme, The British Library, novembre, 34 p.
Spencer, Grace, Claire Maxwell, et Peter Aggleton. 2008. « What Does "Empowerment" Mean in School-
Based Sex and Relationship Education? », dans Sex Education, vol. 8, n° 3, p. 345-356.
Spink, Amanda, H. Cenk Ozmutlu et Daniel P. Lorence. 2004. « Web Searching for Sexual Information: An
Exploratory Study », dans Information Processing and Management, vol. 40, p. 113-123.
Stern, Susannah R. 1999. « Adolescent Girls’ Expression on Web Home Pages: Spirited, Sombre, and Self-
Conscious Sites », dans Convergence : The Journal of Research into New Media Technologies,
vol. 5, n° 4, p. 47-52.
Storer, Horatio R. 1968. « The Law of Rape », dans The Quarterly Journal of Psychological Medicine and
Medical Jurisprudence, New York : D. Appleton and Co., vol. ii, p. 47-67.
Suzuki, Lalita K. et Jerel P. Calzo. 2004. « The Search for Peer Advice in Cyberspace: An Examination of
Online Teen Bulletin Boards about Health and Sexuality », dans Applied Developmental Psychology,
vol. 25, p. 685-698.
Symposium-débat. 2010. « L’hypersexualisation chez les jeunes filles mène-t-elle à des pratiques sexuelles
à risque? » Conférence, Québec, Université Laval, Chaire d’étude Claire-Bonenfant et Centre de
recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF), 11
mars. Avec les conférencières Linda Bérubé, Francine Lavoie et Hélène Manseau.
Teitelman, Anne, Sarah Radcliffe et Mercedes Morales-Aleman. 2008. « Sexual Relationship Power, Intimate
Partner Violence, and Condom Use Among Minority Urban Girls », dans Journal of Interpersonal
Violence, vol. 23, n° 12, p. 1694-1712.
Tiefer, Leonore. 2012. « Medicalizations and Demedicalizations of Sexuality Therapies », dans Journal of Sex
Research, vol. 49, n° 4, p. 311-318.
Tiefer, Leonore. 2010a. « Activism on the Medicalization of Sex and Female Genital Cosmetic Surgery by the
New View Campaign in the United States », dans Reproductive Health Matters, vol. 18, n° 35, p. 56-
63.
Tiefer, Leonore. 2010b. « Beyond the Medical Model of Women’s Sexual Problems: A Campaign to Resist the
Promotion of "Female Sexual Dysfunction" », dans Sexual and Relationship Therapy, vol. 25, n° 2,
p. 197-205.
337
Tiefer, Leonore. 2006. « Female Sexual Dysfunction: A Case Study of Disease Mongering and Activist
Resistance », dans PloS Medicine, vol. 3, n° 4, p. 0436-0440.
Tiefer, Leonore. 2005. « Dyspareunia Is the Only Valid Sexual Dysfunction and Certainly the Only Important
One », dans Archives of Sexual Behavior, vol. 34, n° 1, section spéciale « Peer Commentaries on
Binik (2005) », p. 49-51.
Tiefer, Leonore. 2002. « Arriving at a "New View" of Women’s Sexual Problems », dans Women & Therapy,
vol. 24, n° 1-2, p. 63-98.
Tiefer, Leonore. 2001a. « The "Consensus" Conference on Female Sexual Dysfunctions: Conflicts of Interest
and Hidden Agendas », dans Journal of Sex & Marital Therapy, vol. 27, p. 227-236.
Tiefer, Leonore. 2001b. « The Selling of "Female Sexual Dysfunction" », dans Journal of Sex & Marital
Therapy, vol. 27, p. 625-628.
Tiefer, Leonore. 2000. « The Medicalization of Women’s Sexuality », dans The American Journal of Nursing,
vol. 100, n° 12, p. 11.
Thompson, Sharon. 1990. « Putting a Big Thing into a Little Hole: Teenage Girl’s Accounts of Sexual
Initiation », dans The Journal of Sex Research, vol. 27, n° 3, p. 341-361.
Tolman, Deborah L. 2002. Dilemmas of Desire: Teenage Girls Talk About Sexuality. Cambridge, MA : Harvard
University Press, 247 p.
Tolman, Deborah L. 2001. « Female Adolescent Sexuality: An Argument for a Developmental Perspective on
the New View of Women’s Sexual Problems », dans Women and Therapy, vol. 24, n° 1/2, p. 195-209
et dans Ellyn Kaschak et Leonore Tiefer (éd.), A New View of Women’s Sexual Problems, The
Haworth Press Inc., p. 195-209.
Tolman, Deborah L. 1999. « Asking some unasked questions ». En ligne [novembre 2012].
www.wcwonline.org.
Tolman, Deborah L. 1994. « Doing Desire : Adolescent Girls’ Struggles for/with Sexuality », dans Gender and
Society, vol. 8, n° 3, p. 324-342.
Tolman, Deborah L., Celeste Hirschman et Emily A. Impett. 2005. « There Is More to the Story: The Place of
Qualitative Research on Female Adolescent Sexuality in Policy Making », dans Sexuality Research
& Social Policy, vol. 2, n° 4, p. 4-17.
Tolman, Deborah L. et Laura A. Szalacha. 1999. « Dimensions of Desire: Bridging Qualitative and Quantitative
Methods in a Study of Female Adolescent Sexuality », dans Psychology of Women Quaterly, vol. 23,
p. 7-39.
338
Toms, E. G. et W. Duff. 2002. « "I Spent 1½ hours Sifting through One Large Box…": Diaries as Information
Behaviour of the Archives User: Lessons Learned », dans Journal of the American Society for
Information Science and Technology, vol. 53, n° 4, p. 1232–1238.
Travers, Max. 2009. « New Methods, Old Problems: A Skeptical View of innovation in Qualitative Research »,
dans Qualitative Research, vol. 9, n° 2, p. 161-179.
Vance, Carole. 1992. « Negotiating Sex and Gender in the Attorney General’s Commission on Pornography »,
dans Lynne Segal et Mary McIntosh, éd., Sex Exposed: Sexuality and the Pornography Debate,
London : Virago, p. 29-49.
Vance, Carole. 1992b (1982). Pleasure and Danger: Exploring Women’s Sexuality. London : Pandora Press,
462 p.
Vanwesenbeeck, Ine. 2009. « The Risks and Rights of Sexualization: An Appreciative Commentary on Lerum
and Dworkin’s "Bad Girls Rule" », dans Journal of Sex Research, vol. 46, p. 268-270.
Verbrugge, Lois M. 1980. « Health Diaries », dans Medical Care, vol. 18, n° 1, p. 73–95.
Vidal, Jérôme. 2006. « Judith Butler en France : trouble dans la réception », dans Mouvements, n° 47-48, mai-
juin. En ligne [novembre 2011]. http://jeromevidal.blogspot.com.
Wakefield, Jerome C. 2012. « The DSM-5’s Proposed New Categories of Sexual Disorder: The Problem of
False Positives in Sexual Diagnosis », dans Clinical Social Work Journal, vol. 40, p. 213-223.
Walker, J. 2005. « Weblog », dans Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Routledge. En ligne
[novembre 2012]. http://jilltxt.net/archives/blog_theorising/
final_version_of_weblog_definition.html.
Walkerdine, Valerie. 1990. Schoolgirl Fictions. London : Verso, 216 p.
Ward, Elaine et Jane Ogden. 2010a. « Commentary on Experiencing Vaginismus: Sufferers’ Beliefs about
Causes and Effects », dans Sexual and Relationship Therapy, vol. 25, n° 4, p. 429-433.
Ward, Elaine et Jane Ogden. 2010b [1994]. « Experiencing Vaginismus – Sufferers’ Beliefs about Causes and
Effects », dans Sexual and Relationship Therapy, vol. 25, n° 4, p. 434-446.
Weinberg, Martin S., Colin J. Williams, Sibyl Kleiner et Yasmiyn Irizarry. 2010. « Pornography, Normalization,
and Empowerment », dans Archives of Sexual Behavior, vol. 39, p. 1389-1401.
Weissberg, Jean-Louis. 2001. « Fluidification-réception-production : auteur et amateur », dans Éric Guichard
(dir.), Comprendre les usages d’Internet, p. 73-81.
339
Wiederman, Michael W. 2000. « Women’s Body Image Self-Consciousness During Physical Intimacy With a
Partner », dans The Journal of Sex Research, vol. 37, n° 1, p. 60-68.
Wiles, Rose, Graham Crow et Helen Pain. 2011. « Innovation in Qualitative Research Methods: A Narrative
Review », dans Qualitative Research, vol. 11, n° 5, p. 587-604.
Williams, Linda. 1989. Hard Core: Power, Pleasure, and the "Frenzy of the Visible". Berkeley : University of
California Press, 330 p.
Yang, Shih-Hsien. 2009. « Using Blogs to Enhance Critical Reflection and Community of Practice », dans
Educational Technology & Society, vol. 12, n° 2, p. 11-21.
Yoder, Janice D. et Arnold S. Kahn. 1992. « Toward a Feminist Understanding of Women and Power », dans
Psychology of Women Quartely, vol. 16, n° 4, p. 381-388.
Zukic, Naida. 2008. « Webbing Sexual/Textual Agency in Autobiographical Narratives of Pleasure », dans Text
and Performance Quarterly, vol. 28, n° 4, octobre, p. 396-414.
Annexe 1 : Codes utilisés pour l’analyse
Activités sexuelles
a utilisé ecstasy
intérêt très jeune pour la sexualité
historique sexuel
homosexuelle
vierge
virginité = tabou
Agentivité corporelle
bonne
pas bien dans sa peau
pourrait s'améliorer
s'est améliorée
Agentivité personnelle
amélioration
agentivité personnelle forte
agentivité personnelle forte en apparence mais timide à l’intérieur
influence parentale importante
Agentivité sexuelle
à l'aise d'en parler
à l'aise d'en parler - moyennement
a moins de désir que chum
aimerait en avoir plus
amélioration - nouveau chum
amélioration - nouvelle blonde
amélioration - temps
amélioration expérience
avant
aurait aimé en avoir plus
chum gênant
chum insistant
chum player
complexée
confiance faible
contrôle élevé
contrôle faible
décide de dire non parce que pense aux conséquences
dit oui sous pression
gênée
honteuse d'avoir des désirs
influence parentale négative
inhibée
initiation égale
342
initiation élevée
initiation faible
joue une game de séduction
ne savait pas désir
ne voulait pas s'avouer homosexuelle
n'en parlait au chum ou à la blonde
n'en parlait pas au chum – pour ne pas faire de peine
parle de sexualité avec chum ou blonde
pas à l'aise
pas à l'aise d'en parler
pense à lui avant elle
plaire à son chum
plaisir faible
point de non retour
se comparait à la norme
se sentait anormale
se sentait incompétente
sentiment ambigu envers sexualité
bonne compréhension de la situation
c’est ma sexualité pas celle de mes parents
capacité contrôle dépend partenaire
capacité désir dépend chum
capacité d'être à l'aise dépend partenaire
capacité d'initier dépend chum
capacité exprimer désirs dépend chum
chum bizarre ou player
chum écoute et comprend
chum insistant
chum pas eu de blonde = rassurant
complexée
confiance - souhaite améliorer
confiance dépend apparence
confiance dépend comportement chum
confiance dépend expérience à elle
confiance dépend expérience à lui
connaît ses limites
contrôle faible
déçue
échelle de l'initiation - égal
échelle de l'initiation - plus basse que chum
échelle de l'initiation - plus élevée que chum
échelle du contrôle - égal
échelle du contrôle - plus bas que chum
échelle du contrôle - plus haut que chum
343
échelle du plaisir - égal
est satisfaite mais souhaite améliorer
fait confiance au chum
finit par dire oui mais ok
frustrée sur occasion
futur imaginé - meilleure agentivité
futur imaginé - pouvoir faible
garde des choses pour elle - positif
initiation élevée
initiation faible
initiation faible - ne désire pas plus
maintenant
aimerait avoir plus de pouvoir
bonne confiance
bonne estime de soi
chum gênant
confiance en soi faible
connaît désir
contrôle élevé
contrôle faible
en parle au chum ou à la blonde
estime qu'elle aura plus de contrôle
heureuse
initiation bonne
initiation faible
moins complexée
ne dérange pas de ne pas en avoir beaucoup
ne se compare plus à la norme
n'en parle pas au chum ou à la blonde
panne de désir
plaisir élevé
plus à l'aise
plus à l'aise d'en parler
porte responsabilité sur le chum
pouvoir faible à zéro
sait parler au chum ou à la blonde
satisfaite de sa vie sexuelle
se dit dépendante affective
se laisse aller
serait capable avoir pouvoir mais ne le fait pas
n'aurait rien changé
ne sait pas dire non
ne sait pas pourquoi elle l'a fait
ne se sent pas coupable ou honteuse
344
ne souhaite pas en avoir plus
n'en parle pas au chum ou à la blonde
n'en parle pas pour ne pas faire peine au chum
orientation - questionnements
ouverte à de nouvelles expériences
pas à l'aise
pas capable de parler au chum
pas de questions sur orientation
pas l'impression d'être hypersexualisée
pense à elle avant lui
pense à lui avant elle
plaisir faible
pouvoir dépend expérience à elle
pouvoir dépend expérience du chum
pouvoir dépend personnalité de la blonde
pouvoir dépend personnalité du chum
première fois
déçue
n'était pas prête
pas d'attirance physique
ressentait pression sociale
ressentait pression sociale mais a résisté
sait reconnaître qu’elle n’est pas prête
se sentait prête
se sentait prête mais faux
se sentirait prête
prend en charge sa sexualité
prend sa revanche
prête à essayer de nouvelles choses
prévoyante
regret dépend du gars
regrette un peu
rôle de régulation
sait ce qu'elle veut
sait demander ce qu'elle veut
sait demander condom
sait dire non
sait dire non mais pourrait dire oui sous pression
sait parler à son chum ou à sa blonde
sait parler chum - tourne en engueulade
satisfaite de sa vie sexuelle
se compare aux autres
se demande si elle doit toujours dire oui
se dit naïve
345
se sent coupable ou déçue
se sent plus à l'aise quand pas de relation
se sent responsable des problèmes du chum
serait prête à laisser le contrôle au chum
sexualité = bof
sexualité = sérieux ou important ou aime ça
situation du couple - crée insécurité
situation du couple - s'en fout
situation du couple = important
trouve l'autre plus important
un peu peur de la sexualité
veut attention et séduire
Blogue (méthode)
blogue a aidé
pour aller plus s'informer
pour constater évolution
pour se sentir moins honteuse
blogue ou entrevue
s’est censurée
ne s'est pas censurée
appréciation
Choix qu’elle aurait fait pour le blogue
ouvert
semi-ouvert
commentaires
pas de commentaires
plus d'interventions
oui
non
privé
si ouvert ne serait censurée
oui
non
peut-être au début mais pas après
fun
gênant
impression d’être un devoir
oui
non
limite blocage
n'a pas fait réaliser rien
n'en fera pas plus tard
pourrait en faire plus tard
Blogues en général
346
avantages
consulte des blogues
limites
n'en consulte pas ou peu
Citation importante
Cours FPS
utile
pas très utile
Éducation parentale
parents non répressifs
parents peu ouverts
parents ouverts
parents un peu répressifs
Forums
à prendre avec grain de sel
consultés ou utiles
forums de gars
Ne connaît pas mais intéressée
forums de médecins
Ne connaît pas mais intéressée
limites
nuisible
pas consultés
pour la curiosité
Images
à titre juste illustratif
ont fait réfléchir sur la sensualité
Internet
applique les trucs
avant
gênée d'y aller
ne cherchait pas
pas gênée d'y aller
questions anatomiques
s’en servait comme guide
évolution dans les questions
GARS – ce qu’elles pensent de leurs préoccupations ou recherches
gênée d'y aller
influence
limites
maintenant - pas gênée d'y aller
maintenant - questions plus complexes
ne vérifie pas les sources
n'osait pas y aller plus jeune
347
n'utilise pas pour améliorer agentivité
n'y va pas souvent
n'y va pas de façon compulsive
pas très utile
pas utile pour prise de position sujet controversé
pas utile pour sujet psychologique
s'amuse en apprenant
sujet
1re fois - curiosité
1re fois - non
1re fois - stressée
accouchement - curiosité
accouchement - inquiétude
acronymes sexuels ou dictionnaire en général
agentivité sexuelle
amour - curieuse
anorgasmie - inquiétude
art érotique - curiosité
art érotique - dégoûtée
avortement - inquiétude pour amie
avortement - intérêt simple
cancer du sein ou autoexamen - inquiétude
caudalisme - curiosité
ce que les hommes aiment ou pensent - curiosité
choc toxique ou tampons - inquiétude
circoncision - curiosité
comment embrasser
comment séduire - apprendre
communication concernant la sexualité - curiosité
condom - curiosité
contraception - indifférence
contraception - inquiétude
contraception - intérêt ou curiosité
crainte de grossesse - anxiété
cybersexe - amusant mais épeurant
cybersexe - curiosité
cybersexe - dégoûtée
cybersexe - épeurant
cybersexe - étonnée
cybersexe - excitée
désir sexuel - honteuse
déviances sexuelles - anxiété
déviances sexuelles - curiosité
déviances sexuelles - dégoûtée
348
différences hommes-femmes
douleur - honte
durée d'une relation sexuelle
dysfonctions érectiles - curiosité
dysfonctions érectiles - inquiétude
échangisme - curiosité
ecstasy - curiosité
ecstasy - déçue
éjaculation lente - inquiétude
éjaculation précoce - complexée
éjaculation précoce - dégoûtée
éjaculation précoce - inquiétude
éjaculation précoce - motivée à résoudre problème
érection - curiosité
érotisme ou art sexy - plaisir
examen gynécologique - inquiétude
excision - curiosité
excision - dégoûtée
fellation - apprendre
fellation - curiosité
fellation - dégoûtée
fellation - enthousiaste
fellation - inquiétude
femme fontaine - curiosité
fétiches - curiosité
forme de l'utérus - inquiétude
frigidité - curiosité
grossesse - curiosité - positif
grossesse hâtive - tristesse empathie
grosseur des seins
grosseur des seins - honte
histoire de la sexualité - curiosité
histoires érotiques - apprendre
histoires érotiques - plaisir
histoires érotiques de mangas
humour - amusée
hypersexualisation - choquée
hypersexualisation - curiosité
implants mammaires - curiosité
infections urinaires - inquiétude
infertilité - inquiétude
jouets sexuels - curiosité
masturbation - curiosité
masturbation - honte de ne pas connaître ou faire
349
menstruations - curiosité
menstruations - inquiétude
ITSS - curiosité
ITSS - dégoûtée
ITSS - inquiétude
NE VA PAS VOIR ITSS ou très peu
orgasme - curiosité
orgasme - inquiétude
orientation sexuelle - intérêt simple
orientation sexuelle - interrogations
panne de désir - curiosité
panne de désir - inquiétude
pénétration anale - curiosité
pénis ou grosseur du pénis - curiosité
pH vaginal - inquiétude
physique - complexée
pilosité - curiosité
pilosité - inquiétude
pilule du lendemain - curiosité
point G - curiosité
porno de type manga
pornographie - apprendre
pornographie - curiosité
pornographie - déçue
pornographie - dégoûtée
pornographie - étonnée
pornographie - excitée
pornographie - honte
pornographie - intérêt simple
positions sexuelles - curiosité
positions sexuelles - piquant
pratiques sexuelles hors normes - curiosité
pratiques sexuelles hors normes - dégoûtée
pratiques sexuelles ou norme - curiosité
pratiques sexuelles ou norme - honteuse
préliminaire - honte
pub sexuelle - appréciation
pub sociale sur le condom - appréciation
quiz - indignée
quiz - pour s'amuser
relations amoureuses
rupture du frein - inquiétude
saignements après relation
secrétions vaginales - anxiété
350
secrétions vaginales - curiosité
seins - curiosité
sensualité
sexe et alcool
sexe oral - curiosité
sites de rencontre
sperme - dégoûtée
trucs pour mettre piquant
vagin ou vulve - curiosité
vagin ou vulve - inquiétude
vaginisme - inquiétude
vaginisme - intérêt simple
vaginite - curiosité
vaginite - inquiétude
vasectomie - curiosité
vidéo explicative
vidéoclips sexy - excitée
vidéoclips sexy - indignée
virginité - inquiétude
VPH - inquiétude
très utile
très utile – pour les tabous
utile pour plus tard
vérifie les sources
y allait plus souvent plus jeune
y allait pour le fun
y va de façon compulsive
y va par curiosité
y va pour info
y va pour se rassurer
y va souvent
y va souvent - parce que chum
Internet a aidé
arguments - contre porno
complexes - physique
connaissances - 1re fois
connaissances - cancer du sein ou autoexamen
connaissances - ce que les hommes aiment ou pensent
connaissances - comment embrasser
connaissances - condom
connaissances - contraception
connaissances - crainte de grossesse
connaissances - douleur
connaissances - ecstasy
351
connaissances - examen gynécologique
connaissances - fellation
connaissances - histoire de la sexualité
connaissances - hypersexualisation
connaissances - infections urinaires
connaissances - masturbation
connaissances - ITSS
connaissances - orgasme
connaissances - orientation sexuelle
connaissances - par le biais de la pornographie - ce qu'est une MILF
connaissances - par le biais de la pornographie - comment faire
connaissances - par le biais de sites de rencontres ou cybersexe
connaissances - par le biais de vidéos explicatives
connaissances - positions
connaissances - pratiques sexuelles hors normes
connaissances - préliminaires
connaissances - relations amoureuses
connaissances - rupture du frein
connaissances - secrétions vaginales
connaissances - trucs pour mettre piquant
connaissances - vagin
connaissances - vaginisme
connaissances - vaginite
curiosité - pénis
curiosité - sexe oral
fascination - positions
fun - se sentir normale
honte - douleurs
honte - grosseur des seins
inquiétude - 1re fois
inquiétude - avortement
inquiétude - cancer du sein ou autoexamen
inquiétude - comment embrasser
inquiétude - contraception
inquiétude - crainte de grossesse
inquiétude - éjaculation lente
inquiétude - examen gynécologique
inquiétude - infections urinaires
inquiétude - menstruations
inquiétude - ITSS
inquiétude - pilule du lendemain
inquiétude - secrétions vaginales
inquiétude - vagin ou vulve
inquiétude - vaginisme
352
inquiétude - vaginite
inquiétude - virginité
intérêt - contraception
interrogations - orientation sexuelle
plaisir - cybersexe
plaisir - pornographie
se procurer jouets sexuels
Internet n'a pas aidé
arguments contre avortement
compréhension - homosexualité
connaissances - 1re fois
connaissances - ce que les hommes pensent
connaissances - choc toxique ou tampons
connaissances - circoncision
connaissances - comment séduire
connaissances - douleur
connaissances - durée d'une relation sexuelle
connaissances - fellation
connaissances - forme de l'utérus
connaissances - infertilité
connaissances - jouets sexuels
connaissances - masturbation
connaissances - menstruations
connaissances - ITSS
connaissances - par biais quiz
connaissances - par le biais de dictionnaires web
connaissances - par le biais de la pornographie
connaissances - pénis
connaissances - point G
connaissances - positions sexuelles
connaissances - pratiques homosexuelles
connaissances - pratiques sexuelles ou norme
connaissances - sexe et alcool
connaissances - trucs pour mettre piquant
connaissances - vaginisme
crainte de grossesse
honte - anorgasmie
honte - masturbation
honte - préliminaires
inquiétude - 1re fois
inquiétude - anorgasmie
inquiétude - contraception
inquiétude - dysfonctions érectiles
inquiétude - menstruations
353
inquiétude - ITSS
inquiétude - vaginisme
plaisir - histoires érotiques
sites de rencontres ou chat – déçue
sites de rencontres ou chat – dégoûtée
MSN
va sur MSN
va sur un site de revue semblable
Orientation sexuelle
hétérosexuelle
homosexuelle
homosexuelle – parents le savent
Pornographie
contre
lorsque chum y va - se sent mal
ok pour chum
pas d’intérêt
pour
pour mais ça dépend
y va pour apprendre
y va pour le fun
Quiz
va faire des quiz pour s’amuser
Si Internet n’avait pas existé
aurait eu moins de connaissances – donc Internet utile pour connaissances
aurait fallu qu’elle se dégêne
aurait fallu trouver info ailleurs
aurait rien changé - mais Internet pratique
Internet donne confiance
Internet donne contrôle
Internet mine la confiance en soi
Internet rend anxieuse
Internet rend déçue (trop d’attentes)
Sites gouvernementaux
avantages
limites
utilisés
pas utilisés
Sources
Source préférée
amis
Internet
livres
livres - mais utilise plus Internet
354
magazine
médecin
mère
parents
pour le physique - Internet
pour le psychologique - mère
pour le psychologique - parents
Source – 2e place
amis
Internet
livres
magazines
médecins
Source 3e et 4e places
amis
cours et profs
infirmières
livres
médecins
mère
père
sœur
Source non utilisée
amis
chum
cours et profs
famille élargie
livres
médecins
parents
père
Source peu utilisée
Internet
Source utilisée (par déduction; hors classement)
amies
amis - limites
avant - livres
chum
cours et profs
famille élargie
histoires érotiques - magazines et livres
infirmière
355
Internet - surtout pour divertissement
livres
magazines
magazines porno
médecins
mère - grossesse
mère - physique
mère - psychologique
parents
père
pharmacienne
sœur
télévision
confusion fiabilité vs utilisation
Vaginisme
craint de faire du vaginisme
considéré tabou
fait du vaginisme
fait du vaginisme mais capable d’en parler - pas tabou
n’a pas fait de vaginisme mais a eu mal























































































































































































































































































































































































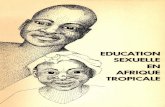



![Santaemilia, José (2009) “La vie sexuelle de Catherine M.: A journey through ‘woman’, ‘sexual language’ and ‘translation’”. Sendebar 20 (2009): 123-141. [ISSN 1130-5509]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321885bb257cd26d003f417/santaemilia-jose-2009-la-vie-sexuelle-de-catherine-m-a-journey-through.jpg)








