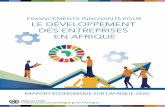education sexuelle en afrique tropicale
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of education sexuelle en afrique tropicale
CDU 613.88 (6)
Centre de Recherches pour le Développement International
Siège social: Case Postale 8500, Ottawa, K l G 3H9
Édition microfiche: $1
EDUCATION SEXUELLE EN AFRIQUE TROPICALE
Compte-rendu d'un séminaire interafricain tenu à Bamako du 16 au 25 avril 1973 sous les auspices du Ministère de !'Education nationale de la République du Mali en collaboration avec le Service Quaker (American Friends Service Committee).
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE
CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
OTTAWA, CANADA 1973
NOTE DE L'itDITEUR
C'est à la demande des participants au Premier Séminaire Interafricain sur }'Éducation Sexuelle que Je Centre de Recherches pour Je Développement International a publié ce recueil des communications présentées à Bamako en Avril 1973.
Les opinions exprimées lors de ce séminaire sont variées, et elles sont présentées ici dans leur intégrité. Si des modifications ont été faites dans certains textes, c'est dans Je but d'adapter une présentation orale, parfois enregistrée lors du séminaire, à la présentation écrite. Le CROI a pris soin en ce faisant de ne modifier ni Je sens, ni l'opinion des auteurs.
Le CROI, corporation publique créée par Je Parlement canadien et dirigé par un conseil de gouverneurs de divers pays, a pour but d'entreprendre, d'encourager, de soutenir et de poursuivre des recherches sur les problèmes des régions du monde en voie de développement et sur les moyens d'application et d'adaption des connaissances scientifiques, techniques et autres au progrès économique et social de ces régions.
Nous espérons qu'une large diffusion des opinions échangées lors du séminaire sera utile à tous ceux qui sont concernée par Je problème. Nous remercions les participants qui nous ont communiqué leurs textes.
Centre de Recherches pour le Développement International, B.P. 8500, Ottawa, Canada, KJG 3H9.
table des matières
INTRODUCTION 5
LE PROBLÈME EN AFRIQUE TROPICALE lO
MISE EN GARDE D'UN MÈDECIN AFRICAIN 15
POURQUOI UNE ÈDUCATION SEXUELLE 17
RÉFLEXIONS SUR LE PROBLÈME AU CONGO 20
SEXUALITÉ ET FÉCONDITÉ DANS LA VALLÉE DE L'OUÉMÉ 27
LA FEMME WEMENOU 52
«PLANNING» TRADITIONNEL AU MALI 54
LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L'ENFANT 61
UN POINT DE VUE MUSULMAN SUR L'ÉDUCATION SEXUELLE 70
UN POINT DE VUE CATHOLIQUE SUR L'ÉDUCATION SEXUELLE 75
UN POINT DE VUE PROTESTANT SUR L'ÉDUCATION SEXUELLE 80
POINT DE VUE D'UN ÉDUCATEUR AFRICAIN SUR L'ÉDUCATION SEXUELLE 86
ÉDUCATION SEXUELLE ET ÉMANCIPATION DE LA FEMME 91
NOTIONS D'ÉDUCATION SEXUELLE 98
L'ÉDUCATEUR DE LA SEXUALITÉ 103
L'ENFANT, «SUJET'' DE L'ÉDUCATION SEXUELLE 108
RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉMINAIRE 114
CONCLUSIONS ET DISCOURS DE CLÔTURE 116
BIBLIOGRAPHIE 119
LISTE DES PARTICIPANTS 122
introduction Pierre Pradervand Sociologue, délégué du Service Quaker en Afrique de l'ouest, Dakar
Lorsqu'en automne 1971 le Service Quaker ouvrit un bureau à Dakar, nous fûmes loin d'imaginer l'intérêt que nous rencontrerions pour les problèmes d'éducation sexuelle. L'opinion émise même par certains «spécialistes» était que c'était là une question tabou en Afrique qu'il serait imprudent ou malaisé d'aborder.
C'était fort mal connaître et l'ouverture d'esprit des éducateurs de la région, et l'acuité des problèmes qui se posaient au niveau du comportement sexuel des jeunes. Jusqu'à récemment en effet la société traditionnelle offrait aux populations des normes en matière de comportement sexuel qui étaient assez universellement sui vies en Afrique tropicale, et qui ont peut-être permis à cette région d'atteindre, au cours des siècles, au niveau de la sexualité, un équilibre que l'Europe ne connaît pas. Mais plus récemment, et surtout en milieu urbain depuis l'indépendance, il y a eu un brusque effondrement des moeurs traditionnelles, sous l'influence combinée d'une urbanisation accélérée, de l'impact - dans ce domaine nocif - des mass media occidentaux, de l'imitation des comportements occidentaux par des jeunes qui veulent paraître «à la page», de besoins économiques, etc. La causalité exacte du phénomène est complexe et varie sans doute d'un pays à l'autre.
li s'en est suivi une certaine« liberté» sexuelle qui a créé beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résolvait, en premier lieu chez les jeunes euxmêmes, dont elle traduit plus le désarroi que la liberté. Ceci explique donc l'initiative du Service Quaker, organisme bénévole s'occupant en Afrique de l'Ouest d'information sur les problèmes d'éducation sexuelle et de planning familial, qui visait à permettre à un groupe de responsables africains d'examiner la nature et l'ampleur du problème.
Les documents rassemblés ici ont été présentés
dans le cadre du Premier Séminaire lnterafrican sur !'Éducation Sexuelle, organisé à Bamako du 16 au 25 avril 1973, sous l'égide du Ministère de !'Éducation Nationale de la République du Mali. À notre connaissance, c'était la première fois qu'un séminaire de ce genre se réunissait en terre africaine, et il convient ici de souligner le mérite du gouvernement malien qui a osé aborder officiellement et publiquement - puisque le séminaire a reçu une large publicité au Mali, tant par la radio que par la presse écrite - un thème qui reste malgré tout délicat.
Une cinquantaine de participants des deux sexes, presque tous Africains, et provenant de onze pays francophones d'Afrique subsaharienne, prirent une part active à des débats qui furent aussi animés que cordiaux. La plupart des participants venaient du domaine de l'enseignement, mais aussi de la santé, des services sociaux, _et de l'administration.
Pour susciter une réflexion . .. Ce livre, pas plus que le séminaire, ne prétend
faire le tour du problème. Mais on peut espérer qu'il va susciter une réflexion que chaque pays devra mener pour lui-même sur le pourquoi et le comment d'une éducation sexuelle.
Tous les exposés faits à la conférence ne sont pas reproduits ici, soit parce qu'ils recouvrent des thèmes fort bien traités dans d'autres ouvrages (par exemple, la physiologie de la reproduction ou les méthodes contraceptives modernes), soit que les manuscrits ne nous soient pas parvenus. C'est le cas de l'excellent exposé fait par Monsieur le Ministre de !'Éducation Nationale.
li faut noter également que certaines transcriptions de présentations orales ont été adaptées, sans en modifier le sens ni le contenu, à la présentation écrite, ou condensées, pour éviter les répétitions qui sont inévitables lors d'un séminaire.
5
Ce séminaire comprenait trois étapes. La présentation des faits (physiologie de la reproduction, données ethnographiques et psychologiques, contraception); une discussion des valeurs (aspect philosophique de la question); et finalement des ateliers sur les aspects pédagogiques du problème.
Dans la première partie il convient de souligner la remarquable étude de M. Roger Brand, ethnologue dont la sensibilité lui a permis de réaliser une intégration dans le Sud Dahomey rarement atteinte par les spécialistes de cette discipline auprès des populations qu'ils étudient. Son étude, qui ne prétend pas représenter une population africaine« typique» (si tant est qu'une telle population existe) a le mérite de souligner l'existence d'une éducation sexuelle fort poussée dans certaines ethnies, ce qui fut une révélation complète pour plusieurs participants. Cette enquête souligne le besoin d'une étude approfondie de ce qui s'est déjà fait en Afrique dans ce domaine, avant d'importer aveuglément des modèles culturels étrangers.
Nécessité d'études africaines Une telle étude est déjà entreprise au Mali par
l' Association Malienne pour la Promotion et la Protection de la Famille (AMPPF) en collaboration avec le Centre de Recherches pour le Développement International, d'Ottawa (CROI) et mériterait d'être entreprise également dans d'autres pays. Comment en effet pourrait-on élaborer une éducation sexuelle réellement africaine (et les participants furent unanimes sur la nécessité d'un ressourcement inspiré par la culture africaine), si on ne connaît même pas les coutumes traditionnelles dans ce domaine?
C'est pour cette raison que les résultats préliminaires des recherches entreprises par l'AMPPF sur la contraception et l'éducation sexuelle traditionnelles revêtaient une si grande importance dans le cadre de ce séminaire. L'étude présentée conjointement par André Laplante, ethnologue québecois du CROI, et son assistant de recherche malien, Bourama Soumaoro, n'a pas manqué de passionner les participants. La plupart de ces derniers découvraient avec étonnement tout un éventail de techniques contraceptives et abortives traditionnelles, des «purificateurs», des produits contre la stérilité,
6
qui démontrent sans contestation possible qu'une tradition contraceptive existe depuis des temps très reculés en Afrique tropicale, (ou en tout cas en Afrique de l'Ouest). L'importance de cette «découverte» n'est peut-être pas tant sur le plan médical (on ne connaît pas encore l'efficacité réelle de ces techniques, bien que des recherches soient en cours), que sur le plan culturel et psychologique. Elle peut en effet changer considérablement le débat passionné mené actuellement en Afrique sur le problème du planning familial et de la limitation des naissances, la contraception moderne ne représentant alors plus une rupture absolue avec le passé mais une amélioration technique de pratiques existantes.
Il en va de même de l'éducation sexuelle: elle ne représente plus une tentative pour « dépraver » les jeunes, comme le craignent les gens mal informés, mais au contraire une tentative de renouer avec des pratiques éducatives largement répandues jusqu'à un passé récent, et qu'il importe de restaurer, (bien que sous une forme plus moderne, bien sûr) si l'on ne veut pas que la jeunesse des grandes villes soit livrée à elle-même.
Une mise en garde La mise en garde du Dr. Ondaye contre l'utili
sation de l'éducation sexuelle comme élément d'une stratégie de la limitation des naissances surprendra certains par sa vigueur, d'autant plus que les phénomènes de dénatalité et de subfertilité conduisant à une certaine souspopulation ne se rencontrent que dans quelques régions de l'Afrique, surtout le Congo, le Gabon, certaines régions du Cameroun, de la République Centrafricaine et du Zaïre, (alors que d'autres connaissent au contraire des problèmes sérieux aggravés encore par des taux de croissance démographique très élevés, indépendamment des questions de densité).
Néanmoins, le Dr. Ondaye sait très bien ce dont il parle, et certains organismes occidentaux devraient prendre ses paroles comme un avertissement sérieux, à savoir que toute pression malthusienne sur l'Afrique francophone risque de produire - a déjà produit en fait - l'effet exactement contraire de celui qu'on espérait: une levée de boucliers contre le planning familial, qui rend son adoption, même dans une perspective raisonnable de simple composante d'une protec-
tion maternelle et infantile (PMI) équilibrée, beaucoup plus difficile.
La justesse de la mise en garde du Dr. Ondaye est encore soulignée par l'exemple suivant: le printemps passé, l'ambassadeur d'une nation occidentale, intéressé par le séminaire de Bamako, nous a convoqué pour obtenir de plus amples renseignements sur son déroulement. Au cours de la conversation, il fit des remarques sur le prix - selon lui excessif - des condoms (préservatifs masculins) dans la région, et suggéra qu'il faudrait subsidier l'achat massif de préservatifs pour permettre de les écouler à très bas prix, («très discrètement» comme il le soulignait), car, ajoutait-il, «si les jeunes gens commencent à s'en servir avec leurs amies, ils continueront plus tard lorsqu'ils sont mariés».
Nous pensons pour notre part que le problème tant de l'éducation sexuelle que du planning familial est un peu plus complexe que cela, et que de le poser en ces termes risque de vicier a priori tous les efforts pour que des Africains résolvent euxmêmes le problème de l'éducation sexuelle selon leurs propres critères et sans ingérences extérieures abusives. La guerre, disait Poincarré, est une affaire trop dangereuse pour laisser aux mains des militaires. Le paraphrasant, on pourrait dire que l'éducation sexuelle en Afrique est un problème trop complexe et délicat pour le laisser aux mains «d'experts» occidentaux qui presque toujours, ne connaissent que fort peu de choses à l'Afrique.
Développement psychosexuel Le Dr. Suzanne Képès, dans un exposé très
apprécié des participants, réussit une présentation, remarquable par sa simplicité, du développement psychosexuel de l'enfant européen, car on ne connaît pratiquement pas la réalité africaine dans ce domaine. En effet, l'observation clinique dans ce domaine reste trop tributaire des pays occidentaux et de Freud pour ne pas soulever aux moins quelques interrogations fondamentales quand on l'applique à l'Afrique, interrogations que le Dr. Képès était d'ailleurs la première à soulever. Car sans entrer dans le débat continu entre spécialistes portant sur l'universalité des modèles freudiens, on est en droit de supposer a priori que le développement psychosexuel de l'enfant africain élevé dans une
famille élargie lui offrant de nombreuses sources d'affection non exclusives pourrait différer quelque peu de l'enfant européen qui reste beaucoup plus limité dans ce domaine.
L'émancipation féminine Dans la deuxième partie du séminaire, l'exposé
le plus applaudi fut certainement celui de Madame Jacqueline Ki-Zerbo de Ouagadougou, qui évoqua avec une grande franchise le problème brûlant de l'émancipation féminine. Il existe aujourd'hui en Afrique très peu de questions qui soulèvent autant de passions que celle-ci. Le plus remarquable dans la matinée consacrée à ce débat, fut la discussion qui suivit l'exposé, et au cours de laquelle les hommes présents firent une sorte d'auto-analyse assez étonnante, tournant autour de la peur subconsciente que les hommes disent ressentir face à la femme (d'où la tentative constante faite par l'homme à travers l'histoire pour dominer la femme, et ce dans toutes les sociétés). Ces questions ont des incidences importantes sur la problématique de l'éducation sexuelle, même si ces dernières n'apparaissent pas à première vue.
Les trois exposés sur les questions religieuses permirent d'éliminer certains des clichés faciles si répandus dans ce domaine, concernant, notamment, la contraception. Lors des discussions, plusieurs orateurs soulignèrent le rôle négatif joué par certains missionnaires chrétiens qui ont souvent lourdement culpabilisé une sexualité qui traditionnellement n'était pas hypothéquée par les comportements névrotiques et névrogènes qui caractérisent l'histoire occidentale dans ce domaine. Mais certains participants africains n'ont pas man'qué de souligner que l'Islam est aussi étranger au fond culturel original de l'Afrique subsaharienne que le christianisme, bien que l'Islam a eu une capacité d'adaptation très supérieure, lui ayant permis de s'implanter beaucoup plus solidement que le christianisme.
Finalement, Monsieur le Proviseur Soumaré a décrit en termes éloquents la réalité sociologique du milieu bamakois, au niveau du comportement sexuel des jeunes (qui est sans doute très proche de celui des autres grands centres urbains africains). Il y a une réalité à laquelle il importe de faire face, à savoir que l'activité sexuelle des jeunes (et ceci dans le monde entier presque), est
7
de plus en plus fréquente, commence à un âge de plus en plus jeune (onze à douze ans actuellement, si ce n'est pas plus tôt même -contre quatorze, quinze, seize ans autrefois), et prend des formes de plus en plus «libres» et «déviantes». L'avortement provoqué illégal, l'absorption massive de Nivaquine, d'aspirine, la prise anarchique de pilules contraceptives sans aucune surveillance médicale, ne sont que la partie visible d'un iceberg dont la masse réelle est ignorée de presque tout le monde, mais destinée à créer de très graves problèmes si on ne s'en occupe pas rapidement.
Car il n'est plus possible de croire que nous avons affaire ici à des effets secondaires « inévitables» du développement, comme le voudraient certains économistes et «experts» occidentaux qui ne voient du développement que l'aspect technologique. Car quel est ce« développement» qui a des effets si déplorables, est-on en droit de se demander?
C'est ici l'occasion de mentionner une des conclusions les plus importantes (et peut-être la plus importante) du séminaire, à savoir qu'il est exclu de vouloir aborder Je problème de l'éducation sexuelle en dehors du contexte général du développement d'un pays. Vouloir faire de l'éducation sexuelle alors que le milieu ambiant pousse à la facilité dans ce domaine, c'est perdre son temps. Vouloir encourager chez les jeunes un comportement sexuel responsable, alors qu'un certain tourisme de masse financé et développé par l'Ouest encourage trop souvent le développement de la prostitution (tant masculine que féminine), alors que des films érotiques européens de bas étage passent devant des auditoires de jeunes adolescents dans presque toutes les salles de cinéma, alors que certains achètent les privilèges des jeunes lycéennes par des robes, pagnes, des soirées au dancing, parfois avec l'assentiment des parents, bref, alors que tant de réalités de la vie sociale encouragent un comportement sexuel irresponsable, vouloir faire de l'éducation sexuelle sans s'occuper de ce contexte plus large serait non seulement inutile mais nuisible.
Une remise en question C'est la raison pour laquelle les participants
ont abordé des problèmes aussi divers que la politisation de la femme ou la création massive
8
d'emplois, montrant qu'ils entendaient définir la problématique en dehors de tout schéma préfabriqué et de toute contrainte intellectuelle. Il reste à souhaiter que de retour chez eux, ils sauront ne pas se laisser prendre au piège de la simple formulation de programmes d'éducation sexuelle pour les écoles, aussi pressants soient ces derniers, mais sauront insister sur la nécessité de remettre en question tout le processus de développement déséquilibré, dépendant, et «excentré », imposé de l'extérieur à l'Afrique.
Le séminaire s'est terminé par une série d'ateliers dirigés par le pédagogue chevronné qu'est M. Gaston Gauthier de Montréal. Comme M. Gauthier n'a pas présenté d'exposé, nous avons reproduit ici trois études importantes qu'il a préparées pour le séminaire. Ces exposés intéresseront avant tout les éducateurs, désireux de passer, au delà des débats de fond, à une action concrète dans l'immédiat, aussi modeste soit-elle.
Parmi les débats qui animèrent le séminaire, il convient de mentionner la table ronde consacrée à l'accès des jeunes à la contraception, et dirigée par le Dr. Faran Samaké, président de l'AMPPF. Bien que des avis très différents et parfois opposés aient été exprimés sur la question, il semble correct de dire que l'avis de la majorité des participants du séminaire était qu'à partir d'un certain âge, les jeunes hommes et jeunes filles devraient avoir un accès contrôlé à la contraception.
On trouvera une bibliographie élaborée par les soins de M. Gaston Gauthier en fin de volume. Il est important de souligner le fait que tous les titres de cette bibliographie se rapportent à des études occidentales. Cela attire l'attention sur l'urgence de recherches dans ce domaine par des auteurs africains. Le Québec, plus que la France, offre d'intéressantes possibilités d'étude dans le domaine de l'éducation sexuelle et il est à espérer que des éducateurs africains désireront se perfectionner dans ce domaine important dans les années à venir.
Recommendations du Séminaire Dans les recommendations du séminaire, il
était suggéré que chaque pays organise un séminaire analogue à celui de Bamako, mais dans un cadre national et uniquement pour des participants nationaux. Les lecteurs de cet ouvrage se-
A
/. 'éru1i.rn1e f><m mard1v all/rt• /11 1c1111t~1.\t.
runt hcurcu~ d'apprendre: qu'un orgami.mc 'péc1alisé des Nation~ U 1111!~. fort intcrC:ssé par le~ résu Il il 1 s de Bamako, i.e: prnpui.c j u::.t cm cnt de meure i1 la tlîsposilion des pays 4ui le désircrmcnl 1k'> foruh et dei; spéciah::.lc:. puur mener de::. sêminJi rcs tlc cc genre.
Nuus ne pourrions pas h:rmincr celle introduction sans n:merc1cr h:::. aulonté:-. maliennes, cl tuut r;srllculiéremenl MonMeur le M1ni,trc cJe rl·ducallon Noiti.:>nak. pour l'a1.-cuc1I trèHord1al qu'elle!. réservèrent au~ par11~·1pant::. du séminaire, amsi que Madame I· lia. la présidente du ConHlé d'Açcuei1 M•1licn. dont lc:l> rcmar4ua-
bh:::. talent-; tl' oq~an1~atrn:c furent un facteur imr1>rlan1 cJu SU\.:CÎ:I> du ~éminaire, ma collaboni· t ricc sénégalai::.c, ~t.idame Marie Angéli11uc Sav.111é. tjUI SC cJévuua de raçon lolak pendant toute la durée du '>ém1murc. sans oublier lcl> par· tkipanb cu,\-lllêrne::.. dont la présence ai;siduc, matin et M>ir, nous permit de COU\'Tlr un programme Je truv<1il ambitieu" en un IJpi. de temps fort court
Nou .. remercions aussi 1rè!> pari u:ulièrcml!nl 14! L R. IJ. l., 4u1 a Jssurè la publication cl la d1:.t n· bu11on c.lt: cc document.
9
le problème en af ri que tropicale Pierre Pradervand
C'est pour répondre aux préoccupations de centaines d'éducateurs et de responsables que le Service Quaker a pris l'initiative d'organiser cette rencontre, placée sous le patronage du Ministère de !'Éducation Nationale du Mali, qui voudra bien accepter ici nos remerciements pour l'accueil si positif qui a été fait à notre demande. Nous remercions en même temps le Gouvernement de la République du Mali, qui a eu la largesse de vues - et le courage, disons le - d'héberger un séminaire sur au thème brûlant auquel d'autres pays ont refusé de se frotter, même si leurs jeunes en pâtissent.
Urgence du problème Depuis dix-huit mois, j'ai eu le privilège d'être
presque constamment en voyage à travers différents pays de !'Afrique de l'Ouest francophone. Il m'a été donné de diriger des débats sur les problèmes de la sexualité (ou d'y participer) avec près de 2,000 personnes, surtout des jeunes, mais aussi des enseignants, du personnel de la Santé, etc ... Le problème qui, il y a quelques années seulement, semblait se limiter uniquement à quelques grandes métropoles, gagne de plus en plus les villes d'importance moyenne, voire les grands villages de l'intérieur. Dans presque toutes les régions, on constate un accroissement préoccupant des maladies vénériennes, des avortements provoqués chez les jeunes filles, d'une espèce de demi-prostitution devant fournir une ressource financière d'appoint, de comportements sexuels qui posent plus de problèmes qu'ils ne résolvent.
Ainsi, vous savez sans doute que depuis plusieurs années on peut acheter dans les « sexshops » d'Europe et d'Amérique du Nord des «poupées» en matière plastique, ou gonflables, de forme humaine, et représentant une femme ou
IO
un homme nu, et qui doivent permettre aux célibataires esseulés d'avoir ce qui passe pour des rapports sexuels en tau te quiétude. On s'imagine difficilement un symbole plus frappant de la tragique aliénation des rapports humains et de la sexualité atteints en Occident, que cet érotisme plastique au rabais. Or, récemment, un collègue africain, membre d'une association de planning familial d'un pays ouestafricain, prenait part à un débat public sur ce sujet dans une petite bourgade de son pays. Quelle ne fut sa surprise d'entendre un jeune homme de l'auditoire avouer être détenteur d'une de ces poupées et soutenir« que c'était très bien pendant les examens ». lis étaient partis en France, une douzaine de jeunes stagiaires, et il pensait qu'au moins une dizaine d'entre eux en avait ramené des poupées pareilles.
L'aspirine contraceptive Autre exemple frappant: dans un lycée de la
côte, un groupe de garçons avait persuadé les filles qu'elles devaient avoir des rapports sexuels trois jours avant les examens pour réussir ces derniers: certaines filles payaient les garçons pour avoir des rapports avec eux. Vous savez aussi le nombre préoccupant de jeunes filles qui prennent de la Nivaquine pour avorter et qui, trop souvent, arrivent mourantes ou mortes à l'hôpital. Nombre de jeunes gens aussi donnent une aspirine à leur amie en lui disant «c'est la pilule, tu peux y aller sans crainte». L'aspirine contraceptive: on découvre du neuf tous les jours!
Un nombre croissant de jeunes filles prend la pilule contraceptive, mais d'une façon aussi anarchique que dangereuse, selon la fantaisie du moment: deux ou trois jours avant les rapports sexuels, cinq jours après, une tous les deux jours, deux tous les trois jours, voire un cycle entier de vingt-sept pilules à la fois, comme cette jeune fille
..... . " ....... .....
dont me parl:ut un pèdiatrc africain cl qu'on a rctruu\ c chc1 un 11:11\.'heur qui de\ a11 la guérir de son mau~a1~ e!>prit Je me sou\ic:n., même d'un déhat ~ur IJ .,c\ualué auqud f ai flilrtu.:1pè danll un grand l)cèc tc:chmque · aprè~ h.: déhat. un grand Jeune homme un rcu cmh:1rrallw me de· rnanlk. " Muns1cur. JC prends la pilule depuis 4ucl4ue tcmpi. : C!o.l-cc que cda va me li.ure du mal·~"
hnalernenl. la plupart d·cntrc \ou., ètcll con~· cicnts de la m:1:. .. c de photos cl de rc\ ucs purnullrarhi4ucs qui circulent M1us .:arc en ·\lriqui: tr1lp1calc · 11 n'est probablement riai. un I~ t:cc de la Clllc ou nn n'en lroun:. même les plu:. scvércs ou <t hicn·rcn~ilnti. '" l\lê1m: de~ lllm .. purnn~ru rhi. llUe~ de Xmm i.0111 '1~1unnéi. d;in:. 11111: demi·
dandcl>tinitc . . • Seul' ccu\ 4u1 ne sont pJ!> Hill ment en contact
J\ c:c IJ 1cunc~sc: ou 4u1 \culent dèhbèrèmcnl ignorer le pr11hlè1m: pcu,ent nier "'" amrili:ur. l eux qui, t:ommc \oUs, en mesurent n11cu~ les dan{!crs, réalisent qu'une n:chcr~·hc de :.olulmns s'impose d'urgence.
S1tnli douh: cette crise du comportement sexuel cn \lr14uc lall-cllc parllc d·une cri~c mondi.1lc hc.sucoup plui. \J~tc. mai~ c:llc: pn:nd c:n 1\friquc: de, d11m:nsmn!> riart1cuhcrc~ dùc!o entre autre~ à l.1 hrutahté et la )uud;un.:tc: de sun e.\lcns1on, c:I
du 1':111 4o'cllc !>':iJOUh: à tant <l\rnlrc~ prohlC:mcs 4u1 !!rêvent le~ forces lie pa) 1' cni;;orc jeum:s.
Le hui de i.:etlc rcm:onln:. ruur lc:!o organi~~l· teurs, ..: .. 1 ;1\ ant tout d'cn1;?al!cr un lar1;?e di;iloj,!Uc
11
l '11rlwt1isarirm 11/U.\Sll't' el dé.wrd1>11t1ù 11ggr<11't' le {lmbltl1t11'
entre Africains, dialogue qui, nous l'espérons h1cn. se conunucra dans le cadre d'autre) rencontres et llérnina1tes. soit sur le plan nalÏonal, soit sur un plan plu!> technique:. car il est èv1dent qu'en dL' jours nou!> n'allons pa!> faire le: tour du problème. Si nou!> ne faisions que prc:ndrc conscience de sa complexité, ce serait déjà beaucoup.
Je ne veux pa~, dans celle alloculH>n d'introduction, chercher à définir cc qu ïl faudrait enten-
I:!
drc par éducation ~cll.uclle. Ce serait déja oncntcr le~ travaux de lu 2ème panic de cette réunion, mais je voudrais sun plement auirer l'attention sur quelques points 4ui ~ont ressortis con!>tammenl au cours de mes d1scu!>sions a\'C(. des responsables africurns de nombreux pa)~.
Quelques aspec«s fond 11111('111 :tu x D'abord il est certain 4u'un rnmlèlc africain
d'éducation sexuelle, tenant compte de l'histoire culturelle, des structures sociales et de la psychologie de !'Afrique devra être élaboré. On ne peut - c'est tellement évident qu'on voudrait n'avoir pas à le rappeler - on ne peut adopter des modèles européens dans un domaine qui touche à tant d'interdits culturels. D'ailleurs, en dehors des pays scandinaves et de quelques expériences fort limitées ici et là, on chercherait de tels modèles en vain; mais il convient d'attirer l'attention sur le fait que la notion même de modèle peut avoir quelque chose de fixe, de figé même, peu adapté à une période de bouleversement culturel rapide comme celle que nous vivons aujourd'hui.
Traditions africaines Contrairement à ce que pensent certains, il
existe des traditions africaines séculaires en matière d'éducation sexuelle, dont certaines d'ailleurs, pratiquées en milieu rural, sont encore extrêmement vivaces. Plutôt que de céder au reflexe conditionné fréquent en Afrique francophore, «Qu'est-ce qui se fait en France?», nous nous demanderons, avec MM. Brand, Laplante, et Soumaoro: «Qu'est-ce qui se fait en Afrique dans ce domaine?». C'est pour cela qu'on ne saurait trop insister sur la contribution des anthropologues à ce séminaire, dont l'apport sera sans doute déterminante pour orienter votre réflexion, en attirant votre attention sur des coutumes aussi vivantes qu'efficaces et, doit-on ajouter avec regret, ignorées.
Le contexte global du développement Il existe un grand danger à étudier le problème
de l'éducation sexuelle en dehors du contexte global du développement. La vie sexuelle ne se déroule pas dans un paquet de cellophane aseptisé mais dans un réseau intense de relations sociales, de structures politiques ou linguistiques, de rapports d'ethnie, de générations et de classes.
Si nous ne pouvons sans doute pas aborder tous ces problèmes, du moins devrons-nous les garder présents à l'esprit. Mais voici deux exemples de ces relations du problème de l'éducation sexuelle avec d'autres problèmes:
Vous savez que depuis quelques années l'Europe déverse un torrent de pornographie aussi analphabète que misérable sur l'Afrique. Je fais allusion ici à ces films de troisième catégorie
qu'on n'oserait jamais même projeter dans une sous-préfecture de province en France, mais dont on inonde l'Afrique, avec les effets très négatifs que vous savez. Est-ce le résultat du hasard? Bien sûr que non! C'est le résultat de la politique délibérée de deux compagnies françaises de distribution qui enrichissent leurs actionnaires en avilissant le goût des jeunes africains. Vouloir faire une éducation sexuelle saine parallèlement à l'existence de cette situation scandaleuse revient un peu à nourrir un homme pendant que quelqu'un d'autre lui scie la jambe. Des solutions, il en existe; elles sont connues; mais elles relèvent du domaine politique et économique.
Un autre exemple est celui de la République de Chine. Le service Quaker (AFSC) a eu le privilège d'envoyer récemment deux missions d'étude dans ce pays au cours des deux dernières années. Dans un rapport écrit par un des participants de la deuxième mission, j'ai relevé que la Chine avait vraisemblablement le nombre le plus élevé de jeunes arrivant vierges au mariage. Ceci est d'autant plus remarquable que l'âg,e au mariage en Chine est beaucoup plus élevé que dans la moyenne des pays du Tiers Monde. Loin de moi l'idée de faire ici l'éloge de la chasteté prémaritale ! Ce n'est pas là mon intention. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'il est possible, puisque la Chine l'a fait, de sublimer l'énergie de centaines de millions de jeune dans la construction de leur pays. Mais cela exige aussi sans doute, une restructuration globale de la société et souligne de nouveau que le problème du comportement sexuel des jeunes ne peut pas être résolu indépendamment des autres problèmes sociaux.
En Chine, les jeunes participent à de nombreuses activités en dehors de leur travail. Mais notons d'abord que tous trouvent immédiatement du travail à la sortie de l'école, ce qui est loin d'être le cas en Afrique. Au Sénégal par exemple, seulement un tiers des jeunes arrivant chaque année sur le marché du travail, trouvent un emploi. Ensuite, en Chine, ils ont des activités sportives nombreuses; ils participent à des réunions politiques au travail et dans les organisations de jeunes; ils ont les moyens de continuer à se cultiver et à s'éduquer parce que l'État les a mis à lèur disposition. Le contraste avec le sort des jeunes chômeurs de milieu urbain en Afrique est frappant.
13
Éducation sexuelle et vision de l'homme Tôt ou tard, on s'aperçoit que toute discussion
de l'éducation sexuelle aboutit à des problèmes philosophiques de base, et notamment à une certaine vision de ce qu'est l'homme (en philosophie: une anthropologie). Toute discussion du problème qui chercherait à éviter ce fait risque soit de rester superficielle, soit de tourner en rond. Car entre l'optique mécaniste et matérialiste - je prononce ces mots sans aucun jugement de valeur - des Américains Masters et Johnson (qui voient dans la sexualité avant tout la résultante de phénomènes psychochimiques analysables en laboratoire,) et une optique spiritualiste, qui voit dans la relation sexuelle l'occasion d'un dépassement de soi, voire une pédagogie de l'ascèse, il est évident que ce qui les sépare, c'est avant tout deux visions de l'homme radicalement différentes.
Éducation sexuelle et contraception Je voudrais attirer aussi votre attention sur un
danger réel qui risque de se profiler dès que certaines organisa tians occidentales s' a perçai vent que vos pays s'intéressent à l'éducation sexuelle.
Vous savez que depuis quelques années, les pays occidentaux dépensent des sommes toujours croissantes pour encourager la limitation des naissances dans le Tiers Monde. Alors que de moins en moins de fonds sont disponibles pour des projets d'assistance économique ou sanitaire, des sommes énormes - qu'on n'arrive même pas à dépenser, même en les gaspillant - sont disponibles pour une campagne malthusienne concertée qui a des aspects très troublants que j'ai analysés ailleurs. Aussi faudrait-il vous attendre à ce que diverses organisations accourent soudain pour mettre de l'argent à votre disposition, en vue de faire de« l'éducation sexuelle)). Mais, pour elles, ce qui les intéresse avant tout - parfois uniquement - c'est la vulgarisation de méthodes contraceptives.
Ainsi un collègue, expert de l'UNESCO, visitait récemment un pays anglophone africain qui a un programme énergique de limitation des naissances. S'intéressant aux problèmes d'éducation sexuelle, il demande au médecin africain, directeur de !'Association nationale de planning familial, si on faisait quelque chose dans ce domaine. Le médecin répondit qu'il faisait lui-même des
14
exposés sur la contraception dans les écoles. Surpris de cette approche, l'expert lui demanda si les parents des élèves étaient au courant. «Oh, jamais de la vie, s'entendit-il répondre, ils y seraient opposés)).
On peut réellement craindre qu'une approche aussi limitée crée beaucoup plus de problèmes qu'elle ne résoud et qu'elle ne manquera pas de renforcer chez les parents l'hostilité envers l'éducation sexuelle.
Et est-il besoin de dire que cette vision étriquée qui réduit l'éducation sexuelle à la simple information contraceptive, est aussi myope que celle qui réduit l'amour au frottement de deux épiderme? Il convient, de plus, de se poser des questions sur les motivations politiques de cet intérêt. Certaines formes d'aide sont empoisonnées. J'ose espérer que vous mettrez vos gouvernements en garde contre ce danger.
Ne pas privilégier les privilégiés La plupart des participants à ce séminaire sont
des éducateurs. Ce n'est pas un hasard. En effet, c'est au niveau des jeunes scolarisés que les problèmes semblent être les plus graves. De plus, nombre d'États, sans parler des familles, dépensent des sommes importantes pour éduquer des filles qui sont ensuite expulsées, souvent juste avant la fin des études, pour cause de grossesse. Mais il ne faudra pas oublier que la population scolarisée, c'est déjà un groupe très privilégié, surtout au niveau secondaire, et il nous faudra aussi garder à l'esprit les autres jeunes nonscolarisés chez qui le problème se pose aussi.
C'est le moment ici de mentionner aussi que si aucun expert francophone africain de l'éducation sexuelle ne participe à ce séminaire, c'est que nous n'en connaissons aucun. Nous sommes les premiers à le regretter et à espérer que ce séminaire pourra susciter peut-être quelques vocations dans ce domaine. Mais au moins puis-je avancer que les experts étrangers qui sont ici sont bien plus conscients de leur ignorance de l'Afrique que de leur compétence en tant que techniciens de l'éducation sexuelle dans un milieu industrialisé.
Ils viennent donc, non pour étaler des connaissances, mais pour partager une expérience, nouer un dialogue, et, ne l'oublions pas, apprendre de vous et avec vous.
mise en garde d'un médecin africain Docteur Gérard Ondaye Médecin-Chef des écoles, Brazzaville
Les problèmes de sexualité et d'éducation sexuelle en Afrique Noire n'ont jamais été abordés aussi largement, aussi franchement, par des groupes aussi divers qu'à Bamako, lors du premier séminaire interafricain sur !'Éducation Sexuelle. Jamais en ma connaissance, autant de discussions, de doctrines établies, de critiques parfois passionnées ne se sont confrontées avant d'arriver à des conclusions admises par toutes les délégations sur un sujet aussi délicat, aussi tabou que la sexualité et la formation de l'homme.
Certes, il a fallu beaucoup de courage et de solides convictions au Service Quaker pour oser poser le problème de la sexualité tel qu'il se présente actuellement en Afrique Noire, non pas parce que les problèmes sexuels prennent la «Une» de nombreux magazines et journaux européens, mais pour attirer l'attention de l'Afrique sur le danger de la contagion, le danger pour cette Afrique non encore entièrement africaine de régler ces problèmes spécifiques sur le modèle européen.
Notre crainte en arrivant à Bamako était de prendre part à un séminaire organisé par un service dont les membres nous sont connus pour leur. puritanisme. Nous ne pouvions admettre de trahir le Congo en servant sans conscience les objectifs à long terme de l'Occident, nataliste pour luimême et malthusien pour l'Afrique. Car nous étions convaincus que certaines activités, pour philanthropiques qu'elles paraissent aux yeux de ceux envers lesquelles elles s'exercent, ne demeurent pas moins dangeureuses par la suite et, également, trop intéressées pour ceux qui les subventionnent.
Le bénéficiaire ne comprend pas toujours l'exactitude du but attendu, surtout quand on s'adresse à lui avec un langage qu'il ne peut maîtriser, qu'on lui donne des conseils qu'il ne peut suivre, retenir et exploiter scientifiquement.
Les motivations profondes ... Il faut souvent beaucoup d'intelligence pour
découvrir les motivations profondes du généreux donateur qui sait ce qu'il fait, ce qu'il donne, et ce qu'il attend de ses dons.
Cette crainte nous ne l'avons pas cachée à nos amis Pierre Pradervand et Marie Angélique Savanet du Service Quaker (A.F.S.C.) et nous leur sommes reconnaissants de la franchise avec laquelle ils nous ont répondu et sommes heureux de proclamer notre identité de vue avec la leur sur les problèmes d'éducation sexuelle.
J'ai toujours pensé et continue à croire que l'éducation sexuelle ne peut être entreprise par n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment.
Comme tout processus éducationnel, elle commande un travail de recherche préalable, d'inventaire, de prospection, de formation de personnel compétent, bref, un programme, un plan. L'éducation sexuelle comme l'éducation tout court est une affaire d'équipe, d'une équipe spécialisée, compétente, décidée, avec des objectifs précis.
Une éducation sexuelle qui engagerait l'Afrique dans une politique anti-nataliste ne peut être admise dans une Afrique sous-peuplée, exploitée, néo-colonisée. Malgré tout ce que peuvent déverser sur l'Afrique les démographes, sociologues, économistes occidentaux africanistes, je n'ai jamais compris pourquoi ces prétendus amis de l'Afrique n'ont jamais vu le danger de la surpopulation, de la surconsommation, de la longévité qui pèsent sur l'Europe, alors qu'ils les vivent quotidiennement.
Comment faire confiance à ces dits amis qui ne voient pas le danger démographique de l'Europe, danger constitué par le faible taux de mortalité, les progrès réalisés en matière de santé de la mère
15
et de l'enfant. la longévité 4u1 ne l'ait que croitre d'année en anni:e, la ~urcunsummation. cl la ~odé1é d'explo1ta11on dan!> la4ucllc ils v1,·enl.
Comment conseiller lu hm1tat1on des naissan· cc~ à des pay~ don1 le dcmarrage socioéconomique est entravé en p;irtic par le manque de brus ·r L'Afrique n'a pa~ bc:.om d.éduca1iun se>.uclle. si œlle-d ét;nt ~ynony me de limitation des naissances sou!> 4uclquc forme que cc soit. Le conlrôlc des naissancci. imposé à I' /\fr11.1uc par l'Ocl'idenl est la preuve que la société occidentale n'a pas abandonné ses :.enllmcnts de haine. d'cxplo11a1ion et de mcpm pour l'Afrique.
Je ~uis part1cuhèremenl peiné quand je pense que 4uel4ues africain!.. mo}ennanl qudques sub\C:ntiuns europêenne~. ouhhcnl 4uc le danger pour l':\fnque de demain n'e:.1 pas la surnatalité, mai:> bien son sous-peuplement qua empêche la production cl une meilleure répartition des biens de consommation. Cc!o al ricain~ européanisés oubli1.:111 que rEurnpc n'est pas l'Afrique; que l'Afti4uc duit demeurer a fncainc si elle veut survivre.
Un danger nou!t guéte à travers l'éducation !lcxuclle. avec tout ..:e qu'elle comporte d'applkat1on~ heureuses ou malhcureu~ci. . c'est l'Europe Jcstructricc. malthusienne L'èducation sexuelle rour être bénéli4uc à l'Afrique doit avoir pour objectif la formation de l'homme :1lncain dan~ 1'on corps, son âme et son esprit l:.lle doit respcc-
(fl
Ier la pcri.onne humaine. elle doit mener l'homme à IJ dignué. à la liberté de choh. non pour détruire. mai~ rour construire. pour procréer, en ~uc de produire.
S1 demain le~ a lm:ains conscient~ 1'Cntcnt le bt:· ~oin d'c~paccr le!. nm~sances (t:I non le!. linutcr). lie retarder la pro1:réat1on en vue d'équilibrer prn· ducliun et cunsommation,
Si demain les jeunes afri1:ains se i;cntent lihérès Je la peur 1.J'uH11r des enfants aHrnt 4u'ib ne 1'01cn1 en m~urc d'en assurer les :.oins. le dl'.vcloppcmenl et l'épanou1ssemcn1.
Si dcmdin. le nombre d'aHlrlcmc::nt., cnmincb d11111 nue, et no~ .!>oeurs ne meurent plus aus~1 nombrcu~cs de suit~ de pratiques abortives.
S1 demain. le 'pc.:trc d'une gn"'e.,~c non déi.1rèc. d'une mu11iat1on. d'une p~cudo frigidité ou d'une 11npu1~san..::c d'origine 1)it)chologi4ue n'cnlrnvcnl l'lus la sexualité de l'•nlulesccnt,
Si dcma in. I' A friquc peul être lière d\1voir une jcunci.\c saine d'c!>prit et de corps. ~a•h;1111 uppré· cicr la wxualué et h:s qucs11on!. sexuelle<; â leur JUSlc valeur,
S1 dcrm11n. l'édu..:ation ~e~uelle Jc\lcnl partie antcgrantc de tou 1 processus êduca11onncl. c'est à nu) ami~ du Service Quaker. a leur courage. à l.:ur .1111our du proch;un. à leur haute .:omprèhcn~ion lies problèmes di;: la sexuahlé dan!> le monde cl en A trique que nous le devrons. l ls 11n1 poi.é la pn:mièrc pierre. À nou~ ll>us. èducateur·s. médecins, psych!)logues, sociologues, parents. rcligicu.\ cl tous ceux 4ui croient en la pu1i.sanœ de l'éducaliun. de continuer l'éd1 lice dont ils ont prudemment mai~ (crmcmcnl posé les fondation!>
Cc hHc qui esl une oeuvre 1.:ummunc est un e\Cmplc de coopèration. de collaborallon 1n1crafr11.:aine. Il est le S) mbolc de cette A fnque qu1 o;c cherche. de cette Afru.iuc M longtcmp~
c'<ploitée, mêpmêc, de celle /\ fnquc qui ne ~urv1 l que p:ircc que Sel> enfants tiennent à vivre, cl n'è· pargncrunt aucun sacrilkc pour qu'un jour l'homme d'Afrique, tm:c lllui. se~ frères du Tiers M1>ndc, comrnc un !>Cul hral>, leYe111 haul !.! tlam· hca u de 1:1 l 1 bcrté, de la j U!> t ice !IOC ia le cl de la p<tl\ pour qu'enlin \'l~c à Jamais l'lwmmt'. cet homme 4u1 ne conn.iitra ni la couleur de la peau. 111 de d.1~~c >oc1alc, n1 de rchg1un
f / t•\ w rèdtKé aprè.1 fr Simi11om1 1
• pourquoi une éducation sexuelle? Docteur Seydou Diakité, Directeur, Service d'Hygiène Publique et de !'Assainissement du Mali
Dans la précieuse documentation qui nous a été fournie par le service Quaker, on relève dans la préface de «Ainsi commence la vie»:
«Un jour viendra où l'anatomie et la physiologie des organes génitaux seront enseignées à l'école comme celles de l'estomac ou des poumons, mais il faudra plusieurs générations encore pour que dans nos pays l'on puisse parler librement et sainement de ces sujets.»
En effet, en Afrique de l'Ouest en général et au Mali en particulier, l'interdiction de parler librement de ces choses est telle que, à moins d'appartenir à la caste des griots, forgerons ou autres, il ne viendrait à l'idée de personne, homme ou femme, de prononcer devant plus âgé que soi, à plus forte raison devant ses parents ou enfants, le terme de rapport sexuel ou coït par exemple.
Cependant, l'importance de la sexualité dans la vie humaine se faisant de plus en plus évidente, personne, semble t-il, ne peut mettre en doute la nécessité d'une éducation sexuelle. Rencontrer l'être aimé, s'unir à lui, fonder un foyer, sont des événements qui marquent l'existence d'un être humain, assurent son bonheur ou provoquent son échec.
Une ignorance quasi-totale Si l'éducation prépare l'enfant à la vie adulte,
lui enseigne les règles de la vie en société, les éléments d'un métier, commen( ne pas le préparer également à la vie sexuelle qui jouera dans sa vie un si grand rôle? Si en Europe 10 à 20% des enfants ont été informés par leurs parents ou d'autres éducateurs sur l'essentiel des problèmes de la sexualité, on peut affirmer sans risque d'être démenti qu'au Mali l'ignorance est quasi-totale en matière d'information sur l'éducation sexuelle.
Il en résulte cette conclusion pénible: au moins 25% des concessions, (je ne dis pas des familles)
de la ville de Bamako renferment une fille-mère, l'initiative par les parents se bornant pour la mère au simple contrôle discret de la serviette hygiénique lors des menstrues. Quant aux garçons, aucune allusion sur ce que devra être son futur rôle de procréateur. Cependant la famille est le premier lieu d'apprentissage de la vie affectueuse. C'est dans les relations avec ses parents ou ceux qui les remplacent - ses grands-parents, ses frères et soeurs - que l'enfant découvre peu à peu ce qu'est l'affection, l'amour, l'indifférence, la haine. Il découvre aussi ce qu'est le désir et sa satisfaction, le plaisir.
Ainsi beaucoup de parents souhaiteraient parler à leurs enfants et beaucoup d'enfants souhaiteraient que leurs parents leur parlent. Bien souvent, sinon toujours, les parents sont désarmés - ils n'arrivent pas à trouver les mots qu'il faut, - ils sont gênés, et cette gêne semble plus marquée à certains moments de la vie: début de l'adolescence et des rapports sexuels par exemple. Pourtant, si rien n'est changé dans l'éducation, tout semble avoir changé aujourd'hui en ce qui concerne le tabou et la pudeur. Tout se passe comme si l'on tombait dans un excès inverse.
Mystérieuse, voire honteuse hier, la sexualité s'étale maintenant au grand jour au point de faire partie de notre univers visuel et mental. Le cinéma, la télévision, la presse, les magazines et surtout la publicité, tous utilisent la sexualité sur une grande échelle comme le meilleur procédé pour faire vendre l'information et n'importe quelle marchandise. C'est en «sexualisant» un produit quelconque (dentifrice, parfum, automobile etc ... ) en l'associant à une image féminine appétissante, qu'on l'impose à un vaste public.
La mode elle-même met en valeur les formes du corps masculines, mais surtout féminines. Par
17
/. Ï111111111t• dotl trrnwt•r tlmu H'.I rt'l"ti11t1.\ h• .lt'll.I dl' la l't'.\fltm.111htl1té
c:i1c111 pie, une rohc produ1l sùn effet a la foi~ par ce qu·ellc cache el par ce qu'cllt.: moule autant que par i.:c qu'elle dé~·o1lc:. Le pan1.i1~1n. le short, le maillot de bain nou' ont habitué~ ;i ne plus rien trouver de my~térieux dans l'am1tlllnÎc de la lemme
t n èr:ilace de la .,l'\t1ali1è l\inM la pudeur d'hier lait place à un étalage de
la sex u:1llté qui se ma111fcs1c également !.Ur le plan de.'\ mucur:.. Nvu" as~1i.1uns donc à une sorte de hbc.:ra11on de la ..e\uailtê par rapporl à l'atmo~phèrc th: tabou Cl de lll)Slérc QUI r1mrirégnall
IX
.1u1rdois. 81cn de~ èlémenl~} uni contribué. Ccr· tain5 incrumncnt I' affaihlis'\cmcnt <le~ slruc1ur1:' formhalcs. le <lèdin de la morale religieu~c. la mL\itè de l'èculc, de l'unh·cr~llé, du lieu lk travail. Mai~ 'ii cc :.ont là des uspci:t~ d'une évolu· 1100 normale. la vraie: cau\e .:.emhh: linah:mcnt d'<>rdre sc11:n111i1~uc, par la connaiss;.ince de plu!. en JllUS apprulùndJc de~ a'ipeC!!. hiolo~tqUC:S,
p~yi:holug14uc:.. s1Jc1aux cl ph)Mquc~ dc la scxualitè.
Ainsi d1c:1 le~ animaux !>auvu1,ic~. l'ac11vité \C\uclle ne \C l1m11c nullement à J'a~tc
cupulatoirc, ma1i. ~c 1radu11 par un ensemble de
rites qui seuls Je rendent possible. L'intervention d'évocateurs d'ordre olfactif ou visuel, des particularités du plumage par exemple pour les canards et les perruches, forme la condition nécessaire des approches entre mâles et femelles. Les danses prénuptiales des oiseaux, les offrandes de fleurs ou de coquillages dont les primitifs australiens font hommage à Jeurs compagnes, Je rôle de territoires qui sont spécialement consacrés aux amours, attestent l'importance et la variété de ce rituel.
Les zoologistes qui ont observé les règles hiérarchiques qui marquent dans les basses-cours les rapports des sexes, la fréquence des couples monogammes et les témoignages de fidélité entre conjoints, ne permettent guère de douter de l'existence d'une ébauche d'affectivité sexuelle dans des espèces aux ressources psychiques jugées pourtant modestes. Et même chez les primitifs ou prétendus tels, l'acte sexuel garde son caractère de besoin et sa fonction naturelle: assurer la perpetuation du groupe. Il s'entoure d'interdits multiples. Dans la tradition africaine, chez les adolescents, les rites d'initiation correspondent à une éducation publique de la sexualité, règlée par la morale tribale.
Si nous voyons aujourd'hui s'effacer les vieux prestiges de l'amour-passion, c'est pour des raisons que rend suffisamment évidentes l'évolution des structures sociales depuis Je début du siècle. La famille de naguère, liée aux traditions patriarcales, fortement hiérarchisée dans l'autorité de l'aïeul, enracinée au sol par la fidélité au bien héréditaire, a disparu pour faire place au couple instable, mobile, symbole de la précarité qui affecte toutes les institutions de notre temps. De parental, Je lien est devenu conjugal.
Une expérience hasardeuse Selon cette perspective, la rencontre de
l'homme et de la femme, dégagée des antiques servitudes communautaires, mais aussi démunie des sauvegardes naturelles dont elles étaient la rançon, prend la valeur d'une expérience, toujours nouvelle et toujours hasardeuse.
Or, c'est dans un milieu qui n'a que récemment acquis son autonomie et sa signification propre, Je monde des adolescents, que l'on voit s'ébaucher et s'élaborer Je modèle présent de la relation
inter-sexuelle. Garçons et filles se rejoignent dorénavant hors des surveillances attentives, des précautions et des subterfuges qui entouraient naguère encore l'éveil affectif. Les femmes, en effet, n'ont plus besoin de recourir aux mythes du coeur pour assurer leur plaisir désormais sans danger, et leur affranchissement, bientôt sans limites.
Leur maturité affective, plus précoce que celle des garçons, leur garantit l'avantage sur des partenaires d'âge égal et leur assigne ainsi l'initiative dans Je jeu sexuel. La virginité, jadis considérée comme un symbole d'honneur, voire comme un capital a préserver et à monnayer, se trouve, de ce fait dévaluée. L'acte sexuel lui-même n'implique aucun engagement moral, se réduit à un simple geste dépouillé de toute résonance profonde, et ne reçoit que la signification subjective qu'on veut bien lui accorder, au gré des caprices successifs.
La crise de l'amour Un auteur a dit quelque part que Je douzième
siècle avait inventé l'amour et Je vingtième siècle l'abolit. On peut donc se demander si cette crise de l'amour ne se révélerait pas comme une crise de la civilisation.
Aux régulations physiologiques qui commandent la sexualité animale, l'homme avait prudemment substitué une régulation par les interdits sociaux d'une part, et aussi une régulation par Je risque: risque vénérien ou risque d'une procréation inopportune. Les progrès de la thérapeutique et de la contraception sont aujourd'hui en voie d'annuler ces risques. Faute de toute conscience dans Je .péché, et faute de toute régulation matérielle, notre civilisation technique ne se voitelle pas exposée à verser dans une barbarie plus dégradante que les pires barbaries animales?
En vérité, la vie sexuelle ne peut se passer d'une éthique. Si l'homme sait trouver dans la relation à autrui Je sens d'une responsabilité et exprimer dans Je langage du désir l'aspiration à des biens supérieurs, il obtiendra de faire oeuvre créatrice et de collaborer à l'ascension spirituelle de son univers. Sinon, on devra craindre que soit à jamais compromis l'effort millénaire pour découvrir, à travers la pariade charnelle, des valeurs plus hautes, et l'homme et la femme se rejoindront non plus dans l'amour, mais dans Je mépris.
19
réflexions sur le problème au congo Docteur Gérard Ondaye
On a trop longtemps négligé l'importance de la sexualité chez l'homme. Elle devient aujourd'hui un élément conscient et scientifique du développement socio-culturel, parce que l'homme a voulu, à cause de son égoïsme, que le corps de la femme devienne un instrument d'excitation, et ce dans un but soit commercial, soit volontaire. La vie sexuelle est devenue l'une des plus importantes sources de déséquilibre, surtout dans les pays qui se disent «libérés.»
La vraie liberté est celle qui maîtrise l'instinct sans abolir celle qui permet le libre choix. La liberté ce n'est pas de considérer la sexualité comme un tabou dont on ne doit pas parler, alors que tout le monde en parle, ce n'est pas de refuser la connaissance aux enfants qui en ont besoin pour pouvoir juger d'eux-mêmes et agir en conséquence.
Sexualité et sensualité L'aliénation qui veut que les problèmes de
sexualité soient écartés au profit de la sensualité et du génital doit faire place à l'éducation de la personne humaine, en tant qu'élément social qui considère tous les autres éléments de cette société non comme des objets de jouissance, des esclaves, des tyrans, des idoles, ou des maîtres, mais des sujets libres et égaux.
Si la psychanalyse a eu le mérite de révéler au monde européen l'importance de la formation de la sexualité, il faut aussi, en tant qu' Africains, reconnaître que comme toute oeuvre, elle a son côté négatif, celui d'avoir négligé la puissance de la volonté maîtrisante de l'homme.
Complexe d'Oedipe, libido, voilà des mots qui doivent donner à réfléchir quand des Africains décident de se réunir pour étudier ensemble les problèmes de la sexualité. Je ne cherche point ici à désexualiser le complexe d'Oedipe, ce serait une
20
grave erreur, quand on sait que c'est par son père et sa mère que l'enfant apprend à connaître les sexes. Bien au contraire je voudrais seulement rappeler que les Africains que nous sommes, aliénés par la culture de ceux qui ont cru être la source de notre culture, oublions qu'avant Freud, l'Afrique d'avant l'invasion Européenne, forte de cette vérité, reconnaissait déjà que la sexualité humaine n'est ni un tabou, ni un jouet, et encore moins un objet d'enseignements magistraux, mais une discipline intégrante de l'éducation civique, morale et psychologique de l'enfant.
Les nations négro-africaines ont de tout temps attaché une importance particulière à l'évolution de la sexualité de leurs enfants. Les cérémonies d'initiation, de circoncision, de mariage, que quelques esprits malveillants ont considéré volontairement comme des rituels magiques et fétichistes, sont la preuve de l'intérêt que le négro-africain attachait à la sexualité. L'Afrique, ce continent aux mille coutumes, devrait faire réfléchir ses fils sur la signification profonde de certains rites, certaines coutumes d'hier qui, à cause de notre acculturation, passent pour dénuées de tout fondement scientifique et dignes de primitifs sauvages.
L'égalité des sexes Les adversaires de l'Afrique ont vu dans nos
coutumes barbarie, tyranie, commercialisation de l'amour, et domination de la femme, alors que le négro-africain peut se vanter d'avoir été et reste encore celui qui vénère et honore la femme. Celui-ci, depuis l'antiquité, a su reconnaître l'égalité en droit et en devoir à tous les sexes. Combien de pays dits civilisés peuvent, à l'exemple de!' Afrique, se vanter d'avoir eu tout au long des siècles des reines, des diplomates, des juristes femmes? Combien de pays peuvent comme les
nations négro-africaines, répondre tout haut que toutes les institutions, centrées sur la famille, ont été établies dans le seul souci de sauvegarder le bonheur du couple et de sa progéniture?
Nous devons, au cours de ce séminaire, étudier les problèmes de la sexualité par rapport, certes à notre époque, mais aussi à notre pays, car l'une des causes des perturbations de la sexualité en Afrique, se retrouve dans le non-respect de la tradition africaine, source d'équilibre et de bien être physique, moral et social du négro-africain. L'Afrique d'hier nous a légué tout un enseignement de l'éducation sexuelle. Il nous revient le devoir d'étudier une méthodologie nouvelle applicable à ces principes. La dot que d'aucuns avec l'apparition des monnaies occidentales ont transformé en commerce, est simplement un signe que la fille devra désormais quitter son père et sa mère pour s'attacher à son mari, ce mari qui doit lui procurer non seulement le bonheur et le bien être par l'amour, mais aussi par les soins matériels.
Dans certaines tribus, le versement de la dot était précédé d'une période d'observation des futurs époux: ainsi le fiancé devait vivre quelque mois chez ses futurs beaux-parents. Là, il devait donner la preuve par son travail, son sens du devoir, montrer qu'il était capable de donner un toit, et de la nourriture à sa future épouse qu'il se doit d'aimer en toute circonstance.
La fiancée très souvent avait fait des séjours plus au moins longs auprès de sa belle famille qui devait l'initier aux travaux de la maison, à sa future tâche d'épouse et mère, et surtout à connaître sur le plan psychologique son futur époux, car nulle mieux que la belle-mère ne pouvait connaître celui qui lui sera lié pour la vie.
Initiation traditionnelle L'initiation à la sexualité était connue et res
pectée de toute l'Afrique Noire et ce n'est pas par mystère que des adolescents de nos villages savent tout de l'homme et de la femme, sans pour autant être précoces sexuellement, comme cela se voit dans nos famillles dites évoluées. La mère africaine veille sur le développement staturepondéral de son fils, mais aussi sur celui de la sexualité, et elle ne se gène pas dès qu'elle remarque la moindre anomalie chez son fils de demander au petit camarade si celui-ci «réagit comme tout le monde».
Mais cette sollicitude, cette attention permanente des parents envers leurs enfants, loin de favoriser la précocité sexuelle, favorisait la maturité des fonctions sexuelles, harmonisait la sexualité. Il était rare qu'une jeune fille, même dotée très jeune, partageât avec son mari le lit conjugal avant l'épanouissement complet de toutes les fonctions endocriniennes, psychologiques et mentales. De même le mariage ne pouvait être prononcé si le mari était dans l'incapacité physique ou mentale de le consommer. La fille était l'amie, la confidente de sa mère, car c'est auprès d'elle qu'elle devait apprendre à devenir épouse et mère. Toute son éducation de fille, épouse et mère devait partir de la maison avant que la collectivité y ajoute le complément.
L'Afrique d'hier nous apprend que c'est à la maison que commence l'éducation de la sexualité et non dans la rue, à travers les revues pornographiques, les grands romans d'amour, les écrans de cinémas et l'importation des coutumes et modes parfois contraires à la bienséance africaine. En foulant aux pieds les preceptes fondamentaux del' Afrique sur la sexualité, certaines personnes ont fait de l'amour, source de bonheur et de bien-être physique mental et social, un amour purement vénal. Ce faisant, elles ont avili ce qui est beau, pur et noble. Si j'ai parlé de la dot, c'est justement pour relever cette erreur qui veut que l'amour vénal que nous connaissons aujourd'hui soit la conséquence de la dot. Cette opinion est fausse et ne peut être soutenue que par ceux qui ne veulent pas reconnaître ou ignorent tout de la culture africaine.
Un fait nouveau : la prostitution La prostitution semble un fait nouveau, du
moins en République Populaire du Congo. Elle peut être vaincue car je suis convaincu que la femme congolaise, par essence ne peut admettre de se vendre. Et si elle s'est p~ostituée, c'est parce qu'elle a été poussée par les besoins socioéconomiques et culturels imposés à elle par la colonisation et l'impérialisme. Il nous appartient donc dès à présent de protéger notre soeur par une prise de conscience nouvelle afin que nos enfants puissent un jour dire, l'Afrique reste l'Afrique, malgré les connaissance techniques et socio-économiques qui demeurent l'attribut de l'humanité entière.
21
Penchons nous un peu '-Ur les causes de cc: qui fuit l't>bJcl de cc séminaire. Id. cha~uc pays a ses problèmes. son expc;ncncc, ~i. échecs et sc:s réussites, et il ~c:rait dilticilc Je ~ènérali!>cr. Cc· pendant un lait reste \rai. Parh1u1 c.:n Afrique, la 1cune~~e pose un problème 'oc1al d'ordre moral, Cl\'iquc:. :.anitairc:. vom: méme pohuquc et é1:11nom1quc:. L'on pourrait croire que: le momie va a la dérl\c. Mail> l<1 JCUllC!IM! fait sun cxpêricnce, lia ré\'olutson. une ré\'olution qui s'i· d.:n111ic i1 son tcmpi. comme hu:r nous avons nous aussi rm!tcndu accomplir la nôtre. Notre devoir est ile canaliser cette révolu11011. lui indiquer la \'Oie de la réussite:, de la vérité pour un munde de pai11, de :.anté, d'égalité et de JUllli..:c suc1alc.
On a parlé de ré\•olu11un i.c\ucllc. Pcr">nnellc· ment j.: n'> cro1~ pa~. Je p.:n'c plu1ùt 4u"il s'agit d'111ad;ip1a11on de la :.exuahlc au\ ~ocîétés dan~ Jc,1.jucllci. nou~ 111von!I. Am~i. un peu partout. on parle de pcril ' 'énèncn en rccrudci.ccncc, de gro!>· ~csi.ei. non dé:.irécs. de hllc~·mèrcl>. d'a11llrtc·
ment~ criminels a'·ec forte murrnlitè. Croyet· 11011:> t.J,uc cc i.oil 41a, la révolu lion seii:uelle ·~
La l{épublit.tuc Populaire du ümg(1, l\llUr i.a pan. ne croil pa' à cette p~eudlHé\·ulutivn 4u1 n ·c,I autre que la conséquence Je ccrl:uni. fans h1sturu.(uc,, culturels et socio-ècono1111quc~ qu'il faut 1n\'cntoncr, anal~ser. pour puu\oir tin:r dcll le1;ons. t:n ce qui ntlU!> concerne. Je mal a commencé en 1964· I %5 avec une pointe en l 96X· 1%1J. cl Ici. cause~ doivent avoir leur~ origines. en plui. de 1'1gnmancc, dans les phènuménc~ sucio· èc1111om1qucs que nous cssayoni. de schcmatisi.:r.
Ll• ( ·un~c> lnH'l' .. on au.•nir i\pri:l> lel> trois gloncu!>e:. en 1963. le Congo
opte pour le i.ociah~mc :.c1c:nt1liquc. Puur > pancnir. 11 drnt d'abord arriver ;i l'unllé natm· nalc <l11n1 l'ab~cncc en l'.159 avaJI déJ:i c(1Utc chr:r au peuple. l.'élé111ent qu'il laut a\.oir. car plu" 111 a lléa bic. plus facile à con va inçrc:, c!>l la Jeuncs~e. C'c:!>t ainlli qu'en l'.IM Ici. lllllU\'Cmenl!>
de jeunes seront dissous et regroupés en un seul, la J.M.N.R. Toute décision, pour salutaire qu'elle soit, à son côté négatif. Les jeunes perdent là-même ce qui faisait leur force morale, leurs menues occupations, leurs loisirs, d'autant plus que la nouvelle organisation n'offre pas de structures pouvant remplacer le scoutisme, le jecisme, le guidisme, la vaillance, et l'idéal philosophique.
Plus tard c'est la nationalisation de l'enseignement. Les barrières jusqu'ici établies entre les sexes tombent brusquement, et comme toujours dans pareils cas, c'est l'occasion de manger le fruit défendu, même si ce fruit doit vous coûter la vie. Les tabous, l'ignorance, l'attachement aux théories philosophiques contribueront énormément à aggraver cette situation. Il faut citer en passant l'idéalisme de certaines femmes intellectuelles, sans connaissance de la réalité africaine, qui croient émanciper la fille congolaise en défendant la cause de la liberté sexuelle et des filles mères.
Toute révolution humaine a ses points sombres. Ce n'est pas la révolution congolaise qui échapperait à la règle. La période la plus difficile, la plus sombre de notre lutte fut avec une certaine gauche anarchiste qui fera régner la terreur et ne reculera pas devant ce que nous appelons volontiers la bestialité. C'est le libertinage en plein. La révolte des enfants contre leurs parents, la dépravation des soeurs. À ces faits historiques qui sont à classer aux erreurs de notre lutte pour la libération de notre pays, il existe des causes que je considère comme beaucoup plus déterminantes dans la situation que nous vivons. Ce sont des causes culturelles et socio-économiques.
L'école comme partout a manqué à son rôle de formation. Les problèmes de la sexualité en sont exclus, et même dans les cours d'anatomiephysiologie, on fait volontairement silence sur tout ce qui a rapport à la sexualité. Le petit Congolais se fait son éducation dans la rue, les parents l'ayant abandonné dès le jour où il a été baptisé, et ce, au nom de la morale chrétienne. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et cherchent à percer le plus tôt possible le mystère de ce péché qu'on commet par la pensée, par l'action et par l'omission. Sexualité devient synonyme de sensualité, précocité sexuelle, aventure sexuelle.
L'apprentissage du corps Devant cette situation, nous avions été obligés,
au cours d'un séminaire organisé à l'intention des institutrices, de lancer l'appel suivant en faveur de !'Éducation sanitaire et sexuelle:
«Combien de morts atroces, de mutilations de nos soeurs, d'avortements illégaux, de grossesses non désirées, de garçons et de filles qui ont rejoint les rangs de chômeurs par notre faute, parce que nous ne leur avons pas donné la connaissance, nous ne les avons pas éduqués en vue, non de se prostituer, non de limiter les naissances, mais de leur faire prendre une place dans cette vie où. ils ont eux-mêmes droit à leur part de bonheur.
Nous devons apprendre à la jeune fille, au jeune garçon, au plus jeune même, à connaître son propre corps, à en appécier non seulement la beauté, mais aussi la valeur, la richesse, et à le dominer.
Le jeune qui entre dans la puberté doit savoir ce qui l'attend, son devoir vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son pays. La fille africaine doit connaître, comme les autres filles sous d'autres cieux, la joie d'une grossesse désirée, le bon heur de porter dans ses bras un enfant attendu avec beaucoup d'espoir, d'amour et de tendresse. Nous devons apprendre à nos soeurs, nos élèves, ce qu'elles sont dans le corps et leur esprit de femme, ce que c'est qu'une menstrue, un cycle menstruel, l'acte sexuel avec ce qu'il a de plus beau, de plus noble, et les processus de la procréation. Nous devons apprendre aux garçons que le fait d'avoir des organes externes n'est pas un signe de domination et que virilité n'est pas synonyme d'exploits amoureux, mais un signe de complémentarité, d'union des corps et d'esprit.
L'oeuvre d'éducation est une oeuvre de longue haleine. Elle est difficile et délicate et requiert la collaboration de tous: médecins, pédagogues psychologues, assistantes soçiales, parents.»
Un problème urbain Ce pathétique appel se justifie quand on sait
que depuis 1965, le nombre de maladies vénériences ne fait qu'augmenter. Le nombre de grossesses, de filles mères, et avortements provoqués inquiète les chefs de famille, comme les dirigeants. Quand on sait le devenir scolaire d'une fille de seize ans obligée d'abandonner ses
23
études pour des congés de maternité, n'est-on pas frappé de voir les nombreux résidus que l'école actuelle met à la disposition de la rue pour un avenir incertain. Combien de suicides, d'empoisonnements n'aurait-on pas évité si l'on avait donné à la jeune fille, au jeune garçon, une information sexuelle?
Ce serait exagérer que de faire croire que le phénomène ici dépeint est général au Congo. Il s'agit d'un problème surtout urbain, intéressant les grandes agglomérations dans lesquelles le facteur socio-économique et culturel reste dominant. C'est justement à partir des villes que doivent commencer nos efforts, car bien souvent dans un pays, c'est la ville qui contamine la campagne. Si la ville importe de la campagne, la population, les vivres et produits nécessaires à la vie, elle reste néanmoins grande exportatrice d'idées nouvelles, d'habitudes, d'attitudes diverses.
Le manque de collaboration avec les écoles ne nous a pas permis d'établir des statistiques précises sur le comportement sexuel dans notre pays, et nous avons mis en place dans les écoles cette année une équipe spécialisée dans l'éducation sanitaire, nutritionnelle et sexuelle qui nous permettra dans les années à venir de mieux cerner le problème.
L'équipe mise en place se propose dans un premier temps d'entrer en contact avec le personnel enseignant, les élèves et tous ceux intéressés par les problèmes de la scolarité et de la santé des élèves pour créer une motivation, un besoin d'éducation. Ce premier travail réalisé, ils passeront à la pratique, mais là, le schéma de travail ne peut être le même pour tous les degrés d'enseignement et les divers établissements. Nous avons commencé par la tranche d'élèves capables d'appréhender l'importance des sujets évoqués, de comprendre le bien fondé de l'enseignement, je veux parler des deuxièmes cycles de l'enseignement secondaire.
Leçons et séminaires Les séances d'éducation se font sous forme de
leçons-discussions. Malheureusement nous n'avons jusqu'ici, faute de matériel, réussi à y adjoindre les moyens audio-visuels. Dans le premier cycle du secondaire, l'enseignement n'est pas obligatoire. Seuls les volontaires assistent aux
Jeune mère africaine
leçons, discussions et projections de dispositives, affiches ou images. C'est pour obéir aux réalités locales que nous nous gardons de généraliser cet enseignement.
Le primaire est le secteur qui nous pose le plus de problèmes car c'est par l'école normale d'instituteurs, par les maîtres, que nous devons atteindre les enfants. Malheureusement rien a été fait jusqu'ici en direction des écoles de métier, dont les écoles normales. Une lueur d'espoir perce cependant. Les élèves de ces écoles nous expriment eux-même .la nécessité d'intégrer l'éducation sanitaire et sexuelle dans les programmes d'enseignement. En attendant, nous organisons depuis deux ans des séminaires à l'intention des enseignants et instructeurs du Service de l'alphabétisation fonctionnelle des adultes. Dans les centres de protection maternelle et infantile, les quelques éducateurs sanitaires essaient d'y jeter les bases d'un enseignement des problèmes de la sexualité.
Il y a tellement d'imperfections dans ce que nous essayons de réaliser que nous pensons que ce séminaire est l'unique chance pour nous, une fois rentré au Congo, d'élaborer un vrai plan d'activité fondé sur les points que nous définirons
Un plan ne représente rien en soi, s'il ne peut par la suite être évalué afin d'en corriger les erreurs et exécuté. Or la réalisation d'un projet implique la possession préalable de techniciens et d'une équipe motivée et consciente de la tâche à accomplir avec ce qu'elle a de réussite et d'échecs. Nous n'avons ni techniciens, ni équipe cohérente solidement instruite des problèmes de la sexualité. Certaines méthodes à utiliser en matière d'information ou d'éducation sanitaire nous sont inconnues et le matériel éducationnel nous fait défaut. C'est encore pour toutes ces raisons que nous osons dire, notre reconnaissance au peuple malien et à son gouvernement pour l'accueil qui nous est réservé, car nous comptons beaucoup sur ce premier séminaire interafricain qui n'aura pas seulement un intérêt socioculturel, mais une bien plus grande signification : la volonté de !'Afrique de s'unir, de se connaître, de se comprendre pour mieux apprécier et lutter ensemble dans l'esprit de !'Organisation de !'Unité Africaine pour que l'Afrique vive libre et indépendante.
25
sexualité et fécondité dans la vallée de l'ouémé Par Roger Brand Ethnologue, Cotonou
Les populations concernées par cette étude sur la sexualité et la fécondité sont situées au nordouest de Porto-Novo, capitale du Dahomey. Elles sont d'origines diverses mais on les nomme « Wemenous »,ce qui signifie« les habitants de la vallée de l'Ouémé ». Parmi elles, nous trouvons des Yoruba-Nago venus de l'est, des Fon venus de l'ouest des régions d'Abomey et de Cavé, des Adja venus de l'ouest de la région du fleuve Mono, et enfin, les Aïzo qui semblent être une très vieille ethnie résidant sur les rives du fleuve Sô. Ces différentes ethnies et les divers courants d'immigration ont amené des changements importants dans la vie des populations, d'une part sur le plan linguistique et d'autre part sur celui de certaines coutumes propres à telle ou telle ethnie: par exemple le statut des femmes dans le mariage. Ainsi, nous avons des villages d'origine Yoruba qui gardent encore les lois d'origine concernant le mariage mais qui ne parlent plus un seul mot de Yoruba et qui ont perdu leurs grandes divinités nommées « Orisha ». Par contre, nous trouvons des villages d'origine Fon ou Adja et même Aïzo, qui ont accepté les divinités Yoruba, et c'est le cas également de certaines sociétés secrètes telles les sociétés de Gelede et d'Oro.
Ces populations vivent en villages, soit le long des rives de l'Ouémé et de la Sô, soit sur les bords du plateau qui borde la rive gauche de l'Ouémé. Il n'y a aucune habitation isolée: toute vie humaine est groupée autour d'une divinité appelée « Vodun ».
LES CULTES YODUN Nous pouvons dire que les cultes Yodun s'a
dressent aux forces de la nature et aux ancêtres divinisés, que les Wemenous adorent et servent. Le rituel Vodun est fondé sur l'expérience et sur
Statuette articulée utilisée pour /'éducation sexuelle dans le culte Vudun
les données des sens. Le monde imaginaire qui dirige les cultes Yodun, est le seul à pouvoir donner une signification à la vie quotidienne immédiate.
Ainsi, le rituel est capable aussi de trouver des solutions positives à un grand nombre de problèmes importants, solutions qui n'ont pas besoin d'être vérifiées. Toute solution proposée par le rituel est efficace en elle-même tant au niveau de l'individu qu'au niveau du collectif. Certes, telle solution peut être préférée à une autre par l'individu ou le groupe qui doit la vivre et l'intégrer à sa vie, mais en aucun cas cette solution n'est mise en doute ou à l'épreuve auparavant. La solution proposée réclame une adhésion totale et définitive sans quoi son efficacité n'est pas possible. Nous verrons ainsi comment les cultes Vodun règlent la vie des gens au niveau de leur sexualité.
Groupées autour d'un Yodun, les familles ont constitué des villages. Les Wemenous sont essentiellement tournés vers le travail de la terre: culture du maïs blanc, d'haricots rouges, de manioc, d'igname, de patate douce, de taro, ainsi que des légumes, notamment les épinards et les tomates. Ils ap.provisionnent, tous les cinq jours, les marchés de Dangbo et d'Azoolisé pour les populations de la vallée de l'Ouémé et les marchés de Porto-Novo et de Cotonou; en fait ils approvisionnent les deux seules grandes villes de la côte. Le transport des vivres se fait en pirogue par les fleuves de l'Ouémé à l'Est et la Sô à l'Ouest, et à travers le lac N okoué.
Il existe aussi de nombreux pêcheurs sur le pourtour du lac Nokoué et sur les rives des deux fleuves. Ceux-ci approvisionnent d'abord en poissons, les habitants des villages, puis le marché de Cotonou.
Pour une telle étude, il nous a fallu organiser et simplifier les données recueillies auprès des populations afin d'en tirer un maximum d'enseigne-
27
ments ~us.;eptibles d'être ullk~. l:n effet. nuU!> n'aH>ns jamais cntrepm. une enquête !.)!itèmall· que i.ur I~ prohlèmc!t de la l>c>.ualltè. mais n~lU:. a11ms l'écu plusu:urs année!> parmi cc:. popula· lions cl nuus avons rcle1é certaines altitudes se· ucllcl> qui nous 0111 intérel>~C. l.n aucun ca~
n'avom •• nous fait une enquête du style" CAP,.,• Pour celte étude sur la fécondité et l:1 sexualité
del> lrnbilants de la vallée de l'Ouémè, nous av()n!> établi trois niveaux le premier niveilu concerne l'éducation !>cxuclh: de lïndi11du dunnèe par le!> p;m:nts génllc:urs et l'cnloural!,?e de ceux-ci; le ~econd niveau concerne l'ci.Juca11on !tC\uclle des ind1v1dus donnée par la société, le troi~ième niveau concerne réducation i.e>.uclle part1cuhére donnée Ju:\ initiés de certainl> cuhe~ Vrn.lun. En unnexc. le point de vue lëm1nin du cumpor1cmcn1 sexuel des femmes dam. la vallée de l'Ouèmé sera ;malysé par Fanny l.inty, notre 4.:ollahoratricc:.
tducation sexuelle de l'rnd1v1du donnée par. se!> parents géniteur~ : Le premier 1111•eau concerne r éducation sexuelle tic l'indlVldù donnée par les purent!> géniteurs ""'JÎIÔ 11 et l'cntuural!c de ces derniers. L "éducallon ~c:xudlc de l'mdi\' Îdu n'eiuste pas en tant qu'cnse1gncmcnt comme nous le concevons. Elle exisle à plu)ICUr!> niveaux et elle n'a p:.i!> la même ~alcur ~elon le ~exc Il e~t dont hon de voir sépmémcnt l'êducJlion sexuelle donmie aux garçon!> cl celle donnèe aux lilles. l.c passage de l'étal d'enfant à l'ê!Jt d'adulte sur le plan sexuel est très împ1)rl:in1 pour les deu"' sexe!>. l>ans la description de l'èducat1on )Cxuelle de!. ~arçons el de~ fille!., nou~ donneron~ les élêments importants qui caractèmenl l'è\eil à la sexualité.
1,'U>l lCATIOl'li SEXl' El.l.F m.s GAR(Ol\S L'éducauon sexuelle du garçon ~ fuît sous la
rc,ponsabilité des homme!> et en premier lieu ~ou~ la n:spon!>abilité du pi:rc l!Cni1eur. (La mère peul ) participer. mai~ ne prend pas d'initiatives.)
Le père oblige la mère à foire le premier bain du bébé garçon : cc premier bain cunsislc à pl1inger le bébé, le ventrc en l'air, dans une eau assez choiude. L'eau chaude a rour effet de provoquer l'êrecllon de la verl,le d~ l'enfant. S1 la verge se drc!.tse, le père est sali!>f;ut, ainM que la mére. L'êrcd1on de la verge du hèbè Mgnttie pour le père que Min enfant n·e~l p;ii; 1mpu1~sant. Elle est le signe de la puissance l>C\ucllc en rapport a1'ec la procréatil)n.
1 111111- J)\I ll-'110\IU
d .'.l rC','H1" ttuthro C'"-' tl.•.Ji.ufcc) :-':~
j~i~
, ' , ,-,
1
' ' 1 I
• I , . .
... .! •t•
J Per41co,. , . . , '. ', .
1 1,---... _ ..
1~· 1 ... , ,. ............. -... ' 1
f l Ot.U "
< 'ur11• d11 /Jultomi•r. l.u r(•gum à111/u•1· t'SI l11it'lwrét'
N 1 t;J lt I A
OVf.M(
Le pérc indique le moment où dc\ra être: 1,;1rconc1~ Slln lits. C'e:;t lui qui dêcide Je la ma1urilé de ~on enfant, sur le plan physique cl aussi i.ur le plan économique. Un père peut décider de taire circuncm: i.on enfant en vue de cunclurc un mariage 4u1 lui sera hénéllquc alors que l'enfant n'a que i:inq ou six ans, ou afin qu'il pui~~e foire par-
• ( '1• .roJtll tle.\ enq1u•1c•.r qui ~·i.wnt ù défe,,nim•r lt1 t"OllllUl.\.\CJfl('t'. 1 C / les tJllitudt•s f A J et /cJ prat/-1/llt' 1P1 dl' la rvntraaptitm dam 1111t• pup11lat1ut1 dontlét' /Je flmnbrt'11s1·.~ e11quh1•s dt' typt• CAP ""' été mt'llét•s '°" Afriqut'. e11 génhal awr dt• muig"'J rèç11/1au. (Nuit' Je /'Mi11:ur J.
,. ... " .! ...
{ \kl'I· Dfl •\11111
Ill; l .\ K 1 1;10"
Dl VOi JI MC
-"' -.. .. c: ... .,
-...
lie d'une ~oc.:1étè d'homme!. ou d'un c.:ulti: Vodun. Le père explique à son garçon les rappoM!.
sexuels. Dé\ que son ~arçon a été dn:oncis, le père peul lui expliquer c;ummcnt !.e fonl Ici. rappons sexuels entre homme et femme. Cela rc· vient à dire 4ue le père lui enseigne c.:ommcnt se sc:n·ir de son seAc:, où ç'c!i.l posi.ible et ou cc n'est pas pos~iblc, et quand c'est possible. Il lui apprc:nd à prendre grand ~0111 dei.on ~eAc .. ncn '"ou •t nckui "· Il lui indique aus!.i un cerlain nrnnhre d'aphrodisiaques qui lui permcuront d'avoir de hc:au11 cl Ions enfants.
Le: père lui parle de!> rîsquci. dïmpu1s..,anc.:c. li fait faire: de~ scarilicatiom i.ur le: c.:orjb de l>On
garçon alin de le protéger contre l'impuissance que des sorciers p1>0rraicnt lui envoyer; .:es si:a· rili1:at1ons ~ont frutes sous le!> deux umuplatc:s. 11 lui cn~1:1gnc: J'ut1hsat1un de remède~ i.:ontrc l'im· pu1!>!.ance: plante!., 111grèdient!> 1.h\ers. Il lui ap· prenu ucs paroles cllit:accs à prononi:cr lorsqu'il devra ~e servir de i.:cs rcmédes. Il lui lionne des cun~dl' en vue de ne pas perdre: sa \'mlité. reconnue .rn mumenl du pn:m1er bain. par exemple nc pa'> marcher sur un p)thon ou rcnjamhcr. éviter le~ hOllllllCS Cl le~ l'c:mmc:s cons1dérél> par la ~11c1été nimme sorciers, et beaucoup d'autres cni.:i>re .
fous cc!> conseils sont donnés au moyen de contcs, proverbes. histoires plaisante~. et aussi en induiuant que tel homme est 1mpu1i.i.ant uu telle femme stérile:. Le fait que le père informe son llan;on circom:is de certains problémcs liés à lu procréation amène le 1.rnn;on à se conlier à lui lor!>4u'il a des dillicullés d'ordre sc:ll.ucl, par e\emple une maladie 4u'il aurait pu c.:ontracter km; de rapports scxuell> a\ cc del> femmes hbres de ,un village ou d'un village voisin .
I.e rôll' de la mi:re l· n fait. c;'c:st la mère qui commence l'~duca
tion w\uclle à ~on enfant, qu'il soit garçon ou hile. Hic donne le premier bain â i;vn gan;on: ce premier bain drnt révéler la virilité ou l'impuis· sancc lie son enfant. Oès cc premier bain, la mère orientera l'enfant vers l'usage: de son i.cxc.
l:lle évc:dle le garçon à la sexualité physique· le: premier bain a pernm de reconnaitre la \'1rilité du gan;on. 11 faut que œttc vi rililé ~u11 nun sc:ulc:mcnl protégée contre le "magnan 11 , esprit mauvais qui rend les hommes impu1~san1s, mais dévdoppée, d'où celle pratique du ma~~agc: de: la verge lurs du bain quoud1c:n du gari;un
A chaque to1lcUc du petit garçon. de la nais~ancc JUS4u'à troi~ ani;, la mère fail cuulc:r sur le gland un mince filet d'eau 1ièdc pendant une honne tli1aine de minutes; en même tempi;, la mère accompa~ne de la main la pc.iu qui recouvre le gland. Elle répète cc: geste JUl>qu'au mo· ment uù la verge entre: en èrcc.:t1on. l.a tuih:tte ûu béhè !le lait ainsi c.:haquc JOUr : celle tuilclte si dè· taillée des organes génitaull du gilrcyon permet de lutter contre les inllammations, appch!cs aussi cc magnan "· dûc:~ à la chaleur et à l'humidité ambiante. D'un côté, nuu~ avun:. le souci de
l'hygiène, et de l'autre la peur des maladies qui pourraient donner l'impuissance. Toute maladie est causée par un esprit ou donnée par un sorcier.
En plus de ce bain particulier donné à la verge, la mère fait de même avec l'anus, « migômê » et lui applique fréquemment des clystères. Ces clystères, souvent à base d'eau tiède et de piments rouges, permettent à l'enfant d'être toujours propre, mais aussi d'être éveillé à la sensualité. Nous trouvons deux éléments essentiels à l'éveil du plaisir: d'une part la douleur, d'autre part la jouissance.
Que peuvent signifier réellement ces pratiques? Il faut dépasser l'explication s'arrêtant au seul aspect de l'hygiène et voir comment l'enfant est ainsi éveillé dès sa naissance à la sensualité, dans un but procréateur. L'érection de la verge est pour la mère et la famille le signe que le garçon est puissant et qu'il pourra donner la vie dans l'avenir.
L'aspect positif d'une telle pratique repose sur la notion que partagent les parents géniteurs et les autres membres de la famille, qu'il faut lutter dès la naissance contre la stérilité ou l'impuissance. Nous constatons que ces populations sont orientées vers une puissance physique du sexe qui doit donner la vie. Ceci est tout à fait normal du fait qu'elles ne connaissent pas médicalement le phénomène de la stérilité.
La circoncision La circoncision est l'événement le plus impor
tant pour les jeunes garçons. L'âge de la circoncision varie beaucoup d'un village à l'autre et d'une famille à une autre, entre six et quinze ans pour les garçons vivant dans les villages de la basse vallée de l'Ouémé. C'est le père géniteur, sur les conseils du chef de la grande famille, qui décide de faire circoncire son enfant.
Pour l'opération elle-même, il fait appel à un grand spécialiste. Ce dernier est un paysan et il est le seul dans toute la vallée de l'Ouémé à pratiquer rituellement la circoncision et à faire les scarifications rituelles sur les corps des initiés au culte Vodun, ou à faire des scarifications esthétiques demandées par les jeunes filles. Parfois, c'est un oncle paternel de l'enfant qui pratique l'opération. Maintenant, l'opération est pratiquée par les infirmiers dans les dispensaires.
À quoi correspond la circoncision? Dans toute
30
la vallée de l'Ouémé, la circoncision « gbo ado », des garçons n'est pas une cérémonie publique. Souvent, ce n'est qu'un seul garçon à la fois qui subit cette opération; parfois plus, mais cela est rare.
La circoncision correspond pour le garçon qui la subit à un passage de l'état d'enfance irresponsable à l'état d'un jeune garçon qui s'intègre à la société des adultes. En effet l'enfant, garçon ou fille, jusqu'à l'âge de sept ou dix ans, appartient au domaine de l'irresponsabilité et vit en somme dans la sphère maternelle et féminine. Il faut sortir le garçon non circoncis, appelé« atôtô »,de ce monde pour qu'il puisse rejoindre le monde des hommes.
La circoncision marque cette coupure avec le monde féminin et son entrée dans le monde masculin. La circoncision place le garçon au niveau de son sexe réel: c'est un mâle. Elle le rend responsable de son sexe: il devra maintenant prendre des précautions pour ne pas devenir impuissant. L'âge nubile pour le garçon se dit« asidida huenu » (femme prendre maison), ce qui signifie que le garçon circoncis peut prendre une femme et l'amener dans sa maison. Le garçon de sept ans circoncis aura un nouveau statut dans la famille mais aussi dans la société.
Conséquences sociales de la circoncision Le garçon pourra écouter les propos concer
nant le mariage. Dans sa façon de vivre il devra faire attention aux autres, tout spécialement aux femmes. Voici un exem pie du changement de statut d'un jeune circoncis reconnu par les femmes elles-mêmes: nous avons pu voir des réactions de jeunes femmes initiées au culte de Sapata interdire à des garçons âgés de sept à quinze ans de s'assoir sur leur banc parce que ces jeunes garçons avaient été circoncis quelque temps auparavant. Surpris par cette réaction, nous avons interrogé ces jeunes femmes, qui ont répondu: «Maintenant, untel est devenu homme; il a été circoncis; son baton (verge) peut ouvrir mon chemin. Alors, il faut l'éloigner de nous car il n'est pas notre mari.»
Le garçon pourra assiter à certaines cérémonies familiales et rituelles des cultes Vodun et entrer dans les sociétés secrètes régies par ces mêmes cultes Vodun. Ces sociétés composées uniquement d'hommes, lui sont ouvertes si son père
géniteur ou le chef de la grande famille le lui permettent. Certes, tous les garçons n'y entrent pas, mais en général les jeunes garçons circoncis sont pressés d'y entrer car ils deviennent de ce fait des membres actifs de leur village. Ces sociétés vont les initier à devenir des hommes, tant sur le plan de la force que sur le plan de la sexualité
Aucune de ces sociétés (l'une se nomme « Zangbêto », ou gardien de la nuit, une autre «Oro») n'accepte de femmes; leurs activités sont orientées vers une coercition des femmes: elles ne doivent pas sortir la nuit lorsque les« Zangbêto » sortent, ne doivent pas sortir de la case lorsque « Oro » se fait entendre, même pendant la journée. En définitive, les garçons circoncis appartenant à une société d'hommes sont initiés par celle-ci à leur rôle d'homme en lutte contre la femme.
Ces sociétés secrètes d'hommes remplacent le père géniteur dans son rôle d'éducateur: le jeune circoncis, membre d'une société secrète, est ouvert aux problèmes collectifs et apprend à contrôler ses instincts. Dans l'une des sociétés, « Gelede », les garçons sont initiés aux relations sexuelles à travers des danses où ils sont travestis en femmes et simulent le coït avec d'autres garçons maintenus dans leur rôle d'homme.
L'ÉDUCATION SEXUELLE DES FILLES L'éducation des filles appartient aux femmes et
en particulier à la mère. Le rôle du père est insignifiant jusqu'à l'âge de sept ans dans le cas où la mère de la fillette reste auprès de son père. Mais si la mère a quitté le père géniteur de la fillette, celui-ci a une influence indirecte sur l'enfant, car elle apprendra rapidement qu'elle devra le rejoindre vers l'âge de sept ans. Nous avons vu quelques mères refuser cette obligation et parler d'une façon désobligeante du père.
Le rôle du père se borne en attendant à faire quelques cadeaux de nourriture et d'argent. Mais aussi, le père peut déjà promettre sa fillette en mariage à un homme; ce dernier pourra voir l'enfant et lui faire des cadeaux. Dans certain cas, la fillette sera mise au courant de la situation et toute la maisonnée lui parlera de son mari.
La mère éveille la fillette dès sa naissance à la sensualité. Le bain quotidien est le moment propice à cet éveil. Lors de ce bain la mère excite le clitoris au moyen d'un filet d'eau tiède qu'elle fait
couler pendant une dizaine de minutes; en même temps, la mère masse le clitoris et étire les petites lèvres. L'anus aussi reçoit un bain quotidien provoquant (comme c'est le cas pour le garçon), l'excitation de cette partie du corps.
Cette excitation est provoquée en vue de lutter contre la frigidité. Si pour les garçons, le premier bain permet de vérifier une éventuelle impuissance physique, pour les filles, il n'en est rien; d'où le massage du clitoris et des petites lèvres afin de préserver la fillette d'une éventuelle frigidité, vue comme stérilité. L'excitation pendant le bain de la fillette se fait jusqu'à l'âge de trois à quatre ans. La mère génitrice est souvent remplacée par une soeur utérine plus âgée ou même par une co-épouse.
Nous avons vu maintes fois des fillettes âgées de quatre à sept ans éveillées à la sensualité de leur sexe par des adultes hommes. Ces fillettes sont assises sur les cuisses d'un vieux, et celui-ci, tout en bavardant avec elle ou avec un autre homme, excite de son petit doigt gauche le clitoris et les petites lèvres. Les fillettes se laissent faire et l'assemblée ne dit rien.
Cette excitation du clitoris et l'étirement des petites lèvres deviendra une véritable initiation vers l'âge de douze ans.
Après trois ans, la fillette rejoint le groupe des fillettes âgées de quatre à douze ans. Jeux et petits travaux de la case sont leurs occupations. Elles jouent avec de petites poupées qu'elles confectionnent avec des branches ou qu'elles se font acheter au marché: elles les portent sur le dos à l'instar de leur mère, dont elles imitent le rôle.
La mère s'occupe avec soin de sa fille lorsque celle-ci a ses premières règles. Elle va lui donner surtout des conseils en relation avec la société: elle lui enseignera tous les interdits liés aux règles, lui apprendra a confectionner des linges cachant son état et à préparer des aliments spéciaux pour ces jours.
Les premières règles C'est le moment où, pour la famille génitrice
(ajitô), la fillette passe dans le monde des adultes. Elle quitte le monde des enfants qui passent leur journée à jouer et à faire quelques petits travaux. Maintenant, elle devra participer pleinement à la vie de la famille: aller aux champs, préparer la nourriture pour toute la famille lorsque ce sera
31
son tour, aller vendre les produits des champs au marché.
Si son père est polygame, la jeune fille sera soumise non seulement à sa mère (génitrice) mais aussi à la première des femmes de son père, si sa mère n'est pas cette première femme. En accord avec son père, la première femme, la mère, et les autres femmes détermineront le jour ou la semaine où elle devra être au service de toute la famille: faire la cuisine et le ménage, tirer l'eau, nettoyer les vêtements du père et des enfants, recevoir les invités et les étrangers de passage.
En définitive, elle acquiert le statut de femme et devra être respectée comme telle. Au contact de sa mère ou des autres femmes de la maison, elle apprend tout ce qui concerne le phénomène des règles: les interdits liés aux règles, les sanctions liées à la transgression de ces interdits liés aux règles. Elle apprendra à se retirer dans la case pnlvue pour les femmes ayant leurs règles, «la xô ».
Les premières règles sont l'occasion d'ouvrir la jeune fille à la con naissance de ce qui régit la vie de tout homme et spécialement des femmes. Les menstrues se disent<< la». Les premières règles se disent « sê la » - les règles de « Sê ». La mère ou une vieil1e femme de la famille raconte à la jeune fille devenue « yôkpô » (fille nubile), qui est Sê. Il s'agit d'un guide, créature de Dada Sêgbô, placé auprès de chaque homme et de chaque femme pour les diriger et qui les suit partout. L'influence du Sê se poursuit tout au long de la vie. C'est donc le Sê qui ouvre le chemin de la vie à la jeune fille en lui donnant ses premières règles.
Un nouveau statut C'est à partir de ce moment que le père peut
décider de donner sa fille en mariage à un homme ou de promettre sa fille à un homme. Les premiers échanges d'ordre économique peuvent avoir lieu tout de suite entre le futur mari et la famille de la jeune fille, ce qui entraîne pour la jeune fille des obligations envers l'homme qui désire la prendre pour femme: elle soit s'abstenir d'entretenir des relations avec un autre homme ou de chercher un autre mari. Ce changement de statut au niveau de la famille est reconnu aussi par la société: les habitants du village et spécialement les hommes voient en cette jeune fille devenue nubile, « yôkpô », un nouvel élément qui peut
32
être bon pour eux. De jeunes garçons de son âge lui font la cour, et vont, dans certains cas, jusqu'aux relations sexuelles complètes.
Les hommes reconnaissent à la jeune fille nubile son nouveau statut en lui prodiguant des conseils sur le mariage, en lui faisant de petits cadeaux, en l'invitant lors des cérémonies mortuaires dans leur famille. Cette reconnaissance de la jeune fille nubile va même plus loin: ainsi en langue Wemênou le temps de la grossesse se dit: « xo huenu »(ventre maison), ce qui peut signifier un passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte donnant la vie. « Xo huenu » signifie aussi «âge où l'on peut être frappé.» En effet, un enfant, fille ou garçon, ne peut être en aucun cas fustigé publiquement ni enchaîné. Par contre, un adulte, lorsqu'il a transgressé une loi sociale, peut être fustigé et enchaîné sur la place du village.
Ainsi, la jeune fille nubile, lorsqu'elle est enceinte, acquiert le statut complet d'adulte et de ce fait peut subir toutes les lois et contraintes des adultes. Ce changement de statut social lui permet d'entrer dans le groupe des jeunes filles du village de douze à vingt ans qui vont lui apprendre à devenir une jeune femme.
La pratique de l'étirement Le deuxième élément important de l'éducation
sexuelle des jeunes filles concerne l'étirement des petites lèvres et du clitoris. Cet étirement mécanique nommé « yodindon », est pratiqué couramment dans la vallée de l'Ouémé par les jeunes filles de douze à vingt-trois ans, avant le mariage, afin d'avoir un clitoris appelé « ananganta » (développé). Les femmes mariées pratiquent aussi cet étirement lorsque le mari trouve le clitoris trop petit ou pas assez excitant.
Les jeunes filles pratiquent l'étirement dans la case de l'une d'elles, et surtout le soir, soit seules, soit à plusieurs. Il leur faut une orange acide, appelée « danxomêgbo », une brindille de branche de palmier, appelée « xacucu » qui sert à percer l'orange et en retirer le jus, et un petit pagne qu'on roule en forme de noeud (pour s'assoir) appelé « kansunnun ». La jeune fille se sert uniquement de sa main gauche pour l'étirement. Elle s'enduit du jus sorti de l'orange, étire les petites lèvres, masse le clitoris et l'étire également. Cette pratique peut durer de dix minutes à une heure. Pendant les séances collectives, les plus âgées ra-
content des contes ayant trait aux effets de cet étirement: déboires des femmes vis-à-vis des hommes, déboires des hommes vis-à-vis des femmes, et avantages de cette pratique tant dans les relations entre hommes et femmes que dans sa pratique entre les femmes elles-mêmes.
La main gauche ayant servi à l'élongation du clitoris est porteuse de stérilité (d'impuissance) lorsqu'une femme, après l'étirement, met les doigts de cette main dans la bouche d'un garçon. Parfois certains garçons sont conviés à ces séances et y assistent. Certaines mères refusent à leur fille de pratiquer l'élongation en commun pour plusieurs raisons: la jeune fille apprend trop de choses sur la façon de se servir de son sexe; aussi ces séances permettent à la fille d'entretenir des relations avec des garçons qui peuvent y assister. Les femmes de cette région pratiquent l'élongation des petites lèvres et du clitoris en partie par réaction contre l'excision, qui était pratiquée par les groupes Yoruba venus s'installer dans la région. Les femmes veulent aussi égaler les hommes dans les jeux de l'amour. Certaines femmes nous ont dit qu'elles« faisaient jouir l'homme du fait de l'élongation du clitoris» et qu'elles maitrisaient la jouissance dans les relations sexuelles. D'autres femmes disent que, grâce à l'étirement des petites lèvres, elles peuvent interdire à l'homme l'accès du vagin:« Les petites lèvres ferment notre chemin». L'élongation apparaît ici comme un moyen de défense contre le pénis de l'homme qui veut la pénétrer. Pour certaines femmes, les petites lèvres élongées sont vues comme une sorte de préservatif.
Une forme de libération Aussi, faut-il voir dans ce phénomène le désir
de la femme d'être libre de sa sexualité par rapport aux désirs de l'homme, de jouir et d'avoir des enfants. La femme, du fait de cette pratique particulière, a acquis une expérience sensuelle de la sexualité en se passant de rapports hétérosexuels. La jeune femme vierge, comme la mère, peut par ce procédé se libérer des contraintes d'une sexualité basée sur la puissance de l'homme.
Il nous faut mentionner ici l'enseignement de moyens contraceptifs traditionnels, donné pendant les séances d'élongation des petites lèvres et du clitoris. Cet enseignement est donné par les
plus âgées. Ainsi, toutes les jeunes filles arrivent à connaître les plantes, paroles efficaces et autres moyens qui les empêcheront d'être fécondées lors de rapports sexuels complets.
Pour les hommes, l'élongation des petites lèvres et du clitoris apporte un plaisir pl us grand que dans le cas de non-élongation.* C'est ainsi qu'il y a des femmes mariées, non originaires de la région, qui doivent sur les instances de leur mari pratiquer cette coutume. Cette coutume est assez étendue dans la vallée de l'Ouémé; nous avons consulté le.s sages-femmes des maternités d'État, qui nous ont dit que huit femmes sur dix avaient pratiqué l'élongation. En ville et dans les grands centres urbains, elle semble en regression, mais pas dans les villages de la vallée.
L'importance des seins Le troisième élément important dans la
sexualité féminine repose sur la sexualité découlant des caresses faites aux seins. Le rôle des seins dans la vie sexuelle féminine est important. À un premier niveau, la sensibilité féminine est centrée autour des seins dans son rôle maternel. L'enfant joue très souvent avec les seins de sa mère et spécialement le mamelon. À un second niveau, la sensualité féminine est entretenue par des caresses et des succions des mamelons entre femmes. Nous voyons très souvent des jeunes filles qui ont des jeux érotiques très beaux basés uniquement sur des caresses et des succions des seins.
Les seins, siège d'une grande partie de la sexualité féminine, sont aussi des critères de
*W. H. Masters et V. E. Johnson «Les réactions sexuelles» écrivent à ce sujet: «Des récits rapportent que certaines tribus africaines mesurent la sexualité de la femme d'après la longueur du clitoris et /'hypertrophie labiale. Dans ce but, dès /'enfance, les femmes de ces tribus subissent des manipulations pend,ant un nombre d'heures inca/eu/ables pour stimuler le développement de cette érection artificielle. On a rapporté que ces filles obtenaient une hypertrophie évidente du clitoris et des petites lèvres, sinon au moment de leur puberté, du moins vers treize ou quatorze ans. Bien que /'hypertrophie par manipulation soit reconnue possible, il n'y a pas d'informations sûres reliant directement /'hypertrophie à une sexualité particulièrement intense.» (p. 78.)
33
beauté non seulement pour les hommes mais aussi pour les femmes elles-mêmes. Chaque forme de seins porte un nom et il existe toute une littérature orale les concernant. Les jeunes filles entre elles peuvent envier les seins d'une telle ou faire des réflexions sur ceux des autres. Les garçons reprennent les dénominations des seins données par les jeunes filles et parlent d'une telle en fonction de ses seins. Les différentes formes de seins sont l'occasion de contes plaisants, soit en faveur d'une jeune fille courtisée, soit pour se moquer d'elle. La forme dite« kanon » appartient à la catégorie des seins naissant appelés « anonkuin », qui signifie «graine de sein». Les jeune, filles n'aiment pas rester à ce stade et les hommes se moquent régulièrement de celles qui restent longtemps à ce stade. La forme dite « gonon », ou calebasse droite, est la forme préférée des hommes et des femmes, le critère esthétique le plus appréciée. La forme dite« dogbenon » correspond aux seins flasques et pendant très bas. Dès qu'une jeune femme a eu sa première maternité, ses seins ont tendance à prendre cette forme. D'où les mots dépréciatifs des hommes vis-à-vis du corps d'une jeune mère. Pour l'ensemble des hommes, la jeune mère a quitté le monde des jeunes filles non seulement par sa maternité mais aussi par les critères de beauté que représentent ses seins.
Les seins sont les éléments primordiaux des préludes de l'amour entre hommes et femmes. Lorsqu'un homme désire avoir des relations sexuelles avec une jeune fille ou une jeune femme, il
Kanon (graine de sein)
34
la complimente sur ses seins et tâche de les toucher, de les caresser. Si celle-ci accepte ce jeu, cela veut dire qu'elle accepte les désirs de l'homme et les futurs rapports par la suite. De même, une femme peut présenter ses seins à caresser à un homme: cela signifie qu'elle désire avoir des relations avec lui.
Scarifications et tatouages Les scarifications et les tatouages sont aussi
des éléments importants de la sexualité féminine; ils apparaissent comme des éléments esthétiques de la beauté féminine. Sans rentrer dans une explication des tatouages et des scarifications, nous pouvons dire que beaucoup de femmes se font scarifier pour attirer les hommes et certaines se font même tatouer le nom de l'homme qui deviendra leur mari ou qu'elles aiment.*
LE RÔLE DE LA FAMILLE Afin de situer le problème de toute éducation
d'un enfant dans ces sociétés à histoire orale, il faut parler des rapports des parents géniteurs entre eux, et des autres membres de la famille.
Sans faire une étude de la parenté dans ces sociétés vivant dans la basse vallée de l'Ouémé, nous situerons le rôle de la famille polygame dans l'éducation sexuelle des jeunes garçons et fillettes.
*Ed. Foa, «Le Dahomey» écrit à propos des tatouages: «Chez les femmes, le comble de /'élégance consiste en un gros pointillé en relief au niveau de/' estomac et limité sur un espace parfaitement rectangulaire, carré ou losange» (p. 163.)
Go ta (tête de calebasse)
En effet, les échanges matrimoniaux sont nombreux et nous trouvons des situations fort différentes, allant d'un régime à filiation patrilinéaire et à résidence patrilocale, à un régime à filiation matrilinéaire et à résidence patrilocale.
Le rôle de la famille nucléaire (père et mère vivant ensemble avec leurs enfants) dans l'éveil de la sexualité des enfants est important. Il y a un enseignement tacite: la vie communautaire d'une famille permet aux enfants de voir les rapports sexuels entre leurs parents et d'en connaître la fréquence; l'éducation sexuelle se fait dans la case. Cet enseignement est reconnu par la société et les cas d'inceste (appelé« lô »)sont condamnés s'ils sont connus de la société.* (En langue Wemenou, le terme « Xo lô » signifie d'une part inceste, et d'autre part «battre ses parents». Nous remarquons deux aspects: le premier d'une souillure des parents par un acte envers leurs enfants, le second d'une souillure des enfants qui battent leurs parents. Le spectacle des relations entre leurs parents amène parfois les enfants âgés de sept à douze ans à les imiter entre eux.)
Lorsque le père est polygame, sa vie sexuelle apparaît aux autres comme étant puissante. Les enfants, filles et garçons, voient que le père peut exercer sa virilité auprès de plusieurs femmes dans sa propre concession. Nous avons toujours été frappé de la fierté des enfants de polygames devant la puissance fécondante du père. Par contre, la puissance fécondante du mari polygame est souvent une source de jalousie entre coépouses: les plus âgées sont délaissées pour des
Go non (calebasse droite)
plus jeunes qui peuvent donner la vie. Tous les enfants nés d'un père polygame reçoivent une même éducation lorsque leurs mères restent dans la concession.
De ce que nous venons de décrire sur la formation sexuelle des filles et des garçons, il est possible d'établir des schémas donnant les différents stades de formation et de comprendre ce qu'ils signifient pour l'individu, fille ou garçon, pour les parents géniteurs, et pour la société.
Le premier stade pour le garçon correspond à l'excitation de la verge. Ceci signifie que la mère est l'instrument de cet éveil, que le garçon subit cette excitation, et que la société et le père la désirent en vue de lutter contre l'impuissance.
Le second stade pour le garçon correspond à la circoncision. Le fils passe de l'état irresponsable à l'état responsable et rejoint son père tout en se séparant de sa mère; au niveau de la société, il rejoint le groupe des hommes et il peut prendre femme.
Le premier stade pour la fille correspond à l'excitation du clitoris. La mère est l'instrument de cet éveil que la fille subit et que la société et le père désirent en vue de lutter contre la stérilité et de la préparer à son rôle de femme.
Le second stade pour la fille correspond à l'apparition des premières règles. La fille passe sexuellement de l'état d'enfant à l'état d'adulte et rejoint sa mère dans sa fonction de femme. Son père et la société la considèrent comme femme, et elle rejoint le groupe de jeunes filles âgées de douze à vingt ans.
Dogbenon (sein qui descend)
35
Le troisième stade pour la fille correspond à l'élongation du clitoris et des petites lèvres. La jeune fille s'éveille à la réalité de son sexe et fait l'expérience de la femme par la femme.
Le quatrième stade pour la fille correspond aux jeux érotiques. Elle est éveillée à la sexualité et apprend, par la femme, l'usage de sa sexualité.
En conclusion de ce premier niveau d'éducation sexuelle de l'individu donnée par les parents géniteurs, nous pouvons dire que l'image directrice de la formation sexuelle des garçons apparaît dans la lutte contre l'impuissance, et celle des filles dans la lutte contre la stérilité mais aussi dans l'individualisation de la sensualité féminine.
ÉDUCATION SEXUELLE PAR LA SOCIÉTÉ Le second niveau de cette étude sur la sexualité
et la fécondité des populations de la vallée de l'Ouémé concerne l'éducation sexuelle donnée aux individus par la société.
Nous aurons deux plans d'explication: le premier parlera de la vie de la société; le second des cultes Vodun régissant la vie.
Toute la vie de la société parle du sexe en termes de procréation. L'individu, homme ou femme, est éveillé à la valeur de son sexe tant sur le plan de son efficacité persan nelle ou individuelle que sur le plan de son efficacité sociale. Les adultes en parlent continuellement et il existe toute une littérature orale relatant les prouesses sexuelles de l'homme et de la femme ou leurs incapacités.
Les symboles de la sexualité Il y a plusieurs symboles sexuels féminins. La
calebasse (Ka) représente avant tout la «matrice de la femme». Elle est l'élément le plus féminin de la nature et le signe de la vie. La valeur de matrice de la vie est reprise aussi par les Vodun. Ainsi, nous trouvons dans la cosmogonie des Yoruba-Nago l'association de deux divinités, créatrices des autres dieux: ce sont « Odudua, la femme et Obatala, le mari, qui sont enfermés dans une grande calebasse fermée: Obatala est en haut et Odudua est en bas».
Nous pouvons dire que la calebasse est associée à la fécondité sur quatre plans. Le premier se situe sur le plan cosmique: les dieux sont nés dans une calebasse; le second au plan de l'homme: la matrice de la femme; le troisième au plan
36
de la femme: la forme des seins, critères esthétiques et critères de fécondité; le quatrième se situe au plan culturel: la calebasse sert dans la cuisine comme instrument et elle est un élément d'échange entre l'homme et la femme. En effet, la calebasse, symbole de la femme, sert d'instrument pour les messages amoureux entre l'homme et la femme. Il existe au Dahomey tout un art pour graver les calebasses afin qu'elles puissent transmettre des sentiments amoureux.
La calebasse sert de support à tout un langage amoureux tel ce message allégorique d'un jeune homme à sa fiancée, comportant des figures (un coeur, un rein, deux yeux), et un proverbe: «Que ton coeur soit calme, que tes reins restent tranquilles et mes deux yeux seront sur toi. » Le sens du proverbe est: «Ne te trouble point, mais obéis à mes volontés et tu trouveras en moi une protection et un dévouement absolus. »
L'oeuf est le symbole de la vie. Nous parlerons plus loin du cas où une mère allaitant un enfant en conçoit un autre. Pour la cérémonie de purification de cette femme, on fait usage d'un oeuf qui a été pondu sur le toit de la case d'un homme, pour signifier que la femme, comme la poule, doit donner la vie à bon escient et pas n'importe quand. Dans de nombreux mythes relatant la vie des femmes, nous avons relevé que les ovipares (oiseaux et reptiles) sont souvent les alliés de la femme.
Certains fruits (oranges, citrons) sont des symboles de sexualité féminine. Nous voyons souvent les fillettes se servir de citrons ou de mandarines qu'elles attachent à la hauteur de leurs petits seins: elles veulent imiter les jeunes filles et leur mères. L'orange amère, appelée« danxomêgbo », dont les jeunes filles se servent lors de l'étirement du clitoris, est aussi un symbole féminin; seules les femmes peuvent la cueillir et s'en servir. Parfois, l'homme s'en sert pour fabriquer des « charmes » pour capter l'amour d'une femme.
Les symboles sexuels masculins Le phallus se rencontre sous différentes for
mes: un simple bout de bois taillé, un petit morceau de fer planté en terre, une petite pierre ayant la forme d'une hache néolithique. Le phallus est lié au Legba, divinité règlant la fécondité de la femme et de l'homme.
L'orange « Danxomêgbo », symbole de la sexualité feminine
Les bananes sont considérées comme la plante mâle par excellence: les bananiers appartiennent aux hommes. Les femmes doivent demander aux hommes l'autorisation de se servir des feuilles de bananiers comme moyen de préservation de la nourriture. Le bananier lui-même est le signe du chef. Il représente l'élément mâle qui gouverne la société. Ainsi, lorsqu'on veut faire partir un chef, on déracine un bananier et on le promène dans le village, puis on l'enterre symboliquement dans une fosse. Ceci signifie qu'on a enterré le chef en question et que son rôle de chef est terminé pour la société. Ce chef doit abdiquer, et même se donner la mort afin de ne pas être méprisé.
La feuille de bananier intervient aussi à la naissance de l'enfant. La mère donne la vie à l'enfant mais c'est le père qui le recueille et le protège dans ce monde. Ainsi, à l'accouchement, on doit toujours placer l'enfant sur des feuilles de bananiers réchauffées à la flamme. Ces feuilles représentent le père reçevant son enfant et le protégeant contre la nature.
La lance (huan) n'apparait qu'à l'occasion des cérémonies rituelles des cultes Vodun. Seuls les « avocê »,ou serviteurs des Vodun, ont droit de la porter et de danser avec elle.
La massue (makpo) est l'attribut masculin par excellence. Sa forme, représente les organes génitaux de l'homme, « nenkui ». Les femmes « Avocê » ont droit de la porter et de danser avec.
Nous trouvons également de nombreux symboles sexuels ambivalents: ainsi, le soleil et la lune sont tantôt mâles, tantôt femelles. Cette ambivalence est marquée dans les rituels des cultes Vodun. Dans la case des morts, «les asen », autels portatifs en fer représentant un défunt, sont rangés en fonction du sexe: les « asen » représentant une femme sont mis à droite de l'ancêtre commun; les « asen » mâles, à gauche.
Les nombres deux et trois, matérialisés par des moulures en creux ou en relief, marquent aussi le sexe: deux moulures pour signifier le féminin, trois moulures pour signifier le masculin. Les symboles masculins et féminins sont nombreux mais peu sont compris par les non-initiés aux cultes Vodun.
Les sym baies sexuels apparaissent aussi au niveau linguistique. Pour déterminer l'élément mâle, on emploi le terme « asu » qui indique le masculin. Pour déterminer l'élément féminin, on
38
emploie le terme « asi » qui indique le féminin. Ainsi, on emploie ces deux termes pour marquer soit le féminin, soit le masculin d'un animal ou d'un objet. Langbô asi par exemple, signifie brebis, et langbô asu, bélier. La plante « féminine >1 hayohayoé asi est l' aspi/ia latifo/ia, la contrepartie «masculine» étant hayohayoé asu, blainvi//es gayana. Une poterie rituelle femelle appartenant au Vodun « Lisa» sera « Lisa zin asi. »
Le rôle sexuel des vêtements Malgré l'état de nudité relative des hommes et
des femmes lorsqu'ils sont dans la case, les vêtements portés dans la concession, aux champs ou au marigot ont une signification sexuelle très importante. Le sexe est toujours protégé du regard des autres. Par contre, les poitrines restent libres de tout vêtement. Couvrir ses seins pour une femme revient à refuser sa condition de femme. Certes, avec l'apparition des religions d'importation comme le christianisme ou l'islam, les femmes ont tendance à se couvrir la poitrine lorsqu'elles sortent de leur concession ou reçoivent des étrangers. Le fait de se déshabiller en public relève de la folie.
La parure est le signe de tout prélude à des relations sexuelles complètes ou incomplètes. La femme se pare de tous ses bijoux (colliers, bagues, bracelets) et se parfume. Le garçon prend son plus beau pagne, se peigne de son mieux et porte quelques bagues pour attirer la femme désirée. Il lui offre des bagues portant des symboles gravés lui disant son amour.
Le flirt est toujours sym balisé par l'envoi d'un pagne à la femme désirée. On dit: « do acô xa mê » (envoie pagne don elle), ce qui signifie: je te désire. Courtiser une femme se dit en fonction des parures que l'homme lui offre. Qui aime courtiser la femme se dit: « acô do xa mêtô. » En définitive, la parure « acô » est le signe de tout témoignage d'amour. Le don d'une parure à l'être aimée est un témoignage d'amour qui se dit en langue Wemenou « acô dudo ». Lors des mariages, une partie de la dot remise à la jeune femme doit comprendre une malle de pagnes que la jeune femme va conserver précieusement. Avoir ses premières relations sexuelles avec une femme se dit: « gba avô », (prendre pagne), pour le garçon.
.Jt-11111!.\ garp111,1 J11m 1111 1'1//ng1 /ai U.l/rt' dit ~lu/ Oa/Um1t•r
L:1 dan~l' indhiduaJiM· Il' !lt'\ t
Lu dun~e pcrmcl au dan~cur rndiv1ducl de se préscntcr comme un être sc11uel. homme ou !Cmme. La !>OUples~c de' mou\erth:nti.. le r)thme cadencé en contraste~ cl lcs rèpétitiùn'i d'une 1111duhtlion. d'une impulsion unprovisèc, h1 me· 'ure de~ pa~ 4u1 suivent le!> bauemcnb <lu tambour et le:. ii.e!tlt:.\ grac1cu :1.. l\:1a,11c11é dci. mou1 cmcnts du corp:.. sonr aut;,.int de sumula1ioni. pour le SC'<I! L1ppusé de celui du danseur.
Les 8:m.;un!> cin.:onc1!t rl!çu11cnt uni: êuuc;1tion pUClKulière à h:u r ~c.JO;c lur~4u 'ib ~0111 cntrê' d:in~ la i.oc1è1è "Cicledc "· tc hut ûci. ûunscs Je Gdcde e,1 dc rendre le!> "~urdères" fo1orahlc!. afin qnc le<, JCUnc~ L?cn' pUlll~ent vi\'rc et granuir Et il C\li.te une uani.e par111;uhèrc dJn~ ccttc :.i1c1èté d'hummei.. oil les partenaires, 111u1our!> hum mci.. '1mulent le coït entre eu,., le!> unl> portant le' attnhub fèmmin' (plaMron a1ec si:m~. vulve) les ..iutres Ici. allnbub m;hculm, (pénis art1..:ulé:..) Ces dan~e' 11111 lieu, généralement. lûrs Je~ pre-1111èrcs pluies cl ~) mholiscnt la fécond11é de la terre. lé1:ondéc par la pluie. mai~ au~i.1 h1 ll:com.hlê <le la fcmmc. lëcondée p;tr rtw111mc.
S1 lc.'I ûunseur~ cl le~ ûanscusci. ~ont le~ i.eul~ à èrrouvc:r le:~ effet'> 1111 mc:di.1h de la J..ini.c, les
~réctateurl> ) participent au:.M d'une la~on plus lente et plul> progrcs~1ve. mat~ qui amène à la méme l."ondui.ion: la n.:connaii.sa111:c dc: l>llll sc'e et cduJ dc:i. autre~.
::,;ms tomber tlan~ l'c;i;cès <l'm1erprèta11on des 'i) mboh:s, l'expérience nous a permis Lie dèeou-1 nr 4uc: certaines situations 4uu11dicnne~ ont une '>1gnihcation ~exucllc unportanlc. C'c:~t h: cas lur~4u'un hum me prend snn rcra~ avec une femme: cc partage, pour les autre-;, signilie 4ue illllmmc: a accè:. â 1."ellc femme, car la coutume:
\eut 4uc: llmmmc nwngc à part. soit avc:c d'autre:. hnmnu:~. suit avcc ses lili..
L11 'ignitil'al ion du repus 11 y a une ..:c:r1a1ne opposition cntrc le repas et
l'unit>n se.JO;ucllc, parce que h: rep;il> est un évènement qui ..Cparc homme cl femme Dans hl vallée Je l'Ouémé, le problème dc la relation entre le rcp;i~ et l'union ~cxucllc duit être vu de ÛCU.\ maniêrei..
l.J première rc1oinl la cuncephûn tradition· nellc <le beaucoup Lie pcupk:. d'Afrique. c'csl à li ire que la lemme C'\l I' èlèmcnt pa~sif dan" J'unlun sc-.;uclle alotl> que l'hnmme ..:~t l'élément a~lll. l>;llJ\ le repas, IÏloltlmC eJ.1 I' èh:mcnt )>ôh-
sif: il reçoit et il accepte, alors que la femme apparai't comme l'élément actif, elle prépare et elle donne.
Dans l'union sexuelle, l'homme prend la femme et la féconde: il devient l'élément actif alors que la femme, qui se donne et reçoit, devient l'élément passif. L'homme qui refuse un repas peut signifier à la femme qu'il la rejette.
Cette première manière de concevoir les relations sexuelles entre l'homme et la femme nous indique que l'homme détient la première place, alors que la femme n'apparaît active qu'au niveau de la préparation de la cuisine.
Cela revient à dire: si l'homme accepte le repas de la femme, cela signifie que la femme peut lui donner la force mais en contrepartie, celle-ci accepte de recevoir la vie de l'homme.
La seconde manière de concevoir la relation repas-union sexuelle nous indique que la femme devient l'élément actif premier et que l'homme, même s'il est donneur de la vie, reste soumis au désir de la femme.
En effet, il est courant de voir dans les villages de la vallée de l'Ouémé des hommes allant le soir au marché du village pour y acheter de la nourriture. Y vont-ils parce que leur femme est indisposée ou en voyage? Non, ils y vont parce que leur femme a refusé de préparer la nourriture et les renvoie de la case. Si nous leur demandons pourquoi, ils nous répondent: «Ma femme est méchante, elle «grève>> la sauce et la natte». Nous n'analyserons pas les causes de ces dissensions, mais nous allons voir comment la femme est consciente de sa force tant sur le plan de la préparation de la nourriture que sur le plan de l'union sexuelle. Ici, la femme apparaît comme maîtresse de la vie.
Sa part active se situe non seulement dans le repas qu'elle prépare et qu'elle donne mais aussi dans l'union sexuelle qu'elle accepte et dans laquelle elle prétend accepter l'homme. Nous retrouvons les dires des femmes au sujet de la pratique de l'élongation du clitoris et des petites lèvres: «C'est nous qui faisons jouir l'homme et nous pouvons lui interdire l'accès de notre chemin».
Dans cette seconde manière de concevoir la relation repas-union sexuelle, nous nous apercevons d'un clivage dans les buts du repas et l'union sexuelle. La vie (la force) passe en deuxième posi-
40
tion; l'intérêt de la femme dans son action passe en premier. L'homme doit se soumettre à la femme s'il veut avoir les mêmes prérogatives que dans le premier cas. Les deux attitudes se rencontrent fréquemment et les membres d'une concession, d'un lignage, d'une famille les voient et les connaissent.
Les déviations sexuelles Les déviations sexuelles, dans le monde
traditionnel, sont rares. Pour l'ensemble de la population, elles relèvent de la folie ou d'individus n'ayant aucun statut social.
Pour les hommes, il existe très peu d'homosexualité. Ceci est très compréhensible lorsqu'on comprend la peur de l'impuissance: le sexe doit être protégé et il ne doit servir qu'à donner la vie. Lui donner un autre but, c'est refuser de donner la vie, donc s'exposer aux risques de devenir impuissant.
Pour la femme, la peur de la maternité est réelle ainsi que la difficulté de nourrir son enfant. Ceci amène les jeunes femmes à envisager leur vie sexuelle sous un autre aspect. L'usage manuel par les femmes d'une banane mûre est assez fréquent pour satisfaire leur besoin de relation sexuelle. Il est toléré mais en général les femmes employant ce moyen sont mal considérées et leurs maris sont méprisés par les autres hommes: le mari n'est pas un bon mari et il ne sait pas satisfaire sa femme.
Le massage du clitoris et les jeux érotiques peuvent apparaître comme des déviations sexuelles à une mentalité d'européen, mais en aucun cas pour les populations de la basse vallée de l'Ouémé et surtout pour les femmes. Ce n'est qu'un moyen de satisfaire leurs désirs sexuels sans avoir recours à l'homme. C'est ainsi que les femmes peuvent espacer leur maternité sans pour cela rejeter la réalité de leur sexe.
Méthodes de contraception Le terme contraceptif est généralement
employé pour signifier «empêcher toute maternité». Ici, nous nous trouvons devant le problème de la limitation des naissances vu du côté des femmes. Malgré le désir d'avoir une nombreuse progéniture, la limitation des naissances pose un problème sérieux aux populations de la vallée de l'Ouémé. Nous avons d'un côté les rites de fécondité et de l'autre, la limitation des
)t'llllt' ft'llllllt' llllC;lllêlllJll Ult'( dt!\ lt'UrtfÏt'UlltJll.\. ('(' \11111 /t•.1 at!mt!lll\ 1mp11rtcltl(.1 tic• /u H'\llQfllé
/t!m111i11c
-Il
naissances par des méthodes plus ou moins efficaces.
L'abstinence sexuelle de la femme qui allaite son enfant est fondée sur la peur de mettre le bébé en danger: les rapports sexuels gâtent le lait -donc risquent de faire mourir le bébé.* Cette pratique est relative, car il existe un Vodun qui règle la vie d'une mère donnant le jour à un enfant pendant le temps où elle en allaite un autre.
L'interruption des rapports avant l'insémination (coït interrompu) est la méthode la plus courante, mais les difficultés viennent des hommes qui n'aiment pas interrompre leur acte. Pour eux, l'interruption signifie «son infériorité vis-àvis de la femme». Pour la femme, l'interruption parail désagréable parce que le sperme de l'homme qui inonde son pubis et ses cuisses« est sale». C'est une des raisons du refus des femmes de s'unir à l'homme et de la pratique entre elles de l'élongation du clitoris ou des jeux érotiques.
Contraception magique Les autres méthodes contraceptives sont d'or
dre magique. Les hommes n'en pratiquent aucune mais sont dans ce domaine soumis aux femmes. Les femmes ont plusieurs méthodes fondées sur une conception magique des effets des plantes et de la parole prononcée avant l'acte. Elles préparent des décoctions à base de plantes et les prennent avant l'union sexuelle avec un partenaire masculin.
Les garçons sont sceptiques quant à l'efficacité de ces plantes; et ils y voient plutôt un moyen de pression pour les forcer à un mariage légalisant la paternité. L'emploi de bagues ayant baigné dans des décoctions d'herbes est très fréquent. En fait, presque toutes les femmes portent ces bagues «contraceptives»: leur effet est d'empêcher une maternité après les relations sexuelles. Généralement se sont les femmes âgées qui fabriquent ces bagues et enseignent aux clientes les formules à prononcer au début de tout rapport sexuel. Ces femmes appartiennent au monde des Vodun dans ce qu'ils ont de maléfique. Ici apparaît l'élément magique de la vie; la femme peut, par des moyens mystérieux, arrêter ou contrecarrer les effets de la nature. Pour cela, il suffit de se mettre
*Cette croyance se retrouve dans la plupart des régions de l'Afrique tropicale (Note de/' éditeur).
42
Certaines scarifications . ..
en ralation avec les individus, hommes ou femmes, qui possèdent le maniement de ces moyens.
Certaines scarifications faites dans le dos et sur le ventre sont aussi employées comme moyen
a g
... auraient une vertu contraceptive
contraceptif. Ainsi, des femmes se font scarifier dans le dos et sur le ventre par de vieilles femmes
qui introduisent dans la plaie des poudres à effet contraceptif; ces vieilles femmes enseignent des paroles qui permettront de rendre stérile toute union sexuelle.
Nous retrouvons ici l'élément magique fondé sur la nature: les plantes et la puissance de la parole. Il faut savoir que pour les populations de la vallée de l'Ouémé, la parole connue et prononcée est efficace; elle est créatrice par ellemême.
L'emploi de la Nivaquine comme moyen contraceptif appara1î maintenant dans la brousse. Les jeunes filles prennent quatre à six Nivaquines avant l'union sexuelle et elles prétendent être stériles. L'abus de la Nivaquine en ce sens est destructif; les conséquences de tentatives d'avortement sont parfois mortelles.
CULTES VODUN ET VIE SEXUELLE Les cultes Vodun assurent une éducation se
xuelle en luttant contre l'impuissance de l'individu, en interprétant la position de l'enfant à la naissance et en évitant les anomalies dangereuses pour la société. Dans les rapports sociaux, ces cultes assurent la stabilité des lignages, donc de la société.
Nous savons que la peur de l'impuissance, vue comme stérilité, est manifestée dès la naissance du bébé: on veut s'assurer par le bain et les massages du pénis que le petit garçon est puissant physiquement. Pour les populations de la vallée de l'Ouémé, l'impuissance reconnue est un malheur qui anéantit la position sociale d'un homme ou d'une femme.
Les cultes Vodun ont officialisé la valeur du sexe en acceptant qu'un Vodun soit le gardien de la fécondité de l'homme et de la femme. Le Vodun « Legba » est ce gardien.
Le Vodun « Legba » protège l'individu et la famille. La vision d'un « Legba »du village muni d'un énorme phallus signifie que la divinité peut donner des enfants à ceux qui lui demanderont son aide et qui se mettront sous sa protection. On peut voir des femmes ayant des difficultés à avoir des enfants venir lui offrir des oeufs et des poulets, des plats cuisinés et aussi s'unir symboliquement à lui en faisant toucher leur sexe par le phallus du Legba, afin d'obtenir des enfants et de n'être pas stérile. La présence du Vodun « Legba » se traduit visuellement dans le paysage par
43
des phallus planté!> dans de., tertre'> en terre ou hien par des slatucllc:. anthropomorphe~ l~mm1· ne!> et masculine".
S1 d'un côte lei; cultes \.odun \culent asliurer la cun11nui1è de la vie cl mellcnt l'un des kur'> au service de l'homme. toute la sm:1è1é est aus~i mohiliséc contre l'impu1!>sancc. l.'impuissancc est vue davantage sur k plan physique 4uc 11hysiolot?ique. On recherche J'aburd le~ élémenb e\lér1curs permettant de dire qu'un homme est 11npu1ssan1 ou Je dire qu'une femme est stérile. Pour rhumme un pilrh: d'1mpu1ssam;e "ncnkuin" (le sexe est mort.I Pour la femme, un parle de !ltênhlè: "J.. liboto" (~cxc ~an:. urifü:c ou ah· 'c111.:e de règle!>.)
l .es 'i~nt>S de l'impui!ls:tnct• Pour les populations de rüuémë. ccna ine~
anomalies physi4ucs ;1uircs ~1uc cdlcs conœrnani les tlrga nes génitaux, s1gn !lient lïm poissani.:e Un orteil rele~é p:1r de~.-.u~ le~ Jutrc~ " bu:.u " : les pieds plat!> "akpakpo 11 : une dcn111iun débutant
par la machoirc :.upèrieurc "adu"'u Mn atia": le:. denh pou 1tSa n 1 le:. une:. i.u r le!> autre:. " adu kpaJ..a,ë " · Ces parti.;uldritês '>igmhent ausi.i 4uc l'nommc 4u1 les pu!.sêdc :.era un être d1tl11;1li: et mèl.:han1 pour le~ autres.
Les anomalici. des organes gémrnux i.ont : l'a bscnce <le testicules (ma kpêkan); la prèscncc de deux l>Cl(ci.: la non érection de la verge: h>r' du premier barn du bèbé (11 est a1tcin1 pJr le cc ma· gn:in »); et le pubi~ glabre (mama).
Nuu:. lr\1u v11n!I encore deu.11. catégories de nlo}cni. mai. en oeuvre pour combattre r1mpu1'i· ~•mec · le' mo)ens personneb. ou 111d1\ 1dud,, cl le!> mo~Cll!> !>OctauJ.. Parmi le!> premu:r!> ~onl li:s haJ!.UC'> :1) ant hmgnê dani. uc• pl:rnle!>: ~i:!.
hagues. appelée~ "gandidan "• ont été 1rc111pècs dans dei. bains <le plantes appartenant aux Vmlun cl sur les4uelles on a prononcé dei. paroles clhcaL:cs. Ces bagues sont portées Mllt aux dt\IJ:',li.,
i.oit au\ orteils . cela dépend del> inlliVH.lu:o. cl de~ dire!> du Vodun u Fa 11, i.i celui-et a êtè consulté. Dcl> ceintures c(lnli:~·t1onnéei. dan!. t.h::. peaux de
caïman ou de panthère apparaissent comme des éléments protecteurs contre ceux qui voudraient provoquer l'impuissance chez un homme. Parmi les moyens personnels qui ont trait directement au corps, nous trouvons le massage de la verge lors du bain du bébé et les scarifications dans le dos qui sont poudrées de plantes préservatrices. Enfin, on fait prendre aux hommes des aphrodisiaques qui permettent de vérifier la virilité de l'homme.
L'impuissance est aussi combattue au niveau social. L'homme peut consulter le Vodun «Fa», divinité de la divination, pour savoir comment combattre l'impuissance ou pour connaître celui qui veut le rendre impuissant. Par le «Fa», l'homme apprend les moyens individuels qui lui seront efficaces et à quel Vodun il devra se donner ou donner un enfant pour que l'impuissance ne lui vienne pas. Il apprend aussi à quel Vodun il doit s'en remettre et la nature des offrandes et des sacrifices nécessaires à la bonne marche de son entreprise. Le second moyen «social» consiste à reconnaître tout ce qui peut rendre impuissant, et qui est enseigné par le père à son garçon.
Stérilité de la femme Certains éléments qui permettent de dire
qu'une femme est stérile sont semblables à ceux qui signifient l'impuissance de l'homme. Parmi les anomalies corporelles, nous trouvons l'orteil relevé (busù), les pieds plats (akpakpo), les jambes sans mollet (do), une dentition débutant par la machoire supérieure (aduwu sin aga), et les cjents poussant les unes contre les autres (adu kpakasê).
Ces anomalies corporelles font dire qu'une telle femme sera difficile et méchante pour les autres et ne donnera pas d'enfants. Nous remarquons un seule anomalie corporelle différente de la femme dite stérile: le mollet est un critère de beauté; une femme sans mollet n'est pas belle.
Parmi les anomalies des organes génitaux qui font dire qu'une femme est stérile, nous trouvons un sexe sans orifice (kliboto), l'absence de seins, le pubis glabre (marna), l'absence de règles (kliboto) et la présence de deux sexes. Il est à remarquer que l'absence de règles est un élément important pour comprendre la réalité des menstrues des femmes. Une femme qui a ses règles doit se marier et donner la vie. Une femme qui n'est pas
Tamtams décorés de symboles sexuels
mariée ou qui ne veut pas se marier est considérée comme une femme n'ayant pas ses règles, donc stérile. Il nous est arrivé de constater la surveillance par les familles de femmes considérées comme n'ayant pas de règles. Les règles de la femme sont les garants de la vie. Ainsi, une femme ayant atteint la ménopause est considérée comme un homme. Elle peut à ce moment assumer toutes les responsabilités de l'homme, devenir un chef d'une famille élargie ou d'un culte Vodun. Elle rejoint les hommes et quitte le domaine de la femme. Les femmes ont conscience de la stérilité qui les menace et recherchent tous les moyens en leur possession pour lutter contre ce mal. En effet, dans un mariage monogame ou polygame, la stérilité est toujours mise sur le compte de la femme: l'homme n'est jamais mis en cause. Les femmes veulent donc se protéger contre ce mal.
Quels sont les moyens à leur disposition? Certains sont liés à la parure: le port d'une ceinture autour des reins (alinkan), de bagues cuites dans des plantes (gandidan), d'une corde de grossesse (ko-kan) ou de bracelets de perles aux mollets. D'autres sont liés au sexe: les scarifications faites sou3 les seins et contenant des poudres protectrices contre les sorciers qui voudraient les rendre stériles; le massage du clitoris et des petites lèvres.
Les moyens «sociaux» employés par les femmes pour lutter contre la stérilité sont les mêmes que pour les hommes avec une exception: les femmes atteintes de stérilité ou qui accouchent souvent d'un enfant mort-né vont s'unir symboliquement au Legba de tel ou tel village.
Positions à la naissance Les garçons et les filles de tout âge assistent
aux événements de la naissance, soit en tant que membres de la famille du nouveau-né, soit en suivant les cérémonies d'intégration de l'enfant dans la société. La naissance de tout être est quelque chose d'important; il faut donc savoir si la venue au monde d'un enfant est normale ou particulière, si elle signifie quelque chose. La venue de l'enfant au pays de la vie est si importante qu'il importe de bien le situer dans le monde, de l'insérer dans tous les éléments qui agissent sur l'homme, de bien le placer dans le concert des différents Vodun.
45
La position de l'enfant à la naissance annonce quelque chose à ses parents et aux membres de la famille et du groupe. Elle est un présage de la vie future de l'enfant. Nous savons qu'une naissance normale se fait par la tête: l'enfant sort la tête en premier. Or, il arrive que des naissances se fassent par le siège, par les pieds, ou autrement: bras en premiers, mains ouvertes, cordon ombilical autour du cou, avec la poche des eaux.
Toutes ces particularités sont interprétées comme signe de quelque chose: elles annoncent la présence d'une divinité qui va régler la vie future de l'enfant. Elles indiquent aussi que la vie appartient aux Vodun: l'homme ne fait qu'en bénéficier. Aussi!' enfant est-il soumis dès sa conception aux Vodun, et même sa formation dans le sein de la mère est suivie de très près par un être nommé Sê. Les jeunes apprennent ainsi que la vie qu'ils peuvent donner est soumise à des lois des Vodun et que la moindre transgression d'une loi sur la vie se manifeste à la naissance d'un enfant.
Nous n'entrerons pas dans les détails des différentes positions de l'enfant à la naissance, mais nous pouvons souligner que la naissance des jumeaux représente une marque de la bienveillance des Vodun; au début, les hommes naissaient par trois, mais maintenant cette bienveillance des Vodun se limite aux jumeaux parce que le hommes n'ont plus suivi les lois de la vie et qu'ils faisaient ce que bon leur semblait. Cette attention des gens aux premiers moments de la vie humaine dans le monde les oblige à suivre non sans difficultés les règles édictées par les cultes Vodun et les autres chefs. Les cultes Vodun ont conscience de ces difficultés de les suivre; ils tentent de régler les abus en ce qui concerne les relations sexuelles qui entraînent l'apparition de la vie, mais aussi l'apparition de la mort dans le cas des avortements.
Destruction de la vie Il y a dans la conception du refus de donner la
vie deux aspects qui ont la même conséquence, la destruction de la vie, mais qui ne sont pas vus sous le même angle. Un enfant né avant terme et dont le sexe est inconnu corrspond à un avortement non provoqué. Cet enfant porte le nom d'« ozo »; c'est en fait un foetus embryonnaire qui s'est naturellement décroché de l'utérus. Un tel avortement se dit « gble xo » (mauvais ventre)
46
ce qui signifie que le ventre de la femme en grossesse est malade.
Les chefs des cultes Vodun savent qu'une bonne part de ces accidents sont dus aux maladies vénériennes et à certains travaux que font les femmes pendant leur grossesse. Comme ils n'ont rien pour lutter contre les maladies vénériennes, ils ont choisi de se placer sur un plan religieux.
L'avortement provoqué concerne également l'enfant né avant terme et dont le sexe est inconnu. C'est un foetus embryonnaire ou déjà formé qui est expulsé après des manoeuvres abortives. L'enfant né ainsi est appelé « hungbandan », ce qui signifie «amas de sang». L'avortement se dit aussi « hungbandan », mais l'acte lui-même se dit «do xo » (enlever ventre), c'est à dire faire sortir l'enfant.
Ces êtres au sexe encore indistinct sont considérés comme Vodun et iis entrent dans la catégorie des « Toholu » ou enfants monstres. Les « hungbandan » apparaissent comme étant «la vie en puissance». Il semble qu'ils représentent une atfeinte à la vie, et signifient le danger des rapports trop fréquent entre l'homme et la femme.
Il ne faut pas oublier que les relations sexuelles sont vues avant tout comme moyen de donner la vie: c'est-à-dire d'avoir des enfants. Ainsi tout rapprochement entre l'homme et la femme est vu en fonction de la vie et il doit en résulter quelque chose de visible. En fait, toute union complète entre l'homme et la femme engendre un être qui a le potentiel soit de devenir un être vivant, soit de rester un « hungbandan ».
La destruction de la vie demande l'intervention des Vodun afin de régler ce problème. Il va sans dire que le cas d'un avortement provoqué « hungbandan » soulève le problème de la vie donnée par l'homme et par la femme; il en résulte que l'homme et la femme sont les instruments de la vie mais qu'elle ne leur appartient pas. Toute femme qui engendre des enfants « hungbandan » doit subir des purifications d'ordre social, et parfois même le sort de son enfant, c'est-à-dire la mort.
Les cultes Vodun sont très sensibles aux premiers moments de la vie de l'homme sur terre. Ils tiennent compte des anomalies corporelles, l'absence de la vie, et enfin des naissances trop rapprochées.
Anomalies corporelles Les anomalies corporelles sont nombreuses et
en général considérées corn me appartenant au Vodun « Toholu ». La plus caractéristique est «toute excroissance sur les doigts». Cette anomalie est appelée « agê ». Les difformités que le Vodun « agê » donne aux enfants viennent de ce qu'il vit en brousse et que ces enfants ont été conçus dans les champs de leurs parents. Les relations sexuelles en dehors de la case sont en général mal vues et même sanctionnées si elles sont découvertes. Toute relation sexuelle faite dans les champs ou dans les bois entraîne l'apparition d'un enfant « agê », avec des excroissances sur les doigts. Ainsi, nous pouvons dire que la société, à travers ses Vodun, détermine l'endroit où peuvent avoir lieu les relations sexuelles complètes.
Parmi toutes les anomalies corporelles possibles, la plus importante est la naissance d'un enfant hydrocéphale qu'on nomme Toxosu ou Toholu. Les Toxosu ou Toholu habitent certaines sources et lagunes. Leur nombre est infini, car chaque rapprochement de l'homme et de la femme peut en engendrer un, mais tous ne prennent pas une forme visible et vivante. Quand ils le font, c'est pour tracasser les humains. Là, nous rejoignons les cas des enfants « hungbandan ».
L'apparition dans une famille d'un « Toxolu » est le signe d'un mécontentement, un rappel à l'ordre. La vie est précieuse et les hommes comme les femmes le savent: ils prennent de nombreuses précautions pour pouvoir assumer la ,continuité de la vie, de la famille. Mais ils connaissent les aléas de la maternité et les dangers que court la femme. Si bien que tout rapprochement de l'homme et de la femme demande à assurer une chance de réussite.
La monstruosité est le signe d'un dérèglement de la société dû souvent au non respect de la loi, d'un interdit édicté par les ancêtres ou est causée par les Vodun. L'anomalie humaine est causée par un dérèglement du système. Aussi, faut-il le rétablir par des cérémonies qui groupent tous les « Toxolu », afin de les apaiser et d'aider à rétablir l'équilibre dans la famille et dans la société.
Les rois d' Abomey ont si bien compris le danger de l'apparition de« Toxosu »dans leurs lignages et dans leur royaume qu'ils en ont fait un culte à part et qu'ils l'ont élevé à un grand culte
royal dit le culte des « nesuhué ». Le culte des « Toxolu » a permis de régler les mariages entre parents proches et d'interdire à des hommes atteints de graves maladies de donner des enfants. Ainsi, nous pouvons dire que les anomalies corporelles sont les signes d'un désordre au niveau de la sexualité.
Enfants mort-nés L'absence de vie à la naissance est aussi une
anomalie grave. Lorsqu'une femme donne naissance à des enfants mort-nés (Abiku) ou morts en bas âge, on dit que ce n'est pas la venue au monde d'enfants chaque fois différents mais qu'il s'agit du même être, appelé « abiku » en yoruba ou « djikui »en gun, qui est censé venir au monde un bref moment pour s'en retourner au pays des morts.
Le terme « abiku » s'emploie selon deux aspects. Le premier désigne une catégorie d'esprits maléfiques qui cherchent constamment à pénétrer en parasites dans les corps d'enfants durant leur existence intra-utérine ou dès leur naissance pour profiter de l'alimentation qui leur est destinée. Cela signifie que toute maternité dans son temps de grossesse a des dangers et qu'il faut protéger la femme.
Le second aspect signifie que le terme« abiku » est applicable dès la naissance à tout nouveau-né dont tous les premiers frères utérins sont morts dès leur naissance ou du moins avant la naissance de leur afüé. Ici, cela signifie que la mère est en cause. Les chefs des cultes Vodun savent que la syphilis est très répandue et ils veulent, par ce culte, faire prendre conscience de certains facteurs humains destructeurs.
Les cultes Vodun s'adressent aussi au problème des naissances rapprochées: enfant né d'une femme qui est en train d'allaiter un autre enfant, enfant né d'une femme qui n'a pas connu un retour de couches, enfant d'une jeune fille qui n'a pas encore connu ses premières règles. L'enfant né ainsi porte le nom de « Dosu ». Sa mère est considérée comme une insouciante qui ne pense pas à sa maisonnée.
On peut donc constater que la société est consciente du phénomène de la fécondité: malgré l'allaitement, il peut y avoir conception. La conception au temps de l'allaitement repose davantage sur la peur de faire mourrir l'enfant qui est
47
allaité par le fait que la mère ait des rela tians sexuelles, que par le fait qu'une mère allaitant son enfant ne doive pas avoir d'enfants pendant ce temps là. La cérémonie de purification d'une mère dans cette position de maternité indique bien que la mère doit veiller à assurer la vie de son enfant avant de penser à en donner un autre.
Asu-xixa Les cultes Vodun permettent d'assurer la sur
vie de l'homme et de la femme dans leurs rapports sociaux qui doivent évoluer afin de permettre une adaptation aux situations nouvelles. La cérémonie dite « asu-xixa » sert à résoudre des problèmes d'ordre familial et collectif: les personnes confessent leurs transgressions vis-à-vis leur famille, les Vodun, ou la société. Cette cérémonie a lieu surtout lorsqu'il y a des problèmes de mésentente entre époux, et parents, lorsqu'il y a adultère, stérilité, ou mort d'enfant en bas âge. Dans tous les cas où nous avons pu y assister nous avons constaté que le problème de l'adultère de la femme a été envisagé et elle a dû en parler sans rien cacher.
Ainsi, les cultes Vodun, en règlant les rapports sexuels entre l'homme et la femme favorisent une organisation qui procure le meilleur profit social et humain, en particulier pour la préservation de la vie humaine et l'accroissement de la population.
ÉDUCATION DES INITIÉS VODUN Nous avons pu nous rendre compte de l'impor
tance des cultes Vodun dans la vie. En décrivant l'éducation sexuelle que ceux-ci donnent à leurs initiés dans les enclos des différents Vodun, nous entrons dans un domaine tout particulier, celui des initiations. Il va sans dire que nous ne mentionnerons que ce qui correspond à notre sujet d'étude actuel, celui d'une éducation sexuelle donnée aux futurs initiés des cultes Vodun « Sapata », divinité liée à la terre, à « Huvê »,
divinité agraire liée aux plantes et aux arbres, et à « Legba », divinité protectrice de la fécondité.
Nous trouvons dans une même promotion d'initiés des âges très différents, de cinq à trente ans. Mais en général, l'âge moyen se situe entre treize et dix-sept ans pour les jeunes filles et de douze à dix-sept ans pour les jeunes garçons. Certains enclos ont des promotions où l'âge moyen
48
La représenlalion de scènes d'union au moyen de
11
i ·' ' ' 1
li I'
1 i i
ces statue/les permet un défoulement des tensions nées d'une abstinence sexuelle
49
est de dix ans. Certaines promotions ne comprennent que des garçons ou des filles. En général, nous trouvons davantage de promotions féminines que de promotions uniquement masculines.
Abstinence sexuelle Pour tous les Vodun, même si le temps d'initia
tion est très court, une période d'abstinence sexuelle est obligatoire en vue d'acquérir la pureté nécessaire aux rapports futurs avec la divinité. Cette période d'abstinence peut ne durer que quelques jours, mais peut aussi aller jusqu'à trois ans. (Pour les initiés aux cultes de Sapata et de Huvê, la formation des jeunes filles et garçons dure trente-six mois).
La pureté acquise à travers l'abstinence sexuelle est nécessaire pour assurer l'efficacité des actes de l'homme vis-à-vis de la divinité. Sans cette pureté rituelle, l'homme ne peut rien réussir en s'adressant à son Vodun, lequel est, de ce fait, inefficace. Cette pureté est également requise pour préparer un médicament à base de plantes et autres ingrédients.
Pour la divination par statuettes, dite « bocio kinkan », ou la divination «sin kinkan », la présence d'un enfant, garçon ou fille, vierge, est nécessaire pour assurer l'efficacité. Mais si les initiés aux cultes Vodun pratiquent l'abstinence sexuelle pendant un temps plus ou moins long, ils n'admettent en aucun cas le célibat: tout individu mâle ou femelle doit donner la vie. Le célibat entre dans la catégorie de l'impuissance. L'efficacité de l'action de l'homme dans ses rapports avec la divinité est liée à un état de pureté basé sur le refus de donner la vie. Dans un sens, l'homme doit perdre sa fonction de donner la vie.
Statuettes articulées Malgré cette abstinence forcée, les novices
reçoivent, dans les enclos d'initiation de Sapata et de Huvê, une éducation sexuelle au moyen de diverses techniques d'enseignement. Des statuettes articulées en bois sont utilisées pour simuler le coït entre l'homme et la terre, et entre l'homme et la femme. Il y a des danses qui n'ont lieu que rarement, surtout à l'occasion des premières semailles, et qui ne sont vues que par les initiés. Les statuettes permettent de rappeler ces moments, de réactualiser la présence efficace de la divinité et de rapprocher les initiés.
50
Les novices apprennent ainsi ce que représente le coït. Il apparaft que la représentation répétée de ces scènes d'union entre l'homme et la femme au moyen de statuettes permet un défoulement naturel des tensions nées d'une abstinence sexuelle.
Lutte contre l'impuissance Dans les enclos d'initiation Vodun, les novices
sont mis en garde contre l'impuissance, vue comme stérilité. En effet le novice, garçon ou fille, doit par la suite donner la vie afin de pouvoir être remplacé auprès de la divinité. On leur apprend donc à lutter contre la stérilité en leur faisant des scarifications, sous les deux seins pour les femmes, et dans le dos pour les garçons. Ces scarifications les protègent contre les sorciers qui voudraient les rendre impuissants.
On leur apprend également l'utilisation de certaines plantes dites aphrodisiaques qui permettent de préparer des décoctions favorables à la maternité. Ces décoctions servent aussi à préparar des « glo », amulettes préservatrices ou donneuses de puissance. Les amulettes sont souvent des bagues, « alogan », qui ont été trempées dans ces décoctions et que les hommes et les femmes portent soit aux doigts des mains, soit aux orteils.
Éducation sexuelle spécialisée Dans chaque promotion importante d'initiés, il
y a des femmes qui auront par la suite des responsabilités importantes. C'est le cas de la cheftaine d'un enclos d'initiation, nommée « yagba ». Elle reçoit corn me les autres initiés les enseignements concernant la sexualité, mais aussi un enseignement spécialisé en matière d'aphrodisiaques et de stérilisants. L'enseignement concernant les aphrodisiaques est compréhensible en fonction du désir d'avoir des enfants, mais l'enseignement de stérilisants apparaft comme contradictoire à la mentalité commune.
Pour le comprendre, il faut se placer dans l'optique de l'existence des Vodun, qui assurent la vie parmi les hommes. Il est nécessaire qu'il y ait des gens, hommes, mais surtout femmes, qui soient spécialisés dans le culte et qui puissent perpétuer les coutumes et les lois des différents Vodun.
Les Yagba ont pour principale fonction de former des individus, hommes et femmes, qui deviendront des serviteurs, des épouses des Vodun.
Pour les former, il faut leur enseigner non seulement des mythes, des lois, mais aussi la façon de danser, d'entrer en transe de possession, d'appartenir aux Vodun. Les Yàgba doivent donc rester jeunes et être capables d'enseigner la danse malgré leur âge. Pour rester jeune, un seul moyen: ne pas donner trop d'enfants. Les maternités épuisent une femme et l'empêchent aussi d'être toujours au service des Vodun.
On rendra donc une Yagba stérile losqu'elle aura eu trois ou quatre enfants, afin qu'elle puisse mieux assurer sa fonction de cheftaine d'un enclos et qu'elle ne vieillisse pas trop vite.*
Apprentissage sexuel À la fin de son temps de formation, chaque
nouvel initié appprend symboliquement, sur une natte, l'acte de s'unir avec un homme si c'est une femme, avec une femme si c'est un homme.
On prend pour cela un enfant dit vierge (garçon non circoncis) et on le fait coucher sur la natte avec le nouvel initié. Tous deux sont recouverts d'un grand pagne que la cheftaine de l'enclos pose sur eux, La cheftaine donne à ce moment des conseils pour l'union et place l'enfant dans la position admise par les Vodun. Par cet acte symbolique, le nouvel initié a de nouveau accès à une sexualité normale et met fin à son abstinence sexuelle obligatoire. Si le novice a retrouvé l'usage de son sexe, il ne pourra en faire usage que s'il est marié selon la coutume. Dans le cas d'un novice célibataire, il faudra que toute sa promotion participe à une cérémonie qui consiste, si c'est une femme à la conduire chez son mari et à faire entrer dans la maison le Vodun en même temps que l'épouse. Ce qui revient à dire que l'usage de son sexe reste conditionné à la vie rituelle et à sa dépendance vis-à-vis du Vodun.
Une cheftaine d'enclos d'initiation est préparée à devenir stérile par les moyens d'ordre religieux mais aussi par l'apprentissage de moyens contraceptifs. On lui enseigne l'usage des plantes contraceptives (racine de loko) et des médicaments susceptibles d'arrêter la grossesse. On lui apprend à préparer les bagues qui empêchent <l'a-
*Cette stérilité est induite par l'absorption d'une décoction à base de feuilles qui rend la Yagba définitivement incapable d'être enceinte. (Note de /'éditeur.)
voir des enfants. À ce niveau de vie sexuelle, il n'y a pas confusion entre virilité-puissance et fécondité-impuissance. La pensée des cultes Vodun crée un rapport différent entre la fécondité et la stérilité.
CONCLUSION Cette courte étude sur la sexualité et la
fécondité des populations de la basse vallée de l'Ouémé nous a permis de connaître un aspect très particulier de leur conception de la vie et de la façon dont les cultes Vodun règlent leur relations sexuelles. Nous pouvons affirmer que nous nous trouvons devant une société très structurée et qui est consciente de ses valeurs humaines et religieuses. La société régie par les cultes Vodun prend soin de toute vie naissante et elle refuse tout gaspillage, autant sur le plan économique que sur celui des forces de l'homme.
Ce que nous venons de décrire ne relève pas du passé mais est encore actuel, en 1973, dans toute la basse vallée de l'Ouémé. Certes, la société européenne commence à pénétrer les mentalités et il y a quelques clivages déjà entre les jeunes, alphabétisés dans les écoles, et les jeunes non alphabétisés. Mais nous avons constaté que les jeunes filles alphabétisées savent prendre ce qui les intéressent dans la conception de la vie sexuelle des européennes tout en gardant leur savoir ancestral.
Bibliographie sommaire BAUMANN H. & WESTERMANN D.,
1962, « Les peu pies et les civilisations de l' Afrique» Payot, Paris.
BRAND R., 197 l, «Statuettes articulées Yoruba», in Anthropos, n° 66, pp 550-554.
BRAND R., 1972, «Plantes médicinales en usage chez les Gun » Librairie Notre Dame, Cotonou.
FOA Ed., 1895, «Le Dahomey, histoire, géographie, moeurs, coutumes, commerce, industrie» A. Hennuyer, Paris.
MASTERS W. H. & JOHNSON V. E., 1970, «Les réactions sexuelles» Laffont, Paris.
POUILLON J., 1972, «Manières de table, manières de lit, manières de langage ». in Nouvelle Revue de psychanalyse, n° 6.
SEGUROLA R. P., 1963, «Dictionnaire FonFrançais », Librairie Notre Dame, Cotonou.
51
la femme Y1emenou Fanny Linty
La vie sexuelle de la femme africaine Wemenou est tout à fait différente de la vie sexuelle de la femme européenne, tout au moins en ce qui concerne les habitants de la vallée de l'Ouémé, dans le Dahomey.
Très jeune, dès l'apparition de ses règles, la jeune fille se marie pour s'accoupler avec un homme qu'elle a plus ou moins choisi. Cet acte est plus un acte de fécondation qu'un acte d'amour et même qu'un acte uniquement charnel. En effet, tout rapport sexuel a uniquement pour but de procréer et de faire jouir son mari. Elle n'essaye nullement de partager le plaisir de celuici; le but qu'elle recherche est la fécondation, car une bonne épouse doit avoir beaucoup d'enfants. li semblerait que l'acte charnel procure à la Wemenou une répulsion physique: «C'est sale,» nous dit-elle, et elle essaie de les éviter le plus souvent possible.
Nous trouvons de longues abstinences sexuelles. Dès que la femme est enceinte, elle se refuse à son mari, jusqu'à la fin de l'allaitement de son enfant. Elle se retranche derrière une excuse très facile, en affirmant que les rapports sexuels sont très nuisibles pour le lait de l'enfant. Il faut bien souligner le mot excuse, car la jeune Wemenou alphabétisée sait fort bien qu'il n'en est rien, et respecte uniquement, à sa convenance, les vieilles croyances de ses ancêtres et de son culte.
En dehors de ses rapports sexuels conjugaux, la femme Wemenou d'une certaine façon se prostitue. Elle ne se donne pas, mais s'offre à n'importe quel africain ou étranger pourvu qu'elle puisse en retirer un certain profit, surtout matériel, aussi minime soit-il (pagne, sandales, bijoux de pacotille, etc.). Même si l'attrait charnel n'existe pas, si le physique, l'âge, la personnalité ne l'intéressent pas, seule la gentillesse de l'homme, ou plus exactement sa richesse, l'attire. Plus u:i homme
52
est généreux, plus il aura de succès auprès des Wemenous, d'autant plus que le tam-tam ne reste pas muet dans ces cas-là et que, comme toutes les femmes du monde, elle est très consciente des vertus de son corps.
Les jeux érotiques La sensualité prend pourtant une grande place
dans sa vie. Elle est certainement aussi sensuelle qu'une européenne, mais très différente dans son comportement. Les femmes aiment à se retrouver entre elles, par petits clans. Elles sont assises paisiblement dans ou devant une case et se livrent à des jeux érotiques très variés, sans pudeur ni contrainte, où elles puisent une jouissance physique qui semble suffire à leur vie sexuelle.
Il serait pourtant faux de les prendre pour des lesbiennes, car contrairement à celles-ci, il n'y a aucun déséquilibre chez elles. Depuis sa naissance, son adolescence, et jusqu'à sa maturité, la femme Wemenou a été éduquée dans ce sens: elle se fait jouir elle-même, ou demande l'aide d'une compagne. C'est son problème de femme. La fécondation est le problème du couple (mari et femme unis socialement) et, contrairement aux Européens, ces deux problèmes sont bien différents et bien distincts.
Toutefois, la femme Wemenou de plus en plus en contact et en confiance avec la femme européenne, est tout à fait consciente de la grande différence sensuelle qui les sépare l'une de l'autre.
La femme blanche est pour elle un objet de curiosité tant sur le plan physique que sur le plan sensuel. La femme européenne sera soumise à différents tests. On essaiera, psychologiquement, de la rapprocher de la femme Wemenou en la coiffant à l'africaine, en l'habillant d'un pagne, en la couvrant de bijoux et elle devra même, symboliquement, donner le sein à un enfant. Lorsque la
lemme noire ~cnl que la femme blanche 'emble lui être M1um1se. elh: lui fera ~ub1r quelques Jeu~ èrutiqucl>. entre femme~. où le:. ~eins ~0111 le plus J.!tantJ facteur: 11~ ~crnnt adm1rè~. palpés et care'i~és ;ne1. beaucoup d'allentwn. de pa~ .. wn cl J'citdtal11>n.
L'effet "cnsuel clicomplé n'étant pa~ survenu. l.i \\ emc110u comprend par !>On 1nstinc1 qu'une européenne allend bcaucuup phi' de l'amour que cc qu'elh: peul lur prm.:urcr en lanl que femme. Son intuititln lui fait com prcndn: qu'il y a " :autre chose"• ~a Jalousie et peut-être ~ei. scni. s'èvcillent cl elle 1.~!>a1c Je se rapprocher o;en~ucllcmcnt de la femme cutopcennc.
Cc ral'prnchemenl ps)diulog1que se \'oil de fa.;on trè'> C\ 1dentc dan .. ~a tenue \C!>llment;urc et ~urtout ~c~ sous-vêtement~. L:llc \CUI 1m1tcr la femme hlunr.:hc. elle veut essayer d'être une bhinche a tout prix, mê:mc s1 sa tenue \·cstimen1a1rc ne .,·harmom~e absolument pas a\cc les formes de "'" curp' et sa co ndll um de vie. l::. llc l'or 1er a "dans ks gramJes occasions», un slip et un \OUlien-gurgc pour ~c .. cnur plui. lemme, plus femme européenne:. Lllc \Orlera de plu~ en !'lus M:) sein~. non p;is par pudcur (la pudeur n'ciusle pa-. pour elle tJans cc ll(]rn;iincl mais pour y découvrir un nou~cau Jeu érotique curupécn. Le h:user. ahi.1>lumen1 inconnu che1-clle ju~qu';i
mai ntcn:1111. i.emblc ê~alemcnt éveiller sa ~cnsuali1é. et nou.., vcrruns une \'l.'cmcnou tendre spon-1.mè1m:n1 .'>C:~ lévres a un homme:, \UrlOUl o;ÏI CSI
c:ur\>p~en.
Il scmhlc 4ne la Wcmcnuu ci.I 1rè ... a111réc par c:t très curieuse de tuul <.:c qui 1t1ucbc au durn;1ine propre de la femme On la \crrà prendre une ou <.leu)!; .. p1luh:s" au couri. de sun qde mcns1rucl, non pas d:111~ un but cuniraccr>1il, mais un1quemcn1 pour 11111ler cerlatnc femme curupècnnc. Si \OU.\ lui ollre1 de:-. garnitures h) !llénu.iue:. lfllerncs en lui pré:.cntanl cela comme un objet utiht:iire 4uclcunquc mais tri:\ apprécié des t<:mmc~ eurnpècnne .... clic s'en Jch1ntèrc ..... era. mab s1 vous lut tJonne1 1'cll.plic;1t1un cll.accc de l'u111i1é de ces tampon .... au~~i161 son ci.prit s'cn:illc, elle ' 'CUI le~
avoir. plu!> pour le!> J.!itrder du:1-cllc, parmi ~es trérnr!> Intimes, que !'OUT les Ulih'>cf d'une fa1ton h)gtémque
1.cs i;eins qui juucnt un rôle lrè ... important dans la\ ie ~ensudl'! de la Wemcnou sunt ~uuvcnt !'Our elle un ubjet de préuccupatum. Trè~ souvent
f e111mc• 1vèmb11111
/or.\ J'mw , ht•111011h' Jr """u' Lt! ncainc cs~u1e de musquer a\ ci.: i.Ci> main!\ une partie de ses se111s trè~ lourds cl trèî. pendant~. el c' prime l'a rfo is le Jésî r " d'en cou pcr " pour .1vu1r de~ i.cm~ à l'europèennc. hu:n que les critère~ de he:1utè en sonl très d11Tércnl~.
Il ~cmblcr;iit que lu Wcmcnou soit un peu lasse de: I' cd uca hllO se"' ucll c q u ·clic re1101t de ses a ncê-1 re~ el qui est gérée par ~on culte. cl serait prèle ;i recevoir nnc: nouvdlc èducatiun. l outefo1s, 11 ~cra i1 un (leu usé cJe croire qu'une femme Wemcnuu .1hJnùunncr.1i1 cumplètcment i.un éduca111111 anCc'llralc Ulc en gardera certamcmcnt toull!l> les i.:11u1uincs et hab1tudcs qui pourrau:nt lui apporter une sa11sfacliun personnelle tant sur le l'lan l>Ocial que sur le plan seni;ucl.
«planning» traditionnel au mali André Laplante, Ethnologue, C.R.D.I. * Bourama Soumaoro, Guérisseur, Bamako
Depuis une dizaine d'années on a beaucoup parlé à travers le monde de planning familial et de contraception. Des campagnes massives de publicité et des efforts sans précédent ont permis à une bonne partie de la population mondiale d'avoir accès à des services de contraception. Au cours de la même période, de fortes résistances se sont manifestées dans les pays du Tiers-monde. Souvent, les élites intellectuelles perçurent la contraception comme une importation occidentale contraire aux moeurs de leur peuple et parfois même, comme un instrument du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental. Il y aurait long à dire sur les causes de ces résistances et sur les intentions des promoteurs occidentaux de la contraception. Nous croyons, pour notre part, que les réticences des intellectuels du Tiersmonde tiennent beaucoup plus aux idéologies et aux objectifs suivis par les promoteurs du planning familial qu'au fait que ces pratiques contraceptives soient étrangères aux moeurs locales. À notre connaissance, on a toujours pu identifier des pratiques contraceptives traditionnelles chez tous les peuples où on a tenté de le faire.
L'Afrique de l'Ouest ne fait pas exception. Les études d'Acsadi et de Morgan ont montré qu'il existait au Nigeria une vaste gamme de moyens contraceptifs traditionnels, que ces moyens étaient connus par une majorité des adultes de la population, et que pendant de longues années encore, les masses nigerianes allaient recourir aux moyens traditionnels plutôt qu'aux méthodes modernes.
Au moment où le Mali songe à s'engager sur la voie d'un programme national de planning familial, l'équipe du Centre-pilote a cru impor-
*C.R.D.l. Centre de Recherches pour le Développement /nlernalional. Ollawa
54
tant de procéder à un inventaire des pratiques traditionnelles d'espacement des naissances et de contraception.* Cet inventaire est loin d'être terminé; l'équipe a d'abord entrepris une série d'une trentaine d'entrevues en profondeur dans un village du Wasulun (cercle de Y anfolila, région de Sikasso) et dans un quartier de Bamako (Hamdallaye); plus tard, on prévoit effectuer de semblables sondages dans toutes les régions du Mali. Les résultats obtenus au cours de cette première étape démontrent en tout cas l'existence d'un bon nombre de méthodes contraceptives traditionnelles et d'une préoccupation sérieuse de la population en matière d'espacement des naissances. Nous présenterons ici une courte description des méthodes inventoriées; par la suite, nous proposerons quelques réflexions sur la signification de cette enquête dans la mise en oeuvre d'un programme malien de planning familial.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, tous les informateurs interrogés au cours de cette enquête préliminaire, hommes et femmes, résidents des villes ou des campagnes, connaissent au moins deux méthodes pour réduire les risques de fécondation. Parmi les méthodes recensées, certaines sont fondées sur les connaissances physiologiques traditionnelles (abstinence périodique, relations sexuelles multiples ... ) et n'impliquent pas l'emploi d'instruments ou d'ingrédients. D'autres dérivent clairement de principes magiques (tafo). Plusieurs reposent sur les connaissances pharmacologiques locales; ce sont les moins connues et les plus secrètes. Il est intéressant de noter qu'à l'exception de l'abstinence et du tafo, les méthodes contraceptives que nous décrirons
*Bamako est la première ville francophone de l'Afrique de /'Ouest à avoir une clinique pilote de planning familial (Nole de /'éditeur)
sont toutes réservées à certaines occasions spéciales (décès du chef de famille, querelles entre coépouses ... ) ou destinées à un milieu social marginal (prostituées, villages chrétiens ... ).
L'abstinence sexuelle en période post-partum est probablement le principal moyen utilisé par les familles maliennes dans le but d'espacer les naissances. En milieu wasulunké, la femme doit s'abstenir d'avoir des relations sexuelles jusqu'à ce que son enfant soit sevré, c'est à dire jusqu'à ce qu'il marche ou jusqu'à ce qu'il puisse parler. Pour faciliter cette pratique, il est fréquent qu'on envoie la nouvelle accouchée chez ses parents. Le
Le N'Talenfura, toile d'araignée utilisée à la manière d'un diaphragme
« denafin » (aller montrer l'enfant) permet d'éviter les multiples occasions où l'abstinence serait compromise.
Il ne fait pas de doute que la pratique de l'abstinence sexuelle en post-partum telle qu'elle est présentée par les wasulunké vise d'abord à éviter une nouvelle grossesse au cours de la période normale d'allaitement. Bien qu'on ait conscience de la protection relative que fournit l'allaitement, on sait que cette protection diminue avec le temps et qu'elle souffre d'importantes exceptions. Le terme « seremuso » désigne aussi bien la femme dont le retour de couches est précoce (moins de
six mois) que celle qui se trouve enceinte avant la fin de la période normale d'allaitement; le terme « sereden »désigne l'enfant dont il faudra hâter le sevrage à la suite de la nouvelle grossesse. On affirme au Wasulun qu'un « sereden », même lorsqu'on tente de prolonger l'allaitement le plus longtemps possible, a très peu de chances de survivre. La mère d'un tel enfant, la« seremuso »,
doit subir les sarcasmes et les plus vifs reproches de son entourage.
Même si le désir d'éviter une nouvelle grossesse avant que l'enfant ne marche constitue le principal fondement de l'abstinence, il n'en constitue pas le seul. Trois autres raisons de s'abstenir sexuellement au cours de la période post-partum nous ont été mentionnées par nos informateurs. Tout d'abord, on croit que la semence masculine en se répendant dans le corps empoisonne le lait maternel et provoque chez le nourrisson de fortes diarrhées. Ensuite, l'élevation de la température du corps au moment des relations sexuelles est sensée déteriorer le lait maternel et rendre l'enfant malade. Enfin, le même phénomène de l'élevation de la température, dit-on, bouche les canaux du mamelon et diminue la ration de lait dont dispose le bébé.
Tous les informateurs que nous avons interrogés connaissent les termes « sereden » et « seremuso ». Cependant, le respect de l'abstinence sexuelle prolongée est beaucoup plus rare à Bamako qu'au Wasulun. Certaines femmes de milieu urbain pratiquent toujours l'abstinence sexuelle jusqu'au sevrage, mais la plupart des informateurs bamakois prétendent qu'une abstinence de quarante jours est non seulement suffisante, mais que c'est la seule qui respecte les prescriptions coraniques. D'autres informatrices opinent qu'une abstinence de trois mois, si le nourrisson est un garçon, et de quatre mois si c'est une fille, offrent une protection suffisante.
Quoi qu'il en soit de ces variations, il faut retenir que l'abstinence sexuelle post-partum est connue de tous, qu'elle témoigne fermement des désirs maliens en matière d'espacement des naissances et qu'elle semble beaucoup moins respectée en milieu urbain qu'en milieu rural. Nous reviendrons sur les implications de cette situation et sur le rôle que pourrait jouer le planning familial moderne comme alternative à l'abstinence sexuelle post-partum.
55
Contraceptifs et croyances physiologiques D'usage bien moins fréquent, l'abstinence
périodique nous a semblée aussi connue que l'abstinence prolongée en post-partum. Les notions de nos informateurs sur le cycle menstruel différent totalement des notions occidentales généralement acceptées. On considère les quatre ou cinq jours qui suivent la fin des règles comme la période la plus fertile du cycle. L'abstinence périodique en milieu traditionel malien revêt donc une forme qui peut paraître étrange aux yeux des biologistes de formation occidentale; la femme qui désire éviter une grossesse s'abstiendra, non pas pendant les jours qui suivent l'ovulation, mais au cours des jours qui suivent la fin des règles. Il est indispensable de résumer ici les principales croyances traditionnelles sur les causes de la fécondation.
La fécondation résulte, dit-on, de la rencontre des sécrétions génitales féminines et masculines. En Bambara et en Malinké, un même terme (canindji) désigne les sécrétions des deux partenaires. Pour qu'il y ait fécondation, plusieurs facteurs doivent être réunis. On prétend ainsi que l'orgasme doit survenir en même temps chez l'homme et chez la femme. Ensuite, la probabilité d'une fécondation est d'autant plus grande que le plaisir est plus vif. Deux informatrices d'un âge avancé nous ont assuré qu'elles avaient su identifier pendant toute leur vie féconde, chaque relation sexuelle qui aboutissait à une fécondation. Un plaisir intense, une légère douleur au niveau du pubis de même que la perception d'un grand plaisir chez le partenaire masculin constituent, aux dires de ces informatrices, les signes presque certains d'un début de grossesse. Enfin, la fécondation est plus probable au cours des jours qui suivent les règles parce que la matrice est plus réceptive, mais aussi parce que la femme peut ressentir pendant cette période un plaisir plus intense. La femme qui partage ces notions et qui ne désire pas être enceinte évitera naturellement d'avoir des relations à la suite des règles.
Une seconde méthode pourrait découler de ces croyances physiologiques. Une femme qui éviterait l'orgasme, ou qui réussirait à contrôler son plaisir sexuel, réduirait la probabilité d'une fécondation. Une seule informatrice nous a mentionnée avoir déjà eu recours à cette technique, en
56
ajoutant d'ailleurs qu'il s'agissait là d'une chose très difficile à réussir.
Une autre croyance physiologique donne lieu à des pratiques contraceptives qui, par nature, ne sont applicables que dans un contexte illégitime. Une femme qui a des relations sexuelles avec plusieurs hommes différents, dans un bref laps de temps, est réputée ne pas pouvoir concevoir. Un précepte connu de tous nos informateurs se formule de la façon suivante: «le lait de chien avec le lait de chèvre et le lait de vache ne caille pas». En d'autres termes, si on mélange des laits d'espèces différentes on n'obtiendra jamais du lait caillé et de la même façon, les sécrétions génitales de plusieurs hommes ne peuvent jamais entraîner de fécondation. «Toutes les jeunes filles et toutes les femmes de Bamako connaissent ce principe» nous confie une informatrice. Il reste que la pratique des relations sexuelles avec plusieurs hommes doit être exceptionnelle. En fait, on se réfère plutôt à cette notion lorsqu'une femme est soupçonnée de stérilité et qu'on veut en trouver les causes.
Notons d'ailleurs que les croyances physiologiques que nous venons d'évoquer, et dont découlent ces pratiques contraceptives, ont toutes d'importantes implications dans les problèmes de stérilité. Une femme présumément stérile est invitée à multiplier les relations sexuelles au cours des premiers jours qui suivent la fin des règles. D'après un guérisseur du Wasulun, l'incapacité chez une femme de jouir sexuellement provoquerait une insuffisance de sécrétions génitales et favoriserait ainsi la stérilité; dans certains de ces cas, l'administration d'un lubrifiant et d'un aphrodisiaque pourrait régler le problème. Au Wasulun, et dans plusieurs milieux de Bamako, une femme présumée stérile est souvent soupçonnée d'avoir des relations extra-maritales avec plusieurs hommes. Avant que d'autres hypothèses soient envisagées, des marabouts ou des guérisseurs sont consultés afin d'établir l'innocence ou la culpabilité de la femme.
Contraceptifs et pharmacopée traditionnelle
Les méthodes dont nous avons traité jusqu'ici constituaient des applications évidentes de notions traditionnelles largement connues; aucune d'elles ne comportait l'utilisation d'un instrument ou d'un produit quelconque. Nous avons
!f
...........
l m· dmu111t• dt• plu111f1<'1H11111 /m11i/111h• â A.e1mp1tle1. Ouguml". 11.Jmu. pour 11•mr c·cm11•1t• 1/1-.\ <'"""'"'''·\ •'I traditio11.~ lornh·.~. hic•n lt'.1 L'tm1witrt·.
IO\ cntorie au cour!. de nul re enquête bon numhrc de métlwdc' contraceptive~ fondées au rnnlrnirc ~ut des prm..:1res magique:. secret~ ou i.ur une c11nna1ssancc rharma.;olùg14uc cmp1ri4uc. toutC!io \.'CS méthodes supposent l'u111is.11ion c1'1n:.1ru-111cnts ou de produil!> plus ou moin:. courants. l lnc ~cule d'entre elh: .... lc lafo. nou ... a semblé largement connue.
Le talo e ... t une cordelette de coton ~ut laqudle Sünt fait:. dct- nuc:ud., A .:ha4uc nvcud est lié..: unc parole magi4uc ~cercle que réelle le marabout ou le guêri~~cur Le nomhri: t.le noo.;udi. \'Urie en lonc-111111 de la largeur du ha ... ~in de la lemme. Une fuis terminé. le tafo C!tt expérimenté ~ur une r>oule r>undeu!>c; s1 la poule ces~c de pondre. 11 esl rcm1~
à la chente Celle-ci e~I tenue de le porter pour la première foi.., au début des règles. On prétend que l.1 durée de I' clTct cuntraccptll e\I ~ans hmih: et tjll ïl pcrsi~tc ;iui.s1 lungtcmp... tjUC le talu c't porté.
\Jnc llUtrc ùc ces méthodes, le N'T:.ilcnfura. rc"crnblc hcaucoup <1 u\ tc.:hni4ue~ mudcrnc~ Ju dt.lphrat?me uu Je la c;1pc .:cn1c:ilc. Le N' falcnlura est une tuile d°41ruigncc très étam:hc 4u\1n trouve ;ibuncfommcnt dans lcl> vieilles mabun!. Certaines h:nunc!> de Bamakl>. en partîculu:r ùcs prostltUèC!>, ,·en SCT\cnl à l't>cCaSlllO. (. h:.iquc toile ne peut si:n ir que ruur une M!Ulc rclutwn i.cxudlc. Le NTalcnfuru est emplo}ê en méde\.'tnc 1rnù111onndlc pnur panser le~ blessures ~r.i.-
57
I I
ves et pour obstruer l'orifice des cornes qui servent de ventouse. On doit signaler que le N'Talenfura constitue un élément important de plusieurs instruments de musique maliens. Parfois, le N'Talenfura s'utilise de pair avec un tafo.
Contraceptifs oraux La racine de N'Gwane (nom wasulunké d'un
arbuste de la région de Sikasso), aux dires d'un de nos informateurs qui affirme l'avoir fait utiliser par ses femmes depuis vingt ans, aurait une efficacité contraceptive surprenante. La racine est d'abord sèchée et réduite en poudre. La femme qui désire éviter une grossesse doit prendre chaque jour deux pincées de cette poudre en solution dans de l'eau chaude. La racine de N'Gwane est aussi utilisée pour traiter les aménorrhées et pour retarder la ménopause. Le Dr Koumaré du laboratoire malien de médecine traditionnelle procède actuellement à des analyses de ce produit.
Plusieurs des méthodes recensées constituent comme le N'Gwane des «contraceptifs oraux», c'est à dire qu'elles supposent la consommation d'un produit quelconque. Ainsi, on attribue des vertus contraceptives aux infusions du « N'Tomi » (Tamarin) lorsqu'une femme en boit en grande quantité juste avant les relations sexuelles. La réputation des infusions de tamarin comme contraceptif est bien établie au Nigéria et aux Antilles autant qu'au Mali.
On trouve au plafond des cuisines une poussière noire laissée par la fumée. Ce dépôt, le Samanene, est quelquefois considéré comme contraceptif; deux pincées en solution dans l'eau, la soupe ou la sauce suffiraient à protéger une femme pendant une journée.
Les propriétés contraceptives du « didlo » (Hydromel) sont connues dans les milieux traditionnels non-musulmans où nous avons mené nos enquêtes (milieu animiste ou chrétien). Une chanson du Wasulun évoque la stérilité temporaire des femmes d'un village chrétien, au cours de la saison où le miel est récolté:
58
«Je n'irais jamais à Gualala Les femmes y sont toutes enceintes au même moment. Elles ne sont pas grosses au temps du Sandjukuman L'hydromel en est la cause Car l'hydromel, chez elles, n'est pas totem».
On retrouve l'alcool de miel dans une recette contraceptive qui sert dans une circonstance précise. À l'occasion des cérémonies mortuaires des chefs de famille au Wasulun, les filles du défunt reçoivent une liberté sexuelle temporaire, et peuvent choisir tous les amants qu'elles veulent pendant sept jours. Pour éviter les risques de grossesse, on prépare le « konkoro hadji», en mélangeant du tamarin, du piment et du miel avec de l'eau. Le terme « moridlo », qui signifie alcool des marabouts, est aussi employé pour désigner le contraceptif en question.
Deux autres contraceptifs, le« n'sere wulen »et le« segekata », ne sont jamais utilisés volontairement par ceux qui les consomment. L'écorce du « n'sere wulen » est séchée au soleil, pilée, séchée, de nouveau, et réduite en poudre. Le produit obtenu est sensé provoquer une aménorrhée chez la femme qui le consomme. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeller un contraceptif d'agression. Celle qui l'emploie le fait normalement pour empêcher ses co-épouses d'être fécondée. Pour parvenir à cette fin, on dit qu'il lui suffit de mélanger une coque d'arachide de poudre de « n'serewulen » à la sauce du repas des femmes. L'écorce du n'serewulen est aussi utilisée pour le traitement des blessures et des hémorragies.
Le « segekata » (potasse) est utilisé couramment dans la confection des sauces et du tô (gâteau de mil). On croit que le segekata, en quantité suffisante, constitue un excitant sexuel pour les femmes; au contraire, les mêmes quantités consommées par les hommes rendraient ceux-ci partiellement impuissants. Compte tenu de ces propriétés, le dosage du segekata deviendrait une arme particulièrement féroce entre les mains d'une co-épouse jalouse. Non seulement un dosage abusif permettrait-il de limiter les naissances d'une co-épouse indésirable en rendant le mari impuissant, mais il laisserait celle-ci avec ses désirs inassouvis. Nous atteignons avec le segekata l'ultime limite de ce qu'on pourrait appeler un contraceptif. Au sens strict, le terme« contraception» se rapporte aux moyens qui permettent d'éviter une fécondation tout en ayant des relations sexuelles. L'abstinence sexuelle, volontaire ou imposée, peut difficilement à ce titre être considérée comme contraceptif; elle n'en constitue pas moins un moyen de limitation ou d'espacement des naissances.
J1•11111•\ /1/h·~ Ma.rnï f A <'fll'tll l.tl r111r11r1', /'1111 "'"' 11/lt'l//f\ 1r11d1111111111•/,, "" la fc•111111r
l c~ donnccl> recueillies JU~qu'1c1 par le <:entre p1h>1c dc phrnning f;.urnliul de B;im.1ku ne pcrmel· lent p.1s d'ê~.i.lucr préci.,émc111 l';unplcur Jcs pr.1· 111.1uei. 1r.1dit1unndle11 d'cspaccmenl Je~ nu1~i.11.n· cc' cl de contn11.:crtion au ;\<l;il1 ()c., an.tl)i.c:s Je lahmJl01rc llnt été amon.:éc.,. mai' O\IU!> n'avons
clll.•>re .1ucune 1dèc de l'ellîl:ac1h: Jes 1~roduih c:I de., met h111J.:., 10\ en 1 unèe' N \ll> don née' i.e pré· ll'lll 41rnnd mëmc à qucl4ue~ dèdui:t111n:. d'ordre
général. San' pccher par optuni~me. nou~ rou~uni.
Cl>pètcr 4uc certains dei. contraccpt1fl> rc..:ucdli' iucnt quclqu'clhciJ..:llé. Il c~t intérc!.sanl de 11ouh· gncr à w ~UJC:I que la contradiction entre lcl> nulwni. rnJI icnnc\ cl "occident a les•• \u r o la pénoJc lé1:lmdc 11 du cyde mcn~trucl 111.: pourrait être yu';ipp.ircntc l\u cours dei. dcbah 1k cc 'c1111nam:. le l>r. S111anm: l\C:pé!t mcn1111nnait 1.1uc
Le tajà: cordelette de coton avec des noeuds qui possèderait une vertu contraceptive.
de récentes recherches menées en Europe tendraient à démontrer que la plupart des «ovulations spontanées» se produisent au cours des premiers jours qui suivent la fin des règles et que ces ovulations semblent liées à l'intensité du plaisir ressenti par la femme; le Dr Képès ajoutait qu'il se pourrait bien que le taux d'échecs phénoménal caractérisant les méthodes rythmiques (Ogino, sympto-thermique, ... ) soit attribuable à l'ignorance des processus d'ovulation spontanée.
Le précepte relatif aux relations sexuelles d'une femme avec plusieurs partenaires pourrait avoir aussi un solide fondement. Des recherches effectuées auprès de prostituées en Occident ont confirmé que dans certaines conditions, la promiscuité entraînait une baisse considérable de la fécondité. Plusieurs hypothèses ont déjà été proposées pour expliquer le phénomène (variations du pH vaginal, immunisation contre les spermatozoïdes, etc ... ). Une des méthodes qu'on nous a décrites pourrait receler d'étonnantes possibilités; la poudre de N'Gwane est utilisée à des lîns contraceptives, mais aussi pour guérir des aménorrhées ou pour retarder la ménopause;
60
il y a là une analogie frappante avec les anovulants modernes (la pilule) qui justifie certainement une analyse approfondie en laboratoire. Bref, il n'est pas exclu que les connaissances traditionnelles maliennes en matière de contraception contribuent un jour au perfectionnement de certaines méthodes de planning familial.
S'il est trop tôt pour estimer l'importance précise des pratiques de contraception au sein des populations maliennes, on peut sans grand risque avancer qu'elles sont fort communes. Le nombre de méthodes que nous avons recueillies au cours de ces recherches préliminaires ne laisse pas d'être impressionant compte tenu du fait que nous n'avons interrogé qu'une trentaine d'informateurs. L'usage de ces contraceptifs, cependant, n'a pas un caractère systématique. Ceux-ci sont utilisés pour parer à des dangers occasionnels, et non pas comme moyen principal d'espacement des naissances. Une femme mariée pensera à recourir au tafo ou à d'autres contraceptifs traditionnels si son mari ne respecte pas la période normale d'abstinence pendant l'allaitement. De multiples situations illégitimes, telles les relations pré-maritales, extra-maritales, certaines formes de prostitution, pourront aussi pousser une femme à se« protéger» au moyen de ces diverses méthodes. Mais il est remarquable de constater la grande discrétion, sinon le secret et parfois même la désapprobation qui entourent les propos qu'on tient sur les méthodes en question.
Au contraire, l'abstinence sexuelle prolongée en période d'allaitement est perçue comme une pratique honorable et dont on parle ouvertement. L'abstinence post-partum constitue manifestement la méthode normale d'espacement des naissances dans les populations maliennes où nous avons enquêté. Qui plus est, les raisons qu'on présente pour justifier cette pratique sont conçues dans une stricte perspective de santé maternelle et infantile.
En terminant, nous devons souligner avec vigueur une des conclusions les plus évidentes et des plus significatives de ces recherches préliminaires: la politique du ministère de la Santé publique qui préconise la mise sur pied de services de planning familial dans un but d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, a de très vastes assises populaires, et, sans doute aussi, des racines fort anciennes.
le développement psychosexuel de l'enfant Docteur Suzanne Kepès, Paris Médecin du travail, gynécologue, psychosomaticienne
Avant Freud, la sexualité de l'enfant était peutêtre, comme à la campagne, connue des nourrices, mais elle n'était pas connue des médecins, ou mal connue, et il était convenu de considérer l'enfant comme un «ange», comme un être qui n'a pas de besoins sexuels. Freud s'est surtout intéressé à la sexualité de l'enfant à partir d'un an. Mais, dans mes consultations gynécologiques, j'ai été tellement frappée d'entendre, en écoutant les femmes frigides me parler de leur mère, avec des mots tellement. .. importants, importants soit dans le sens de l'amour, très grand, pour la mère, soit dans le sens de la haine, très grande, pour la mère, que je rne suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait avant la naissance et pendant la vie in utero.
On ne sait rien de très précis sur la vie intrautérine, mais on sait déjà qu'il y a des enfants qui sont désirés, et d'autres qui ne le sont pas. Il y a eu, je crois, des recherches faites sur l'électroencéphalogramme de l'enfant in utero et j'ai entendu dire qu'on sait que l'enfant pleure parfois in utero, qu'il a, en tout cas, des signes de souffrance psychique qui se traduisent par des modifications de l'électro-encéphalogramme.
Cette souffrance de l'enfant in utero peut venir, peut-être, de la mauvaise humeur de la mère, de son état de malaise dans la société, de l'acceptation de la grossesse, et de sa relation avec l'environnement familial, avec son mari, ses parents, ses beaux-parents, avec la société. Ce qui est certain c'est que, à la naissance, il se passe quelque chose d'extraordinaire entre la mère et l'enfant. L'enfant qu'elle a porté neuf mois lui apparaît et, bientôt, ils ne vont plus faire qu'un, qu'un seul. C'est-à-dire que pendant toute la première année de sa vie, l'enfant vit par la mère et la mère vit
pour l'enfant. Il y a là, au début, dans les quinze premiers jours de la vie, une sorte d'état de fusion complète entre le nourrisson et sa mère.
À la naissance, le nourrisson n'est pas du tout conscient, il est un être indifférencié, psychophysique, qui vit totalement dans l'inconscient qu'on appelle le« ça», dont il va sortir très lentement et très progressivement, grâce à la mère et par la mère. Parce que la mère, tous les jours, à toute heure du jour, sent ce dont a besoin l'enfant, et qu'elle caresse l'enfant, elle le nettoie, elle lui donne à manger. Chacun des gestes de la mère est un plaisir pour l'enfant; plaisir sur tout le corps; plaisir sur le sexe, pourquoi pas? Bien sûr, je crois qu'il y a le problème de l'hygiène, et qui est important, mais il y a aussi des mères qui embrassent le ventre de l'enfant, ou le sexe, ou les fesses, c'est une manifestation de tendresse! Je l'ai vu, en France, je l'ai vu autour de moi, des mères embrassant le ventre de l'enfant ou son sexe; c'est une telle fusion, il n'y a pas de problème, c'est tout naturel !
La formation du cc moi» L'enfant ne reste pas toujours un nourrisson de
quinze jours; il devient bientôt un nourrisson d'un mois, puis de deux mois, et peu à peu, très doucement, il se forme un petit «moi», un tout petit «moi», c'est-à-dire qu'il distingue la mère, la mère ou le substitut maternel. Tout enfant, sur cette terre, n'a pas la chance d'avoir sa mère, il a parfois une nourrice, il a parfois un parent d'adoption, et nous verrons tout à l'heure quelles peuvent être les différences. Mais en tout cas, dans le cas le plus courant, quand la mère est là, la mère, peu à peu, aide l'enfant à sortir de l'inconscient, à se former une petite personnalité. L'enfant reconnaît la mère et à partir du moment
61
où il reconnaît la mère, il fait une différence entre «lui» et« l'autre». Et ça, c'est capital. Il est capital de savoir ce qui va se passer à ce moment-là. Quelle va être l'attitude de la mère? Si la mère est trop possessive, si elle est inattentive, cette différenciation entre le «ça» de l'enfant et le « moi » va mal se faire.
Si, au contraire, la mère sait juste ce dont l'enfant a besoin, c'est-à-dire le langer, le laver, le nettoyer, l'embrasser puis le remettre dans son lit, et ensuite lui donner à manger dès qu'il pleure, l'enfant va apprendre qu'il y a des moments où on peut être satisfait et des moments où on ne peut pas être satisfait. La mère qui serait tout le temps après son enfant, à lui donner toujours à manger, le gaverait, en ferait un obèse, et elle serait une mauvaise mère.
Que la mère caresse et porte souvent son enfant, qu'elle soit toujours là, ça c'est très bien, et je suis émerveillée, en Afrique, de voir le petit enfant au contact du dos de sa mère. Je pense que là, l'enfant africain a une chance énorme par rapport à l'enfant européen qui n'est pas si souvent, si gentiment, si tendrement toujours près de sa mère. En Europe, effectivement, l'enfant est remis plus souvent dans son lit; je crois que c'est dommage pour les premiers temps, mais je ne saurais pas dire jusqu'à quel moment.
Il faut bien, tout de même, qu'un jour le nourrisson qui arrive à trois, quatre mois, commence à goûter la différence entre le moment où on est tout seul et où on a un besoin, et celui où arrive la mère. À ce moment-là, elle lui donne à manger, elle le caresse, il connaît le plaisir, il connaît la détente. Quand la mère l'a reposé, qu'il s'endort et que renaît, un peu plus tard, le besoin de faim, où celui d'être changé, il connaît le déplaisir. Mais cette alternance entre le plaisir et le déplaisir façonne déjà sa personnalité, lui donne une idée - très vague - qu'il y a un monde extérieur et que, dans ce monde extérieur, il y a la mère, essentiellement la mère.
Le stade oral Freud a appelé ce stade: le stade« oral». Et il
ne s'y est pas attardé davantage. Effectivement, le plaisir principal de cette période est le plaisir qui vient par la bouche, par le lait maternel. Plaisir qui n'est pas seulement dû au fait que le lait descend délicieusement dans l'estomac, mais
62
aussi qu'il est pris au niveau du sein de la mère. Et il y a, en même temps, la chaleur, la caresse et la douceur du sein maternel, et il associe le sein maternel et le plaisir de sentir son estomac se remplir. Ce sont plutôt les élèves-femmes de Freud qui se sont attardées sur cette partie, parce que, évidemment, Freud était un homme et ne pouvait pas sentir cela! Il y a eu plus tard des analystes, un surtout, dont je vous recommande vivement la lecture, il s'appelle Winicott; il a écrit des livres merveilleux sur les besoins de l'enfant et sur les besoins de la mère.
Freud, comme je vous le disais, ne s'est pas tellement attardé à la phase orale, à la première année de l'enfant; il s'est plutôt attardé au stade suivant que vous connaissez certainement, le stade «anal», puis le stade «génital» ou «oedipien».
Le stade anal Le stade anal commence après le stade oral,
après la première année, il va de un à trois, quatre ans, selon les cultures, selon la mère, selon les principes de la mère et de l'entourage. C'est le moment où l'enfant prend du plaisir à donner ou à ne pas donner ses selles à l'extérieur. Si la mère est très obsessionnelle et très avide, pour des raisons faciles à comprendre, d'avoir un enfant propre dans certaines conditions (quand elle est pressée ou quand elle a du travail) l'enfant est soumis à une contrainte trop grande, parce que le sphincter de l'anus n'est pas encore préparé à un tel dressage. Si la mère a du temps et si elle sent bien son enfant, elle le laissera évoluer au cours de ce stade anal, tranquillement, de façon à ce que le sphincter de l'anus progresse, se développe, puisse commander lui-même de donner ou de ne pas donner la selle.
Parallèlement à ces stades freudiens, ou décrits par Freud, donc stades psychologiques, il y a des processus biologiques, physiques, de maturation que nous ne devons jamais perdre de vue. Chacun des stades psychologiques s'appuie sur le biologique, sur le développement endocrinien, sur le développement du cerveau, sur la maturation progressive du système nerveux. Chacun de ces stades (oral, anal et génital ou oedipien) est accompagné de modifications dans le corps et dans le système nerveux. Par exemple, à partir d'un an l'enfant apprend à marcher, à parler, et
« La chaleur, la caresse et la douceur du sein maternel . .. »
-
I " Um• pt•tilt' /lt'r.w11111alilé st' Jurml' . •• "
quand on parle du stade anal, il ne rau1 pas ou· hlicr qu'il se produil déjà une socialisation de l'enfant. puisqu'il marche e1 commence â parler. Tout ce qui va l'aider sur le plun du développe· mcn1 moteur va aussi l'aider sur le plan psychologique, cl tout cc qui l'iude sur le plan psycholu~HjUC, inversement, J'.aitlc Sur le plan moteur.
te stade 11ëni111I /\près le :-.tadc anal, il y <t le stade génital où
l'enfant s'intéresse beaucoup moins à la nourriture, beaucoup moins à cc qui se passe au niveau des selles. el davantage il ce 4ui se passe au niveau de snn !>CXc. C'eNt la découverte du !>CXC. C'est la découvene au!>si de la masturbation. En général, c'est à cet âge-là que lon voit Ici. pell!!> gar<;ons jouer avec leur pénis et que l'un ne voit pas. assel souvent. h:i. petites HIies jouer avec leur clitoris. Je dis " pas asscl SOU\'Cnt 11 , et j'essa)·er;1i d'expliquer celle atfirma· 11on lorsL1ue je parlerai des fcmmci. fr1g1des. Oans le passé, 11 ) ava11 une: wlérancc plu~ grande de: la sociètê, de la men: et du père, v1s·û-v1~ de la mas· turbatîon Je renfont. La ma!>turhation a été con· sidérée comme a11-réable et innoffensÎ\IC jusqu'au dix-neuvième siècle. À cette épuquc de purila· nismc vic10ricn, clic est apparue comme quelque
chose 4ui était déplaisant, qu·11 ne fallait pai. fam.:. C'est au dix-neu\11èmc !>Îède. époque du dé· veloppcment de la bouq1cm~ie et du puntamsmc vktorien. que sont apparus les interdits conccr· nant la masturbatiuu.
Or. l'enfant sait très bien ce qui se pas~c au ni· veau de ses parent~. même s1 le~ parents ne dbcnl rien. G ràce au langage 1nfra·verbal. qui est !11 1111·
portant dans l'enfonce, l'enfant "sent n cc que pensent les parents de sa masturbation. S1 les pa· rcnts la tolèrent, l'enfant lie masturbe avec plai!>ir, il en retire un plaisir, et un plaisir au1orisè. Ce plaisir autorisé lui permet de pro· grcs~c:r dans la suite de !Ion dèvc:loppcmenl. St, au contraire, les parenb ne tolèrent pas la masturbation. ne l'a);int ras pra1i4uéc 1>u. ayant des idée!> que celle masturha11on est nociYc 1)our l'enfant. ils ernpèchent l'enfant, cro} anl bien faire, et à cc moment là, l'enfant re~~ent
une culpabilité. C'est une lie~ première~ :1ppa· rt 110 ns de lu culpabilité.
Oonc. au stade dil genital. l'enfant s'intéresse il '>On St:lle, JOUC avec i.on J>e'(C l)U ne JOUe pa~ U\"CC
-son sc:-.c. mais. en tout ca!>, 11 est apparu tian:. sa vie on "moi" plus dillërcndê, plus fort . Il n'y a pas encore de "i.ur-moi "• pas beaucoup, un tuul pt:tit "sur-moi n peul-être, cl il a maintenant la nolioo 'jUe, â côté de la mère qu'il croyait lui ap· parteoir totalcmeo1, 11 y a aussi Je père.
l::.n 11111. cc: pi:re est déJà présent dès la première annèt: - \lU devrait l'êtn:. Il dc:vrait être préi.ent dans la dcu•oi:mc: année. mai~ très souvent. l'en· fan1 ne prend \•ra1ment con!IC1ence du pi:rc: qu'a la tro1s1èrnc: année:. Parce 4uc: l>On dévc:loppcmcnt ps)cho-motcur est tel. wn mtelligenL-c c~t telle. 4u"il réah~c m1eu11 les cho~ei. cl 4u"il commence à voir 4u"il y a tro1~ pcri.onnagc:1o lus. la mère. le p.:rc.
l ne r<'la1ion objecuste. li y a cc 4u'on appelle: une: cc relation
objectale 11 • Le mjer est le nourrisson. L'objt•t d'a· mour c~t IJ mère. On appelle la 11 relation ohjec· talc:" la relation qui s'étahl11 entre le nourns~on (sujet) et la mère (Objet) C'est â partir de celle: première rclatwn ohJcctalc hrndamc:ntalc: 4uc !;C:
construit un être hu111u111 harml)nieux. C'c~I le prenuer hon départ. Il y a unc dcux1êmc étape importante 4u1 !>C Joue, quand le père entre en scène: L'entant apprend alors 4u'1I ) a un troi· sième peri.onnagc: d il 'a réaliser 4uc: cc: tro1Mèmc: personnage appanient a i.a mi:re et ras a lui. Cc:ci suscite dcll !M!ntimcnts con1plcl(e~: 11 avait Jusque· là unc mère tout à lui, et d'un seul coup. 11 faut la p:irlôtger avc:c un père, un .. troisième"
Le rôle de cc: père n'ci.t pa:. M facile. 11 laut à la foi~ 4u'1I )Oil Haimcnt le përe, nia1i. 4uïl devienne en même tcmp~ un ami de son cnfont. Quand 11 ) 0 agjt d'un nourrmon garçon. d'un petit garçon, la situation ~e prè!:>Cntc de la faljon ~ui· \'ante . le petit garçon adore )3 mère:. Il \ 011 apparaitre le: përc et il commence â avoir 4uel4ucs rèadlOO) d'ho)ttlité \ÎS a VIS de cc père. Mais. tl)ut de même, ce pèrt: JUUe avec lui - si le p~re joue a,·ec lui - et tl dc\'1ent un ami. Le: père est fort, le père le lance en l'air, le: père r,111 a\'eC lui des la!> de chobe) nou\ellci. que ne r.u~all pa'> lu rnére Il de\1cnt un ami pour l'enfant. Donc, la rivalité entre le: petit garçon et le père peut ~·es· tomper et l'c:nfanl c1>mmencc a avoir un senti· ment d'amitié, d"idc:nt1hi:a11nn in•cc cc père qui a le même ~c:'<c que lui. S1 celle identilicallon est po)111vc:, c'c)t·a-dire s1 le père e:.1 prèi.cnt, chaleu· reu.>. et bon. celle: 1dcnt1hcillaon va aboutir au l'ranchl~bemcnt du i.tadc gënital oc:ù1pien. L 'c:n· font va sortir du triangle et entrer dan~ la vie :.oc1alc. PuiS<juÏI s'eM 1dcnl1lié au pi:rc, il va, fort du prcnm:r amour de sa mère. fort ensuite de: cc ~re qui n'c:.t pas :.on rJ\al. mais un ami, entrer
/ '!l>l /, !//.
·/
~ .•.;, 1m11't't1I. Ji lt-ndrt'mi:111. prèJ Je- .1u mhe . .. »
dan~ la vil: sociale harmon1cu~cmcnl et passer à l'~ole. 1c~ quatre, cinq et six an). et là. corn· menccr à s'auacher il d'autres que le père et la mère.
t"c)t la l"é1olu11un i.ouhallahlc. celh: 4u1 serait 1dè;1lc. 4u1 pcrrm:ttru à l'enfant d'avoir, donc. une mi:rc chJlcurcui.c, pa~ lrup poi.scssivc, pas ja· loui.c lorsque le père commence û )'occuper de: l'c:nfan1. cl un père cf'1aleurcu:1.. l'enfant i.e dérn· die un pcl1t peu de se~ parents pour aller vers les groupes d'âge~ qu'il rencontre à l'école.
l 1ra 4·arrl'fo11r dilticil(• Pour une: peille llllc, c'e!>t heaucoup plus
cumphqué, plus d1llic1k; c'c:sl en c1ud1an1 et en è..:uutant les prnhlèmc~ de\ fcmmci. fr1g1dcs 4ue JC ~u1~ redc~ccnduc peu à peu <lu problème oedipien et du problème du père, au stade pnmitil dont j'ai parlë. celui de la relation archaïque mèrem1urr1i.i.on. de celle rc:l,111on 4uc je crois fondamentale. Parce que, e1Tcc11vcmcn1. le: prc·
mier objet d'amour du petit nourrisson-fille est la mère, quelqu'un du même sexe. C'est-à-dire quelqu'un qu'à la fois on adore, mais qui, en même temps, lorsque l'enfant va arriver vers trois ans au stade oedipien, et que la petite fille va s'attacher à son père - qui est l'autre sexe - la petite fille se trouve, là, à un carrefour très compliqué. Elle commence à avoir des sentiments complexes, qu'on appelle ambivalents, vis à vis de la mère. Elle continue à en avoir énormément besoin, elle l'aime toujours, mais en même temps, cette mère est la compagne de ce premier homme qu'elle rencontre sur son chemin et qui est son père. Et qui l'aime, et qu'elle aime. Donc, la mère peut être considérée comme une rivale.
Tout cela est très schématique, et ne doit pas être pris trop à la lettre. C'est simplement un guide pour aider à comprendre la complexité de l'âme humaine et pour nous initier à l'ambivalence des sentiments humains. Ambivalence que l'être humain doit - dans toute la mesure du possible - comprendre d'abord, et, en la comprenant, la dominer partiellement. Totalement je ne crois pas. Mais partiellement tout au moins.
Le silence génital Quand on a quitté ce stade génital oedipien, on
arrive au stade dit «de silence génital» où l'enfant entre à l'école. De six à douze ans, il apprend la vie en société. li se développe énormément sur le plan statural. Vous savez combien les enfants grandissent entre six et douze ans. Leur système endocrinien se prépare à la puberté, lentement; rien n'apparaît, mais en profondeur il se fait un travail intense. En tout cas, sur le plan du langage, sur le plan de la socialisation, il se passe énormément de choses et la vie de l'enfant est intense.
li se pose des problèmes sexuels, mais pas d'une façon profonde. li s'en pose avec les petits copains, avec les petites filles à l'école. Je crois que, dans cette phase, l'essentiel est de ne pas culpabiliser l'enfant à propos des jeux sexuels qui peuvent être surpris par les parents ou par les enseignants. Mais l'intensité sexuelle n'est pas très violente. La «pulsion» sexuelle n'est pas très forte. Et si l'adulte ne fait pas d'irruption intempestive dans ce qui se déroule, l'enfant va être concentré essentiellement - même s'il se mas-
66
turbe de temps à autre - sur ses copains, sur l'école, sur le maître d'école ou la maîtresse d'école, sur l'extérieur de la maison. Je crois que là, c'est vraiment une tâche importante pour les maîtres, pour les enseignants, que d'aider l'enfant à se situer en dehors du triangle oedipien, en dehors de la famille.
Mais cette phase tranquille doit bientôt se terminer et nous arrivons à la pré-puberté, puis à la purberté. À la pré-puberté, la pulsion sexuelle réapparaît. Et, cette fois-ci, elle est génitale, elle est sexuelle, elle est localisée dans le sexe. Ce qui ne veut pas dire que l'enfant ne soit pas toujours affectueux et qu'il n'ait pas besoin de tendresse, mais la «pulsion» sexuelle réapparaît.
À la pré-puberté, la situation n'est pas encore critique: première poussée sexuelle, première réaction de l'entourage, mais tout de même, l'enfant reste fortement attaché à l'école et à ses parents.
Puberté Par contre, lorsque l'on entre dans ce qu'on ap
pelle la puberté, qui est définie sur le plan somatique, sur le plan endocrinien, par la mise en fonction du système ovaires et testicules et des relations entre l'ovaire et l'hypophyse et entre les testicules et l'hypophyse, quand se déclenche tout l'axe hypophyse-système génital, alors, parallèlement à ce développement neuro-endocrinien, apparaissent des pulsions sexuelles extrêmement fortes, les plus fortes de toute la vie. On n'est jamais si ardent sexuellement que dans cette période de l'adolescence. Et c'est pourtant cette période où nous, adultes, - pour des tas de raisons dont nous allons parler aujourd'hui - nous ne pensons pas que l'adolescent puisse et doive donner libre cours à sa pulsion sexuelle. Nous ne le pensons pas parce que nous avons une espèce de conscience que l'adolescent n'est pas prêt complètement à vivre ses pulsions sexuelles.
En effet, il a des pulsions sexuelles très fortes dans le «ça», mais il n'a pas encore un «moi» très développé. Le «moi», qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence, c'est la perception, c'est la créativité, c'est le raisonnement. li n'a pas encore un «sur-moi» très développé. Le «sur-moi», c'est l'ensemble des valeurs morales, l'ensemble des idéaux qui viennent s'ajouter à la personnalité et l'orienter vers des buts qui sont différents de la
Beaucoup plus tôt que /'enfant européen, /'enfant africain a des responsabilités familiales
pulsion sexuelle, différents de la réalisation du «moi» et qui sont« au service», si l'on peut dire, des autres.
Le conflit de l'adolescence
Donc, pour l'adolescent, les pulsions sexuelles sont très fortes, mais le « moi» n'est pas encore bien structuré, bien fort, et quant au «sur-moi», vous voyez qu'il est partiellement conscient et partiellement inconscient. Ce « sur-moi » n'a pas encore défini, d'une façon ... définitive, ferme, ce qu'il veut faire de son existence.
L'adolescence est une période extraordinaire. On a tendance à l'oublier. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, les adultes ont si facilement tendance à oublier leur adolescence. Peut-être à cause de l'intensité de la pulsion sexuelle, qui gêne l'adulte. C'est fort possible; en tout cas beaucoup d'adultes, quand ils parlent avec leurs adolescents, oublient ce qu'ils ont été eux-mêmes à cet âge-la. L'adolescent a une pulsion sexuelle formidable, où le conflit oedipien est réactivé, où le garçon a de nouveau une poussée d'amour vers sa mère, et la fille vers son père, et en même temps il doit refouler cette pulsion, parce que c'est le tabou de l'inceste, parce que l'enfant sait qu'il ne peut pas coucher avec sa mère - ou avec le père - il sait que c'est interdit. Mais c'est tout de même vers les parents que se produisent les premières pulsions sexuelles, parce que les premières sensations de l'enfant ont lieu vers les parents. Alors, il ne peut pas, donc il refoule, il refoule dans le «ça» toutes les pulsions sexuelles à l'égard des parents.
C'est une époque extraordinaire, parce qu'en même temps, alors qu'il refoule, il cherche autre chose; il cherche à se dévouer. C'est l'époque où les adolescents s'enthousiasment pour des grandes causes, pour des passions artistiques ou politiques et, effectivement, s'ils peuvent trouver une canalisation à leurs pulsions, à leur libido, à leur énergie instinctuelle vers une grande idée généreuse, cela les aide. Cela les aide, à condition que ce «sur-moi» ne soit pas trop lourd pour le «moi». Parce que, si le« moi» n'est pas fort, il y aura un déséquilibre et les idées généreuses vont être un peu comme du vent, ou comme un château de cartes, ne s'appuyant pas sur une personnalité, sur un «moi» fort.
68
Le père : un ami Le rôle du père peut, de nouveau, être très im
portant. Puisqu'il y a réactivation du conflit oedipien, puisqu'il y a réactivation de l'amour pour la mère - qui est refoulé - c'est là que peut, que doit intervenir le père. Il doit être l'ami et celui qui introduit l'enfant à la vie professionnelle, à la vie sociale. Le père parle de son travail, devrait décrire les joies du travail, et cela initie l'enfant à la vie extérieure. L'enfant sait qu'il peut s'appuyer sur son père, s'identifier à lui et refouler, sans trop de danger, la pulsion sexuelle vers la mère.
À ce moment-là, le rôle de l'entourage, aussi, est important parce que l'adolescent n'est pas uniquement en contact avec le père et la mère, il est en contact avec des jeunes de son âge. Et là, la pulsion sexuelle va pouvoir s'exprimer. Il n'y a pas de tabou aussi fort qu'envers les parents, il y a un désir qui va vers les jeunes de son âge et ce désir, celui-là, il sent qu'il est permis. Plusieurs occasions et plusieurs solutions se présentent: ou bien le jeune a la permission, par la société, d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un àu sexe opposé, alors il a des relations hétérosexuelles plus ou moins mûres, et plus ou moins réussies. Ou bien il n'a pas cette possibilité, parce qu'il y a des interdits: l'enfant se retire alors un peu en lui-même, et il a tendance à fréquenter des gens du même sexe. Car le sexe opposé effraye avant d'attirer, le sexe opposé est différent, tandis que le même sexe, c'est plus simple.
C'est ce qu'on appelle la phase d'homosexualité normale de l'adolescence. Phase d'homosexualité qui est une étape que l'enfant devra - ou devrait - franchir, en mûrissant, pour accéder à des relations hétérosexuelles ultérieures. C'est une phase, aussi, de narcissisme, c'est-à-dire d'amour de soi. Si l'enfant ne peut pas aimer qulqu'un du sexe opposé, ou s'il ne peut pas aimer quelqu'un du même sexe, il s'aime soi-même, il a tendance à se renfermer, à se contempler devant un miroir comme Narcisse. Les filles passent des heures à leur toilette et les garçons - quoi qu'en en dise - eux aussi. Ou alors, tout le contraire: ils deviennent débraillés pour réagir contre ce narcissisme, parce qu'ils veulent braver l'opinion.
Que choisit la société? Qu'est-ce que nous, adultes, nous devons faire
à celle épo4ue·lâ '! Il > a deuA solulwns. Ou bien la ~1X1étë interdit b rdalion) hétéro·
,c,uellc3 du jeun..: adolescent en pleine pul~wn. m: l'ouhhc1 pai.. en pleine hh1do, pub1on qui ne 'cra plu~ J:11na1~ ausM forte 4u'a celh: êpo4uc de la \Îc. li faut alorl> un éituto1re à celte hh1do, ~oit Ju c:ôté de'> rcl:111ons homOl>exuell~. Miii du côtê de' rclalloni. avec le corps lu1-mêm.:. c'est·â-<.hre narcii.~11.1uc'>. égoï~tc~. louroècl> \Ch lïnléneur. l>Oll du côté du "sur-mo111, ~·e:.t-à-1.hre 1'1:x.illa· l1t1n de .. 1dëuuit. des gruuflC~ de pionnier~. des @.roupcs dc scoul!>, de~ bantJe, t.l'adolcscenh, des coparn~ avec lc!>4uel~ on cht11~11 de:. huts dilhc1les â .111e1mJre ou de~ huh de prnvocat1on. MJt\ s'il n') a pal> de rclat1oni. hctt!ro~exuellelo, il fout h1en t.lirc 4ue celle lihido. elle exbtc. die cM qucl4ue pJrt. l:.llc peul ausM être complètement refoulée tians l°IOCOO~Clent. Cl 4,j:J, ça ne SC J'l:ISSe pa~ luU· J••uri. lri:!. bien Parce 4ue i.1 Ioule la pubion i.e· \Udk c\I refoulée tians l'im:t1nsc1e111, alorl> on .1hou111 à ce don1 Je vou~ parlai~ tout à l'heure· ci 1.1 fng1d11é ou a 1'1mpu1!\sance.
Ou alor~. la sociëté choisit de hm:.er faire l'ad11k:.1:cnt. c·e~t·à·d1re lui permettre: d'a\•tm des n:lauon~ hétëro~cxuellc~. Dan~ cc cas, la ,oc1é1è prend au~:.• de~ rc:spon~abilitël> pui~~uc, si toutes i.:~ pub11>n' ~'udlc:. 4u1 sont dan:. le "ça" \Onl 'c canaliser ver:. de' relai ion:. hétéro~e>.udh:s
J\'Unt 4ue le "mrn" et le "sur-moi" ~oient comph:lcmcnt fonnë!>. là au:.M, nou:. prcnun' une respon'>ah1h1é. en dehor' 1k toute mur.tic et en se pla.,:anl \llnplemcnt d,in, la pcr:.ped1\ e du dévt:luppcment han110111eu\ de lïnt.11\ 1du l>e toutes manière,, nou' prcnonl> t.lci. respon!>ahilité!t.
f"~oÏ\me. lmpui\\llncc. rri~idih' <.. e 4uc j'J1 pu eon,1a11.:r. c'est que 1'1otenen-
1111n uu lu culpab11t1é de:. parent~. l'intcnentiun mul.tdroite ou trop précoce de:. parents dan., la 'cxu:1litê de l'cnfanl, la po:.:.c\SI\ 11é trop grande de\ purcnh :.ur le corpl> et l.t psychê de renfant. le' intcnht' trop forh et trop nuntbreu\. ou ;ihm. une mauvaise 1dcnt1hcat1on de' enfant:. aux 1ma· ~es parentale~. c'c:.t-à-d1re le lai! 4uc l'enfant \·ive pre' d'un couple dê~uni. d'un cou ph: 4u1 ne vit pa' h1en \a relai 1110 alfc:cti\c cl :.c\ucllc, tlJU 1 .:da aboutit au fall 4uc raduhe - cet enfant de\'enu adulte - va être m:1I prèparè il la rclJllon hètëro:.e\ucllc. 4uïl la \"1vra mal. sutt en étant ê~oÏ:.lc, :.011 en ëtanl 1mpuiv.ant, soit, pour la
, • l.u mért 1t11t Îlll' /1•
Cl.' doflf l't'llfUlll Il f1t0 \0/ll •
femme, en èlant frigide . J'ai uctuellement dan~ mon tra\ail en i.:hentèlc:
privée. commcni.:c à dC:pou1fler (c, tlos:.icrs t.lc~
patiente~ 4u1 ~ont ~enuc' me: voir pour lngid1té tlc:pu1:. 4uin1c ans. J\11 s1x-1:c:nts t.lossiet\, mais JC n'en Jt dépouillé 4ue lro1s cent 1:1n4uante. avec l'.11Jc d'une p:.}chol~iguc 4ui ,..·intércs~c :1 i:es pw· blè111cs. Cela m'a JlCrmb de voir 4ue sur les JSO prc:nuer~ t.lu~sier:. dêpou1IJé, de femmes frigides. ck lemmes 1• enue~ pour fn1!1d11é l.Jc d1i. "1·enuc: ... pour frigidité» pari:e 4uc ces femme~ ne \Ont pas rédlcmcnt tr1g1dc~. clic' ont un trouble actuel. mais pus une tare délintll\e) 80',i ne :.c :-ont jamais flla:.turbécs d.in~ l"c:nfjlll.:e, ne gardent :JU·
1:un ... ouvcnir. ni dans l'enhtncc, nt dani. l':idul.::...:cnce. du plu1Mr de la masturbai wn l:.t 70''1 sont nëc' Jjn~ de., lam1lh:s dc:.untcs
un point de vue musulman sur l'éducation sexuelle Elbekaye Kounta, Bamako
Je ne saurais mieux commencer mon exposé que par ce passage du Glorieux Coran, où l'Éternel dit à son Envoyé: «Appelle les hommes dans le sentier de ton Seigneur par la sagesse et par des admonitions douces; si tu entres en dispute avec eux, fais-le de la manière la plus honnête, car, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui dévient de son sentier et ceux qui suivent le droit chemin.»
M'inspirant de ce verset, mon exposé repassera donc sur les versets coraniques, la Tradition du Prophète, la jurisprudence musulmane, les moeurs et coutumes négro-Africaines. J'aurai également recours parfois aux témoignages de non-musulmans. De ce fait, cet exposé sera exempt de passion et de partialité.
Avant de parler d'une philosophie de l'Islam sur l'éducation sexuelle et pour vous permettre de mieux saisir cet exposé, j'attire votre attention sur deux signes caractéristiques de l' 1 slam qui ont fait son génie à l'époque où les musulmans cherchaient à connaître le vrai visage de leur religion, et qui font, hélas, aujourd'hui son malheur à cause de l'ignorance de ses adeptes:
• Le fait d'avoir reconnu les instincts humains, mais en les assujettissant à des lois rééducatives. Mohammed son fondateur est comme tous les communs mortels: il mange, dort, se marie, connaît la joie, le bonheur et les difficultés du mariage, fait des enfants et connaît la tendresse paternelle et l'amour filial.
• La souplesse et la facilité d'adaptation dont il fait preuve à l'égard des moeurs et de la mentalité de ses adeptes.
Ceci dit, voyons maintenant ce que pense l'Islam de l'éducation sexuelle, et comment ce phénomène est traité par l'Islam. On peut dire, d'ores et déjà et sans ambiguïté, que l'Islam préconise l'éducation sexuelle et exhorte même à la répandre. Mais comment? C'est là le point
70
d'interrogation, auquel il faut essayer de répondre.
Indulgence et souplesse L'Islam, pour traiter ce genre de question qui
n'est pas à la base de ses fondements, a une philosophie qui fait preuve d'indulgence et de souplesse afin d'atteindre son objectif sans provoquer de troubles chez ses adeptes. Mais quant aux fondements essentiels, tels que !'Unicité de Dieu, le refus de l'idolâtrie, l'islam les affronte directement et franchement pour couper court à toute équivoque dès le début.
Les philosophies de l'Islam ont été unanimes à affirmer que l'éducation morale était l'essence même de l'éducation islamique et que l'éducation avait pour but la perfection morale, condition sine qua non de l'édification de sociétés saines et vertueuses. L'éducation sexuelle, sans sortir de ce cadre général, a eu le privilège d'être mieux traitée, pour des raisons d'ordre religieux, hygiénique, et social, par le Coran, les Hadiths et la Jurisprudence musulmane.
Par le Coran Les problèmes sexuels traités - bien que de
façon peu approfondie - par le Coran sont à peu près les suivants:
La procréation, (de quoi l'homme est créé et comment.) L'Éternel dit: «C'est lui qui vous a créés de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un grumeau de sang coagulé, il vous fait naître enfants. >>
La virginité: L'Éternel dit à propos de la Sainte Marie; «Et Marie fille d'lnran, qui conserva sa virginité, nous lui insufflâmes une partie de notre esprit. Elle crut aux paroles du Seigneur, à ses livres; et elle était du nombre de personnes pieuses.>>
Jeune garçon à récole coranique
E'cole rnro11iqu<! à Lugos. Nigérict
Le Coran fait mention également des rapports sexuels, éjaculation Cl sperme: de l'ablution et du bain après les rapports sexuels: de la puhertê cl du mariage; de l'interdiction de relations sexuelles en période de menstrues ou après l'accouchement et avant l'arrêt du sang: de la stérilité. durée de grossesse. allaitement et sevrage; de la polygamie, de l'adultère. l'homosexualité. cl du divorce. Dan~ tout ce que je viens d'énumérer, le Coran se borne le plus souvent à des in formations générales. disons même élémenl<tircs. Cependant nous pouvons en déduire l'idée suivante: la démystification de la sexualité, c'est-à-dire que le
72
sexe ne doit plus être considéré comme tabou, comme quelque chose dont on a honte de parler étant donnt\ que le Coran. malgré son caractère sacré. en fait menlion.
Traditions du prophl>tc Après le glorieux Coran, les textes islamiques
les plus importants sont les 1raditions relatives au prophète Mohammed (Hadiths). transmettant ses dires, ses gestes. voire son auitude silencieuse, sur les sujets les plus divers. Cesl dans cette parlie que nous trouvernns Je détail de tout ce qui a cté sommairement brossé par le Coran. En plus.
nous y trouverons quelques renseignements sur la circoncision et les moyens de régulation des naissances.
Le Professeur O. Hodas, de !'École des Langues Orientales vivantes de Paris, dit dans son ouvrage sur, « L'islamisme» (page 107 ,) que: «Malgré la discrétion accoutumée dont font preuve les musulmans, pour tout ce qui touche à leur gynécée, les femmes du Prophète ont subi, elles aussi, une constante interview dont les résultats sont insérés tout au long dans les Hadis. Nous connaissons dans tous leurs détails leur conduite vis-à-vis de !'Envoyé de Dieu, nous savons comment elles faisaient leur toilette en toute circonstance, et il n'est pas une seule bonne musulmane qui ne cherche à observer scrupuleusement les usages et la conduite de ces épouses modèles qui figurent en bonne place parmi les traditionnalistes de la première heure. »
Je dois vous dire en passant qu'actuellement, même si toutes nos soeurs musulmanes ne cherchent pas à observer scrupuleusement les usages et la conduite des épouses du Prophète, néanmoins, certaines d'entre elles observent encore quelques préceptes islamiques dans les relations matrimoniales, tels l'ablution après la satisfaction des besoins naturels, a près les rapports sexuels, l'abstention de toute relation sexuelle pendant le cycle menstruel de la femme, etc ...
Si les musulmans du sexe féminin doivent imiter les épouses du Prophète, l'idéal de tout m usulman du sexe masculin est de modeler sa conduite sur celle du Prophète Mohammed dont les traditions nous font connaître comment il accomplissait les actes les plus· intimes de son existence terrestre, en entrant dans des détails qui nous paraissent souvent superflus. Mohammed dit: «Mon message organise les affaires religieuses et terrestres, les affaires spirituelles et corporelles, les affaires individuelles et communautaires.» Voyons donc, comment le message de Mohammed a organisé le problème sexuel des êtres humains qui, à mon avis, a un caractère à la fois religieux, terrestre, corporel, individuel et communautaire.
Reconnaissance des instincts Premièrement, l'Islam a reconnu tous les ins
tincts humains parmi lesquels se trouve en premier lieu celui de la satisfaction des besoins
sexuels. Il a ensuite élaboré des méthodes pour domestiquer cet instinct, qui se subdivisent en trois catégories:
Méthode basée sur la satisfaction du besoin sexuel en contractant le mariage entre un homme et une à quatre femmes au maximum pour répondre à la nécessité biologique et sexuelle. Sur ce point, un esprit impartial ne trouvera aucun reproche solidement fondé contre l'Islam. Faisons remarquer que la polygamie n'est pas une institution islamique, elle était connue et pratiquée bien avant l'apparition de l'Islam: les Juifs prati~ quaient cette institution sous Moïse, sans restriction aucune. La Bible est fort claire à ce sujet. Abraham, Jacob, David et Salamon étaient tous polygames. La polygamie n'était pas explicitement interdite aux premiers temps du Christianisme, car la mission du Messie était non d'abolir la loi Mosaïque mais de la parfaire. (Évangile selon St. Mathieu).
Le Pasteur camerounais Bahokan dit:« On n'a pas le droit de condamner la polygamie, que même le Christ n'a pas condamné chez Abraham.» Chez nous ici, avant et beaucoup après la pénétration islamique, on contractait la polygamie, non limitée à quatre, mais pouvant s'étendre à des dizaines de femmes. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on la pratique illicitement, et c'est ce qu'on appelle débauche.
Méthode spirituelle Elle englobe l'éducation morale et ClVlque
basée généralement sur la vertu. Les premières notions d'une vraie éducation sexuelle sont insérées dans cette méthode d'une manière pédagogique unique dans son genre. Quelques exemples:
L'enfant: fille ou garçon est sensibilisé par l'intérêt qu'on porte à son sexe depuis ses premiers mois. Après chaque eviction d'urine on verse un peau d'eau sur son sexe. À l'âge de sept ans, on l'invite à faire la prière. Il apprend comment on se nettoie, comment on fait l'ablution pour prier.
À l'âge de dix ans, on l'oblige à prier, on lui indique les signes de puberté qui sont presque tous relatifs aux organes génitaux: l'apparition des poils pubiens, le cycle menstruel, l'éjaculation nocturne. À cet âge également, l'enfant doit savoir les raisons qui obligent le musulman à faire
73
ou refaire une ablution ou un bain généralement appelé grande ablution. On lui cite parmi ces raisons: les rapports sexuels complets ou incomplets.
Et à partir de dix ans, l'enfant peut approfondir ses connaissances, surtout quand on lui enseigne le code du mariage; il doit savoir pourquoi on se marie, comment choisir librement son conjoint, les avantages du mariage, ses difficultés, pourquoi avoir des enfants, grossesse, accouchement, allaitement, sevrage et durée normale entre les naissances etc. Cet enseignement est donné pour les enfants d'un à dix ans, la plupart du temps et dans la plupart des pays musulmans, par les parents, les grand-parents, ou par uri autre membre de la famille.
Au delà de dix ans l'enseignement revient généralement à des éducateurs particuliers qui se chargent de l'éducation de l'enfant soit dans sa maison soit chez les parents. Le père autrefois collaborait avec l'éducateur au choix des matières qui seront enseignées à son enfant.
En cette période, quelques conseils pratiques sont donnés aux enfants. C'est ainsi que l'Islam conseille au fiancé de voir le visage, les mains et les pieds de sa future femme, d'entendre sa voix et d'apprécier sa conversation. L'Islam ordonne, en outre, aux hommes d'avoir beaucoup d'égards envers leurs femmes et d'être doux et cléments avec elles; il dit:
«Soyez convenable avec elles, malgré l'antipathie qu'elles peuvent vous inspirer, elles peuvent être pour vous une source de bonheur.» Le meilleur gain de l'homme après la crainte de Dieu, dit-il, est d'avoir une épouse pieuse et obéissante, qui répand la gaieté dans la maison et protège, durant l'absence de son mari, son honneur et ses biens. De même, le Prophète recommande à la femme d'être tendre avec son époux: «Connais ton rôle envers ton mari, car il dépend de toi de faire de lui ton paradis ou ton enfer.»
L'Islam connaissant bien la nature des êtres humains ne s'est pas contenté des deux premières méthodes que nous venons de voir. Il a instauré les moyens de châtiment corporels pour la protection de ses institutions spirituelles et morales: cents coups de fouet au célibataire, femme ou homme, pris en flagrant délit d'adultère. Les hommes et les femmes mariés seront passibles de lapidation jusqu'à ce que mort s'ensuive.
74
Il faut souligner que les succès de l'Islam en Afrique sont dus en grande partie au respect qu'il porte à notre civilisation négro-africaine qui, depuis longtemps et avant la pénétration Islamique, chrétienne ou européenne, a montré son efficacité dans la protection de nos moeurs par une éducation sexuelle non moins importante que celle de l'Islam. Comme champ d'études, j'ai pris un groupe d'habitants d'une partie de la région de Bamako. En dépit de la présence de différentes ethnies, les éléments composant ce groupe prétendent qu'ils sont de la même origine. Ils sont communément appelés habitants de Dougou, Kerawané, Kiban, Kolobo, Dioni et Boidougou. Les habitants de quatre premières localités ont embrassé l'Islam depuis bien longtemps tandis que ceux des autres n'ont été convertis que vers les années 1950.
Bien que musulmans depuis fort longtemps, les habitants de quatre premiers ont conservé la majeure partie des moeurs sexuelles de leurs ancêtres animistes. À titre d'exemple nous pouvons fournir les indications suivantes:
Toutes les jeunes filles de cette région portaient le « limpé » composé de deux bandes de coton destinées à cacher leur nudité. Les jeunes, garçons et filles du même âge, se rencontraient chez une vieille femme du village pour organiser des veillées. Chaque garçon liait amitié avec une jeune fille. De ce fait, il était tenu de défendre l'honneur et la vertu de son amie. La circoncision conférait au garçon le droit d'être intégré dans la société des adultes. Quant à la jeune fille, elle est admise dans la société des femmes à partir du moment où elle échange son « limpé » contre le pagne, c'est-à-dire le jour de son mariage. Le « limpé » est symboliquement coupé. Elle devient « finitigui » - porteuse ou femme mariée.
Les musulmans de cette région sont conscients de la contradiction apparente qu'il y a entre les préceptes de l'Islam et des coutumes que je viens d'évoquer sommairement. Mais compte tenu de leur valeur morale et éducative ils ont estimé devoir de les conserver. En guise de conclusion je dirai simplement que toute philosophie d'éducation sexuelle qui ne se fonde pas sur le perfectionnement moral de l'homme est vouée à l'échec, de même que toute civilisation qui ne se fonde pas sur la notion du bien et de la vertu est trompeuse et fictive. Elle n'est que mirage.
un point de vue catholique sur l'éducation sexuelle Révérend Père Joseph Roger de Benoit, Aumônier des jeunes, Bobo-Dioulasso, Haute Volta
li s'agit bien en effet d'un point de vue catholique. Car cet exposé a deux limites importantes: La première, c'est qu'il aurait dû être fait normalement par un Africain. Des empêchements de dernière heure n'ont pas permis à la personne pressentie de venir à Bamako. La seconde, c'est que le point de vue que j'exprimerai n'est pas forcément partagé par tous les catholiques. li y a toujours eu, dans l'Église catholique, un double courant, et c'est ce qui explique les doléances que nous avons pu entendre au sujet de tabous sexuels introduits en Afrique par certains missionnaires. li n'est donc pas inutile de préciser cette double tendance.
Courant pessimiste et antiféministe Ce courant a sa source dans le péché du pre
mier couple, tel que le rapporte le récit imagé de la Bible. Dans un premier temps, l'homme accueille avec satisfaction la « compagne » que lui donne Dieu, l'aide «qui lui est assortie». «C'est l'os de mes os, la chair de ma chair». Après la faute, le changement d'attitude de l'homme est total. li se désolidarise de la femme, oubliant la joie avec laquelle il l'avait reçue et se déchargeant sur elle de la responsabilité du péché : «C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé ... »
À travers toute la Bible, il serait possible de faire un florilège des textes qui présentent la femme comme un danger permanent pour l'homme et la source de tous ses malheurs. Ce pessimisme antiféministe se retrouve même chez Saint Paul qui conseille à la femme d'être soumise à son mari, d'avoir la tête couverte dans les assemblées et de se garder d'y prendre publiquement la parole ... Cependant il faut noter que si !'Apôtre n'encourage pas au mariage, c'est dans la perspective, familière aux premiers Chrétiens,
d'un retour tout proche du Christ, donc de la fin de ce monde.
Ce courant se retrouve dans toute l'histoire de l'Église. Et pendant mille ans après St Augustin, on trouve des auteurs pour soutenir que les rapports sexuels sont permis, tolérés pourrait-on dire, à cause de la reproduction, mais ne sont pas bons en eux-mêmes. Et pour certains catholiques influencés par un jansénisme et un pessimisme toujours renaîssants, l'exercice de la sexualité ne se justifie que par la fin procréatrice, le plaisir mutuel que les époux y trouvent n'étant toléré que comme «un remède à la concupiscence» ...
Dans un tel contexte, il est évident qu'il ne peut être question d'éducation sexuelle. Les époux en connaîtront toujours assez sur ce qu'on appelle «les parties honteuses» pour s'en servir pour faire des enfants ... (Comme s'il n'était pas presque blasphématoire de qualifier de «honteux» les organes créés par Dieu pour que les hommes s'associent à sa tâche magnifique du don de la vie). La seule « éducation » consistera à mettre en garde contre les dangers multiples de la sexualité, contre les maladies vénériennes en particulier, et à énoncer un certain nombre de règles morales, qui se présentent souvent comme des interdictions gratuites que rien ne vient justifier.
Courant optimiste et féministe Ce pessimisme antiféministe a sans cesse été
combattu par une conception plus saine du couple et de la sexualité. À travers toute la Bible, Dieu choisit d'exprimer l'amour qu'il a pour les hommes à travers l'image de l'amour conjugal. La permanence de cette comparaison depuis le livre de la Genèse («À son image, Dieu les créa, homme et femme il les créa ... »)jusqu'au livre de l' Apocalypse où le Christ célèbre ses noces éternelles avec l'Église, aboutit à la conviction
75
( t!ré111onie de munugt• ,.,, Rèp11bliq1w Rw(wdut\<'
que l'amour conjugal c~t 1'1111ugc même de l'a· rnuur ue Dieu.
l::t il oc s'..1g11 j'lil!t d'un amour uoi4ucmco1 i.p1rituc:L Le magoili4uc chant <l'amour qu·e~t le Cantique des (aotiquell cuollenl <les <lei.criptions 4u'uoe époque plu~ puntuinc que la nôtre trnu\'JÎenl fort êrotiqucs l:.t cc: o'ei.t pa:. la moindre llurpnsc de certain~ Jeune:~ Chrétiens que de découvrir. toujours dan\ la Bible. une anthologie de te11tes â la gloire cl à lu louange de la femme qui ne leur laisse uucunc chance d'établir sur I' Él:ri turc Sa inlc leu ri. prêtent ioni. à une supériorité lJUt:lconquc i.ur le~ jeunes lilles. Au c-ontrairc, la Bible contient des exemples magoili· qucs lie courage, de lidélité, de dcvoucmcn1 d1Jnnés par des femme:..
IJanl> !c Nou\·cao reMamcnt, le rôle jouê par la femme est souvent be:1uwu p plu~ brillant que cc· lui tenu rar lc.'.5 hommell . l:.t la créature la plus ~énéréc par r Eglise c;1lhol11~ue c~t h1cn J\l:mc Enlln la liberté dont Jé:.u~ f;.11t rrcuvc <lans Sl!S re· !allons <1vec les femme~ ne <lcvran la1sl>er au1.~un
7h
espoir auit anlifém1nis1es. EL s1 dan:. l'histoire de I' f:ghsc, on trouve des te111es pessimistes lJUant au mariugc cl à la scx ualité, il se trouve 1ou1 aulunl d';1utcurs pour les réfuter. Je n'en d1crai que deux.
Corn1111:nlan1 le texte de SI l>aul " Pour cc qui c'>I de:. rn:rge:. JC n·ai pa:. d'ordres du Seigneur " Il Cor. 7, 25). un célèbre auh'!ur du 5ème Mè:cle 1Amhro:-1as1cr) déclare : «Il du n'avoir p;is rc41u d' ordrc uu Seigneur pan;..: lJUe le créateur du ma· riagc ne pouvait lui imposer aucun ordre: oppu~ au mariugc :.am. critiquer sa propre action au11 1lr igi ncs. n
Un sièdc plus tard. le Papc SI Grégoire le (jran<l cxrhquitit amsi le pas!.age du P:.aumc: "V~i~ct,Je !.Ull> né <lans la foule. et <liin~ h: pé1:hc. ma mère m'a c-onçu »: "Il ni: faut pa~ l'entendre 1.·umme M le:. hommes ëta1en1 conlius tian:. le péché rarcc que le.~ relation:. entre èpou:\ :.craicnt coupables. Cette chasle acl1\'ité n'imrhquc nulle l:11.1te rour celui qui est rmirié C'el>t Dieu "lui a prevu les rapport!. conjugaux, lorsqu'il a c-réé
l'homme et la femme au commencement.» Le terrain était donc prêt pour un renouveau
de la spiritualité du mariage et une redécouverte des valeurs de la sexualité, tels qu'ils se sont produits depuis le début de ce siècle. Une fois remise en lumière la grandeur et la richesse, même spirituelle, du mariage et de l'union conjugale, la nécessité d'une éducation sexuelle se faisait sentir pour ne pas s'engager à la légère sur une voie qui peut conduire à l'épanouissement mutuel et au dépassement des époux, mais qui peut aussi, faute de lumière, s'engager dans des impasses.
Quelques textes officiels Sans vous accabler de déclarations officielles, il
n'est pas inutile de montrer que cette position optimiste et cette nécessité de l'éducation sexuelle sont reconnues par les plus hautes autorités de l'Église, de façon de plus en plus nette.
Dans sa lettre encyclique sur le mariage, Pie XI affirme que la grandeur du mariage ne vient pas seulement du caractère religieux que lui donne la bénédiction de l'f:glise: «Il y a quelque chose de sacré et de religieux même dans le mariage naturel.» Le Pape Pie XI 1 affirme la légitimité du plaisir sexuel:« La volupté qui vient légitimement du mariage n'est pas condamnable en soi». (Sacra Virginitas).
Plus explicitement encore, tous les Évêques réunis en Concile Général à Rome entre 1963 et 1965, ont demandé, dans leur document sur l'éducation chrétienne, que «les jeunes bénéficient d'une éducation sexuelle à la fois positive et prudente au fur et à mesure qu'ils grandissent» (N° 1). Enfin, commentant l'encyclique de Paul VI sur le mariage, les Évêques français déclaraient en 1968: «L'éducation des jeunes à l'amour est d'une importance capitale. Elle commence de bonne heure, elle est l'affaire de tous: parents, prêtres, éducateurs, médecins, mouvements de jeunesse, etc.» (Note pastorale, Lourdes 8 novembre 1968).
Une véritable éducation sexuelle Comme le montre l'expression «éducation des
jeunes à l'amour», il ne s'agit pas de faire une simple information sur l'anatomie et la physiologie des organes génitaux et de la reproduction, qui serait donnée à un moment bien déterminé, prévu par un programme scolaire. C'est toute une
éducation qui doit commencer très tôt et accompagner toute la croissance de l'enfant et du jeune. Il s'agit, selon Pie XI 1, de «former une génération depuis ses premières années (pour la réussite du mariage)». Et la Commission Episcopale française de la famille, dans une Note intitulée «Qu'est-ce qu'aimer?» (24 septembre 1970) a précisé:
«Les adolescents ont le droit d'être informés des réalités de la vie et notamment de recevoir une franche information sexuelle. Il est important que cette information précède leur évolution physique et psychologique, afin qu'ils puissent assumer ce qu'ils éprouveront, en connaître la signification pour en maîtriser les manifestations. C'est la meilleure façon de dédramatiser la puberté.»
L'éducation sexuelle n'est donc qu'une partie de /'éducation en général et ne doit pas en être séparée. Le Pape Paul V 1 déclarait récemment:
«Sans barrage ni refoulement, il s'agit de favoriser une éducation qui aide l'enfant et l'adolescent à prendre progressivement conscience de la force des pulsions qui s'éveillent en eux, à les intégrer à la construction de leur personnalité, à en maîtriser les forces montantes pour réaliser une pleine maturité affective aussi bien que sexuelle, à se préparer par là au don de soi dans un amour qui lui donnera sa véritable dimension, de manière définitive et exclusive.»
Ne pas nier les pulsions, encore moins les refouler, mais ne pas les laisser s'exprimer sans frein : au contraire utiliser leur force pour la construction de la personnalité, c'est au fond rechercher à rendre toujours plus pleinement humains - c'est-à-dire éclairé par l'intelligence et orientés par l'amour - les rapports entre personnes, que ce soit au plan des relations interpersonnelles, des relations familiales ou des relations sociales.
Cela suppose la présence autour de l'enfant d'un climat affectif équilibré, fait d'amour et de joie, que l'enfant se sente accepté et aimé tel qu'il est, comme garçon ou comme fille, - qu'il trouve dès les premières années de son existence la possibilité d'un évolution saine de sa vie instinctive selon son sexe.
Maîtrise de soi Cette éducation comporte certes une informa-
77
11un dam: cl rn!dse 1.1u1 pourrait se résumer ainsi: - Rcpondrc IOUJOllr~ il. 111u1cs le~ 4ucs1ionl>. 'llOOn rcnfant ira chercher aillcuri. h:!o. informal111ns dont 11 a besoin; - rcrondrc tuu 1011rs a\ c.: 1 r.inchil.e, i.inon 11 pcrdt.i rnnhancc en ses parent~
lurs1.1u'il ,·apcrcc1•ra 411'1111 lui a menu: - ne pa~ dm: plus qu'il n'en demundc cl 1.1u'il n'est capable de comprendre. M;:m celle tnform:itmn ne scr.1 une cduca11on que s.1 clic 'i'accompagni: J'une in
forma11on Ju caractère cl de la pcr!>onnahtè · ·•On mettra principalement l'accen1. dan~ l'éducat11m sexuelle, comme d':ullcurs dans tuu1e éducat11:in. ~ur la m:.iitri~c de '"' el la form.1t1un religieuse." (Pte XII. 13 aH1l 19'.\l).
<..clic maitrne de Slll est cupitale. l lie el>t r .. u:· 11uil.it1on par le .1cunc de 'a pleine d11ncn~1un hu-
7X
mamc. Ccst rmtelligcm:c cl la vul1>nté 4u1 d111· vent cummandcr toutes ces n:lalions. a vcc lui· m.;rnc cl avec les autre~. Il lui faut pour cela ~e hhcrcr autant que fom: 'c peut d'une dépendance ré.,1gnéc ou \Olontairc a l'égard des dètermims· mes. 4u'11!. ~un:nt interne!> commc le~ pubilln'>. ou cxtcrnci., - ~·en libérer au muin!> .:n prenant ..:on~cience et si po~Mhle en les ut1h.,an1 rour la ..:un,trucllun de sa pcr.,onnalltè
Celle maitrise de ~01 ne peut cert.i1n.:ment pa~ être le !ru 11 li' une êdu..:atwn cx.du~Î\'Clllcnl mow-11,anh: 4u1 'crait rnclhc.1cc ou même Jangcn:u!>c i:n prm 0411,inl dei. rcluu lc.:mo:nb cl de~ 'cn11mcnh ~le culJMh1l11c 'uu 1 cn1 nun !ondés. C. elle mailri~c de ~oi ne peut '>C ha~cr que sur une viswn Je rtwrnmc dont l;,i vie momie n·c~I 11uc la cun~ê·
quence logique dans l'existence quotidienne.
L'amour, avec des prioritês Pour les catholiques, vous savez que cette vi
sion est la suivante: l'homme est crêê par Dieu â son image, c'est â dire avec des facultês de connaître et d'aimer qui lui permettent de participer de plus en plus pleinement â la vie divine et d'y trouver la satisfaction totale de ses aspirations vers Je Vrai, Je Beau, le Bien. Cette participation se fait par l'Amour de Dieu et l'Amour de tous les autres hommes sans exlusive, mais avec des prioritês. Et Dieu en partageant la vie des hommes, en Jêsus-Christ, leur a donnê les moyens de rêaliser cette vocation, malgrê tous les obstacles.
Dans cette vision, la vêritable êducation sexuelle sera une êducation â l'amour authentique. Cette êducation commence di:s les premiers moments de la vie en apprenant â l'enfant â ne pas voir tous ses caprices satisfaits et â faire certaines actions dans Je but de faire plaisir aux autres. Elle inspire Je respect des organes gênitaux, non pas de façon nêgative et traumatisante, mais parce qu'ils sont appelês â être les instruments de l'expression de l'amour et du don de la vie. Elle aide le jeune â franchir toutes les êtapes de sa formation â l'amour, notamment celle de la masturbation qui risque de Je conduire â un repli egoïste sur lui-même.
Et pour ne pas allonger cette communication, nous prendrons un dernier exemple: nous ne dirons pas aux jeunes: les relations sexuelles avant le mariage sont interdites par la morale, c'est un pêchê, il ne faut pas en avoir. Nous leur dirons, en bref: l'amour du prochain fait la grandeur de l'homme, l'amour conjugal en est une des formes les plus êlevêes. Les relations sexuelles avant Je mariage ne sont pas, surtout pour la femme, un point de dêpart satisfaisant pour une vie sexuelle êpanouie et risquent au contraire de laisser des sêquelles.
Elles ne sont pas toujours l'expression d'une vêritable amour, exclusif et dêfinitif. Elles sont souvent inspirêes par J'êgoïsme masculin, favorisêes par l'ignorance fêminine. Elles compromettent donc la rêalisation d'un amour authentique et risquent d'empêcher l'homme d'atteindre â
sa vraie dimension, â sa vraie grandeur. C'est pourquoi un homme et une femme soucieux de rêaliser pleinement leur amour ne doivent pas en avoir. Cela est conforme au plan de Dieu, qui nous a crêê pour Je bonheur, qui connaît mieux que nous Je chemin â suivre pour êviter les erreurs et arriver au but, qui, en un mot, a plus d'ambition et de respect pour nous que nous-mêmes.
L'esprit qui, selon nous, doit inspirer l'êducation sexuelle est cette vision globale de l'homme qui se rêalise pleinement dans l'amour et qui doit diriger toutes les forces qui sont en lui vers l'êpanouissement de cet amour pour son bonheur et celui des personnes qu'il aime.
En Afrique Il resterait â dire ce que pourrait être cette êdu
cation sexuelle en Afrique. Quant â sa nêcessitê, lors de la rencontre panafricaine-malgache des laïcs catholiques â Accra en août 1971, Je groupe francophone des carrefours sur la famille a adoptê la motion suivante:
« Donner une êducation judicieuse aux jeunes gens et aux jeunes filles portant sur les questions sexuelles, inculquer aux jeunes une vêritable notion du but du mariage afin d'en arriver â la notion du vêritable amour».
En ce qui concerne Je contenu de cette êducation, il revient aux Africains de la dêterminer en dêtail. Le mariage et la sexualitê sont des rêalitês profondément marquêes par la diversitê des cultures. L'approche de ces probli:mes, la forme de l'êducation devraient être inspirêes par les attitudes traditionnelles, au moins celles qui sont le plus profondêment ancrêes dans la mentalitê et dont l'ignorance risquerait de provoquer des rêactions nêgatives, plus ou moins conscientes.
Mais nous pensons qu'une vêritable êducation sexuelle suppose une vision globale de l'homme, une foi en sa dignitê et dans sa capacitê de se surpasser dans un vêritable amour, un respect profond de l'autre; et en particulier, si l'enfant trouve ce respect chez les êducateurs â son êgard, il sera plus facilement portê â respecter les autres, et notamment celui ou celle avec qui il s'efforcera de rêaliser un vêritable amour.
79
un point de vue protestant sur l'éducation sexuelle Jean Banyolak Conseiller familial Douala-Deido, Cameroun
Ce point de vue protestant sur l'éducation sexuelle n'a pas la prétention d'être celui de tous les protestants. Je ne les connais pas tous et tous ne peuvent pas être du même avis. Ce point de vue est protestant plutôt dans ce sens que j'ai reçu une formation de conseiller familial de plusieurs milieux protestants en Afrique et en Europe. Actuellement je suis chargé par la Fédération des Églises Protestantes de l'éducation sexuelle au Caméroun depuis 1969.
Le sexe publicitaire L'éducation sexuelle n'est qu'une partie de l'é
ducation générale. Puisque cette dernière est nécessaire à l'heure actuelle, l'éducation sexuelle. l'est aussi. Tous les pays développés que je connais donnent l'éducation sexuelle. Le niveau de développement actuel del' Afrique suffit pour que l'éducation sexuelle soit lancée partout. Si elle manque à sa propre place, à la maison parentale, à l'Église ou à l'école, les enfants la reçoivent inévitablement dans la rue et se font de la sexualité des images fausses. L'éducation sexuelle est nécessaire aussi car les milieux urbains tendent de plus en plus à une accentuation excessive de la sexualité. Le cinéma, les illustrés et la pornographie en témoignent. Pour attirer l'attention du public sur les affiches, on écrit parfois en très gros caractère le mot SEXE, puis on rédige l'annonce en dessous. Dans une grande ville africaine, j'ai lu une fois sur une affiche:« SEXE: ... les billets de la loterie sont en vente ici ! ». Plusieurs passants lisaient cette affiche. En présentant ce séminaire, le Service Quaker a eu raison d'écrire que la question n'est même plus de savoir si on va faire l'éducation sexuelle, mais comment on va la faire.
Pédagogie Commençons par la question: qui doit la fai-
80
re? Comme l'éducation sexuelle commence avant l'âge scolaire, elle concerne d'abord les parents. Ceux-ci ont la responsabilité d'élever et d'éduquer les enfants que Dieu leur confie. Si les deux parents sont vivants, l'éducation sexuelle ne sera pas donnée par le père ou la mère seuls, mais simultanément par les deux. En règle générale, le parent à qui l'enfant pose une question ne devra pas dire : « Va demander à ta mère » ou « Va demander à ton père».
Puisque l'éducation sexuelle fait partie intégrante de l'éducation générale, l'Église et l'école en sont aussi responsables. Le maître volontaire qui veut la donner aux élèves a besoin d'être soutenu par les autorités de son établissement. Une telle éducation peut être efficacement donnée par le professeur de sciences naturelles, d'instruction civique ou de français.
Pour qu'un éducateur ou enseignant puisse assurer une éducation sexuelle, il faut qu'il soit choisi, formé et contrôlé par un travail en équipe. Il faut une formation à la fois personnelle et théorique. L'équilibre de la personne est particulièrement important ainsi que sa maturité sexuelle, affective et spirituelle. Les exposés magistraux ne suffisent pas, il faut aussi une disponibilité et la capacité de répondre aux questions les plus diverses.
En raison de l'évolution de la psychologie des jeunes, garçons et filles seront réunis séparément. À partir de 17 ans on peut réunir ensemble les groupes mixtes de jeunes qui ont l'habitude de se réunir souvent.
L'éducation sexuelle concerne non seulement les parents et les maîtres, mais tous les éducateurs: animateurs d'associations de jeunes, ministres de cultes, responsables ecclésiastiques, conseillers familiaux, assistants sociaux, et en général ceux qui exercent une influence directe
sur l'attitude des parents et des jeunes.
Connaissance de la vérité Comment vont-ils faire l'éducation sexuelle?
C'est tout d'abord en donnant aux jeunes une information exacte sur tout ce qui concerne la sexualité. Dans ce domaine aussi, les jeunes ont pleinement le droit d'entendre la vérité. C'est elle seule qui dévoile les mystères. «Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité» (1 Timothée 2: 3-4).
Les parents et les éducateurs diront donc la vérité dans un vocabulaire simple que les enfants peuvent comprendre. Quand j'explique l'anatomie et la physiologie des organes sexuels dans ma langue maternelle, le bassa, je désigne les ovules par les oeufs de la femme; les ovaires sont les poches des oeufs; les trompes, le chemin des oeufs; l'utérus, la chambre du bébé; le vagin, le chemin de la naissance; et les spermatozoïdes, la semence de l'homme. Un vocabulaire fin aide à faire passer l'information sans choquer ! 'auditoire.
Pour que l'éducation sexuelle ait du succès, elle ne va pas se limiter à cette information biologique que même les livres peuvent fournir. L'exemple d'un amour conjugal réussi et d'une vie familiale heureuse, une réflexion commune et approfondie entre les jeunes et les adultes sur les problèmes sexuels complètent l'information et présentent l'éducation sexuelle sous toutes ses formes.
Le jeune homme (ou la jeune fille) qui reçoit cette éducation veut être pris au sérieux. Un dialogue sincère, mené dans un entretien en face à face avec un seul adolescent, est très fructueux. Contrairement à ! 'instruction, donnée et reçue comme elle est, l'éducation vraie a besoin d'un dialogue. Celui-ci à son tour est favorisé par un climat de confiance.
Éthique Cherchons ensuite à trouver quelques grandes
lignes d'une éthique africaine en matière d'éducation sexuelle. Dans les temps passés, nos ancêtres attachaient une très grande importance à la virginité féminine. Même à l'heure actuelle au Caméroun, cette coutume apparaît pendant la célébration des noces. Si le mari trouve sa femme
vierge, il remplit une bouteille d'eau jusqu'aux bords, y plante une jeune branche de palmier qu'il garnit avec beaucoup de billets d'argent. Une jeune fille fraîche porte cette bouteille pleine, sort de la chambre à coucher des jeunes mariés avec un cri de joie et danse partout dans la cour. L'argent qui orne cette bouteille est une récompense destinée aux parents de la jeune femme parce qu'ils ont bien gardé leur fille vierge jusqu'au mariage. Mais si la jeune fille danse avec une bouteille d'eau remplie à moitié, c'est que la femme n'était pas vierge et c'est une honte pour elle et toute sa famille. Près de 80% des garçons que j'ai interrogés souhaitent épouser des jeunes filles vierges. Donc la virginité féminine n'est pas encore démodée en Afrique.
La virginité masculine est difficile à déterminer car l'homme n'a pas d'hymen. Une contradiction existe à ce sujet: presque tous les garçons que j'ai interrogés veulent épouser des filles vierges, mais eux-mêmes ne peuvent pas rester vierges. Les filles se partagent en deux catégories: les filles «traditionnelles » sont pour la virginité, et les filles «modernes» pour les relations préconjugales comme les garçons. Les mots hymen et hyménée, qui sont des synonymes du mot mariage, doivent leur apprendre que la fille ne doit normalement être déflorée que dans le mariage. Le lieu officiel reconnu légitime de par tout le monde et dans tous les temps pour l'acte sexuel, c'est le mariage. Selon !'Écriture Sainte, l'homme et la femme forment ensemble l'image de Dieu (Genèse 1 :27).
L'Évangile su prime la domination de l'homme par la femme et la domination de la femme par l'homme (Galatiens 3 :28). La relation sexuelle de l'homme et de la femme fait naître «une seule chair», la personne conjugale (Genèse 2 :24 et 1 Corinthiens 6: 15-20). Le don de l'un à l'autre dans la relation sexuelle est un don total, joie particulière et jouissance pour l'homme et la femme qui, selon la promesse du Créateur, s'unissent pour la vie. Ni les relations sexuelles avant le mariage, ni le concubinage ne permettent de vivre cette promesse.
L'unité humaine Une autre piste à suivre est l'accent sur l'unité
entre le corps, l'âme et l'esprit d'un être humain en bonne santé. La sexualité n'est qu'un aspect de l'amour, mais de nombreux jeunes confondent
81
ces deux termes et pensent que la sexualité et l'amour signifient la même chose. L'éducateur cherchera à définir les deux. L'acte sexuel ne devrait avoir lieu que s'il y a amour vrai.
Nous découvrons que l'amour, le mariage et la sexualité sont trois forces qui tendent l'une vers l'autre. L'amour vrai tend vers la durée, donc vers le mariage qui entraîne l'acte sexuel qui à son tour fait grandir l'amour. Si un homme et une femme suppriment l'un de ces trois éléments, les deux autres qu'ils maintiennent finissent par disparaître et toute leur relation d'amour devient malheureuse. Ce triangle est utile à quiconque parle du vrai amour, du vrai mariage ou de la vraie sexualité. Dans une éducation sexuelle clairvoyante, il est indispensable d'insister sur l'unité de ces trois systèmes dynamiques, et de combattre en même temps toutes les actions qui veulent les séparer.
Mariage
C b 0 i X
d'intérêt
L'amour libre, c'est-à-dire l'action de s'unir sexuellement à une personne sans vouloir l'épouser, sépare le mariage de la sexualité. La prostitution, c'est-à-dire le fait d'avoir les rapports sexuels avec une personne qu'on n'aime même pas, sépare la sexualité de l'amour. Le choix d'intérêt, c'est-à-dire l'action de consentir à épouser une personne qu'on n'aime pas réellement, sépare l'amour du mariage.
L'éducation sexuelle des jeunes est avant tout un problème d'adultes. Il est certain qu'elle cause des difficultés aux jeunes. Cependant certains garçons et filles ne semblent même pas conscients de la carence de l'éducation sexuelle dans leurs programmes éducatifs. Lorsque les parents et les éducateurs veulent remplir leurs devoirs d'éducation sexuelle, une foule de difficultés se soulèvent devant eux. En conséquence, la plupart d'entre
82
eux abandonnent cette lourde tâche. Voici les conversations que j'ai eues avec différentes personnes sur ce sujet:
À la question « Pourquoi ne donnez-vous pas l'éducation sexuelle?» Pierre répondit: «Je ne l'ai pas reçue moi-même. Comment voulez-vous que je donne aux autres ce que je n'ai pas?»
Je lui dis: «Si vous n'avez pas reçu une telle éducation autrefois, il est fort possible de l'acquérir aujourd'hui. Laissez-vous conseiller par une personne expérimentée, lisez une bonne documentation à ce propos, ou bien participez aux conférences où ce thème sera exposé.» La difficulté de Pierre est celle d'un grand nombre d'africains: C'est le manque de connaissances scientifiques.
Calvin: «J'ai appris en Europe comment on donne cette éducation, mais il me manque du temps pour cela. Faut-il alors sacrifier mon travail professionnel?»
Je lui dis: «Le fait d'avoir appris comment on donne l'éducation sexuelle vous en rend responsable d'une manière ou d'une autre. Vous n'ignorez plus sa nécessité. S'il vous manque beaucoup de temps, je vous comprends. Mais dire qu'il vous manque complètement de temps tous les jours pour vos chers enfants, c'est alors une question de votre emploi du temps; d'une part vous avez le travail à l'usine, mais d'autre part il y a les heures de repos, le temps de loisir, le week-end et même les vacances. Je ne conçois pas qu'il soit impossible de trouver même un peu de temps pour une chose si essentielle ! »
Luc: «Je suis ancien <l'Église et considère tout ce qui concerne la sexualité comme tabou et péché. Quant à moi il n'est pas question de parler de ces choses sales. »
J'ajoutai: «La sexualité n'est pas un péché en soi, mais plusieurs personnes corn mettent des péchés dans ce domaine. La Bible parle de la vie sexuelle sans arrière-pensée. Elle montre que Dieu, Créateur de toutes choses, est aussi le créateur de la vie sexuelle. Dieu ne veut pas que l'homme reste seul, mais il lui donne une femme semblable à lui (Genèse 2: 18).
Les enfants - provenant de la sexualité -sont un cadeau de Dieu et une bénédiction (Psaumes 127: 3-5). La sexualité n'est pas le fruit du péché, car Dieu l'avait donnée au premier couple humain, Adam et Ève, bien avant leur chute.
Saint Clément d'Alexandrie a dit a ce propos: «Il ne convient pas que nous ayons honte de nommer par leurs noms les choses que Dieu n'a pas jugé honteux de créer.»
André: «J'ai connu un échec grave dans le domaine sexuel. Alors je ne peux plus parler de la sexualité avec autorité.»
Je lui dis: «Vous êtes bien placé pour montrer aux jeunes comment ils peuvent éviter de tomber dans le même piège que vous. Le Christ nous offre son pardon pour nos échecs et nos manquements. Il nous réconcilie avec lui-même, avec nous-mêmes et avec le partenaire. Le Chrétien n'est pas celui qui ne connaît pas l'échec, mais qui peut le reconnaître, et changer pour vivre en nouveauté de vie.»
Voici ensuite quelques propositions concernant le programme d'éducation sexuelle. Il y a toujours intérêt a réunir les enfants selon leur âge.
Première phase: l'enfance, jusqu'a six ans; Donnez aux enfants en bas âge surtout un bon exemple de vie conjugale, vie pleine de générosité, d'amour et de bonheur.
Répondez bien aux questions des enfants, en particulier celles qui touchent a la sexualité. Exemples: - En voyant le bébé de leur voisin nouvellement revenu de la maternité, le petit Joseph âgé de quatre ans demande spontanément: «Papa, oü achète-t-on les enfants?» Son père lui répond d'un ton calme et sérieux: «Mon petit Joseph, on n'achète pas les enfants, mais lorsque Papa et Maman s'aiment beaucoup, leurs semences se rencontrent dans le ventre de Maman d'oü grandit peu a peu un enfant.» Joseph continue: « Comment les enfant sortent-ils du ventre de leur mère?» Sans rire, son père lui explique tout naturellement que « Dieu a merveilleusement fait une «poche a bébé» dans le ventre des femmes. Lorsque le bébé est assez grand, cette poche s' ouvre toute seule pour que le bébé puisse sortir.»
En surprenant son père qui se baigne, la petite Monique se met a pleurer. «Monique pourquoi pleures-tu?» demande Maman. «C'est parce que Papa a entre les jambes une petite queue, mais moi je ne l'ai pas!». Sa mère la console en ces termes: «Monique, je ne l'ai pas non plus, mais je ne pleure pas. Quand tu seras grande, tu auras deux jolis seins comme moi que Papa n'a pas.» Monique sourit et Maman continue: «C'est Dieu notre Créateur qui a voulu que hommes et fem-
mes soient différents. » Expliquez aussi aux enfants a cet âge la forma
tion et la vie d'une famille. Voici une petite leçon donnée a Annette: «L'amour de papa pour maman les avait conduits au mariage. Maintenant, maman prépare la nourriture pour nous tous, puis elle lave le linge et s'occupe de la beauté de notre maison familiale. Papa va au travail pour chercher de l'argent pour toute la famille. Il décide tout avec maman. Nous nous aimons beaucoup en famille. Mais en dehors de notre famille, par exemple a la rue, il y a aussi des gens méchants dont il faut se méfier. Quand un inconnu veut t'emmener chez lui, ne le suit pas et ne lui demande pas sa banane. »
Pendant la période de latence, entre 7 et 12 ans parlez aux adolescents des modes de reproduction des êtres, en présentant sur le même plan la reproduction des plantes, des animaux et des hommes, car tous obéissent a cette loi naturelle: Cellule mâle + cellule femelle = fruit. Exemples : Les étamines d'une fleur mâle produisent les cellules mâles, le pollen. Une fleur femelle a un canal, le pistil qui aboutit a une chambre appelée ovaire qui contient les cellules femelles, les ovules. Transporté par le vent, l'eau ou un animal, par exemple l'abeille, le pollen arrive sur la fleur femelle, passe par le pistil et s'unit avec l'ovule. Les deux se marient et le résultat en est la formation du fruit.
D'autre part, la cellule mâle d'un coq s'unit avec la cellule femelle d'une poule. Les deux cellules se marient, !'oeuf se forme, se développe et donne comme résultat un petit poussin.
De même, la cellule mâle de papa (spermatozoïde) s'unit avec l'ovule de maman et donne comme résultat un bébé.
Cependant, l'homme est différent des autres créatures car il est l'image de Dieu, c'est-a-dire il a de l'intelligence et une volonté libre. Chez les plantes et les animaux, la reproduction de l'espèce se fait sans responsabilité; tandis que chez l'homme et la femme, leur reproduction se fait avec responsabilité.
Préparez également les enfants a cet âge aux transformations sexuelles qui vont bientôt se produire dans leur corps: parlez ainsi au garçon de la barbe, de la mue de la voix, de l'éveil de son désir sexuel et sa maîtrise, et des pollutions nocturnes. Parlez a la jeune fille du développement des seins,
83
de l'évolution, des règles périodiques, des pulsions et changements de caractère qui vont intervenir dès la puberté.
La puberté, entre 13 et 21 ans; c'est la phase décisive de l'éducation sexuelle. Elle est marquée par le trouble et l'insécurité que provoquent chez l'adolescent les transformations de son comportement.
Il est alors temps de montrer aux jeunes les dangers de mauvaises compagnies, de mauvais spectacles et d'une mauvaise littérature. Expliquez leur une bonne et une mauvaise utilisation du désir sexuel: masturbation trop fréquente, prostitution, homosexualité, concubinage, viol, inceste sont une mauvaise utilisation de son désir sexuel. Par contre, l'investissement du désir dans la formation professionnelle, les engagements au service d'autrui, le stockage de l'énergie du désir comme le barrage d'une usine électrique accumule l'eau utile pour la production de l'énergie utilisable, adopter avec son partenaire dans le mariage un bon rythme de relations intimes en alternant des périodes d'abstinence et de dialogue des corps, constituent une bonne utilisation de son désir sexuel.
Le désir sexuel est comme un feu. Satisfait dans le mariage, il est comparable à un feu de fourneau qui brûle à sa place; alors il rend service aux êtres humains. Mais la satisfaction du désir sexuel en dehors du mariage est semblable à un feu d'incendie qui fait des aventures et des ravages en causant aux êtres humains beaucoup plus de dommages qu'il ne leur rend service.
D'autres questions à discuter avec les jeunes âgés de plus de dix sept ans sont celles concernant la virginité, la camaraderie, l'amitié vraie, l'évolution de l'amour, les maladies vénériennes, le célibat, le mariage, comment apprendre à connaître l'autre sexe et comment devenir une personne capable de vivre avec une autre personne tout une vie, etc.
Elle s'adresse aux adultes, au-delà de 22 ans, les jeunes engagés dans le mariage, ceux qui travaillent et les étudiants. Organisez des sessions de sensibilisation où des questions sexuelles seront traitées, par exemple la régularisation des naissances, l'avortement, la frigidité, la stérilité, l'hérédité, l'adoption, la filiation, la stérilisation, le cycle féminin, l'hygiène sexuelle et comment développer et varier le dialogue des corps et le
84
plaisir sexuel dans le mariage.*
Buts Demandons-nous enfin quels sont les buts que
l'éducateur devrait viser à atteindre par l'éducation sexuelle.
• L'éducation sexuelle doit offrir une aide efficace contre l'excès d'accentuation de la sexualité dans le public.
• Elle doit aussi donner à l'enfant grandissant une connaissance plus complète correspondant à son âge.
• L'évolution affective des jeunes nous apprend que dans un premier temps, le garçon se sent attiré par toutes les femmes, ou par la femme en général. Ensuite il désire un groupe de femmes, par exemple les brunes, les sveltes, ou les collégiennes. De ce groupe préféré, il arrive enfin à choisir une seule qu'il aime. La fille « moderne>> (différente de la fille traditionnelle) suit la même évolution affective. Lorsque les jeunes parviennent à choisir un seul partenaire par amour, on parle à ce moment de leur maturité affective. L'éducation sexuelle sera donc l'action des parents et des éducateurs en vue d'une maturation progressive des jeunes sur le plan affectif.
• Un autre but à viser serait de faire comprendre le vrai sens de la sexualité humaine aux jeunes qui apprendront à mieux respecter le sexe opposé. La sexualité animale est différente de la sexualité humaine. L'homme et la femme qui s'unissent comme les animaux sont bêtes et sauvages. Chez les animaux, l'instinct pousse le mâle vers la femelle et la sexualité est une fonction biologique en soi ; tandis que chez les êtres humains, l'acte sexuel engage non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit de son partenaire.
• Un but extrêmement important à viser par l'éducation sexuelle, c'est la prise de conscience des jeunes et des adultes afin que chacun soit responsable de ses actions envers soi-même, envers son partenaire et envers leur postérité. C'est cla-
* M. Jean Banyolak a écrit une excellente brochure de vulgarisation pour adultes sur ces problèmes, intitulée« Ma femme n'aime plus nos relations sexuelles» (Collection VOICI MON PROBLÈME, n°2) qui peut être obtenue de l'auteur. Adresse: B.P. 54, DOUALA-DEIDO, Cameroun (Note de /'éditeur)
. -
\ L
.. lmtu.'1 cl1·1·um '"'" uljrrh1• tlt: /i/111.1 ùotÎl/ll<'J l'I dt• 1·wln1a
nlîer 4uc l'union se\uc:lk humaine du11 IOUJuUr!> êlrC hcc iH'eC la di~pUl>lliuO de rm:ndrc: la rcspon~ab1litè de son partenaire i.exucl cl des enfants èvcnl ucl.s, sinon '>a ~cxuahté c~I inh umaînc.
La plupart des protestants édairél> croient 11uc le déi.1r !>cxucl n'est pas motuvais. maii. c'ci.1 la sa-11sfoc11on 1nsuncu11e, ègoï,1c ou abus111e <li: ci: désir 401 c'il mauvaise. Le charme cl l'attrait du sexe •)pposè ont è1è créés par Dieu et 1>011t très norrn:1u" La !>cxualîté C)t un dun cxccllcnl de D1c:u et la Jouissance ltcxucllc e!>t un dmenl du couple. L'acte scxuc:I unit l'bomme cl la femme comn1c un puni sur un llc\He un11 uni: rive â
l'autre L'union !>exuc:llc dans h: manage est sem· hlahh: :'1 un pont métallique très durable. En dehors du mariagc, cc pont en tronc~ d'arbres fat· hic!. s'arrête au milieu du tleuve sans mener nulle
pari Il est permii.. prudent cl :.ûr de traverser p;.m1blemcnl un fleuve: :.ur un ponl mé1alli11ue.
11 est écri1 dan!> Cjenèse 2:24: "C'est pour'{uui rhumme 4uittera son père cl ~a mère, (pour le manage) et s·auachern à sa femme, (par l'amour) et ils deviendront une :.euh: drnir (dàn~ la )C\uahtè). " L'amour, le mariat1-c el la !oe:Xual11c veulent et doi' ent être insèparablcs dan~ une \·éntahlc éducation ~e:4.uclle
point de vue d'un éducateur africain sur l'éducation sexuelle Bakaroba Soumaré Proviseur du Lycée Askia Mohamed, Bamako
Ce point de vue résulte d'un certain nombre de réflexions, faites a partir d'observations de certains comportements sexuels de jeunes scolarisés maliens depuis les premiéres années d'études dans les écoles fondamentale jusqu'aux années de lycée. Mon exposé comporte donc les différentes parties suivantes: observations de certains comportements sexuels d'éléves des deux sexes; réflexions sur ces observations; problémes que cela pose; point de vue sur les solutions de ces problémes.
Comportements sexuels d'éléves Avant d'aborder ces observations je voudrais
vous rapporter partiellement une étude de quelques signes de la puberté en milieu scolaire bamakois. Cette étude datant des années scolaires l 967-68 et 1968-69 a été publiée dans une revue périodique de l'Institut des Sciences Humaines, intitulée «Les Études Maliennes». Son auteur, Monsieur Marna Diakité, a bénéficié de la collaboration du Personnel de l'inspection médico-scolaire, des instituteurs et professeurs de la ville de Bamako.
Selon cette étude, (la premiére de ce genre au Mali), la puberté peut être définie comme étant « la période de mutation biophysiologique et psychologique qui fait passer de l'enfance a l'adolescence». Elle est caractérisée par diverses transformations aussi bien chez la fille que chez le garçon : développement et mise en fonction des glandes génitales ; développement des seins; mue de la voix, etc. Il faut ajouter que les caractéres sexuels secondaires ne se précisent pas tous simultanément.
Cette étude de quelques signes de la puberté a consisté essentiellement a essayer de déterminer d'une part les âges d'apparition des poils axillaires et pubiens, et d'autre part les âges auxquels se développent les seins et le scrotum chez les éléves
86
des deux sexes de diverses écoles de la ville de Bamako. Ces éléves étaient au nombre de 62 l dont 31 l garçons et 310 filles âgés de 10 a 19 ans.
La répartition de ces 62 l éléves était la suivante (il faut attirer l'attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un échantillon tiré au hasard, mais d'un groupe sélectif - les scolarisés - et que, par conséquent, les données ne sont pas nécessairement applicables a toute la population; note de l'éditeur): 72 garçons et 75 filles âgés de l O ans; 85 garçons et 55 filles de l l ans; 56 et 71 de 12 ans; 44 et 49 de 13 ans; 26 et 36 de 14 ans; 15 et 12 de 15 ans; 2 et 7 de 16 ans; 7 et 4 de 17 ans; 4 garçons de 18 ans; et 2 garçons et une fille de 19 ans. Le siége permanent de l'enquête était l'inspection médico-scolaire. On y envoyait matin et soir les éléves.
Les travaux d'enquête ont abouti a des résultats qui« permettent d'affirmer la précocité de la puberté, remarquable surtout chez les filles». En effet chez celles-ci « la puberté commence a s'installer a partir de 12 ans ». L'âge moyen de cette puberté est de 13-14 ans environ. Par exemple, sur 36 filles âgées de 14 ans, 22,2% avaient les seins développés, et 38,8% étaient réglées. Sur 12 filles âgées de 15 ans, 58,4% avaient les seins développés, et 58,3% étaient réglées. Quant aux garçons, l'âge de la puberté est de 17-18 ans environ.
Pour en revenir aux observations, précisons que certaines sont personnelles, d'autres m'ont été rapportées par des collégues éducateurs (maîtres du premier et du deuxiéme cycle de l'enseignement fondamental et professeurs) avec lesquels j'ai eu de longues conversations et discussions a propos des comportements sexuels de nos jeunes scolarisés maliens.
Premiére série d'observations Elles se situent au niveau du premier cycle de
l'l:nsc1gncmcnl fondamental lce 4oc l'on ap~lle en d·autrc:. lieu>. l"écoh: pnmam:). À Bamako, le recrutement scolai rc se luit il di ffèrents iige!\: six, ~c:pt, huit an:. et mëmc à neuf c:I à dix ani.. compte tenu du llu>. d'effectif!. d'enlanb scol<1mahlc~ et de lïn~ulli~um:e de!\ Jocaull. s.:olam::. d'accueil.
Déjà dans ce premic:r c.)'clc d'étude~
fondamentales, au nin:ao de la 1r111sièmc et de la ~uatrièmc année. le!-. èli:vcs lonl partie de pclili. dubs au sein des 4uart1crs qu'1b habi1en1. Cei. dub:. corn prennent au!-.~t bien des garçon~ \jUC des hiles. environ du mëmc âge. Ils :.ont ù 1'1mag.e de: ceux de leur!'. ainés du dcuxièrnc c)dc d'ètudci., cl dont JC parlerai tout a l'heure. Comme acl!Yllés de ces" nuni duhl>" (e1>.pre!>,1Un cons:.11.:réc). il y a les parties de thé. les surprisc~·parlics. On a rcmar4uê qu'au cour:. des :..urpnse!>·partics. l'on é1c1nt. à un monu.:nt d1Jnné. la lumière pend<tnl \jUC: lei. "mini danseur!!" se trou\ cnt !\Ur la p1~te. 1·1 alori. "~a y va" d;in~ l'ohscunlé ..•
On ;i c1Jni.1atê chct. cei- êh:,c:. de tnm.1èmc et de \jUatm':me ;innée ~ucl4uc~ ms de gTlhM.:s-.e 1 un cas en tro1s11:me annëc en un autre en quatricme ann~ dan!> une école: lie lfama~u). Cela paraît 1mpo~Mhle à prcnui:re vue ma1i. au Mah, compte tenu d'une: part de la précocité de la puherté chet l;1 tille, et d'autre part des ;igc~ de rccrutc:ment (si,, ~pl, hu11. neuf et dix ;ins) 11 sulfü qu'une jeune !Ille recrutée à ncu r ans ou à dix an~ <IÎI rcllouhlé une clai.sc (prc:mii:rc année ou dcu\ièmc: année par exemple) pour qu'elle ait, en rcdouhlant une fob. trc11.e uu 4uatorze ani. en troi~ième année, et qualur1c ou quinte <tn!> en 4uatr1èmc année.
(;rosst•,.!>eS "" da•M~ dt! dnquiême Il e,1 à remarquer 4uc cet état de grossesse est
connu dan!> l'entourage de rrntéTc!>Sêe, la nou\·clle se: 1ranMnet de bouche a ore1llc:. d'une élève à l'autre. Quant au directeur d'école, il c~1 le plui. ){)UVC:lll le dernier j l'apprendre car un fail tout pnur le lui cm:hcr par crainte Je la sam;tion qui peut ~·ensuivre. à savoir l'e\dusiun délinitivc. La vmlc mêdicale de:. jeunci. fille~ a heu, pour celles <les d;a!>:.e~ ordinaire::., une fois par <1nncc scolaire: (au déhu! de l'annèc:). Les grosi.i:sscs se rencontrent aussi chet des hllci. des dai.i.es de cinquième cl si"1:1è111e. l'ar exemple, dcu:1. fille~ en gruS!\CM•t: sur vrngt-llcu\ dans une dassc de \l'l.tèmc: :J !kt mako
( t' 1e1t111• mu/11•11 J1•1·ru-t-il Jrot/\'t'T .w11 du•n11t1 101/f .\·1•11/ '>
Uc·uxiême série d'obscm11io11s : Elle' unt trait aux comporlc:ments sc:Auel!> des
Clèves du deuxième qde de: l'ensc1gncment lond;11nenlal (ce qui ~·orrc!>pond au premier .:yclc de l'cnsei(!nemcnt i.ecundaire dans d'autrc:i. pays). Cclui-1;1 cumrwrh: les dm;i.cs de i.cpl1émc. hui· 11ème et neuvii:me annêcs (i.oit cinquième:. qua-1r1èmc cl 1rms1èmc aillcur:!>).
Les écolières cl les écoliers de~ classes de i.cptièmc, hu111èmc c:t neuvième font aU~M partie. du moins pour la plupart, de dub!> de thé dani. le!> qu;irlicrs (le~ écoles fondamentales du deuxième ..:>cle étant à ré!l1me e"'ternat). Les clubs sunt mi'ltes. avec une majorité de gun;uns. Cc sont les heu~ J'iu::tmtês qui. au demeurnn1. ne 'ont p<1:. toujours saines: l'un des membres foil du thé (le cuût est supporté par les ~u11sat1ons <le-; membres) 4ui est servi en lruis lcmrs PcnJanl que l\m dè~uste le thé. un autre memhrc fait écouter -.ur èlectrophune de l;i "pur musique» ou du "Jamci. Brown».
11 \a !>ilni. dire que cc~ acl1v1té\ comprennent entre uu lrcs Ici. surpnsei.-partî~. urgan1séci. de
prêfêrence le samedi aprês-midi, le samedi soir ou le dimanche (matin ou soir). Au cours de celles-ci, il semble que les garçons utilisent deux procêdês pour avoir les filles qu'ils dêsirent: si la fille boit de l'alcool, lui en faire prendre une dose pouvant la mettre dans un certain êtat de faiblesse; si elle ne boit pas d'alcool, mettre à son insu un stupêfiant ou de la drogue dans son verre. Le cavalier amenera ensuite quelque part la jeune fille qui aura succombê.
Que dire des grossesses au niveau des jeunes filles de ce deuxième cycle d'êtudes? À en croire les dêclarations des directeurs et directrices d'êcoles, elles sont plus nombreuses que dans le premier cycle. Toutefois il ya lieu de prêciser qu'en classe de neuvième (classe d'examen) il y en a moins que dans les deux classes prêcêdentes. Il y a un comportement remarquable sinon courageux de la jeune fille en grossesse: elle fait tout pour le cacher aux yeux du maitre et du directeur. Elle fait de l'êducation physique comme toute autre jeune fille de sa classe, même à un stade avancê de la grossesse.
Quels sont les auteurs de ces grossesses? Ce ne sont jamais des garçons de la même classe car la fille de septième, huitième ou neuvième recherche toujours comme amant un garçon d'une classe supêrieure (un lycêen ou un êlève d'un êtablissement similaire). Ce sont parfois des jeunes gens d'un rang social moyen (ex-êlève ayant un mêtier, petit fonctionnaire, etc.) qui s'habillent bien, dansent bien, sont dêcontractês, qui sont« à la page» comme le disent elles-mêmes les jeunes filles. Ce sont aussi et surtout des adultes d'un rang social assez êlevê, capables d'entretenir la jeune fille sur le plan matêriel. À cet âge là, la jeune fille veut se faire une certaine toilette, se faire remarquer au sein de l'êcole, se faire admirer par les garçons de l'êtablissement. Si la jeune fille appartient à une famille pauvre qui ne peut supporter le coût de cette toilette, il y a de fortes chances qu'elle cède devant les offres de ce monsieur qui a une voiture, de l'argent, etc. Malheureusement si elle devient enceinte celui-ci ne reconnaîtra pas la paternitê. À la rigueur, il prendra en charge les frais du nourrisson.
Troisième sêrie d'observations Elles concernent les jeunes gens (garçons et fil
les) de lycêes ou d'êtablissements de niveau
88
êquivalent. Pour ce qui est des jeunes filles de lycêes de Bamako je peux dire que chaque annêe, l'on enregistre des cas de grossesses. Leur nombre est variable d'une annêe à l'autre. L'on a constatê que celles qui se sentent rêellement en grossesse ne se prêsentent pas à l'êcole le jour de la visite mêdicale. Elles n'y reviendront pas et officiellement on les considère au bout d'un certain temps comme dêmissionnaires. Celles qui, par un moye.n ou par un autre, ont êchappê à la première visite mêdicale, et qui voient leur grossesse avancêe, essayent d'obtenir des permissions d'absence en invoquant de faux motifs. Au cours de ces permissions de quelques jours (une semaine par exemple) ce sera ou bien l'accouchement (si la grossesse est à terme) ou bien l'avortement. Et la jeune fille reviendra à l'êcole avec un certificat mêdical certifiant tel ou tel êtat de santê.
Quant aux lycêens tels que ceux de l'êtablissement que je dirige (le Lycêe Askia Mohamed), je dirai que c'est un groupe quelque peu mixte, en ce sens qu'il y a sur les mille êlèves (internes et externes) soixante-huit filles dont les unes sont maliennes (douze), les autres êtrangères (cinquantesix.) Les jeunes filles maliennes boursières sont hêbergêes au Lycêe de Jeunes filles. Depuis quatre ans, je n'ai enregistrê qu'un seul cas de grossesse (une fille malienne). Par contre, il y a parmi les garçons des pères, surtout au niveau des êlèves de classes terminales. Par exemple, cette annêe un êlève de classe terminale, boursier entier, interne, a demandê par êcrit la mise à l'externat avec bênêfice de sa bourse pour la raison suivante: il veut avec sa bourse supporter les frais d'êtudes, (dans un centre privê), de la jeune fille avec laquelle il a eu un enfant. Le but de la bourse entière êtant de mettre l'êlève lui-même dans les meilleures conditions de travail pour rêussir, il va sans dire que la demande a êtê rejetêe. Ce cas est un cas d'espèce, car en gênêral le lycêen père n'accepte pas de supporter les frais du nourrisson, et à fortiori les frais d'êtudes de la jeune maman. Ce sont les parents de celle-ci qui les supportent.
RêHexions sur ces observations Les rêfiexions auxquelles je me suis livrê quant
aux comportements sexuels de ces jeunes scolarisês de diffêrents âges et de diffêrents ni veaux
d'étude:. m'ont cundu1l il la recherche des causes profondes de 1cls cumporlcmcnts. San!> prèlcndre saisir de faljun ccrt;.nnc cc' causes, Ji: voudrais èmellre un certain nombre d'idées qui, me semble-Hl. 1lnt des rappom dm:cts a\CC elles.
À côté de celle prêco..:itè de la pubcr1è cbc1 la Jt:unc lillc m:ilienne, il ) a louh: une évolution qui !i'esl opèrèc de la fai;un de sentir, d'a111r. bref de: \'ivre de la Jeune clladine malienne dc~1u1i. la pèriode prècolomalc JUsqu'j nos. Jours. Celle èvolution e~I la rc!sullantc d'interactions de dl\·cr!i fac leur~ soda ux. èconom iq ues, cu lt u reis. cl c. A prop11!> de ces dernier:.. je put:- dire quïl) a eu une cc:r1a1nc .1ccultun11ion lors de la pérmde coloniale, dunl les clleh uc ~ont malheureusement pas encore etlacc::. de nos jours.
Le rd.lchcmcnl de:~ moeurs est dû c~sen11clle-111en1. ~ mon ~ens. à notre 1:ond11iun de ~oui.dè,·elupperncnt. L 'èculièrc de retour de l'école n'es1 pa!t de la part de se:. p:m:nli. l'objet d'a11en-11on dan' le ~cns d'une certaine èd111.a11on fam1halc, car le rère el la mcre sont préoccu(lês par la rci..:herche du pain quot1d1cn, chacun de ~on côté. Ou encore cette autre mère dirnrcée, ayant de~ i:nfants a char~e. pou!>:.e ~u tille à k1 dèh;1uche (lOUr :J\'Oir de l'argent Une autre: h1ér.irch1e de valeur~ murales semble i:tabhc par le' 1eunei; homnw~ de cc:. ecolc~ lundamcntalc!.. l·n effet. devant Ici. cai. de gro:.sci.~e de .1cunc:. tille~. qu'est cc qu'on le:. entend d1n: '! " l.a !lrllS\es~e 1."e~I le brevet de la \ITI litè ••. J b trou\ ent cette gru:.:.cs)c norm&1h: de même que l'mhdél11é de li.I Jeune lille :.ur h: plun de~ rapporh :.c:ii.ucb au !>ein du même dub.
Il ne laut pas négliger l'clkt néra~tc de l'cnvironnemcnl 'u r les comportements dei. jeunc:. t?cns de:!> ville:.. par exemple le' photo-roman~ uù i.unt décme.; Ile' ,l\'Cnturc~ amourcusci. de gcn~ de ~ocièh:!§ occ1dcn1ales. C.c~ a1en1ures ne \onl pa~ pour la plup:irl de bonnes rclcrcncei. . Cc:. photo· romans circulent chinde:.linemenl entre les écolière:. On peut citc:r ègah:menl les tilrn!> interdits .su\ mumi. de: sciie ou de db.-hu1t an., mais dont le~ i.pectalcurs :.ont en ('lart1c: ccu:11-là mémc pour le~quds ils :.unt interdit!>, et l'inadl\ 1té llan:. laquelle se trouvent l'élève de dassc pnm:ure cl l'èlèvc de cla!>se d'enseîgncmcnt secondaire après a\·oir quitté l'école:. Ne lrou\·ant rien à faire. il se crée une ac1iv111!. d'où le: club de 1hê, le~ surpril>espart1es.
1. 'àJ11n11io11 1e:mdlt• dc•1·ru11 t!trt'
l//IC' /Ulrtit• Îtlfégrt.ttllt• ,J11 1llfT/111/111,,
,f,•11,dg1tt'lll<'lll .1c-c t1f/du1rt'
Ll~ prohli.-mes <IUl' ccl11 (IO!>l'
'iclon Ici. règlcmenb de~ imtilullon!> !>colaires millicnnci.. une jeune tille uflicicllenu:nt reconnue en gru!>scsse e~t dèhn1ll\emcnt cxduc de: l"é1;ibhsscmcn1. Par contre le garçon, Je ly,'èen père, c11n1inue 1r:mqu1llcment se~ étudt:i.. li y a là un problème: ccl u1 de la ~anct1on appliquée à la Jeune lllh: à CUU!ie de >.on cùmportcmenl !>CllUCI
alnr!> que 'ion camarade de !telle m:lscuhn ayant cumrms un acte analogue n·est pu:. m4u1été. La Jeune lille C!.l·ellc cntîercrncnt rei>ponsablc de ce yu1 lui 1:s1 arrivé'? Pour m:1 pari je pense 4ue non. ( ar la société n'a pu~ rnis cc:ttc jeune fille dans 1<111tcs le::. condition~ empêchant cet Jccidc:nt qu'c!<I la grossesse. Lin autre: problc:mc c:.t celui de rcnfanl et de l'..tdolescenl lais!.(! li lu1-mC:mc.
, , ,,\·/111.1 L'l?lll' étJU('{lfilJll .l't'.\'Ul'lil' (/t•1•rui/ CIJlllflll'fll'l'f 1/t;.1 rfro/c• prilll{l/ft'
111 • .u.:tif. Ces adolci.ccnts ont de' tendances, des ruls1ons qui dü1vcnt être canalisées dans un cer· tain sen:..
1 ci. solutioni. de cc!> problèmei. peuvent se trou· \'Cr dans une éducation sexuelle bien comprise Celle-ci devra â mon !>cns être menée à plusicur:. mvcauJt :
• . 111 11i 1 eau dt• /' froft' cela nécc~i.11c au pré a· loihlc une recherche quant à la ps)chologie de l'cnfonl africain qui, :.ommc toule, de par le mi· lieu alkctif' dani. lequel il est élevé, a des réactioni. fonJr11ncn1alcmcnt d1tlércn1cs dc c.:ellcs de l'enfant européen Par la suite, une prul!r;.1mmatwn Je celle éd uca11110 pourra ërre faite en fonction Jcs rê~ull:1ts de celle recherche. Cctle program· m•llion doit envisager l'éducation sexuelle depuii.. l.t troisième année de l'cnse1gncmcn1 fondamcn· tal JU~qu"à la d;isi.c terminale de l~..:éc. L"ensci· gncmcnl comportera rutilisatiun au,si fréquente 4uc Jlossibk de~ rnuyens audio·\ ii.uck li néce!>Si· h:ra ;rnssi l.i furmallun de form.itcurs (111ui1rc!. du 1 cr l"i du 2c i.:ydc:- lormé~ respci.:11 vc111en t d;111s Je-; rn~tit ub pédagol!it1uc~ d'cnseigncrm:nt gènéral, cl
les écoles normale~ secondaires . proh:s:.eurs ~or· 1;1111 de !'École Normale Supérieure)
lJCI
Ln lin 11 faut envisager la con~lltullon de da!>Sc~ m1u1;:s pour la mise en pratique de cet cn~c1gnemcn1. Car il m'a èté donné de coni.tatcr l1lrs de la prnjcction aux L}cécn~ du lilm 1n1itulc "N.titre •> que ccUlC.·ci sont étrungt:r!> à leur prn· prc corps du fait qu"1b éclatJÎcnt de rîrc à la vue dc:s organes génitaux males Cl lcmclle~. La das~c 1111 \le contrd1ucrai1 avantagt:u .. cmcnt à rappro· cher garçons et tilles, donc à csturnpcr cc recul du Jeune p.ir rapport à son ct>rps.
• 1111 11fr1•t111 jumilial c•t "" ni1•1•t111 dl' tou11• /11 wâété: Une èt<1pc d'informatiün c~t nécc~~airc ruur faire d1~r:ir.1itrc i.:crtain~ liihou~. cercaanc'> ..:ro)ancc:. - telles 4ue celle qui consiste a c.:ro1re 4u'édut.:t1tion ~cxucllc \'CUI dire arprendrc aux jeunes à faire l'amour. Le~ méthodes audio· visuelles pourrnnl ici être utilbéei. ainsi que l°èdu· c.tllun rar IJ rncho
• ·fo 1111·t•a11 1'11ji11 dt tu111t• lu Jt'llflt'S.\t' Celle· ~1 doit être organisée de f:i~on telle qu'elle p1mse mener des a1:tivitês saines, des udÎYllés qui l'uc· ..:upcnt pleincmcnl, tant il est vrai que pour ilVoir ~crtain~ componcmenls ~e:-.uc:l:o. néfastci; il foui J11uir le temps d') penser, de ~·ennu)er dan~ une ..:crtamc ina1:tiv1té.
éducation sexuelle et émancipation de la femme Jacqueline Ki-Zerbo Directrice, Cours Normal de Jeunes Filles, Ouagadougou, Haute Volta
Que nous soyons réunis ici au Mali pour parler de l'éducation sexuelle est significatif. Parler des problèmes sexuels dans des groupes de travail constitués d'éducateurs prouve que ces problèmes ont perdu leur caractère tabou et s'imposent à notre société corn me tous les autres problèmes de l'éducation, de santé et de développement économique. Cette évolution s'explique par lareconnaissance objective de la réalité de ces problèmes et par la nécessité inévitable d'y trouver des solutions. Solutions que les uns et les autres, nous sommes venus chercher avec ferveur dans les intérêts des jeunes dont nous sommes responsables et peut-être aussi dans un intérêt de développement et d'équilibre personnels.
Le vocable «sexe» en lui-même porte une certaine charge affective qui provoque de la gêne chez certains groupes de jeunes. Même une expression aussi anodine que «sexe féminin» ou «sexe masculin» provoque des mouvements divers et des ricanements gênés dans une classe, parce que le mot sexe a été retréci et réduit à un synonyme d'organe génital dont l'évocation émoustille certains esprits.
Or si le sexe désigne la conformation particulière de l'être vivant, qui lui assigne un rôle spécial dans l'acte de génération, il désigne aussi «l'ensemble des caractères physiques, intellectuels, moraux qui distinguent l'un de l'autre l'homme et la femme».
L'éducation sexuelle dont nous allons parler déborde donc largement le seul problème des rapports sexuels pour couvrir l'ensemble des problèmes qui se posent au niveau des relations entre l'homme et la femme au sein de la société.
f:tre femme sans regret Et puisqu'il nous a été précisément demandé de
traiter de l'éducation sexuelle dans ses rapports
avec l'émancipation de la femme, nous affirmerons que le premier objectif de l'éducation sexuelle doit être d'amener les femmes à ne pas regretter d'être femmes mais au contraire à se sentir bien dans leur peau et assumer totalement leur féminité.
La naissance d'un garçon ou d'une fille est accueillie différemment dans les familles. Il y a quelques jours encore un parent d'élève qui a deux belles jeunes filles dans mon établissement m'annonçait avec fierté qu'il venait d'avoir son premier fils. Pour marquer le coup, il avait tué un boeuf à la place du mouton habituel. . . Le garçon part avec un préjugé favorable et nos griots se font les porte-paroles fidèles de notre «sagesse» populaire lorsqu'ils proclament que telle femme de caractère qui a réussi est un « véritable» homme. À réussite égale, l'homme vaut mieux que la femme. À la rigueur, une femme qui a réussi vaut mieux qu'un homme vaurien. Notre société africaine et l'éducation que nous donnons dans notre propre famille sont les principaux agents de la survie de ces préjugés.
Ce père était fier et heureux d'avoir un garçon parce que son nom ne disparaîtra pas et que sa descendance est désormais assurée. Vous comprenez dès lors pourquoi la Commission de la condition de la femme des Nations Unies a longtemps travaillé sur le problème de la nationalité et du nom des femmes mariées.
Même si la femme mariée arrive à conserver son nom de jeune fille le problème ne sera qu'à moitié résolu puisque ses enfants, sauf cas exceptionnels dans les sociétés matriarcales, porteront le nom de leur père.
À la maison il y a des tâches qui nécessitent force et vigueur, ce sont des tâches nobles, dignes d'être réservées aux garçons. Certaines autres nécessitent patience et persévérance parce qu'il faut
91
toujours les recommencer, celles-la sont réservées au.\ li lies. Leur soum Il-Sion et leur résiinatio n les leur font accepter i.:ms d1flicultè. Je suis obli!!èe de ménager la suscep11b1htè de mun cuisinier rarcc qu'il est outré de voir que je fais purfois laver la vim!.cllc aux garc.;ons alon, que les lilles se rcf'O!ocnt. Bien que les li lies soient les aînées et 4ui: dan~ la b1mnc 1 rad ilion afrn:alnc clics devraienl plutôt faire travailler les garc.;uns ... J'ai été am'>1 .imenéc à constater que le droit d'ainesse c~t toujours \!Ulablc a IÏnléneur de groupes ap· p.irtcnant au même ~cM: mais 4u'1I c)t parfois '-'lHllrcdit par la réparll1ton des !aches féminines cr masculines.
route notre éduca111.1n don 1 cndre a faire en MJrle que le sc.\e ne soit pas un hand1car dans le pr11ccssu~ d'èpanou1ssement de la personnalité hurn;11ni: À cet ég<1rd nous examinerons 1:erta1ns aspects particuliers lie l;i scxu<iltlé qui cntrnvcnl l'ép:111ou1sscmcnt de la t'cmme.
A!>p«l ph~·!>iqu" d ... ht .,,.,ualih· On .1dmct couramment 4uc lu lèmmc est
•• laiblc "· Cettc luiblc~i.c congénitale sm:ialcmcn1 reconnue aulori:.c en 4ucl4uc sorte certaines fc:mmi::. a 'C dorloter Cl à choyer leurs duulcur\, Ulll
ranl ~ur renscmhlc de i.e) -.ocur~ la rèpulatmn d'èlrc douillet1c3 el l'accusat100 J'ah~cnté1sme :-.ur le plan profe~~ionncl. IY.iucun~ ont J'u1llcuri. e~pliq11.! les douleuri. qui aq:ompagncnl lcs règle:. comme un refus de la femme ou di: IJ jeune tille
d'assumer su c.:ondilion féminine . N'étant pus 1-ujctte à ce genre de sou!Tram:ei.. J'ignore si ce sont des douleurs ph)siulogi4ues l>U
f'!o)'Chul>omat14uci.. Il me semble 4u'il serait utile de répandre une !die: c.\plicatwn parmi nos jeunes tilles 4u1 ont 1cndanc.:c â i.'alitcr trn1s a quatre JOUrS rar ITHliS Cl il faire foi it lit c.:rnyancc répandue scion la4ucllc il sultil de se laver sur Je mëmc emplacement ou il\CC lu mèmc èronge qu'une femme 4uÎ a de~ règles doulourCU'>C~ f'OUT Clin· 1 r.1.:tcr soi-même cc mal contagieux ..•
l:.n mar'> llJ72, fa1 fa1lh avoir dan!. mon èla· hlisscmenl une révolution "sunglantc" à propn~ du lieu de sèchagc des serviette~ périodiques l;n demandant au)I internes de la1re sé.;hi:r cc hnge comme IOUl> le:. autri:s au i.ulc1I cl au sé..:hu1r commun. je me ~u1s heurtée il une rc:s1slancc donl l'explication m'échappe ju~4u'à cc jour. Peur de se f;ure \'Olcr l>l>ll linge mllmc. pudeur d'exposer un linge in~ullb:immcnt la\'è ou croyance: plus 11hi.cure en.;urc en une.: force mag.1quemenl altJchèc au linge lcminm. Je ne Sali. .. ,
L'attitude de mc:i. jcuncl> lilles m'a en tuut cui. rêvêlê 4ue Ici. règles ont une signilication autre 4ue les explic.:ut1ons physiologuiues que les mêdc· cins en donnc:nl. M}stêrc. matllc et obsc:uranlli.mc !>ont trcs riruchc:s cl 11 nous faut rélléch1r -.cncu~cmcnl li t.:clle trilogie
La femme tend également â ut1lii.cr son aspccl physi4uc ..:0111 mc une arme de cu114uêtc. [)'où le probli:me du tcmri. pi!s!>ê de\ anl le' miroirs et le llrohli:me de l'c:\acl1tudc que nou' connuhsons dan!> nos intcrnati. Certaines élévcl> sont trop prèoccupée.s par leur corpll en lc4ucl elles 1m·e!.· 11i.scn1 beaucoup d'argent, (crème, poudre. ma-4u1llagc et h1Joux) de: temps cl d'èncrgie 4ui !lunt .iutant de tcmp' perdu pour b étudci. E.llco; cherd1cnl il ilgu1chcr le:. JC:Uncs gcn.s ou 1:er1a1ni. adullci. dont elles per1,01ven1 la cuncup1si:encc:. 4u1ttc ensuite à se: détendre ou à être les victime~ de ceu\ 4u'ellcs 0111 tcntél>. Il n'csl pui.étonnunt que lc\ 11111uvcnn:nh de hbèrut111n de la li:mmc i.e \l)ICnt ;utaqUéll Ù Cel Ui.pect (lUrlh:Ulicr Cl que lcll
r\ 1m:nca1m:\ •llClll jeté JU\ !>UftleS le!. l>llUlll:OS· 1wrl!l!l> et aulrc!o .111nhuts de la h:1111nitè Il n'c'>I pu:. alors étunnunt 4uc 1'.o11h1c S;irach1ld, mcmhre lundutcur du " Mou\emclll de libèruuun de l.i 11.:mmc " ait proclamé.
"Nous dason~ que pendant la plui. grande par-111: Je l'histoire. la i.cxu:iluè a été en fait, à la fois
notre auto-destruction el notre seule arme possi· bic pour nous défendre et a lfir mer notre existence.»
Sans en arriver à ces silhouclle~ ascxuêcs aux cheveux longs et aux blue-jeans identiques qu'on voit dans les rues de l'Europe d'aujourd'hui, il nous faut mettre la !Cmmc africaine en garde contre une tendance trop marquée à soil!ner son aspect extérieur et à investir dans les toi lcuc~ coût c uses des sommes qui pou rra icnt être pl us valablcmc:nt utilisées pour la santé cl l'èducution de la famille.
À l'l!spect physique, extérieur et vestimentaire, est également lié l'aspect génétique. La femme en Afrique est celle qui est faite pour prucréer. En cela rAfrique rejoint Napulêon qui n'hésitait pas à écrire, "La femme n'a pa~ à se réaliser mais à servir . .. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse de~ enfants; clic est donc ~a
propriété c<>mme 1· arbre à fruit est celle du jardinier"·
À partir du moment où les dictionnaires ont cessé de définir la femme comme " la compagne de l'homme,. pour reconnaître en elle un être hu· rnain à part entière. il de\'icnl clair que la femme ne ~c marie plu~ ~eulemt:nt pour perpétuer l'es· pèce par den1ir ou par intérêt. Elle se marie rour être heureuse. Dès lors le marîage est séparè de la procréation qui devient l'enrn.:hissemcnt. l'élar· !,!issement <les rt:lations conjugales et nt>n plus leur linalité el leur justiticat10n.
La femme a droit au bonheur. Elle sc réali!>e peut-être par le~ autre!>, mai:. c'est a elle de chui· ~ir lu niic la 1m:illeure pour •i lleindre ~on plein épanouissement dans lïntèrêt de la société toute entière.
Aspl'cl social de 111 Sl':1.uali1i· Nou~ avons déjà abordé cet a~pcct en parlant
de l'éducation donnée aux tilles et aux gar~un!> t:l en es4uissanl l'évolution du hen entre manage et procréation. i\ rrêtons-nou:. plus particulièrement au problème du mariage et du statut de la femme. Le célibat féminin. en dehors de la religion. se com;uit di llicilcment, cl miu~·mêmes par1icip<1ns à la diffusion de l'idèc scion la4uelle la femme est faite pour le manage et cdlc qui ne ~c marie pas n'atteint pal- toute ~il stature humaine.
Dès que nous a\1011!> une nièi.:c, une c.:uusine ou une lllle qui a lini ses études, nous la harcelons de
4uestions el risquons de la pousser dans les bras du premier venu parce que nous lui donnons l'im· pression que «le mariage est la norme de l'inser· lion sociale"·
Dans un tel climat le manage compte parmi les causes frèquenles d'abandon scolaire. soit que la jeune lillc prenne le mariage comme solution à ses problèmt:s économiques (parents qui n'arrivent pas à payer les frais d'études ou les toi lellcs coûtcusr.:s souhaitées) soit qu'elle considère que son destin se trouve dans le mariage et non dans les études. donnant ainsi raison à Simone de Beauvoir lor~qu'clle écrit "Tant qu'une parfaite ég<ililé économique ne sera pas réalisée dans la société cl tant que les lll(lcurs ;iutorisenl la femme à proliter en 111nt qu·épouse el mailressc des privilèges détenus par certains hommes, le rêve d'une réussite passive se maintiendra en clic cl freinera se~ propres accomplissements"· Qui d'entre nous ici n'a présent à l'espnt l'e11.emple précis de telle jeune lille renonçant à ses études pour prolilcr de la réussite de tel homme déjà installé au risque de détruire son foyer et sa famille . ..
l.es jt>unl'S m~res célib:1tain''> Le mariage précoce résolvait beaucoup de pro·
blêmes qui se posent à nous aujourd'hui avec une acuité lancinante. à savoir le problème des gros· scsses des 1eunes tilles non mariées et leurs i:orollaires, qui sont les problèmes des mères
l. 111 murJ d'e1/phuhétisatio11 <Ill Can11!rou11
93
célibataires, de ravorlemenl el de lu contraçeption.
Les jeunes mères célibataires sont tic plus en plus nombreuses dam; nos p:1ys. Certaines arri· vent ù élever convenablement Jeurs enfants parce qu'elles sont c!t:onomiquemcnt indépendantes et qu'elles ont choisi d'assurer seule leurs re~ponsabililés. Telle cette jeune mère Eu· rnpèennc de dix-huit ans qui, à la question« tics· vous heun:use "· répond: "Oui. Je me dis souvent; qu'est-ce que tu serais devenue si tu n'avais pas ton flls'! Étudier indéfinemenl, cc n'est pas drôle. je n";m1is pas de but tians la vie. J'étais hlo-4uèe de tous côtés•>. Témoignage terrible qui de· vrait nous faire réfléc.:h ir dans une direction nouvelle, autre que la condamnation pure et simple Je la fille-mère. D'autres mères céhbataires au con1n11re restent à la charge de Jeurs familles ou sont obligces de se prostituer pour survivre et faire 'ivre l.:u r progéniture. Tout en étant encore rare, l'avortement est une réal ilé de plus en plui. envahissante. Dans le désarroi, les jeunes filles ahsorbent IOUies sortes de mixtures traditionnelles ou les médicaments modernes au plus grund risque de leur vie ou de leur santé future.
Des médecins cupides en font une source paralli:le de rcssou rccs en exigeant des somnH!S cxhorhilantcs par rapport aux moyens Hnanciers de~ ramilles. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous verrons tout à l'heure com1i1ent nous pouvons es· saycr de prévenir.
... < >
94
Aspect intellectuel Pendant longtemps on a considéré la femme
comme un être essentiellement dominé par son affectivité cl dotée de qualités in1cllcc1uclles plus proches du coeur 4ue de l'esprit de géomctrie. Elle est intuitive et fine. L'esprit d'analyse et de création sont le propre de l'homme. Théories souvent exposées cl défendues. Contenions n(lus de citer Christine de Pisar qui dès le XVe sîèclc écrivait:
"Si la coutume était de meure les petites lilles :i l'école cl que communément on leur lil apprendre les sciences comme on fait au11 !ils, elles apprendraient aussi parfaitement el entendraient les subtilitês des arts et des sciences comme ils font"· Celle pionnière a été entendue et les succès accumulé~ par les femmes depuis leur accession à lenseignement ont conlirmé les prophéties tl u X Ve siècle. L'éducation peut amener les jeunes lilles il devenir des personnes adultes «c'est-à· dire capables de vouloir et de.: pouvoir se passer de protection, capables de vivre pour leur propre compte».
Aujourd'hui la jeune lillc n'est plus condamnée aux im;1gmatiuns du coeur. elle peut hien sûr r€· ver du Pri nec charmant mais elle peul aussi rêver de devenir Ma rie Curie ou Valentine T erechko~·a.
Pcrmellcz.·moi de vous signaler une corrélation que j'ai constatée entre l'intérêt pris dans les études, les rèsu hats ~colaircs cl les 1:as Je grossesse survenus dans mon ètablisscmenl. Sans en tirer une lui et en reconnaiss<tnl quelques cal> d'exception, je flUÎs dire que les ca!> de grossesse sun•iennenl surtout chez les élê:ves qui s'intére!>scnt peu à leurs études ou 4 ui y réussissent mal; elles sont fréquentes surtout chel le~
redoublanlcs. Je pense irrésistiblement au têmo1-gnage de celle jeune mère célibataire que j'ai citée plus haut el aussi uux résultats d'une enquête faite sur les motivations des relations sexuelles chez les udolescenls.
Aspect psyl·hologi11uc et sc11ti1mmt:1I Cette enquête a révélé que ce sont dei. stimula
tions psychologiques d'ordre !>Ocial qui poussent le~ adulcsccnb aux relations hétérnscxuclle~ el non pa~ <Jcs stimulations biulogi~ues el inst1nct1-ves comme on pourrait le croire et curn me cer· tains le pensent à wrt. Bien sùr l'instim:t ~e,.ucl
est daoi. la nature hum:1h1c et la tcn!.1011 biologique c!tt rèellc not:immcnl au nrnmcnl de la f1uhcrté. La prci.s1on de l'm~tim:I M:\ucl est accrue d;io~ notre monde .u:tuel qui d11fui.c en t?rand l.i hth:r:11urc cl le' (lhull>S porno~raph14ucs . On p..:ul même: s'interroger i.ur );.1 rcpcn:u~i:.1on de~
lilms dits d'éduc;itinn l>CXuctlc llUÎ sont de plus ..:n rlus (ln>Jelès sur nol> ècrans. L 'alphHhêll!>alion n. a flUl> que de~ ai.pcct \ p11Ml1f~ cl OU.!> jcunci. llnl
l'accèi. à lllUleS SOrle\ de documents qui pCU\ent C\:Jccrhc:r les fon:e:. qui sommc1lh:nt en eu:\ C'c:~l
puur11uoi je vuudraîs rmuvoir \'oui. livrer ici le!> rèsullJls lort intèresi.ant '> de cette enquête.
Che1 les garçon!> Ici. dé.,iri. sc\ud<. i.e ll1Jntfc!--
1cnt tilt et les c . ..:pèncncci. -1e\ucllci. wnl mull,éei. (lJf le dê!>!t de M: montrer moderne cl êm:.1nc1pè (être Jan!> le \'enl). d"11111ter l"ad1v1tè i.e~uelh: dei. adulu:i.; d':.illirmcr ;igrcssi\'cment leur ma,cu hnitè (hrc:' et de IJ \ irilitc); 1.1":1111icipcr l:i -.al •~IJction sc\udh: en ra1i.on du recul de l':'.tt?C du manage: de confirmer \a \'mhtê en cullcct1on· nanl le:. conquête~ .11nvureusc:.. et de J11m1ner ravcri.ion èf"rOU\èe Jlllltr I" ;1ulrc .!.e\C.
Quant il ux lillc~. leur déiur Je r1n111ni lè sc-1'Uclle ou de l'accepta11on du dèi.ir d'autrui i.'exphquc par les mouvauoni. !.u1vantel>: curiu!>ttè de \•osr comment se comporte l'autre !>C;\C; corn· ment 11 e\t fait. 1.juclle., )uni ~c:. démon:.tratiom èruti4uc:s: parce que d'iiutrcs le font. p:.ir faihlesse physi11uc de\ an1 l'impétueuse agrc:ss1\'1lè du mâle. Jlar crainte de pai..,cr pour 1nseni.ihlc ou lillc à 1dècs rctrogr:tdc,, r>a r :.enl 1mcnt de piLiè p..1ur le ~arçon troublé par le dèsir. compcn~a1ion des g.1lantencs cl des c;1deauA Liu so11p1r:.int. ou désir de i.e compnrtcr comme dei. femmes :iduhclt.
Ll' 'agui.' à l"âmt• Cette hi.le de mutl\ at ion .. ":rait prohahlcrnent
la même s1 l'enquête du l>r. Smith ;Hait ètc Elite en Afrique. 11 foudraît y ajouter la pauvreté cl le i.ous·dêvcloppement en cc qui nous ~·um:crnc. Il me ~cm hie cependant 'Ill 'elle la1:.~e Lie côté la ton.1htc i.c:ntllnentalc qui predominc d;1ns les rc· Jauon<> '>e\uclles chc1 l;i femme. Ouin: le ~cntimc:ni de pitié citè par Smilb, je crub fort que le!. rcl.ilwns. ~c!\ucllc~ del> adolc~ccntc:s portent une charge <tlfocth c trèi. unportilnle. Soit par 1dèah· \Jl1un du parte na ire. 'il.lit par la rechcn.:hc d·u ne cornpcnsat1on à des manques profondèmcnl nHJll>
,,b!tcurcmcnl ressentis. C'est le vu~ue à l'ilme, c'est l'absence de hui dans la vie.
1 out comme l'adulte:. maii. peut-être à un degré plus grand. l'adoJcSçcnt ai.pire ;i i.onir de sa -.uhtude et à comrnuni1.jucr avec autrui. Comme Tllll}cn de commumcat1on, 11 d1spo~c de l:.i parole èchangèe. du dialogue. Il peut avoir recours à la relation scxuellc en tant '' lJU'êlarg1ssemen1 de la gamme de cunna1s!>anccs de l'autre et par \'OÎe de ~·onsè4uencc, de mc1llcurc cunna1i.,ance de !iOÎ 11.
Cur111si1é de cunnai1rc l'autre, de i.urprcndre son cum purtcmcnl érotil)ue. Désir de "tmu,·cr quel-1.ju'u n d'autre en vérité, en ~a vènté. chercher il connJîlrc non seulement à travcrl> ~es mots, mais. au~'' sc.i. ~este), dans ~es rôle~. !>C\ incantation~. .,c~ fantasmes. \.'·c~t-à-d1re l'aimer.,
hus•r:uion chc1 les jt•unc!> lilks La ~cxualitè comme moyen d'cxpn:ssion et de
clllll 11lun1cat1un ;ivec autrui occupe une rlace lrè~ llllportantc dans la \ 'IC de J' 1nd1\ldU Cl tout parll· cuhèrcmen1 dan:. l:s ,je de la femme Del> relathlll!o \CAUcllc:<. ~<1ll!ol.1i!>ante!. ~ont mdbpcn!>able'> il l'équilihrc ~cn11mcntal. intdlc:ctucl et moral Une femme l>e:itucllcmcnt :.at1sl:lite est chaMc et lldèlc. elle ci.t en :iccord a\'~ elle-même comme m·cc lei. :iu1rc~. Hic n'èprou\·e ni agrcssi\'Îlè mal.1d1vc à !'ègard d'autrui. 01 ml11bit111n. for111ei. de Cllmplexc d'1nfèriontè il l'é~ard du ~cxc fort
Il y a de forlcs chances pour qu'une femme qui n'a pas délibérement choisi la chastelé et qui n'est
95
pu~ sexuellement ~:itisf:Jilc i.e montre mstablt:, ac;iriâlre ,,u d'une tendrcll!.e par trop dèrnonstra-11ve à l'égard de: son entourage et nolammcnt de ~es enfants. l:llc aura tendance il couver <.:c~
derniers, à les accaparer uu heu de dicrdicr â les pn.:parer à couper le~ amarre!> familial..:!>. L·insa-11.,faclion !>c.11udlc: trouvera une heurcu .. c: com('ll:ll~alion 11u au ra de~ rérc:rcussiuns nl!faste:. dan!> l'excrc1cc de la prolè:ss1on. se~ rclalions •.111cc sci. cullègucs el Ici. au Ires s..:rnn l plus ou ntoins 1cin1c!c'i par son équ1hbrc d..: femme frulltrée.
L:1 ~e.\ual11é est un ai.pccl important de J'éra· nouisi.cmcnl personnel. Un a~pcct tri:~ important mms Rllll cs.,..:nltcl cummc on aurait tcnd:1m:e à nou\ le fair<: croire aujourd'hui. À une femme 1ngémcur. on a posé la 4uc'>l1on de sa\'111r 4u1 elle était au Juste, un ingénu:u 1 ou une maitresse de 111:11son. Elh: rcpondil CCCI. qui me: parait Ion val.1hlc \.'Omme \iatlquc: pour le:. Jeune:!> dont nous 'ommes re.-.ponsables
"Je ne cro1!> ras 4u'on pu1i.st: vivre d'amour <.culcmcnl. Nous avons le droit à 1uutes les joies de la \'ie, à tous ses bien~. Ma.., tout de même. la chose la plu) cs!.cntic:llc. û mon avis. c'est le pou· voir de crècr. le travail 4u'on :urne, le sentiment d'êlrc utile, nécci.i.airc <•UX homme:."·
Pour u1w ,>durnlion 'il'1'Ul'llt• lih~ratrin•
Une telle éducauon ci.l i.:cllc 1.JUI aide la femme à ne pas porter sa sexualité comme une tare mais
•.
.-(.• 4 ·!t.·
'}
?.
a l'intègrcr pour en faire un élément ~onsidérablc d'une pcrsonnalilé aduhc. c'cst-à-d1r.: autonome et n:spon~ablc. Pour que la lcmmt: ne se !.ente ras coupable d'être femme il faut réduqucr <lan~ un certain c1111te'l:tC et <lan<. une orientation bien prèdse. Il laut notamn11:n1 lui donner k!. même:. chances qu'à l'homme égalité d'aci;èi. à J'éducat1un, égalité d·ac<.·c:. au tra\'ltil rcmunérê. égalité d'cJ\en:cr les rcspuns;1h1 hté:. ruhliqucs. l.a fe111111e n'en ~cra pa~ moins lemme, dh: le ~era d.1van1agc:.
l cs:.anl d'être: " IJ compJgnc doc11t: cl pas~1-vc " qui rch;iu:.sait la pu1~sancc 1k lïwmme d'aulrefoill, elle llev1enllra " la partenaire acl 11•c et responsable" dont rêH:nt ks Jeunes li!en~
d'aujourd'hui Mise hur~ d'une tutelle plusieurs IUI'> ~culaires, Ja femme ne ~·cmanc11)e pai., c·c~t· il·llirc ne prend pa!> tic~ hhcrtés 111c11n!>idérèc:. mais elle :.c comportera t:n ('ll:r\onne rc;,,ponsahlc. 1 'homme cl la sodé te: J11\\ cnl Jldcr la lc:m me: il
1)arvenir à une telle autonnnuc pour 4u·c11c J:.· ... umc i.e~ lihcrté:. san~ en abuser. Î\ qu<111ll l'a\'C· n..:ment de celle lemme nouvelle'! Le~ cchecs cu1· :.anll. 4ue nou:. cnrc1u:.trom. dan~ notre prulessmn 11'eJucat..:ur' peu\c:nl nou~ en faire d11uter. <.:cr· lm ne~ réahlc1' nous la1~:.ent cspêrer un ;I\ enir pa~ 1 rop h.1mu11n ni tror clu1gné de lïnrnge de notre lemme énH111c1pée. L'accè:. à l'éduc;1t1~1n :.colairc Cl la IOÎ\itè de l'école amcncnl gan;on-. cl fille~ ;1 lf<l\aillcr t:ÔlC: à COtC \Uf h::. même~ hune:.. (c compagnllllllagc dans 1..: tr:n·ail est un pu1!.sanl l'acteur tic dèmystificallon. Soutenue par une in· lormatiun 1.;11ne :.ur la cunfunm1lwn ph~s1olllJc!I·
4uc de l'un et l'autre sc\c, clh; !>uprrnncra à coup :.ûr 1'11,!noran\e et la cur1m1té 4u1 l'J\compagncnt cl 4ui 1:on1>l1 tuent une <.lè~ cau:;e~ <le:. c>.pericncc:. ~c \ ucl le~ prècows.
l n appel à la H1lo111t• nior:tk 1 lnc 1nlurm;1l1on saine cl 'cicnt11i4oc ne sullit
pa~. t!IC devra étrc C\llll plèlèc pur Un appel à la \'ulonté morale el j la re:.pun:.at11lih: 4u1 ,11lirerait l'Jllcnllon de:. JCUnc~ 'lur cc: 4ue Mar\ Ora1:.on appelle la " l111m:n~wn sociale:. c·e~Hl·<.l1rc LjOc la :.e\ualllè J!.COltuh: comme tdk dépa~:.c le couple 1111-mème et 1n1érc:.~c le: contexte humain <.l;rn' lc!:jUCI 11 ~·sn:.i:rc et p;1~ wulc:mcnl h: conle\lc unmi:diJI '"
l-aut-11 co11imelln: un acte qui ns4uc d':ipp1:h:r à la vie un 1roi~1i:me i:lrc 4u'on ne pourrait pa~
a.:r.:uc1llir cl èlever dan~ le!\ r.:<rndition~ les meilleures. Faut-il effacer les lra.:es ck .:cl a1.:1e ou h: prèvcmr par li! cc>ntra..:cptù>n '! La .:onlraœptwn est un racleur de libèra11on de la femme en .:c 4u'ellc lui cnlévc. comrrn: le di1 si bien Francine üumas « toute crainte de gro~sei.sc non Ûè!>irèc ,, cl lui «rend dans le domaine sexuel le sentiment 4u'ellc cst la UU!>!>Î comme une pcrsunnc 4ui peut arnir SC!> désirs, ~on plaisir. sel. projets et 4u'aui.:unc 1m:nacc, aui.:unc fatalitè n'est li1 i:omme un p1i:ge de la vie, de l'cspé.:c ». tomb1cn de i:hcfs de services paraly!>és par le!> c.:ongés annuels de maternité et ..:t>mbien de jeu ne~ femme~ à l:.i :;an té dèlahrée !>l'nl d'accord avec: une telle allirmation !
Il serait d·~1illcur!> intérc!>i.anl d'ctudicr la r.:ontrnception dan~ l'r\fri4ue 1r;1ditionncllc où on 1:onsidérai1 lc!> fcmmcs 4ui a..:..:oud1cn1 tous les ans comme des malades à soigncr. On les 1:roya1t proliliques non pas à 1.:ausc des rclati ons sexuelles pend~1111 b période~ de lt!conditc.! (..:c qu'on ignore san:. doute) mais à 1.:au~e d'unr: œnainc prédisp1!· ~•lion p:irl iculièrc qu "il fout soigner pour 4ue l'enfant qui esl au ~ein puisse être sulfü:1mmcnt nourri cl 111ar1:hcr avant d'être sevre en rm~on de l'annonci.: d'une nouvdle (!fO!>sesi.e (sérè mousso).
Ln ccmtr:iception Faut-il pour autant mettre la i;ontraception au
service des jeunes tilles'! Question ridicule, certes, mais que je pose sérieusement à notre asse in blée. Les jeunes tilles n'attendent plus que la contraçeption soit mise à leur disposition; elles en usent et en abusent peut-être dèjà. Cela ne signilie+il pas que nous éducateurs n'avons pas encore réussi à trouver des prnduit!> dc rem placc.:mcnl au mariage précoce et à l'épreuve de la virginité, 4ui tenaient lieu de garde-fous autrefois'! Serionsnous incapables de forgcr la conscience et la volonté de nos jeunes pnur les amener à meure un 1.:ertain ordre dani. leur vie conformément au dicton: "Il faut faire i:haque chose en :.on temps», Ne pourrions-nous pas élablir avec clics un dialogue facile cl ..:onliant <JUI nous pcrmcltrait de répondre à leurs questions. à leurs inqu iétudes et à leur a1tcntc en temps voulu pour êvilcr qu'elle~ ne rechcrchen l dans des relations sexuelles faites en ..:ar.:hettc et donc forcément fru!>lranles pour elles, le réconforL et J'èchangc avec autrui 4uc nous n'aurons pas su leur proi:urcr'?
La longue marche de la femme vers sa libéra-
tion est près du terme. La femme est sur le point de s'accomplir. Françoise Parturier dans sa letlre .1ux hommes a raison d'é1.:rire:
"Incomplète, mutilée, mais autrement que ne le pensait Freud. 1:1 fommc a vécu longtemps dans une ~eulc dimension. celle du coeur. Puis. à la lin du X 1 Xe sii:de, elle a atteint la seconde dimension, celle de l'esprit, el dieu pu vivre fi la fois avec sa tête et son coeur, familialement et S•>cialcment. Enfin. de nos jours, elle vient d'atteindre à l'unité platonic.:icnnc en cllnquéranl le troisiëme élément de la trilogie naturelle de l'être humain, en <tpparen.:c le plus humble. le basventrc, el, par un paradoxe que nulle philosophie n'expliquera jamais, c'est le sexe, en effet, 4ui lui ouvrira les portes de la métaphysique». ( Lcttrc ouverte :1ux hommes).
Une inlt'l!ralion harmonieuse Il nous faut faire en sorte que le sexe, celle
noun:Jlc dimension. ne l>Oit pall un facteur d'<1sservissement, ne soil pas une entrave il l'accomplissement de la personnalitë féminine. L'èdu<:;llion sexudlc ûoit réunir les conditions favorables à l'ëmancipalion et à la libération de la fommc en l'aidant à intègrer harnwnicusement tuus le!> éléments d'une personnalité mûre el èquilibrée.
Noui. sommes réunis pour chercher ensemble comment, où, 4uand et 4ui doit faire i:cne èdur.:atwn lihèratrice.
l'una1111t• ul!t1111 au mu relit~ I C'a111ému111
')7
• notions d'éducation sexuelle Gaston Gauthier, Coordinateur des Sciences Familiales, Commission des écoles Catholiques de Montréal, Québec, Canada
Pour amorcer une réflexion sur la pédagogie de l'éducation sexuelle, on sent le besoin de tenter de clarifier le concept même. Car il est évident que plusieurs définitions de l'éducation sexuelle sont possibles, tout comme il existe plusieurs définitions de la pédagogie ou de l'éducation selon les écoles de pensée et selon les milieux. Nous présenterons comme point de départ à notre réflexion les trois points suivants: l'actualité de l'éducation sexuelle, l'éducation sexuelle parentale, et l'éducation sexuelle scolaire.
L'ACTUALITÉ DE L'ÉDUCATION SEXUELLE
Dans un certain sens, l'éducation sexuelle n'est · pas un phénomène nouveau. C'est à dire que l'homme n'a certes pas attendu l'avènement des mots «éducation sexuelle» pour la pratiquer, c'est à dire pour parler de sexualité, des rapports hommes-femmes ou pour s'instruire sur les modalités de la reproduction' humaine. En ce sens l'éducation sexuelle peut être considérée comme aussi ancienne que l'homme lui-même.
Par ailleurs, divers facteurs sont apparus et ont contribué à donner à l'éducation sexuelle une actualité nouvelle et même à la constituer comme une entité propre. Mentionnons certains de ces facteurs.
La technologie: Il semble bien que l'avènement des méthodes ou produits anti-conceptionnels qui rendent l'homme davantage maître de sa propre reproduction, fasse quelque peu reculer les craintes qu'il avait face à sa sexualité. D'autre part, comme beaucoup de ces produits sont d'usage féminin, on peut bien penser que le statut et le rôle de la femme peuvent en être changés considérablement. Car alors la femme acquiert le pouvoir direct de contrôler la transmission de la vie. D'où un intérêt nouveau pour les questions concernant la reproduction humaine.
98
La surpopulation: Une prise de conscience se fait des limites du nombre d'hommes que la terre peut nourrir et éduquer. En conséquence il devient insatisfaisant de donner à la sexualité humaine un sens exclusivement procréatif. D'autres significations doivent être trouvées pour exprimer le sens de la sexualité humaine, d'autres définitions doivent être fournies. D'où pour les collectivités, la nécessité de nouvelles réflexions, de révision des concepts établis et d'éducation.
Les échanges inter-culturels: La plus grande facilité qu'ont maintenant les peuples de communiquer entre eux entra1Î1e que par exemple les rôles sexuels, les rôles de l'homme et les rôles de la femme sont pour ainsi dire confrontés et comparés d'une société à une autre. Ce qui implique ou entraîne des révisions et appelle de nouveaux efforts d'éducation.
Les idéologies considérant la îemme comme égale de l'homme. Les sociétés qui sont touchées par des idéologies présentant la femme comme égale de l'homme: Les sociétés qui sont touchées voir leurs conceptions des rôles sexuels. Par exemple, les pays influencés par le mouvement pour l'émancipation de la femme vont constater assez vite que le mythe de la passivité sexuelle de la femme est de plus en plus vide de sens. Il leur faudra alors trouver de nouveaux termes pour parler de la sexualité féminine.
Les progrès des sciences humaines: La« science officielle » a répété longtemps qu'il y avait une dichotomie entre l'âme, partie noble de l'homme, et le corps partie moins noble; que dans le corps humain, les organes génitaux étaient moins nobles que les autres organes. Ces affirmations et d'autres semblables ne tiennent plus devant la psychologie et la sexologie modernes. L'éducation sexuelle peut apporter ici un certain nombre de correctifs importants.
Les cinq facteurs mentionnés n'expliquent sans
doute pas totalement l'actualité de l'éducation sexuelle; ils suffisent pourtant à montrer comment un certain nombre de questions et de problèmes sexuels appellent maintenant de nouvelles interrogations et de nouveaux essais de réponse.
Ajoutons que ces interrogations comme ces essais de réponse, appartiennent à chaque société et plus particulièrement aux écoles et aux parents.
L'ÉDUCATION SEXUELLE PARENTALE Le rôle ou la part des parents dans l'éducation
sexuelle est souvent proclamé et même souvent revendiqué comme un rôle exclusif. Attardonsnous donc un peu à cette fonction parentale.
Depuis que Freud a fait redécouvrir l'importance des toutes premières années de la vie de l'enfant sur la formation de sa personnalité et depuis qu'il a révélé l'existence d'une sexualité infantile tout aussi précoce, l'importance du rôle des parents dans la formation de la personnalité et de la sexualité de l'enfant est devenue évidente pour tous ceux qui étudient ces questions. Mais il convient quand même de l'affirmer encore. Car dans l'éducation sexuelle des enfants, les parents ont un rôle décisif, unique et irremplaçable. Ce rôle est décisif parce que son influence se fait sentir dès les toutes premières années de la vie de l'enfant et la marque ainsi profondément pour l'avenir. Une fois ainsi clairement reconnu l'apport des parents, il faut quand même le voir de façon plus concrète. Dans la pratique et dans la vie il est bien clair que certains parents faussent l'éducation sexuelle de leur enfant. Par exemple il y a des parents qui transmettent parfois sans trop le savoir le dégoût de la sexualité. Aussi ne faut-il pas voir ce rôle des parents de façon trop idéalisée.
Souvent les parents situent l'éducation sexuelle au niveau de la communication verbale avec leur enfant et ils demandent: Comment devons-nous répondre à telle ou telle question de l'enfant concernant le sexe? Beaucoup de parents avouent a voir de la difficulté à répondre à de telles questions et encore plus nombreux sont ceux qui pratiquent la politique du silence. Ce silence est trop répandu pour qu'on ne s'y arrête pas.
Il semble en effet qu'une des caractéristiques importantes de l'apprentissage verbal de la sexualité par l'enfant soit la non-appellation
(en anglais: non-labeling) ou, si l'on veut, l'absence de mots ou un non-langage.
Alors que, pour désigner les autres réalités qui l'entourent, l'enfant est progressivement muni de termes toujours plus différenciés, (exemple du feu: l'enfant apprend que c'est chaud, que ça brûle, que le poële est tantôt chaud et tantôt pas chaud), pour la sexualité, la plupart des enfants sont laissés dans la non-désignation, la nonappellation ou à des appellations toutes primaires et souvent négatives. On peut imaginer quelques conséquences de cette situation de nonappellation.
La première conséquence est l'incapacité infantile de concevoir ses parents comme des êtres sexués. La seconde est que le silence est comblé par les mots et les termes (et les attitudes) émanant d'autres apprentissages et désignant d'autres réalités. En d'autres termes, le vide est rempli. Ainsi, si dans une société donnée, on y contrôle davantage l'expression de l'agressivité chez les filles que chez les garçons, ce contrôle de l'agressivité va pour ainsi dire« déborder» sur les comportements sexuels et dans ce milieu, les fillettes apprendront toutes jeunes à être sexuellement passives.
La troisième conséquence: incapable de nommer ou d'exprimer son corps en tant que sexué, l'enfant va tenter de l'exprimer en phantasme. Ainsi on aura la production du phantasme montrant la femme comme un homme castré, ou celui qui dit que chez la femme, le pénis est caché sous les poils pubiens. La quatrième est que le silence contribue au mystère et pour l'enfant le sexe devient d'autant plus intéressant. On peut donc penser que ce silence va contribuer aux jeux sexuels, le jeu étant le mode d'expression privilégié de l'enfant.
Quand le silence est d'or Toutes ces conséquences pourront sans doute
apparaître comme fâcheuses et pourtant, il n'est pas interdit de croire que dans beaucoup de cas, ce silence est préférable à des paroles qui seraient trop empreintes de négativisme ou d'anxiété. C'est le cas de dire que pour beaucoup de parents trop anxieux ou ayant une vue trop négative de la sexualité, le silence est d'or. Reste à expliquer ce silence chez la majorité des parents. Avançons donc une hypothèse d'explication.
99
Tout se passe comme s'il y avait une sorte de barrière ou de voile entre la sexualité de l'enfant et celle des parents. Si cette barrière existe, il en résulte naturellement que des parents trouvent difficile de «parler» de sexualité avec Jeurs enfants. Or, une telle barrière existe de fait et dans Je langage technique, on l'appelle l'interdit de l'inceste; c'est-à-dire l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec des parents. Cette interdiction se retrouve chez à peu près tous les peuples de la terre. À notre avis, c'est l'existence de cette barrière qui explique Je mieux et Je plus en profondeur pourquoi il est difficile pour des parents de parler de sexualité avec Jeurs enfants. En d'autres termes, si les parents ne parlent pas de sexualité avec Jeurs enfants, ou bien s'ils trouvent difficile de Je faire, cela s'explique par une sorte de conséquence ou d'effet de l'interdit de l'inceste. C'est là une hypothèse d'explication qui nous apparaît intéressante pour expliquer un silence presqu'universel.
Ceci dit, on comprend mieux, semble-t-il, les difficultés des parents et, ce qui importe davantage, ceux-ci comprennent mieux Jeurs propres difficultés. Mais on ne doit pas en conclure pour autant que les parents n'ont rien à y faire et qu'ils ne doivent pas répondre aux questions de l'enfant. Venons-en donc à ces fameuses questions. Comment y répondre?
La question dicte la réponse De façon générale, disons que la réponse de la
mère ou du père doit se construire à partir de la question de l'enfant. C'est un truisme de Je dire, mais c'est la question de l'enfant qui dicte la réponse à fournir. On lui dit ce qu'il veut savoir. On s'applique à lui répondre de façon simple, c'est-àdire avec des mots qu'il peut comprendre; de façon exacte, car il ne faut pas transmettre de faussetés à l'enfant; et de façon progressive; il est impossible de donner un cours intégral de sexologie ou d'anatomie à l'occasion d'une seule question de l'enfant. Notre réponse à l'enfant est à construire au fil des jours et des années.
Mais on peut souhaiter bien mieux encore. Nous avons dit que c'est la question de l'enfant qui dicte la réponse. Ne vaudrait-il pas mieux de dire que plus que la question de l'enfant, c'est l'enfant lui-même qui nous dicte la réponse. Quand par exemple un enfant demande explicite-
100
ment« d'où viennent les bébés?», Je parent attentif ne peut-il pas parfois déceler une autre question implicite comme par exemple: Moi, maman d'où je viens? Pourquoi ce parent ne répondrait-il pas à ce genre de question en tenant compte aussi d'un psychisme et de la personnalité de l'enfant?
L'éducation sexuelle de l'enfant n'est pas seulement une affaire de questions-réponses. Elle ne se fait pas seulement par les mots et les paroles. Si bien qu'on pourrait dire que les parents qui ne parlent jamais de sexualité avec Jeurs enfants font quand même et de façon très profonde et très importante une éducation sexuelle. D'ailleurs on peut dire qu'avant même que l'enfant ne soit capable de parler ou de poser des questions, son éducation sexuelle est déjà commencée!
Pourquoi? Parce qu'en plus d'être un ensemble de réponses faites aux questions de l'enfant, en plus d'être un ensemble d'informations qu'on lui transmet, l'éducation sexuelle résulte d'une sorte d'apprentissage muet. Par cet apprentissage, l'enfant acquiert des attitudes face à sa sexualité propre, comme face à l'autre sexe; il apprend les rôles de garçon ou de fille que la société lui trace, et peut être plus profondément encore, il se fabrique sa propre identité sexuelle. Mais qu'en est-il au juste de cette identité sexuelle et comment les parents contribuent-ils à la formation de cette identité chez l'enfant?
Chacun de nous à un moment ou à l'autre, de façon explicite ou non, se pose les questions suivantes ou d'autres semblables: Suis-je vraiment féminine? Suis-je vraiment viril? Jusqu'à quel point suis-je masculin ou féminine? Comment les autres me voient-ils comme femme ou comme homme? Suis-je aussi masculin ou féminine que les autres? Pour les enfants, des questions semblables se posent très tôt dans leur vie: Suis-je un vrai garçon ou bien suis-je une vraie fille? Or les réponses que l'individu fournit à ces questions quand il est enfant, adolescent ou adulte, l'amènent à se voir ou percevoir d'une certaine façon, Je conduisent à se fabriquer à ses propres yeux une certaine image de lui-même, c'est cette manière de voir soi-même, c'est cette image de soi qui constitue l'identité sexuelle d'un individu.
À noter que chacun souhaite ardemment être pleinement masculin ou féminin. Semblablement les jeunes garçons et les fillettes veulent se percevoir comme des vrais garçons et de vraies fil-
Lo q11t'lf11Jll dt' /'e11/a111 dtcu lu r 1;11111t\I' li /1111r111r; u'/lt' répmue t'.I/ ci c1111.Hriuri• au .fi/ dt•\ J<1ltrt ,., dt•.1 tlllll;,.,
h:s - cumrne r1nd11iucn1 leur\ rêa1:t111n:-. prc:.quc tOUJ'>Uts :is:-.c1 1·1~es 4uand des petits ~an.;un~ se lom tr:111er de" lillcllc ••ou que de!> lillci. .,·cnien· t.lenl appeler " ~arçon!> "
Mal!> celte identité sexuelle: ne se bâtit que prù· grei.s11ement i:hez. l'cnfan1 Elle n:~ultc d'un ap· prentii.~ugc i:onlin u et le~ parent~ y con1rihuen1 pour une lrês large rrnrl parce 4 ue les parents sont rour rcnl ant les premier~ modi:le!> de mas.:ulinilè et de fè1111mh!. C'e-l>l dans ~c' relation~ de tou~ les jour~ avec i:c~ premu:r:. modèh.-:.. c·e~t dan~ :;es
rèa..:t111ni. â ces mémes modèles, c'est a p;;irt1r des allitutlc~ de ses parents, vis·a·vis de l'enfant. que ..:ch1ki lli.se cl cono;1rui1 son idcnltlc! sexuelle.
1 >c~ ctudes ont montrè quelle !>Ottc de rarents a1d;11cnl le mieux leur!'> cnfanb dan:. l·ette con!>-1ru1,:l1on de leur 1dcn111è. On i.a11 par exemple qu'un garçon dont le père ùiccupe de lui cl qui puo;loède une certaine influence au foyer comme a l'c\lèrteur. qui cM oillachant et démahlc. et jouir de fe~lllllC de~ autres, on ~ail que t:C ~ar.;on va davant:lt!-C 11nitcr son (lCrc d sïdcnt1her a1•ec lu1
1111
et par conséquent va se construire plus facilement son identité sexuelle de garçon. Et semblablement pour la fille dont la mère possède ces mêmes traits. Donc les parents, le père et la mère contribuent à la formation de l'identité sexuelle à la mesure même de leurs qualités propres et à la mesure de leur influence ou de leurs «poids» dans la vie de l'enfant.
Ils y contribuent aussi comme couple. Une recherche a en effet révélé que plus l'enfant a une idée positive du mariage, plus son développement psycho-sexuel s'en trouve accéléré. Or, c'est d'abord et surtout les relations inter-personnelles que ses propres parents ont entre eux comme époux qui fournissent à l'enfant ses idées positives ou négatives concernant le mariage.
Il reste que d'autres facteurs que les parents contribuent à l'éducation sexuelle de l'enfant. Parmi ces facteurs examinons l'école ou le système scolaire et leur contribution à l'éducation sexuelle.
L'ÉDUCATION SEXUELLE SCOLAIRE Concernant l'éducation sexuelle faite par
l'école, notre réflexion progresserait si nous tentions de répondre à certaines questions. La première est: L'école influe-t-elle sur le développement psycho-sexuel de l'enfant?
Il nous semble bien que l'école, par sa philosophie, ses structures et même ses modes d'organisation, influence le développement.
Alignons certains exemples faisant ressortir cette influence scolaire: l'école décide de la mixité ou de la non-mixité des classes, et confie certaines classes à des professeurs féminins ou masculins. L'école en créant des classes crée des groupes d'enfants, or on sait l'importance des groupes de paires dans l'éducation sexuelle. Par ses critères de sélection des professeurs elle choisit pour ses enfants des modèles d'identification; elle influence quand elle garde silence, parce que son silence dit à l'enfant que le sexe est innommable.
Quelles raisons l'école peut-elle avoir de vouloir s'engager dans l'éducation sexuelle? Une réponse souvent entendue est, «parce que les parents ne le font pas, l'école doit agir». Cet argument appelle l'école à un rôle de suppléance. En fait pour beaucoup d'enfants, cette suppléance pourra s'avérer utile. Il reste toutefois qu'un tel
102
argument suggère davantage une action orientée vers les parents eux-mêmes pour qu'ils prennent leur responsabilité.
Une autre raison postulant l'intervention de l'école, c'est que celle-ci doit promouvoir l'épanouissement de toute la personnalité de l'enfant et que la sexualité est une composante importante de cette personnalité. Naturellement ce point de vue postule que l'école détient un rôle plus large que simplement informatif ou un simple rôle d'instruire l'enfant.
Enfin une troisième raison pour laquelle l'école devrait intervenir, c'est que l'école en tant qu'institution sociale et communautaire et en tant que milieu de vie doit contribuer à l'établissement d'un certain langage sexuel commun à une société et à la recherche d'attitudes communes face à la sexualité.
Enfin, notons que certains souhaitent que l'école intervienne en ce domaine pour alléger certains maux sociaux, p. ex. combattre les maladies vénériennes ou réduire le nombre des filles mères.
Selon quelles modalités l'école va-t-elle s'engager dans l'éducation sexuelle? Disons que l'école pourrait intervenir seulement à l'occasion ou à partir d'un programme qu'elle se serait donné. Pour notre part nous croyons qu'il y avait avantage à nous munir d'un programme.
Conclusion Nous aimerions souligner ce~·tains points. L'é
ducation sexuelle nous apparaît comme tout ce qui contribue à l'épanouissement de la personnalité en tant que celle-ci est sexuée. C'est dire qu'elle n'est pas seulement une éducation de la génitalité, mais aussi des autres dimensions sexuées de la personne.
Ses buts à long terme sont d'aider l'enfant à devenir un adulte plus capable de relations hétérosexuelles adéquates et plus apte à devenir un bon époux ou une bonne épouse. Et de façon plus rappochée elle doit viser à éclairer et développer l'enfant dans la conquête de son identité sexuelle, dans la recherche d'une meilleure perception de ses rôles sexuels; lui fournir les informations qu'il recherche, l'aider dans le développement de ses attitudes.
Contribuer à l'éducation sexuelle c'est, selon nous, une façon de contribuer à la promotion de l'homme.
l'éducateur de la sexualité Gaston Gauthier
Les meilleurs projets d'éducation sexuelle risquent d'avorter si une attention particulière n'est pas apportée à l'éducateur de la sexualité, à celui ou celle qui va être appelé à remplir des tâches d'information et d'animateur de groupes de jeunes ou d'adultes ou encore des fonctions de conception et de planification de ces tâches.
On aura compris que pour le moment nous laissons de côté l'éducation sexuelle faite par les parents, pour concentrer ici notre attention sur l'éducateur agissant auprès de groupes de jeunes ou d'adultes. À propos de cet éducateur de la sexualité nous nous poserons un certain nombre de questions.
L'intervention du ~~non-parent» Quels sont les fondements de l'intervention
d'un non-parent dans l'éducation sexuelle? Qu'est-ce qui le légitime à intervenir dans ce domaine'1
Disons que selon nous, il ne faut pas fonder ou légitimer cette intervention seulement sur les carences parentales. Certes, dans beaucoup de cas, l'éducateur peut assumer et assumera de fait des rôles de suppléance pour compenser l'insuffisance des parents.
Il nous semble que ce qui fonde l'intervention de l'éducateur de la sexualité, c'est l'émergence d'une sorte de nouveau langage social concernant la sexualité. Les diverses sociétés ont toujours parlé de la sexualité d'une façon ou d'une autre dans leurs traditions, leurs folklores ou dans les autres modes d'expression de leurs cultures.
Or il arrive qu'avec l'évolution, de nouveaux agents d'intervention sociale apparaissent, des réseaux d'écoles sont constitués et se développent, des services de santé publique ou d'autres services sociaux sont créés. Ces deux nouveaux agents d'intervention se trouvent confrontés à des
problèmes, par exemple maladies venenennes, tilles-mères, planning familial, qui appellent des efforts préventifs ou éducatifs auprès de la population. Ces nouveaux agents sentent que sur ces problèmes et sur d'autres semblables, leur perception de la réalité ou les connaissances qu'ils ont acquises au sujet de la sexualité seraient utiles ou nécessaires au mieux-être de leur milieu; cette perception ou ces connaissances ne sont ou ne seront pas véhiculées par les agents traditionnels d'intervention.
Ils savent d'autre part que dans toute société, il y a une sorte de langage ou de non-langage social concernant la sexualité, que la sexualité ne s'exprime pas seulement chez l'individu ou dans la vie familiale mais qu'elle a pour ainsi dire une expression collective qui s'incarne par exemple dans les rôles sexuels, dans les attitudes collectives envers la femme ou envers l'homme. Selon nous, c'est l'existence même de ce langage collectif sur la sexualité qui fonde l'intervention de l'éducateur de la sexualité.
Celui-ci devient un agent d'intervention quand il estime pouvoir apporter une contribution de nature à améliorer le langage collectif sur la sexualité.
Qui sont ces éducateurs? Quand on examine les professions ou les em
plois exercés par ceux qui entreprennent des actions d'éducation sexuelle dans leur milieu, on constate ce que sont des médecins, des infirmières, des enseignants, des gens formés aux sciences sociales ou encore des gens qui se sont donnés une formation en militant dans des organismes spécialisés comme par exemple des organismes de planing familial ou dans d'autres organismes familiaux ou enfin des pasteurs, prêtres ou professeurs de religion.
103
Si d'autre part on examine le genre de formation les préparant à faire de l'éducation sexuelle, on est conduit à faire certaines distinctions.
D'abord, entre ce qu'on pourrait appeler une formation générale, à savoir des études comme infirmière ou comme enseignant qui ne sont pas des apprentissages portant explicitement sur des questions pertinentes à l'éducation sexuelle. Reconnaissons pourtant l'importance et l'énorme apport de cette formation à l'éducation sexuelle.
Ensuite, il y a des genres de formation plus explicites ou plus spécifiques à l'éducation sexuelle ou à tout le moins à des questions pertinentes à la sexualité. Ajoutons qu'il y a diverses sortes de formations spécifiques, soit l'auto-formation, la formation de perfectionnement ou de recyclage, et la formation académique.
L'auto-formation L'histoire de l'éducation sexuelle révèle qu'il y
a toujours eu dans les divers milieux une période qu'on peut appeler l'« ère des pionniers». Ces pionniers se sont formés par eux-mêmes aux tâches de l'éducation sexuelle. Ils se sont donnés une sorte d'auto-formation. Soulignons l'importance de cette auto-formation pour chacun de nous. Car aujourd'hui les théoriciens de l'éducation des adultes tendent à lui accorder la toute première place parmi les genres de formation. Par exemple,. Allen Tough a montré, à Toronto, comment l'adulte qui n'est inscrit à aucun cours ou à aucune école ou université consacre 200 heures par année à apprendre par lui-même et à se formuler et à réaliser pour lui-même des projets éducatifs. D'autre part, en éducation des adultes, l'unanimité des andragogues (pédagogie des adultes) est pratiquement faite sur l'importance de la motivation à apprendre pour un adulte.
C'est-à-dire que par soi-même, l'éducateur de la sexualité peut beaucoup pour sa propre formation. Naturellement les moyens de cette auto-formation varient d'un individu à un autre et d'un milieu à un autre. Soulignons seulement l'importance d'apporter une auto-critique à nos propres efforts d'éducation sexuelle ou en d'autres termes de pratiquer la méthode d'essais et d'erreurs (trial and error).
L'éducateur de la sexualité tire aussi profit s'il suit certaines activités dont le présent séminaire
104
est un exemple évident, ou certains cours de perfectionnement dans des écoles de formation ou les universités, par exemple les cours de psychologie.
L'éducateur apprend aussi beaucoup s'il a l'opportunité d'appartenir à une équipe ou à un centre intéressé soit aux questions d'éducation sexuelle soit à des questions s'y rattachant.
Formation académique Certaines écoles de formation d'enseignants
comme certaines universités, incluent maintenant des éléments concernant l'éducation sexuelle. Dans des écoles d'infirmière, des facultés de médecine et de formation d'enseignants, l'éducation sexuelle fait partie du curriculum.
De plus, à ma connaissance, parmi les universités francophones, il y a l'université de Louvain (Belgique) qui offre un programme de deux ans concernant la sexualité et l'Université du Québec, à Montréal, qui offre un programme de trois ans. L'idéal serait naturellement que des centres d'études semblables existent aussi ailleurs.
Éducateurs et thérapeutes Quels sont les rapports entre l'éducateur de
la sexualité et les thérapeutes? Trop souvent à notre avis, on formule à cette question des réponses trop inspirées des intérêts professionnels ou autres de chacun, sans parler des réponses émanant de rivalités individuelles.
Selon nous il y a des différences et des ressemblances entre ces deux agents d'intervention. D'abord sur le plan des clientèles. Il est bien évident que la clientèle du thérapeute est différente de celle de l'éducateur. Le thérapeute attire à lui les cas de dysfonctionnement ou de troubles individuels alors que l'éducation sexuelle s'adresse à des gens dits normaux.
D'autre part, au plan des modes d'intervention, des méthodes ou des techniques utilisées, il y a certes des différences mais aussi des ressemblances. Quand par exemple le thérapeute est d'obédience psychanalytique et qu'il travaille au niveau de l'inconscient, son intervention est bien différente de celle de l'éducateur oeuvrant au niveau du conscient.
*Il s'agit de dijjërentes écoles de pensée dans la psychologie nord-américaine.
Mais si le thérapeute a une approche « rodgerienne » et surtout « behavioriste » ou « comportementale»* et s'il travaille auprès des groupes à partir d'une approche fondée sur une théorie de l'apprentissage, et en oeuvrant au plan conscient, et si d'autre part l'éducation sexuelle perçoit sa tâche comme dépassant la simple transmission d'information et devant s'intéresser à une certaine interaction et aussi aux aspects affectifs et sociaux, alors le travail du thérapeute et celui de l'éducateur ont bien des traits communs. Chacun à leur manière, ils touchent au fonctionnement psycho-affectif et psycho-social des gens.
Le rôle des attitudes À ce propos, il est toujours opportun de rappe
ler à des éducateurs de la sexualité l'importance d'être attentifs aux dimensions socio-affectives des thèmes qu'ils abordent. Ainsi on a raison d'attirer l'attention de ces éducateurs sur le rôle joué par leurs attitudes à eux comme sur celui joué par les attitudes des groupes auxquels ils s'adressent quand il est question de sexualité. On a sans doute raison d'écarter des fonctions d'éducateur de la sexualité les personnes manifestant des dysfonctionnements ou des troubles psychiques.
De plus on peut naturellement souhaiter une certaine maturité chez l'éducateur sexuel. Mais va-t-on exiger une maturité optimale de tous ces éducateurs? Va-t-on les obliger tous à se soumettre à des tests de maturité?
Selon notre expérience ces tests ne sont pas requis. Pour notre part, nous considérons qu'une personne d'une maturité moyenne peut devenir un bon éducateur de la sexualité. En d'autres termes, nous disons que si une personne est assez mûre pour être enseignant, infirmière, médecin etc., cette maturité est ordinairement suffisante pour être éducateur de la sexualité. Notre expérience le confirme d'ailleurs: à Montréal nous avons confié l'éducation sexuelle scolaire des enfants aux enseignants que nous avions, (nous les avons aidés à se recycler, il est vrai) et nous n'avons pas d'une façon générale rencontré de ditficultés attribuables à un manque de maturité des enseignants.
Qu'on nous entende bien! Nous ne disons pas n'avoir aucune exigeance quant à la maturité de l'éducateur de la sexualité. Ce serait d'une imprudence et d'une naïveté impardonnables. Ce serait
rassurer faussement les éducateurs. Mais à l'autre extrême, nous n'acceptons pas non plus de poser à ces éducateurs des exigences de maturité tel~ les qu'elles excluent à toutes fins pratiques tous ceux qui normalement devraient s'occuper d'éducation sexuelle. Exiger aucune maturité c'est de la naïveté et de la fausseté, exiger une maturité parfaite, c'est de !'hantise sexuelle ou de l'utopie.
Pour revenir aux rapports entre éducateurs et thérapeutes, résumons en disant que selon nous, leurs démarches se complètent ou devraient se compléter. Nos professeurs aident au dépistage des pathologies qu'ils réfèrent aux thérapeutes. À l'inverse, plusieurs agences de consultation matrimoniale ou services sociaux ont fait appel à nos professeurs d'éducation des adultes pour fournir à leurs clients des activités de formation touchant des questions familiales et sexuelles. Ces agences ou services considéraient l'intervention éducative comme un heureux complément à leurs propres interventions thérapeutiques ou à leur consultations.
Par ailleurs, nous nous félicitons du fait que beaucoup de thérapeutes prêtent leur concours a nos efforts d'éducation, les considérant comme autant d'actions préventives.
Attitude de l'éducateur Quelles attitudes sont requises chez l'éducateur
de la sexualité? Il est fort difficile de répondre à cette question. D'abord parce qu'elle est fort complexe, ensuite parce que les attitudes sont pour une bonne part fonctions des valeurs et des normes d'une société donnée et par conséquent varient d'un milieu à un autre.
On peut toujours dire, et cela est souvent répété, que l'éducateur devrait d'abord et avant tout être conscient de ses propres attitudes, c'està-dire connaître lui-même comment il est prédisposé à réagir face à l'éducation sexuelle et aux autres questions à connotation sexuelle. Comment peut-il y parvenir? Naturellement, l'éducateur pourrait être soumis à certains tests d'attitudes, comme par exemple le SKAT, (Sex Knowledge and Attitude Test). Cela supposerait que des ressources en« testing »soient accessibles à l'éducateur.
Mais comment y parvenir sans cela? À mon avis, un des moyens c'est d'observer ses propres comportements ou réactions face à des questions
105
discutées concernant la sexualité, des questions telles que les relations sexuelles prémaritales, la masturbation, l'homosexualité, etc. Ensuite c'est de comparer ses comportements et ses réactions avec les comportements et les réactions d'autres personnes. Ainsi l'éducateur arrive peu à peu à se situer, à identifier ses attitudes propres. On peut imaginer certains exercices pour aider l'éducateur à découvrir autant ses attitudes propres que celles des gens à qui il adresse ses interventions.
Une question de valeurs Quelle doit être la conduite de l'éducateur de la
sexualité quand il se trouve devant des oppositions de valeurs? D'abord disons qu'il ne nous apparaît pas réaliste en éducation sexuelle de vouloir agir comme en science ou en sexologie où l'on peut et où l'on doit dans certaines recherches ignorer les valeurs ou les normes. En éducation, la neutralité objective est pratiquement souvent impossible.
Or il arrive que l'éducateur puisse se trouver dans l'un ou l'autre des situations suivantes: les groupes où il intervient sont composés de personnes ne partageant pas entre elles les mêmes valeurs; ou bien encore, l'éducateur s'aperçoit que ses valeurs à lui ne sont pas conformes aux valeurs d'une partie ou de la totalité du groupe avec lequel il travaille.
Il nous apparaît que la conduite de l'éducateur pourrait alors s'établir selon les lignes suivantes:
• L'éducateur respecte les personnes possédant des valeurs opposées aux siennes et leur permet de s'exprimer.
• L'éducateur s'applique à ce que les membres de son grau pe se respectent les uns les autres.
• S'il parle des valeurs qu'il ne partage pas luimême, il en parle honnêtement et objectivement.
• S'il doit parler de ses propres valeurs, il évite de se transformer en propagandiste, il se limite à les présenter sobrement en disant comment il les perçoit et pourquoi; il accueille favorablement les opinions contraires aux siennes.
• Il est utile qu'il se rappelle l'adage suivant: «Les valeurs ne s'enseignent pas, mais elles s'apprennent>> - (Values are not taught, they are caught). Cet adage contient une bonne dose de vérité. Car les valeurs se transmettent davantage par des personnes qui en vivent que par ceux qui les professent.
106
Nous sommes bien conscients, reconnaissonsle, qu'en présentant de telles lignes de conduite à l'éducateur, nous sommes nous-mêmes en train de prendre une position relativiste inspirée durelativisme des normes et des valeurs sexuelles. D'autre part, nous admettons qu'en partant d'autres perceptions des valeurs, l'éducateur puisse se tracer à lui-même d'autres lignes de conduite.
Les cas pathologiques Comment !'éducateur peut-il parler des cas de
pathologie sexuelle? À ce propos, disons qu'il n'est pas toujours possible d'éviter ces questions se référant à des cas pathologiques. Comment faire alors? Certains conférenciers, professeurs, éducateurs utilisent ce que l'on pourrait appeler une «pédagogie de choc». À des auditeurs déjà horrifiés ou inquiets, ils présentent une surcharge du tableau, v .g. ayant à répondre à une question concernant l'homosexualité, ils disent:« Tous les hommes sont des homosexuels « en puissance >> ou encore, «Il y a un homme sur trois qui est homosexuel à Montréal>>. Ce genre de pédagogie de choc procure des succès oratoires faciles. Mais selon nous, ce n'est pas une pédagogie.
Une autre façon d'agir, c'est d'utiliser ce qu'on pourrait appeler une «pédagogie descriptive». Cela consiste à fournir le plus de détails possibles. Exemple, à un auditoire de garçons, décrire les diverses façons prises par les filles pour se masturber. Autre exemple, si on a à parler d'un cas de fétichisme sexuel,* on énumère, par exemple, une liste détaillée de vêtements utilisés par le fétichiste sexuel, avec leur couleur, comment le fétichiste se les procure, etc .... Ce genre de pédagogie descriptive obtient presque toujours, elle aussi, un «succès>> facile. Mais nous nous demandons «A quoi sert-elle?>>
Une troisième façon de présenter des «cas pathologiques», c'est ce qu'on pourrait appeler
*Il s'agit d"un comportement de nature obsessive qui pousse un individu à tirer un plaisir sexuel de la simple manipulation de certains vêtements: soutien-gorges, slip, etc . .. Ce type de déviation sexuelle semble très rare. voire inexistant, en Afrique tropicale. Il est par contré caractéristique de groupes où existe un refoulement de /'énergie sexuelle. (Note de /'éditeur).
\ 'b (, ,
J '
,
" l.t' pt:rt• t•t lu mht• t 0m11rib1w111 ù lu jormo11w1 dt• l'idt·11111é .1t•.\11t•ll1• ci fo me.111r1• mémt' c/1• lt•11r.1 qmi/111•.1 r•mprt•.1 . •. y
une " pc!dagugie 1'Cient ih~uc et ubJecll\ c ». Par e\cmpk. à llcl> gcn~ traurna11..ës r>Jr un cas Ll'in· çc~tc survenu dans leur m1hcu, un fournil un hun rc\umé de!> opinion~ de: 1-reud uu de quelque au· trc C\pcrt nu chcn;heur A cc prop01', nou1' ne \ou Ion' pa!>, bu:n entendu. ce,-.cr d' appu} cr la pêdagutiie de la sexualité sur lu reehcn.:hc et la 'c1enc..:, m.Jti. il f.iut quand 11\~mc le Iain: en lcnanl compte del> c1n:ons1anccs.
Une 4u;Ur1emc façtin. c'cs1 la pédJgog1c morah~atm.:e. Une de~ caractéri~114ue& du moralisateur - qu'il m: laut pascunlunllre a1cc le moraliste- c'ci.t, pour aini.i dire, qu'il i.autc de~ é1apc1' cl qu'il accule din:t:te1m:n1 une 1 alcur a un comportement pour montrer le défaut ou la ma· lit:c de: i.;c co111portcrne111 1:.xcmph:, un ra1run qui dit à son cmph>}ee "SI vou" ;n1c1 la consc1cm:c profc:~1'10nndlc, M adcmoi:.cllc. 1 ou~ 1'Crt1:1 armée â l'heure: ..:c malin•>. Autre c\cmrlc. !.lire :i un couple qui \'lenl de !>e mancr u S1 1·uus av1e1 le ,.en-. de la nwtcrn11e c:1 de la pa1c:rnHé, \ ' tlU!> \Ous
donncr1c1 un enhm1 tout de suite"• "Si vuu:.
J\ 1cL le ~en' di: la prii:re, rnu~ m: scnc1 pa~ homosexuel"· etc •. Nmurellcmcnl. celle péda-1.wg1e prèscnte les inc~,nvên1c:nll> de -"On s1mrlisme.
Pt:ul-on 1mag1ncr une autre pédagogie plu' ,a. ll'l l'aisanle'? Il me :.cmblc qu'un ruurra11 ùm ap· procher en "c rél~ranl .1uJ1 pr incipe~ su1van1:..
• Situer la path~1lo(t1C dan' un contc,tc humain rlu!. glohal. Par c:>.cm pic, avant de p:1rlcr de td ca~ de fé11ch1~me sexuel, dire le!> autre!> ltmb
de la rcrwonuhtè lk l'homme li!tu.:h1!.le, • :Ve pa~ dramal1l>er. pu1:.que par euJoi·mcmes
t:i:!o ..:a!. sonl dèJii forl chargé~ affcct1vcmcnl cl
èmoti\cmcnt. • Parler de raide. de!o scrvu.:c!. ou trailcrncnts
qui -.unt a-:ccss1blci. à cc'> rcr .. onnci.. (. c que nnu) venons de dire concerna ni la péda·
gog1c de la puthulugic. ~·apphqucr,111 ausi.1, puur une ..:crtainc part, à la présenlataun de cas de dé\l:ll1ons Lies norme!> ~c,.uellc ... et 1 audrnit au!'.si pour une ~orte de pèdagHl.!IC de la dè1•1ance -"C'luelle.
1 ()7
l'enfant «suiet» de l'éducation sexuelle Gaston Gauthier
Si on veut faire de l'éducation sexuelle, il faut bien s'arrêter un peu à penser à l'enfant luimême, «sujet» de cette éducation.
C'est là une évidence, mais qu'il n'est pas inopportun de rappeler. D'abord parce que souvent la tentation « d'adultiser », de concevoir les choses avec des yeux d'adultes apparaît en éducation sexuelle.
Ensuite parce que du moins selon notre conception de la pédagogie, l'enfant est au centre même de tout effort pédagogique s'adressant à des enfants. Puis parce que l'enfant est le principal agent de son éducation sexuelle.
Enfin parce que tout éducateur sexuel se trouve confronté avec les questions suivantes: 1 ° quelle est l'information des jeunes auxquels je m'adresse? 2° quelles sont leurs attitudes en tant qu'être sexués? 3 ° quelles sont leurs attitudes et leurs perceptions de personnes du sexe opposé. Autant de questions nous amenant à désirer une certaine description de l'enfant comme sujet de l'éducation sexuelle.
Notre description suivra les âges de l'enfant avec, d'abord des éléments concernant le développement sexuel de l'enfant de zéro à six ans, ensuite d'autres points concernant le développement sexuel de six à douze ans; et enfin certains éléments concernant l'enfant ou le jeune de douze à dix-huit ans. Mais avant d'entreprendre notre description, nous sentons le besoin de formuler deux remarques préliminaires.
Plusieurs approches Une première remarque préliminaire au sujet
des diverses approches possibles; car il y en a plusieurs.
• L'approche empirico-quantitative: appelée aussi étude statistique, laquelle tire ses données d'échantillons de population et en dégage des
108
pourcentages concernant les divers comportements sexuels. L'exemple le plus connu est naturellement Kinsey.
• L'approche clinique: On pourrait aussi partir d'une approche psychanalitique comme l'a si bien fait le docteur Paul Le Moal dans son livre «Pour une authentique éducation sexuelle» ( 1 ). Nos données proviendraient alors des observations et des interventions auprès de personnes présentant des difficultés de comportements et notre cadre de référence serait la psychanalyse. (À noter que l'approche de Gesell se situe quelque part entre les travaux empirico-quantitatifs et les travaux cliniques; qu'elle s'éloigne davantage de la statistique que de la clinique.
• L'approche développementale: L'approche développementale représentée surtout par Carlfred Broderick étudie les facteurs de développement de l'hétéro-sexualité et présente des étapes de ce développement.
• L'approche où la sexualité infantile apparaît comme le développement d'une relation ou d'une communication.
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette dernière approche parce qu'elle nous apparaît assez intéressante et nous allons pour notre part la privilégier. Toutefois comme les résultats de la recherche en ce domaine sont encore fort rares, comme la synthèse n'est est pas encore faite, et surtout comme l'éducation sexuelle pose un certain nombre de questions auxquelles aucune de ces approches prises exclusivement n'apportent de réponse, notre approche sera aussi quelque peu éclectique et empruntera aux diverses approches.
L'enfant jusqu'à six ans Nous voudrions recommander ici d'être atten
tif au caractère relatif des données que nous al-
Ions fournir ici, parce que les vanat10ns socioculturelles influent enormement sur le developpement soit psycho-sexuel soit socio-sexuel de l'enfant.
L'information sexuelle chez l'enfant de zero à six ans: En ce qui concerne le sexe, il semble bien que dès l'âge de deux ans environ l'enfant sache qu'il y a des filles et qu'il y a des garçons et d'autres toutes premières notions s'y rattachant. Pour sa part C. E. Brown (2) a demontre qu'à l'âge de 3 ans l'enfant est parfaitement capable de dilferencier le sexe masculin et le sexe fominin.
D'autre part, on voit souvent des enfants de trois à cinq ans jouer «au père et à la mère». N'est-ce pas dire qu'ils ont une certaine idee du mariage? De façon plus precise, une recente etude de C. B. Farel! (3) a montre comment chez des enfants de cinq ans, il y avait une connaissance assez precise de certaines conditions d'eligibilite des partenaires dans le mariage. Ces enfants savaient qu'un partenaire pour un mariage eventuel ne devait pas appartenir à la même famille que son futur conjoint, devait être du sexe oppose, et avoir à peu près le même âge.
Mais ce qui importe encore plus c'est que Farrell a montre que dès cet âge la majorite de ces enfants etaient dejà «engages» face à leur propre mariage futur. En effet dejà à cet âge la majorite de ces enfants manifestaient leur intention de se marier eux-mêmes plus tard.
Comme les enfants de ces âges trois à cinq sont des explorateurs infatigables, ils ont leurs questions et leurs réponses à eux sur les phenomènes de la reproduction. Plusieurs exemples assez savoureux nous en sont fournis dans le très beau livre de Kornei Chukovsky (4) psychologue et homme de lettres russe, - en anglais le titre du livre est" From two to five, c'est-à-dire« De deux à cinq ans». En voici quelques exemples:
-«Ma fille de six ans, Tus ka, raconte un père, vit un jour une femme enceinte et elle dit alors en riant:
-«Oh ! quel gros ventre» - Je lui dis alors «Ne rie pas de cette femme,
elle porte un bebe dans son ventre. » - Alors Tuska horrifiee repond " Comment,
elle a mange un bebe? » Ou, - " Dis maman, est-ce que les mères donnent
aussi naissance aux garçons? Mais à quoi servent les
pères alors? »
- "Maman qui m'a mis au monde? Toi? Je le savais parce que si c'etait papa qui m'avait mis au monde, j'aurais eu une moustache.»
- «Si j'avais su que tu etais si desagreable, je ne serais pas ne au monde de toi Maman. »
- «Pourquoi as-tu donne naissance à un papa si desagreable? »
- «Dis, maman, quand je suis nee comment as-tu su que je m'appelais Yurochka? »
- Eric, âge de cinq ans dit ; « Mon père a promis à maman une montre-bracelet si elle donnait naissance à un garçon. Mais s'il me donnait la montre à moi, je lui en ferais une dizaine de bebes. »
Nous avons cite Chukosky parce qu'il nous replace bien dans le monde imaginaire de l'enfant et parce que ces citations de propos en fan tins peuvent utilement nous rappeler que la « logique» et la perception de l'enfant n'est pas celle de l'adulte pour ce qui concerne la sexualite comme pour les autres questions.
Attitudes et perception de soi Les travaux de John Money (5) sur le cas
d'hermaphrodisme montre que dès l'âge de deux ans le rôle sexuel de l'enfant est dejà fortement etabli. Il n'y a pas de doute que la vie quotidienne de l'enfant lui fournit des occasions nombreuses et variees de faire l'apprentissage d'attitudes face à la sexualite. Par exemple les soins de proprete requis, la nudite parentale occasionnelle ou coutumière, les incursions à la salle de bain etc., la grossesse de la mère, d'une tante ou d'une voisine, etc.
Mais soulignons surtout le fait que les parents ont des exigences dilferentes pour les filles et pour les garçons et contribuent puissamment à inculquer, à «imprimer» (imprinting) les attitudes de l'enfant comme être sexue.
Attitudes envers le sexe oppose Cette periode de la vie de l'enfant est aussi de
terminante pour la formation de ses attitudes par rapport au sexe oppose.
Comme premier facteur y contribuant, mentionnons l'identification que l'enfant fait de luimême comme appartenant à son sexe propre et faisant que l'enfant se perçoit et se sent comme un garçon ou une fille. Un autre facteur agissant:
109
les relations de l'enfant avec le parent de sexe opposé. Certaines études sur l'homosexualité semblent indiquer certains défauts dans cette relation avec le parent de sexe opposé, ce parent de futur homosexuel étant alors ou bien trop séduisant, trop punisseur ou bien présentant des troubles affectifs. Selon Broderick l'image du mariage que l'enfant se fait à cet âge serait aussi un autre facteur influant sur la formation de ses attitudes hétérosexuelles.
Mentionnons aussi que vu la plus grande présence de la mère, l'apprentissage du rôle masculin serait alors plus difficile pour le garçon que l'apprentissage du rôle féminin pour la fille. Dans un âge plus avancé, c'est l'apprentissage du rôle féminin qui va devenir plus difficile parce que la société le privilégie moins.
Enfin notons l'influence de la fratrie puisque O. Brim a montré que dans les familles de deux enfants, si l'aîné est une fille, le garçon qui est le benjamin va développer davantage des traits féminins, ceci pour des enfants dont l'aîné a 5 ans.
L'enfant de six à douze ans Très souvent, on présente la période de six à
douze ans de la vie de l'enfant comme une période de latence sexuelle, comme si à cet âge la sexualité de l'enfant était comme mise au repos ou endormie et on explique ce sommeil en disant que l'enfant investit alors davantage dans le processus de socialisation.
Si cette latence existe, il faudrait renoncer pratiquement à l'éducation sexuelle des enfants de ces âges.
Il arrive que de fait certains acquis de l'anthropologie comme certaines données de recherches empiriques viennent sinon ébranler ce concept de latence, du moins le nuancer fortement. Pour le montrer, nous ferons appel aux travaux de Kinsey et Ramsey. Leurs résultats ne sont plus pleinement concordants mais suffisent à notre propos. L'incidence des jeux hétérosexuels, des jeux de « coïts )), de la masturbation, des jeux homosexuels, y est révélée pour les garçons et pour les filles. (Référons-nous aux graphiques de Broderick) (6).
L'information sexuelle possédée par des enfants de six à douze ans est relativement peu connue. Peu ou pas de données de recherches
110
nous ont renseignés à ce sujet. Il semblerait bien toutefois que ces enfants
aient quelque idée des phénomènes de la grossesse et de la naissance. Par exemple, il faut noter le vif intérêt des enfants de six ou sept ans pour tout ce qui concerne les bébés. D'autre part, il semblerait que la majorité d'entre eux n'ait qu'une idée confuse de la relation génitale (du coït), encore que, comme on l'a dit, un certain nombre se livrent à des jeux de coït, que certains autres sont initiés par des adultes ou des plus âgés.
La proportion de ceux qui disent vouloir se marier s'accroît encore durant cette période. Broderick montre qu'à dix ans, 55 à 60% des garçons sont certains qu'ils vont se marier et 80% des filles. À douze ans 65 à 70% des garçons et 90% des filles.
Cet âge étant celui de la croissance, le développement du corps offre le plus grand intérêt aux yeux de l'enfant, y compris le développement des caractères sexuels. Ainsi les enfants de dix et onze ans manifestent un vif intérêt pour les différences sexuelles comme le développement des seins chez les fillettes.
Notons ici qu'une source d'information sexuelle importante pour ces enfants, c'est le groupe de paires ou les amis de leur âge. Diverses études ont montré que les enfants apprenaient beaucoup de leurs amis. Enfin plusieurs exemples peuvent être fournis montrant l'intérêt de ces enfants pour l'information sexuelle.
Perception de soi comme être sexué C'est un fait connu que cet âge est le temps de
la séparation des garçons et des filles: les garçons jouent entre garçons et les filles entre elles. Cet te séparation indique peut-être un certain malaise face à son rôle sexuel propre.
Ce malaise serait plus fortement senti chez les filles. En effet, quand on demande à des enfants de cet âge: préférerais-tu être un garçon ou une fille? La très grande majorité des garçons disent qu'ils préfèrent leur sexe propre, alors qu'une bonne proportion des filles disent qu'elles auraient préféré être un garçon. Cette ambivalence des filles et cette assurance des garçons peuvent être sans doute attribuées aux différences de statut accordées aux hommes et aux femmes dans notre monde.
Tableau I
Catégories selon contenu des réponses Sexe Âge 10-11 ans 12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans
% % % % Romantique Garçons 40 56 71 71
Filles 33 44 59 65 Amitié Garçons 23 24 21 24
Filles 24 34 31 27 Hostilité ou exploitation Garçons 3 1 1 0
Filles 4 2 1 1 Absence de relation Garçons 34 19 7 4
Filles 38 20 9 7 Total (N) Garçons (587) (874) (1444) (808)
Filles (581) (941) ( 1208) (816)
Tableau II
Catégories selon le contenu des réponses Sexe
Romantique Garçons Filles
Amitié Garçons Filles
Hoslilité ou exploitation Garçons Filles
Absence de relation Garçons Filles
Total (N) Garçons Filles
Propos complémentaires Cet âge de six-douze est un âge hétérosexuel,
ce n'est pas seulement l'âge de l'auto-érotisme et des étapes - mal connues il est vrai - sont franchies vers l'hétérosexualité. Le langage, le vocabulaire sexuel est pauvre au dire des enseignants, les mots de la rue sont utilisés. De façon générale, la sexualité de cet âge est moins dramatique, moins conflictuelle, qu'à l'adolescence. Les comportements sexuels sont vécus comme des jeux et souvent comme des jeux de groupes.
L'enfant de douze à dix-sept ans Nous allons nous limiter ici, pour traiter de
l'enfant de douze à dix-sept ans, à un commentaire de l'étude faite par Broderick et Weaver en 1968. Nous privilégions cette étude parce qu'elle
Âge 10-11 ans 12-13 ans 14-15 ans 16-17ans
% % % % 13 25 38 45 11 20 31 33 IO 17 25 28 IO 13 22 26 11 11 8 6 15 11 11 11 66 47 29 21 64 56 36 30
(588) (856) ( 1126) (785) (581) (920) (1164) (757)
correspond davantage à notre cadre de référence qui nous incline à considérer les phénomènes sexuels comme des phénomènes de relations et de communication humaine. Ensuite parce qu'elle nous semble suggestive de certaines possibilités pédagogiques.
Hypothèse Toute situation hétérosexuelle impliquant un
garçon et une fille est interprétée, perçue d'une certaine manière par chacun d'eux et cette interprétation ou cette perception conditionne beaucoup la sorte de communication qui s'ensuit, à savoir le type de message émis et la réception accordée à ce message. Broderick et Weaver s'adressent à 3,550 enfants des écoles de la Pensylvannie et par une sorte de démarche projective
111
leur demandent de réagir librement. (Selon vous que se passe-t-il? Pourquoi?) à quatre images fort simples et selon nous ingénieuses.
Ils compilent les réponses obtenues en procédant à une analyse de contenu. Comme chacune des quatre images présente un garçon et une fille, ils classent les réponses en quatre catégories présentant divers types de rapport ou de relations garçon-fille.
Catégorie 1 - Une relation romantique; 2 - Une relation d'amitié; 3 - Une relation d'hostilité ou d'exploitation; 4 - L'absence de relation entre le garçon et la fille
Le tableau 1 partage les réponses selon ces catégories, le sexe et l'âge des répondants, et ce pour les 2 premières images (statiques). Dans la première image statique, un garçon se tient debout près d'une fille; dans l'autre, le garçon et la fille sont assis l'un près de l'autre.
(Voir tableau I en page précédente groupant les réponses aux deux premières images statiques.)
Ensuite il examine les réponses aux deux images dynamiques ou dans un cas, un garçon court après une fille et dans un autre cas, la fille court après le garçon. Le tableau II en fournit les résultats
Conclusions de cette recherche • Il y a de 10 à 17 ans une sorte d'évolution
continue de la communication entre garçons et filles;
• La communication garçons-filles est de plus en plus perçue comme «hétérosexuelle» c'est-àdire privilégiant de plus en plus le caractère sexué des communiquants;
• la supposée hostilité qu'on prétend souvent devoir exister entre des enfants de ces âges se manifeste très faiblement. Au lieu de parler d'hostilité face à l'autre sexe, mieux vaudrait parler d'incertitude et d'une certaine tension;
• entre garçons et filles une seule différence de perception: les garçons s'avérant plus enclins à fournir des interprétations amoureuses ou romantiques aux images soumises.
Pour le reste, la perception des garçons diffère peu de celle des filles.
Comme derniers commentaires sur cette recherche, mentionnons les points suivants:
112
• Elle nous apparaît une contribution importante pour amorcer l'étude du développement de l'hétérosexualité;
• On souhaiterait qu'elle soit reproduite dans un autre contexte socio-culturel;
• Il serait intéressant de mettre ces résultats en relation avec d'autres études, comme le développement de l'intelligence ou de la personnalité;
• Redisons notre admiration pour cette recherche directe, simple et offrant une graduation progressive selon l'âge
Conclusion générale Rappelons quel était notre propos initial: dé
crire le développement sexuel de l'enfant, sujet de l'éducation sexuelle, ou plus réalistement offrir une description de l'enfant à partir de certains éléments connus avec une relative certitude.
Reconnaissons très simplement que nous avons sélectionné les faits présentés. Nos critères de sélection étaient 1° leur référence au développement sexuel de l'enfant; 2° la vérificabilité de ces faits.
Répétons l'avertissement que nous avons formulé au début concernant les variations socioculturelles et leur importance décisive dans ce développement de l'enfant comme être sexué.
On pourra certes nous reprocher d'avoir négligé certaines écoles de pensées, d'avoir omis de citer telle ou telle recherche. Nous l'accepterons sans sourciller. Mais nous serons satisfaits si seulement nous avons pu contribuer en éducation sexuelle à amorcer une réflexion où les regards de chacun se portent un peu plus vers l'enfant.
Bibliographie (1) Le Moal Paul, Pour une authentique édu
cation sexuelle, Vitte, Lyon, 1968
(2) Brown, D. E., Sex-Rôle Development ln a Changing Culture, Psychological Bulletin, (1958) 55, 232-42
(3) Farell, C. B., A wareness And Attitudes of Pre School Childrens toward Heterosexual Social Relationship (Master's thesis Pensylvania State University, 1966
(4) Chukosky Kornei, From Two to Five, Berkeley, University of California, Press, 1968
(5) Money, John, Hampson J. Gand Hampson J. C., Hermaphroditism: Recommandations
Hetmmuft tif:' fe1me.1 j11J.-.1 arrn·am de' la bro11.1.1t• .rn111 1t111itm.1 tlt• \t'.\tuJ!ilt' 1 our(•111 "" ril/1• dn ri.1111u•1 1·1m1·1111111
<...onccrn1ng A~Mgnmenl ol Scx. Change llf Sc.\ und Psycholog1cal M:.magcmcnt: Bull John l lopldm. Ho~p .• l~S'\, 97: 2114-.IOU
(t>J Brodcrid. <...arlfrcd 8 .. . 'frwal Bt'lumur 1 rmm1g Pre-.·l dofr.1n•111.1 in Jou rn a 1 of Soci a 1
hsuc'>, XXII. no 2, ·\pril 1%b. pp. 6-2:!
( 7) Hrodcn..:k Car li r1.'t.I B., Soc1i1I ltctcrn-
\C\ual Ocvclopmcnl among Negro!> and \\lute. .lournal of M:irriagc and 1-amil), 27, .200-203, 1965.
(!l) Hrndcm:k l arltre<.I B .• and Wcavcr .lc;an, rhe Pcn;cptuul Cuntcxt ol' bO)·girl communication, ~1Jmagc and Fam1I)' Li'·ing JO (41 p. IM-6.2!l, 1%K
11.l
recommandations adoptées par le séminaire
Le premier Séminaire Interafricain sur !'Éducation Sexuelle, tenu à Bamako du 16 au 25 Avril 1973 à l'initiative du Service Quaker et sous le haut patronnage du Ministère de !'Éducation Nationale du Mali,
Considérant, a. Les faits: - la transformation de la vie familiale (relâ
chement des moeurs) - la jeunesse victime de cette transformation
réagit soit en contestant, soit en adoptant des modèles importés; sa réaction a des incidences sur la vie politique, économique et socio-culturelle
- les attitudes souvent négatives et punitives des adultes face aux jeunes.
b. Les causes: - l'agression culturelle qui fait que les valeurs
originelles sont disloquées - l'éclatement de la vie familiale - la négligence de la vie sexuelle consécutive
aux tabous religieux et sociaux. Compte tenu de ce qui précède, Recommande: 1. De situer l'éducation sexuelle dans le con
texte global de l'éducation en général, car sa dignité et la nécessité urgente la placent au même niveau que l'éducation physique et sanitaire, l'éducation civique et morale, l'éducation intellectuelle et scientifique.
2. D'éviter une mauvaise interprétation de l'éducation sexuelle en l'appelant selon le contexte social de chaque pays: éducation familiale; initiation à la vie; préparation à la vie du couple et de la famille.
3. De contrôler sérieusement et, selon la gravité, d'interdire les moyens audio-visuels importés traitant de la sexualité et qui ne sont en réalité qu'une exploitation commerciale éhontée et abusive de l'Afrique.
114
4. De considérer l'éducation sexuelle comme un facteur important du développement de la santé mentale de l'individu et de la société entière.
5. D'intégrer les programmes d'éducation sexuelle dans les programmes de formation des enseignants, des médecins, des prêtres, des pasteurs, des marabouts, des assistants sociaux et asistantes sociales, des parents, des sagesfem mes, des infirmières et infirmiers, des conseillers familiaux, des élèves et des étudiants.
6. De créer et d'animer des foyers de jeunesse, d'organiser les loisirs des jeunes, de prendre des mesures pour le plein emploi, d'aider les jeunes à investir leurs désirs dans une formation professionnelle et dans le service d'autrui.
7. De créer et de favoriser des centres pilotes pour le bien-être et l'équilibre de la famille par la régulation des naissances et la lutte contre la stérilité.
Au terme de ses travaux, les participants du Séminaire recommandent vivement à chaque gouvernement d'organiser un Séminaire national pour mieux cerner les problèmes qui lui sont spécifiques. Ils tiennent également à exprimer leur vive reconnaissance au Gouvernement Malien d'avoir accepté la tenue du séminaire à Bamako.
Liste des Pays participants: Cameroun, Congo, Côte d'ivoire, Dahomey, Gabon, Guinée, Haute Volta, Mali, Sénégal, Tchad, Togo.
*Ces recommandations ont ete acceptées à /'unanimité des participants à /'exception de la troisième phrase des considérants où un délégué aurait préféré le mot « repressives » à la place de «négatives et punitives »
-J -1
I.e Jéminaire dt• Ba111ak11 a .w11/ig11é que lt1 création d't•ntplui.\ pour h>.\ je1t111!s étt1il un élémc•llf .fu11da-1111•111al t'f indispt'nsable de la .wl111iu11 à long fc•mw du prohlh1tt'. En lw111. llm11t• Volta. école> de bruus.~I! : t'll bus. t't'l/lfé' de Jim1w1itm r11rale 1111 Mali
conclusions et discours de clôture Madame Bâ Aminata, Directrice, Lycée de Jeunes Filles, Bamako
Jamais le vieux dicton mandingue qui dit « la parole est malaisée et dangeureuse et le silence négatif et aliéniant »n'a été aussi vrai que dans le domaine précis et délicat qui nous préoccupe aujourd'hui.
La sexualité a toujours été un problème qu'on s'est évertué d'entourer d'un voile pudique et combien fallacieux. Ici comme ailleurs, les structures mentales de l'homme sont restées en retard sur la réalité.
Aussi devons-nous nous réjouir de cette rencontre tant attendue pour aborder, sans complexe et sans restriction morale ou religieuse et pour la première fois, un problème à la fois vieux et cependant revêtant à certains égards une nouveauté pour l'Afrique.
Dans l'Afrique précoloniale, la jeunesse animée d'un même idéal constituait une même classe sociale. Une telle structure corn mandait des rapports sains où le problème de la « sexualité» ne se posait pas en termes conflictuels. Dans le cadre de la communauté villageoise, l'égalité économique de la femme et de l'homme était assurée, même si par ailleurs une structure archaïque conférait à l'homme un rôle dominant. L'éducation de l'enfant ne concernait pas la famille seule, mais la société villageoise entière.
-En tout cas, il est réconfortant de constater que le séminaire a permis d'enregistrer de sérieux progrès dans le sens de la demystification des esprits.
Le problème de l'éducation sexuelle doit être désormais abordé dans une optique globale et réaliste. Nous ne devons plus, au risque de tomber dans le travers de certains pays européens, hésiter de prendre nos responsabilités, et toutes nos responsabilités, pour traiter de front ce problème afin de lui trouver une solution conforme à nos valeurs. Dans un monde où un érotisme de bon marché s'infiltre partout, même par le viol
116
des consciences, particulièrement dans notre société où l'urbanisme offre l'exemple hideux d'un plagiat aliénant, favorisant la promiscuité et la dégradation des moeurs, il ne saurait y avoir de fausse pudeur, ni de place pour un puritanisme à rebours pour ne pas faire prévaloir la nécessité de l'éducation sexuelle: il y va de la vie et de la survie de notre peuple.
Tout effort au niveau de la seule famille serait vain, si à l'école le maître et le professeur n 'assurent pas la continuité de l'éducation familiale et si, dans la vie quotidienne, c'est à dire dans la société en général, les conditions ne sont pas créées pour permettre à l'enfant, à l'adolescent de bénéficier des possibilités réelles d'un épanouissement constant et équilibré.
C'est pourquoi l'éducation sexuelle, comme l'a démontré notre séminaire, doit s'inscrire dans le contexte de notre éducation générale et faire partie intégrante de tout un système collectif d'éducation permettant à l'enfant de s'épanouir et d'échapper au déséquilibre affectif, et à l'angoisse gu lendemain.
L'irruption de certaines civilisations dans nos sociétés a engendré des déséquilibres de toutes natures, facteurs d'acculturation et de déracinements sociologiques. La jeunesse ainsi tiraillée entre des courants culturels souvent contradictoires a perdu de ses vertus initiales.
Des tabous et dogmes religieux ont été institués, qui ont fini par ébranler le contexte naturel dans lequel évoluaient si harmonieusement nos enfants.
Une telle mutation de la structure économique et culturelle de la société africaine a eu comme conséquence directe la dislocation de la grande famille africaine et sa parcellisation en une multitude de cellules sociales et d'entités individuelles, antagonistes. Des systèmes d'éducation d'essence discriminatoire ont contribué à briser l'harmonie
1. ··~--·· . -~.
.,..s- .. 4111....J
·~
~ --• ~
.... "" · ~
·- ... ~ ... -
C"' ,/1!11\ phmo.f reprben1e111 /t• t·u1llrlJ5tr f.'t1lrc> un milœu rurul 1·11corc• rt.futi1·l!mrm coltérn11 t'I C1rdu1111é. t'l 1111 mtlfru 11rhuin s·o111•c•m Jé.wrgtJ11isi-. uu les Jf.'1J11t•:. .1tu11 .w111·t·111 lui.~.,ë,1 à t•1n-mim1·.1
..
existant entre l'homme et la femme, entre le garçon et la jeune fille et, fait plus grave, entre la ville et la campagne.
Ainsi, à partir de la nécessaire mutation de la société qui a entraîné celle de la famille africaine, et sous l'emprise de l'accultaration qui a fait disparaître l'apport de la tradition et de la coutume, l'éducation sexuelle s'est relâchée ou a presque disparu dans les centres urbains. Nos campagnes elles-mêmes ne sont malheureusement pas épargnées.
Telles me paraissent être, dans les généralités, les données de base qui permettent de cerner le problème dans toute son ampleur.
Je formule le souhait que ce premier séminaire interafricain sur l'éducation sexuelle soit suivi d'autres afin que l'Afrique, dans l'unité et la paix, trouve une juste solution à ce problème.
Discours de clôture M. Tiémoko Sangaré, Directeur de Cabinet, Ministère de !'Éducation Nationale
li m'est particulièrement agréable d'adresser à tous ceux qui ont animé ce séminaire nos sincères remerciements et notre profonde gratitude.
Pendant onze jours, vous avez travaillé de façon extrêmement intensive pour couvrir un programme très chargé. Rien, même la chaleur ne vous a empêchés de travailler avec un grand sérieux et d'aborder en toute franchise des problèmes complexes dans le cadre d'une « première» africaine qui, je crois qu'on peut le dire, a été un réel succès, dans la mesure où le but initial du séminaire, celui de créer un dialogue, a été atteint. Permettez-moi de vous en féliciter.
Sans doute, votre rencontre n'est-elle que le point de départ, le premier jalon d'une recherche qui doit et ne peut que continuer. En effet, vos discussions vous ont bien plus révélé la complexité immense du problème auquel vous vous êtes attaqués qu'elles ne vous ont apporté de solutions.
Des solutions d'ailleurs, il est peu vraissemblable qu'on en trouve au niveau de la pédagogie, de l'éducation, tant qu'on ne les a pas trouvées au niveau de la société entière. Dans la mesure où la problématique du comportement sexuel des jeu-
118
nes a ses causes profondes au niveau de l'organisation politique, économique et culturelle de nos pays, ce n'est que dans le cadre d'une restructuration globale de la société qu'une solution au moins temporaire pourra se trouver.
Je dis bien temporaire, car, en fin de compte, le problème se reposera, dans des termes différents, à nos descendants, comme il s'est posé à nousmêmes. Ce qui en fait l'acuité particulière, aujourd'hui, est l'accélération des processus historiques conduisant à des changements sans précédant à tous les niveaux de la société. C'est ce qui rend plus que jamais indispensable le concours de tous: éducateurs, parents et cadres politiques. Pour créer cette chaîne, il faut que les terminologies adaptées, tout en étant nécessairement expressives, ne soient pas répulsives.
Aussi, je voudrais formuler le voeux qui semble d'ailleurs correspondre à vos propres conclusions: que vous trouviez une expression meilleure pour décrire le processus d'initiation à la réalité sexuelle des adolescents. Le professeur Gauthier nous apprend qu'au Québec, on parle d'éducation personnelle et sociale. L'expression souligne la double dimension individuelle et sociale de la sexualité.
De retour chez vous, il va falloir concrétiser ce que vous avez appris ici. Ce ne sera certes pas une tâche facile, étant donné le nombre de préjugés dont s'entoure la question. Néanmoins, il faut espérer que l'échange inter-États qui s'est amorcé ici continuera sous une forme ou une autre (peutêtre, pour commencer, par un simple bulletin de liaison) et vous stimulera dans cette tâche.
Une de vos plus importantes tâches, et une des plus complexes, étant donné la diversité linguistique et culturelle de nos États, sera l'élaboration des outils pédagogiques qui nous permettront de transmettre cette éducation à nos jeunes. Car une fois tranchée la question complexe de l'orientation idéologique de cette éducation, à savoir son orientation éthique, normative, il reste toute une pédagogie à inventer, à créer, tant il est vrai que nous ne pouvons nous permettre d'aggraver l'aliénation culturelle de nos peuples par l'adoption de modèles étrangers. Qui fera cette éducation? Dans quelle langue? A l'aide de quels outils? A partir de quel âge? Autant de questions que vous n'avez pas eu le temps d'approfondir ici mais qu'il vous faudra creuser en rentrant chez vous.
bibliographie générale Etablie par M. Gaston Gauthier
Introduction : Sexualité - Généralités Bastin, Georges, Dictionnaire de la psychologie sexuelle, Dessart, Bruxelles, 1970. Berge, André, La sexualité aujourd'hui, Casterman, 1970, l 72p Brecher, Edward, M. Les sexologues, Laffont, Paris, 1971, 406 p. Duyckaerts, François, La formation du lien sexuel, Dessart, Bruxelles, 1964, 326 p. Ford C. S. et Beach F. A., Le comportement sexuel chez l'homme et l'animal. Laffont, Paris, 1970, 391 p. Freud, Sigmund, La vie sexuelle, Presses U niversitaires de France, Paris, 1970, 160 p. Freud, Sigmund, Trois essais sur la sexualité, Gallimard, Paris, 1923, 190 p. Hesnard, A. La sexologie, Payot, Paris, 1964, 43 l p. Jeannière Abel, Anthropologie sexuelle, AubierMontaigne, Paris, 1964. Malinowski, Bronislaw, La sexualité et sa répression dans les sociétés primitives, Payot, Paris, 1967, 232 p. Morali, Daninos, Dr. André Sociologie des relations sexuelles. Presse Universitaires de France, Paris, 1963, 128 p. Morali, Daninos, Dr. André, tvolution des moeurs sexuel/es. Casterman, Tournai, 1972, 172 p. Schelsky, Helmut, Sociologie de la sexualité, Gallimard, Paris, 1966, 253 p. Van Lier, Henri, L'intention sexuelle, Casterman, Tournai, 1968, 166 p. En collaboration, La sexualité (2 tomes) Marabout, Verviers, 1964. En collaboration, Sexo/ogie-Lexikon, Gonthier, Genève, 1963, 405 p. En collaboration, Sexualité humaine. Centre d'études Laennec, Lethielleux, Paris 1966, 339 p.
Éducation sexuelle - Généralités Arthur André, Les mystères de la vie expliqués aux enfants, Ed. Ouvrières, Paris, 1970, (l volume pour les parents et l volume pour les enfants, 46 et 40 pages). Berge, Dr. André, L'éducation sexuelle chez l'enfant, Presses Universitaires de France, Paris 1968, 161 p. Chambre, Pierre, Les jeunes devant /'éducation sexuelle, Nérel, Paris 1950, 154 p. Charles, Jean, Simple dictionnaire d'éducation sexuelle, Solar, Paris, 1968. Cholette-Pérusse, Françoise, La sexualité expliquée aux enfants, Jour, Montréal, 1965, 159 p. Dallayrac, Nicole, Les jeux sexuels des enfants, Diagnostics Publication Premières, Paris, 1972, 186 p. Le Moal, Dr. Paul, tducation et rééducation sexuelle, en internat, École des Cadres, Waterloo, 1958, Cahiers d'information, 6, 64 p. Le Moal, Dr. Paul, Pour une authentique éducation sexuelle, Vitte, Lyon, 1961, 204 p. Natanson, Jacques J. et Madeleine, Sexualité et tducation, Éditions Ouvrières, Paris, 1968, 236 p. Roland-Michel, Marianne, tducation Sexuelle familiale, Delachaux et Niestle, Neuchatel, 1966, 149 p. Valabrèque, Catherine, L ·éducation sexuelle à /'étranger, Casterman, Tournai, 1972, 151 p. En collaboration, Ma nue/ d'éducation sexuelle, Sudel, Paris ou Delachaux et Niestlé, Neuchatel, 1972, 47 p. En collaboration, L'expérience scandinave, Laffont, Paris, 1971, 290 p. Numéros de revues - L'éducation sexuelle, Revue Préparons !'Avenir, N° 9, avril 1968, Éditions Magnard, Paris. Numéros de revues - L'éducation sexuelle, Re-
119
vue Cahiers pédagogiques, N° 59, février-mars, 1968, Lyon, 119 p.
Éducation sexuelle - Éducation à l'amour Promm, Brich, L'art d'aimer, Épi, Paris, 1968, 157 p. Rougemont Denis de, l'amour et /'Occident, Pion, Paris, 1958, 332 p. Rougement Denis de, Les mythes de /'amour, Gallimard, Paris, 1967, 317 p. Madinier, Gabriel, Conscience et amour, Presses Universitaires de France, Paris, 1962, 127 p. Nygren, Anders, Erôs et Agapè, la notion chrétienne de /'amour et ses transformations, Aubier, Paris, 1962, 3 volumes.
Biologie de l'homme Bouckaert, Jean-Pierre, Comment naissent les hommes: la reproduction, les âges de la vie, Béatrice Nauwelearts, Paris, 1960, 316 p. Brien, Paul, Biologie de la reproduction animale: blastogène, gamétogénèse, sexualisation, Masson, Paris, 1966, 292 p. Houillon, Charles, Sexualité, Hermann, Paris, 1967, 197 p. Kahn, Frederic, Notre vie sexuelle, Albert Muller, Zurich, 1967. Mongeau, Dr. Serges, Cours de sexologie, tome 1, Jour, Montréal, 1967, 117 p.
Biologie féminine Beauvoir, Simone de, Le deuxième sexe, Gallimard, Paris, 1960. Marie, Bonaparte, La sexualité de la femme, Presses Universitaires de France, Paris, 1967, 159 p. Chasseguet-Smirgel, J. et Alie, La sexualité féminine, Payot, Paris, 1964, 313 p. Buytiendijk, F. J. J., La Femme, Desclée de Brouwer, 1954, Bruxelles. Deutsch, Hélène, La psychologie des femmes, Presses Universitaires de France, Paris, 1964, 328 p. Grégoire, Ménie, Le Métier de femme, Pion, Paris, 1965, 315 p. Mead, Margaret, L'un et /'autre sexe, Gonthier, Paris, 1966, 349 p. Mead, Margaret, Moeurs et société en Océanie, Pion, Paris, 1963, 553 p. Piret, Roger, Psychologie différentielle des sexes,
120
Presses Universitaires de France, Paris, 1965, 155 p. Rocheblave-Spenlé, Anne-Marie, Les rôles masculins et féminins, Presses Universitaires de France, Paris, 1964, 346 p.
Les réactions sexuelles Brecher, Ruth et Echward, Analyse du compor-tement sexuel humain, Planète, Paris, 1967, 239 p. Masters William H. et Johnson Virginia B., Les mésententes sexuelles, Latfont, Paris, 1968, 383 p. Ibid., Les réactions sexuelles, Latfont, Paris 1968, 383 p.
Grossesse Carles, Jules, La fécondation, Presses Universitaires de France, Paris, 1960, 128 p. Flanagan, Géraldine L., Les neuf premiers mois de la vie, Laffont, Paris, 1963, 95 p. Gautray, Jean-Pierre, Reproduction humaine: aspects actuels de biologie clinique. Avec collaboration de E. Chambaz, A, Darbel et P. Léger, Masson, Paris, 1968, 596 p. Mongeau, Dr. Serge, Cours de sexologie. tome 3, Jour, Montréal, 1967, 124 p. Rostand, Jean, La formation de l'être: /'histoire des idées sur la génération, Hachette, Paris, 1961, 222 p. Rostand, Jean, l'aventure avant la naissance, Gonthier, Paris, 1953, 153 p. Rostand, Jean, Maternité et biologie, Gallimard, Paris, 1966, 179 p. Voigt K. D. et Schmidt H., Les hormones sexuelles, Latfont, Paris, 1970, 248 p.
Planning familial Baud, Dr. Raymond, Les effets de la pilule, Marabout, Verviers, 1971, 191 p. Colette, Carisse, Planification des naissances en milieu canadien français. Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 1964, 227 p. Carreau, Dr. Suzanne Parenteau, Faire /'amour, faire un enfant? (fécondité et régulation des naissances) Séréna Montréal, 1972, 55 p. Charbonneau, Hubert et Mongeau, Serge, Naissances planifiées, Jour, Montréal, 1966, 160 p. Dalsace Jean et Palmer, Raoul, La contraception, Presses universitaires de France,
Paris, 1967, 216 p. Draper, Elisabeth, Conscience et contrôle des naissances, Laffont, Paris, 1971, 382 p. Gebhard, P. H., Pomeroy, W. B. et Alice, Enquête sur la conception, la naissance et /'avortement, Paris, Laffont, 1971, 363 p. Guerrand, Roger-Henri, La libre maternité, Casterman, Tournai, 1971, 165 p. Havemann, Ernest, La régulation des naissances, Time-Life International, Hollande, 1967, 118 p. Sauvy, Alfred, La prévention des naissances, P.U.F., Paris, 1965, 128 p.
Valeurs et sexualité Alsteens, André, Dialogue et sexualité, Castermann, Tournai, 1969, 352 p. Durand, Guy, Éthique de la rencontre sexuelle, Fides, Montréal, 1971. Oraison, Marc, Le mystère humain de la sexualité, Seuil, Paris, 1966, 160 p. Oraison, Marc, Une morale pour notre temps, Fayard, Paris, 1964, 219 p. En collaboration, La force des rencontres, Homme et Fem"!e, il les créa, Fides, Montréal, 1970, (Documents de catéchèse 80 et 96 p. au cours secondaire).
La masturbation Alsteens, André, La masturbation chez /'adolescent, Desclée de Brouwer, 1967, 229 p. Desjardins, J. Y. et Crépault, C., Le mythe du péché solitaire, Éd. de l'homme, Montréal, 1969, 127 p.
Homosexualité Caprio, Frank, L'homosexualité de la femme, Payot, Paris, 1959, 341 p. Corrozo, Dr. Jacques, Les dimensions de /'homosexualité, Privat, Toulouse, 1968, 252 p. Giese, Dr. Hans, L'homosexualité de l'homme, Payot, Paris, 317 p. Hoffman, Martin, L'univers homosexuel, Laffont, 1971, 254 p. Magee, Bryan, Un sur vingt, Étude de l'homosexualité chez l'homme et la femme, Laffont, Paris, 1967, 275 p. Mongeau, Dr. Serge, Cours de sexologie, tome 5, Jour, Montréal, 1970, 120 p. En collaboration, Homosexualité, Marne, Paris, 1967, 198 p.
Démographie et planning familial Dourlen-Rollier, Anne-Marie, Le planning familial dans le monde, Payot, Paris, 1969, 266 p. Pradervand, Pierre, Introduction aux problèmes de planning familial et de la limitation des naissances dans le Tiers Monde, Éd. Centre de planning familial du Québec, Montréal, 1971, 366 p.
Éducation sexuelle - Niveau élémentaire Andry A. C. et Schepp. S., Comment naissent les enfants, Time-Life, Laffont, 1969. Delarge, Bernadette, La vie et /'amour (enfants de 3 à 8 ans) Éditions Universitaires, Paris, 1969, (ensemble de fiches). Delarge, Bernadette, L'éducation sexuelle de nos filles .à partir de 8 ans, Éditions Universitaires, Paris, 69 p. Delarge, Bernadette, L'éducation sexuelle de nos fils à partir de 8 ans, Éditions Universitaires, Paris, 1968, 63 p. Delarge, Bernadette, La vie et /'amour, Éditions Universitaires, Paris, 1968, (filles de 8 à 13 ans), 143 p. Delarge, Bernadette, La vie et /'amour, Éditions Universitaires, Paris, 1968, (garçons de 8 à 13 ans) 143 p. Gendron, Dr. Lionel, La merveilleuse histoire de la naissance, Éditions de l'homme, Montréal, 1969, 95 p. Lobe Mira et Veigel Susi, Je voudrais un petit frère, Hatier. Monchaux, Marie-Claude, La vérité sur les bébés, Magnard, Paris, 1968, 88 p. Power, Jules, Ainsi, commence la vie, Laffont, Paris, 1968, 95 p.
Éducation sexuelle - Secondaire Bell, Robert R., Rapport sur la sexualité préconjugale, Laffont, Paris, 1971, 382 p. Chesser, Eustace, Les relations sexuelles des 15/20 ans, Marabout, Verviers, 1969, 165 p. Pomeroy, Wardell, B., Les garçons et le sexe, Buchet-Chatel, Paris, 1971, 178 p. Pomeroy, Wardell, B., Les filles et le sexe, Buchet-Chatel, Paris, 1970, 184 p. Thibault, Colette, À la découverte de la sexualité, Dunod, Paris, 1971, 175 p.
• • •
121
liste des participants au séminaire interafricain sur l'éducation sexuelle
CAMEROUN Mr. Jean Banyolak, Conseiller Conjugal, Douala-Deido. Mme. Alvine Ekotto, Inspectrice de !'Enseignement Primaire, déléguée adjointe de !'Éducation, Yaounde. Mme. Minna M'Bappe, Directrice du Lycée de Filles, Douala.
CÔTE D'IVOIRE Mme. Anne Allangba, Sous-Directrice responsable de !'Education Féminine, Ministère de !'Éducation Nationale, Abidjan. M. Coulibaly, Principal du Collège Abdijan II, Abidjan. M. J.-J. Folquet, Chef de Cabinet, Ministère de !'Éducation Nationale, Abidjan.
CONGO Mme. Albertine Mantissa, Directrice CET, Brazzaville. M. Antoine N'Dinga, Directeur Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique, Brazzaville. Dr. Gérard Ondaye, Directeur de !'Hygiène Scolaire, Brazzaville.
DAHOMEY Mr. Aissi, Membre Comité National Dahoméen pour le Planning Familial (CNDPF) Cotonou. Mme. Irène Ako, Professeur Directrice du CNFP, Cotonou. Mr. Alphonse Chabi, Professeur, Porto Novo. Mr. Dehoué, Instituteur, Membre CNDPF, Cotonou. Mme. Michèle Gnonlonfoun, Professeur CET, Cotonou. Mr. Sébastien Idohou, Chef de Cabinet, Porto Novo. Mme. Paulette Viakinnou, Sage-femme, Porto Novo.
HAUTE VOLTA Mme. Habibou Bilga, Institutrice, Membre de !'Association des Femmes Voltaïques, Ouagadougou. Mme. Jacqueline Ki-Zerbo, Directrice du Cours Secondaire de Jeune Filles, Ouagadougou. Mme. Mariam Nacoulma, Aide-Sociale, Ouagadougou. Mme. Rosalie Sniare, Institutrice, Kaya. Mr. Karim Soma Traore, Instituteur, Kaya. Mme. Jeanne Zongo, Directrice de Lycée, Ouagadougou. R. P. Joseph Roger de Benoist, aumônier de jeunesse, Bobo Dioulasso.
GABON Mme. Joséphine Avomé, Sage-femme, Libreville. Mme. Delphine Yeyet, Responsable de !'Animation, Union des Femmes, Libreville.
122
GUINÉE Mr. Amadou Diare, Ambassade de Guinée, Bamako.
SENEGAL Mme. Sokhna Deme, Sage-femme, Dakar. Mme. Oury Gueye, Institutrice, École d'application de Médina I, Dakar. Mlle. Isaac, Archevêché, Dakar. Mr. Ka Proviseur, Rufisque.
MALI Mr. Abdoulaye Ba, Professeur IPN, Bamako. Mme. Ba, Aminata Diallo, Directrice du Lycée de Jeunes Filles, Bamako. Mr. Hamma Ba, Administrateur Civil, Direction Nationale Affaires Sociales, Bamako. Mr. Seydou Ba, Inspection Générale de la Jeunesse et des Sports, Bamako. Dr. Seydou Diakité, Directeur du Service d'Hygiène et de l' Assainissement du Mali, Bamako. Mme. Salamata Diaye, Directrice, École Niaréla, Bamako. Mme. Ramatoulaye Guissé, Directrice ENTF, Segou. Mr. Bakoroba Soumaré, Proviseur du Lycée Askia Mohamed, Bamako. Mme. Sokona Sy, Directrice de la Maternité, Hôpital Gabriel Toure, Bamako. Mme. Thiam Fanta Diallo, Directrice de !'École de Bozola, Bamako.
TOGO Mme. Eugénie Adekplovie, Assistante Sociale, Direction des Affaires Sociales, Lomé. Mr. Hermann Attignon, Secrétaire Général du Ministère de !'Éducation Nationale, Lomé. Dr. Arthur Creppi, Ancien Chef de la Médecine Scolaire, Lomé. Mr. Komlan Gbati, Proviseur, Lama-Kara (Togo). Mme Clémentine Gbeassor, Directrice École Catholique, Bassadji. Mme. Angèle Quashie, Directrice d'École, Lomé. Mme Antoinette Sedalor, Direction Affaires Sociales, Lomé.
TCHAD Mr. Timothée Ngakoutou, Maître Assistant, Université du Tchad, Fort-Lamy.
OBSERVATEURS M. Pierre Guilbert, Cinéaste, Paris. M. Philippe Lecorps, Psychologue, École Nationale de la Santé Publique, Rennes. Mme. Catherine Valabrèque, Vice-Présidente, Mouvement Français pour le Planning Familial, Paris.
CONFÉRENCIERS ÉTRANGERS M. Roger Brand, Ethnologue, Cotonou, Dahomey, et Evian, France. M. Gaston Gauthier, Éducateur et sexologue, Montréal. Dr. Suzanne Képès, Gynécologue et psychosomatricienne, Paris. M. André Laplante, Ethnologue, CROI (Ottawa) et AMPPF (Bamako).
SERVICE QUAKER, DAKAR (A.F.S.C.) M. Pierre Pradervand. Mme. Marie-Angélique Savané.
123
< IH:'.IHTS \liSl' en fornw rt-dac1ionndh·: \lc\andn: l>or111~ n~k1 P1crrr.: l'r:1dcrv;ind, f\11mc ,.\ngél14uc S:nanè ( ouH·rruu•. d<' .. 'lins. mi'>l' <•n pai:t.>: Sah1nc Ucrl!c.:1-\ aut:oulcur' Photographiei.: P. 4, Bureau lnternatiunal du l r;iva1I (81 T). l icnèvc ; 11. Cl R IC. Gcni:\c. 12, Hl f : 1 {l, 011-cumcntuuon l-rança1w. 1->am. 18. C J R IC . .'.!.?, l>111.:umcnt.it1on lrança1M:. 24. CRDI; 2b, )7, lfoger Brand; .N. Organ1-.almn Muralmlc de la Santé (OMS). Genève. Pierre Pillcl; 44, 5), Roger Brnnd: 57. 5q, Bll : b), <H. li RJC; 65. Cll<IC. M. f h. Calloir. t17, CIRIC. <11>. BIT; 71, UN~SLO, Alma~}·\authc) ~ 73, BI 1. 77, 79, l>11cumental1on l'ram;:.1111c; lif>, l IN l!SCO. de l>cckcr: Xt<, BIT; 90. OMS. J. Mohr. 91, llNl:.SCU. Mure et bel} n Bcrnhc11n. 93 à 91S, UI 1. 10~. OMS, Pierre ftlllct. 108, LIRll. 11 <i en h.iul. UNE.Sn>. Marc et l:.n:lyn Hcrnhcim; cn ha~. IUT; 11 X. 1:n haut, lJ NESCO. J. Il. Blo,,..cr : en ha:.. lJNt:SC:O. P. A Pi1tt:1
hupn-~ion:
Com('lagnic ,n mprimc11c \!o:n:urc
.. fo111ré:il. Canada
1.!4
EDUCATlON SEXUELLE
EN AFRIQUE
TROPICALE