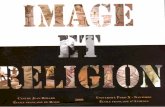La migration comme processus :dynamiques patrimoniales et parcours d'installation des immigrés...
Transcript of La migration comme processus :dynamiques patrimoniales et parcours d'installation des immigrés...
LA MIGRATION COMME PROCESSUS : DYNAMIQUESPATRIMONIALES ET PARCOURS D'INSTALLATION DES IMMIGRÉSDANS L'ITALIE MODERNE (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE) Beatrice Zucca Micheletto Belin | Annales de démographie historique 2012/2 - n° 124pages 43 à 64
ISSN 0066-2062
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2012-2-page-43.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zucca Micheletto Beatrice, « La migration comme processus : dynamiques patrimoniales et parcours d'installation des
immigrés dans l'Italie moderne (Turin au XVIIIe siècle) »,
Annales de démographie historique, 2012/2 n° 124, p. 43-64.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Belin.
© Belin. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
L’historiographie des phénomènesmigratoires et de la mobilité à l’époquemoderne a connu ces dernières annéesun profond renouvellement. La recons-truction de parcours individuels,marqués par des changements fréquentsd’activités ou de lieux de résidence, etleur analyse précise ont permis d’affran-chir la société d’Ancien Régime d’un deses stéréotypes les plus ancrés, celuid’avoir été une société immobile1. Parailleurs, l’accent a été mis de manièrecroissante sur les modalités d’intégrationdes migrants dans le tissu social urbain àtravers la mise en place et/ou la mobilisa-tion de réseaux de diverses natures (fami-liaux, régionaux, professionnels, etc.). L’analyse des réseaux, outil empruntéà l’anthropologie britannique2, a consti-tué un tournant historiographiqueessentiel. L’étude de Philip Mayer(1961) est de ce point de vue très repré-sentative de ce type d’approche, dans samanière d’analyser deux modèles oppo-sés d’installation de populations migran-tes à East London, en Afrique du Sud :celui des «Red », de langue Xhosa etcelui des « Scholars », originaires descampagnes environnantes. Les deuxgroupes construisent de façon anti-nomique leur rapport à la ville : les«Red » fréquentent des compatriotes et
conservent des relations avec leursparents restés à la campagne, limitantvoire rejetant tout contact et lien avecleur milieu d’accueil, au point d’êtredéfinis par Mayer comme « encapsulés »dans leur réseau communautaire ; àl’inverse, les «Scholars » travaillent à élar-gir et diversifier leur réseau, multipliantles efforts pour s’intégrer dans la réalitéurbaine et privilégiant la création desnouveaux liens. Ces modèles – et l’ana-lyse de réseau qui a permis leur démons-tration – ont connu un grand succès etont durablement constitué un cadreprécieux d’étude des migrations, aurisque d’être parfois utilisés de manièrerigide et mécanique. Une large partie des travaux sur lesphénomènes migratoires a concentréson attention sur les seuls efforts d’inté-gration des immigrés à leur nouveaumilieu. La recherche des moyens pours’assurer l’accès aux ressources semble sefaire uniquement par le biais descontacts et des relations nouées avecceux qui habitent déjà en ville ou y sontnés. Les immigrés apparaissent ainsicomme des individus totalementdépouillés des relations matérielles etimmatérielles de leur communauté deprovenance. Cela a par exemple pousséla démographie historique à privilégier
43
ANNALES DE DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE 2012 n° 2 p. 43 à 64
LA MIGRATION COMME PROCESSUS :
DYNAMIQUES PATRIMONIALES ET PARCOURS
D’INSTALLATION DES IMMIGRÉS DANS L’ITALIE
MODERNE (TURIN AU XVIIIe SIÈCLE)
par Beatrice ZUCCA MICHELETTO
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
l’idée que le mariage avec un natif ouune native de la ville d’accueil est a prioriun indice d’intégration urbaine réussieet d’un accès facilité aux ressources (DeVries, 1984).Certains travaux ont toutefois mis envaleur l’importance des rapportscommunautaires et leur statut de filtreentre le migrant et la société urbaine,grâce au contrôle exercé sur certainesniches du marché du travail urbain. Lesindividus arrivent ainsi en ville par lescircuits communautaires, à l’intérieur degroupes de compatriotes avec lesquelssouvent, au début de leur carrière, ilspartagent un toit et un métier. Lescontacts avec le milieu urbain sont doncassurés par la communauté d’origine etles parcours d’installation sont condi-tionnés, selon le schéma des chaînesmigratoires, par l’ensemble des liens etdes ressources déjà expérimentés etconstruits par les compatriotes précé-demment arrivés, tandis que l’échangeavec d’autres milieux reste limité ouabsent3.Des études récentes (Arru, 2003 ; DeClementi, 2003) ont néanmoinscommencé à questionner ce rapportdichotomique entre nouveaux arrivés etmilieu urbain, en montrant que la rela-tion entre espace de provenance etespace d’installation peut s’organiser demanière souple, par la manière dontcertains immigrés savent tirer profit desressources de leur communauté d’ori-gine tout en habitant ailleurs. Les résul-tats de ces recherches ont eu d’impor-tantes conséquences sur la vision desimmigrés : traditionnellement décritscomme des indigents, des mendiants, ouplus largement de pauvres gens pousséspar la misère, les migrants apparaissentde plus en plus comme des individuspourvus de moyens. C’est l’une des
conclusions du livre pionnier de Fortu-nata Piselli (1981), qui explique que lamigration transocéanique du début duXXe siècle a concerné au premier chef desItaliens qui disposaient d’un minimumde moyens pour financer le voyage et lespremiers frais d’installation, ou quiétaient suffisamment crédibles et fiablespour obtenir un prêt. Ces études, quiont le mérite d’attribuer leur juste poidsà l’ensemble des liens et des ressources –ceux maintenus dans la communautéd’origine aussi bien que ceux bâtis dansle nouveau milieu – négligent toutefoisl’aspect fluide de la condition d’immi-gré. Elles prennent peu en compte leseffets du parcours de vie (vieillissement,changement dans la composition duménage, évolution du contexte écono-mique) sur les attentes et les besoins desindividus et des familles migrantes, etnégligent de ce fait les variations que cesévolutions occasionnent dans le recoursaux ressources communautaires et loca-les. En autres termes, il ne suffit pas dedire que les immigrés conservent etparfois tirent profit de biens et de rela-tions dans leur patrie d’origine, il fautaussi éclairer la chronologie de cesusages et la façon dont ils se modifient àmesure que se poursuit et se consolidel’installation dans un nouveau milieu. L’histoire contemporaine, la sociologieet l’anthropologie ont modifié au coursdes trente dernières années l’appréhen-sion de la migration, désormais conçuecomme un processus, un parcours réalisépar étapes et non un événement ponc-tuel. La compréhension des étapes de ceparcours, des difficultés et des succès desnouveaux arrivés, est avant tout lacompréhension d’une dynamique endevenir et de son contexte social, cultu-rel et économique (Gribaudi, 1987 ;Werbner, 1990 ; Ramella, 1998 ; Sayad,
44
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
1999 ; Ceravolo, Eve, Meraviglia, 2001).Dans cette perspective, le sens donnépar les immigrés à la conservation debiens et de relations dans la commu-nauté d’origine doit être questionné.Quelle est la valeur attribuée à cesressources ? Quels sont leur place et leurpoids dans le déroulement de trajectoi-res visiblement orientées vers l’instal-lation définitive ailleurs ? Enfin,combien de temps ces relations et cesbiens conservent-ils un intérêt pour lesmigrants et à quel moment ou dans quelcontexte décident-ils d’y renoncer ? C’est à partir des acquis historiogra-phiques précédents que mon articleenvisage d’analyser les connexions entrele processus d’installation en ville et lemaintien de patrimoines dans le « pays »d’origine chez les individus qui ontimmigré à Turin dans la seconde moitiédu XVIIIe siècle4. L’analyse suggère que ladécision d’entretenir biens et autresressources « à distance » est liée à desphases spécifiques de l’existence et ne semaintient que jusqu’au moment oùd’autres exigences et nécessités devien-nent prioritaires, contraignant à uninvestissement plus important en ville etpoussant les individus à se défaire desbiens et liens jusque là préservés. Eneffet, les patrimoines familiaux sont desréalités mouvantes, constammentsoumis aux événements démogra-phiques et professionnels. Dans cette perspective, l’analyse desfacteurs et des circonstances liés auparcours de vie individuel et familials’avère fondamentale pour expliquer lesmotivations qui conduisent à garder ouà délaisser capitaux fonciers et sociauxinitiaux. La notion de « ressource » estcruciale. Je l’entendrai ici comme l’en-semble des moyens – biens matériels etrelations sociales obtenus par les hasards
de la vie (héritage, etc.) ou recherchésconsciemment – auxquels individus etfamilles ont accès et recours pour survi-vre ou améliorer leurs conditions d’exis-tence. Le but de cet article sera donc demontrer les formes de la relation entremigrants et patrimoines d’origine, ens’appuyant, d’un point de vue méthodo-logique, sur la reconstruction biogra-phique. Le croisement des sources et lesuivi longitudinal des familles dans lesactes notariés permettent de compren-dre comment s’articulent les étapes d’ar-rivée en ville et comment évolue lerapport avec la communauté d’origine.Cela permet enfin d’insister sur lanotion de processus, fondamentale pourla compréhension des phénomènesmigratoires. Dans un premier temps, seront analy-sées la qualité et l’extension des réseauxrelationnels des immigrés qui s’installentet se marient à Turin au cours de laseconde moitié du XVIIIe siècle. Dans lamajorité des cas, ces alliances prennentplace en dehors des réseaux de compa-triotes et laissent entrevoir la grandeaccessibilité relationnelle offerte par uneville d’Ancien Régime, bien que de taillemoyenne, comme l’était Turin. Viendraensuite l’étude de certaines dynamiquespatrimoniales en fonction d’un doubleobjectif : expliquer, d’une part,comment et pourquoi les immigrésconservent des liens et des patrimoinesdans leur lieu de provenance et, d’autrepart, quand et pourquoi cela n’est pluspossible pour certains.
MIGRATIONS ET MÉTIERS : UNE VARIÉTÉ DE PARCOURS
Tout au long du XVIIIe siècle, Turinconnaît une forte croissance urbaine quilui permet de passer de 58000 habitants
45
LA MIGRATION COMME PROCESSUS (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
environ en 1750 à plus de 76000 dansles années 1790. La populationredescend ensuite à 60 000 personnesenviron en 1802, lors de l’annexion à laFrance napoléonienne, après unepériode de crise économique et de guer-res (Castiglioni, 1862). Siège de la courainsi que des structures administrativeset bureaucratiques du Royaume deSardaigne, Turin est aussi un centre arti-sanal et manufacturier important. Lapolitique économique, fortementmarquée par les principes du colber-tisme, apporte un appui considérable àla production du fil de soie , l’organzino,renommé et exporté dans toute l’Eu-rope, et soutient avec un moindre succèsles activités de tissage et de vente detissus et de dentelles (en soie, voiles etgazes, bas)5. Dans la seconde moitié dusiècle, plus de 37 % de la population estactive dans les diverses branches de l’ar-tisanat et dans les manufactures, 30 %dans les services manuels (serviteurs etservantes, cochers, porteurs, cuisiniers,palefreniers), tandis que 10 % partici-pent aux activités commerçantes, desgrands négociants et marchandsjusqu’aux petits vendeurs au détail6. La présence d’un centre économique etpolitique engendre un marché du travailvarié, particulièrement attractif entermes d’opportunités de profits et d’em-plois. Tout au long du XVIIIe siècle, d’im-portants flux migratoires alimentent laville depuis les montagnes et campagnesenvironnantes, celles du Piémont enpremier lieu et dans une moindre mesurede la Ligurie, de la Savoie, des valléessuisses et de l’État de Milan. La popula-tion immigrée – c’est-à-dire les individusnés en dehors de Turin – constitue unbassin de main-d’œuvre essentiel à lacroissance urbaine. Au tout début duXIXe siècle, 60 % environ des hommes
âgés de 26 à 60 ans sont nés hors de laville, et il en est de même pour plus de40% de la population féminine entre 15et 40 ans7. Assez naturellement et malgréd’importantes différences en fonctiondes métiers et du sexe, la majorité desmigrants s’oriente vers ce qui constitueles deux piliers du système économiqueet social turinois : l’artisanat et les servi-ces manuels. Les tableaux suivantsprésentent cette distribution à partir durecensement urbain réalisé en 1802. À l’instar de ce qu’on observe dansd’autres villes européennes de l’AncienRégime, les immigrés occupent à Turindes espaces et des niches professionnellesspécifiques, mais ils sont aussi amenés àen partager certains avec les Turinois,tandis qu’ils sont quasiment absentsd’autres8. À l’intérieur d’un marché dutravail fragmenté et stratifié, les immi-grés de sexe masculin se concentrentsurtout dans les services manuels :serviteurs ou domestiques (13,2 %),portefaix ou hommes de peine (5,4 %),cuisiniers (3,9%), porteurs de vin(brentatore) (2%). D’autres encore sontmaçons (4,3%), boulangers, fabricantsd’eau-de-vie et de confitures, ouvendeurs de produits alimentaires. Il est des domaines d’activités oùimmigrés et Turinois travaillent côte àcôte : c’est le cas chez les cordonniers,perruquiers et tailleurs. Il apparaît enrevanche que le contrôle des activitésnécessitant une haute qualification resteentre les mains des Turinois : tissage dela soie (les vellutieri représentent plus de3 % des actifs turinois masculins) et lesautres métiers liés à celle-ci (soit lesfabricants de bas, fabricants de rubans etpassementeries – bindellai), mais aussiprofessions artisanales spécialisées, tellesque la bijouterie et l’orfèvrerie, l’impri-merie et la reliure des livres9.
46
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
Le recensement de 1802 fournit deséléments très comparables du côté desfemmes même s’il sous-estime fortement
leur présence sur le marché du travail.Les immigrées travaillent surtout commeservantes (46,4 %), cuisinières, ou dans
47
LA MIGRATION COMME PROCESSUS (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE)
Immigrés TurinoisBranches n % n %Serviteurs, domestiques 1216 13,2 262 4,1Marchands et vendeurs 545 5,9 674 10,5Porteurs 500 5,4 118 1,8Cordonniers 439 4,8 374 5,8Maçons 395 4,3 95 1,5
Cuisiniers 357 3,9 67 1,0Boulangers 289 3,1 98 1,5Vendeurs de produits alimentaires 218 2,4 55 0,9Porteurs de vin (brentatori) 181 2,0 17 0,3
Tisserands en soie (vellutieri) 92 1,0 211 3,3Fabricants de rubans et passementeries 30 0,3 68 1,1Bijoutiers 28 0,3 104 1,6Imprimeurs, relieurs 23 0,3 86 1,3Faiseurs de bas 20 0,2 90 1,4Autres métiers 4845 52,8 4107 63,9Total 9178 100,0 6426 100,0
Tab. 1 Principaux métiers des hommes (15 ans ou plus) selon l'origine* (Turin, 1802)
*Pourcentages calculés au sein de la population active (déclarant un métier), respectivementpour le groupe des immigrés et pour celui des natifs de Turin.
Source : Recensement turinois de 1802.
Immigrées TurinoisesBranches n % n %Servantes 1863 46,4 641 19,1Couturières 203 5,1 494 14,7Cuisinières 153 3,8 23 0,7Blanchisseuses, repasseuses 123 3,1 202 6,0
Vendeuses de produits alimentaires 114 2,8 90 2,7
Tisserandes en soie (vellutiere) 101 2,5 188 5,6
Fileuses en soie (filatoiere) 97 2,4 15 0,4Modistes, bonnetières 67 1,7 179 5,3Fabricantes de rubans et passementeries 18 0,4 52 1,5
Autres métiers 1280 31,8 1478 44,0Total 4019 100,0 3362 100,0
Tab. 2 Principaux métiers des femmes (15 ans ou plus) selon l'origine* (Turin, 1802)
*Pourcentages calculés au sein de la population active (déclarant un métier), respectivementpour le groupe des immigrées et pour celui des natives de Turin.
Source : Recensement turinois de 1802.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
les manufactures de soie en qualité defileuses (filatoiere). Les Turinoises, enrevanche, qui partagent certaines activi-tés avec les immigrées (dans le petitcommerce de produits alimentaires, parexemple), l’emportent dans l’artisanatqualifié du textile (bonnetières etmodistes – cuffiaie – ; tisserandes en soie– vellutiere – ; fabricantes de rubans),ainsi que dans la confection des vête-ments (couturières). En comparaison desimmigrées, leur présence dans les servicesmanuels est limitée : elles occupent dansl’ensemble beaucoup moins souvent lesfonctions de domestique ou de cuisi-nière, mais elles sont majoritaires parmiles blanchisseuses10.Dernier élément susceptible d’affectersignificativement le marché du travailturinois : la présence importante detravailleurs saisonniers et temporaires.De nombreuses études ont éclairé lescaractéristiques de ce modèle migratoirespécifique : les individus n’envisagentpas de s’établir en ville mais se conten-tent d’occuper et de contrôler des nichesspécifiques du marché du travail, tout enalternant leur résidence entre leurcommunauté d’origine et la ville pourdes périodes plus ou moins longues(Levi, Ramella, 1989 ; Levi, 1985 ;Lamberti, 2002a, 2002b, 2003 ;Contini, 2011). C’est le cas des servi-teurs, cuisiniers et porteurs de vin (lesbrentatori) originaires des vallées deLanzo, non loin de Turin, ou descordonniers du Val de Sesia, au pied duMont Rose. D’autres limitent leurséjour urbain à quelques mois, commeles maçons qui se déplacent en suivantles chantiers (en provenance surtout desvillages du Biellese ou du Luganese), ouencore les domestiques, surtout originai-res de la Savoie, venues en ville pour seconstituer une dot.
ÉPOUX ET TÉMOINS : AU-DELÀDES RÉSEAUX COMMUNAUTAIRES
À ce stade de l’analyse, il est indispen-sable de s’interroger sur le poids desréseaux communautaires pour ceux quienvisagent de s’installer définitivementen ville. Comme dans d’autres villeseuropéennes, les données sur la prove-nance des époux montrent à Turin l’im-portance des immigrés au sein de lapopulation urbaine. Elles suggèrentaussi qu’en ville, les occasions derencontre se multiplient, surtout entreindividus originaires de communautésdifférentes. D’après le recensement de1802, 31,2 % des couples ont unconjoint né en dehors de la ville alorsque dans 36,2 % des cas les deuxconjoints sont des immigrés. Enrevanche 32,6 % des couples sont cons-titués de Turinois de souche11. Parmi lescouples composés de deux immigrés,plus d’un tiers (35,2 %) ont une originecommune. Mais cette proportion sures-time certainement le poids des mariagesendogames puisque le recensementprend en compte tous ceux qui habitenten ville au moment de sa rédaction, ycompris les couples arrivés à Turin déjàmariés.Toutefois, d’autres sources permettentde mieux saisir la portion de la popula-tion qui se mariait à Turin et planifiaitd’y établir sa propre famille, et témoi-gnent de la grande accessibilité relation-nelle assurée par le tissu urbain et, enrevanche, du faible poids de la commu-nauté d’origine dans les comportementsmatrimoniaux. Je songe d’abord auxprocessicoli matrimoniali, c’est-à-dire auxdéclarations de liberté matrimonialefaites devant le curé de la paroisse. Dansce type d’acte, les deux époux présententdeux témoins chacun pour certifier
48
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
qu’ils sont libres de tout lien matrimo-nial antérieur (en d’autres termes qu’ilsremplissent la condition de veuvage oude célibat qui autorise le mariage). Sur548 couples mariés entre 1760 et 1791dans la paroisse turinoise des Ss.Processo et Martiniano12, 176 sontconstitués de deux conjoints immigrés ;parmi ceux-ci, le taux d’endogamiedépasse à peine 5 % (soit 10 couplesseulement), très en dessous donc desniveaux relevés dans le recensement13.L’analyse des couples enregistrés dans lesactes de mariage de l’état civil turinoisde la période napoléonienne (1803-1814) débouche sur des conclusionsanalogues, au point que « l’hypothèseselon laquelle le mariage entre migrantsen ville est favorisée par une provenancegéographique commune semble davan-tage le fruit d’un a priori qu’une preuvedocumentée » (Allegra, 2005, 468). Cesrésultats conduisent donc à minorer lerôle des chaînes migratoires et desréseaux communautaires, des mécanis-mes qui ont pourtant été largement misen avant dans la littérature scientifiquesur le sujet14. Cela ne doit évidemment pas conduireà dénier tout rôle aux réseaux commu-nautaires pour l’insertion dans le tissuurbain. La majeure partie des immigrésarrivés par le biais de ces réseaux ne visepas l’installation définitive, mais plutôtun usage temporaire et saisonnier15. Enrevanche, pour ceux qui s’installent, l’ef-fet des relations communautaires semblealler en s’affaiblissant au fil des années,voire, dans certains cas, être carrémentabsent16. En d’autres termes, soit cesliens n’existent pas et n’affectent pas lesparcours migratoires, soit ils sont provi-soires et destinés à être abandonnés oufortement réduits au fur et à mesure quel’installation se poursuit. Plusieurs
études ont ainsi fait ressortir l’impor-tance et la diffusion des parcours demigration « individuels » par rapport àceux conditionnés par les chaînes migra-toires et les compatriotes. Selon cesrecherches, à l’époque moderne déjà, denombreux individus arrivent en ville parleurs propres moyens, de manière auto-nome, simplement attirés par les oppor-tunités de travail et d’amélioration desconditions de vie – espérées ou réelles –qu’une grande capitale peut offrir(Pooley, Turnbull, 1998 ; Cavallo, 2001 ;Lesger, Lucassen, Schrover, 2002 ; ZuccaMicheletto, 2006).Les processicoli offrent cependant lapossibilité d’approfondir l’analyse duréseau car chaque époux présente deuxtémoins. Sans recouvrir l’ensemble desrelations sociales d’un couple, cesdonnées permettent de savoir avec quiles immigrés nouent leurs relations. Ilest alors possible de mesurer le degréd’homogénéité de ces réseaux en fonc-tion de la provenance de même que lafréquence avec laquelle les époux ontrecours à des compatriotes pour témoi-gner en leur faveur. Comme le montre le tableau 3, parmiles 344 époux immigrés enregistrés dansles processicoli pour la période 1760-1791, seuls 16 % environ ont un témoinappartenant à la même communautéd’origine, et 12,5 % choisissent deuxtémoins ayant cette caractéristique. Leconstat est le même du côté des épousesimmigrées (244 sur 548), avec desproportions respectives de 16,4 % et10,7 %. Si spécifiques qu’elles soient, cesdonnées montrent néanmoins que lesmécanismes des chaînes et les réseaux decompatriotes ont un poids limité sur lechoix du conjoint et des témoins. Laville offre la possibilité de rencontresvariées et, grâce à son tissu social assez
49
LA MIGRATION COMME PROCESSUS (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
« perméable », permet de construire desrelations dégagées des conditionnementscommunautaires17. Ces résultats ne doivent toutefois pasamener à mésestimer, et donc sous-esti-mer, l’importance du maintien des liensavec la communauté d’origine pour ceuxqui s’installent en ville d’une façon défi-nitive. De ce point de vue, les dyna-miques autour des patrimoines conser-vés dans le village d’origine permettentsans doute de saisir l’aspect pluscomplexe, fluide et en devenir, desphénomènes migratoires.
LES IMMIGRÉS ET LEURSPATRIMOINES FACE À LA VILLE :QUELQUES MODÈLES
Pour connaître l’étendue des patrimoi-nes des immigrés dans leur communautéd’origine et parvenir ainsi à élaborercertains modèles de gestion, j’ai réaliséune recherche nominative dans les archi-ves notariales de la ville de Turin18 et desrégions d’origine à partir d’un groupe de94 artisans immigrés à Turin et apparais-sant comme témoins dans les processicolimatrimoniali durant la période 1740-178019. Cet échantillon est représentatif
des métiers les plus communs parmi lesimmigrés : on y trouve 26 cordonniers,22 menuisiers, 18 boulangers, 13 perru-quiers, 11 fabricants d’eau-de-vie et4 tisserands en soie. La recherche apermis de repérer 30 transactions, dont21 ont pour objet une ou plusieursparcelles foncières (les pezze). Au cœurdes échanges, on trouve des terres desuperficies variables (allant de quelquestavole à plus de 10 giornate pour chaquechamp échangé)20, destinées aux culturestypiques de ces régions : champs decéréales, alteni (champs de céréales etvignobles)21, potagers, champs de chan-vre, mais aussi prés, prés arborés, pâtura-ges, bois. Dans ces transactions figurentaussi des immeubles : cassines, étables,caves, fenils, petites maisons, souventéchangés avec les terres environnantes.Les valeurs de ces biens couvrent un largespectre de prix : de 2 à 11 livres pour unetavola de pré, de 2 à 6 livres pour une debois. Le prix des champs de céréales estplus uniforme : 3 livres environ partavola dans toutes les transactions. Toutefois, l’analyse typologique destransactions ne suffit pas à répondre auxquestions posées dans l’introduction, surles connexions entre trajectoire de vie
50
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
n %
Epoux immigrés avec un témoin immigré de la même communauté 54 15,7
Epoux immigrés avec deux témoins immigrés de la même communauté 43 12,5
Total des époux immigrés 344 100,0
Epouses immigrées avec un témoin immigré de la même communauté 40 16,4
Epouses immigrées avec deux témoins immigrés de la même communauté 26 10,7
Total des épouses immigrées 244 100,0
Tab. 3 Conjoints immigrés choisissant des témoins de leur communauté d'origine (Processicoli matrimoniali de la paroisse Ss. Processo et Martiniano, 1760-1791)*
Source : Processicoli matrimoniali, paroisse Ss. Processo et Martiniano.
* Pourcentages calculés sur l'ensemble des époux immigrés (344 individus) et des épouses immigrées(244 individus).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
des immigrés, parcours d’installation enville et maintien ainsi que gestion despatrimoines locaux. Pour ce faire, il estindispensable de croiser les actes nota-riés avec les données biographiques etprofessionnelles de chaque artisan, repé-rées grâce au recensement des arts etmétiers réalisé à Turin en 1792 et grâceaux processicoli matrimoniali. Nousparvenons alors à reconstruire les étapesdu parcours de vie et à élaborer desmodèles de comportement. La voie d’acquisition la plus naturelledes biens et des patrimoines est l’héritage.Prenons l’exemple des frères Gio’ Andreaet Guglielmo Cerutti, boulangers àTurin, et originaires de Sommariva delBosco, un village du Piémont méridional.Tous deux ont encore moins de trente anset résident déjà en ville lorsqu’ils devien-nent héritiers universels de leur père,mort en 1759. Ils héritent alors d’unemaison, d’un champ et de quelquescrédits dans leur communauté d’origine,celle où leur père a toujours vécu. Lesfrères s’accordent finalement sur unpartage et signent un acte de division àTurin en 1761. Chacun obtient la valeurtotale de 792 livres en biens, crédits etargent22, somme assez importante si l’onconsidère que la majorité des dots turi-noises de la même période atteint à peineles 500 livres (Allegra, 1996, 177). Demême, les frères Panarallo, Ambrogio,Gio’ Batta, Giuseppe et Pietro, originai-res d’Arassa dans le Val de Sesia, au pieddu Mont Rose, vivent à Turin dans lesannées 1760 où ils travaillent commemenuisiers. À la mort de leur père en1765, ils héritent d’une grande maison etd’un certain nombre de parcelles dansleur village d’origine, ainsi que de l’atelierde menuiserie de Turin23.Quel est le destin de ces biens ?Comment et jusqu’à quand sont-ils
entretenus et maintenus ? Lorsqu’il estpossible de suivre le cours des transac-tions, deux comportements opposésressortent : soit les artisans conservent(et parfois élargissent) leurs propriétésdans la communauté d’origine, soit ilss’en débarrassent. Dans les années quisuivent le partage d’héritage, entre 1763et 1771, les frères Cerutti réalisent uncertain nombre de transactions concer-nant des biens situés à Sommariva delBosco, et ceci apparemment sans jamaisquitter Turin. L’aîné surtout, Gio’Andrea, mène une politique d’achatconséquente : en juillet 1770, il acquiertune parcelle de presque 96 tavole pourla somme de 1 084 livres24, puis, septmois plus tard, en février 1771, unchamp de 6 ares payé 600 livres25.Toutefois, le choix d’accumuler desbiens fonciers ne semble pas destiné, àmoyen terme, à favoriser un retour àSommariva puisque Gio’ Andrea pour-suit au contraire un parcours personnelet professionnel visant clairement àl’installation définitive en ville. Devenumaître boulanger et propriétaire d’uneboutique florissante, il se marie, en1763 à Turin, avec Maria MargheritaMusso (qui lui apporte une dot de325 livres, trousseau compris)26.Quelques années plus tard, le recense-ment des arts et métiers de 1792 lesignale comme étant à la tête d’unegrande boulangerie comptant9 employés (ouvriers et apprentis)27. Leparcours de son frère cadet, Gio’Guglielmo, est similaire. Marié en 1765à Turin avec Teresa Fontana28, il achèteau cours de cette même année uneboulangerie pour 6 500 livres. Lavendeuse est Rosa Antonietta, fille ethéritière universelle d’un autre boulan-ger jadis installé à Turin, Antonio MariaAntonietta29.
51
LA MIGRATION COMME PROCESSUS (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
Autre exemple, celui de FrancescoFelice Ruffinat, boulanger à Turin, quiacquiert en 1763 et 1771 plus de17 giornate de bois à Trana, son villaged’origine, ainsi qu’un alteno de50 tavole, jouxtant un alteno déjà en sapossession30. Les biens achetés ont uneétendue remarquable, si l’on se réfère àune étude sur le Piémont de la fin duXVIIe siècle qui démontre qu’unepropriété foncière composée de 4 ou5 giornate de alteno est alors suffisantepour faire vivre une famille de quatrepersonnes (deux adultes, deux enfants)(Levi, 1985). Néanmoins, son parcoursde vie et son parcours professionneltémoignent une fois encore d’une nettevolonté de sédentarisation en ville. Il semarie à Turin et, en 1792, il a atteint laqualité de maître boulanger, gérant uneboutique avec un collègue et deuxouvriers31. Ces brefs parcours mettent en lumièrela souplesse qui caractérise le rapport desimmigrés à leur communauté d’origineet l’ambivalence d’une volonté concomi-tante d’installation et d’intégration dansle nouveau milieu et d’une politique demaintien ou d’élargissement despatrimoines « à distance ». Je reviendraisur les motivations à l’origine de cescomportements, mais elles apparaissentcomme l’expression limpide d’une stra-tégie visant à multiplier et diversifier lesressources face au caractère incertain etaléatoire de l’expérience migratoire et del’économie urbaine. Pour d’autres en revanche, s’installer enville signifie se défaire de son identiténatale, ou au moins de celle susceptiblede s’exprimer dans la conservation et l’en-tretien des biens ruraux. La reconstruc-tion biographique montre que certainsmigrants, à l’inverse des frères Cerutti oude Ruffinat, choisissent de céder progres-
sivement leur patrimoine. L’histoirepatrimoniale de Gio’ Giacomo BonadéBottin est à cet égard exemplaire. Luiaussi boulanger à Turin, originaire d’unhameau des vallées de Lanzo, sonparcours d’insertion urbaine s’inscritdans une stratégie de relâchementprogressif des liens économiques (unhéritage paternel là aussi) avec sa localitéd’origine. Son rapport privilégié avec laCompagnia di San Paolo, une des confré-ries parmi les plus puissantes et les plusactives de la ville, témoigne de son accèsaisé à certaines ressources urbaines et deson insertion dans un réseau social spéci-fiquement turinois. C’est la Compagniadi San Paolo qui paie une dot de charité àsa femme, Francesca Maria Varetta,épousée en 175332, et c’est encore cetteinstitution qui lui loue une chambre dansun de ses immeubles afin qu’il puisse yexercer son métier. Par ailleurs, laCompagnia n’est pas la seule confrérieavec laquelle il noue des rapports,puisque lors de la rédaction de son testa-ment en 1780, Gio’ Giacomo rappelleson appartenance à plusieurs autresconfréries de la ville auxquelles revient lacharge d’organiser ses funérailles33. Laconstruction d’une identité urbainespécifique, dont témoignent ces indices,s’accompagne d’un abandon progressifdes biens au pays natal. Plusieurs annéesaprès son départ, et après la division del’héritage paternel34, Gio’ Giacomo vend,en avril 1776, à son frère, résidant encoreau pays, « une maison avec cheminée, ungrenier, deux caves, une écurie et unfenil » situés dans le village, pour360 livres35. Quatre ans plus tard, en avril1780, il vend à son compatriote (et peut-être parent), Bartolomeo Bonadé Bottin,une parcelle de pré et bois de 100 tavolepour la somme de 100 livres36. Enfin, enaoût 1780, il nomme son frère héritier
52
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
universel de tout bien et droit « partoutoù ils se trouvent »37. À ce stade de l’analyse, se pose la ques-tion de la valeur et de la significationattribuées aux biens situés dans lacommunauté d’origine par ceux qui,comme les frères Cerutti ou FrancescoFelice Ruffinat, choisissent de conservervoire d’agrandir ce patrimoine. Si lareconstruction biographique laisse devi-ner que le retour n’est pas l’objectif pour-suivi, il faut en revanche prendre encompte la valeur de ces biens et leur rôlede ressource face à une éventuelle diffi-culté économique – puisqu’ils permet-tent de diversifier les revenus entre villeet campagne et ainsi de minimiser lesrisques –, mais aussi dans le cas du recou-vrement d’une dette ou encore pourréaliser un achat d’une certaine valeur,comme celui d’une boutique. En 1770,Giorgio Florio, tailleur originaire deBioglio et domicilié à Turin, est débiteurde 220 livres en faveur de GiacobinoPiana, somme qu’il se révèle incapable depayer malgré de multiples sollicitationsde Piana. Pour échapper à une action enjustice, il se résout à vendre à réméré(vendita con riscatto) une parcelle de préet champ portant un certain nombred’arbres fruitiers d’une superficie de88 tavole, qu’il possède à Bioglio et dontla valeur est fixée pour l’occasion à220 livres38. La vente avec pacte deréméré est un mécanisme qui correspondsouvent au recouvrement d’une dette(Corazzol, 1979), la possibilité pourFlorio de récupérer la parcelle témoi-gnant néanmoins du rôle de réserve jouépar ce bien. Il assure sa solvabilité dansune société d’Ancien Régime où le petitcrédit tient une place considérable à tousles degrés de l’échelle sociale. Dans cette perspective, le patrimoinelocal apparaît de surcroît indispensable
lors du mariage, lorsqu’il s’agit decautionner la dot de l’épouse. Dans lespays de droit romain, la dot, indispensa-ble pour les filles de tous les milieuxsociaux, est payée par l’épouse et/ou safamille au moment du mariage39. Ilarrive cependant fréquemment que despères ou des frères hésitent devant lepaiement de cette somme souvent consi-dérable en comparaison du patrimoinedomestique et exigent de l’époux qu’ilcautionne le capital dotal en faisantmontre d’une disponibilité équivalentede moyens. Or, l’héritage situé dans lacommunauté d’origine est souvent leseul patrimoine dont ces artisans, préco-cement installés en ville et dont lemétier assure le quotidien sans permet-tre d’accumulation de capital, disposentpour répondre aux attentes de protec-tion patrimoniale de l’épouse et de safamille. Les archives notariales regorgentd’exemples en ce sens. La dot de Polis-sena Davini, fixée à 362 livres et10 sous, est assurée par son mari Gio’Giuseppe sur une maison (un corpo dicasa) qu’il possède dans sa ville natale,Coni (Cuneo en italien), alors que lecouple habite Turin depuis longtemps40.Il en va de même pour les conjointsAnna et Gio’ Matteo Bordiga, domici-liés à Turin. La première reçoit lors deson mariage une dot de 300 livres quiest ensuite assurée sur deux parcellesfoncières (une de vignes et une de bois)situées à Valfenera, communauté d’ori-gine de son époux41.
DOTS, INTERMÉDIAIRES ETRELATIONS VERTICALES
Les biens possédés dans la communautéd’origine autant que les liens sociauxentretenus ne proviennent pas unique-ment des dynamiques successorales ou des
53
LA MIGRATION COMME PROCESSUS (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
relations de parenté. Les migrants eux-mêmes recherchent, maintiennent oudélaissent des relations dans cettecommunauté. L’exemple le plus significa-tif est celui de l’implicatario. Il s’agitsouvent d’un notable, chargé par lesmigrants d’administrer leurs biens, etnotamment ceux payés à titre de dot. Eneffet, si le mari n’était pas pourvu demoyens suffisants pour assurer le capitaldotal, ce dernier était confié à l’implicata-rio, c’est-à-dire à un courtier ayant fonc-tion d’intermédiaire42. La gestion parcelui-ci des biens dotaux des couplesayant quitté leur pays d’origine offre doncun point de vue privilégié pour observerles dynamiques relationnelles spécifiquesentre les émigrés et l’implicatario qui restesur place. Andreina De Clementi a observé ladiffusion et le succès du rôle du média-teur dans les migrations transocéaniquesdes Italiens à la charnière des XIXe etXXe siècles. Dans cette phase historiqueparticulière, l’élargissement du marchéimmobilier, la nécessité d’obtenir del’argent liquide et le déplacement defamilles complètes à l’étranger, ont favo-risé la naissance d’une notabilité localemineure chargée d’assurer les transac-tions, les prêts d’argent et les procura-tions au nom de ceux qui s’en allaient(De Clementi, 2003, 319). Mais cespersonnages ne caractérisent pasuniquement les grands flux migratoiresdu début du XXe siècle, et sur bien despoints, on observe des similitudes avecles implicatari des biens dotaux duXVIIIe siècle. L’implicatario commence par encaisserl’argent de la dot, puis l’engage dans uninvestissement sûr et rentable. Il paieensuite au couple les intérêts au taux légalde 4 % par an, une rente qui, selon levoeu de la loi, est censée aider au main-
tien de la famille. Cette médiation estsouvent formalisée par un acte notarié,comme celui stipulé entre les conjointsCastagna et l’implicatario LudovicoTinetto, perruquier de profession, endécembre 1769, dans lequel ce dernierdéclare avoir reçu « à titre d’emploi » (atitolo d’impiego) 3 000 livres dotales ets’engage à en payer les intérêts chaquesemestre43. De la même façon, la restitu-tion définitive du capital dotal au couplecomporte la délivrance d’une quittanceformelle signée devant le notaire.Afin de mieux saisir la nature des rela-tions entre ces personnages et les couplesémigrés à Turin, j’ai analysé 56 quittancespour restitution de dot, réalisées devantun notaire, entre 1760 et 1780, par descouples installés à Turin mais non origi-naires de la ville44. Une bonne partie desimplicatari appartient au groupe desnotables. Parmi eux, on rencontre sixnotaires, deux avocats, un médecin, unsénateur mais on compte aussi deux arti-sans (un fabricant de perruques et unimprimeur), un officier et un prêtre. Cesintermédiaires sont aussi des personnagesenracinés dans la société locale, d’où ilstirent leur respectabilité et leur réputa-tion d’hommes de confiance. En effet, lesdonnées de l’échantillon nous appren-nent que 27 des 56 implicatari sont nésdans la communauté d’origine de l’undes conjoints (ou des deux) dont ilsgèrent la dot ; 24 y sont encore domiciliéstandis que 3 seulement sont installés àTurin. Les conjoints connaissent doncpersonnellement l’implicatario et le tien-nent pour un homme de confiance.Citons Gio’ Bartolomeo et GioannaQuadropani, fileurs et tisserands en soie àTurin, qui confient leurs 500 livres aucomte Gio’ Angelo Craveri, résidant àRacconigi, localité d’origine du mari45,ou encore Emanuele et Lucia Mollo dont
54
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
la dot de 534 livres est remise « a titolodi impiego» à Giuseppe Ollivero, habi-tant Sommariva del Bosco, pays natalde Lucia, où ses frères sont encoredomiciliés46.L’intermédiaire joue par ailleurs unrôle essentiel lors de la vente des biensdu mari qui ont servi à assurer la dot.Par leur réputation et leur position ausein de la communauté, les implicatarisont souvent les acquéreurs les plus inté-ressés par ces biens soumis au droitdotal. Ainsi, Domenica Borgogna reçoiten 1731 une dot de 250 livres caution-née par son mari sur une maison qu’ilpossède dans son village natal de Virle.Près de quarante ans plus tard, endécembre 1769, Giuseppe Borgognavend pour 950 livres la maison aunotaire Marco Antonio Musizzano, quidevient ainsi l’implicatario chargé degérer et de payer les intérêts sur les250 livres dotales47. Ce mécanisme, quitransforme un bien immobilier enargent comptant, révèle une premièreprise de distance explicite des émigrésvis-à-vis du pays natal, un patrimoine enargent liquide étant sans doute plusfacile à gérer et demandant un engage-ment minime sur place.
HORIZON D’INVESTISSEMENT ETCYCLE DE VIE DES ÉMIGRÉS
Le croisement des sources et la recons-truction biographique montrent aussique ces patrimoines et ces relationsverticales maintenues dans la commu-nauté d’origine sont limités dans letemps par l’intérêt que les migrants enretirent. Il faut donc examiner lesraisons qui poussent ces derniers àmettre fin à ces liens matériels et imma-tériels. Cela implique plus largementd’interroger l’horizon d’investissement
de ces individus, d’explorer leur atten-tes, projets et stratégies. Parfois, ils four-nissent eux-mêmes des explications :certains mots indiqués par un notairezélé lors de la rédaction des actes fontbien comprendre que, face à unenouvelle vie urbaine, les biens fonciers etruraux au pays ne sont plus considéréscomme indispensables ; au contraire,leur conservation pèse comme une obli-gation qui n’est plus rentable en raisondes coûts d’entretien élevés ainsi que del’obligation d’une présence régulière surplace qu’il n’est plus possible d’assurer.Carlo Camilla, fabricant d’eau-de-vie àTurin, vend, en 1760, une parcelleabandonnée, autrefois plantée en vignes,située dans les campagnes autour deMondovi, sa localité de naissance(Piémont méridional), afin, selon sesmots, « d’en éviter davantage la détério-ration », et la dépréciation pourrait-onajouter, « à cause du fait qu’il habiteTurin depuis 17 ans »48. Le choix de vendre répond parfois àun projet migratoire49 explicitementproclamé, comme dans le cas de Gio’Domenico Allaria, originaire deCantoira (village montagnard des valléesde Lanzo), qui commence sa carrière àTurin comme boulanger. Il se rend, en1741, chez un notaire turinois et déclarevouloir vendre à ses deux frères restés surplace sa portion de l’héritage paternelencore indivis « suite à sa décision derester en ville pour apprendre unmétier»50. Gio’ Domenico signe pourcela avec ses frères un véritable accord,renonçant à tout droit sur l’héritagetandis que ses germains s’engagent à luipayer 400 livres avec intérêts pendant lesquatre années suivantes. Ils devront enoutre lui envoyer un petit trousseaupour lui permettre de s’habiller décem-ment pendant les premiers temps de son
55
LA MIGRATION COMME PROCESSUS (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
installation : « deux pièces de toile duvillage, une chemise, un manteau sansmanche et une paire de caleçons en toilede bonne qualité »51. Gio’ Domenico seconserve toutefois une possibilité, certesconditionnelle, de revenir au village :pendant les quatre ans durant lesquelsses frères lui payeront les 400 livres, ilgardera un droit d’usufruit sur laportion de la maison héritée « chaquefois qu’il lui conviendra de s’y rendrepour y habiter, pour maladie, guerre ouautres accidents »52. Ses mots laissentdonc entrevoir un véritable projetformateur qui, dans les intentions deGio’ Domenico, doit déboucher sur uneinstallation définitive en ville et luigarantir une réussite professionnelle.Bien conscient des risques d’un telchoix, il s’assure toutefois pour quelquesannées encore la possibilité de jouir d’untoit dans son pays natal et ne renoncepas aux relations avec les membres de safamille restés au village, ce qu’ontpermis de confirmer les archives notaria-les locales. Entre 1741 et 1761, Gio’Domenico se porte à plusieurs reprisescréancier et garant de ses frères et d’unebelle-sœur, résidant au village53.Les sources ne sont pas toujours aussiloquaces et les raisons qui poussent lesmigrants à délaisser leurs biens dans lacommunauté d’origine sont souventplus difficiles à saisir. C’est donc la miseen séquence des événements biogra-phiques qui suggère de possibles clés delecture. Dans le cas du boulanger Gio’Giacomo Bonadé Bottin, déjà cité,l’abandon du patrimoine local a lieu –très significativement –, quelques moisavant la rédaction de son testament, lors-qu’il doit prévoir une réserve suffisanted’argent dans son héritage pour rendre ladot à la veuve, le moment venu. Ce n’estdonc pas un hasard si en avril 1780, il
cède pour 100 livres une parcelle situéeen son village natal54 et, quelques moisplus tard, dans son testamentd’août 1780, reconnaît à la veuve, à titrede restitution dotale, cette même somme(100 livres plus les linges et les vêtementsd’usage personnel)55. La mise en perspective d’événementsdémographiques, d’évolutions de la viefamiliale et individuelle et des nécessitésde survie constitue l’approche analy-tique la plus pertinente pour appréhen-der les raisons qui poussent les couples àcesser les relations avec l’implicatario et àdemander la restitution du capital dotal.Parmi les 56 couples étudiés, 28, soit lamoitié, ont des enfants à charge, souventdes nourrissons. Parmi eux, 19 ont plusde trois enfants tandis que deux épouses,déjà mères, sont enceintes. Un autregroupe (7 sur 56) réunit des couplesdéclarant être « âgés » ou « décrépits » etdésormais incapables de se maintenir autravail. Au bout du compte, la décisionde rompre les liens avec la communautéd’origine intervient pour la majorité desfamilles lorsqu’elles se trouvent confron-tées à une situation de déséquilibre entreressources disponibles et besoins desmembres du ménage. L’isolement rela-tionnel et économique évoqué par lescouples les plus âgés, sans enfant, consti-tue un autre facteur. Tout bien consi-déré, une situation de nécessité peutmodifier les équilibres et les priorités desimmigrés en ville par rapport à leurvillage d’origine. Suivons encore dans ledétail le cas de Giacomo et DomenicaCostamagna en détaillant la chronologiedes événements et en montrant leurentrelacement. En 1775, les conjointsCostamagna, originaires de VillafrancaPiemonte mais installés à Turin, deman-dent à l’implicatario la restitution des250 livres dotales. Ce dernier, leur
56
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
compatriote, s’était engagé, par actenotarié datant de novembre 1772, àinvestir l’argent, à payer les intérêts et àrendre le capital au bout de six ans.Cependant, moins de trois ans plus tard,en mars 1775, Giacomo et Domenicademandent la restitution de l’argent et larésiliation du contrat car, ainsi qu’ilsl’expliquent, ils « sont chargés de sixenfants [...] tous encore incapables degagner leur vie et dépourvus de toutmoyen de survie » et ont des dettes àrembourser56. Certaines situations parti-culièrement critiques sont susceptiblesde faire renoncer les immigrés à touterelation avec l’implicatario ou, plusdirectement encore, de les pousser à sedéfaire des patrimoines dans la commu-nauté d’origine, dont le maintien n’étaitenvisageable qu’en fonction de ressour-ces familiales suffisantes. Quandsurvient une situation très difficile,l’intérêt de garder ces biens « à distance »cède la place à l’exigence d’une disponi-bilité immédiate de moyens, et cela,naturellement, même longtemps aprèsl’installation du couple en ville. Par ailleurs, le déséquilibre entreressources et consommation n’est pas leseul facteur susceptible d’affecter laqualité des liens entre les émigrés et leurvillage de naissance. Une situation d’iso-lement relationnel et/ou économiquepeut avoir des conséquences analogues,comme le démontre le cas des épouxMartino et Giuliana Macario. Installé àTurin depuis bien des années, le couplerenonce aux liens avec la communautéd’origine, San Maurizio, en deux étapes.Après leur mariage, en 1743, la dot avaitété cautionnée par le mari sur un immeu-ble dans le village natal57. Presque trenteans plus tard, en octobre 1771, décisionest prise de se défaire de cet immeubleinutilisable et de le vendre afin de confier
l’argent à un implicatario, l’épicier PietroAntonio Friolo, leur compatriote. C’est àtravers lui que le couple conserve un lienavec San Maurizio pendant encore sixannées. Mais, en novembre 1777,intervient une seconde décision : lademande de restitution définitive de l’ar-gent dotal et de résiliation du contratd’engagement58. Les actes notariés nousapprennent que le couple est à cette dateassez âgé, sans enfant, et l’on peut endéduire que la gestion de leur boulangerieturinoise est devenue pénible59. Le choixd’abandonner le dernier lien matérielavec la communauté d’origine prenddonc place à un moment spécifique deleur existence, lorsque l’argent dotaldevient nécessaire à la survie du coupledans la vieillesse. Enfin, un autre moment de lourdetension au sein de l’économie domes-tique est celui où il faut constituer unedot pour une fille à marier. Cet objectiffournit une bonne raison de vendre lesbiens que le couple n’a plus de réel inté-rêt à conserver et à entretenir, comme lemontre le cas des conjoints Emprino.Résidant à Turin, ils n’hésitent pas, afinde pourvoir aux 400 livres de dot promi-ses à leur fille récemment mariée, à sedéfaire de deux parcelles – un alteno de3 giornate et 60 tavole de superficie etune parcelle de bois de 50 tavole –situées dans la campagne de Carignano,ville d’origine de la mère60. Les données de la reconstructionbiographique sont forcément partielleset l’on ne peut bien entendu exclure lapossibilité que ces couples aient possédédans leur région d’origine des biens dontla trace n’a pas été conservée. Toutefois,les données disponibles sur ces individusémigrés à Turin montrent des parcoursprofessionnels et de vie profondémentenracinés en ville. Les couples considérés
57
LA MIGRATION COMME PROCESSUS (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
sont depuis longtemps domiciliés dansla capitale piémontaise, et c’est là qu’ilsse sont rencontrés et mariés pour lamajorité d’entre eux. L’hypothétiqueprésence d’autres patrimoines n’invalidedonc pas l’idée que les stratégies familia-les, de survie et/ou de mobilité socialedes immigrés au cours des différentesphases de leur sédentarisation dans lemilieu urbain, affectent les choix d’élar-gissement, de pérennisation ou, aucontraire, de liquidation des patrimoi-nes situés dans la communauté natale.
LA MIGRATION COMMEPROCESSUS
L’analyse de réseaux est désormais unoutil indispensable pour tous ceux quienvisagent d’étudier et comprendre lesphénomènes migratoires. Elle a permisd’aboutir dans l’étude des émigrés à Turinau XVIIIe siècle à quelques solides conclu-sions. Les réseaux relationnels desnouveaux arrivés sont fluides et oscillententre le maintien des liens et des biensdans la communauté d’origine et la néces-sité d’utiliser ces mêmes ressources pours’intégrer dans le tissu social urbain. Lechoix du conjoint semble au contraireéchapper à la logique des réseaux decompatriotes. Par ailleurs, se marier enville n’entraîne pas de rupture immédiateet définitive des liens avec le pays natal,où, transcendant les parcours migratoires,continuent d’exister, voire de prospérerintérêts matériels et relations personnelles. Mais l’analyse des réseaux sociaux desimmigrés ne suffit pas à expliquer la
signification et la valeur que ces derniersattribuent à certains intérêts, biens etrelations communautaires. Tous les indi-vidus, nés en ville ou en dehors de celle-ci, se trouvent immergés dans desréseaux relationnels (Eve, 2001), ce quiimporte est donc de comprendrecomment et combien de temps ces rela-tions sont conservées et, à l’inverse, dansquelles situations elles perdent leurimportance au point d’être finalementabandonnées. Pour répondre à ces ques-tions, il est indispensable d’approcherles phénomènes migratoires de l’époquemoderne comme des dynamiquesfluides et « en devenir », c’est-à-direcomme des processus et non comme desévénements ponctuels61, comme l’his-toire contemporaine le fait depuisquelques années (Gribaudi, 1987 ;Werbner, 1990 ; Ramella, 1998 ; Sayad,1999 ; Ceravolo, Eve, Meraviglia, 2001).Cela signifie attribuer leur juste poidsaux événements démographiques etéconomiques de chaque famille ainsiqu’aux diverses phases du parcours devie. En effet, lorsque les équilibres s’altè-rent ou que l’accès aux ressources, lesexigences et les priorités familiales etindividuelles se modifient, on observeune transformation équivalente du rôleet du poids que chacun attribue auxbiens et relations communautaires.
Beatrice Zucca MichelettoPost-doctoral fellow
GRHis, Groupe de Recherche d’HistoireUniversité de Rouen
58
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
1. La bibliographie sur les migrations d’AncienRégime est désormais vaste et s’enrichit de plusen plus. Parmi les travaux les plus récents, voirpar exemple Page Moch, 1992 ; Fontaine, 1996 ;Lucassen, Lucassen, Van der Linden, 1999 ;Rosental, 1999 ; Arru, Ehmer, Ramella, 2001 ;Arru, Ramella, 2003.
2. Outre (Mayer, 1961), voir (Hannerz, 1980 ;Piselli, 1995).
3. Voir par exemple Raison-Jourde, 1976 ; Piselli,1981 ; Poitrineau, 1982 ; Moulin, 1994. Et pourla période contemporaine (Ambrosini, 2001).
4. Tout au long de l’article, « les nouveaux arrivésà Turin » seront définis comme immigrés,migrants ou émigrés, selon le contexte de réfé-rence – ville d’installation ou communauté dedépart.
5. Sur ce sujet, voir Bracco, 1992 ; Chicco, 1995,2002 ; Ambrosoli, 2000.
6. Archivio Storico del Comune di Torino (désor-mais ASCT), Censimento della popolazione, 1802.Pourcentages calculés sur l’ensemble de la popu-lation qui a déclaré un métier, soit27 451 hommes et femmes. Le recensement du1802 de la ville de Turin a été intégralementtranscrit par une équipe d’étudiants sous la direc-tion de Maria Carla Lamberti. Je tiens à remercierMadame Lamberti pour m’avoir permis d’utiliserle recensement, déposé auprès de la Sectiond’Histoire économique du Département d’His-toire de l’Université de Turin (Lamberti, 2002b).
7. Données calculées à partir du recensement du1802.
8. Pour l’Italie voir Gozzini, 1989 ; Menzione,1990 ; Belfanti, 1994 ; Guenzi, Massa, Moioli,1999 ; Arru, Ramella, 2003. Pour des autres villeseuropéennes voir Garden, 1970 ; Perrot, 1975 ;Kaplan, Koepp, 1986.
9. Données calculées sur la population masculineavec un métier âgée de 15 ans et plus, soit9 178 immigrés et 6 426 Turinois.
10. Données calculées sur la population féminineavec un métier à partir de 15 ans, soit4 019 immigrées et 3 362 Turinoises.
11. Données extraites du recensement du 1802.En valeurs absolues : 3 393 couples mixtes ;
3 939 couples composés par des immigrésuniquement ; 3 540 couples d’époux turinois.
12. Archivio Arcivescovile di Torino (dorénavantAAT), Fondi Parrocchiali, Sezione XVIII.
13. Par « endogamie », j’entends ici les mariagesimpliquant des individus originaires de la mêmecommune. Le groupe analysé est composé de548 couples, dont 176 couples d’immigrés,136 couples de Turinois et 236 couples mixtes.
14. Les risques d’une analyse des dynamiquesmigratoires uniquement fondée sur les réseauxcommunautaires ont été largement abordés, en2001, dans un très intéressant volume monogra-phique de Quaderni Storici (Arru, Ehmer,Ramella, 2001).
15. Voir, par exemple, les études de LaurenceFontaine consacrées aux colporteurs. Cette cher-cheuse élabore un modèle migratoire qui estpartie intégrante de la structure du marché dutravail des vallées alpines de l’époque moderne(Fontaine, 1993, 2003).
16. Ce phénomène a été repéré aussi dans d’aut-res terrains européens. Ceux qui émigraient et semariaient à l’étranger et en dehors du groupe descompatriotes ne revenaient plus vivre dans lacommunauté d’origine. - Voir par exemplePoitrineau, 1982 ; Maitte, 2009.
17. L’étude de Sandra Cavallo (2001) consacréeaux chirurgiens turinois entre XVIIe et XVIIIe sièclesconduit à des conclusions analogues.
18. La reconstruction biographique fondée surune recherche nominative pour la ville de Turinest envisageable du fait de l’existence de répertoi-res conservés par le bureau centralisé des actesnotariés (l’Insinuazione), introduit par le Ducdans ses domaines à partir du 1610. L’Insinua-zione de la ville de Turin est organisée en répertoi-res nominatifs et cela facilite donc la recherchenominative des individus, malgré les difficultésqui tiennent à la masse des données, aux homo-nymies et aux variations dans l’écriture des nomsde famille.
19. Dans les processicoli, on compte1 669 témoins de mariage immigrés.
20. Les tavole et les giornate sont des unités desurface utilisées à Turin et dans les campagnes
59
LA MIGRATION COMME PROCESSUS (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE)
NOTES
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
alentours. Une giornata est équivalente à100 tavole (c’est-à-dire à plus de 38 ares). Unetavola correspond à 38 mètres carrés environ(Martini, 1976).
21. L’alteno est une parcelle cultivée en bandes,en mêlant céréales et vignobles ; il s’agit d’uneculture typique du paysage rural piémontaisd’Ancien Régime (Levi, 1989, 49, 80).
22. Archivio di Stato di Torino (désormais AST),sez. riun., Insinuazione di Torino, a. 1761, l. 4,ff. 701r-702v.
23. Comme on le voit à travers deux actes dedivision passés entre les frères et un neveu héritierd’un des frères déjà décédé, datant respective-ment de 1770 et 1771. Archivio di Stato di Varallo(désormais ASVar), notaio Ravelli Giacomo,vol. 10168 ; AST, sez. riun., Insinuazione diTorino, a. 1771, l. 6, ff. 1307r-1312v.
24. Soit 11 livres et 4 sous pour chaque tavola.AST, sez. riun., Insinuazione di Torino, a. 1770, l.8, ff. 467r-468r.
25. Soit 100 livres pour chaque are (100 mètrescarrés). AST, sez. riun., Insinuazione di Torino, a.1771, l. 3, ff. 657r-v.
26. AST, sez. riun., Insinuazione di Torino, a.1763, l. 12, ff. 393r-394r.
27. AST, sez. I, Materie economiche, Commercio,Categoria IV, mazzo IIa addizione, Volume conte-nente li nomi, cognomi e patria de’ mastri e padronie de’ loro rispettivi lavoranti ed apprendizzi delliarti e mestieri.
28. AAT, Fondi Parrocchiali, Sezione XVIII.
29. AST, sez. riun., Insinuazione di Torino, a.1764, l. 11, f. 93r-v.
30. Ibid., a. 1763, l. 1771.
31. AST, sez. I, Materie economiche, Commercio,cat. IV, mazzo IIa add., Volume contenente li nomi,cognomi e patria de’ mastri e padroni …
32. AST, sez. riun., Insinuazione di Torino,a.1753, l. 11, ff. 705r-v.
33. Ibid., a. 1780, l. 8, ff. 1420r-1421v.
34. La division de l’héritage paternel est réaliséedans la communauté d’origine en 1763.
35. AST, sez. riun., Insinuazione di Torino, a.1779, l. 9, ff. 629r-v.
36. Ibid., a. 1780, l. 4, ff. 1974r-1975r.
37. Ibid., l. 8, ff. 1420r-1421v.
38. Ibid., a. 1770, l. 9, ff. 431r-432v.39. La bibliographie sur la dot est extrêmementvaste. Pour une introduction aux systèmes dotauxde l’Italie d’Ancien Régime, voir Pene Vidari,1980-1981, 1983 ; Klapisch-Zuber, 1990 ; Calvi,Chabot, 1998 ; Groppi, Houbre, 1998.40. AST, sez. riun., Notai di Torino, vol. 2765,ff. 86r-96v.41. Ibid., vol. 2764, ff. 335r-349r.42. Selon la définition d’intermédiaire donnéepar Gabriella Gribaudi (1980).43. AST, sez. riun., Insinuazione di Torino, a.1770, l. 2, ff. 1305r-1311v.44. Les quittances ont été saisies dans les registresde l’Insinuazione de Turin.45. AST, sez. riun., Insinuazione di Torino, a.1763, l. 2, ff. 255r-256v.46. Ibid., Notai di Torino, vol. 2754, ff. 476r-479v.47. Ibid., vol. 2755, ff. 375r-384v.48. Ibid., Insinuazione di Torino, a. 1760, l. 3,ff. 1429v-1430v.49. Selon la notion de projet migratoire dévelop-pée par Paul-André Rosental (1999).50. Citons les mots exacts : “in seguito alla delibe-razione fatta di trattenersi per apprender ed esercirqualche mestiere in questa città”, AST, sez. riun.,Insinuazione di Torino, a. 1741, l. 12, ff. 75r-76v. 51. Ibid.52. Ibid.53. Ibid. Insinuazione di Ceres, vol. 24, ff. 255r-v ;vol. 27, ff. 709r-v.54. Ibid., Insinuazione di Torino, a. 1780, l. 4,ff. 1974r-1975r.55. Ibid., a. 1780, l. 8, ff. 1420r-1421v.56. Ibid., Notai di Torino, vol. 2764, ff. 376r-388r.57. Ibid., Insinuazione di Torino, a. 1743, l. 11,ff. 97v-98v.58. Ibid., a. 1777, l. 12, ff. 1279r-1282v.59. Ibid., a. 1763, l. 5. ff. 320r-v. 60. Ibid., Notai di Torino, vol. 2777, ff. 422r-453r.61. Sur ce point, je renvoie aux remarques deSimona Cerutti à propos de la notion de « proces-sus » développée par E. P. Thompson (Cerutti,1996).
60
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
61
LA MIGRATION COMME PROCESSUS (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE)
ALLEGRA, Luciano (1996), Identità in bilico.Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento,Torino, Zamorani.
ALLEGRA, Luciano (2005), «Un modèle demobilité sociale préindustrielle. Turin àl’époque napoléonienne», Annales Histoire,Sscienses Sociales, mars-avril, 443-474.
AMBROSINI, Maurizio (2001), La fatica diintegrarsi, Bologna, Il Mulino.
AMBROSOLI, Mauro (2000), “The marketfor textile industry in eighteenth centuryPiedmont: quality control and economicpolicy”, Rivista di Storia Economica, 3,343-363.
ARRU, Angiolina, EHMER, Joseph, RAMELLA,Franco (dir.) (2001), Quaderni Storici,106.
ARRU, Angiolina, RAMELLA, Franco (dir.)(2003), L’Italia delle migrazioni interne.Donne, uomini, mobilità in età moderna econtemporanea, Roma, Donzelli.
ARRU, Angiolina (2003), “Reti locali, retiglobali: il credito degli immigrati (secoliXVIII-XIX)”, 77-110, in L’Italia dellemigrazioni interne. Donne, uomini, mobi-lità in età moderna e contemporanea, A.Arru, F. Ramella (dir.), Roma, Donzelli.
BELFANTI, Carlo Marco (1994), Mestieri eforestieri. Immigrazione ed economiaurbana a Mantova fra Sei e Settecento,Milano, F. Angeli.
BRACCO, Giuseppe (dir.) (1992), Torino sulfilo della seta, Torino, ed. Archivio StoricoComune di Torino.
CALVI, Giulia, CHABOT, Isabelle (dir.)(1998), Le ricchezze delle donne. Dirittipatrimoniali e poteri familiari in Italia(XIII-XIX secc.), Torino, Rosenberg &Sellier.
CASTIGLIONI, Pietro (1862), Relazione gene-rale con una introduzione storica sopra icensimenti delle popolazioni italiane daitempi antichi sino all’anno 1860, vol. I, in
Statistica del Regno d’Italia, Popolazione.Censimento degli antichi stati sardi (1gennaio 1858) e censimenti di Lombardia,di Parma e di Modena (1857-1858),Torino, Stamperia Reale.
CAVALLO, Sandra (2001), “La leggerezzadelle origini: rottura e stabilità nelle storiedei chirurghi torinesi tra Sei e Settecento”,Quaderni Storici, 106, 59-90.
CERAVOLO, Flavio, EVE, Michael, MERAVI-GLIA, Cinzia (2001), “Migrazioni e inte-grazione sociale: un percorso a stadi”, 83-116, in L’Italia delle disuguaglianze, M. L.Bianco (dir.), Roma, Carocci.
CHICCO, Giuseppe (1995), La seta inPiemonte 1650-1800, Milano, F. Angeli.
CHICCO Giuseppe (2002), “Alla periferiadella moda. Mercanti e tessitori nel Sette-cento”, 911-938, in Storia di Torino,vol. IV, Torino, Einaudi.
CERUTTI, Simona (1996), « Processus etexpérience : individus, groupes et identitésà Turin au XVIIe siècle », 161-186, in Jeuxd’échelles. La micro-analyse à l’expérience, J.Revel (dir.), Paris, Gallimard-Le Seuil.
CONTINI, Sabrina (2011), Matrimoni epatrimoni in una valle alpina. Il sistemadotale in Valsesia nei secoli XVIII e XIX,Varallo, Zeisciu Centro Studi.
CORAZZOL, Gigi (1979), Fitti e livelli agrano: un aspetto del credito rurale nelveneto del ‘500, Milano, F. Angeli.
DE CLEMENTI, Andreina (2003), “Dovefiniscono le rimesse. I guadagni dell’emi-grazione in una comunità irpina”, 291-338, in L’Italia delle migrazioni interne.Donne, uomini, mobilità in età moderna econtemporanea, A. Arru, F. Ramella (dir.),Roma, Donzelli.
DE VRIES, Jan (1984), European Urbaniza-tion 1500-1800, Cambridge Mass.,Harvard University Press.
EVE, Michael (2001), “Una sociologia deglialtri e un’altra sociologia: la tradizione di
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
62
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
studio sull’immigrazione”, QuaderniStorici, 106, 233-259.
FONTAINE, Laurence (1993), Histoire ducolportage en Europe (XVe-XIXe siècles), Paris,Albin Michel.
FONTAINE, Laurence (1996), “Gli studi sullamobilità in Europa nell’età moderna:problemi e prospettive di ricerca”,Quaderni storici, 93, 739-756.
FONTAINE, Laurence (2003), Pouvoir, identitéset migrations dans les hautes vallées des AlpesOccidentales (XVIIe-XVIIIe siècles), Grenoble,Presses Universitaires de Grenoble.
GARDEN, Maurice (1970), Lyon et les Lyon-nais au XVIIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres.
GOZZINI, Giovanni (1989), Firenze francese.Famiglie e mestieri ai primi dell’Ottocento,Firenze, Ponte delle Grazie.
GRIBAUDI, Gabriella (1980), Mediatori,Torino, Rosenberg & Sellier.
GRIBAUDI, Maurizio (1987), Itinérairesouvriers. Espaces et groupes sociaux à Turinau début du XXe siècle, Paris, EHESS.
GROPPI, Angela, HOUBRE, Gabrielle (dir.)(1998), CLIO. Histoire, femmes et sociétés,7, Femmes, dots et patrimoines, [En ligne],mis en ligne le 03 juin 2005. URL :http://clio.revues.org/704
GUENZI, Alberto, MASSA, Paola, MOIOLI,Angelo (dir.) (1999), Corporazioni egruppi professionali nell’Italia moderna,Milano, F. Angeli.
HANNERZ, Ulf (1980), Exploring the City.Inquiries Toward an Urban Anthropology,New York, Columbia University Press.
KAPLAN, Steven, KOEPP, Cynthia (eds.)(1986), Work in France. Representation,meaning, organization and practice,Ithaca/London, Cornell University Press.
KLAPISCH-ZUBER, Christiane (1990), « Lecomplexe de Griselda : dots et dons demariage », 185-213, in La maison et lenom. Stratégies et rituels dans l’Italie de laRenaissance, Ch. Klapisch-Zuber (dir.),Paris, EHESS.
LAMBERTI, Maria Carla (2002a), “Immigra-zione e mercato del lavoro in una città diantico regime: Torino all’inizio dell’Otto-cento”, Bollettino Storico-BibliograficoSubalpino, fasc. II, 583-629.
LAMBERTI, Maria Carla (2002b), “Una fonte“vecchia” per nuovi problemi: i censi-menti per lo studio della mobilità in etàpreindustriale”, Quaderni Storici, 110,545-552.
LAMBERTI, Maria Carla (2003), “Immigratee immigrati in una città preindustriale:Torino all’inizio dell’Ottocento”, 161-205, in L’italia delle migrazioni interne, A.Arru, F. Ramella (dir.), Roma, Donzelli.
LESGER, Clé, LUCASSEN, Leo, SCHROVER,Marlou (2002), “Is there life outside themigrant network? German immigrants inthe XIXth century Netherlands and theneed for a more balanced migration typol-ogy”, Annales de Démographie Historique,2, 29-50.
LEVI, Giovanni (1985), Centro e periferia diuno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte eLiguria in età moderna, Torino, Rosenberg& Sellier.
LEVI, Giovanni (1989), Le pouvoir auvillage : histoire d’un exorciste dans lePiémont du XVIIe siècle, Paris, Gallimard(éd. italienne, 1985, L’eredità immateriale.Carriera di un esorcista nel Piemonte delSeicento, Torino, Einaudi).
LEVI, Giovanni, RAMELLA, Franco (1989),“Immigrazione e doppio lavoro lungo ilcorso della vita. Alcune osservazioni sulPiemonte dell’Ottocento”, Annali Cervi,11, 101-110.
LUCASSEN, Jan, LUCASSEN, Leo, VAN DERLINDEN, Marcel (eds.) (1999), Migration,Migration History, History. Old Paradigmsand New Perspectives, Berne/Berlin/Frank-furt, Peter Lang.
MAITTE, Corine (2009), Les Chemins deverre. Les migrations des verriers d’Altare etde Venise (XVIe-XIXe siècles), Rennes, PUR.
MARTINI, Angelo (1976), Manuale di metrolo-gia ossia misure, pesi e monete, Roma, ERA.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
63
LA MIGRATION COMME PROCESSUS (TURIN AU XVIIIE SIÈCLE)
MAYER, Philips (1961), Townsmen or Tribes-men: Conservatism and the Process ofUrbanisation in a South Africa City, CapeTown, Oxford University Press.
MENZIONE, Andrea (1990), “Immigrazionea Livorno nel secolo XVII attraverso iprocessi matrimoniali”, Bollettino diDemografia Storica, 12, 97-102.
MOULIN, Annie, (1994), Les maçons de laCreuse : les origines du mouvement, Cler-mont-Ferrand, Institut d’études du Massifcentral.
PAGE MOCH, Leslie (1992), Moving Euro-peans. Migrations in Western Europe since1650, Bloomington/Indianapolis, IndianaUniversity Press.
PENE VIDARI, Gian Savino (1980-81),“Osservazioni sui rapporti patrimonialifra coniugi nel Piemonte del sec. XVIII”,Rivista di Storia del Diritto Italiano, 54,19-60.
PENE VIDARI, Gian Savino (1983), “Dote,famiglia e patrimonio fra dottrina epratica in Piemonte”, 109-121, in Lafamiglia e la vita quotidiana in Europa dal‘400 al ‘600, Atti del convegno internazio-nale Milano 1-4 dicembre 1983, Roma,Ministero dei Beni Culturali.
PERROT, Jean-Claude (1975), Genèse d’uneville moderne. Caen au XVIIIe siècle, Paris/LaHaye, Mouton.
PISELLI, Fortunata (1981), Parentela edemigrazione: mutamenti e continuità inuna comunità calabrese, Torino, Einaudi.
PISELLI, Fortunata (dir.) (1995), Reti. L’ana-lisi di network nelle scienze sociali, Roma,Donzelli.
POITRINEAU, Abel (1982), Remues d’hom-mes : essai sur les migrations montagnardesen France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris,Aubier-Montaigne.
POOLEY, Colin, TURNBULL, Jane (1998),Migration and Mobility in Britain since theXVIIIth century, London, UCL Press.
RAISON-JOURDE, Françoise (1976), La Colo-nie auvergnate de Paris au XIXe siècle, Paris,Commission des Travaux Historiques-Ville de Paris.
RAMELLA, Franco (1998), “In fabbrica e infamiglia: le operaie italiane a Paterson,New Jersey”, Quaderni Storici, 98, 383-427.
ROSENTAL, Paul-André (1999), Les sentiersinvisibles. Espaces, familles et migrationsdans la France du XIXe siècle, Paris, EHESS.
SAYAD, Abdelmalek (1999), La doubleabsence : des illusions de l’émigré aux souf-frances de l’immigré, Paris, Seuil.
WERBNER, Pnina (1990), The MigrationProcess. Capital. Gifts and Offerings amongBritish Pakistanis, New York/Oxford/Munich, Berg.
ZUCCA MICHELETTO, Beatrice (2006),“Flussi migratori a Torino nella secondametà del XVIII secolo”, Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino, CIV, fasc. II, 513-559.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin
64
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
Cet article étudie les liens entre le processusd'installation en ville et le maintien de patri-moines et de relations sociales dans lacommunauté d’origine parmi les immigrés àTurin dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.L'étude s'interroge sur la signification de laconservation et de la gestion de ces biensmatériels et relationnels par les migrants, endépit de trajectoires de vie visiblementorientées vers l'installation définitive enville. Elle analyse en outre les raisons suscep-tibles d’amener à la liquidation de ces bienset à l’abandon de ces relations. À l'aide d'uncorpus important d'actes notariés et d'une
méthodologie de recherche fondée sur lareconstruction biographique, cette étudemontre que l'entretien de biens et d'autresressources « à distance » est lié à certainesphases et/ou situations spécifiques de l’exis-tence des migrants et ne se maintient quejusqu'à l’émergence d’exigences nouvellesdevenues prioritaires. Ce travail entend ainsimontrer à quel point il est pertinent d’abor-der les phénomènes migratoires de l'époquemoderne comme des processus en devenir,c'est-à-dire des parcours réalisés par étapesqui évoluent au fil des années et en fonctiondes projets et des attentes des migrants.
This article focuses on the relationshipbetween the settlement patterns of migrantsin 18th century Turin and their decision tokeep assets in and relations with their nativecommunity. This work investigates how andwhy migrants in Turin maintained and mana-ged material and immaterial resources in theircommunity, even if they settled in the city. Inaddition, the paper studies the conditions inwhich these assets and relationships becameless important and respectively were sold outand abandoned. Based on a large sample ofnotarial deeds and by means of a biographic
reconstruction methodology, this researchshows that the decision to keep assets andrelationships which were (quite) far fromTurin was strictly connected to specific lifephases and situations of migrants. Conse-quently, these goods were hold up until otherneeds became prior. In turn, more importantinvestments elsewhere were required.Furthermore, this paper suggests the reliabi-lity of studying Old Regime migrations asphenomena in progress, that is, paths realizedstep by step, which could change over theyears with migrants projects and wishes.
RÉSUMÉ
SUMMARY
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 22
0.41
.2.5
7 -
23/0
8/20
13 0
7h05
. © B
elin
D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 220.41.2.57 - 23/08/2013 07h05. © B
elin