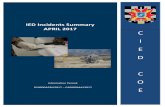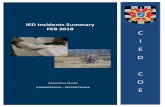Journal de lecture et de recherche - Théories des moments - Master 2 - EFIS - 2014-2015 - IED -...
-
Upload
univ-paris8 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Journal de lecture et de recherche - Théories des moments - Master 2 - EFIS - 2014-2015 - IED -...
Angéline GLUARD N° 12317335 E-mail : [email protected] Téléphone : 06 64 13 60 33
Théorie des moments
Journal de recherche
A partir du livre :
Henri Lefebvre et la pensée du possible, Théories des moments et
construction de la personne, Remi Hess, Paris : Anthropos, 2009
Enseignant :
Remi HESS
Master 2 Sciences de l’Éducation
Éducation, formation et intervention sociale (EFIS)
IED PARIS 8 - Année 2014/2015
GLUARD_Angéline_Théorie_des_moments_Journal_de_recherche_M2_2014-2015_V2
Cette version corrige les erreurs que j’ai pu noter depuis la dernière publication…
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 2 Janvier 2015
Sommaire
Introduction ................................................................................................................................ 3
Journal de recherche ................................................................................................................... 4
Petite conclusion, avant la suite…à l’attention de Remi Hess ................................................ 115
A voir plus tard ....................................................................................................................... 117
Ça peut servir ......................................................................................................................... 120
À garder, à étudier, à creuser pour ma recherche et le mémoire de Master 2 ........................ 122
Bibliographie .......................................................................................................................... 122
Webographie ........................................................................................................................... 124
Index ....................................................................................................................................... 127
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 3 Janvier 2015
Introduction
Mercredi 26 novembre 2014, 12h32, voiture, mon coin romantique au bord de l'eau
J'ai terminé, cette nuit à deux heures du matin, la lecture du livre de Remi Hess sur Henri
Lefebvre. Je n'ai pas tenu mon objectif de terminer dimanche soir comme je me l'étais fixé. Je
comprends maintenant pourquoi. Ma lecture a été impliquée. Impliquée au point de me mettre,
non seulement à identifier les points « A voir plus tard », et « Ça peut servir », comme je le fais
souvent, à surligner ce qui me paraît indispensable « à garder et à étudier » pour l'élaboration
de mon mémoire de Master, mais aussi à écrire les fondations, les plans et les premières briques
de ma construction, de mon advenir, de ce qui pourrait être possible, de ce qui me fait envie
pour la suite, pour rester en-vie.
J'ai noté au fur et à mesure de la lecture, débutée il y a douze jours exactement, tous les passages
qui ont permis à mon esprit de transductiver. Remi Hess écrit page 157 : « La pensée associative
ne serait-elle pas le non-moment, par excellence ? ». J'aurais plutôt tendance à appeler ce
moment, chez moi : le moment de l'ébullition. C'est un moment que j'aime, un moment qui
arrive sans l'avoir forcément choisi (le cas pour cette lecture, puisque je ne l'imaginais pas au
début). Ce moment me permet de me sentir vivante, de me faire prendre conscience que mon
cerveau fonctionne bien, en tout cas, les connexions ont l'air de se faire correctement,
rapidement et profondément.
Au-delà du fait que la lecture de ce livre montre Remi Hess dans différents moments de sa vie,
j'ai découvert sa sensibilité et son intérêt pour le romantisme allemand, l'esprit d'humanité, les
thèmes centraux de mon mémoire de Master, de l’œuvre que je souhaite produire cette année.
Samedi 27 décembre 2014, 12h37, bureau, maison,
Je reprends l'écriture et la mise en page de ce journal.
Voici le code des couleurs que je vais utiliser ici :
Surligné en gris : les passages du livre qui m'ont interpelés
Encadré en bleu : mes réflexions ultérieures à la lecture du livre et à mes prises de notes initiales
Surligné couleur sable : texte issu d’e-mails ou de posts sur les forums
Surligné en vert : textes d’autres auteurs
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 4 Janvier 2015
Journal de recherche
Vendredi 14/11/2014, 18h10, La Rochelle, bar de la marine
Page 6 :
« H. Lefebvre n’est pas le premier à s’intéresser à ce concept de moment. Hegel lui donne une
place importante dans son œuvre. Dans la pensée philosophique allemande, cette
conceptualisation est d'ailleurs constamment présente, même si R. Hess montre qu'elle reste
implicite.
Chez Hegel, le concept a d’ailleurs plusieurs significations. R. Hess a trouvé un emploi
complexe de ce terme chez les auteurs contemporains de Hegel, par exemple dans Les écrits
pédagogiques de Schleiermacher (1826), mais en même temps, à cette époque, la théorie des
moments, bien que présente, n’est pas dégagée. »
Hegel fait partie des allemands de l'époque romantique que je dois étudier pour mon mémoire,
pour ma culture philosophique et pour moi. Je note que chez Hegel le concept de moment est
présent et qu'il a plusieurs significations. Cela me donne une piste de recherche. Je note
également « Les écrits pédagogiques de Schleiermacher » et je trouve deux liens intéressants,
issu du dictionnaire de Ferdinand Buisson1 et un article de Didier Moreau2, mon directeur de
mémoire. Je sauvegarde cet article dans mon dossier « Projet de recherche/Documents de
travail », il me sera sûrement très utile.
Samedi 15/11/2014, 21h37, bureau, maison
Page 12 :
« Henri Lefebvre est le théoricien du «Possible».
Il y a quarante ans, dans Position : contre les technocrates, en finir avec l'humanité-fiction, il
nous propose les «fragments d'un manifeste du Possible».
[...]
C'est d'un abîme qu'il faut parler (p. 15).» Alors que l'on envoie des fusées dans la lune, on est
incapable de produire des logements aux cloisons insonorisées ! Nous nous trouvons face à la
loi d'inégal développement. »
1 http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3596 2 https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/807343/filename/Comprendre_pour_A_duquer_les_aphorismes_pA_dagogiques_de_Schleiermacher.pdf
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 5 Janvier 2015
Non seulement cet abîme de la loi d'inégal développement nous montre que dans notre société
les décalages sont impressionnants mais on peut voir aussi les décalages qu'il peut y avoir entre
les différentes parties du globe.
Je lis un article qui parle de ce texte : René Lourau. Henri Lefebvre, Position : contre les
technocrates, Paris, Éditions Gonthier, 1967, L'Homme et la société, 1967, vol. 4, n° 1, pp. 251-
2553.
Je garde ce texte dans mon dossier «_COURS\UE1-Théorie des moments»
Pages 12-13 :
«L'anthrope devra savoir qu'il ne représente rien et qu'il prescrit une manière de vivre plus
qu'une théorie philosophico-scientifique. Il devra perpétuellement inventer, s'inventer, se
réinventer, créer sans crier à la création, brouiller les pistes et les cartes du cybernanthrope, le
décevoir et le surprendre. Pour vaincre et même engager la bataille, il ne peut d'abord que
valoriser ses imperfections : déséquilibre, troubles, oublis, lacunes, excès et défaut de
conscience, dérèglements, désirs, passion, ironie. Il le sait déjà. Il sera toujours battu sur le plan
de la logique, de la perfection technique, de la rigueur formelle, des fonctions et des structures.
Autour des rocs de l'équilibre, il sera le flot, l'air, l'élément qui ronge et qui recouvre.
Il mènera le combat du rétiaire contre le myrmidon, le filet contre l'armure.
Il vaincra par le style (p. 230).»
Je ne sais pas ce qu'est un myrmidon. Une première définition 4 m'indique que c'est une
«personne de petite taille, insignifiante et sans valeur, voire prétentieuse, ridicule, et qui veut
paraître supérieure ». Sur Wikipédia, j'apprends qu'Ovide dans Les Métamorphoses, mentionne
les Myrmidons5, de simples fourmis travailleuses.
« Valoriser ses imperfections », me fait penser à Carl Rogers et la congruence, dont il parle dans
Le développement de la personne6. Savoir parler de ses problèmes pour faire émerger chez
l’autre le développement de la pensée d’un possible.
Journal imbriqué : samedi 27 décembre 2014, 19h34, bureau, maison
J'ai commencé depuis quelques jours la lecture des Métamorphoses d'Ovide. C'est passionnant.
Je note de faire attention quand j'y serai, aux Myrmidons, partie VII, ligne 6547.
3 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/homso_0018-4306_1967_num_4_1_1044 4 http://www.cnrtl.fr/lexicographie/myrmidon 5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Myrmidons 6 Carl ROGERS, Le développement de la personne, Paris : DUNOD, 1968 7 http://bcs.fltr.ucl.ac.be/META/07.htm
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 6 Janvier 2015
Page 13 :
« Accompagnant un mouvement politique qui veut fédérer les résidus des systèmes, nous
voudrions montrer qu'un effort de l'individu est possible pour développer les germes qu'il porte
en lui, pour les développer et se tourner systématiquement vers une création de la personne
comme œuvre. »
Mon projet de recherche, cette année, comme en Master 1 porte sur la formation de soi. La «
création de la personne comme œuvre », et cette notion d'effort que l'individu va devoir faire
me paraît primordial. Faire l'effort, de changer, de réfléchir à sa condition, de se demander
pourquoi l'on veut se former, de se donner les moyens de développer sa formation de soi, est
nécessaire. Je me rapproche du sujet de recherche que j'aimerais bien entamer un jour sur le
point d'équilibre, le point où tout bascule, le point où l'on se dit, où l'on se parle à soi-même, où
l'on découvre que l'insupportable est atteint, qu'il faut un changement. Je l'ai vécu ce moment,
je sais donc qu'il est possible… Je le raconterai si j’ai le temps.
Journal imbriqué : vendredi 26 décembre 2014, 12h58, The roof-escalade, La Rochelle
J'attends Gaël, Lucas et son ami Valérian. Ils font du « bloc ».
Je me décide aujourd'hui à reprendre l'écriture impliquée de ce journal de recherche. Et j'ai
envie d'imbriquer mes réflexions, ce que je ne fais pas d'habitude et qui me donne l'impression
désagréable de tricher lorsque je reprends mes notes. Voilà. Ce sera encadré en bleu. Je vais
préparer un code couleur que je vais mettre en introduction.
Je viens de relire ce que j'ai écrit depuis le début. C'est drôle, j'étais à La Rochelle aussi le 14
novembre lorsque j'ai commencé la lecture du livre sur Henri Lefebvre.
Je disais donc que je me suis relue et comme je l'ai indiqué dans le cours « Ecriture et expérience
professionnelle » de Martine Morisse, j'ai l'impression d'être une autre personne quand j'écris
et surtout quand je me relis. J'aime bien en général ce que je lis de moi. Mais si j'en éprouve le
besoin, je modifierai un peu mes phrases, si elles sont mal tournées ou si elles nécessitent des
précisions pour la bonne compréhension.
Page 13 :
« La théorie des moments voudrait se proposer pour penser la dissociation, pour transformer en
ressource ce que l'homme d'aujourd'hui vit comme dispersion, fragmentation. La théorie des
moments est un effort pour articuler continuité et discontinuité, unité et diversité, forme et
fragments, thème déjà réfléchi, au niveau de l'œuvre, par les Romantiques allemands (1799-
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 7 Janvier 2015
1800), dans leur revue, l'Athenaum. Cette théorie peut donc s'inscrire dans un continuum de
pensée. Elle a sa place dans une histoire de la philosophie de la conscience.»
Les romantiques allemands ? Je suis surprise et plutôt heureuse de lire cette phrase. Les
« fragments » me font penser aux Fragments de Novalis8, que j’ai lus en partie, l’an passé. Les
œuvres de Novalis sont présentes dans la bibliographie de mon projet de recherche. En revanche
je note de chercher des informations sur la revue l’Athenaum.
Page 14 :
« Construire une théorie des moments constitue un enjeu déterminé : apporter des outils à ceux
qui veulent penser leur vie au-delà de l’année scolaire, comptable ou fiscale, à ceux qui veulent
construire une unité, une cohérence, une totalité dans l’œuvre de leur vie, sans la réduire à une
seule de ses dimensions. Le moment, c'est l'effort pour donner de la consistance aux germes
que nous portons. C'est une méthode qui, partant que quotidien, tente de nous faire entrer dans
le possible. »
Dans ce paragraphe, ce sont les notions d’effort, comme vu plus haut, d’outil, de méthode, du
quotidien qui m’intéressent. Les « conseillers », dans le sens les conseilleurs ne sont pas les
payeurs, ne proposent jamais d’outils. C’est un peu trop facile de dire « fais ça » et « tu
obtiendras ça ». Comment fait-on ? Un jour, c’était il y a quinze ans, j’ai eu une formation, du
coaching en développement personnel. Le formateur, nous a dit que ce serait bien d’écrire ce
que nous aimerions être, qui nous aimerions être, dans un an, dans deux ans, dans dix ans, dans
trente ans.
Mais il ne nous a pas donné d’outil pour écrire ça. Je me souviens seulement de ce conseil
aujourd’hui et bien sûr, je n’ai jamais rien écrit sur ce que j’aimerais devenir. Je ne pense pas
que ce soit trop tard… j’ai encore du travail à faire pour construire ma vie, mon œuvre. Mais
c’est vrai que je verrais un peu mieux où je vais si j’écrivais là où je veux aller. J’hésite à mettre
ce point à l’ordre du jour de la rubrique pour ma recherche ou à voir plus tard… Je vais le mettre
dans les deux.
Dimanche 16 novembre 2014, 10h25, bureau, maison
Page 14 :
8 Novalis, Œuvres complètes. 2, Les fragments, Paris : Gallimard, 1975
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 8 Janvier 2015
« Je veux me penser comme une personne qui, au-delà de ses dissociations, construit son unité
dans la diversité. Concrètement, je fais des projets, auxquels je m'identifie.
[…]
Ces moments ne sont pas les mêmes pour tous, mais les observer met au jour qu’ils nous
constituent une identité, notre identité. »
Je m’interroge sur le fait de construire son unité dans la diversité. En effet, je suis unique. Moi,
Angéline, personne n’a eu la même vie que moi, ni les mêmes expériences, ni les mêmes goûts,
ni les mêmes qualités ou défauts. Mais est-ce que cette diversité me construit réellement ? Cela
m’apporte des expériences. Je peux dire que je déteste être au milieu d’une foule, ou bien que
les lentilles, jamais, je n’en mangerai. J’adore regarder les vagues de l’océan, j’aime écouter
mes garçons jouer de la guitare. Est-ce que cela me construit ? Non. En revanche, observer ces
moments, prendre le temps de se demander pourquoi ce moment est plaisant pour moi ou non,
essayer de comprendre pourquoi un moment que j’aime ne sera pas apprécier par d’autres, ou
l’inverse, c’est cela qui me construit. Et c’est comme cela que je vais pouvoir faire des projets
réellement pour moi et non pas pour faire plaisir à quelqu’un, qui pourrait me faire croire que
« ça », c’est un projet pour moi.
Journal imbriqué : samedi 27 décembre 2014, 22h20, bureau, maison
Page 126, du livre L’entrée dans la vie9, Georges Lapassade écrit : "Au stade de l'autonomie,
l'enfant […] est en principe libre de faire son choix". Si je reprends l'étymologie du mot
autonomie, du grec autos : soi-même et nomos : loi, règle, je suis autonome, je suis libre de mes
choix, je me crée mes propres règles. Mais pour cela, il faut en avoir conscience.
Page 15 :
« Définition du moment
Le terme de moment est polysémique. On peut cependant identifier trois principales instances
de ce terme : le moment logique, le moment historique, enfin le moment comme singularisation
anthropologique d’un sujet ou d’une société. »
Je note cette définition du moment, même si je la trouve un peu complexe. A voir plus tard pour
essayer de la traduire en langage de tous les jours.
9 LAPASSADE Georges, L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement de l’homme, Paris : Anthropos, 1963-
1997
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 9 Janvier 2015
Page 15 :
« Ce contexte sémantique n’échappe pas à Hegel lorsqu’il conçoit sa logique dialectique. Dans
son Introduction à la critique de la philosophie du droit, Hegel élabore le modèle d’une
dialectique organisée en trois moments. La dialectique hégélienne distingue l’universalité, la
particularité et la singularité. »
Voici donc les définitions selon Hegel, vu plus haut. Qu’est-ce que la dialectique et ses
différents modèles selon Hegel ? Wikipédia m’aide10 et je peux résumer ainsi : pour Hegel, la
dialectique c’est la thèse, l’antithèse et la synthèse. C’est bien sûr un peu plus complexe que ça,
mais j’ai besoin de simplicité, de traduire ces concepts pour le commun des mortels.
Page 16 :
« En éducation, dans ses écrits pédagogiques, Friedrich Schleiermacher montre que la difficulté
de l’école est de mobiliser l’enfant qui vit dans le présent pour travailler à se préparer un avenir.
Le moment présent lutte contre le moment à venir : “ Dans chaque moment pédagogique, on
produira donc toujours quelque chose que l'enfant ne veut pas. Chaque moment précisément
pédagogique s'avère ainsi comme un moment inhibant. La conscience immédiate est égale à
zéro. ” Et plus loin : “ Chaque influence pédagogique se présente comme le sacrifice d'un
moment précis pour un moment futur. On se demande donc si on a le droit d'effecteur de tels
sacrifices [p. 46]. ” »
Ce passage m’interpelle parce qu’il me fait penser à mes garçons qui ont compris, depuis qu’ils
sont petits, que c’est bien pour préparer leur avenir, c’est bien pour eux, qu’ils travaillent à
l’école. Ma mère a une petite phrase qui résume : « tant qu’à se lever chaque matin, autant que
ça serve à quelque chose, autant que ce soit efficace. »
Alors c’est vrai que j’ai cette chance de n’avoir pas eu besoin pendant toute leur scolarité de les
pousser à apprendre leurs leçons. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et je n’arrive pas à trouver un
exemple pour illustrer ce que moi, ou le père de mes enfants, avons fait pour que ni l’un ni
l’autre ne vivent exclusivement dans le présent. Il faut que je leur demande, ce sera le plus
simple.
10 http://fr.wikipedia.org/wiki/Dialectique
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 10 Janvier 2015
Journal imbriqué : samedi 27 décembre 2014, 23h27, bureau, maison
Je m’aperçois en me relisant ici, que je n’ai pas posé ma question aux garçons. Je viens de leur
envoyer un e-mail, ils ne sont pas là cette semaine. Je reviendrai mettre la réponse, si elle arrive
avant de rendre ce journal.
De : Angéline Gluard
Envoyé : samedi 27 décembre 2014 23:26
À : 'Rémi'; 'Lucas'
Objet : Question pour mes cours...
Coucou mes garçons,
Désolée de vous mettre encore à contribution, mais vous êtes ma principale source
d’inspiration, alors, je viens « puiser ».
Si vous trouvez que j’abuse, ce n’est pas grave je ne serai pas vexée si vous ne me répondez
pas.
Voici la question du jour, à partir de cette phrase d’Henri Lefebvre, dans la Théorie des
moments… :
« … la difficulté de l’école est de mobiliser l’enfant qui vit dans le présent pour travailler à se
préparer un avenir. »
J’écris que mes garçons, depuis qu’ils sont petits savent que c’est pour eux qu’ils travaillent
et que j’ai rarement été obligée de les pousser à faire leurs devoirs, par exemple. Enfin, en
tout cas, j’ai cette impression.
Si vous pensez, comme moi, que vous travaillez consciemment à vous préparer un avenir,
comment, par quelle méthode, quels mots avons-nous dit, ou pas dit, votre père et/ou moi,
ou bien les instits’, ou quelqu’un d’autre, pour que cette mobilisation se fasse ?
Bisous tout plein,
Mum
PS : j’en profite pour vous dire que je suis super fière de vous deux. Je vous aime mes garçons
chéris.
Journal imbriqué : dimanche 28 décembre 2014, 11h32, bureau, maison
J’ai eu la bonne surprise en me levant ce matin de lire la réponse de Lucas. Je laisse ses phrases
sans aucune modification.
De : Lucas
Envoyé : dimanche 28 décembre 2014 00:21
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 11 Janvier 2015
À : Angéline
Objet : Re: Question pour mes cours...
Coucou,
pour ma part j'ai toujours travaillé avec sérieux car j'ai très vite compris que l'argent ne vient
pas en claquant des doigts. Et une des choses qui m'ont motivé a été de voir les abrutis que je
me coltinait dans mes classes de collège et de m'imaginer leur avenir, et ce n'était pas très beau
à imaginer. Du coup j'avais une sorte de " regarde ce qui t'attends si tu ne travailles pas assez !!
", et cela m'aidait a bien travailler. J'ai donc gardé cette méthode et j'ai pris l'habitude de me
forcer à travailler. Malheureusement, j'ai eu l'impression de me relâcher vers les dernière
semaine et encore maintenant, mais je pense que c'est l'attente des vacances qui a provoqué
cela. Pour revenir sur la phrase du bonhomme, je pense que certains élèves, au collège, ne se
rendent pas compte que ne pas travailler vas beaucoup les handicaper, et cette prise de
conscience ne se fera qu'au lycée, donc l'élève qui n'a rien retenu des ses cours élémentaires ne
s'en sortira pas, mais il y des aides pour ça je dis peut être n'importe quoi.
Je pense que papa et toi nous avez bien éduqués car vous nous avez laissé le choix, quand les
parents forcent l'enfant à avoir des bonnes notes ou une limite de moyenne ( l'année dernière,
le père à Nathan voulait qu'il ai 15 de moyenne au minimum ), alors l'enfant se met la pression,
et par expérience, je sais que l'on fait beaucoup plus d'erreurs stressé que détendu.
Voilà j'espère t'avoir aider, j'ai peut être dit n'importe quoi mais bon.
Désolé pour les fautes d'orthographe s'il y en a.
Nous aussi on est fier de toi.
Bisous,
Lucas
Si je reprends son texte, Lucas a bien appliqué une méthode : une première phase d’observation,
une deuxième phase de création de son leitmotiv, un outil, une petite formule magique qu’il se
répète et une troisième phase : l’effort à fournir. J’ai presque envie de rajouter une quatrième
phase : celle où il prend conscience que ses efforts sont récompensés, qu’être détendu, libre de
ses choix lui permet de faire moins d’erreurs et il a la capacité d’analyser son comportement du
moment (le relâchement à l’approche des vacances).
Je vais m’arrêter là pour ce matin. Nous allons déjeuner avec la famille de Gaël pour un Noël
en retard…
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 12 Janvier 2015
Dimanche 16/11/2014, 12h37, bureau, maison
Page 17 :
« La prise de conscience d’un déjà vécu, dans une situation aux conditions similaires, permet
de dénommer et de structurer le moment (moment du travail, moment de la création) et de
pouvoir à nouveau l’identifier, à partir de ses critères connus, liés aux éléments constituant sa
situation. En prenant conscience du moment, on prend également conscience de son épaisseur
à la fois dans l’espace (situation) et dans le temps ouvert (le retour du moment sous une forme
comparable). Dans le déroulement du temps, on va pouvoir distinguer différents moments
anthropologiques (le moment du repas, le moment de l’amour, le moment du travail, le moment
philosophique, le moment de la formation, etc.). »
C’est curieux, j’ai bien cette sensation d’« épaisseur » du moment. Et ce qui l’est encore plus
c’est que deux exemples de méthode de conscientisation de moment me viennent à l’esprit : les
albums de « Martine11 » et les accessoires des poupées Barbie. Un petit retour en enfance…
De Martine à la ferme à Martine fête son anniversaire, en passant par Martine fait la cuisine,
que j’ai lu et relu, quand j’étais petite fille, les situations bien particulières de cette petite
aventurière du quotidien.
Pour les poupées Barbie, c’était le moment de la baignade avec la tenue « maillot de bain », le
moment du bal avec la magnifique robe étincelante, ou bien celui de la sortie à cheval avec sa
tenue d’équitation.
Je n’ai pas étudié avec attention ce qui inonde aujourd’hui les rayons de jouets des filles ou
garçons, je ne sais donc pas s’il existe toujours cette distinction dans les moments
anthropologiques où l’enfant peut s’identifier.
Page 17 :
En 1808, Marc-Antoine Jullien propose de distinguer le moment du corps et de la santé, le
moment de la rencontre avec les autres, et le moment du travail intellectuel.
Ce livre de Marc-Antoine JULLIEN12, Essai sur l'emploi du temps ou méthode qui a pour objet
de bien régler l'emploi du temps, premier moyen d'être heureux, destinée spécialement à l'usage
11 Gilbert Delahaye, Marcel Marlier, Martine…, Bruxelles : Casterman, 1954 (pour le numéro 1) 12 Marc-Antoine Jullien, 1810 (seconde édition), Essai sur l'emploi du temps ou méthode qui a pour objet de bien
régler l'emploi du temps, premier moyen d'être heureux, destinée spécialement à l'usage des jeunes gens de 15 à
25 ans, Paris : Didot
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 13 Janvier 2015
des jeunes gens de 15 à 25 ans, que l’on peut trouver en version ancienne, numérisée13, est
sûrement l’une de mes plus précieuses découvertes de ma reprise d’études. Kareen Illiade a
édité un livre sur le sujet, mais je ne l’ai pas encore lu et je ne sais pas s’il est accessible à tous.
Je vais noter de me pencher sérieusement sur le sujet. Je me souviens d’avoir envoyé le lien à
ma sœur Alexandra qui intervient auprès d’adolescents en lycées professionnels. Elle l’a lu et
utilise certains trucs et astuces, mais je ne sais pas lesquels. A voir plus tard.
Page 17 :
Se former, c’est donner forme et signification à ses moments. C'est aussi une possibilité pour
concevoir l'advenir.
Quand j’ai repris le conservatoire en 2011, après avoir, adolescente, étudié la flute traversière,
et que j’ai commencé à apprendre le violoncelle, j’ai pris conscience de ce que ce moment
musical signifiait. La flûte, c’est ma mère qui avait choisi cet instrument, parce qu’elle avait vu
un concert flûte et harpe et que la flûte ce serait plus pratique et moins cher qu’un piano,
l’instrument que j’aurais aimé étudier… Donc ce moment était un premier pas vers mon
autonomie, à 41 ans ce serait temps !
Apprendre à jouer d’un instrument est prenant, ça voulait donc dire, que j’allais avoir un
moment pour moi, un moment régulier et intense, comme ça ne m’était pas vraiment arrivé
depuis des années, parce qu’il y avait les enfants, le travail, la routine, et surtout le fait de penser
que ce n’était pas possible.
Depuis, je me suis trouvée un autre moment, celui des études qui a mangé mon moment musical.
Mais mon violoncelle m’attend, bien emmitouflé dans sa housse que je lui ai faite moi-même
pendant un de mes moments couture…
Pour en revenir à la phrase que j’ai surligné ici, me former au violoncelle, instrument que j’ai
choisi, dont j’avais envie, cela m’a donné la possibilité de concevoir mon « advenir ». Cela m’a
permis de me rendre compte que je pouvais envisager de me former à autre chose, encore et
encore. Je ne suis pas déçue.
Page 20 :
13
http://books.google.fr/books?id=Md8UAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 14 Janvier 2015
Comme au monde, la relation à l’autre (aussi bien dans ses formes individuelles que collectives,
groupales ou sociales) y reste fondamentale. Quand la durée rejoindra la temporalité (Jean-Paul
Sartre) et l’historicité (Henri Lefebvre), elles s’ouvriront nécessairement davantage, les unes
comme les autres, à l’intersubjectivité. Celle-ci nous semble devenir alors la trame ultime de la
complexité.
Complicité et complexité sont intimement liées, et mériteraient, en ce sens, une analyse plus
approfondie.
Je note moi aussi de prévoir d’étudier cette liaison intime de complicité et complexité, que je
ne comprends pas vraiment au moment où je lis ceci. A voir plus tard.
Page 21 :
Dans les usages gestionnaires les plus répandus, le temps calendaire se transforme facilement
en espace ou en étendue (les “ emplois du temps ”, les échéanciers, les programmes et les plans,
avec leurs exigences de mensuration et de quantification, d’évaluation, les rapports coûts-
efficacité…) ; ils se dévitalisent, se déréalisent et se déshumanisent à partir d’une rupture
dialectique avec la praxis (celle-ci soigneusement distinguée des pratiques plus routinières).
Une homogénéisation galopante que tout contribue aujourd’hui à renforcer (politique-spectacle,
recherche de conformisation, “ politiquement correct ”, mondialisation-globalisation,
concertation au lieu de négociation…) en résulte encourageant une sorte de médiocratisation
généralisée.
C’est en effet assez frappant cette homogénéisation. Pour prendre un exemple concret et plus
terre à terre, il suffit de regarder la tête magnifique des tomates identiques, bien rangées des
supermarchés mais au goût détestable.
« …la gestion managériale des conflits les digère littéralement, pour mieux les contrôler et les
maîtriser. Mais, évidemment, de façon, cette fois, toute dialectique, une telle “ anesthésie
sociale ” aboutit à faire de ce cimetière de conflits, inconsidérément réduits et “ traités ”, le lit
d’une violence beaucoup plus dangereuse, parce que “ déniant ” la réalité de l’autre en
désaccord, et n’entrevoyant plus comme issue que l’éradication pure et simple des “ obstacles ”.
Ce passage me sera utile peut-être dans mon environnement professionnel actuel, ainsi que
l’ouvrage : Cf. Jean-Pierre Le Goff, Le mythe de l’entreprise, La Découverte/essais, Paris, 1992.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 15 Janvier 2015
Page 23 :
Le “ moment ” a quelque chose à voir avec “ l’éternel retour ” de Nietzsche*. Pour ce dernier,
la puissance n’est pas infinie. C’est même la thèse centrale du nietzschéisme, selon H. Lefebvre.
“ Le monde est un infini fini. Son aspect infini, c’est le temps. Les énergies et les possibles, les
actes, les moments sont finis, c’est-à-dire à la fois déterminés, discontinus, non épuisables ”.
* Note : H. Lefebvre, Nietzsche, Editions sociales internationales, Paris, 1939, p. 83. Ce livre a été réédité en
2003 chez Syllepse (Paris).
Je note cet ouvrage à lire plus tard, mais surtout, je voudrais ajouter que l’aspect infini pour moi
c’est non seulement le temps, mais aussi la répétition de chaque moment fini. Et ces moments
qui peuvent être plus ou moins les mêmes et qui se répètent depuis le début de l’humanité, me
paraissent avoir cet aspect « infini » : moment de l’alimentation, moment de la chasse, moment
de l’amour, moment de l’éducation, moment de la famille, moment du travail,…
Page 24 :
Le moment tel que le formule ici H. Lefebvre est donc quelque chose qui revient, une forme
que l’homme donne à ce qui revient. C’est une forme, une Bildung*, terme qu’il emploie, dans
le même ouvrage, à propos du travail que Marx et Engels avaient opéré par rapport à l’œuvre
de Hegel : “ Marx et Engels avaient donné une forme – une Bildung – européenne au sentiment
germanique et hégélien du devenir. Le moment où il avait été possible de concevoir cette grande
synthèse, où ses éléments s’étaient, comme spontanément, présentés à la méditation, était
passé ».
* Note : Dans ce contexte, G. Weigand préfère le mot allemand Form au mot Bildung. C'est le mot
qu'utilise Humboldt.
Hegel, Humboldt, Bildung, mon moment de la recherche n’est lui, pas encore terminé, je suis
en plein dedans… Je cherche dans le texte du livre de Remi Hess, et je trouve les références de
l’ouvrage : Marx, F. Engels, L'idéologie allemande, Edition sociales, 1968. Je suppose qu’ici je
trouverai de la matière sur le « sentiment germanique et hégélien du devenir ». Le devenir est
un terme important je pense pour ma recherche sur la formation de soi tout au long de la vie. Je
note aussi ce terme.
Page 24 :
« L’auteur de Zarathoustra montre qu’il faut dire non à tout instant limité et en proie au néant
et dire oui à l’accomplissement. »
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 16 Janvier 2015
Vivre pleinement, intensément, chaque moment de sa vie : on le dit souvent mais le fait-on
vraiment ?
Si je dis que je veux passer une semaine de vacances et profiter de mes garçons, qu’est-ce que
je vais faire concrètement ? Rester devant mon ordinateur, pendant qu’eux seront chacun dans
leur chambre, ou devant la télévision, supporter leur « bof » si je propose une activité ? Et en
réfléchissant, à ces fameux moments d’accomplissement, c’est-à-dire, ceux où la présence au
moment est entière, c’est en effet ceux-là qui nous transportent, qui nous enrichissent, qui nous
prouvent que nous sommes vivants, humains et le bien-être est total. Mon exemple concret est
celui où, justement, je vais arrêter toute activité pour m’asseoir, me poser et écouter simplement,
regarder avec mes yeux de mère, mes deux garçons qui jouent de la guitare ensemble, ce qui
n’arrive pas forcément très souvent. Mais il se produit alors, une sorte d’osmose, un moment
de plaisir intense, où se mêlent musique, étincelles dans les yeux, partage, et je sais maintenant
que c’est ça la vie.
« Dire non à tout instant limité », c’est peut-être ce que je vis, inconsciemment jusque-là, avec
ma famille. Je n’ai pas envie de faire la route, de « perdre » du temps et des sous à trouver des
cadeaux à tous, alors, j’ai répondu « non » à toutes les invitations de ma mère et de mes sœurs.
Je fais l’ours… j’ai envie de ne voir que Gaël et mes garçons, je dis que je fais une overdose de
famille. Mais finalement, en lisant cette phrase, je me dis que c’est ça : je ne veux pas de ce
moment qui sera forcément limité, par manque de temps. Je préfère ne rien faire et me rattraper
plus tard… Je m’inquiète juste de savoir si ce ne sera pas trop tard… Ne pas culpabiliser…
Page 25 :
« Pour Zweig, Kant et les autres (Schelling, Fichte, Hegel et Schopenhauer) ont l'amour de la
vérité, « un amour honnête, durable, tout à fait fidèle. Mais cet amour est complètement
dépourvu d'érotisme, du désir flamboyant de consumer et de se consumer soi-même ; ils voient
dans la vérité, dans leur vérité, une épouse et un bien assuré, dont ils ne se séparent jamais qu'à
l'heure de la mort et à qui ils ne sont jamais infidèles. » Le rapport de Kant à la vérité est de
certitude conjugale. Cela rappelle le ménage, les choses domestiques. Kant et les philosophes
allemands qui ont suivi ont construit leur maison ; ils y ont installé leur fiancée. Ils travaillent
de main de maître à la valorisation du terrain qui entoure la maison. »
J’aime bien cette idée de construire sa maison et valoriser le terrain autour pour y installer « la
vérité ». Depuis ma mésaventure d’avoir été trahie, par le père de mes enfants, qui m’a menti
et trompé pendant des années, je visualise bien la vérité liée à la certitude conjugale…
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 17 Janvier 2015
Aujourd’hui, et ce n’était pas forcément le cas avant, où moi aussi, il m’est arrivé de mentir, la
vérité est devenue plus qu’un amour, c’est une passion, un phénomène qui me guide sans cesse.
Je dirais presque que la vérité me brule les doigts, ou plutôt la curiosité de connaitre la vérité…
En Licence et en Master 1, j’avais écrit mes réflexions sur la vérité. Je fais une petite reprise,
ici, du devoir de M1, lu et noté par Bertrand Crépeau :
GLUARD_Angéline_Journal_Penser_l_institution_Journal_de_recherche_M1_2013-2014 :
Page 20 :
Samedi 26 octobre 2013, 07h42, toujours dans le train
Je relis l'éloge de la sincérité de Montesquieu que Gérard Carton nous a transmis pendant le
séminaire « Le chemin du leadership », et je retiens cette phrase : « Ceux qui négligent de nous
la dire (la vérité) nous ravissent un bien qui nous appartient. »14
Page 72 :
Mardi 26 novembre 2013, 21h07, bureau, maison
Je vais reprendre mes deux textes de l'an passé sur le sujet de la vérité. Dans les extraits des
pédagogues, devoir de validation demandé par Augustin Mutuale, j'avais terminé comme ça :
Pour conclure, je citerai Jean Jaurès, dans son Discours à la jeunesse, au Lycée d'Albi, le 30
juillet 190315, paru dans Anthologie de Jean Jaurès de Louis Lévy, Paris : Calmann-Lévy, 1983,
p. 273 : « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi du
mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de
nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. »
Repris de mon journal du cours de Lucette Colin, Désir d'apprendre et ses aléas, en Licence 3 :
Dimanche 17 février 2013 à 17:45
J’ai deux garçons, adolescents de 14 et 16 ans. Je me souviens de la période des questions « Et
pourquoi ? Pourquoi ? ». Je leur ai demandé, après que j’ai eu lu le cours, s’ils avaient eu
l’impression d’avoir eu toujours les bonnes réponses à leurs questions, même celle de savoir
comment on fait les bébés… Oui, ils confirment : je ne leur ai pas dit qu’ils étaient nés dans des
choux ! Je me souviens de la période des questions, et d’avoir dépensé une bonne énergie à
répondre, trouver les réponses adaptées, à chercher quand je ne savais pas, à leur dire la vérité.
14 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k272923/f11.image 15Discours de Jean JAURES : http://fr.wikiquote.org/wiki/Jean_Jaur%C3%A8s
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 18 Janvier 2015
Je reproduis ce qu’on fait mes parents, tout simplement.
Et si c’était ce respect que l’on a de la parole de l’enfant, de sa question, de l’envie de lui
apporter une réponse, qui allait lui donner envie de continuer à être curieux, à connaître, à
savoir, à avoir envie d’apprendre… ?
Mardi 26 novembre 2013, 22h52, bureau, maison,
Page 74 :
J'ai retrouvé mes autres histoires de vérité, toujours dans le journal pour le cours de Lucette :
Dimanche 24 mars 2013 à 22 :58
Page 3, de la séquence 6 du cours : Dire la vérité, toujours, on en revient souvent à ce point.
Mais je me souviens du cours de Marilia AMORIM, Discours et construction de sens, au
premier semestre, sur ce sujet, j'avais essayé de me remettre en question par rapport à mon
obstination à dire « qu'il n'y a que la vérité qui compte ». J’avais alors trouvé les ouvrages
suivants que je vous fais partager ici, aujourd'hui :
- « Le principe général du mensonge est de manipuler des signes pour économiser des forces »
(Guy DURANDIN, Les Mensonges en propagande et en publicité, PUF, 1982, p. 29) ;
- « Le mensonge est, dans beaucoup de cas, la politesse du désespoir, le baume de la blessure.
Le mensonge est inhérent à la possibilité de penser et de dire, à la possibilité d'énonciation —
de dépasser l'exacte mesure, ce qu'on ne s'empêche la plupart du temps de faire (l'exacte mesure
n'existant que de manière partielle). ... Je pense donc je mens / je dis donc je mens / je mens
parce que je dis et je pense. » (Edmundo MORIM DE CARVALHO, Paradoxes des menteurs :
philosophie, psychologie, politique, société, Paris : L'Harmattan, 2010 (il existe plusieurs
volumes).
En revanche, le concept de Rousseau « La réponse doit donc se faire avec la plus grande
simplicité, sans mystère, sans embarras et sans sourire, elle ne doit pas laisser planer un mystère
sur la question parce qu'en fait, elle doit anéantir à tout jamais la curiosité de l'enfant16. » me
paraît être l'idéal : faire au plus simple quand on ne sait pas...
Forum de l'EC Discours et construction de sens, de Marilia AMORIM : Pour ce cours, j’ai
trouvé deux contre-exemples… 1- Catégorie de qualité : principe de sincérité
Extrait du cours : « Même si la sincérité est en général souhaitable, il y a bien des situations où
16 http://fr.wikisource.org/wiki/Page:Rousseau_-_Collection_compl%C3%A8te_des_%C5%93uvres_t4.djvu/386
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 19 Janvier 2015
le mensonge est préférable […] Par exemple, dans la situation de couple, il arrive parfois que
le mensonge, qu’il soit grand ou petit, devienne un moyen d’éviter le conflit […] pour que le
couple reste ensemble. »
Oui, je confirme, par mon expérience personnelle : le mensonge, permet d’éviter le conflit, mais
seulement le conflit immédiat.
Le mensonge, même celui qui est inconscient, c’est-à-dire le mensonge à soi-même, ne sera pas
un gage de solidité d’un couple.
Et un jour ou l’autre, celui ou celle qui aura pris cette liberté de mentir, ce retrouvera prisonnier
de ces mensonges, de ses non-vérités et de ses non-sincérités et un conflit bien plus grand pourra
se révéler. Encore une fois, par mon expérience personnelle, je peux dire qu’ « il n’y a que la
vérité qui gagne ».
Un petit exemple, hors histoire de couple (vous avez senti, en sous-entendu, que c’est un sujet
brûlant dans mon vécu !) :
Ma nièce Charlène est étudiante.
Tous les midis, elle déjeune dans son studio avec deux de ses amies Lydie et Mathilde.
Elles ont très peu de temps pour se préparer des pâtes et les manger.
Lydie n’aide jamais pour mettre le couvert ou pour faire bouillir l’eau des pâtes et s’installe
dans le canapé pour « jouer » avec son téléphone.
Charlène en a assez mais n’ose pas lui dire sincèrement ce qui l’exaspère et préfère « faire la
tête » et ne rien dire pour éviter un conflit…
C’est si simple pourtant ! Une petite vérité est toujours bonne à dire et à entendre : « Lydie,
j’aimerais que tu nous aides à mettre le couvert lorsqu’on arrive au studio ».
Et Lydie, soit elle participera, soit elle ne viendra plus chez Charlène si elle n’accepte pas le
« contrat ».
Ce n’est peut-être pas l’endroit, ni le moment de développer cette idée, dans ce cours, mais je
suis convaincue qu’il ne peut pas y avoir de conflit, entre des interlocuteurs qui se sont toujours
parlés avec sincérité, avec vérité et sans mensonge.
Aujourd’hui, je pense encore et toujours la même chose, la vérité est un bien vraiment précieux
pour soi, pour les autres, pour l’humanité.
Page 25 :
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 20 Janvier 2015
Alors que chez les autres philosophes allemands, l'existence s'écoule avec une tranquillité
épique, l'aventure intellectuelle de Nietzsche prend une forme tout à fait dramatique. C'est une
succession d'épisodes dangereux, surprenants. Il n'y a pas d'arrêt. On est dans des transports
permanents. Nietzsche ne connaît pas le repos dans la recherche. Il est soumis à une constante
obligation de penser. Il est contraint d'aller de l'avant. Sa vie a la forme d'une œuvre d'art. C'est
aussi une souffrance de ne pouvoir s'arrêter.
Il y a deux ans, en allant passer quelques jours à Berlin, j’avais acheté à l’aéroport, un journal
Le Point - Hors – Série sur Nietzsche17. Je venais d’avoir la licence, et je me disais que ce serait
bien que je me mette à étudier les philosophes, pour la suite, en Master 1. Le hasard a fait que
je débute avec lui…
Bien sûr, je ne suis pas une grande spécialiste, mais le peu que j’ai lu de lui et sur lui, m’ouvre
les yeux sur moi-même. Là encore, chez moi, il n’y a pas d’arrêt. Enfin si, quand je tombe,
d’épuisement… Et même si je sais que je dois me ménager pour ne pas tomber, je continue
quand même. Mon cerveau est en constante ébullition. Mais je n’ai pas envie de trop souffrir
alors il va falloir que j’apprenne à me reposer l’esprit… mais quand je découvre tout ça…
Page 26 :
« […] revenons à la lecture de ce Nietzsche d'H. Lefebvre. Il constate que les instants ne sont
pas d’égale densité. Certains acquièrent une certaine épaisseur. Ils s’enracinent profondément
dans la vie. […] Il y a aussi des paroles plus expressives que d’autres. Certains actes se
distinguent dans la masse des émotions et des instants, comme s’ils éclairaient un long
cheminement du temps. […] La durée de notre vie semble s’approfondir. La ligne du temps
semble devenir une spirale, une vivante volute, une involution de tout le passé. Le contenu de
la conscience s’élargit. Nous saisissons notre être avec une sorte de force rétroactive qui éclaire
le passé, le concentre et le porte au niveau du présent. »
Comme je l’ai écrit plus haut, vivre intensément un moment permet cette épaisseur,
l’approfondissement de la vie. En lisant la « spirale », là aussi ça me rappelle un des points que
j’ai dit le plus apprécier dans ma recherche, en master 1.
17 http://boutique.lepoint.fr/produit/483/nietzsche-%E2%80%93-le-philosophe-de-
l%E2%80%99anticonformisme
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 21 Janvier 2015
Rechercher l’intensité, l’épaisseur des moments, éclairer sa vie,… c’est aussi chercher de la
saveur, du goût, et c’est là qu’entre en ligne l’esthétique, dans le vouloir faire de sa vie une
œuvre d’art, ou plus simplement, dans le vouloir faire de sa vie une belle vie.
Page 29 :
« Tout étant est un positif, c’est-à-dire un posé ; en même temps qu’il est posé comme tel et
comme étant, se trouve simultanément posé un étant qui l’environne et que lui n’est pas […]
Hegel montre par exemple que la prairie n’est prairie que dans son opposition à la forêt ou aux
champs cultivés. Du fait qu’il est posé, chaque être est un opposé, un conditionné qui
conditionne. Dans son être-saisi, il renvoie par-delà lui-même. Il a besoin d’être complété. Il
n’est pas autonome. »
Dur dur pour cette fin d’après-midi. Mais je conserve ce passage, je suis sûre qu’il me sera utile
pour ma recherche. En tout cas je pense, que de toute façon, on n’est rien tout seul. Un étant,
un être humain, a besoin des autres, qui ont besoin de lui pour vivre.
Page 29 :
« Chaque moment spatial ou historique sera conservé dans ce dépassement-élévation
(Aufhebung, notion que nous reprenons ultérieurement). »
Je note ce terme Aufhebung. Se dépasser pour s’élever… Je verrais donc plus loin si cela
m’inspire, et si cela a un sens pour ma recherche.
Page 30 :
« Pourtant, en chaque acte, il y a le moment du Désir. Mais le Désir n'est jamais qu'un moment,
qui se supprime en jouissant pour laisser apparaître la vérité de la conscience, de la réflexion,
du concept. À la fin, le Sujet reconnaît et la vérité de chaque moment, de chaque désir, de
chaque plaisir, et la vérité de l'ensemble. Il unit la signification des moments, y compris le désir
et la jouissance, avec le sens, c'est à dire la vérité totale18. »
….
Journal imbriqué : lundi 29 décembre 2014, 22h47, bureau, maison
18 H. Lefebvre, La fin de l’histoire, Paris, Anthropos, 2° éd., 2001, p. 24-25.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 22 Janvier 2015
Je devais commencé à fatiguer, ce dimanche 16 novembre, où j’ai lu et écrit tout ça… et là,
pour ce passage je n’ai mis aucun commentaire.
Voici ce qui me vient à l’esprit maintenant. Le désir d’une cigarette… J’ai arrêté de fumer en
2011, avec une méthode qui pourrait s’apparenter à ce qui est écrit ici. Le moment du désir de
fumer une cigarette « n’est jamais qu’un moment », qui ne dure en réalité que trois secondes.
Je me souviens bien que tous les éléments de ma méthode, je les ai pensés, je les ai réfléchis
après le désir assouvi de les avoir fumées ces cigarettes. Et j’ai pu unir tous ces petits moments
de réflexion pour me créer ma vérité, ma méthode qui a bien fonctionné pour moi…
Je vais mettre mon petit texte ici :
Partage d'expériences : Arrêter de fumer, 23 juillet 2014, 14:42
Fumeuse depuis plus de vingt ans, j'ai arrêté le mardi 1er mars 2011.
Voici ma méthode, une liste de p'tits trucs :
- avoir très envie d'arrêter, et ça personne ne peut l'avoir à votre place
- fumer sa dernière en se disant que c'est la dernière
- changer ses croyances, se dire et écrire, je crois que je suis capable d'arrêter, je crois en ma
réussite
- transférer le bien-être immédiat que procure LA cigarette sur un autre thème, j'ai choisi les
odeurs
- ne plus fumer allait vouloir dire que je ne "sentirai" plus la cigarette, mais je sentirai bon
- transférer l'action d'aller acheter un paquet de cigarettes par l'action d'aller acheter un bouquet
de fleurs qui sentent bon, pendant quelques semaines
- avoir de la crème pour les mains dont on apprécie l'odeur, s'en mettre un peu et se frotter les
mains, le même temps que pourrait durer une cigarette, dès que l'envie de fumer est trop forte,
sentir ses mains (qui en plus deviendront toutes douces...)
- s'acheter un gros cadeau qui correspond à peu près au budget cigarettes (j'ai acheté ma
voiture...), se faire le marché suivant : si tu te remets à fumer, tu redonnes ton cadeau (j'adore
trop ma voiture pour la revendre...)
- pendant quelques mois, j'ai eu des rhumes, quintes de toux, mal à la gorge : j'avais l'impression
que toute cette partie interne avait été "brulée" et que tout repoussait, et ça passe, alors pas
d'inquiétudes.
Deux points très importants :
- se dire cette phrase : si tu as réussi à tenir jusqu'ici, tu peux continuer, ...si tu as tenu une
journée, tu peux continuer une autre journée...
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 23 Janvier 2015
- l'envie irrésistible de fumer une cigarette ne dure en fait que 3 secondes environ... 3
SECONDES, 1 2 3 JE NE CRAQUE PAS.... et voilà, c'est passé, on peut penser à autre chose
de plus intéressant...
Le point le plus important : arrêter de fumer c'est devenir LIBRE
Voilà, maintenant, je vais essayer d'appliquer ma méthode pour arrêter de grossir !!!
…
Partage d'expériences : Arrêter de fumer, 28 juillet 2014, 22:48
J'ai oublié une chose très importante dans cette histoire d'apprendre à arrêter de fumer ou de
grossir...Et ça m'est revenu aujourd'hui. On apprend des autres, on se sert des autres comme
modèles ou comme guides. Et pour arrêter de fumer, je me suis dit cette petite phrase comme
une sorte de rituel : si Jack, mon ancien chef a arrêté de fumer, je peux le faire !
Il a fumé la pipe pendant des années, puis trois paquets de Malbo par jour, et il a arrêté en 2010.
Page 33 :
« En somme la compréhension de la nature exacte de la contradiction, et notamment de son
degré d'universalité dans le temps (sa durée) et dans l'espace (son extension), est au cœur de la
méthode dialectique19. »
Je me rends compte que je ne sais pas ce qu’est la dialectique. Alors je note les références de
l’article de Jean-Marie Brohm.
Page 35 :
« La méthode dialectique consiste donc à saisir l'universel dans le particulier et le particulier
dans l'universel, c’est-à-dire à viser le singulier en tant que combinaison dialectique originale
et unique de l'universel et du particulier. Ces considérations théoriques peuvent être appliquées
à des situations très concrètes et actuelles. »
C’est ce dont j’ai besoin, de situations concrètes, pour comprendre cette méthode dialectique.
L’universel dans le particulier, le particulier dans l’universel, il va falloir que je me trouve des
exemples. Peut-être qu’après la lecture de l’article de Jean-Marie Brohm, ce sera plus simple…
19 Jean-Marie Brohm, “ Au sujet d'une sainte trinité dialectique : l'universel, le particulier, le singulier ”, in Les
IrrAIductibles, revue interculturelle et planétaire d’analyse institutionnelle n°1, juin-juillet 2002, pp. 246-247
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 24 Janvier 2015
Page 36 :
« La dialectique hégélienne, prise dans son sens logique, a été développée dans le mouvement
de l’analyse institutionnelle, par René Lourau, dans L’Analyse institutionnelle. Il reprend les
trois moments hégéliens d’universalité, particularité et singularité20. »
Je retrouve les notions d’universel, de particulier et de singulier. Je comprends ceci : l’universel
c’est tout le monde, le particulier, ce sont les personnes qui m’entourent, le singulier, c’est moi.
Page 36 :
« Patrice Ville rappelle que les propriétés des trois moments hégéliens sont les suivantes :
chaque moment est négation des deux autres, chaque moment est affirmation des deux autres,
ils sont indissociables, ils sont à la fois en relation négative et en relation positive avec chacun
des deux autres21 . »
Moi qui aime bien les maths, ça vaudrait le coup de faire un petit schéma avec ces trois moments
qui se rejoignent et se repoussent… Les relations entre ces trois moments pourraient être
détaillées en appliquant ces formules, pour donner des exemples concrets.
Plus loin dans le texte, Remi Hess parle de l’institué, l’instituant, l’institutionnalisation, trois
termes qui nous avaient donné du fil à retordre en Licence dans le cours animé par Sandrine
Deulceux.
« René Lourau propose une dernière « triplette dialectique » : le moment idéologique, le
moment libidinal, le moment organisationnel. »
Je note22 parce que ça m’intéresse, mais je n’arrive pas encore à trouver d’exemples
concrets…
Page 37 :
« Le dernier chapitre de La science de la logique, de Hegel, est intitulé : l’idée absolue. En fait,
il est une reprise très explicite de la méthode dialectique de Hegel, que l’auteur situe dans
l’histoire de la pensée. On y trouve une réflexion sur l’articulation des moments dans la
dialectique. Je renvoie ici à ce chapitre. »
20 René Lourau, L’Analyse institutionnelle, Paris, Minuit, 1970, p. 10 21 Patrice Ville, Une socianalyse institutionnelle, Gens d’école et gens du tas, Paris 8, thèse d’état, 12 septembre
2001, p. 45 à 57. 22 Voir René Lourau, L’Analyse institutionnelle, Paris, Minuit, 1970, p. 282
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 25 Janvier 2015
Eh bien, c’est noté, Professeur Hess ! Ça m’intéresse de creuser la piste Hegel, pour ma
recherche. Il faut que je voie avec Didier Moreau ce qu’il en pense. Je vois sur le site de la
médiathèque de Niort, qu’une édition est présente : Hegel, Science de la logique, Traduction
par S. Jankélévitch, Paris : Aubier, 1947-1949
Page 42 :
« Ce qui est valable pour un groupe ou une institution vaut également pour la personne. L’entrée
en psychanalyse survient à un moment particulier de la vie du sujet, lorsqu’il formule pour lui-
même l’idée que le dispositif de la cure lui serait utile pour sortir des difficultés qu’il traverse.
Toute entrée en thérapie (psychologique, mais aussi somatique), correspond à un moment de
prise de conscience, à une demande. Les socianalystes ont montré le cheminement qui s’opère
entre le moment de la demande conscientisée, et la commande. L’analyse, c’est justement
l’analyse des chemins conduisant d’une demande à une commande. »
Je garde ce point pour ma future étude sur le point d’équilibre. Ce moment de prise de
conscience me fascine. Qu’est-ce qui va le déclencher ? A voir plus tard…
Page 42 :
« La notion de bon moment existe déjà dans la philosophie grecque, c’est la notion de kairos,
notamment chez Aristote chez qui la notion s’inscrit dans sa recherche de l’équilibre, et plus
particulièrement de sa recherche du juste milieu, que l’on retrouvera d’une certaine manière,
dans la notion de tact que développera, à la suite de Herbart, F. Schleiermacher, lorsqu’il
développera les qualités requises par le pédagogue. […] Michel Foucault l’a souligné dans
L’usage des plaisirs23.
Le Kairos, petit dieu ailé grec, de l’opportunité qu’il faut saisir quand il passe24. Eh bien, ça me
fait pas mal de matière pour entamer une future recherche… Je garde… J’aime beaucoup avoir
un petit dieu, qui a l’air bien malicieux pour illustrer cette notion de moment de basculement
entre l’avant et l’après la saisie de l’opportunité, du bon moment, le point d’équilibre ou plutôt
de déséquilibre.
Page 43 :
23 Michel Foucault, L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984. 24 http://fr.wikipedia.org/wiki/Kairos
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 26 Janvier 2015
« Dans sa réflexion à partir du Malaise dans la culture, de Freud, Michel Plon montre que cette
question du bon moment est un problème central pour les trois métiers impossibles selon Freud :
gouverner, soigner, éduquer (Regieren, Analysieren, Erziehen)25. Dans ces métiers, la question
est toujours de choisir le « bon moment pour intervenir ». »
Ma culture freudienne est assez limitée, alors, je découvre cette idée que « gouverner, soigner
et éduquer » sont « trois métiers impossibles ». Entre les grèves des infirmières et des membres
de l’éducation nationale, et les mauvais rapports entre le gouvernement, quel qu’il soit et le
peuple, ou les patrons et leurs salariés, en effet, on peut dire que ce ne sont pas des métiers
« possibles ». Ça me plairait bien aussi d’avoir le temps de trouver comment s’y prendre pour
une « pensée du possible » pour ses métiers là. Forcément, il doit y avoir des centaines d’études
déjà faites là-dessus, mais bon, ça n’a pas l’air d’avoir beaucoup changé les choses…
Page 43 :
« Chez Freud, la qualité du clinicien, c’est d’accepter de ne pas brusquer les choses […]. Selon
lui, rien ne sert de forcer l’autre, même quand on a raison, qu’on détient le savoir sur lui. Il faut
attendre le «bon moment», c’est-à-dire ce temps propice, cet instant adéquat, où l’autre est
capable d’entendre ce qu’on veut lui dire. […] Le bon moment de parler, de dire, c’est le
moment où l’autre a quelque chose à attendre de vous, se trouve être en demande, bref vous
écoute dans ce que vous pensez pouvoir lui dire de lui.
[…] Selon Freud, le « métier » du pédagogue, de thérapeute ou du politique, serait dans leur
capacité à attendre le « bon moment » avant d’intervenir.
Je me souviens de la fois où ma copine Sylvie, qui venait de se séparer du père de ses enfants
m’appelait à l’aide. Je lui parlais, lui racontais mon expérience vécue du même moment, et je
lui donnais des conseils. Je me souviens de lui avoir dit : « De toute façon tout ce que je suis en
train de te dire est en train de glisser sur toi comme de l’eau sur les plumes d’un canard ». Elle
était trop dans sa colère, est véritablement incapable d’entendre ce que je lui racontais.
Et ça me rappelle également, mes débuts de femme « libérée », après dix-neuf ans de vie
commune, où je n’ai pas écouté mes amis qui me disaient que ce n’était pas une bonne idée de
me mettre en ménage avec JJ. Ça m’aura donné l’occasion de vivre ce moment tellement
25 Michel Plon “ De la politique dans le Malaise au malaise de la politique ”, in Jacques Le Rider, Michel Plon,
Gérard Raulet, Henri Rey-Flaud, Autour de Malaise dans la culture de Freud, Paris, PUF, 1998, 154 pages.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 27 Janvier 2015
insupportable, dont je parle plus haut, en page 6, qui m’a permis d’ouvrir les yeux, qui ont
permis le changement.
Attendre le « bon moment », pour parler, me parait être une marque de sagesse. J’aimerais
tendre vers cette patience. Je suis souvent trop impulsive et ça me nuit.
Page 45 :
« Dans la stratégie, le côté décisionnel du kairos suppose un temps préalable, durant lequel on
a pris soin de construire un dispositif. Le rapport de l’autre au temps est un élément essentiel
de l’analyse stratégique, et il déterminera le choix tactique d’intervenir ou pas. »
Voici peut-être la solution, le remède à mon problème de ne pas être une fine stratège…
« Construire un dispositif »… En fait, dans ma stratégie d’avoir une belle vieErreur ! Signet
non défini., je « construis mon dispositif » : j’ai une bonne situation, j’élève mes enfants en les
guidant au maximum vers l’envie d’avoir une belle vie, je reprends des études pour me
permettre d’avoir un diplôme et me donner la possibilité d’évoluer vers un emploi plus proche
de mes valeurs et de mes envies.
Ha ! La touffe de cheveux, du kairos qui voudra bien m’embaucher pour le job de mes rêves, il
faudra qu’elle soit bien solide, tellement je vais l’attraper fort !
Page 46 :
« Tous les auteurs qui se sont intéressés à la théorie du «bon moment», développe une
temporalité qui dialectise, à la manière hégélienne, trois moments : le perçu, le conçu, l’action
(H. Lefebvre), voir, juger, agir (formulation des militants de l’action catholique dans les années
1930), ce que J. Lacan reformule dans son célèbre sophisme du temps logique et de la certitude
anticipée : l’instant de voir, le temps pour comprendre, le moment de conclure. On sait que,
dans une première période de sa vie, Lacan s’est beaucoup intéressé à Hegel ! »
Tous ces « trois » me font penser au chiffre trois des contes, que j’ai étudiés dans ma note
d’investigation de Master 1.
« Ces trois moments sont bien antérieurs à Hegel : ils sont déjà présents chez Hippocrate. Le
médecin grec inscrit sa théorie du bon moment dans une trilogie du même type :
- […] le moment de l’enquête. […]
- Le second moment est celui du diagnostic. […]
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 28 Janvier 2015
- Le troisième moment est celui de l’intervention.
[…]
Dans toute situation d’analyse, de politique ou d’éducation, le praticien doit aller jusqu’au bout,
de ces trois étapes, de ces trois moments, de ces trois temporalités.
Percevoir, comprendre et juger, intervenir pour conclure sont donc les trois moments de ce
processus qui ouvre sur le «bon moment». La pratique impose donc une prise en compte
permanente de l’étendue et de la durée. »
Ce découpage permet de prendre conscience, de détailler notre comportement vis-à-vis des
situations pour lesquelles nous avons à faire face. Je pense que c’est le secret de la réussite de
toute entreprise d’aller au bout de chacune de ses étapes. Dans mon monde du travail
informatique, dans les projets que nous menons, le « bon moment » est le moment choisi par le
client. Alors les contraintes de plannings imposés nous empêchent d’aller au bout de chaque
étape pour avancer sereinement dans nos projets. Les tensions sont constantes et limite
« inhumaines ». Ce point des trois étapes me paraît important aussi pour ma recherche.
Page 47 :
Le questionnement des moments privilégiés se fonde sur trois prises de position26.
La première, épistémologique, tient au choix d’une approche multiréférentielle qui, d’emblée,
implique le renoncement à un point de vue totalisant et achevé. […]
La seconde prise de position, axiologique, consiste à aborder le sujet adulte comme co-auteur
de ses propres transformations existentielles. […]
La troisième prise de position, théorique, s’appuie sur un questionnement des moments
privilégiés du point de vue des temps qu’ils mobilisent.
[…] les temps successifs d’une vie apparaissent éclairés, oblitérés ou reconstruits après-coup
en fonction des réorientations des projets du sujet.
Comme tout projet, le projet d’entrer en formation, ne doit pas se faire sans ces prises de
position, ces questionnements. Quand j’ai pris la décision d’étudier en 2012, pour la licence, je
me suis bien questionnée sur la notion de temps : est-ce que j’aurai le temps de concilier travail
26 Lesourd, Francis, Les moments privilégiés en formation existentielle, Contribution multiréférentielle à la
recherche sur les temporalités éducatives chez les adultes en transformation dans les situations liminaires, thèse
de sciences de l’éducation, sous la direction de Jean-Louis Le Grand, LAMCEEP, soutenue à Paris 8, 29 octobre
2004
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 29 Janvier 2015
salarié à plein temps, vie de maman et de femme, et vie d’étudiante ? Je n’ai pris conscience
des positions épistémologiques et axiologiques qu’au fur et à mesure de mon apprentissage.
Page 48 :
Parmi les chantiers de recherche qu’a ouvert, en Sciences de l’éducation, la prise en compte
d’une multiplicité des temps, cette thèse se situe plus particulièrement dans la filiation des
recherches de Gaston Pineau relatives à une chrono-formation. La chrono-formation est définie
comme formation de temps formateurs.
[…] Au cours des moments privilégiés, l’action du sujet adulte se porte sur sa propre
infrastructure temporelle, l’altère profondément et, partant, fait émerger ce qui lui apparaît
après-coup comme une transformation existentielle.
C’est ce que j’ai écrit juste avant… je ne me suis préoccupée que du temps à consacrer à mes
études et je me suis aperçue après coup, et toujours aujourd’hui, que je me transforme, et que
je suis de moins en moins achevée surtout lorsque je vois l’étendue de tout ce qu’il est possible
d’apprendre…
Je note les recherches de Gaston Pineau que je n’ai encore jamais étudié. Ce sera peut-être utile
pour ma recherche.
Page 48 :
« […] il est possible d’envisager le guidage pour le sujet lui-même de ses transformations
existentielles comme objet de recherche en formation. Cette hypothèse est mise à l’épreuve de
vécus rapportés par une enquête. Le mode d’observation s’appuie sur des histoires de vie en
formation et des entretiens. L’explicitation biographique constitue un mode d’observation
rétrospective de la mise en œuvre concrète des savoir-passer. Ce mode d’observation des savoir-
passer constitue également, pour le sujet, un mode d’accompagnement de leur conscientisation.
Ecrire ce que l’on ressent, comment on a vécu tel ou tel épreuve ou évènement et ce que cela
implique au niveau de la formation de soi, va faire l’objet de ma recherche. Je note de voir si il
y a des références aux romantiques allemands dans les travaux de Gaston Pineau. Mais en tout
cas, je pourrai faire des liens.
Page 51 :
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 30 Janvier 2015
Henri Lefebvre, René Lourau et Raymond Fonvieille sont morts, avant d'avoir eu le temps de
découvrir ce monde du virtuel. Cet espace virtuel se superpose à l'espace institutionnel et à
l'espace tout court.
Je pense souvent à ça, quand je lis des phrases d’auteurs anciens, qui sont d’une fraicheur
actuelle. J’essaye d’imaginer comment ils seraient aujourd’hui, à quelle place dans la société,
invités ou non aux émissions de télévision, avec une page dans tous les réseaux sociaux qu’ils
pourraient animer eux-mêmes… Quand on voit aujourd’hui la part du virtuel dans nos vies,
c’est assez curieux en effet de voir que cette superposition vue par Remi Hess, en 2000, lors de
l’écriture de cette phrase, s’est transformée en imbrication presque totale de l’espace virtuel
dans l’espace tout entier.
Page 52 :
« L'exigence de la théorie. Le sentiment du professeur qui vit le chahut dans sa classe, et qui
croit que ce vécu est particulier, que les autres ne vivent pas cela. Nécessité de décrire et
d'accepter ce quotidien singulier et de tenter de le comprendre. L'AI doit être confrontée aux
grands thèmes lefebvriens. »
Je viens d’entendre au journal de France 2, dans un sujet sur les chalets de Noël sur les Champs
Elysées, une commerçante dire : « les gens sont de toute façon obligés d’acheter des
cadeaux… ».
Mais bien sûr madame… vous ne seriez pas un peu exigeante en matière de théorie sur les
cadeaux de Noël ? Voilà deux ans que j’offre à toute la famille des cadeaux que je n’ai pas
achetés, mais que j’ai fabriqués et qui ont été appréciés…
Page 54 :
« […] on pourrait même dire que leur travail est empêché par la classe des buveurs de sang, des
« criminels de paix27 », des fascistes ordinaires que sont des gens comme Jeanne Chaos et
Martin Bouffon-Poussière.
27 L'expression se retrouve chez F. Basaglia et R. Lourau.
Franco Basaglia (éd.), Les criminels de paix, (1973), Paris PUF, 1976.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 31 Janvier 2015
Je ne sais pas si on peut le dire dans ce cas, mais cette expression
« criminels de paix » me parait être un oxymore. J’avais été
surprise par ce terme lors de l’exposition de la série des Mariées
célibataires de Kimiko Yoshida que j’ai 28pu découvrir en octobre
2010 à la MEP Maison Européenne de la Photographie à Paris.
Voici La mariée qui dit non.
Je note donc cet ouvrage où plusieurs auteurs ont participé dans
ma liste de choses « A voir plus tard ». Il est peu disponible et introuvable à des prix
raisonnables… 200 € environ… c’est curieux… Il est à la bibliothèque de Paris 8, j’irai voir
lors du prochain regroupement. Ça m’intrigue…
Je trouve un article qui référence cet ouvrage, sur le site de Cairn, de Laurence Gavarini,
« L'institution des sujets », L'Homme et la société 1/ 2003 (n° 147), p. 71-93 29 .
Page 56 :
Je suis absorbé par la lecture de Kurt Meyer : sa présentation de H. Lefebvre, comme
romantique révolutionnaire ou plutôt comme révolutionnaire romantique, est tout à fait
passionnante.
Haha ! Intéressant… Henri Lefebvre serait un romantique révolutionnaire ! Je note donc les
références de l’ouvrage de Kurt Meyer30.
Je trouve également un article L’Internationale situationniste et la querelle du romantisme
révolutionnaire, écrit en 2007 par Patrick Marcolini31.
« A garder pour ma recherche ».
Page 57 :
Lefebvre montrait qu’il suffisait d’écrire deux phrases en exergue, pour faire passer un texte
refusé quatre ans durant : qu’est-ce qu’un comité de lecture ? comment fonctionne la censure ?
etc. qu’est-ce que le pouvoir des censeurs ?
28 http://www.aucube.fr/index.php?/projects/kimiko-yoshida/ 29 www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2003-1-page-71.htm 30 Kurt Meyer, Henri Lefebvre Ein Romantischer Revolutionnär, Wien, Europaverlag, 1973. 31 Article L’Internationale situationniste et la querelle du romantisme révolutionnaire, écrit en 2007 par Patrick
Marcolini : http://noesis.revues.org/723
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 32 Janvier 2015
Ce sujet m’intéresse aussi… pour sûr, je n’aurai pas assez d’une vie pour tout étudier… Lorsque
je suis allée à Anderlecht, près de Bruxelles, visiter
la Maison d’Erasme, où sont présentés certains de
ses livres censurés. Je mets ici une de mes photos,
où l’on voit bien les lignes brûlées. Je m’étais dit
qu’il devait y avoir un lien entre le mot censure et le
mot cendre. J’ai un tout petit peu cherché mais je
n’ai rien trouvé de flagrant. « A voir plus tard ».
Page 58 :
En 1964, lorsque naît le Groupe de pédagogie institutionnelle (GPI), René Lourau voit ce qu’il
peut faire : il s’implique dans sa classe pour mettre en place l’autogestion pédagogique. Très
vite, Georges Lapassade donne à René le choix des textes, fait par Gilles Deleuze sur le thème
Instinct et institution (Hachette, 1953) ; il y a là des textes d’Hauriou, de G. Tarde.
José Tomé, un de nos collègues étudiants de ce Master 2, parle de pédagogie institutionnelle.
Je ne suis pas trop au fait de ce groupe. Mais ça a l’air intéressant, surtout la mise en place
d’autogestion pédagogique. Je cherche si je peux trouver le livre de Deleuze. Oui, il est même
disponible à l’ESPE de Niort. Je note les références dans ma rubrique « ça peut servir ».
Page 59 :
« Quand l’adolescent dénonce ses parents, il oublie que ce sont eux qui l’on fait : refonder l’AI
passe, pour moi, par un travail d’exploration des origines ; remonter dans le passé pour dégager
les virtualités du présent. Pourquoi G. Lapassade est-il contre H. Lefebvre ? […] Il faut que je
parvienne à parler de ces choses avec lui, à moins qu’H. Lefebvre ne soit une ombre entre
Georges et René, entre Georges et moi ? Ma condition d’exister passe par la conciliation de
plusieurs héritages.
C’est curieux cette notion d’héritage, mais c’est important parce que c’est ce qui nous construit.
Si on en revient au titre de ce cours « Théorie des moments et construction de la personne ».
Les moments passés à étudier, à « pomper » un héritage, dans le sens intellectuel, nous
construisent et nous façonnent soit à l’image de celui que l’on est en train de lire, soit à l’image
inverse, soit à l’image mixte de ce qui nous plait ou pas chez lui…
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 33 Janvier 2015
Je me souviens d’avoir été subjuguée justement par ce que j’ai lu d’Erasme, au cours de la
Licence, et d’avoir reçu un petit coup de lucidité, en Master 1, en lisant un texte de Stefan
Zweig32 qui montre que « l'attitude des humanistes à l'égard du peuple, leur insouciance des
réalités a arrêté la force d'action de leurs idées. Leur faute fut de vouloir instruire le peuple de
haut au lieu d'essayer de le comprendre et de se laisser enseigner par lui. »
Dans le cours d'Anna Terzian, du Master 1, « Technologies éducatives et formation tout au long
de la vie », nous avons étudié Grundvig, pédagogue danois, entre autres, considéré comme le
père de la formation tout au long de la vie. Inspiré par ses voyages en Angleterre et notamment
par un séjour à Trinity College de Cambridge, il rêvait d’une école « permettant à des hauts
fonctionnaires du roi de côtoyer les filles et les garçons du peuple pour qu’ils puissent connaître
les besoins des citoyens. »
Page 62 :
« Dans Le manifeste différentialiste, de très beaux passages : ce qui est dit de la religion
catholique est proche de ce qui deviendra Éloge du péché. »
Je veux noter les références. J’aimerais bien lire ces livres, quand j’aurai un peu de temps. Pour
Le manifeste différentialiste33, pas de problème pour le trouver. En revanche L’éloge du péché
est complétement absent de ma recherche Google. Il faudrait que je demande à Remi Hess s’il
peut m’aider à trouver cet ouvrage.
Page 64 :
« Samedi 6 et Dimanche 7 janvier 2001,
Je passe tout le week-end à écrire mon “retour” sur Le sens de l’histoire : j’ai déjà fait 42 pages.
Pour densifier, j’utilise Âme et compétences, livre important, mais difficile à présenter à un large
public : les auteurs élèvent à un très haut niveau de réflexion, une question pratique assez
banale. »
Pourquoi, toujours et encore les « auteurs élèvent à un très haut niveau de réflexion… » ? Je
note ce passage qui va bien avec ce que j’ai dit un tout petit peu plus haut au sujet d’Erasme et
Grundvig. Réécrire tous ces textes compliqués, les mettre à la portée de tous, me tient
32http://www.booston.fr/article-stefan-zweig---erasme---grandeur-et-limite-de-l-humanisme-119130000.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig 33 Henri Lefebvre, Le manifeste différentialiste, Paris : Gallimard, 1970
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 34 Janvier 2015
particulièrement à cœur. Je me rends compte, même dans ce Master, que certains de mes
camarades utilisent sans cesse des mots, des phrases, des tournures vraiment « trop »
universitaires. Moi, je n’ai pas l’intention de faire partie d’une élite qui ne partagerait pas ce
que j’ai découvert. Je suis généreuse, en vrai, et partager, donner ces trésors à toutes et à tous,
c’est ce qui me parait être un des principes de l’esprit d’humanité. Je note « pour ma
recherche. »
Page 66 :
« Il y a deux moments dans l’écriture d’un livre : celui où l’on façonne les briques, celui où l’on
élève les murs pour construire l’œuvre. La deuxième phase est celle où les choses s’agencent :
on écrit des transitions. La logique du plan apparaît alors progressivement, et conduit à refaire
des morceaux nécessaires, pour l’harmonie de l’ensemble. La relecture est longue : elle est
multiple et plurielle. À ce moment-là, on introduit des notes, des renvois qui valorisent le texte,
et il faut savoir finir. Dans le journal, la construction est une ligne de production de briques : on
escamote la seconde phase du travail.
Merci Remi pour cette description de votre méthode d’écriture. L’utilisation du mot brique
m’interpelle et j’ai envie de vous faire partager ce que j’avais écrit dans mon journal
d’investigation de l’an passé.
Dimanche 29 décembre 2013, 16h05, bureau maison
Soleil et ciel bleu inattendus en ce jour d'hiver, alors nous avons sorti les motos, et nous sommes
allés pique-niquer avec de bons sandwichs au fromage, à Vouvant, près de la tour de la fée
Mélusine.
C'était magnifique, un très bon moment, et une très agréable ballade de motards du dimanche.
Et la fée Mélusine, comme légende à intégrer dans mon projet de recherche, c'est non seulement
une bonne idée, mais c'est essentiel, parce qu'elle incarne tellement de valeurs. Elle pourrait
nécessiter toute une vie de recherche à elle seule !34
Cette bâtisseuse m'inspire, et pendant le chemin du retour j'ai pensé qu'il
serait temps de construire mon journal, mon bâtiment de pensées, pas
avec des « briques », mais avec des « ru-briques »... Je vais donc ouvrir
mes rubriques « A voir plus tard » et « ça peut servir » et y mettre mes
trouvailles de la matinée. Je me dis qu'une rubrique « De qui je parle ? »
34Légende de la fée Mélusine : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lusine_%28f%C3%A9e%29
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 35 Janvier 2015
pourrait m'aider à présenter mes « personnages », mes compagnons de route dans cette aventure
du Master à l'IED...
Page 69 :
« Cette lecture révèle que toute l'œuvre de H. Lefebvre est passionnante : tout texte de lui
renvoie à un mouvement. Idée d’écrire à Desclée de Brouwer, pour leur proposer un livre dans
leur collection “Témoins d’humanité35 ”. »
C’est beau ce nom d’éditeur : Desclée de Brouwer… Je note cet ouvrage, pour voir ce que je
pourrais en tirer « pour ma recherche », pour la notion d’esprit d’humanité.
Page 74 :
« La productivité est liée à un engagement, et à la construction d'ethnométhodes
particulièrement efficaces, par exemple : ses «programmes». Lefebvre se donne des
programmes, comme des Traités, en huit volumes, dont il fait le plan. Il ne les réalise pas
toujours, mais deux livres peuvent sortir d'un tel projet. »
Je suis impressionnée par cette productivité. J’aimerais tellement avoir aussi le temps d’écrire,
écrire, écrire… Les « programmes », ça me fait penser à mes listes, à ce que j’inscris dans mes
rubriques, comme celles que je mets en fin de ce journal. Ce serait une bonne idée, un jour
quand j’aurai plus de temps de faire des plans d’ouvrages que je pourrais écrire, ça m’aiderait
à me lancer dans l’écriture.
Page 79 :
« Sa pensée nous invite à l’invention, à la lutte pour un monde plus humain et à l’ouverture. »
Cette phrase d’introduction au colloque sur Henri Lefebvre me parle. Moi qui ne connaissait
absolument pas Henri Lefebvre, je découvre au fur et à mesure de la lecture de ce livre, qu’un
héritage pourrait bien commencer à se transmettre pour et avec moi…
Page 83 :
35 Cf. chez cet éditeur : Penser l’hétérogène, d’Ardoino et de Peretti, 1998
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 36 Janvier 2015
Cette lecture me conduit à relire mon livre sur Lefebvre, important : je ne savais plus que j’avais
noté tant de choses.
C’est drôle, on dirait moi… Quand je me replonge dans ce que j’ai écrit depuis la licence, dans
mes photos, que je fais par milliers, qui sont souvent pour moi le moyen de noter quelque chose,
je trouve que c’est énorme ! Mais quoi faire de tout ça ? Je n’en sais rien, pour l’instant,
j’engrange mes informations, je me fais un tas de matières premières et quand viendra le
moment, le bon moment, le moment propice à la création, je les utiliserais du mieux possible.
C’est pour cela quand même que c’est important de trier un peu, indexer, pour pouvoir aider sa
mémoire à retrouver où est rangée telle ou telle information.
L’outil informatique est quand même vraiment formidable pour ça. Mais encore faut-il savoir
s’en servir. Je pense que je maitrise assez bien, depuis vingt-quatre ans que je manie la souris…
Et ça vaudrait peut-être le coup que j’investisse un peu de temps dans la formation des
universitaires, des écrivains, des auteurs, des étudiants, à des méthodes simples mais efficaces.
Bien sûr, il en existe sûrement déjà des tonnes de bouquins pour ça, mais pas fait à ma sauce…
Ça me rappelle mes cours chez les gens quand j’avais ma petite entreprise d’assistance
informatique à domicile… Je pourrais me baser sur mes carnets de note de chacune de mes
interventions pour établir une méthode accessible à tous, mais vraiment à tous… Allez, je le
note dans « A voir plus tard ».
Page 86 :
Ce que la philosophie n'avait jamais pensé avant Lefebvre, c'est le quotidien. Le concept de
quotidienneté renvoie au concept de résidu qui est une véritable transgression de la tradition
philosophique. Après avoir insisté sur le moment de la praxis - c'est-à-dire de la pratique
investissant la théorie -, le moment de la mimesis où l'imitation l'emporte sur la créativité, et
enfin le moment. de la poièsis qui contredit le précédent en lui substituant une franche
innovation, Georges Labica montre comment l'éclatement de la philosophie va, chez Lefebvre,
de pair avec la construction d'une nouvelle unité philosophique (la métaphilosophie).
Je garde ce passage pour ma recherche. La poièsis, la créativité, le quotidien, sont des mots-
clés dont j’ai déjà prévu de me servir pour mon mémoire.
Page 87 :
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 37 Janvier 2015
« La troisième journée a permis de tracer le portrait d'un « Henri Lefebvre pédagogue », moins
connu que les deux précédents : le penseur du quotidien, de l'urbain, et le philosophe.
Pascal Diard, enseignant en histoire, a expliqué comment lui-même fondait sa pédagogie de
projet sur le dépassement de toute pédagogie, laissant la place à l'imprévu, faisant de
l'enseignant un artisan « débrouillard », avec un regard en positif. »
Je suis vraiment ravie de découvrir cette mine d’or… Là, c’est pour un autre futur projet que
j’avais noté en fin de licence, Augustin Mutuale nous avait demandé de préparer en vue du
Master 1, une liste des objets de re.cherche qui nous intéresseraient.
Ce passage me fait penser à celui-ci :
- Les enseignants qui osent :
Comme le professeur d’Histoire de l’Art de mon fils (M. Nicolas Marjault), ou d’autres,
j’aimerais étudier ce qui fait son « p’tit plus » que les autres n’ont pas. Et pourquoi pas :
développer une « formation » pour les enseignants à ce « p’tit plus ».
Page 94 :
« Dès la publication en 1936 de la Conscience mystifiée (avec Norbert Guterman) et, surtout,
de la Critique de la vie quotidienne en 1947 (1), Henri Lefebvre a été l'un des philosophes et
sociologues les plus connus en France (sait-on qu'on lui doit le terme de “société de
consommation” ?). Généralement, on en fait le “père putatif” de Mai 68, par son projet de
“changer la vie”, l'idée de la révolution comme fête et de l'insurrection esthétique contre le
quotidien. »
Je ne connais pas le terme « père putatif », et je découvre que : c’est celui que l’on croit être le
père mais qui ne l’est pas.
Page 95 :
« Quant à la définition de la modernité, […], Lefebvre la bâtit en “mixant”, si on peut dire, des
pensées qui semblent “incompatibles” : celles de Hegel (Etat), de Marx (société) et de
Nietzsche (civilisation). Hegel, Marx, Nietzsche ou le royaume des ombres paraît en 1975.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 38 Janvier 2015
Je note les références36 de cet ouvrage, je pourrais en avoir besoin pour ma recherche. Je vais
le trouver en bibliothèque, mais à l’achat, il est lui aussi introuvable sauf à des prix supérieurs
à cent euros. Je trouve ça curieux quand même que les éditeurs ne rééditent pas régulièrement
leurs ouvrages… Cela fait encore un autre frein à l’accès à la connaissance pour tous.
Page 100 :
Dès sa première lecture de K. Marx, de F. Engels et de Lénine, H. Lefebvre découvre une
critique radicale de l’État.
Je pense à mes garçons, et surtout Lucas, qui lorsque nous sommes allés
quelques jours à Berlin en juillet 2013, a tenu absolument à poser à côté
de ces statues. Je ne sais pas s’il a lu Marx ou Engels, en tout cas, les
personnages ont l’air de l’intéresser. Je lui ferai peut-être lire ce livre
d’Henri Lefebvre…
Page 102 :
« Une nouvelle version de L’introduction à la critique de la vie quotidienne est rééditée en 1958.
Le volume 2, sur Les fondements d’une sociologie de la quotidienneté, paraît en 1961. »
Je note ces deux références37 pour ma recherche.
Page 103 :
H. Lefebvre laisse ses assistants développer leurs propres recherches. Il les encourage à
enseigner leur propre pensée, ce qui n’était pas fréquent avant Mai 1968, où l’assistant était le
répétiteur des idées du professeur. C’est ainsi qu’aux enseignements de H. Lefebvre se
surajoutent ceux d’Eugène Enriquez, Jean Baudrillard, René Lourau et Henri Raymond, Maïté
Clavel…
36 Henri Lefebvre, Hegel, Marx, Nietzsche ou le Royaume des ombres, Paris : Casterman, 1975 37 L’Introduction à la Critique de la vie quotidienne, Paris : Grasset, 1946, 2e édition précédée d'un avant-
propos, Paris : L'Arche, 1958), Henri Lefebvre
Les fondements d’une sociologie de la quotidienneté, Paris : L’Arche, 1961, Henri Lefebvre
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 39 Janvier 2015
Bienveillance ! Voici le mot qui me vient à l’esprit quand je lis ce passage. Et aussi
émancipation, liberté, dans un objectif de créativité, de faire émerger de nouvelles idées.
Page 104 :
« Il relit les tragiques grecs. Il lui semble que la clé de la philosophie, la clé du monde, soit à
chercher de ce côté. H. Lefebvre ne pense pas que l’on puisse tirer quelques choses des mythes.
C’est dans le tragique qu’il faut chercher. H. Lefebvre voit la solution davantage du côté de
Prométhée que du côté de Dionysos. […] La tragédie ressuscite le héros tragique qui réapparaît
et revit sa mort. C’est de là qu’on peut tirer une philosophie. Cette démarche peut sembler très
loin du marxisme. Mais pas si loin qu’on ne le croit. Marx ne dit-il pas lui-même qu’il a incarné
Prométhée ? Ces thèmes seront repris dans Qu’est-ce que penser 38?(1985).
Je garde ce passage pour ma recherche. Je ne connais pas le mythe de Prométhée.
Bien sûr, je suis d’accord avec le fait que « la clé du monde » peut être dans les écrits anciens.
Ce sont nos vieilles, très vieilles racines. Et plus elles sont profondes et lointaines, plus elles
doivent pouvoir nous apporter de richesses et de réponses à nos questions existentielles
d’aujourd’hui.
Pages 104-105 :
« Il a relu Musil. Pour lui, L’homme sans qualité est le roman de la dissolution du monde
moderne. Le héros de Musil parle en philosophe. […] À côté de Musil, H. Lefebvre a lu
Shakespeare, les tragiques grecs, René Thom (théorie des catastrophes). Il constate que la
tragédie grecque a permis aux Grecs de vivre, qu’elle leur a permis de s’accepter, d’accepter
leur monde (leur cosmos).
Je note les références des ouvrages de Musil39, ils sont à la médiathèque de Niort.
Qu’est-ce que la théorie des catastrophes40 ? Je regarde sur Wikipédia, ça a l’air fascinant, je
mets ça dans ma rubrique « ça peut servir ».
Page 109 :
38 Henri Lefebvre, Qu'est-ce que penser ? Paris: Publisad, 1985
39 Robert Musil, L’homme sans qualités. Plusieurs tomes, Paris : Editions du Seuil, 1973 40 http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_catastrophes
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 40 Janvier 2015
« Je ne reprends pas ici le détail de la théorie des moments définie dans La somme et le reste.
Je crois que ce thème constituerait un livre en soi. Sur les 777 pages de cet ouvrage, la théorie
des moments est présente dans un tiers des chapitres, ou sous forme spécifique et dégagée, ou
sous forme implicite. Quatre chapitres s'y réfèrent explicitement :
-trois dans la troisième partie (la vie philosophique) : «Moments», «Le moment philosophique»,
«Encore sur les moments : l'amour, le rêve, le jeu»,
-un dans la cinquième partie (L'inventaire), où le chapitre VII s'intitule «théorie des
moments». »
Je note ce passage au cas où j’en aurais besoin. Et je note les références de l’ouvrage41.
En cherchant juste « La somme et le reste », je tombe sur un blog de l’association du réseau
mondial d’études lefebvriennes… : http://www.lasommeetlereste.com/
Lundi 17 novembre 2014, 12h33, pause déjeuner voiture, au bord de l’eau
Page 114 : dans le paragraphe qui concerne le moment du jeu
« Dans l'abstrait, la volonté de jouer ne crée que des jeux sans profondeur, sans réalité - des
petits jeux de société. Les vrais jeux gardent quelque chose de leur participation initiale à la
totalité. « Le déplacement vers les jeux des objets magiques s'accompagne évidemment de
métamorphoses radicales, telles qu'une formalisation très particulière : la règle du jeu42. »
Le jeu définit ses catégories : la règle, le partenaire, l'enjeu, le risque et le pari, la chance,
l'adresse, la stratégie. […] Les frontières des moments dépendent des moments et des hommes.
Tout peut se jouer et devenir jeu. »
Ce moment du jeu, la notion de magie, les catégories, ces termes me font penser aux contes que
j’ai étudié l’an passé et m’inspirent que le jeu est vraiment très proche et notamment le jeu
vidéo. J’avais écrit cette petite phrase dans ma note d’investigation, page 29 :
Dans les chapitres précédents, les descriptions des différentes étapes dans un conte, qui
symbolisent les moments importants, les changements dans la vie de chacun, me font penser
aux jeux vidéo d'aventure. Les scènes qui se succèdent, avec des personnages, des épreuves, les
« boss », monstres à exterminer, permettent de se dépasser pour atteindre le niveau suivant.
41 Henri Lefebvre, La Somme et le reste, (autobiographie), 4° éd. Paris, Anthropos, 2009 42 Henri Lefebvre, La Somme et le reste, (autobiographie), 4° éd. Paris, Anthropos, 2009, p. 643
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 41 Janvier 2015
Page 114 :
« Avec ses catégories propres, le jeu révèle une modalité de la présence : «Mon partenaire
apparaît jouant, en tant que joueur ; et bien que je puisse retrouver dans le jeu les qualités ou
défauts que je lui connais par ailleurs, il peut s'y montrer extrêmement différent de ce qu'il est
par ailleurs. »
Je me souviens d’une période entre 18 et 22 ans, à peu près, où j’étais très mauvaise joueuse.
Si je perdais, je balançais les cartes si on jouait au tarot, je soulevais et rejeter le plateau de jeu
de scrabble, je faisais la tête… En revanche, si je gagnais je ne me vantais pas. D’ailleurs, ça
me fait penser que j’étais très grossière en voiture, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir.
En tout cas, je sais que je me suis calmée pour ces deux phénomènes, en même temps. J’avais
vu quelqu’un faire une crise encore pire que moi, et ça m’avait servi de leçon.
Page 115 :
« Qu'est-ce que le repos ? Les termes de décontraction ou de détente confondent idéologie,
mythe, besoin. « Les techniques du repos existent depuis que la civilisation existe mais assez
mal dégagées et utilisées. On s'aperçoit seulement aujourd'hui qu’une science du repos,
ménageant les conditions objectives et subjectives de ce moment, doit se constituer. Il n'est pas
facile de se reposer pour l'être humain, qui a pour essence l'activité. Il ne suffit pas de s'étendre
pour se décontracter, de fermer les yeux et de boucher ses oreilles pour atteindre l'apaisement
ou la paix43. » »
Je ne comprends pas bien le lien entre « décontraction » et « idéologie, mythe, besoin ». Une
« science du repos » serait en effet indispensable pour les personnes comme moi, qui n’arrivent
pas à se décontracter complétement. On devrait apprendre ça à l’école… un petit souvenir me
revient quand même, vraiment du plus profond de ma mémoire, puisque c’était quand j’étais en
maternelle, il y a, hum, …, quarante ans : étendue sur un matelas, dans la salle de sieste, comme
tous les autres enfants, je ferme les yeux, la maîtresse passe pour soulever un bras de chacun.
Je dois laisser mon bras mou « comme une poupée de chiffon » a-t-elle dit… Et en écrivant ces
mots, je sais que lorsque mon corps me réclame du repos, j’essaye, inconsciemment, de devenir
une « poupée de chiffon ».
Page 115 :
43 Henri Lefebvre, La Somme et le reste, (autobiographie), 4° éd. Paris, Anthropos, 2009, p. 645
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 42 Janvier 2015
« Le moment de la justice et du jugement ne se forme pas dans la nature. Ce moment est
invention de l'homme civilisé. La pensée ontologique le projeta en l'être absolu, en voyant en
Dieu, le juge suprême. Aujourd'hui, la vie entière relève de la justice et du jugement ; pourtant,
le jugement n'est qu'un moment. »
Même si je suis baptisée, que je suis allée au caté, que j’ai fait ma communion et que je me suis
même mariée à l’église, je ne crois pas en un Dieu tout puissant qui nous juge. Je crois en la
Nature, je crois en Nous, les êtres humains. Alors la justice, oui, elle doit être un moment pour
ce qui nous concerne en tant qu’être humain par rapport aux autres êtres humains. Nous
établissons des règles, des lois, dans notre monde civilisé et nous nous jugeons selon le respect
de ces lois. Mais la Nature nous jugera à sa façon. L’exemple du réchauffement climatique est
assez flagrant lorsque l’on voit le dérèglement météorologique , parce que nous n’avons pas
respecté la Nature.
Page 117 : au sujet du moment de la poésie
« Ce moment s'installe dans le langage. « Un objet, un être, un aspect fugitif reçoivent ainsi le
privilège d’une charge intolérable, incroyable, inexplicable de présence. Un sourire ou une
larme, une maison, un arbre, devient un monde. Ils le sont véritablement, pour un moment qui
dure, et qui, se fixant en parole se retrouvera et se répètera presque à volonté dans le devenir.
Un sourire, un nuage s'éternisent ainsi44. »
Ce passage me rappelle ce que j’ai écrit dans ma note d’investigation de Master 1 dans le
paragraphe qui concerne mon rapport à ma recherche, page 4 :
Mon père est un conteur, un poète, un rêveur, un voyageur. Ma mère est une conteuse, d'une
bienveillance lucide, courageuse, fonceuse. Tous les deux sont généreux et savent partager pour
toutes les choses de la vie. Alors forcément, élevée entre ces deux êtres, j'ai eu mon lot
d'histoires, aussi bien imaginaires que réelles, et cela m'a fait pousser.
Et je suis une conteuse, une rêveuse, une voyageuse, d'une bienveillance lucide, courageuse,
fonceuse et généreuse. Je n'écris pas de poésie, je ne suis donc pas poète, en revanche, je
m'émerveille de ce qui est poétique, des belles petites ou grandes choses de la vie, un coucher
de soleil, mes deux garçons qui jouent de la guitare ensemble, les papillons qui virevoltent, la
puissance de la mer et ses vagues, les couleurs des saisons, la main de mon amoureux qui prend
la mienne...
44 Henri Lefebvre, La Somme et le reste, (autobiographie), 4° éd. Paris, Anthropos, 2009, p. 646-647
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 43 Janvier 2015
Page 117 :
« Pour un romantique, « la chute d'une feuille a autant d'importance que la chute d'un État. C'est
Amiel, je crois, qui a écrit cette phrase à propos de la poésie romantique allemande. Nous
pouvons imaginer un tel poète écrivant un fort beau poème, très pur, sur la chute d'une feuille,
en déclarant qu'elle a pour lui une importance capitale, plus d'importance qu'une guerre
mondiale ou qu’une révolution45. » »
Je ne sais pas qui est Amiel… Je me sens inculte… mais bon, je vais chercher. En tout cas, cette
phrase sur la chute d’une feuille, me transporte. Je trouve des infos, à garder pour ma
recherche46.
Page 118 :
« …toute civilisation est créatrice de formes. « Elle diffère en ceci de la société (qui consiste
en une structure économique, en un mode de production, en rapports de propriété, etc ...) et de
la culture (qui consiste en connaissances, contenus appris, faits retenus, en œuvres admises) ».
H. Lefebvre veut relier ces trois termes sans les confondre ; il veut les distinguer sans les séparer.
« La civilisation crée des formes dont il y aurait lieu de suivre la constitution dans l'histoire.
Ainsi le formalisme des paroles et le rituel des gestes, courtoisie et politesse, comme modes de
contact et de communication47. » »
J’aime bien cette idée de « suivre les formes créées par la civilisation ». La politesse, par
exemple, me fait penser aux lettres que s’échangeaient mes grands-parents avant leur mariage.
Ils demandaient, chacun à leur tour des nouvelles de toute la famille, des parents, des frères et
sœurs, … Déjà, aujourd’hui, je pense que les amoureux ne s’écrivent plus que par SMS ce qui
empêche de s’étaler et d’aller un peu plus droit au but… Je note ce point à voir plus tard.
Page 119 :
« La théorie des moments n'est concevable que dans une transduction entre le sociologique et
l'individuel. Rien ne les sépare : « Les moments que l'individu peut vivre sont élaborés (formés
ou formalisés) par l'ensemble de la société à laquelle il participe, ou par tel groupe social qui
45 Henri Lefebvre, La Somme et le reste, (autobiographie), 4° éd. Paris, Anthropos, 2009, p. 646 46 http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Amiel 47 Henri Lefebvre, La Somme et le reste, (autobiographie), 4° éd. Paris, Anthropos, 2009, p. 648
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 44 Janvier 2015
diffuse dans l'ensemble de la société son œuvre collective (tel rituel, telle forme de sentiments,
etc.)48. » Ces réalités relèvent de la sociologie. Elles constituent des moments en tant que la
nature et le naturel entrent dans les structures de la conscience sociale. »
Je garde ce passage pour ma recherche, pour l’aspect « esprit d’humanité ».
Page 121 :
« La quotidienneté est le terreau du moment. Elle lui est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Les
moments virtuels sont à la fois mêlés et séparés, dans le quotidien. Elle représente à son niveau
certains caractères de la vie naturelle. L'émergence du moment se fait par une intervention du
sujet : style, ordre, liberté, civilisation, et aussi, peut-être, philosophie. »
Le « sujet » intervient pour faire naitre son moment. Il y a une action, quelque chose se
déclenche. Je pense à notre petit moment concret de boire notre thé le matin, au travail. C’est
un vrai salon de thé, chez nous : la bouilloire, les cuillers à thé ou sachets à remplir, thés en vrac
de toute sorte, noir, vert, blanc, rouge, infusions, aromatisés menthe, fruits jaunes, fruits rouges,
caramel, russe, ou fraise-rhubarbe (mon préféré !). En général, c’est moi qui déclenche le
moment du thé. Ça devient automatique, je n’ai pas besoin de regarder l’heure, mon organisme
réclame ce moment, c’est donc bien un caractère de « vie naturelle ». A 9h30, à peu près, je me
lève, je vais remplir la bouilloire d’eau, je la mets à chauffer. Quand le petit bouillon se produit
et que le bouton se relâche, j’envoie un petit message à mes collègues des bureaux alentours :
« L’eau est chaude… ». Et chacun, vient remplir sa cuiller ou son sachet, met son eau chaude,
reste un peu pour discuter de sa soirée de la veille ou du week-end, de ce que l’on prévoit de
faire pour le déjeuner le midi, enfin on parle de tout et de rien, de la vie, de nos enfants, de nos
chéris, on fait un peu de philo-sophie, si le cœur nous en dit… Mes collègues, entre autres,
s’appellent Sophie et Anne-Sophie, mon deuxième prénom après Angéline, c’est Sophie…
Nous sommes de grandes Sages… surtout au moment du thé !
Page 121-122 :
« L'intervention sur la vie quotidienne consiste à répartir, les éléments et les instants du
quotidien dans les moments, afin d'en intensifier le rendement vital. Extraits de la quotidienneté,
les moments permettent une meilleure communication, une meilleure information. Ils
permettent aussi de définir de nouveaux modes de jouissance de la vie naturelle et sociale. La
48 Henri Lefebvre, La Somme et le reste, (autobiographie), 4° éd. Paris, Anthropos, 2009, p. 651
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 45 Janvier 2015
théorie des moments ne se situe donc pas hors de la quotidienneté, mais s'articuler avec elle en
s'unissant à sa critique pour y introduire ce qui manque à sa richesse. Penser ses moments
permet alors de « dépasser au sein du quotidien, dans une forme nouvelle de jouissance
particulière unie au total, les vieilles oppositions de la légèreté et de la lourdeur, du sérieux et
de l'absence de sérieux49. » »
Quand j’analyse ce moment du thé au travail, je sais qu’il y a un truc qui me déplait, c’est le
moment où l’on jette le contenu d’herbes ou de thé mouillés… Les cuillers à thé, il faut les
vider et c’est… pénible… ça colle, ça en met partout. Bon, je ne suis pas assez calée, il faudrait
que je demande à d’autres spécialistes du thé, mais pour ce moment du thé, « ce qui manque à
sa richesse », je vais l’« y introduire » dès que j’aurais trouvé une solution qui me conviendra
mieux… Bon, c’est un tout petit exemple concret, mais je garde ce passage, il faudrait que je
trouve d’autres exemples personnels qui, j’en suis sûre, viendraient coller parfaitement à ce
« modèle ». Je garde ce passage ainsi que le précédent pour ma recherche.
Page 123 : Au début du chapitre 8, je note la citation d’introduction et je la garde pour ma
recherche.
« La théorie des moments surmonte l'opposition du sérieux (éthique) et du frivole (esthétique)
comme celle du quotidien et de ce qui est noble, élevé, supérieur (culturel). Elle révèle la
diversité des puissances de l'être humain total, puissances qui viennent à l'homme de son être
et de « l'être » (disons, pour éviter l'interprétation spéculative : de la Nature, de la nature en lui,
de sa nature). »
Page 124-125 :
« Malgré le changement des situations, quelque chose demeure. Ce quelque chose est le
moment lefebvrien. Les termes psychologiques (états, émotions, attitudes, comportements, etc.)
sont insuffisants pour le caractériser, car le moment suppose à la fois la re-connaissance d'autrui
et de soi. La re-connaissance s'impose aux deux, malgré le mélange des connaissances à des
ignorances dans la situation originale qu’ils expérimentent ensemble. »
49 Henri Lefebvre, La Somme et le reste, (autobiographie), 4° éd. Paris, Anthropos, 2009, p. 655
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 46 Janvier 2015
Ce « quelque chose » me plait, je le trouve très poétique. Ce moment à deux, permet en effet
un mixage impressionnant, si on analyse bien, de ce que l’un et l’autre connait ou pas, ensemble
ou pas…
Page 125 :
« Dans la rencontre, il y a reconnaissance de l'analogie et de la différence de l'expérience de
chacun dans le temps vécu. Chacun vit une modalité spécifique de la répétition. « Quelque
chose » se rencontre à nouveau : « Illusion ou réalité, le temps vécu se retrouve à travers les
épaisseurs et le chemin parcourus. En même temps, il s'évanouit et se connaît. Aucune
détermination proprement sociologique ou historique ne suffit à définir cette temporalité50 . »
Ainsi, H. Lefebvre pose que la théorie des moments est un effort pour rendre portée et valeur
au langage. »
Je note ce passage, qui me sera utile pour ma recherche. « Les épaisseurs et le chemin
parcourus », c’est, pour moi la matière première de la formation de soi.
Page 125 :
« Dans le langage commun, le mot moment se distingue peu du mot instant. Et cependant, il
s'en distingue. On dit : Ce fut un bon moment..., ce qui implique à la fois une certaine durée,
une valeur, un regret et l'espoir de revivre ce moment ou de le conserver comme un laps de
temps privilégié, embaumé dans le souvenir. Ce n'était pas un instant quelconque, ni un simple
instant éphémère et passager51 ».
Forcément, je ne peux que penser ici, à mes bons moments, toujours intenses, et infiniment
bienfaisants pour moi, d’avoir mes garçons à mes côtés, Gaël, mon amoureux, et de partager
ensemble ne serait-ce qu’un bon gâteau, une discussion, un moment de musique… En revanche,
même si je peux garder l’espoir de revivre un de ses moments, je sais, par expérience, que ce
ne sera jamais identique. C’est comme la première fois que l’on se rend dans un endroit, ou que
l’on voit un film. Les conditions ne peuvent jamais être toujours réunies pour avoir exactement
les mêmes sensations, si on revoit ce film ou si l’on se rend de nouveau dans un endroit qui
nous avait plu. Tout simplement aussi, parce que nous « grandissons », chaque minute qui
50 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne tome 2 (Chapitre VI), p 342
51 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne tome 2 (Chapitre VI), p 343
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 47 Janvier 2015
sépare deux moments, qui peuvent paraitre semblables, nous aura appris quelque chose de
nouveau, qui nous aura changé.
Page 126 :
« À ce moment de son exposé, H. Lefebvre évoque le système hégélien, dans lequel le terme :
moment reçoit une promotion. H. Lefebvre rappelle que chez Hegel, le moment désigne les
grandes figures de la conscience. La conscience du maître et celle de l'esclave dans leurs
rapports, la conscience stoïcienne ou sceptique, la conscience malheureuse, etc. sont des
moments de la dialectique de la conscience de soi. Ainsi, le moment dialectique « marque le
tournant de la réalité et du concept : l'intervention capitale du négatif qui entraîne désaliénation
mais aliénation nouvelle, dépassement par négation de la négation, mais nouvelles étapes du
devenir et nouvelles figures de la conscience52. » »
Je garde ce passage, un peu complexe, mais qui parle d’Hegel, pour ma recherche.
J’aime bien la « promotion », attribuée au moment. J’ai l’impression que l’on pourrait mettre
une sorte de note, de niveau aux moments. Une cotation, par rapport à des critères, pourraient
être envisagée pour chaque moment, qui pourrait bien sûr, être noté différemment par les
participants, comme on l’a vu plus haut, la « re-connaissance », n’étant pas la même. Mais,
bon, en fait, c’est ce qui se passe en vrai. Si je dis, après avoir vu un film : « j’ai vraiment passé
un bon moment », peut-être que Gaël, lui me dira : « j’ai trouvé ça long, ce film m’a ennuyé ».
Nos moments n’auront pas forcément la même note, la même valeur, la même épaisseur.
Page 126 :
« Le quotidien est banal. C'est un mélange informe. L'analyse y reconnaît, pourtant, les germes
de tous les possibles. « Les germes des moments s'y pressent et s'y distinguent mal. Ainsi dans
l'enfance et l'adolescence, le jeu et le travail, le jeu et l'amour, il faut une pédagogie sévère et
un effort pour arriver à particulariser le travail, à spécifier l'ensemble d'attitudes, de
comportements et de gestes qu'il groupe, que ce travail soit matériel ou intellectuel53 ». »
En lisant ce passage, je pense aux petits enfants, ou aux grands d’ailleurs, qui vont demander
quelque chose ou attendre quelque chose de leurs parents, qui répondent : « ce n’est pas le
moment ». J’essaie de trouver un exemple… ça ne vient pas… je reviendrai…
52 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne tome 2 (Chapitre VI), p 344 53 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne tome 2 (Chapitre VI), p 345
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 48 Janvier 2015
Mardi 18 novembre 2014, 12h38, pause déjeuner voiture, au bord de l’eau
Page 128 :
« Ainsi, la vie spirituelle apparaît à H. Lefebvre comme une constellation. Il adopte ce symbole.
Le quotidien occulte la constellation des moments qui monte à l'horizon. « Chacun choisit son
étoile, librement, c'est-à-dire avec l'impression d'une irrésistible nécessité intérieure. Personne
n'est obligé de choisir. La constellation des moments ne se prête à aucune astrologie : point
d'horoscope pour la liberté54. » »
C’est fou ces drôles d’associations : horoscope et liberté, moments et constellations. Je pense à
ces fameuses « boites », ces « carrés » dont ma mère parle souvent. Son petit concept se
rapproche de la théorie des moments. Chacun d’entre nous se créée une sorte de quadrillage, et
remplit ses « carrés » comme il l’entend, on choisit donc librement de les remplir ou non. Il faut
trouver un équilibre avec le nombre de ses « carrés », s’il y en a trop (un peu comme moi à
certaines périodes de ma vie), ça peut vite tourner à l’hyperactivité et donc au surmenage, s’il
y en a très peu, la perte d’un seul « carré » peut être dramatique (comme certaines femmes qui
n’ont que deux carrés : leur mari et leur enfant ; quand le mari veut divorcer ou meurt, il ne
reste à la mère, que l’enfant, qui partira forcément quand ce sera « son » moment. Et là elle se
retrouvera toute seule, sans aucuns autres moments déjà présents dans sa « constellation »). Je
pense que les dépressions dont souffrent beaucoup sont dues souvent à ce phénomène… Enfin,
je crois.
Page 128 :
« Les moments s'opposent aux faux soleils qui éclairent la vie quotidienne : la morale, l'État,
l'idéologie. Ces soleils empêchent l'individu de jouer des possibilités du quotidien.
« Malheureusement les étoiles des possibles ne brillent que la nuit. Tôt ou tard, le jour quotidien
se lève, et les soleils (y compris le soleil noir de l'angoisse vide) remontent au zénith. Les étoiles
ne brilleront que la nuit, tant que l'homme n'aura pas transformé ce jour et cette nuit55.
Je pense à un moment que je ne vis pas et dont je suis un peu jalouse… Mais, c’est la vie. Mes
garçons et leur père, depuis quelques années, passent régulièrement, un week-end en pleine
nature. Ils se retrouvent tous les trois, dans une clairière d’une forêt, ou près d’un lac, enfin dans
54 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne tome 2 (Chapitre VI), p 347-348 55 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne tome 2 (Chapitre VI), p 348
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 49 Janvier 2015
un endroit le plus sauvage qui soit dans notre pays de plus en plus « surveillé ». Ils plantent leur
tente, ou plutôt, ils lancent leur tente « deux secondes » à la tombée de la nuit et la rangent au
lever du jour, pour, quand même, respecter cette règle, cette loi de l’Etat. En général, ils se font
un feu de camp, sur lequel ils font fondre des marshmallows, qui sert de lumière et à les
réchauffer pendant qu’ils profitent du ciel étoilé. Ce feu éloigne ou attire… les bêtes sauvages
de la campagne, et ils ont toujours cette phrase lorsqu’ils me racontent leur week-end : « On a
eu un peu peur, on a entendu des bestioles… ».
J’espère que je serai assez en forme et que ce sera toujours possible, quand j’aurai des petits
enfants, je pourrais vivre avec eux ce genre de moments.
Pages 128-129 :
« L'hypothèse du moment, c'est la rupture avec les accomplissements imposés. C'est l'idée
qu'une fête individuelle, et librement célébrée, fête tragique, donc véritable fête, est possible ;
et qu'il ne dépend de chacun d'entre nous de la créer. La perspective d'H. Lefebvre n'est pas de
supprimer les fêtes ou de les laisser tomber en désuétude, dans la prose du monde. C'est d'unir
la Fête à la vie quotidienne. »
Je viens de dire juste avant que finalement il ne dépend en effet que de moi de créer une fête de
chaque instant, de chaque moment.
Page 129 :
« « La possibilité se donne ; elle se découvre ; elle est déterminée et par conséquent limitée et
partielle. Vouloir la vivre comme totalité, c'est donc nécessairement l'épuiser en même temps
que l'accomplir. Le Moment se veut librement total ; il s'épuise en se vivant. Toute réalisation
comme totalité implique une action constitutive, un acte inaugural. Cet acte, simultanément,
dégage un sens et le crée. Il pose une structuration sur le fond incertain et transitoire de la
quotidienneté (qu'il révèle ainsi : incertaine et transitoire, alors qu'elle apparaissait comme le
réel solide et certain)56 » ».
Ce passage m’intéresse pour ma recherche. La formation de soi tout au long de la vie est une
possibilité que l’on se donne. Je développerai sûrement cette notion « d’épuiser en même temps
qu’elle s’accomplit ».
56 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne tome 2 (Chapitre VI), p 348
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 50 Janvier 2015
Page 129 :
Cette théorie a un rapport avec l'existentialisme, puisqu'elle décrit et analyse les formes de
l'existence. Mais elle s'en distingue en se disant essentialiste. «Les moments pourraient se
nommer aussi bien des essences que des attributs et modalités de l'être ou des expériences
existentielles». H. Lefebvre parlerait plus volontiers de puissances que d'essences, car le but
pratique de la théorie est «la transformation de ces puissances, totalités partielles vouées à
l'échec, en quelque chose d'imprévisiblement neuf et véritablement total, qui surmonterait la
contradiction trivialité-tragédie57 ».
Ce passage m’interpelle, je le garde pour ma recherche.
Page 130 :
« Le moment n'est pas la situation, car il résulte d'un choix, d'une tentative. Le moment suscite,
crée des situations. Il condense les situations en les reliant. Grâce au moment, les situations ne
sont plus subies dans le vécu banal, mais prise en charge au sein du vivre. »
Le moment. est conscientisé : mon moment du « violoncelle », c’est moi qui le choisi. Mon
moment « études », n’est pas mon « vécu banal », qui sera plutôt celui de m’occuper de mettre
mon linge à laver, de regarder dans la boite aux lettres si le facteur est passé, ou peler des
légumes pour faire une soupe, mais étudier, c’est mon moment qui me construit, c’est bien de
mon « vivre » dont il s’agit. Il me vient à l’esprit quand même que mes petits moments de vécu
banal, comme d’éplucher des légumes, est devenu une sorte de thérapie pour me calmer de ma
journée et du stress du travail.
Page 132 :
« Mais H. Lefebvre montre que des hommes qui ne sont ni artistes ni philosophes parviennent
aussi à s'élever au-dessus du quotidien en se construisant des moments : amour, travail, jeu, etc.
« La vie spontanée n’offre que mélange et confusion : connaissance, action, jeu, amour. Par
rapport à cette vie, l’homme cultivé tend à séparer ce qui est donné comme mélangé, les
éléments ou formants de la vitalité spontanée, dont il se servira pour constituer les moments58. »
L’homme cultivé unit ce qui se donne séparément à la conscience spontanée : la vie et la mort,
la vitalité et le tragique de l’échec. »
57 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne tome 2 (Chapitre VI), p 349 58 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne tome 2 (Chapitre VI), p 356
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 51 Janvier 2015
Unir, séparer, réfléchir, prévoir, se projeter, voici les termes qui m’apparaissent pour cet homme
cultivé qui construit ses moments, qui se construit.
Page 134 : réflexion sur la représentation
« Je puis me représenter l’autre en dehors de sa présence ; je puis me représenter l’œuvre en
dehors de sa présence. La représentation est donc un lien entre la présence et l’absence. »
J’aime beaucoup ce concept de « représentation ». Mon fils Rémi vit à Nantes pour ses études.
Quand il est absent de la maison, je me le représente. Je le visualise dans son studio, dans le
parc en train de lire un livre, avec ses amis (que je ne connais pas), je l’imagine, je me le
représente dans différentes situations. J’imagine ses moments.
Page 135 : dans Henri Lefebvre, La présence et l’absence, Paris : Casterman, 1980
« L’œuvre, parce qu’elle est ainsi spécifiquement humaine, implique un respect qui a une portée
éthique. Il faut éviter d’en faire une théorie qui donnerait des leçons. La civilisation est une
œuvre éclatée. L’œuvre ne peut s’accomplir sans constituer une totalité. « Dans toute œuvre, on
retrouve donc un moment technique et un moment du savoir, un moment du désir et un moment
du travail, un moment du ludique et un moment du sérieux, un moment social et un moment
extra-social, etc. (p. 197). » »
Cette définition d’une œuvre me parle, je la comprends et j’aimerais que ce soit ça qu’on
apprenne à l’école.
Page 135 :
« Expliquer l’œuvre suppose que l’on prenne en compte la complexité de ses moments. Car
autonomiser un aspect : l’économique, par exemple, détruit l’œuvre… « L’œuvre implique du
jeu et des enjeux, mais elle est quelque chose de plus et d’autre que la somme de ces éléments,
de ces ressources, de ces conditions et circonstances. Elle propose une forme, qui a un contenu
multiforme – sensoriel, sensuel, intellectuel – avec prédominance de telle ou telle nuance de la
sensualité ou de la sensibilité, de tel sens, de telle technique ou idéologie, mais sans que cette
prédominance écrase les autres aspects ou moments (p. 197).»
Voilà, ce que je voulais dire juste avant. A l’école, on nous « apprend » à expliquer une œuvre,
mais j’ai toujours eu la désagréable sensation qu’il n’y avait que du subjectif. Et je ne
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 52 Janvier 2015
comprenais jamais d’où venaient ces explications d’œuvres. Là, c’est du concret, même si c’est
encore un peu complexe et confus, je garde ces deux passages pour ma recherche, et pour moi,
tout simplement, pour m’aider à comprendre les œuvres, et ce qui fait leurs plus ou moins
grandes valeurs.
Page 136 :
« Savoir et vécu interagissent dans la production de l’œuvre. Alors que le producteur se trouve
exproprié de son produit, le créateur reste au cœur des formes qu’il invente. Le créateur se
distingue du savant, non par le savoir ou le non-savoir, mais par le trajet qui conduit à l’œuvre
et qui intègre le savoir dans le processus de création.
[…] Le savant accumule du savoir. L’artiste s’adresse au vécu pour l’intensifier. Il ne cherche
en aucun cas à le soumettre. »
Est-ce que nous, étudiants de Paris 8, et apprentis-chercheurs proche du laboratoire d’Experice,
sensibles à la tenue d’un journal, nous ne serions pas des « artistes », des « créateurs », plus que
des « savants » ? Je compare avec mes amis David et Annelise, en licence de psychologie, à
l’IED et mon fils Rémi, étudiant de deuxième année en Lettres supérieures. Ils doivent
apprendre tout par cœur. Pour ma part, je n’apprends rien par cœur, je raconte ma vie, je fais
des liens, je les écris. Tous les trois, ils vont retenir des choses, ils seront donc capables de
ressortir du tac au tac le nom d’une pathologie, d’un élément du cerveau, d’un concept physio-
psychologique, ou le nom d’un auteur, d’un peintre, des titres d’œuvres… La différence avec
moi, c’est que j’indexe ! Je sais où chercher l’information dont j’ai besoin parce que je l’aurai
indexée dans mes écrits (merci aussi l’informatique qui nous permet des recherches de mots…).
Le fait d’écrire me permet d’intégrer des concepts, des idées, d’en faire germer d’autres. Mais
je ne pourrai pas tout le temps répondre immédiatement lors d’une conversation à des questions
précises de dates, d’auteurs et d’ouvrages. Ma mémoire n’est donc pas saturée, elle est
disponible pour peut-être autre chose… créer une œuvre, créer sa vie ? L’inconvénient, c’est
que dans notre société, l’évaluation par les notes, par les concours, par les épreuves écrites, me
font me sous-estimer. Je me sens nulle, souvent, parce que justement je ne sais pas répondre
immédiatement. Allez, j’arrête de faire mon Caliméro, ça me plait bien de me dire que je suis
une Arrrtiste !
Page 136 :
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 53 Janvier 2015
« Le travail de l’art, c’est d’exalter le vécu, voire de le transfigurer. L’art et la création se
développent dans le registre des représentations. Mais la création en sort d’une part par la
spontanéité, la vitalité, l’immédiateté perdue et retrouvée, et d’autre part par l’ampleur des
horizons et par la pluralité des sens. Le créateur dépasse les représentations non seulement par
le travail d’écriture, mais aussi par le dépassement des perspectives. »
Je vais transmettre ces passages sur l’œuvre, à Rémi, ça pourrait lui être utile pour ses cours
d’Histoire des Arts.
Ce passage continue de confirmer ce que je suis, ce que je fais, en tant qu’Arrrtiste… Je créé
en permanence, à partir de mon quotidien, j’ébullitionne, ça peut partir dans tous les sens, mais
je me dépasse, je dépasse des frontières que jamais je n’aurais pu imaginer.
Page 136 :
« Les marginaux sont souvent objectivés par le système. Mais, à la marge, il existe aussi des
hommes des frontières qui réussissent à défier le système, pour le mesurer du regard et de la
pensée, pour faire émerger une connaissance critique. H. Lefebvre écrit : « Alors que les gens
pris dans la masse n’en aperçoivent qu’un recoin –leur lieu, leurs alentours, leur groupe, leurs
intérêts – l’homme des frontières supporte une tension qui en tuerait d’autres : il est à la fois
dedans et dehors, inclus et exclu, sans pour autant se déchirer jusqu’à la séparation. […] Il va
toujours vers d’autres terres, vers l’horizon des horizons, de moments en moments, jusqu’à ce
qu’il aperçoive les lignes lointaines d’un continent inexploré. Découvrir, c’est sa passion (p.
202). » »
Etre dedans et dehors, me fait penser à l’époque où j’ai créé ma petite entreprise d’informatique
à domicile. A temps partiel, trois jours pour mon travail salarié, deux jours pour ma petite
entreprise. Je me retrouvais donc à la fois dedans et dehors de l’entreprise, où je suis toujours
salariée, à temps plein aujourd’hui. Et en effet, cela m’a permis de « faire émerger une
connaissance critique », j’avais l’impression physique, d’avoir pris assez de hauteur pour voir
avec attention et lucidité ce qui se passait dans cette boite. D’où mon mal-être constant, parce
qu’aujourd’hui, je me sens totalement exclue par rapport à mes valeurs, et à ce que je pense
qu’il serait bien de faire dans cette entreprise. Mais, dans mon chemin vers la sagesse, je me dis
que je ne connais pas les objectifs de nos actionnaires. S’ils ont décidé de faire couler la boite,
alors, oui, leurs actions, les comportements de nos chefs sont en adéquation…
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 54 Janvier 2015
Page 136-137 :
« L’œuvre lutte pour sa durée. Elle immortalise un instant, une beauté mortelle et fugitive, un
acte, un héros… L’œuvre contient le temps, le retient. Elle cristallise le devenir. L’œuvre a donc
un temps propre. Elle échappe à la division du travail bien qu’elle soit un travail. Mais elle n’est
pas un produit. Même si elle se vend, l’œuvre n’a pas de prix. L’œuvre restitue la valeur d’usage.
Elle est totalité. »
Page 137 :
« L’œuvre est un centre provisoire qui rassemble ce qui, par ailleurs, se disperse. Toute œuvre
a cette qualité. L’enjeu de l’œuvre, c’est un projet qui peut échouer : se proposer l’unité, la
totalité des moments. »
Je note ces deux passages, je les trouve beau, tout simplement.
Page 138 :
« L’œuvre est une accumulation de travail, mais il faut comprendre ce terme dans un sens très
large. La négation, le savoir critique, l’oubli des opérations accomplies par des moyens
techniques appropriés participent de ce travail. En allemand, on distingue arbeiten et erarbeiten.
Les deux termes signifient travail. Mais le surplus de sens du second terme, c’est la notion
d’élaboration, mieux de perlaboration. « Le travail patient et appliqué se dépasse constamment
par l’inspiration qui reprend contact avec le vécu, avec l’immédiateté passée ou possible ; mais
il faut aussi revenir au travail (p. 207).» »
Le terme de perlaboration m’interpelle, je cherche sur Wikipédia59. C’est une définition liée à
la psychanalyse. Ce passage m’inspire, justement, que c’est ce que j’aime par-dessus tout : un
de mes plus grand sentiment de réussite, c’est quand, par mon travail, cela inspire une idée, une
envie à quelqu’un.
Page 140 :
« Au moment de la conception de l’œuvre, l’absence apparaît lorsque l’artiste prend ses
distances avec les matériaux qu’il a rassemblés. Le créateur a besoin de prendre du recul par
rapport à ce qu’il a déjà produit ou amassé : expériences, techniques, souvenirs, projets. Sa
pensée prend alors la posture du rejet, de la critique, de la confrontation, de la négation. Le
59 http://fr.wikipedia.org/wiki/Perlaboration
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 55 Janvier 2015
travail exige du recul, des blancs, des vides… Survient alors l’objet. Celui-ci figure-t-il dans
le tableau ? N’est-il que suggéré ? « Dans la peinture, comme dans la poésie, l’objet s’invoque,
s’évoque, se convoque. Il devient actuel, donc présence, autre face de son absence, puisqu’il ne
peut être là en personne (p. 210). » »
En fait, j’ai vraiment ce sentiment, à chaque fois que je me lance dans quelque chose d’un peu
nouveau : j’entasse, je cherche de la matière première, j’engrange des informations, et je prends
du recul, c’est vraiment ça… Je pourrais, même si Remi Hess, a déjà entendu ma soutenance
de note d’investigation de Master 1, remettre ici le texte de la méthode de « conception » de ma
petite œuvre.
Voici la méthode que je me suis inventée pour l'écriture de ma note :
Lorsque j'avais devant moi, la quinzaine de livres que j'avais empruntée en bibliothèques, j'ai
pensé ceci : « Avec tout ça, je me sens prête à faire une véritable œuvre d'art ! J'ai l'impression
que chaque livre est un tube de peinture d'une couleur particulière. Il ne me reste plus qu'à
utiliser des touches des unes et des autres, de les assembler pour arriver à quelque chose
d'esthétique, quelque chose de beau, et qui me convienne ».
En fait, j’ai repris cette phrase et j’ai associé une couleur à tous les mots-clés, que j'avais définis
comme étant essentiels à ma recherche. J’ai « peint » de chaque couleur correspondante les
extraits de texte que j’avais noté dans mon journal, les plus intéressants pour ma note. J’ai
ensuite classé par couleur tous les extraits dans chaque chapitre de mon plan. J'ai résumé en une
seule ligne tous les paragraphes pour vérifier l'équilibre et réajuster entre les quatre chapitres.
J’ai pu alors assembler les phrases selon chaque thème, en essayant d’être la plus exhaustive
possible et de ne rien oublier.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 56 Janvier 2015
Page 141 :
« Le créateur d’œuvre n’échappe pas au quotidien. Il lui faut une demeure, un lieu, un espace
où il puisse manger, dormir, travailler. Mais, à la différence des gens du sens commun, le
créateur ne se laisse pas engloutir dans le quotidien. Il se l’approprie, mais s’en dégage. Il tire
du quotidien les représentations dont il a besoin, mais il crée une distance par rapport au
quotidien. Le philosophe vit aussi ce destin, mais il a tendance à s’installer dans cette
distanciation. L’artiste, lui, ne s’installe pas dans la distance au quotidien. Il construit son espace
d’action poiétique. Ainsi, il profite des phases de distanciation pour entrer en contact avec
d’autres œuvres, avec d’autres influences. Cependant, il y a une proximité entre le créateur
d’œuvre et le philosophe, mais ils ne le savent pas. »
Le terme « poïétique », que j’ai utilisé dans ma note d’investigation de Master 1, a toujours été
un peu obscur pour moi. Ici, avec ce passage, il s’éclaircit. Je suis contente, aujourd’hui, je me
sens « créatrice d’œuvre », tout ce que j’ai lu aujourd’hui me parle énormément. Je m’identifie
totalement…
Page 142 : au sujet du moment utopien
« Entrer dans une œuvre, c’est découvrir un pays où règne une utopie. En effet, il y a toujours
dans une œuvre le moment de l’utopie. L’artiste a imaginé. Il a perçu le possible et l’impossible,
le prochain et le lointain. Il se dégage du réel. Il propose une autre façon de voir, de percevoir,
de vivre. Il définit une liberté, un destin, une raison ou une déraison. Bref, il suscite la présence
et l’absence. Il invite à un accomplissement, un épanouissement. »
Je note ce passage parce qu’il résume bien ce qui a été dit plus haut. Il sera utile pour ma
recherche.
Page 142 : au sujet du moment. du jeu et du sérieux
« Dans l’action poiétique, créatrice de présence, il y a une imbrication du moment du jeu et du
moment du sérieux. Faire une œuvre nécessite une discipline, une organisation de l’emploi du
temps, un projet. C’est l’aspect sérieux. Mais en même temps, l’œuvre est une aventure, c’est
un jeu dans lequel on rencontre, comme dans tous les grands jeux, des embûches, des obstacles
qu’il faut lever ou contourner pour avancer. […] Chaque tentative créatrice, le long du trajet,
risque beaucoup : échec, abandon, blocage en chemin. […] « Le moment du jeu implique non
seulement le risque, mais le hasard (chance ou malchance), l’ouverture, l’aventure, la
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 57 Janvier 2015
découverte de l’inconnu et peut-être du mystère. Le moment du sérieux implique l’inquiétude,
la découverte de l’enjeu et de son importance (p. 216). »
Finalement, je me rends compte, que je pourrais écrire ici aussi, ce que j’ai dit lors de ma
soutenance en Master 1 sur ce qui m’avait plu et déplu pendant ma recherche. Allez, soyons
fous ! C’est plutôt agréable, en fait, de prendre conscience que ce que j’avais écrit correspond
bien à ce que des auteurs comme Henri Lefebvre ou Remi Hess ont aussi décrit. Je n’ai donc
rien inventé, mais j’en ai eu conscience, je l’ai écrit, et je m’en souviens en lisant ce passage.
Voici ce texte :
Oui, j'ai rencontré des difficultés, de deux ordres.
Tout d'abord, matérielles au sujet des livres. J'ai acheté les quatre ouvrages conseillés par les
enseignants. Mais j'ai eu beaucoup de mal à me procurer L'enfant et les fables, de Michel Fabre.
J'ai quand même réussi en cherchant sur internet, j'ai trouvé un exemplaire d'occasion en
Belgique.
Pour les autres ouvrages, je les ai trouvés, soit à la médiathèque de Niort où je vis, soit à la
bibliothèque universitaire de Nantes, quand même à deux heures de route de chez moi.
J'ai aussi perdu beaucoup de temps en utilisant un carnet pour prendre mes notes au lieu de les
taper directement à l'ordinateur. Je trouvais plus pratique de glisser mon carnet dans mon sac à
main. Finalement c'est mon sac à main que j'ai changé pour un sac d'ordinateur.
J'ai été déçue également de ne pas avoir pu consulter deux thèses qui m'intéressaient. Celle
d’Ernest Tonnelat, de 1912, sur Les frères Grimm. Cette thèse est présente à Nantes mais
indisponible pour cause de réparation, j'espère que je pourrai un jour la consulter sur place. Et
celle de Léa SOUCCAR, de 2003, de l'université Saint-Joseph de Beyrouth au Liban : La fée
libératrice, Quand la littérature jeunesse offre des étincelles de résilience.
D'un point de vue plus personnel, j'ai eu des difficultés à me concentrer sur un périmètre sans
le dépasser. J'avais l'impression de partir dans tous les sens, et justement, j'avais du mal à définir
le périmètre de ma recherche. Cela m’a fait perdre du temps, ce qui m’a obligé à me mobiliser
beaucoup plus intensément à la fin.
La création de la rubrique « A voir plus tard » m'a aidé à y glisser tous les sujets sur lesquels je
m'étais laissé emporter à plusieurs reprises. Et en ce qui concerne le périmètre, j'ai réussi à le
définir par les pistes de Didier Moreau fournies dans ses e-mails et par ma réflexion que j'ai
mise à l’épreuve dans le cours de Clarisse Faria-Fortecoef.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 58 Janvier 2015
Au niveau de la gestion de la vie familiale, j'ai fait des allers-retours entre la bulle où j'étais
plongée pour tout ce qui concernait ma recherche et la bulle « Famille », avec les tâches
quotidiennes et le partage de tous les moments de vie.
J'ai trouvé beaucoup plus difficile que lors de la licence, le passage de l'un à l'autre, je me suis
sentie frustrée et j'ai culpabilisé aussi bien de ne pas passer assez de temps en famille, ni assez
de temps pour ma recherche qui prenait du retard. Je pense que je ne me suis pas assez bien
organisée, j'aurais dû me préserver des plages d'études et de famille plus longues pour qu’elles
soient aussi bien les unes que les autres plus intenses et efficaces.
J'ai vécu de grands moments de solitude, et même si Bertrand Crépeau m’avait prévenu que je
devais l'apprivoiser cette solitude dans la recherche, j'ai trouvé que l'ambiance était pesante.
Peut-être que cela était dû au peu d’échanges avec les enseignants, ainsi qu’avec les autres
étudiants. Tous étaient sans doute très occupés.
Je n’aime pas me sentir aussi seule, et pour essayer de dissiper mes doutes, j’ai essayé de faire
partager mes trouvailles autour de moi, en famille ou au travail sans trop les submerger de
détails…
Et pour finir dans les difficultés, je me suis sentie perdue dans des livres que j'ai trouvé
compliqués à lire et à comprendre et aussi parce que je ne savais pas comment m’y prendre,
comment avancer.
C'est en réduisant mon périmètre, en écoutant les conseils avisés de mes coachs à domicile,
Gaël mon amoureux et mes fils Rémi et Lucas, en plus du temps que j'ai investi dans les
dictionnaires, que j'ai pu ouvrir les barrières qui me bloquaient.
Ce qui m'a le plus intéressé dans cette période de recherche, c'est d'abord le champ infini des
possibles qui s'est ouvert devant moi. En poussant un peu plus loin mes recherches, j'ai fait des
découvertes insoupçonnées, comme l'œuvre de Novalis, par exemple, ou certains des contes de
Grimm que je n'avais jamais ni lus ni entendus.
Ce que j'ai apprécié dans cette recherche, c'est de chercher et de ... « trouver »... Par exemple
l'article d'Alice Miller sur le Petit Chaperon rouge, ou bien le mystère des trois livres successifs,
dont parle Humboldt dans sa conclusion de l'Esprit de l'humanité. Ces livres qui devaient
répondre aux questions : en quoi consiste cet esprit ? Comment le reconnaît-on ? Comment est-
il formé ? J'ai trouvé en relisant attentivement la préface, qu'il est indiqué que cette œuvre
restera inachevée...
Et ce qui m'a plu par-dessus tout, c'est de faire des liens, de trouver des liens, entre ce que je lis,
ce que j'écris, ce que je puise tout au fond de ma mémoire, puis ce que je lis à nouveau si je me
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 59 Janvier 2015
replonge dans mon journal. Cet effet « spirale » m'a permis de créer encore de nouveaux liens,
cela me permet d'imaginer que je ne m'ennuierai jamais, tout au long de ma vie.
Page 145 :
Accéder à la présence, obtenir les dons du hasard et de la rencontre, suppose de prendre des
risques. Le risque, c’est celui de l’échec, de la pauvreté, de la poursuite vaine, celui de la fin du
moment de la présence, qui laisse blessure et nostalgie. Accéder à la présence suppose
d’accepter la souffrance qui glisse le désespoir dans le lieu de la joie. Le désespoir (qui n’est
pas l’angoisse) est un moment de l’action poiétique. Ceux qui refusent le risque du désespoir
parce qu’ils ne veulent pas souffrir n’ont aucune chance d’accéder à la joie de la présence.
Quand je lis ce passage, je me dis que je suis désespérée, de voir certaines personnes qui
m’entourent et qui ne prennent jamais aucun risque. Leur vie est fade, enfin pour moi,
finalement, ce n’est peut-être qu’une histoire de goût. J’ai noté dans la webographie de ce
journal, l’Essai sur le goût, de Montesquieu. Ça m’intéresserait de le lire pour voir si ça
m’aiderait à comprendre cette envie de vie fade.
Page 146 :
« La recherche de la présence est-elle un élitisme ? Oui, mais un élitisme « modeste, insolent à
l’occasion mais discret et presque secret (p. 231). » Ce serait une sorte de stoïcisme sans fatum
uni à un épicurisme subtil (Épicure prenait le plus grand des plaisirs à boire un verre de bonne
eau fraîche). Il s’agit d’un élitisme par rapport à ceux qui ne se soucient que du confort et
ignorent que « bonheur et malheur sont des jumeaux qui grandissent en même temps60. » »
Je garde ce passage pour ma recherche.
Mercredi 19 novembre 2014, 12h25, pause déjeuner voiture, au bord de l’eau
Journal imbriqué : samedi 3 janvier 2015, 18h31, bureau, maison
Ha, je respire… je n’avais jusqu’ici, que pris des notes très très succinctes, alors, j’ai pris
beaucoup de temps ces derniers jours pour retrouver mes idées, les références, et les mots tout
simplement que j’avais voulu écrire.
60 F. Nietzsche, Le Gai savoir, fragment 338, cité par Lefebvre.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 60 Janvier 2015
Je savais qu’à un moment donné, j’avais changé ma stratégie de prise de notes, et que ça allait
être un peu plus aisé pour la rédaction au propre de ce journal.
Voilà, on y est…
Page 149 :
« Pour Lefebvre, de la pensée, il en va comme de l'amour : « toujours unique, toujours nouveau.
Et toujours reprenant ses thèmes, les siens. Acte et non état. Provenant d'une rencontre, d'un
mot, d'un détail infime, ascendant puis se dégradant et parfois reprenant son ascension. Inégal
à soi et à son destin. Partie prenante d'un moment appartenant comme tel à l'espèce humaine, à
un peuple, à un groupe, et cependant individuel. »
Je vais écrire de vraies phrases du coup, de ce que je pense et pourquoi je note tel ou tel passage
de ce livre. C'est drôle que je me dise de faire ça juste au moment de ce paragraphe.
Mon cerveau toujours en ébullition, m'amène des idées, des détails infimes, constamment et ça
me gêne pour me concentrer. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais j'ai ouvert un
nouveau cahier où je note, au stylo plume, que j’adore et ça me donne l’occasion de l’utiliser,
tout ce qui vient perturber ma concentration.
Je m'observe…
Je note ce passage par rapport au fait que la pensée est toujours unique, nouvelle, rencontre,
mot, détail infime…
Page 152 :
« Cette prise de conscience m’a conduit à faire un pas de côté, en me posant la question : qu’en
est-il de mon vécu, de la fluidité du sujet que je suis, qui ne rentre pas dans le cadre (framework,
«dispositif») des moments. »
Je pense à Lucette Colin, que j’avais comme enseignante en Licence 3, et qui utilisait cette
expression, « pas de côté », je ne connais personne d'autre qui dit ça… Alors je me demande si
c’est Remi Hess qui l’a apporté en héritage à Lucette, l’inverse, ou bien est-ce un héritage de
quelqu’un d’autre ?
Page 154 :
« Ma question : y a-t-il des gens, qui vivent en dehors de tout moment ? Le problème : quelqu’un
placé en prison se voit détruire progressivement tous ses moments, mais, pas seulement le
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 61 Janvier 2015
prisonnier ! Le malade hospitalisé en hôpital psychiatrique, celui que l’on appelle un chronique,
n’a plus de moment : les rythmes bureaucratiques de l’institution agencent sa vie.
Avant d'aller plus loin dans la lecture, il me vient à l'esprit mes passages à l'hôpital, la maternité
(lien avec la prison, dans le sens où l'on ne peut pas sortir). J'y suis allée à chaque fois en
préparant mes moments Hôpital. Je ne voulais pas m'y ennuyer… finalement, à chaque fois, je
n'ai rien utilisé de tout ce que j'avais amené, livres, broderies,… je n'ai fait que penser et vivre
les moments. comme ils venaient, vivre l'instant présent, au rythme des allées et venues du
personnel hospitalier, des visites, des pleurs ou des câlins de mes petits.
Page 159 :
Une personne conduit sa voiture, tout en discutant avec les autres passagers de la voiture, tout
en fumant, en écoutant de la musique.
Dans ces situations, le sujet est mobilisé en même temps, psychiquement, dans plusieurs
activités : le conducteur suit les aléas de la circulation, le collègue ou ami discute, le fumeur
surveille son mégot pour empêcher les cendres de tomber dans la voiture, l’auditeur apprécie
l’interprétation de l’orchestre philharmonique de Berlin d’un morceau de Beethoven, qu’il
n’avait pas écouté depuis longtemps, etc. Dans ce type de situation, le sujet se dissocie en
plusieurs personnes. Peut-on alors parler de moment, ou ne serait-il pas plus juste de parler de
non-moment ?
On parle pas mal de dissociation dans le forum du cours de Remi Hess, Théories et pratiques
de l’intervention. C’était toujours obscur pour moi. Voici un exemple de dissociation, j’en avais
besoin ! J’essaierai d’analyser mon comportement pour voir quand et comment, dans quel
pourcentage je me dissocie. Ça me fait penser, que souvent, mais, justement, j’essaie de me
concentrer pour ne plus le faire, je capte les conversations de mes voisins de table au restaurant.
Ce qui fait que je les écoute et que je ne suis plus attentive à Gaël ou aux enfants qui sont à la
même table que moi. Ne serais-je pas un peu trop curieuse ? Si, sûrement, mais je me soigne !
Page 159 :
« Alors, on laisse l’esprit à la dérive, celui-ci s’adonne à l’une de ses activités préférées : la
transduction ! Dans les situations contraintes, dans les institutions totales qui ne prennent pas
en compte les sujets, les membres, les participants au dispositif ont toujours tendance à
transduquer. »
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 62 Janvier 2015
Je pense à Swan Bellelle qui va parler de transduction
dans une heure, pour la soutenance de sa thèse. Je garde
le terme « transduquer », même si j’avais prévu de dire
plutôt « transductiver »…
Transduquer me fait penser à un aqueduc… Cette photo
de l’aqueduc de Ségovie, où je suis allée en septembre
2013, illustre bien le fait que je transduque…
souvent…
Jeudi 20 novembre 2014, 12h32, pause déjeuner voiture, au bord de l’eau
Page 170 :
« C’est fait. Je médite au succès de Véronique Dupont, ma nièce. On en parlait dans la voiture
avec Lucette, qui me reconduisait au métro pour la Gare du Nord. C’est un beau succès qui s’est
construit avec méthode. J’ai embauché Véro. Je l’ai initié à la vie universitaire. Lucette l’a fait
ensuite recruter comme vacataire à Paris 8. Hélène l’a préparé au concours pour les épreuves
juridiques. C’est formidable ce travail d’équipe. « Véro va pouvoir tenter un recrutement de
catégorie A », a dit Lucette. C’est certain. Elle réussira tous les concours qu’elle passera. C’est
une perfectionniste. Dans son genre, elle est une surdouée.
Je repense aussi à ce jour où j'ai aidé Brigitte, la sœur de Gaël, à faire son CV.
Elle a commencé à travailler comme serveuse. Elle s'est arrêtée pour élever ses trois enfants et
justement pour assurer les études de ses filles, elle avait besoin financièrement de se remettre à
travailler. Pas facile pour elle d’imaginer se diriger vers un autre domaine que la restauration...
Et dans son cas, l'estime de soi était inexistante. Mais en creusant un peu, elle en a fait des
choses intéressantes pendant toutes ses années : élever ses enfants, rénover des appartements
avec son mari, s’occuper de la gestion immobilière des appartements en location, étudier les
impôts et négocier les crédits immobiliers, et sur ces deux sujets elle est incollable ! Elle a
trouvé, grâce à ce CV authentique, un poste dans une entreprise de traitement de courrier, ce
qui lui permet d'avoir des horaires bien plus adaptés à sa vie de famille que dans la restauration.
Et après deux ans maintenant, elle qui appelait sa responsable « ma Supérieure », est devenue
responsable de l'équipe...
Se poser, prendre le temps de réfléchir à ces moments de vie où l'on a appris sans s'en rendre
compte est en effet essentiel pour continuer sereinement son chemin, pour savoir ce dont on a
besoin pour donner un sens à sa vie. Le fait d'avoir écrit les mots, même sur une seule page de
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 63 Janvier 2015
CV, un résumé de ses expériences, qu'elle a pu visualiser, a été vraiment formateur pour elle.
Page 174 :
« En relisant un article d’Althabe, hier, j’ai pris conscience que le temps bien utilisé est la chose
la plus précieuse. C’était déjà l’idée de De Luze : « Vous perdez votre temps chez les Verts,
écrivez ! », me disait-il en 1999. Je ne le comprenais pas. J’avais 52 ans. Aujourd’hui, j’en ai
57. Et je commence à comprendre que j’ai manqué de présence à mon œuvre. Certes, j’ai écrit
un journal. Mais celui-ci n’est que le témoin de ma dissociation. Aujourd’hui, il devient
important de construire, avec méthode. »
Oui, j’en suis convaincue, il ne faut pas perdre de temps, son temps. En fait, il faut faire ce
qu’on a envie de faire… au moment où c’est aussi possible de le faire.
J’ai envie d’écrire, d’écrire je ne sais pas encore quoi, mais je sais que là, j’écris pour le Master
2, et que je n’ai pas le temps physiquement, d’écrire autre chose, de lire autre chose que les
cours ou les ouvrages à lire pour ma recherche… Alors, l’été prochain, verra peut-être mon
entrée dans l’écriture…
Page 174 :
À la sortie du cimetière, Patrice m’a proposé de me ramener. J’ai accepté. Mais, il devait faire
un arrêt à deux pas de la MJC du Point du Jour, pour embrasser ses parents. Je suis monté avec
lui. Son père m’a appelé Remi, comme s’il me connaissait depuis toujours. Il a lancé la
conversation sur la mort de Gérard, sur l’Allemagne.
Souvent, on n'a pas l'impression, on ne pense pas que les autres, nos collègues, les gens que
l’on rencontre, parlent de nous à leurs proches. Je suis toujours très étonnée moi aussi quand un
détail me le prouve. C'est pour ça que c'est important de parler, parler de ceux avec qui l’on vit
nos journées, ceux qui nous marquent, ceux qui nous font penser. C’est ça pour moi l’esprit
d’humanité.
Page 175 :
« Pour écrire, il faut accepter de faire un pas de côté, par rapport à ses parents. Dans un premier
temps, les parents ne supportent pas qu’on écrive. Il faut aller au-delà de cela, se battre pour
écrire pour soi, sur la forme et sur le fond. »
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 64 Janvier 2015
Dans sa troisième lettre, à écrire pour le cours « Théories et pratiques de l’intervention »,
Carmen, une de mes amies étudiantes a dit ça aussi à propos de son père qu'elle a même fait
pleurer… mais elle continue à écrire, elle va « au-delà de cela ».
Page 175 :
« Je retrouve dans mon casier un texte, écrit l’an passé par Laurence Valentin sur l’autogestion
pédagogique61. Amusant de relire cela avec un an de recul. »
Amusée, ou plutôt étonnée, impressionnée, je le suis à chaque fois que je me relis. Comme si
je n'avais pas conscience du poids de mes mots sur le moment. J'aimerais bien avoir un peu plus
de recul sur ce que j'écris pour voir si ce n'est que « amusant » au bout d'un moment ou si
d'autres sentiments arrivent… Qu’est-ce que cela m’apporte ? Je ne sais pas si dans mes
romantiques allemands à étudier, ils se relisaient, et qu’est-ce que ça pouvait leur apporter ? Je
ne sais pas encore si au cours de mes recherches je trouverai ce genre de choses, mais ça
m’intéresse en tout cas. A garder pour ma recherche.
Page 176 :
J’ai lancé mon idée de Maison de retraite autogérée, la vie de Château, créatrice d’emploi pour
la jeunesse ! J’ai fait rire la compagnie. Or, cette histoire est des plus sérieuses. Comment vivre
sa retraite dans une perspective où s’articule la gestion des besoins individuels, inter-individuels,
groupaux, organisationnels. J’ai défendu l’idée d’un ancrage au village. Mais aussi d’une
mobilité : comment voyager ? Tenir compte du soleil…
J’ai presque la même idée… J’ai toujours rêvé de m’occuper d’un centre de loisirs. En fait, c’est
une maison de retraite qu’il faut que je créée ! En septembre je suis allée à Détroit aux Etats-
Unis. Dans ces grandes villes et surtout dans les banlieues où on est obligé de prendre la voiture
pour aller chercher son pain, je me suis demandée où étaient les anciens. Pas de papis-mamies
sur les grandes avenues. En fait, ils sont tous regroupés en communautés, dans des villages
« seniors », ils ne sont pas mélangés au reste de la population. Comme d’ailleurs, c’est le cas
aussi pour les quartiers « latino », « afro », « blancs »… C’est très curieux et assez désagréable
en fait comme sensation…
61 Intitulé “ Réponse à un courageux anonyme qui n’a pas encore compris l’autogestion ”, suite et réponse à
“ Critiques constructives ”.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 65 Janvier 2015
En revanche, comme de nos jours, les anciens, les jeunes, leurs enfants ne veulent pas s’en
occuper, il va bien falloir trouver des solutions d’hébergement et de moyen de leur apporter tout
le bien-être dont ils ont besoin. « L’ancrage au village » me parait absolument indispensable.
A voir plus tard.
Page 178 :
Elle avait apporté une valise pleine de livres, et Lucette s’est mise à lire des pages entières de
Gusdorf, sur le Romantisme. J’entendais d’une oreille : passionnant le père Gusdorf ! J’ai dit à
Charlotte, que Lucette et moi l’avions connu. C’était à Hagetmau, en 1985, dans un colloque
organisé par la ville natale d’Henri Lefebvre.
Je note Gusdorf, sûrement très intéressant pour ma recherche sur le romantisme allemand.
Vendredi 21 novembre 2014, 19h08, L’Acclameur, salle d’escalade, en attendant Lucas
Page 180 :
« Je suis arrivé à l’Université catholique de l’Ouest. J’ai été dire bonjour à Constantin Xypas,
pour lui signaler mon arrivée. Ensuite, j’ai été dans la salle du jury. Les documents ne sont pas
prêts : il faut attendre. Quelqu’un qui ne porterait pas son journal avec lui serait dans le non-
moment ; il vivrait cette attente comme une perte de temps ; moi, je vis cet épisode comme une
chance supplémentaire de poursuivre ma méditation.
Moi non plus je ne m'ennuie jamais, au pire, si je n’ai pas de cahier et de crayon, je note sur
mon téléphone, et si je n’ai pas mon téléphone, j'observe les gens, les nuages, les arbres, les
bâtiments, ce qui m’entoure, comme le fait Claudine, une autre amie étudiante de l’IED. Quelle
force dans les derniers textes qu’elle a écrits. Ça a dû lui faire du bien de réussir à écrire ces
mots pour les lettres demandées par Remi Hess, pour la validation de son cours. Enfin
j’espère… Elle qui dit qu’elle n’ose pas, là, elle a tout balancé… Impressionnant.
Pour revenir à l’attente, je pense à l’histoire du chapeau d’aventurier de mon fils Rémi à l’ile
d’Yeu. Il faut que je retrouve mon Journal de bord que j’avais fait à l’occasion de ces vacances.
Page 180 :
« Un membre du jury a annoncé le passage au LMD (Licence, master, doctorat) : le contenu de
la licence va être centré sur la communication et l’on me propose de rétrograder, l’année
prochaine, de la fonction de président du jury, à celle de vice-président (les sciences de
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 66 Janvier 2015
l’éducation, restant une option de la nouvelle licence). J’ai annoncé mon absence, pour fait de
congé sabbatique l’an prochain («Je pars au Brésil», ai-je dit). Malgré cette absence, on me
demande de rester membre. Mon nom semble fait tenir l’institution. Jusqu’à maintenant, j’ai
toujours du être là, en tant que président, mais le statut de vice-président me permettra
l’absentéisme. Tant mieux ! Cela me fera une économie de temps.
Je pense à l'implication. Les gens, les politiques, les personnes dans le monde associatif aussi,
qui prennent, qui acceptent des mandats multiples pour lesquels ils ne pourront pas s’impliquer,
ni s’y tenir réellement... je ne comprends pas… Est-ce une question d'argent ? De prestige ?
Dans le cas ci-dessus, on comprend que c’est l’institution qui demande à ce que Remi Hess
accepte, par rapport à son nom.
Page 181 :
« Par association, Lucien Hess (1902-1986) à Dachau refusa d’assister à un concert de musique
classique. Il avait peur d’être submergé par ses émotions, et d’en mourir.
Donc, pour lui, l’opéra, source d’émotions, donc de péché, doit être fui plus que tout spectacle. »
Pourquoi est-ce qu'être submergé par les émotions, pleurer de tristesse ou de joie, serait un
péché ? Je n’avais pas conscience de ce point. Mais oui, on peut dire que pleurer, ça ne se fait
pas pour un homme, comme pour le père de Carmen, dont je parle un peu plus haut. Mais de là
à ce que ce soit un péché, je ne le savais pas… et je ne comprends pas pourquoi. Surtout, quand
même que les larmes, il n’y a pas plus naturel.
Page 182 :
« Ne pas peindre, chez moi, était une sorte d’interdit intériorisé… L’Opéra n’est-il pas pour
moi un interdit de la même famille ?
Quelle est la nature de ces moments, qui nous ont été interdits ? »
Je propose ici à Remi Hess, une autre idée de lettre à écrire pour la validation de son cours
« Théories et pratiques de l’intervention » : les moments interdits...
Page 182 :
« Pendant que j’écris, Setsuko raconte le rituel des funérailles au Japon : il n’y a pas de si
grandes différences avec nos propres rituels. Certes, les Japonais donnent plus d’ampleur aux
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 67 Janvier 2015
rituels, et encore ; je pense à Hubert, et à son Tombeau pour Henriette. Ce que raconte Setsuko
me semble intéressant par rapport à mes propres funérailles : où vais-je mourir ? à Paris ou
Sainte Gemme ? mon rêve serait d’être incinéré, si je meurs à Paris et enterré, si je meurs à
Sainte Gemme.
Lors des funérailles de mon oncle Yves, le frère ainé de mon père, mon père nous a parlé de ce
qu'il souhaitait pour lui : être enterré et pas incinéré, avec ses grands-parents paternels. Il nous
a dit qu’il a déjà préparé sa plaque funéraire, c'est glauque, mais c'est tout lui ! En revanche, ce
moment avait été important pour moi, parce que je n’ai pas eu besoin de lui demander. Je ferai
pareil avec mes garçons. Quand je commencerai à me sentir plus vieille, quand j’aurai des petits
enfants, ou tout simplement quand j’aurai réfléchi sérieusement à la question, de savoir où je
voudrais être pour l’éternité, ce qui n’est absolument pas le cas pour l’instant… je leur dirai.
Page 183 :
« On parle de la Sonate au Clair de lune, que nous écoutons, interprétée par Rubinstein) selon
Bernard Haller, un comédien qui a joué cette sonate en l’accompagnant d’un commentaire à
lui : les cheminements de la pensée du pianiste, pendant qu’il exécute un morceau. Cette
performance m’intéresse, car c’est une illustration de la dissociation (mot utilisé par Odile) :
c’est la déconstruction du moment musical. Odile ne peut plus écouter ce morceau, sans
entendre le commentaire de Bernard Haller. »
Ça me fait penser au concert à la Carrière du Normandoux, à Tercé, près de Poitiers. J’avais été
impressionnée par le lieu mais aussi par l’un des artistes de cette soirée concert : il avait repris
la partition d’un compositeur, Chopin, je crois, mais je ne m’en souviens pas très bien. Ce qui
m’avait marqué, c’est qu’il avait repris cette partition en jouant les notes à l’envers. Il
commençait par la fin… C’était très curieux à entendre, ça se laissait écouter, mais, bien sûr, ça
ne ressemblait absolument pas à l’œuvre originale.
Page 184 :
« Oui, c’est vrai, eux ne vivent que dans une pièce. Ils ne chauffent l’hiver que dans leur salle
à manger-cuisine : les chambres restent froides. Antoinette et Gilbert n’ont pas de livres, donc
aucune raison de s’aménager une bibliothèque ; ils ne font pas de peinture, pourquoi s’aménager
un atelier ? »
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 68 Janvier 2015
Je pense immédiatement à Calliope.... et Michel Beaud62, écrivain, professeur d'université, qui
a même été président de Paris 8, spécialiste économique et de l'écriture de la thèse... Je suis
allée chez eux, lorsque j’avais ma petite entreprise d’assistance informatique. Il voulait que je
l’aide sur plusieurs points techniques et que je réponde à certaines questions de Calliope. Ils
avaient des Macintosh, alors, c’était difficile pour moi, je ne maitrise pas trop ce système. A
l’époque, je n’avais aucune idée de qui était ce monsieur, et même si le nombre de livres était
très impressionnant, que leur maison était plus près de la taille d’un château, ils avaient des gros
pulls, et ne vivaient que dans une toute petite partie peu chauffée… J’avais ressenti un décalage.
Je pourrais écrire un livre sur ma rencontre avec ce couple, ces personnages, même si je ne les
ai vu que deux fois. C’est dommage, ça c’est mal terminé…
Il faudrait que je raconte mes moments d'assistance informatique. Il faudrait que je reprenne
mon cahier où j’ai noté toutes mes interventions, c’est une vraie mine d’informations
croustillantes.
Page 185 :
« Pour ma part : « L’écriture de soi, faire des traces » (sur le journal). Titre du panel : Fragment,
suspension, trace, l’impact de la Révolution à la périphérie.
Résumé de mon intervention possible : « Un aspect peu exploré de la Révolution, c’est le travail
d’écriture de soi des acteurs. Souvent, disciples ou fils de disciples de l’auteur des Confessions,
les Révolutionnaires se formèrent, mais aussi se racontèrent dans des formes d’écriture
impliquée : monographies, thèses, discours ; mais aussi et surtout : correspondances et journaux.
Le cas de Marc-Antoine Jullien est tout à fait significatif ; responsable de l’Instruction publique
sous Robespierre à 19 ans, il avait quitté l’école à 16 ans ; sa formation se fit, par une
correspondance journalière avec sa mère, disciple de Rousseau. Par la suite, il devint le
théoricien et le pédagogue du journal, dont s’inspirèrent, à la suite de Maine de Biran, des
centaines de diaristes du XIXème siècle, en France, en Europe, mais dans le monde, puisque
ses travaux furent, de son vivant, traduits en huit langues ».
Charlotte. Il faut suppléer son absence. On écrit : « En 1775, l’Allemagne qui pense, (Herder,
Goethe, etc.) rompt avec le classicisme français inspiré par Rome. La Révolution française
secoue fortement les héritiers du Sturm und Drang, du Kantisme, etc. La notion de fragment
défendue par les Romantiques d’Iéna (Schlegel, Novalis) déplace le projet révolutionnaire du
politique (qui semble avoir échoué dans la Terreur), vers l’esthétique. Avec Schiller, les
62 http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Beaud
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 69 Janvier 2015
Romantiques refondent la vie autour de l’œuvre, mais une œuvre dont la forme se cherche sans
fin. On entre dans une esthétique de l’inachèvement ». »
Je reprends ce long passage, toutes ses informations me seront utiles pour ma recherche.
Ce serait bien que j’ai accès aux travaux de Charlotte, je vais demander à Remi Hess comment
la contacter.
Page 185 :
« L’art d’habiter les moments. Patrice parle de la dimension agonistique, qui a quelque chose à
voir avec l’impetus : ces moments foudroyants réorientent entièrement la vie du sujet. »
Je ne sais pas ce qu’est l’impetus ni la dimension agonistique, d’ailleurs…
Je trouve ces définitions :
Agonistique : « a) Relatif à la lutte, notamment à la lutte pour la vie. »63
Impetus : « incitation, impulsion, transport. »64
Page 186 :
J’ai évoqué le travail de Benyounès, et de Jenny dans notre collectif ; je travaille sur le rapport
entre les Romantiques d’Iéna (Schlegel, Novalis), et nous, rapport que j’ai beaucoup travaillé à
partir des recherches de ma fille Charlotte, cet été.
A garder pour ma recherche.
Page 186 :
Je ne puis pas fuir. Il me faut rester ici. Je vis une crise. Le temps passe. Des moments me sont
imposés, dans les jours qui viennent, et le temps fuit.
Je ne puis pas accepter de gaspiller le temps dont j’ai besoin, pour construire mon moment de
l’écriture.
Pareil !
Page 187 :
63 http://www.cnrtl.fr/definition/agonistique 64 http://fr.wiktionary.org/wiki/impetus
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 70 Janvier 2015
« Ce qui m’a frappé, dans ma visite de la maison phocéenne, c’est son “ être là ”, à cet endroit,
depuis le VIème siècle avant Jésus Christ. […] C’est étonnant que la technique de construction
n’ait pas évolué en 24 siècles.
La ruine est donc un fragment qui nous renseigne sur le mode de vie passé, et qui nous permet
de mesurer le surplace de la civilisation pendant toute cette période. L’archéologie, sciences des
traces, est une méditation à partir de fragments. »
Je garde ce passage pour Rémi, mon futur archéologue. J’aime bien l’expression « sciences des
traces ».
Ce qui me frappe aussi c’est que la construction d’un mur n’évolue pas en vingt-quatre siècles,
et que la construction de nous-même, la construction de nos moments, à approfondir sûrement,
n’a pas l’air d’évoluer beaucoup non plus.
Page 188 :
« Hier et aujourd’hui (ce matin), j’ai relu 180 pages de ma fille Charlotte. Je sens dans ses pages
une énergie qui me ressource, alors que chez mes étudiants, je me sens pompé. Je ne trouve pas
de passion dans les écrits de la plupart de mes étudiants. Ce qu’ils écrivent m’emmerde. Il y a
des exceptions. Mais globalement, je trouve que la plupart des mémoires sont sans enjeu. Il n’y
a pas de thèse, pas de point de vue que l’on défende avec énergie.
Chez Charlotte, je trouve une pensée polémique, une lutte à mort contre la médiocrité. Ce n’est
pas achevé, mais on sent vraiment l’énergie. On trouve cette force aussi chez Johan Tilmant. »
Décidemment, il faut vraiment que je lise les travaux de Charlotte !
Qui est Johan Tilmant ?
Je cherche et je trouve un ouvrage Tact, autorité, expérience et sympathie en pédagogie, Johann
Friedrich Herbart, édité par Johan Tilmant, préface de Gabriele Weigand, Paris : Economica,
Anthropos, 2007. Il est disponible à la bibliothèque universitaire de Nantes.
Je note donc cet ouvrage pour ma recherche. Johann Friedrich Herbart (1776-1841), philosophe
allemand, qui a inspiré Pestalozzi. Je trouve un article qui m’intéresse65.
En revanche, je ne trouve aucune autre information sur Johan Tilmant, mis à part qu’il était
doctorant rattaché à Experice.
J’espère que je ne suis pas trop « emmerdante »…
65 http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/herbartf.pdf
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 71 Janvier 2015
Page 189 :
« Chez l'amnésique, le traumatisé crânien, qui a perdu la mémoire, totalement ou en partie, qui
est devenu une autre personne (sans ses expériences, ses souvenirs, ses repères, ses émotions
d'avant), qui repart à l'âge adulte de zéro, que sont devenus ses moments et à partir de quoi va-
t-il s'en construire d'autres, puisque tout lui est étranger, à part son deuxième apprentissage ? »
Aujourd’hui, Julie, une étudiante de M2, a ouvert un sujet dans le cours de Valentin, « L’entrée
dans la vie », dont le titre est « Sommes-nous adultes ? ». Je verrai si j’ai besoin d’intervenir.
Ce passage m’y fait penser, mais je n’ai rien à dire pour l’instant. Je n’ai jamais vécu ce
phénomène, il n’y a eu personne dans ma famille proche à qui il a fallu tout réapprendre. Ah,
si, juste un de mes clients, le papi qui m’avait donné un appareil photo. Il avait fait un AVC.
Mais bon, je me souviens seulement qu’il n’avait quand même pas tout perdu puisqu’il se
servait toujours bien de son ordinateur. En tout cas ça doit être très intéressant d’étudier ce
phénomène et de participer à ce deuxième apprentissage. Je le note dans la rubrique à voir plus
tard.
Journal imbriqué : dimanche 4 janvier 2015, 14h39, bureau, maison
Depuis, j’ai posté deux textes sur le forum de Valentin relatif à ce point. Je les reprends ici.
Forum : La prématuration - Sujet : Sommes-nous adultes ? - Auteur : ANGELINE GLUARD
Posté le dimanche 14 décembre 2014 à 22:12
Bonsoir tout le monde,
Moi aussi j'ai lu un truc qui m'a fait penser à ce cours.
Extrait de mon journal de lecture du moment :
Walter BENJAMIN, Le conteur, réflexion sur l'œuvre de Nicolas LESKOV, dans Œuvres III,
Paris : Gallimard, 2000
Les extraits de Paul VALERY sont tirés de "Les broderies de Marie Monnier", Pièces sur
l'art, in Œuvres, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, t. II, p. 1244
Page 128 : "C'est sans doute Paul Valéry qui a décrit de la façon la plus marquante l'image
spirituelle de cet univers artisanal d'où provient le conteur.
Parlant des choses parfaites qu'on trouve dans la nature, perles fines, vins profonds et mûrs,
personnes véritablement accomplies, il évoque "la lente thésaurisation des causes successives
et semblables."
[…] "L'homme jadis imitait cette patience. Enluminures ; ivoires profondément refouillés ;
pierres dures parfaitement polies et nettement gravées ; laques et peintures obtenues par la
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 72 Janvier 2015
superposition d'une quantité de couches minces et translucides […] – toutes ces productions
d'une industrie opiniâtre et vertueuse ne se font guère plus, et le temps est passé où le temps
ne comptait pas.
L'homme d'aujourd'hui ne cultive point ce qui ne peut point s'abréger."
De fait, il est même parvenu à abréger le récit. Nous avons vu naître la short story, qui s'est
attachée à la tradition orale et ne permet plus cette lente superposition de couches minces et
translucides, où l'on peut voir l'image la plus exacte de la façon dont le parfait récit naît de
l'accumulation de ses versions successives."
On ne "cultive point ce qui ne peut point s'abréger" : alors comme nous, êtres voués à
l'inachèvement, nous ne pourrons pas être "abrégés", et bien, nous ne nous cultivons plus…
La nature, le monde parfait, "le temps est passé où le temps ne comptait pas"… ce texte, de
Benjamin, pour info, a été écrit en 1936...
Les "couches minces et translucides" n'existent plus et semblent avoir été remplacées par de
bonnes grosses couches épaisses d'éducation à la sauce commerciale…
Achetez ! Vous serez plus heureux !
Le retour aux traditions me parait essentiel pour sortir de ce chemin qui nous plonge au fond,
non de la caverne, mais d'un gouffre sans aucune lumière.
Lisez des contes !
Et bonne nuit...
Angéline
Forum : "L'entrée dans l'organisation", "La nouvelle génération" - Sujet : Continuons
d'avancer ! - Auteur : ANGELINE GLUARD
Posté le samedi 20 décembre 2014 à 19:18
Bonjour, bonsoir,
J'ai fini de lire les deux chapitres demandés.
Au sujet de la définition des générations, comme il est indiqué page 137 : "La perception de
l'ici et maintenant de telle société à tel moment du siècle n'est pas la même pour les anciennes
et pour les nouvelles générations qui sont ensembles les témoins des mêmes événements, mais
qui les vivent et les interprètent différemment."
Je pense à tous les chinois qui vont vivre les prochaines coupes du monde différemment selon
s'ils font partie ou non de la génération qui aura l'obligation de faire du foot à l'école.
(Information du journal de France 2 d'aujourd'hui, samedi 20/12/2014)
Je lis les commentaires sur le forum.
Maxime parle de l'enfant qui lui avait dit : "Maxime, je veux rester un enfant", alors il me
vient ceci à l'esprit :
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 73 Janvier 2015
Quand je me sens "vieille", dans le sens, pantouflarde, aux petits rituels immuables, avec des
pensées négatives sur le fait que je ne sais pas faire telle ou telle chose,… je pense à ma mère.
A 63 ans, après avoir élevé 5 enfants, elle a créé un commerce à l’âge de 40 ans, elle s'est
mariée 5 fois, a créé sa petite entreprise à 55 ans.
Elle est toujours en quête de nouvelles activités. (Normalement son dernier mari, rencontré en
2007 est le bon, c'est l'homme de sa vie !)
Elle découvre encore, de jour en jour, elle est curieuse de tout et s'intéresse à tout.
Avec Gaël hier soir, nous avons eu un cours d'initiation à l'escalade.
En effet, découvrir une nouvelle activité nous mets dans la position de l'enfant. C'est ce que
nous avons ressenti, tous les deux.
Ce moment nous a permis de nous dépasser, de nous révéler à nous même, et aux autres, ce
dont nous sommes capables.
Nous avons pu concrètement sentir ce qu'est le dépassement de soi, et surtout ça nous a rendu
vraiment heureux.
Même si aujourd'hui nous avons des courbatures pour les muscles que nous n'avons pas
l'habitude de faire travailler, c'est le bonheur.
En me levant ce matin, j'ai dit à Gaël : "juste avant de me réveiller, j'étais en train de rêver que
j'escaladais", et il m'a répondu : "moi aussi !".
Alors, si nous disions aux enfants, dès leur plus jeune âge, que nous restons enfants toute la
vie de toute façon.
Notre monde regorge de tellement de choses à découvrir...
Notre corps et notre esprit sont prêts à fonctionner, tout au long de notre vie, pour apprendre
aussi à se connaître soi-même, à découvrir ce qui nous rend heureux, comme des enfants.
Je demande à Lucas, qui est tout près : "C'est quoi pour toi un adulte ?"
Il me répond : "c'est quand on peut passer son permis de conduire. Mais si tu veux une
réponse un peu plus philosophique : Etre adulte c'est quand on change ses souvenirs d'enfance
en nostalgie".
Je suis scotchée, estomaquée. "C'est de qui cette phrase ? De toi ?" Il me répond que non, il l'a
entendu hier à la "criée".
Dans son lycée, une fois par mois, les élèves de l'atelier théâtre lisent les mots écrits par les
élèves et "postés" dans la boite spéciale.
Donc il ne sait pas de qui c'est, mais je trouve ça génial, surtout qu'il l'est retenu et qu'il me
l'ait ressorti du tac au tac.
Rémi n'est pas loin, il a presque 19 ans et le permis de conduire.
Je lui demande : "Est-ce que tu te sens un adulte ?".
Il me répond : "Oui, parce que je suis autonome, je suis libre de mes choix."
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 74 Janvier 2015
Ça me dit quelque chose cette phrase, ...je lui lis page 126 : "Au stade de l'autonomie, l'enfant
[…] est en principe libre de faire son choix".
Rémi me dit : "Oui, regarde l'étymologie d'autonomie, du grec autos : soi-même et nomos :
loi, règle. Mais je ne me sens pas adulte dans le sens où je ne suis pas encore indépendant au
niveau financier.
Mais il existe des personnes indépendantes au niveau financier qui ne sont toujours pas
autonomes, qui vivent chez leurs parents, ou qui ont besoin d'eux ou d'autres personnes pour
faire leurs choix de vie justement".
Il ajoute qu'être adulte c'est aussi entrer dans la vie "politique" avec le droit de vote. Je lui dis
qu'il existe aussi maintenant un apprentissage pour les enfants à la vie politique.
Ils peuvent être délégués de classe, ou siéger au conseil municipal des enfants dans certaines
communes.
Finalement, nous continuons notre discussion philosophique sur le fait d'être indépendant non
seulement au niveau financier mais au niveau affectif.
Et nous en concluons qu'en tant qu'êtres humains nous sommes tous dépendants affectivement
de notre famille, de nos amis, de notre groupe, de notre société, en fait nous dépendons tous
des autres.
Ça me fait un bien fou ces conversations avec mes garçons.
Conscients ou inconscients, les choix que j'ai faits sont surement les bons, face aux
incertitudes du mode d'éducation à donner à mes enfants (page 127), même si je sais que je ne
suis pas seule responsable de leur développement physique et intellectuel.
Je sens de la sincérité, de l'intelligence et de la liberté dans leurs actes et dans leurs paroles.
Je les sens "entrer dans la vie"... et d'une manière qui me rend heureuse, sereine et confiante
pour leur avenir.
Je vous remercie de m'avoir lue jusqu'ici.
Bonne soirée,
Angéline
Page 191 :
« …dans notre groupe d’Attractions passionnelles, on a l’impression que notre QI est égal au
QI du plus intelligent, multiplié par le nombre de participants au groupe de travail ! Mais on se
trouve dans une situation de groupe “ sujet ”. On s’aime, on se respecte. On a besoin de chacun
pour aller plus loin. Christine remarque qu’une énergie se libère dans les groupes sujets. »
Des maths ! Elle est sympa cette formule de calcul !
J'aime le « on s'aime »... Cette semaine j'ai entendu plusieurs reportages sur la coupe Davis de
tennis. Henri Lecomte et Yannick Noah disent tous les deux la même chose, le succès de la
réussite à chaque coupe Davis française gagnée, c'est que les joueurs s'aiment…
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 75 Janvier 2015
Je ressens ce sentiment avec mes plus proches collègues. Autant notre mal-être dans l’entreprise
est palpable, autant, et peut-être pour compenser, nous nous aimons vraiment, nous sommes
soudés, nous nous entendons bien, c’est très agréable, et surtout on réussit bien à faire notre
travail, on partage.
Page 191 :
Quand les filles sont parties, j’ai lu Sens et non sens, de Maurice Merleau-Ponty66. […]
La rêverie herméneutique du psychanalyste, qui multiplie les communications de nous à nous-
mêmes… cherche le sens de l’avenir dans le passé et le sens du passé dans l’avenir67… ”.
Merleau-Ponty compare cette posture à celle de notre vie même qui, en mouvement circulaire,
appuie son avenir à son passé et son passé à son avenir, et où tout symbolise tout.
Il faudrait vraiment que je lise du Merleau-Ponty. A voir plus tard.
Samedi 22 novembre 2014, 14h45, salon, maison
« Sans renier cet optimisme, pour avoir travaillé cette année 2004 à la construction de mon
moment de la peinture (j’en suis à une trentaine de toiles), je dois dire que je ne suis plus satisfait
du tout de ce que j’ai produit, et je suis moins optimiste sur ce que je fais, car au fur et à mesure
que je produis, que je lis des ouvrages sur la peinture, que je visite des expositions, je découvre
sans cesse davantage ce qui me reste à faire, pour donner à voir une toile qui correspondrait
vraiment à ce que j’ai dans la tête, tout en tenant compte de l’état du contexte de la communauté
de ceux qui peignent. Du coup, dans une notation de la semaine passée (journal d’un artiste), je
me demande si la construction de ce nouveau moment. n’est pas un peu tardive.
Si je raconte cela, c’est pour me poser la question “ y a-t-il un “ bon moment ” dans la
biographie de quelqu’un pour installer un nouveau moment ? ”. »
Je pense au moment « participation à la vie de la cité, de la région » où j'aimerais plus
m'impliquer, depuis que j’ai participé aux groupes de travail sur les aides au niveau de
l’éducation, de l’orientation et de la formation, avec l’équipe de la région Poitou-Charentes.
Mais ce n'est pas la bonne période. Je ne peux physiquement pas tout faire… Mais je vais quand
même prendre le temps d’aller présenter le résultat de notre travail le 12 décembre prochain
devant les élus. Nouvelle expérience pour moi qui sera de toute façon enrichissante.
66 Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1966. 67 M. Merleau-Ponty, op. cit. p. 42.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 76 Janvier 2015
Page 193 :
« Aucune école des Beaux-Arts ne prévoit de recruter un pré-retraité comme étudiant. »
Je pense à mes dernières vacances, à Détroit aux Etats-Unis. Nous étions hébergés chez Gérard,
un français retraité, qui a travaillé et vit à Détroit depuis 30 ans. A la retraite, donc, il a pris le
temps de rentrer dans son moment peinture, il prend des cours, à priori, tous les âges sont
acceptés. Il a des copines, et ça a l’air de lui plaire, surtout les « modèles », de femmes nues de
préférence… Pendant notre séjour il est allé à son cours. Le lendemain matin, je lui demande :
« Alors Gérard, elle était sympa la modèle ? ». Il me répond : « en fait, c’était un grand black
avec un grand sexe… ». C’était très drôle.
Pages 196-197 :
« John Locke écrit dans son Traité sur l'Entendement humain, (vol. 3, Londres, 1714, p. 425) :
« Il n'y a presque rien d'aussi nécessaire, pour le progrès des connaissances, pour la commodité
de la vie et l'expédition des affaires, que de pouvoir disposer de ses propres idées ; et il n'y a
peut-être rien de plus difficile dans toute la conduite de l'intelligence, que de pouvoir s'en rendre
tout-à-fait le maître ». Il montre que le journal peut être l’espace d’un travail philosophique.
John Locke a tenu un journal toute sa vie, qu’il a indexicalisé. »
A garder pour ma recherche et pour toute la vie : l'important est d'écrire et d'indexicaliser. J’en
ai déjà parlé un peu plus haut, page 50.
Page 197 :
« Machiavel a conservé les doubles des courriers qu’il envoyait aux princes de Florence, pour
conseiller leur action. Il s’est appuyé ensuite sur ses lettres pour écrire ses écrits politiques. »
Je ne sais pas si un jour j’écrirais des textes politiques, mais j’ai commencé à écrire à François
Hollande, notre président de la république, à Jérôme Baloge, le maire de Niort, là où je réside.
J’écris dès qu’une idée me traverse l’esprit en lien avec l’actualité, mais c’était plutôt cet été,
où j’avais un peu plus de temps.
Il faut que je continue, ça me fait me sentir citoyenne. Ils ne me répondent pas forcément ou par
réponse type du secrétariat, mais ce n’est pas grave.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 77 Janvier 2015
Page 197 :
« Marc-Antoine Jullien (1775-1848)
Dans son ouvrage de 1808, Marc-Antoine Jullien produit la première systématisation du journal
des moments. Dans ce livre, Marc-Antoine Jullien propose aux jeunes, d’écrire trois
journaux différents :
-un journal du corps (santé),
-un journal de l’âme (où l’on restitue ses rencontres avec les personnes, et ce que l’on tire de
ces rencontres sur le plan moral),
-et un journal intellectuel (où l’on note les connaissances intellectuelles que l’on acquiert ou
par rencontre ou par lecture ; ainsi notées, les connaissances deviennent des savoirs).
Ce livre fut écrit dans un contexte où l’école n’existait pas pour tous. Le journal apparaissait
donc comme une sorte de formation totale de l’être.
Je suis fan de Marc-Antoine, depuis la licence où je l’ai découvert dans le cours d’Education
comparée de Ridha ENNAFAA. Ce petit résumé de son ouvrage sur l’Emploi du temps est
parfait. Je le garde pour ma recherche.
Page 198 :
I).- Les formes générales du journal
Le journal est tenu au jour le jour. On peut écrire le soir ce qui s’est passé dans la journée ou
le lendemain ce qui s’est passé la veille. Mais globalement, contrairement à l’histoire de vie ou
aux Mémoires, cette forme d’écrit personnel est inscrite dans le présent. Même avec un petit
décalage, on écrit toujours au moment même, où l’on vit ou où l’on pense.
Ce n’est pas un écrit après coup, mais un écrit dans le coup. On accepte donc la spontanéité,
éventuellement la force des sentiments, la partialité d’un jugement, bref, le manque de recul.
Je dois me ressaisir et écrire plus dans le coup qu'après coup, j'en meurs d'envie. Mais je dois
m'accorder ce temps d'écriture, absolument.
Journal imbriqué : dimanche 4 janvier 2015, 15h56, bureau, maison
J’en ai marre de dire tout le temps la même chose : « je voudrais avoir du calme, je voudrais
avoir plus de temps pour écrire ». Mais écris bon sang !
L’autre jour, j’ai posté ceci dans le cours de Martine Morisse, « Ecriture et expérience
professionnelle ».
Forum : ATELIERS D'ÉCRITURE - Sujet : Texte 1 A partir du texte de Duras
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 78 Janvier 2015
Auteur : ANGELINE GLUARD - Posté le jeudi 25 décembre 2014 à 14:18
Bon-jour de Noël,
Hier soir, nous parlons "Ecriture". Je radote... je redis que pour me mettre à écrire, il me
faudrait un cadre inspirant, comme au château de Saché.
Gaël, mon amoureux, grand spécialiste de Charles Bukowski, me dit qu'il a écrit un truc là-
dessus, et que si tu dois écrire, tu le feras quelles que soient les conditions.
Ce matin, il m'a retrouvé la "page" :
"l'air et la lumière et le temps et l'espace
--------------------------------------------
"...tu sais, j'avais toujours ou une famille, ou un boulot, un truc
pour m'en
empêcher
mais maintenant
j'ai vendu ma maison, j'ai trouvé cet
appartement, un grand studio, faudrait que tu voies
l'espace et
la lumière.
pour la première fois de ma vie je vais avoir l'endroit
et le
temps pour créer."
non, mon petit chéri, si tu dois créer
tu créeras même si tu travailles
16 heures par jour dans une mine de charbon
ou
tu créeras dans une petite chambre avec trois enfants
pendant que tu touches
l'aide sociale,
tu créeras la moitié du cerveau et du
corps
explosé,
tu créeras aveugle
estropié
fou,
tu créeras avec un chat qui te grimpe dans
le dos pendant
que la ville entière vacille sous les tremblements de
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 79 Janvier 2015
terre, les bombardements,
les inondations et les incendies.
mon petit chéri, l'air et la lumière et le temps et
l'espace
n'ont rien à y voir
et ne créent rien
sauf peut-être une vie plus longue qui te permettra
d'inventer de nouvelles
excuses."
Avec les damnés : textes et poèmes choisis, Bukowski, Charles, et Martin, John. Paris :
Grasset, 2000. Livre de poche, pages 507 et 508.
Alors, plus d'excuses... c'est parti...
A bientôt,
Angéline
Page 198 :
« Le destinataire du journal. Dans un premier temps, le journal est un écrit pour soi (individuel
ou collectif), alors que la correspondance est un écrit pour l’autre. Cependant, on peut
remarquer que le journal, même intime, est un écrit pour l’autre.
En effet, même si je n’écris le journal que pour le relire moi-même, “ Je est un autre ” (Rimbaud)
entre le moment de l’écriture et le moment de la lecture ou de la relecture. C’est même ce
changement qui s’est opéré en moi que je mesure en relisant mon journal. Comme lorsque l’on
regarde une photo de notre enfance, en même temps que l’on se reconnaît, en même temps on
mesure combien on a changé. »
Je trouve les références de la phrase de Rimbaud, dans une lettre à Paul Demeny du 15 mai
187168. J’ai vraiment cette impression moi aussi, de ne pas être la même personne quand je me
relis. Ces histoires de photo de notre enfance me rappellent que je voudrais écrire des histoires
de ma famille, à partir de photos. J’en ai plein derrière moi, des cartons entiers. Je voudrais
prendre une photo au hasard et écrire tout ce qui me vient à l’esprit juste en la regardant,
développer un texte à partir de ce qui apparaît, du moment, de la personne ou des réflexions
qu'elle m'apporte. Ça me démange d’essayer… Pour voir ce dont je suis capable...
68 http://www.philophil.com/dissertation/autrui/Je_est_un_autre.htm
http://fr.wikisource.org/wiki/Lettre_de_Rimbaud_%C3%A0_Paul_Demeny_-_15_mai_1871
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 80 Janvier 2015
En ce qui concerne les deux sites web que j’ai notés ici, ils pourront m’être utiles pour ma
recherche.
Journal imbriqué : dimanche 4 janvier 2015, 16h32, bureau, maison
J’ai déjà imbriqué à ce sujet en page 6, mais j’y reviens parce ce que ce passage m’y fait penser.
Pour donner une autre référence sur ce point, à Remi Hess, en plus de Rimbaud, voici le texte
de Marguerite Duras. Il n’est pas très long, je le mets ici.
Texte de Marguerite Duras, Ecrire - Collection folio, Editions Gallimard, 1993.
Texte proposé par Marie-Noëlle Hôpital
"Écrire. Je ne peux pas.
Personne ne peut.
Il faut le dire, on ne peut pas.
Et on écrit.
C’est l’inconnu qu’on porte en soi écrire, c’est ça qui est atteint. C’est ça ou rien.
On peut parler d’une maladie de l’écrit.
Ce n’est pas simple ce que j’essaie de dire là, mais je crois qu’on peut s’y retrouver, camarades
de tous les pays.
Il y a une folie d’écrire qui est en soi-même, une folie d’écrire furieuse mais ce n’est pas pour
cela qu’on est dans la folie. Au contraire.
L’écriture c’est l’inconnu. Avant d’écrire, on ne sait rien de ce qu’on va écrire. Et en toute
lucidité.
C’est l’inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n’est même pas une réflexion, écrire, c’est
une sorte de faculté qu’on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d’une autre
personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui quelquefois,
de son propre fait, est en danger d’en perdre la vie.
Si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire, avant de le faire, avant d’écrire, on n’écrirait
jamais. Ce ne serait pas la peine.
Écrire, c’est tenter de savoir ce qu’on écrirait si on écrivait — on ne le sait qu’après — avant,
c’est la question la plus dangereuse que l’on puisse se poser. Mais c’est la plus courante aussi.
L’écrit ça arrive comme le vent, c’est nu, c’est de l’encre, c’est l’écrit et ça passe comme rien
d’autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie."
M.D.
Neauphle-le-Château, 1993.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 81 Janvier 2015
Pages 199-200 :
« L’écriture du journal est-elle scientifique ? Le journal n’est qu’un outil. L’archéologue
s’interroge-t-il pour savoir si un marteau est scientifique ? Non. Il l’utilise intelligemment ou
pas, dans son travail de fouille. En matière de journal, la science se trouve dans le rapport
adéquat que l'on construit à cette technique de recueil de données. Et une dimension de ce
rapport se trouve dans la distance que l’on construit au journal, lors de la relecture, et à
l’exploitation que l’on fait des données recueillies dans des écrits plus élaborés.
Prendre du recul. Dans cette pratique d’écriture, on accepte que le recul survienne plus tard.
Nous pouvons distinguer le moment de la lecture du moment de la relecture du journal. La
lecture survient au cours de l’écriture même du journal. Alors que je suis en train d’écrire mon
journal, je me souviens avoir écrit quelque chose antérieurement sur le même thème. En
recherchant ce fragment, je suis conduit à relire plusieurs passages. Que je retrouve ou non le
fragment recherché, je retrouve des notations passées qui influent sur mon écriture
d’aujourd’hui. Plus le journal est volumineux, moins j’ai un souvenir actualisé de son contenu.
La lecture permet donc de jouer dans l’écriture même, sur une élaboration d’un thème ou d’un
autre. Dans la relecture, il y a une volonté de faire un travail de distanciation plus systématique.
Alors que l’on a lu des passages du journal, la relecture prend en compte le tout du journal,
lorsque celui-ci est terminé. Il est pris comme un ensemble. L’approche peut être thématique,
en s’appuyant sur l’indexicalisation. Une approche multiréférentielle permet de lire le journal
sous des angles différents (individuel, inter-individuel, groupal, organisationnel, institutionnel,
par exemple, pour reprendre les niveaux de l’analyse multiréférentielle de Jacques Ardoino).
Ainsi, si le journal de terrain capte, au jour le jour, les perceptions, les évènements vécus, les
entretiens, mais aussi les bribes de conçu qui émergent, avec un peu de recul, la relecture du
journal est un mode de réflexivité sur la pratique. La relecture du journal permet donc une
démarche régressive-progressive autorisant à se projeter dans l’advenir (voir Méthode
régressive-progressive).
Comme les autres formes d’écriture impliquée (autobiographies, correspondances,
monographies), le journal est une ressource pour travailler la congruence entre théorie et
pratique. »
Je vais garder ce passage long, si j’ai besoin un jour d’expliquer, en citant Remi Hess, ce qu’est
la pratique du journal dans la recherche scientifique. Je voudrais aussi en parler dans mon
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 82 Janvier 2015
mémoire, pour ma recherche : le moment de recherche, le moment de réflexion, le moment
d'écriture, moment de lecture, de relecture, de réécriture... et de lecture à nouveau plusieurs
mois ou années ensuite. C'est mon effet « spirale », dont j'ai déjà parlé et qui me plait tant.
Page 200 :
« Peut-on concevoir une supervision pour le diariste ? Dans sa méthode de 1808, Marc-Antoine
Jullien conseille de faire des bilans hebdomadaires, mensuels des acquis du journal et de donner
à lire ces bilans à un adulte distancé qui permet d’aider à l’évaluation du travail d’écriture. Faire
lire son journal à l’autre aide ainsi à progresser dans sa recherche. »
Je pense que c'est vraiment ce qu'il me manque. Ecrire au jour le jour, assez bien, sans que ce
ne soit des bouts de phrases, que mon texte soit bien mis en forme, que ce soit lisible tout de
suite par quelqu'un... je me rends compte qu'en écrivant ça, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait,
même depuis la licence. C'est peut-être ça qui me ronge, me démange, me bloque. Mais est-ce
que ça vaut le coup que je modifie ma méthode de travail maintenant ? Je fais du mieux que je
peux de toute façon… Mais c’est vrai que je ne fais pas lire, ou du moins pas entièrement mon
journal à quelqu’un au fur et à mesure. Il faudrait que je demande à mes collègues, à mes voisins,
enfin ceux qui s’ennuient, si ça les intéressent…
Samedi 22 novembre 2014, 16h37, auto-école, dans la voiture en attendant Lucas
Page : 200
II).- Les formes particulières de journal
Le journal intime ou personnel est celui que tient l'adolescent ou l'homme de lettres. Il a fait
l’objet de nombreuses études (Michelle Leleu, Alain Girard, Béatrice Didier, Philippe Lejeune).
Le journal intime prend comme objet le vécu personnel d'une personne. Notre travail ne s’inscrit
pas dans le prolongement de cette forme de journal. Henri-Frédéric Amiel a passé sa vie à écrire
un Journal intime, dont le volume est considérable (16 000 pages). Je suis heureux d’avoir ce
journal dans ma bibliothèque de Sainte-Gemme. Je le regarde avec plaisir.
Je note ce passage pour le donner à Rémi, il en aura peut-être besoin pour ses cours en français.
Il étudie l’autobiographie pour sa deuxième année de prépa. En effet, le journal intime d’Amiel
doit être fabuleux à regarder.
Page 201 :
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 83 Janvier 2015
« La lecture du journal d’Amiel montre que l’objet du journal intime est l’exploration de la
construction du “ moi ”, du “ Je ”. C’est un tâtonnement quotidien pour débusquer toutes les
facettes de la personnalité. »
Décidemment, c'est une mine encore une fois de lire votre ouvrage Professeur Hess. Je garde
ce passage pour ma recherche.
Page 201 :
« Je m’inscris dans un continuum d’écriture de journaux qui va de Marc-Antoine Jullien (1808),
J. Korczak (1918), R. Fonvieille (1947-2000)…, et qui refuse l’intimité. On écrit un journal
pour l’autre. C’est une forme de suivi d’une recherche au quotidien. »
Ecrire son journal, rechercher au quotidien... quoi ? Le bonheur ? Comment toujours mieux
vivre ? Se questionner... je pense à Valéry, mon ami étudiant depuis la licence à l’IED, qui se
pose toujours des questions, son cerveau est constamment en recherche de réponses. Mais je ne
me souviens pas de l'avoir lu, de l'avoir vu écrire quelque chose qui dise : j'ai trouvé ! Et il n’a
pas l’air heureux du tout ; ce serait bien qu’il trouve au moins une réponse…
Page 203 :
« Personnellement, je ne me suis pas contenté des trois journaux suggérés par Marc-Antoine
Jullien.
Je fragmente mes journaux en fonction de mes moments. Je tiens jusqu’à 18 journaux en
parallèle. Mais ce n’est pas, pour moi, une consigne ou une norme. Ce chiffre correspond au
nombre de chapitres du Sens de l’histoire, moments d’une biographie. Je rappelle le contexte
d’écriture de ce livre. Christine Delory-Momberger me propose, dans un contexte de vie
difficile pour moi (perte de mes parents), de raconter mon histoire de vie. »
Est-ce que ces dix-huit moments, pourraient correspondre à la fameuse liste que j'aimerais faire
depuis longtemps, de toutes les choses de la vie ? Je vais essayer de trouver les titres des
chapitres de ce livre. Je trouve sur le site de Decitré69.
69 http://www.decitre.fr/livres/le-sens-de-l-histoire-9782717842951.html?v=2
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 84 Janvier 2015
Sommaire
LE RECIT DE VIE DE LA PRODUCTION A LA RECEPTION : UNE EDUCATION
DE SOI
o Modèle autobiographique et invention de soi
o Construction biographique et projet de soi
o Une posture herméneutique, l'hétérobiographie
o La tradition des Vies et le paradigme de l'exemplarité
o L'âge de la Bildung : hétérobiographie et éducation de soi
LES RECITS DE VIE DE REMI HESS : MOMENTS D'UNE BIOGRAPHIE
o L'éducation domestique
o L'école, l'université
o Le moment des vacances
o L'Analyse institutionnelle
o La pédagogie
o L'engagement politique
o La danse
o Les femmes
o Le moment intellectuel
o L'écriture, la lecture ; La bibliothèque
o Le jardin
o Interventions et voyages
o L'écriture pour soi, l'écriture pour l'autre
o Les ruptures instituantes
o De la beauté d'avoir des ennemis
o L'Allemagne ; Voyage en germanitude
o L'interculturel
o L'improvisation
ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE DU MOI : RETOUR SUR CE LIVRE
o Retour sur l'histoire ou les histoires que ce livre raconte de moi-même
o Quelle est la spécificité de notre dispositif d'histoire de vie ?
o L'histoire de vie comme moment socio-historique d'une anthropologie du moi.
Tout ceci m’inspire, que ce livre pourra m’être utile, encore une fois, pour ma recherche.
Une partie de ces dix-huit moments correspondent à ce que je peux appeler des moments
indispensables des « choses de la vie » comme « L'éducation domestique », « L'école,
l'université », « Le moment des vacances », « Le moment intellectuel »,…
Pour d’autres, je les regrouperais, en moments de loisirs comme « La danse », « Voyage »,…
Je me rends compte, que mon idée de lister les choses de la vie est impossible. Enfin, ce ne
serait pas simple. Je verrai ça plus tard.
Page 203 :
« Quand on réussit à identifier un nouveau moment, à le décrire, on fait un progrès dans la
conscience de soi, mais aussi dans la conscience du groupe, et la conscience du monde. Il faut
pouvoir échanger autour de ce travail d’éclaircissement. »
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 85 Janvier 2015
Avoir conscience de soi, de ce que l'on est, de ce que l'on vit, on ne peut le faire que si l'on se
pose, et le fait d'écrire est un des meilleurs moyens de se poser. J'ai tellement envie d'écrire,
sans m'arrêter... si je prenais un congé sabbatique moi aussi ? Malheureusement, financièrement
ce ne serait pas possible, pas maintenant, mais ne désespérons pas !
Tant que j'y pense, je crois avoir identifié un nouveau grand moment dans ma vie : mon
overdose de famille. Je n’ai plus envie de voir que mon amoureux et mes garçons.
Lucas vient de finir son cours de conduite, je reprendrai l'écriture plus tard.
Samedi 22 novembre 2014, 19h20, bureau, maison
Page 209 :
« Un bon produit, une bonne patate, c’est tout de même autre chose que la bouffe de survie. Il
faut être un peu malade, pour avoir la sensation de ces choses. Il existe une différence de nature
entre l’élevage et l’éducation. J’ai l’impression que certains élèvent leurs enfants. J’essaie
d’éduquer les miens au goût des choses simples de la vie. »
Je garde cette idée, de différence entre élever ses enfants et les éduquer. Pour les miens aussi,
je leur donne le goût des choses simples de la vie. Mais je pense que cela va au-delà de l’action
de « donner ». Je partage avec eux, on en parle, ils ne sont pas forcément d'accord...
Page 211 :
« Par transduction, avec Qu’est-ce qu’une vie réussie ?, relue ce matin très vite (3 mn) et sans
lunette, je me suis posé la question : qu’est-ce qu’une vie qui échoue ? Luc Ferry, l’auteur, a-t-
il réussi sa vie dans cette formule de 4° de couverture : “ Luc Ferry est philosophe. Son œuvre
est déjà traduite dans vingt-cinq langues. Il est actuellement ministre de la Jeunesse, de
l’Education nationale et de la Recherche, ” ou plutôt dans le fait qu’il est parvenu aujourd’hui
même à jeter 500 000 personnes dans la rue contre lui ? »
J'adore ! Une autre lettre à proposer à Remi Hess pour valider son cours « Théories et pratiques
de l’intervention » : en quoi pouvons-nous dire que notre vie est réussie, ou ratée ? Je note les
références du livre70, au cas où j’ai trois minutes à perdre.
Dimanche 23 novembre 2014, 10h17, bureau, maison
70 Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Luc Ferry, Paris : Grasset, 2002
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 86 Janvier 2015
Page 217 :
« Vendredi 13 juin 2003,
Je me replonge dans Delacroix pour sortir d’un état psychique détestable (je suis dispersé,
atomisé). Je ne lis pas beaucoup en quantité (ce matin du 12 mai au 28 août 1853), mais cela
me calme. En 1853, Delacroix a 55 ans, c’est-à-dire un an de moins que moi cette année. Je
ralentis ma lecture pour tenter de comprendre comment il vit mon âge. Sa technique d’écriture
qu’il décrit le 12 mai est assez importante […] »
Ça m'intéresse... Comme hier, avec David et Annelise nous avons parlé des musiciens ou des
auteurs, anciens, je leur ai dit mon grand intérêt pour connaître l'histoire de vie de ces personnes
célèbres. Lire ou écouter des œuvres écrites par ces personnes, au même âge que celui que l'on
a, au moment où on le fait me paraît indispensable. Je pense que c’est un vrai plus pour vivre
et s'impliquer dans cette étude d'une personnalité. A garder pour plus tard, cette idée de faire
faire cette activité, dans mon centre de loisirs multi-âges. J’ai réfléchi et j’aimerais bien
m’occuper des gens mais de tous les âges, pas que les anciens…
Page 219 :
« Mes lectures me donnent le goût de me mettre sérieusement à la fondation d’Attractions
passionnelles, revue planétaire d’art et d’éducation. »
Je note de chercher la revue « Attractions passionnelles… ». Je trouve ce bout de texte dans le
blog « Les analyseurs », animé par Benyounès Bellagnech 71, l’article date du 15 juin 2012 :
« La quatrième revue devait s’appeler Attractions passionnelles, une revue d’amour et de poésie.
Un comité de rédaction s’était constitué et avait produit une liste de 34 numéros à produire.
Cette revue, animée par Charlotte Hess et Valentin Schaepelynck, mais aussi Audrey, Liz Claire
(devenue depuis chargée de recherche au CNRS), et quelques autres, s’est transformée en
émission de radio. »
J’ai retrouvé le site de la radio : Radio libertaire72, 89.4, et l’émission Zone d’attraction, toujours
programmée le vendredi à 11 heures. Mais il n’y a que de la musique… Où sont passés Charlotte
et Valentin ?
71 http://lesanalyseurs.over-blog.org/categorie-10781361.html 72 http://media.radio-libertaire.org/index.html
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 87 Janvier 2015
Page 221 :
Jeudi 25 décembre 2003, 10 h,
Je lis dans l’ouvrage acheté hier ce commentaire du tableau de Charles Sovek : Luke, Maryland
(40x40 cm) : “ Une heure d’étude pour un moment de quelques minutes. Le coucher du soleil
avait transformé cette zone industrielle en une merveilleuse composition de forme et de
couleurs. Après avoir ébauché grossièrement les motifs d’ombre et de lumière, l’artiste a peint
les variations de teintes et de tonalités et terminé par quelques détails. De tels moments sont si
rapides que l’artiste doit davantage se fier à son instinct qu’aux règles picturales73. ”
Je pense à mes tubes de peinture qui m'attendent dans le tiroir numéro quatre du petit meuble
derrière moi... J'ai tout le matos, mais je sais que je ne pourrai rien peindre tant que je n'aurai
pas commencé sérieusement à écrire. C'est curieux, peut-être bloquant finalement, par rapport
au fait que je sois bloquée pour écrire. Et si je peignais...
En tout cas de ce passage, ce qui m'interpelle c'est cette histoire d'ombre et de lumière. Je me
suis déjà interrogée la dessus, tous les tableaux que j'aime sont ceux où il y a un contraste fort.
Où la lumière, un rayon, un éclat apparaît.
Je pense aux photos de Gaël, aussi, sûrement à cause de la zone industrielle dans le passage que
je viens de noter. Ce serait plutôt bien d'essayer de retravailler ses photos, où formes et couleurs
sont très flashy, et les reproduire en peinture. Ça peut me donner une idée pour commencer à
sortir mes pinceaux... Me vient tout de suite à l'esprit le grand container orange et gris avec le
« roseau » en tige filetée ou bien la photo du mur rouge avec la poubelle verte et le matelas
dans les environs de Dénia. Je demande à Gaël, il va me retrouver cette photo. A bien regarder
ces deux photos, je pourrais me spécialiser dans la peinture d'un mur ou une surface colorée, un
truc devant et un bout de ciel (bleu ou très nuageux).
73 Greg Albert, Rachel Wolf, La peinture à l’huile, Paris, Fleurus, 2000, p. 50.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 88 Janvier 2015
Photos : www.gaelchauve.com
Dimanche 23 novembre 2014, 13h14, bureau, maison
Page 234 : dialogue entre Remi Hess et Isabelle Nicolas
« -La dépression n’est pas négative, si on la contrôle. Lorsque j’ai perdu mes parents, en 1997-
98, je suis entré dans une période de décomposition de ma transversalité. […]
-Si je suis une artiste, je dois être capable de transformer l’invivable en œuvre, dit Isabelle.
-Oui. J’ai souvent formulé des phrases proches. Mon grand-père entre 1914-1918, séparé de sa
famille, de par son statut de fonctionnaire municipal, obligé de rester au milieu des
bombardements (22 fois la maison qu’il habitait a été détruite par des bombardements ; quel
miracle qu’il ait survécu !), a construit sa vie en construisant son œuvre : un journal inestimable
que j’ai publié en 1998… »
Le « point d'équilibre » : j'y pense et j’y repense depuis hier soir. Avec mon amie Annelise,
bénévole à SOS Amitiés, nous avons parlé de ce qui déclenche le décrochage du téléphone par
les personnes qui appellent. Quel est le point d'équilibre, qui va déclencher l'envie d'appeler.
Ce projet de recherche reste toujours aussi important pour moi. Le point d'équilibre est pour
moi le point, la limite du supportable, de « l'invivable ». Par rapport à ce passage que j’ai noté,
est-ce que cela veut dire que les artistes, finalement n'atteignent jamais le point d'équilibre, que
leur œuvre est le moyen de supporter l'insupportable pour ne pas arriver au point où le
changement s'opère ?
Page 238 :
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 89 Janvier 2015
Ce cours me passionne. Il s’agit de composition. Comment
composer une exposition ? C’est la question. D’autre part,
comment s’y prendre ? En dégageant des moments dans le thème.
[…]
Deux autoportraits fantastiques 1907-1960 de Brancousi.
Je ne connaissais pas du tout Constantin Brâncuși74. Je découvre,
et je tombe amoureuse de son art… J’adore aussi le fait que même
son atelier ait été une œuvre d’art.
Photo : Lycée Valognes de Caen
Page 244 :
« Je suis dans mon trip familial. C’est très intéressant… Je sens chez mes proches un groupe de
fans, aussi bien chez Lucette, Charlotte qu’Hélène, Yves, Constance ou Nolwenn. C’est la
première fois que je fais l’unanimité autour de ma recherche, mais, pour la première fois aussi,
j’ai des hésitations, je ne me sens pas trop sûr de moi. »
Ne pas se sentir sur de soi, alors que tous nos proches nous soutiennent ? J'ai déjà éprouvé ce
sentiment, en fait, c’est pratiquement tout le temps... Est-ce que ce ne serait pas, justement,
parce que l’on croit que nos proches sont trop gentils, qu’ils ne sont pas objectifs ?
Pour être sûr de soi, ne faut-il pas faire des choses pour lesquelles on se dépasse, et qui soient
« validées » par des spécialistes ?
Peut-être que pour la peinture, un regard de « spécialiste » apporterait de la confiance. Mais
comment choisir le bon spécialiste à qui demander ? Qui sont les spécialistes ? Et pourquoi ?
Je repense à cette pub, il y a longtemps, qui présentait que le spécialiste c’est : « bébé ». Je
cherche et je retrouve une vidéo de cette publicité. C’est vraiment magique internet et les
moteurs de recherche. En fait, ça date de 1985, et le slogan exact était : « Chez Nestlé, le
président, c’est Bébé75 ».
Page 254 :
« Sur ma carte d’accès à bord, je lis cette phrase qui sert de devise à l’aéroport de Paris : “ Notre
plus belle destination, c’est vous ”. Qui a trouvé cela ? C’est vrai que ma destination : c’est moi.
74 http://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i 75 http://www.ina.fr/video/PUB3784055116
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 90 Janvier 2015
“ L’œuvre de l’homme, c’est lui-même ”, a dit Lefebvre. Je veux rajouter : “ L’œuvre de
l’homme, c’est son mouvement pour devenir lui-même ”. »
En lisant ce passage, je pense au prospectus qui m'avait été distribué après avoir soutenu mon
petit mémoire de Master 1.
Comme Remi Hess avait apprécié ma méthode de travail à
partir des couleurs, et que nous en avions parlé un grand
moment, j'avais écrit à Didier Moreau et Remi Hess cet e-mail :
Je suis ravie des retours que vous avez faits sur mon travail.
En sortant de la fac, une jeune fille m'a distribué un prospectus
que je vous mets en pièce jointe.
METTEZ DE LA COULEUR DANS VOTRE AVENIR
Encore une fois, je vais garder ce signe comme une jolie pierre
qui jalonne mon chemin de recherche...
Page 256 :
« Maceo (Brésil), le 6 février 2004, 18 h 30,
Je viens de m’arrêter de peindre. Aujourd’hui, je me suis vraiment remis à la peinture. A
Salvador, je me suis lancé à peindre : G 1 (gouache) Lulu rêveuse (à partir d’une photo du 1er
janvier 1999 chez R. Lourau) ; G 2 Capitaine d’escorte (d’après une photo de Charlotte
lorsqu’elle avait 12 ans) ; G 3 Paul sur les ruines de sa maison (1915) à partir d’une photo
agrandie de l’époque. J’ai terminé G 3 aujourd’hui (ce matin). Mais je m’aperçois que je
maîtrise moins bien la technique de la gouache, que l’huile. C’est assez paradoxal, puisque j’ai
fait moins d’huile. Pourtant, ma forme de travail correspond davantage à ce qu’exige l’huile.
Ce soir, j’ai repris G 4 (vue sur la mer, Maceo, de l’hôtel Ibis), et j’ai fait G 5 : Nuit sur la mer,
Maceo vue de l’hôtel Ibis. G 5 me plaît davantage que les autres. »
Les G1, G2... me font penser aux R1, R2, R3... dont on a parlé hier soir avec nos amis David et
Annelise, Gaël et les garçons. Les albums de bandes dessinées de Gaston Lagaffe sont
numérotés de cette façon. On parle rarement de BD dans les forums de l'IED. Je me suis surprise
hier soir, j'avais l'impression d'être la plus « cultivée » en la matière et notamment spécialisée
en éditions DUPUIS, avec ma collection depuis 1988 des hebdomadaires de SPIROU
Magazine... Bon, je me suis juste trompée au sujet de La vallée des bannis que j'attribuais à
Franquin... Non, ce sont bien Tome et Janry, les auteurs de cet album. En revanche, Franquin a
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 91 Janvier 2015
créé le Marsupilami, qui apparaît aussi bien aux cotés de Spirou, qu'aux cotés de Gaston Lagaffe.
Le Marsupilami est un personnage transverse...
Page 258 :
Un enfant de 9 ans couvert de poux et de gale (pelage) sur le cuir chevelu tournait autour de
nous. Il semblait s’intéresser à nous, à moi, très absorbé que j’étais par mon dessin. Sergio lui
a dit de circuler. Il est revenu. Il a voulu voir mon carnet à dessins. Je lui ai montré. Il a alors
saisi mon stylo et a voulu écrire (très difficilement) MARCOS, son prénom, dans mon carnet.
Lucette voulait prendre des distances par rapport à lui (du fait des maladies qu’il portait ; elle
n’est pas en bonne santé), et lui voulait vraiment construire un dialogue avec moi. J’ai essayé
alors de le dessiner sous son nom. Mais j’étais debout, et lui aussi. Il bougeait. Le dessin que
j’ai fait de lui est le plus loupé de tout ce que j’ai fait aujourd’hui, mais il ne m’en voulait pas.
Il m’était reconnaissant de l’avoir pris comme modèle76 .
Je pense à notre américaine à vélo, dans Détroit, qui
voulait faire le sujet... Voici ce que j'ai noté dans mon
journal du voyage : « Gaël prend cette photo.
Couleurs, lignes, fils
électriques, tout y est.
Mais notre cycliste du
jour veut absolument que
l'on y mette un « sujet » sur cette photo et se propose gentiment.
C'est drôle, elle avait l'impression, surement bizarre, que l'on ne
prenait « rien » en photo.
Page 259 :
« Pour mes dessins, je constate que je liquide le trait, lorsque je les peins. J’ai plusieurs
possibilités. Ou je les laisse ainsi, ou je repasse au stylo noir par-dessus. L’avantage de la
deuxième solution est de faire ressortir le trait ; l’inconvénient est que cela ne correspond à rien.
Je n’utiliserais pas ce procédé dans le contexte de la peinture à l’huile.
En même temps, dans les bandes dessinées, le trait est relativement important : il facilite la
lisibilité. »
76 Sur cette rencontre forte, voir la suite dans le Journal de Maceo.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 92 Janvier 2015
C'est curieux, il y a exactement trente minutes, je viens d'écrire qu'on ne parle pas souvent de
BD à Paris 8 et sur les forums de l’IED... J'ai dû inspirer Remi Hess...
Page 263 :
« Après le concert, des organisateurs avaient prévu un petit cocktail. C’est à la queue devant le
buffet, que l’on prit conscience qu’il y avait vraiment du monde dans ce colloque. J’avais
dessiné pendant le concert (les musiciens sont pour moi, un bon thème de recherche) ; ne
cherchant pas à être le premier servi, je continuai en griffonnant la queue devant le buffet… »
Les queues, voilà un bon thème à travailler.
Je reprends ce passage, lu cet été dans Enfance berlinoise de Walter Benjamin, dans Sens unique,
Paris : 10-18, 2000, page 135 :
« ALLEMANDS, BUVEZ DE LA BIERE ALLEMANDE
« La populace est possédée envers la vie spirituelle d'une haine frénétique qui a reconnu dans
le comptage des corps le plus sûr moyen de l'anéantir. Chaque fois qu'on le leur permet, ils se
mettent en rangs, ils avancent en bon ordre, vers un feu roulant ou vers un grand magasin.
Personne ne voit plus loin que le dos de celui de devant, et chacun est fier d'être, de cette manière,
exemplaire pour celui qui le suit.
Cela, les hommes ont appris à le faire depuis des siècles, à la guerre, mais ce sont les femmes
qui ont trouvé le défilé de parade de la misère : faire la queue. »
Page 275 :
« La mort de mes parents m’a effondré. J’ai eu du mal à me sortir de cette expérience, car je ne
me rendais pas compte vraiment de ce qu’est la mort. Avec les disparitions d’Hubert de Luze,
Gérard Althabe et Joseph Gabel en moins d’un mois, j’ai l’impression d’être entré dans une
autre période de ma vie : je ne peux plus mettre à demain des choses qui me tiennent à cœur, et
que je me représente intérieurement : livres, toiles. »
J'ai peur, moi aussi, de ce moment qui arrivera, c'est sûr, un jour ou l'autre. Je commence à
prendre conscience que si j’ai le projet de vouloir fuir très loin, à l'étranger, en Australie, au
Canada, en Amérique du Sud, c'est peut-être pour ne pas vivre ce moment-là. Mais c'est idiot.
Ce qui l'est surtout c'est mon attitude actuelle. Je me culpabilise parce que je fais une overdose
de famille. Ma mère m'a montré sa vraie nature pendant nos deux semaines à Détroit. Mon père
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 93 Janvier 2015
ne me parle plus parce que je n'ai pas voulu et surtout pas pu lui donner d'argent. Et je me dis
que si je ne les vois plus, dès maintenant, je me préparerai mieux à leur mort. C'est horrible ce
que j'écris. Mais c'est quand même ce que je pense. Je bosse comme une dingue, je fais plein
de choses, et j'ai l'impression d'être la méchante de la famille. Je vais rester dans cette posture.
J'oublie tout pour me consacrer uniquement à mes études, à ma recherche, mes deux garçons,
mon amoureux, et mon travail pour continuer à gagner des sous pour manger…
Page 276 :
« Je parle à Liz, d’Abélard et Héloïse : eux aussi, il faut en parler dans notre revue. En fait, la
passion, nos passions, quelle place leurs donner ? »
Je demande à Lucas s'il connaît l’histoire d’Abélard et Héloïse, il me dit que non. Je ne me
souviens plus quand j'ai découvert cette histoire d'amour médiévale, mais je devais bien avoir
25 ans ! Il faut que je demande à Rémi, mais je pense qu’il connaît ça par cœur, vu que l’an
dernier il a étudié la littérature médiévale. Il faut que je fasse lire ça à Lucas, je me souviens
que ça avait passionné son père. Nous avions même été voir leur tombe au cimetière du Père
Lachaise lors de l’une de nos visites touristiques parisiennes.
Page 278 :
« … je n’ai jamais de journal terminé, sauf dans le cas des journaux de voyage dans lequel du
début à la fin, j’écris dans un carnet. Il y a donc une unité, une cohérence d’ensemble que je ne
parviens pas à trouver dans les autres “ moments ”, qui se construisent sur une plus longue
durée, dans des recueils et des supports de nature différente. J’ai réussi à trouver une solution
technique à ce problème en lisant les Romantiques d’Iéna, les animateurs de la revue Athénaum
(1799-1802). Ils font l’éloge du fragment : le fragment a une unité ; il tend vers la forme
définitive, même si cela n’est pas encore achevé. L’inachèvement est au cœur de l’expérience
humaine. Si l’homme meurt avant d’avoir épuisé toutes ses virtualités, l’œuvre aussi : l’œuvre
est un processus. Le fragment peut être repris : c’est une idée forte, un germe.
Je repense à Novalis et ses fragments... Je garde ce passage pour ma recherche.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 94 Janvier 2015
Page 279 :
Liz Claire travaille. Je lis le catalogue de l’exposition Füssli
(1741-1825) : la peinture m’intéresse. Est-ce bien le peintre
préféré de Charlotte ? Je vais aller taper le programme (38
numéros) d’édition d’Attractions passionnelles, histoire de
l’imprimer et de pouvoir travailler dessus à midi.
Füssli, mon fils Rémi, me l'a fait découvrir le week-end dernier.
Le silence est une toile torturée mais fascinante.
Il m’indique aussi le site, d’où est tirée cette photo, le Web Gallery of Art77, où le rendu des
couleurs est bien respecté.
Dimanche 23 novembre 2014, 19h08, bureau, maison
Page 281 :
Hier et aujourd’hui, j’ai relu 180 pages (mot à mot) du mémoire de maîtrise de Charlotte, ma
fille, que j’ai corrigées attentivement : son texte est vraiment intéressant. Les idées défendues
ne me sont plus étrangères, depuis cet été, passé à Sainte Gemme : Charlotte a écrit l’essentiel
de ce texte, au cours de son séjour chez nous. Ce texte est programmatique pour moi : beaucoup
d’idées qui y sont analysées ont eu une postérité chez H. Lefebvre, les Surréalistes et dans
l’analyse institutionnelle.
Hier, j'ai écrit une lettre à Remi Hess, avec un chèque pour qu'il m'envoie le livre Henri Lefebvre,
romantisme révolutionnaire. Je lui demande l'adresse e-mail de Charlotte pour la contacter. Mon
projet de recherche est étonnamment proche du mien. Peut-être que ce mémoire de maitrise
pourrait m'aider, mais surtout dans le sens de ne pas refaire ce qui l'a déjà été. En tout cas, j’ai
cherché ce mémoire sans succès… Je trouve ça dommage en fait que ce genre de document ne
soit pas disponible à tous. Je ne dis pas qu’il faut forcément que ce soit gratuit, mais en tout cas
présent et accessible. Un mémoire, c’est le résultat, le produit, d’un travail, plus ou moins
considérable selon la quantité et la qualité des informations qui le composent, et le partager,
c’est continuer à le faire vivre ce travail. Enfin, je crois. Je me suis inscrite sur le site
academia.edu, je vais y publier ma note d’investigation de Master 1.
Page 281 :
77 http://www.wga.hu/index1.html
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 95 Janvier 2015
En lisant Charlotte, on découvre que notre problème aujourd’hui, c’est d’être romantiques… A
développer. Cette lecture pose la question de l’esthétique, de l’œuvre, de l’artiste, du mot esprit,
etc. : ce texte est fondateur d’une théorie qui s’applique aux IrrAIductibles, à Attractions
passionnelles, etc. La Symphilosophie nous concerne au premier chef.
En quoi est-ce un problème aujourd’hui d'être romantiques ? Est-ce que ça peut me donner une
piste pour ma recherche ?
Page 281 :
Dans ce que j’ai lu, Charlotte ne développe pas clairement des choses qu’elle a brillamment
formulées, dans ses dernières interventions orales : ainsi, du rapport entre “ esthétique et
politique ”. Samedi soir (25/9), elle est venue dîner à la maison : elle a beaucoup argumenté sur
cette thématique.
Autres fragments à construire : Le style, La Weltlitteratur (le mot n’apparaît pas dans le
mémoire), L’interculturel, L’improvisation (esquissée légèrement chez Charlotte).
Est-ce que le style est le thème sur lequel il faut que je construise mon œuvre ? Comment je
vais savoir détecter, comprendre, analyser, expliquer, comparer, le style dans les écrits que je
dois étudier pour ma recherche. Je n’ai aucune culture littéraire, et là, j’ai peur de me noyer
dans un sujet que je ne vais pas maîtriser. Ne paniquons pas tout de suite, avançons…
Page 282 :
Charlotte est venue dîner à la maison hier soir, et je l'ai informée du travail que nous avions fait
tous les deux dans la journée. Elle est très contente de la tournure des évènements. Elle se réjouit
de ta rencontre avec Jean-Marie Pradier et de la chance que ce serait de te voir occuper un poste
à Paris 8.
Le thème principal de nos échanges a été la symphilosophie (mot qui, pour les Romantiques, -
comme je te l'ai expliqué - signifie le travail de production intellectuel en équipe). Charlotte
pense que nous nous inscrivons dans cette tradition.
La symphilosophie... Est-ce que le travail en équipe permet la formation de soi, l'esprit
d'humanité ? Sans chercher je réponds « Oui ». A garder pour ma recherche.
Page 288 :
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 96 Janvier 2015
« -Je travaillais jusqu’à maintenant à partir du concept de résidu (H. Lefebvre).
Depuis la recherche de Charlotte sur le Romantisme allemand, je suis obligé de glisser vers le
fragment. Mes résidus se métamorphosent donc en fragments, qui s’agencent esthétiquement
en installations.
Ces installations n’ont d’autre finalité, pour moi, que de produire un effet de beau : je suis donc
dans une perspective esthétique. Cependant, dans un mouvement de dissociation transductive,
je me mets à oublier que c’est moi artiste qui ait produit ce rassemblement de fragment. Et c’est
alors l’archéologue qui dort en moi, qui se réveille, et se met à interpréter ce que l’on peut voir
de la vie sociale et de la nature d’une époque, à la lecture de ces traces.
Fragments, « résidus qui se métamorphosent », effet de beau, perspective esthétique,
interprétation, à garder pour ma recherche.
Dimanche 23 novembre 2014, 20h40, bureau, maison
Page 289 :
« Avant d’ouvrir le commentaire, nécessité de faire le catalogue des fragments rassemblés.
Chaque page du Cahier aura donc un numéro. Ce sera un numéro de page, mais que l’on
nommera numéro d’installation. Chaque page est une installation à partir de fragments.
Mais dans I1, I2, I3, In, chaque fragment aura un numéro fr1, fr2, fr3… Ainsi, chaque fragment
pourra être nommé dans le corps du texte, par un matricule I120, fr14. Cette immatriculation
permettra le commentaire et donc le rapprochement de fragments, ayant des installations
différentes. »
J'ai l'impression de me « voir » en train de normaliser ma méthode d'indexation de toutes mes
photos de famille. Il y quelques années que je travaille à ce projet que j'ai appelé « chantier ».
J'ai commencé à scanner toutes mes photos, j'en ai vraiment beaucoup et je n'ai pas terminé.
Pour chaque photo, je la renomme en indiquant l'index, que j'ai défini dans un fichier texte du
répertoire Chantier :
FG Famille Gilles ou Gilles seul (mon père)
FM Famille Martine (ma mère)
FAN Famille Angéline
FV Famille Virginie (ma sœur, la n° 2)
FAL Famille Alexandra (ma sœur, la n° 3)
FE Famille Emilie (ma sœur, la n° 4)
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 97 Janvier 2015
FN Famille Nicolas (mon frère, le n° 5)
FI Famille initiale
AG Amis Gilles
AM Amis Martine
AAN Amis Angéline
AV Amis Virginie
AAL Amis Alexandra
AE Amis Emilie
AN Amis Nicolas
AFI Amis famille initiale
Si une seule personne ou ses descendants F.. ou A..
Si plusieurs personnes de la famille mes parents ou mes sœurs et mon frère : FI
Si plusieurs personnes amis de la famille : AFI
J'écris ensuite dans le nom de chaque photo, le prénom de la personne ou des personnes, le lieu
et la date si je m'en souviens (ce qui est de moins en moins le cas !)
C'est un travail de titan.
Page 190 :
« J’ai mis de la musique différente aujourd’hui. D’abord du jazz (Petrucciani), puis Offenbach.
En allant me coucher, je suis heureux d’avoir réussi à noter toutes les associations qui se sont
produites, au fur et à mesure de mon action créatrice de l’après-midi. C’est difficile de garder
le souvenir d’une transduction. D’ordinaire, on oublie ce qui vous conduit du coq à l’âne. »
Ce qui me paraît le plus difficile, c'est d'avoir la présence d'esprit de prendre son crayon et son
papier pour noter. Ça rejoint ma réflexion d'écouter de la musique spécifique lorsqu'on est en
colère, c’est une méthode que l’on met en place avec mon fils Lucas. On est en colère, on râle,
on peste, on met une musique dont on a besoin pour nous calmer. Mais comment arrive-t-on à
se dire : « il faut que je mette de la musique, j’ai besoin de me calmer ».
Quel est l'événement déclencheur, la p'tite étincelle du cerveau qui s'allume pour dire, là tu
abuses, tu dépasses ton point d'équilibre et tu agis... Pour la transduction, qu'est-ce qui s'allume
pour se dire de prendre son papier et son crayon ?
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 98 Janvier 2015
Page 292 :
« Ces illustrations sont trois toiles de Caspar David Friedrich : Femme à la fenêtre, Le Christ
rouge, Contemplation de la mer (Ces titres sont de moi, car le titre des toiles n’est pas mentionné
dans le mémoire). Ce travail comporte une bibliographie de 72 livres. La couverture rouge et
noire est très romantique. »
Je pense à la salle du laboratoire Experice, où nous étions lors du premier regroupement de cette
année, avec les étagères où sont entassés tous les mémoires et thèses des années passées, tous
reliés avec des ressorts plastiques. Je voudrais que mon mémoire de Master 2 soit beau. Je
demanderai à Charlène, si elle est d’accord, de me faire une reliure exprès pour mon exemplaire,
mon œuvre de l'année... Charlène est relieuse d'art et son travail est fabuleux.
Note 346 de la page 297 :
Raymond Bayer, Entretiens sur l’Art abstrait, Ed. Pierre Cailler, Genève, collection “ Peintres
et Sculpteurs d’hier et d’aujourd’hui ”, 1971. Raymond Bayer, professeur à la Sorbonne avait
déjà publié en 1971 : L’esthétique de la grâce, Alcan, 1934 ; Léonard de Vinci, Alcan, 1934 ;
Essais sur la méthode en esthétique, Flammarion, 1953 ; Epistémologie et logique depuis Kant
jusqu’à nos jours, PUF, 1954 : Traité d’esthétique, Armand Colin, 1956 ; Histoire de
l’esthétique, Armand Colin, 1961 ; Esthétique mondiale du XXème siècle, PUF, 1961.
A garder, à chercher, à trouver, à lire, à décortiquer, pour ma recherche.
Page 299 :
J'ai commencé mes lectures par Bernard Sobel, Un art légitime78. […] On trouve dans son livre
ces vers de Heinrich Heine :
“ La vie a un droit
C’est celle des changements
Tout ce qui empêche la vie de changer
Doit être combattu ”.
78 Bernard Sobel, Un art légitime, Actes Sud, Le temps du théâtre, conçu et réalisé par Sylviane Gresh, 1993.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 99 Janvier 2015
Il faut que je cherche par-là, pour plus tard, pour mon ami Gérard le consultant, spécialiste de
la conduite du changement. Il connaît sûrement cet auteur. Cette phrase est essentielle !
Je note sur Wikipédia, qu’Heinrich Heine est considéré comme le « dernier poète du
romantisme »79. Mais je ne trouve pas trace de ces quatre vers. Je demanderai à Remi Hess, ou
j’irai consulter ce livre, il est à la médiathèque de Niort.
Page 300 :
Avant d’oublier, je note les autres livres acquis ces jours-ci : De l’architecture à l’épistémologie,
la question de l’échelle80, Edward Lucie-Smith, L’érotisme dans l’art occidental81, Georges
Jamati, La conquête de soi, méditations sur l’art82, R. Bayer, Traité d’esthétique83.
Je note, pour ma recherche, les ouvrages de Georges Jamati et Raymond Bayer.
Pages 304-305 :
Christian Noorbergen commente trois toiles sur le corps.
[…]
Passage de ce que l’on ne supporte plus à la révolte. Quatre, cinq femmes qui sont survenues
au milieu des chiens. Ce n’est pas un esprit cartésien qui décide ce que l’on va peindre».
Oui, « le passage de ce que l’on ne supporte plus à la révolte », c’est ça que j'appelle le point
d'équilibre., la survenue du désir de changement. J’aime bien cette expression, elle est très
parlante.
Page 309 :
« Aujourd’hui, j’ai relu le 12ème
prélude d’Introduction à la Modernité, d’Henri Lefebvre. C’est
un texte sur le romantisme. À la lumière du mémoire de maîtrise de Charlotte, je suis quelque
peu déçu. J’espérais trouver de solides références au romantisme allemand, mais ici, Henri ne
travaille vraiment que sur les Romantiques français. Malgré tout, ce long texte sera important
un jour. Il faut lui trouver sa place, à l’intérieur de notre retour au Romantisme. »
79 http://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine 80 De l’architecture à l’épistémologie, la question de l’échelle, sous la direction de Philippe Baudon, Paris, PUF,
1991, 362 pages. 81 Edward Lucie-Smith, L’érotisme dans l’art occidental, Paris, Hachette, 1972, 286 pages, illustrés. 82 Georges Jamati, La conquête de soi, méditations sur l’art, préface de Ferdinand Dauphin, Paris, Flammarion,
1961, 474 pages. 83 R. Bayer, Traité d’esthétique, Armand Colin, Paris, 1956.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 100 Janvier 2015
A garder pour ma recherche, pour le romantisme, mais pas allemand...
Je note ce thème important que j’aimerais aborder dans mon mémoire : notre retour au
romantisme.
Page 315 :
« J’ai affiché l’affiche de l’exposition Enigma Monsù Desiderio : un fantastique architectural
au XVIIème siècle sur le mur de la salle de séjour. Et je me suis mis à lire les deux livres offerts
par Monique Sary84 : je découvre un peintre romantique, avant l'heure ; l’avantage de cette
peinture est qu’elle comporte tous les éléments du Romantisme : fragments, ruines, esthétique
de l’inachèvement, mystère de la signature. »
A garder pour ma recherche, si j’ai besoin d’illustrations.
Page 320 :
« Nathalie me dit que la couleur n’est pas indispensable, qu’aujourd’hui, la modernité accepte
bien le noir et blanc. Je dis que je viens de visiter l’exposition de Monsù Desiderio, à Metz, et
ce peintre du XVII° siècle mérite la couleur. Je montre le catalogue de l’exposition, et un
ouvrage de Michel Onfray sur ce peintre, avec 80 pages d’illustrations en couleurs. Je prends
conscience que Nathalie vit dans le présent, et que moi j’ai envie de stimuler l’émergence d’un
Continuum romantique, depuis l’Antiquité. »
Moi aussi ! Je me dis que c'est ça, qui me caractérise depuis que je suis toute petite, je suis
romantique, et peut-être que c'est ça qui fait ma personnalité d'originale, qui peut paraître sans
doute « désuète » ou « has been ». J'aime cette idée. Gaël, lui serait plutôt dans le continuum
des années 70, ça le fascine. Il ne rate pas une émission, un reportage, une expo, ou un livre de
photos de cette époque, de la période qui nous a vus naitre.
Page 321 :
« Picabia travaille à partir d’une malle au trésor, dans laquelle il puise les images rassemblées.
Cela me fait penser à la malle à partitions ou à mélodies, de J. Strauss. Moi aussi, j’ai une telle
84 Monsù Desiderio, Scénographie pour la terreur et la pitié, présenté par Michel Onfray, Metz, Musées de la
Cour d’Or, 2004, relié ; et Enigma, Monsù Desiderio, Un fantastique architectural au XVIIème siècle, Metz,
Musées de la Cour d’Or, Ed. Serpenoise.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 101 Janvier 2015
caisse. Je veux systématiser cette technique. Dans mon atelier, je veux construire une
bibliothèque spécialisée. Il me faut beaucoup d’images pour puiser des idées et des modèles. »
Mon envie de choisir une photo de famille au hasard pour écrire est très proche... C'est drôle,
c'est étonnant plutôt... Aujourd’hui, ma malle au trésor est représentée par le canapé lit dans ma
pièce-bureau, où dans le bac qui sert d’entourage, de coffre, sont entreposées des boites
cartonnées, où sont rangées toutes mes photos. Pour les atteindre je dois soulever une partie du
matelas et du cadre métallique du canapé qui pèse une tonne, où il y a toujours tout un tas de
trucs qui l'envahissent, en gros, un couvercle de malle au trésor pratiquement inamovible... ou
au prix de gros efforts.
Page 329 :
« Les problèmes de lumière découverts à Metz, étaient aussi présents à Anvers. Rubens conçut
de grandes fenêtres pour y remédier. La maison de campagne de Rubens était, elle aussi, très
impressionnante.
Quelle relation existe-t-il entre l’espace dont on dispose, et la capacité créatrice ? C’est une
question que je me pose souvent. L’aisance de Rubens a été acquise par lui-même, compte-tenu
de la pauvreté relative de sa famille. »
Je pense la même chose pour l'écriture surtout depuis que je suis allée, en mai dernier, entre
Tours et Angers, visiter le château de Saché, où Balzac a été hébergé et où il a écrit un grand
nombre de ses livres. En voyant la bâtisse, le jardin, les fleurs, le paysage, Oui je me suis dit
que moi aussi, je serais sûrement capable d'écrire de belles choses... dans un endroit pareil, mais
bon, j'aimerais tant essayer d'écrire... Ha ! Ça me travaille !
Lundi 24 novembre 2014, 12h28, voiture, pause déjeuner au bord de l’eau
Page 332 :
« Seule lecture d’hier : le volume 5 de L’Histoire de L’Art d’Elie Faure. Son idée : entre 1815
et 1925, Paris est le centre du monde en recherche de peinture. L’énergie du mouvement est le
romantisme : même les cubistes sont romantiques. Ce travail a lieu en France, mais en se
mondialisant (acceptation des influences extérieures). »
En plus de la musique, il faut que je parle de la peinture romantique dans mon mémoire
romantique.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 102 Janvier 2015
Page 334 :
« Les Islettes ! Quelle promenade bizarre nous faisons : arrêt surréaliste. Il faut que je demande
au contrôleur, si le train normal passe par notre itinéraire : le paysage est très champêtre, un
chemin de terre longe la voie ferrée.
Il y aurait des photos à faire de cette région romantique ; Clermont-Argonne : des gens
descendent ! »
Clermont Argonne je ne connais pas mais c'est une belle idée de faire un livre de photos de
régions romantique. Je vais en parler à Gaël.
Page 337 :
« La quatrième : Romain avec sa mère. Pour cette toile, je les vois poser à la manière de Lucette
et Pascal : Romain lirait un livre et Alex le tiendrait par le cou. Cela demanderait une pose :
techniquement, cela demanderait de faire des photos, de les faire développer, de faire des
agrandissements, etc. Aurais-je le temps de tout faire, lors de mon projet séjour ici ?
Accepteront-ils de poser ? »
Au niveau de l’écrit, en tout cas pour Remi Hess, il n'y a pas besoin de demander.
Aujourd'hui il publie les lettres échangées avec ses relations sans demander l'autorisation.
Ce n'est plus privé, c'est public d'écrire à Remi Hess.
Ecrire son journal en citant des personnes est-ce autorisé ? Ecrire oui, mais publier ?
Je me suis posée la question lorsque je cite mes collègues, Valéry, Carmen,… est-ce que je mets
leur nom de famille ou non ? J’ai fait le choix de « non ». Nous sommes de la même promotion,
j’ai leur nom par ailleurs. En revanche, si quelqu’un me contacte pour me dire qu’il ou elle est
intéressé par le travail de Valéry ou Carmen, je ferai en sorte de les mettre en contact.
Page 338 :
« Si j’avais laissé Lucette et Pascal à Metz, l’idée d’Alex aurait été de détruire cette toile,
comme Lucette voulait protester, contre le fait que je peigne une toile de Brigitte. Chaque toile
est un moment qui implique mes ayants-droits : il faut que chaque ayant-droit, qu’il soit enfant
ou disciple, ait son portrait.
On est toujours heureux d’avoir une toile de soi ou de ses ascendants ; ce type de travail se
transmet dans la famille, de génération en génération. »
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 103 Janvier 2015
C'est exactement ce que je veux léguer à mes petits petits enfants, ou neveux, l'histoire des
personnes de ma famille, de leur famille, en écrivant à partir des photos tirées au hasard de ma
« malle canapé » au trésor.
Page 341 :
« J’écoute la Sonate 16 de Beethoven : comment Romain peut-il détester la musique classique ?
Rien que d’y penser me fait froid dans le dos. »
Je ne comprends pas comment Romain peut jouer de la harpe et détester la musique classique ?
Il y a un truc qui m'échappe... Ou alors, c’est qu’il joue du rock ou uniquement de la musique
contemporaine ? Ou bien, est-ce pour lui une contrainte de jouer de cet instrument ?
En fait, je repense à mon stage au conservatoire de musique et de danse de Niort pour valider
la licence et à toutes mes années à apprendre la musique (flûte traversière et violoncelle) depuis
trente-quatre ans. Je n’arrive pas à concevoir qu’on contraigne un enfant à jouer d’un instrument.
Mais ce n’était peut-être pas le cas de Romain. Je demanderai à Remi Hess, ce qu’est devenu
le « moment harpe » chez son fils.
Page 349 :
Paris, vendredi 22 avril, 8 h 30,
Je découvre avec plaisir l’envoi de Bernadette : la frappe de mon second carnet Journal d’un
artiste (29 novembre 2004- 27 janvier 2005). Je vais le relire immédiatement. Bernadette
commente :
“ Cher Remi, Je t'envoie enfin La suite d'un Journal d'un artiste. […]
Ton journal a été souvent un journal de lecture sur la peinture, mais cela restait aussi une
question de regard, seule la forme, les couleurs changeaient. Cependant, des réflexions
profondes sont intéressantes. En te lisant, mon regard sur la peinture a progressivement changé.
En suivant la création, puis la lente élaboration d'une toile, ta progressive découverte de la
peinture, je ne regarde plus les toiles de la même manière dans les expositions. Je les regarde
plus en profondeur, en essayant d'en comprendre le cheminement de fabrication.
Juste avant de lire ce passage, je me disais : « Bon, c'est bien, mais où veut-il en venir ? »
Maintenant, en lisant le commentaire de Bernadette, je vois la dimension « Construction de la
personne », en l'occurrence « Construction » de Bernadette ou moi. Tout ce que j'ai noté depuis
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 104 Janvier 2015
le début de ma lecture sur ce que Remi Hess a écrit va m'aider dans ma construction toujours
inachevée... Je vais me mettre à peindre, à écrire à partir de mes photos de la « malle-canapé »
à trésor. J'ai envie de me sortir les tripes de tout ce travail. Comme dirait ma mère quand elle a
lu mon premier journal de recherche en janvier dernier : tu es allée chercher des trucs très
profonds, jusqu'au bout de tes orteils ! »
Lundi 24 novembre 2014, 20h32, bureau, maison
Page 350 :
« En me relisant, de trouve à la date du jeudi 13 janvier 2005 : « Il faut que je m’habitue, à ce
que mes amis ne voient pas le monde, comme je le vois ». Commentaire d'aujourd'hui : si la
peinture m'aidait à intégrer ce fait, je serais plus heureux.
Les gens ne partagent que rarement mon rapport au monde, ma vision des choses : mon
originalité, ma spécificité, ma valeur se produisent de cet écart entre l'autre et moi. J'ai un
rapport singulier à l'homme et à la société. L'autre, aussi. »
Je pense ça aussi pour moi. J'ai l'impression parfois d'être une illuminée, d'avoir des idées
loufoques, de faire des trucs que les autres ne font pas, et souvent, je me dis que ceux qui
m'entourent doivent me prendre pour une folle. Mais, est-ce vrai ? Qui sont les gens qui ne
partagent que rarement votre rapport au monde ? Y en a-t-il beaucoup ? En tout cas, il y a, je
pense, un grand nombre de personnes qui apprécient, voire, admirent Remi Hess. J'ai
véritablement commencé à écrire depuis deux ans, pendant la licence. Si... au boulot, depuis
des années j'écris des documentations d'applications informatiques qui plaisent à ceux qui les
lisent : ce sont des textes techniques enfin compréhensibles ! Bon, ce que je voulais dire, c'est
que même si j'ai écrit des choses un peu farfelues parfois, j'ai quand même réussi mon passage
en master 2... Est-ce que c'est parce que je suis sincère dans ce que j'écris justement sans me
prendre la tête à savoir si ça va plaire ou non ?
Page 352 :
Fragments d'une recherche
«Tout est semence»
Novalis, Le Monde doit être romantisé, Paris, Allia, 2002, p. 74, § 188.
«La trans-duction, opération de pensée sur/vers un objet virtuel pour le construire et le réaliser. Ce serait
une logique de l'objet possible et/ou impossible.»
H. Lefebvre, Logique formelle et logique dialectique, préface à la seconde édition, 1969, p. XXIII.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 105 Janvier 2015
“C’est un devoir de faire profiter les autres de sa propre expérience”.
George Sand, L’histoire de ma vie.
Je vais parler de Novalis dans mon mémoire, des fragments, des semences, pourquoi ne pas
parler de George Sand ? A garder pour ma recherche.
Page 355 :
« Le moment de l'apéritif, sorte de sas, est un espace-temps qui permet au groupe de redéfinir
progressivement, ensemble et individuellement, le moment commun. Le moment du repas est
vécu, mais, lorsqu'on invite des amis, il est d'abord conçu : la forme sociale de la rencontre,
passe par une idée, une décision préalable.
Le moment manqué est celui qu'on laisse passer, comme Lucette laisse passer les champignons
au profit de sa conversation avec Martine ! Il y a un germe. Mais il est mort. Quelle disponibilité
au moment ? Dans le vécu, les moments virtuels sont légions, ils se croisent ; ce sont des germes :
ils traversent le champ perceptif. »
Je ne dirais pas que le germe du moment manqué soit mort. Il est vivant dans l’écriture, dans
ce journal. Il est vivant dans la tête de Remi Hess. Peut-être que ce germe va se développer, que
la prochaine fois, il dira clairement à Lucette qu'elle ne doit pas manquer ce moment des
champignons avec son mari !
Page 356 :
« Dans ses notes, Christine parle du moment autre, où « l'on sent, goûte le pimenté sucré de ce
qui se passe, sans trace ». Ni vu, ni connu : « un moment dans ; fusion dans ce moment UN, où
l'on est toujours deux, trois, douze, plus ce qui est entre nous : la distance, pleine, englobante ».
Ce pimenté sucré de Christine V. est pour moi de l'ordre du pathique. »
La prochaine fois que j'anime une réunion et que je vois mes interlocuteurs en train d'écrire sur
leur clavier, en sachant pertinemment que ce ne sont pas des notes de ce que les autres ou moi
sommes en train de dire, j'y mettrai peut-être bien un peu de piment... Je vais y réfléchir... Il
faut que j'observe exactement ce qui se passe les prochaines fois. En fait, je vais être obligée de
sortir de mon moment de concentration sur l’animation de la réunion pour participer au moment
« pimenté sucré »...
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 106 Janvier 2015
Mardi 25 novembre 2014, 12h52, voiture, pause déjeuner au bord de l’eau
Page 363 :
Ce moment conçu, voulu voilà 40 ans, prend forme dans un espace : donner cet espace
spécifique aux livres nous permet de récupérer les autres pièces pour leur donner une autre
destination. […] La territorialisation du moment de la bibliothèque permet ainsi de donner leur
espace aux autres moments de la vie de famille.
Cette réflexion sur le moment de la bibliothèque me fait dire : toute conception de moment
passe par la création d'un dispositif adapté, qui puisse l'accueillir. Beaucoup de familles
conçoivent la maison, l'appartement comme l'établissement de leur transversalité. Ma maison
est arrivée dans ma vie, pour résoudre un problème de rangement de livres. La maison n'a pas
été un but en soi, mais un moyen permettant au moment de la bibliothèque de se déployer.
J'ai un terrain au bord de la Sèvre, en site classé Marais poitevin. J'ai rêvé pendant des années
d'avoir exactement ce que j'ai aujourd’hui. Mais... depuis trois ans maintenant, nous y avons
passé seulement trois journées exceptionnelles, deux soirées pique-nique, et trois fois deux jours
de débroussaillage ! Je l'ai mis en vente, parce que je me dis que ça fait trop de contraintes...
Mais personne n'en veut ! Est-ce un signe ? Est-ce que je dois le garder ? Oui. Il faut que je créé
ou bien qu'arrive le bon dispositif. Alors je pourrais créer mon moment « terrain au bord de
l'eau ». J'ai des centaines d'idées pour ce terrain, qui peuvent aller de la création d'un jardin
philosophique, d'un labyrinthe végétal, à une roseraie, à l'installation de sculpture (peut-être que
Gaël qui a envie de faire un truc manuel, ça pourrait l'intéresser...), à un kiosque à musique où
je pourrais jouer du violoncelle (ma prof en rêve, elle qui joue régulièrement dans les arbres !)
mais il faut du temps et peut-être un peu d'argent...
Mes études sont arrivées en même temps que l’opportunité d’acheter ce terrain. Alors, je ne
pouvais pas tout faire en même temps. Je ne vais pas insister pour le vendre. Je vais m'en
occuper, je vais concevoir ce moment. qui me tient à cœur. Et donc il me faut créer le dispositif
adapté. En fait, comme dans tout projet, il faut savoir vers quoi on veut aller, l'objectif, quels
sont les moyens dont on dispose pour réussir, ou comment les obtenir, quels sont les risques ou
les écueils à éviter, quel degré d'implication doit on y mettre.
Journal imbriqué : lundi 5 janvier 2015, 22h46, bureau, maison
J’ai laissé ma pancarte à vendre sur le portail du terrain. Et ça y est, j’ai trouvé un acheteur. Il
n’a même pas marchandé le prix. Il a la même passion que moi pour cet endroit. J’ai
l’impression de me voir il y a trois ans. J’ai besoin de sous. Rémi voudrait aller à la Sorbonne,
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 107 Janvier 2015
à Paris, l’an prochain. Il faut que j’aie le maximum de moyens pour qu’il puisse faire ses études
dans de bonnes conditions. Tant pis pour le terrain, j’en trouverai peut-être un autre encore plus
agréable et où je pourrai créer mon dispositif adapté plus facilement.
Page 365 :
« Mon œuvre d'éditeur n'est pas explicable, sans ce moment de la bibliothèque : c'est un produit
de ce moment.
Un moment produit de situations, et à plus ou moins long terme, de nouveaux moments. »
Mon moment études produira un moment. recherche d'une nouvelle vie, d'un nouveau métier...
Mardi 25 novembre 2014, 21h35, bureau, maison
Page 374 :
« Dans cette expérience, conçue par Georges, je découvris un intérêt pour l’organisation de
stages résidentiels, dans des lieux où tout est à organiser par soi-même. Si une rencontre de
groupe a lieu, là où gîte et du couvert sont prévus, le travail ne porte que sur un contenu
(intellectuel) et sur l’analyse des conflits à l’intérieur du groupe : par contre, une location de
murs où l’on s’occupe soi-même de la nourriture permet davantage de créativité groupale, de
capacité instituante.
[…] Le plus souvent, le village de vacances est une construction moderne (en béton), sans
aucune épaisseur culturelle. Par opposition, le Domaine aux loups, Le Meux, Ligoure étaient
des bâtisses anciennes, pleines de recoins… »
Le Domaine aux loups me fait penser à l'île d'Yeu et à l'Auberge du Loup blanc. Tout se met en
mouvement dans mon esprit, quand je pense à cet endroit, à ce concept : un minigolf, une
ludothèque, un salon de thé, une salle de contes, toute en bois, avec un poêle et des bougies,
quand c’est le soir, avec une fondue au chocolat. C’est mon rêve… entre autres… et c’est bien
ça mon problème, je voudrais faire trop de choses, incompatibles. Voyager, par exemple, ce
n’est pas compatible avec « gérer une Auberge du Loup blanc ».
Page 376 :
« Le socialisme utopique s’inscrit dans le continuum romantique qui, lui-même, est le
prolongement du Mouvement du Libre-Esprit. Le moment de Sainte-Gemme contient ces
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 108 Janvier 2015
brindilles. L’Université de Sainte-Gemme est un concept de la dimension communautaire de
mon établissement champenois.
L’analyse institutionnelle s’inscrit dans le continuum romantique. J’ai adhéré à ce mouvement
par transduction : j’y ai retrouvé un cadre pour faire vivre cet héritage du Libre-Esprit.»
Le libre-esprit... le libre pensé, le libre parlé, le libre-écrit.... je garde ce passage pour ma
recherche.
Page 380-381 :
« Se raconter au niveau des moments est un travail d’explicitation, moment de la conception.
[…] Le bilan de compétence n’est-il pas également un travail d’explicitation de l’implicite des
compétences non perçues, non conçues ? Parmi les dispositifs de clinique des moments : la
socianalyse, le bilan de compétence, l’histoire de vie, la recollection, qui font appel à un tiers. »
Le journal, outil sans appel direct à un tiers : cependant, dans la technique de Marc-Antoine
Julien, il y a une personne qui rencontre régulièrement le diariste, pour faire le point avec lui
sur ce qu’il produit ; la clinique, dans ce cas, serait toujours un travail de réflexion, s’appuyant
sur un tiers.
A garder pour ma recherche.
Page 384 :
« En cherchant Daniel Rops, je suis tombé sur Le travail en musique, Les progrès de la musique
fonctionnelle85 de W.L. Landowski : je dévore ce livre d’un trait. Au départ, je le trouve
loufoque, mais ensuite, je le prends très au sérieux. Je suis conduit à m’interroger sur ce que dit
cet auteur, et à me questionner sur ma propre histoire.
La thèse de Landowski : écouter de la musique lorsqu’on travaille augmente la productivité de
30%. Ce livre s’adresse aux chefs d’entreprise pour qu’ils diffusent de la musique dans leurs
ateliers. »
Pour la musicienne, travailleuse, que je suis, ce sujet m’intéresse et je l’étudierais bien un peu,
à voir plus tard.
Page 392 :
85 W.L. Landowski, Le travail en musique, Les progrès de la musique fonctionnelle, Paris, Plon, 1949, 80 pages.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 109 Janvier 2015
« Autre motivation. Dans le prolongement de ma lecture de Genèse et structure de la
phénoménologie de l’Esprit, je médite sur mon journal comme suite (dépassement) des
journaux de Paul et de Claire (mon grand-père, ma mère). […]
Pour le sujet, cette histoire ne commence pas avec lui. Ce qu’il expérimente lui-même, c’est ce
qu’il connaît, mais l’appropriation de la connaissance accumulée par l’humanité (avant, avec
lui), c’est le savoir : l’appropriation du savoir passe par une reconnaissance (parfois douloureuse)
des expériences antérieures de ses ascendants. La compréhension (froide) des expériences faites
par ses parents, ses grands-parents, etc. est un moyen d’analyse de la place que l’on occupe
dans le village historique. »
A garder pour ma recherche. J’aime beaucoup cette idée de « village historique », j’ai envie
d’ajouter de « famille historique ».
Page 397 :
« Eduard Spranger propose une typologie, concernant les six attitudes fondamentales de l’esprit
par rapport au monde : économique ou technologique, légal et politique, scientifique, artistique,
religieuse. La personne agence au niveau de la personnalité, ces six facteurs pour composer une
conscience singulière : la dominance de l’un ou l’autre des facteurs dans une personne
singulière86 donne six types de posture ou caractère. Eduard Spranger estime que ces six types
ont une valeur heuristique dans l’étude de la société. Puis-je voir dans ces six formes d’esprit
des moments ? Idée d’une dominante de tel ou tel moment, chez chaque personne particulière.
Dans ces caractères, l’expérience personnelle du sujet joue un rôle déterminant. L’élaboration
de la posture se fait par la construction de l’expérience. »
Cela me rappelle un cours de pseudo sociologie, dans la formation d'assistante de direction, que
j'ai suivi, en 1990. On avait un document qui détaillait des types de familles, avec des
illustrations. Ça m'avait fasciné, parce qu'au-delà du fait que je trouvais trop stricte ce
rangement des personnes en catégories, je me suis rendue compte que la réalité était vraiment
très proche. Je pense souvent à ce document. Je crois que je l'ai gardé dans le grenier chez mes
ex-beaux-parents. Ce serait bien que j'aille y faire un tour pour récupérer tous mes « trésors »
avant qu’ils ne disparaissent.
Page 398 :
86 Wilhelm Dilthey, an introduction, p. 50.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 110 Janvier 2015
« Pendant ce voyage, je vais me relire: je suis curieux de savoir ce que j’ai pu écrire sur Ernst
Bloch, que je commence à bien connaître depuis mon travail avec Sophie Amar. »
Hello Sophie ! C’est curieux sa présence dans ce journal et en même temps en tant que collègue
étudiante de Master 2. Nous sommes dans la même promo ! Du coup, je me sens toute petite,
et très respectueuse de ses commentaires et écrits sur les forums. Je sens vraiment l’héritage de
Remi Hess chez elle.
Page 400 : Au sujet de Sophie.
« En l’écoutant parler, dans mon cerveau, je revivais la conceptualisation d’E. Bloch :
1) Le génie a une conscience anticipante.
2) En lui, le travail d’incubation se développe dans l’extrême lenteur, attendant que les
conditions sociales environnantes soient favorables à une sortie de la torpeur.
3) Surgit l’inspiration : insight, illumination, éclaircissement ; l’émergence de la lumière
est la révélation que l’heure est venue d’entrer dans un autre moment.
4) La productivité : dès qu’il rencontre la lumière, le créateur sait qu’il doit produire ; il se
met au travail. Il se confronte au non encore conscient : il entre dans un combat, une lutte sans
repos jusqu’à la réalisation de l’œuvre. »
J’ai envie de faire le parallèle avec le Gustave de Jean-Paul dans la Loge invisible87 et son
enfance avec le génie. Ça correspond exactement à cette « période d'incubation. »
Je note d’étudier Ernst Bloch88. Le principe de l’espérance est disponible à la médiathèque de
Niort. Je note qu’il a inspiré Walter Benjamin, dont j’ai déjà commencé à étudier ses œuvres
pour ma recherche.
Je pense aussi et toujours à mon point d'équilibre, est-ce que ce pourrait être la rencontre avec
la lumière ? « L'heure est venue d’entrer dans un nouveau moment », est une expression
excellente… J’imagine une maîtresse d’école qui frappe dans ses mains en disant d’une voix
chantante : « Allez les enfants, c’est l’heure d’un nouveau moment.. » Bon, je crois, que ce
serait l’heure pour moi, à plus de minuit maintenant de changer de « moment. » et d’aller
dormir… Mais j’aimerais bien ne pas remettre à demain la lecture de ce livre.
87Jean Paul Richter, La Loge invisible, Paris : Corti, 1965 88 http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bloch
Bloch, Ernst, Le Principe espérance : Parties I, II, III, Publication : Gallimard
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 111 Janvier 2015
Page 404 :
Je disais à Gaby en sortant de la conférence que notre projet de travailler sur “l’Autre logique”
me semble plus éclairant pour comprendre en quoi PISA passe à côté du réel. […] Ce que les
psychologues ont construit pour les individus, les évaluateurs de PISA l’ont projeté dans le
social.
Je repense au concept de Jean-Marie Brohm, vu pages 33 et 35 du livre, au sujet de l’universel,
du particulier et du singulier. Je trouve ça vraiment dommage que toutes ces grandes études
passent « à côté du réel », que tout le monde le sache, et que personne ne fasse rien pour changer.
Mais ce cas est le même pour sûrement un bon nombre d’études de toute sorte. Il y a souvent
un décalage entre les chiffres et la réalité. Ça s’étudie, ça doit sûrement l’avoir déjà été… Je
garde quand même ce point dans ma rubrique « A voir plus tard ».
Page 405 :
« Avoir du tact, c’est intervenir comme il faut, quand il faut : la pertinence, l’opportunité sont
des éléments du tact, sorte de sensibilité clinique, qui permet d’aider l’enfant, le jeune,
l’étudiant, au moment où il en a besoin. L’an prochain, il y aura un grand colloque Herbart à
Karlsruhe. Gaby souhaiterait que je fasse une communication sur le tact pédagogique. Ce
colloque est organisé pour le second centenaire d’un ouvrage d’Herbart : Allgemeine Pädagogik
aus dem Jahre 1806. »
Je note de garder ce passage pour moi, « A voir plus tard ».
Journal imbriqué : mardi 6 janvier 2015, 13h56, pause déjeuner, bureau, travail
En fait, le lendemain, Remi Hess a publié un post sur le forum de son cours « Théories et
pratiques de l’intervention », dans lequel il pose les questions suivantes :
« Le tact, c'est un mot très fort.
Avoir du tact, c'est un art, peut-être le seul objet de l'éducation, non ?
Puis-je parler de tout avec tact ? »
Voici ma réponse.
Forum : Pour faire bref - Sujet : tact d'hier et d'aujourd'hui
Auteur : ANGELINE GLUARD - Posté le mercredi 26 novembre 2014 à 19:45
Bonsoir,
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 112 Janvier 2015
Je viens de recevoir un message de Nathalie, une ancienne étudiante de L3. Elle vient enfin
d'avoir un poste de remplaçante dans une classe de CE1/CE2 depuis 2 ans qu'elle attend !
Je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que j'étais contente pour elle et je lui souhaite
bon courage.
Elle vient de me répondre à l'instant et comme je suis touchée par sa réponse, je me dis que c'est
le bon moment pour venir ici parler de tact.
J'associe le tact avec la bienveillance.
Le tact permet de toucher l'autre en lui apportant quelque chose dont il a besoin, qu'il le sache
ou non.
Dire quelque chose avec tact, c'est dire la vérité, dire le positif, le dire avec congruence, et
toujours dans l'esprit d'humanité qui sert à faire grandir l'autre.
Est-ce que ça existe des cours de "tact" ? Des fois, j'en aurais bien besoin...
Enfin, je dis ça parce que j'ai dit des choses, que la personne en face n'attendait pas que je dise,
et qu'elle m'en veut toujours...
Mais peut-être qu'un jour elle reviendra vers moi en me disant "Merci"...
Pour éviter toute interprétation, cette personne n'est ni prof ni étudiant(e) à l'IED... ça c'est du
tact...
A plus tard,
Angéline
Page 408 :
« Quand j’habite un moment., je n’en vois pas forcément tous les éléments.
La conscience du moment. n’oblige pas à une conscience de tous ses éléments. Un moment est
une forme de présence de la conscience, qui occupe une forme qui absorbe ses éléments
constitutifs. »
Le moment. est pensé ici comme global, entier, sans les détails, les « éléments ». Je garde ce
passage pour ma recherche. Il me parait important, à développer pour la formation de soi par la
conscientisation des moments et ses différents éléments, les plus fins justement.
Page 413 :
« Mes premiers étudiants impliqués furent des garçons ; j'ai nommé Pierre, Augustin, Ahmed,
il y en avait d’autres.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 113 Janvier 2015
L’originalité de Kareen est de m’avoir écrit, deux mois après m’avoir rencontré : "Monsieur, je
veux être votre disciple. […] Pour qu’il y ait disciple, il faut qu’il y ait “maître”. Kareen m’a
construit comme maître : après elle, je ne pouvais plus nier mon existence de maître : le disciple
fait le maître. […] H. Lefebvre enseignait en même temps à 2000 étudiants ; très vite, j’ai eu
conscience que je n’étais pas 1 parmi 2000. J'ai su que ma relation à Henri n’était pas sociale,
mais intime : pas corporellement (je ne l'approchais pas), mais sur le plan des idées. »
Comment faire si l'on ne fait pas partie des gens qui sortent du lot, ou plutôt, si tout le monde
sort du lot, soit par sa posture de disciple ou de non-disciple justement ?
Autre réflexion sur la gestion des disciples : comment faire quand il y en a trop ?
Comment gérer les « jalousies », la disponibilité, le temps à accorder à chacun, comment
chacun peut avoir droit à un « moment. » ? Choisit-on ses disciples ?
Je ne peux pas m’empêcher de penser à Laurence Z, notre spécialiste du « moment. du vin ».
Elle nous a laissé, en plan, tous seuls, lors du premier regroupement de Master 1 alors qu’elle
était notre référente, juste pour ne pas rater son maître, Remi Hess, qui était en train de partir,
alors qu’elle avait encore quelque chose à lui demander. J’ai vraiment eu cette impression de
relation maître-disciple à cet instant.
Page 414 : Note 475
« La sociologie des organisations distingue les relations hiérarchiques (line), des relations de
conseil (staff). On trouve cette idée dès l'époque de Taylor, Fayol. Sur ce point, voir G.
Lapassade, Groupe, organisation, institution, 5° édition, Paris, Anthropos, 2006. »
J’ai lu ce livre en licence, mais je ne me souviens pas de ce concept de line et staff. A relire
donc, à voir plus tard, je pourrais en avoir besoin au travail.
Mercredi 26 novembre 2014, 01h16, bureau, maison, je ne suis toujours pas couchée…
Page 425 :
« Dans le choix de mes moments, et de leur conception pour moi, il y a nomination d’une manie :
plus j’explore mes fantaisies, plus je me réalise.
Fourrier pose le principe qu’en civilisation, les gens sont invités à se conformer à des modèles
standards : on ne les invite pas à l’individuation, bien au contraire ; par contre, en harmonie, je
puis dire mes derniers fantasmes : plus je les exprime, plus je trouve les partenaires dont j’ai
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 114 Janvier 2015
besoin pour les mettre en acte. Sur le plan de la recherche, plus je décris mes méthodes, mes
objets, mes intérêts de recherche, plus je vais pouvoir trouver les personnes avec qui chercher. »
C’est drôle de parler de manie, est en même temps, c’est vraiment ce qui se passe : un
débordement d’énergie, voire de folie, dans l’intensité que l’on peut donner à ses moments,
comme je fais là, ici, en pleine nuit, à fond dans ma lecture et mon écriture…
Je garde ce passage pour ma recherche.
Page 432 :
« Hier, j’ai découvert un passage de Novalis qui définit bien ce que j’ai voulu créer en instituant
le journal du Moment conçu : “ Intérieurement, on sait et on accomplit à proprement parler
toujours ce que l’on veut savoir et faire. Comprendre cette action se révèle infiniment difficile.
Une observation précise du premier moment de la velléité – qui est en somme le germe, nous
convaincra que se trouve déjà à l’intérieur tout ce qui, par la suite, va seulement se
développer89 ”.
“ La vie ne doit pas être un roman que l’on nous donne mais que nous faisons90 ”.
“ Tout doit devenir aliment. Art de tirer de la vie de toute chose. Le but de la vie est de tout
animer. Le plaisir est vie. Le déplaisir est un moyen en vue du plaisir, comme la mort un moyen
en vue de la vie91. ” »
Je note ce passage, dont la deuxième citation de Novalis est déjà dans mon mémoire… Je garde
le reste pour ma recherche.
89 Novalis, Le monde doit être romantisé, p. 74, § 191 ; voir aussi § 203. 90 Novalis, opus cit., p. 73, § 187. 91 Novalis, opus cit., p. 69, § 166.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 115 Janvier 2015
Petite conclusion, avant la suite…à l’attention de Remi Hess
Mardi 6 janvier 2014, 21h13, bureau, maison
Je viens de terminer la remise au propre de mes notes.
Je me souviens, qu’à la fin de la lecture de votre livre, dans la nuit du 26 novembre, j’étais
soulagée d’avoir réussi à terminer presque dans les temps que je m’étais fixés. J’avais juste
deux jours de retard…
J’éprouve un sentiment à peu près identique d’avoir relu et repris toutes ses informations qui
vont m’être précieuses, uniques et originales pour ma recherche.
Alors, je tiens à vous remercier, Professeur Remi Hess, pour m’avoir donné l’occasion de vous
lire aussi intensément, d’avoir voyagé avec vous au soleil d’Amérique du sud, aussi bien que
dans vos peintures.
Hier j’ai écrit à mon ami Gérard, le consultant, pour lui dire que je lisais votre livre au sujet de
la Théorie des moments et de la pensée du possible d’Henri Lefebvre. Il m’a répondu ceci :
« Oui, c’est très intéressant Henri Lefebvre. Les « moments » découpent le temps et donc la
vie. La mémoire des moments est structurante de la vision de l’existence… ».
Et pour finir sur un « moment » de saison, avec les bonnes résolutions de nouvelle année, je
voudrais vous faire partager mon dernier « toupet ». Les toupets que je provoque, ont
impressionné Bertrand Crépeau, lorsqu’il avait validé mon journal, pour les cours « Penser
l’institution » et « Journal de recherche » de Master 1.
J’ai écrit ce qui suit au réalisateur de films Patrice Leconte, le 1er janvier 2015 :
Bonjour Monsieur Patrice Leconte,
Je vous ai entendu aujourd’hui sur BFM TV et je vous ai écouté avec attention :
« Le jour où tous les gens qui peuplent cette planète auront simplement du respect pour autrui,
il n’y aura plus aucun dysfonctionnement.
Je veux bien et avec plaisir prendre cette résolution :
Respecter autrui du matin au soir, et même la nuit, mais j’aimerais bien ne pas être tout seul. »
Vous n’êtes pas tout seul !
Et je suis ravie, justement, d’avoir entendu vos mots, de ne plus être seule, contre ce combat
permanent qui est le mien, depuis des années, même s’il ne se situe qu’à un petit niveau.
Je voulais donc, par ce message, vous remercier.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 116 Janvier 2015
Je vous souhaite une très bonne année respectueuse…
Angéline Gluard
Hier, le 5 janvier 2015, il m’a répondu ceci avec en pièce jointe cette magnifique photo qui me
fait penser à un ange et qui était nommée « Belle année 2015 ».
Chère Angéline Gluard,
Très touché par votre email, que mon agent m'a fait suivre.
Puissions-nous être entendus par un maximum de terriens...
Belle et bonne année.
Je vous embrasse,
Patrice LECONTE
Bonne année 2015 à vous, Professeur Remi Hess, une année importante, puisqu’elle verra le
moment de la retraite se concrétiser et s’éclater comme des fusées de feux d’artifices, en une
multitude de nouveaux moments de joie de pouvoir faire ce qu’il vous plait…
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 117 Janvier 2015
A voir plus tard
Mercredi 26 novembre 2014, 17h15, voiture, en attendant Lucas au code, à l'auto-école
Depuis décembre 2013, je tiens une liste de tout ce qui m'intéresse mais que je ne peux pas
étudier tout de suite.
Alors si un jour je ne sais pas quoi faire, je viendrai piocher ici de la matière...
Les brindilles de cette liste sont pour moi comme les index des livres fait par Remi Hess.
Je m'aperçois, en reprenant ma liste dans ce journal, qu'elle devient de plus en plus longue.
Il va falloir que je réfléchisse à un classement, à ajouter au moins la date de l'entrée de la
brindille dans ma liste, ou autre chose.
Je me dis que je vais attendre un peu et quand cette liste dépassera dix pages, j'agirai.
****************
– Les temporalités, le cours de Licence 3 de Francis LESOURD
– Robert King Merton, sérendipité, déviance, anomie
– Georges Lapassade, Jacques Ardoino, entropie, anomie
– Comment mesurer l'implication ou l'énergie que déploient ceux qui ont le sens du
devoir ? (P'tit plus des professeurs)
– L'esprit de l'humanité... Est-ce que celui qui forme ou qui produit a conscience de ce
besoin d'.humanité nécessaire pour mener à bien son entreprise ? .Projet : Montrer,
former, ouvrir les yeux à cet esprit d'.humanité
– Etudier comment et pourquoi intervenir lorsque l'on rencontre une situation anormale,
autour de nous, dans la rue, au travail,… (exemple : la mère, son téléphone et son fils à
la gare de Niort à six heures du mat')
– Ecole des parents
– Revoir le contenu de la JDC Journée défense et citoyenneté
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F871.xhtml
– Étudier l'enthousiasme
– Étudier les bulles, se mettre dans sa bulle, bulle de bonheur, bulle de bien-être
– L'implication que l'on met dans tout ce que l'on fait
– Envisager des œuvres de création communes
– Médecine traditionnelle hindoue - soigner par la méditation sur les contes
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 118 Janvier 2015
– Jean Piaget, La représentation du monde chez l'enfant, ALCAN, PUF, 1926
– Dante et la Divine comédie
– Les Parques et les Tapis
– Comment aider les parents à lire ou dire les contes de fées ?
– Contes de fées turcs, histoire d'Iskander, voir Die Dedrohung, d'August Nitschke
– Contes de Basile
– Les contes de ma Mère l'Oye
– Djuna Barnes, romancière américaine (1892-1982)
– Marian Cox a recensé 345 versions du conte de Cendrillon
– Conte égyptien tiré de Contes populaires d'Afrique de René Basset, Paris : Guilmoto,
1903
– Erik H. Erickson, Identity of the Life Cycle, Psychological issues, NY, IUP, 1959
– Contes albanais d'Auguste Dozon
– Poésie et vérité de Goethe
– Wolff, philosophe allemand
– Fables de Phèdre et de Gellert
– Roman philosophique La Macarise de l'Abbé d'Aubignac
– Le Criticon de Baltasar Gracian
– Le point d'équilibre
– Pédagogie de l'imagination
– Etudier pourquoi les responsables politiques ou d'entreprises sont toujours frileux a la
nouveauté, au changement, aux idées qui touchent au bien-être, à la bienveillance
– Ecrire ce que je voudrais devenir dans un an, dans deux ans, dans dix ans, dans trente
ans
– Etudier plus sérieusement l’emploi du temps de Marc-Antoine Jullien et lire le livre de
Kareen Illiade, demander à ma sœur Alexandra si elle l’utilise pour ses cours, si oui
quoi et comment ?
– Les « criminels de paix », ça m’intrigue : Franco Basaglia (éd.), Les criminels de paix,
(1973), Paris PUF, 1976
– Etude à faire sur la censure et voir s’il y a un lien avec le mot « cendre »
– Henri Lefebvre, Le manifeste différentialiste, Paris : Gallimard, 1970
– Reprendre mes carnets de note d’interventions d’assistance informatique à domicile
pour en extraire une méthode de formation informatique utile, efficace, pour tous,
vraiment…
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 119 Janvier 2015
– La civilisation créatrice de formes, les formes, des moments particuliers seraient à
étudier dans l’Histoire, quelle est leur évolution, exemple de la politesse
– Créer une maison de retraite comme un centre de loisirs, avec le concept « d’ancrage
au village », terme employé par Remi Hess
– Etudier le phénomène de deuxième apprentissage pour une personne ayant perdu la
mémoire, suite à un traumatisme
– Lire du Merleau-Ponty
– Concevoir une activité de découverte d’un auteur ou d’un compositeur ou d’un
peintre, au même âge que celui que l’on a à ce moment
– Pourquoi les grandes études « PISA » ou autres avec données chiffrées passent « à
côté du réel » ? Pourquoi un décalage entre les chiffres et la réalité ?
– Concepts de line et staff, G. Lapassade, Groupe, organisation, institution, 5° édition,
Paris, Anthropos, 2006
– Tact pédagogique – Tact, autorité, expérience et sympathie en pédagogie, Johann
Friedrich Herbart, édité par Johan Tilmant, préface de Gabriele Weigand, Paris :
Economica, Anthropos, 2007
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 120 Janvier 2015
Ça peut servir
Dimanche 29 décembre 2013, 16h16, bureau maison
Le « ça peut servir » est la boite, dans l'entrée d'une maison, sur un plan de travail de cuisine,
sur un bureau qui contient ce que j'appelle les « rinchinchins », les petits objets qui traînent, un
bouton à recoudre, un bout de gomme, des pièces de monnaie, un jeton de chariot, un trombone,
une punaise, un vieux bon d'achat pour un truc super important, mais qui est sûrement déjà
périmé depuis très longtemps,... Et dans cette boite, je vais y mettre ce que j'ai trouvé depuis le
début de l'écriture de ce journal et qui mérite d'être gardé, au cas où j'en aie besoin un jour ou
l'autre. Je regarde « rinchinchin » sur Google, et je m'aperçois, qu'il existe une
définition : » mauvais joueur de violon qui va faire danser dans les villages »... rien à voir avec
ma définition, tant pis, je garde mon mot quand même ! Et je note donc mon premier
« rinchinchin », les références de ce dictionnaire rouchi-français (rouchi est le patois de
Valenciennes), peut-être que dans un dictionnaire de patois charentais, la définition d'un
« rinchinchin » serait plus proche de la mienne.
Mercredi 26 novembre 2014, 17h30, voiture, en attendant Lucas au code, à l'auto-école
Les brindilles de cette liste sont pour moi comme les chutes de photos ou de toiles cutterisées
que Remi Hess conservait dans son carnet Dalien n° 3 ou les enveloppes classées dans la caisse
réservée.
****************
– Gabriel Antoine, Joseph Hecart, Joseph Ransart, Dictionnaire rouchi-français,
Valenciennes : Lemaître, 1834
– Trouver un dictionnaire de patois charentais
– Au restaurant « Le Resto », le 6 novembre, ils nous ont servi en amuse-bouche un
velouté au Combava : crème du Barry au chou-fleur. Fabuleux !
– Claude me propose un livre le 6 novembre : Hell's Angels de Hunther S. Thompson
(Folio). C'est une des premières enquêtes où l'auteur a vécu avec les protagonistes.
– Xénophon : http://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nophon
– Asynchronie
– Adorno
– Habermas
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 121 Janvier 2015
– Livre de Claude Fleury, Catéchisme historique: contenant en abrégé L'Histoire sainte
et La Doctrine
Catéchisme historique..., de Claude Fleury : http://www.google.fr/books?id=_vI-
AAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=one
page&q&f=false
– Techniques des différents types d'entretiens, cours de Martine Morisse
– Jean-Pierre Le Goff, Le mythe de l’entreprise, La Découverte/essais, Paris, 1992
– H. Lefebvre, Nietzsche, Editions sociales internationales, Paris, 1939 (réédité en 2003
chez Syllepse, Paris)
– Gilles Deleuze, Instincts et institutions, Paris : Hachette, 1953, ouvrage disponible à
l’ESPE de Niort.
– Théorie des catastrophes :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_catastrophes
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 122 Janvier 2015
À garder, à étudier, à creuser pour ma recherche et le mémoire de Master 2
Sujet
Les Romantiques d’Iéna (Schlegel, Novalis)
La symphilosophie... Est-ce que le travail en équipe permet la formation de soi, l'esprit
d'humanité ?
Ecrire ce que je voudrais devenir dans un an, dans deux ans, dans dix, dans trente ans
Le « devenir », l’ « advenir »
Terme Aufhebung : se dépasser pour s’élever
“C’est un devoir de faire profiter les autres de sa propre expérience”, George Sand,
L’histoire de ma vie.
Mythe de Prométhée.
Gusdorf, sur le Romantisme
Monsù Desiderio
Georges Labica : métaphilosophie, éclatement de la philosophie chez Lefebvre =
construction d'une nouvelle unité philosophique
Romantiques d’Iéna, les animateurs de la revue Athénaum (1799-1802).
Bibliographie
Ardoino et de Peretti, Penser l’hétérogène, Bruxelles : Desclée de Brouwer, 1998
Raymond Bayer, L’esthétique de la grâce, Paris : Alcan, 1934
Raymond Bayer, Essais sur la méthode en esthétique, Paris : Flammarion, 1953
Raymond Bayer, Traité d’esthétique, Paris : Armand Colin, 1956
Raymond Bayer, Histoire de l’esthétique, Paris : Armand Colin, 1961
Raymond Bayer, Esthétique mondiale du XXème siècle, Paris : PUF, 1961
Ernst Bloch, Le Principe espérance : Parties I, II, III, Paris : Gallimard, 1976
Jean-Marie Brohm, Au sujet d'une sainte trinité dialectique : l'universel, le particulier,
le singulier, in Les IrrAIductibles, revue interculturelle et planétaire d’analyse
institutionnelle n°1, juin-juillet 2002
Gilbert Delahaye, Marcel Marlier, Martine, Bruxelles : Casterman, 1954 (pour le n° 1)
Christine Delory-Momberger, Remi Hess, Le sens de l’histoire. Moments d’une
biographie, Paris : Anthropos, 2001
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 123 Janvier 2015
Wilhelm Dilthey, Introduction à l’étude des sciences humaines : essai sur le
fondement qu'on pourrait donner à l’étude de la société et de l'histoire, Paris : PUF,
1942, p. 50. Six attitudes fondamentales, six types de posture
Hegel, Science de la logique, Traduction par S. Jankélévitch, Paris : Aubier, 1947-
1949
Georges Jamati, La conquête de soi, méditations sur l’art, préface de Ferdinand Dauphin,
Paris : Flammarion, 1961
Marc-Antoine Jullien, Essai sur l'emploi du temps ou méthode qui a pour objet de bien
régler l'emploi du temps, premier moyen d'être heureux, destinée spécialement à l'usage
des jeunes gens de 15 à 25 ans, Paris : Didot, 1810 (seconde édition)
Georges Lapassade, L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement de l’homme, Paris :
Anthropos, (1963), 1997
Henri Lefebvre, Nietzsche, Paris : Editions sociales internationales, 1939, réédité en
2003 chez Syllepse, Paris
Henri Lefebvre, La fin de l’histoire, Paris : Anthropos, 2° éd., 2001
Henri Lefebvre, Hegel, Marx, Nietzsche ou le Royaume des ombres, Paris : Casterman,
1975
Henri Lefebvre, L’Introduction à la Critique de la vie quotidienne, Paris : Grasset, 1946,
2e édition précédée d'un avant-propos, Paris : L'Arche, 1958
Henri Lefebvre, Les fondements d’une sociologie de la quotidienneté, Paris : L’Arche,
1961
Henri Lefebvre, Qu'est-ce que penser ?, Paris : Publisad, 1985
Henri Lefebvre, La Somme et le reste, (autobiographie), 4° éd. Paris : Anthropos,
2009.
Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne (3 tomes), Paris : L’Arche, 1947 (deu-
xième édition 1958) ; 1962 ; 1981.
Henri Lefebvre, La présence et l’absence, contribution à la théorie des représenta-
tions, Tournai : Casterman, 1980.
Henri Lefebvre, Introduction à la modernité. Préludes, Paris : Editions de Minuit,
1962, 12ème prélude
K. Marx, F. Engels, L'idéologie allemande, Paris : Edition sociales, 1968, à propos de
Hegel, de la Bildung
Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Paris : Nagel, 1966.
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 124 Janvier 2015
Kurt Meyer, Henri Lefebvre Ein Romantischer Revolutionnär, Wien : Europaverlag,
1973
Robert Musil, L’homme sans qualités. Plusieurs tomes, Paris : Editions du Seuil, 1973
F. Nietzsche, Le Gai savoir, fragment 338, cité par Lefebvre.
Novalis, Œuvres complètes. 2, Les fragments, Paris : Gallimard, 1975
Jean Paul Richter, La Loge invisible, Paris : Corti, 1965
Carl Rogers, Le développement de la personne, Paris : Dunod, 1968
Bernard Sobel, Un art légitime, Actes Sud, Le temps du théâtre, conçu et réalisé par
Sylviane Gresh, 1993.
Webographie
Schleiermacher : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-
buisson/document.php?id=3596
Didier Moreau, article sur Les écrits pédagogiques de Schleiermacher :
https://hal.archives-
ouvertes.fr/file/index/docid/807343/filename/Comprendre_pour_A_duquer_les_aphori
smes_pA_dagogiques_de_Schleiermacher.pdf
Patrick Marcolini, article L’Internationale situationniste et la querelle du romantisme
révolutionnaire, écrit en 2007 par: http://noesis.revues.org/723
Ecrire et Indexicaliser : John Locke, Traité sur l'Entendement humain, (volume 3,
Londres, 1714)
http://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Locke_-
_Essai_sur_l%E2%80%99entendement_humain.djvu
Hegel, concept de moment, plusieurs significations,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
René Lourau. Henri Lefebvre, Position : contre les technocrates, Paris, Éditions
Gonthier, 1967, L'Homme et la société, 1967, vol. 4, n° 1, pp. 251-255
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/homso_0018-
4306_1967_num_4_1_1044
Les Myrmidons : http://www.cnrtl.fr/lexicographie/myrmidon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myrmidons
Les Métamorphoses d’Ovide : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/META/00.htm
La dialectique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dialectique
Marc-Antoine Jullien, Essai sur l'emploi du temps… :
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 125 Janvier 2015
http://books.google.fr/books?id=Md8UAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Essai sur le goût ; précédé de Éloge de la sincérité, Montesquieu, Paris : A. Colin,
1993 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k272923/f11.image
Discours de Jean Jaures : http://fr.wikiquote.org/wiki/Jean_Jaur%C3%A8s
Jean-Jacques Rousseau- Collection complète des œuvres t4, contenant les IV premiers
Livres d’Emile, ou de l’Education, Genève, 1782 :
http://fr.wikisource.org/wiki/Page:Rousseau_-
_Collection_compl%C3%A8te_des_%C5%93uvres_t4.djvu/386
Nietzsche – Le philosophe de l’anticonformisme, Juin - Juill. 2013
http://boutique.lepoint.fr/produit/483/nietzsche-%E2%80%93-le-philosophe-de-
l%E2%80%99anticonformisme
Soutenance de ma note d’investigation de Master 1
https://www.academia.edu/9783800/Soutenance_Master_1
Les mariées célibataires Kimiko Yoshida
http://www.aucube.fr/index.php?/projects/kimiko-yoshida/
Gavarini Laurence, L'institution des sujets, L'Homme et la société 1/ 2003 (n° 147),
p. 71-93
www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2003-1-page-71.htm
La fée Mélusine : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lusine_%28f%C3%A9e%29
Théorie des catastrophes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_catastrophes
Perlaboration : http://fr.wikipedia.org/wiki/Perlaboration
Article sur Herbart
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/herbartf.pdf
Rimbaud : Je est un autre
http://www.philophil.com/dissertation/autrui/Je_est_un_autre.htm
http://fr.wikisource.org/wiki/Lettre_de_Rimbaud_%C3%A0_Paul_Demeny_-
_15_mai_1871
Frédéric Amiel : http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Amiel
Le sens de l’histoire : http://www.decitre.fr/livres/le-sens-de-l-histoire-
9782717842951.html?v=2
Blog « Les analyseurs » : http://lesanalyseurs.over-blog.org/categorie-10781361.html
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 126 Janvier 2015
Radio libertaire, émission Zones d’attraction : http://media.radio-
libertaire.org/index.html
Photos de Gaël, Gaël Chauve : www.gaelchauve.com
Constantin Brancusi :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i
Publicité Bébé président Nestlé : http://www.ina.fr/video/PUB3784055116
Web Gallery of Art : photos aux bonnes couleurs de la plupart des tableaux
http://www.wga.hu/index1.html
Heinrich Heine : http://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
Ernst Bloch : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bloch
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 127 Janvier 2015
Index
Advenir, 3, 14, 15, 84, 126
Apprendre, apprentissage, 10, 14, 19, 24,
30, 31, 43, 54, 73, 75, 76, 106, 123
Autonomie, 9, 14, 22, 76
Avenir, 10, 11, 12, 76, 77, 92
Bienveillance, 40
Changement, 7, 28, 42, 47, 82, 91, 101,
102, 122
Construction de soi, 8, 9, 18, 34, 52, 58,
64, 83, 91, 96, 107, 114, 116
Créer, création, créativité, 6, 7, 12, 13, 37,
38, 40, 54, 56, 58, 59, 106, 109, 110,
113, 121
Curiosité, 19, 20
Devenir, 8, 15, 16, 21, 24, 42, 43, 44, 49,
56, 92, 117, 122, 126
Dialectique, 10, 15, 24, 25, 26, 48, 108,
126, 128
Dissociation, 7, 63, 65, 69, 98
Ecrire, écriture, 3, 7, 8, 9, 11, 18, 22, 23,
30, 31, 33, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 54,
55, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69,
70, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 100, 103, 104, 105, 107,
108, 111, 113, 116, 117, 118,122,
124, 126, 128
Effet spirale, 21, 22, 61, 84
Effort, 7, 8, 12, 104
Emancipation, 40
Equilibre, 6, 27, 50, 57, 91, 122
Esprit d'humanité, 3, 17, 21, 22, 35, 36, 43,
45, 47, 60, 65, 76, 78, 98, 115, 121,
126, 128
Esthétique, 22, 39, 47, 57, 71, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 126
Ethique, 47, 53
Formation de soi, 7, 17, 31, 48, 51, 98,
115, 126
Implication, 3, 68, 78, 89, 110, 121
Inachèvement, 9, 60, 71, 74, 96, 103, 107,
127
Inspiration, 22, 36, 56, 87
La Nature, 24, 43, 45, 47, 50, 68, 74, 88,
95, 96, 98, 109
Le bon moment, 27, 28, 29, 36, 37, 48, 49,
78, 115
Liberté, 20, 24, 40, 45, 50, 58, 76
Lucidité, 34, 44, 55, 83
Moment d’accomplissement, 17
Moment de la justice, 43
Moment de la mort, 69, 95
Moment de la musique, 14, 17, 48, 100,
104, 106, 112
Moment de la peinture, 56, 57, 70, 77, 78,
90, 92, 93, 94, 96, 103, 104, 106, 107
Moment de l'ébullition, 3, 21, 55, 62
Moment de solitude, 60
Moment du désir, 23
Moment du jeu, 41, 42, 58, 59
Moment du repos, 21, 42, 43, 113
Moment du thé, 46
Moment intense, 17, 22
Moment pour moi, 14
Moments d'assistance informatique, 70
Moments de vie, 64
Moments interdits, 69
Observer ses moments, 9, 12
Opportunité, 27, 109, 114
Ouvrir les yeux, 28, 121
Partage, 17, 19, 35, 36, 44, 48, 60, 77, 88,
97, 118
Particulier, 25
Journal de recherche - Théorie des moments et construction de la personne IED – SDE – M2
Angéline GLUARD 128 Janvier 2015
Pensée du possible, 1, 3, 6, 7, 8, 14, 16, 19,
27, 28, 31, 37, 51, 56, 57, 58, 60, 65,
70, 87, 108, 118
Point d’équilibre, 7, 26, 27, 91, 100, 102,
113
Pour ma recherche, 2, 8, 16, 22, 26, 30, 31,
33, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48,
49, 51, 52, 53, 58, 60, 61, 65, 66, 67,
71, 73, 79, 82, 84, 85, 87, 96, 97, 98,
99, 101, 102, 103, 108, 111, 112,
113, 115, 117, 118, 126
Prise de conscience, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 21, 22, 26, 29, 30, 45, 48, 49, 52,
59, 62, 65, 66, 68, 87, 94, 95, 103,
112, 113, 115, 116, 121
P'tit plus, 121
Quotidien, 8, 13, 32, 38, 39, 45, 46, 47, 49,
50, 52, 55, 58, 85, 86
Réussite, 23, 29, 56, 67, 77, 88, 109
Romantisme, 3, 5, 8, 31, 33, 44, 66, 67, 71,
97, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
111, 128
Romantisme révolutionnaire, 33, 97, 128
Sagesse, 28, 55
Se dépasser, 19, 22, 42, 46, 54, 55, 56, 59,
75, 92, 126
Se mobiliser, 11
Sincérité, 18, 20, 21, 76, 129
Singulier, 25
Tact, 27, 73, 114, 115, 123
Transduction, 3, 45, 63, 64, 88, 100, 111
Transverse, 93
Universel, 25
Vérité, 18, 19, 20, 21