Jouin Jeanne. Le costume de la femme israélite, au Maroc. Journal de la Société des...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Jouin Jeanne. Le costume de la femme israélite, au Maroc. Journal de la Société des...
Jeanne Jouin
Le costume de la femme israélite, au MarocIn: Journal de la Société des Africanistes. 1936, tome 6 fascicule 2. pp. 167-186.
Citer ce document / Cite this document :
Jouin Jeanne. Le costume de la femme israélite, au Maroc. In: Journal de la Société des Africanistes. 1936, tome 6 fascicule 2.pp. 167-186.
doi : 10.3406/jafr.1936.1608
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jafr_0037-9166_1936_num_6_2_1608
LE COSTUME DE LA FEMME ISRAÉLITE AU MAROC,
PAR j Jeanne JOUIN. j
i {Planches XXVI à XXVIII.)
A. — LE COSTUME CITADIN
Vêtement. — Les jeunes filles et jeunes femmes s'habillent à l'européenne ; elles portent des toilettes achetées en confection dans les magasins de la ville française ou façonnées par les petites couturières du Mellah * d'après quelques gravures parisiennes, plus ou moins heureusement copiées ; les tissus brillants et les tons vifs sont les préférés.
Les personnes d'âge mûr et les vieilles femmes sont vêtues d'une banale camisole à manches longues et étroites, boutonnée à l'avant et appelée bala 2; d'une ample jupe, say a 3, froncée ou plissée sur une étroite ceinture et fendue de chaque côté, sur la hanche, comme les anciens cotillons de nos paysannes ; pour la rue, un moelleux châle de laine ou de soie, San 4 ou panuelo 5, jeté sur les épaules complète l'ajustement. A Sefrou, le bâta est souvent remplacé par une sorte de soutane écourtée, noss-qaftàn 6 ou 'ajami, recouverte d'une blouse transparente farajiya. Cette mise était la tenue ordinaire des Juives citadines vers la fin du siècle dernier comme en témoignent les photographies de l'époque 7. Sur ces documents les fillettes Israélites sont habillées, comme
1. Quartier juif au Maroc. 2. Mot arabe, plur. balat. (Cf. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes. Paris,
1927). 3. Mot espagnol : jupe de femme, dérivé du latin sagum, quia aussi donné saye. 4. Altération de châle. 5. Mot espagnol signifiant foulard, plur. say at. 6. Liti. moitié deqaftan. Le qaftan est la robe des citadins musukmans (hommes
et femmes) ; il est recouvert d'une tunique légère, généralement de mousseline transparente, que les hommes appellent farajiya et les femmes mansuriya ou dfina.
'Ajami (Ar.) a le sens d'étranger, non arabe. 7. Voir entre autres la photographie illustrant l'article sur Fès dans The Jewish
Encyclopedia. New-York, Londres.
168 SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES
les petites musulmanes de ce temps et d'aujourd'hui, d'un long qaftan et d'une tunique de mousseline serrée à la taille par une ceinture.
Le costume traditionnel, celui que décrivent ou représentent les voyageurs anciens. Hôst, Lemprière, Godard, Delacroix, Amicis, Rey, Lenz, s'est conservé dans la toilette d'apparat, le ksivat el kebira (grand costume) .
Voici reproduites (Planche XXVI, fig. 3 et 4) les illustrations de Hôst et de Lenz, et ci-dessous une traduction de la description du médecin anglais Lemprière * : « Le costume de la femme juive se compose d'une chemise de fine toile à manches larges et flottantes qui tombent presque jusqu'au sol ; sur la chemise on porte un qaftan, ample vêtement de laine ou de velours de couleur variée qui arrive aux hanches et couvre tout le buste à l'exception du cou et de la poitrine ; les bords du qaftan sont brodés d'or. On met ensuite le geraldito ou jupon de fin tissu de ' laine vert, dont les bords et la pointe sont parfois brodés d'or. Ces vêtements sont maintenus à la taille par une large ceinture de soie et d'or dont les bouts pendent en arrière ; quand les Juives sortent, elles se couvrent d'un haïk ».
Examinons maintenant en détail le ksivat el kebira dans lequel nous allons retrouver toutes les pièces énumérées par Lemprière ; il comprend :
1° Un corselet à manches courtes, très largement échancré sur la poitrine et agrafé au-dessous des seins au moyen de boutons en filigrane d'argent et de boutonnières en passementerie d'or. Ce vêtement (le qaftan de Lemprière) s'appelle gonbaïz [qasot2 à Tétouan). (Planche XXVI, fig. 1 et 2.)
2° Un plastron destiné à remplir l'échancrure du corselet. Ce plastron est indépendant et se fixe au moyen de lacets que l'on noue dans le dos; il se nomme punta 3 à Tétouan, péto 4 à Tanger, ktcf à Rabat, Salé et Mogador, ujha 5 à Fès, Meknès et Sefrou.
1. Hôst (G.). Nachrichten von Marokosund . . . in den Jahren 1760 bis 1768. Kopenhagen, 1781.
Lenz (Dr Oskar). Timbouctou. Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, trad, de l'allemand par Pierre Lehautcourt.
Lemprière (Dr William). A tour from Gibraltar to... Marocco. London 1791, p. 194- 195. Lemprière nous montre les musulmans vêtus : « au-dessus de la chemise d'un caftan semblable à une ample robe de chambre, sans manches, tombant presque jusqu'aux pieds et fait de soie, de coton ou d'un tissu laine or... », p. 386,
2. Plur. gonâbez de l'espagnol gambax qui désignait une tunique que l'on portait sous le haubert.
A rapprocher du terme syrien qombàz encore usité de nos jours et qui désigne une sorte de longue redingote retenue à la taille par une ceinture. Voir Dozy, Dictionnaire détaillé des noms de vêtements chez les Arabes.
Qasot de caçote, en portugais : veste militaire. 3. En espagnol : poitrine. 4. En espagnol : plastron. 5. Ktef et ujha sont des mots arabes ; le premier signifie épaule ; le second face.
LE COSTUME DE LA FEMME ISRAÉLITE AU MAROC 169
3° De larges manches de mousseline kmam * [mangos à Tétouan). Dans les villes de la côte, ce sont des manches cloches, formées de six ou huit panneaux évasés réunis par un galon d'or ; elles sont volumineuses, toujours indépendantes, se coulissent au-dessus de l'épaule et se portent retournées et attachées dans le dos avec des épingles. Dans les villes de l'intérieur, ce sont des manches droites ou à pointe (droit fil sur l'épaule, biaisées sous l'emmanchure) ; elles sont tantôt indépendantes et tantôt appartiennent à une chemisette de calicot ; elles se portent retroussées en bouffant sous le mancheron du gonbaïz.
4° Une ample jupe jeltèta [jialdeta^ à Tétouan) entièrement ouverte devant et que l'on ajuste en rabattant un des côtés sur l'autre (ce qu'en terme de couture on appelle une jupe portefeuille). La. jeltèta ou jialdeta mesure dans le bas plus de trois mètres de tour ; elle n'est pas froncée comme la saya ; l'ampleur de la partie inférieure est acquise au moyen de trois pointes, herat (une derrière et une de chaque côté) et de coutures biaisées sur la hanche. Depuis une trentaine d'années la jelit a à Fes, Meknès et Sefrou est remplacée par une saya.
5° Une ceinture-écharpe de soie lamée d'or dénommée hezàm dans les villes du littoral et kušaka à Fes, Meknès et Sefrou. Cette ceinture fait deux fois le tour du corps et se porte pliée en trois dans le sens de la largeur ; beaucoup sont terminées par des cordonnets de soie à glands d'or.
La veste; la jupe et le plastron sont de velours vert ou rouge (généralement vert dans l'intérieur, rouge sur la côte et à Marrakech). Une somptueuse ornementation de galons et de broderies d'or rehausse encore l'éclat du tissu. La disposition générale du décor est depuis longtemps fixée par la tradition (comparer le dessin de Hôst à la récente photo, PI. XXVI, fig. 2) et la fantaisie de la brodeuse ne peut s'exercer que dans les détails. Souvent une étoile à cinq rayons, figuration très stylisée de la main porte-bonheur, brille de chaque côté de la jupe au niveau de la hanche et une colombe, emblème de félicité, se distingue parmi les arabesques qui ornent le corsage ou le plastron. Les costumes de Tétouans sont les plus beaux, car ils comportent moins de galons et davantage de broderies. De l'avis général la Juive représentée par Lenz était originaire de cette ville, car seule les Juives tétouanaises ont été et sont encore capables de broder aussi magnifiquement l'angle de
1 . De l'espagnol mangas, manches. 2. Lemprière (v. ci-dessus) note geraldilo, Godard [Notes d'un voyageur. Alger.
1864, p. 42) giraldeta ; ce dernier mot semble bien l'appellation originale (tirée d'une racine latine girare) avec signification de « jupe tournante, que l'on fait tourner», ce qui s'accorde avec sa forme. A rapprocher de giralda, tour-minaret de l'ancienne mosquée de Seville et de giraldete (esp. rochet sans manches, vêtement ecclésiastique).
170 SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES
leur jialde ta. Un costume complet de ce style vaudrait aujourd'hui quatre mille francs, un costume orné de galons quinze, cents francs.
Jadis, lorsqu'une jeune Israélite se mariait, elle recevait en dot, de son père, « un grand costume » qu'elle étrennait le jour de ses noces et conservait toute sa vie pour les grandes occasions (mariage, circoncisions, etc.). Dans les circonstances moins solennelles (jours fériés, réceptions familiales etc..) elle portait une toilette de même coupe, mais en drap sombre et généralement ornée d'appliques de soie rouge.
Aujourd'hui l'épousée duMellah, sauf de très rares exceptions, se contente du costume d'apparat de sa mère, ou, s'il est trop usagé, de vêtements d'emprunt. Demain vous la verrez dans la robe blanche des mariées d'Europe ; le ksivat el kébira ne sera plus qu'un souvenir.
On ne pourra que regretter la disparition de ces somptueux vêtements de velours et d'or qui ont pu faire comparer les Juives marocaines à « autant de princesses d'Asie » l. Leur origine est certes lointaine et, sans tomber dans l'exagération de Rey 2, qui veut les rattacher aux premiers temps de la société hébraïque, nous pouvons, je crois, les considérer comme un héritage de la Castille apporté par les exilées de 1492.
Les Juives des villes marocaines, avec leur costume traditionnel particulier sans rapport avec celui des femmes indigènes, font exception dans le monde Israélite. En règle générale, les filles d'Israël suivent les modes en cours parmi les classes supérieures de leur pays d'adoption. A Alger et à Tunis, avant de s'habiller comme les Françaises, les Juives s'habillaient comme les riches musulmanes, avec quelques lustres de retard sur la fantaisie du jour.
Une grande fierté de leur origine espagnole (ou prétendue telle) 3, la réclusion forcée dans un quartier spécial, véritable cité à part de la cité musulmane : telles sont sans doute les raisons qui ont conduit nos Israélites marocaines à perpétuer les vêtements de leur aïeules andalouses ou castillanes.
Coiffure. — Une vieille coutume juive dont il est maintes fois question dans le Talmud interdit à la femme mariée de laisser voir sa chevelure. Libre à la jeune fille de se parer comme il lui plaît de ses boucles ou de ses longues nattes, mais l'honnête épouse est tenue de se couvrir la tête, de façon à dissimuler jusqu'à la racine de ses cheveux.
1. Amícis (E. de). Le Maroc, trad, de l'italien par IL Belle. Paris, 1882, p. 275. 2. Iîey. Souvenirs ďun voyage au Maroc. Paris, 1845, p. 86. 3. Au Maroc, dans les villes, tous les Juifs se réclament d'un ancêtre espagnol,
dont beaucoup prétendent savoir encore le nom ainsi que celui de l'endroit qu'il habitait dans la péninsule. Dans bien des cas la généalogie est inventée. Il y avait de nombreux Juifs à Fès et à Marrakech avant l'édit de Ferdinand et d'Isabelle.
Fig. 20. — Coiffures de Juives marocaines. 1. swâlef(Fès, Meknès, Séfrou); 2. riyeš denna'am (Taroudant) ; 3. mahdur (Tiznit, Talaint) ; 4. swâlef (Rabat, Tétouan).
172 SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES
Dans les villes marocaines, la nouvelle génération ne tient plus aucun compte de l'antique ordonnance ; les jeunes femmes ne se distinguent pas de leurs sœurs non encore mariées ; toutes se promènent tête nue dans les rues du Mellah et, pour les grandes sorties, se coiffent d'un chapeau. Les personnes d'âge moyen transigent avec le vieux précepte ; elles ont bien la tête couverte d'un fichu, en toutes circonstances, mais ne se font point scrupule de laisser paraître la naissance de leurs bandeaux lustrés. Leur fichu, sebniya, est un carré de soie, avec ou sans franges, venu en droite ligne de nos fabriques de Lyon. Il est plié en diagonale, la pointe tombe sur le dos, les extrémités se croisent sur la nuque et viennent former à l'avant, légèrement de côté, un nœud discret. Seules les vieilles femmes se conforment encore strictement à l'observance talmudique. La plupart portent un sebniya plié et noué de la façon que nous venons de décrire, mais disposé très bas sur le front, de manière à barrer hermétiquement le passage aux cheveux ; les autres s'enveloppent la tête d'une écharpe, festûl, retenue par un sebniya plié en bandeau.- Le festul est en soie unie, généralement rouge, lisérée d'or ; il mesure 0 m, 50 de large environ, sa longueur varie entre 1 m. 50 et 3 m. 50 ; les anciens spécimens sont ornés aux deux extrémités d'une haute bande tissée d'un fil d'or pur ; ces précieuses parties font souvent défaut dans les modèles récents ou bien sont remplacées par une bande de soie jaune. Le festul s'attache sur la nuque au moyen d'épingles ou de cordonnets ; ses pans flottent sur le dos ; s'ils dépassent de beaucoup la taille, on les glisse sous la ceinture. Lorsque l'écharpe n'a pas de bandes décoratives, ses deux extrémités sont réunies par une couture. Le festul * est ancien ; nous le reconnaissons facilement dans le dessin de Hôst et dans la description de Lemprière : « Les femmes mariées se couvrent la tête d'un fichu de soie rouge noué à l'arrière et retenu par un ruban de soie dont les extrémités pendent sur le dos ».
Autrefois, si nous en croyons Lenz, les Juives marocaines, non contentes de dissimuler leur chevelure, portaient tête rase à partir du jour de leur mariage. Cette pratique était aussi en usage dans les ghettos de l'Europe centrale et d'Orient.
Pour remédier à la sévérité du précepte talmudique qui prive le visage de la femme de sa parure naturelle, les rabbins, tout au moins à partir du xvie siècle, autorisent le port d'une chevelure artificielle, à condition toutefois que la perruque soit en partie couverte d'un fichu et qu'elle
i. Ce mot figure dans le dictionnaire de Pedro de Alcala avec le sens de voile ou coiffe de femme (v. Dozy, Diet, des noms de vêtements chez les Arabes). Le festul doit être rapproché des anciennes écharpes de tête des musulmanes marocaines uqaya, êerbiya et únšembar, en usage encore de nos jours en Orient. Uuqaya est noir à bandes terminales or, le šerbiya rouge à bandes or, le šembar noir à bandes rouges.
■ LE COSTUME DE LA FEMME ISRAÉLITE AU MAROC 173
n'utilise pas le cheveu humain. Aussi, dans les temps modernes et spécialement pendant les xviu9 et xixe siècles, porter perruque est coutume courante parmi les matrones israélites. La nature des simili-cheveux varie suivant les contrées ; on trouve du crin en Allemagne, des bandeaux de satin marron en Pologne et en Hongrie, des brins de ficelle noire en Russie, des frisettes de plumes d'autruche en Syrie, etc..
En Tunisie vers 1880 les rabbins, conciliants, toléraient les cheveux naturels et les Juives se fournissaient de postiches chez les perruquiers de Paris ou de Marseille '. En Algérie, il ne semble pas que les faux- cheveux aient eu grand succès. En tout cas, les nombreux portraits d'Israélites algéroises exécutés à l'époque de l'occupation française n'en portent pas trace ; sous le haut cylindre d'argent, la sarma, un simple serre-tête de soie noire bande le front. Par contre, le Maroc peut être considéré comme le pays essentiel des Juives à perruque. Jusqu'au début de ce siècle, pas de matrone quelque peu élégante qui ne se parât de postiches. Aujourd'hui, si nous exceptons quelques vieilles femmes de Fès et de Meknès, les cheveux artificiels ne se portent plus, dans les villes, que pour accompagner le costume d'apparat, le ksivat el kébira. La perruque se place au-dessus du festùl.
Dans les villes de la côte, elle se compose d'une frange d'épais fils de soie noire (haute de 40 centimètres) ajustée à la partie inférieure d'une bande semi-rigide (longue de 30 cent., large de 15). Les semi-cheveux de soie forment deux bandeaux terminés par des nattes ; ce sont les su aie f', des enroulements de fils d'or marquent la naissance et l'extrémité des nattes (Fig. 20, n° 4). La bande semi-rigide appelée sfïfa est faite d'un morceau de toile gommée recouverte de velours et de galons dorés. Les angles inférieurs sont munis de lanières d'attache que l'on noue sur la nuque ; ces lanières sont en cotonnade blanche, ornées de motifs multicolores brodés au point de Rabat (point lancé) avec de la soie floche et bordées de pompons. La perruque- mise en place, on réunit par une épingle les angles supérieurs du sflfa qui prend ainsi l'aspect d'un bonnet conique. Le sommet du cône est alors recouvert d'un beau sebniya à franges ou d'un châle de manille, paňuelo de manilla, dont la pointe retombe sur le dos. Le sfïfa représenté (PI. XXVI, fig. 2) n'est pas du modèle courant. C'est un diadème de grand prix rehaussé de perles et de pierres précieuses et spécialement atFecté à la parure des mariées.
Dans les villes de l'intérieur la formule est un peu différente. En terme de métier le postiche que nous venons d'étudier est un « demi- tour », il ne garnit que la moitié de la tête ; celui de Fès, Meknès et
1. Voisin (Mme de). Promenade d'une Française dans la Régence de Tunis. Paris, 1884, p. 147.
. Société des Africanistes. 12
174 SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES
Sefrou est un « tour » (Fig. 20, n° 1). Le sflfa forme une couronne dont l'avant est une bande ridige composée d'un carton recouvert de velours galonné et l'arrière une tresse de fils d'or qui épouse le galbe de la tête et assure l'équilibre parfait du système. La frange de soie, sicâlef (longue de 0.80) séparée au milieu du front dessine deux bandeaux, puis retombe sur le dos mêlée aux pans du feëtùl. Un foulard à franges plié diagonale- ment en plusieurs doubles posé à cheval sur la partie antérieure du sfîfa, et noué vers l'arrière, achève l'ajustement.
Les fournitures nécessaires' pour confectionner une perruque (fils de soie, galons d'or) sont exécutées par le passementier israélite ; le montage est l'œuvre des femmes. Une perruque à. frange de soie naturelle vaut 75 fr. à Fès, 60 fr. à Rabat. Les Juives de Fès représentées sur la photographie citée plus haut * ont des postiches du type « villes de la côte » ; le modèle actuel, le « tour », est une innovation récente. Le haut sfifa lui-même n'aurait guère plus d'un siècle d'existence. Le sflfa primitif ne mesurait que quelques centimètres de large et s'est perpétué à Debdou.
B. — LE COSTUME DANS LES CAMPAGNES. Debdou.'
Vêtement. — Selon une formule déjà rencontrée à Sefrou et courante au xixe siècle dans toutes les villes, les Juives de Debdou portent en guise de corsage un qaftân écourté, nosss- qaftân, recouvert d'une fara- jiya de mousseline brodée ; comme jupe, une saya (PI. XXVIII, 1). Cette saya est généralement en indienne à fleurettes multicolores sur fond noir ou brun Elle est ornée d'un pli transversal et de deux ou trois rangs de points d'épines (bu-'arruj) exécutés avec du coton perlé dont la couleur varie tous les 8 à 10 centimètres. Elle est large et s'évase en éventail comme la jupe des gitanes, les femmes s'étoffant d'un ou deux jupons, sayat, de nansouk ou de calicot pourvus d'un haut volant froncé. Les personnes riches portent une ceinture de cuir brodé d'or medomma importée de Fès ; la medomma est la ceinture usuelle des citadines musulmanes. Le kswat-el-kébira a figuré autrefois dans le garde-robe des Juives de Debdou car en cherchant au fond des vieux coffres, on trouve parfois d'anciens plastrons de velours brodé d'or.
Les fillettes portent un long qaf tan et une farajiya ; elles n'ont point de ceinture.
Coiffure. — Au Mellah de Debdou, comme dans tous ceux que nous allons maintenant visiter, la tradition talmudique relative aux cheveux de
1. Cf. note 7, p. 167.
LE COSTCMR DE LA FEMME ISRAÉLITE AU MAROC 175 !
la femme est scrupuleusement respectée. Jusqu'au jour de son mariage la j Juive va tête nue ; à partir de ce jour (qui a lieu entre sa dix et douzième année), elle se couvre hermétiquement la tête et ne se décoiffe même pas pour dormir, quels que soient la complication et le poids de l'ajustement. Elle conserve sa chevelure qu'elle divise en deux ou quatre nattes, suivant les localités, et coupe seulement les mèches les plus exposées à paraître : une plaque sur les tempes ou sur la nuque, une légère couronne autour de la tête, etc.. Elle se peigne une ou deux -, lois par semaine avec mille précautions, après avoir tendu un voile [ au-dessus d'elle, afin que sa chevelure ne soit pas un instant exposée nue N \ à la face du ciel. Les faux-cheveux sont d'usage constant; leur nature i varie suivant les ressources du pays. Í
Les Israélites de Debdou portent au-dessus d'un serre-tête de coton j rouge, sebniya, des swalcf de soie noire fixés à un sjifa « demitour » haut 3 seulement de trois doigts et prolongé par des cordons d'attache. L'étroit I sfïfa épouse la ligne du front et se devine a peine sous le mharma, grand 1 foulard triangulaire à frange rapportée qui complète la coiffure. Le ] mharma vientd'Algérie ; c'est le fichu de tête ordinaire des Algériennes \ musulmanes et israélites. D'ailleurs Debdou, situé dans le Maroc orien- - tal, n'est qu'à une centaine de kilomètres de la frontière.
La colonie juive de Berguent est une filiale de celle de Debdou. Les usages vestimentaires j sont identiques, exception faite du corsage ; c'est une chemisette de mousseline blanche, à larges manches froncées, décorée de broderies géométriques disposées sur l'épaule et autour de la fente de poitrine (PL XXVIII, fig. 5). Il existe deux modèles de broderies : l'un, ancien, est exécuté aux points de croix et points nattés avec de la soie rouge et bleue; l'autre, moderne, emploie les tons jaune et noir ; la technique s'est abâtardie ; un point lan^é très lâche remplace presque partout les points à fils comptés.
Cette chemisette représente-t-elle, un vieux vêtement tombé en désuétude à Debdou, une création locale ou une influence algérienne ? L'état actuel de mes connaissances ne me permet pas de me prononcer.
Région du Sous. — Taroudant. — Tizmt. — Talaint.
Vêtement. — Le seul corsage usité, c'est le traditionnel corselet à manches courtes déjà rencontré sous la dénomination de gonbaïz ou de qasot et qu'on appelle ici qaffán (PI. XXVII, fig. 1 et 2). Le plastron, coulissé au cou et à la taille, porte le nom de dzaliko l ; la chemise celui
1. De l'espagnol jaleco tiré lui-même du turc yelek, comme notre mot français gilet.
176 SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES
de sayâ. La jupe courante dite faltita i n'est autre que la say a des Juives citadines. Tous ces vêtements sont confectionnés avec des cotonnades ou des lainages aux tons neutres, autant que possible peu salissants, car la garde-robe est des plus réduites. Le souci d'élégance s'exprime en points d'ornements, travaillés généralement en noir au bord du décolleté et sur les coutures apparentes du corsage.
L&jeltèfa est connue ; c'est la jupe de cérémonie. Elle est en velours rouge, ornée de galons d'or disposés en bordure dans le bas et sur le pourtour des pointes herat. Elle s'accompagne d'un corselet de même tissu et de manches de mouseline, comme dans les villes. Bien rares dans le Sous les familles qui peuvent s'offrir le luxe d'un tel costume, mais les privilégiées de la fortune mettent de bonne grâce leurs trésors vestimentaires à la disposition de leurs parentes et amies, pour les grandes occasions.
Coiffure. — a). Dans les oasis occidentales du Sous (Tiznit, Talaïnt, Inlilleb...) l'essentiel de la coiffure féminine au Mellah c'est le curieux mahdùr, à la fois humble postiche et fin bijou (Fig. 20, n° 3). Fait unique peut-être dans les annales de la perruque, ici, c'est l'orfèvre qui est perruquier. Pour façonner une perruque, l'artisan se procure quelques belles queues de bovidés ; le crin détaché du cuir est disposé en nappe épaisse et travaillé de fils d'argent sur dix bons centimètres de haut ; le métal court entre les mèches comme la navette du tisserand entre les fils de chaîne du m t' tier ; puis, l'étrange tissu est rehaussé de trois gouttières d'argent ornées de filigrane et de rosaces émaillées vertes et jaunes. La partie inférieure des mèches s'échappe du lacis argenté comme une sombre frange ; cette frange va former deux bandeaux à l'intersection desquels viendront se balancer quelques légères pendeloques frontales. L'orfèvre a terminé sa tâche ; les femmes, à l'aide de fantaisistes oripeaux, vont achever le travail. Par leur soin, l'extrémité des simili-cheveux est enfermée dans deux solides gaines, les côtés du mahdùr pourvus de larges brides et l'arrière renforcé d'nn épais bourrelet. Gaines et brides, nouées sur la nuque, servent à assujettir la coiffure ; le bourrelet retient le festùl de soie rouge liseré d'or dont les pans flottent librement sur le dos. Les boucles d'oreilles sont le complément presque indispensable de l'ajustement ; elles sont d'argent massif ciselé et émaillé. Afin que leur poids ne déforme pas trop l'oreille, on les suspend à un filet qui passe sur le sommet de la tête.
b). Les matrones israélites de Taroudant se coiffent, comme maintes vieilles citadines, du festûl retenu par un bandeau frontal (PI. XXVII, fig. 1). Jadis, elles se garnissaient les tempes de gracieuses touffes de
1. De l'espagnol falda, jupe ou basque, ce quipeni au-dessous de la ceinture.
LE COSTUME DE LA FEMME ISRAÉLITE AU MAROC 177
plumes d'autruche noires, riyes den na am (Fig. 20, n° 2), mais la disparition des caravanes entre la capitale du Sous et le Soudan les a privées de leurs postiches.
Midelt.
Vêtement. — Les vêtements des Juives de Debdou et du Sous dérivent du costume des Juives citadines ; les vêtements en usage dans les Mellahs de l'Atlas et du Sahara s'apparentent au costume des femmes indigènes dont la fameuse tunique drapée Yi^âr est une survivance du peplos antique et représente un héritage de la domination romaine.
L'Israélite de Midelt s'habille, comme la Berbère musulmane de la région, d'une chemise iamir de cotonnade blanche et d'un izâr de même tissu ; le tout retenu à la taille par une ceinture multicolore. La coupe du tamïr n'offre rien de particulier ; c'est un vêtement droit, à manches larges et plates, fendu sur la poitrine et garni d'un col-baguette haut d'un doigt.
U izâr est une pièce rectangulaire de i à о m. de long, large d'1 m. 60 environ et formée de deux lés cousus lisière contre lisière. La façon de draper Yizâr est connue. La femme s'enroule dans la draperie après en avoir replié la partie supérieure sur une hauteur assez variable, conditionnée par la dimension du tissu, la taille du sujet et la longueur qu'il lui plaît de donner à son vêtement (les plus longs ne dépassent pas la cheville, les plus courts arrivent au bas du mollet ; la partie repliée forme un rabat extérieur. Le mouvement d'enroulement part du côté gauche ; le dos est couvert avant la poitrine. Le tour achevé, le pan arrière et le pan avant de Yizâr sont assujettis l'un à l'autre sur chaque épaule. L'étoffe doit plaquer sur le dos, bâiller très profondément sur le côté (il s'agit du côté droit bien entendu) et légèrement sur la poitrine.
L'opération complète nécessite au plus 3 m. 50. Ce qui reste d'étoffe tst ramené sur le dos ; on met alors la ceinture sur laquelle on laisse retomber la partie supérieure du surplus mentionné qui forme ainsi une sorte de jupe flottante. Cette portion flottante de Yizâr, remontée sur l'épaule et soutenue par la main, peut devenir une poche dorsale fort commode pour asseoir le nourrisson ou porter les charges encombrantes : cueillette de bois mort, herbes fourragères, etc. (PI. XXVIII, iîg. 4).
Au Maroc, de même qu'en Algérie et en Tunisie, les pans de la tunique drapée sont généralement reliés au moyen d'une paire de fibules d'argent. Ce procédé est rarement employé dans la région déshéritée de Midelt où l'argent est trop rare pour que l'on se permette de le transformer en épingles. Le mode de fîxion le plus répandu, c'est le nouet : les portions du tissu à joindre sont superposées au-dessus d'un petit corp rond (noyau,
178 SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES
bouton) autour duquel on ligature. On use encore de cordonnets cousus en bonne place sur le bord replié de la draperie. Les moins coquettes se contentent d'une épingle anglaise ou même d'une épine.
La ceinture des Juives he^âm-en-nemri est une bande rigide, large de 10 cent, et de longueur suffisante pour faire deux fois le tour du corps ; elle est confectionnée par les couturières du Mellah avec des
Fig. 21. — Coiffures de Juives marocaines. 1. dlâïl (Midelt); 2. mahdur (Ouarzazat) ; 3. tagjimt mta'-el-beger(Dadès<Todra); 4. sfifu et temùz (Figuig).
LE COSTUME DE LA FEMME ISRAÉLITE AU MAROC 179
tissus brochés montés sur toile gommée ou sur carton. Les brocarts employés sont de provenance européenne.
Les Israélites ne portent pas la handira, ample écharpe-plaid des femmes berbères du Moyen-Atlas. L'hiver, elles revêtent un tricot de laine ou un qaftân de drap au-dessus de leur chemise.
Uizâr est en défaveur près des jeunes générations dont nombre de représentantes ont adopté cette mise : chemise, saya, de nansouk à volant, farajya de mousseline et medomma.
Coiffure. — Les matrones juives se garnissent les tempes de longues et lourdes mèches de poils de chèvre dlaïl, à vrai dire peu seyantes. Dans les villes et à Debdou, c'est le passementier qui fabrique les perruques; à Tiznit, c'est l'orfèvre ; à Midelt, c'est le cordonnier. Un capuchon de cuir enveloppe l'extrémité supérieure de chaque mèche, puis les deux capuchons sont reliés par un filet qui s'appuie sur le sommet de la tête (Fig. 21,n°l).
Les cheveux, partagés par une raie médiane, sont nattés avec de gros brins de laine brune hiut-des-suf. L'opération terminée, les deux nattes sont relevées de manière à former en arrière du front, d'une oreille à l'autre, un gros bourrelet. Les dlaïl mis en place, la femme se coiife d'un bonnet, bniqa, qui recouvre les tresses et descend très bas sur la nuque ; un sebniya plié en bandeau ceint le front. Le bniqa 1 a exactement la forme d'un capuchon de burnous ; il s'attache au moyen de deux brides nouées vers l'arrière. Le tissu employé vient de Fès ; c'est une soie gommée rouge quadrillée de vert, de jaune ou de violet. Le bord antérieur de la coiife est renforcé à l'aide d'une tresse de soie ou d'une bande d'étoffe différente de celle du bonnet ; il est à remarquer que cette bordure est généralement verte du côté gauche, rouge ou à dominante rouge du côté droit. Le sebniya est un foulard lyonnais. Les femmes berbères de la région se font deux nattes tortillées sur la nuque et s'enveloppent la tête d'un fichu de soie ou de coton, fixé par une cordelette enroulée plusieurs fois autour du front.
Bien des jeunes femmes aujourd'hui préfèrent aux dlaïl les sivalef de Fès et de Meknès. La soie qui coûte cher et vient de loin leur semble une matière plus noble que le poil de chèvre.
Ouarzazat.
Vêtement. — Gomme leurs coreligionnaires de Midelt, les femmes
1. Le bniqa est en usage à Alger comme bonnet de bain, en Kabylie (sous le nom de tabuiket), en Tunisie (sous le nom de kufiya, au Yemen chez les femmes israélites (sous le nom de Kagula). C'est une très ancienne coiffure. Cf. Dozy, Dictionnaire détaillé des noàiè de vêtements chez les Arabes.
180 SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES
israélites d'Ouarzazat portent ample chemise et peplos blanc mais les vocables usités diffèrent ; ici, la chemise est dite say a (au lieu de tamir)', le terme ďizár ne s'applique plus qu'au peplos ordinaire, de calicot ; une élégante draperie de mousseline se dénomme soqqâ (PL XXVII, fig. 4).
On emploie comme ceintures d'épaisses bandes de laine, haute d'une main, tissées dans le Mellah même, par les femmes, sur petit métier. Beaucoup sont tricolores . (vert, rouge, bleu) ; les différents tons sont répartis en rayures transversales ou dessinent des figures géométriques (triangles, chevrons etc.) qui rappellent le décor des tapis régionaux.
Coiffure. — La perruque porte, comme à Tiznit, le nom de mahdùr (Fig. 21, n° 2). Elle est faite d'une queue de bovidé ou bien de deux, superposées, suivant la beauté des organes dont on dispose. Les poils qui adhèrent toujours au cuir forment deux bandeaux ; ces bandeaux sont prolongés par des tresses de laine ; une autre tresse, de laine également, est fixée sur le bord arrière du cuir. Ces trois nattes nouées sur la nuque servent à assujettir la perruque. Une charmante garniture court sur les bandeaux ; elle comporte des pièces de monnaie d'argent, des perles tubu- laires de corail rouge, des spirales de métal argenté, le tout appliqué sur un ruban noir.
Les cheveux de la Juive, séparés en deux mèches, sont tressés à hauteur de l'oreille avec de nombreux brins de laine afin d'augmenter le volume. Les nattes, repliées sur elles-mêmes une ou deux fois suivant la longueur de la chevelure, forment deux volumineux boudins demùj qui descendent jusqu'à la naissance de l'omoplate. L'extrémité des demùj est agrémentée de piécettes d'argent, de perles de corail et de cornaline. Une courte écharpe de soie rouge à rayures multicolores 'abruq enveloppe la tête, en arrière des postiches. Cette écharpe s'attache sous les demuj, qu'elle recouvre donc entièrement. Un carré de soie noire rayée de jaune sebniya, plié diagonalement en bandeau, entoure la tête et maintient V'abrûq. Ce sebniya peut être remplacé par un foulard lyonnais à franges (appelé ici qtib). U'abrûq et le sebniya viennent de Fès ou de- Marrakech. Les demûj représentent la coiffure classique des musulmanes du Sud marocain. Mais chez celles-ci les demùj ne sont point emprisonnés dans le tissu, ils sont apparents et glissent le long des joues, encadrant harmonieusement le visage. Le fichu de tête est un carré de cotonnade blanc ou bleu retenu par un bandeau.
Vallées du Dadès et du Todra.
Vêtement. — La chemise et la tunique drapée sont blanches ou le furent car, dans ces régions pauvres en eau, les lessives sont peu fré-
LE COSTUME DE LA FEMME ISRAÉLITE AD MAROC 181
quentes. Les femmes, Israélites et musulmanes, ont ici une façon particulière d'ajuster ťizar, qui à ma connaissance ne se rencontre nulle part ailleurs dans l'Afrique du Nord et n'a jamais été signalée dans le costume antique. La pièce d'étoffe, repliée d'abord dans sa partie supérieure exactement comme il a été dit plus haut, fait deux fois le tour du corps, en laissant chaque fois une épaule à découvert ; comme les deux tours se contrarient, les deux épaules sont finalement garnies et on obtient sur •le dos et sur la poitrine un effet de croisé du plus beau style (PI. XXVII, fîg. 3). L'izâr des musulmanes est en coton bleu sombre.
La ceinture est une cordelière de laine multicolore.
Coiffure. — La perruque tagjimt mta^-el-beger (Fig1. 21, n° 3) est une réplique de celle d'Ouarzazat, mais l'ornementation, plus simple, comprend seulement trois perles (argent, corail, cornaline) disposées en enfilade le long de la raie et une légère pendeloque frontale.
L'Israélite se rase très largement la nuque ; des cheveux, restants elle fait deux nattes qu'elle relève au-dessus de l'oreille. Son écharpe de tête 'abrùq n'est autre qu'un festul citadin ou seulement une partie de festul suivant ses moyens. Sur cette écharpe, en arrière des postiches, un bandeau auréole son front ; ce n'est pas un sebniya comme à Ouarzazat, mais un rectangle de cotonnade rouge plié en trois et prolongé par des cordons d'attache. Ce rectangle porte parfois un décor de losanges exécuté aux points d'épine ou de chaînette, avec de la soie verte et jaune ; on l'appelle alors bniqa. Une garniture de monnaie d'argent cousue sur un ruban noir et nommée sflfa souligne le bandeau ; les bords du sflfa peuvent être ornés d'une chaînette d'argent.
Le iagjimt mta*-el-beger ;est d'usage récent. L'ancienne perruque sivalef était volumineuse ; celle que nous représentons (Fig. 22) compte trente- six queues de bovidés et pèse sept cent cinquante grammes. La facture n'a rien de compliqué; les queues, réunies cuir contre cuir, sont liées solidement ; les poils s'entrecroisent, ceux du côté gauche passent à droite
Fig . 22. — Coiffure de Juive marocaine : swillefet tašhím (Todra).
182 - SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES
et réciproquement ; il en résulte deux énormes bandeaux. La raie médiane qui manque forcément de netteté était recouverte d'une rangée de perles. Les swàlef s'accompagnaient de deux écheveaux de laine roulés en forme de demi-fuseau (tashïn), qui glissaient des tempes sur l'épaule. Le vicomte de Foucault a dessiné une Juive du Todra ainsi coiffée et en a donné la reproduction dans son ouvrage *.
Tafilalet.
Vêtement. — L'Israélite fîlalienne porte une robe-chemise, saya ou dorra'a, une pièce d'étoffe helali drapée selon le procédé commun, une ceinture hézam (PI. XXVIII, fig. 3).
La saya est la robe ordinaire; c'est- une tunique droite en cotonnade rouge à pois ou fleurettes blanches, fendue sur la poitrine, pourvue d'un petit col-baguette et de larges manches:
La dorraa est la robe élégante. Au point de vue de coupe, elle ne se différencie de la saya que par une plus grande largeur d'ouverture des manches qui se portent retournées et attachées l'une à l'autre sur le dos au moyen de cordonnets. La dorra'a est en coton uni rouge ou blanc (plus souvent rouge) ; elle est ornée de broderies très caractéristiques exécutées sur la poitrine et sur les manches (sur l'envers des manches bien entendu puisqu'on les retourne). Le décor est toujours le même ; il représente un jeu de losanges inscrit dans un carré sur les manches, dans un rectangle sur la poitrine. Le travail est fait au point de chaînette et. au point d'épine, avec de la soie verte et rouge sur vêtement blanc, verte et jaune sur vêtement rouge. Les parties brodées sont doublées de cotonnade à pois ou fleurettes (PI. XXVIII, fig; 2).
La tunique drapée hilali est en cotonnade blanche et rouge ; on en voit également de mousseline blanche à dessins imprimés ou soutachés rouges et verts du plus charmant effet. La ceinture est le hezam-en-nemri déjà rencontré à Midelt.
L'importance donnée au rouge dans la toilette ne doit pas être attribuée à la résistance de ce ton aux brûlures du soleil, comme certains marchands l'affirment, mais bien à sa valeur symbolique de joie et de prospérité. Le deuil se porte en blanc. A ce point de vue, les Juives du Tafi- let se différencient de leurs coreligionnaires de Midelt, d'Ouarzazat, du Dadès et du Todra, que nous avons vues habillées de blanc. Elles s'apparentent aux Israélites de l'oasis de Gabès et de l'île de Djerba (sud- tunisien), qui sont presqu'èxclusivement vêtues de rouge.
Les fillettes, même mariées, sont simplement vêtues d'une saya les
1. Charles de Foucacld, Reconnaissance au Maroc, Paris, 1888.
LE COSTUME DE LA FEMME ISRAELITE AU MAROC 183
jours ordinaires, d'une dorra'a les jours de fête ; elles ne revêtent Vizâr que lorsqu'elles sont nubiles.
Le costume de la mariée se compose d'une dorra'a non brodée et d'une longue bande lammula de soie rouge à passements d'or, large d'environ quatre doigts. La 'ammala fait le tour de la coiffure, contourne les épaules, croise sur la poitrine et s'attache dans le dos.
Les musulmanes ont pour tout vêtement une tunique drapée de cotonnade bleu sombre. Les Juives de Colomb-Béchar (Algérie) s'habillent comme celles du Tafîlalet.
Coiffure. — L'originalité de la coiffure consiste dans les grùn (cornes), coussinets jumeaux de gros brins de laine brune composés chacun de deux écheveaux dont l'un mesure en longueur le double de l'autre. On voit aisément d'après la figure 23 de quelle façon s'agencent les écheveaux,
Fig. 23. — Coiffure de Juive marocaine : grûn (Tafîlalet).
comment le grand, préalablement passé dans le petit, est ensuite replié sur lui-même, puis comment les trois bouts, rapprochés, sont solidement ligaturés. De chaque côté du petit écheveau on remarque l'existence d'un passage. Ces passages servent à fixer les grùn. La femme, qui a fait de ses cheveux quatre nattes (deux au-dessus de chaque oreille), glisse les deux nattes de chaque côté dans les passages en question du coussinet correspondant placé au-dessus de sa tête ; les nattes ressortent au-dessus du coussinet ; on les noue, on les enroule autour des grùn, qui se trouvent ainsi irrémédiablement assujettis. Quelques lanières de tissu hiùt-des-uf
184 SOCIÉTÉ DES AFRICAMSTES
habilement entrecroisées, achèvent d'équilibrer les cornes qui pèsent 250 grammes. Un bonnet bniqa semblable à celui de Midelt recouvre les grûn. La pointe en est rabattue. Un mouchoir sebniya bande le front. Un foulard à franges sebniya del g ta, entièrement déployé et fixé par un angle sur le bniqa au moyen d'une agrafe, flotte sur les épaules. .
Le bniqa est en coton rouge uni, orné d'un décor couvrant brodé, de même style que celui de la dorraa. Le bord antérieur du bonnet présente les particularités déjà signalées au sujet de celui de Midelt. Le sebniya est généralement en soie noire à rayures rouges ; le sebniya del geta est en soie multicolore, mais à dominante rouge.
Sharmonisant parfaitement avec l'ensemble, des boucles d'oreilles d'or torsadé ornées d'une boule de corail et de cornaline achèvent ce remarquable ajustement.
Avant de sortir la Juive fîlalienne jette sur sa tête et ses épaules une pièce d'étoffe légère izar del geta composée de trois lés. Les lés latéraux sont blancs lisérés de rouge ; le lé central est de mousseline blanche brodée mécaniquement de fleurettes de soie aux tons variés. Ces tissus sont de provenance européenne.
La mariée porte des sivalefdxx même type que ceux de Debdou. Ce n'est que le huitième jour après la cérémonie qu'une femme n'ayant jamais été veuve ni divorcée la coiffa solennellement de ses grûn. Ces curieux grûn qui évoquent des cornes de bélier ont vraisemblablement une origine fort ancienne el se rattachent à d'antiques superstitions de la corne, talisman contre le mauvais œil. 11 n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'à Djerba la mariée israélite porte sur le front deux cornes de gazelle, afin 'de se préserver des maléfices.
FlGUlG.
Vêtement. — Les Juives de Figuig semblent les parentes pauvres de leurs sœurs et voisines de Ksar-es-souk et de Colomb Béchar. Comme celles-ci, elles portent la saya de cotonnade rouge et blanche mais elles n'ont point de dorraa. Aucune fantaisie dans leur izâr qui n'est que de calicot blanc uni. Leur ceinture, à rayures transversales rouges et blanches, est une simple écharpe de laine tissée dans le pays.
Coiffure. — Un bandeau sfifa formé par quatre ou cinq petites nattes de crin de cheval alignées les unes au-dessous des autres, barre le front ; au milieu du sfifa brille une fine rosace d'or halla ponctuée d'une éclatante perle rouge 'aqiqa (Fig. 22, n° i).
La femme, après s'être rasé la nuque et les tempes, se fait deux nattes qu'elle torsade ensuite avec de gros brins de laine, jerrûf. Elle relève
LE COSTUME DE LA FEMME ISRAÉLITE AU MAROC 1 8o
alors les deux torsades, temùz *, dans la position indiquée sur la figure, puis s'enveloppe la tête dans l'écharpe classique de soie rouge à lisérés d'or et bande jaune, que l'on appelle ici uqâya (au lieu de festûl). Au-dessus, elle étend un beau foulard à franges plié en triangle ; les pointes latérales du foulard, ramenées en avant, enturbannent le front. Une chaînette d'argent henz (de haneš — serpent) agrémentée de boucles d'oreilles et pendeloques frontales complète l'arrangement.
Les musulmanes de la région portent aussi des temuz disposés comme il vient d'être dit et s'enturbannent de deux carrés de coton ou de soie suivant les moyens.
On ne peut qu'admirer l'ingéniosité avec laquelle les Juives marocaines ont éludé la loi talmudique et mis a profit la licence donnée par les rabbins. On ne trouverait nulle part ailleurs collection si curieuse et si variée de postiches : fils de soie, queues de vache, crins de cheval, poils de chèvre, écheveaux de laine, plumes d'autruche, montés sur passementerie, sur cuir, sur argent... Et je ne puis affirmer que la collection présentée dans cet article soit complète, les colonies israélites de la région du Dra récemment conquis ayant échappé à mes investigations.
Le modernisme qui révolutionne la mode dans les mellahs citadines a jusqu'ici épargné ceux des campagnes. Mais il est à craindre que, la facilité de plus en plus grande des moyens de communication aidant, l'influence des grandes villes ne se fasse sentir avant peu, jusque dans les plus lointaines bourgades. Et ce serait dommage, car les costumes originaux et souvent magnifiques des Juives des campagnes marocaines (les dernières Juives à perruques sans doute) constituent un élément de pittoresque du plus haut intérêt 2.
1. Pour demûj. 2. Les dessins qui illustrent cet article ont été exécutés par Girard Besancennot,
d'après la collection rapportée par l'auteur pour le Musée d'ethnographie de Paris. Les planches ont été exécutées d'après des clichés de l'auteur.
Société des Africanistes, 1936- Planche XXVI.
Le Costume de la femme israélite au Maroc. 1. - Juive de Fez. — 2. - Juive de Tétouan. — 3. - Juive en costume d'apparat,
d'après I enz. — 4. - Juive marocaine, d'après Hôst.
o/9c>
Société des Africanistes, 1936. Planche XXVII.
Le Costume de la femme israélite au Maroc. 1. - Juive de Taroudant. — 2. -Juive de Tiznit. — 3. - Juive de Tinghir.
4. - Juive de Ouarzazat.

























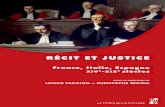






![[tapuscrit original] Femme et langue. Sexe et langage (1982)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6336af56e8daaa60da100428/tapuscrit-original-femme-et-langue-sexe-et-langage-1982.jpg)











