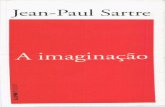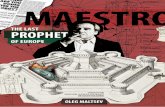Jean de Menasce et T.S. Eliot
Transcript of Jean de Menasce et T.S. Eliot
1 JEAN DE MENASCE, «Observations d'un dysarthrique sur ses moyens de communication», Journal depsychologie normale et pathologique 70 (1973) 209. On peut ajouter à ce bilinguisme français-anglais un contactprécoce avec la langue allemande par l'intermédiaire d'une de ses gouvernantes (à partir de sept ou huit ans,selon ses propres dires, art. cit., 211). Un écho de cette familiarité avec l'allemand se retrouvera dans latraduction française d'une œuvre de MAX SCHELER, Vom Umsturz der Werte, sous le titre L'homme du ressentiment,publiée chez Gallimard en 1933. Étonnamment, le nom du traducteur n'y est pas mentionné. La premièreversion de l'essai de Max Scheler, intitulée «Über Ressentiment und moralisches Werturteil», parut pour lapremière fois dans Zeitschrift für Pathopsychologie en 1912 à Leipzig. Trois ans plus tard, l'auteur le reprendra etle complétera, le publiant sous le titre Das Ressentiment im Aufbau der Moralen dans Gesammelte Abhandlungen undAufsätze. Il le remaniera une fois encore en 1919 et lui donnera son titre définitif. C'est ce texte que deMenasce traduira, en supprimant quelques notes et répétitions jugées inutiles.
JEAN DE MENASCE ET T. S. ELIOT
par Jean-Michel RoessliUniversité de Fribourg (Suisse)
Georges Cattaui publie, en 1957, dans la collection «Classiques du XXe siècle», un petitlivre consacré à T. S. Eliot. En exergue de son opuscule, il inscrit la dédicace suivante : «AJEAN DE MENASCE, O. P., qui, le premier, traduisit T. S. Eliot et le fit connaître en France». Quise souvient encore aujourd'hui que c'est à un jeune homme, connu plus tard commeDominicain spécialiste des religions de l'Iran ancien, que nous devons les premièrestraductions françaises d'une œuvre réputée difficile ? L'extrême rareté des allusions à Jeande Menasce dans les études sur Eliot et la méconnaissance quasi absolue de ses traductionsauprès des lecteurs francophones nous forcent à conclure qu'on l'a à peu près complètementoublié. Cet oubli justifie à lui seul que l'on se penche sur cette collaboration et que l'onessaie de reconstituer, autant que faire se peut, un chapitre méconnu de l'histoire littérairedu XXe siècle.
Jean de Menasce et T. S. Eliot se sont rencontrés pour la première fois entre 1922 et1924 à Oxford. T. S. Eliot, l'aîné des deux, se rendait au Balliol College pour y retrouver lephilosophe anglais Bertrand Russell, dont il était un ami très proche. Jean de Menasce, soncadet de quatorze ans, y était venu en 1920, pour entreprendre des études de philosophieet de sciences politiques; il en sortira quatre ans plus tard avec le titre de Bachelor of Arts.Les circonstances précises de leur rencontre nous sont inconnues, mais ce qui ne fait pasl'ombre d'un doute, c'est que, malgré leur appartenance à des générations et des horizonsculturels différents, les deux hommes avaient plusieurs centres d'intérêt en commun. Ceux-ciseront appelés à s'enrichir et à se préciser au fil des années. Parmi eux figurent l'amour dela littérature et des préoccupations religieuses qui occuperont rapidement le devant de lascène. Dans leur cas, ces deux centres d'intérêt se sont du reste bien vite mêlés, au point queleur cheminement spirituel et leur activité littéraire et intellectuelle seront constamment etintimement liés tout au long de leur vie : le caractère et la thématique des poèmes d'Eliottraduits par de Menasce sont là pour en témoigner, l'itinéraire propre à chacun d'eux leconfirme de façon encore plus éclatante.
Les raisons qui ont conduit Jean de Menasce à traduire des textes de T. S. Eliot enfrançais ne sont pas connues, mais on peut penser que le climat de formation et d'échangesintellectuels intenses qu'il a rencontré à Oxford y est pour beaucoup. Quoi qu'il en soit, Jeande Menasce était tout désigné pour cette tâche. Sa parfaite connaissance du français et del'anglais, son intérêt pour les questions linguistiques1 et sa sensibilité littéraire le qualifiaient
JEAN DE MENASCE ET T. S. ELIOT 2
2 Dans sa jeunesse, Eliot estimait que le genre de poésie dont il avait besoin pour apprendre «sa proprevoix» n'existait pas en Angleterre et ne pouvait être trouvé qu'en France. Ces maîtres en littérature à cemoment-là furent les symbolistes français, Jules Laforgue et Tristan Corbière en particulier (G. CATTAUI, T.S. Eliot, Collection «Classiques du XXe siècle», Éditions Universitaires, Paris, 1947, pp. 20-21).
3 Le mysticisme et la logique, Payot, Paris, 1922. Le recueil de Bertrand Russell, publié à Londres en 1918,contient trois autres essais que de Menasce a également traduits : The Study of Mathematics, 1902 (L'étude desmathématiques), On Scientific Method in Philosophy, 1914 (La méthode scientifique en philosophie) et On the Notion of Cause,1912 (De l'idée de cause).
Signalons au passage que la première recension de T. S. Eliot, parue dans The Nation, le 23 mars 1918,porte précisément sur cet ouvrage de Bertrand Russell. Il est peu probable que de Menasce en ait euconnaissance à l'époque de sa traduction, car la recension ne portait pas de signature et c'est Russell lui-mêmequi a révélé le nom de l'auteur par la suite; cf. G. G. LEITHAUSER/N. C. DYER, «Bertrand Russell and T. S.Eliot : their dialogue», Russell : the Journal of the Bertrand Russell Archives, N. S. 2 (1982) 7-28). Il n'est pas du toutsurprenant qu'Eliot ait écrit cette recension, d'abord parce qu'il était un ami de Russell, ensuite parce qu'ils'était lui-même beaucoup intéressé au mysticisme et à la psychologie de l'expérience religieuse, sousl'impulsion d'un livre de William James (The Varieties of Religious Experience, 1902), dont il avait suivi les coursde philosophie à Harvard; cf. L. GORDON, Eliot's Early Years, London, 1971, Appendix I, pp. 141-142). Elioty avait également étudié le sanskrit et le pali et connaissait très bien les textes les plus importants de latradition religieuse hindoue : les Upanishads et la Baghavad Gita.
4 Étant donné les liens respectifs de T. S. Eliot et Jean de Menasce avec Bertrand Russell, on peutlégitimement se demander si ce n'est pas par son intermédiaire que les deux hommes ont fait connaissanceet ont élaboré leur projet de traduction.
5 M. LELEU, «Cinq lettres inédites de Jean de Menasce et Charles Du Bos», dans Cahiers Charles Du Bos, n/18, mai 1974, p. 105. Cf. la contribution de Michel Dousse dans le présent volume.
6 J. DONNE, «Poèmes», La Nouvelle Revue Française 115 (1923) 620-629. Ces traductions consistent en sixpoèmes profanes, extraits de Songs and Sonnets : «Aubade» («The Good-Morrow»); «La promesse» («TheUndertaking»); «L'apparition» («The Apparition»); «L'extase» («The Extasie»); «L'indifférent» («TheIndifferent»); «L'interdiction» («The Prohibition»); un poème sacré : «Hymne à Dieu le Père» («A Hymne toGod the Father»); et un fragment du sermon prononcé par John Donne à la mort de Jacques Ier d'Angleterre.En réalité, «The Extasie» avait déjà été traduit en français par Miss Ramsay en 1918. Sur tout cela, cf. lacontribution d'Anthony Mortimer dans ce volume.
tout spécialement pour rendre dans une langue chère à l'auteur américain2 des textes dontla difficulté saute immédiatement aux yeux de tout lecteur. De plus, malgré son jeune âge,Jean de Menasce avait déjà acquis une solide expérience de la traduction. En 1922, âgé devingt ans à peine, il avait donné une version française de Mysticism and Logic3 de BertrandRussell, dont il suivait l'enseignement à Balliol College. Certes, le caractère philosophiqueet même technique de cet ouvrage ne requiert pas les mêmes compétences que la poésie,mais il exige néanmoins une précision et un sens aigu de l'abstraction, qui ne lui sont pasétrangers. Pour autant qu'on en puisse juger, Bertrand Russell ne semble pas avoir eu à seplaindre du résultat4.
C'est au cours de cette même année 1922 que Jean de Menasce affronte le défi detraduire de la poésie. En effet, une lettre adressée à Charles Du Bos le 18 octobre nousapprend qu'il prépare une traduction de John Donne, «un volume d'Œuvres en Prose et enVers, précédées d'une importante biographie-étude-critique contenant des lettres, desdocuments du temps, etc.». Et, «en attendant... comme un avant-goût des poèmes deDonne», il exprime son désir de faire paraître dans la Nouvelle Revue Française quelquestraductions qu'il a faites au cours de l'été5. Son vœu sera exaucé l'année suivante : septpoèmes et un fragment de sermon du poète «métaphysicien» anglais du XVIIe siècle serontainsi offerts pour la première fois aux lecteurs de langue française6.
JEAN DE MENASCE ET T. S. ELIOT 3
7 La critique littéraire contemporaine tient généralement The Waste Land pour le chef d'œuvre poétique deT. S. Eliot et considère que c'est l'une des œuvres qui a exercé la plus grande influence sur la littérature anglo-américaine du XXe siècle.
8 On peut se faire une idée de la collaboration entre les deux écrivains grâce au facsimilé du manuscrit dupoème (The Waste Land. A Facsimile and Transcript of the Original Drafts including the Annotations of Ezra Pound, ed.by Valerie Eliot, Londres, 1971).
9 Grand maître du trobar ric, Arnaut Daniel, né vers 1150-60 dans la Dordogne, passait pour un poeta dificil(selon Martín de Riquer). Il bénéficia de la reconnaissance non seulement de Dante, mais aussi de Pétrarque(Trionfi IV, 42).
10 DANTE ALIGHIERI, Purgatorio XXVI, 117 : «fu miglior fabbro del parlar materno». Sur cette conceptiondu poète comme artisan de la langue, cf. également Convivio I, XI, 11-13. Le chant vingt-six du Purgatoireinfluencera également un autre poème de T. S. Eliot traduit par Jean de Menasce; cf. ci-dessous «Som del'escalina».
C'est fort de cette familiarité avec une poésie extrêmement subtile et raffinée que Jeande Menasce aborde la traduction de T. S. Eliot, dont la réputation est alors grandissante.Jean de Menasce inaugure son entreprise avec The Waste Land. Ce choix en dit long sur lahauteur de son ambition et la difficulté de la tâche à laquelle il s'attelle. En effet, The WasteLand est un long poème de 433 vers, d'une rare complexité, riche de résonnances multipleset foisonnant d'une immense érudition. Il ne m'appartient pas de revenir ici en détail sur lagenèse et les péripéties qui entourent la rédaction de ce texte, dont l'importance pourl'histoire des lettres anglo-américaines du XXe siècle n'est plus à démontrer7. Qu'il suffisede rappeler qu'Eliot en a conçu le projet vers 1914-1915, qu'il en a composé diversfragments avant 1920, et que la première version en a été écrite d'un seul jet en décembre1921, au cours d'un séjour en Suisse (à Chardonne, au-dessus de Vevey), où Eliot s'étaitrendu pour soigner la dépression dont il souffrait. Au cours du voyage qui devait le ramenerà Londres un peu avant Noël, Eliot s'arrête à Paris et présente le manuscrit de son poèmeà Ezra Pound, qui en critique la longueur (1000 vers) et lui propose son aide pour le réviser.Il suggère d'en supprimer huit parties et intervient sur le texte par de nombreuses petitescorrections, réduisant le poème à ses 433 vers définitifs. Au début de l'année suivante, Eliotfait une nouvelle fois appel à Pound pour lui demander son opinion sur les dernières petitesretouches qu'il veut apporter à son poème. Pound les approuve, de sorte que T. S. Eliot peuten préparer la publication8. C'est ainsi que quelques mois à peine après que l'Ulysse de Joycea été révélé aux lecteurs anglophones paraît The Waste Land dans le premier numéro de larevue The Criterion, dont T. S. Eliot est à la fois le fondateur et le directeur, et qui jouera unrôle si important sur la scène littéraire anglo-américaine de notre siècle. Dans la premièreédition américaine du poème, publiée en novembre 1922 dans The Dial, Eliot ajoutera, ensigne de reconnaissance, une dédicace à Ezra Pound, qu'il appelle il miglior fabbro, selonl'expression employée par Dante Alighieri pour désigner le troubadour périgourdin ArnautDaniel9 dans le chant vingt-six du Purgatoire10. Dès sa parution, The Waste Land connaît unretentissement immédiat, que le Dial Award vient couronner à la fin de la même année.
Jean de Menasce, qui a pris connaissance du poème dès sa publication, ne semble pas enavoir entrepris la traduction avant la fin de l'année 1925. C'est en tout cas ce que laissepenser la mention qui figure au bas de la dernière page de sa traduction, laquelle paraît enmai 1926 : «Traduction de JEAN DE MENASCE (revue et approuvée par l'auteur, d'après ladernière édition de Poems 1909-1925)». Or, le volume de Poems 1909-1925 sort de presse le
JEAN DE MENASCE ET T. S. ELIOT 4
11 On peut évidemment se demander si cette précision n'est pas donnée pour des raisons de droit d'auteur,le poème de T. S. Eliot n'étant plus en 1926 sa propriété légale, mais celle de l'éditeur. Si tel était le cas, rienn'empêcherait de penser que le projet de traduire The Waste Land a vu le jour plus tôt. Mais je n'ai trouvéaucun indice pour étayer cette hypothèse.
12 Jean de Menasce se fait baptiser dans la foi catholique, en l'église Saint-Etienne-du-Mont, le 19 mai 1926,en présence de Louis Massignon; cf. la contribution de Georges Darmon dans le présent volume. Cf. aussiPH. CHENAUX, «Du judaïsme au catholicisme : réseaux de conversion dans l'entre-deux-guerres», dans Laconversion aux XIXe et XXe siècles, études réunies par N.-J. Chaline et J.-D. Durand, Arras, 1996, pp. 95-106.
13 T. S. ELIOT, «La Terre mise à nu», L'Esprit 1 (1926) 174-194. I. FERNANDEZ («À propos de Jean deMenasce traducteur», Mémoire dominicaine 11 (1997/2) 75-85) se demande pourquoi et comment cettetraduction de Jean de Menasce «a paru dans une revue animée par H. Lefebvre et G. Politzer, et qui contenaitun article hostile à Maritain». Je ne dispose d'aucun élément pour répondre à cette question.
14 D. GALLUP, T. S. Eliot : A Bibliography, London, 1969, p. 276 [D109].15 CHRÉTIEN DE TROYES, Perceval ou le Conte du Graal, v. 1708-1709 : «Defors les murs ne voit neant/Fors
mer et eve et terre gaste» (Œuvres complètes, Paris, 1994, p. 727); cf. aussi vv. 1750 et 1771. L'adjectif gastequalifie également la Forêt solitaire de la Veuve Dame, mère de Perceval (ibid., vv. 75; 392). L'idée expriméedans les deux cas est très proche : l'adjectif évoque les douloureuses conséquences de la guerre qui s'inscriventdans le paysage.
Je n'ai malheureusement pas pu mettre la main sur un exemplaire de Philosophies pour vérifier l'informationde Gallup.
16 T. S. ELIOT, «Deux attitudes mystiques : Dante et Donne», Le Roseau d'or («Chroniques» 3) 14 (1927)149-173. Le périodique était dirigé par Jacques Maritain et Stanislas Fumet. Ce volume porte le titre général«Frontières de la poésie» par Jacques Maritain.
17 J. DE MENASCE, «Situation du sionisme», Le Roseau d'or («Chroniques» 5) 24 (1928) 153-205. Cf. lescontributions de Philippe Chenaux et Georges Darmon dans ce volume. Rappelons que trois ans plus tôt Jeande Menasce avait été nommé secrétaire du bureau sioniste de Genève et que sa famille était liée à celle deHaïm Weizman, premier président du futur État d'Israël en 1948.
23 novembre 192511. Jean de Menasce a donc travaillé très rapidement. Dans un intervallede temps très court, il a traduit non seulement l'intégralité du poème, mais aussi les notesexplicatives qu'Eliot a eu le soin d'écrire pour faciliter la compréhension de son texte, et lesnombreuses citations en langues étrangères qui jalonnent le poème. Sa traduction, qui portele titre La Terre mise à nu, paraît en mai 1926, le mois de sa conversion12, dans le premiercahier d'une revue qui n'en comptera que deux : L'Esprit13. Selon Donald Gallup 14, latraduction de Jean de Menasce a été reproduite dans un numéro de la revue Philosophies sousle titre La terre gaste, un titre qui traduirait parfaitement l'original anglais, s'il n'avaitl'inconvénient de recourir à un adjectif de l'ancien français, que peu de lecteurs d'aujourd'huicomprennent encore. The Waste Land, la terre gaste, est une allusion explicite à cette terredévastée qu'occupe le château de Blanchefleur où se rend le chevalier Perceval dans le Contedu Graal de Chrétien de Troyes15.
Cette traduction française de l'un des poèmes les plus influents du XXe siècle aterriblement souffert d'avoir été publiée dans un périodique disparu prématurément, etdevenu, de ce fait, d'accès difficile. C'est sans doute ce qui explique l'oubli dans lequel elleest plongée. Cet oubli est tel qu'il m'a semblé opportun de la reproduire en annexe de cevolume, telle qu'elle apparaissait dans la revue L'Esprit de 1926.
Après The Waste Land, Jean de Menasce quitte momentanément la poésie de T. S. Eliotpour traduire un de ses essais, qu'il publie en 1927 sous le titre Deux attitudes mystiques : Danteet Donne, dans le quatorzième numéro du Roseau d'or16, où l'année suivante il livrera sesréflexions sur la Situation du sionisme17. La traduction de l'essai d'Eliot permet à de Menascede reprendre et d'affiner («pour serrer le texte de plus près») la mise en français de quelques
JEAN DE MENASCE ET T. S. ELIOT 5
18 J. DONNE, «L'extase», La Nouvelle Revue Française 115 (1923) 623-625.19 Jean de Menasce a été rappelé à Alexandrie par son père, quand celui-ci a appris que son fils s'était
converti au catholicisme. Il y restera deux ans avant de rejoindre l'Europe.20 Pour le détail de ces corrections, cf. T. S. ELIOT, The Varieties of Metaphysical Poetry, Londres, 1993, p. 309.21 Op. cit., pp. 309-318.22 Bien sûr, ceux qui avaient la possibilité de se rendre à la bibliothèque de King's College à Cambridge
ou à Harvard pouvaient les lire dans leur version originale grâce aux deux seuls exemplaires mis à ladisposition des chercheurs; cf. T. S. ELIOT, The Varieties of Metaphysical Poetry, Londres, 1993, p. 1.
23 BPU Genève, Fonds Cattaui, Ms. fr. 5157, f. 280.24 T. S. ELIOT, «Perch'io non spero...», Commerce 15 (1928) 5-11. Cette revue littéraire paraissait quatre fois
par an, généralement au terme de chaque saison. Ce poème a été reproduit à la suite de l'article d'IrèneFernandez («À propos de Jean de Menasce traducteur», Mémoire dominicaine 11 (1997/2) 81-85).
strophes du poème The Extasie de John Donne, qu'il avait traduit dans son intégralité quatreans plus tôt pour la Nouvelle Revue Française18. Il y donne également la traduction d'une odede Lord Herbert of Cherbury, un autre poète anglais du XVIIe siècle, qu'Eliot cite dans sonessai.
Il n'est pas dépourvu d'intérêt de signaler que la version anglaise de l'essai d'Eliot n'ajamais été publiée sous la forme que de Menasce a utilisée pour sa traduction. En effet, letexte qu'Eliot a fait parvenir à de Menasce est une version abrégée de la troisièmeconférence qu'il a prononcée en mars 1926 dans le cadre des Clark Lectures à Trinity College,Cambridge.
C'est en Egypte19 que Jean de Menasce prépare sa traduction, sur la base d'un documentdactylographié, aujourd'hui perdu. Il y travaille au cours de l'été 1926 et l'envoie à Eliotd'Alexandrie le 15 octobre. Une lettre d'accompagnement décrit les quelques correctionsqu'il y a introduites et les soumet à l'approbation de l'auteur20. Les archives de T. S. Eliot enconservent une copie imprimée, qui porte, sur la page de titre, la signature d'Eliot et lamention de l'année 1927, sans aucune autre indication. La conférence de Cambridge diffèredu texte de Jean de Menasce par la suppression des deux paragraphes d'introduction,d'importantes modifications dans le corps du texte et une conclusion entièrement nouvelle.Cette conférence, ainsi que les sept autres du cycle présenté à Cambridge, devait faire l'objetd'une refonte complète de la part d'Eliot et paraître en un volume qui devait s'intituler TheSchool of Donne. Pour des raisons diverses, qu'il ne m'appartient pas d'élucider ici, le projetn'a jamais vu le jour. Il a fallu attendre l'initiative de Ronald Schuchard pour que le texte desClark Lectures soit enfin édité, avec la collaboration de Valerie Eliot, la veuve de l'écrivain,et de nombreux chercheurs. Il est paru sous le titre The Varieties of Metaphysical Poetry, en1993, chez Faber and Faber à Londres, où Eliot avait publié une grande partie de son œuvreet dont il avait été le directeur pendant treize ans. L'éditeur a eu la riche idée de reproduirela traduction de Jean de Menasce21, qui est ainsi longtemps restée le seul moyen d'accéderà la substance d'une de ces célèbres conférences22.
Une lettre du 25 avril 1928 adressée à Georges Cattaui nous apprend que de Menasce estappelé à revenir une nouvelle fois à la poésie d'Eliot : «As-tu lu Eliot ? Il vient de m'envoyerun beau poème à traduire pour "Commerce"»23. Bien que de Menasce ne précise pas le titredu poème, il doit s'agir de «Perch'io non spero...», paru, avec le texte anglais en regard, auprintemps 1928 dans le quinzième cahier de la revue Commerce, publiée par les soins de PaulValéry, Léon-Paul Fargue et Valéry Larbaud24. Ce poème sera repris presque sanschangement en 1930. Il formera alors la première des six parties de Ash Wednesday (Mercredi
JEAN DE MENASCE ET T. S. ELIOT 6
25 BPU Genève, Fonds Cattaui, Ms. fr. 5157, f. 280. Jean de Menasce souligne le verbe «doit».26 BPU Genève, Fonds Cattaui, Ms. fr. 5157, f. 276.27 G. CAVALCANTI, Rime con le rime di Iacopo Cavalcanti, a cura di Domenico de Robertis, Torino, 1986, pp.
135-139. Chez Cavalcanti, ces mots ne constituaient pas le titre du poème, mais son incipit.28 T. S. ELIOT, «Som de l'escalina», Commerce 21 (1929) 100-103.29 T. S. ELIOT, «Cantique de Siméon», Le Roseau d'or («Chroniques» 7) 33 (1929) 69-71.30 Le poème d'Eliot est publié pour la première fois le 24 septembre 1928 par Faber & Gwyer, avec des
dessins de E. McKnight Kauffer.31 Eliot a tout fait pour officialiser sa conversion, d'abord en Grande-Bretagne, ensuite dans les autres
pays. Par ses traductions, Jean de Menasce en diffusa la nouvelle auprès des intellectuels et des chrétiens delangue française.
des cendres). Il suffit de lire le poème de T. S. Eliot pour se rendre compte qu'un tournant s'estproduit dans sa vie. Et ce tournant est précisément d'ordre religieux. Le poème se fait l'échod'une mutation qui se préparait de longue date et qui s'est concrétisée une année plus tôt parla conversion du poète. En effet, T. S. Eliot, de confession unitarienne, s'était converti àl'anglicanisme en 1927. Jean de Menasce, lui-même un converti de fraîche date, ne pouvaitqu'y être très sensible. Dans la lettre à Georges Cattaui mentionnée ci-dessus, il ajoute :«Encore un qui cherche et qui doit trouver. Je l'aime plus que je ne saurais le lui écrire»25.Quelques mois plus tôt, dans une lettre adressée à ce même Georges Cattaui, il écrivait,prophétiquement : «T. S. Eliot est non seulement un grand poète, mais une âmeextraordinairement belle : une sorte de saint raté; à qui il faudrait même peu (il le sait) pourretrouver sa ligne»26. La lettre, expédiée d'Alexandrie, est datée du 25 juin 1927, soit quatrejours avant le baptême de T. S. Eliot. Rien n'indique que de Menasce était au courant de cequi se préparait. Son baptême à lui remontait à treize mois, presque jour pour jour.
Le titre italien donné à la première édition du poème est la reprise explicite des premiersmots d'une des ballades les plus célèbres de Guido Cavalcanti, le meilleur ami de Dante27
: «Perch’i’non spero di tornar giammai», qui deviendra sous la plume d'Eliot «Because I donot hope to turn again», modulé en variations successives tout au long du poème, et queJean de Menasce rend par «Et puisqu'il n'est plus rien qui me soit un retour...». Le titre dupoème traduit par Jean de Menasce ne sera pas retenu dans l'édition de Ash Wednesday. C'estprobablement que pour Eliot, ce titre, qui s'imposait dans une édition isolée du poème,n'avait plus sa raison d'être, à partir du moment où celui-ci était intégré dans un recueilauquel l'auteur avait prévu de donner un autre titre (Ash Wednesday), jugé plus représentatifde l'ensemble.
En 1929, Jean de Menasce traduira encore deux autres poèmes d'Eliot, un pour la revueCommerce : «Som de l'escalina»28, qui formera la troisième partie de Ash Wednesday, et l'autrepour le Roseau d'or29 : A Song for Simeon (Cantique pour Siméon), écrit en 192830, mais inséréultérieurement dans Ariel Poems. Les deux poèmes confirment la profonde mutation qui serévélait déjà dans «Perch'io non spero». Jean de Menasce en est le témoin et le porte-paroleauprès de la communauté des lecteurs francophones31.
Tout comme «Perch'io non spero...», et pour les mêmes raisons, me semble-t-il, le titre«Som de l'escalina» disparaîtra de l'édition de Ash Wednesday en 1930. Ce titre est empruntéau chant vingt-six du Purgatoire, où Dante prend lui-même la voix d'Arnaut Daniel, le poètepérigourdin qu'il admirait tant, et l'imite dans sa propre langue : «Ara vos prec, per aquellavalor/que vos guida al som de l'escalina,/sovenha vos a temps de ma dolor!» (Je vous priemaintenant, au nom de la valeur (c'est-à-dire de la grâce divine),/qui vous guide au sommet
JEAN DE MENASCE ET T. S. ELIOT 7
32 DANTE ALIGHIERI, Purgatorio, XXVI, 145-147. Par rapport à «Som de l'escalina», on note dans la versiondu poème inséré dans Ash Wednesday l'interversion des vers trois et quatre dans la première strophe (peut-êtreune erreur ?) et la substitution de l'adjectif «agèd» pour «giant shark» à la fin de la deuxième.
33 Jean de Menasce a enseigné à l'Université de Fribourg (Suisse) l'histoire des religions et la missiologie,de 1938 à 1948.
34 T. S. ELIOT, «Aux Hindous morts en Afrique» («To the Indians Who Died in Africa»), Présence. Revueinternationale des Lettres 5 (1946) 18-19.
35 G. CATTAUI, Trois poètes : Hopkins, Yeats, Eliot, Paris, 1947, pp. 152-153.36 Publié en 1943 chez Harcourt Brace & Company pour la première édition américaine et en 1944 chez
Faber & Faber pour la première édition britannique.37 Eusebio e Trabucco. Carteggio di Eusebio Montale e Gianfranco Contini, a cura di Dante Isella, Milan, 1997, p.
54. Je remercie M. Romano Broggini d'avoir porté cette lettre à ma connaissance. Sur les liens entre Jean deMenasce et Gianfranco Contini, cf. la contribution de Romano Broggini dans le présent volume.
de l'escalier (c'est-à-dire au sommet de la montagne du purgatoire), qu'il vous souvienne àtemps (c'est-à-dire devant Dieu) de ma douleur!)32.
Dix-sept ans séparent ces deux traductions des deux dernières que Jean de Menasce afaites de l'œuvre de T. S. Eliot. En effet, il faut attendre avril 1946, alors qu'il enseigneencore à l'Université de Fribourg (Suisse)33, pour lire un autre texte d'Eliot traduit par Jeande Menasce. Il s'agit de «Aux Hindous morts en Afrique», publié, avec le texte anglais enregard, dans Présence. Revue Internationale des Lettres, éditée à Genève34. C'est un très beaupoème de circonstance écrit en 1943 à la demande de Miss Cornelia Sorabji pour le livreQueen Mary's Book for India. Il sera repris sans changement en 1969 dans The Complete Poemsand Plays of T. S. Eliot. En 1947, Georges Cattaui, auquel Jean de Menasce avait transmis sonenthousiasme pour T. S. Eliot, publie un livre intitulé Trois poètes : Hopkins, Yeats, Eliot. Dansl'annexe de son ouvrage, il reproduit la traduction que son cousin Jean de Menasce a faitedu fragment IV de East Coker35, un poème composé en 1940 et inséré plus tard dans FourQuartets avec Burnt Norton, The Dry Salvages and Little Gidding36.
Après ce poème, Jean de Menasce ne traduira plus aucun texte de T. S. Eliot. Pourquoi ?L'intérêt s'est-il émoussé ? L'évolution intellectuelle et religieuse d'Eliot l'a-t-elle déçu ?Difficile de le savoir. Une lettre du 22 avril 1934 adressée à Georges Cattaui pourrait fairepenser à la deuxième possibilité : «As-tu revu Eliot qui désirait te voir ? Son dernier livre estbien décevant. Il se sent roi dans un pays d'aveugles, mais combien il est borgne! Je voudraisbeaucoup le décider à venir ici». À quel livre Jean de Menasce fait-il allusion ? Il pourraits'agir de After Strange Gods : A Primer of Modern Heresy, paru chez Faber and Faber, le 22février 1934, un ouvrage dans lequel Eliot se montre particulièrement dogmatique et sévèredans son jugement sur les auteurs contemporains. Une faille semble donc s'être insinuéedans leur relation, et cela déjà bien avant les dernières traductions de Jean de Menasce. Letémoignage de Gianfranco Contini, le célèbre romaniste italien qui a enseigné à l'Universitéde Fribourg en même temps que de Menasce, confirme, cinq ans plus tard, que ce derniern'a plus tout à fait la même admiration pour la poésie de T. S. Eliot. Dans une lettre du 19novembre 1939 adressée à Eugenio Montale, Contini, rapporte le jugement de Jean deMenasce, «una delle persone più intelligenti che ho incontrate (di quelle che si contano sulleprime dita della prima mano...)», sur le recueil de poésie Occasioni que Montale vient de faireparaître : «C'est éliotique, mais infiniment plus poétique qu'Eliot»37.
Malgré le déclin de l'intérêt et de l'admiration de Jean de Menasce pour Eliot, lacorrespondance avec Cattaui nous révèle qu'il a précieusement conservé, presque jusqu'àla fin de sa vie, les livres qu'Eliot lui avait offerts et dédicacés, ainsi que tous les documents
JEAN DE MENASCE ET T. S. ELIOT 8
38 Le fonds est répertorié sous le titre «T. S. Eliot related material in Balliol College Library».39 BPU Genève, Fonds Georges Cattaui, Ms. fr. 5157, f. 385.40 Elles sont respectivement datées de la St Jean Baptiste 1933; du 23 août 1935; du 11 novembre 1942
et du 13 April 1946.41 Du 31 mai 1940.42 Eliot se faisait lui-même une idée assez semblable de la fonction complexe de la correspondance entre
deux amis : «The desire to write a letter, to put down what you don't want anybody else to see but the personyou are writing to, but which you do not want to be destroyed, but perhaps hope may be preserved forcomplete strangers to read, is ineradicable. We want to confess ourselves in writing to a few friends, and wedo not always want to feel that no one but those friends will ever read what we have written», cité en exerguedu premier volume de correspondance de T. S. Eliot par sa veuve Valerie Eliot (V. ELIOT (ed.), The Lettersof T. S. Eliot, Vol. I, 1889-1922, London, 1988).
43 On en possède quelques fragments, publiés ici et là dans diverses études, dont certaines figurent dansla bibliographie générale, publiée à la fin du présent volume. Mais les archives du Saulchoir ont révélé que Jeande Menasce avait de très nombreux correspondants avec lesquels il restait fidèlement en contact. Nul douteque si nous pouvions connaître le contenu, ne serait-ce que partiel, de toute cette correspondance, nouspourrions lever bien des incertitudes sur des pans entiers de la vie du dominicain.
44 V. ELIOT (ed.), The Letters of T. S. Eliot, Vol. I, 1889-1922, London, 1988. Ce volume ne comporteaucune trace du nom de Jean de Menasce.
liés au poète qu'il avait suivi de près dans sa jeunesse. Ce n'est que dans la maladie et faceau sentiment de la mort prochaine que Jean de Menasce s'est résolu à s'en séparer pour lesoffrir à la bibliothèque du Balliol College, qui les abrite encore aujourd'hui38 : «J'ai fini pardonner tous mes Eliotica (livres dédicacés, etc...) à la bibliothèque de mon vieux collège deBalliol où ils seront bien gardés et à la disposition des chercheurs, tout en constituant unsouvenir de moi»39. Les archives Jean de Menasce au couvent du Saulchoir de Parisconservent les deux lettres que Vincent Quinn, le responsable de la Bibliothèque du BalliolCollege à cette époque, a adressée à Jean de Menasce à la suite de sa proposition de léguerses «Eliotica». La première lettre, datée du 29 septembre 1972 et écrite à la main, remerciede Menasce de son offre, tandis que la deuxième, datée du 18 octobre de la même année,accuse réception de l'envoi et renouvelle officiellement les remerciements de la bibliothèquedu Balliol College. Les archives du Saulchoir conservent par ailleurs une copiedactylographiée du poème de T. S. Eliot traduit par Jean de Menasce «Aux Hindous mortsen Afrique», le texte également dactylographié de «Little Gidding» (10 pages) et de «The DrySalvages», ce dernier avec l'en-tête de Faber and Faber Ltd, 24 Russell Square, London. Ony trouve encore cinq lettres de T. S. Eliot, quatre d'entre elles portant l'en-tête de Faber andFaber Ltd40, l'autre celui de The Criterion. A Quarterly Review41.
Ces quelques lignes n'avaient pas d'autre ambition que de poser quelques jalons dansl'histoire de la relation entre Jean de Menasce et T. S. Eliot. Beaucoup de lacunes subsistent.Pour espérer les combler, ne serait-ce que partiellement, il faudrait pouvoir faire une étudeapprofondie de la correspondance des deux hommes. Elle seule, mieux que tout témoignagede seconde main, serait en mesure de nous révéler le contenu de leurs échanges, laprogression et l'évolution de leur amitié, ainsi que les motifs de leur rapprochement et lescauses de leur éloignement42. Mais, pour l'heure, on ne dispose d'aucune édition complètede la correspondance de Jean de Menasce43, et celle de T. S. Eliot, préparée par sa femmeValerie, ne couvre pour l'instant que la période 1889-192244. On peut espérer que deséditions ultérieures viendront combler ce vide.
JEAN DE MENASCE ET T. S. ELIOT 9
45 Irène Fernandez, dans son article déjà cité («À propos de Jean de Menasce traducteur», Mémoiredominicaine 11 (1997/2) 75-80), propose sur ce sujet des réflexions d'autant plus intéressantes qu'elless'appuyent sur le contenu d'une conférence inédite de Jean de Menasce sur la traduction de la poésie («OnTranslating Poetry», prononcée à Princeton en 1951 ou 1953). Grâce à la générosité de Madame Fernandez,le texte de cette conférence est reproduit en annexe du présent volume.
La liste des ouvrages offerts par Jean de Menasce à la bibliothèque du Balliol College mentionne unmémoire de maîtrise de M.-Th. Mallet sur la réception de T. S. Eliot en France. Ce mémoire de 1970 faitréférence à Jean de Menasce, mais j'ignore ce qu'il en dit, car je n'ai pas pu le consulter (la liste du BalliolCollege n'en donne pas le titre exact). L'étude la plus complète sur les traductions françaises de T. S. Eliot estcertainement celle de J. F. HOOKER, T. S. Eliot's Poems in French Translation : Pierre Leyris and Others, Ann Arbor,1983. Le résumé que j'ai pu en lire (T. S. Eliot. Man and Poet, Volume 2 : An Annotated Bibliography of aDecade of T. S. Eliot Criticism : 1977-1986, Compiled and Annotated by Sebastian D. G. Knowles and ScottA. Leonard, Orono, 1992, pp. 236-237) nous apprend par exemple que Pierre Leyris, le traducteur le plusconnu d'Eliot en français, s'est servi des travaux de Jean de Menasce et de quelques autres.
Cette étude, qui se voulait historique, a laissé de côté l'essentiel : l'art de la traduction deJean de Menasce. Il serait fort intéressant d'en faire une étude approfondie, de manière àcomprendre sa façon de travailler, la conception qu'il se faisait de la traduction et sonrapport à la poésie45. Dans le cadre restreint de cette contribution, je me contenterai de direque l'importance de ses traductions pour l'histoire de la réception du poète anglo-américainrend difficilement compréhensible l'oubli dans lequel elles ont été plongées. Seule leurdispersion dans des revues d'accès parfois difficile peut l'expliquer. En tout état de cause,le rôle d'initiateur que Jean de Menasce a joué dans la diffusion et la reconnaissance del'œuvre de T. S. Eliot en France justifie à lui seul qu'on les fasse sortir de l'ombre et qu'onles relise. Non pas qu'il faille les substituer aux traductions qui ont été faites après lui Sparmi lesquelles celles de Pierre Leyris sont les plus connues et sans doute aussi les plusbelles S, mais pour donner à entendre une autre voix, une autre musique, celle d'un hommequi s'était senti si proche du multilinguisme et de l'universalisme culturel d'Eliot qu'il a crupouvoir lui prêter sa langue et sa voix pour le faire connaître aux lecteurs de languefrançaise.
46 Ce texte, qu'Eliot a choisi de mettre en exergue de son poème dès 1922, est tiré du Satiricon de Pétrone(48, 8). Il est reproduit dans la traduction de Jean de Menasce, mais comporte des fautes typographiques quej'ai corrigées : S∂bulla, t∂ d◊leij et ¢podane√nd◊lw (des d se sont apparemment substitués par erreur auxq). Ni T. S. Eliot ni Jean de Menasce n'ont traduit ces lignes, qui signifient : «Et la Sibylle, donc! A Cumes, jel'ai vue moi-même de mes yeux suspendue dans une bouteille, et quand les enfants lui demandaient : "Sibylle,que veux-tu ?", elle répondait : "Je veux mourir"»; cf. L. AMPELIUS, Liber memorialis 8, 16. (Note de Jean-MichelRoessli)
LA TERRE MISE A NU
Pour Ezra Poundil miglior fabbro
Nam Sibyllam quidem Cumis egoipse oculis meis vidi in ampullapendere, et cum illi pueri dicerent,S∂bulla, t∂ q◊leij; respondebatilla, ¢poqane√nq◊lw46
I. S L'ENTERREMENT DES MORTS.
Avril est le plus cruel des mois, qui lèveLes lilas de la terre morte, mêleLe souvenir et le désir, éveilleLes racines assoupies sous la pluie du printemps.
5 L'hiver nous avait tenus chaud, qui couvreLa terre de neige oublieuse, nourritUn peu de vie avec des tubercules sèches.L'été nous a surpris tombant sur le StarnbergerseeEn averse : nous nous sommes arrêtés sous la colonnade
10 Et nous avons poursuivi, dans le soleil, jusqu'au Hofgarten.Et nous avons bu du café et parlé pendant une heure.Bingar keine Russin, stamm aus Litauen, echt Deutsch.Et quand nous étions enfants chez mon cousin l'archiducIl m'emmena sur son traîneau,
15 Et j'avais peur. Il me dit : Marie,Marie, tiens bon. Et la descente nous emporta.Dans les montagnes, c'est là qu'on se sent libre.Je lis presque toute la nuit, et l'hiver je vais dans le Midi.Qu'est-ce que ces racines qui s'accrochent et ces branches qui poussent
20 Sur ces débris pierreux ? Fils de l'homme,Tu ne sais et tu ne devines, car tu ne connaisQu'un amas d'images brisées que frappe le soleil,Où l'arbre mort n'abrite point, que le grillon ne relève point,Où le roc sec est sans bruit d'eau. Pourtant,
25 Il y a une ombre sous ce rocher rouge(Viens donc à l'ombre de ce rocher rouge),Et je te montrerai une chose qui n'estNi ton ombre au matin s'avançant derrière toi,Ni ton ombre le soir venant à ta rencontre;
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 11
30 Je te montrerai la terreur dans une poignée de poussière.
Frisch weht der WindDer Heimat zuMein Irisch Kind,Wo weilest du ?
35 « Tu m'as, l'an dernier, donné des jacinthes;Ils m'ont surnommée la fille aux jacinthes. »S Pourtant quand nous sommes revenus du jardin des jacinthesTrès tard, tes bras chargés et tes cheveux mouillés,Je ne pouvais parler, mes yeux se dérobaient,
40 Je n'étais ni vif ni mort, et je ne savais rien,Regardant au cœur de la lumière, du silence.Oed' und leer das Meer,
Madame Sosostris, chiromancienne illustre,Était fortement enrhumée, néanmoins,
45 Passe pour être la femme la plus clairvoyante d'Europe.Armée d'un vilain paquet de cartes : Voici, dit-elle,Votre carte, le marin phénicien noyé(Those are pearls that were his eyes ! Voyez.)Voici Belladonne, la Dame des Rochers,
50 La Dame des situations.Voici l'homme aux trois anses, et voici la Roue,Et voici le marchand borgne, et cette carte,Qui est blanche est ce qu'il porte sur le dos.Et qu'il m'est interdit de voir. Je ne trouve pas
55 Le Pendu. Craignez la mort par l'eau.Je vois des foules qui tournent en rond.Merci. Si vous voyez cette chère Madame EquitoneDites-lui que je lui apporte l'horoscope moi-même :Il faut être si prudent par ces temps !
60 Irréelle cité,Sous le brouillard marron d'une aurore d'hiver,London Bridge déversait une foule si lourde.Je n'aurais jamais cru que la mort eût tant défait d'hommes !Ils exhalaient des soupirs brefs et rares
65 Et chacun rivait son regard devant ses piedsRemontèrent la côte et descendit King William Street,Jusqu'au lieu où Sainte Marie Woolnoth sonne les heuresAvec un bruit sourd au dernier coup de neuf heures.Là j'aperçus un homme que je connaissais et je l'arrêtai d'un cri :
[« Stetson !70 Toi qui étais avec moi dans les navires à Mylae !
Le cadavre que l'an dernier tu as planté dans ton jardin,A-t-il commencé à lever ? Sera-t-il en fleur cette année ?
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 12
Ou bien le gel soudain a-t-il attaqué sa corbeille ?Oh ! keep the dog far hence, that's friend to men,
75 Or with his nails he'll dig it up again !Toi ! hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ! »
II. S UNE PARTIE D'ÉCHECS.
The Chair she sat in, like a burnished throneLuisait sur le marbre où la glaceAux supports travaillés, dont les vignes en fruit
80 S'entr'ouvraient aux regards d'un Cupidon doré(Tandis qu'un autre se couvrait les yeux de l'aile)Multipliait les feux des lustres à sept branchesReflétant la lumière sur la table où montaitA sa rencontre, la lueur de ses bijoux
85 Versée à profusion des écrins de satin.Dans des fioles d'ivoire et de verre de couleurEntr'ouvertes, sommeillaient ses étranges parfums.Onguents, poudres, liquides, qui troublaient, confondaient,Noyaient les sens dans les odeurs;
90 Montaient sur le vent frais venu de la fenêtre,Alourdissaient les flammes allongées des chandelles,Projetaient leurs fumées sur le laquearia,Émouvant le dessin des caissons du plafond.D'énormes bûches nourries de cuivre
95 Brûlaient, vert et orange, encadrées de pierre de couleurEt dans cette lumière triste nageait un dauphin sculpté.Dépeinte, au-dessus de la cheminée ancienne(Comme d'une fenêtre sur la scène rustique),La métamorphose de Philomèle, si brutalement forcée
100 Par le sauvage roi; or, là, le rossignolEmplit tout le désert de sa voix inviolableEt crie toujours au monde (et le monde poursuit) :Djag djag a des oreilles sales.Et d'autres souches fanées du temps
105 Étaient dépeintes sur les murs; formes fixéesQui se penchaient, penchées, étouffant la chambre cernée.Des bruits de pas glissaient dans l'escalier.Sous la lumière du feu, sous la brosse, ses cheveuxDressées en pointes de feu
110 Luisaient à devenir des mots, puis, sauvagement immobiles.
« J'ai mal aux nerfs ce soir. Oui, mal. Restez ici.Parlez-moi. Pourquoi ne parlez-vous jamais ? Restez.A quoi pensez-vous ? Quelle pensée ? Quoi ?Je ne sais jamais à quoi vous pensez. Pensez. »
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 13
115 Je pense que nous sommes dans la ruelle aux ratsOù les morts ont perdu leurs os.
« Quel est ce bruit ? »Le vent sous la porte.
« Et maintenant quel est ce bruit ? Que fait le vent ?120 Rien, encore rien.
« Rien,Ne savez-vous rien ? Ne voyez-vous rien ? Ne vous rappelez-vousRien ? »
Je me rappelle125 Those are pearls that were his eyes.
« Etes-vous vivant ou mort ? N'avez-vous rien en tête ? »Que
O O O O that Shakespeherian RagIt's so elegant
130 So intelligent.
« Que ferai-je maintenant ? Que vais-je faire ? »« Je vais sortir, comme je suis, et parcourir les rues,Les cheveux défaits. Que ferons-nous demain ?« Que ferons-nous jamais ? »
135 L'eau chaude à dix heuresEt s'il pleut, la limousine à quatre heuresEt nous ferons une partie d'échecs,Forçant des yeux sans paupières et attendant qu'on frappe à la porte.
Quand le mari de Lili fut démobilisé, j'lui dis140 J'n'y vais pas par quatre chemins, moi-même, que j'lui dis.
C'EST L'HEURE, ON FERME.Maintenant qu'Albert va revenir, arrange-toi un peu,Il voudra savoir ce que t'as fait de c't'argent qu'il t'a donnéPour t'acheter des dents. Oui, j'étais là.
145 Fais-les-toi enlever toutes, Lili, et achète un râtelier,Qu'il dit, je l'jure, j'peux pas te regarder comme ça.Et moi, j'peux pas non plus, que j'dis, et c'pauvre Albert,Qu'a été au front ces quatre ans, il voudra rigoler un peuEt si c'est pas avec toi, y en aura d'autres, que j'dis.
150 Ah ! c'est comme ça, qu'elle dit. Un peu ! que j'dis.Et ben, j'saurai à qui je dois ça, qu'elle dit, et m'regard de travers.
C'EST L'HEURE, ON FERME.Si t'aimes pas ça, t'as rien à dire, que j'dis.Y en a d'autres qui peuvent faire leur choix !
155 Mais si Albert fout le camp, ce n'sera pas faute d'être prévenue.T'as pas honte, que j'dis, d'avoir l'air si décatie,(Et ça n'a que trente et un ans !)C'est pas ma faute, qu'elle dit, faisant la tête,C'est ces cachets qu'j'ai pris pour l'faire passer, qu'elle dit
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 14
160 (Elle en a déjà eu cinq et a failli passer avec le dernier),Le pharmacien avait dit qu'ça irait, mais j'suis plus la même depuis.Ah ! t'es pas maline, que j'dis.Eh ! ben, si Albert n'te laisse pas tranquille, tant pis pour toi, que j'dis.Quand on n'veut pas d'enfants, c'est pas la peine de s'marier.
165 C'EST L'HEURE, ON FERME.Et le dimanche qu'Albert était revenu, ils avaient une jambe de porcEt m'avaient dit de venir dîner pour l'avoir tout beau, tout chaud,C'EST L'HEURE, ON FERME ;C'EST L'HEURE, ON FERME ;
170 Bonsoir, Bill ; Bonsoir, Lou ; Bonsoir, May ; Bonsoir.R'voir, Bonsoir, Bonsoir.Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, good night.
III. S LE SERMON DU FEU.
La tente du fleuve est rompue : les derniers doigts des feuillesS'accrochent et s'enfoncent dans la rive mouillée.
175 Le vent parcourt la terre brune en silence. Les nymphes s'en sont alléSweet Thames, run softly, till I end my song.Le fleuve n'emporte ni bouteilles vides, ni papiers à sandwichs,Ni mouchoirs de soie, ni cartons, ni bouts de cigarettes,Témoignages des nuits d'été. Les nymphes s'en sont allé,
180 Et leurs amis, héritiers désœuvrés des directeurs de banque,Sont partis sans laisser d'adresse.Sur les bords du Léman, je m'assis pour pleurer...Sweet Thames, run softly, till I end my song.Douce Tamise, coule calme, car mon chant n'est ni fort ni long,
185 Mais, derrière moi, j'entends dans la bise glacéeLe cliquetis des os et le ricanement dont toute la face est traversée.
Un rat se glissa doucement à travers la végétation,Traînant son ventre visqueux sur la rive.Tandis que je pêchais dans le sombre canal
190 Une soirée d'hiver, derrière l'usine à gaz.Songeant au naufrage du Roi, mon frère,Et à la mort, auparavant, du Roi, mon père,Corps blancs nus sur le sol bas et humide,Os rejetés dans la petite mansarde basse et sèche
195 Que remue seul le pied du rat le long de l'an.Mais derrière moi, de temps en temps, j'entendsLe bruit des trompes et des autos qui conduirontSweeney vers Mrs. Porter au Printemps.O the Moon shone bright on Mrs. Porter
200 And on her daughterThey bathe their feet in soda waterEt ô ces voix d'enfants, chantant dans la coupole !
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 15
Twit, Twit, Twit,Djag, djag, djag, djag, djag, djag,
205 Si brutalement forcéeTeru
Irréelle Cité,Sous le brouillard marron d'un méridien d'hiver,M. Eugenidès, marchand à Smyrne,
210 Mal rasé, la poche pleine de raisins secs,T et AP Londres, documents à vue,M'invita en français démotiqueA déjeuner au Cannon Street HôtelSuivi d'un weekend au Métropole.
215 A l'heure mauve, quand les yeux et les dosSe relèvent du bureau, quand le moteur humain attendComme un taxi attend battantMoi, Tirésias, encore qu'aveugle battant entre deux vies,Vieillard aux seins ridés de femmes, j'ai pu voir
220 A l'heure mauve, l'heure du soir qui peine au retour,Ramenant le marin du large,La dactylo, à l'heure du thé, range son petit déjeuner,Allume son poêle et étale son repas en bottes,Derrière la croisée déployée en péril
225 Ses tricots qui sèchent, atteints des derniers rayons du jour.Sur le divan (la nuit, son lit) s'empilentBas, pantoufles, chemises et corsets.Moi, Tirésias, vieillard aux tétons ridés,J'ai perçu ce spectacle et j'ai prédit la suite.
230 J'attendais, moi aussi, la visite prévue.Il arrive, lui, le jeune homme bourgeonnant,Employé d'une petite agence, avec un seul regard hardi,Un des obscurs à qui sied l'assuranceComme un chapeau haut de forme à un millionnaire de Bradford,
235 L'instant, il le devine, est maintenant propice.Le repas est fini, elle est lasse et s'ennuie,Il entreprend de l'engager par des caressesQui, sans être appelées, ne sont pas repoussées.Excité, résolu, il attaque au plus vite,
240 Rien ne vient s'opposer au progrès de ses mains;Sa vanité n'exige point de réciproque,Et de l'indifférence se fait un bon accueil(Et moi Tirésias, j'ai d'avance éprouvéTout ce qui s'est passé sur ce divan ou lit,
245 Moi qui me suis assis au pied des murs de ThèbesEt qui ai pénétré au plus profond des morts),Dépose, bienveillant, le baiser de la finEt descend à tâtons l'escalier sans lumière.
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 16
Elle jette en passant un regard dans la glace250 A peine consciente de son amant parti;
Son cerveau lui accorde une demi-pensée :« Eh ! bien, voilà, c'est fini et tant mieux. »When lovely woman stoops to folly S etParcourt sa chambre, seule, après
255 Elle lisse ses cheveux d'une main mécaniqueEt met un disque au gramophone.
« This music crept by me upon the waters »,Et tout le long du Strand, vers Queen Victoria Street.O Ville, Ville, j'entends parfois
260 Auprès d'un bar public de Lower Thames StreetLe doux vagissement de quelque mandoline,Et au dedans, un bruit de verres et de voixOù les marchands de poisson paressent à midi.Où les Murs de Magnus Martyr recèlent
265 Une inexplicable splendeur de blancheur et d'or d'Ionie.
Le fleuve sueHuiles et goudrons.Les chalands voguentAu retour des marées,
270 Voiles rouges,LargesSous le vent, tournent sur la vergue lourde.Les chalands essuientDes buches à la dérive
275 Vers Greenwich,Par delà l'Ile aux Chiens.
Weialala leia.Wallala leialala.
Élisabeth et Leicester,280 Avirons battants
La proue forméeD'une conque d'orRouge et or.L'onde soudaine
285 Effleure les deux rives.Vent du Sud-EstEmportant au fil du courantLa volée de cloches,Tours blanches.
290 Weialala leia.Wallala leialala.
« Trams et arbres poudreux,Highbury m'a fait, Richmond et Kew
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 17
M'ont défait. A Richmond, je levai un genou295 Engourdi dans le fond d'un canot trop étroit. »
« Mes pieds sont à Moorgate et mon cœurSous mes pieds. Après la chose,Il pleura. Il promit un nouveau départ.Je ne dis rien. De quoi lui en voudrais-je ? »
300 « Sur les sables de MargateJe ne puis rapporterRien à rien.Les ongles cassés de mains sales.Mes gens, modestes gens, qui ne demandent
305 Rien. »
la la
Je m'en fus alors à CarthageArdent, ardent, ardent, ardent.O Seigneur, tu me cueilles ;
310 O Seigneur, tu cueilles,
Ardent.
IV. S LA MORT PAR L'EAU.
Phlébas, le Phénicien, mort depuis quinze jours,Oublia le cri des mouettes, et la houle lourde des mersEt les gains et les pertes.
315 Une lame de fondLui picora les os en murmures. Par montées et par chutes,Il refit les étapes de sa vie antérieure,En pénétrant le tourbillon.
Juif ou Gentil,320 O toi, qui fais tourner la roue et regardes d'où vient le vent,
Pense à Phlébas, qui a, jadis, été fort et beau comme toi !
V. S CE QUE DIT LE TONNERRE.
Après le feu des torches, rouge sur les visages en sueur,Après le silence gelé dans les jardinsAprès l'agonie au milieu des pierres
325 Lamentation et pleurs,Prisons, palais et résonancesDes tonnerres printaniers sur les monts éloignés,Le vivant est mort aujourd'hui,Nous qui vivions nous nous mourons
330 Avec un peu de patience
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 18
Il n'y a pas d'eau, seul le rocher,Le rocher et pas d'eau et la route poudreuse,La route en lacets là-haut dans la montagne,Montagnes de rocher sans eau,
335 S'il s'y trouvait de l'eau, nous ferions halte pour nous désaltérerAu milieu des rochers on ne peut s'arrêter ni considérer.La sueur est séchée, les pieds sont dans le sable.Si seulement il y avait de l'eau parmi les rochers,Montagne morte bouche aux dents carriées qui ne peut cracher
340 On n'y peut demeurer debout, ni s'y coucher ni s'y asseoir.Il n'y a pas même de silence dans les montagnes,Mais le tonnerre stérile et sec, sans pluie.Il n'y a pas même de solitude dans les montagnes,Mais des visages rouges et maussades ricanent et menacent
345 Aux portes des maisons de boue craquelée.
S'il y avait de l'eauEt point de rocher,S'il y avait du rocherEt aussi de l'eau,
350 Et de l'eau,Une source,Un lac dans les rochers,S'il n'y avait que le bruit de l'eauSans la cigale,
355 Ou l'herbe sèche qui chante,Mais un bruit d'eau sur le rocherOù l'ermite-pêcheur chante dans les pinsDrip, drop, drip, drop, drop, drop, drop,Mais il n'y a pas d'eau.
360 Qui est le troisième qui marche toujours à côté de toi ?Quand je compte, il n'y a que toi et moi ensemble.Mais quand je regarde en aval, la route blanche etIl y a toujours quelqu'un d'autre qui marche à côté de toi,Qui glisse enveloppé d'un manteau brun, avec un capuchon.
365 Homme ou femme, je ne saisS Mais qui est là, qui marche de l'autre côté de toi ?
Quel est ce bruit très haut dans l'air ?Murmure de maternelles lamentations.Qu'est-ce que ces hordes encapuchonnées qui grouillent
370 Sur des plaines sans fin, trébuchant sur la terre craquelée,Ceintes du seul horizon plat ?Quelle est cette cité par delà les montagnes ?Craquements et réformes et éclats dans l'air mauve,Tours qui croulent,
375 Jérusalem, Athènes, Alexandrie,Vienne, Londres,
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 19
Irréelles.
Une femme étira très fort ses longs cheveux noirs,Et sur le violon de ces cordes fit murmurer de la musique,
380 Et des chauves-souris au visage d'enfantDans la lumière mauve sifflèrent en battant de l'aile,Et rampèrent, la tête en bas, le long d'un mur noirci,Et dans l'air des tours à l'enversSonnaient leurs cloches évocatrices qui battaient l'heure,
385 Et des voix chantaient dans les citernes vides et dans les puits taris.
Dans ce trou désolé au milieu des montagnes,Dans le clair de lune affaibli, l'herbe chanteSur les tombes retournées, autour de la chapelle.Une chapelle vide où ne vit que le vent,
390 Sans fenêtres, et la porte oscille.Des os secs ne peuvent faire de mal à personne.Seul, un coq sur la girouette,Co co rico, co co rico,Dans un éclair. Puis une bouffée d'air humide
395 Portant la puie.
Le Gange était affaissé et les feuilles engourdiesS'apprêtaient à la pluie, tandis que les nuages noirsS'assemblaient au lointain, par-dessus l'Himavant,La jungle s'accroupissait, recroquevillée en silence,
400 Alors le tonnerre parla.DA,Datta : qu'avons-nous donné ?Mon amie, le sang faisant battre mon cœur,La terrible hardiesse d'un instant d'abandon
405 Qu'une ère de prudence ne peut jamais reprendre,Par cela nous avons été, par cela seulQui ne figurera pas dans nos nécrologiesNi dans les souvenirs que drape l'araignée bienfaisante,Ni sous le sceau que rompt le notaire sec
410 Dans nos chambres videsDA,Dayadhvam : j'ai entendu la clefTourner une fois dans la serrure, une seule fois.Nous pensons à la clef, chacun dans sa prison
415 A penser à la clef, confirme sa prison.Seules, à la nuite tombante, des rumeurs éthéralesFont revivre un instant un Coriolan défait.DA,Damyata : le navire répond
420 Dispos sous la main habile à la voile et à l'aviron,La mer était tranquille, ton cœur eût répondu
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 20
Dispos à une invite, battant docilementSous des mains tutélaires.
Assis sur le rivage,425 Je pêchai; derrière moi la plaine aride.
Et moi, mettrai-je au moins de l'ordre dans mes terres ?
London Bridge is falling down, falling down, falling down,Poi s'ascose nel foco che gli affinaQuando fiam ceu chelidon. O hirondelle, hirondelle,
430 Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie.
J'ai roulé ces fragments à l'appui de mes ruines,Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe.Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih, Shantih, Shantih.
NOTES
LA TERRE MISE À NU, d'Eliot, est suivie de notes explicatives et de références.Nous les avons traduites ci-dessous en y ajoutant quelques notes que le lecteur français nous semble
demander; mais nous avons pris soin de distinguer celles-ci par le signe §.Ces références se rapportent aux emprunts faits par Eliot à d'autres auteurs. Lorsque ces emprunts sont
dans la langue originale, nous les avons reproduits dans le texte en italique. Lorsque Eliot les a rendus en anglais,nous les avons traduits à notre tour; mais ils sont imprimés dans le texte en caractères ordinaires. Enfin, nous avonsnaturellement laissé les emprunts anglais en anglais en y adjoignant une traduction dans les notes. (N. d. T).
Outre son titre, le plan et une bonne partie du symbolisme de détail de ce poème m'ont été suggérés par le livre de Miss JessieL.-Weston sur la légende du Graal : From Ritual to Romance Londres, Macmillan). A vrai dire, je lui dois tant, que le livrede Miss Weston résoudra les difficultés du poème beaucoup mieux que ne le peuvent faire mes notes. Je le recommande donc,indépendamment du grand intérêt qu'il présente par lui-même, à tous ceux qui jugeront que le poème en vaut la peine. Je doisbeaucoup, également, à un autre ouvrage d'anthropologie, qui est de ceux qui ont exercé une action profonde sur notre génération;j'entends Le Rameau d'Or; je me suis particulièrement servi des deux volumes intitulés : Atthis, Adonis, Osiris. Le lecteurde ces ouvrages reconnaîtra immédiatement dans le poème certaines allusions à des rites de végétation. (NOTE DE L'AUTEUR.)
I. S L'ENTERREMENT DES MORTS
(20) Cf. Ezekiel, II, 1.(31) Tristan und Isolde, I, vers 5-8.(42) Ibid., III, vers 24.(46) Je ne connais pas exactement la composition du paquet de cartes du Tarot, dont je me suis écarté,
comme on le voit pour autant que cela me convenait. Le Pendu, qui appartient au paquet traditionnel, meconvient doublement : parce que je l'associe mentalement au Dieu Pendu de Frazer, et parce que jel'associe au personnage encapuchonné du passage des Disciples d'Emmaüs, dans la cinquième partie. LeMarin phénicien et le Marchand apparaissent plus loin, comme aussi les «foules», et la Mort par l'eau quis'opère dans la quatrième partie. Quant à l'Homme aux Trois Anses (qui fait réellement partie du paquetde Tarot) je l'associe tout à fait arbitrairement au Roi pêcheur lui-même.
(48) (The Tempest.
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 21
Ces perles ont été ses yeux) §.(60) Cf. Baudelaire :
Fourmillante cité, cité pleine de rêves,Où le spectre en plein jour raccrocha le passant.
(63) Cf. Inferno, III, 55-57 :« Si lunga tratta
di gente, ch'io non avrei mai credutoche morte tanta n'avesse disfatta. »
(68) Phénomène que j'ai souvent constaté.(74) Cf. la Complainte du White Devil de Webster :
(O éloigne le Chien, qui est l'ami de l'homme,Sinon, avec ses pattes, il le déterrera) §.
(78) V. Baudelaire. Préface aux Fleurs du Mal.(Sainte-Marie-Woolnoth est une église et King William Street une rue de la Cité de Londres, enplein centre d'affaires) §.
II. S UNE PARTIE D'ECHECS.
(77) Cf. Anthony and Cleopatra, II, 2, v. 190.(Le siège qui la portait, comme un trône poli) §.
(92) Laquearia. V. Énéide, I, 726 :dependent lychni laquearibus aureis
incensi, et noctem flammis funalia vincunt.(98) Scène rustique. V. Milton, Paradise Lost, IV, 140.(99) V. Ovide, Métamorphoses, VI, Philomela.(100) Cf. Troisième Partie, vers 204.(115) Cf. Troisième Partie, vers 195.(118) Cf. Webster : « Is the wind in that door still ? »
(Le vent est-il encore dans la porte ?) §(126) Cf. la partie d'échecs dans Women beware Women de Middleton.(128-130) (O O O ce rag Shakespeaherien :
C'est si élégant,Si intelligent) §.
(141) (Annonce de l'heure de clôture des cabarets en Angleterre) §.
III. S LE SERMON DU FEU.
(176) V. Spenser, Protalamion(Douce Tamise, coule calme tant que durera ma chanson §)
(192) Cf. The Tempest, I, 2.(196) Cf. Day, Parliament of Bees :
When of the sudden, listening you shall hearA noise of horns and hunting, which shall bringActaeon to Diana in the Spring,Where all shall see her naked skin...(Quand tout d'un coup, vous entendrezUn bruit de trompes et de chasse, qui mèneraActéon vers Diane au printempsEt tous pourront voir sa peau nue) §.
(197) Cf. Marvell, To his Coy Mistress.(199) Je ne sais d'où provient la ballade dont sont extraits ces vers :
Elle m'a été rapportée de Sydney (Australie),(Oh ! la lune brillait sur Madame PorterEt sur sa fille,Elles se lavent les pieds dans du soda) §.
(202) V. Verlaine, Parsifal.(210) Les raisins secs étaient cotés « Transport et Assurance Payés jusqu'à Londres »; et le récépissé était remis
à l'acheteur contre paiement de la traite à vue.
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 22
(218) Tirésias, quoique simple spectateur, et nullement « personnage », n'en est pas moins la personne la plusimportante du poème, celle qui synthétise toutes les autres. De même que le marchand borgne,marchand de raisins secs, finit par se confondre avec le Marin Phénicien, lequel n'est pas entièrementdistinct de Ferdinand, Prince de Naples, de même toutes les femmes ne sont qu'une femme, et les deuxsexes se rejoignent en Tirésias. A vrai dire le « sujet » du poème est ce que voit Tirésias. Tout le fragmentd'Ovide [III, 320-338] est d'un grand intérêt au point de vue anthropologique :
... Cum Junone jocos et major vestra profecto estQuam, quae contingit maribus, dixisse, « voluptas ».Illa negat; placuit quae sit sententia doctiQuarere Tiresiae : venus huic erat utraque nota.Nam duo magnorum viridi coeuntia silvaCorpora serpentum baculi violaverat ictuDeque viro factus, mirabile, femina septem,Egerat autumnos; octavo rursus eosdem,Vidit et « est vestre si tanta potentia plagae »,Dixit « ut auctoris sortem in contraria mutet,Nunc quoque vos feriam ! » Percussis anguibus isdem,Forma prior rediit genetivaque venit imago.Arbiter hic igitur sumptus de lite jocosa,Dicta Jovis firmat; gravius Saturnia justoNec pro materia fertur doluisse suiqueJudicis aeterna damnavit lumine nocte,At pater omnipotens (neque enim licet inrita cuiquam,Facta dei fecisse deo) pro lumine adempto,Scire futura dedit poenamque levavit honore.
(221) Ceci peut bien n'avoir pas l'exactitude des vers de Sappho, mais je pense au pêcheur côtier qui rentre àla tombée de la nuit.
(253) V. Goldsmith, la chanson du Vicar of Wakefield.(Quand belle femme s'abandonne) §.
(257) The Tempest, voir plus haut :(Cette musique glissait à mes côtés sur l'eau) §.
(264) L'intérieur de Saint-Magnus-Martyr est à mon avis un des plus beaux intérieurs de Wren. Voir TheProposed Demolition of City Churches (P. S. King et Son, Ltd).
(266) Ici commence la Chanson des (trois) Filles de la Tamise. Du vers 292 au vers 306 (inclus) elles parlentalternativement. V. Götterdämmerung, III, I : les Filles du Rhin.
(276) V. Fronde, Elisabeth, I, chapitre IV, lettre de De Quadra à Philippe II d'Espagne :« Dans l'après-midi, nous étions sur la nef à regarder les jeux nautiques. La reine était seule avec LordRobert et moi sur la poupe, et ils commencèrent à badiner, tant et si bien que Lord Robert dit enfin, enma personne, que rien ne les empêcherait de se marier si la reine le voulait bien. »
(293) Cf. Purgatorio, v. 133 :« Ricorditi di me, che son la Pia;Siena mi fe, disfecemi Marema. »
(307) V. Saint Augustin, Confessions : « Je m'en fus alors à Carthage où un chaudron d'amours impures mebourdonna aux oreilles ».
(308) Le texte complet du Sermon du Feu du Bouddha (qui correspond en importance au Sermon sur laMontagne) dont sont extraites ces paroles se trouve traduit dans Buddhism in Translation (Harvard OrientalSeries) du regretté Henry Clarke Warren. M. Warren a été un des premiers pionniers des étudesbouddhiques en Occident.
(309) Egalement des Confessions de saint Augustin. Ce rapprochement de deux représentants de l'ascétismeoriental et occidental, au point culminant de cette partie du poème, n'est pas fortuit.
V. S CE QUE DIT LE TONNERRE.
Au début de la cinquième partie, il est fait usage de trois thèmes : le pèlerinage à Emmaüs, la marche versla Chapelle Dangereuse (voir le livre de Miss Weston) et la décadence actuelle de l'Europe orientale.
(357) Il s'agit du Turdus aonalaschkae pallasii, l'hermit-thrush, que j'ai entendu dans la province de Québec.Chapman dit : « il niche dans les forêts désertes et dans les fourrés... Son chant n'est remarquable ni par
LA TERRE MISE À NU DE T. S. ELIOT TRADUIT PAR JEAN DE MENASCE 23
la variété, ni par le volume, mais par la douceur du ton et l'exquise modulation, qui n'ont pas leurspareilles » (Handbook of Birds of Eastern North America). Son « chant d'eau courante » est renommé à justetitre.
(360) L'inspiration des vers suivants s'est renforcée d'un récit d'exploration polaire (je ne sais plus au justelaquelle, mais je crois qu'il s'agit de celle de Shackelton) : on rapportait que les explorateurs, à bout deforces, avaient toujours l'illusion d'être un de plus qu'ils ne pouvaient compter.
(366-376) Cf. Hermann Hesse, Blick ins Chaos : Schon ist halb Europa, schon ist zumindest der halbeOsten Europas auf dem Wege zum Chaos, fährt betrunken im heiligem Wahn am Abgrund entlang undsingt dazu, sing betrunken und hymnisch wie Dmitri Karamasoff sang. Ueber dieser Lieder lacht derBürger beleidigt, der Heilige und Seher hört sie mit Tränen.»
(401) « Datta, dayadhvam, damyata » (Donne, compatis, dirige). La légende du tonnerre se trouve dans leBrihadaranyaka-Upanishad, 5, 1. Une traduction en est donnée par Deussen : Sechzig Upanishads des Veda,p. 489.
(408) Cf. Webster, The White Devil, V, VI.« ... they'll remarry
Ere the worm pierce your winding sheet, ere the spiderMake a thin curtain for your epitaphs. »
(Ils se remarierontAvant que le vers n'ait percé ton suaire, avant que l'araignéeN'ait tissé un voile fin pour tes épitaphes) §.
(412) Cf. Inferno, XXXIII, 46 :« ed io sentii chiavar l'uscio di sotto,all orribile torre ».
Voir aussi E. H. Bradley, Appearance and Reality, p. 346 : « Mes sensations externes ne me sont pas moinsprivées que ne le sont mes pensées et mes sentiments. De toute façon, mon expérience gît à l'intérieurde mon cercle, étanche à l'extérieur, et encore que leurs éléments soient semblables, chacune de cessphères est opaque à celles qui l'entourent... Bref, en tant qu'expérience qui apparaît dans une âme,l'univers est particulier à chacun, et chaque âme en a la privauté. »
(425) V. Weston, From Ritual to Romance; le chapitre sur le Roi Pêcheur.(427) (Premier vers d'une chanson populaire anglaise :
« le Pont de Londres croule, croule ») §.(428) V. Purgatorio, XXVI, 148 :
Ara vos prec, per aquella valorQue vos guida al som de l'escalina,Sovegna vos a temps de ma dolor.Poi s'ascose nel foco chegli affina.»
(429) V. Pervigilium Veneris. Cf. Philomèle dans les deuxième et troisième parties.(430) V. Gérard de Nerval, Sonnet El Desdichado.(432) V. Kyd, Spanish Tragedy :
Or donc, je te rapiécerai.Jérôme est redevenu fou) §.
(434) Shantih. Répété ainsi, ce mot est la fin consacrée d'un Upanishad. « La Paix qui dépasse l'entendement» traduit faiblement le sens de ce mot.
T. S. Eliot.
Traduction de JEAN DE MENASCE,(revue et approuvée par l'auteur,d'après la dernière édition de POEMS (1909-1925)).
Paru dans Jean de Menasce (1902-1973), textes réunis par Michel Dousse et Jean-MichelRoessli, Fribourg 1998, p. 39-53 et 205-225.