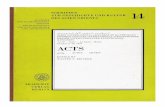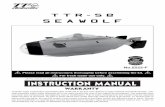s the giant outer planets - Jupiter. Saturn, Uranus, and Neptune
J.-Y. Eveillard, Y. Maligorne, Une statue de Neptune Hippius à Douarnenez
-
Upload
univ-brest -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of J.-Y. Eveillard, Y. Maligorne, Une statue de Neptune Hippius à Douarnenez
actes du xe colloque international sur l’art provincial romain, p. 557 à p. 563
Jean-Yves Éveillard, Yvan Maligorne
Une statue de Neptune Hippius à Douarnenez (Finistère)
Abstract : A fragmentary statue representing Neptunus has recently been discovered on a |
beach at Douarnenez (France). Its inscribed base, bearing a dedication to an otherwise unknown
Neptunus Hippius, was identified in 1948, only a few meters away. This study provides a short
examination of this monument, dedicated by a curator civium Romanorum.
Le 31 mars 2004 a été découverte fortuitement sur la plage du Ris à Douarnenez (Finistère) une statue en granite incomplète mais identifiable avec Neptune grâce à l’ un de ses attributs canoniques. C’ est à quelques mètres de cet endroit qu’ a été récupérée en 1948 une base inscrite portant une dédicace à la même divinité 1. La proximité des deux découvertes, l’ utilisation du même matériau, les proportions respectives de la base et de la statue permettent de les rapprocher. Cette découverte nous a amenés à réexaminer la base et à proposer une approche globale du monument 2.
Le contexte de la double découverte
La statue a été découverte sur la plage du Ris à Douarnenez, à la limite des plus hautes mers (fig. 1). Elle gisait face contre terre, enfoncée dans un lit de sable et de petits galets. La base inscrite se trouvait à l’ air libre à quelques mètres à l’ ouest lorsqu’ elle fut remarquée en 1948 3. Les deux éléments gisaient au pied d’ une micro-falaise et on peut penser qu’ ils en sont tombés 4. En 1973, on y voyait en coupe des murs ainsi qu’ un sol recouvert d’ une épaisse couche de cendres 5. Après leur chute, les deux blocs ont dû être exposés un certain temps aux intempéries et probablement roulés par la mer avant d’ être enfouis dans le cordon littoral de sable et de galets : c’ est ce dont témoignent les cassures émoussées et les reliefs atténués.
Les environs du lieu de découverte abondent en vestiges de l’ époque romaine : bassins de salaisons, habitats, thermes 6. Les nombreux établissements de salaisons disséminés sur le pourtour de la baie de Douarnenez attestent
1. Merlat 1952.2. Éveillard 2005, 2006, 2007.3. Merlat 1952, p. 67.4. Nous remercions vivement M. Josick Peuziat pour les renseignements qu’ il nous a fournis sur l’ aspect du littoral ancien.5. Sanquer 1973b, p. 23-78.6. Galliou 1989 ; Le Goffic, Peuziat 1999.
J.-Y. Éveillard, Y. Maligorne • Une statue de Neptune Hippius à Douarnenez (Finistère)
558
que cette activité était largement implantée 7. Dans ce contexte, la découverte d’ un monument dédié à Neptune n’ a rien de surprenant.
La statue
La statue a été retrouvée incomplète (fig. 2). Il manque la tête, le bras droit, et elle est brisée au milieu des mollets. Les dimensions de la partie conservée sont les suivantes : hauteur : 0,60 m ; largeur : 0,36 m ; profondeur : 0,20 m.
Si l’ on se fonde sur un canon de 6 employé pour l’ Hercule en marbre retrouvé sur le site voisin des Plomarc’ h 8 et qui semble assez proche de celui de notre statue, le personnage entier devait mesurer environ 0,80 m. En ajoutant 0,15 m pour la plinthe, on atteint une hauteur totale qui approche le mètre.
Le matériau est un leucogranite dit “granite de Locronan”, à grain fin-moyen, identique à celui que l’ on peut voir dans la carrière abandonnée du Mez en Locronan, située à 4,5 km. La pierre est jaunâtre, un peu altérée, caractéristiques qui la différencient de la base, plus claire et moins oxydée, mais qui peut avoir été extraite de la même carrière (expertise Louis Chauris). C’ est un matériau moyennement apte à la sculpture, ce qui ne fait que valoriser le résultat obtenu par l’ artiste. Ainsi, pour composer avec les contraintes que la pierre lui imposait, il a habilement transformé la ronde bosse en haut-relief en utilisant comme fond la draperie qui recouvre tout l’ arrière du corps. Son savoir-faire se mesure également au rendu précis des muscles pectoraux et abdominaux, encore appréciable malgré l’ usure. Le galbe des cuisses est très réussi, mais, à son passif, la partie inférieure du corps semble trop massive comparée au torse. Le personnage était hanché, en appui sur sa jambe gauche, la jambe droite étant relâchée et légèrement décalée vers l’ avant. Le bras gauche est tombant et la main tient, plaquée contre la
7. Sanquer, Galliou 1972.8. Moitrieux et al. 2003, p. 584.
Fig Ο . 1. Carte des structures d’ époque gallo-romaine de la plage du Ris en
Douarnenez et Kerlaz (d’ après Le Goffic, Peuziat 1999) et emplacement de la
découverte de la statue.
Les ateliers de sculpture régionaux : techniques, styles et iconographie
559
Fig Ο . 2. La statue de Neptune du Ris en Douarnenez (Finistère). a. Vue de face ; b. Profil gauche (cl. S. Goarin, Musée départemental breton, Quimper).
J.-Y. Éveillard, Y. Maligorne • Une statue de Neptune Hippius à Douarnenez (Finistère)
560
hanche, une forme arrondie qui se prolonge par un appendice jusqu’ à la pliure du coude. En éclairage rasant, le bec et la queue d’ un petit dauphin, l’ un des attributs canoniques de Neptune, peuvent être parfaitement distingués. Le bras droit se détachait du corps à l’ horizontale (ou éventuellement replié en V) et s’ appuyait certainement sur un trident, second attribut canonique de Neptune. Cette position est suggérée par l’ arrachement du bras au départ de l’ épaule et par le pan de draperie qui le soutenait sous l’ aisselle.
Le Neptune du Ris se rattache à un schéma très répandu en Gaule et dans l’ ensemble du monde romain sur des supports divers et avec des variantes nombreuses 9. Il est semblable à celui du Zeus Nemeios de Lysippe, dans lequel le trident et le dauphin sont remplacés par le sceptre et le foudre.
La statue trouve pleinement sa place dans une série de sculptures en granite limitée géographiquement à l’ arrière-pays de Douarnenez et dont il n’ existe pas d’ équivalent dans le reste de la Bretagne 10. La découverte du Ris confirme la présence de sculpteurs maîtrisant le façonnement de ce matériau difficile. Les indices font défaut pour dater leur activité. L’ analyse de l’ inscription de la base peut contribuer à combler cette lacune.
La base
Longue de 0,73 m, profonde de 0,55 m et haute de 0,56 m, la base présente un plan pentagonal. Les faces latérales sont assez soigneusement traitées et la face arrière est brute. Sur le lit de pose sont conservés quatre trous de scellement. L’ inscription, érodée et lisible seulement en lumière rasante, est composée de capitales plutôt régulières et soumise à une mise en page assez rigoureuse, un effort ayant été fait pour centrer les lignes ; cependant, l’ alignement horizontal laisse parfois à désirer. Le champ épigraphique est ceinturé par un cadre lisse. La première lecture, proposée par P. Merlat 11, a été sérieusement amendée par R. Sanquer 12, que nous suivons à un détail près : l’ invocation initiale du numen Augusti nous semble devoir être résolument écartée ; on n’ observe pas la moindre trace d’ un n en tête de la première ligne, et les trois lettres aug sont parfaitement centrées.
Aug(usto et) / Neptuno Hippio / C(aius) Varenius Voltin(ia tribu) / Varus c(urator) c(ivium) R(omanorum) (quartum) / posuit.
La dédicace nous renseigne d’ abord sur l’ identité du dieu, Neptunus Hippius. Il s’ agit là de la première mention épigraphique 13 d’ une épithète documentée par des sources littéraires 14. Comme Neptunus Equester, Neptunus Hippius est l’ équivalent latin d’ un Poseidon Hippios bien attesté ; l’ épithète étant une simple translittération dont la finale est latinisée, elle renvoie selon toute probabilité à un milieu fortement hellénisé. La mention de l’ empereur régnant n’ a rien pour surprendre et ne tranche pas avec les usages épigraphiques régionaux 15.
9. LIMC VII, s.v. “Poseidon / Neptunus” (E. Simon 1994) et LIMC VI, s.v. “Neptunus in den nordwestlichen Provinzen” (G. Bauchhenß 1994).10. Éveillard 2007, p. 126-127.11. AE, 1952, 22 = ILTG, 338 = AE, 1953, 112.12. Sanquer 1973a, p. 218-225 (= AE, 1999, 1070).13. Ibid., p. 224.14. Festus, 101. Arnaldi 1997, p. 226, note qu’ en Italie, Neptunus n’ est jamais qualifié d’ Equester et que le seul équivalent de Poseidon Hippios y est Consus.15. CIL XIII, 3096, 3101, 3104.
Les ateliers de sculpture régionaux : techniques, styles et iconographie
561
Le dédicant est vraisemblablement un étranger à la cité. Plaide d’ abord en ce sens sa fonction de curator civium Romanorum : ces corpora pouvaient accueillir des indigènes ayant reçu la citoyenneté, mais ils avaient plutôt vocation à recevoir des allogènes ; selon W. van Andringa, étaient concernés au premier chef des citoyens ne disposant pas du domicilium dans leur cité d’ accueil et ayant besoin de se regrouper pour défendre leurs intérêts 16. Son état civil permet peut-être de préciser ces propositions. Le gentilice Varenius, d’ origine italienne, est bien documenté en Gaule Narbonnaise, et la très grande majorité des occurrences provient de Nîmes ou du territoire des Volques Arécomiques 17. Enfin, la Voltinia est la tribu où César et Auguste inscrivirent les nouveaux citoyens de Transalpine, sauf dans les colonies de vétérans ; il est vrai cependant que la mesure affecta aussi la Comata, comme le prouvent les exemples des Santons et des Tricasses 18.
Revenons sur la fonction du dédicant. L’ inscription de Douarnenez est le seul document qui signale une répétition de la charge de curateur 19. Le fait que C. Varenius Varus ait occupé quatre fois ce poste peut être interprété de deux façons : on pourrait en déduire que sa stature était telle qu’ il s’ est imposé durablement comme
16. Andringa 1998, p. 171-173.17. CIL XII, 2760, 2789, 3020, 3780 et 4004, AE, 1963, 70.18. Maurin 1978, p. 160.19. Sur les curateurs des associations de citoyens romains, Gogniat Loos 1994, p. 31-33.
Fig Ο . 3. La dédicace à Neptune Hippius (cl. S. Goarin, Musée départemental breton, Quimper).
J.-Y. Éveillard, Y. Maligorne • Une statue de Neptune Hippius à Douarnenez (Finistère)
562
le meilleur représentant du groupe des cives Romani installés chez les Osismes ; on peut cependant se demander si ce groupe était très étoffé et si la répétition des curatèles n’ est pas l’ indice d’ une absence de concurrents ou du manque d’ envergure des autres membres de l’ association. En l’ absence de toute précision géographique, on est en droit de supposer que le ressort de la curatèle est la civitas. L’ érection de la dédicace à Douarnenez ne prouve pas que c’ est là que le conventus avait son siège, encore moins que l’ association avait une structure fédérale, avec un siège au chef-lieu (Carhaix-Vorgium) et des succursales sur le territoire 20. Il semble cependant très probable – et nous ne faisons ici que reprendre une hypothèse déjà formulée par R. Sanquer et souvent reprise depuis – que la présence de ces cives Romani était d’ abord liée à l’ activité de production de garum et de salaisons 21. Or, c’ est dans l’ actuelle Douarnenez et ses environs immédiats qu’ ont été découvertes les officinae les plus nombreuses et les plus importantes, ce qui fait de ce secteur l’ épicentre d’ un réseau réparti sur l’ essentiel du littoral de la baie de Douarnenez 22. Ainsi, il n’ est pas impossible que les cives Romani aient eu leur schola à Douarnenez, et que les découvertes successives de la dédicace et de la statue en indiquent l’ emplacement. Les parentés architecturales entre maisons et sièges d’ associations ne facilitent pas l’ identification de ces derniers 23, et peut-être les vestiges du bâtiment ont-ils été anciennement mis au jour sans que leur fonction ait été identifiée. L’ inscription ne dit rien des circonstances de l’ érection de la statue, mais le “posuit” final, très neutre, invite a priori à exclure tout contrat votif.
Dernier point sur lequel le document peut être sollicité, la datation. L’ absence de filiation paraît renvoyer à une date relativement tardive, ce que ne contredit pas la forme des lettres, qui renverrait, selon Y. Burnand, au iie s. 24.
Conclusion
Un hasard heureux a permis la découverte, à quelques décennies de distance, d’ une dédicace et d’ une statue appartenant au même monument ; le cas est unique dans l’ Ouest. L’ étude conjointe des deux composantes permet d’ affirmer que si le dédicant était un allogène, il a fait appel à un sculpteur local, à tout le moins à un personnage actif dans la région de Douarnenez, qui exécuta la commande dans un matériau local 25. L’ octroi à Neptune d’ une épithète exceptionnelle n’ a apparemment eu aucune incidence sur le type iconographique mis en œuvre, à moins, hypothèse invérifiable, qu’ un protomé de cheval ne se soit dressé aux pieds du dieu.
20. Hypothèse proposée par Sanquer 1973a, p. 227 et, très prudemment, par Chastagnol 1980, p. 195. On sait maintenant que les pagi n’ avaient pas de chef-lieu, vici et pagi appartenant à des échelons différents de la structure de la cité ; de surcroît, l’ importance de Douarnenez a été largement surestimée. 21. Sanquer 1973a, p. 216.22. Sanquer, Galliou 1972, p. 209-213.23. Bollmann 1998.24. Nous remercions vivement le Professeur Burnand de cette information.25. Les propriétaires des ateliers de salaisons des Plomarc’ h et du Port-Rhu, à Douarnenez, firent d’ autres choix, puisqu’ ils importèrent des statuesen marbre ou en calcaire (Moitrieux et al. 2003, p. 587-589).
Les ateliers de sculpture régionaux : techniques, styles et iconographie
563
BIBLIOGRAPHIE
Andringa 1998 : Andringa (W. van), “Observations sur les associations de citoyens romains dans les Trois Gaules”, Cahiers du Centre Glotz, IX, p. 165-175.
Arnaldi 1997 : Arnaldi (A.), Ricerche storico-epigrafiche sul culto di Neptunus nell’ Italia romana, Rome.
Bauchhenß 1994 : Bauchhenß (G.), LIMC VI, s.v. “Neptunus in den nordwestlichen Provinzen”, Munich et Zürich, p. 497-500.
Bollmann 1998 : Bollmann (B.), Römische Vereinshäuser. Untersuchungen zu den Scholae der römischen Berufs-, Kult- und Augustalen-Kollegien in Italien, Mayence.
Chastagnol 1982 : Chastagnol (A.), “L‘organisation du culte impérial dans la cité à la lumière des inscriptions de Rennes”, in A.-M. Rouannet-Liesenfelt, La civilisation des Riedones, Brest, p. 187-199.
Éveillard 2005 : Éveillard (J.Y.), “Douarnenez, Le Ris”, Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, CXXXIV, p. 18-20.
Éveillard 2006 : Éveillard (J.-Y.), “Douarnenez et Corseul : analyse comparative de deux statues masculines en granite”, Patrimoine, Bulletin archéologique de Corseul-la-Romaine, XX, p. 28-30.
Éveillard 2007 : Éveillard (J.-Y.), “Actualité de la sculpture en pierre d’ époque romaine en Bretagne”, Aremorica, 1, p. 127-129.
Éveillard à paraître : Éveillard (J.-Y.), “À propos de la découverte d’ une statue de Neptune à Douarnenez (Finistère)”, in J. Napoli (éd.), Ressources et activités maritimes des peuples de l’ Antiquité, Actes du colloque de Boulogne, 12-14 mai 2005, à paraître.
Galliou 1989 : Galliou (P.), Carte archéologique de la Gaule, 29, Finistère, Paris.
Gogniat Loos 1994 : Gogniat Loos (F.), “Les associations de citoyens romains”, Études de Lettres, p. 25-36.
Le Goffic, Peuziat 1999 : Le Goffic (M.) et Peuziat (J.), “Les thermes du Ris-Izella en Kerlaz (Finistère) dans leur contexte gallo-romain”, Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, CXXVIII, p. 99-115.
LIMC : Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, 8 volumes, Zurich et Munich, 1981-1997.
Maurin 1978 : Maurin (L.), Saintes antique des origines à la fin du VIe s. après Jésus-Christ, Saintes.
Merlat 1952 : Merlat (P.), “Note sur une base consacrée à Neptune trouvée près de Douarnenez”, Gallia, X, p. 67-75.
Moitrieux et al. 2003 : Moitrieux (G.), Maligorne (Y.), Éveillard (J.-Y.), “Sur quelques aspects du culte herculéen en Gaule”, Latomus, 62, p. 574-597.
Sanquer 1973a : Sanquer (R.), “Une nouvelle lecture de l’ inscription à Neptune trouvée à Douarnenez (Finistère) et l’ industrie du garum armoricain”, AB, LXXX, fasc. 1, p. 215-236.
Sanquer 1973b : Sanquer (R.), “Chronique d’ archéologie antique et médiévale”, Bulletin de la Société archéologique du Finistère, CI, p. 23-78.
Sanquer, Galliou 1972 : Sanquer (R.), Galliou (P.), “Garum, sel et salaisons en Armorique gallo-romaine”, Gallia, 30, 1, p. 189-223.
Simon 1994 : Simon (E.), LIMC VII, s.v. “Poseidon / Neptunus”, Munich et Zürich, p. 483-497.