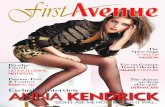interview XXe siècle
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of interview XXe siècle
ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE CHARLEAutour de Discordance des temps : une brève histoire de la modernitéLudivine Bantigny et al. Presses de Sciences Po | Vingtième Siècle. Revue d'histoire 2013/1 - N° 117pages 231 à 246
ISSN 0294-1759
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2013-1-page-231.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bantigny Ludivineet al., « Entretien avec Christophe Charle » Autour de Discordance des temps : une brève histoire de
la modernité,
Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2013/1 N° 117, p. 231-246. DOI : 10.3917/vin.117.0231
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.
© Presses de Sciences Po. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
VINGTIÈME SIÈCLE. REVUE D’HISTOIRE, 117, JANVIER-MARS 2013, p. 231-246 231
Entretien avec Christophe CharleAutour de Discordance des temps : une brève histoire de la modernitéLudivine Bantigny et Quentin Deluermoz
Quoiqu’il soit cohérent par rapport à votre travail sur les intellectuels ou sur les capitales culturelles, cet ouvrage sur la « discordance des temps » paraît original dans votre parcours d’historien 1. Pourquoi vous être attelé à ce questionnement ? Pourriez-vous retracer la genèse et les objectifs de ce projet ?
Dans mon travail d’historien, j’ai toujours cherché à alterner des ouvrages de type ana-lytique et monographique et des ouvrages de type synthétique : au début de ma carrière, par exemple, j’ai fait paraître un ouvrage d’ensem-ble sur les hauts fonctionnaires 2 avant d’écrire ma thèse d’État sur les élites, plutôt mono-graphique 3 ; après avoir publié quatre dic-tionnaires biographiques d’universitaires 4, j’ai tenté une synthèse sur La République des uni-versitaires 5 ; après Naissance des « intellectuels », j’ai élargi la problématique exposée pour le cas français à l’Europe avec l’essai synthétique Les Intellectuels en Europe au xixe siècle 6. De la même
(1) Christophe Charle, Discordance des temps : brève histoire de la modernité, Paris, Armand Colin, 2011.
(2) Christophe Charle, Les Hauts Fonctionnaires en France au xixe siècle, Paris, Gallimard, « Archives », 1980.
(3) Christophe Charle, Les Élites de la République (1880-1980), Paris, Fayard, 1987.
(4) Christophe Charle, Les Professeurs de la Faculté des let-tres de Paris, Paris, CNRS éditions/INRP, 1986-1987, 2 vol. ; id. et Eva Telkes, Les Professeurs du Collège de France (1900-1939), Paris, CNRS éditions/INRP, 1988 ; id., Les Professeurs de la Faculté des sciences de Paris (1901-1939), Paris, CNRS éditions/INRP, 1989.
(5) Christophe Charle, La République des universitaires, Paris, Éd. du Seuil, 1994.
(6) Christophe Charle, Naissance des « intellectuels », Paris, Éd. de Minuit, 1990 ; id., Les Intellectuels en Europe au xixe siècle,
manière, après avoir accumulé des matériaux monographiques sur la relation entre trans-formations sociales et mutations culturelles avec, d’une part, mon livre sur le théâtre 7 et, d’autre part, l’enquête collective sur les capita-les culturelles menée au sein de l’Institut d’his-toire moderne et contemporaine 8, j’ai éprouvé le besoin d’une nouvelle approche synthéti-que à propos des thématiques dont m’ont fait prendre conscience ces comparaisons entre les lieux de l’innovation culturelle. Dans les capi-tales culturelles, comme dans les théâtres des capitales, on saisit de manière contrastée la façon dont les élites culturelles, mais aussi les publics dans leur diversité, et les institutions en charge de la préservation du patrimoine cultu-rel accompagnent parfois le changement his-torique, y résistent souvent et comment il se manifeste de manière différentielle dans divers champs, soit la thématique centrale de Discor-dance des temps.
Paris, Éd. du Seuil, 1996, « Points », 2001.(7) Christophe Charle, Théâtres en capitales, naissance de la
société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne, 1860-1914, Paris, Albin Michel, 2008.
(8) Christophe Charle et Daniel Roche (dir.), Capitales culturelles, capitales symboliques, Paris et les expériences européen-nes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002 (actes du colloque international tenu au Collège de France du 21 au 23 octobre 1999) ; Christophe Charle (dir.), Capitales européennes et rayonne-ment culturel xviiie-xxe siècle, Paris, Éd. Rue d’Ulm, 2004 ; Chris-tophe Charle (dir.), Le Temps des capitales culturelles, xviiie-xxe siè-cle, Seyssel, Champ Vallon, 2009.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
232
LUDIVINE BANTIGNY ET QUENTIN DELUERMOZ
Vous notez aussi, à juste titre, le lien entre cette « brève histoire de la modernité » et mes travaux sur les avant-gardes présents dans divers articles ou dans mes livres sur les intel-lectuels 1. Il y a aussi un lien, moins visible, avec l’une des thématiques qui sous-tend La Crise des sociétés impériales 2 : l’incapacité des élites des trois pays analysés à éviter la guerre, puis à reconstruire le monde après elle, vient du fait que, dans chacune des sociétés impériales, elles prétendaient détenir chacune une forme du sens de l’histoire, et que renoncer à leur projet national et impérial serait une trahison de leur mission. Cette discordance entre cette repré-sentation exclusiviste de la dynamique histo-rique et les véritables solutions qui auraient évité les deux catastrophes du 20e siècle ren-voie, en dernière analyse, à des représentations du passé de ces nations impériales désaccordées avec un présent critique et un avenir problé-matique parce qu’incompatible avec celui de la nation voisine et rivale ou, plus généralement, avec les nouveaux rapports de force dans le monde. Les élites des trois sociétés impériales se sont converties, au cours du 19e siècle, à des variantes de la nouvelle représentation de l’his-toire que j’appelle la « modernité » qu’elles ont d’abord imposée aux populations qu’elles diri-gent, puis aux peuples qu’elles dominent mais qui se heurte immanquablement à la prétention similaire de leurs concurrentes et voisines.
C’est pourquoi on retrouve dans Discordance des temps une reprise au second degré de ces thé-matiques ainsi que des approfondissements de points négligés dans les ouvrages antérieurs. J’ai aussi tenter d’alterner, au fil des chapitres, des approches très synthétiques et d’autres plus analytiques sur des exemples jugés significatifs.
(1) Voir notamment Christophe Charle, Paris fin de siècle, culture et politique, Paris, Éd. du Seuil, 1998.
(2) Christophe Charle, La Crise des sociétés impériales : essai d’histoire sociale comparée de l’Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne, 1900-1940, Paris, Éd. du Seuil, 2001, 2008.
En même temps, c’est la contradiction de tout essai synthétique, sous peine de ne jamais finir ou de devenir illisible à force de nuances et d’exem-ples, je n’ai pas pu aller aussi loin que j’aurais voulu pour ne rien oublier et surtout élargir le regard qui reste sans doute trop franco-centré puis européo-centré.
L’ouvrage fait explicitement référence à la notion de « régime d’historicité » inaugurée par François Hartog et, après Reinhart Koselleck, à l’idée que la Révolution française – « l’événement fondateur de la modernité politique » (p. 317 de votre livre) – ouvre une période caractérisée par un nouveau rap-port au temps, par une tension vers un avenir sou-dainement plus ample et marquant. Comment vous êtes-vous approprié cette notion ?
Je partage évidemment les définitions et les perspectives de ces deux auteurs tout en essayant d’élargir leur définition à laquelle je reproche d’être trop intellectualiste. Ils ont tendance à vouloir saisir ce rapport au temps historique presque trop exclusivement à partir de l’étude d’un nombre limité d’auteurs consa-crés qui s’expriment essentiellement dans la sphère savante (historiens et philosophes de l’histoire principalement). Ils me semblent sui-vre ce que Pierre Bourdieu appelle, dans Médi-tations pascaliennes, « l’illusion scolastique » : saisir le monde historique ou la réalité à tra-vers les regards et les réflexions de leurs homo-logues savants ou historiens antérieurs, sans se poser la question de savoir si cette repré-sentation savante pénètre plus largement dans d’autres couches sociales, ni mesurer les déca-lages chronologiques et les conflits entre ces réflexions anticipatrices et les perceptions et le vécu des contemporains d’autres milieux sur lesquels, malheureusement, on est beaucoup moins bien informé parce que ce ne sont pas des professionnels de l’écriture.
En effet, un nouveau régime d’historicité ne peut véritablement être considéré, selon moi,
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
233
EnTRETIEn AVEC CHRISToPHE CHARLE
comme dominant les représentations sociales et les modes d’action des divers groupes que si la nouvelle représentation du temps historique est diffusée bien au-delà des élites savantes ou même des élites tout court. L’une des spécifici-tés du régime d’historicité de la modernité est sa vocation au prosélytisme, puisqu’il entend faire agir les membres d’une société donnée en fonction d’un futur que certains croient pou-voir prévoir, anticiper et même modeler. Mais toute l’histoire du 19e siècle et du 20e siècle en Europe occidentale puis dans le reste de l’Eu-rope, aux États-Unis ou dans les autres conti-nents, peu à peu entraînés dans ce processus, montre l’énorme décalage entre cette « bonne nouvelle » de la modernité et la capacité des élites, des sociétés et des instances internatio-nales à faire agir à l’unisson les peuples en ce sens et à les convertir au nouveau régime d’his-toricité. La seconde spécificité de ce régime (et elle résulte même de sa dynamique interne), est qu’il se reformule en permanence à chaque fois que la discordance entre l’avenir annoncé (ou la réinterprétation du passé et du présent proposée) s’avère intenable ou insoutenable, si bien qu’on assiste à des cycles de moder-nité ascendante, classique, puis critique, qui suscitent, en sens inverse, des discours et des mobilisations antimodernistes, elles aussi iné-galement radicales, qui obligent les tenants de la modernité à reformuler leur projet et leurs arguments pour les rendre plus consensuels et réduire la « discordance des temps » au sein de chaque société.
Vous définissez cette modernité comme « le futur au présent » (p. 152) ou, plus loin, comme « un futur meilleur proposé comme présent certain » (p. 284). Partant de cette acception, quelle place, historique-ment déterminée, un tel régime d’historicité accor-de-t-il selon vous au passé ? Est-ce un rapport de pur rejet, ou une tension sous forme d’intégration complexe et, en dernière instance, d’incorporation ?
Ce discours sur l’avenir implique à l’évidence une réinterprétation du présent en fonction de cet avenir supposé mais aussi, inséparablement, du passé, puisque les régimes d’historicité antérieurs, à l’inverse, concevaient le présent et l’avenir en fonction d’un maintien ou d’une préservation du passé (« la tradition », « la cou-tume », « le précédent », « l’héritage »). Il ne s’agit pas, la plupart du temps, sauf dans les versions les plus radicales de la pensée de la modernité, qu’elles soient révolutionnaires ou s’assument comme utopiques, de faire « table rase » du passé, selon la formule de L’Interna-tionale, mais de réinterpréter ce passé comme argument en faveur de la nouvelle dynami-que tournée vers l’avenir. Pour convaincre des contemporains formés depuis toujours dans la révérence au passé et à la tradition, il faut inverser le regard et prouver que le passé lui-même contient les germes de ce nouvel ave-nir et démontrer que, loin d’être une rupture ou une divergence par rapport à l’histoire jus-que-là vécue, il fournit des signes et des preu-ves possibles de la vérité de ce nouveau régime d’historicité. Marx a ironisé sur les révolution-naires de 1789-1792 qui se représentaient eux-mêmes en citoyens romains refondant une république antique ou sur ceux de 1848 qui pensaient revivre la révolution antérieure de 1792 ; on voit aujourd’hui même, de manière fallacieuse sans doute, compte tenu de la diffé-rence des sociétés et des contextes, fleurir les expressions « printemps arabe », « printemps érable », par transposition du fameux « prin-temps des peuples » de 1848. Chaque homme ou femme, chaque peuple a plus de mémoire de son passé personnel ou collectif que de capa-cité réelle d’anticiper son avenir surtout dans les sociétés modernes de plus en plus instables. L’aptitude des tenants du discours de la moder-nité à faire jouer en leur faveur une réinterpré-tation du passé et à l’arracher à la pensée du sens commun de la reproduction, de la répétition
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
234
LUDIVINE BANTIGNY ET QUENTIN DELUERMOZ
et de la conservation est un atout décisif dans cette conversion au nouveau regard historique. Les hauts et les bas de la modernité renvoient à cette capacité inégale selon les conjonctures à le faire et à le faire partager.
Dans votre livre, l’étude des groupes sociaux « confrontés aux transformations en cours » (p. 81) apparaît fondamentale. De fait, vous affrontez des questions difficiles concernant les relations au temps et à l’histoire, notamment celle de leurs contours sociaux. Les groupes plus « populaires » intervien-nent plutôt tardivement en 1848, mais surtout au moment où ils sont touchés par cette nouvelle défi-nition de la modernité. Ne participent-ils pas avant à l’élaboration d’un nouveau rapport au temps ? Serait-ce là une autre « discordance » à ajouter aux autres, plus intellectuelles ?
Passer d’une histoire intellectuelle ou cultu-relle de la modernité et de la discordance des temps à une véritable histoire sociale est une difficulté majeure et je suis bien conscient de ne l’avoir réussi qu’inégalement selon les pério-des ; tout simplement parce que les sources pos-sibles pour mesurer de manière différentielle la relation des divers groupes au nouveau régime d’historicité dépendent elles-mêmes du degré d’imposition de celui-ci et de l’appropriation par les groupes les plus dominés des savoir-faire qui permettent plus tard à l’historien d’avoir accès à leurs représentations sans qu’elles soient médiatisées par le discours ou le regard des groupes dominants qui, inévitablement, les réinterprètent ou les transforment en fonction de leurs propres intérêts et conceptions.
En même temps, l’apparition de témoigna-ges émanant authentiquement de ces groupes dominés est un indicateur de leur conversion progressive à ce nouveau regard, même s’il y a lieu de rappeler, après Alain Corbin, qu’il faut prendre garde au caractère exceptionnel de ces autobiographies et surtout au biais rétrospectif qu’implique la capacité pour des individus de
milieu populaire à faire le bilan de leur vie et à en tirer le sens dans un regard synthétique com-parable à celui des élites pour lesquelles c’est une sorte de privilège culturel et social qui va de soi. Chaque historien, en fonction de ses objets d’étude préférés, a tendance à puiser dans les sources qu’il maîtrise le mieux pour analyser ce rapport des groupes dominés à l’historicité. Alain Corbin, spécialiste à ses débuts et pour une grande partie de son œuvre des mondes ruraux traditionnels, a beaucoup réagi contre les visions optimistes et progressistes qu’ont développées les élèves d’Ernest Labrousse pour rendre compte de la conversion des régions rurales à la modernisation et à l’intégration dans la communauté politique nationale peu à peu construite par les diverses révolutions du 19e siècle. À l’inverse, Maurice Agulhon, Vin-cent Robert ou certains politistes, qui se sont penchés sur les modes d’intégration politique des groupes ruraux ou populaires à une société de plus en plus influencée par les innovations allant de pair avec la modernité, ont souligné les voies souvent paradoxales par lesquelles cette nouvelle attente d’un avenir qui ne serait pas qu’une reproduction de la tradition et du passé ont pu changer les comportements de régions autrefois contre-révolutionnaires ou conserva-trices. L’énorme bibliographie monographique qui existe maintenant sur les sociétés du 19e siè-cle gagnerait à être reprise de manière plus sys-tématique et synthétique en fonction de cette tension centrale que j’ai surtout dû aborder à partir d’analyses sur Paris et le monde urbain mais que je tente d’élargir aussi aux campagnes dans le chapitre sur le projet républicain ou dans celui sur les nouveaux modes de commu-nication liés aux divers progrès techniques.
Puisant dans l’œuvre de Balzac les figures de quel-ques « demi-soldes de l’Empire, déjà surannés dans leur redingote élimée » sous la Restauration, Fran-çois Hartog voit surgir ce qu’il appelle lui aussi une
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
235
EnTRETIEn AVEC CHRISToPHE CHARLE
« discordance des temps » qui pétrirait la Comé-die humaine 1. Vous relevez dans votre ouvrage que Balzac est l’un des premiers à employer le terme de « modernité », dès 1822 (p. 18). Vous expliquez aussi que l’auteur de La Peau de chagrin y « peint en accéléré la course désespérée de sa génération » ; ses « héros favoris essaient de fonder une aristocra-tie moderne capable de réconcilier le passé et le pré-sent pour construire un avenir durable » (p. 87). Ainsi, dans votre livre, des romans (ceux de Hugo, de Zola, plus tard de Huxley), des tableaux (ceux de Delacroix, de Courbet ou de Manet), des films (Les Temps modernes de Chaplin et Metropo-lis de Lang) sont-ils longuement décrits et très fine-ment analysés. Selon vous, quelle est la spécificité de l’art et de la littérature pour approcher en historien les disjonctions, dissonances et discordances tempo-relles ? Existe-t-il d’autres modes d’accès particuliè-rement privilégiés pour une telle enquête ?
Dans un essai synthétique comme celui que j’ai tenté, la grande difficulté est de mobiliser non seulement les travaux antérieurs (même s’ils n’ont pas été conçus en fonction de la pers-pective que j’ai choisie), des données nouvel-les qu’on a pu élaborer dans d’autres travaux monographiques et des exemples significatifs rationnellement choisis pour être démonstra-tifs, puisqu’il y a toujours un risque d’arbitraire lié au fait qu’aucun historien n’a pu tout lire et tout voir et dépend forcément de ces goûts et obsessions personnelles quoiqu’il essaie de les contrôler. Ces exemples plus approfondis que j’ai choisis ne l’ont pas été uniquement (comme c’est trop souvent le cas) en fonction d’un pan-théon rétrospectif d’œuvres et d’auteurs qu’il est de bon ton de citer pour « illustrer » cer-taines périodes. Les exemples sont privilégiés parce qu’ils occupent des positions compara-bles dans l’offre culturelle d’une époque don-
(1) François Hartog, « La temporalisation du temps : une longue marche », in Jacques André, Sylvie Dreyfus-Asséo et François Hartog (dir.), Les Récits du temps, Paris, PUF, 2010, p. 12.
née et qu’ils ont suscité au moment même des réactions clivantes et révélatrices du fait que ces œuvres ou ces auteurs ont touché des points sensibles de la perception de certaines catégo-ries à la discordance des temps ; c’est pourquoi j’ai privilégié des œuvres qui ont rencontré sur le moment même un public et un écho social certain (aussi bien Notre-Dame de Paris que La Peau de chagrin sont des succès). Bien que proposant des regards inverses sur le moment 1830 et avec des transpositions littéraires elles-mêmes inverses (un faux roman historique, un faux conte oriental contemporain), ces deux fictions sont révélatrices du débat central du champ littéraire et intellectuel en ces années extraordinairement productives pour la vie politique, sociale et culturelle française. Afin que l’utilisation d’exemples tirés de la littéra-ture, de l’art ou du cinéma soit justifiée et véri-tablement éclairante par rapport au problème historique qu’on veut sinon résoudre du moins mieux appréhender avec les regards des contem-porains, il faut au préalable avoir construit les espaces sociaux et culturels (les champs pour reprendre la notion de Bourdieu) qui les ont produits et dans lesquels ils se déploient et avoir établi l’exacte position occupée par l’écri-vain, l’artiste ou le cinéaste considéré. Cela permet de déterminer dans quelle mesure les représentations qu’il propose et l’écho social et culturel qu’il a suscité sont véritablement révé-lateurs de ce qu’on cherche à comprendre, le nouveau rapport au temps de ce moment pré-cis. Il ne s’agit pas, selon un biais romantique trop souvent sous-jacent à beaucoup d’analy-ses trop naïves ou rapides, de faire confiance au « génie », c’est-à-dire, selon la représentation usuelle, à la capacité prophétique de tel ou tel auteur, mais plutôt de concevoir ces œuvres ou ces personnalités comme des points de tension de la discordance des temps, parce que leur tra-jectoire, leur position et leur projet dans leur champ d’activité les ont placées à l’entrecroise-
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
236
LUDIVINE BANTIGNY ET QUENTIN DELUERMOZ
ment des forces sociales et culturelles contra-dictoires à l’œuvre à ce moment précis. L’ina-chèvement du tableau de Gustave Courbet, L’Atelier du peintre (1855), son occultation et son échec commercial, les versions tronquées du film Metropolis de Fritz Lang (1928) liées aux impératifs commerciaux, les changements de regard historique et social au fil des diffé-rents cycles romanesques de Zola, etc., doivent être ainsi pris en compte comme révélateurs de ces tensions historiques, bien loin, on le voit, du commentaire purement esthétique, forma-liste et lettré qui canonise, éternise et déhisto-ricise le « chef-d’œuvre ». La division du tra-vail entre les disciplines en charge de la culture passée a eu tendance à interdire à l’historien de le faire ou à ne le pratiquer que sur des œuvres « banales », voire délégitimées (le roman-feuilleton, la littérature populaire, etc.), si bien que l’histoire n’intègre pas l’analyse de nom-breuses productions culturelles réservées à des spécialistes patentés. Fort de travaux antérieurs et surtout d’évidents rapprochements en cours entre disciplines qui autrefois s’ignoraient (voir le récent ouvrage collectif produit par des lit-téraires et des historiens sur La Civilisation du journal 1), je me suis permis de transgresser sys-tématiquement ces interdits, parce qu’ils m’em-pêchaient, pour l’objet qui était le mien, d’aller assez loin dans les analyses que seules ces pro-ductions symboliques permettent.
La démonstration évoque, entre 1830 et 1930, plu-sieurs temps de la modernité qui, malgré les cri-ses, se diffusent socialement et spatialement, tout en restant installée sur ce rapport au temps ouvert en 1789. Vous évoquez dans ce travail, comme dans certains de vos livres précédents, la notion de cycle : un certain répertoire de mots, gestes, situations ou
(1) Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thé-renty et Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du journal : histoire culturelle et littéraire de la presse française au 19e siècle, Paris, Nou-veau monde, 2011.
réflexes mentaux rejoueraient malgré le décalage des contextes, du fait de la reproduction d’une cer-taine configuration – c’est net dans le chapitre sur le libéralisme par exemple, lorsque vous rappelez que « l’échelle des espaces et la diversités des peuples et des produits concernés a changé », mais que « la dynamique de l’histoire espérée ou crainte reste fon-damentalement la même » (p. 179). Pourriez-vous préciser l’importance de cette notion dans votre pro-pre travail, puis ses conséquences pour ce sujet : un cycle ou une répétition de perceptions du temps et de tentatives d’appréhension de l’avenir, qui rejoue dans un même régime d’historicité ? Il y a là plu-sieurs niveaux d’enchevêtrement qui impliquent peut-être une lecture non linéaire, mais assez verti-gineuse, des 19e et 20e siècles.
Cette idée de cycles historiques des repré-sentations des trois dimensions du temps histo-rique était déjà présente dans les conclusions de La Crise des sociétés impériales et de Les Intellectuels en Europe au xixe siècle. En soi, elle n’a rien d’ori-ginal, si l’on se souvient de la célèbre phrase de Marx qui ouvre Le 18 Brumaire de Louis Napo-léon Bonaparte, dont le titre lui-même est la condensation de cette idée que les hommes et les femmes, même les plus grands d’entre eux, sont souvent guidés dans leurs actions les plus décisives par le recours à des précédents histori-ques qui les inspirent ou leur donnent confiance dans leur capacité à maîtriser une conjoncture incertaine. Il n’y a évidemment aucune rai-son de ne pas étendre ce principe d’analyse à d’autres qu’à ceux que l’histoire traditionnelle a tendance à considérer comme les acteurs cen-traux, alors que les nouvelles conceptions de l’historiographie ont fait entrer dans la dyna-mique historique de nouvelles forces et grou-pes dont il convient de comprendre les interac-tions. Si, dans la première phase de l’histoire des Annales et antérieurement chez Simiand et Labrousse, les cycles étaient mesurés à partir d’indicateurs externes et objectifs pour aboutir à des modèles statistiques (cycles de prix, cycles
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
237
EnTRETIEn AVEC CHRISToPHE CHARLE
des salaires, cycles démographiques), la tâche actuelle des historiens qui prennent en compte la dimension culturelle et des représentations des groupes humains est de déterminer dans quelle mesure, entre ces conjonctures objec-tives, s’interposent des conjonctures subjecti-ves qui ne s’interprètent pas seulement selon la notion simple de « retard », de « résistance », de frein des « mentalités », de « méconnais-sance », d’« inertie » face au changement his-torique, explications simplificatrices souvent utilisées par les interprètes des modèles éco-nomiques quand les comportements des grou-pes ne correspondent pas à la rationalité pré-vue par la théorie. Chaque société à un instant t est composée non seulement de groupes aux intérêts sociaux divergents, mais aussi de géné-rations socialisées différemment aux représen-tations du temps historique ou ayant inégale-ment éprouvé au fil des conjonctures (multiples ou uniques) ses effets positifs ou négatifs. Nous n’avons malheureusement trop souvent que des outils simplificateurs pour faire ces ana-lyses des convergences et divergences entre ces expériences historiquement formatrices, comme la notion de « génération », celle de « période », celle de « crise », tout simple-ment parce que les modes d’accès à ces vécus divergents des rapports au temps historique des divers groupes sont en permanence défor-més par les témoignages des groupes domi-nants ou de leurs interprètes et porte-parole, et qu’il est toujours plus facile de proposer un récit unificateur et synthétique que de longues enquêtes pour mettre en valeur les discordan-ces. Mais répondre complètement à cette ques-tion supposerait pratiquement d’écrire un nou-veau livre.
Ce qui est vertigineux, c’est non seulement cette coexistence à un moment donné de cycles de mémoire, de représentations du présent et du futur divergents dans une société donnée, mais de manière plus globale à l’échelle inter-
nationale entre différents pays, dont les histoi-res, les trajectoires multiplient les décalages et les incompréhensions ; ce, malgré la ten-dance actuelle de l’historiographie à vouloir construire de nouveaux grands récits (histoire globale, histoire connectée, histoire des systè-mes mondes, histoire transnationale, etc.) ou celle des sciences sociales à renouveler le dis-cours sur la modernité, après la phase de confu-sion et de doute de la prétendue « postmoder-nité », en parlant de « modernités multiples » ou d’accélérations différentielles des processus historiques.
Un des étudiants dont je suis la thèse, Rémy Pawin, a par exemple démontré, en travaillant sur les représentations du bonheur dans la société française entre 1944 et 1981 1, que la trop fameuse expression des « Trente Glorieu-ses », inventée par Jean Fourastié, reposait sur une erreur d’adjectif, puisque c’est la période de renoncement à la guerre et à la gloire qui doit en principe l’accompagner, au profit de la quête du bonheur. Surtout cette expression construit un mythe rétrospectif complet quand on la confronte à un certain nombre d’enquê-tes et de sondages effectués pendant ces années vues aujourd’hui comme un âge d’or. En réalité, la conversion de générations de Français à la perception optimiste de ce moment où les indi-cateurs « objectifs » sont presque tous positifs (surtout si on les compare à ceux d’aujourd’hui) a été beaucoup plus lente que ce que la notion de Trente Glorieuses impliquerait. Au terme de son analyse, Rémy Pawin conclut qu’il fau-drait plutôt parler de « treize heureuses » net-tement plus tardives (1962-1975), à la fois le temps que les menaces antérieures ou actuel-les s’effacent (le souvenir de la guerre, les dra-mes liés à la guerre d’Algérie) et que la repré-
(1) Rémy Pawin, « Trente Glorieuses, treize heureuses ? Représentations et expériences du bonheur en France entre 1944 et 1981 », thèse de doctorat en histoire sous la direction de Christophe Charle, Université Paris-I, 2010.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
238
LUDIVINE BANTIGNY ET QUENTIN DELUERMOZ
sentation d’un futur heureux s’impose malgré les décalages entre les groupes et les régions pour l’accès à la « société de consommation ». Même si Rémy Pawin dispose d’enquêtes per-mettant d’embrasser toute la population pour déconstruire cette vision enchantée d’une nou-velle modernité qui s’imposerait sans césures dans la France de la haute croissance, il bute lui aussi sur un autre problème : les sondages d’opinion sur lesquels il s’appuie ne permettent pas de feuilleter ces représentations du présent et de l’avenir hors de grandes catégories socia-les très simplificatrices par rapport aux com-plexités d’une société en pleine transforma-tion. Pour le 20e siècle, il y a encore à réaliser un énorme travail d’enquête approfondie pour différencier les cycles de représentation du temps historique, a fortiori pour le 19e siècle où l’on ne peut que très peu mobiliser les enquê-tes sociales comme pour le 20e siècle.
C’est dans cet esprit d’ailleurs que, pour Paul Ricœur, la « discordance » énonce « l’absence de contempo-ranéité des contemporains 1 ». Certains penseurs comme Ernst Bloch, dans les années 1930, ont été frappés par cette non-contemporanéité qui rend toute période hétérogène quant à ses rapports au temps, par là même pluriels et coexistants. Votre travail contribue à en faire l’analyse historique. À vous lire en effet, on a le sentiment que les révolutionnaires de la première moitié du 19e siècle, jusqu’à l’efferves-cence de 1848-1849 incluse, ces « intellectuels, mili-tants, combattants » principalement (p. 127), vont trop vite et voient trop loin : la modernité politique qu’ils déploient est trop en avance sur les traditions vivaces de leur temps ; leurs contemporains ne leur sont finalement pas contemporains ; en somme, leur « impatience des limites » (p. 134) les marginalise. En revanche, avec les accélérations initiées au milieu du 19e siècle qui ouvrent bien davantage sur l’ave-
(1) Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éd. du Seuil, 2000, 2003, p. 250.
nir, avec les progrès qui s’accomplissent alors dans de nombreux domaines (les transports, l’urbanisme, la presse, les échanges économiques) et « rend[ent] l’impossible possible » (p. 241), la modernité devient hégémonique – même si, comme vous le soulignez, « les populations rurales et les classes plus pauvres […] ne se sentent pas directement concernées par cette modernité » (p. 273). En somme, la « pre-mière modernité » que vous décrivez, entre 1830 et 1850, serait au fond un rapport au temps dominé, concurrencé qu’il serait par la tradition et le poids du passé, quand la « modernité classique » (1850-1890) deviendrait pour sa part dominante ; un brouillage s’opérerait à la fin du 19e siècle et au cours du premier 20e siècle, la modernité devenant tout à la fois tolérée, critiquée et dépassée par l’anti-modernité comme, déjà, par une sorte de postmoder-nité « [remettant] en cause le “sens de l’histoire” » (p. 339). Êtes-vous d’accord avec cette lecture ? Et le cas échéant, quelle interprétation donner de la Com-mune dans un tel cadre, par-delà la désormais clas-sique mais toujours belle formule de Jacques Rouge-rie, « aurore ou crépuscule » ?
Oui, vous avez résumé assez synthétique-ment le schéma d’ensemble qu’il faudra sans doute complexifier à la fois régionalement pour la France et réinterroger pour les autres pays d’Europe malgré certaines convergences internationales soulignées dans le chapitre 8, et réévaluer aussi si l’on passait à une échelle mondiale à partir d’exemples fascinants comme ceux de certains pays d’Asie qui se voient impo-ser la modernité occidentale de l’extérieur et où se déclenche un profond débat (parfois tou-jours en cours) sur la négociation possible ou non avec l’héritage interne et la représentation du temps qui va de pair.
Si l’on revient au cas que vous citez de la Commune, il faudrait sans doute sortir des schémas qui ont trop longtemps empêché d’en voir les complexités ; d’abord on oublie trop que dans ce Paris de la Commune existait aussi toute une population enfermée dans la capitale,
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
239
EnTRETIEn AVEC CHRISToPHE CHARLE
qui n’avait ni rallié le camp versaillais ni sym-pathisé avec les plus radicaux ayant pris le pou-voir dans la ville, si bien que la simplification des visions binaires révolution/contre-révolu-tion trahit la complexité d’une ville aux cou-ches moyennes nombreuses et partagées entre le patriotisme et la solidarité avec ceux qui ont souffert pendant le siège (ce qui les fait désap-prouver la violence versaillaise de la répres-sion) et la peur d’une révolution radicale qui rappelle les temps de la Terreur ou les journées de juin 1848 ; au sein même du camp révolu-tionnaire, on a montré de longue date aussi les divergences entre plusieurs générations et groupes dont les représentations de l’histoire ne sont évidemment ni celles de Marx (large-ment ignoré), ni celles de Bakounine, et qui oscillent entre la répétition de 1848, le souve-nir mythique de la Commune de 1792, les uto-pies de Proudhon ou tout simplement le refus de la réaction monarchiste comme en 1830. Paris est une ville où l’histoire est tellement présente dans tous les lieux centraux ou par l’intermédiaire des témoins des diverses géné-rations (dont certains sont encore actifs lors des événements de 1870) qu’il est vain de chercher un sens unifié et synthétique qui pourrait résu-mer les projets et les attitudes des participants. Il y a bien sûr une discordance fondamentale avec l’ancienne France qu’incarne l’assemblée de Versailles, mais il y aussi toute l’accumula-tion des représentations du changement liée à l’histoire troublée de la ville et à ce mythe d’une ville guide dans l’histoire française, alors que les transformations du Second Empire ont déjà réduit ce poids central de la capitale avec le glissement durable du centre de gravité politique via le suffrage universel, même mani-pulé, dans les provinces depuis 1849, ce que les révolutionnaires de 1871 ne veulent pas accep-ter. Ce balancement permanent entre l’obses-sion du passé révolutionnaire parisien, un pré-sent qui entre mal dans les schémas antérieurs
et un avenir qui ne paraît plus confirmer le cycle révolutionnaire explique l’incertitude des interprétations et des débats des acteurs et des troupes de la Commune. Il faudra toute la dia-lectique de Marx puis de Lénine pour parvenir à faire croire que ce moment de grande incer-titude du camp révolutionnaire peut servir de modèle d’une nouvelle modernité révolution-naire en d’autres temps et d’autres lieux.
Bien qu’elle soit évidemment présente, la Première Guerre mondiale n’apparaît que fugitivement dans votre réflexion sur la modernité. Est-ce parce que, comme l’a également montré Jay Winter, le moder-nisme est né avant la guerre et n’a pas été engendré par elle ; tout au contraire, le conflit aurait plutôt favorisé certains retours à la tradition – la Grande Guerre, « le plus “moderne” des conflits, a suscité une multitude de phénomènes qui tournaient radi-calement le dos à la modernité 1 », souligne Jay Winter. Est-ce finalement surtout la guerre qui a introduit, pour reprendre l’une de vos expressions, un « rapport malheureux à l’historicité » (p. 20) ?
Je n’ai pas affronté directement la guerre de 1914, non seulement pour les raisons que vous évoquez, mais aussi parce que je l’avais déjà en partie traitée dans La Crise des sociétés impéria-les et ne souhaitais pas me répéter. Je l’ai donc abordée à partir de ses résultats plus que dans son déroulement. Sa fonction fondamentale par rapport à ma problématique est de modifier en profondeur le rapport de la France à l’his-toire, en lui redonnant une position hégémo-nique temporaire en Europe. On a trop oublié que la France, en dépit de sa fierté d’avoir initié l’ère des révolutions (et donc la nouvelle repré-sentation du temps historique traitée dans les deux premières parties du livre), a traversé le
(1) Jay Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning : The Great War in European Cultural History, Cambridge, Cambridge Uni-versity Press, 1995 ; trad. fr., id., Entre deuil et mémoire : la Grande Guerre dans l’histoire culturelle de l’Europe, Paris, Armand Colin, 2008, p. 67.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
240
LUDIVINE BANTIGNY ET QUENTIN DELUERMOZ
19e siècle en position d’infériorité permanente, du fait de ses trois défaites majeures (1814, 1815 et 1871) face aux puissances conserva-trices, qui luttent contre le pays de la Révolu-tion. Avec la victoire difficilement arrachée en 1918, le programme républicain de redresse-ment de la grande nation est enfin complété et semble conforté par la victoire sur les puissan-ces conservatrices. Illusion bien entendu, mais sans laquelle on ne peut comprendre le nou-veau rapport à la modernité des Français dans l’entre-deux-guerres : ils souhaiteraient arrê-ter le temps et empêcher les remises en cause par les vaincus ou les révolutionnaires qui vou-draient dépasser la Révolution française par la révolution communiste ou la révolution colo-niale. Le centre de gravité de la modernité cri-tique, dont l’épicentre était à Paris en tant que capitale des avant-gardes avant 1914, tend ainsi à se déplacer vers d’autres espaces du monde, et ce processus continue jusqu’à nos jours selon des cycles complexes.
En ce qui concerne la fin de la période traitée dans votre livre, vous évoquez plusieurs moments de basculement possibles pour cette articulation entre passé, présent et avenir née au 19e siècle : la Pre-mière Guerre mondiale, les années 1930 et surtout la situation très contemporaine. Pourriez-vous pré-ciser ces décalages : dans l’espace défini par votre étude, existerait-t-il selon vous un ou plusieurs régimes d’historicité au 20e siècle ? Par ailleurs, comment analysez-vous les transformations les plus récentes, qui paraissent peut-être éloignées de la notion couramment employée de « présentisme » (vous évoquez en conclusion les nouvelles formes de millénarismes religieux, l’anxiété écologique, le rejet de la foi scientifique etc.) ?
Si l’on raisonne au plan le plus général, je défends la thèse d’après laquelle la dynami-que générale reste pendant la plus grande par-tie du 20e siècle celle de la modernité, même si celle-ci présente des variantes, des accéléra-
tions ou des rebroussements spécifiques selon les conjonctures et selon les espaces, puisqu’à mesure qu’on avance dans le siècle le nouveau régime d’historicité s’impose à des sociétés et à des traditions historiques de plus en plus éloignées du lieu initial de son émergence. On s’est beaucoup interrogé, dans l’historio-graphie du fascisme ou du nazisme par exem-ple, sur la « modernité » ou non de ces mou-vements et de ces régimes et sur la capacité à combiner de manière apparemment contradic-toire des reconstitutions d’un passé mythique (le mythe romain en Italie, le mythe aryen ou germain en Allemagne), une pédagogie volon-tariste de la mobilisation en fonction des objec-tifs du régime pour créer un « homme nou-veau » et une construction utopique d’un nouvel avenir combinant les pires régressions (militarisation, enfermement, suppression des acquis de la démocratie libérale, domination masculine exacerbée, racisme) et la volonté modernisatrice pour assurer la puissance et la domination sur les autres peuples par l’indus-trialisation, l’urbanisation, le culte de la tech-nique, etc. Ces alliances, improbables dans le cadre de la modernité classique où tradition et progrès, régression intellectuelle et moder-nisation pratique étaient incompatibles, ne le sont plus dans la phase critique au cours de laquelle se déploient ces deux mouvements, puis ces deux régimes. Il s’agit de répondre aux insuffisances avérées de la modernité classique après les graves crises traversées par ces deux pays, sans pour autant accepter les alternatives proposées par deux autres modèles de moder-nité qui influencent d’autres parties de l’Eu-rope, à savoir la modernité de type américain et la modernité (largement fantasmée) de type soviétique.
On pourrait ainsi multiplier les déclinai-sons de cette nouvelle phase de la modernité critique, que ce soit dans le cadre de l’avè-nement du régime militaire au Japon et de
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
241
EnTRETIEn AVEC CHRISToPHE CHARLE
sa dérive totalitaire, de la Turquie kémaliste, de certains régimes autoritaires d’Amérique latine, etc. Par-delà les spécificités, toutes les élites qui conquièrent l’hégémonie dans ces zones nouvellement touchées par le nouveau régime d’historicité sont habitées par un sen-timent d’urgence, d’obsession de lutte contre le temps, de la nécessité d’emprunter des rac-courcis pour rattraper les anciennes puissances modernes, de convertir au besoin de force des populations encore plus ancrées dans des tradi-tions et un autre régime d’historicité plus diffi-cile à modifier encore que dans les pays d’Eu-rope du 19e siècle.
Faute de place, je n’ai pas pu traiter en détail la deuxième partie du 20e siècle et j’ai seule-ment suggéré qu’après la nouvelle catastro-phe de la Seconde Guerre mondiale et malgré les découvertes désespérantes qu’elle aurait dû susciter dans les esprits (au point de remet-tre en cause les fondements même du régime d’historicité de la modernité), on a l’impres-sion d’un nouveau départ et d’une montée en puissance paradoxale d’un nouvel optimisme avec des décalages selon les temps et les lieux (voir les remarques plus haut sur les préten-dues « Trente Glorieuses » françaises), et avec l’invention, dans les deux camps de la guerre froide, de nouvelles représentations de l’ave-nir renouant avec les lendemains qui chantent. Toutefois, comme dans les périodes antérieu-res traitées dans mon livre, un nouveau bas-culement critique se produit (en gros au cours des années 1970), où aussi bien l’avenir révo-lutionné des parties du monde influencées par l’idéologie communiste puis tiers-mon-diste, que l’avenir de prospérité partagée des pays sous influence américaine commencent à subir un questionnement critique de la part d’abord d’avant-gardes, puis de plus en plus de nouveaux mouvements sociaux et intellectuels, questionnement conforté par les dérègle-ments économiques croissants (crises pétroliè-
res, montée du chômage dans les pays déve-loppés, crises récurrentes de nombreux pays en développement), par les crises politiques, par l’émergence de l’écologie politique et de l’anxiété croissante devant un monde « fini », contradictoire avec la thèse d’avenir maîtrisa-ble et maîtrisé au fondement du régime d’his-toricité de la modernité.
Ce que vous appelez le « présentisme », je suppose en suivant François Hartog, ne me paraît pas être complètement une rupture avec le régime d’historicité de la modernité. Préten-dre saisir le futur au présent est une certaine forme de modernité. Ce que vous évoquez ensuite est plutôt le nouvel essor de pensées traditionnalistes et régressives qui prétendent apparemment, au contraire, revenir au régime d’historicité antérieur gouverné par le passé, la tradition, la perpétuation des visions ancien-nes, et dont les grandes religions sont évi-demment (malgré la tentative du catholicisme pour se mettre à jour dans la phase optimiste des années 1960) les supports privilégiés. Les débats de plus en plus virulents autour de l’is-lam et de l’islamisme en sont la manifestation la plus connue, mais il en est d’autres tout aussi paradoxales. On peut mentionner le fonda-mentalisme chrétien, si influent pourtant dans la nation qui prétend toujours être le leader de la modernité, les États-Unis, ou encore la reconversion à l’orthodoxie de la Russie ex-so-viétique après plusieurs générations de déchris-tianisation forcée et d’athéisme officiel. Il est toujours dangereux de pratiquer l’analogie en histoire, surtout pour comparer des phénomè-nes anciens, sur lesquels on dispose de travaux relativement approfondis, et des phénomènes actuels, saisis à travers une perception souvent journalistique et biaisée. Je ne peux m’empê-cher cependant de comparer ces phénomènes de réévaluation de la tradition, du passé et de mémoires anciennes que sont les renouveaux religieux avec ces combinaisons improbables
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
242
LUDIVINE BANTIGNY ET QUENTIN DELUERMOZ
de la modernité critique que j’évoquais plus haut à propos des mouvements fasciste et nazi. Comme dans les années 1920 et 1930, il s’agit de proposer un nouvel avenir distinct de la modernité classique, telle qu’incarnée par l’Eu-rope occidentale et les États-Unis, en réinves-tissant, sous forme de tradition réinventée et de mobilisation par la conversion en profon-deur des esprits, les héritages les plus anciens des cultures des pays considérés. Cela n’empê-che pas, par ailleurs, l’adoption des signes les plus visibles de la modernité technique, écono-mique ou financière, ce qui indique bien qu’il ne s’agit pas non plus d’un retour complet au régime d’historicité traditionnel.
Dans un ouvrage dirigé par François Hartog et Jacques Revel, l’historien médiéviste Jérôme Bas-chet évoque sa connaissance du Chiapas contempo-rain : à ses yeux, « le Chiapas fait éprouver une discordance des temps 1 ». Une tout autre manière de concevoir le temps paraît mieux éprouvée par ce dépaysement radical, comme si le déplacement dans l’espace affectait en l’enrichissant notre pro-pre rapport au temps. La modernité que vous décri-vez dans votre livre est européenne, puis occiden-tale avec l’américanisation des années 1920-1930 : comment tracer les contours spatiaux d’un rapport au temps ou à l’histoire ? Le reste du monde, pour-tant affecté par le développement des sociétés euro-péennes et américaine dès les années 1860, vit-il dans un autre régime d’historicité, un autre rap-port au temps, une autre modernité ? Ou est-il marqué lui aussi par ces transformations, et com-ment d’après vous ?
Votre question est très pertinente et cette enquête serait évidemment à faire systéma-tiquement mais demanderait la mobilisation de spécialistes des différentes aires culturelles
(1) Jérôme Baschet, « L’histoire face au présent perpétuel : quelques remarques sur la relation passé/futur », in François Hartog et Jacques Revel (dir.), Les Usages politiques du passé, Paris, Éd. de l’EHESS, 2001, p. 55-74, p. 59.
capables de recueillir documents et témoigna-ges en profondeur, au-delà de la mince cou-che d’élite occidentaliste ou occidentalisée qui apparaît peu à peu dans divers pays affectés par l’expansion européenne ou américaine, colo-niale ou non. De même qu’il est clair que la dis-cordance des temps reste très forte au sein de la France pendant une grande partie du 19e siè-cle ou dans la plupart des autres pays d’Eu-rope. A fortiori ces décalages entre le nouveau régime d’historicité et les plus anciennement établis perdurent dans la plupart des régions du monde, même celles apparemment les plus modernisées. Cela est d’autant plus remarqua-ble que les groupes dominés sont ceux qui subissent de plein fouet les « dégâts du pro-grès » et sont les moins bien partagés dans l’appropriation des profits que doit en principe apporter l’avenir radieux promis. J’évoquerai deux exemples pour illustrer ce discours trop général et que seul un travail collectif permet-trait de rendre moins incertain. On interprète souvent l’énorme mouvement migratoire parti d’Europe au 19e siècle à destination des États-Unis, du Canada ou d’autres continents « vier-ges » comme l’un des signes de la confiance dans l’avenir de populations autrefois rurales et traditionnelles et de leur volonté de partager les promesses de la modernité du développe-ment économique et de l’ouverture du monde aux échanges. Si une fraction de ces migrants relève bien de ce ralliement à la modernité, les lettres envoyées par beaucoup d’autres à leurs familles restées dans le pays d’origine attestent qu’à l’inverse, nombre de ces migrants partis coloniser de nouvelles terres cherchaient en fait à échapper à la prolétarisation et à l’indus-trialisation et tentaient de retrouver ailleurs l’assise rurale et artisanale traditionnelle qu’ils voyaient menacée par les transformations éco-nomiques en Europe. Il y a fort à parier que nombre des mouvements migratoires contem-porains du sud vers le nord ou entre certains
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
243
EnTRETIEn AVEC CHRISToPHE CHARLE
sud ne relèvent pas tous de la prétendue « mon-dialisation » que nous vantent les apôtres de la modernité contemporaine mais également, de manière indirecte, de tentatives pour préser-ver des statuts menacés par les transformations accélérées en cours.
Dans un autre registre, celui de la philosophie d’ins-piration marxiste, Daniel Bensaïd avait également réfléchi à cette « discordance des temps 1 ». Or, une source de réflexion essentielle chez ce penseur était l’œuvre de Walter Benjamin, conjuguant « les pro-messes de libération future avec la rédemption d’un passé opprimé », se défiant des victoires et éprou-vant un « sentiment de dette envers les vaincus 2 ». Benjamin fut, écrit également François Hartog, l’« homme de la brèche du temps 3 ». Que vous ins-pire ce grand arpenteur du 19e siècle, de ses failles et de ses passages ? Vous-même faites aussi, pour partie, une histoire des vaincus – les révolutionnai-res des années 1830-1848 notamment. Éprouvez-vous, pour parler le langage de Benjamin, le besoin de les « sauver » ?
Je me méfie toujours d’une histoire qui s’éri-gerait en jugement dernier (dans un sens posi-tif ou négatif). Si mon questionnement sur le régime d’historicité n’est pas seulement le désir de parcourir autrement le cours des deux derniers siècles, il ne s’agit pas pour autant d’en profiter, de manière masquée, pour dis-tribuer les bons et les mauvais points, de réha-biliter les uns, ou de condamner les autres parce qu’ils auraient su percevoir ou non, com-prendre ou non ce qui était en train d’adve-nir et que l’historien, fort de son surplomb et de sa mise à distance, a beaucoup plus de faci-lités pour décrire. Il est probable que choi-sir ce type d’histoire au second degré tient à une inquiétude, bien de notre temps, et qu’elle
(1) Daniel Bensaïd, La Discordance des temps : essais sur les cri-ses, les classes, l’histoire, Paris, Éd. de la passion, 1995.
(2) Ibid., p. 207.(3) François Hartog, Régimes d’historicité : présentisme et
expériences du temps, Paris, Éd. du Seuil, 2003, 2012, p. 177.
peut retrouver l’écho des grandes figures que vous citez. Mon rapport à l’histoire du 19e siè-cle français et notamment parisien ne peut pas être cependant le même que celui de Walter Benjamin, pour la simple raison que ce der-nier, en tant qu’intellectuel allemand margina-lisé et vivant une époque de plus en plus tra-gique, projetait à l’évidence, à la suite de son illustre inspirateur Marx, nombre des obses-sions que tous les intellectuels allemands révo-lutionnaires ou progressistes ont projetées sur le pays de la Révolution française et sa capitale, et sur la nation qui, la première, a honoré les philosophes et les grands écrivains alors que les princes allemands les opprimaient ou les exi-laient. Le projet du livre inachevé et impossible de Benjamin sur « Paris capitale du 19e siècle » traduit notamment cette utopie intellectuelle compensatrice de la misère intellectuelle alle-mande : recréer, par la force de l’accumulation et de la transposition des documents histori-ques les plus divers, l’atmosphère, « l’aura », le mythe et le frisson historique dont cette ville, dans l’imaginaire allemand progressiste, était chargée depuis Heine. Des chapitres ou passa-ges de mon livre reprennent certains éléments de ce programme, sans céder aux facilités un peu vaines de vouloir égaler les illustres poètes de cette ville de Hugo à Baudelaire, de Balzac à Zola. J’aimerais sans doute pouvoir retrouver, au-delà de ces textes illustres et trompeurs, le rapport au temps historique des millions d’in-connus ayant arpenté les rues de cette ville si chargée de souvenirs et d’histoire, rêve poéti-que et non travail d’historien ; il faut garder raison non sans nostalgie.
Cette enquête pose à l’évidence, vous le notez à plu-sieurs reprises, le problème de la position de l’histo-rien, situé entre deux temporalités, donc « tout entier traversé par la discordance des temps » (p. 392). Pourriez-vous développer les implications et les enjeux de cette situation ? Qu’ajoute cette conscience
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
244
LUDIVINE BANTIGNY ET QUENTIN DELUERMOZ
des historicités au « rôle social » de l’historien ? À ces égards, qu’apporte la mise au jour des discordances du 19e siècle pour l’interprétation du 20e siècle ?
Il me semble avoir répondu indirectement à la première partie de la question dans ma réponse précédente. Sans se faire trop d’illu-sion sur « le rôle social de l’historien » dans une société qui substitue la mémoire à l’his-toire et le mythe du passé au passé véritable-ment reconstitué par les savants, il est clair que si ce livre pouvait amener ses lecteurs à rom-pre avec certaines illusions produites par les nouveaux modes d’accès à l’histoire qu’en-gendrent les médias électroniques ou audiovi-suels, il n’aura pas été complètement vain de l’écrire. En tant que professeur des Universi-tés, j’ai pu constater que les générations suc-cessives d’étudiants auxquelles j’ai pu faire cours depuis plus de vingt ans ont de plus en plus de difficultés à pénétrer dans l’historicité du 19e siècle à travers les supports écrits, tout simplement parce que la langue du 19e siècle, si proche qu’elle puisse nous paraître de la nôtre, est le produit d’un autre système d’enseigne-ment et encore l’héritière d’une tradition rhé-torique humaniste et classique. Cette tradition avait sans doute encore cours dans la période où j’ai moi-même été formé, mais, même pour les bons étudiants que j’ai encore la chance d’avoir dans mon auditoire, elle n’est décidé-ment plus celle qui les a formés. Cela explique les nuances imperceptibles par eux et les diffi-cultés à comprendre la manière de penser ou de décrire la réalité de ces documents histori-ques, qu’ils soient littéraires ou non d’ailleurs. À l’inverse, je parviens mieux, me semble-t-il, à leur faire sentir les décalages et les discor-dances avec notre époque, et donc à leur faire poser, je l’espère, les bonnes questions à ces époques maintenant lointaines à travers des documents de type graphique, visuel, cartogra-phique, statistique, etc., où ce filtre rhétorique ne s’interpose pas et où l’on est moins victime
des biais introduits par les témoins et leur façon d’écrire. Bien entendu, ce serait tomber dans un positivisme un peu réducteur de renoncer à la richesse des textes au profit de ces autres for-mes plus « neutres » d’accès à l’information sur le passé. À partir de ce premier regard, il faut tâcher de réinvestir de manière plus armée la lecture des textes qui ne vont plus de soi, faute des clés rhétoriques.
Cet exemple « pédagogique » me semble illustrer la fonction actuelle de l’historien : être le médiateur, le traducteur, le donneur d’équi-valents, pour faire comprendre, mesurer, inter-préter la discordance des temps, non seule-ment dans le sens présent/passé (pourquoi ces témoins du 19e siècle pensaient-ils ainsi et ne le faisons-nous plus ?), mais aussi passé/futur (pourquoi imaginaient-ils ainsi l’histoire à venir et pourquoi ne le pouvons-nous pas ?) et enfin présent/ futur (comment pouvons-nous utiliser cette expérience historique rétrospec-tive pour affiner notre propre perception du présent et éventuellement du futur ?).
Si l’on reprend l’hypothèse des cycles internes au régime d’historicité de la moder-nité, on a une première réponse à votre ques-tion. Contre une vision dominante du 20e siè-cle comme siècle complètement à part (« court 20e siècle », « âge des catastrophes », « siècle des ténèbres ») ou énigme alternant le meilleur et le pire, ou en perpétuel procès, une lecture dix-neuviémiste du 20e siècle à travers la discor-dance des temps de plus en plus marquée, sans en réduire la spécificité ou l’exceptionnalité, a le mérite de retrouver des principes d’intelli-gibilité historiques libérés des schémas prêts-à-penser binaires, hérités de la guerre froide, ou, à l’inverse, des lectures postmodernes sub-jectivistes et confusionnistes. Il ne s’agit là que d’hypothèses, qui demandent des vérifications, des travaux nouveaux pour les valider et, sur-tout, un travail de coopération internationale. S’il était à peu près tenable jusqu’en 1940 (et
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
245
EnTRETIEn AVEC CHRISToPHE CHARLE
encore de moins en moins) de se limiter à une analyse de la modernité à partir d’une vision occidentalo-centrée, le nouveau défi de l’his-toire de la modernité aux 20e et 21e siècles serait, avec l’aide des historiens de toutes les autres aires culturelles, de tester ces question-nements dans les nouveaux espaces progres-sivement conquis par ce régime d’historicité ainsi qu’à travers des déclinaisons forcément différentes et divergentes de la discordance des temps dont il est porteur.
Dans un passage sur les années 1880-1900, vous notez que cette « fin de siècle […] tend à assimiler fin du siècle et fin de l’histoire » (p. 320) ; en concluant votre livre, vous évoquez, pour la fin du 20e siècle cette fois, « les brèves illusions de l’après-commu-nisme sur “la fin de l’histoire” » (p. 387). Derrière le constat historique pointe une réflexion de nature plus directement politique. Par ailleurs, le titre de votre « conclusion provisoire », « La modernité dure long-temps », résonne comme en écho avec celui que Louis Althusser donna à son autobiographie, L’Avenir dure longtemps 1. Althusser entendait alors laisser davantage de place aux acteurs comme sujets faisant l’histoire, une histoire par là même sans fin, car sans téléologie. Comment vous situez-vous finalement par rapport à ces pensées de l’histoire, qui nécessairement engagent politiquement ? D’une manière plus géné-rale, travailler sur la discordance des temps, en cher-chant à dénaturaliser celui de ses contemporains, n’a-t-il pas inévitablement une dimension politique ?
Tout historien en général, comme le disait Ernest Labrousse dans l’entretien qu’il avait bien voulu m’accorder en 1979 2, a un « for inté-rieur politique » qui ne s’exprime pas toujours comme « for extérieur » dans ses écrits acadé-miques, mais peut se retrouver ailleurs. Né à la
(1) Louis Althusser, L’Avenir dure longtemps suivi de Les Faits, Paris, Stock/Éd. de l’IMEC, 1992.
(2) Ernest Labrousse, « Entretiens », présentés et annotés par Christophe Charle, Actes de la recherche en sciences sociales, 32-33, 1980, p. 11-27.
vie publique en mai 1968 en tant qu’élève de lycée gréviste quelques jours après les premiè-res barricades du Quartier Latin, mon rapport à l’histoire a toujours été habité par la nostal-gie de la participation à un moment histori-que comme celui-là, d’autant plus intensément vécu que je n’avais à l’époque que 17 ans et qu’il n’était pas encore totalement admis qu’un « mineur » (la majorité était à 21 ans) et un lycéen (donc soumis à une administration auto-ritaire dans un lycée comme Henri-IV) puisse se prévaloir d’un droit de grève déjà problé-matique quand il s’agissait de vrais étudiants. Je pense que mon orientation vers l’histoire, après un passage par la littérature, puis mon engagement pendant quelques années dans un parti politique, et dans un syndicat, puis plus tard dans des groupes de réflexion relevait de ce sentiment d’un lien nécessaire entre l’investis-sement dans certains objets historiques et leur écho dans les questions politiques sociales ou culturelles contemporaines.
Quoique élève à l’École normale supérieure à l’époque où il y enseignait encore, je n’ai jamais suivi d’enseignement d’Althusser même si j’ai lu ses livres au début de mes études supérieu-res. Formé dans les années où le structuralisme occupait le haut du pavé intellectuel et lecteur de ceux qu’on rattachait parfois abusivement à ce courant, je n’ai pas non plus opté pour les for-mulations dérivées qui pouvaient se retrouver en histoire à l’époque, comme l’histoire struc-turale, la longue durée, l’histoire des mentalités ou un certain « foucaldisme ». Au contraire, j’ai abordé le 19e siècle et l’historicité à partir des œuvres, des témoignages, des biographies et des trajectoires d’écrivains et d’intellectuels, non par empirisme ou subjectivisme antistructura-liste, mais par souci de réconcilier ce que les cou-rants intellectuels alors dominants prétendaient incompatible ou vain : élaborer des modèles d’interprétation généraux sans effacer les mar-ges d’autonomie des acteurs, leurs représenta-
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po
246
LUDIVINE BANTIGNY ET QUENTIN DELUERMOZ
recherche (ARESER) en 1992. Ce jeu d’échos qui pourrait faire conclure à la « concordance des temps » souligne la plupart du temps au contraire la discordance et le décalage entre les espoirs nourris pour l’avenir et les évolutions réelles beaucoup moins concluantes constata-bles peu après : incertitude plus que jamais sur le rôle des intellectuels dans la société du spec-tacle et des médias, absence d’un espace politi-que et intellectuel transnational malgré l’élar-gissement de l’Europe, visions de plus en plus divergentes sur les modèles universitaires à adopter pour faire face aux divers problèmes de la massification et de la compétition mondiale entre universités prônée par les instances inter-nationales dans ces domaines, etc. 1 Ce décalage pourrait inciter au pessimisme et au repli dans le passé. À l’inverse, ces erreurs de diagnostic sur la modernité, hier comme aujourd’hui, ou demain, invitent à toujours plus de vigilance et à se déprendre des schèmes tout faits et des automatismes de pensée. Bref à pratiquer la cri-tique historique, fondement de tout.
Christophe Charle, Université Paris-I, Institut d’histoire moderne et contemporaine
(IHMC), CNRS, 75005, Paris, France.
Christophe Charle, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-I, membre de l’Institut universitaire de France, dirige l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (CNRS-ENS) et préside l’Association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la recherche. Auteur ou éditeur de plus de trente d’ouvrages, il a récemment publié Théâtres en capitales : naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne (1860-1914) (Albin Michel, 2008) et, avec Jac-ques Verger, Histoire des universités xiie-xxie siècle (PUF, 2012). Son prochain livre, Homo historicus, réflexions sur l’histoire et les historiens paraît en janvier 2013 aux éditions Armand Colin. ([email protected])
(1) Voir Christophe Charle et Charles Soulié (dir.), Les Ravages de la « modernisation » universitaire en Europe, Paris, Syllepse, 2007 ; Christophe Charle et Jacques Vergé, Histoire des universités, xiie-xxie siècles, Paris, PUF, « Quadrige », 2012.
tions ou leurs productions symboliques. Par ce type de perspective, j’étais donc d’emblée dans la même orientation que celle du présent livre, res-saisir la perception du temps historique, l’espace d’action des acteurs et leurs stratégies ainsi que leur vision du passé, du présent et de l’avenir. C’est pourquoi je me suis retrouvé de plain-pied, dès ma maîtrise, dans les propositions sociolo-giques de Pierre Bourdieu qui se situait exacte-ment au même point d’articulation pour saisir les sociétés présentes comme les sociétés pas-sées, les sociétés modernes comme celles rele-vant de l’anthropologie sociale et surtout parce qu’il avait le souci de réconcilier les apports des diverses sciences sociales, de concevoir les espa-ces sociaux comme des structures historiques en mouvement produites par l’histoire et contri-buant à faire advenir une nouvelle histoire.
Mon premier travail cherchait les origines de l’engagement intellectuel de Zola et, ulté-rieurement, plus largement, celles des écrivains naturalistes, parce que l’époque que je venais de vivre autour de 1968 avait non seulement de nouveau reposé cette question, mais aussi mon-tré la perpétuelle recomposition de cette notion d’« intellectuel » et la transformation de ses marges d’action au cours des années 1970. Mon interrogation parallèle sur les élites de la Répu-blique par un jeu de miroir se posait également au moment même où les élites technocratiques du gaullisme essoufflé laissaient la place aux nouvelles élites socialistes, rupture qui rappe-lait assez clairement l’avènement de la Républi-que des « nouvelles couches » des années 1880 à un siècle d’écart. De même, mes recherches sur les universités et les universitaires entraient en résonance avec les transformations des uni-versités en France ou ailleurs dans les années 1990, ce qu’on a appelé la seconde massifica-tion, réflexion que j’ai prolongée dans le pré-sent, en fondant, avec Pierre Bourdieu, Daniel Roche et d’autres collègues, l’Association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Eco
le N
orm
ale
Sup
érie
ure
- P
aris
-
- 12
9.19
9.63
.32
- 11
/01/
2013
19h
13. ©
Pre
sses
de
Sci
ence
s P
o D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Ecole N
ormale S
upérieure - Paris - - 129.199.63.32 - 11/01/2013 19h13. ©
Presses de S
ciences Po