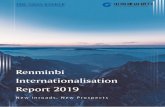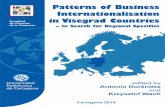Internationalisation des capitaux et emploi: les bases théoriques
Transcript of Internationalisation des capitaux et emploi: les bases théoriques
1
Internationalisation des capitaux et emploi: les bases
théoriques
Iyad Dhaoui
Research Unit Money, Development and Infrastructures (MODEVI), Faculty of
Economics and Management of Sfax, Airport Road km 4.5, Sfax, 3018.
Research Interests: Financiarisation
Lien:https://www.academia.edu/6706064/Internationalisation_des_capitaux_et_emploi_l
es_bases_theoriques
Abstract
Ce chapitre présente tout d’abord une brève caractérisation de la mondialisation financière en
considérant quelques définitions clés. Le but est de présenter des fils conducteurs et des pistes
de réflexion sur plusieurs éléments de la mondialisation financière.
A cet égard, le travail présenté voudrait fournir des éléments analytiques et factuels
permettant d’établir des liens entre la mondialisation financière et d’autres éléments
constitutifs essentiels du système capitaliste mondial.
Ensuite, les questions fondamentales posées par ce processus seront analysées. Ces questions
portent sur les formes de l’instabilité financière internationale et sur les liens entre intégration
financière et marché du travail.
Concernant ce dernier point, des questions vitales surgissent :
La financiarisation accrue des groupes industriels serait-elle sans lien avec l’aggravation du
chômage ?
La précarité de l’emploi, la montée du chômage ne serait-ils pas autant d’expressions de
l’émergence d’un régime d’accumulation mondial nouveau, dont les principaux bénéficiaires
seraient les détenteurs des revenus financiers ?
Keywords : Intégration Financière, Financiarisation, Institution du Marché du Travail.
2
Introduction
L’intégration financière internationale est l’une des tendances majeures de mouvement
contemporain de la mondialisation des économies. Cependant, il convient de souligner que
cette tendance est loin d’être une nouveauté historique.
La mondialisation financière caractérise un processus d’intégration des marchés financiers
internationaux sous le double impact de la libéralisation financière internationale et de
l’accroissement de la mobilité international des capitaux.
A. Une brève caractérisation de la mondialisation financière
I. Définition de la mondialisation financière
Pour les économistes, la mondialisation financière se définit comme un accroissement
massif des transactions internationales en actifs financiers, soit comme la convergence des
prix d’actifs financiers identiques vers un niveau commun sur tous les marchés mondiaux.
I.1. Première définition : l’accroissement du volume des transactions en actifs
financiers.
Il y a globalisation financière lorsque les échanges entre pays, de prêt bancaires, d’actions,
d’obligations, de produits dérivés, tels que les options ou contrats à terme, s’accroissent.
I.2. Deuxième définition : la convergence des prix
Une conséquence naturelle de la baisse des coûts de transactions au niveau international est
la convergence des prix d’actifs financiers identiques vers un niveau international commun,
qu’ils soient achetés, par exemple, à Tokyo, Frankfort ou Singapour.
En effet, si le prix d’un bon donné du trésor américain est plus élevé sur le marché de
Frankfort que sur celui de Singapour, par exemple, il est profitable d’acheter ce bon du trésor
en grande quantité à Singapour et de le vendre à Frankfort. Ce faisant, on fera baisser le prix à
Frankfort et augmenter le prix à Singapour ce qui conduira à une convergence: c’est le
processus que les économistes appelle arbitrage.
Dans ce chapitre, on va utiliser de façon prédominante la première définition, basée sur
l’accroissement du volume des transactions internationales.
II. La distinction entre mondialisation financière et intégration financière
3
La mondialisation financière et l’intégration financière sont en principe deux concepts
différents.
La mondialisation financière est un concept global qui fait référence à l’interconnexion
croissante du monde qu’opèrent les flux financiers internationaux.
L’intégration financière fait référence aux liens d’un pays donné avec les marchés de capitaux
internationaux.
Ainsi, il est clair que ces concepts sont étroitement apparentés.
Par exemple, la progression de la mondialisation financière s’accompagne nécessairement
d’une intégration financière croissante en moyenne.
III. Les avantages théoriques de la mondialisation financière
Il existe un quasi consensus chez les économistes en ce qui concerne les gains du libre-
échange des biens et des services.
En revanche, les économistes demeurent bien plus divisés sur la question de la mondialisation
financière.
La théorie économique attribue un certain nombre d’avantages potentiels à la mobilité des
capitaux. La mondialisation financière est à même de stimuler l’investissement dans des pays
pauvres leur permettant ainsi de se développer plus rapidement. Elle permet également une
meilleure diversification du risque au niveau mondial et elle favorise les transferts de
technologie.
III.1. Investissement et coût du capital
Certains pays riches qui ont une population vieillissante épargnent beaucoup pour financer
leurs retraites mais ont une économie peu dynamique avec des taux de rendements faibles.
Par opposition, certaines économies émergentes ont une population très jeune, avec un niveau
de revenu faible et donc peu d’épargne. Mais ces pays peuvent en revanche avoir beaucoup de
projets à forts rendements financier.
Dans un cas comme celui-ci, tout le monde gagne lorsque le capital financier du pays riches
peut être investi dans le pays émergent : le pays a des rendements plus élevés sur son capital
et peut ainsi mieux financer son régime de retraite. Le pays émergent quand à lui se développe
plus vite grâce à un investissement plus élevé.
Dans cet exemple, on voit bien qu’une vertu potentielle de la mondialisation financière est de
permettre au capital financier de quitter un pays dans lequel il est sous utilisé pour aller
4
grossir le flux d’investissement dans un pays où il n’y en avait pas assez. L’économie
mondiale en est rendue plus efficace et tout le monde y trouve son compte.
De plus, lorsque des flux de capitaux étrangers accroissent le capital financier disponible
pour l’investissement des entreprises d’un pays, cela fait baisser le coût de l’investissement
pour les entrepreneurs de ce pays : il y a plus d’investissements potentiels et le risque est
mieux partagé.
Ce faisant, l’économie du pays qui reçoit les flux financiers s’en trouve stimulée et plus
d’emplois peuvent être crées.
III.2. Diversification des risques
Dans un monde où les rendements sur les actifs financiers sont volatils, des investisseurs qui
placeraient leurs argents exclusivement dans des actifs financiers d’un type donné
s’exposeraient à des lourdes pertes potentielles.
La mondialisation financière permet aux ménages d’acquérir des actifs très divers et de pays
différents. Par exemple si l’économie d’un pays s’écroule, il est bon que les ménages de ce
pays puissent investir leur argent ailleurs et tirer un revenu de leurs fonds placés à l’étranger.
III.3. Transfert de technologie et de techniques de gouvernance, amélioration du
système financier domestique
Lorsque, grâce à la mondialisation financière, des entreprises peuvent être achetées par des
étrangers, ceux-ci peuvent utiliser des technologies qu’ils ont eux-mêmes développées, ou des
techniques de gouvernance qui leur sont propres, pour restructurer l’activité de production de
ces entreprises.
Dans certains cas, cela peut rendre l’entreprise restructurée et le pays qui reçoit
l’investissement plus compétitif et donc avoir un effet positif sur l’économie.
De façon similaire, lorsque des banques étrangères s’implantent dans un pays émergent,
elles peuvent amener des règles prudentielles et une capitalisation plus importante, ce qui peut
améliorer les performances du système financier domestique.
IV. Les coûts théoriques de la mondialisation financière
La théorie économique attribue également à la mondialisation financière des maux
potentiels très sérieux. Au premier rang, la globalisation financière tend à accroître la
5
probabilité de crises financières au sein des pays émergents. Elle peut aussi aggraver les
imperfections des marchés financiers locaux, au lieu de les rendre plus performants.
Elle rend également plus aisée l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.
IV.1. Les crises financières
Les crises financières se définissent comme des épisodes de fuite brutale de capitaux ayant
des conséquences catastrophiques pour le pays considéré.
IV.2. Imperfection des marchés financiers
Les marchés financiers sont souvent ce que les économistes appellent des marchés
imparfaits1.
Il y a souvent sur ces marchés des problèmes d’information asymétrique et quelquefois des
problèmes de corruption. Les marchés financiers sont aussi sujets à des problèmes de panique,
de concurrence imparfaite,… Ces imperfections peuvent être source de prises de risques
excessives résultant en faillites lors de détournement de la conjoncture.
V. Les facteurs de la mondialisation financière
Tout facteur conduisant à une baisse des coûts de transaction sur les marchés financiers
favorise ainsi la mondialisation financière.
V.1. Les facteurs d’ordre technologique
Le développement des technologies de télécommunication a été un élément majeur
expliquant la croissance des transactions financières internationales.
En effet, la baisse du coût des télécommunications stimule l’échange d’informations et la
mobilité du capital financier en est accrue.
Ainsi, tout investisseur désirant acheter des titres d’une entreprise étrangère entend bien avoir
un certain nombre d’informations avant de réaliser sa transaction.
Le développement de certains produits financiers dérivés comme les options ou les contrats à
terme permet également aux investisseurs de mieux couvrir les risques d’investissements
internationaux.
V.2. Les facteurs d’ordre politiques
1 Les imperfections des marchés financiers ont été étudiées en économie depuis les années 1970.
6
Il existe des facteurs de politique économique qui ont contribué significativement à
l’accroissement des échanges financiers internationaux.
Ainsi, certains pays dans lesquels les gouvernements avaient adopté des lois interdisant
l’achat d’entreprises locales par des étrangers, ou empêchant leurs citoyens de placer leurs
argents ailleurs, ont levé ces restrictions sur les flux de capitaux. Bien évidemment, ces pays
sont exclus, partiellement ou complètement de la globalisation financière.
V.3. L’accroissement des flux migratoires
L’accroissement des flux migratoires est aussi un facteur favorable à la mondialisation.
En effet, ces flux favorisent la constitution de réseaux internationaux au sein desquels se
développe un commerce très intense de biens et de capitaux.
VI. Les mesures de l’intégration des marchés financiers
VI.1. Les mesures basées sur les théories d’évaluation des actifs
Dans ce contexte, on peut citer le modèle d’évaluation des actifs financiers à
l’international. Ces modèles sont utilisés pour l’estimation des valeurs des actifs financiers
cotés sur divers marchés financiers.
Beaker et Harvey (2003)2 ont utilisé le modèle des actifs financiers pour mesurer le degré
d’intégration entre les différents marchés.
VI.2. Les mesures basées sur les coefficients de corrélation
L’étude des coefficients de corrélation des rendements entre les séries boursières est la
technique la plus simple pour examiner l’intégration des marchés financiers. En effet, plus
ce coefficient est proche de l’unité, plus l’hypothèse de l’intégration est acceptée.
Cette méthode a été utilisée par Levy et Saranat (1970)3 et Solnik (1974)
4 en vue
d’identifier les bienfaits à court terme de la diversification internationale.
VI.3. Les mesures basées sur la méthode de cointégration
2 Beaker G. et Harvey C., Emerging market finance, Journal of empirical finance, Vol 10, issue 1-2, 2003.
3 Levy H. et Saranat M., International diversification of investment portfolios, The American Economic
Review, Vol. 60, n0 4, pp 668-675, 1970.
4 Solnik B.H., The intezrnatiuonal pricing of risk: an empirical investigation of the world capital structure,
Journal of Finance, n0 29, 1994.
7
Le développement de la théorie de cointégration remonte à Granger (1986)5 qui a étudié
l’interdépendance entre les marchés financiers internationaux dans le contexte du non
stationnarité des séries temporelles. Cette cointégration peu être interprétée comme une
relation d’équilibre à long terme entre les variables étudiées.
VI.4. Les travaux de Lane et Milesi-Ferretti
Les travaux de Lane et Milesi-Ferretti (2006)6 permettent d’avoir une vision relativement
précise de l’expansion des mouvements internationaux de capitaux depuis les années 70.
Les deux auteurs proposent en effet une mesure de l’intégration financière internationale en
volume :
Avec : AEit : le stock des actifs étrangers
EEit : le stock des engagements étrangers
B. La mondialisation financière : quelles sont les questions
Les effets de la mondialisation financière sont l’objet d’importants débats entre les
économistes. Certaines questions sont particulièrement importantes à considérer.
I. Formes st explications de l’instabilité financière
La mobilité internationale croissante des capitaux est source de risques importants pour
l’économie mondiale.
Par ailleurs, les crises financières ont des coûts macroéconomiques considérables.
Notons que les crises financières prennent leur ressort sur de nouvelles pratiques adoptées par
les agents sur les marchés financiers7.
II. L’emploi au cœur du débat
II.1. Financiarisation et flexibilité du travail
5 Granger C., Development in the study of cointegrated economic variables, Oxford Bulletin of Economics
and Statistics, n0 48, 1986.
6 Lane P.R et Milesi-Feretti G.M., The external wealth of nations market: revised and extended estimates
foreign assets and liabilities, IMF Working Papers, 2006. 7 Pour une analyse plus complète, se rapporter à Allegert et Le Merrer (2007), chapitre 4.
IFTPIBit=(AEit +EEit )
PIBit
8
L’objet de cette pratique consiste à établir des relations entre la financiarisation et les
modifications observées dans la gestion de la force du travail.
La financiarisation sous ses formes diverses entraîne une flexibilité accrue des salaires et de
l’emploi.
Le terme flexibilité revêt des sens différents selon les auteurs. L’OCDE oppose la ״ flexibilité
numérique״ à la ״flexibilité fonctionnelle״. La première concerne toutes les formes
quantitatives de flexibilité, tant internes qu’externes à l’entreprise, et qui ont pour objet les
salaires et l’emploi. La seconde est d’ordre plus quantitatif et traite en fait de l’adaptabilité de
la main d’œuvre.
Notons que ces deux types de flexibilité entretiennent à l’évidence des rapports entre elles,
mais il convient de les distinguer l’une de l’autre. On peut considérer par exemple que lorsque
les entreprises préfèrent le long terme au court terme, elles privilégient la diminution de la
main d’œuvre ce qui les conduit à chercher la flexibilité fonctionnelles du travail8.
II.2. Mondialisation financière et institutions du marché du travail
La libéralisation de la plupart des systèmes financiers nationaux et la multiplication des
nouveaux instruments financiers conduisent à des modes de régulation originaux qui mettent
en concurrence les anciennes formes institutionnelles, en particulier les institutions du marché
du travail qui ne parviennent pas à s’ajuster aux nouvelles dynamiques de la concurrence et de
l’innovation financière.
Conclusion
En termes plus simples, une des vertus potentielles de la mondialisation financière est qu’elle
met en contact acteurs économiques nationaux et acteurs économiques étrangers. Et dans
certains cas, un processus bénéfique d’échange de savoir-faire peut s’opérer.
Théoriquement, l’internationalisation des capitaux influence le marché du travail de multiples
façons surtout une flexibilité des salaires et de l’emploi et des changements des institutions de
ce marché.
8 Amadeo E.J. et .Camargo J.C. (1995) notent que le débat sur la flexibilité port davantage aux États-Unis
sur la flexibilité fonctionnelle qu’en Europe, où il tend à être plus centré sur la flexibilité quantitative dans la mesure où la définition des postes de travail y est moins rigide et flexibilité du marché du travail, tant des salaires que des emplois, est moins déployé en Europe qu’en Amérique.
9
Bibliographie
I. Ouvrages et Articles
1) ALLEGRET J.P. ; Le MERRER P. [2007], «Économie de la mondialisation»,
Collection OuvertureÉconomique, De Boeck, Bruxelles.
2) AMEDEO E.J. ;CAMARGO J.P. [1995],«New unionism and the relations among
capital, labour and the state: A global perspective»,in Brazil in J. Schor and J. You
(editors) Capital, United Nation University Press.
3) ARGHIRI E. [1974], «Myths of development versus myths of underdevelopment», New Left Review, Vol. 1,n0 85. 4) ARTHUIS J. [1993], «Les délocalisations et l’emploi», Les Éditions
d’Organisation,Paris.
5) BEAKER G.; HARVEY C. [2003], «Emerging market finance», Journal of
Empirical Finance, Vol. 10, Issue 1-2.
6) DESTANNES G. [2002], «Relations économiques internationales», Dalloz,
Paris.
7) EICHENGREEN.TOBIN et WHYPLOSZ. [1995],«two cases for sand in wells of
international finance», Economic Journal.
8) FONTAGNÉ L.; PAJOT M. [1999], «Investissement direct à l’étranger et
échanges extérieurs : Un impact plus fort aux États-Unis qu’en France», Économie et
Statistique, Vol. 6, n0 7,pp : 326-327, Paris.
9) GRANGER C.[1986], «Development in the study of cointegrated economic
variables», Oxford Bulletin of Economics and Statistics, n0 48.
10) HATZICHORONOGLOU T. [2006], «L’impact des délocalisations sur l’emploi:
problèmes de mesure et implications politiques», OCDE, Document de Travail,
n0 33(19), Paris.
11) LANE P.R.; MILESI-FERRETTI G.M. [2006], «The external wealth of nations
market: revised and extended estimates of foreign assets and liabilities», IMF
Working Papers, WP/06/29.
12) LEAMER E. [1996 b], «Effort, wages and the international division of labor»,
NBER Working Papers, n0 5803.
13) LEVY H.;SARANAT M. [1970], «International diversification of investment
portfolios», The American Economic Review, Vol.60, n0 4, pp 668-675.
10
14) LIPSEY R.E.;WEISS M.Y. [1984],«Foreign production and exports of individual
firms», Review of Economics and Statistics, Vol.66, n0 2.
15) MARKUSEN J.R. ; VENABLES A.J. [1999], «FDI : acatalyst for
industrialdevelopment», EuropeanReview, n°43.
16) MATHIEU C. ; STERDYNIACK H. [1994], «L’émergence de l’Asie en
développement menace-t-elle l’emploi en France ?», Observatoire et Diagnostique
Économique, Paris.
17) MAURICE B. [1987], «Relations économiques internationales»,Hachette, 5ème
édition, Paris.
18) MUCHIELLI J.L. [2001], «Relations économiques internationales», Hachette,
Paris.
19) PASSET O. et al [2000], «Une certaine hésitation», Revue de l’OFCE, Vol. 75,
Issue 1.
20) PAUQUET L. [2006], «Les besoins de recrutement des entreprises entre
emploi qualifié et emploi non qualifié», CREDOC, n0 194.
21) SOLNIK B. H. [1974], «Theinternational pricing of risk: An empirical
investigation of the world capital market structure»,Journal of Finance, n0 29.
22) TOUJAS B.; MAGNIER A. [1993], «Innovation technologique et performance à
l’exportation : une comparaison des cinq grands pays industrialisés», INSEE,
Document de Travail, 1993.
23) VERNON R. [1966], «International investment and international trade in the
product cycle», Quarterly Journal of Economics, Vol.80, n°2.
24) WOOD A. [1998], «Globalization and the rise of market labour inequality»,
The Economic Journal, Vol.108, n°450.
II. Sites Internet
Banque des Règlements Internationaux : http://www.bis.org Le site contient de nombreuses informations statistiques sur la mondialisation financière (notamment des données sur les financements internationaux). Le rapport annuel est particulièrement intéressant. Il est publié chaque année.
OCDE : www.oecd.org
statistiques financières internationales
Perspectives de l’emploi de l’OCDE, Les délocalisations et l’emploi :
11
tendances et impacts : www.oecd.org/els/employmentoutlook
www.oecd.org/publications/syntheses
BITwww.ilo.org.com Base de données du BIT: bureau de la bibliothèque et des séries d’informations:http:///www.ilo.org/publications/french/support/lib/resources/ilodatabase.htm