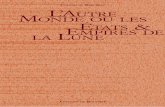Hély M., Pudal R., Simonet M., 2014, « Autre économie », autre démocratie sociale ? Sur...
Transcript of Hély M., Pudal R., Simonet M., 2014, « Autre économie », autre démocratie sociale ? Sur...
289
«!Autre économie!», autre démocratie sociale ? Sur les relations entre syndicats patronaux
de l’économie sociale et solidaire et champ politique
Matthieu HÉLY, Romain PUDAL et Maud SIMONET
«!Les entreprises de l’économie sociale ne sont pas des entreprises comme les autres, mais commes les autres, elles sont des entreprises.!»
Alain Cordesse, président de l’USGERES, 18 avril 2012.
En février!2012, le numéro!4 de la La Lettre de l’USGERES –!l’Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs de l’économie sociale fondé en 1994 1!– était consacré à l’élection présidentielle. Alain Cordesse, président de l’Usgeres et vice-président du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire écrit ainsi dans l’éditorial!:
«!Sur fond de crise de dette et de l’économie financiarisée, 2012 s’annonce comme une année importante pour le choix et les orientations politiques de ces cinq!prochaines années. L’USGERES, fidèle à son positionnement d’organisation professionnelle indépendante de tout pouvoir politique, ne prendra position pour aucun des candidats en lice. La période actuelle est l’occasion de rencontrer les états-majors de campagne pour formuler nos propositions et contributions pour sortir du chômage de masse et de la crise économique. Comme d’autres, nous sommes écou-tés ; espérons que nous serons également entendus à l’heure des choix et des priorités qui seront posés pour le prochain quinquennat!».
Alain Cordesse évoque alors les trois!questions posées par l’USGERES à six!candidats à l’élection présidentielle ou à leur représentants (François!Bayrou,
1. Suite à la loi quinquennale de décembre!1992 portant sur la formation professionnelle, les partenaires sociaux se sont vus confier le pilotage des OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé) et en l’espèce pour l’économie sociale et solidaire (ESS) c’est l’OPCA Uniformation qui va remplir ce rôle. C’est dans la continuité de cette réforme que naît l’USGERES en 1994. L’USGERES couvre aujourd’hui douze!branches professionnelles, à côté de l’UNIFED –!l’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social, autre regroupement de syndicats employeurs du secteur, créé un an plus tôt et qui en couvre!quatre. Cf.!Annexe.
MATTHIEU HÉLY, ROMAIN PUDAL ET MAUD SIMONET
290
Jean-François!Copé 2, François!Hollande, Eva! Joly, Jean-Luc!Mélenchon et Hervé!Morin) et leurs réponses publiées dans La Lettre.
«!Comment le pays peut-il s’appuyer sur l’économie sociale pour développer l’em-ploi ? Quelle place l’économie sociale devrait-elle tenir dans la prochaine mandature qui s’annonce sur fond de crise de la dette et de l’économie financiarisée ? Quelle forme doit, selon vous, prendre la reconnaissance de la représentativité patronale de l’économie sociale qui constituerait une évolution importante de la démocratie sociale dans notre pays ?!»
interroge ainsi l’USGERES. Du «!je ferai tout pour mettre l’économie sociale sociale au cœur du redressement de notre pays!» de François!Bayrou à l’«!ESS est une alternative crédible à l’approche financiarisée et non-productive de l’économie!» d’Eva!Joly en passant par «!l’économie sociale est un vecteur de croissance juste et équitable!» de François!Hollande, «!toutes les réponses louent la qualité de l’ESS et l’engagement de ses acteurs!: “incontournable“, “actifs”, “ça marche”, “au cœur de notre économie”…!» comme on peut le lire sur le site de l’Atelier, le Centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire en Ile de France.
Les questions posées par l’USGERES aux candidats comme les réponses apportées par ceux-ci donnent bien à voir l’état des relations entre les syndicats employeurs de l’économie sociale et le champ politique aujourd’hui. Après une période d’institutionnalisation par la gauche socialiste et écologiste, puis de légi-timation au-delà des clivages partisans plus récemment, l’ESS comme cause et moyen d’action politiques semble une évidence partagée par l’ensemble du champ politique français. C’est à ce moment de reconnaissance institutionnelle quasi généralisée qu’une revendication politique nouvelle se fait entendre avec force dans le champ de l’économie sociale!: celle de la représentativité des syndicats employeurs.
L’ESS comme politique!: une cause de plus en plus consensuelle
L’histoire des relations entre l’ESS et le champ politique est d’abord marquée par le retour de la thèmatique de «!l’économie sociale!» dès le début des années!1970 puis par un processus d’institutionnalisation du monde associatif essentiellement entrepris par la gauche au pouvoir dans les années!1980 et!1990 3. À!partir des années!2000, la cause est celle de l’économie sociale et solidaire, et elle devient progressivement plus consensuelle, comme incontournable, bien au-delà des clivages partisans.
2. À!l’époque Nicolas Sarkozy ne s’était pas encore déclaré officiellement et Hervé!Morin n’avait pas annoncé son ralliement au candidat de l’UMP.
3. Schématiquement, on pourrait dire que l’ESS s’ancre dans deux traditions, l’une issue du socialisme utopique, passant par le PSU jusqu’au PS aujourd’hui dans sa version minoritaire, l’autre plutôt liée à!68 et ses multiples déclinaisons –!engagements écologistes, communautaires, féministes, alternatifs, etc. Or, il y a une sorte de coup de force symbolique dans l’association de ces deux!traditions qui crée bien des confusions voire nourrit des conflits internes à cette mouvance.!
«!AUTRE ÉCONOMIE!», AUTRE DÉMOCRATIE SOCIALE ? …
291
«!Retour!» de l’économie sociale et institutionnalisation du monde associatif par la gauche au pouvoir!: 1970-2001
Dès!1970, la fondation du Comité national de liaison des activités mutualistes coopératives et associatives (CNLAMCA) relance la dynamique de l’économie sociale dont l’expansion avait été fortement encadrée par la dilatation des missions de l’État social 4. En!1980, le CNLAMCA adopte une Charte de l’économie sociale dont l’article!7 stipule que les entreprises de l’économie sociale sont «!au service de l’homme!».
L’arrivée de la gauche au pouvoir en!1981 a indéniablement constitué un temps fort dans la structuration institutionnelle et l’unification du «!mouvement!» associa-tif, désormais rattaché à l’éphémère ministère du Temps libre. Le Conseil national de la vie associative (CNVA) est créé par le décret du 25!février!1983 et placé sous l’autorité du Premier!ministre. Il constitue la première instance de représentation politique du monde associatif et a pour mission d’éditer des bilans réguliers sur les évolutions de la vie associative et de formuler des propositions.
À!partir de!1992, le CNVA n’est plus la seule instance de représentation du monde associatif. En effet, la Conférence permanente des coordinations associa-tives (CPCA) regroupant 16 coordinations associatives nationales investies dans des domaines très variés, du sport à la culture, en passant par le tourisme et la famille (le CPCA revendique environ 500 000!associations adhérentes), est créée. L’organisation des premières Assises de la vie associative en février!1999 constitue une étape décisive dans l’institutionnalisation des rapports entre l’État et le monde associatif 5. Elle marque en effet la reconnaissance politique, par Lionel!Jospin, Premier!ministre de l’époque, du statut de la CPCA comme «!instance représenta-tive du mouvement associatif!» et la fin du monopole du CNVA, qui demeure un service consultatif auprès des pouvoirs publics.
La concertation avec la puissance publique, organisée au sein des premières Assises nationales de la vie associative, débouche sur la signature par l’État et la CPCA, en!2001, de la Charte des engagements réciproques entre État et associations. Le CNVA est alors désigné comme l’instance chargée d’évaluer la mise en œuvre de cet acte officiel. Suite à l’organisation de ces assises, le monde associatif bénéficie pour la première fois d’une tutelle ministérielle explicite puisqu’en avril!2004, Jean-François!Lamour devient ministre de la Jeunesse des sports et de la Vie associative. Par ailleurs, la volonté tenace de la CPCA de poursuivre la concertation avec l’État aboutit à la première conférence nationale qui s’est déroulée le 23!janvier!2006 sous l’égide du Premier!ministre Dominique de Villepin. Trois!axes de développement sont privilégiés!: affirmer la place des associations dans le dialogue civil, consolider les relations contractuelles entre les pouvoirs publics et mieux accompagner et
4. HELY M. et MOULEVRIER P., L’économie sociale et solidaire!: de l’utopie aux pratiques, Paris, La!Dispute, 2013.5. SIMONET M., «!L’expertise associative et la représentation politique du monde associatif!: entretiens
avec Julien Adda et Philippe-Henri-Dutheil!», in SIMONET!M. et LOCHARD!Y., L’expert associatif, le savant et le politique, Syllepse, Paris, 2003, p.!109-128.
MATTHIEU HÉLY, ROMAIN PUDAL ET MAUD SIMONET
292
reconnaître l’activité bénévole. La seconde édition de cette conférence, de nouveau organisée par le CNVA, avec la collaboration notamment de la CPCA s’est assignée des thèmes très proches de la précédente!: la place des associations dans le dialogue civil, les relations entre les associations et les pouvoirs publics, État et collectivités et la reconnaissance et la valorisation de l’engagement bénévole et volontaire.
La création d’instances dédiées à la promotion des intérêts du monde associatif a sans doute participé à renforcer la place accordée à ce dernier par l’État en main-tenant l’exigence de consultations régulières et de tenir les engagements annoncés. En dépit d’une mise en œuvre très lente des décisions prises, force est de consta-ter que la représentation du monde associatif dans les institutions politiques s’est, malgré tout, significativement renforcée en particulier dans le cadre de la réforme du Conseil économique et social, désormais rebaptisé en Conseil économique, social et environnemental. Cette réforme a en effet modifié le nombre de représen-tants du monde associatif qui sont désormais!36 (soit 18 %!des membres) contre 15!auparavant (soit 8 %!des membres du précédent conseil). Dans son rapport remis au Premier!ministre en!2010 sur «!la représentation du monde associatif dans le dialogue civil!», Luc!Ferry évoque la réforme du CNVA, appelé à se transformer en Haut conseil à la vie associative et doté de moyens supplémentaires. Cette instance resterait rattachée auprès du Premier!ministre et conserverait ses fonctions d’ex-pertise. La bicéphalie du monde associatif, officialisée à partir de!1999, serait ici consacrée par une séparation claire des rôles entre une CPCA, chargée d’incarner la diversité sectorielle du monde associatif et le Haut conseil à la vie associative, servant d’instance de consultation et d’expertise pour l’élaboration des politiques publiques.
L’ESS!: une cause politiquement consensuelle
Ce mouvement de reconnaissance et d’institutionnalisation se poursuit dans les années!2000 et ce n’est plus simplement le monde associatif mais bien l’ensemble de l’économie sociale et solidiare qui est visé. Ainsi, le gouvernement de Lionel Jospin a reconnu le secteur de l’ESS en lui donnant son premier secrétariat d’État dirigé à l’époque par l’écologiste Guy!Hascoët de!2000 à!2002. En!2006, dans le cadre de la redéfinition d’une nouvelle délégation à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale, le Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l’économie sociale (CEGES) a demandé et obtenu, la création d’un Conseil supé-rieur de l’économie sociale (qui se substitue au Comité consultatif antérieur, lequel n’avait plus été réuni depuis 2002 6).
6. Créé par décret (no!2006 - 826) le 10!juillet!2006, le Conseil supérieur de l’économie sociale est présidé par la ministre de l’Économie, de l’Industrie et des Finances, Christine!Lagarde. Cette instance sera réformée en 2010, par Marc-Philippe!Daubresse, ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives, et Laurent!Wauquiez, Secrétaire d’État chargé de l’emploi auprès du ministre de l’Économie, de l’In-dustrie et de l’Emploi Christine!Lagarde, pour prendre le nom de Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS).
«!AUTRE ÉCONOMIE!», AUTRE DÉMOCRATIE SOCIALE ? …
293
Enfin, en!2012 , Benoît!Hamon est nommé ministre de l’ESS dans le gouver-nement dirigé par Jean-Marc!Ayrault. Selon le décret relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé de l’éco-nomie sociale et solidaire et de la consommation, le ministre de l’ESS
«!prépare et met en œuvre la politique relative au développement de l’écono-mie sociale et solidaire et aux activités d’intérêt général ou d’utilité sociale qui y concourent. Il est associé à la préparation de la politique à l’égard des associations, des structures coopératives et mutualistes et de toutes les autres catégories d’orga-nismes répondant aux objectifs de l’économie sociale et solidaire. Il participe à l’éla-boration de la politique de la ville, de la politique de l’insertion par l’activité écono-mique et de l’insertion dans l’emploi, ainsi qu’à l’élaboration de la réglementation fiscale et de la réglementation de la commande publique dans la mesure où elles concernent l’économie sociale et solidaire!».
L’un des premiers axes de la politique menée par le ministre de l’ESS consiste à adopter une loi cadre définissant notamment son périmètre.
Toutefois, malgré les piliers revendiqués par certain-e-s (pas de dividendes aux actionnaires, démocratie interne, projet économique centré sur l’humain) le flou définitionnel qui entoure l’ESS permet des rapprochements multiples, au-delà des affinitiés traditionnelles. Ainsi, c’est le centriste Francis!Vercamer qui fait un rapport parlementaire remarqué et favorable à l’ESS et c’est Jean!Sarkozy qui préside aux destinées de l’ESS au conseil général des Hauts de Seine. De fait, pratique-ment l’ensemble des organisations politiques se sont exprimées en faveur de l’ESS –!ce qui en fait un sujet de consensus rarement atteint. Lors de la dernière campagne présidentielle, il est à noter que le CEGES avait, à la manière de l’USGERES avec sa lettre, convié chacun des candidats –!sauf le FN!– à venir s’exprimer sur l’ESS et donner les grandes lignes de son action en matière d’économie.
Au niveau des collectivités territoriales, l’intérêt des élus locaux pour l’ESS doit évidemment être réinscrit dans le contexte historique des transferts de compé-tences réalisés par l’État aux collectivités territoriales ; ce qui n’est évidemment pas sans conséquence sur l’effort financier de ces dernières. Mais, au-delà de ce contexte général, penser que seuls les territoires classés «!à gauche!» développe-raient des politiques publiques en faveur de l’ESS serait une erreur. Le département des Hauts-de-Seine, dirigé par une équipe «!de droite!», a ainsi créé l’événement en novembre!2011 en inaugurant le 1er forum départemental de l’ESS des Hauts-de-Seine à la suite de la constitution du Conseil départemental de l’ESS présidé par Jean!Sarkozy, élu en charge de l’insertion et de l’ESS. Cette initiative est la marque d’un investissement finalement plus partagé, parce qu’économiquement et symboliquement rentable, entre la gauche et la droite. La présence de ténors de la scène politique nationale, en particulier de Patrick!Devedjian, au titre du conseil général des Hauts-de-Seine, et de Jean!Sarkozy, en qualité de président du Conseil départemental de l’ESS, à l’occasion du «!forum de l’ESS des Hauts de Seine!» ce 28!novembre!2011, atteste de l’importance prise par le secteur. Introduisant la jour-née, ponctuée notamment par la remise des prix aux lauréats de l’appel à projets
MATTHIEU HÉLY, ROMAIN PUDAL ET MAUD SIMONET
294
visant à récompenser les «!entrepreneurs sociaux!», Jean!Sarkozy revient sur le choix du lieu, dédié généralement aux séminaires d’entreprises, de la Grande Arche de la Défense!:
«!Alors, pourquoi La Défense ? Était-ce simplement par goût de provocation ? Je ne sais pas, mais en tout cas il y avait peut-être un peu un souci de transgression. Le désir, d’être là où on ne nous attendait pas. Sur l’économie sociale et solidaire et géographiquement. Du symbole et ensuite, par sens. Le symbole de La Défense, parce que c’est au cœur du capitalisme traditionnel, dont les excès ont pu apparaître au grand jour. Le changement c’est au cœur de ce lieu qu’il doit germer et que les codes traditionnels doivent être bousculés. Parce que, comme l’a rappelé encore une fois Patrick!Devedjian, les mots d’économie et de création de richesse ont un sens ici. Et que les mots de solidarité, de création de valeur humaine, gagneront peut-être à en avoir un plus grand. Et dans le contexte actuel de crise, qui a fait éclater au grand jour cette urgence, je crois que plus que jamais apparaît la pertinence de la révolution tranquille que constitue l’économie sociale et solidaire. Révolution tranquille parce qu’elle apporte des réponses aux problèmes que nous traversons aujourd’hui, par qu’elle est force d’innovation, parce qu’elle propose un développement qui est équi-libré, et parce qu’elle est l’œuvre d’entrepreneurs pragmatiques, et non pas le résultat d’une idéologie abstraite et déconnectée des réalités.!»
Ainsi, la rhétorique de légitimation de l’ESS s’homogénéise-t-elle, au-delà des clivages partisans, moins autour d’une rupture avec le capitalisme que dans l’accom-pagnement, par des initiatives solidaires, d’une «!révolution tranquille!» vers une économie plus «!humaine!» et «!démocratique!». S’il serait excessif de nier toute nuance partisane au sujet de l’«!ESS!», force est néanmoins de constater qu’il existe un consensus, dans l’espace politique, pour admettre et conforter la légitimité de l’ESS et la nécessité d’en soutenir le développement.
Or, conforter la légitimité du secteur et en soutenir le développement passe aujourd’hui, selon l’une des principales organisations patronales du secteur, l’USGERES, par une nouvelle revendication!: la reconnaissance de la représentativité patronale des syndicats employeurs de l’économie sociale.
Politique de l’ESS!: l’enjeu de la représentativité patronale
L’ESS représente aujourd’hui 8 %!du PIB, 9,2 %!des entreprises en France soit près de 215 000!établissements employeurs. Entre!2006 et!2008, l’ESS a contribué pour 18 %!à l’augmentation des effectifs salariés grâce à la création de 104 000!emplois. L’emploi dans des organisations de l’ESS représenterait aujourd’hui environ 10 %!de l’emploi salarié soit 2,3millions de salariés.
À!ce jour, l’USGERES revendique 770 000!salariés et 60 000!employeurs, recou-vrant douze!branches professionnelles!: l’animation, l’aide à domicile, l’accompa-gnement social des jeunes, le développement local, etc.
De la structuration des syndicats employeurs…
Cette structuration, encore récente, d’un syndicat employeur résulte de plusieurs processus.
«!AUTRE ÉCONOMIE!», AUTRE DÉMOCRATIE SOCIALE ? …
295
Premièrement, il s’agit de prendre acte de la croissance de l’emploi salarié dans les secteurs de l’ESS –!à 80 %!dans les associations. Ce phénomène de salarisation a eu pour conséquence la progressive prise de conscience de devoir se «!compor-ter en employeurs!» du côté des responsables d’un certain nombre de structures!: l’application de conventions collectives, le respect du droit du travail, la formali-sation et l’institutionnalisation de certaines modalités du dialogue social (délégué du personnel, délégué syndical…) deviennent des enjeux de première importance. Selon la formule humoristique de l’un de nos interviewés, «!il n’y a pas des patrons de gauche ou de droite, mais seulement de bons ou de mauvais patrons!». Cette prise de conscience progressive, qui ne semble pas encore achevée pour autant selon plusieurs de nos interlocuteurs 7, est notamment au principe de la création par l’USGERES et des représentants des cinq!confédérations syndicales de salariés en avril!2001 d’un groupe de dialogue social. Ses activités ont été reconduites en juillet!2003 pour faire de ce Groupe de dialogue social un lieu permanent d’échange et de travail entre l’USGERES et les confédérations syndicales.
C’est aussi la volonté de «!parler d’une seule voix!» face à des organisations syndicales salariées lors de négociations diverses qui a sans doute motivé cette structuration.
Enfin, il faut souligner l’ambition pour certains fondateurs de syndicats employeurs d’incarner un «!patronat!» –!beaucoup préfèrent parler d’entrepreneurs ou d’employeurs!– différent de celui du Medef. Cet élément crucial de la représenta-tion qu’ont d’eux-mêmes les employeurs de l’ESS fonctionne comme un marqueur identitaire fort.
Cette prise de conscience, cette volonté et cette ambition sont au principe d’une démarche qui vise à faire reconnaître par les pouvoirs publics l’USGERES comme un acteur patronal à part entière. La voie privilégiée pour y parvenir consiste à être reconnue comme une organisation interprofessionnelle, et non simplement multi-branches, ce qui permet alors d’être présent dans différents organes de négo-ciation et de discussions!: la Commission nationale de la négociation collective, le Conseil supérieur la prud’homie 8, le Conseil économique, social environnemental et le Conseil d’administration de l’ANACT.
C’est précisément dans cette optique qu’à l’occasion des élections prud’ho-males de décembre!2002 l’USGERES, l’UNIFED, le GEMA et l’UNASSAD (devenue
7. Une vingtaine d’entretiens ont été menés avec des responsables et des personnalités historiques de l’ESS au cours de notre enquête débutée en 2010, (recherche PICRI financée par la région Ile-de-France et intitulée «!Le dialogue social dans les entreprises de l'économie sociale. État des lieux et perspectives!».).
8. Au titre de l’ Article R. 1431-6. Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’ho-mie sont!: 1o!Cinq!membres sur proposition du Mouvement des entreprises de France (Medef), parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites ; 2o!Un!membre, représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ; 3o!Un!membre sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entre-prises (CGPME) ; 4o!Un!membre, représentant les professions agricoles, sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ; 5o!Un!membre, représentant les employeurs artisans, sur proposition de l’Union professionnelle artisanale (UPA).
MATTHIEU HÉLY, ROMAIN PUDAL ET MAUD SIMONET
296
membre de l’USGERES en!2003) s’associent pour présenter 125!listes «!Employeurs de l’économie sociale!: associations, coopératives , mutuelles, fondations!». Ces listes ont obtenu près de 12 %!des suffrages. Et ce que beaucoup ont considéré comme un succès a ouvert la voie à la création de l’Association de formation des élus prud’homaux, l’APFEES. Cette dynamique a connu un second temps fort avec les élections prud’homales de 2008!: les listes présentées sous l’étiquette AEES –!Association des Employeurs de l’Économie Sociale!– ont en effet recueilli quelque 19 %!des voix, soit une nette progression par rapport aux 7,7 %!des voix enregis-trés en!2002. L’AEES, qui regroupe l’USGERES, l’Unifed et le GEMA, représente 200 000!employeurs. Elle obtient donc 465!conseillers dans les instances prud’ho-males contre!280!en!2002 –!essentiellement dans la section «!activités diverses!».
… à la question de la mesure de représentativité patronale
Comme le rappellent Sophie!Béroud, Karel!Yon et Jean-Pierre!Le!Crom, il convient de bien distinguer les règles de représentativité des organisations employeurs selon le niveau de négociation 9!:
– dans l’entreprise, il n’y a théoriquement pas de problème de représentativité pour l’employeur, de facto représentatif de l’entreprise, mais la question peut aujourd’hui être posée même à ce niveau du fait des contours plus incertains de la notion d’entreprise ;
– dans les branches, sauf exceptions, la représentativité était obtenue par «!entente mutuelle!» entre organisations patronales (ce point est important car cela signifie qu’en cas de reconnaissance mutuelle, ce sont les organisa-tions patronales qui définissent le périmètre de la branche, avec toutefois l’aval de l’administration du Travail, qui réunit les commissions mixtes paritaires). À!défaut d’accord entre organisations, la représentativité était accordée par le ministère du Travail, sous le contrôle du Conseil d’État ;
– au niveau interprofessionnel, en l’absence de texte, étaient reconnues repré-sentatives les organisations patronales siégeant à la Commission nationale des conventions collectives. Ce critère servait aussi à désigner les organisations représentatives dans les instances consultatives et paritaires, mais sans que ce soit toujours très clair et avec des variations selon la compétence et les attri-butions des dites instances.
Au niveau interprofessionnel, le structuration des employeurs de l’économie sociale interroge les fondements de la négociation collective dans la mesure où elle n’est pas représentée par les organisations patronales actuellement reconnues comme représentatives!: Medef, CGPME, UPA, UNAPL, FNSEA, et CNMCCA. Après deux!ans de négociation, le premier accord interprofessionnel sur la forma-tion professionnelle tout au long de la vie dans l’économie sociale a été signé le
9. BEROUD S., YON K. et LE CROM J.-P., «!Représentativités syndicales, représentativités patronales. Règles juridiques et pratiques sociales. Introduction!», Travail et emploi, 2012, no!131, p.!5-22.
«!AUTRE ÉCONOMIE!», AUTRE DÉMOCRATIE SOCIALE ? …
297
22!septembre!2006 par le GEMA, l’UNIFED, et l’USGERES, côté employeurs et, la CFDT, la CFTC et la CGT, côté salariés. Dans un contexte de refondation du paysage social, l’USGERES a formulé le 20!mai!2008 une demande officielle de représentativité à Xavier!Bertrand, alors ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité afin de siéger dans un certain nombre d’instances du dialogue social qui lui sont aujourd’hui fermées. En l’absence de réponse valant décision implicite de rejet, l’Union a saisi le 19!septembre le Conseil d’État pour faire valoir ses droits. Le Conseil d’État a annulé, le 12!janvier!2009, la décision du ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité de refuser l’agrément de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la formation tout au long de la vie dans l’économie sociale. Dans leur communiqué, les organisations patronales de l’économie sociale (GEMA, UNIFED, USGERES) se sont félicitées de cette déci-sion qui renforce la légitimité de cet accord et demandent au ministre de tirer les conclusions de la décision du Conseil d’État et d’étendre l’ANI sans attendre. Depuis le 1er!août!2010, l’USGERES estime que cet accord est le premier à avoir été étendu par l’État. L’USGERES a donc déposé en février!2010, une requête en contentieux au Conseil d’État pour faire reconnaître sa représentativité au plan patronal 10. Par cette action, l’USGERES revendique d’être représentée dans!:
– la Commission nationale de la négociation collective, afin de permettre à l’US-GERES de participer, comme les autres organisations patronales, à l’examen de la validité des accords collectifs de travail ;
– le Conseil supérieur de la prud’homie, au regard des résultats obtenus par les syndicats d’employeurs de l’économie sociale aux dernières élections prud’homales ;
– le Conseil d’administration de l’ANACT, en raison des travaux novateurs enga-gés par l’Union sur la prévention des risques professionnels.
Le 25!avril!2013, l’USGERES et le SYNEAS (relevant de l’UNIFED au niveau confédéral) ont annoncé travailler à la création d’une union de l’ensemble des employeurs de l’économie sociale et solidaire 11. C’est donc la conception «!univer-selle!» de la négociation collective interprofessionnelle qui est ici remise en cause puisque pourraient exister de fait plusieurs «!interprofessions!». Les employeurs de l’ESS, du fait de leur statut juridique, ne sont en effet pas représentés par les chambres de commerce (n’étant pas des entreprises commerciales ou de services 12). Or, la prétention du Medef à représenter universellement les employeurs de l’indus-trie, du commerce, de la construction et des services est remise en cause par la structuration du syndicalisme patronal de l’ESS qui intègre ces secteurs (avec les coopératives et les mutuelles). Le cadre de la négociation nationale interprofes-sionnelle est ainsi vidé de sa substance puisque la représentativité patronale ne serait plus que «!multibranches!»!: Medef et CGPME pour l’industrie, le commerce
10. Cf.![http://www.usgeres.fr/actu.php?id=66].11. Cf.![http://www.usgeres.fr/actu.php?id=133].12. Cf.!MAGGI-GERMAIN N. et LE CROM J.-P., «!La construction de la représentativité patronale!», rapport
remis à la DARES, 2011.
MATTHIEU HÉLY, ROMAIN PUDAL ET MAUD SIMONET
298
et les services, l’UPA pour l’artisanat, l’UNAPL pour les professions libérales et la FNSEA pour l’agriculture. Ce point de vue fait l’objet d’une controverse pour les partisans d’un maintien de «!l’interprofession!» reconnue, en dernière instance, par les pouvoirs publics.
En résumé, si l’on admet que l’interprofession n’existe pas, l’USGERES pour-rait être reconnue comme une organisation «!multibranches!», au même titre que l’UNAPL ou la FNSEA. Mais, dans ce cas de figure, se posera la question du péri-mètre puisque l’économie sociale empiète aussi sur l’industrie, le commerce et les services. En revanche, si la conception classique de l’interprofession est réaffir-mée par le Conseil d’État, l’USGERES aura du mal à justifier sa prétention à la représentativité puisque ses performances électorales aux élections prud’homales sont amoindries par son absence dans 3!sections sur!5 (industrie, commerce, agriculture) 13. Le rejet de la requête de l’USGERES par le Conseil d’État dans son arrêt du 26!octobre!2012 confirme pour l’instant cette dernière hypothèse 14. Néanmoins, la mise sur agenda politique d’une réforme de la représentativité patro-nale 15 et la stratégie d’alliance de l’USGERES avec le SYNEAS pour créer pendant l’été!2013 un seul et unique syndicat patronal des employeurs de l’ESS pourraient de nouveau modifier la donne.
La structuration des organisations patronales, tentant de jouer jeu égal avec le Medef ou la CGPME, et la montée en puissance d’un mouvement comme le MOUVES portant haut et fier les couleurs de l’entrepreunariat social, conduisent les organisations patronales de l’ESS à nouer un dialogue avec l’ensemble des forma-tions politiques –!FN excepté. Ces organisations semblent donc aujourd’hui entrete-nir et développer des liens de plus en plus solides, mais aussi de plus en plus diver-sifiés, avec les organisations politiques!: ainsi le lien historique avec la gauche et les écologistes a-t-il tendance à céder le pas à une sorte de «!pragmatisme/réalisme politique!» assez en congruence avec ce même pragmatisme/réalisme du point de vue économique.
De l’autre côté, les crises financières à répétition, les critiques de plus en plus acerbes dont le modèle néo-libéral en économie fait l’objet peuvent tout à fait inciter
13. MAGGI-GERMAIN N., «!Fonctions et usages de la représentativité patronale!», Travail et emploi, 2012, no!131, p.!23-45.
14. Dans ses propositions formulées à l’occasion de la Conférence sociale des 20 et 21!juin!2013, l’US-GERES faisant montre d’une grande prudence en évitant le terme équivoque «!d’interprofession-nel!»!en souhaitant que «!soit identifié, entre les branches et l’interprofession, un niveau multi-professionnel afin que les organisations qui sont aujourd’hui considérées en dehors du champ de la négociation collective nationale interprofessionnelle puissent accéder à une forme de représenta-tion!». Cf.!le site internet de l’USGERES à la rubrique des communiqués.
15. Confirmée par le ministre du Travail, Michel!Sapin, lors de la 3e!convention employeur de l’USGERES en octobre!2012. À!l’occasion de la seconde!Conférence Sociale organisée par le gouvernement, le Medef, la CGPME et l’UPA ont adopté une position commune sur la représentativité patronale. Le Premier!ministre, Jean-Marc Ayrault, a ainsi déclaré dans son discours de clôture du 21!juin!2013!: «!En ce qui concerne la représentativité patronale, le Gouvernement prend acte de la position commune des organisations d’employeurs. Elle exprime un socle de principes, dont la déclinaison opérationnelle appelle un travail complémentaire. Le directeur général du travail, Jean-Denis!Combrexelle, accompa-gnera ces travaux. Nous nous donnons jusqu’au mois d’octobre pour aboutir.!»
«!AUTRE ÉCONOMIE!», AUTRE DÉMOCRATIE SOCIALE ? …
299
les politiques et leurs organisations à aller chercher du côté de l’ESS des discours –!si ce n’est toujours des pratiques!– qui redorent leur blason!: une «!économie au service de l’humain!» (pas des actionnaires) voilà bien une croyance économique 16 susceptible de «!fédérer!» des programmes politiques bien différents les uns des autres. Ainsi François!Bayrou, dans sa réponse à la lettre de l’USGERES en!2012 déclarait-il voir dans l’ESS!:
«! tout simplement la première tentative de dépasser le vieux clivage entre la droite et la gauche, au profit d’un mouvement qui s’enracine aussi bien dans la pensée sociale, parfois révolutionnaire, que dans la philosophie personnaliste, avec la visée humaniste qui est la sienne!».
Reste, au-delà des discours, à voir quels soutiens réels issus du champ politique les patrons de l’économie sociale et solidaire rencontreront dans leur entreprise de reconnaissance. Si la cause de l’ESS paraît incontournable à défendre aujourd’hui étant donné le poids du secteur dans la production et dans la création d’emplois, la question de la représentativité patronale des employeurs de l’ESS paraît quelque peu contournée, justement, par certains des candidats à la présidentielle interrogés par l’USGERES… pour bien mesurer les enjeux de cette reconnaissance sans doute faut-il se pencher a présent, mais c’est un autre sujet, sur les relations entre le champ politique et les organisations patronales représentatives, et notamment le Medef.
16. Au sens que lui donne Frédéric Lebaron, LEBARON F., La crise de la croyance économique. Dynamiques socio-économiques, Bellecombe-en-Bauges, Éd. du Croquant, 2010 ; cf. aussi les travaux de Fanny Darbus à ce propos, DARBUS F., Pratiques et praticiens de l'économie solidaire (2000-2007). Contribution à la sociologie des croyances économiques, thèse, sociologie, EHESS, 2009.
MATTHIEU HÉLY, ROMAIN PUDAL ET MAUD SIMONET
300
Annexe!– Synidcats employeurs affiliés aux confédérations de l’économie sociale (UNIFED et USGERES) en 2010
Branche Composants
Aide à domicile
Union nationale des associations du service à domicile (UNADMR)Fédération à domicile
Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire – membre de la confédération syndicale des familles (FNAAFP/CSF)
Réseau des associations d’aide à domicile (ADESSA)Union nationale des associations de soins
et services à domicile (UNA)Sociale-médico-
socialeSyndicat national des associations laïques employeurs du secteur
sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS)
Logement socialFédération nationale des centres pour la protection,
l’amélioration et la conservation de l’habitat et Associations pour la restauration immobilière (PACT-ARIM)
Animation Conseil national des employeurs associatifs (CNEA)Acteurs du lien social et familial
Syndicat national d’associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO)
Tourisme socialSyndicat d’associations de tourisme, de promotion sociale,
de vacances et de loisirs (SATPS)Foyers de jeunes
travailleursSyndicat national employeur des foyers
Résidences sociales et services pour jeunes (SNEFOS)
Radios libres Syndicat national des radios libres
Missions localesUnion nationale des missions locales PAIO
Organismes d’insertion sociale et professionnelle (UNML)
SportConseil social du mouvement sportif (COSMOS)
Union des clubs des championnats français de football (U2C2F)Golf associatif Groupement français des golfs associatifs (GFGA)La coopération (Confédération
générale des SCOP)Union des groupements d’employeurs mutualistes
Tableau!1. – Composition de l’USGERES.
Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (SNASEA) et le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP)
Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI)
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non lucratif!(FEHAP)
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC)La Croix-Rouge
Tableau!2. – Composition de l’UNIFED.