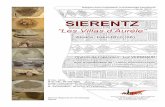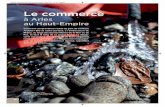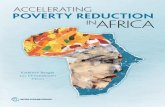Haut Commissariat aux réfugiés / UN Agency For Refugees (UNHCR)
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Haut Commissariat aux réfugiés / UN Agency For Refugees (UNHCR)
Page 1 sur 34
RAPPORT DE STAGE
HAUT-COMMISSARIAT AUX REFUGIES (HCR)
ISTANBUL-TURQUIE
Migrants – frontières gréco-turque1
31 Août 2011
M2 « Géopolitique » (Université Paris 1, Ecole Normale Supérieure)
Céline Pierre-Magnani
1Source: http://actualite-generale.dhnet.be/athenes-grece-frontiere-turquie.html
Page 2 sur 34
A la mémoire de Cevat, réfugié afghan, 19 ans,
tué dans un accident de voiture le 24 Août 2011
et à tous les migrants qui perdent la vie
sur les routes dans l'espoir d'un avenir meilleur
Page 3 sur 34
Merci à Cengiz Aktar, Fuat Özdoğru, Selen Ay, Ismet Yasak, Fatih Alkadah et Mathilde
Crépin pour m'avoir ouvert les portes du bureau d'Istanbul et avoir, à tout moment, répondu à
mes questions. Merci à Gizem d'ASAM, Ebru de DABATEM, Cemgil et Kenan bey de
Yeldeğirmeni, Seda et Pelin d'IKGV, Clémence et Irem de HCA d'avoir accepté nos rendez-vous
et avoir soutenu notre démarche pendant la rédaction du rapport. Merci à Renée, Jiresse,
Ferhat, Mohammed, David, Nancy et tous ceux qui ont accepté de dévoiler une partie de leur
existence.
Page 4 sur 34
SOMMAIRE
A Cevat ... ..............................................2
Remerciements..................................................................................................................................3
I. INTRODUCTION................................................................................................................6
II. HISTOIRE ET ROLE DU HAUT COMMISSARIAT AUX REFUGIES..........................8
LE HAUT COMMISSARIAT AUX NATIONS UNIES : UNE AGENCE DE L’ONU.................8
-D'une mission ponctuelle …...........................................................8-…à une assistance permanente........................................................9
MISSION : PROTECTION DES REFUGIES...........................................................................9
- « être ou ne pas être » réfugié :......................................................9- Procédure de détermination de statut de réfugié (RSD – Refugee
Status Procedure)............................................................................................................................10- Nuances et interprétation :le travail du droit................................12
III. LES REFUGIES EN TURQUIE : INTÊRETS ET ENJEUX D’UNE LOI SURL’ASILE.............................................................................................................................14
ETRE DEMANDEUR D’ASILE EN TURQUIE : RÔLE DU HCR..............................................14
- Une présence nécessaire en Turquie............................................14- L’antenne d’İstanbul…………………………………………….17
TENSIONS ET VICISSITUDES D’UNE LOI SUR L’ASILE.....................................................18
- La diplomatie du funambule : intérêts nationaux et régionaux encontradiction ?................................................................................................................................18
Page 5 sur 34
-Le combat contre l’immigration illégale : un obstacle àl’application des Droits de l’Homme ?...........................................................................................19
IV. STAGE AU BUREAU DU HCR – ISTANBUL...............................................................22
UN CADRE DE TRAVAIL INTERNATIONAL : Interprétariat / traduction.........................22
RAPPORT SUR LA CONDITION DES MINEURS NON-ACCOMPAGNES EN TURQUIE(Unaccompanied minors-UAMs) :.....................................................................................23
- Les mineurs non-accompagnés : une population vulnérable....................23- Quelle disponibilité des sources ?............................................................24- Déroulement de la recherche ?.................................................................25
SITUATION DES MINEURS NON-ACCOMPAGNES : PRINCIPAUX RESULTATS.............26- Cadre légal : perspectives croisées ..........................................................27- Conditions de réception des mineurs non-accompagnés :........................28- Condition de la recherche de terrain : obstacles et limites ......................29
V. CONCLUSION..................................................................................................................30
BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................................................31
SITOGRAPHIE............................................................................................................................................31
ILLUSTRATIONS ET TABLEAUX...........................................................................................................32
ANNEXES....................................................................................................................................................33
Page 6 sur 34
I. INTRODUCTION
Si l’instabilité politique et économique de la Turquie l’a souvent inscrite au rang des
foyers de départs des migrations, le pays est depuis toujours, un territoire de passage et
d’immigration. Marche entre les continents asiatique et européen, elle draine chaque année des
milliers de migrants, faisant de la frontière avec la Grèce, la première porte d’entrée vers
l’Europe. Parmi les diverses motivations qui poussent à l’exil, la persécution est considérée
comme un motif à part. Chaque année, les conflits armés, les guerres, l’instabilité politique
conduisent des individus voire des populations entières à fuir leur terres natales. Prenant en
compte la spécificité de ces migrations, la communauté internationale incarnée par l’ONU s’est
dotée d’un cadre juridique afin de gérer et d’aider ces populations. L’accession au statut de
« réfugié » permet ainsi de bénéficier d’une protection internationale. Si plusieurs pays se sont
dotés de loi sur l’asile, vide juridique ou fragilité politique empêche l’application des
engagements internationaux dans de nombreux États. Le Haut Commissariat aux Réfugiés
(HCR), qui compte parmi les nombreuses agences de l’ONU, a été mandaté pour assister ces
derniers dans la gestion des flux de réfugiés et demandeurs d’asile. Il joue, sur le territoire turc,
un rôle crucial. Si la Turquie a ratifié la Convention de Genève de 1951 et son protocole relatifs
au statut des réfugiés, elle avait à l’époque imposé une limite géographique qui demeurent encore
aujourd’hui. Seuls les demandeurs d’asile originaires de pays du Conseil de l’Europe peuvent
accéder au statut de réfugié sur le territoire turc. Pertinente au lendemain de la Seconde guerre
mondiale qui a déchiré l’Europe, la limitation géographique exclue désormais les demandeurs
d’asile issus des principaux foyers de départ (Irak, Afghanistan, Iran, Somalie ...). Si un
Règlement a été nécessairement adopté en 1994, suite à l’afflux massif de populations issues du
conflit en Irak (1991), il reste insuffisant dans le contexte actuel. Le HCR intervient donc dans la
gestion des populations auxquelles la Turquie ne reconnaît pas le statut de réfugié sur son sol. En
dépit des pressions internationales, la Turquie maintient sa limitation géographique, avançant son
caractère de « territoire de transit » pour des migrants en route vers l’Europe.
Page 7 sur 34
Cependant, les paramètres géopolitiques régionaux viennent changer la donne.
Pleinement engagée dans le processus d’adhésion à l’Union Européenne depuis 2005, la Turquie
s’est alors lancée dans un vaste effort d’adoption de l’acquis européen. Dans ce contexte, le pays
doit se doter d’une loi sur l’asile qui est désormais en préparation. Particulièrement préoccupés
par la question des migrations en général, illégales en particulier, les gouvernements de l’Union
Européenne plaident pour une suppression de limitation géographique et un renforcement du
contrôle aux frontières.
La présentation du rôle du Haut Commissariat aux Réfugiés permettra dans un premier
temps de situer l’action de l’organisme et son rôle particulier sur le territoire turc. Un retour sur
l’expérience de stage offrira ensuite une perspective interne et concrète de l’organisation avant
d’exposer, enfin, les résultats du travail réalisé.
Page 8 sur 34
II. HISTOIRE ET RÔLE DU HAUT COMMISSARIAT AUX
REFUGIES
III. LE HAUT COMMISSARIAT AUX NATIONS UNIES : UNE AGENCE
DE L’ONU
- D'une mission ponctuelle ...
Prolongement de la Société des Nations, l’Organisation des Nations Unies créée en
1945 au lendemain de la Seconde guerre mondiale est une organisation internationale qui
regroupe la majorité des États de la planète. Elle s’est donnée pour mission de coordonner des
opérations afin d’œuvrer pour la promotion de la paix, des Droits de l’Homme, du
développement et du droit international. Son administration se compose de différentes
commissions, institutions et programmes spécialisés dans ces domaines2.
Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) est une des nombreuses agences de l’ONU. Son
statut voté le 14 décembre 1950 par la résolution 428(V) de la Grande assemblée des Nations
Unies, l’Agence est mandatée pour diriger et coordonner l’action internationale pour la protection
des réfugiés à travers le monde. Financée conjointement par les États, les organisations
intergouvernementales, et les Nations-Unies, son objectif premier est de préserver les droits et le
bien-être des réfugiés. En coopération avec les autres agences de l’ONU (UNICEF, PAM,
OMS ....) et les ONG (Croix- Rouge ...), elle assure à chacun le droit de déposer une demande
d’asile et trouver refuge et sécurité dans un autre pays selon trois modalités:
1) retour dans le pays d’origine
2) intégration locale
3) réinstallation dans un pays tiers.
2Site de l’ONU : http://www.un.org/fr/aboutun/structure/index.shtml
Page 9 sur 34
Créé au lendemain de la Seconde guerre mondiale pour gérer le flux de réfugiés qu’avaient
généré les conflits, le HCR était initialement mandaté pour 3 ans, pour assister les Etats dans la
mise en place de systèmes d’asile nationaux.
-…à une assistance permanente
Face à l’importance de la tâche et le besoin constant d’activités de protection, le travail
du HCR se poursuit et s’impose de plus en plus comme une nécessité permanente. Son mandat
est désormais systématiquement reconduit. Officiellement, chaque gouvernements est en premier
lieu responsables de protéger les réfugiés sur son territoire. La mission du HCR se résume
principalement à un travail d’assistance ; il intervient principalement dans les États n’ayant pas
mis en place de système d’accueil et de gestion des réfugiés efficace. Dans la résolution initiale,
la Grande assemblée enjoint les États à coopérer avec la nouvelle institution pour lui permettre
d’assurer ce travail humanitaire, social à caractère non-politique. Réparti sur près de 120 pays,
l’équipe compte actuellement près de 7 190 salariés et ne cessent de s’agrandir. L’ensemble de
l’activité des bureaux nationaux est piloté depuis le siège, à Genève. En 2008, 147 pays avaient
signé le protocole. Cette même année, le HCR a pris en charge près de 31,7 millions de réfugiés.
Les cinq premiers pays de destination des demandeurs d’asile en 2010 ont été : les États-Unis, la
France, l'Allemagne, la Suède et le Canada. Ensemble, ces cinq premiers pays d'asile accueillent
plus de la moitié (56 %) de la totalité des demandes d'asile comptabilisées3.
IV. MISSION : PROTECTION DES REFUGIES
- « être ou ne pas être » réfugié :
Un réfugié est une 4 “personne qui craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors de son pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait
3« le nombre des demandeurs d’asile a diminué de moitié durant la dernière décennie », Genève, 28 mars 2011 http://www.unhcr.fr/4d8cc801c.html4 Site UNHCR: http://www.unhcr.fr/4b0ab1b59.html
Page 10 sur 34
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays...” extrait de la Convention de
Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.
La création du HCR institutionnalise une tradition d’accueil des réfugiés historiquement
attestée ( Hittites, Babyloniens, Assyriens… ). Cependant, les flux migratoires se composent
d’individus aux trajectoires et aux motivations diverses face auxquels l’agence s’est dotée d’une
terminologie adéquate. Ainsi, les termes de demandeur d’asile, réfugiés, déplacés internes,
migrants font chacun l’objet d’une définition et d’un traitement spécifique. Le HCR parle
également de « mouvement migratoire mixte » (MMM) depuis 2007/2008 pour désigner ces flux
hétérogènes et s’est doté d’un Plan d’action. Le demandeur d’asile est un requérant auprès du
HCR dont le statut n’a pas encore été déterminé. Si les réfugiés, contraints de fuir leur pays, se
retrouvent sans droits dans un pays tiers, les déplacés internes sont eux, des migrants n’ayant pas
dépassé les frontières de leur pays. Ils restent juridiquement placés sous la responsabilité de leur
gouvernement bien que la mission du HCR se soit progressivement étendue à la protection de ces
populations dans les pays souffrant d’instabilité politique (28 en 2010 avec Afghanistan,
Colombie, RDC …). La confusion entre migrants économiques et réfugiés est fréquente: ils
empruntent les mêmes itinéraires, les mêmes transports ... Les migrants économiques sont définis
comme des individus ayant “ quitter leur pays de leur plein gré afin d’améliorer leurs conditions
de vie”. A la pratique, la difficulté d’attribution de statut est évidente. La définition peine à rendre
compte du large éventail des situations qui contraignent les individus à quitter leur pays. Des
systèmes nationaux d’asile existent afin d’établir ceux des demandeurs d’asile qui peuvent
effectivement bénéficier d’une protection internationale. En cas de non conformité avec la
définition des réfugiés, les migrants tombent dans l’illégalité et sont susceptibles d’être renvoyés
dans leur pays.
- Procédure de détermination de statut de réfugié (RSD – Refugee Status Procedure)
Une fois entrés sur le territoire, les migrants peuvent entamer une démarche de demande
d’asile auprès des autorités nationales ou du HCR dans les États où le système d’asile est
défaillant ou inexistant. Pour les pays comme la Turquie, c’est à l’agence qu’incombe la tâche
d’évaluer les situations individuelles et de déterminer le statut des requérants. Toute la difficulté
Page 11 sur 34
réside dans le processus de détermination du statut. Pour pallier le vide juridique actuel, le HCR a
mis en place une procédure parallèle à l’enregistrement habituel auprès des autorités (Ministère
de l’Intérieur, Bureau de l’asile et de l’immigration dans le cas turc). Le premier enregistrement
auprès du HCR consiste en un travail d’orientation. Cet entretien dit « de première instance »
permet d’évaluer la crédibilité de la démarche, d’ouvrir une demande d’asile et de recueillir des
données de base ( Bio-data ) : pays d’origine, raisons du départ, arrivée en Turquie ... Une
deuxième entrevue, plus longue, permet aux juristes (legal officer) de poser des questions plus
détaillées afin d’évaluer l’adéquation du cas à la définition officielle de « réfugié ». A l’issue de
cette deuxième entrevue, la détermination de la « crédibilité » de la demande ( RSD – Refugee
Status Determination ) est dite « à charge de la preuve » ; elle repose sur le témoignage du
requérant et sur les informations disponibles concernant le contexte que le juriste (legal officer)
pourra trouver sur la base de données de référence du HCR : REFWORLD5. Une fois les
informations suffisantes recueillies, le juriste doit réaliser une détermination de statut
(assessment) par une évaluation en deux étapes :
1) crédibilité de l’identité
2) crédibilité des raisons du départ
Tableau 1 : Evaluation d’une demande pour l’obtention du statut de réfugié
Évaluation de
la crédibilité
Identité Raisons de départ Poursuites de la procédure
Situation 1 Non-crédible Non-crédible Refus (droit à faire appel)
Situation 2 Crédible Non-crédible Refus ou autre forme de protection
subsidiaire (extended mandate)
Situation 3 Crédible Crédible Recherche sur le caractère « fondée »
des craintes
Une fois le statut de réfugié attribué, le requérant bénéficie d’une protection internationale et se
voit proposer trois solutions durables :
5 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain
Page 12 sur 34
-1) retour dans le pays d’origine ( selon la volonté du réfugié)
-2) l’intégration locale
-3) la réinstallation dans un pays tiers.
Pour la Turquie, les principaux pays de réinstallation sont l’Australie, le Canada et les
États-Unis. Chaque pays publie chaque année un quota de réfugiés par nationalité qu’il est en
capacité d’accueillir. Certaines populations ont plus de mal à être réinstallées que d’autres. C’est
le cas des afghans en Turquie, pour lesquels les perspectives réelles de réinstallation sont
considérablement réduites.
- Nuances et interprétation : le travail du droit
L’évaluation de l’identité est une première étape indispensable. La confirmation de
l’origine permet de faire bénéficier le requérant du statut de réfugié selon le principe de « prima
facie »6 ( comme par exemple les Irakiens du centre et du sud) . Certaines régions sont également
définies par le HCR comme ayant atteint un « niveau de violence généralisée ». C’est le cas
actuellement des régions centre et sud de la Somalie, la Côté d’Ivoire, l’Afghanistan, le Soudan
de l’Ouest où banditisme et récurrence des conflits armés empêchent toute stabilisation politique.
Dans ce cas de figure, dès lors que son origine est confirmée, le requérant est immédiatement
reconnu comme réfugié. Dans tous les cas de figure, les cas sont étudiés afin d’évaluer la
compatibilité du cas avec le statut de réfugié, statut qui offre la protection la plus complète.
Dans le cas où identité et raisons de départ sont validées comme crédibles, le juriste
entame une recherche plus précise pour évaluer le caractère fondé, ou non, des craintes avancées.
La base de données du HCR, Refworld, compile des documents de natures diverses (rapports sur
les pays d’origines réalisés par les services de renseignement nationaux7, documentation
politique, rapports d’ONG, médias...) afin de soutenir la recherche d’éléments validant la
« crédibilité ».
Dans la définition officielle du réfugié, des cinq critères avancés, c’est « l’appartenance à un
groupe social » vulnérable qui constitue le critère le plus souple, laissé à l’interprétation du
6 Dans certaines situations, lorsque les raisons sont évidentes (guerre, les conflits armés...), les populations peuvent bénéficier de procédures spécifiques. C’est le cas lors des déplacements
massifs, les populations sont reconnues « prima facie », comme les Irakiens en Turquie.
7 United states department of state, UK border agency ...
Page 13 sur 34
juriste, et fait l’objet d’enjeux considérables. Les différents types de persécution font l’objet
d’une abondante littérature tant il est indispensable de prendre en compte le contexte culturel de
départ. Dans certaines régions d’Afghanistan, les pratiques de vendetta menacent la vie des
individus sur des générations, ils peuvent ainsi obtenir le statut de réfugié. Le HCR évalue
l’intégration de certains groupes vulnérables à l’aune de la sentence encourue. La polémique
s’était ainsi enflammée autour de la question des hommes adultères en Iran. La prise en compte
de la peine encourue, la lapidation, avait finalement fait conclure à un réel danger.
Des « Guidelines » sont publiés régulièrement pour préciser les modalités d’application
des règles générales propres à la détermination du statut de réfugié (RSD). Une fois le statut de
réfugié obtenu, trois solutions durables sont en théorie possible ( retour, intégration locale,
réinstallation dans un pays tiers ), mais le vide juridique en Turquie rend caduque toute
possibilité d’intégration locale.
Page 14 sur 34
V. LES REFUGIES EN TURQUIE : INTÊRETS ET ENJEUX
D’UNE LOI SUR L’ASILE
VI. ETRE DEMANDEUR D’ASILE EN TURQUIE : ROLE DU HCR
- Une présence nécessaire en Turquie
Issus d’un pays membre du Conseil de l’Europe, les Tchétchènes fuyant la Russie sont
l’un des rares groupes de population à bénéficier du statut de réfugié en Turquie et à être pris en
charge par les autorités. L’instabilité récente de l’environnement régional de la Turquie a fait
considérablement augmenter les flux de demandeurs d’asile issus d’Irak (37%), d’Iran (27%) ou
d’Afghanistan (19%)8. Les prévisions du HCR pour l’année 2011 s’élèvent à près de 24 400
personnes enregistrées et assistées par l’organisation, chiffre qui reste dérisoire au regard du total
estimé à près de 993 4009. Dans ce contexte, la présence du HCR sur le sol turc s’est imposée
d’elle-même. Elle prend en charge l’enregistrement et le traitement des demandes d’asile.
8 http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d7cf.html9
Chiffres prévisionnels du HCR Turquie http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d7cf.html
Page 15 sur 34
Illustrations 1 : Répartition des antennes du HCR en Turquie 10
10 http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/page?page=4aae621d7cf
Page 16 sur 34
Les trois solutions durables (retour, intégration locale, réinstallation) utilisées par le HCR se
réduisent dès lors à deux, dans la mesure où la Turquie refuse toute intégration locale de
population auxquelles elle ne reconnaît pas la qualité de réfugiés. Les procédures peuvent différer
légèrement selon les conditions d’entrée des migrants sur le sol turc.
Schéma1 :Procédure de demande d'asile en Turquie
DEMANDEUR D’ASILE
ENTREE LEGALE ENTREE ILLEGALE
ENREGISTREMENT-HCRRDV Police + HCR(enregistré par le Ministère del’Intérieur)
RDV Police + HCR (lieu : ville d’entrée)
Envoi dans une ville satellite+Permis de résidenceDEUXIEME INTERVIEW:Ankara / Van / IstanbulRésultat :Acceptation / Refus
Les enregistrements doivent se faire dans la ville par lequel le demandeur d’asile est entré
sur le sol turc en cas d’entrée illégale. Les villes côtières et frontalières comme Istanbul, Van,
Izmir sont donc concernées en premier lieu. Pour désengorger les administrations concernées
dans les villes d’arrivée, le système organise une répartition des demandeurs d’asile sur
l’ensemble du territoire en les envoyant dans des « villes satellites » ( de 30 à 51 villes satellites
depuis avril 2011 ) à l’issue de l’entretien de première instance.
Page 17 sur 34
Pour les demandeurs d’asile, l’accès à la procédure est une première variable. Certains
sont pris par les services de Police et détenus aux frontières sans avoir la possibilité de formuler
une demande d’asile. Considérés comme des migrants illégaux, ils souffrent souvent de longue
période de détention. Une fois la demande émise et les deux entretiens réalisés, d’autres obstacles
compliquent encore la démarche. En plus des délais de plusieurs mois, voire années, dans
l’attente de la décision sur leur statut, l’obtention du permis de résidence « ikamet » pose
problème. Indispensable pour régulariser leur séjour en Turquie, il est délivré par les services de
police à raison de 177euros par semestre. Si les dernières circulaires viennent assouplir cette
condition financière difficile à remplir, l’obtention de l’ikamet reste une procédure longue. Elle
est d’autant plus importante qu’elle est la condition sine qua non de l’accès aux soins et à
l’éducation.
Par l’intermédiaire d’accord de coopération avec les ONG (Sığınmacılar ve Göçmenlerle
Dayanışma Derneği, SGDD, ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Vakfı, IKGV), le HCR tente
d’encourager et de soutenir les conditions de vie des demandeurs d’asile et le suivi des
procédures, notamment dans les villes satellites. Deux types de coopération sont en place: les
ONG du secteur ont le statut de “Partenaire d’exécution” (Implemented partner) si le HCR
délègue une partie de son travail en échange d’une contribution financière, ou le statut de
“Partenaire opérationnel” (Operational partner) pour une coopération plus ponctuelle.
Le HCR n’est cependant pas destiné à rester indéfiniment sur le sol turc. Responsable du
bureau du HCR à Istanbul, Fuat Ozdoğru utilise souvent la métaphore du vers à soie pour
expliquer le rôle de l’organisation en Turquie. A l’image de l’insecte qui meurt progressivement
pour produire le fil de soie, les activités du HCR et les transferts de compétences aux autorités
qu’intègre son mandat reviennent à diminuer toujours plus sa légitimité sur le territoire,
l’aboutissement étant de rendre les structures nationales complètement autonomes.
- L’antenne d’İstanbul
Le bureau d’Istanbul compte actuellement une équipe de quatre salariés permanents et un
juriste détaché d’Ankara pour accélérer les procédures de détermination de statut (RSD), une
petite équipe relativement à la somme de travail à accomplir dans la mégalopole. Il a plus
particulièrement pour mission: la gestion de la région de Marmara, la gestion des cas de
Page 18 sur 34
détention, de suspension à la déportation et d’accès à l’asile; enregistrement et interview; la
coordination avec les ONG; la relation avec les médias; la coordination avec les donneurs.
Il bénéficie d’un solide réseau d’ONG et d’associations pour améliorer la protection des
réfugiés dans différents domaines (Juridique, sanitaire, culturelle ...). L’ONG IKGV (Fondation
pour le développement des ressources humaines) est un partenaire actif. En tant que « Partenaire
d’exécution », l’organisation prend en charge l’accueil et l’orientation des demandeurs d’asile.
D’autres organisations comme HCA (Helsinki citizen Assembly) assurent, elles, une expertise et
un soutien juridique pendant le déroulement des procédures, d’autant plus nécessaire que la
plupart des requérants ne sont pas au fait de leurs droits. La dimension psychologique fait aussi
l’objet d’une attention particulière. Comme le regrette la psychologue de l’ONG DABATEM, si
l’aide psychologique est rarement considérée comme une priorité, les épreuves traversées par de
nombreux requérants peuvent faire obstacle au bon déroulement des procédures (troubles du
comportement, difficultés à s'exprimer lors des entretiens de première et deuxième instance ...).
Enfin, dans le cas plus particulier des mineurs non-accompagnés, le bureau du HCR est en
contact permanent avec les services sociaux en charge de la garde des enfants dans les deux
foyers présents à Istanbul (Yeldeğirmeni, Kadıköy – Atatürk, Bahçelievler).
La qualité de la communication entre les différentes institutions est cruciale pour assurer
une prise en charge globale et renforcée.
VII. TENSIONS ET VICISSITUDES D’UNE LOI SUR L’ASILE
- La diplomatie du funambule : intérêts nationaux et régionaux en
contradiction ?
La Turquie s’est, depuis 2003, lancée dans de vastes réformes pour l’acquisition des normes
et des standards européens dans le domaine de l’asile. En 2005, elle a adopté le Plan d’Action
National pour l’alignement sur l’acquis européen, et la Directive d’exécution qui fait
provisoirement office de « loi sur l’asile ». Selon le Plan d’Action National, la Turquie prévoit
officiellement de modifier la limitation géographique à la condition que les infrastructures
d’information sur l’asile et les réformes administratives soient réalisées. Ce n’est pas tant la
Page 19 sur 34
réforme du système d’asile que la levée de cette limitation géographique qui pose réellement
problème. Prise entre la défense des intérêts nationaux immédiats et des intérêts régionaux dans
ces négociations avec l’Union Européenne, la question de la limitation géographique symbolise le
rapport de force et cristallise les tensions. La sécurisation de son territoire la rend réticente à toute
modification.
Certains observateurs dénoncent une manipulation de la législation turque au profit des
intérêts européens11 sans prendre en compte la spécificité du cas turc. Du point de vue de
Bruxelles, la levée de la limitation géographique permettrait d’arrêter une partie des demandeurs
d’asile en route vers l’Europe sur le sol turc. D’autre part, l’adoption de l’acquis, dont le
règlement de Dublin (I – 1990 ,II - 2003)12, laisse craindre à un retour massif des demandeurs
d’asile ayant gagné l’Europe par la Turquie. Le texte stipule :
« Si le demandeur a franchi irrégulièrement les frontières d’un État membre, ce dernier est
responsable de l’examen de la demande d’asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après
la date du franchissement irrégulier de la frontière. »
Sa position géographique, espace de transit vers l’Europe, et la difficulté matérielle du
contrôle aux frontières rendraient la Turquie responsable d’un nombre important de demandes
que son administration n’est actuellement pas en mesure de gérer. La levée de la limitation
géographique et l’adoption des textes européens sur l’asile laissent craindre une transformation
du territoire en « espace-tampon », dont la charge dépasserait les capacités d’accueil.
- Le combat contre l’immigration illégale : un obstacle à l’application des Droits de
l’Homme ?
Le renforcement des contrôles aux frontières, la lutte intérieure contre l’immigration
illégale selon les standards européens transforment progressivement le pays en « Fortress
11 Nurcan Ozgur Baklacioglu “Building “Fortress Turkey”: Europeanization of Asylum Policy in Turkey”
12 Règlement de Dublin qui établit les critères et les mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33153_fr.htm
Page 20 sur 34
Turkey »13 (Forteresse Turquie) selon le constat de Nurcan Özgür Baklacioglu, qui parle
volontiers d’ « européanisation de la politique d’asile turque ».
Or, la mise en application des Droits de l’Homme et des principes de protection énoncés
dans la Convention de Genève de 1951 se heurte à ces dispositifs de sécurité. Le renforcement
aux frontières des systèmes de lutte contre l’immigration clandestine, faute d'être sélectif, fait
également obstacle à l’accès des demandeurs d’asile au territoire turc14. Si un des grands
principes défendu par le HCR est « le non-refoulement des réfugiés aux frontières »,
l’organisation aux niveaux des frontières devraient faire l’objet d’une vigilance particulière et
être renforcée. Faute de soutien légal et de conseil dans leur langue maternelle, de nombreux
réfugiés potentiels se voient empêchés d’accéder à la demande d’asile. La frontière gréco-turque
est, à ce titre, exemplaire. Confrontée à l’augmentation des mouvements migratoires mixtes, la
Grèce a pour projet la construction d’une clôture et la mise en place d’un dispositif de contrôle
(Frontex) afin de limiter l’afflux d’immigrés entrant en Europe via la Turquie. 15
13 reprenant l’expression fréquemment employée pour critiquer la politique Frontex de l’Union Européenne
14 Lisa Montmayeur, la frontière terrestre gréco-turque au cours de l’Histoire : espace de jonction, espace de fermeture ? 24 juin 2011, blog de l’OVIPOT http://ovipot.hypotheses.org/579715 « le mur contre les clandestins est insdispensable », Ta Nea, Lia Neafyge, Stelios Vradelis http://www.courrierinternational.com/article/2011/01/12/le-mur-contre-les-clandestins-est-indispensable
Page 21 sur 34
Illustration 2 : Projet de clotûre à la frontière gréco-turque 16
Si ces mesures visent à endiguer une immigration économique lourde, les demandeurs
d’asile sont, de cette manière, bloqués aux frontières. L’adoption de l’acquis européen et la
suppression de la limitation géographique se résumeraient à un transfert de responsabilités de la
gestion des demandes d’asile en Turquie. Les principes acceptés par la signature de la
Convention de Genève n’échapperont pas à la contradiction si la construction de la « Forteresse
Turquie » ne s’accompagne pas de l’organisation d’un service de conseil juridique aux frontières
pour préserver la sécurité des demandeurs d’asile.
16 http://www.courrierinternational.com/article/2011/01/12/le-mur-contre-les-clandestins-est-indispensable
Page 22 sur 34
VIII.STAGE AU BUREAU DU HCR – ISTANBUL
IX. UN CADRE DE TRAVAIL INTERNATIONAL : Interprétariat /
traduction
La connaissance de plusieurs langues est une condition sine qua none pour tout travail
auprès du HCR. La présence de nombreux internationaux au sein du HCR Turquie, et
l’organisation hiérarchiquement chapeautée par Genève limite les communications dans les
langues nationales. L’anglais est donc la langue de communication au sein de l’organisation;
procédures et rapports sont rédigés dans cette langue.
La connaissance d’autres langues est également requise. L’afflux massif d’Afghans et
d’Iraniens impose la présence de persanophones. L’instabilité en Irak a un impact direct sur la
Turquie ; les arabophones sont aussi nombreux.
Les francophones sont aussi fréquemment sollicités. En plus de traductions ponctuelles qui
m’étaient confiées ( lettres de demandeurs d’asile francophones notamment ), le travail
d’interprétariat était une activité quotidienne. L’importance du flux de réfugiés africains issus des
anciennes colonies françaises et belges impose la présence d’un interprète à toutes les étapes de la
procédure (enregistrement auprès du HCR, consultations médico-psychologiques, communication
avec le personnel des orphelinats dans le cas précis des enfants …). J’ai donc assisté mes
collègues lors des fréquentes procédures d’enregistrement, ainsi que lors de réunions où la
présence d'un interprète francophone nécessitait mon intermédiaire. La connaissance du turc m’a
beaucoup servi. Si le HCR gère flux et enregistrement, la prise en charge des réfugiés revient
essentiellement aux ONG locales et aux services sociaux où peu de francophones peuvent assurer
l’échange.
Les soucis d’économie amènent l’organisation à privilégier l’embauche de
bilingues/plurilingues, mais fait également appel à des interprètes extérieurs pour les cas plus
particuliers ( Somali, Tamoul, Cinghalais etc. )
Chaque requérant a le droit de choisir la langue dans laquelle il va s’exprimer lors des procédures
et de la recherche de la « crédibilité » lors des entretiens d’évaluation des cas (Refugee Status
Determination -RSD). Concrètement, la question de la communication est un obstacle qui
Page 23 sur 34
complique considérablement le séjour des demandeurs d’asile/réfugiés en Turquie. Le rapport de
l’ONG HCA 17 atteste de nombreuses atteintes aux Droits de l’Homme aux frontières. Le manque
d’interprètes empêche nombre de migrants d’accéder à la procédure de demande d’asile.
X. RAPPORT SUR LA CONDITION DES MINEURS NON-
ACCOMPAGNES EN TURQUIE (Unaccompanied minors-UAMs) :
La période de stage a été l’occasion de rédiger un rapport. Deux stagiaires présentes sur la
période, nous disposions de trois mois pour réaliser une étude comparative entre la situation
turque et européenne.
- Les mineurs non-accompagnés : une population vulnérable
La réalisation d’un rapport sur les conditions de réception des mineurs réfugiés a constitué
la principale tâche de ce stage au HCR. Dans l’optique de l’accession à l’Union Européenne, la
Turquie s’est lancée dans un processus d’acquisition tous azimuts des normes européennes
exigées par Copenhague. Faisant du respect des Droits de l’Homme une condition à toute
poursuite des pourparlers, la Turquie s’est engagée dans un vaste effort d’évaluation dans tous les
domaines. Le rôle de « tuteur » du HCR le rend responsable de l’évaluation de la correspondance
aux critères dans le domaine de l’asile. Or, parmi les demandeurs d’asile, plusieurs catégories de
population ont été désignées comme «particulièrement vulnérables » ( LGBT18, femmes seules,
malades … ) et font l’objet d’une attention et de traitements particuliers.
Les « mineurs non-accompagnés » font partie de ces catégories. Le terme désigne « les
ressortissants de pays tiers ou apatrides âgés de moins de dix-huit ans qui entrent sur le
territoire des États membres sans être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux, de
par la loi ou la coutume, et tant qu'ils ne sont pas effectivement pris en charge par une telle
personne, ou les mineurs qui ne sont plus accompagnés après leur entrée sur le territoire des
17 Unwelcome guests: the detention of refugees in Turkey’s “foreigners’ guesthouses”, Helsinki citizen assembly, 200718Lesbian Gay Bisexual and Transgender
Page 24 sur 34
États membres tout enfant de -18 ans qui n’est sous la responsabilités d’aucun tuteur. »19 Le
cœur de notre travail consistait en un recensement de la littérature existante sur le sujet du côté
européen et turc afin d’effectuer une étude comparative.
-Quelle disponibilité des sources ?
Le travail d’évaluation et d’harmonisation effectué au sein de l’Union Européenne offre
un large éventail de rapports et articles relatifs aux situations nationales et européennes. En plus
d’une mise en ligne de tous les textes légaux, la réalisation régulière de rapport nationaux qu’elle
exige rend disponible un grand nombre de références mises à jour, sur des thèmes précis.
- Mineurs non-accompagnes – une étude comparative sur l’UE , European Migration
Network, 201020
Principale source utilisée, ce rapport récent synthétise l’état des lieux des conditions de réception
de cette catégorie de population dans tous les pays de l’Union Européenne à partir de rapports
nationaux. Il combine cadre juridique et mises en pratique, les compare d’un pays à l’autre et
formule des recommandations dans le but d’harmoniser les meilleures pratiques.
Tous les textes juridiques qui déterminent le cadre de la recherche étaient également facilement
accessibles.
- Eur –Lex 21 , site du journal officiel de l’Union Européenne a constitué une source
précieuse pour toutes références juridiques. La catégorie « mineurs non-accompagnés » est
abordée et traitée à l’aune de la vulnérabilité qui lui est reconnue dans les textes internationaux.
Les dimensions théoriques et pratiques étaient donc disponibles pour évaluer la situation de
l’Union Européenne.
Si les sources disponibles au HCR permettaient de retracer le cadre juridique de la situation
turque, la collecte d’informations concernant la pratique a constitué le principal enjeu de notre
19Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,fr&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=260539:cs&page=20 http://www.emn.fi/files/288/0._EMN_Synthesis_Report_Unaccompanied_Minors_Publication_(Sept10)_1_.pdf21 http://eur-lex.europa.eu/
Page 25 sur 34
travail de recherche. Une enquête de terrain était indispensable pour compenser relativement ce
manque.
- Uygulama Talimati, Genelge 57 - ( Implementative directive - Circular No: 57) –
2006.
Le vide juridique actuel empêche toute prise en charge des réfugiés à l’échelle nationale (hors
Conseil de l’Europe). Le Ministère de l’Intérieur compense en partie cette lacune par l’émission
ponctuelle de directives et circulaires. Depuis 2006, les administrations confrontées à la gestion
des réfugiés et demandeurs d’asile ( Police, services sociaux …) ont pour principale référence ce
texte destiné à encadrer les procédures. Faute d’instance de référence unique, les responsabilités
se repartissent entre le Ministères de la politique familiale et sociale, bureau de l’Immigration et
de l’asile sous la houlette du Ministère de l’Intérieur.
- Déroulement de la recherche
Lectures et sélections de la législation sur le sujet nous ont occupées dans un
premier temps. La présence sur le terrain nous a également permis de rassembler des données
pour pallier le manque de rapport officiel synthétisant l’état des conditions de réception des
mineurs non-accompagnés. Pour ce faire, nous avons participé à plusieurs manifestations
(journée internationale des réfugiés, 20 Juin, cours de turc au foyer … ) et avons sollicité
plusieurs entretiens avec les divers acteurs du domaine22: ONG selon leur domaine de
compétence ( ASAM = activités culturelles, Helsinki citizen assembly = assistance juridique,
IKGV = accueil et organisation des entretiens avec le HCR, DABATEM = soutien
psychologique) et travailleurs sociaux ( notamment au foyer de Kadıköy, directeur et sociologue
du foyer ).
22 Voir entretiens en Annexes
Page 26 sur 34
Illustration 3: Journée des réfugiés
Renée Ngangambi, refugié congolais : discours à l'occasion de la Journée
internationale pour les réfugiés. Levent, Istanbul. 24 Juin 2011
La recherche et la rédaction de ce type de rapport nous a confronté à des documents
d’origine et de nature très diverses. Lecture et sélection de textes juridiques nous ont beaucoup
mobilisées. Le site du journal officiel de l’Union Européenne (Eur-lex23) reste la référence
technique de base. Les rapports émis par l’Union Européenne ou les organes qui lui lie ?
( Commission européenne, European migration network, Commissaire européen aux Droits de
l’Homme … ) élaborent un état des lieux et rappellent les orientations de sa politique. Les
directives et circulaires émises par le Ministère de l’Intérieur turc nous ont aussi beaucoup servi.
Principalement adressées aux fonctionnaires, elles ont une dimension pratique et concrète, plus
aisément comparables à la réalité de terrain turque. Statistiques, cartes de localisations ont été
autant de données brutes disponibles auprès du HCR qui ont permis de faire une évaluation de la
situation en terme de proportions et de chiffres. Les rapports régulièrement émis par les ONG du
secteur ont été d’un recours précieux. Thématique, l’orientation militante de ces organisations
23 http://eur-lex.europa.eu/
Page 27 sur 34
encourage la réalisation d'enquêtes et d’entretiens avec les réfugiés etc., autant de témoignages
qui auraient été difficiles à obtenir dans le cadre d’un stage de trois mois. Ils permettent
également de mettre en évidence les problèmes très concrets que rencontrent les réfugiés dans
leur vie quotidienne.
XI. SITUATION DES MINEURS NON-ACCOMPAGNES : PRINCIPAUX
RESULTATS
L’étude comparative avait pour but de dégager les faiblesses de la pratique turque et de formuler
des recommandations à l’usage des acteurs du secteur (HCR, ONG, Police, administrations ...).
- Cadre légal : perspectives croisées
Un rapport sur les mineurs non-accompagnés devaient prendre en compte les textes
juridiques liées aux deux thématiques : l’asile et les mineurs non-accompagnés.
Les mineurs non-accompagnés, intégrés à la catégorie plus large des enfants, font l’objet de
chapitres particuliers dans les conventions et textes internationaux : Convention de Genève
1951, Convention sur la protection des enfants de la Hague, Convention de l’ONU sur le droit
des enfants). C'est à ces textes généraux que s'intègrent ensuite les textes signés au niveau
européen ou national. L’Union Européenne s’est elle-même dotée d’une Convention, de
charte et de résolutions: Convention européenne pour la protection des Droits de l’Homme et
des libertés fondamentales24 , Charte pour les Droits fondamentaux de l’Union Européenne25,
Résolution du conseil du 26 Juin 1997 sur les mineurs non-accompagnés ressortissants d’un
pays tiers.
La réglementation sur l’asile de l’Union Européenne comporte fréquemment des
traitements particuliers pour les mineurs non-accompagnés comme la Directive sur les
conditions de réception des demandeurs d’asile26.
24 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG25 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm26 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0009:EN:NOT
Page 28 sur 34
- Conditions de réception des mineurs non-accompagnés :
Beaucoup de problématiques relevées quant aux conditions de réception des mineurs non-
accompagnés sont imputables à un cadre général lacunaire. Si la future loi sur l’asile pourra
apporter des réponses au vide juridique précédemment évoqué, les situations individuelles se
heurtent également aux faiblesses du système administratif turc. A l’image des demandeurs
d’asile majeurs, ils rencontrent des problèmes à plusieurs étapes de la procédure (détention
abusive, longueur des procédures, frais de permis de résidence ... ).
La barrière de la langue, faute d’interprète, est fréquemment évoquée comme un des
obstacles récurrents à une bonne application du droit. Si le HCR couvre les frais d’interprétariat
lors des entretiens, les moyens manquent souvent dans les foyers, les ONG et les postes de
Police. Une fois enregistrés et reconnus comme tels, les mineurs non-accompagnés sont installés
dans des foyers, sous la responsabilité des services sociaux (SHCEK). A Istanbul, les foyers de
Yeldeğirmeni (garçons) et Atatürk (filles) comptaient 64 enfants, et 83 pour toute la Turquie à
l’été 2011.
La longueur des procédures immobilise également de nombreux mineurs pour des durées
indéterminées. Plusieurs acteurs du secteur préconisent une décentralisation partielle de ces
procédures qu’Ankara ( gestion par le Ministère de l’Intérieur) ne peut visiblement assurer
efficacement. L’obtention du permis de résidence (ikamet) pose également problème aux
mineurs. A l’été 2011, seul 1/6 des mineurs du foyer de Yeldeğirmeni était en possession d’un
ikamet. Si les frais de santé y sont couverts par des accords avec le gouvernorat (Valilik), il ne
s’agit que d’une solution ponctuelle. Bien que l’accès à l’éducation soit gratuit et obligatoire
jusqu’à 14 ans, il devient également problématique dès lors que les mineurs ne peuvent fournir de
numéro d’identification nationale.
- Condition de la recherche de terrain : obstacles et limites
Le statut particulier dont bénéficient les mineurs est largement connu parmi les réseaux de
migrants. Les adultes tentent fréquemment de se faire enregistrer comme mineurs non-
accompagnés afin de bénéficier du traitement de faveur, compliquant la tâche des ONG en charge
Page 29 sur 34
de les accueillir. En cas de doute, un rapport médical peut être demandé afin d’attester de l’âge du
requérant.
Pour les mineurs non-accompagnés, il est parfois difficile de faire valoir ses droits. Aux
postes frontières, des abus sont régulièrement signalés. Plusieurs d’entre eux sont enregistrés
comme majeurs par les services de Police, afin d’alléger la procédure27.
La localisation du stage à Istanbul facilitait l’accès aux institutions situées dans le
périmètre de la ville. Les visites au foyer de Yeldeğirmeni ont été riches d’enseignement, mais
restent insuffisantes. La qualité des services du foyer de Yeldeğirmeni en fait un établissement
exemplaire en terme de réception et de suivi des mineurs. A l’origine, l’établissement rassemblait
enfants de rue turcs et réfugiés. Les difficultés de gestion l’ont progressivement conduit à se
consacrer à la population des réfugiés, permettant au personnel de se spécialiser et d’assurer un
encadrement plus ciblé selon leurs problématiques propres. Les filles quant à elles(au nombre de
4 en date du 20 Août) ne bénéficient pas de tels soins. En petit nombre, elles ne peuvent être
logées qu’avec d’autres enfants turcs, et souffrent souvent d’exclusion. Les conditions ne nous
ont pas permis de leur rendre visite.
De la même manière, le manque de moyens alloués pour la réalisation de ce rapport nous
a empêché de nous rendre dans d’autres villes de la Turquie concernées. Si Istanbul regroupe une
majorité des mineurs, il s’agissait d’avoir une vue globale de la situation (Amasya, Eskişehir,
Erzurum, Isparta, Tokat …).
D’autre part, un entretien avec la Police aurait pu être enrichissant dans le cadre du
rapport, mais l’autorisation ne nous a pas été donnée de le faire. Particulièrement sensible à son
image, l’organisation du HCR reste vigilante dans toutes démarches, notamment dans ses
relations avec l’extérieur. Tout contact avec des personnes tiers ou des organismes extérieurs doit
faire l’objet d’une approbation de la hiérarchie. Si la marge d’initiative s’en trouve limitée, la
cohérence et la discrétion de ses activités en dépendent.
XII. CONCLUSION
27 Helsinki Citizens' Assembly Turkey, Unwelcome guests: the detention of refugees in Turkey's foreigners' guesthouses, April 2008,
Page 30 sur 34
Dans la perspective de l’adhésion à l’Union Européenne, le domaine de l’asile en Turquie
est amené à connaître de nombreux changements dans les années à venir. Le vide juridique actuel
devrait être prochainement comblé par la Loi sur l’asile en préparation. La question de la levée de
la limitation géographique concentrent les enjeux sur l’avenir des flux de demandeurs d’asile.
Les conditions de réception des populations, mineurs non-accompagnés comme les autres,
devraient s’en trouver nettement améliorée.
Cependant, le rapport effectué ne reflète qu’une partie de la réalité tant les flux migratoires
échappent à toute exacte comptabilité. Les cas enregistrés et suivis par le HCR ne sont que la
partie immergée de l’iceberg, et l’effort doit se poursuivre pour une plus large et une plus
complète application des engagements et des principes auxquels les États ont souscrit.
BIBLIOGRAPHIE
- Nurcan Özgür Baklacioğlu, Building “Fortress Turkey”: Europeanization of Asylum Policy
in Turkey, The Romanian Journal of European Studies, 78, 2009. 14 pages
Page 31 sur 34
- Helsinki Citizens' Assembly Turkey, Unwelcome guests: the detention of refugees in Turkey's
foreigners' guesthouses, April 2008
- Lisa Montmayeur, « la frontière terrestre gréco-turque au cours de l’Histoire : espace de
jonction, espace de fermeture ? » , 24 juin 2011, OVIPOT, http://ovipot.hypotheses.org/5797
- Jérôme Valluy, "Contribution à une sociologie politique du HCR : le cas des politiques
européennes et du HCR au Maroc", Recueil Alexandries, Collections Etudes, mai 2007, url de
référence: http://www.reseau-terra.eu/article571.html
SITOGRAPHIE
- Site des Nations Unies : http://www.un.org/fr/
- Site du HCR : http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d2df.html
- Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT) : http://ovipot.hypotheses.org/5797
- Site de Refworld : http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain
- Site du Courrier International : http://www.courrierinternational.com/
ILLUSTRATIONS ET TABLEAUX
Tableau 1 : Evaluation d’une demande pour l’obtention du statut de réfugié...............................11
Illustrations 1 : Répartition des antennes du HCR en Turquie.......................................................15
Schéma1 :Procédure de demande d'asile en Turquie......................................................................16
Illustration 2 : Projet de clotûre à la frontière gréco-turque...........................................................21
Page 32 sur 34
Illustration 3: Journée des réfugiés, discours de Renée .................................................................26
XIII.ANNEXES
- 1- Organigramme de l’ONU