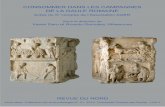2012: Diskursordnungen des Lernens, Dispositive des Schöpferischen
Evolution des systemes d'irrigation et gestion de la salinite des terres irriguees
Transcript of Evolution des systemes d'irrigation et gestion de la salinite des terres irriguees
Evolution des systemes d’irrigation et gestion de la
salinite des terres irriguees
Serge Marlet
To cite this version:
Serge Marlet. Evolution des systemes d’irrigation et gestion de la salinite des terres ir-riguees. Ali Hammani, Marcel Kuper, Abdelhafid Debbarh. Seminaire sur la modernisation del’agriculture irriguee, 2004, Rabat, Morocco. IAV Hassan II, 11 p. <cirad-00188188>
HAL Id: cirad-00188188
http://hal.cirad.fr/cirad-00188188
Submitted on 15 Nov 2007
HAL is a multi-disciplinary open accessarchive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come fromteaching and research institutions in France orabroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, estdestinee au depot et a la diffusion de documentsscientifiques de niveau recherche, publies ou non,emanant des etablissements d’enseignement et derecherche francais ou etrangers, des laboratoirespublics ou prives.
Projet INCO-WADEMEDActes du Seminaire
Modernisation de l’Agriculture IrrigueeRabat, du 19 au 23 avril 2004
Evolution des systemes d’irrigation et gestion de lasalinite des terres irriguees
Serge Marlet
CIRAD-AMIS,TA 40/01, 34398 Montpellier Cedex 5, France
E-mail : [email protected]
Resume - Le developpement de l’irrigation s’est, dans la majorite des situations, accompagne del’apparition de processus de salinisation, de sodisation ou d’alcalinisation des sols a des degres d’im-portance divers. Si les situations apparaissent tres variees en raison des caracteristiques du milieunaturel et des modalites de gestion de l’eau et des systemes de culture, ces degradations resultentpour l’essentiel de modes de gestion inappropries dans les systemes irrigues. En retour, des mesurescorrectives permettent souvent d’ameliorer ces situations qui ne sont donc pas ineluctables. Ces inter-actions sont analysees sous l’eclairage de situations dont les evolutions ont ete similaires en Egypte,au Pakistan, au Mali et au Maroc, presentes lors du seminaire PCSI 2002 : « Vers une maıtrisedes impacts environnementaux de l’irrigation » (Marlet et Ruelle, 2003[7]), (confort hydrique, re-montee de la nappe, engorgement, salinisation des sols, programme de drainage, rarefaction des eauxde surface de bonne qualite, mobilisation de ressources souterraines, baisse du niveau des nappes,degradation de la qualite des eaux). La salinisation des sols apparaıt aussi comme un indicateurpertinent pour l’evaluation de la performance de ces systemes irrigues. La periode contemporaine estprincipalement caracterisee par un accroissement de la complexite sous l’influence conjointe d’uneliberalisation des pratiques, d’une diversification de la demande et d’une rarefaction des ressources eneau. La mobilisation des eaux souterraines apparaıt donc comme une solution interessante pour lesagriculteurs, mais elle s’accompagne aussi de nouvelles menaces sur la conservation des ressources eneau et du sol, et sur la durabilite des systemes d’irrigation. L’impact reel de l’evolution des sols surla productivite des systemes de culture est mal connu. La modernisation de la gestion des systemesirrigues passe alors par le developpement et l’adaptation continue de nouveaux dispositifs perennes desuivi et d’evaluation et d’outils de pilotage couplant differents criteres hydrauliques, agronomiques,organisationnels et environnementaux. Des adaptations des methodes de pilotage sont necessaires,mais les responsables ne disposent generalement pas des informations necessaires, ce qui entraıne desdelais et des couts eleves pour identifier des solutions. Cependant, les indicateurs lies a la salinite dessols sont tres utiles car refletent aussi les performances globales de ces systemes.
Mots cles : alcalinisation, drainage, eau souterraine, gestion de l’eau, irrigation, ressource en eau,salinisation, sodisation, sol, systeme irrigue, Egypte, Pakistan, Mali, Maroc.
Actes du Seminaire ”Modernisation de l’Agriculture Irriguee” 2
1 Introduction
L’histoire revele que certaines societes basees sur l’agriculture irriguee ont echoue (Tanji, 1990[10]).La Mesopotamie, aujourd’hui l’Irak, a souffert de la salinisation des sols entre 2400 et 1700 BC.Le probleme tire son origine d’une dispute entre les cites sumeriennes d’Umma et Girsu concer-nant les droits relatifs a l’utilisation des eaux et des terres. Les dysfonctionnements qui enresulterent conduisirent a une elevation de la nappe et une salinite excessive des sols. Malgrepres de 5000 ans d’experience, cette societe finit par decliner.
L’histoire recente est marquee par une formidable extension des superficies irriguees (Umali,1993[12]). Elles sont passees de 8 millions d’hectares en 1800, 48 millions d’hectares en 1900, apres de 300 millions d’hectares aujourd’hui. Elles representent 15% des superficies cultivees maisproduisent plus du tiers de la production alimentaire mondiale, et jusqu’a 50% pour le ble ou leriz. Elles contribuent a la securite alimentaire, la reduction de la pauvrete et l’amelioration de laqualite de la vie d’une part importante de la population mondiale. Cependant, le developpementde l’irrigation s’est constamment heurte a des menaces sur sa durabilite. Parmi elles, nousnous interesserons plus particulierement a celles liees aux evolutions de la salinite des terresen relation avec la gestion des systemes hydrauliques et des systemes de culture irriguees. Onadmet generalement que plus de 50% des systemes irrigues sont affectes a des degres divers parla salinite ; 20 a 30 millions d’hectares seraient severement affectes, et 60 a 80 millions d’hectaresa un degre moindre, soit 10 a 48% de la superficie irriguee. La salinite est un probleme majeurdans la plupart des grands systemes d’irrigation en Inde, au Pakistan, en Chine, ... et dans leMaghreb.
Dans un premier temps, nous presenterons les grands traits de l’histoire hydraulique et agricolede quatre situations en Egypte, au Pakistan, au Mali et au Maroc, symptomatiques de l’evolutiondes systemes irrigues. Puis nous tenterons d’en tirer quelques enseignements generiques sur lesrelations existantes entre les evolutions de la gestion hydraulique et agricole dans les perimetresirriguees, la dynamique des nappes phreatiques et la salinisation des sols. Un interet particuliersera porte sur la necessaire adaptation des modes de gestion des systemes irrigues dans le contexteactuel marque par une penurie croissante d’eau de surface de bonne qualite en concurrence avecles besoins urbains ou industriels ; l’irrigation correspond a environ 69% des prelevements et86% de la consommation en eau au niveau mondial.
2 Etudes de cas
2.1 Le delta du Nil (egypte)
La synthese realisee par Ruf (1995)[9] montre qu’en deux periodes, de 1890 a 1915 et de 1965 a1985, la mise en œuvre de nouveaux moyens d’arrosage a conduit aux points limites de la sali-nisation suite a une remontee de la nappe phreatique. Ces evolutions resultent d’inadequationsentre irrigation et drainage, mais aussi de nombreux bouleversements associes en matiere deconduite des systemes de culture ou de formes d’organisation et de gestion fonciere, sociale,politique et juridique pour l’acces aux terres amenagees et aux ressources hydriques.
Le bassin de reception de la crue (hod) est reste pendant cinq mille ans la base des amenagements.Les eaux de la crue intervenant d’aout a octobre etaient guidees vers les hods ou elles sejournaientquelques semaines, humidifiant le sol et deposant ses alluvions. La reussite de la campagneresultait de la capacite des communautes paysannes a entretenir et a gerer les amenagements, etsurtout de coordonner la vidange des hods pour ensemencer ensuite les terrains a la volee au furet a mesure du retrait des eaux pour la culture hivernale de ble et d’orge. Aucune preparation dusol n’etait alors necessaire. Les mauvaises herbes etaient asphyxiees par la submersion prolongee.
Theme 2 : Vers une gestion durable de l’irrigation : consequences sur les options de modernisation S. Marlet
Actes du Seminaire ”Modernisation de l’Agriculture Irriguee” 3
Les alternances d’humectation et de dessiccation permettaient de maintenir la structure du sol.La fertilite des sols etait entretenue par le depot d’alluvions. La couche superficielle de sedimentsconstituait un lit de semence tres favorable a la condition de semer avant la formation d’unecroute. Enfin, la submersion controlee puis la vidange des bassins permettait de desaliniser lesterres.
Le premier bouleversement est intervenu progressivement au cours du XIXe siecle avec l’intro-duction et le developpement de la culture du coton. Sa mise en place etant assuree au printempspendant l’etiage du fleuve, il est desormais necessaire d’irriguer et la sakkia, et son corollaire latraction attele, se generalisent. La recolte du coton n’intervenant qu’en septembre/octobre, il estaussi necessaire de proteger la recolte de la submersion pendant les hautes eaux en dispersantla lame d’eau dans un vaste reseau de canaux surcreuses. Avec la disparition des periodes desubmersion, la preparation des terres en traction attelee devient necessaire pour la preparationdu lit de semence et la lutte contre les adventices. Le fumier est collecte et epandu pour lemaintien de la fertilite suite a la disparition du limonage et a une mineralisation plus rapide dela matiere organique. Sous l’effet conjugue du surcreusement des canaux, d’une augmentation del’intensite culturale et de l’extension des superficies irriguees, la nappe phreatique remonte tresproche de la surface et des efflorescences salines apparaissent dans differents secteurs du delta.Ces deux phenomenes concourent a une diminution des rendements, en particulier du coton. Ledebat oppose alors les tenants de mesures contraignantes de facon a reduire le pompage et laremontee de la nappe aux partisans du drainage. Le reseau de drainage est finalement acheveen 1920 en meme temps qu’un systeme de rotation de la distribution de l’eau au niveau destertiaires etait perpetue pour abaisser le niveau de la nappe et lutter contre la salinisation.
Le second bouleversement fait suite a l’edification du haut barrage d’Assouan (1964) et a l’accen-tuation d’un encadrement etatique a partir des annees 50. La reforme agraire s’accompagne alorsde la mise en place de cooperatives qui decident du choix des cultures et gerent la preparation desterres qui devient mecanisee. Des pompes mobiles se substituent progressivement aux Sakkiaset contribuent a un nouvel accroissement de l’intensite culturale (double culture annuelle) etdes irrigations. Le reseau de drainage est devenu insuffisant et de nouvelles efflorescences salinesapparaissent. Le debat resurgit alors et un vaste programme de drainage par drains enterres estfinance par la banque mondiale. La mecanisation entraıne par ailleurs de nouveaux problemesde compaction et d’entretien de la fertilite.
L’etat aura consacre les moyens necessaires a des adaptations des systemes de drainage pourla lutte contre l’engorgement et la salinite. Elles ont ete realisees avec retard du en partie ala difficulte d’apprehender l’origine du phenomene, son ampleur et les moyens d’y remedier.Cependant, le systeme continue d’evoluer avec la colonisation de terres nouvelles posant leprobleme d’une possible rarefaction des ressources en eau, mais aussi avec la diversification desmodes de production agricole associee a des demandes en eau differenciee en terme de dotationset de frequence d’arrosage.
2.2 Le bassin de l’Indus (Pakistan)
Le travail realise par Kuper et Habib (2003)[5] nous permet d’analyser la gestion de la salinite parl’irrigation dans un des plus vastes et plus ancien systeme irrigue a travers le monde. Le systemedu bassin de l’Indus irrigue environ 16 millions d’hectares a partir de 128 milliards de m3 derivesdes affluents de l’Indus. Les eaux souterraines sont traditionnellement utilisees dans cette regionet 350000 puits existaient au debut du XXe siecle, contribuant alors a 40% des irrigations. Malgrele developpement des systemes hydrauliques, 200000 puits etaient encore fonctionnels dans lesannees 60, contribuant alors a 15% des irrigations. La salinite est depuis longtemps associeea l’engorgement des sols avec l’introduction a grande echelle de systemes perennes d’irrigation,mais aussi localement avec une salinite primaire liee a la nature des materiaux issus de sedimentsmarins.
Theme 2 : Vers une gestion durable de l’irrigation : consequences sur les options de modernisation S. Marlet
Actes du Seminaire ”Modernisation de l’Agriculture Irriguee” 4
Depuis la fin du XIXe siecle, la priorite a ete donnee a differentes mesures hydrauliques decontrole de la remontee de la nappe, tandis qu’une evaluation annuelle de la salinite est realiseedepuis 1943. La Water and Power Development Authority (WAPDA) est creee en 1958 pours’attaquer aux problemes d’engorgement et de salinite a travers un vaste programme de drainagehorizontal et vertical (Salinity Control And Reclamation Projects – SCARP). Depuis les annees70, 16000 forages publics ont ete mis en place dans le but d’abaisser le niveau de la nappephreatique, et de completer les volumes desservis par le reseau d’irrigation. Les forages furentensuite transferes aux agriculteurs en raison de couts d’entretien et d’exploitation excessifs.Rapidement encourages par des subventions publiques, les agriculteurs prefererent la mise enplace de 500000 forages superficiels de capacite plus modeste (30 l.s−1) contribuant pour 30 a40% des irrigations a la parcelle. La salinite des sols semble s’etre ameliore entre les prospectionsde 1953-54 et 1977-79, les sols sales passant de 47 a 33%, soit quand meme 4.2 millions d’hectares.Cette decroissance est attribuee a l’effet conjugue d’une baisse de la nappe et d’une augmentationde la disponibilite en eau d’irrigation d’origine souterraine pour le lessivage.
Dans le meme temps, les sols sodiques sont estimes a 25% et les chercheurs mirent en evidencel’effet defavorable des eaux souterraines, bicarbonatees et sodiques, sur la degradation de lafertilite. Cette situation a ete plus precisement etudiee dans la zone desservie par le canalFordwah (75000 hectares). On y trouve 6.4 forages pour 100 hectares representant une capacitede pompage superieure a 3 fois les quantites d’eau desservies par le canal. De l’amont vers l’avaldu systeme hydraulique, on y observe conjointement une diminution de la disponibilite en eaude surface et une degradation de la qualite des eaux souterraines. Elles se conjuguent avec lavariabilite des sols et une certaine iniquite des dotations d’eau entre les canaux tertiaires pourinduire a une grande diversite de situations auxquelles les agriculteurs sont confrontes. Malgreune proportion importante de sols sales ou sodiques, ils sont parvenus a maintenir une intensiteculturale d’environ 150% grace a l’utilisation conjuguee des eaux de surface et souterraines.La reallocation d’eau de surface de bonne qualite vers les zones ou les eaux souterraines sontsalees apparaıt comme une solution pour ameliorer la qualite des sols et les performances del’agriculture irriguee.
2.3 L’office du Niger (Mali)
Les perimetres de l’Office du Niger presentent un interet particulier en raison d’une doublespecificite liee a l’alcalinisation des sols et a une vocation quasi-exclusivement orientee vers lariziculture irriguee (Marlet, 2002[6] ; Kuper et Tonneau, 2002[4] ; N’Diaye et al, 2003[8]). La miseen valeur de la zone a debute en 1947 avec l’achevement du barrage de Markala. Initialementpresente vers 45 metres de profondeur, la nappe est devenue sub-affleurante en une vingtained’annees sous l’influence de l’irrigation et d’un aquifere peu permeable. Les amenagements gra-vitaires, initialement destines a la culture du coton, ont alors evolues vers une monoculture deriz pendant la saison pluvieuse. Depuis la rehabilitation progressive des amenagements a partirde la fin des annees 80, on observe une intensification spectaculaire de la riziculture irrigueedont les rendements sont passes de 2 t/ha a plus de 5t/ha de paddy en une dizaine d’annee,et un developpement progressif des cultures de contre-saison, essentiellement maraıcheres. Leseaux du fleuve Niger sont peu mineralisees. Aussi ont-elles longtemps ete considerees comme nepresentant aucun risque jusqu’a ce que des phenomenes d’alcalinisation et de sodisation des solssoient formellement identifies. Les eaux sont caracterisees par une alcalinite residuelle positiveet conduisent a une augmentation du pH et de la sodicite des sols lorsqu’elles se concentrent.
Dans la periode precedant la rehabilitation des perimetres, la maıtrise de l’irrigation et du drai-nage etait deficiente. L’alcalinite et la sodicite des sols argileux peu permeables et situes dansdes cuvettes mal drainees ont augmente. Les sols sableux plus permeables semblent avoir eteplus efficacement lessives et draines, notamment avant la remontee de la nappe. Dans la periodesuivant la rehabilitation des perimetres, la maıtrise de l’irrigation et du drainage s’est amelioree
Theme 2 : Vers une gestion durable de l’irrigation : consequences sur les options de modernisation S. Marlet
Actes du Seminaire ”Modernisation de l’Agriculture Irriguee” 5
et les cultures se sont developpees pendant la contre-saison. Ces evolutions ont profondementmodifie le regime hydrologique des sols et de la nappe et induit une rupture dans l’evolutiondes proprietes chimiques des sols : le pH, la conductivite electrique et la sodicite des sols sa-bleux ont rapidement augmente tandis qu’ils diminuaient sur les sols argileux. Ces evolutionssont particulierement sensibles dans l’horizon superficiel tandis que les proprietes des horizonsprofonds restent partiellement heritees des evolutions anterieures. La topographie joue un roledeterminant dans la distribution des sels a differentes echelles, les points hauts apparaissant,aux yeux du chercheur comme a ceux du paysan, comme les plus sensibles a la degradation.
Les travaux realises permettent d’analyser les processus qui conditionnent ces evolutions. Lebilan des sels apparaıt negatif pendant la saison rizicole en raison d’importantes sorties d’eau etde sels par le systeme de drainage et 73% des sels sont issus de la vidange superficielle (flushing)des bassins rizicoles. Le bilan des sels apparaıt positif pendant la contre-saison en raison del’alimentation de la nappe resultant d’une mise en eau quasi-continue des canaux d’irrigation,notamment sur les formations les plus permeables. Le maintien d’une lame d’eau permanentepermet aussi le developpement de conditions reductrices, la mobilisation de l’alcalinite et sadiffusion vers la lame d’eau superficielle, puis son evacuation par le drainage (Dicko et al, 2002[2]).Il permet en outre de maintenir le pH des sols a des valeurs favorables pour la riziculture. Surles parcelles maraıcheres, les techniques de culture et d’irrigation apparaissent moins aptes aprevenir ou a contourner le probleme pose par l’alcalinisation et l’engorgement.
L’eau est encore tres abondante a l’office du Niger en raison de la faiblesse des superficiesequipees, et la maıtrise de l’irrigation et du drainage est globalement satisfaisante. Les perspec-tives d’evolution sont neanmoins marquees par une amplification des facteurs de risque lies al’accroissement des superficies irriguees, une moindre qualite des infrastructures hydrauliques etun developpement de cultures de diversification plus sensibles a l’engorgement et a l’alcalinitedes sols.
2.4 L’office regional de mise en valeur agricole du Tadla (Maroc)
Le perimetre du Tadla est l’un des plus anciens du Maroc. Il est souvent pris en exemple pour lesquestions qu’il pose en matiere de prevention de la salinisation des sols (Debbarh et Badraoui,2003[3] ; Bellouti et al, 2003[1]). La mise en eau des premiers secteurs hydrauliques remonte a1938, et environ 100000 hectares sont irrigues gravitairement depuis 1974 pour la culture duble, de la betterave, des fourrages, l’arboriculture fruitiere et le maraıchage. Le perimetre esttraverse par l’oued Oum Rbia et se trouve ainsi divise en deux sous-perimetres : Beni Amird’une superficie de 27000 ha en rive droite est irrigue par les eaux relativement salees (0.7 g/l)recemment regularisees du barrage El Hansili sur l’oued Oum Rbia ; et Beni Moussa d’unesuperficie de 69500 ha en rive gauche est irrigue par les eaux de bonne qualite (0.3 g/l) dubarrage Bin el Ouidane sur l’oued El Abid.
Comme dans beaucoup de perimetres irrigues, le developpement de l’irrigation s’est accompagned’une remontee generale de la nappe induisant des problemes d’engorgement et de salinite. Lereseau de drainage par fosse a ete concu entre 1948 et 1950 pour controler la remontee de lanappe et evacuer les eaux excedentaires hors du perimetre. Son impact est reste tres limite.
Le pompage dans la nappe s’est developpe apres la periode de secheresse des annees 1980.A cote de 17 stations de pompage mis en place par l’ORMVAT, les agriculteurs ont recourua des pompages dans la nappe pour faire face aux frequentes penuries d’eau. Le nombre depuits ou forages est estime a plus de 10000 a l’heure actuelle et continue d’augmenter. Lesdeux phenomenes contribuent a un abaissement du niveau de la nappe pendant les periodes desecheresse tandis que ce niveau tend a remonter pendant les periodes de meilleure pluviometrie.La nappe apparaıt ainsi comme un moyen de pallier l’irregularite et l’insuffisance des apportsd’eau de surface par le reseau hydraulique. Mais la periode actuelle est marquee par une baisse
Theme 2 : Vers une gestion durable de l’irrigation : consequences sur les options de modernisation S. Marlet
Actes du Seminaire ”Modernisation de l’Agriculture Irriguee” 6
rapide de la nappe qui menace la durabilite du systeme. De plus, l’utilisation accrue de la nappes’accompagne aussi d’une aggravation des risques de degradation des sols et des eaux souterrainesen l’absence de veritable exutoire naturel. Les phenomenes de salinisation et sodisation des solsse manifestent principalement dans le perimetre de Beni Amir et la partie avale du perimetrede Beni Moussa en raison de la mauvaise qualite des eaux souterraines.
Pour faire face a ces difficultes, l’ORMVAT s’est engage dans deux directions. La premiereinitiative porte sur la mise en place d’un dispositif de suivi de la qualite des eaux et des sols. Ilrepose sur un reseau d’environ 272 piezometres pour le suivi de la bathymetrie, dont 100 pourle suivi de la qualite des eaux souterraines, d’une part, et un reseau de 40 sites pour le suivi dela qualite des sols. La seconde initiative porte sur le developpement d’un systeme de gestion deseaux de surface permettant de rationaliser et de planifier la distribution des eaux de surface,notamment pendant les periodes de penurie. Ce systeme reste cependant a adapter en fonctiond’une situation marquee non seulement par une utilisation accrue des eaux de nappe, mais aussia la modernisation des techniques d’irrigation, a une liberalisation des choix d’assolement parles agriculteurs et a la mise en place d’associations d’usagers de l’eau.
3 Discussion
3.1 Des evolutions similaires dans de nombreux perimetre irrigues
Ces differents exemples s’inscrivent dans le cadre d’evolutions similaires que l’on retrouve dansde nombreux grands programmes d’irrigation.
Dans une phase initiale de developpement, la disponibilite est eau est generalement suffisante.Ce confort hydrique conduit a une remontee de la nappe induisant conjointement des contraintesliees a l’engorgement et, a plus long terme, a la salinite des sols (twin menace).
Elle se poursuit le plus souvent par la mise en œuvre de programmes de drainage dont l’ob-jectif est de controler la profondeur de la nappe et d’evacuer les sels excedentaires apportespar la nappe ou les eaux d’irrigation. Le drainage par fosse ou par reseau de drains enterresest progressivement adapte aux evolutions des systemes irrigues et a l’intensite des contraintesliees a l’engorgement, notamment dans les zones de delta a l’exemple du delta du Nil. Dansles situations ou l’engorgement cohabite avec la necessite de mobiliser des ressources en eauadditionnelles lorsque les eaux de surfaces sont deficitaires (vallee de l’Indus, plaine du Tadla),les politiques publiques sont souvent relayees par des initiatives individuelles de pompage dansla nappe qui contribuent ainsi a resorber les problemes d’engorgement. L’office du Niger faitexception dans la mesure ou la riziculture sous submersion est generalisee pendant la saison plu-vieuse. Le systeme de drainage superficiel n’a pas ici d’autres fonctions que l’evacuation des eauxpluviales excedentaires et la vidange rapide des casiers rizicoles, meme si il contribue conjointe-ment a l’evacuation de sels hors des zones amenagees. Les contraintes liees a l’engorgement eta l’alcalinite des sols s’y expriment davantage pendant la contre-saison mais aucun programmespecifique n’a encore ete mis en œuvre.
Avec la rarefaction des ressources en eau de surface de bonne qualite, la mobilisation de res-sources en eau additionnelles devient necessaire. Elle apparaıt comme la consequence de situa-tions variees associant un accroissement de la demande (accroissement des superficies irriguees,augmentation de l’intensite culturale, ...) et une reduction de l’offre (degradation du climat,concurrence des besoins urbains ou industriels, ...). L’utilisation accrue des ressources en eausouterraine prend la forme d’un developpement, generalement anarchique, de puits et forages parles agriculteurs, parfois aussi par la mobilisation de ressources en eau marginales : eaux de drai-nage, eaux usees, ... . Les exemples du Pakistan et du Tadla au Maroc illustrent ces evolutions.La durabilite de ces systemes resulte alors de la gestion raisonnee du reservoir constitue par
Theme 2 : Vers une gestion durable de l’irrigation : consequences sur les options de modernisation S. Marlet
Actes du Seminaire ”Modernisation de l’Agriculture Irriguee” 7
la nappe, les bonnes annees lorsque la ressource en eau (pluie ou irrigation) est abondantecontribuant a recharger une nappe dans laquelle les agriculteurs puisent pendant les periodes depenurie. La tendance est cependant marquee par une baisse preoccupante du niveau des nappes.Dans le meme temps, le systeme conduit a un recyclage continue des eaux qui favorise l’accrois-sement de la salinite, de l’alcalinite ou de la sodicite des sols, et ce d’autant plus que la qualitedes eaux souterraines apparaıt localement de mauvaise qualite.
Fig. 1 – Des evolutions conjointes des contraintes hydriques, de la nappe et de la salinite similaires dansde nombreux perimetres irrigues (d’apres Zimmer, 2003[11])
3.2 Des causes specifiques aux innovations hydrauliques et agricoles et al’evolution de la salinite
Les exemples presentes permettent aussi d’illustrer la diversite des processus de decision, dechoix techniques et de leurs consequences sur l’evolution de la salinite. En coherence avec lemodele general presente precedemment, nous distinguerons deux approches : la premiere releved’une intensification des systemes de culture irriguee par la mobilisation de nouveaux moyens deproduction ; et la seconde d’une optimisation de la productivite de l’eau et des terres irrigueesen raison de leur disponibilite limitee.
Il convient avant toute chose de souligner que les logiques d’intensification et d’amelioration dela productivite de l’eau et des terres sont totalement legitimes et qu’il n’est pas question de lescondamner, qu’elles qu’en soient les consequences environnementales. Le debat a toujours opposeles tenants d’un equilibre des systemes selon une approche naturaliste ou anthropologique, auxadeptes de la modernisation selon une confiance dans la technologie et le progres. Il ne s’agitpour nous ni de privilegier, ni d’opposer l’une et l’autre de ces approches qui semblent a la
Theme 2 : Vers une gestion durable de l’irrigation : consequences sur les options de modernisation S. Marlet
Actes du Seminaire ”Modernisation de l’Agriculture Irriguee” 8
fois necessaires et complementaires. Ces debats qui ont pu par exemple emailler les differentsepisodes de l’histoire hydraulique du delta du Nil sur le drainage, sont les memes que ceux nousrencontrons aujourd’hui au sujet du developpement inconsidere du pompage dans les nappes oude la degradation de la qualite des eaux sous l’influence des pratiques agricoles.
Dans un premier groupe de situations, la mobilisation de ressources en eau additionnelles vapermettre une augmentation de l’intensite culturale dont l’influence sur la remontee de la nappephreatique et l’apparition progressive d’efflorescences salines ont ete developpees precedemment.Les proprietes des sols, la topographie, les systemes de culture ou les techniques d’irrigationinteragissent pour determiner le fonctionnement hydrologique et une repartition heterogene dessels dans le milieu. Ces processus se deroulent dans un contexte general de developpement del’irrigation mais aussi sous l’influence de certaines conditions specifiques comme :
– l’amelioration successive des methodes de pompage et la regularisation des ressourceshydriques (barrage d’Assouan) en egypte rendant inoperant le systeme de drainagepreexistant ;
– la rehabilitation du systeme d’irrigation permettant une mise en eau continue du systemed’irrigation et le developpement de cultures de contre-saison au Mali, et conduisant a unalimentation accrue et de la nappe et une augmentation de la salinite sur les formationsles plus permeables (tandis que le statut des cuvettes argileuses etait ameliore par larehabilitation du reseau de drainage) ;
– la desaffectation progressive des puits traditionnels au profit des eaux de surface dans lespremieres phases du developpement de l’irrigation au Pakistan, favorisant la remonteede la nappe et le developpement de la salinite.
Dans un second groupe de situations, des deficiences en eau locales ou generalisees ont pro-gressivement conduit les agriculteurs a recourir aux eaux souterraines, non seulement pour lamobilisation de volumes d’eau supplementaires, mais aussi pour ameliorer la flexibilite de ladistribution de l’eau dans une logique de diversification des productions. Les qualites des eauxde surface et souterraines vont alors influencer fortement l’intensite et la nature des processusgeochimiques et, en consequence, les modalites de mise en valeur des terres. La salinisation dessols se manifeste rapidement mais les agriculteurs parviennent dans le meme temps a controlercet exces de sel par une conduite des irrigations et un choix de culture approprie ; ces processussont par ailleurs reversibles avec l’amelioration du lessivage. Les processus d’alcalinisation et desodisation se developpement plus progressivement et de maniere insidieuse dans la mesure oules manifestations sont peu visibles et qu’ils sont moins reversibles. Contrairement a certainesidees recues, la riziculture sous submersion et le drainage superficiel apparaissent comme unmoyen efficace de pallier ces contraintes, meme si elle favorise dans le meme temps une rechargeimportante de la nappe.
Si l’on peut relever le caractere durable des contraintes liees a la salinite, on pourra aussinoter que ces processus ne sont pas lineaires mais connaissent des ruptures, favorables oudefavorables, resultant de l’evolution des choix techniques. Dans l’espace, ils s’averent de pluscomme extremement heterogenes, les zones affectees etant souvent limitees a certaines situations(influence du type de sol, de la position dans le reseau hydraulique, ...) dans le perimetre et acertaines parties des parcelles de culture (influence de la topographie en irrigation gravitaire,...). Enfin, les dimensions spatiales et temporelles peuvent interagir a l’exemple de l’Office duNiger ou les zones d’accumulation de sels se sont reportees des cuvettes argileuses vers les leveessableuses suite a la rehabilitation des amenagements.
Au-dela de ces grands traits, l’impact reel de l’evolution des sols sur la productivite des systemesde culture est paradoxalement mal connu. Les concepts habituels permettant d’apprecier l’in-fluence de la salinite sur la reduction des rendements sont inoperants. Dans les faits les paysansadaptent leurs pratiques en matiere de choix de culture, de dose et frequence d’irrigation, ...pour minimiser les impacts defavorables. C’est donc davantage en terme de contraintes sur lefonctionnement du systeme et de cout de ces formes d’externalite qu’il conviendrait de raisonner
Theme 2 : Vers une gestion durable de l’irrigation : consequences sur les options de modernisation S. Marlet
Actes du Seminaire ”Modernisation de l’Agriculture Irriguee” 9
les contraintes liees a la salinite.
3.3 Le contexte actuel du decideur marque par un accroissement de la com-plexite
L’origine des grands systemes irrigues est souvent liee a une strategie coloniale de productionde matieres premieres agricoles. La culture du coton irrigue a ainsi ete promue pour les be-soins des industries textiles des pays du nord, et certains choix restent encore assujettis auxpolitiques macro-economiques et sectorielles des etats, a l’exemple de la betterave ou encoredu ble au Maroc. Le temps des politiques dirigistes en matiere d’assolement ou de gestion dessystemes de culture apparaıt cependant revolue dans la plupart des situations. Les choix tech-niques des agriculteurs resultent desormais principalement d’une analyse du contexte technico-economique. Les agriculteurs s’orientent de plus en plus souvent vers une diversification de leurssystemes de culture et des techniques de production, notamment en matiere de choix des asso-lements ou de reconversion des methodes d’irrigation gravitaire. L’allocation des ressources eneau et la prevention des impacts environnementaux de l’irrigation doivent desormais se raisonnerdans un contexte economique, social ou institutionnel marque par le desengagement de l’etat etl’emergence de nouveaux acteurs.
On constate dans le meme temps une forte interdependance entre les differents acteurs dans lesamenagements collectifs. Les pratiques des agriculteurs sont contraintes par un certain nombrede causes qui les depassent : amenagements anterieurs, modification des regles d’allocation del’eau par les gestionnaires en fonction de l’evolution de la ressource, contexte economique, ... Dememe, les gestionnaires doivent s’adapter aux strategies des agriculteurs et a leurs consequencessur la demande en eau dans des situations ou l’offre est de plus en plus souvent deficitaire. Dansun amenagement collectif concu pour l’organisation d’un “ tour d’eau ”, de quel autre choixdispose un agriculteur que creuser un forage pour augmenter la souplesse des arrosages ?
Les mesures prises en matiere de lutte contre la salinite par l’adaptation a la fois des choixtechniques des agriculteurs et des modalites de pilotage des systemes d’irrigation ont pu se revelerd’une certaine efficacite. Mais les situations considerees ne sont ni stationnaires, ni homogenes,et il convient de les amenager en permanence. De plus, les choix effectues peuvent conduire ades effets contradictoires, resolvant un probleme pour en creer de nouveaux. Ces evolutions sontdonc marquees par un accroissement de la complexite dans le fonctionnement et la gestion deces systemes irrigues.
3.4 Grille d’analyse pour l’aide a la reflexion et a la decision
Il decoule de cette complexite que toute amelioration des performances hydrauliques, agrono-miques et environnementales des systemes irrigues est rendue difficile sans la mise en œuvrede nouvelles demarches associant les differents acteurs et institutions concernees, et combinantle developpement d’outils d’evaluation des performances et d’aide a la gestion des systemesd’irrigation.
Les outils et methodes et leurs utilisateurs sont a definir en fonction des situations considerees,et restent pour une large part un domaine d’investigation pour la recherche. Cependant, noussuggerons d’insister sur :
La definition prealable des objectifs prioritaires et leur hierarchisation. Derriere cette evidencese cache en fait de grandes difficultes quant a la nature des criteres economiques, agronomiques,politiques, sociaux ou environnementaux a privilegier dans le contexte ;
La mise en œuvre de demarches participatives croisant les jugements des differents acteurs du
Theme 2 : Vers une gestion durable de l’irrigation : consequences sur les options de modernisation S. Marlet
Actes du Seminaire ”Modernisation de l’Agriculture Irriguee” 10
systeme sur chacune des etapes de la demarche ;
La prise en compte concomitante et coherente des differents domaines hydrauliques, agrono-miques, socio-economiques et environnementaux qui determinent les performances des systemesirrigues, que ce soit pour l’evaluation et la mise en œuvre de dispositifs de suivi, ou le developpementd’outils d’aide a la decision et de pilotage des systemes d’irrigation au profit des institutions encharge de leur gestion ; et :
La prise de conscience des problemes d’incertitude rencontres en raison de situations complexeset evolutives et du caractere forcement partiel et subjectif des criteres retenus pour le diagnosticet la decision. Plus specifiquement en matiere de salinisation et d’evolution de la fertilite des sols,il convient de noter qu’il se passe generalement quelques annees entre les causes et l’apparitiondes premiers symptomes, puis quelques annees supplementaires pour la mise en œuvre de mesurescorrectives et la resolution du probleme observe.
4 Conclusion
Les differents exemples presentes permettent de souligner les consequences des evolutions hy-drauliques et agricoles sur l’evolution de la salinite, et plus generalement les performances dessystemes irrigues. Des corrections et adaptations des methodes de pilotage et de gestion sontnecessaires mais les responsables ne disposent generalement pas des informations et outils per-mettant d’y parvenir. Cette situation est susceptible d’induire des delais importants pour l’iden-tification de solutions, et des couts considerables.
Les evolutions constatees sont la consequence d’une evolution des choix techniques en fonctiondu contexte et des contraintes imposees par l’environnement physique et socio-economique, maisaussi de l’inadaptation progressive des moyens utilises pour la gestion des systemes d’irrigation.A contrario, l’amelioration qui resulte de mesures correctives parfois tardives, souligne la capacited’un controle accru de la salinite par la mise en œuvre non seulement de moyens techniques,mais aussi de formes d’organisation plus appropriees.
Pour y remedier, la mise en œuvre d’approches integrees et demarches participatives sont unelement determinant de la modernisation des systemes irrigues dans un contexte de liberalisationdes choix techniques des agriculteurs, et donc de plus grande complexite du systeme. La hierarchisationdes objectifs, la mise en place de dispositifs perennes de suivi ou le developpement d’outils d’aidea la decision et de pilotage au profit des utilisateurs sont un ensemble d’enjeux indissociablespour une gestion plus reactive et efficace. Parmi les differents indicateurs consideres, ceux lies ala salinite des sols apparaissent comme des indicateurs synthetiques des performances globalesde ces systemes et de leur durabilite.
References
[1] BELLOUTI A., CHERKAOUI F., BENHIDA M., DEBBARH, A., SOUDI B., BADRAOUIM., 2003. Mise en place d’un systeme de suivi et de surveillance de la qualite des eauxsouterraines et des sols dans le perimetre irrigue du Tadla au Maroc. In S. Marlet, P. Ruelle(eds), Vers une maıtrise des impacts environnementaux de l’irrigation. Cederom du CIRAD,Montpellier, France
[2] DICKO M.K., MARLET S., VALLES V., NDIAYE M.K., CHEVASSUS-ROSSET C.,CONDOM N., 2002. Influence of biogeochemical mechanisms on soil alkalinity in flooded soil.In Transactions of 17th ISSS world congress, August 2002, Bangkok, Thailand. CDROM
Theme 2 : Vers une gestion durable de l’irrigation : consequences sur les options de modernisation S. Marlet
Actes du Seminaire ”Modernisation de l’Agriculture Irriguee” 11
[3] DEBBARH A., BADRAOUI M., 2003. Irrigation et environnement au Maroc : Situationactuelle et perspectives. In S. Marlet, P. Ruelle (eds), Vers une maıtrise des impacts envi-ronnementaux de l’irrigation. Cederom du CIRAD, Montpellier, France
[4] KUPER M., TONNEAU J.P., 2002. L’Office du Niger, grenier a riz du Mali. Montpellier,Ed. CIRAD/KARTHALA
[5] KUPER M, HABIB Z., 2003. Containing salinity through irrigation management : the caseof the Fordwah area in Pakistan. In S. Marlet, P. Ruelle (eds), Vers une maıtrise des impactsenvironnementaux de l’irrigation. Cederom du CIRAD, Montpellier, France
[6] MARLET S., NDIAYE M.K., 2002. La fertilite des sols. Des risques d’alcalinisation lies al’irrigation et aux pratiques de culture. In M. Kuper et J.P. Tonneau (eds). L’Office du Niger,grenier a riz du Mali. Ed. CIRAD/KARTHALA, 163-167
[7] MARLET S., RUELLE P., 2003. Vers une maıtrise des impacts environnementaux de l’irri-gation. Actes de l’atelier du PCSI, 29-29 mai 2002, Montpellier, France. Cederom du CIRAD,Montpellier, France.
[8] N’Diaye M.K., Marlet S. et Dicko M., 2003. Maıtrise de l’irrigation et du drainage en rizi-culture irriguee et desalcalinisation des sols a l’Office du Niger (Mali). Modele, hypotheseset arguments. In : S. Marlet, P. Ruelle (eds), 2003. Vers une maıtrise des impacts environne-mentaux de l’irrigation. Cederom du CIRAD, Montpellier, France (figure en page 4 au debutdu paragraphe 2.3)
[9] RUF T., 1995. Histoire hydraulique et agricole et lutte contre la salinisation dans le delta duNil. Secheresse, 6, 307-317.
[10] TANJI K.K., 1990. Nature and extent of agricultural salinity. In K.K. Tanji (ed.), Agricul-tural salinity assessment and management. New-York, ASCE, 1-17.
[11] ZIMMER D., 2003. Introduction du seminaire PCSI. In S. Marlet, P. Ruelle (eds), Vers unemaıtrise des impacts environnementaux de l’irrigation. Cederom du CIRAD, Montpellier,France
[12] Umali, D.L., 1993. Irrigation-Induced salinity. A growing problem for development and theenvironment. World Bank technical paper number 215, 78 p. (figure en introduction en hautde la page 2).
Theme 2 : Vers une gestion durable de l’irrigation : consequences sur les options de modernisation S. Marlet