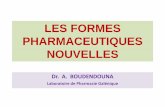Étude des processus cognitifs de construction et d’interprétation de combinaisons conceptuelles...
Transcript of Étude des processus cognitifs de construction et d’interprétation de combinaisons conceptuelles...
L’Année psychologiquehttp://www.necplus.eu/APY
Additional services for L’Année psychologique:
Email alerts: Click hereSubscriptions: Click hereCommercial reprints: Click hereTerms of use : Click here
Étude des processus cognitifs de construction et d’interprétation decombinaisons conceptuelles nouvelles
Sandra Jhean-Larose et Guy Denhière
L’Année psychologique / Volume 106 / Issue 02 / June 2006, pp 265 - 304DOI: 10.4074/S0003503306002053, Published online: 03 June 2009
Link to this article: http://www.necplus.eu/abstract_S0003503306002053
How to cite this article:Sandra Jhean-Larose et Guy Denhière (2006). Étude des processus cognitifs de construction et d’interprétation decombinaisons conceptuelles nouvelles. L’Année psychologique, 106, pp 265-304 doi:10.4074/S0003503306002053
Request Permissions : Click here
Downloaded from http://www.necplus.eu/APY, IP address: 193.51.85.60 on 01 Mar 2015
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
Étude des processus cognitifs de construction et d’interprétation de combinaisons
conceptuelles nouvelles
Sandra Jhean-Larose*
1
et Guy Denhière
2
1
I.U.F.M. de Paris, Université de Paris 8
2
Laboratoire de Psychologie Cognitive, UMR 6146 CNRS, Université de Provence
RÉSUMÉ
Dans cet article, nous présentons et nous discutons les principaux modèlesexplicatifs de l’interprétation de combinaisons conceptuelles « Adjectif-
Nom » («
grive rocheuse
») et « Nom-Nom »
(« cheval zèbre », « chaise lit »
)proposés ces dernières années. S’ils postulent tous que l’interprétation d’unecombinaison conceptuelle implique la mise en relation de ses constituants(Modificateur et Nom Principal), ces modèles se distinguent par la naturedes processus invoqués pour établir cette relation et par le rôle joué par lesconnaissances du monde. La première catégorie (Gagné et Shoben, 1997,Gagné, 2000, 2001) suppose que le Modificateur et le Nom Principal sontliés par un ensemble limité de relations thématiques. La seconde catégorieinvoque la notion de schéma et ses propriétés structurales et fonctionnellespour rendre compte de l’élaboration de la signification (Smith, Osherson,Rips and Keane, 1988 ; Murphy, 1988). Au sein de cette dernière, lesmodèles du « double processus » de Wisniewski (1997, 2001) et de « lacombinaison conceptuelle guidée par la satisfaction de contraintes » deCostello et Keane (2000, 2001) visent à rendre compte d’une part, del’ensemble des interprétations en termes de relation, de propriété oud’hybridation entre les composants de la combinaison et, d’autre part, durôle joué par les connaissances sur les processus d’interprétation.
Cognitive processes in new conceptual combinations interpretation
ABSTRACT
This paper describes and discusses recent theories of conceptual combination made up of aModifier (adjective or noun) and a head noun. If all models assume that the interpretationof a conceptual combination implies that a relation is established between the Modifier and
*I.U.F.M. de Paris, 10, Rue Molitor, 75016 Paris, Université de Paris 8, E.A. 4004 « Cognition & Usages ». [email protected]
266
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
the Head Noun to create a new concept, they differ by the kind of link and process impliedto create this connexion between the two concepts. The first category of models (Gagné etShoben, 1997) assume that the world knwledge concerning the relations that are typicallyused with the Modifier concept is brought to bear immediately as part of the interpretationprocess (Gagné, 2000, 2001). The second category puts forward the notion of schema withits structural and functional properties to determine the meaning of combined concepts(Smith, Osherson, Rips and Keane, 1988 ; Murphy, 1988). Among this category, the « DualProcess » model (Wisniewski (1997, 2001) and the « Constraint-Guided Conceptual Combi-nation Model » (Costello et Keane, 2000, 2001) first try to take into account the differenttypes of interpretation : relational, transfert of property and hybrid, and secondly to describehow and when world knowledge influences conceptual combination.
Tout à coup, une armée de monstres m’oppressait. Ils naissaient plus hideux les uns queles autres. Comme surgis de la terre de ma peur. L’homme aux ailes de pie. La grenouillecouronnée. La souris aux mains de vieille femme. La taupe aux yeux émeraude. Le cerfaux pattes d’oiseau. Le chien au visage d’ogre. Le crapaud bavant du poison. La brebisau sexe de vierge. L’écureuil droséra. La sangsue saponaire. L’épervier épinoche. La buse,tête-de-chardon. L’étourneau fibule. L’araignée grand-chêne. Le frelon amanite. L’agneausalamandre. La gerboise à queue précaire. Le pélican pastèque. Le congre coquelicot. Leloup aux pinces de crabe. Le putois buisson. Le grillon polypore. Le lombric au busted’enfant. La caille aux dents de brochet. La belette épineuse. Le cygne cymbalaire. Lacarpe capucine. Le dindon dragonnier. Le hérisson vautour. La lamproie florescente. Lechat trilobite. La guêpe phacochère. Le bélier baudroie. Le héron talitre. Le capricorne àbec-de-canard. La pintade pissenlit. La grive rocheuse. La tanche scarabée. Le scorpionsanglier. La murène sauterelle. Le daim dactyle. Le hibou planorbe. L’ange aux pieds dechèvre. Et d’autres démons encore que je ne parviens même pas à décrire.Dominique Sampiero, Le dragon et la ramure (pp. 23-24), 1998, Éditions Verdier, 11220Lagrasse.
Les recherches sur le traitement des aspects sémantiques du langage ontconnu un développement considérable au cours de ces dernières décen-nies (Kintsch et van Dijk, 1978 ; Miller et Kintsch, 1980 ; Anderson,1983 ; Le Ny, 1979, 1980, 1989 ; Denhière et Baudet, 1992). Qu’il s’agissede la production ou de la compréhension du langage, la capacité à traiterles différentes formes de combinaison conceptuelle, notamment lesformes « Modificateur-Nom » : « Adjectif-Nom » ou « Nom-Nom »,apparaît capitale. Alors que la production du langage exige en effet decombiner des catégories lexicales et conceptuelles de façon telle que lesrègles syntaxiques et sémantiques d’usage de la langue soient respectées, lacompréhension implique que les concepts activés en mémoire au fur et àmesure de la lecture ou de l’audition d’une phrase soient organisés en unestructure cohérente et interprétable. Ainsi envisgée, la notion de combi-naison conceptuelle réfère à une phrase elliptique qui comporte deuxconstituants ; un premier, nom ou adjectif, qui est désigné par le terme demodificateur (
Md
, dans la suite) et qui est supposé influer sur
l’interpré-tation sémantique d’un second, toujours un nom, qualifié de nom
Combinaisons conceptuelles nouvelles
267
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
principal (
NP
, dans la suite) (Murphy, 2002). C’est le cas d’expressionscourantes comme « opération vérité », « micro trottoir », « Paris Plage »,« musicien danseur », « couple amorce », « combinaison cible », etc. Lescombinaisons conceptuelles doivent être distinguées des noms composésqui sont formés de plusieurs mots (« chef-lieu, arc-en-ciel, monte-charge,chauffe-plat », etc.), qui réfèrent à un objet unique, et qui sont répertoriésdans les dictionnaires et constituent une entrée dans le lexique mental.Dans la mesure où l’intégralité des travaux expérimentaux que nous rap-portons ont été réalisés en langue anglaise, il convient de noter dèsmaintenant que la position du modificateur dans les couples adjectif –nom correspond aux règles syntaxiques d’usage de la langue anglaise etnon à celle de la langue française. Ce point sera envisagé quand nous dis-cuterons du degré de généralité à accorder aux résultats obtenus.Envisagé sous l’angle de la psychologie cognitive, le problème posé parl’interprétation d’une combinaison conceptuelle réside dans l’identifica-tion des processus qui président à la construction d’une signification duconcept complexe à partir de la présentation des constituants. Pour tenterde faciliter la résolution de ce problème, il est utile d’examiner cequ’apportent les combinaisons conceptuelles. Trois cas sont généralementdistingués (Downing, 1977). Premièrement, les combinaisons concep-tuelles sont souvent utilisées à la manière des anaphores comme référentd’un autre concept, cité antérieurement dans le discours. Ainsi, aprèsavoir décrit le premier homme à avoir reçu un cœur artificiel, « BarneyClark », le locuteur évoquera le « Heart Man » pour désigner cet homme(Gerrig & Murphy, 1992). Deuxièmement, les combinaisons concep-tuelles apportent des informations concises et pertinentes, ainsi « footballparking » désigne une aire où l’on peut garer sa voiture pendant la duréed’un match de football (Wisniewski, 1997). Troisièmement, une combi-naison conceptuelle est créée pour désigner une catégorie nouvelled’objets. « Fish Sandwich » (« sandwich au poisson ») désigne une caté-gorie nouvelle de sandwichs, différant des autres notamment par sacomposition, son temps de préparation, son goût. Cette différence estdéterminée par le nom ou l’adjectif modificateur situé en position initialede la combinaison. En dépit de ces nouvelles caractéristiques, le référentde la combinaison conceptuelle conserve un certain nombre de traitssémantiques qu’il partage avec le nom principal.Sur le plan empirique, la manière de déterminer la signification résultantde la présentation de combinaisons conceptuelles nouvelles consiste àexaminer les interprétations qui leur sont attribuées par des individus, lecaractère nouveau des combinaisons étant défini par le fait que cescombinaisons ne correspondent pas à des entrées lexicales du dictionnaire
268
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
et que les participants ne les ont jamais lues ou entendues auparavant(Wisniewski & Gentner, 1991 ; Wisniewski & Markman, 1993 ; Wis-niewski, 1996 ; Markman & Wisniewski, 1997 ; Wisniewski & Love,1998).Dans cet article, nous nous proposons de passer en revue les principauxmodèles explicatifs de l’interprétation de combinaisons conceptuelles dutype « Modificateur-Nom Principal », « Adjectif – Nom » et « Nom –Nom », proposés ces dernières années
1
. Bien que ces modèles postulenttous que l’interprétation d’une combinaison conceptuelle implique l’exis-tence d’une relation entre les référents de ses constituants, ils peuvent êtreregroupés en deux catégories principales selon la nature des processus quiprésident à l’établissement de cette relation et le degré supposé deconstruction des concepts et des relations susceptibles d’être activés. Lapremière catégorie, inspirée de la linguistique (Levi, 1978), suppose queles concepts constituants d’une combinaison sont liés par un ensemblelimité de relations thématiques. Elle est représentée par le modèle CARIN(Competition Among relations In Nominals) proposé par Gagné &Shoben (1997) et Gagné (2002). La seconde catégorie invoque la notionde schéma avec ses propriétés structurales et fonctionnelles pour rendrecompte de la création de la signification. Alors que le modèle SMM(« Selective Modification Model ») formulé par Smith, Osherson, Rips &Keane (1988) ne traite que des combinaisons « Adjectif - Nom », lemodèle CSM (« Concept Specialization Model ») proposé par Murphy(1988, 1990) s’étend aux combinaisons « Nom - Nom ». Ces modèles, quiutilisent exclusivement le processus d’instanciation de schémas, ne per-mettent de rendre compte que d’une catégorie d’interprétations, celle quirenvoie à l’établissement d’une relation sémantique entre le modificateuret le nom principal. Les modèles proposés ultérieurement, qu’il s’agissedu modèle du « Double processus » (« Dual Process ») de Wisniewski(1996, 1997, 2001) ou du modèle C3 de « la combinaison conceptuelleguidée par la satisfaction de contraintes » (« Constraint-Guided Concep-tual Combination Model ») de Costello et Keane (2000, 2001) nesouffrent pas des mêmes limites : ils visent à rendre compte d’une part,des interprétations en termes d’établissement de relation, de transfert depropriété ou d’hybridation entre les deux termes des combinaisons et
1
Nous excluons de notre revue les recherches qui portent sur la formation des concepts conjonctifs du type « UnX qui est aussi un Y » (« un jeu qui est aussi un sport ») qui relèvent davantage de l’élaboration d’une théorie desconcepts et de la typicalité (voir Hampton, 1987, 1988, 1995) que de l’étude de l’interprétation des combinai-sions conceptuelles du type « Modificateur-Nom Principal ». De plus, ces combinaisons hybrides formées par lesconcepts conjonctifs ne représentent qu’environ 10% des combinaisons rencontrées dans la langue anglaise (voirMurphy, 2002, p. 464).
Combinaisons conceptuelles nouvelles
269
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
d’autre part, du rôle joué par les connaissances dans le processusd’interprétation.Le plan que nous suivrons consistera à présenter dans un premier tempsle modèle CARIN, inspiré de la linguistique, puis suivant une démarchequi va du spécifique au général, nous exposerons les modèles SMM(Smith, Osherson, Rips & Keane, 1988) et CSM (Murphy, 1988, 1990),avant d’aborder les modèles plus généraux du « Double processus » (Wis-niewski, 1996, 1997, 2001) et le modèle C3 (Costello & Keane, 2000,2001). Nous conclurons ensuite en discutant des avantages respectifs deces modèles, de leur portée explicative et des contraintes spécifiques liéesà la langue française, comparée à la langue anglaise.
1. UN MODÈLE UTILISANT UN ENSEMBLE LIMITÉ DE RELATIONS SÉMANTIQUES
ENTRE LE MODIFICATEUR ET LE NOM PRINCIPAL : LE MODÈLE CARIN
(GAGNÉ ET SHOBEN, 1997 ; GAGNÉ, 2002)
1.1. Caractéristiques principales du modèle CARIN
Gagné et Shoben (1997), se référant à Gleitman & Gleitman (1970),Kay & Zimmer (1976), supposent que : (i) les rapports susceptibles d’êtreétablis entre deux concepts nominaux peuvent être décrits par un nombrelimité de relations sémantiques comme le propose la taxonomie de 16relations proposée par Levi (1978) : localisation, cause, à propos de,matière, ressembler à, etc., et que (ii) les individus utilisent ces relationspour interpréter les combinaisons nouvelles proposées. Le modèleCARIN, qui accorde donc une large place au processus de sélection d’unerelation entre les constituants de la combinaison conceptuelle, postule enoutre que la représentation du concept modificateur (Md) qui est activéecomporte l’ensemble des relations susceptibles d’impliquer ce dernier.CARIN suppose en effet que « l’histoire combinatoire » d’un nom utilisécomme Modificateur (Md), les traitements antérieurs dont ce mot a faitl’objet, influencent son interprétation dans une combinaison conceptuellenouvelle et que les connaissances sur ce Nom - Modificateur (Md) inter-viennent dans l’interprétation d’une combinaison nouvelle. La facilitéd’interprétation d’une combinaison nouvelle (Md-NP) est déterminéepar la disponibilité en mémoire de la relation pertinente. Par exemple,
270
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
dans le cas où « Mountain » (« Montagne ») est posé comme modificateurdans des combinaisons comme « Mountain Stream » (« Ruisseau Mon-tagne »), « Mountain Goat » (« Chèvre Montagne ») ou « MountainCloud » (« Nuage Montagne »), la relation qui est la plus fréquemmentretenue pour interpréter ces combinaisons est celle de « localisation ». Larelation « à propos de », activée pour interpréter la combinaison « Moun-tain Magazine » (« Magasine Montagne »), est beaucoup moinsfréquemment associée à « Mountain » que la relation « localisation ».Cette connaissance relative à l’utilisation pertinente d’une relation pourun concept donné, qualifiée de « distribution relationnelle » par Gagné etShoben (1997), reflète l’expérience acquise à propos des combinaisonsconceptuelles. Comparée à celle du Nom - Modificateur (Md), l’histoirecombinatoire du Nom - Principal (NP) exerce une influence moindre surl’interprétation d’une combinaison conceptuelle nouvelle.Les résultats de deux expérimentations sont en accord avec cette hypo-thèse. Une première expérience (Gagné et Shoben, 1997) a mis enévidence que le temps mis pour juger la plausibilité d’une interprétationvariait en fonction de la fréquence relative des relations thématiques asso-ciées au modificateur et non en fonction de celle du nom principal.Autrement dit, les combinaisons pour lesquelles la relation utilisée pourle modificateur est très fréquente : par exemple, localisation dans« Mountain Stream », (« Ruisseau Montagne »), « Mountain Goat »(« Chèvre Montagne »), « Mountain Cloud » (« Nuage Montagne »), sontplus facilement interprétées que celles pour lesquelles la relation est peufréquente : relation « à propos de » pour « Mountain Magazine »(« Magasine Montagne »), par exemple. Une seconde expérience réaliséepar Gagné (2001) a également montré que des combinaisons - cibles sontplus facilement interprétées quand elles sont précédées par des combinai-sons - amorces dans lesquelles le modificateur et la relation Md-NP sontidentiques. Ce résultat suggère que l’augmentation de la disponibilitéd’une relation facilite l’interprétation d’une combinaison nouvelle et quela pré-activation d’un modificateur augmente la disponibilité d’unerelation.Ces résultats ont conduit Gagné (2002) à développer le modèle CARIN enprécisant le rôle de l’information lexicale et conceptuelle dans l’interpré-tation des combinaisons conceptuelles nouvelles. Au préalable, elle établitune distinction entre « lexème composé » et « combinaison conceptuellenouvelle » et elle suggère l’existence d’un continuum allant des combinai-sons hautement familières : « Stop Sign » (« Signal Stop »), « SaladDressing » (« Sauce salade »), aux combinaisons nouvelles : « ChocolateTwig » (« Brindille Chocolat »), « Sand Pie » (« Tourte Sable ») ; l’expé-
Combinaisons conceptuelles nouvelles
271
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
rience passée des participants exerçant un effet sur l’interprétation descombinaisons nouvelles. Cette expérience préalable est supposée agir surl’interprétation des combinaisons en exerçant un effet sur la disponibilitédes items lexicaux en mémoire et, par voie de conséquence, en facilitantla sélection d’une interprétation particulière.
Ainsi, si l’on considère lecouple : « decomposing compounds », un linguiste favorisera l’interpréta-tion « mot composé » alors qu’un chimiste privilégiera l’interprétation« composé chimique ».
1.2. Validations expérimentales
Afin de déterminer la manière dont les informations lexicales et concep-tuelles interviennent au cours du processus d’interprétation decombinaisons conceptuelles nouvelles, Gagné manipule expérimentale-ment la disponibilité lexicale et la disponibilité relationnelle en utilisantun paradigme d’amorçage (Meyer et Schvaneveldt, 1971 ; Fischler, 1977 ;Neely, 1977, 1991 ; Neely et Keefe, 1989 ; Roediger et Challis, 1992).Reprenant la distinction entre amorçage sémantique et amorçage rela-tionnel, Gagné considère que l’amorçage sémantique rend compte del’accessibilité en mémoire du modificateur et du nom principal alors quel’amorçage relationnel renvoie à la compréhension des processus de sélec-tion d’une relation et de combinaison des concepts. Appliquée auxcombinaisons conceptuelles, la procédure d’amorçage sémantique d’une
combinaison-cible
(Md-NP) par une
combinaison-amorce
(Md-NP)conduit à prédire que le temps de réaction à la
combinaison-cible
varieraen fonction de la force de la relation sémantique entre les deux combinai-sons. L’identification d’une
combinaison-cible
reliée sera facilitée et sontemps d’interprétation (TR) sera plus court du fait de la plus grandequantité d’activation lexicale. En effet, Gagné postule que si l’entrée lexi-cale des mots sémantiquement reliés est activée, alors la présentationd’une
combinaison-amorce
contenant un mot sémantiquement relié à l’undes constituants de la
combinaison-cible
augmentera la disponibilité de cemême mot au niveau de la cible. Afin de tester cette hypothèse, Gagné(2002) réalise deux expérimentations dans lesquelles elle manipule lasimilarité sémantique entre les noms principaux des
combinaisons-amorces
et des
combinaisons-cibles
(expérience 1) ainsi qu’entre les modi-ficateurs de ces mêmes combinaisons (expérience 2).Dans la première expérience, le matériel se compose de 60 combinaisonsextraites du corpus de Gagné & Shoben (1997). Chaque combinaisonpossède une interprétation littérale et la fréquence de la relation entre sescomposants, envisagée dans les sens Md-NP et NP-Md, est dichotomisée
272
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
en élevée ou faible. Selon le principe de la distribution relationnelleévoqué plus haut, les combinaisons se répartissent en quatre catégo-ries définies par le croisement des facteurs Fréquence de la relation(faible vs élevée) et sens de la relation (Md vers NP vs NP vers Md).Trois types de
combinaisons-amorces
ont été construites pour chaque
combinaison-cible
. Deux d’entre elles ont leur nom principal (NP)sémantiquement similaire au nom principal (NP) de la
combinaison-cible
. Pour l’une des deux, la relation qui lie les deux constituants estidentique (exemple : « Surgery Remedy ») à celle qui lie les constituantsde la
combinaison-cible
(« Oil Treatment ») alors que pour l’autre, larelation est différente (« Disease Remedy »). Le troisième type de
combi-naison-amorce
(« Alligator Leather ») renvoie à une condition neutre oùles deux constituants de la combinaison ne sont pas reliés sémantique-ment à la cible.Gagné (2002) prédit un amorçage sémantique qui se traduira par destemps de réponse significativement plus courts dans les deux conditionsoù les noms principaux des combinaisons amorces et cibles sont séman-tiquement similaires, comparées à la condition neutre. Cette facilitations’explique par le fait que l’entrée lexicale du nom principal est rendueplus disponible par l’amorçage sémantique dans les deux conditionsRelation. Gagné prédit également une absence d’effet d’amorçage rela-tionnel puisque la disponibilité d’une relation n’est pas affectée par lenom principal. En accord avec les prédictions, les résultats indiquent uneffet d’amorçage sémantique et une absence d’effet d’amorçagerelationnel.Dans la seconde expérimentation, Gagné déplace la similarité sémantiquedu nom principal (NP) au modificateur (Md) des combinaisons concep-tuelles amorces et cibles. Deux types de
combinaisons-amorces
ont leurmodificateur sémantiquement similaire avec celui de la
combinaison-cible
.Dans l’une des deux conditions, la relation qui lie les deux constituantsest identique à celle qui lie les constituants de la cible alors que dansl’autre, la relation est différente. Un troisième type de
combinaisons-amorces
(condition neutre) dans lequel le modificateur et le nom prin-cipal ne sont pas sémantiquement reliés à ceux de la
combinaison-cible
estconstruit. Comme pour l’expérience 1, Gagné prédit un effet d’amorçagesémantique et, contrairement à l’expérience précédente, un effet d’amor-çage relationnel parce que les
combinaisons-amorces
et les
combinaisons-cibles
partagent des modificateurs similaires. Les résultats sont en accordavec ces prédictions : un effet d’amorçage sémantique et un effet d’amor-çage relationnel sont obtenus.
Combinaisons conceptuelles nouvelles
273
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
Les résultats des deux expériences rapportées indiquent que la disponibi-lité lexicale et relationnelle peuvent toutes deux faciliter l’activitéd’interprétation de combinaisons conceptuelles nouvelles. Dans les deuxexpérimentations, les
combinaisons-cibles
sont plus facilement interprétéeslorsqu’elles sont précédées par une
combinaison-amorce
dans laquelle l’undes constituants est proche sémantiquement de l’un des constituants de lacible que lorsque l’amorce est non reliée à la cible. Dans l’expérience 2,l’interprétation d’une
combinaison-cible
est davantage facilitée lorsque lecouple-amorce comprend le même modificateur et la même relationsémantique que le couple-cible que lorsqu’elle comprend le même modi-ficateur et une relation différente. Ces résultats indiquent que : (i) lemodificateur et le nom principal n’exercent pas les mêmes effets surl’accès à l’information relationnelle et que (ii) la disponibilité d’une rela-tion est sensible aux caractéristiques des utilisations antérieures dumodificateur mais non du nom principal.Comme nous l’avons signalé plus haut, la large place faite à la disponibi-lité des relations Md-NP pour rendre compte de l’interprétation descombinaisons conceptuelles nouvelles est une des propriétés du modèleCARIN. Cette disponibilité est déterminée par le modificateur. Selon lesauteurs du modèle, la représentation du concept modificateur inclut lesconnaissances relatives aux relations dans lesquelles il est le plus fréquem-ment inséré ; la facilité avec laquelle une combinaison est interprétée varieen fonction de la disponibilité de la relation pertinente. Au cours del’interprétation d’une combinaison conceptuelle nouvelle, plusieurs rela-tions entrent en compétition. Plus une relation relève du modificateurconcerné, plus sa disponibilité s’accroît et plus sa probabilité d’être sélec-tionnée augmente. Le nom principal n’est pas impliqué dans la sélectioninitiale d’une relation. Le modificateur « suggère » des relations et le choixse fait par la suite en fonction du nom principal.
1.3. Limites du modèle CARIN
Si les résultats des deux expériences rapportées sont compatibles avec lemodèle proposé, certaines limites demeurent. La version initiale deCARIN pose que (i) la distribution relationnelle du modificateur est lepremier facteur à exercer un effet sur la sélection d’une relation et que (ii)chaque modificateur possède sa propre distribution relationnelle. Lesrésultats de Gagné (2002) qui indiquent qu’une combinaison amorceexerce un effet sur la sélection d’une relation dans le cas où le modifica-teur de la
combinaison-amorce
est identique à celui de la
combinaison-cible
sont en accord avec ces hypothèses. Cependant, comme nous le verrons
274
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
par la suite, des résultats expérimentaux indiquent que l’information rela-tionnelle associée à un modificateur n’est pas le seul facteur à exercer uneffet sur la sélection d’une relation au cours de l’interprétation d’unecombinaison nouvelle. De plus, le modèle ne propose pas une définitionclaire des concepts de distribution relationnelle du modificateur et desimilarité sémantique des modificateurs communs à différentes combi-naisons. Ces deux facteurs renvoient à des sources d’informationassociées à deux processus différents. Le premier d’entre eux renvoie àl’accès à la distribution relationnelle du modificateur et à la sélection de larelation la plus fréquemment utilisée avec ce concept. Ce processus prenden compte la fréquence absolue de chaque relation. Le second processusconsiste dans l’activation de l’ensemble des combinaisons antérieurementrencontrées qui partagent un modificateur similaire.Pour conclure, Gagné (2002) suggère la possibilité de l’existence de deuxvoies possibles de sélection d’une relation sémantique lors de l’interpréta-tion de combinaisons conceptuelles nouvelles. Une première voieutiliserait le processus algorithmique de liaison des deux constituants dela combinaison sur la base de la distribution relationnelle du modificateurtel qu’il a été mis en évidence expérimentalement. Une seconde voiereposerait sur le recouvrement en mémoire de combinaisons concep-tuelles antérieurement traitées, recouvrement qui serait rendu possible,par exemple, par une organisation des connaissances en mémoire sousforme de schémas.Ce mode d’organisation de la mémoire sémantique est postulé par lafamille des modèles d’interprétation des combinaisons conceptuellesque nous allons maintenant aborder. Nous décrirons cette classe demodèles en allant des plus spécifiques avec le modèle SMM de « Modi-fication sélective » (« Selective Modification Model ») de Smith,Osherson, Rips & Keane (1988) et le modèle CSM de « spécialisationconceptuelle » (« Concept Specialization Model ») de Murphy (1990)aux plus généraux avec le modèle du « Double processus » (« Dual Pro-cess » ) de Wisniewski (1996, 1997, 2002) et le modèle C3 de« combinaison conceptuelle guidée par la satisfaction de contraintes »(« Constraint-Guided Conceptual Combination Model ») de Costello &Keane (2000, 2001). Dans ce cadre, un concept est envisagé comme unschéma, un cadre (« frame ») qui représente les connaissances mini-males dont nous disposons à propos d’un endroit, d’un événement oud’un objet. Ces connaissances ont été acquises au fil de nos expériencespersonnelles et de nos apprentissages. Les schémas s’organisent en attri-buts instanciés par des valeurs typiques ou attribuées par défaut(Minsky, 1975 ; Rumelhart, 1980).
Combinaisons conceptuelles nouvelles
275
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
2. LES MODÈLES RECOURANT À LA NOTION DE SCHÉMA
2.1. Le modèle SMM de Modification Sélective (Smith, Osherson, Rips & Keane, 1988)
2.1.1. Caractéristiques principales du modèle
Ce modèle, décrit pour la première fois par Smith & Osherson (1984), neporte que sur les combinaisons conceptuelles du type « Adjectif-Nom ».Ce modèle postule que le processus de combinaison conceptuelle« Adjectif-Nom » s’explique par les effets de typicalité. Par exemple, sil’on prend la combinaison conceptuelle « Pet Fish », à quoi peut bien ren-voyer un « Pet Fish » typique ? Classiquement, la réponse à cette questionest recherchée dans l’analyse en extension des concepts « pet » et « fish »,c’est-à-dire dans l’étude de l’ensemble des objets auxquels réfèrent cesconcepts. De façon générale, l’interprétation finale de la combinaisonconceptuelle « Adjectif-Nom » de type « XY » se décrira par « X ^ Y »,c’est-à-dire « quelque chose qui est à la fois X et Y » (Osherson et Smith,1981).
2.1.2. Validations expérimentales du modèle
Ce modèle repose sur une première série de résultats expérimentaux quiont conduit Smith et Osherson (1984) à poser l’existence de ce qu’ilsappellent « l’effet de conjonction » : quand un item est décrit par unecombinaison conceptuelle, il devient plus typique de cette dernière quede ses constituants pris isolément. Cet effet peut être illustré parl’exemple expérimental relatif à la combinaison conceptuelle « RedApple » (« Pomme Rouge ») que nous empruntons à Smith & Osherson(1984). À la présentation d’une image représentant une pomme rouge,les participants la jugent comme hautement caractéristique d’unepomme (7,81 sur une échelle de typicalité allant de 0 à 10) et d’unechose rouge (8,5). Cependant, ils jugent cette image comme étantencore plus typique de la catégorie « Red Apple » (8,87). Cet effet estdavantage marqué lorsque la combinaison conceptuelle n’est pastypique de la catégorie d’appartenance du nom principal. Ainsi, pour lacombinaison « Brown Apple » (« Pomme Marron »), son image serajugée typique des choses « marron » (6,93), peu typique de la catégorie« pomme » (3,54) mais hautement typique des « pommes marron »(8,52).
276
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
Comment expliquer qu’un trait sémantique peu typique d’une catégoriedevienne hautement typique d’une sous-catégorie ? Smith et al. (1988)postulent que les concepts s’organisent en structures conceptuelles sché-matiques (voir le tableau I ci-dessous). Un schéma comporte une sériede dimensions (ou attributs) et de valeurs (ou traits) associés à chaquedimension. Dans l’exemple ci-dessus, le concept « Pomme » est notam-ment caractérisé par les attributs « couleur », « forme », « texture », etc.Cette structure schématique constitue une représentation synthétique dela catégorie des pommes. Cette représentation en termes de structureconceptuelle ne se limite pas à une simple liste de traits définitoires etpermet de rendre compte des propriétés et des relations existant entreces différents traits. Bien que les pommes puissent être rondes, vertes,marrons, acides, sucrées, rouges, certaines de ces propriétés sont exclu-sives : vert / rouge / marron ; sucré / acide, par exemple. Une tellestructuration du concept de « pomme » fait apparaître les relations pos-sibles entre ses différentes dimensions. Chaque attribut renvoie à uneliste de valeurs possibles auxquelles sont associées des valeurs de typica-lité (valeur maximale de 30). À chaque attribut est associée une valeur dediscrimination (à gauche dans le tableau). Si un attribut est importantpour un concept donné, c’est-à-dire si cet attribut est pertinent etpermet de distinguer ce concept d’un autre concept, alors sa valeur dediscrimination sera élevée. Dans l’exemple « pomme » ci-dessus,l’attribut « Couleur » est plus discriminant que les attributs « Forme » et« Goût ».Smith et al. (1988) supposent que cette décomposition permet derendre compte des changements conceptuels opérés au cours de l’inter-prétation d’une combinaison conceptuelle adjectif-nom. Considérons lacombinaison « Pomme rouge », le fait de spécifier l’attribut couleuraura deux conséquences importantes sur le traitement et sur l’interpré-tation résultante. Premièrement, les poids
attribués à l’attribut« Couleur » vont se porter sur la valeur « Rouge ». Deuxièmement, lavaleur de discrimination de l’attribut « Couleur » va augmenter. Autre-ment dit, l’attribut « couleur » est plus pertinent pour la combinaison« Pomme rouge » que pour la combinaison « Pomme lisse ». Cette façond’appréhender le changement conceptuel permet de rendre compte del’effet de conjonction. En conclusion, le modèle SMM de « Modificationsélective » de Smith et al. (1988)
permet d’apporter une première des-cription du processus d’interprétation. Dans une combinaisonconceptuelle « adjectif-nom », l’adjectif augmente les poids associés à lavaleur de typicalité à laquelle il réfère et il augmente la discriminationde l’attribut concerné.
Combinaisons conceptuelles nouvelles
277
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
2.1.3. Limites du modèle
L’analyse extensionnelle impliquée par le modèle SMM ne s’appliquequ’aux adjectifs dont l’interprétation peut se faire indépendamment dunom auquel ils sont associés dans la combinaison. Or, nombreux sont lescas où la signification attribuée à l’adjectif est dépendante du nom auquelil est associé dans la combinaison. Ainsi, dans l’exemple « Gros papillon »,l’interprétation de cette combinaison ne renvoie pas à « ensemble desgrosses choses » ^ « ensemble des papillons » (il est même fort probableque cette intersection soit vide !). Un « gros papillon » est « un papillon
Tableau I. Exemple de structures conceptuelles relatives au concept « Pomme » et à la combinaison conceptuelle
« Pomme rouge » (Smith et al., 1988).
POMME POMME ROUGE
Attribut Couleur : 1 Attribut Couleur : 4
Rouge 25 Rouge 30
Vert 5 Vert
Marron Marron
… …
Attribut Forme : .50 Attribut Forme : .50
Rond 15 Rond 15
Carré Carré
Cylindrique 5 Cylindrique 5
… …
Attribut Texture : .25 Attribut Texture : .25
Lisse 25 Lisse 25
Rugueux 5 Rugueux 5
Bosselé 5 Bosselé 5
… …
Légende : dans chaque colonne, les attributs (couleur, forme, texture) sont écrits en gras. Les chiffres écrits à droite des attributs indiquent leur valeur de discrimination ; les chiffres écrits à droite de la valeur des attri-buts (rouge, vert, marron) indiquent leur valeur de typicalité.
278
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
relativement gros, comparativement aux autres papillons ». De même, lesadjectifs non prédicatifs, qui ne jouent pas le rôle de prédicat dans unestructure propositionnelle, ne peuvent être traités correctement parl’approche extensionnelle. L’interprétation « ingénieur atomique » pour« quelqu’un qui travaille dans le domaine de l’énergie atomique » ne peutêtre décrit comme la résultante de « ensemble des ingénieurs » ^ « chosesatomiques ». Enfin, cette approche conduit à prédire que les combinai-sons conceptuelles « Nom (X) – Nom (Y) » sont symétriques puisqueX^Y = Y^X. Or, il s’avère que l’interprétation d’une combinaison « XY »diffère de celle de « YX ». « Desk lamp » est « une sorte de lampe debureau » alors que « Lamp Desk » réfère « à un type de bureauparticulier ».Une approche extensionnelle de la question initialement posée à proposde « pet fish » amènerait à conclure que la solution est à rechercher ducôté de l’intersection « Animal domestique typique » ^ « Poissontypique ». Or, expérimentalement, les réponses les plus fréquemmentproduites par les sujets : « poisson rouge » et « guppy » – peu typiquesdes animaux domestiques et atypiques de la catégorie « poissons » – nevalident pas cette hypothèse. Autrement dit, la typicalité d’une combi-naison conceptuelle n’est pas fonction de la typicalité de sesconstituants.De plus, l’explication des effets de conjonction avancée par Smith et al.(1988) a entraîné toute une série de critiques relatives à ce modèle, lesplus vives portant sur la question de la modification conceptuelle.Ce processus semble être beaucoup plus complexe que ce que Smith et al.(1988) laissent entendre. En effet, il arrive fréquemment que, dans unecombinaison conceptuelle, un adjectif ne renvoie pas à une uniquedimension susceptible d’être modifiée au cours de l’interprétation. Ladimension en question se trouve très souvent en relation avec le nomprincipal de la combinaison. Par exemple, l’adjectif modificateur « corpo-rate » ne s’applique pas aux mêmes dimensions selon le nom principalauquel il est associé : ainsi, dans « Corporate Car », « corporate » portesur la dimension « Appartenance », alors que dans la combinaison « Cor-porate building », ce même adjectif renvoie à la dimension« Localisation » (Murphy, 1988). Pour interpréter ce type de combinai-sons, il est nécessaire de sélectionner le trait du modificateur le pluspertinent pour l’appliquer au nom principal. La dimension à modifierdépend de l’interaction Modificateur * Nom principal.Medin & Shoben (1988) énoncent une autre limite du modèle SMM.Cette limite repose sur le constat selon lequel, dans une combinaisonconceptuelle nouvelle, il est très fréquent que le modificateur change
Combinaisons conceptuelles nouvelles
279
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
simultanément plusieurs dimensions du nom principal. Ces auteursconstruisent quatre types de combinaisons conceptuelles « adjectif-nom » : CC1 (« light-colored shirt »), CC2 (« dark-colored shirt »), CC3(« summer shirt ») et CC4 (« winter shirt »). D’après le modèle SMM, lesadjectifs « light-colored » et « dark-colored » modifient la dimension« couleur » du concept « shirt », alors que « winter » et « summer » modi-fient une autre dimension, celle du « moment où la chemise est portée ».Medin et Shoben (1988) supposent que ces deux dimensions : « couleur »et « saison » sont corrélées avec d’autres dimensions et que la modifica-tion de l’une d’entre elles aura comme conséquence de modifier lesautres. Pour tester cette hypothèse, ils demandent à des sujets de produiredes jugements de typicalité pour « light-colored shirt » et « dark-coloredshirt » en tant qu’exemplaires des catégories « winter shirt » et « summershirt ». Les résultats indiquent que « light-colored shirt » est jugée plustypique de « summer shirt » que « dark-colored shirt » et que « dark-colored shirt » est jugée encore plus typique de la catégorie « wintershirt » que « light-colored shirt ».Ces résultats mettent en cause la généralité du modèle SMM de Smith,Osherson, Rips & Keane (1988) et conduisent à une interrogation. Sil’effet d’un adjectif dans une combinaison conceptuelle est de modifierune dimension du nom principal, comment expliquer les résultats selonlesquels un adjectif référant manifestement à une seule dimension puisseen affecter d’autres ? L’explication avancée par Medin & Shoben (1988)consiste à supposer que les individus possèdent des connaissances rela-tives aux relations causales qui existent entre les différentes dimensionsd’un concept.Les résultats expérimentaux autorisent donc à conclure que le modèleSMM ne permet pas de rendre compte de la diversité et de la complexitédu processus d’interprétation des combinaisons conceptuelles. Si cemodèle permet de décrire une partie du processus de modificationconceptuelle, celle qui est associée au phénomène de typicalité, il ren-contre des difficultés à expliquer pourquoi un adjectif modifie différentesdimensions associées à des noms principaux différents et il ne peut rendrecompte des cas où le modificateur est un adjectif non prédicatif ou unnom. De plus, ce modèle suggère que les adjectifs ne modifient qu’uneseule dimension du nom principal alors que, comme nous venons de levoir, ils peuvent agir sur plusieurs dimensions. La combinaison concep-tuelle recouvre donc un processus plus complexe qu’une simple(re)distribution de poids associés à des attributs d’une structure concep-tuelle schématique et aux traits sémantiques qui les composent.
280
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
2.2. Le modèle CSM de « Spécialisation Conceptuelle » de Murphy (1988)
2.2.1. Caractéristiques principales du modèle
Le modèle CSM de spécialisation conceptuelle, comme le précédent,postule une représentation schématique des concepts, Murphy (1988)considérant que les réseaux d’attributs capturent mieux les significationsauxquelles les individus sont sensibles que les systèmes de relations géné-rales et qu’ils permettent de rendre compte des deux activités mentalesimpliquées dans toute interprétation d’une combinaison conceptuelle :l’attribution d’une signification et l’imputation d’un référent.
Ainsi, parexemple, il est probable que le schéma « éléphant » comprenne les attri-buts « couleur » et « habitat » susceptibles d’être instanciés par des valeursfortement typiques telles que « gris » et « zoo ». Ces valeurs peuvent êtreplus ou moins complexes et renvoyer à d’autres schémas, et les traite-ments appliqués à un schéma peuvent être appliqués à ses valeurs(Rumelhart et Ortony, 1977). Cohen & Murphy (1984) supposent que leprocessus de combinaison conceptuelle consiste à utiliser le concept« Nom Modificateur » pour instancier les valeurs des attributs du concept« Nom principal ». Ainsi, une interprétation possible de la combinaison« robin snake » (« Serpent Rouge-gorge ») consiste à instancier l’attribut« manger » du schéma « snake » par le concept modificateur « robin », cequi conduit à « un serpent qui mange des rouge-gorges ».Le modèle CSM diffère du modèle SMM exposé précédemment sur deuxpoints essentiels. Murphy (1988) postule que les connaissances des indi-vidus interviennent (i) dans la sélection de l’attribut à instancier auniveau du nom principal et (ii) dans l’élaboration du nouveau concept.Selon Murphy (1988), « il est impossible de créer un concept « complet »si l’on ne connaît que les deux concepts impliqués. Il est nécessaired’accéder à une vaste base de données, aux connaissances du monde,pour élaborer un concept complet ; ces connaissances influençant le pro-cessus d’interprétation » (p. 533).
Murphy (1988) décrit la manière dontles connaissances sont utilisées pour élaborer une interprétation de lacombinaison conceptuelle « Apartment dog » (« Chien Appartement »)(p. 540). Une première interprétation est construite par instanciationd’un attribut du concept Nom principal « Dog » : les individus activent enmémoire à long terme l’ensemble de leurs connaissances sur les chiens etils utilisent ces informations pour modifier leur interprétation de lacombinaison conceptuelle. Cette modification consiste à ajouter des attri-buts à la combinaison comme, par exemple, « qui aboie », « névrosé »,etc. Ainsi, la notion de changement conceptuel, comprise comme la pro-
Combinaisons conceptuelles nouvelles
281
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
duction d’un nouveau concept, ne consiste pas seulement dansl’instanciation d’un attribut du nom principal par le modificateur, ellecomporte également l’ajout d’attributs au nom principal. Ceci est particu-lièrement important pour les combinaisons dans lesquelles lemodificateur est un nom. En effet, contrairement à certains adjectifs, unModificateur-Nom ne spécifie pas directement la dimension à modifierau niveau du nom principal. Quelle dimension particulière est « pointée »par le concept « Dog » ? Les connaissances relatives à ce concept sontnombreuses et permettent de produire des interprétations pour lescombinaisons « Dog Magazine » (« Magasine Chien »), « Dog Food »(« Nourriture Chien »), « Dog Trainer » (« Dresseur Chien »), etc. Aucours de l’interprétation de la combinaison « Dog Magazine » parexemple, les connaissances associées au concept « chien », posé commevaleur instanciable dans la structure schématique, guideront la sélectionde la dimension la plus pertinente au niveau du schéma « Magazine ».Une fois la sélection de la dimension pertinente opérée, plusieurs inter-prétations co-occurrentes possibles de la combinaison sont élaborées.Dans l’exemple de la combinaison « Dog Magazine », au cours de l’inter-prétation, des inférences sur les propriétés associées à un « magasine pourchiens » seront élaborées : ce magasine apportera probablement des infor-mations relatives à la nourriture canine, au dressage, etc. Selon Murphy,l’étendue de la recherche de propriétés associées dépend des exigences dela tâche. Les connaissances exercent un effet sur le processus d’élabora-tion d’inférences via l’activation d’informations liées à l’expériencepersonnelle, ce que Hampton (1987) appelle le « feed-back exten-sionnel ». Ce dernier se produit une fois l’interprétation de lacombinaison conceptuelle terminée.
2.2.2. Validations expérimentales du modèle
Les résultats de deux expériences réalisées par Murphy (1988) peuventêtre invoqués à l’appui de ce modèle. Ces expériences ont pour but demontrer que, contrairement à ce que prédit le modèle SMM de Smith etal. (1988), l’élaboration d’un concept complexe provoque l’émergence detraits qui ne sont pas évoqués par les concepts composant la combinaisonMd-NP. Dans la première, 18 couples Adjectif-Nom (« green bicycle »(« Bicyclette Verte »), « empty stores » (« Magasins Vides »), « russiannovels » (« Romans Russes ») sont présentés à des individus à qui ondemande de juger le degré de typicalité d’une propriété (« painted green »(« peint en vert »), « lose money » (« perte d’argent »), « (originally)written in Russian » (« rédigé à l’origine en langue russe ») sur une échellede 1 à 7 en présence des composants de la combinaison et de la combi-
282
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
naison elle-même. Pour 15 des 18 couples, la propriété à évaluer est jugéeplus typique de la combinaison que de ses composants Adjectif et Nom :clairement, « lose money », ne constitue pas une propriété (saillante) de« Empty ». Murphy en conclut que « l’on ne peut prédire l’effet exact del’adjectif sans connaître le nom qui est modifié » (p. 545).La seconde expérience vise à répondre à l’objection selon laquelle la pro-priété choisie par l’expérimentateur pour chacun des 18 couples estarbitraire, qu’elle n’appartient pas aux propriétés les plus importantes etne reflète pas un traitement « naturel » en situation. Aussi, Murphy construit100 combinaisons à partir de 10 adjectifs (« nouveau, bon, long, social »)et 10 noms (année, main, monde, maison) parmi les plus fréquents selonles normes de Francis et Kucera (1982) et demande à trois participantsune définition pour chacune d’entre elles. La question posée concerne icila constance de la modification apportée par l’adjectif : l’effet produit parl’adjectif varie-t-il en fonction du nom auquel il est associé ou demeure-t-il constant ? Les résultats indiquent que l’interprétation de l’adjectifdépend de la nature du nom qu’il modifie : on observe en effet unemoyenne de 6,95 définitions différentes par adjectif et, dans certains cas,l’adjectif provoque l’évocation d’acceptions différentes du nom associé(« main » partie du corps vs direction vs assistance, par exemple).En conclusion, les combinaisons conceptuelles Adjectif-Nom comportentdes propriétés qui ne sont pas celles de leurs composants : l’adjectif prenddes sens différents selon la nature du nom qu’il modifie et les acceptions dunom qui sont activées varient en fonction de la nature du modificateur.L’élaboration des combinaisons conceptuelles de ce type impliquent l’inter-vention de processus d’interaction entre les deux composants et non pas unsimple transfert de propriétés des composants vers la combinaison.
2.2.3. Limites du modèle
Bien que le modèle CSM de « spécialisation conceptuelle » semble consti-tuer un modèle cognitif plausible de l’interprétation de combinaisonsconceptuelles, la critique principale susceptible de lui être adressée résidedans le fait que, comme le modèle SMM, il n’envisage que les processusqui conduisent à des interprétations relationnelles des combinaisonsconceptuelles. Or, des interprétations en termes de propriétés, du type« un zèbre est un cheval à rayures » pour la combinaison « ZèbreCheval », ou des interprétations hybrides en termes de relation et depropriété, comme pour la combinaison « Pet Fish », sont susceptiblesd’être produites. Le modèle du double processus proposé par Wis-niewski (1997), que nous allons maintenant exposer, se fixe notammentpour objectif de pallier cette insuffisance.
Combinaisons conceptuelles nouvelles
283
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
2.3. Le modèle du « Double Processus » : Création de scénario et Comparaison/Construction de Wisniewski (1997)
2.3.1. Caractéristiques principales du modèle
Wisniewski (1997) étend le modèle CSM de « spécialisation concep-tuelle » et développe le rôle des connaissances dans le processusinterprétatif des combinaisons conceptuelles. Le modèle du « DoubleProcessus » vise à rendre compte des trois types d’interprétations possi-bles d’une combinaison conceptuelle : établissement d’une relation entrele Modificateur (Md) et le Nom Principal (NP), transfert d’une propriétédu Modificateur (Md) vers le Nom Principal (NP) et Hybride, en intro-duisant une phase de comparaison et une phase de construction (voir letableau II ci-dessous).Wisniewski (1997) postule l’intervention de deux processus : la création descénarios et la comparaison/construction pour rendre compte de la formula-tion de différents types d’interprétation des combinaisons conceptuelles.
Tableau II. Processus cognitifs supposés rendre compte des différents types d’interprétation de combinaisons
conceptuelles selon les modèles de « Spécialisation conceptuelle » (Murphy, 1988) et du « Double Processus » (Wisniewski, 1997).
Légende : Md = Modificateur ; NP = Nom Principal.
Types d’interprétation de combinaisons
conceptuelles
Modèle de « Spécialisation
Conceptuelle » (Murphy, 1988)
Modèle du « Double Processus »
(Wisniewski, 1997)
Établissement d’une relation entre Md et NP
Instanciation de schémasIntervention des connaissances
Création de scénarios impliquant Md et NP
Transfert d’une propriété de Md vers NP
Instanciation de schémasIntervention des connaissances
Comparaison entre Md et NP et Construction de la signification
Hybride : Établissement d’une relation entre Md et NP et Transfert d’une propriété de Md vers NP.
Instanciation de schémasIntervention des connaissances
Comparaison entre Md et NP et Construction de la signification
284
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
Les interprétations qui conduisent à l’établissement d’une relation entreles constituants de la combinaison consistent à élaborer un scénario plau-sible impliquant les constituants de la combinaison. Reprenant à soncompte la représentation des concepts sous la forme de schémas, Wis-niewski (1996, 1997) considère que les schémas contiennent des scénariosexprimés par les verbes décrivant des actions, des événements ou desétats. Par exemple, le schéma conceptuel de « Savon » comprend le scé-nario « Laver » qui comporte des rôles sémantiques tels que « Récipient »,« Agent » et « Instrument ». Selon cet auteur, l’interprétation d’unecombinaison conceptuelle nouvelle s’organise souvent autour d’un verbe,les constituants de la combinaison étant assignés aux rôles thématiquesque comporte la signification du verbe pour constituer un scénario plau-sible (Fillmore, 1968 ; Schank, 1972 ; Gentner, 1981 ; Levin, 1993, voirFrançois & Denhière, 1997 pour une revue). Par exemple, une interpréta-tion plausible de « Truck Soap » peut être « un savon pour laver lescamions », les constituants « Camion » et « Savon » jouant respectivementles rôles d’objet et d’instrument dans le scénario « Laver ». Le modèle deWisniewski (1997) prévoit également que le processus de création de scé-narios s’applique à des associés des constituants de la combinaisonconceptuelle, ce qui permet de rendre compte des interprétations entermes de relation de combinaisons telles que « Artist Collector » : « per-sonne qui rassemble les travaux d’un artiste ».Un second processus, le processus de comparaison/construction, différentde la création de scénarios plausibles, est postulé par Wisniewski (1996,1997) pour rendre compte des interprétations de combinaisons concep-tuelles en termes de propriétés, une propriété du Modificateur étanttransférée vers le Nom Principal. Ce processus est supposé être déclenchéquand une faible similarité sémantique existe entre le Modificateur et leNom principal. Le processus de comparaison/construction détermine lestraits communs et les différences existant entre le Modificateur et le NomPrincipal, les résultats de la comparaison constituant la base de l’interpré-tation. Deux types de différences sont envisagés : comparables et noncomparables. Les premières, les différences comparables, sont en relationavec les traits communs et appartiennent à la structure relationnelle par-tagée, alors que les secondes, qui ne possèdent pas ces propriétés, sontdites « non comparables » (Gentner & Markman, 1994). Pour la combi-naison « Cheval Zèbre » (« Zebra Horse »), la comparaison des concepts« Zèbre » et « Cheval » produit le trait commun « Forme du corps » et ladifférence comparable « Rayé ». Cette différence « Rayé » sera transféréede « Zèbre » à « Cheval » afin de produire l’interprétation de la combi-
Combinaisons conceptuelles nouvelles
285
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
naison en termes de propriété : « un Cheval Zèbre est un cheval avec desrayures ».L’introduction de cette distinction entre deux types de différences permetde formuler l’hypothèse selon laquelle les propriétés retenues dans lesinterprétations en termes de propriétés renverront aux différencescomparables qui existent entre le Modificateur et le Nom Principal. Deplus, si le processus de comparaison met à jour un grand nombre de traitscommuns et de différences comparables entre les deux composants, alorsl’interprétation produite sera hybride comme dans le cas par exemple dela combinaison « Robin Canary » : « un oiseau issu du croisement d’unrouge-gorge et d’un canari ».Une extension du modèle prévoit « où » de nouvelles connaissancesseront ajoutées à la représentation du nom principal. Wisniewski et Mid-dleton (2002) supposent que le processus d’interprétation descombinaisons conceptuelles comporte une comparaison spatiale duModificateur et du Nom Principal. Cette comparaison aboutit à l’établis-sement de correspondances entre les localisations et les orientationsspatiales du Modificateur et du Nom principal (« Alignement ») puis autransfert d’une propriété du premier à un endroit déterminé de la repré-sentation du second, et ceci dans une position analogue à sa positioninitiale. Ainsi, un « Bucket Bowl » est interprété comme « un bol avec uneanse placée au-dessus » et non comme « un bol avec une anse placée surun de ses côtés ». Selon le même principe, un « Coffee Cup Bowl »renvoie à « un bol avec une anse sur le côté ».Le processus de comparaison et d’alignement a été initialement évoquédans les modèles traitant de la métaphore et de l’analogie (Gentner, 1983,1989, Holyak & Thagard, 1989 ; voir Gineste et Scart-Lhomme, 1999 pourune revue). Étendu aux combinaisons conceptuelles, ce processus decomparaison implique une mise en correspondance des structures duModificateur et du Nom Principal, une comparaison des traits communsaux deux constituants et une identification des différences. Déceler destraits communs entre deux concepts conduit à faire émerger des diffé-rences (Markman & Gentner, 1993 ; Gentner & Markman, 1994 ;Markman & Wisniewski, 1997). Un résultat expérimental bien établi dansl’interprétation des combinaisons conceptuelles consiste à observer unemeilleure performance dans la condition où les deux concepts de lacombinaison sont sémantiquement similaires. Ainsi, le trait « Avoir desroues » communément produit pour « Voiture » et « Mobylette » conduità mettre à jour la différence « Quatre roues versus Deux roues »(Markman & Gentner, 1993). De plus, le processus de comparaisonsuggère « l’endroit où » la propriété peut être insérée dans la combinaison
286
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
conceptuelle. Une série de résultats expérimentaux tend à valider l’exis-tence de ce processus de comparaison dans l’interprétation decombinaisons conceptuelles, la fréquence des interprétations hybridesaugmentant en fonction inverse de la similarité sémantique entre les deuxconstituants (Wisniewski, 1997).Pour Barsalou (1993), l’interprétation d’une combinaison conceptuellecomme « Zebra Horse » repose sur la représentation des composants per-ceptifs relatifs au Modificateur et au Nom Principal. Le processus decomparaison est supposé mettre en correspondance les sommets des deuxreprésentations puis réduire la comparaison à des aires spatiales plusréduites. Il est également possible de supposer que les sujets accèdent enmémoire à une propriété du Modificateur avant que le processus decomparaison ne soit mis en œuvre. Ainsi, un contexte linguistique parti-culier est susceptible d’indiquer la propriété du Modificateur pertinentepour la nouvelle combinaison conceptuelle (Gerrig & Murphy, 1992).Une autre hypothèse selon laquelle une propriété saillante du Modifica-teur est automatiquement activée à la lecture de ce dernier peut êtreenvisagée (Barsalou, 1982 ; Glucksberg & Keysar, 1990). Dans ce cas, leprocessus de comparaison est nécessaire pour établir la localisationprécise de la propriété à intégrer au nom principal. Dans l’exemple de lacombinaison « Zebra Horse », il est probable que la propriété « Posséderdes rayures » soit facilement accessible à la lecture de « Zèbre » ou qu’ellesoit activée automatiquement.Reste que la question de la sélection d’une différence se pose. Selon Wis-niewski (1997), deux facteurs influencent ce processus de sélection : lecontexte et la saillance de la propriété
.
D’une part, le contexte pointe lapropriété pertinente à sélectionner. Ainsi, les noms peuvent renvoyer àdes propriétés saillantes des concepts concernés, lesquelles sont utiliséesdans la production d’une interprétation. Par exemple, les concepts « Élé-phant » et « Baleine » sont souvent utilisés dans le langage pour référer àde grosses « choses » comme dans les combinaisons familières « Aïl Élé-phant » (« Éléphant Garlic ») et « Requin Baleine » (« Whale Shark »).D’autre part, la saillance d’une propriété donnée, dans la mesure où elledétermine la probabilité avec laquelle un concept appartiendra à unecatégorie particulière s’il possède cette propriété, exerce un effet sur lasélection de la différence, support à l’interprétation finale (Rosch, 1978).En conclusion, l’interprétation d’une combinaison conceptuelle neconsiste pas seulement à transférer une propriété du modificateur vers lenom principal. Cette propriété constitue une source d’information àpartir de laquelle une version nouvelle de cette propriété est élaborée etassignée
au Nom Principal. La construction est un processus cognitif dans
Combinaisons conceptuelles nouvelles
287
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
lequel la propriété sélectionnée est soumise à des contraintes spécifiéespar le Modificateur et le Nom Principal. La nouvelle propriété devraconserver suffisamment de similarité sémantique avec sa source (le Modi-ficateur) de sorte que la contribution du Modificateur à l’élaboration dela signification de la combinaison puisse être déterminée (Nunberg,1979). La construction de cette nouvelle propriété ne doit pas altérer lasignification du Nom Principal.Pour illustrer le processus de construction, voyons comment ce dernieropère parallèlement au processus de comparaison afin de produire l’inter-prétation de la combinaison « Fork Spoon » (« Cuillère Fourchette »).Selon Wisniewski (1997)
,
lors de l’interprétation de « Fork Spoon », lesindividus commencent par « aligner » les côtés d’une cuillère et ceuxd’une fourchette, puis l’extrémité d’une cuillère avec celle d’une four-chette et notent alors une différence importante : la fourchette possèdedes dents alors que l’extrémité de la cuillère est arrondie. Le processus decomparaison identifie l’endroit où, dans la représentation de la cuillère, lapropriété « avoir des dents » peut être intégrée : à l’extrémité de lacuillère. Cependant, il existe un conflit entre la représentation mentale decette propriété au bout de la cuillère et le référent « classique » de cuillère.Les individus doivent mentalement résoudre ce conflit en « attachant lesdents » à l’autre extrémité. Dans ce cas, les dents d’une « Fork Spoon »sont similaires mais non identiques à ceux d’une fourchette. Cette repré-sentation : « dents à l’autre extrémité », préserve la fonction de la cuillère.En résumé, selon le modèle du Double Processus de Wisniewski (1997),les combinaisons conceptuelles nouvelles sont interprétées en utilisant lesprocessus de comparaison et de construction. Par le premier de ces pro-cessus, les propriétés du Modificateur sont comparées à celles du NomPrincipal et les traits qui leur sont communs sont utilisés pour identifierune différence, différence qui sert de base à l’élaboration d’une nouvellepropriété de la combinaison conceptuelle. En plus d’identifier les simili-tudes entre le Modificateur et le Nom Principal, le processus decomparaison indique une localisation spatiale spécifique pour la propriétéà intégrer
au Nom Principal
.
Le processus de construction crée pour lacombinaison nouvelle une propriété qui conserve suffisamment du sensde la « propriété d’origine » (Modificateur) tout en respectant lescontraintes émanant du Nom Principal.Reste à déterminer la nature de la relation existant entre le processus decréation de scénarios d’une part, et les processus de comparaison / construc-tion d’autre part. Wisniewski (1997) envisage le premier indépendammentdes derniers et, à propos de ceux-ci, s’interroge sur leur mode d’action :opèrent-ils de manière parallèle ou séquentielle ? Entrent-ils en compétition ?
288
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
Des recherches menées par Downing (1977), Wisniewski et Gentner(1991), Gagné et Shoben (1997) concourent à mettre en évidence le faitque les individus interprètent les combinaisons conceptuelles en établis-sant une relation thématique entre leurs constituants ; c’est seulement encas d’impossibilité à établir une telle relation qu’ils dérivent, dans unsecond temps, une interprétation en termes de propriétés. Ce constatimplique des processus séquentiels avec une création initiale de scénarios.Les processus de comparaison et de construction ne sont appliqués que sila création de scénarios aboutit à un échec, si une interprétation plausibledans laquelle les deux constituants jouent des rôles différents au sein d’unmême scénario n’a pu être élaborée. Ceci expliquerait pourquoi, dans lecas de combinaisons conceptuelles dont les constituants sont fortementsimilaires, rares sont les interprétations en termes de relations et fré-quentes les interprétations en termes de propriétés ou les interprétationshybrides (Wisniewski & Markman, 1993 ; Wisniewski, 1996). En effet,lorsque les constituants d’une combinaison sont hautement similaires, laprobabilité qu’ils jouent le même rôle thématique est élevé, ce qui réduitles possibilités d’intégration dans un scénario plausible où ils jouent desrôles différents.Cependant, des noms fortement similaires peuvent parfois jouer des rôlesdifférents dans un même scénario. Wisniewski et Love (1998) utilisentdes combinaisons conceptuelles du type « Dancer Musician » (« MusicienDanseur ») pour tester l’hypothèse de la création initiale d’un scénario àpartir d’une épreuve de jugement de plausibilité. Des paires de combinai-sons nouvelles sont construites en respectant deux types de contraintes :leurs constituants sont fortement similaires et, dans les deux combinai-sons, ces constituants renvoient au même scénario. Ainsi, par exemple, lesconstituants de « Dancer Musician » sont plus similaires que ceux de« Mourner Musician » (« Musicien Parent d’un défunt ») et les deuxcombinaisons peuvent être interprétées à partir du même scénario :« Jouer pour ». Les résultats vont à l’encontre de l’hypothèse de la créa-tion d’un scénario initial. Ils indiquent en effet que les sujets jugent plusplausible l’interprétation « un musicien joue pour des danseurs », associéeà la combinaison « Dancer Musician », que celle d’« un musicien jouepour les parents d’un défunt », associée à « Mourner Musician ». Dansune tâche d’interprétation de combinaisons nouvelles, les sujets ont ten-dance à produire une interprétation en termes de propriétés ou uneinterprétation hybride. Par exemple, « Mourner Musician » sera inter-prétée comme « un musicien qui joue de la musique pour les parents dudéfunt », « barrel chisel » comme « un burin utilisé pour les tonneaux » et« fish vulture » comme « un vautour qui prend comme proies les poissons
Combinaisons conceptuelles nouvelles
289
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
morts » alors que les scénarios impliquant ces mêmes noms sont jugésmoins plausibles que lorsqu’ils impliquent des constituants hautementsimilaires. Ces résultats suggèrent que pour les combinaisons concep-tuelles similaires, le processus de création d’un scénario et les processusde comparaison et de construction entrent en compétition
.
Il est plusfacile de comparer des représentations ayant une structure similaire afinde trouver leurs traits communs et leurs différences ; les processus decomparaison et de construction prennent le pas sur la création d’un scé-nario même si une interprétation mettant en œuvre ce dernier resteplausible.
2.3.2. Limites du modèle
En proposant le modèle du Double Processus
,
Création de scénario etComparaison / Construction, Wisniewski (1997) a montré que l’interpré-tation de combinaisons conceptuelles ne se réduisait pas au transfertd’une propriété du Modificateur vers le Nom Principal comme le suppo-saient les modèles SMM de « Modification sélective » (Smith, Osherson,Rips & Keane, 1988) et CSM de « Spécialisation conceptuelle » (Murphy,1988). Le modèle qu’il propose envisage que
l’intégration d’une propriétédu Modificateur dans la combinaison s’effectue grâce à l’intervention desprocessus de comparaison et de construction. D’autres auteurs commeCostello & Keane (1997) ou Estes & Glucksberg (2000) supposent que lesindividus intègrent les nouvelles propriétés à la combinaison conceptuelleà partir de leurs connaissances générales. Ainsi, Costello & Keane (1997)expliquent l’interprétation d’« Angel Pig » (« Cochon Ange ») comme« un cochon qui a des ailes » par l’effet de l’expérience du monde dessujets qui leur a permis d’acquérir un certain nombre de connaissancesrelatives, par exemple, à la localisation spatiale privilégiée (« dans le dos »)associée à une propriété particulière d’objets (« avoir des ailes ») de façonà intégrer celle-ci à un nouveau concept (« cochon »). Autrement dit,l’activation de connaissances spécifiques relatives au Modificateur, dans lebut d’intégrer une propriété au Nom Principal, ne serait pas nécessaire etl’intervention au cours de l’interprétation d’une combinaison du pro-cessus de comparaison ne se justifie plus. Par exemple, l’interprétation dela combinaison « Rose Mushroom » (« Champignon Rose ») en tant qu’« un champignon avec des épines sur son pied » consiste à activer lesconnaissances relatives aux plantes et aux végétaux, à leurs troncs, à leurstiges et à leurs pieds qui supportent généralement des branches, desfeuilles ou des épines.Pour clore la deuxième partie de cet article concernant l’exposé desmodèles d’interprétation de combinaisons conceptuelles reposant sur un
290
Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
format de description schématique, nous aborderons maintenant lemodèle C3 de la « Combinaison Conceptuelle Guidée par la satisfactionde Contraintes » (« Constraint-Guided Conceptual CombinationModel ») proposé par Costello & Keane (2000, 2001).
2.4. Le modèle C3 de la « Combinaison conceptuelle guidée par la satisfaction de contraintes » (Constraint-Guided Conceptual Combination Model)de Costello & Keane (2000).
2.4.1. Caractéristiques principales du modèle
Dans ce modèle, l’interprétation de combinaisons conceptuelles estdécrite comme un processus de construction de représentations quidoivent satisfaire trois ordres de contraintes : la typicalité, la plausibilité etla valeur informationnelle (voir Costello, 1996 ; Costello & Keane, 1997).Les trois types d’interprétations envisagées : par établissement d’une rela-tion, par transfert d’une propriété et hybride, résultent de la satisfactiondifférentielle des trois ordres de contraintes. Cette modélisation algorith-mique, implémentée sur ordinateur, parvient à dégager parmi toutes lesinterprétations possibles, celle qui satisfait au mieux les trois types decontraintes. Ce modèle réussit en effet à produire des interprétationsconjonctives, relationnelles, hybrides et en termes de propriétés selon unedistribution proche de celle observée avec des humains. Comme dans lemodèle du « Double Processus » (Wisniewski, 1997), cette modélisationutilise des représentations schématiques, c’est-à-dire sur des structuresinternes plus ou moins complexes renvoyant à des propriétés, des attri-buts, des rôles et des relations. Contrairement au modèle de Wisniewski(1997) pour qui le processus de combinaison conceptuelle est initiale-ment limité à des informations typiques, Costello et Keane (2000)supposent que ce processus est susceptible de s’appliquer à un nombreimportant d’exemplaires des concepts combinés, à des théories généralesdu domaine concerné et à des événements spécifiques impliquant cesderniers.Chacune des trois contraintes : plausibilité, valeur informationnelle ettypicalité, exerce un effet particulier sur les interprétations des combinai-sons produites. Ainsi, la plausibilité impose la constructiond’interprétations comprenant des informations sémantiques déjà connuesdu sujet, cooccurrentes sur la base de l’expérience antérieure, qui décri-vent un objet ou une collection d’objets susceptibles d’exister. Pour sapart, la valeur informationnelle impose que l’interprétation construite
Combinaisons conceptuelles nouvelles
291
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
apporte des informations nouvelles. Enfin, la valeur de typicalité, consi-dérée comme la contrainte la plus importante du système, nécessitel’élaboration d’une interprétation comprenant des propriétés « diagnosti-ques
» (« typiques ») communes au Modificateur et au Nom Principal dela combinaison. Pour un concept donné, les propriétés à valeur de typica-lité élevée sont présentes dans les différents exemplaires de celui-ci etrarement dans les exemplaires renvoyant à d’autres concepts (Rosch,1978 ; voir Cordier, 1993 ; Dubois, 1983, pour des revues). Ainsi, en fonc-tion de la contrainte de plausibilité, l’interprétation de la combinaison« Cactus Poisson » comme « Poisson Piquant » sera plus fréquente quecelle de « Poisson Vert », du fait que, pour un cactus, la propriété« piquant » est plus typique que la propriété « vert ».
2.4.2. Validations expérimentales du modèleDans le but de confronter les prédictions dérivées des modèles du« Double Processus » de Wisniewski (1997) et de la « Combinaisonconceptuelle guidée par des contraintes » de Costello et Keane (2000) àpropos de la sélection et du transfert d’une propriété du Modificateurvers le Nom Principal, Costello et Keane (2001) ont réalisé deux expé-riences, l’une de compréhension de combinaisons, l’autre de productiond’interprétations.Si les deux modélisations envisagées s’accordent sur la description duprocessus de sélection d’une propriété du Modificateur et de son transfertvers le Nom Principal, elles divergent quant au type de propriétés sélec-tionnées. Selon le modèle du « Double Processus » de Wisniewski (1997),les propriétés utilisées pour interpréter une combinaison conceptuellenouvelle renvoient aux différences « comparables » entre le Modificateuret le Nom Principal, différences qui, nous l’avons plus haut (voir infra,page 119) sont liées aux traits sémantiques communs aux deux consti-tuants. Selon le modèle de la « Combinaison conceptuelle guidée par descontraintes » de Costello et Keane (2000, 2001), les propriétés pertinentespour l’interprétation d’une combinaison sont les propriétés du Modifica-teur qui possèdent une valeur de typicalité élevée, que ces propriétéssoient comparables ou non.Le matériel expérimental élaboré par Costello et Keane (2001) étaitconstitué de seize combinaisons « Animal-Animal » (« Bourdon Pha-lène ») qui résultaient du croisement des facteurs: Nature des différences(comparables ou pas) et Valeur de typicalité (faible ou élevée), ce quipermettait quatre types d’interprétations en termes de propriétés.Dans l’expérience de compréhension, les participants devaient juger surune échelle en sept points le degré d’acceptabilité des quatre interprétations
292 Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
proposées. Dans l’expérience de production, il était demandé aux partici-pants d’élaborer une définition susceptible d’être comprise par desenfants pour chacune des seize combinaisons.Pour la tâche de compréhension, le modèle du « Double Processus » deWisniewski (1997) prédit que les participants choisiront majoritairementles interprétations qui expriment des différences comparables et que, enfonction du rôle attribué à la typicalité, les interprétations impliquant despropriétés fortement typiques seront les plus fréquentes. Selon le modèleC3 de Costello et Keane (2000, 2001), les choix des participants se porte-ront sur les interprétations impliquant les propriétés à valeur de typicalitéélevée). Des prédictions similaires sont posées pour la tâche de produc-tion d’interprétations.Globalement, les résultats de ces deux expériences sont en accord avec lesprédictions dérivées du modèle de Costello et Keane (2000) : seule lavaleur de typicalité élevée d’une propriété du Modificateur et non lacomparaison joue un rôle déterminant dans la sélection de la propriété àtransférer du Modificateur au Nom Principal.Dans l’épreuve de compréhension, deux résultats méritent d’être signalés.Premièrement, parmi les 459 interprétations recensées, celles qui impli-quent des propriétés à valeur de typicalité élevée (313 interprétations)reçoivent significativement plus de jugements positifs que celles quiimpliquent des propriétés à valeur de typicalité faible (146 interpréta-tions). Deuxièmement, les jugements positifs se sont portéspréférentiellement sur les interprétations impliquant des propriétés àvaleur de typicalité élevée et non comparables (147 interprétations) plutôtque sur celles impliquant des propriétés comparables à valeur de typica-lité faible (79 interprétations, p <.01). Ce résultat remet clairement enquestion la prédiction dérivée du modèle du « Double Processus » selonlaquelle les différences comparables déterminent la sélection d’unepropriété.Dans l’expérience de production d’interprétations, les participants ontproduit au total 287 interprétations qui ont été réparties en quatre caté-gories : propriétés, relations, conjonctives et autres. 255 interprétations(soit 89 %) correspondent à un transfert d’une propriété du Modificateurvers le Nom Principal, 13 interprétations reposent sur l’établissementd’une relation entre le Modificateur et le Nom Principal, 10 sont conjonc-tives et 9 sont catégorisées comme « autres ». La majorité desinterprétations en termes de transfert de propriété sont identiques à cellesproposées dans l’expérience de compréhension (168 interprétations équi-valentes à 66 % des interprétations produites). Les participantsproduisent significativement plus d’interprétations impliquant des pro-
Combinaisons conceptuelles nouvelles 293
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
priétés à valeur de typicalité élevée que des propriétés à valeur detypicalité faible (147 contre 21). Aucune différence significative n’est miseen évidence pour les interprétations correspondant à des différencescomparables et à des différences non comparables. Les productions àpartir de propriétés à valeur de typicalité élevée non comparables (77interprétations) sont significativement plus nombreuses que celles élabo-rées à partir de propriétés comparables à valeur de typicalité faible (21).Enfin, les auteurs rapportent une corrélation positive significative entre lafréquence des interprétations produites et la valeur de typicalité ainsiqu’une absence de corrélation entre la fréquence des interprétations pro-duites et la comparabilité des propriétés (Wisniewski, 1997).
2.4.3. Limites du modèleCes résultats confirment le rôle majeur joué par la valeur de typicalité etnon par la comparabilité des propriétés dans le processus d’interprétationde combinaisons conceptuelles nouvelles. Ils sont conformes aux prédic-tions dérivées du modèle de la « Combinaison conceptuelle guidée pardes contraintes » de Costello et Keane (2000) et ne sont pas en accordavec les prédictions dérivées du modèle du « Double Processus » de Wis-niewski (1997). Cette remise en question de la théorie de Wisniewski doitêtre limitée aux seules interprétations en termes de transfert de propriétédu Modificateur au Nom Principal. Les deux expérimentations rappor-tées ne s’intéressaient ni aux interprétations par établissement d’unerelation sémantique entre Modificateur au Nom Principal, ni aux inter-prétations hybrides par transfert de propriété et établissement de relation.
CONCLUSION
Au terme de cette revue, il apparaît qu’aucun des modèles présentés nepermet de rendre compte à lui seul de l’ensemble des résultats expérimen-taux obtenus et que l’interprétation des combinaisons conceptuellesModificateur-Nom Principal est plus riche et plus complexe que ne lesupposent ces modèles (Costello, Estes, Gagné & Wisniewski, 2004). Unmodèle susceptible de rendre compte de l’ensemble des interprétations està développer. De plus, reste à préciser le cours temporel des processusd’interprétation d’une combinaison nouvelle, qu’ils consistent dans l’éta-blissement d’une relation et/ou du transfert d’une propriété ou encore de
294 Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
l’émergence d’une propriété nouvelle, ces activités pouvant se dérouler demanière sérielle ou en parallèle.Les modèles SMM (Smith et al. 1988), CSM (Murphy, 1988) et duDouble Processus de Wisniewski (1997) ont en commun de postuler unecertaine conception de la représentation prototypique des concepts et desupposer qu’une combinaison conceptuelle nouvelle est élaborée à partirdes représentations schématiques des concepts qui la composent. SelonMurphy (2002), cette représentation « inclut les propriétés typiques desconcepts, lesquelles sont pondérées en fonction de leur fréquence et deleur caractère distinctif ; les relations entre les propriétés sont représen-tées plus directement et sont davantage contraintes que dans les modèlesconsistant en une simple liste de propriétés » (p. 470). Dans la mesure oùles combinaisons conceptuelles Md-NP et, plus particulièrement lescombinaisons Nom-Nom (« Typewriter Table », « Table Machine àécrire »), requièrent souvent une représentation abstraite de la catégorieet non une relation entre exemplaires particuliers, une théorie desconcepts en termes d’exemplaires est inadéquate. La difficulté principalerencontrée par les conceptions prototypiques tient au constat que 40 à70 % des propriétés attribuées aux combinaisons sont qualifiées d’émer-gentes car non typiques (ou non évoquées) d’aucun des deux conceptscomposants (Hampton, 1988 ; Wiesniewski, 1997).Pour pallier cette difficulté, une intervention des connaissances est envi-sagée à trois niveaux : le choix du slot du NP à instancier (une table dehauteur adéquate capable de supporter une machine à écrire dans le casde la combinaison « typewriter table »), le choix de l’interprétation la plusplausible lorsque plusieurs interprétations sont activées successivementou simultanément (Wiesniewski & Love, 1998) et, enfin, la dérivation denouvelles propriétés (dites « émergentes ») qui ne sont pas représentéesdans les concepts composants. D’autres auteurs, tels Johnson et Keil(2000), postulent l’intervention d’un raisonnement causal pour expliquerque 40 % des propriétés accordées aux combinaisons ne sont pas attri-buées à leurs constituants Md et NP présentés seuls. Ils considèrent que lapropriété « pneu à crampons », attribuée à la combinaison « ArticBicycle » et jamais à « Artic » ni à « Bicycle », est la trace d’un raisonne-ment causal (« pour rouler sur la neige et sur la glace, il faut que les rouesaccrochent au sol et donc… »). Les résultats obtenus dans deux expé-riences sont accord avec cette hypothèse.Les modèles CARIN (Gagné et Shoben, 1997), du « Double Processus »(Wisniewski, 1997) et de la « Combinaison conceptuelle guidée par la satis-faction de contraintes (Costello et Keane, 2000) quant à eux ne rencontrent
Combinaisons conceptuelles nouvelles 295
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
pas de difficulté à rendre compte de l’intervention des connaissances dansl’interprétation des combinaisons conceptuelles nouvelles.CARIN privilégie l’établissement d’une relation sémantique entre leModificateur et le Nom Principal. Le modèle du « Double Processus »(Wisniewski, 1997) postule (i) l’établissement d’un scénario plausibleimpliquant les constituants de la combinaison ou (ii) la comparaisonentre Modificateur et Nom Principal et la construction de la significationd’un nouveau concept. Le modèle de la « Combinaison conceptuelleguidée par la satisfaction de contraintes (Costello et Keane, 2000) envi-sage l’interprétation de combinaisons conceptuelles nouvelles comme unprocessus de construction de représentations devant satisfaire trois ordresde contraintes : la typicalité, la plausibilité et la valeur informationnelle, lasatisfaction différentielle de ces trois ordres de contraintes permettant derendre compte des interprétations en termes d’établissement de relation,de transfert de propriété ainsi que des interprétations hybrides.Là où les deux derniers modèles envisagent plusieurs processus pourrendre compte des trois types d’interprétations possibles: relationnelle,propriété et hybride, le modèle CARIN renvoie exclusivement à l’élabora-tion d’une relation sémantique entre le Modificateur et le Nom Principal.Les résultats expérimentaux recueillis en faveur de cette hypothèseconvergent sur deux points : l’interprétation relationnelle de combinaisonsrepose sur un processus de sélection d’une relation particulière parmi unnombre fini et limité de possibles et cette sélection est influencée par lestraitements antérieurs des constituants (Gagné et Shoben, 1997 ; Gagné,2000, 2001). Plus précisément, les relations associées à un Md, pondéréesen fonction de leur fréquence d’usage dans la langue, sont activées etentrent en compétition. La distribution relationnelle pondérée (ratio)détermine la sélection de la relation pertinente (Gagné & Spalding, souspresse). Alors que le Nom Principal renvoie à la catégorie, le Modificateurspécifie une sous-catégorie, ce qui explique que l’information associée àce dernier, son histoire relationnelle, soit utilisée pour modifier le NP. LeNom Principal intervient à un autre niveau de l’interprétation de la combi-naison : il permet de juger de la plausibilité de la relation sélectionnée(Gagné et Shoben, 1997).Un problème relatif à CARIN reste non résolu aujourd’hui : les relationsconceptuelles en question apparaissent représentées indépendamment desconcepts singuliers qu’elles sont susceptibles de lier, d’où un amorçagepossible en l’absence de « redondance » lexicale (Estes, 2003). Si, commele suggère Wisniewski (1997, 2000), les traitements attributif par transfertd’une propriété et relationnel par établissement d’une relation opèrent en
296 Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
parallèle, un processus de sélection de l’interprétation pertinente doit êtreenvisagé. Or, deux cas de figures peuvent se poser :– soit que l’on suppose que ces deux traitements renvoient à des pro-cessus sériels auquel cas, l’interprétation sera sélectionnée dès quel’objectif de l’attribution d’une propriété aura été atteint ou que l’établis-sement d’une relation aura été établi,– soit que ces deux traitements sont mis en œuvre en parallèle, auquel casnombreuses sont les interprétations susceptibles d’être produites par cesdeux voies. En effet, de multiples combinaisons conceptuelles sont poly-sémiques (Murphy, 1990 ; Costello et Keane, 1997) et nécessitent la miseen œuvre d’un processus de sélection de l’interprétation pertinente.L’intervention du contexte apparaît alors comme déterminante.Un recueil important de résultats empiriques dans le domaine de l’inter-prétation des combinaisons conceptuelles nouvelles en termes depropriétés conforte le modèle du « Double Processus » de Wisniewski(1997, 2000) selon lequel les processus de comparaison et de constructiondéterminent l’attribution d’une propriété du Modificateur au Nom Prin-cipal. Récemment, Wisniewski et Middleton (2002) ont apporté desarguments en faveur de l’hypothèse selon laquelle le processus d’interpré-tation des combinaisons par attribution de propriétés renvoie à unecomparaison des deux constituants qui aboutit à un transfert d’une pro-priété du Modificateur vers le Nom Principal en respectant descontraintes perceptives, de localisation spatiale par exemple.Certaines composantes de ce modèle du « Double Processus » restent àspécifier. En particulier, le modèle prédit l’existence d’une corrélationpositive entre la similarité sémantique des constituants et la probabilitéd’attribution d’une propriété. En effet, du fait que la similarité facilite lacomparaison entre les deux constituants de la combinaison (Gentner etMarkman, 1994) et que la comparaison est une condition nécessaire àl’attribution (Wisniewski, 1997, 2000), la similarité doit faciliter l’attribu-tion de propriétés. Or, toutes les données empiriques ne confirment pascette prédiction du modèle. Si certains résultats expérimentaux tendent àconfirmer cette prédiction (Markman et Wisniewski, 1997 ; Wisniewski etLove, 1998 ; 2002 ; Wilkenfeld et Ward, 2001), d’autres résultats (Bock etClifton, 2000 ; Costello et Keane, 2001 ; Estes et Glucksberg, 2000 ; Gagné,2000) ne la vérifient pas et tendent à privilégier l’idée que, seules les pro-priétés à valeur de typicalité élevée pour le Modificateur produisent desinterprétations en termes d’attribution de propriétés, au dépit de la simi-larité qui lie les deux constituants de la combinaison. La question qui sepose aujourd’hui aux recherches futures est de trancher entre un modèle,type double processus où comparaison et construction sont posées
Combinaisons conceptuelles nouvelles 297
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
comme conditions nécessaires à l’attribution de propriétés, et desmodèles plus parcimonieux où seule la valeur de typicalité des propriétésdu Modificateur entre en jeu (Estes et Glucksberg, 2000).Le modèle de Wisniewski (1997) a jeté les bases de la réflexion à proposde la dimension attributive de l’interprétation de combinaisons concep-tuelles. Dans une moindre mesure, le modèle du double processus aconforté la place fondamentale du modèle CARIN dans l’étude de ladimension relationnelle du processus d’interprétation en fixant des rôlesfonctionnels différents au Modificateur et au Nom Principal au cours del’établissement d’une relation entre les deux. Comme nous l’avons vuavec le modèle C3 de « Combinaison conceptuelle guidée par la satisfac-tion de contraintes » de Costello et Keane (2000), l’interprétation d’unecombinaison conceptuelle est supposée résulter de la satisfaction de troiscontraintes pragmatiques : la plausibilité, la valeur informationnelle et lavaleur de typicalité. Ici, la plausibilité ne renvoie pas comme précédem-ment à l’idée que le modificateur et le nom principal sont assignés à desrôles thématiques différents posés par une relation fonctionnelle les unis-sant (Murphy, 1990) mais à la signification selon laquelle l’interprétationrésultante devra être pertinente par rapport au contexte pragmatiquedans lequel s’inscrit la combinaison en question.Une critique est susceptible d’être appliquée aux trois modèles précédents. Lerôle particulier attribué au Modificateur dans l’interprétation d’une combi-naison pourrait résulter de l’effet de deux facteurs confondus : la positioninitiale dans le couple et les spécificités de la langue anglaise dans laquellele Modificateur précède le plus souvent le Nom. Un moyen de dissocierl’effet de ces deux facteurs consiste à reproduire le même type d’expé-rience avec des langues dans lesquelles le Modificateur est généralementplacé après le Nom mais dont le sens de lecture reste de gauche à droite.Deux expériences au moins ont utilisé ce paradigme de comparaisoninterlangue, l’une avec l’indonésien, l’autre avec le français.Storms & Wisniewski (sous presse) utilisent des combinaisons extraitesdu matériel de Gagné et Shoben (1997), les traduisent en Indonésien(« musical album », « album musik » ; « gas crisis », « Krisis gas » ; « paperalbum », « album kertas ») et demandent ensuite à des étudiants de l’Uni-versité de Djakarta de compléter des syntagmes incomplets du type :« Nom Principal X » et « X Modificateur » par un nom qui forme unecombinaison familière. Les auteurs constatent que 75 % des noms pro-duits pour compléter un Modificateur et 82 % des noms donnés pourcompléter un Nom Principal sont uniques : ils ne s’appliquent qu’à unterme et un seul. De plus, comme en anglais, les temps de complètementsont plus courts pour les paires « X Modificateur » que pour les paires
298 Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
« Nom Principal X »), ce qui permet de penser que le Modificateurpermet un accès plus rapide à une combinaison familière que ne lepermet un Nom Principal. Dans un second temps, 30 étudiants natifsd’Indonésie de l’Université de Leuven lisent en temps libre des phrasesqui se terminent par une combinaison Nom-Nom (« On Wednesday,Jack thought about the / « album kertas » (« paper album ») ») et indi-quaient par oui ou par non si cette combinaison « avait du sens ». Lesanalyses des temps de réponse répliquent les résultats obtenus par Gagnéet Shoben (1997) : la fréquence de la relation du Modificateur vers leNom Principal détermine les temps de réponse à la combinaison et noncelle du Nom Principal vers le Modificateur. Obtenant les mêmes effetsde la fréquence de la relation Modificateur-Nom Principal en utilisant deslangues dans lesquelles l’ordre des composants d’une combinaison estinversé, Storms & Wisniewski (sous presse) en concluent que, comme leprévoit le modèle CARIN, « le Modificateur possède des privilèges séman-tiques que n’a pas le Nom Principal dans la détermination del’interprétation d’une combinaison » (p. 16).L’expérience réalisée par Maguire et Cater (2004) se fixe les mêmes objec-tifs que la précédente en utilisant la langue française. Ils reprennent laprocédure d’amorçage utilisée par Gagné (2001) qui consiste à faire suivreune combinaison-amorce d’une combinaison-cible en maintenant constantle Modificateur ou le Nom Principal et en faisant varier la relation séman-tique (identique vs différente) qui lie les composants des combinaisonsamorce et cible. Pour mémoire, quand le Nom Principal est maintenuconstant, les temps de réponse à la combinaison-cible ne différent passignificativement en fonction de la relation Modificateur-nom Principal(identique vs différente). Quand le Modificateur est le constituant répété,le maintien de la même relation entre les constituants des combinaisonsamorces et des combinaisons cibles conduit à des temps de réponse signi-ficativement plus courts que lorsque la relation Md-NP est modifiée.Maguire et Cater (2004) dupliquent l’expérience de Gagné (2001) avecdes combinaisons Nom-Nom lexicalisées empruntées à la langue fran-çaise. Ainsi, par exemple, dans le cas où le Modificateur est maintenuconstant, la combinaison-cible « glacier montagne » (« mountain gla-cier ») est précédée de la combinaison-amorce « ruisseau montagne »(« mountain Stream ») qui utilise la même relation ou de « chaussuresmontagne » (Mountain Shoes ») dont les constituants entretiennent unerelation différente. Dans le cas où le Nom Principal est maintenu constant, lacible « sac sport » (« sports bag ») est précédée de « sac voyage » (travelbag) (même relation) ou de « sac cuir » (relation différente. Les résultatsobtenus par Maguire et Cater (2004) suivent le même patron que ceux
Combinaisons conceptuelles nouvelles 299
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
obtenus par Gagné (2001) : absence d’effet d’amorçage quand le NomPrincipal est maintenu constant, et effet d’amorçage quand le Modifica-teur est identique : le temps de réponse à « glacier montagne » estsignificativement plus court précédé de « ruisseau montagne » que de« chaussures montagne ». Ainsi, puisque cet effet d’amorçage a été obtenuavec des langues, Anglais et Français, dans lesquelles l’ordre du Modifica-teur et du Nom Principal est inversé, il est raisonnable de supposer queles deux types de constituants conservent le même rôle dans l’interpréta-tion d’une combinaison, indépendamment de l’odre dans lequel ilsapparaissent.Enfin, les questions qui se posent aujourd’hui renvoient à la généralisa-tion des résultats obtenus à la langue française. Premièrement, il reste àdéterminer dans quelle mesure la place habituelle de l’adjectif, différenteen Français et en Anglais, influence les résultats rapportés ci-dessus pourles les combinaisons « Adjectif – Nom ». Deuxièmement, reste à fixerdans quelle mesure les résultats obtenus avec des combinaisons Nom-Nom lexicalisées peuvent être généralisés à des combinaisons non lexica-lisées et donc nouvelles.Les premières expérimentations que nous avons réalisées en manipulantl’ordre de présentation des couples « Animal-Animal » sont en accordavec l’hypothèse d’un rôle particulier joué par le Modificateur dansl’interprétation de combinaisons conceptuelles nouvelles. Si, quel que soitl’ordre de présentation des éléments de la combinaison « Cheval Rhino-céros », l’interprétation dominante est « un cheval avec une corne/avec lapeau dure », la fréquence de production de ces interprétations passe de 89à 67 % quand « Cheval » est présenté en premier. Le même phénomèneest observé pour l’ensemble des combinaisons. Ainsi, pour « EscargotAraignée », l’interprétation dominante « une araignée /avec une coquille /lente/qui bave » tombe de 89 à 50 % quand « Araignée » est présentée enpremier. Cet effet de l’ordre de présentation s’observe également pour lesobjets fabriqués. Par exemple, l’interprétation dominante de la combi-naison « Chaise Lit » : « chaise pour dormir », passe de 72 à 56 % quand« Lit » est présenté en premier. L’on retrouve donc un effet de l’ordre deprésentation des constituants de la combinaison mais qui interagit avec lafréquence d’occurrence de la relation ou de la propriété déterminantepour l’interprétation. Les recherches en cours visent à préciser les pro-cessus à l’origine de cette interaction en recourant aux modèles récents del’analyse de la signification et de la représentation en mémoire commel’Analyse Sémantique Latente (Landauer et Dumais, 1997). Dans lamesure où nous dispons d’espaces sémantiques anglais et français quirenvoient aux mêmes patrons de relations conceptuelles, des comparai-
300 Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
sons inter-langues peuvent être réalisées (Bellissens, Thérouanne etDenhière, 2004). En effet, Lynott et Ramscar (2001) ont montré que« l’utilisation de l’Analyse Sémantique Latente permettait de rendrecompte de la complexité relative des combinaisons nouvelles, de distin-guer les interprétations en termes de relation et de propriété, de séparerles traits reliés des traits non reliés et, dans une moindre mesure, de hié-rarchiser les traits sémantiques des combinaisons nouvelles en fonctionde leur importance » (p. 8).
BIBLIOGRAPHIE
Anderson, J.R. (1983). The architecture ofcognition. Cambridge (MA), Harvard Uni-versity Press.
Barsalou, L.W. (1982). Context-independentand context-dependent information inconcepts. Memory and Cognition, 10, 82-93.
Barsalou, L.W. (1993). Flexibility, struc-ture and linguistic vagary in concepts: Ma-nifestations of a compositional system ofperceptual symbols. In A. C. Collins, S.E.Gathercole, M.A., Conway, P.E.M, Morris(Eds.), Theories of memory. Hillsdale, N.J:Erlbaum.
Barsalou, L.W. & Hale, C.R. (1992). Compo-nents of conceptual representation : Fromfeature lists to recursive frames. In VanMechelen, J. Hampton, R. Michalski &P. Theuns (Eds.), Categories and concepts:Theoretical views and inductive data analysis.San Diego: Academic Press.
Bellissens, C., Therouanne, P. & Denhiere,G. (2005). Deux modèles vectoriels de lamémoire sémantique: description, théorieet perspective. Le Langage et l’Homme, 39(2), 101-121.
Bock, J.S. & Clifton, C. (2000). The role ofsalience in conceptual combination. Me-mory & Cognition, 28, 1378-1386.
Brachman, R.J. (1978). A structural para-digm for representing knowledge. Cam-bridge, MA: Bolt, Beranck & Newman.
Cohen, B. & Murphy, G.L. (1984). Modelsof concepts. Cognitive Science, 8, 27-58.
Coolen, R., Van Jaarsveld, H.J. & Schreu-der, R. (1991). The interpretation of isola-ted novel nominal compounds. Memory &Cognition, 19, 341-352.
Cordier, F (1993). Les représentations cogni-tives privilégiées. Typicalité et niveau de base.Lille : Presses Universitaires de Lille.
Costello, F.J., Estes, Z., Gagne, C. & Wis-niewski, E.J. (2004). The diversity of Concep-tual Combination. Symposium in the the26th Annual Meeting of the CognitiveScience Society (CogSci 2004). August 4-7th.
Costello, F.J. & Keane, M.T (1997). Poly-semy in conceptual combination: Testingthe constraint theory of conceptual combi-nation. In Proceedings of the Nineteenth An-nual Conference of the Cognitive Science So-ciety. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Costello, F.J. & Keane, M.T (2000). Efficientcreativity: Constraint-Guided ConceptualCombination. Cognitive Science, 24(2), 299-349.
Costello, F.J. & Keane, M.T (2001). Testingtwo theories of conceptual combination:Aligment vs diagnosticity in the compre-hension and production of combinedconcepts. Journal of Experimental Psycho-logy : Learning, Memory & Cognition, 27(1),255-271.
Combinaisons conceptuelles nouvelles 301
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
Denhiere, & G., Baudet, S. (1992). Lecture,compréhension de textes et science cognitive.Paris : Presses Universitaires de France.
Downing, P. (1977). On the creation anduse of English compound nouns. Language,53, 810-842.
Dubois, D (1983). Analyse de 22 catégoriessémantiques du français. Organisation ca-tégorielle, lexique et représentation. L’An-née Psychologique, 83, 465 – 489.
Estes, Z. (2003). Attributive and relationalprocesses in nominal combination. Journalof Memory and Language, 48, 304-319.
Estes, Z. & Glucksberg, S. (2000). Interactiveproperty attribution in concept combination.Memory & Cognition, 28, 28-34.
Falkenhainer, B., Forbus, K.D. & Gentner,D. (1989). The structure mapping engine:Algorithm and examples. Artificial Intelli-gence, 41, 1-63.
Fillmore, C.J. (1968). The case for case. InE. Bach & R.T. Harms (Eds.), Unconstrai-neds in linguistic theory. New York: Holt,Rinehart & Winston.
Fischler, I. (1977). Semantic facilitation wi-thout association in a lexical decision task.Memory and Cognition, 5, 335-339.
Francis, W.N. & Kucera, H. (1982). Fre-quency analysis of English usage: Lexiconand grammar. Boston: Houghton Mifflin.
Francois, J. & Denhière, G. (1997). Séman-tique Linguistique et Psychologie Cognitive,Aspects théoriques et expérimentaux. Greno-ble : Presses Universitaires de Grenoble.
Gagne, C.L. (2000). Relation-based combi-nations versus property-based combina-tions : A test of the CARIN theory anddual- process theory of conceptual combi-nation. Journal of Memory and Language,42, 365-389.
Gagne C.L. (2002). Lexical and relationalinfluences on the processing of novelcompounds. Brain and Language, 81, 723-735.
Gagne, C.L. & Shoben, E.J. (1997). Influenceof thematic relations on the comprehensionof modifier-noun combinations. Journal of
Experimental Psychology : Learning, Memory& Cognition, 23, 71-87.
Gagne, C.L. & Shoben, E.J. (2002). Primingrelations in ambiguous noun-noun combi-nations. Memory & Cognition, 30, 637-646.
Gagne, C.L. & Spalding, T.L. (sous presse).Conceptual combination: Implications forthe mental lexicon.
Gagne, C.L., Spalding, T.L. & Gorrie, M.C.(sous presse). Sentential context and theinterpretation of familiar open-com-pounds and novel modifier-noun phrases.Brain and Language.
Gentner, D. (1981). Verb semantic structu-res in memory for sentences: Evidence forcomponential representation. CognitivePsychology, 13, 56-83.
Gentner, D. (1983). Structure-mapping: Atheoretical framework for analogy. Cogni-tive Science, 7, 155-170.
Gentner, D. (1989). The mechanisms ofanalogical learning In S. Vosniadou &A. Ortony (Eds.), Similarity, analogy andthought. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
Gentner, D. & Markman, A.B. (1994).Structural alignment in comparison: Nodifference without similarity. PsychologicalScience, 5, 152-158.
Gerrig, R.J. & Murphy, G.L. (1992). Contex-tual influences on the comprehension ofcomplex concepts. Language & cognitive Pro-cesses, 7, 205-230.
Gineste, Md & Scart-Lhomme, V. (1999).Comment comprendre des métaphores ?L’Année Psychologique, 99, 447 – 492.
Gleitman, L.R. & Gleitman, R. (1970).Phrase and paraphrase. New York: Acade-mic Press.
Glucksberg, S. & Keysar, B. (1990). Un-derstanding metaphorical comparisons:Beyond similarity. Psychological Review, 97,3-18.
Glucksberg, S., Manfredi, D. & Mcglone, M.S.(1997). How metaphors crate new catego-ries. In T.B. Ward, S.M. Smith & J. Vaid(Eds.), Creative thought: An investigation of
302 Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
conceptual structures and processes.Washington, DC: American PsychologicalAssociation.
Hampton, J.A. (1987). Inheritance of attri-butes in natural concept conjunctions. Me-mory & Cognition, 15, 55-71.
Hampton, J.A. (1997). Conjunction andnegation of natural concepts. Memory andCognition, 25, 888-909.
Heit, E. & Barsalou, L.W. (1996). The ins-tantiation principle in natural categories.Memory, 4, 413-451.
Holyak, K.J. & Thagard, P. (1989). Analo-gical mapping by constraint satisfaction.Cognitive Science, 13, 295-355.
Hummel, J.E. & Holyak, K.J. (1996). LISA: Acomputational model of analogical inferenceand schema induction. In Proceedings of theEighteenth Annual Conference of the CognitiveScience Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Kay, P. & Zimmer, K. (1976). On the se-mantics of compounds and genitives in En-glish. Sixth California Linguistics Associa-tion Proceedings. San Diego, CA: CampilePress.
Kintsch, W. & van Dijk, T.A. (1978). To-ward a model of text comprehension andproduction. Psychological Review, 85(5),363-394.
Le Ny, J.F. (1979). La sémantique psycholo-gique. Paris: Presses Universitaires deFrance.
Le Ny, J.F. (1980). Selective activities andelective forgetting in the process of unders-tanding and recall of semantic contents. InF. Klix et J. Hoffmann (Eds.), Cognitionand Memory. Berlin: VEB Deuscher Verlagder Wissenschaften.
Le Ny, J.F. - (1989) Science cognitive etcompréhension du langage, Paris, PressesUniversitaires de France.
Levi, J.N. (1978). The syntax and semanticsof complex nominals. New York: AcademicPress.
Levin, B. (1993). English verb classes and al-terations: A preliminary investigation. Chi-cago: University of Chicago Press.
Logan, G.D. (1990). Repetition primingand automaticity: Common underlyingmechanisms? Cognitive Psychology, 22, 1-35.
Lynott, D. & Ramscar. (2001). Can we mo-del Conceptual Combination using distri-butional information? In Proceedings of the3rd international Conference in CognitiveScience. Beijing.
Maguire, P. & Cater, A. (2004). Word ef-fects in Conceptual Combination. In Pro-ceedings of the 26th Annual Meeting of theCognitive Science Society (CogSci 2004).August 4-7th.
Markman, A.B. & Gentner, D. (1993a).Splitting the differences: A structural align-ment view of similarity. Journal of Memory& Language, 32, 517-535.
Markman, A.B., & Gentner, D. (1993b).Structural alignment during similaritycomparisons. Cognitive psychology, 23, 431-467.
Markman, A.B. & Wisniewski, E.J. (1997).Similar and different: The differentiationof basic level categories. Journal of Exeri-mental Psychology: Learning, Memory andCognition, 23, 54-70.
Marr, D. (1982). Vision. San Francisco:W.H. Freeman.
Martin, J.D. & Billman, D.O. (1994). Acqui-ring and combining overlapping concepts.Machine Learning, 16, 121-155.
Meyer, D.E. & Schvaneveldt, R.W. (1971).Facilitation in recognizing pairs of words:Evidence of a dependence between retrie-val operation. Journal of Experimental Psy-chology, 90, 227-234.
Miller, J.R. & Kintsch, W. (1980). Readabi-lity and recall of short prose passage: Atheoretical analysis. Journal of ExperimentalPsychology: Human Learning and Memory,6, 335-354.
Murphy, G.L. (1988). Comprehendingcomplex concepts. Cognitive Science, 12,529-562.
Murphy, G.L. (1990). Noun phrase inter-pretation and conceptual combination.
Combinaisons conceptuelles nouvelles 303
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
Journal of Memory & Language, 29, 259-288.
Murphy, G.L. (2002). The big book ofconcepts. Cambridge: MIT Press.
Neely, J.H. (1977). Semantic Priming andretrieval from lexical memory: Roles of in-hibitionless spreading activation and limi-ted-capacity attention. Journal of Experi-mental Psychology: General, 3, 226-254.
Neely, J.H. (1991). Semantic priming ef-fects in visual word recognition: A selactivereview of current findings and theories. InBesner D. & Humphreys G.W. (Eds.), Basicprocesses in reading: Visual word recogni-tion. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Neely, J.H. & Keefe, D.E. (1989). Semanticcontext effects on visual word processing:A hybrid prospective/retrospective proces-sing theory. In Bower G.H. (Ed.), The psy-chology of learning and motivation: Advan-ces in research and theory, Vol.24, SanDiego: Academic Press.
Nunberg, G. (1979). The non-uniquenessof semantic solutions: Polysemy. Linguis-tics and Philosophy, 3, 143-184.
Roediger, H.L. & Challis, B.H. (1992). Ef-fects of exact repetition and coceptual re-petition on free recall and primed wordfragment completion. Journal of Experi-mental Psychology: Learning, Memory andCognition, 18, 3-14.
Rosch, E. (1978). Principles of categoriza-tion. In E. Rosch & B.B. Lloyd (Eds.), Co-gnition and Categorization. Hillsdale, NJ:Erlbaum.
Rosch, E. & Mervis, C.B. (1975). Family re-semblance: Studies in the internal structureof categories. Cognitive Psychology, 7, 573-605.
Rumelhart, D.E. & Ortony, A. (1977). Therepresentation of knowledge in memory.In R.C. Anderson, R. Spiro & W.E. Monta-gue (Eds.), Schooling and the acquisition ofknowledge. Hillsdale, NJ: Lawrence Erl-baum.
Schank, R. (1972). Conceptual informationprocessing. New York: Elsevier.
Taft, M. & Forster, K.I. (1976). Lexical sto-rage and retrieval of polymorphemic andpolysyllabic words. Journal of Verbal Lear-ning and Verbal Behavior, 15, 607-620.
Thagard, P. (1984). Conceptual combina-tion and scientific discovery. In P. Asquith& P. Kitcher (Eds.), PSA: Proceedings(Vol.1). East Lansing, MI: Philosophy ofscience association.
Shoben, E.J. (1993). Comprehending nonpredicating conceptual combinations. InG. Nakamura, R. & Tataban, D. Medin(Eds.), The psychology of learning and mo-tivation (Vol 20). San Diego: AcademicPress.
Smith, E.E. & Osherson, D.N. (1984).Conceptual combination with prototypeconcepts. Cognitive Science, 8, 337-361.
Smith, E.E., Osherson, D.N., Rips L.J., &Keane, M. (1988) Combining prototypes:A modification model. Cognitive Science,12, 485-527.
Wilkenfeld, M.J. & Ward, T.B. (2001). Si-milarity and emergence in conceptualcombination. Journal of Memory and Lan-guage, 45, 21-38.
Wisniewski, E.J. (1994). Interpretations ofnovel noun-noun combinations (Technicalreport). Northwestern University, Depart-ment of Psychology.
Wisniewski, E.J. (1996). Construal and si-milatity in conceptual combination. Jour-nal of Memory & Language, 35, 434-453.
Wisniewski ; E.J. (1997). When conceptscombine. Psychonomic Bulletin & Review, 4(2), 167-183.
Wisniewski ; E.J. (1998). Property instanti-ation in conceptual combination. Memory& Cognition, 26, 1330-1347.
Wisniewski, E.J. (2000). Similarity, alignmentand conceptual combination: Comments onEstes and Glucksberg. Memory & Cognition,28, 35-38.
Wisniewski, E.J. (2001). On the necessity ofAlignment : reply to Costello and Keane(2001). Journal of Experimental Psychology:Learning, Memory & Cognition, 27, 272-277.
304 Sandra Jhean-Larose • Guy Denhière
L’année psychologique, 2006, 106, 265-304
Wisniewski, E.J. & Gentner, D. (1991). Onthe combinatorial semantics of noun pairs:Minor and major adjustments to meaning.In G.B. Simpson (Ed.), Understanding wordand sentence. Amsterdam: North Holland.
Wisniewski, E.J. & Love, B.L. (1998). Proper-ties versus relations in conceptual combina-tion. Journal of Memory and Language, 38,177-202.
Wisniewski, E.J. & Love, B.L. (2002). Rela-tions versus Properties in conceptual combi-nation. Journal of Memory and Language, 38,177-202.
Wisniewski, E.J. & Markman, A.B. (1993).The role of structural alignment in concep-
tual combination. Proceedings of the Fif-teenth Annual Conference of the CognitiveScience Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Wisniewski, E.J. & Medin, D.L. (1994). Onthe interaction of theory and data inconcept learning. Cognitive Science, 18,221-282.
Wisniewski, E.J. & Middleton, E.L. (2002).Of bucket bowls and coffee cup bowls: spa-tial alignment in Conceptual Combination.Journal of Memory and Language, 46, 1-23.
Wisniewski, E.J. & Storms, G. (souspresse). Does the order of head noun andmodifier explain response times in concep-tual combination?