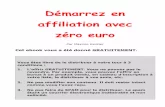Et si le participe passé s’accordait... avec l’objet affecté ?
Transcript of Et si le participe passé s’accordait... avec l’objet affecté ?
Book chapter
Peeters, Bert. (2013). Et si le parti ipe passé s’a ordait... ave l’o jet affecté? In Fabrice Marsac & Jean-Christophe Pellat (ed.), Le participe passé
entre accords et désaccords. Strasbourg: Presses de l’Université de Strasbourg. 67-81.
© Presses de l’Université de Strasbourg, 2013
SOMMAIRE
Fabrice Marsac, Jean-Christophe Pellat – Présentation.
Perspectives linguistiques
Jean-Christophe Pellat – L'accord du participe passé, entre poésie et grammaire ;
Fabrice Marsac, Sébastien Marengo – L'accord du participe passé des verbes de perception
régissant une construction infinitive : reconsidération en vue d'une représentation formelle en
Théorie Sens-Texte ;
Nuria Rodríguez Pedreira, Laura Pino Serrano – L'accord du participe passé des verbes
métrologiques : principes et applications ;
Bert Peeters – Et si le participe passé s'accordait… avec l'objet affecté ? ; Georges Farid – Le participe passé entre la tradition et l'avenir ;
Christel Le Bellec – Comment peut-on rendre les règles d'accord du participe passé
cohérentes ?
Damien Gaucher – L'accord du participe passé en français parlé en tant que variable
sociolinguistique ;
Zuzana Honová – Le participe passé en construction absolue et ses possibilités de traduction
vers le tchèque ;
Ewa Pilecka – Le polonais aurait-il un passé composé ?
Perspectives didactiques
Reine Pinsonneault, Marie-Josée Daviau – L’importance des relations syntaxiques dans les
phénomènes d’accord ; Marie-Noëlle Roubaud, Stéphanie Fonvielle – L’accord du participe passé en classe de sixième : « au hasard, mais avec de la bonne volonté… » ; Paula Bouffard, Adel Jebali – Antidote, un remède à l’accord du participe passé en français
langue seconde ?
Kyriakos Forakis – « Il nous avait assurés que tout serait prêt pour cette date » ou l’accord du participe passé à l’épreuve des « règles » (L1/L2) ; Martha Makassikis – Pistes didactiques pour l’accord du participe passé en français ;
Dan Van Raemdonck – L’accord du participe passé : réformes théorique et pratique.
Fabrice Marsac, Jean-Christophe Pellat – Conclusion.
This is not the published version, but page layout has been respected.
La présente version n’est pas conforme à la version publiée, mais la pagination a été respectée.
67
ET SI LE PARTICIPE PASSÉ S’ACCORDAIT…
AVEC L’OBJET AFFECTÉ ?
Bert Peeters Université Macquarie, Australie
« J’espère que nous allons pouvoir, lundi, à Bruxelles, allonger la liste des sanctions que nous avons pris à l’égard d’un certain nombre de personnalités responsables à la tête de la Syrie ». Mon correcteur Word a immédiatement identifié l’erreur que le ministre Alain Juppé avait commis – pardon, commise – lors d’une conférence de presse en Pologne en mai 2011. Il ne m’a pas signalé que j’avais omis l’accord du participe passé (désormais APP) commis. J’avais voulu tester mon logiciel et il m’a déçu. Quant à M. Juppé, il m’a déçu aussi.
Faut-il continuer à enseigner l’APP quand nos ministres et nos logiciels n’arrivent pas toujours à appliquer les règles en vigueur ?1 À mon avis, oui. Faut-il continuer à transmettre les règles contenues dans les grammaires de référence et les manuels ? J’ai envie de dire non, mais je n’en continue pas moins à enseigner les règles traditionnelles plutôt qu’une refor-mulation, quelle qu’elle soit, de peur que tôt ou tard, où que ce soit, mes étudiants ne retrouvent les règles qu’on connait et ne sortent tout confus de l’expérience. Faut-il encourager la prolifération de soi-disant « tolérances » ? Non. Maintenir des règles qui prescrivent l’APP sans pénaliser le non-accord, c’est faire un aveu
1 « Les plus hautes autorités ont trébuché sur un accord du participe passé qui se perd à l’oral mais reste la marque de la langue écrite... ou surveillée », affirme une page web intitulée Erreurs d’accord au plus haut niveau (<http://www.langue-fr.net/spip.php?article135>) où sont reproduits les énoncés incorrects de plusieurs présidents de la République (cf. aussi Campbell 2008).
68 d’impuissance : c’est dire que les règles existantes sont trop difficiles, mais sans vouloir les abolir. Prôner l’invariabilité systématique du participe passé (désormais PP) risque d’être trop radical : il y a des cas où l’accord parait plus naturel, de sorte qu’on a intérêt à le maintenir. Reformuler les règles, les rendre plus cohérentes et plus transparentes, fût-ce au prix de quelques entorses au « bon usage », puis enseigner les règles reformulées plutôt que les traditionnelles, doit surement être une voie plus prometteuse. Je m’y étais mis dans un article publié autrefois dans la revue Le français moderne (Peeters 1997). Ma proposition, me disais-je, allait surement plaire à ceux qui avaient souci de rendre l’APP plus facile à enseigner. Elle est cependant restée lettre morte. Sauf erreur, l’article n’a été cité que dans des études (Larjavaara 2000 ; Leeman 2004 ; Comănescu 2007) qui ne concernent pas (directement) l’APP. Aussi voudrais-je voir si quinze ans plus tard, moyennant quelques modifications, la règle de 1997 peut être relancée.
L’idée était – et est toujours – d’exploiter le fait « qu’à quelques exceptions près, l’objet direct des verbes conjugués avec avoir a le même ‘pouvoir’ que le sujet des verbes conjugués avec être, pourvu qu’il précède » (Peeters 1997 : 144). Ce pouvoir, c’est bien sûr d’imposer l’APP. Mais quel est le rapport entre le sujet des uns et l’objet direct des autres ? Je proposais trois réponses, dont deux s’inspiraient de la littérature générative de l’époque, alors que la troisième, qui m’était venue en lisant van Voorst (1988), allait plus loin. Je me cite :
Les trois approches se laissent résumer comme suit : a) A est une espèce de B (le sujet d’un verbe conjugué avec être est un objet
direct profond) ; b) B est une espèce de A (l’objet direct d’un verbe conjugué avec avoir est un
sujet passager) ; c) A et B sont l’un et l’autre des espèces de C (le sujet d’un verbe conjugué
avec être et l’objet direct d’un verbe conjugué avec avoir sont l’un et l’autre des objets affectés).
On aura compris que c’est la troisième approche que je défendais en 1997 et que je voudrais revisiter ici. Ni l’étudiant en FLE ni le locuteur natif non versé en linguistique ne gagnent rien à se voir expliquer qu’un PP conjugué avec être s’accorde avec le sujet parce que celui-ci est un objet profond,2 ou
2 C.à.d. un objet direct au niveau de la structure profonde. Dans le cas de certains verbes, dits inaccusatifs, cet objet profond se déplace pour aller occuper la position du sujet. On les a parfois appelés verbes ergatifs, terme plus ancien et parfois décrié (cf. Peeters 1998) motivé par le nom qu’on donne au cas sujet des verbes transitifs dans les langues ergatives (où le sujet des intransitifs peut être formellement assimilé à l’objet direct des transitifs, ce qui pourrait faire supposer qu’il s’agit d’un objet profond).
69 qu’un PP conjugué avec avoir s’accorde avec l’objet direct qui pré-cède parce que celui-ci est un sujet passager.3 L’explication qu’en dernière analyse, l’APP se fait systématiquement soit avec l’objet profond (où qu’il se trouve), soit avec un terme qui à un moment donné était sujet et l’est toujours, ou bien ne l’est plus, ne leur inspirera aucune confiance. Mieux vaut laisser ces histoires de déplacement ou de transformation et adopter la position que quel que soit l’auxiliaire, l’accord se fait toujours (moyennant certaines conditions) avec le même constituant qui, selon le cas, occupe la position du sujet (verbes conjugués avec être) ou de l’objet direct (verbes conjugués avec avoir). En 1997, j’appelais ce constituant objet affecté, sans me rendre compte que ce terme avait déjà été utilisé dans un autre sens. J’avais même eu l’audace d’écrire : « Le terme objet affecté […] est nouveau ».
Il l’était, pour moi qui me demandais comment appeler en français ce que Van Voorst (1988) appelait object of termination. Pour lui, tous les objets directs n’étaient pas forcément des « objets de termination » (Peeters 1990) ni des « objets de terminaison » (Bouchard 1992). En outre, Van Voorst ne s’intéressait ni à l’APP, ni même au français. Il avait simplement conçu la notion en s’appuyant sur les acquis de la grammaire générative de l’époque (sans être lui-même générativiste) et je me disais que l’idée avait du mérite, pourvu qu’on en élargît le domaine d’application. D’où ma décision de parler d’un objet affecté. Or, à mon insu, au moins deux auteurs (Blinkenberg 1960 ; Bally 1965) avaient pro-posé une distinction plus ou moins nette entre objets affectés et objets effectués (cf. aussi Gaatone 1998, Delbecque 2006, Riegel et al. 2009). Reprenons l’exemple qu’offre Delbecque (2006) : dans peindre un portrait, l’objet direct est objet effectué car le portrait n’a aucune existence préalable au processus désigné par le verbe, dont il est le résultat (ce qui veut dire, observe Gaatone, qu’un verbe comme construire ne prend que des objets effectués) ; alors que dans peindre la salle à manger, l’objet direct est objet affecté puisque le processus s’exerce sur une entité existante qui lui est extérieure (ce qui signifie que détruire, antonyme de construire, prend toujours un objet affecté). La différence est essentiellement sémantique. En outre, elle ne dépasse guère le cadre de l’objet direct ; dans ce sens plus ancien, un sujet ne saurait donc jamais être objet affecté ni objet effectué. C’est sur ce point que l’objet affecté tel qu’il est conçu ici diffère de celui de Bally, de Blinkenberg et des autres. Il ne s’oppose pas non plus à l’objet effectué, n’en déplaise à Comănescu (2007 : 103), qui mentionne Peeters (1997) parmi d’autres études recourant à l’opposition affecté/effectué. L’objet affecté
3 Autrement dit, un constituant qui, au cours de l’engendrement d’une proposition, traverse la position du sujet, en route vers sa position définitive, celle de l’objet direct.
70 nouvelle version (désormais OA) se laisse identifier à l’aide de la question Qui ou qu’est-ce qui est + PP ?4 P.ex. : Caroline est partie. Qui ou qu’est-ce qui est parti ? – Caroline ; ou encore J’ai perdu mes clés. Qui ou qu’est-ce qui est perdu ? – Mes clés. Regardons-y de plus près.
1. L’APP (auxiliaire être)
Conformément à la règle courante, le PP conjugué avec être s’accorde avec le sujet.
Celui-ci est toujours un OA et c’est avec lui, quelle que soit sa position, que se fait l’APP (1-2). Il en va de même dans les constructions passives (3) :
(1) Plusieurs soldats français sont morts ces derniers mois en Afghanistan Qui ou qu’est-ce qui est mort ? – Plusieurs soldats français
(2) Où sont passées les neiges d’antan ? Qui ou qu’est-ce qui est passé ? – Les neiges d’antan
(3) Les courses ont été faites par les jeunes : Julie, Marine et Nassir Qui ou qu’est-ce qui est fait ? – Les courses
S’il y a un attribut du sujet, il faudra éventuellement l’ajouter pour avoir un énoncé sémanti-quement complet. Comparez :
(4) Les sénateurs sont élus pour six ans Qui ou qu’est-ce qui est élu ? – Les sénateurs (5) La discussion est devenue plus agressive Qui ou qu’est-ce qui est devenu agressif ? – La discussion
2. L’APP (auxiliaire avoir)
Pour les verbes conjugués avec avoir, la règle en vigueur prescrit l’APP avec l’objet direct, pourvu qu’il précède – ce qui le plus souvent n’est pas le cas. Comme le sujet d’un verbe conjugué avec être, l’objet direct d’un verbe conjugué avec avoir est un OA. On peut donc reformuler la règle, et du coup
4 Au colloque d’Opole, j’avais maintenu l’heuristique adoptée dans Peeters 1997 (Quoi de neuf ? – X qui {être} + PP). Elle s’est heurtée aux objections de Dan Van Raemdonck et Marie-Noëlle Roubaud, que je remercie de m’avoir remis sur le bon chemin. La nouvelle approche n’est pas sans rappeler celle de Wilmet (1999), qui lui aussi part d’une paraphrase contenant l’auxiliaire être, mais sans proposer d’entorses aux règles tradition-nelles. Il me semble que la paraphrase adoptée ici a l’avantage d’être plus facile à manier dans les cours de FLE. D’un point de vue didactique, les variations de nombre et de temps dans la paraphrase qu’ (qui) est-ce qui est (était, sera …) PP ?, d’une part, et le recours à un clitique en cas de verbe pronominal (s’est (s’était, se sera …)), de l’autre, représentent en effet des distractions inutiles et potentiellement préjudiciables.
71 la rapprocher de celle formulée pour les verbes conjugués avec être, en disant que le PP conjugué avec avoir s’accorde avec l’OA, si ce dernier précède :
(6) Cette histoire, je l’ai vécue lors de la maladie de mon père Qui ou qu’est-ce qui est vécu ? – Cette histoire (7) Les amis que Véronique avait invités étaient tous là Qui ou qu’est-ce qui est invité ? – Les amis5
Quand l’OA suit (8-9), il n’y a pas d’accord. En l’absence d’OA (10) non plus :
(8) Un homme avait assassiné sa femme pour l’avoir réveillé Qui ou qu’est-ce qui est assassiné ? – Sa femme (9) Papa et maman ont fait les courses Qui ou qu’est-ce qui est fait ? – Les courses (cf. ex. 3) (10) Les bandits avaient frappé à sa porte tard dans la nuit Qui ou qu’est-ce qui est
frappé ? – Ø La question Qui ou qu’est-ce qui est + PP ? semble être impossible dans le cas du PP eu. Plutôt que de changer la question,6 je propose de formuler un premier correctif aux règles traditionnelles et de décréter que eu ne s’accorde jamais. Il se rapproche ainsi d’un autre PP invariable, à savoir été. Le rapprochement n’a rien d’incongru : avoir et être étant les deux auxiliaires par excellence de la langue française, il ne devrait pas être surprenant que dans leurs usages lexicaux, ils se comportent de la même façon (c.à.d. se conjuguent avec le même auxiliaire et soient invariables). On écrira donc :
(11) Quelle chance j’ai eu de rencontrer tant de vedettes ! Reste un dernier cas, celui du verbe disparaitre. L’APP ne se fait pas, bien que l’OA précède :
(12) À partir de ce moment-là, les problèmes ont disparu Qui ou qu’est-ce qui est disparu ? – Les problèmes
Pour justifier l’invariabilité, il faut prévoir une condition supplémentaire : l’OA doit précéder et il doit être différent du sujet. C’est de la même façon qu’on justifiera le non-accord dans La vitre a cassé et l’accord dans La vitre qu’il a cassée (Qui ou qu’est-ce qui est cassé ? – La vitre). La règle traditionnelle a l’avantage de n’imposer qu’une seule condition (l’objet direct doit précéder) ; elle a le désavantage de ne pas rapprocher l’APP avec avoir de celui avec être.
5 Dans le cas d’un OA objet clitique ou pronom relatif, la séquence proposée pourrait surprendre. Mais ce que proposent de faire les grammaires traditionnelles est tout à fait semblable. J’ai vécu quoi ? – Cette histoire (stric-tement parlant l’). Véronique avait invité qui ? – Les amis (strictement parlant que). 6 Dans Peeters (1997 : 157), afin d’éviter l’utilisation d’un tour inacceptable dans le cas du verbe avoir, la sé-quence Quoi de neuf ? – X qui {être} + PP prenait une forme légèrement différente.
72 3. L’APP (verbes pronominaux)
Les règles de l’APP des verbes pronominaux qu’on trouve dans les grammaires
et les manuels varient selon les auteurs et restent souvent incomplètes, invitant l’étudiant à commettre des erreurs. En résumé, on peut dire que l’APP se fait avec l’objet direct s’il précède ; qu’en l’absence d’objet direct, il ne se fait pas si le pronom réfléchi/réciproque est objet indirect ; et qu’il se fait avec le sujet dans tous les autres cas. Plutôt que de refor-muler la règle d’un seul coup, j’examinerai toutes les possibilités qui se présentent et formulerai des remarques au fur et à mesure. Mon but est d’apporter le moins de modifi-cations possible à la règle de l’APP telle qu’elle se dégage des deux volets précédents. On peut la résumer ainsi :
Pour savoir si un PP s’accorde, A
trouvez son OA en posant la question Qui ou qu’est-ce qui est + PP ?
B Le PP conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec l’OA
Le PP conjugué avec avoir ne s’accorde pas
C Exception : Le PP conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec l’OA si celui-ci précède et s’il est différent du sujet
Selon la règle établie, le PP des verbes pronominaux s’accorde avec l’objet direct antéposé : on adopte la règle de l’auxiliaire avoir quoique ces verbes se conjuguent avec être. Rien d’étonnant à cela, puisqu’être prend la place d’avoir dans le cas des verbes pronominaux transparents, c.à.d. réfléchis et réciproques. Comme l’objet direct qui précède est un OA, on pourra dire, dans une première approximation, que c’est la clause B ci-dessus qui s’applique :
(13) C’est effectivement la première chose que je me suis dite Qui ou qu’est-ce qui est dit ? – La première chose (14) Les enfants qui se sont adaptés aux guerres en seront victimes plus tard Qui ou qu’est-ce qui est adapté ? – Les enfants (15) Elle semble s’être plongée dans l’imprudence Qui ou qu’est-ce qui est plongé ? –
Elle C’est en fait le pronom se qui est OA dans (14-15) et non le sujet (les enfants, elle). Cependant, rien n’empêche d’attribuer le statut d’OA au sujet plutôt qu’au pronom : ils sont coréférentiels. Ne faudrait-il pas en conclure que l’accord, dans ce cas-là, ne doit pas se faire, puisque le sujet et l’OA coïncident ? Non, car l’identité du sujet et de l’OA ne s’oppose à l’accord que dans le cas de l’auxiliaire avoir (clause C).
Dans le cas des tours à sens passif, en revanche, c’est bien le sujet qui est OA. Le fait qu’il suit (17) ne pose aucun problème ; l’auxiliaire est être et l’APP
73 se fait avec l’OA, quelle que soit sa position. Des exemples comme (18-19) sont cependant problématiques :
(16) Cette conversation avec Magali s’est poursuivie longtemps encore Qui ou qu’est-ce qui est poursuivi ? – Cette conversation (17) L’époque où se sont formées ces coulées n’a été que récemment déterminée Qui ou qu’est-ce qui est formé ? – Les coulées (18) Il faut vérifier que les enfants se sont lavé les mains Qui ou qu’est-ce qui est lavé ? – Les mains (19) Maman s’est cassé la jambe en tombant dans l’escalier Qui ou qu’est-ce qui est cassé ? – La jambe
La règle ci-dessus prescrit l’accord, mais il ne se fait pas. Afin de refléter l’usage, il faudra compléter la clause B et prévoir une exception. Il y a invariabilité s’il y a un OA qui suit, à condition toutefois que sujet et OA soient différents, sans quoi l’APP dans des énoncés comme (2) est impossible à justifier. Cela nous donne la règle que voici, où la nouvelle exception (clause B) n’est pas sans rappeler celle de la clause C :
A Pour savoir si un PP s’accorde,
trouvez son OA en posant la question Qui ou qu’est-ce qui est + PP ?
Le plus souvent, le PP conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec l’OA
B Exception :
Le PP conjugué avec être ne s’accorde pas avec l’OA
si celui-ci suit et s’il est différent du sujet
Le plus souvent, le PP conjugué avec avoir ne s’accorde pas
C Exception :
Le PP conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec l’OA
si celui-ci précède et s’il est différent du sujet
Reste à voir ce que deviennent les PP conjugués avec être quand il n’y a pas d’OA :
(20) Les clients ne se sont aperçus de rien Qui ou qu’est-ce qui est aperçu ? – Ø
La recherche d’un OA n’aboutit pas. S’apercevoir de ne sert pas d’équivalent pronominal à apercevoir. C’est un verbe dont l’élément pronominal, inhérent, n’a aucune fonction précise. On prescrira l’accord avec le sujet, conformément à la règle traditionnelle. Cependant, en imposant l’APP des verbes pronominaux avec le sujet s’il n’y a pas d’OA, on fait fi de l’invariabilité traditionnelle du PP dans les énoncés du type (21), où le pronom réciproque est objet indirect. Pour préserver la transparence de la règle, je propose un deuxième cor-rectif : on généralise et on préconise dans ces cas minoritaires l’accord avec le sujet, comme dans (22) :
(21) Obama et Sarkozy se sont téléphoné (22) Obama et Sarkozy se sont téléphonés
74 Maintenir l’invariabilité aurait nécessité d’intégrer l’objet indirect dans la règle. Ce qui m’en a dissuadé, c’est qu’il s’agit d’une fonction qui n’a normalement aucun impact sur la varia-bilité des mots et qui ne joue aucun rôle au niveau de l’APP conjugué avec avoir. La règle unique illustrée dans (20) et (22) se laisse insérer dans le tableau de la façon suivante :
A Pour savoir si un PP s’accorde,
trouvez son OA en posant la question Qui ou qu’est-ce qui est + PP ?
Le plus souvent, le PP conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec l’OA
B Exception :
Le PP conjugué avec être ne s’accorde pas avec l’OA
si celui-ci suit et s’il est différent du sujet
C En l’absence d’un OA,
le PP conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet
Le plus souvent, le PP conjugué avec avoir ne s’accorde pas
D Exception : Le PP conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec l’OA si celui-ci précède et s’il est différent du sujet
D’aucuns seront tentés d’assimiler à (20) les exemples du type (23-24), tours réfléchis, et (25), tour pronominal à sens passif. Tout dépend du point de vue adopté : si on déclare qu’il n’y a pas d’OA, on fera l’accord avec le sujet, en vertu de la clause C ; si, au contraire, on accepte la réponse à la question comme étant valable, c’est la clause B qui s’applique :
(23) Comme par hasard, nous nous sommes retrouvés dans la même boite Qui ou qu’est-ce qui est retrouvé ? – ?Nous (24) Nous nous sommes connus il y a 25 ans Qui ou qu’est-ce qui est connu ? – ?Nous (25) Une erreur d’attribution s’est glissée dans notre article Qui ou qu’est-ce qui est glissé ? – ?Une erreur
Dans (23) et (25), les OA présumés ne sont pas des objets directs très convaincants non plus : nous n’avons pas retrouvé nous-mêmes et l’erreur n’a pas glissé elle-même dans l’article.
4. L’APP suivi d’un infinitif
S’il y a un infinitif qui suit, le cas le plus simple est celui du PP conjugué avec être :
(26) Les policiers étaient venus frapper à sa porte au milieu de la nuit Qui ou qu’est-ce qui est venu ? – Les policiers
(27) Nicole et Joëlle sont sorties faire leurs courses Qui ou qu’est-ce qui est sorti ? – Nicole et Joëlle
75 Il n’y a qu’un seul OA dans (26) ; il se rapporte au PP. L’infinitif n’a pas d’OA (cf. ex. 10). En revanche, il y a deux OA distincts dans (27), car l’infinitif en a un aussi (cf. ex. 3, 9). La règle ci-dessus s’applique. S’il y a deux OA distincts et que le PP se conjugue avec avoir, il n’y a pas de difficulté non plus. Le PP ne s’accorde que s’il a un OA qui précède :
(28) Elle est danseuse, mais je ne l’ai jamais vue danser Qui ou qu’est-ce qui est vu ? – Elle (= l’) (29) Hélas, je n’ai jamais vu danser Ghislaine Fallou Qui ou qu’est-ce qui est vu ? – Ghislaine Fallou
Les choses se compliquent dès que le PP se conjugue avec avoir et qu’il n’y a qu’un seul OA qui précède et qui a l’air de se rapporter aussi bien au PP qu’à l’infinitif. En vertu des règles traditionnelles, un objet direct précédant un PP suivi d’un infinitif se rapporte à l’un ou l’autre, jamais aux deux. S’il est sujet de l’infinitif, il est objet direct du participe, qui s’accorde. S’il se rapporte à l’infinitif, il n’a aucun statut par rapport au participe, qui reste invariable. C’est ainsi qu’on a toujours cherché à justifier l’accord dans (30) et le non-accord dans (31) :
(30) Les jeunes que nous avons entendus chanter allaient être circoncis (31) Ce sont des chants que nous avons entendu chanter pendant notre jeunesse
Faut-il appliquer le même raisonnement à l’OA ? Rappelons qu’un OA peut être partagé s’il est sujet, comme dans l’exemple (32), où le participe s’accorde :
(32) Plusieurs soldats français sont partis mourir dans des conflits loin de chez eux Qui ou qu’est-ce qui est parti (et est mort ; cf. ex. 1) ? – Plusieurs soldats français
Ce serait une contradiction de reconnaitre qu’un OA puisse être partagé dans certains cas (s’il est sujet du PP et de l’infinitif qui suit) et d’exclure cette possibilité dans d’autres (s’il en est l’objet direct). On admettra donc que des chants sert d’OA aussi bien à chanter qu’à entendu. Or, l’auxiliaire est avoir et l’OA précède, ce qui veut dire qu’en vertu de la règle ci-dessus l’accord doit se faire. Ce sera le troisième correctif que nous apporterons aux règles traditionnelles : le PP s’accorde aussi bien dans (33) que dans (34)7 :
7 Nous admettrons toutefois que dans certains cas – p.ex. celui de la fermière que j’ai entendu(e) tuer le chat – on opte pour l’invariabilité, dans la mesure où la réponse à la question Qui ou qu’est-ce qui est entendu ? risque d’être le chat plutôt que la fermière. Tout dépend du contexte. C’est bien la fermière que j’entends si l’acte s’accompagne d’éclats de rire et qu’il soit commis sur un animal déjà inconscient.
76
(33) Ce sont des chants que nous avons entendus chanter pendant notre jeunesse Qui ou qu’est-ce qui est entendu (aussi bien que chanté) ? – Les chants (34) Les jeunes que nous avons entendus chanter allaient être circoncis Qui ou qu’est-ce qui est entendu ? – Les jeunes
Qu’en est-il de l’invariabilité (obligatoire dans le cas du premier et facultative dans celui du second) des PP fait et laissé devant un infinitif ? Les grammaires traditionnelles y voient une irrégularité, mais ce n’en est pas une si on adopte la règle reformulée :
(35) Il n’a pas la conscience tranquille, avec tous ces gens qu’il a fait assassiner Qui ou qu’est-ce qui est fait ? – Ø (tous ces gens est OA d’assassiner ; cf. ex. 8)
(36) Elle maudissait tous les poils qu’elle avait laissé trainer Qui ou qu’est-ce qui est laissé ? – ?Les poils
L’OA dans (35) ne se rapporte pas au participe, qui reste donc invariable. Il en va de même partout où fait est suivi d’un infinitif. Le cas de laisser est moins clair. La tendance est à l’invariabilité (par analogie avec fait), et c’est ce qu’impose la règle adoptée ici. Certes, dans (36), les poils ne semble pas exclu comme OA du PP et l’APP ne devrait pas être proscrit. Cependant, quand on parle de poils qui sont laissés, laisser a un autre sens : à lui seul, il signifie ‘ne plus déranger’ ou bien ‘léguer’ ; suivi d’un infinitif, il implique une permission ou une tolérance. Excellente raison pour dire qu’il n’y a pas d’OA et que l’APP ne se fait pas.
Regardons enfin ce qui arrive si le verbe conjugué est pronominal. Le cas le plus fréquent est celui de se faire et se laisser, PP conjugués avec être qui n’ont pas d’OA :
(37) Angela Merkel s’est fait doubler dans un sondage de popularité Qui ou qu’est-ce qui est fait ? – Ø (38) Les électeurs ne se sont laissé ni acheter ni abuser par son style Qui ou qu’est-ce qui est laissé ? – Ø (39) Deux des jeunes se sont laissé(s) tomber par terre Qui ou qu’est-ce qui est laissé ? – Ø
En vertu de la règle proposée ici, l’APP se fait avec le sujet (clause C) ; il faudrait écrire s’est faite et se sont laissés. Traditionnellement, on a toujours écrit s’est fait ; pour se laisser, on distinguait deux cas (accord si le sujet est également sujet de l’infinitif, invariabilité ailleurs), mais cette distinction a été écartée au profit de l’invariabilité dans l’orthographe rectifiée de 1990. On traitera se faire et se laisser comme des exceptions et on y ajoutera se voir et s’entendre (pour lesquels ladite distinction ne semble pas avoir été abandonnée) :
(40) La conductrice de tram s’est vu menacer par une bande de voyous Qui ou qu’est-ce qui est vu ? – Ø
77
(41) Pierre et Régis se sont entendu condamner à quinze mois de prison chacun Qui ou qu’est-ce qui est entendu ? – Ø
5. Une nouvelle règle pour l’APP
Après intégration de l’exception qui vient d’être signalée, la règle de l’APP
se présente ainsi :
A
Pour savoir si un PP s’accorde,
trouvez son OA en posant la question Qui ou qu’est-ce qui est + PP ?
Le plus souvent,
le PP conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec l’OA
B Exception :
Le PP conjugué avec être ne s’accorde pas avec l’OA
si celui-ci suit et s’il est différent du sujet
Le plus souvent, en l’absence d’un OA,
le PP conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet
C Exception :
Le participe des verbes se faire, se laisser, se voir et s’entendre
ne s’accorde pas s’il est suivi d’un infinitif
Le plus souvent, le PP conjugué avec avoir ne s’accorde pas
D Exception :
Le PP conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec l’OA
si celui-ci précède et s’il est différent du sujet
Cette règle s’écarte de ce qu’on trouve dans les grammaires traditionnelles et les manuels de langue, mais aussi de ce que propose Peeters (1997) ; elle n’en décrit pas moins les mêmes faits linguistiques (observés pour la plupart dans la langue standard), à quelques exceptions près :
- le PP du verbe avoir reste invariable ; - le PP des verbes pronominaux sans objet direct s’accorde avec le sujet ; - le PP des verbes conjugués avec avoir et suivis d’un infinitif s’accorde avec un objet
direct qui précède, même s’il s’agit de l’objet direct de l’infinitif ; - le PP de se laisser, se voir et s’entendre ne s’accorde pas s’il est suivi d’un infinitif.
Chacune des clauses B, C et D comporte une règle introduite par les mots le plus souvent et suivie d’une exception qui y fait écho. B et C stipulent que pour les PP conjugués avec être, l’APP est la règle, que ce soit avec l’OA (clause B) ou avec le sujet (clause C). D stipule que pour les PP conjugués avec avoir, l’invariabilité est la règle. B et D ont été formulées de sorte à être aussi semblables que possible : il importait de montrer que les règles de l’APP ne sont pas aussi arbitraires et incohérentes qu’on ne l’a cru sur la base des descriptions existantes. B souligne que l’accord avec l’OA est la règle, sauf s’il
78
suit et est différent du sujet. D souli-gne que l’invariabilité est la règle, sauf s’il y a un OA qui précède et qui est différent du sujet.
L’ordre des clauses B, C et D n’a pas d’importance ; chacune a son autonomie. Sur ce point aussi, la nouvelle règle est supérieure. Au sein des règles traditionnelles régissant l’APP des verbes pronominaux, il y a un classement à ne pas perdre de vue : ce serait com-mettre une faute que de vouloir faire intervenir un pronom clitique objet indirect (qui bloque l’accord) avant un pronom relatif objet direct (qui l’impose).
Comparée à celle de Peeters (1997), la règle proposée ici a l’incomparable avantage de se prêter à une introduction progressive dans les cours de langue. Je reproduis cinq fois le tableau complet, en ne retenant que ce qu’il faut enseigner à un moment donné (en majuscules) et ce qui, à ce moment-là, est censé connu :
i. On commence par une règle bien connue de la tradition grammaticale : l’accord, avec le sujet, du PP conjugué avec être. L’apprenant sait déjà ce qu’est le sujet car il a ap-pris que le verbe conjugué doit s’accorder avec lui. On ajoute que si le PP est conju-gué avec avoir, il reste en général invariable :
A
B
C
LE PP CONJUGUÉ AVEC ÊTRE S’ACCORDE EN GENRE ET EN NOMBRE AVEC LE SUJET
D LE PLUS SOUVENT, LE PP CONJUGUÉ AVEC AVOIR NE S’ACCORDE PAS
ii. On explique qu’il y a des cas où le PP conjugué avec avoir s’accorde. On introduit
la notion d’OA et on montre que l’objet direct des verbes conjugués avec avoir et le sujet des verbes conjugués avec être sont tous deux des OA (d’où la disparition dans le tableau de la clause C). Ce rapprochement permettra à l’apprenant de voir le rapport entre les deux cas d’accord :
A POUR SAVOIR SI UN PP S’ACCORDE,
TROUVEZ SON OA EN POSANT LA QUESTION QUI OU QU’EST-CE QUI EST PP ?
B LE PP CONJUGUÉ AVEC ÊTRE S’ACCORDE EN GENRE ET EN NOMBRE AVEC L’OA
C
Le plus souvent, le PP conjugué avec avoir ne s’accorde pas
D EXCEPTION :
LE PP CONJUGUÉ AVEC AVOIR
S’ACCORDE EN GENRE ET EN NOMBRE AVEC L’OA SI CELUI-CI PRÉCÈDE
iii. On attire l’attention sur le fait qu’il y a des cas (relativement rares) où l’OA précède
un PP conjugué avec avoir sans que cela provoque l’APP (cas de verbes tels que disparaitre, casser) :
79
A Pour savoir si un PP s’accorde,
trouvez son OA en posant la question Qui ou qu’est-ce qui est PP ?
B
Le PP conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec l’OA
C
Le plus souvent, le PP conjugué avec avoir ne s’accorde pas
D Exception :
Le PP conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec l’OA
si celui-ci précède ET S’IL EST DIFFÉRENT DU SUJET
iv. On explique que les règles déjà assimilées permettent de se prononcer sur l’APP de la
plupart des verbes pronominaux. On introduit les exceptions du type (18-19). On ré-introduit le principe de l’APP avec le sujet dans le cas des verbes pronominaux qui n’ont pas d’OA :
A Pour savoir si un PP s’accorde,
trouvez son OA en posant la question Qui ou qu’est-ce qui est PP ?
LE PLUS SOUVENT,
le PP conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec l’OA
B EXCEPTION :
LE PP CONJUGUÉ AVEC ÊTRE NE S’ACCORDE PAS AVEC L’OA
SI CELUI-CI SUIT ET S’IL EST DIFFÉRENT DU SUJET
C EN L’ABSENCE D’UN OA, LE PP CONJUGUÉ AVEC ÊTRE
S’ACCORDE EN GENRE ET EN NOMBRE AVEC LE SUJET
Le plus souvent, le PP conjugué avec avoir ne s’accorde pas
D Exception :
Le PP conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec l’OA
si celui-ci précède et s’il est différent du sujet
v. On fait remarquer qu’il y a quatre verbes pronominaux dont le PP, suivi d’un infinitif,
reste invariable. On signale que si d’autres participes sont suivis d’un infinitif, les règles déjà assimilées s’appliquent telles quelles :
Pour savoir si un PP s’accorde,
A trouvez son OA en posant la question Qui ou qu’est-ce qui est PP ?
Le plus souvent,
le PP conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec l’OA B
Exception : Le PP conjugué avec être ne s’accorde pas avec l’OA si
celui-ci suit et s’il est différent du sujet
79 (suite)
LE PLUS SOUVENT, en l’absence d’un OA,
le PP conjugué avec être s’accorde en genre et en nombre avec le sujet
C EXCEPTION :
LE PARTICIPE DES VERBES SE FAIRE, SE LAISSER, SE VOIR ET S’ENTENDRE
NE S’ACCORDE PAS S’IL EST SUIVI D’UN INFINITIF
Le plus souvent, le PP conjugué avec avoir ne s’accorde pas
D Exception : Le PP conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec l’OA si celui-ci précède et s’il est différent du sujet
80
Conclusion
Certes, cette proposition d’apprentissage progressif ne fournit pas toujours
les mêmes résultats que les règles traditionnelles. En outre, il reste des cas non envisagés : les verbes précédés de l’objet direct en, les verbes impersonnels, les compléments circonstanciels après des verbes comme vivre, peser, couter, qu’il ne faut pas confondre avec des OA. D’autres recherches devront révéler si une intégration est possible. Le principal acquis de cette étude est de fournir une réponse à la question de savoir pourquoi, selon les règles traditionnelles, c’est le sujet qui compte dans un cas et l’objet direct dans l’autre : il s’agit chaque fois d’un OA. Les modalités de l’APP ne sont pas aussi arbitraires qu’il n’y parait : elles peuvent être décrites d’une façon uniforme et relativement simple. La prise en compte de l’auxiliaire et du sujet reste inévitable : l’OA, concept crucial dans le domaine de l’APP, n’est pas une panacée.
Bibliographie Bally, C. (1965) : Linguistique générale et linguistique française. Bern, Francke Blinkenberg, A. (1960) : Le problème de la transitivité en français moderne : essai syntacto-
sémantique. København, Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Bouchard, D. (1992) : « Accord du participe passé et choix d’auxiliaire ». De la musique à la lin-
guistique : hommage à Nicolas Ruwet, L. Tasmowski & A. Zribi-Hertz (dir.), 1992, pp. 191-204. Gand, Communication & Cognition
Campbell, J. (2008) : « Sarkozy and the past participle : accord… ou pas d’accord ? ». French Studies Bulletin, 2008, n°29 (106), pp. 1-4
Comănescu, F. (2007) : « Entre syntaxe et sémantique, l’objet interne serait-il une catégorie inventée ? ». Les journées de linguistique. Actes du XXIe Colloque, A. St-Pierre & M. Thibeault (dir.), 2007, pp. 101-108. Québec : Université Laval
Delbecque, N. (dir.) (2006) : Linguistique cognitive : comprendre comment fonctionne le langage. Bruxelles : De Boeck & Larcier / Duculot
Gaatone, D. (1998) : Le passif en français. Paris, Duculot Larjavaara, M. (2000) : Présence ou absence de l’objet : limites du possible en français
contemporain. Helsinki, Helsingin Yliopiston Verkkojulkaisut Leeman, D. (2004) : « Les aventures de Max et Ève, j’ai aimé : à propos d’un C.O.D. ‘Canada dry’
». Lexique, syntaxe et lexique-grammaire, C. Leclère, E. Laporte, M. Piot & M. Silberztein (dir.), 2004, pp. 405-412. Amsterdam, John Benjamins
Peeters, B. (1990) : Compte rendu de van Voorst (1988). Revue canadienne de linguistique, 1990, n°35, pp. 396-401
81
Peeters, B. (1997) : « L’accord du participe passé et la notion d’objet affecté ». Le français moderne, 1997, n°65, pp. 143-168
Peeters, B. (1998) : Compte rendu de B. Levin & M. Rappaport Hovav, Unaccusativity : at the syntax – lexical semantics interface (Cambridge MA, MIT Press, 1995). Word, 1998, n°49, pp. 300-304
Riegel, M., Pellat, J.-C. & R. Rioul (2009) : Grammaire méthodique du français. Paris, Quadrige / PUF
Van Voorst, J. (1988) : Event structure. Amsterdam, John Benjamins Wilmet, M. (1999) : Le participe passé autrement : protocole d’accord, exercices et corrigés.
Paris / Bruxelles, De Boeck & Larcier