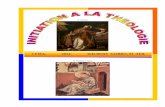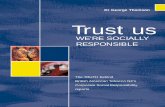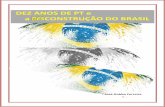ESCHATOLOGY, DR. WILBERT GOBBO
Transcript of ESCHATOLOGY, DR. WILBERT GOBBO
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 1
CFMA, 2012/13 WILBERT GOBBO, M. AFR.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 2
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE ....................................................................... 6
1 L’ESCHATOLOGIE DANS LA BIBLE .................................................... 7
1.1 L’ESCHATOLOGIE DANS L’ANCIEN TESTAMENT ............................ 10
1.2 L’ESCHATOLOGIE DANS LE NOUVEAU TESTAEMENT ................... 10
2 L’ESCHATOLOGIE DANS L’HISTOIRE ............................................ 12
2.1 ORIGENE ET L’ESCHATOLOGIE ............................................................. 12
2.2 IRENEE ET L’ESCHATOLOGIE ................................................................ 14
2.3 TERTULLIEN ET L’ESCHATOLOGIE ..................................................... 15
2.4 AUGUSTIN ET L’ESCHATOLOGIE .......................................................... 15
2.5 THOMAS D’AQUIN ET L’ESCHATOLOGIE ........................................... 17
3 LES APPROCHES DE L’ESCHATOLOGIE CHRETIENS ........... 18
3.1 L’ESCHATOLOGIQUE : LES LATINS ET LES GRECS ........................ 18
3.2 L’ESCHATOLOGIE : LES CATHOLIQUES ET LES PROTESTANTS 19
3.3 QUELQUES ECOLES DE L’ESCHATOLOGIE ........................................ 22 3.3.1 Eschatologie conséquente ........................................................................... 22
3.3.2 L’eschatologie intemporelle ........................................................................ 23
3.3.3 L’eschatologie existentielle ........................................................................ 23 3.3.4 L’eschatologie réalisée................................................................................ 23 3.3.5 L’eschatologie anticipée ............................................................................. 24 3.3.6 L’eschatologie inaugurée ............................................................................ 24
4 LES ELEMENTS DE L’ESCHATOLOGIE .......................................... 24
4.1 LA MORT......................................................................................................... 24 4.1.1 La mort dans la Bible .................................................................................. 24
4.1.1.1 La mort dans l’Ancien Testament ........................................................ 24 4.1.1.2 La mort dans le Nouveau Testament ................................................... 25
4.1.2 La Mort dans la tradition chrétienne ........................................................... 26
4.1.3 La mort selon le Catéchisme de l’Eglise Catholique .................................. 28
4.1.4 La mort dans les Traditions Africaines ....................................................... 30
4.2 L’AU-DELÀ ..................................................................................................... 31
4.2.1 L’au-delà dans la Bible ............................................................................... 31 4.2.2 L’au-delà dans la Tradition chrétienne ....................................................... 31 4.2.3 L’au-delà selon le Catéchisme de l'Église Catholique ................................ 32 4.2.4 L’au-delà dans les Traditions Africaines .................................................... 32
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 3
4.3 LA PAROUSIE ................................................................................................ 33
4.3.1 Parousie dans la Bible ................................................................................. 33 4.3.2 Parousie dans la tradition chrétienne .......................................................... 33 4. 3.3 Parousie selon le Catéchisme de l'Église Catholique ................................. 39 4.3.4 L’au-delà dans les Traditions Africaines .................................................... 40
4.4 LA RESURRECTION ..................................................................................... 40 4.4.1 La résurrection dans la Bible ...................................................................... 40 4.4.2 La résurrection dans la tradition chrétienne ................................................ 40 4.4.3 La résurrection selon le Catéchisme Catholique ......................................... 54
4.5 LE JUGEMENT............................................................................................... 57 4.5.1 Le Jugement dans la Bible .......................................................................... 57
4.5.1.1 Le jugement dans l’Ancien Testament ................................................ 57 4.5.1.2 Le Jugement dans le Nouveau Testament ............................................ 58
4.5.2 Le Jugement dans la Tradition chrétienne .................................................. 58 4.5.3 Le Jugement selon le Catéchisme de L'Église Catholique ......................... 60
4.5.4 Le Jugement dans les Traditions Africaines ............................................... 61
4.6 L’ENFER .......................................................................................................... 61 4.6.1 L’enfer dans la Bible ................................................................................... 61
4.6.1.1 L’enfer dans l’Ancien Testament ......................................................... 61 4.6.1.2 L’enfer dans le Nouveau Testament .................................................... 62
4.6.2 L’enfer dans la Tradition chrétienne ........................................................... 62
4.6.3 L’enfer selon le Catéchisme de L'Église Catholique .................................. 72 4.6.4 L’enfer dans les Traditions Africaines ........................................................ 74
4.7 LE PURGATOIRE .......................................................................................... 74 4.7.1 Le Purgatoire dans la Bible ......................................................................... 74
4.7.2 Le Purgatoire dans la Tradition chrétienne ................................................. 74
4.7.3 Le Purgatoire selon le Catéchisme de l'Église Catholique ......................... 75 4.7.4 Le Purgatoire dans les Traditions Africaines .............................................. 76
4.8 LE CIEL ........................................................................................................... 76 4.8.1 Le ciel dans la Bible .................................................................................... 77
4.8.1.1 Le ciel dans l’Ancien Testament .......................................................... 77 4.8.1.2 Le ciel dans le Nouveau Testament ..................................................... 78
4.8.2 Le ciel dans la Tradition chrétienne ............................................................ 78
4.8.3 Le ciel selon le Catéchisme de l'Église Catholique .................................... 84 4.8.4 La mort dans les Traditions Africaines ....................................................... 85
4.9 LE PARADIS ................................................................................................... 85
4.9.1 Le Paradis dans la Bible .............................................................................. 85 4.9.2 Le Paradis dans la Tradition chrétienne ...................................................... 86 4.9.3 Le Paradis selon le Catéchisme de l’Eglise Catholique .............................. 87 4.9.4 La mort dans les Traditions Africaines ....................................................... 87
4.10 LA VIE ETERNELLE .................................................................................. 87 4.10.1 La vie éternelle dans la Bible .................................................................... 87
4.10.2 La vie éternelle dans la Tradition chrétienne ............................................ 88
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 4
4.10.3 La vie éternelle selon le Catéchisme de l'Église Catholique .................... 88
4.10.4 La mort dans les Traditions Africaines ..................................................... 89
CONCLUSION ...................................................................................................... 90
QUELQUES QUESTIONS SUR L’ESCHATOLOGIE ......................... 91
BIBLIGRAPHIE ................................................................................................... 92
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 5
ESCHATOLOGIE : L’AU-DELA DE L’AU-DEÇA
CHRISTIANISME DU
MOYEN AGE
LA MORT
LA PAROUSIE
LA RESURRECTION
LE JUGEMENT
L’AU-
DEÇA Protologie?
TERRE
ICI-BAS
L’AU-DELA Eschatologie?
CIEL OU
PARADIS
PURGATOIRE
ENFER
LIMBE PATRIARCHES
LIMBES ENFANTS
SUPPLICES/DAMNES
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 6
INTRODUCTION GENERALE
Karl Barth, dans son commentaire de l'Épître aux Romains, affirme, « Un
christianisme qui n’est pas rigoureusement et absolument eschatologique n’a
rigoureusement et absolument rien de commun avec le Christ » (Der Römerbrief,
298). 1
Rahner nous donne le fondement de l’eschatologie en disant qu’Israël ne va plus vers
un futur décrété ou subi mais c’est le futur qui vient vers lui. 2
Il maintient que
l’eschatologie, c’est le problème de l’avenir. Le mot Eschatologie vient du grec
ἔσχατος, eschatos, dernier et λογία, logia, discours, science.
Autrefois, on appelait l’eschatologie « Traité des fins dernières ». Cette branche de la
théologie est concernée par la destination de la création (de l’être humain et de
l’univers).
Eschatologie ou fins dernières « désigne tout ce qui concerne la mort, le jugement,
le ciel, l’enfer, la résurrection, la vie éternelle… » 3
Dans cette liste des fins dernières nous pouvons ajouter la parousie (en grec,
parousia, la venue). Ce mot est associé avec le retour du Christ. Paul quelques fois
utilise le mot épiphanie (en grec, epiphainein, se manifester ou s’illuminer ou se
révéler) ou le mot apocalypse (en grec, apokalupsis, révélation ; apokaluptein,
révéler).
Il faut noter que Karl Rahner nous met en garde contre la conception de
« l’eschatologie » comme les « fins dernières ». L’eschatologie n’est pas non plus un
savoir additionnel, donc facultatif. Elle n’est pas un supplément ni hors-texte.
Également, il ne faut pas limiter l’eschatologie uniquement à l’au-delà des vies
individuelles. L’œuvre de la rédemption est une unité absolue assurée par l’Esprit
Saint. 4
Hans Urs von Balthasar est contre la définition de l’eschatologie comme « les fins
dernières » au pluriel, peut être il eut mieux valu écrire au singulier (fin dernière).
D’ailleurs, on ne peut pas mettre le bonheur, purification et damnation au même pied
d’égalité. Dieu d’amour est le seul point de référence : Il est le ciel pour la personne
qui l’accepte, le purgatoire pour qui se prépare à le rencontrer. Donc la fin de l’être
humain est unique : entrer au sein de Dieu, Amour tout-puissant. 5
Notre objectif principal est d’approfondir notre connaissance de l’eschatologie. Nous
allons viser une étude systématique et systémique de l’eschatologie. Le premier
1 Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 60 ; Cf. Pierre Philippe, Le Royaume des cieux, Paris,
Librairie Arthème Fayard, 1976, p. 23. 2 Cf. Karl Rahner, « Autour du concept de l’avenir », Écrits théologique no. 10, traduction R. Givord,
Paris, Edition Desclée de Brouwer, 1970, p. 98 ; André Manaranche, Celui qui vient, Paris, Éditions du
Seuil, 1976, p. 21. 3 Theo: L’Encyclopédie catholique pour tous, Paris, Droguet-Ardant, 1993, p. 897.
4 Cf. K. Rahner, « Principes théologiques relatifs à l’herméneutique des affirmations eschatologiques »,
Ecrits théologiques, no. 9, traduction R. Givord, Paris, Edition de Brouwer, 1968, p. 155-159. 5 Cf. Hans Urs von Balthasar, « Eschatologie », Questions théologiques aujourd’hui, tome II,
traduction Y. C. Gélébart, Paris, Edition Desclée de Brouwer, 1965, p. 271.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 7
chapitre analysera la fondation biblique de l’eschatologie. L’eschatologie dans
l’histoire fera partie du deuxième chapitre. Le chapitre trois traitera des différentes
approches de l’eschatologie. Le dernier chapitre analysera les différents éléments de
l’eschatologie : la mort, l’au-delà, la parousie, la résurrection, le jugement, l’enfer, le
purgatoire, le ciel, le paradis et la vie éternelle.
La méthode classique nous demande d’étudier les deux ‘loci theologici’ des écritures
(scriptura) et la tradition apostolique (traditio apostolica). Est-ce que nous pouvons
nous contenter de ces deux ‘piliers théologiques’ ? Pouvons-nous bâtir l’eschatologie
avec seulement ces deux ‘emplacements théologiques’ ? Pour mieux étudier
l’eschatologie notre méthode prendra également au sérieux un troisième ‘locus
theologicus’ du ‘contexte humain’ (contextus humanus). Nous allons regarder et
évaluer dans les Traditions Africaines la présence des éléments eschatologiques. De
nos jours tenir compte de la théologie contextuelle n’est pas une option. 6
1 L’ESCHATOLOGIE DANS LA BIBLE
Le mot « eschaton » (et d’autres mots de la même racine) se trouve à plusieurs
reprises dans le Nouveau Testament : escata Mt 12, 45 ; Lc 11, 26 ; 2 P 2, 20 ; Ap 2,
19 ; escataij Ac 2, 17 ; 2 Tm 3, 1 ; Jc 5, 3 ; escataj Ap 15, 1 ; escath Mt 27, 64 ;
Jn. 6, 39 ; Jn 6, 40 ; Jn 6, 44 ; Jn 6, 54 ; Jn 7, 37 ; Jn 11, 24 ; Jn 12, 48 ; 1 Co 15, 52 ;
1 Jn 2, 18 ; escatoi Mt. 19, 30 ; Mt 20, 12 ; Mt 20,16 ; Mc 10, 31 ; Lc 13, 30 ;
escaton Mt. 5, 26 ; Mc 12, 6 ; Mc 12, 22 ; Lc 12, 59 ; Lc 14, 9 ; Lc 14, 10 ; 1 Co 15,
8 ; escatoj Mc 9, 35 ; 1 Co 15, 26, 1 Co 15, 45 ; Ap 1, 17, Ap 2, 8 ; Ap 22, 13 ;
escatou Ac 1, 8 ; Ac 13, 47 ; He 1, 2 ; 1 P 1, 20 ; Jude 1, 18 ; escatouj 1 Co 4, 9 ;
escatw Mt 20, 14 ; 1 P 1, 5 ; escatwn Matt. 20, 8 ; 2 P 3, 3 ; Ap 21, 9 ; escatwj
Mc 5, 23.
Souvent, dans l’Ancien Testament la destinée finale de l’homme et du monde est
confondue avec l’attente d’un Messie qui inaugure une nouvelle période. Dans le
Nouveau Testament l’eschatologie s’ouvre au Royaume de Dieu dont toutes les
personnes sont appelées à faire partie. Le Royaume est lié avec le présent et le futur.
Le Royaume est déjà et pas encore. Le Christ a inauguré le Royaume et l'Église,
ainsi que toutes les personnes de bonne volonté sont appelées à continuer à annoncer
et à construire le Royaume. Ce Royaume sera réalisé/accompli avec le retour de Jésus
Christ. 7
Les Juifs de l’Ancien Testament attendaient le « jour de Yahvé »
1) Comme une menace (Am 5, 18-20)
2) Comme un objet d’espérance pendant l’exil (Jl 3, 4-5)
3) Comme un temps de jugement, après l’exil (Ml 3, 4-5)
6 Cf. Bevans, S., Models of Contextual Theology, Revised and Expanded Edition, (New York: Orbis
Books, 2002), pp. 3-4. ”There is no such thing as “theology”; there is only contextual theology:
feminist theology, liberation theology, Filipino theology, Asian-American theology, African theology
and so forth. Doing theology contextually in not an option…”
7 Cf. Theo: L’Encyclopédie catholique pour tous, Paris, Droguet-Ardant, 1993, p. 897.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 8
1 Co 10, 11, le moment de la dissolution du monde actuel.
Les images qui appartiennent au genre apocalyptique
Dans les évangiles synoptiques, l’eschatologie est présentée par la description d’une
prochaine ruine de Jérusalem avant l’avènement du jour du Seigneur (Mt 24).
Ce qui est nouveau par rapport à l’Ancien Testament, c’est la venue du Fils de
l’Homme dans sa gloire, la Parousie.
Le Christ, par sa résurrection, a ouvert les derniers temps : le Royaume de Dieu
s’achemine vers sa plénitude en réalisation des promesses prophétiques (Ac 1,11) ; ce
temps intermédiaire est celui de l'Église, sous la mouvance de l’Esprit (Jn 16, 5-15 ;
Rm 8, 14-29) ; L'Évangile du salut sera annoncé à toutes les personnes (Mt 28, 19-
20 ; Ac 1, 6-8) ; Il faut les préparer au « Jour du Seigneur », à son retour glorieux et
définitif. Il convient donc de veiller dans l’espérance (Mt 24, 42), puisque ce Jour
arrivera « comme un voleur en pleine nuit » (1 Th 5, 2), et il convient aussi de prier la
prière même du Christ « Que le Règne de Dieu vienne » (Mt 6, 10).
Il y aura un passage de « l’Ancien Monde », le monde du péché (Mt 13, 36ss ; Ap 16 ;
17) et ? que s’accomplira le jugement, « le monde nouveau » s’ouvrira (Ap 21, 1-8).
Également, l'Église, le signe précurseur de ce monde à venir, y trouvera elle-même
son accomplissement en la « Jérusalem céleste ». Elle rassemblera tous les rachetés en
Jésus Christ (Hb 12, 22-29 ; Ap 21, 10-27). Le Christ remettra toutes choses à son
Père (1 Co 15, 15, 25-28).
Nous ne devons pas négliger les questions eschatologiques posées : Quand est la fin
du monde (Lc 24, 21 ; Mt 24, 27)? Qui ou combien seront sauvé/s (Lc 13, 22 ; 26) ?
Et comment (Mt 18, 8-9) ?
Il est important de bien analyser les contextes des textes eschatologiques. Rahner
affirme qu’en faisant un parcours scripturaire il pouvait rassembler quelques
observations concernant la méthode en eschatologie. Elles ne sont que la mise en
forme d’idées déjà rencontrées. Rahner parle de la nécessité d’une eschatologie.
L’intelligence de la foi doit avoir une façon d’exprimer non pas seulement le passé et
le présent mais aussi le futur. En outre, il parle de trois attitudes dans l’eschatologie
classique qui ne s’accordent pas avec l’évangile : libérale et traite du Royaume
comme la finalité des nos actes, dialectique : Jésus Christ n’est qu’un moment
dépassé dans l’histoire et existentielle : qui considère l’individu de façon critique. Ces
trois attitudes présentent l’eschatologie chrétienne comme « pratique, dialectique et
critique » et « arraisonné ». L’eschatologie devient trop inhumaine, trop étrangère et
trop hétéronome. La théologie d’espérance avec celle de la politique aide à améliorer
notre vision de l’eschatologie. 8
Concernant l’immortalité humaine, il est important de dire, « le moi eschatologique
désigne en nous cette part d’irréductible, ce noyau du savoir, du sentir, ce choisir ne
8 Cf. K. Rahner, « Principes théologiques relatifs à l’herméneutique des affirmations eschatologiques »,
Ecrit théologiques, no. 9, traduction R. Givord, Paris, Edition de Brouwer, 1968, p. 141-170.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 9
peuvent paradoxalement être que désir, que rêve, que vouloir, sans objet
identifiable ». 9
D’une façon populaire, il y a quelques textes bibliques qui sont associés avec
l’eschatologie : Dn 9, 24-27 : Le temps des nations - le règne de l'antéchrist :
Dn 9, 24-27 :
[24] "Sont assignées 70 semaines pour ton peuple et ta ville sainte pour mettre un
terme à la transgression, pour apposer les scellés aux péchés, pour expier l'iniquité,
pour introduire l’éternelle justice, pour sceller vision et prophétie, pour oindre le Saint
des Saints.
[25] Prends-en connaissance et intelligence : Depuis l'instant que sortit cette parole
Qu'on revienne et qu'on rebâtisse Jérusalem jusqu'à un Prince Messie, sept semaines
et 62 semaines, restaurés, rebâtis places et remparts, mais dans l'angoisse des temps.
[26] Et après les 62 semaines, un messie supprimé, et il n'y a pas pour lui... la ville et
le sanctuaire détruits par un prince qui viendra. Sa fin sera dans le cataclysme et,
jusqu'à la fin, la guerre et les désastres décrétés.
[27] Et il consolidera une alliance avec un grand nombre. Le temps d'une semaine ; et
le temps d'une demi- semaine il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile du
Temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à la fin, jusqu'au terme assigné pour
le désolateur."
hf,[]y: wyl'ae tWrB.x;t.hi-!miW `yAG-j[;m.Bi ~c;['w> hl'['w> hm'r>mi hn"ydIm. yNEm;v.mib.W hw"l.v;B. 24 Wf['-al{ rv,a] hf'['w> aAby" hZ"Bi wyt'boa] tAba]w: wyt'boa] l[;w> rAzb.yI ~h,l' vWkr>W ll'v'w> wyt'bov.x.m; bVex;y> ~yrIc'b.mi `t[e-d[;w> %l,m,-l[; Abb'l.W AxKo r[ey"w> 25 bg<N<h; %l,m,W lAdG" lyIx;B. bg<N<h; lAdG"-lyIx;B. hm'x'l.Mil; hr,G"t.yI dmo[]y: al{w> daom.-d[; ~Wc['w> `tAbv'x]m; wyl'[' Wbv.x.y:-yKi WhWrB.v.yI AgB'-tp; ylek.aow> 26 ~ylil'x] Wlp.n"w> @Ajv.yI Alyxew> `~yBir; ~b'b'l. ~ykil'M.h; ~h,ynEv.W 27 bz"K' dx'a, !x'l.vu-l[;w> [r'mel. #qe dA[-yKi xl'c.ti al{w> WrBed;y> `d[eAMl; lAdG" vWkr>Bi Acr>a; bvoy"w>.
Dn 12, 1-2 : La grande tribulation, la double résurrection :
Dn 12, 1-2 :
[1] "En ce temps se lèvera Michel, le grand Prince qui se tient auprès des enfants de
ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors depuis
que nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera : tous ceux qui se trouveront
inscrits dans le Livre.
[2] Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les
uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. "
t[e ht'y>h'w> ^M,[; ynEB.-l[; dme[oh' tAyh.mi ht'y>h.nI-al{ rv,a] hr'c' t[eb'W ayhih; t[eh' d[; yAG ac'm.NIh;-lK' ^M.[; jleM'yI ayhih `rp,SeB; bWtK' rp'['-tm;d>a; ynEveY>mi
9 Louis-Vincent Thomas, et al., Réincarnation, immortalité, résurrection, Bruxelles, Publications des
Facultés universitaires Saint-Louis, 1988, p. 22.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 10
~yBir;w> 2 hL,aew> ~l'A[ yYEx;l. hL,ae Wcyqiy" s `~l'A[ !Aar>dIl. tApr'x]l; rh;zOK. Wrhiz>y: ~yliKif.M;h;w> .
Les autres textes sont : Dn 12, 11-12 : L'abomination qui désole ; Luc 21, 24 : Le
temps des nations ; Jn 5, 28-29 : La résurrection des justes et des impénitents ; 2 Tm
3,1-5 : Les temps fâcheux ; L'apostasie ; 2 Tm 4, 3-4 : L'apostasie de l'Église
professante ; 2 Th 2, 3-4 : L'Antéchrist ; 2 Th 2, 8-10 : Fin du temps de l'Église et
apostasie ; 1 Tm 4, 1ss : Mc 13, 22-27 : La Parousie ; 1 Th 4, 15-5, 3 : L'enlèvement
de l'Église ; 1 Co 15, 51-54 : Première résurrection et enlèvement ; 1 Corinthiens 15,
22-26 : La résurrection des justes ; 2 P 3, 10-13 : La destruction de notre monde ; Ap
11,3 : Les deux témoins ; Ap 12, 1-6 : Manigances diaboliques ; Ap 19, 19-20,6 :
Défaite de l'Antéchrist/millenium ; Ap 20, 7-21,4 : Défaite finale de Satan et
Jugement dernier.
1.1 L’ESCHATOLOGIE DANS L’ANCIEN TESTAMENT
Regardons ces textes : par rapport au jugement : Dies irae (jour de colère) ? Jr 15, 1-
2 ; Is 2, 11-19 ; So 1, 15-19 ; Jr 4, 23-26 ; Is 13, 10-13 ; Is 24, 5-6.18-20; Sg 4, 20-5,
23. Par rapport au sheol (Ps 6, 6; 9, 18-19; 16, 20; Dt 32, 22.
Promesse du salut? Is 52, 7; Is 30, 26; Is 25, 6-8; Ps 73, 23-28; le Seigneur
n’abandonnera pas mon âme aux enfers Ps 16, 5-11 ; de l’enfer à la vie éternelle (Dn
12, 2-3), le Seigneur régnera sur eux pour toujours (Dn 7, 27) ; le justes vivent
éternellement (Sag 5, 15-16). 10
Peut être la question que nous pouvons nous poser, y
a-t-il dans l’Ancien Testament des textes qui nous parlent du salut de tous ? Nous
pouvons ajouter que dans le livre d’Esdras il y une croyance que les élus de la
dernière génération vivront avec le Messie une vie bienheureuse de quatre cents ans
sur la terre (Esdras 4 ; 7, 28).
1.2 L’ESCHATOLOGIE DANS LE NOUVEAU TESTAEMENT
Concernant la question de l’après la mort dans la littérature paulienne, 1 Th 4, 13-
18 représente l’héritage de l’apocalyptique judéo-chrétienne, 1 Co 15, 50-57 donne
une interprétation apocalyptique; 2 Co 5, 1-10 reflète l’interprétation anthropologique
et Rm 8, 31-39 donne l’interprétation christologique. 11
La prière de notre Père nous parle du ciel « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom
soit sanctifié ! Que ton règne vienne ! Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux
cieux ! » (Mt 6, 9-10). Nous sommes invités à chercher d’abord le Royaume de Dieu
et sa justice, et tout le reste nous sera donné par surcroît (Mt 6, 33). Le jour exact de la
fin du monde reste inconnu (Lc 12, 40 ; Mt 24, 44), mais le Royaume qui
s’accomplira au dernier jour a déjà commencé (Lc 17, 20-21 ; Mt 12, 28 ; Mc 9, 1 ;
13, 32). Nous avons un mot sur la façon dont la fin du monde se passera (Mt 13, 40-
10
Cf. Pierre Grelot, Le monde à venir, Paris, Le Centurion, 1974, p. 29-44. 11
Cf. André Gounelle et François Vouga, Après la mort qu’y-a-t’il ?, Paris, Les Editions du Cerf,
1990, p. 129-167.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 11
43) et sur le grand jugement présidé par le Fils de l’Homme (Mt 25, 31-46 ; Jn 5,
22.27 ; Ap 1, 12-16). La parabole de Lazare et du riche (Lc 16, 19-31) nous parle de
la rétribution après la mort de chacun. Nous constatons quelques ressemblances entre
quelques textes de Daniel et Mc 13 : profanation du temple (Mc 13, 14 et Dn 9, 27 ;
11, 13) ; détresse de peuple de Dieu (Mc 13, 19 et Dn 12, 1) ; manifestation du Fils de
l’Homme (Mc 13m 26 et Dn 7, 13-14) dans le contexte d’un bouleversement
cosmique Mc 13, 24-25. Les disciples sont invités à se préparer pour l’arrivé du Fils
de l’Homme (Mc 13, 33-37 ; Mt 24, 37-51). Jésus annonce que le salut sera par la
croix (Mc 14, 24 et par. ; Lc 22, 20). Il rappelle qu’au-delà de la croix il y a la vie du
ressuscité (Mc 8, 31 ; 9, 31 ; 10, 34). 12
L’image du Christ-Juge est posé sur le texte de Jean où il nous dit que le but de
la venue de Jésus n’est pas le jugement mais plutôt donner le salut et la vie
éternelle (Jn 3, 16-20). Jésus dit, il ne juge personne (Jn 8, 15). Chaque personne, en
toute liberté, fait un choix, un jugement de sa vie présente comme future (Jn 12, 47).
Il ne faut pas confondre ce jugement personnel avec l’idée de la prédestination qui
ignore la liberté humaine. Les autres peuvent juger et accuser mais non pas le
Christ (Jn 5, 45 ; Mt 12, 41 ; 16, 19 ; 19, 28 ; 1 Co 6, 2). Le livre d’apocalypse donne
quelques détails sur le grand jour du jugement final (Ap 6, 9-11 ; 8, 2-5 ; 11, 16-18 ;
14, 1-5 ; 15, 2-4). Pourtant, il faut être prudent avec l’interprétation de ce livre qui
utilise un langage codé pendant le moment de la persécution du peuple de Dieu. Il y a
d’autres textes qui parlent du Jour de Dieu, le Jour du Christ ou le Jour du jugement (2
P 3, 7.12 ; 1 Co 1, 8 ; 5, 5 ; 2 Co 1, 14 ; Ph 1, 6.10 ; 2, 16 ; 1 Th 4, 15-17 ; Col 3, 1 ; 1
Jn 3, 2 ; Rm 8, 19 ; 1 P 4, 7 ; Lc 12, 40). Suite à ce jugement, la bible ne parle pas
seulement de la vie éternelle mais aussi de la mort éternelle (la seconde mort) (Ap 19,
11-21 ; 20, 14-15 ; 21, 5-8 ; 2 Th 2, 8). Peut-être nous pouvons-nous poser une
question, « S’il n’y avait pas pour les hommes ce risque de damnation finale, la mort
du Christ aurait-elle eu une raison d’être ? ». Chacun va comparaître devant le
tribunal du Christ et il rendra chaque selon ses œuvres (1 Co 3, 8 ; 2 Co 5, 10 ; Ap 2,
23 ; 20, 12 ; 22, 12 ; Jn 5, 25.28-29). La parousie est aussi une indication de la fin des
temps (Ap 1, 7 ; Mt 24, 30). Il y a des textes qui parlent du salut de tous (1 Co 15, 51-
53). La création entière est en attente de sa rédemption (Rm 8, 18-23). Il y a une
invitation à l’espérance à la résurrection (2 Co 4, 14). Il y aura un ciel nouveau (Ap
21, 1-5), la nouvelle Jérusalem (He 12, 22-24). Le martyrs seront auprès de Dieu
éternellement (Ap 7, 15—17). 13
L’eschatologie chez les apôtres: ils ont souligné sur la personne et l’œuvre du Christ
ressuscité qui est établi par Dieu comme le juge des vivants et des morts (Ac 2, 24 ; 3,
15 ; 10, 42). Au jour du jugement, seuls seront sauvés ceux qui auront cru en Lui (Ac
3, 17-26). Il y a une espérance que le retour du Christ sera une grande joie pour les
fidèles (1 Thes 1, 10 ; 2, 19 ; 3, 13) et tristesse pour les impies destinés à une
condamnation éternelle (2 Thes 1, 8-9). Les fidèles qui sont morts ressusciteront
d’abord, puis les vivants (1, Thes 4, 13-18). Paul tient qu’au jugement futur, qui
12
Cf. Pierre Grelot, Le monde à venir, Paris, Le Centurion, 1974, p. 47-55. 13
Cf. Ibid., p. 61-81.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 12
s’exercera par le feu, chacun devra rendre compte de sa conduite (1 Co 3, 13-15). Les
chrétiens doivent se préparer avant de devenir les juges du monde (1 Co 6, 2), En
célébrant l’Eucharistie, ils annoncent le retour du Christ (1 Co 6, 2). Ils doivent veiller
afin de ne pas être condamnés avec le monde (1 Co 11, 32). Lorsque reviendra le
Seigneur, les morts ressusciteront et les vivants seront transformés (1 Co 15, 52). Il
ressuscitera avec ceux qui l’ont fait connaître et aimer (2 Co 4, 7-15). Nous allons
avoir un corps glorifié et transfiguré (2 Co 5, 3-4).
Paul tient que la vie éternelle est déjà attente en quelque façon (Ga 2, 20). Il donne
l’espérance en disant que par sa mort et sa résurrection le Christ a déjà sauvé les siens
de la corruption (Gal 1, 4). La lettre au Romains est très eschatologique : Il y a la vie
éternelle et la perdition éternelle (Rm 2, 5-13), les baptisés sont déjà ressuscités avec
le Christ (Rm 6, 3-8), si l’Esprit habite en nous, nous recevrons la vie éternelle (Rm
8,11). Paul également dans l’épître aux Ephésiens parle du jour de la rédemption (Eph
4, 30), les fidèles qui sont mort avec le Christ, ressusciteront avec lui (Eph 2, 5-6 ; Col
3, 3). Il maintient que lorsque le Christ reviendra tout le monde apparaîtra avec lui
dans la gloire (Col 3, 3). Sans sa vieillesse Paul continue à espérer le Jour du Seigneur
(1 Tm 6, 15 ; 2 Tm 4, 8 ; Tt 2, 13). Certains dissidents s’égarent en parlant de
l’accomplissement total de la résurrection (2 Tm 2, 17) et Paul leur jette l’anathème (1
Tm 1, 19). Paul a espéré, pour lui et pour le juste, la récompense le Jour du Seigneur
(2 Tm 4, 7-8). Paul met l’accent sur la résurrection glorieuse plus que l’enfer. Jacques
parle des sanctions du jugement dernier (Jc 5, 7-9). Pierre insiste sur le retour du
Christ qui viendra juger le vivants et les morts (1 P 4, 5 ; 2 P 3, 4.7-10). Chez Jean, il
y a une spiritualisation de l’eschatologie (Jn 3, 18 ; 1 Jn 3, 14 ; 3, 2). C’est le livre
d’apocalypse qui parle davantage de l’eschatologie (Ap 21, 1-4).
2 L’ESCHATOLOGIE DANS L’HISTOIRE
2.1 ORIGENE ET L’ESCHATOLOGIE
Origène, Clément d’Alexandrie, Grégoire de Nysse sont considérés
« miséricordieux » en proposant le salut universel.
La position anthropologique d’Origène est marquée par son milieu intellectuel. Il
souligne la liberté de tous les êtres humains. Tous tombent dans le péché. Pour nous
aider à trouver notre identité spirituelle perdue Logos se fait matière. 14
Origène faisait de l’Enfer un purgatoire. Ceci a conduit à son témoignage en faveur de
la croyance aux peines purificatrices. Origène a influencé les Cappadociens dans ces
conceptions eschatologiques. Pourtant, ils hésitent quelque peu sur l’éternité des
peines.
Concernant le feu de l’enfer, Origène tient, « Nous trouvons dans le prophète Isaïe
que chaque pécheur a son propre feu qui le châtie : « marchez, dit-il, à la lumière de la
flamme que vous vous êtes allumée vous-même (Is 50, 11) ». Ces paroles semblent
indiquer que chaque pécheur allume pour lui-même de son propre feu, et qu’il n’est
14
Cf. Frédéric Bertrand, Mystique de Jésus chez Origène, coll. « Théologie » no. 23, Paris, Edition
Aubier, 1951.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 13
pas plongé dans quelque feu qui aurait été auparavant allumé par un autre et qui aurait
existé avant lui. De ce feu, l’aliment ce sont nos péchés, que l’Apôtre appelle bois,
paille et foin (1 Co 3, 12). Il me semble que… dans l’âme après qu’elle a accumulé en
elle-même une abondante multitude d’œuvres mauvaises et de péchés, au temps
marqué, tout cet amas de malices s’échauffe en vue du supplice et s’enflamme pour le
châtiment… A ce genre de supplices viendra s’en ajouter un autre, lorsqu’on nous
arrache un membre, nous éprouvons de vives souffrances, mais l’âme, séparée de
Dieu, à qui elle aurait dû être unie, souffrira bien davantage de ce déchirement.
Tiraillée en mille sens divers, elle sera comme divisée d’avec elle-même, et en place
de l’unité harmonique à laquelle Dieu la destinait, elle offrira le spectacle du désordre
et de la confusion ». 15
Jean-Marc Dufort constate deux principes généraux dans la doctrine d’Origène sur
l’enfer : « Elle relève, dit-on ordinairement, de deux principes généraux, qui ont
profondément inspiré sa doctrine eschatologique. D’abord, Origène tend à considérer
le langage eschatologique de la Bible comme directement applicable à l’expérience
religieuse du chrétien individuel. La « rénovation de toutes choses » s’applique donc à
la vie chrétienne en particulier, et la fixation du choix libre par la mort est révocable à
la fin des temps. En outre le thème de l’unité du monde conduira Origène à concevoir
un monde unique qui se développe et travaille sous la conduite de la Providence pour
le plus grand bien de l’homme. L’idée d’une mort qui met fin au « status viae » se
perd donc dans ce grand Tout unifié, que le Logos entraîne après lui vers le salut
définitif ». 16
Origène aborde la question de la résurrection de la chair, « A la résurrection cette
forme corporelle qui distingue Pierre ou Paul revêt de nouveau l’âme, d’ailleurs
embellie ; mais sans le substratum qui lui fut primitivement assigné… ainsi, pour
hériter du royaume des cieux et habiter une région différente de la terre, il nous faut
des corps spirituels : notre forme première ne disparaîtra point pour autant, mais elle
sera glorifiée, comme la forme de Jésus et celle de Moïse et d’Elie restait la même
dans la transfiguration… Le corps du saint sera conservé par celui qui jadis donne une
forme à la chair ; la chair ne subsistera pas, mais les traits jadis imprimés à la chair
seront dès lors imprimés au corps spirituel ». 17
Nous voyons chez Origène une tendance au salut universel : « Tu auras donc de la
joie lorsque tu quitteras cette vie, si tu as été saint. Mais alors seulement ta joie sera
pleine, lorsqu’il ne manquera aucun membre à ton corps. Car toi aussi tu attendras les
autres comme tu fus toi-même attendu. Que si à toi qui n’est qu’un membre, la joie ne
semble pas parfaite tant qu’un autre membre manque, combien plus notre Seigneur et
Sauveur, qui est la Tête et l’Auteur de tout le corps, estime que sa joie n’est point
parfaite, tant qu’il voit quelque membre manquer à son corps… Il ne veut donc pas
15
Origène, Des principes, II, 10, 4-5 ; P. G., II, 236-238, trad. Bardy, Origène, Coll. « Les Moralistes
chrétiens », p. 99-100, et D. T. C., t. XI, 1547. 16
Jean-Marc Dufort, A la rencontre du Christ Jésus : Précis d’Eschatologie chrétienne, Paris, Les
Editions Desclée & Cie, p. 144-145. 17
Origène, In Ps. I, 5 ; P. G., 12, 1093 A – 1096 B ; voir le texte conservé dans Méthode, De
resurrectione, I, 22, Ed. Bonwetsch, 1917, p. 244-247, trad. D’Als, D. A. F. C., t. IV, 995.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 14
recevoir sans toi sa gloire parfaite ; sans toi, c’est-à-dire sans son peuple qui est son
corps et ses membres ». 18
En outre, il dit, « L’apôtre espère que c’est tout le Corps de
l’Eglise qui doit être racheté, et il ne crois pas que la perfection ne puisse être à
chacun des membres à moins que le corps tout entier ne soit pour de bon réuni ». 19
Bien que Origène était condamné nous ne pouvons pas ignorer sa contribution et son
influence dans l’eschatologie : « Origène a été condamné (parce que des disciples
sans discrétion ont répandu sa prétendue doctrine de la « restitution » de toute
chose »). D’autres Pères de l'Église ne l’ont jamais été, bien qu’ils aient soutenu
ouvertement l’apocatastase, ainsi Clément d’Alexandrie, Grégoire de Nysse et
Didyme l’Aveugle, sans compter Jérôme avant ses démêlés avec Rufin ; d’autres l’ont
proposée plus discrètement, considérant que seuls les chrétiens arrivés à la maturité
pouvaient la porter, ainsi Grégoire de Naziance et Maxime le Confesseur. D’autre
part, il est vrai les « sermons pour le peuple » n’ont pas manqué, qui « chauffaient
l’enfer » pour leurs auditeurs : dans le genre horrible, c’est sans doute Basile qui
l’emporte, tandis que Chrysostome adoucit quelque peu le tableau ; ils ne font que
populariser une doctrine que l’on a vue depuis les origines de l'Église ». 20
2.2 IRENEE ET L’ESCHATOLOGIE
L'Apocalypse a véhiculé l’eschatologie chrétienne. Il y avait un millénarisme naïf
d’un côté et un origénisme savant de l’autre. Irénée rapporte avec complaisance les
propos que Papias disait tenir de Jean en personne : « Il viendra des jours où les
vignes croîtront, qui auront chacune dix mille ceps, et sur chaque cep dix mille
branches, et sur chaque branche dix mille bourgeons, et sur chaque bourgeon dix
mille grappes, et sur chaque grappe dix mille grains, et chaque grain pressé donnera
vingt-cinq mesures de vin ». 21
Irénée a beaucoup contribué à dénoncer certaines interprétations millénaristes « des
fables ineptes et de vaines fictions » et à stigmatiser les romanciers de l’eschatologie
qui « roulent dans un abîme de niaiseries et de non sens » et de permettre au livre
suspecté, l’Apocalypse d’entrer dans le canon biblique. 22
Irénée, Justin et Grégoire le
grand admettent des sanctions dès le lendemain de la mort, mais elles sont très
imparfaites, le vrai jugement aura lieu à la résurrection. 23
Irénée était contre la doctrine de la récapitulation esquissée par saint Paul dans Eph
1,10. Pour Irénée, « Le monde sera purifié comme par un feu, non pas jusqu’à
18
Origène, Homélie 7 sur le Lévitique, note 2, Edition Baehrens, p. 374. Cf. H. de Lubac,
Catholicisme : Les aspects sociaux du dogme, 5e Edition, Paris, 1952, p. 356-360.
19 Origène, Comment. A Rom. 7, 5. La même position est répété par Chrysostome : « La Tête n’est pas
vraiment la Tête et le Corps n’est vraiment parfait que lorsque nous sommes tous rassemblés et
étroitement unis ensemble » (In Eph. Hom. III in 1, 23) 20
Hans Urs von Balthasar, Espérer pour tous, Paris, Declée de Brouwer, 1987, p. 50-51. 21
Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre 5, tome II, coll « Sources chrétiennes » no. 153, Paris,
Edition du Cerf, 1969, 415. 22
Cf. Henri de Lubac, Histoire et Esprit : L’intelligence de l’Ecriture d’après Origène, coll.
« Théologie », no. 16, Paris, Edition Aubier, 1950, p. 103. 23
Cf. Adv. Haer., V, 31, 1-2; Justin, Dialogue, V, 3 (Ed. Archambault, Ip. 31) ; Grégoire le Grand,
Dialogue, IV, 29 ; P. L., 96, 483-486.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 15
l’annihilation, mais pour être transformé et renouvelé et finalement mis tout entier au
service des justes. Alors la matière elle-même jouira de l’incorruptibilité et la
splendeur du corps du Seigneur ressuscité transformera tout l’univers en royaume
glorieux (cf. Phil. 3, 20) ». 24
2.3 TERTULLIEN ET L’ESCHATOLOGIE
Ce fervent spiritualiste, admet mille ans de compensation pour les chrétiens comme
dédommagement des biens auxquels ils ont renoncé sur la terre. 25
En parlant de la « résurrection de la chair » il maintient que notre chair est la « sœur
du Christ ». Tertullien écrit : « Cette chair que Dieu assembla de ses mains à l’image
de Dieu, qu’il anima de son souffle à la ressemblance de sa puissance de vie, qu’il
établit pour habiter dans toute son œuvre…cette chair-là ne ressusciterait pas après
avoir été tant de fois la chose de Dieu ? Arrière, arrière, la pensée que Dieu puisse
abandonner à une destruction éternelle l’œuvre de ses mains, l’objet des soins de son
intelligence, l’enveloppe de son souffle, le reine de sa création, l’héritière de sa
libéralité, le prêtre de sa religion, le soldat qui lui rend témoignage, la sœur de son
christ. Nous savons que Dieu est très bon, nous apprenons de son Christ qu’il est le
seul très bon. C’est lui qui commande l’amour du prochain à la suite du sien, il fait
donc lui-même ce qu’il enjoint : il aime la chair qui est son prochain à tant de
titres ».26
Concernant la résurrection de la chaire, Tertullien ajoute, « La substance de nos corps
acquerra un état nouveau, mais elle sera maintenue. Ne serait-ce pas une chose
absurde, unique et, par conséquent, indigne de Dieu de récompenser une autre
substance que celle qui a travaillé ? Quoi ? C’est une chair qui a été déchirée par les
bourreaux et une autre serait couronnée ? C’est une chair qui se sera vautrée dans
l’impureté et une autre serait damnée ? J’aime mieux renoncer à l’espoir de la
résurrection que de me moquer ainsi de la majesté et de la justice de Dieu ». 27
2.4 AUGUSTIN ET L’ESCHATOLOGIE
Il parle de double résurrection. La première, sur terre, pour les bons chrétiens un
millénaire de bon temps en vue de se rattraper les joies privées. La seconde pour tous,
pour des assises générales de l’humanité. 28
Lorsque Tyconius, un ex-évêque
donatiste, interprète les mille ans comme le temps dont lui-même vivait, Augustin
24
Jean-Marc Dufort, A la rencontre du Christ Jésus : Précis d’Eschatologie chrétienne, Paris, Desclée
& cie, 1974, p. 52. 25
Cf. Tertullien, « Contre Marcion », 3, 24 ; P. L. 2, 355. 26
Tertullien, La résurrection de la chair, L IX, P.L. 2, 807 ab, traduction. J. Moingt.. 27
Tertullien, Sur la résurrection des corps, no. 7-9, 56 ; Corpus christianorum, t. II, p. 930-932, 1003,
trad. Turmel. 28
Cf. Augustin, Sermon, 259, 2, P. L. 38, 1197.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 16
montre que le nombre est purement symbolique et qu’il exprime le temps dans sa
plénitude. Sans renoncer à l’eschatologie, il l’a détemporalisé et dématérialisé. 29
Un des éléments très contesté d’Origène est sa conception de réincarnation en vue de
complètement éliminer le mal. Cette position conduit à une vision, une succession
indéfinie des mondes. Ce point est contradictoire avec la foi chrétienne. 30
Il
ressemble à la doctrine qui assure une fin heureuse pour tous (en grec, apocatastase,
une restitution). Bien que l’apocatastase a été condamnée par l’Eglise (DS 411), 31
L'Église n’a pas rejeté la restauration de toutes choses dans le Christ (Ac 3, 21) mais
sa forme philosophique (platonicienne).
Concernant le feu du jugement, Augustin dit, « Que je ne sois pas de ceux à qui tu
diras : ‘Allez au feu éternel ; préparé pour le démon et pour ses anges’. ‘Ne me
corrige pas dans ta colère’, mais purifie-moi en cette vie, fais-moi tel que je n’aie pas
à redouter ce feu purificateur, destiné à ceux qui seront sauvés à travers le feu.
Pourquoi ce feu ? Parce qu’ils ont bâti sur le fondement avec du bois, du foin, de la
paille. S’ils avaient bâti avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, ils n’auraient
à redouter ni l’un ni l’autre feu, non seulement le feu éternel qui tourmentera les
impies, mais celui qui corrigera ceux qui seront sauvés à travers le feu. Il est dit en
effet : ‘il sera sauvé, mais comme à travers le feu’ (1 Co 3, 15). Parce qu’il est dit : ‘il
sera sauvé’, on méprise ce feu et, cependant, bien qu’on soit sauvé par le feu, ce feu
sera plus terrible que tout ce qu’on peut imaginer en cette vie ». 32
Concernant le sort des âmes, Augustin donne un commentaire sur la résurrection de
Lazare (Jn 11, 11). Il tient, « Toutes les âmes, à leur sortie de cette vie, ont des
demeures diverses. Bonnes, elles sont dans la joie ; mauvaises, dans les tourments.
Après la résurrection, la joie des premières sera accrue, les tourments des autres
augmenteront, car elles seront aussi affligées dans leur corps. Les saints patriarches,
les prophètes, les apôtres, les martyrs, les vrais fidèles ont déjà été reçus dans la paix ;
tous recevront ã la fin ce que Dieu leur a promis ; c’est-à-dire la résurrection même de
la chair, la suppression de la mort, la vie éternelle avec les anges. Cette récompense,
nous la recevrons ensemble, le repos qui est en effet accordé aussitôt après la mort, si
on en est digne, est accordé sans attendre. Les premiers à l’avoir eue sont les
prophètes, ensuite les apôtres, beaucoup plus récemment les martyrs, chaque jour les
bons fidèles. Pour les uns c’est depuis longtemps, pour d’autres, un peu moins, pour
d’autres depuis peu, d’autres n’y ont pas encore eu accès. Mais lorsqu’ils s’éveilleront
de leur sommeil, tous ensemble recevront ce qui leur a été promis ». 33
NB : Il est important d’approfondir la conception du “massa damnata” d’Augustin.
29
Cf. Augustin, La Cité de Dieu, traduction G. Bardy, t. XXXVII, 5e série, Paris, Edition Desclée de
Brouwer, 1960, 215 (20. 7, 2). 30
Cf. Jean Daniélou, Origène, Paris, Edition la Table ronde, 1948, p. 281-283. 31
Cf. Denzinger-Schönmetzer, Enchiridium Symbolorum, definitinum et declarationum, 35è edition,
Fribourg-en Brisgau, Herder, 1973. Nous citons cet ouvrage par le sigle DS, suivi du numéro de
l’article. 32
Cf. Augustin, Sur le Psaume 37, no. 3 ; P. L., 36, 397. 33
Augustin, Sur l'Évangile de saint Jean, Traité XLIX, no. 9-10 ; P. L., 35, 1751-1752.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 17
2.5 THOMAS D’AQUIN ET L’ESCHATOLOGIE
Au début de la troisième partie de la Somme théologique, St. Thomas annonce
qu’après avoir traité de la christologie, puis des Sacrements, il abordera « la fin de
l’immortelle vie vers laquelle nous achemine notre résurrection dans le Christ ».
Malheureusement, ce projet est resté en suspens. Il s’est arrêté au milieu de la
théologie des Sacrements. Il n’a pas écrit sur la fin de l’immortelle vie. Pour
compléter l’œuvre inachevée, ses disciples ont puisé le « Commentaires des
Sentences ». Dans son livre Somme contre le Gentils il parle de la résurrection, le feu
de l’enfer, l’état des âmes après la mort, du Purgatoire et du jugement dernier. Dans le
Compendium theologiae, qui est resté inachevé, il traite l’immortalité des âmes après
la mort, du désir de la vision béatifique et il affirme que la béatitude parfaite postule
la résurrection des corps. Il parle également de la damnation, de l’enfer et du
Purgatoire. En outre, il cherche à résoudre le conflit entre l’eschatologie individuelle
et l’eschatologie collective. Également, il revient à la résurrection du Christ et au
jugement dernier. 34
Pour justifier la résurrection de la chair, Thomas d’Aquin écrit, « Nous avons vu que
les âmes des hommes étaient immortelles. Elles continuent donc de subsister une fois
séparées du corps. Or… il est évident que l’union de l’âme et du corps est une union
naturelle, puisque l’âme est par essence forme du corps. Il est donc contre nature,
pour l’âme, d’exister sans le corps. Mais ce qui est contre nature ne peut pas toujours
durer. L’âme ne sera donc pas privée de son corps d’une manière perpétuelle. Et
puisqu’elle continue de subsister éternellement, il faut donc qu’elle soit de nouveau
unie à son corps ; c’est la résurrection. L’immortalité des âmes exige donc la
résurrection des corps… Il faut donc affirmer une nouvelle union de l’âme au corps,
telle que l’homme puisse être récompensé et châtié, dans son corps et dans son
âme ».35
En outre, Thomas d’Aquin répond des objections contre la résurrection de la
chair. Une de ses réponses va dans le sens de la résurrection de tous : « Il ne faut pas
dire non plus que tous ne ressusciteront pas, bien que tous n’adhèrent pas au Christ
par la foi et que tous ne soient pas instruits de ses mystères. Le Fils de Dieu a assumé
la nature humaine pour la restaurer. Ce qui est défaut de nature sera donc réparé en
tous : tous reviendront de la mort à la vie. Mais le défaut personnel ne sera réparé que
dans ceux qui auront adhéré au Christ, soit par un acte personnel, en croyant en lui,
soit du moins par le sacrement de la foi ». 36
Thomas d’Aquin affirme que la vision de Dieu sitôt la mort d’un juste est un bonheur
définitif auquel la résurrection n’ajoutera presque rien d’essentiel, bien qu’elle
s’impose. 37
En outre, il tient que les élus n’auront plus l’espérance mais ils auront la
charité du corps mystique. 38
34
Cf. Thomas d’Aquin, Contra Gentes, lib. IV, c. 79-97 ; Thomas d’Aquin, Compend. Theol., c. 105-
241; Henri Rondet, Fins de l’homme et fin du monde, Paris, Librairie Arthème, 1966, p. 79. 35
Thomas d’Aquin, Contre le Gentils, livre IV, c. 79, trad. Bernier et Kerouanton, Lethielleux, 1957, p.
381-382. 36
Thomas d’Aquin, Contre le Gentils, livre IV, c. 81-82, trad. Bernier et Kerouanton, Lethielleux,
1957, p. 383-391. 37
Cf. Thomas d’Aquin, Summa theologica, 1a, 2ae, qn. 4, art. 6 et 8. 38
Cf. Thomas d’Aquin, Summa theologica, 2a, 2ae, qn. 18, art. 2.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 18
Il critique Joachim de Flore. Il affirme que l’eschatologie est inaugurée
définitivement, on ne doit pas attendre une autre inauguration. L’œuvre de Jésus
Christ a été décisive. L'Église est au service du salut. A la fin, il y aura une histoire
véritable qui entrera dans la joie de Dieu. L’humanité ne peut pas se sauver, elle ne se
totalise que dans le Christ, ardemment attendu. 39
L’existence future sera à la manière
de anges (bios angelikos) et nous serons totalement et sans partage attachés à Dieu
(vacare Deo, vaquer à Dieu, être vide pour Dieu).
Pour Thomas d’Aquin, le Ciel, l’enfer et le Purgatoire ne sont pas d’abord des lieux
matériels, ils sont plutôt spirituels. 40
NB : Le christianisme du moyen âge a bâti une fondation solide de l’eschatologie
malgré beaucoup de limitations, faiblesses et incohérences.
3 LES APPROCHES DE L’ESCHATOLOGIE CHRETIENS
3.1 L’ESCHATOLOGIQUE : LES LATINS ET LES GRECS
En Orient, sans refuser la prière pour les morts, on laissait dans le vague l’avenir des
âmes après la mort. La pratique pénitentielle d’Orient donnait l’absolution des péchés
sans demander de faire une réparation. Cette pratique ne favorise pas la croyance en
une expiation après la mort. L’Occident était convaincu que l’Orient niait le
Purgatoire. Pour eux la rétribution est renvoyée au jugement dernier. Dans le second
concile de Lyon, en 1274, l’empereur a obligé ceux qui refusaient d’accepter la
doctrine catholique sur ces deux point en signant une déclaration (DS 856-859).
L’accord n’a pas eu de suite. Dans le concile de Florence, en 1439 l’Orient (les Grecs)
avait accepté l’existence de peines purificatrices mais tout en refusant les arguments
scripturaires des Latins. Voici une déclaration d’un évêque oriental, Marc d’Ephèse,
« L'Église grecque enseigne que ni le juste ni le pécheur n’atteindront à l’état final de
béatitude ou de tourment avant le jugement dernier. Dans l’intervalle, ils demeurent
en des lieux qui leur sont assignés, les justes avec les anges auprès de Dieu, ou dans le
paradis abandonné par Adam, ou encore dans nos église où ils écoutent nos prières et
font des miracles par l’intermédiaire des reliques ; ils jouissent de la sainte vue de
Dieu et de la lumière qui en émane plus parfaitement que sur terre. Quant aux
pécheurs, accablés de tristesse, ils sont plongés dans l’enfer, dans les ténèbres,
l’obscurité et l’ombre de la mort, mais pas encore dans le feu ». 41
En fin, en 1439, on a fait une allusion au Purgatoire sans parler de feu et on a exposé
le caractère immédiat de la rétribution sitôt la mort (DS 1304-1306).
39
Cf. Thomas d’Aquin, Summa theologica, 1a, 2ae, qn. 106, art. 4. 40
Cf. Thomas d’Aquin, Summa Theologica, Suppl., q. 69, art. 7, cf. aussi, q. 1, art. 2; Cf. aussi, Ia, q. 8,
art. 2. 41
H. Rondet, Fins de l’homme et du monde, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1966, p. 101.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 19
3.2 L’ESCHATOLOGIE : LES CATHOLIQUES ET LES PROTESTANTS
Dans l'Église latine, la croyance au Purgatoire, à un moment donné était associée avec
quelques abus. Il y avait la question d’argent et la croissance des messes privées. Il y a
eu les indulgences avec des jours exacts. Il y avait un slogan du dominicain Tetzel qui
synchronisait la délivrance d’une âme du Purgatoire avec le tintement de l’écu
(ancienne monnaie) au fond du tronc. Au XVe siècle, il était précisé que les
indulgences sont pour mode d’intercession des défunts quand la hiérarchie n’a pas
juridiction au-delà de la terre. La veille de la Toussaint 1517, Lutter affiche ses 95
thèses à Wittenberg. 42
Sans directement refuser le Purgatoire il tenait de curieuses théories à son propos. Il a
rejeté la canonicité du livre de Macchabées sur un passage qui était considéré comme
le fondement de la prière de morts. Il enseignait que les défunt (du moins pas tous)
n’étaient pas certains de leur salut. Il déconseillait de prier pour eux (DS 1487-1490).
En outre, Luther était contre le nombre des sacrements et surtout leur signification. Il
associait la Purgatoire avec une Papauté en mal de finances. 43
L’au-delà posait le
problème du culte des saints. Le culte de saint a été refusé comme une concurrence au
Christ. 44
Egalement, Jean Calvin était contre la prière pour les morts. 45
Il maintient que la
demande de prière exprimée par Sainte Monique à son fils Augustin avant de mourir
est qualifiée de « souhait de vieille ».
Le Concile de Trente a affirmé l’existence du Purgatoire lors de la XVe session
(1563) et il a demandé aux évêques de prêcher cette vérité. Le Concile n’a pas donné
la nature et la durée des peines. Il a demandé d’éviter dans la prédication populaire
tout ce qui pourrait avoir une connotation de superstition (DS 983, 1820).
Il est mieux de souligner dans le protestantisme, l’œuvre de Moltmann, Théologie de
l’espérance. Il donne une théologie structurée. Il choisit les mots avec précaution. Il
commence par régler quelques comptes avec quelques réformistes avant lui : Kant,
Barth et Bultmann. Sous la dimension de l’eschatologie : Kant n’a guère envisagé
qu’une apocalypse intérieure sans la dimension des fins morales ; Karl Barth a
présenté une auto-démonstration de Dieu dans un acte fugitif où tout est dit (Deux
dixit) et Bultmann est dans le subjectivisme à cause de son approche de démythiser.
Pour Karl Barth, l’eschatologie n’est pas dissociée de notre temps. Il dit « attendre la
parousie » c’est « prendre les conditions effectives de notre vie avec tout le sérieux
qui lui revient » (Épître aux Romains). Il tient que la « résurrection est l’éternité ».
Les représentations des derniers jours symbolisent la transcendance absolue de Dieu,
le « Tout-Autre ». L’eschatologie n’est plus relative au temps mais à l’existence.
Nous pouvons retenir que « D’une part, chez Barth, de sa jeunesse à sa maturité, il a
42
Cf. Martin Luther, Œuvres, t. I, traduction P. Jundt, Genève, Edition Labor et Fides, 1957, p. 106-
112. 43
Il maintenait que c’est la « foire du diable » : Martin Luther, Œuvres, t. VI, traduction Jean Bosc,
Genève, Edition Labor et Fides, 1964, p. 283. 44
Cf. « Epître sur l’art de traduire et sur l’intercession des saints » : Martin Luther, Œuvres, t. VI,
traduction Jean Bosc, Genève, Edition Labor et Fides, 1964, p. 201-204. Il nie la prière des saints pour
nous et notre prière recours à eux. 45
Cf. Jean Calvin, L'institution chrétienne, livre 3, 5, 6-10, Genève, Labor et Fides, 1957, p. 141-146.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 20
conduit à la dogmatique ecclésiale qui se veut théologie radicalement
christocentrique, voie dans laquelle la logique interne de l’évolution néo-testamentaire
est nettement renouvelée. D’autre part, il conduit à la systématisation du principe de
l’eschatologie existentielle chez Rudolf Bultmann ». 46
Rudolf Butmann, être chrétien c’est « mener une existence eschatologique ». Pour lui,
l’eschatologie n’est pas une réalité temporelle ni une réalité donnée d’avance face à la
quelle nous pouvons nous situer comme objet et que nous nous pouvons l’analyser.
Pour lui, le Christ est « l’événement eschatologique ». L’eschatologie est liée avec le
don de soi qui se réalise dans une manière déficiente. S’il parvenait a être continu, il
serait lui-même temps et non plus la fin du temps. Il parle d’une foi profondément
authentique pour vivre le christianisme comme une nouvelle naissance, comme un
don de soi absolu à l’existence eschatologique. Pour lui, affrontement entre science et
foi est impossible parce que le christianisme n’a de sens qu’eschatologique.
L’eschatologie qui était considérée comme source des difficultés, avec Bultmann,
devient la solution du nœud gordien. Le danger de cette conception est qu’une fois
que le Christianisme ne peut plus entrer en tension avec l’histoire (avec la réalité
expérimentale dans son ensemble) il n’a plus rien à dire à l’histoire. La foi n’avait
plus de force de discuter sur l’être humain. 47
Oscar Cullmann, un exégète protestant, donne une conception du christianisme
complètement opposée à celle de Bultmann. Pour Cullmann, l’histoire du salut
constitue l’essence même du christianisme du Nouveau Testament, comme
l’eschatologie pour Bultmann. L’essentiel pour Cullmann, est précisément ce que
Bultmann refuse, c’est-à-dire l’histoire réelle dans sa progression et sa continuité.
Cullmann constate l’opposition entre la conception grecque du temps qui est cyclique
et la conception biblique du temps qui est linéaire. La bible nous donne une continuité
ascendante d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Le salut se produit dans le temps. Il
parle de trois temps : avant la création, entre la création et la parousie et depuis la
parousie. Pour Cullmann, l’eschatologie est liée à l’histoire du salut. Pour lui, la
parousie est le « point central ». Avec la venue du Christ il y a un changement « sa
venue marque, pour lui, et déjà de son vivant, le centre de l’histoire ». Ce moment
cardinal ou central ne coïncide pas avec la fin concrète de l’histoire du monde.
Conscient d’être le centre, le Christ a donné une nouvelle vision de l’histoire du salut,
en séparant le centre et la fin. Le centre est déplacé dans le passé, la fin est attribuée
au futur et le présent est associé avec une ère nouvelle, la période de « déjà et pas
encore ». Le temps central est déjà là et la fin qui n’est pas encore reste à attendre. Il
met en valeur l’événement central qui est la venue du Christ déjà réalisée. Suite aux
critiques de sa pensée Cullmann a répondu par son livre « Le Salut dans l’histoire ».
Dans ce livre il affine son premier schéma en qualifiant la « ligne » de mouvement
ondulatoire en tenant compte des hauts et des bas, à la discontinuité dans la continuité.
Il souligne la valeur « existentielle » de l’histoire du salut. Pour lui, croire, c’est être
46
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 61. 47
Cf. Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 61-63.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 21
solidaire de l’histoire salvifique dans le sens de son déjà et de son pas encore, de son
passé, présent et futur jusqu’au retour du Christ. 48
Pour Moltmann le point de départ de sa théologie c’est spes quarens intellectum (une
espérance en quête de sa propre intelligence). Dieu est comme « l’ultime moteur,
ultimum movens » et non pas le « premier moteur ». (Fessard ajoute, il est le non plus
ultra, c’est-à-dire, l’Après sans après). Il parle aussi de la souffrance et de la mort de
Dieu. La passion est un événement douloureux qui sépare et unit le Père et le Fils
(abandon du Père et abandon au Père). 49
Moltmann identifie « l’enthousiasme de
l’accomplissement chez les premiers chrétiens » avec « l’eschatologia crucis »
(eschatologie de la croix) et la « forme de religion de la présence de l’éternité, que
l’eschatologie ne détermine plus que de façon latente-, on peut l’appeler une
eschatologia gloriae » (une eschatologie de gloire). 50
Guilhen Antier, un théologien protestant s’inspire de la philosophie de Søren
Kierkegaard (devenir soi-même) et celle de Paul Ricœur (la représentation sous le
primat du sens) et celle du Jacques Lacan (La représentation dans l’économie
du désir) afin de proposer une eschatologie chrétienne pour notre siècle. Il donne un
commentaire sur « Matthieu 25, 31-46: la bonne nouvelle du jugement ». Il tient que
« Sur un plan théologique, on soutiendra que la justice rétributive est strictement
équivalente à l’injustice, dans la mesure où elle fait dépendre l’identité d’un sujet de
son comportement éthique. Or, dans le droit fil de l'Évangile, c’est de l’accueil gratuit
par Dieu que dépend cette identité et c’est cela qui confère la justice. Par ailleurs, si
l’on considère encore une fois la narration matthéenne dans son ensemble, on
remarquera qu’après la résurrection il n’est plus fait mention d’un quelconque
jugement eschatologique. Celui-ci est remplacé par une exhortation ã la mission
auprès de « toutes les nations» ainsi que par la promesse de la présence de Jésus
« tous les jours jusqu’à la fin du monde (Mt 28, 19-20) ». A cet ultime stade du récit,
Matthieu insiste sur « l’être avec » du Christ dans le quotidien de ses disciples et non
pas sur sa venue à l’extrémité des temps. L’eschatologie est certes maintenue, mais
elle est dégagée de toute idée de rétribution ». 51
Karl Rahner affirme que l’immortalité est moins une évasion dans l’au-delà qu’une
affirmation sur l’en deçà. 52
Concernant la mort, Rahner dit que cet événement affecte l’être humain tout entier et
l’offre tout entier à la résurrection promise. Le corps et l’âme sont tous les deux
48
Cf. Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 64-67. 49
Cf. Jürgen Moltmann, Théologie de l’espérance, Théologie de l’espérance : Etudes sur les
fondements et les conséquences d’une eschatologie chrétienne, Paris, Edition Mame-Cerf, 1970, p.
165, 171. 50
Cf. Jürgen Moltmann, op.cit, p. 59; Jürgen Moltmann, L’Espérance en action, Paris, Edition du
Seuil, p. 22 et 44 ; Jürgen Moltmann, Le Dieu crucifié : La croix du Christ, Fondement et critique de la
théologie chrétienne, traduction B. Fraigneau-Julien, coll. « Cogitatio Fidei » no. 80, Paris, Edition
Cer-Mame, 1974, p. 24-37, 235-283. 51
Guilhen Antier, L’origine qui vient : Une eschatologie chrétienne pour le XXI siècle, Genève,
Editions Labor et Fides, 2010, p. 307-308. 52
Cf. Karl Rahner, « Pour une théologie de la mort», Écrits théologiques, no. 3, traduction G. Daoust,
Paris, Edition Desclée du Brouwer, 1963, p. 117.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 22
concernés. 53
Il ajoute que l’âme d’un mort n’est pas acosmique : elle serait plutôt
pan-cosmique. 54
Ce point de vue est maintenu par Teilhard de Chardin. Il souligne la continuité entre
la terre et l’au-delà. Concernant l’immortalité naturelle de l’esprit, il tient, « le
Cosmos se prolonge organiquement dans le monde des âmes séparées ». 55
L’espérance est une attitude chrétienne par excellence face à la peur de l’eschatologie.
En présentant « La christologie du ¨Samedi saint¨ dans la sotériologie de Hans Urs
von Balthasar », Vincent Holzer affirme que « ‘espérer pour tous’ constitue le thème
ou l’aspect apparemment achevé de la sotériologie balthasarienne…Autrement dit,
¨espère pour tous¨, c’est-à-dire avoir foi en la victoire irréversible du crucifié,
présuppose une christologie du Samedi saint, une christologie de l’abandon
(Gottlosigkeit : Verlassenheit) du Fils par le Père, de ¨ l’être-mort du Fils¨, forme
extrême ou étape ultime de son status exinanitionis ». 56
De nos jours, plusieurs théologiens répètent les mots de Jean Chrysostome: « Ne nous
demandons pas où se trouve l’Enfer, mais efforçons-nous de n’y pas tomber ». Ils
ajoutent que le Purgatoire soit au centre de la terre où ailleurs, c’est une question
vaine que celle du lieu de l’enfer ou du lieu du ciel. 57
3.3 QUELQUES ECOLES DE L’ESCHATOLOGIE
Aujourd’hui, il y a plusieurs écoles de l’eschatologie58
:
3.3.1 Eschatologie conséquente
Cette école est représentée par Albert Schweitzer. Elle maintient que Jésus a été
victime de l’apocalyptique juive. Elle tient que Jésus a vraiment cru à l’eschatologie
chronologique de la fin. Ainsi, Jésus s’est trompé en annonçant que ‘cette génération’
verrait le dénouement. 59
M. Goguel tient que le Christ a utilisé l’eschatologie tout
simplement dans le langage araméen en donnant du sérieux à son message.
53
Cf. Karl Rahner, « La vie des morts », Écrits théologiques, no. 9, traduction R. Givord, Paris, Edition
Desclée de Brouwer, 1968, p. 173. 54
Cf. Karl Rahner, « La vie des morts », Écrits théologiques, no. 9, traduction R. Givord, Paris, Edition
Desclée de Brouwer, 1968, p. 176 ; Cf. Georges Nossent, « Mort, Immortalité, résurrection », Nouvelle
Revue théologique, juin-juillet 1969, p. 623-625. 55
Cf. Teilhard de Chardin, 56
Geneviève Médevielle, Les fins dernières, Paris, Desclée de Brouwer, 2008, p. 109. 57
Jean Chrysostome, Homélie XXXI in Epist. Ad Romanos, c. 5; P. G., 60, 673-674; Cf. Henri Rondet,
Fins de l’homme et fin du monde, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1966, p. 112. 58
Cf. André Manaranche, Celui qui vient, Paris, Editions du Seuil, 1976, p. 49-54. 59
Cf. Franz Müssner, « Le Christ et la fin du monde », Le Christ devant nous, traduction A Liefooghe,
Paris, Edition Desclée de Brouwer, 1968, p. 15-17. Il montre que les mots « cette génération » (Mt 24,
34) ne désignent pas nécessairement les contemporains de Jésus, mais qu’ils ont aussi dans les
évangiles un sens qualitatif : l’ «engeance » des Juifs. Jésus voudrait dire qu’Israël, actuellement
incrédule, verra s’accomplir un jour le retour du Seigneur. Que ce peuple doit vivre jusqu’à cette date,
cela le désigne au respect des chrétiens.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 23
3.3.2 L’eschatologie intemporelle
Karl Barth représente l’école de l’eschatologie intemporelle. Lorsque retentit la Parole
de Dieu, le monde se trouve en crise. L’évangile est comme le signe moins placé
devant la parenthèse algébrique et qui oblige à inverser tous les signes placés à
l’intérieur. En outre, ce jugement frôle la terre, comme la tangent d’un cercle. 60
3.3.3 L’eschatologie existentielle
L’école de l’eschatologie existentielle a comme un précurseur Bultmann qui est un
converti de Karl Barth mais qui a pris une autre voie à la lumière de la philosophie de
Heidegger. Pour lui l’eschatologie tire son origine dans l’image cosmique de la
révolution des astres. Cette image a été transposée par les apocalypses juives qui s’en
sont servie pour décrire le royaume de Dieu avec des cataclysmes mondiaux. La
version séculaire de cette école est représentée par Hegel et Marx. Dans cette école, il
y a une influence johannique, le croyant doit encore devenir ce qu’il est déjà, et il est
déjà ce qu’il doit devenir. Pour Bultmann cette conception est détruite dans la
tradition chrétienne par l’introduction de l’apocalyptique juive. Dans chaque instant,
affirme Bultmann aux croyants, sommeille la possibilité qu’il soit l’instant
eschatologique. A chacun de le réveiller. 61
3.3.4 L’eschatologie réalisée
C. H. Dodd représente l’école de l’eschatologie réalisée dans son livre Les paraboles
du royaume de Dieu. Il est sensible au « déjà » dans l’évangile de Jean. Pour lui, le
salut dans le Jugement est accompli sur la croix. Le retour de Jésus ressuscité est le
second avènement qui est lié à l’effusion de l’Esprit. 62
Pour lui la catégorie de fin est
comme un « résidu d’eschatologie ». Pour lui, le message du Christ peut se résumer
dans la phrase « eschatologie réalisée ». Grâce à l’avènement de Jésus, l’action de
Dieu est entrée dans l’histoire ici et maintenant. Dodd « déclarait que l’ordre éternel
était présent dans la situation concrète et que cette situation était la moisson de
l’histoire qui avait précédé ». Les disciples de Jésus se rendent compte que le mystère
du royaume de Dieu s’est enfin manifesté dans sa mort et dans sa résurrection. L’
Église en célébrant l’eucharistie, célèbre le « sacrement de l’eschatologie réalisée ».
Pour lui, la foi des siècles s’est expliquée dans l’état des choses superposées du passé,
du présent et du futur dans le message eschatologique du Nouveau Testament. Dodd a
influencé d’autres écoles eschatologiques : « En même temps, toutefois, il faut bien
voir que toute la force du christianisme, qui survit à tous les concepts académiques,
60
Cf. Karl Barth, L’Epitre aux Romains, traduction P. Jundt, Genève, Editions Labor et Fides, 1978, p.
38. 61
Cf. Rudolf Bultmann, Histoire et eschatologie, traduction R. Brandt, coll « Foi vivante » no. 115,
Neuchâtel, Ed. Delachaux, 1969, p. 66, 77-97, 206. 62
Cf. C. H. Dodd, The Parables of the Kingdom, Londres, 1935 ; l’Interprétation du quatrième
évangile, (traduction M. Montabrut, coll. « Lectio divina », no. 82, Paris, Editions du Cerf, 1975, p.
499, 562. Il prend acte de deux corrections proposées : « Eschatologie inaugurée » (G. Florovsky) et
« Eschatologie se réalisant » (J. Jeremias). Cette dernière expression lui plaît, dit-il, mais elle est
intraduisible en anglais.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 24
vient, aujourd’hui comme hier, de ce dont cette synthèse est grosse. Car elle unit foi et
vie d’une manière réelle et effective, tandis que ni l’actualisme du jeune Barth, ni
l’existentialisme théologique de Bultmann, ni même une théologie formelle de
l’histoire du salut n’auraient été même esquissés sans cette base d’arrière plan ». 63
Pannenberg maintient que pour les apôtres, « si Jésus est ressuscité, c’est déjà la fin
du monde ». 64
3.3.5 L’eschatologie anticipée
L’école de l’eschatologie anticipée a comme doyen Oscar Cullmann. Il voit dans
l’événement de la mort est la résurrection de Jésus le jour du triomphe, le « Victory
Day ». Cependant, le combat continue pour quelques temps pour l’occupation totale
du terrain avant la fin de la guerre. 65
3.3.6 L’eschatologie inaugurée
Une autre école qui a beaucoup de disciples est celle de l’eschatologie inaugurée. 66
4 LES ELEMENTS DE L’ESCHATOLOGIE
4.1 LA MORT
4.1.1 La mort dans la Bible
4.1.1.1 La mort dans l’Ancien Testament
Le mot « mort » se retrouve plusieurs fois dans l’Ancien Testament : Gen. 21:16, Gn
24, 67 Gn 25, 11 ; Gn 26, 11 ; Gn 26, 18 ; Gn 27, 2 ; Gn 27, 7 ; Gn 27, 10 ; Ex 10,
63
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 69. 64
W, Pannenberg, Esquisse d’une christologie, Paris, Cerf, 1971, p. 73. 65
Cf. Oscar Cullmann, Christ et le Temps : Temps et histoire dans le christianisme primitif, Neuchâtel,
Edition Delachaux et Niestle, 1947, p. 59. 66
Cf. Jean Daniélou, Essai sur le mystère de l’histoire, Paris, Editions du Seuil, 1953, p. 264.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 25
17 ; Ex 19, 12 ; Ex 21, 12 ; Ex 21, 15 ; Ex 21, 16 ; Ex 21, 17 ; Ex 21, 29 ; Ex 22, 19 ;
Ex 31, 14 ; Ex 31, 15 ; Ex 35, 2 ; Lv 16, 1 ; Lv 19, 20 ; Lv 20, 2 ; Lv 20, 9 ; Lv 20,
10 ; Lv 20, 11 ; Lv 20, 12 ; Lv 20, 13 ; Lv 20:15 ; Lv 20, 16 ; Lv 20, 27 ; Lv 24, 16 ;
Lv 24, 17 ; Lv 24, 21 ; Lv 27, 29 ; Nb 1, 51 ; Nb 3, 10 ; Nb 3, 38 ; Nb 15, 35 ; Nb 16,
29 ; Nb 18, 7 ; Nb 23, 10 ; Nb 35, 16 ; Nb 35, 17 ; Nb 35, 18 ; Nb 35, 21 ; Nb 35, 25 ;
Nb 35, 28 ; Nb 35, 30; Nb 35, 31; Nb 35, 32, Deut. 13:5, Deut. 13:9, Deut. 17:6, Deut.
17:7, Deut. 19:6, Deut. 21:22 ; Dt 22, 26; Dt 24, 16; Dt 30, 15; Dt 30, 19; Dt 31, 27;
Dt 31, 29; Dt 33, 1 ; Jos 1, 1 ; Jos 1, 18 ; Jos 2, 13 ; Jos 20, 6 ; Jg 1, 1; Jg 5, 18; Jg 6,
31; Jg 13, 7; Jg 16, 16; Jg 16, 30; Jg 20, 13; Jg 21, 5 ; Rt 1, 17 ; Rt 2, 11 ; 1 S 4, 20 ;
1 S 11, 12 ; 1 S 11, 13 ; 1 S 15, 32 ; 1 S 15, 35 ; 1 S 20, 3 ; 1 S 22, 22 ; 2 S 1, 1 ; 2 S
1, 23 ; 2 S 6, 23 ; 2 S 8, 2 ; 2 S 15, 21 ; 2 S 19, 21 ; 2 S 19, 22 ; 2 S 20, 3 ; 2 S 21,
9 ; 2 S 22, 5 ; 2 S 22, 6 ; 1 R 2, 8 ; 1 R 2, 24 ; 1 R 2, 26 ; 1 R 11, 40 ; 2 R 1, 1 ; 2 R
2, 21 ; 2 R 4, 40 ; 2 R 14, 6 ; 2 R 14, 17 ; 2 R 15, 5 ; 2 R 20, 1, 1 Ch 22, 5 ; 2 Ch
15, 13 ; 2 Ch 22, 4 ; 2 Ch 23, 7 ; 2 Ch 24, 17 ; 2 Ch 25, 25 ; 2 Ch 26, 21 ; 2 Ch 32,
24 ; 2 Ch 32, 33 ; Esd 7, 26 ; Esd 4, 1 ; Jb 3, 5 ; Jb 3, 21 ; Jb 5, 20 ; Jb 7, 15 ; Jb 10,
21 ; Jb 10, 22 ; Jb 12, 22 ; Jb 16, 16 ; Jb 18, 13 ; Jb 24, 17 ; Jb 27, 15 ; Jb 28, 3, ; Jb
28, 22 ; Jb 30, 23 ; Jb 34, 22 ; Jb 38, 17, Ps 6, 5 ; Ps 7, 13 ; Ps 9, 13 ; Ps 13, 3 ; Ps 18,
4 ; Ps 18, 5 ; Ps 22, 15 ; Ps 23, 4 ; Ps 33, 19 ; Ps 44, 19 ; Ps 48, 14 ; Ps 49, 14 ; Ps 55,
4 ; Ps 55, 15 ; Ps 56, 13 ; Ps 68, 20 ; Ps. 73, 4 ; Ps. 78, 50 ; Ps 89, 48 ; Ps 102, 20 ; Ps
107, 10 ; Ps 107, 14 ; Ps 107, 18 ; Ps 116, 3 ; Ps. 116, 8 ; Ps 116, 15 ; Ps 118, 18 ; Pr
2, 18 ; Pr 5, 5 ; Pr 7, 27 ; Pr 8, 36 ; Pr 10, 2 ; Pr 11, 4 ; Pr 11, 19 ; Pr 12, 28 ; Pr 13,
14 ; Pr 14, 12 ; Pr 14, 27 ; Pr 14, 32 ; Pr 16, 14 ; Pr 16, 25 ; Pr 18, 21 ; Pr 21, 6 ; Pr 24,
11 ; Pr 26, 18 ; Qo 7, 1 ; Qo 7, 26 ; Qo 8, 8 ; Ct 8, 6 ; Is 9, 2 ; Is 25, 8 ; Is 28, 15 ; Is
28, 18 ; Is 38, 1 ; Is 38, 18 ; Is 53, 9 ; Is 53, 12 ; Jr 2, 6 ; Jr 8, 3 ; Jr 9, 21 ; Jr 13, 16 ; Jr
15, 2 ; Jr 18, 21 ; Jr 21, 8 ; Jr 26, 15 ; Jr 26, 19 ; Jr 26, 21 ; Jr 26, 24 ; Jr 38, 4, Jr 38,
15 ; Jr 38, 16 ; Jr 38, 25 ; Jr 43, 3 ; Jr 43, 11 ; Jr 52, 11 ; Jr 52, 27 ; Jr 52, 34 ; Lm 1,
20 ; Ez 18, 32 ; Ez 31, 14 ; Ez 33, 11 ; Os 13, 14 ; Am 5, 8 ; Jon 4, 9 ; Ha 2, 5’
4.1.1.2 La mort dans le Nouveau Testament
Le mot “mort” se trouve de fois dans le Nouveau Testament : Mt 2, 15; Mt 4, 16; Mt
10, 21; Mt 14, 5; Mt 15, 4; Mt 16, 28; Mt 20, 18 ; Mt 26, 38 ; Mt 26, 59 ; Mt 26, 66 ;
Mt 27, 1 ; Mc 5, 23 ; Mc 7, 10 ; Mc 9, 1 ; Mc 10, 33 ; Mc 13, 12 ; Mc 14, 1 ; Mc 14,
34; Mc 14, 55; Mc 14, 64; Lc 1, 79; Lc 2, 26; Lc 9, 27; Lc 18, 33; Lc 21, 16; Lc 22,
33; Lc 23, 15 ; Lc 23, 22 ; Lc 23, 32 ; Lc 24, 20 ; Jn 4, 47 ; Jn 5, 24 ; Jn 8, 51 ; Jn 8,
52 ; Jn 11, 4 ; Jn 11, 13 ; Jn 11, 53 ; Jn 12, 10 ; Jn 12, 33 ; Jn 18, 31 ; Jn 18, 32 ; Jn 21,
19 ; Ac 2, 24 ; Ac 8, 1 ; Ac 12, 19 ; Ac 13, 28 ; Ac 22, 4 ; Ac 22, 20 ; Ac 23, 29 ; Ac
25, 11 ; Ac 25, 25 ; Ac 26, 10 ; Ac 26, 31 ; Ac 28, 18 ; Rm 1, 32 ; Rm 5, 10 ; Rm 5,
12 ; Rm 5, 14 ; Rm 5, 17 ; Rm 5, 21 ; Rm 6, 3 ; Rm 6, 4 ; Rm 6, 5 ; Rm 6, 9 ; Rm 6,
16 ; Rm 6:21 ; Rm 6, 23 ; Rm 7, 5 ; Rm 7, 10 ; Rm 7, 13 ; Rm 7, 24 ; Rm 8, 2 ; Rm 8,
6 ; Rm 8, 38 ; 1 Co 3, 22 ; 1 Co 4, 9 ; 1 Co 11, 26 ; 1 Co 15, 21 ; 1 Co 15, 26 ; 1 Co
15, 54 ; 1 Co 15, 55 ; 1 Co 15, 56 ; 2 Co 1, 9 ; 2 Co 1, 10 ; 2 Co 2, 16 ; 2 Co 3, 7 ; 2
Co 4, 11 ; 2 Co 4, 12 ; 2 Co 7, 10 ; Ph 1, 20 ; Ph 2, 8 ; Ph 2, 27 ; Ph 2, 30 ; Ph 3, 10 ;
Col 1, 22 ; 2 Tm 1, 10 ; He 2, 9 ; He 2, 14 ; He 2, 15 ; He 5, 7 ; He 7, 23 ; He 9, 15 ;
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 26
He 9, 16 ; He 11, 5 ; Jc 1, 15 ; Jc 5, 20 ; 1 P 3, 18 ; 1 Jn 3, 14 ; 1 Jn 5, 16 ; 1 Jn 5, 17 ;
Ap 1, 18 ; Ap 2, 10 ; Ap 2, 11 ; Ap 2, 23 ; Ap 6, 8 ; Ap 9, 6 ; Ap 12, 11 ; Ap 13, 3 ;
Ap 18, 8 ; Ap 20, 6 ; Ap 20, 13 ; Ap 20, 14 ; Ap 21, 4 ; Ap 21, 8.
4.1.2 La Mort dans la tradition chrétienne
Voici une phrase philosophique pour nier l’existence de la mort : « Tant que nous
vivons, il n’y a pas de mort ; quand nous mourons, c’est nous qui ne sommes plus ;
donc la mort n’existe pas pour nous ». 67
Roger Troisfontaine distingue « la mort apparente » de « la mort réelle mais
relative » et « la mort réelle absolue ». Il maintient : « La mort apparente : dans une
syncope, la flamme de la vie se fait si petite qu’elle en devient imperceptible. Elle
n’est pourtant pas totalement éteinte ; elle peut même se ranimer spontanément ou
sous l’influence de moyens relativement simples : stimulations, respiration artificielle.
Il est exceptionnel que cet état se prolonge. La mort réelle mais relative : le stade plus
ou moins long de vie totalement suspendue. Mort « clinique » et bien réelle : on peut
inhumer le gisant puisque, laissée à elle-même, l’âme n’animera plus le corps. Saigné
à blanc, par exemple, le sujet est incapable d’activité biologique spontanée. Mais des
expériences montrent que l’on arrive parfois, en réinjectant du sang, à provoquer la
réanimation. En cas de mort réelle relative, on peut dire que, sauf intervention
extraordinaire (soit miraculeuse et alors sans technique humaine, soit naturelle, mais
en recourant à des procédés jusqu’ici inconnus ou inusités), la vie ne reprendra pas.
Ce qui conduira le sujet, plus au moins rapidement, à l’étape ultime. La mort réelle
absolue caractérisée non plus par la suspension de la vie, mais par son impossibilité
totale, suite à l’altération définitive de l’organisme. A quel moment intervient cette
mort absolue ? En bien des cas, il n’y a pas moyen de le préciser. Mais il paraît
exagéré d’assurer que l’âme ne s’évade qu’au moment où meurt la dernière
cellule ».68
Jean-Marc Dufort donne deux définitions de la mort. La première : « La mort est le
terme de notre cheminement, au-delà duquel l’homme ne peut progresser en mérite ou
en démérite, celui où il cesse définitivement son temps « d’épreuve » (au sens latin de
probatio, examen, essai, vérification) ». 69
Cette définition est fondé dans les Ecritures
(Qo 9, 4-6.10 ; Eccli 11, 19-30 ; 14, 13 ; 17, 26s ; Ps 6, 6 ; 29, 10 ; 87, 11-13 ; Jn 9, 4 ;
Lc 16, 19-31 ; Mt 24, 42-44 ; 25, 13 ; Mc 13, 35-37 ; Lc 12, 35-48 ; Ga 6, 10 ; Ap 2,
10). La seconde : « La mort naturelle de l’homme consiste dans la séparation du
corps et de l’âme, qui est immortelle ». Cette définition est au regard de la théologie
actuelle. 70
Cyprian de Carthage dit une parole d’espérance vis-à-vis de la mort. Cette parole est
centrée sur la foi de Jésus ressuscité : « Or, nous qui vivons dans l’espoir et qui
67
Robert W. Gleason, Le monde à venir : Théologie des fins dernières, traduction, René Mazas et
Henri Rondet, Paris, P. Lethielleux Editeur, 1960. 68
Roger Troisfointaines, Je ne meurs pas… , Paris, Editions universitaires, 1960, p. 110-111. 69
Jean-Marc Dufort, A la rencontre du Christ Jésus : Précis d’Eschatologie Chrétienne, Les Editions
Desclée & Cie, 1974, p. 69. 70
Cf. K. Rahner, art. « Death », dans Sacramentum Mundi, T. 2, p. 58, co. 2, no. 1.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 27
croyons en Dieu, nous qui avons la conviction que le Christ a souffert pour nous et
qu’il est ressuscité, pourquoi refusons-nous de quitter ce monde, alors que nous
demeurons dans le Christ et que nous sommes régénérés par lui et en lui ? Pourquoi
nous affligeons-nous tant du départ des nôtres comme s’ils étaient perdus à jamais,
puisque le Christ notre Seigneur, nous réconforte lui-même en ces termes : « Je suis la
résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et quiconque vit en
moi ne mourra jamais » (Jn 11, 25-26) ». 71
Saint Augustin avait entendu parler de plusieurs cas d’Expérience de Mort Imminente,
déjà bien décrite à son époque : Il reconnaît dans son Commentaire littéral du livre de
la Genèse, Livre 12, chap. 32, que ces personnes ravies hors de leurs sens/corps et qui
sont presque mortes, ont conservé « une certaine ressemblance de leur corps », par
laquelle elles peuvent être emportées vers des lieux corporels. « Je ne vois pas, dit-il,
comment il pourrait en être autrement : l’âme garde quelque chose qui ressemble à un
corps lorsque, le corps étant étendu privé de sentiment, mais sans être mort, elle voit
ce qu’une foule de personnes rendues à la vie, après avoir éprouvé cette sorte de
ravissement, ont raconté qu’elles avaient vu ; je ne vois pas, dis-je, pourquoi elle ne
l’aurait pas, une fois que, par la mort corporelle, elle a complètement quitté son corps
». Il faut remarquer que, dans le même texte, saint Augustin affirme que, quant à lui,
il ne croit pas que l’âme emporte un organisme physique… Le débat sur la nature de
ce corps psychique est donc ancien dans l'Église.
Sur la question « qu’est-ce que la mort ? » Hans Küng reconnaît qu’il y a plusieurs
réponses concernant la « mort clinique », la mort biologique, etc. Il tient « On peut la
définir simplement comme l’arrêt irréversible de toutes les fonctions vitales ». 72
Concernant la mort, Durrwell paraphrase la phrase de Heidegger, l’être humain est un
«être-pour-la-mort» (Sien-Zum-Tode). 73
Pour un chrétien cette mort, c’est pour la
communion avec le Christ (1 Co 1, 9). Blaise Pascal tient que « Sans Jésus Christ, la
mort est horrible, elle est détestable et l’horreur de la nature ». 74
La mort de Jésus
donne sens à notre mort. Dieu a voulu, par la mort, amener notre filiation et sa
paternité à « sa perfection » (He 2, 10 ; 5m 9 ; 7, 28). Le fait du Fils de se recevoir
complètement de son Père est sa perfection. Cette perfection à travers sa mort et sa
résurrection (Ph 2, 8 ; 1 Co 5, 7 ; He 5, 8s. ; 1 P 2, 24 ; Lc 24, 26). Il affirme que Jésus
est le « médiateur de mort filiale ». Le Christ est mort et ressuscité pour nous (2 Co 5,
15 ; He 9, 14 ; 1 Th 4, 14 ; Lc 23, 43 ; 1 Co 11, 26 ; Ap 14, 13). Il est la porte (Jn 10,
7) et le chemin (Jn 14, 6). 75
La mort reste un grand mystère. L’être humain est dérangé par cette réalité
mystérieuse. Il cherche à la maitriser en vain: « Confronté au mystère de la mort,
l’homme se dérobe. L’inexplicable le dérange, et il tente d’y opposer une rassurante
description de l’après-mort. Plus cette description sera précise, plus il se sentira en
71
Cyprien de Carthage, Sur la mort, no. 21, in Le Christ devant la mort, Paris, DDB, 1980 ; Isabelle
Chareire, La résurrection des mort, Paris, Les Editions de l’Atelier, 1999, p. 15. 72
Hans Küng, Vie éternelle ?, Paris, Editions du Seuil, 1985, p. 33. 73
Cf. M. Heidegger, Being and Time, New York, Harper and Row Publishers, 1962, p. 296. 74
B. Pascal, Lettre à M. et Mme Périer : Œuvres complètes, Paris, Pléiade, p. 493. 75
Cf. François-Xaxier Durrwell, Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris, Mediaspaul, 1994, p. 45-62.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 28
sécurité. La mort n’est plus alors qu’une formalité, un droit d’entrée dans cet au-delà
qu’il s’est aménagé, s’évadant du fini de l’instant mortel, vers un infini préparé à sa
mesure. Échouant dans une prospective de sa mort propre, puisqu’il ne sait ni quand,
ni où, ni comment il mourra, l’homme se rattrape en quelque sorte dans celle de son
devenir posthume ». 76
Va-t-il faire un « pari arbitraire » ou un « acte de foi
aventureux » ?
Ratzinger donne trois dimensions de la mort: « 1. La mort est présente comme néant
d’une existence vide qui s’écoule dans un semblant de vie. 2. La mort est présente
comme processus physique de décomposition qui traverse la vie, que la maladie
permet de discerner, et dont le terme est la mort physique. 3. La mort se trouve dans la
hardiesse de l’amour de qui s’efface pour faire place à autrui ; elle se rencontre chez
celui qui sacrifie son avantage personnel au profit de la vérité et de la justice ». 77
Pour nous les chrétiens, la mort du Christ donne sens et espérance à notre mort. Nous
pouvons maintenir : « Comprendre la mort du Christ comme lumière sur le scandale
de la mort, c’est revenir à l’agonie et à la croix…celui qui sait la mission d’inaugurer
une métamorphose qu’intègre et dépasse la mort dans la Vie. Il faut que par
l’humanité finie qui le révèle et qui le cache, Jésus s’enfonce assez profond dans notre
condition pour que, visitant la mort et vidant son empire, il installe en plein centre du
monde le pouvoir tout nouveau d’une vie qui abolit la mort. Il pourra dire, non plus à
ses seuls disciples au cours de quelques apparitions limitées encore qu’irremplaçables,
mais à tout homme qui connaît la frayeur de la mort : « Ne crains pas, Je suis le
Premier et le Dernier, le Vivant ; je fus mort, et voici je suis vivant pour les siècles
des siècles, et je tiens (et je détiens) les clefs de la mort et de l’Hadès (Ap 1, 17-18) ».
Alors, chacun le saluera du titre éblouissant et unique en son genre de « premier né
d’entre les mort (ibid. 1, 5) » ». 78
4.1.3 La mort selon le Catéchisme de l’Eglise Catholique
La Catéchisme de l'Église Catholique sur la mort (no. 1006-1019 ; 1051-1052) 79
:
n° 1006 (9) "C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint
son sommet" (GS 18). En un sens, la mort corporelle est naturelle, mais pour la foi
elle est en fait "salaire du péché" (Rm 6,23 cf. Gn 2,17). Et pour ceux qui meurent
dans la grâce du Christ, elle est une participation à la mort du Seigneur, afin de
pouvoir participer aussi à sa Résurrection (cf. Rm 6,3-9 ; Ph 3,10-11).
n° 1007 (12) La mort est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le
temps, au cours duquel nous changeons, nous vieillissons et, comme chez tous les
êtres vivants de la terre, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Cet aspect
de la mort donne une urgence à nos vies: le souvenir de notre mortalité sert aussi à
nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie:
76
Maguy Amigues, Le chrétien devant le refus de la mort, Paris, Les Editions du cerf, 1981, p. 62-63. 77
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 107. 78
G. Martelet, L’au-delà retrouvé : Christologie des fins dernières, Paris, Desclée, 1974, 57. 79
Catéchisme de l'Église Catholique, Paris, Edition de Cerf, 1998.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 29
(14) Souviens-toi de ton Créateur aux jours de ton adolescence, ... avant que la
poussière ne retourne à la terre, selon qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu
qui l'avait donné (Qo 12,1 12,7).
n° 1008 (17) La mort est conséquence du péché. Interprète authentique des
affirmations de la Sainte Écriture (cf. Gn 2,17 3,3 3,19 Sg 1,13 Rm 5,12 6,23) et de la
Tradition, le Magistère de l'Église enseigne que la mort est entrée dans le monde à
cause du péché de l'homme (cf. DS 1511). Bien que l'homme possédât une nature
mortelle, Dieu le destinait à ne pas mourir. La mort fut donc contraire aux desseins de
Dieu Créateur, et elle entra dans le monde comme conséquence du péché (cf. Sg 2,23-
24). "La mort corporelle, à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché"
(GS 18), est ainsi "le dernier ennemi" de l'homme à devoir être vaincu (cf. 1Co
15,26).
n° 1009 (20) La mort est transformée par le Christ. Jésus, le Fils de Dieu, a souffert
lui aussi la mort, propre de la condition humaine. Mais, malgré son effroi face à elle
(cf. Mc 14,33-34 He 5,7-8), il l'assuma dans un acte de soumission totale et libre à la
volonté de son Père. L'obéissance de Jésus a transformé la malédiction de la mort en
bénédiction (cf. Rm 5,19-21).
n° 1010 (25) Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. "Pour moi, la vie
c'est le Christ et mourir un gain" (Ph 1,21). "C'est là une parole certaine: si nous
mourons avec lui, nous vivrons avec lui" (2Tm 2,11). La nouveauté essentielle de la
mort chrétienne est là: par le Baptême, le chrétien est déjà sacramentellement "mort
avec le Christ", pour vivre d'une vie nouvelle; et si nous mourons dans la grâce du
Christ, la mort physique consomme ce "mourir avec le Christ" et achève ainsi notre
incorporation à Lui dans son acte rédempteur:
(27) Il est bon pour moi de mourir dans ("eis") le Christ Jésus, plus que de régner sur
les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous; lui que je
veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche ... Laissez-moi recevoir
la pure lumière; quand je serai arrivé là, je serai un homme (S. Ignace d'Antioche, Rm
6,1-2).
(49) Dans toutes tes actions, dans toutes tes pensées tu devrais te comporter comme
si tu devais mourir aujourd'hui. Si ta conscience était en bon état, tu ne craindrais pas
beaucoup la mort. Il vaudrait mieux se garder de pécher que de fuir la mort. Si
aujourd'hui tu n'es pas prêt, comment le seras-tu demain? (Imitation du Christ 1,23,1).
(51) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à qui nul homme
vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels,
heureux ceux qu'elle trouvera dans ses très saintes volontés, car la seconde mort ne
leur fera pas mal (S. François d'Assise, cant.).
n° 1011 (30) Dans la mort, Dieu appelle l'homme vers Lui. C'est pourquoi le chrétien
peut éprouver envers la mort un désir semblable à celui de S. Paul: "J'ai le désir de
m'en aller et d'être avec le Christ" (Ph 1,23); et il peut transformer sa propre mort en
un acte d'obéissance et d'amour envers le Père, à l'exemple du Christ (cf. Lc 23,46):
(32) Mon désir terrestre a été crucifié; ... il y a en moi une eau vive qui murmure et
qui dit au dedans de moi "Viens vers le Père" (S. Ignace d'Antioche, Rm 7,2).
(34) Je veux voir Dieu, et pour le voir il faut mourir (Ste. Thérèse de Jésus, vida 1).
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 30
(36) Je ne meurs pas, j'entre dans la vie (Ste. Thérèse de l'Enfant-Jésus, verba).
n° 1012 (39) La vision chrétienne de la mort (cf. 1Th 4,13-14) est exprimée de façon
privilégiée dans la liturgie de l'Église:
(41) Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est
transformée; et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure
éternelle dans les cieux (MR, Préface des défunts).
n° 1013 (44) La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce
et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin
et pour décider son destin ultime. Quand a pris fin "l'unique cours de notre vie
terrestre" (LG 48), nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. "Les hommes
ne meurent qu'une fois" (He 9,27). Il n'y a pas de "réincarnation" après la mort.
n° 1014 (47) L'Église nous encourage à nous préparer pour l'heure de notre mort
("Délivre-nous, Seigneur, d'une mort subite et imprévue": Litanie des saints), à
demander à la Mère de Dieu d'intercéder pour nous "à l'heure de notre mort" (Prière
"Ave Maria"), et à nous confier à saint Joseph, patron de la bonne mort:
n° 1018 (13) En conséquence du péché originel, l'homme doit subir "la mort
corporelle, à laquelle il aurait été soustrait s'il n'avait pas péché" (GS 18).
n° 1019 (16) Jésus, le Fils de Dieu, a librement souffert la mort pour nous dans une
soumission totale et libre à la volonté de Dieu, son Père. Par sa mort il a vaincu la
mort, ouvrant ainsi à tous les hommes la possibilité du salut.
n° 1051 (4) Chaque homme dans son âme immortelle reçoit sa rétribution éternelle
dès sa mort en un jugement particulier par le Christ, juge des vivants et des morts.
n° 1052 (7) "Nous croyons que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du
Christ ... sont le Peuple de Dieu dans l'au-delà de la mort, laquelle sera définitivement
vaincue le jour de la résurrection où ces âmes seront réunies à leurs corps" (SPF 28).
4.1.4 La mort dans les Traditions Africaines
Devoir : Comment la mort est perçue dans les Traditions Africaines ou dans ton
ethnie ? Peux-tu comparer la conception de la mort dans la tradition chrétienne et dans
ta culture ?
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 31
4.2 L’AU-DELÀ
4.2.1 L’au-delà dans la Bible
Ce mot, l’au-delà ne figure pas dans la Bible.
4.2.2 L’au-delà dans la Tradition chrétienne
Pouvons-nous parler de la « spatialité de l’au-delà » ? Thomas d’Aquin insiste sur la
spatialité de l’au-delà. Il parle des « demeures » des âmes. Il parle d’une relation non
pas ‘identique’ mais ‘analogique’ entre « l’espace » de l’au deçà et « l’espace » de
l’au-delà. Il y a trois lieux chronologiquement simultanés (avec une petite nuance) et
topographiquement distincts qui forment l’au-delà : l’enfer, le purgatoire et le paradis.
Il y a plusieurs personnes qui considéraient la parabole de l’homme riche et du pauvre
Lazare (Mt 16, 19-39) comme un récit. Le sein d’Abraham comme le paradis, les
séjours des morts comme l’enfer et la maison du riche comme le purgatoire. 80
Durrwell maintient que pour mieux comprendre « l’au delà » nous ne devons pas
ignorer « l’au deçà ». En parlant de « l’au-deçà et l’au-delà » il affirme que la mort de
Jésus était vécue d’un côté par les disciples (et les soldats, les moqueurs et les autres
spectateurs) et le Père de l’autre côté. Il voit aussi la dualité d’un au-deçà et d’un au-
delà dans le mystère de l’incarnation. C'est seulement en Jésus mort et ressuscité que
cette dualité est abolie. Ici, l’histoire terrestre (l’au deçà) n’est ni effacée ni abolie
mais elle est implosée dans l’histoire céleste (l’au-delà). Durrwell nous invite à
« vivre déjà de l’au-delà » (Jn 4, 25 ; Col 3, 3s.).81
Il est important de distinguer l’au-delà de l’au-deçà. Pourtant, il faut reconnaître la
continuité de quelques aspects de l’au-deçà dans l’au-delà et même de la présence de
quelques éléments de l’au-delà dans l’au-deçà. Jean-Marie Aubert affirme que « l’au-
delà commence ici-bas ». Il maintient : « Nous arrivons maintenant au point central de
ces réflexions sur l’au-delà… C’est l’idée de continuité dans l’existence humaine,
80
Cf. André Gounelle et François Vouga, Après la mort qu’y-a-t’il ?, Paris, Les Éditions de Cerf, 1990,
p. 24-25. 81
Cf. François-Xaxier Durrwell, Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris, Mediaspaul, 1994, p. 13-27.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 32
même si celle-ci se développe en deux phases, avant et après la mort. L’au-delà, s’il
est en soi une situation tout autre, dans une sorte d’absolu, il n’en reste pas moins
qu’il s’inaugure dès la vie présente, trouvant en elle ses racines. La tradition
chrétienne a exprimé cette conviction en intégrant dans sa doctrine la conception
grecque de l’âme, qui n’a pas son équivalent précis dans la Bible, et cela par un
besoin d’inculturation, afin, sans la falsifier, de rendre la Parole de Dieu
compréhensible au monde gréco-romain, dans lequel le christianisme se répandit très
rapidement ». 82
Excursus : l’au-delà dans la tradition chrétienne un article par Henri LÜSCHER
Comment se représenter « l'au-delà » ? Le Larousse trois volumes en couleurs 1970 le
décrit comme « l'autre monde, la vie future » ; le Quillet 1959 parle également de
« l'autre monde » et de « l'après la mort », tandis que le Petit Robert 1996 donne : «
Le monde supraterrestre ; la vie, l'activité imaginée après la mort ». Plutôt flou.
L'au-delà serait donc le monde invisible qui nous attend après la mort. Mais quel
monde ? Michel Colucci, dit Coluche, a cru pouvoir résoudre le problème en
déclarant : « Y a-t-il une vie après la mort ? Seul Jésus pourrait répondre à cette
question. Malheureusement il est mort ». Cent ans avant Coluche, Charles Darwin
écrivait : « Le vrai matérialisme fait de Dieu une impossibilité, de la révélation une
vie de l'esprit et de la vie future une absurdité »1.
Cependant, la croyance en un au-delà reprend ses droits dans notre société
postmoderne. La question a même envahi les médias depuis la parution des fameux
ouvrages sur les « expériences de mort imminente » (EMI) du Dr R. Moody : La vie
après la vie (R. Laffont, Paris, 1977), de P. Van Eersel : La Source noire -
Révélations aux portes de la mort (B. Grasset, Paris, 1986), de B. Martino : Voyage
au bout de la vie (Editions Balland, 1987), et de bien d'autres.
4.2.3 L’au-delà selon le Catéchisme de l'Église Catholique
n° 1052 (7) "Nous croyons que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du
Christ ... sont le Peuple de Dieu dans l'au-delà de la mort, laquelle sera définitivement
vaincue le jour de la résurrection où ces âmes seront réunies à leurs corps" (SPF 28).
4.2.4 L’au-delà dans les Traditions Africaines
Devoir : Comment l’au-delà est perçu dans les Traditions Africaines ou dans ton
ethnie ? Peux-tu comparer la conception de l’au-delà dans la tradition chrétienne et
dans ta culture ?
82
Jean-Marie Aubert , Et après… Vie ou néant?: Essai sur l’au-delà, Paris, Desclée de Brouwer, p. 75-
76.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 33
4.3 LA PAROUSIE
4.3.1 Parousie dans la Bible
Le mot Parousia se trouve à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament : paroush
2 P 1, 12 ; parousia Mt 24, 27 ; Mt 24, 37 ; Mt 24, 39 ; 1 Co 15, 23 ; 1 Co 16, 17 ; 2
Co 7, 6 ; 2 Co 7, 7 ; 2 Co 10, 10 ; Ph 2, 12 ; 1 Th 2, 19 ; 1 Th 3, 13 ; 1 Th 5, 23 ; 2 Th
2, 9 ; Jc 5, 8 ; 1 Jn 2, 28; parousian 1 Th 4, 15 ; 2 P 1, 16 ; 2 P 3, 12 ; parousiaj Mt
24, 3 ; Ph 1, 26 ; 2 Th 2, 1; 2 Th 2, 8; Jc 5, 7; 2 P 3, 4 ; parousin He 13, 5.
4.3.2 Parousie dans la tradition chrétienne
Parlant de « la venue du Christ », Durrwell nous invite à regarder quelques textes
bibliques : Mt 25, 1 ; Lc 12, 35 ; 1 Co 1, 7 ; 1 Th 1, 9s.’ Ph 4, 4s. ; Tt 2, 13 ; 1 Th 1, 3
et 2 Tm 4, 8. Les autres textes sur la Parousie sont Jn 21, 4-8 ; 2 Co 3, 18 ; 1 Jn 9, 2 et
Col 3, 4. Il nous invite à l’espérance parce que la venue du Christ est aussi le jour du
salut de l’être humain (Ph 3, 20 ; He 9, 28 ; Rm 8, 23 ; 1 Jn 3, 2). En dehors de la
parousie, il n’y a pas le salut parce que la rédemption se trouve dans le Christ (Rm 3,
24 ; 1 Co 1, 30). Il ne faut pas ignorer l’aspect salvifique de la parousie. Chez Paul le
mot parousie est réservé à l’ultime manifestation du Christ (1 Th 2, 19 ; 3, 13 ; 4, 15 ;
5, 23). Pourtant nous pouvons maintenir que le mystère pascal est aussi parousiaque
(2 Co 5, 15 ; Lc 17, 24s. ; Mt 26, 64 ; Jn 14, 28 ; Mt 11, 3s ; Ac 3, 26. Il y a plusieurs
textes qui nous parlent de la manifestation finale du Fils de Dieu : Mt 24, 29-31; Mt
26, 64 ; Lc 17, 22-37 ; 1 Co 15, 23-28, 2 Co 3, 18 ; 1 Th 4, 16s ; 2 Th 2, 8 ; Ap 1, 7,
etc. 83
Concernant le dernier jour, Marrou affirme, « Le dernier jour n’est pas seulement un
moment dans la chaîne du temps, un jour déterminé d’une année qui portera son
millésime selon l’ère en vigueur chez les historiens d’alors… En réalité, cet
accomplissement accompagne et soutient le déroulement de la durée historique, il est
présent à elle et recueille le fruit de toute larme et de tout élan d’amour. C’est le temps
tout entier qui se trouve de la sorte revêtir une participation à la qualité
eschatologique ». 84
83
Cf. François-Xaxier Durrwell, Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris, Mediaspaul, 1994, p. 28-44. 84
H. I. Marrou, Théologie de l’Histoire, Paris, Edition du Seuil, 1968, p. 86.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 34
Teilhard de Chardin associe le moment de la parousie avec la maturation ultime du
monde : « Sans être un produit de l’histoire, la Parousie ne coïnciderait-elle pas en fait
avec la maturation ultime du monde ? Ce fut, on le sait, l’opinion de Teilhard.
S’opposant à l’idée d’une pure discontinuité entre l’évolution du monde et la Parousie
du Seigneur – idée qui n’est pas davantage celle de l'Écriture – Teilhard demande : «
Pourquoi ne pas admettre plutôt que l’étincelle parousiaque ne saurait jaillir, de
nécessité physique et organique, qu’entre le Ciel et une Humanité biologiquement
parvenue à un certain point critique évolutif de maturation collective ? » ». 85
Concernant le retour du Christ, Ratzinger tient que « Du fait de sa nature, l’arrivée du
Seigneur ne peut se décrire qu’en images. Le Nouveau Testament a emprunté sa
propre imagerie aux représentations du Jour du Seigneur dans l’ancien, elles-mêmes
héritées de l’histoire antérieure des religions. En outre le Nouveau Testament a
emprunté des images aux cultes politiques (épiphanie du Seigneur, etc.) et leurs
propres liturgies. On voit dès lors que concrètement le Jour de Yahvé est le Jour de
Jésus-Christ ; en même temps, face à la prétention cosmique et universelle du pouvoir
politique-Rome, en fait-, se dresse le Seigneurie sans exclusive de Jésus-Christ, lequel
n’est pas le dieu cultuel d’un groupe privé, mais le véritable imperator du monde.
Cela permet d’apprécier correctement les symboles du langage cosmique du Nouveau
Testament. C’est un langage liturgique ; en effet la liturgie impériale de Rome
s’exprime en symboles cosmiques, parce que, pour elle, dans les traditions de l’ancien
Orient, l’empereur est un personnage cosmique-cosmocrator-, la cime du monde et
son point de contacte avec la divinité ». 86
Comme conclusion il ajoute « A considérer les choses ainsi, le thème de la parousie
cesse d’être une spéculation sur l’inconnu. Il devient une interprétation de la liturgie
et de la vie chrétienne dans leur rapport interne et dans leur constant dépassement
d’elles-mêmes. Il devient une invitation à vivre la liturgie comme une fête de
l’espérance et de la présence du Christ cosmocrator. Il doit donc devenir le point de
départ et de rassemblement de cet amour où le Seigneur peut venir habiter. Par
surcroit, le Seigneur s’en est allé à l’avance nous préparer une place dans la maison du
Père (Jn 14, 2 suiv.) ; dans la liturgie, l'Église, marchant avec lui, doit pour ainsi dire
lui préparer des habitations dans le monde. Le thème de la vigilance s’approfondit
ainsi dans la tâche concrète de donner réalité à la liturgie jusqu’à ce que le Seigneur
lui-même lui confère cette suprême réalité qui, en attendant, ne peut être recherchée
qu’en symboles ». 87
Excursus : Parousie dans la tradition chrétienne - un article
PAROUSIE
Terme théologique, dérivant du gr. parousia, et par lequel la pensée chrétienne
désigne le retour du Christ sur cette terre, sa seconde venue parmi les hommes. Le
85
G. Martelet, L’au-delà retrouvé : Christologie des fins dernières, Paris, Desclée, 1974, 166. 86
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 220. 87
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 222-223.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 35
mot parousia, que nos versions traduisent ordinairement par avènement, se rencontre à
plusieurs reprises dans le N.T. (Son emploi fréquent dans les papyrus contemporains
du N.T. en fait le mot technique pour désigner une «visite» de roi ou de grand
personnage, à laquelle les sujets se préparent à l'avance.
I Étude biblique.
Plusieurs textes se bornent à mentionner simplement ce retour du Christ (Mt 24:3
27,Jn 14:3,Ac 3:20 et suivant, 1Co 4:5 11:26 ; 16:22,Col 3:4,1Th 1:10 2:19 3:13 5:23,
2Th 1:7 2:8,1Ti 6:14,2Ti 4:8,Tit 2:13,1Pi 1:7,2Pi 1:16,1Jn 2:28,Ap 3:11 22:12,20).
D'autres passages sont plus explicites et révèlent, lorsqu'on les compare entre eux,
deux tendances différentes. D'après certains textes, la parousie est imminente et des
signes précurseurs l'annonceront; selon d'autres, elle ne se produira que dans une
époque lointaine, sans que personne en puisse déterminer le moment.
Examinons ces textes.
Discours du Mont Olivier sur la
Parousie du Christ
La Parousie en dehors des évangiles
Le retour du Christ est appelé « sa
parousie » par Pierre, Jacques, Jean et
André (Matthieu 24 : 3 ; Marc 13 : 3)
Paul (1 Cor. 15 : 23), Jacques (Jac. 5 : 7 –
11), Pierre (2 Pier. 3 : 4), et Jean (1 Jean 2 :
28 – 29) appellent tous le retour du Christ
une « parousie ».
La Parousie du Christ sera vue et
entendue universellement (Matthieu 24 :
7)
La Parousie du Christ sera vue et entendue
universellement (1 Thessaloniciens 4 : 16)
La Parousie du Christ aura lieu après les
jours de la Grande tribulation sous
l’Antéchrist (Matthieu 24 : 15 – 22, 29)
La Parousie du Christ suivra la persécution
par l’Antéchrist (2 Thessaloniciens 2 : 1 – 10)
Les croyants ne doivent pas être inquiets
au sujet de la Parousie du Christ
(Matthieu 24 : 23 – 26)
Les croyants ne doivent pas être troublés en
ce qui concernent la séquence des
événements pendant le temps de la fin (2
Thessaloniciens 2 : 1 – 10)
Le jour du Seigneur est associé à la
Parousie du Christ (Matthieu 24 : 29)
Le jour du Seigneur est associé à la Parousie
du Christ (2 Thessaloniciens 2 : 1 – 10)
Tous les non-croyants sur la terre
souffriront à la Parousie du Christ
(Matthieu 24 : 30)
Les non-croyants seront punis à la Parousie
du Christ (2 Pierre 3 : 4 ; Jacques 5 : 7 – 12)
La Parousie du Christ se fera avec
puissance et grande gloire (Matthieu 24 :
30)
« L’éclat de sa Parousie » mettra fin à la
persécution par l’Antéchrist (2
Thessaloniciens 2 : 8)
Les anges sont associés à la Parousie du
Christ (Matthieu 24 : 31)
Les anges sont associés à la Parousie du
Christ (1 Thessaloniciens 3 : 11 – 13)
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 36
Christ enverra ses anges pour rassembler
ses élus de partout à sa Parousie
(Matthieu 24 : 31 ; Marc 13 : 27)
La prochaine phase de la résurrection aura
lieu à la Parousie du Christ (1 Corinthiens 15
: 23 ; 1 Thessaloniciens 4 : 16)
L’envoi des anges sera accompagné par
le son retentissant de la trompette
(Matthieu 24 : 31)
La Parousie sera accompagnée par la
trompette de Dieu (1 Corinthiens 15 : 23 ; 1
Thessaloniciens 4 : 13 - 18)
Les saints de la tribulation seront
délivrés à sa Parousie (Matthieu 24 : 13,
29 – 31)
Les croyants attendront d’être délivré à la
Parousie du Christ (Jacques 5 : 7 – 11)
Les disciples sont prévenus qu’un
jugement négatif peut survenir à la
Parousie du Christ (Matthieu 24 : 45 –
51)
Paul et Jean ont prévenus les croyants qu’un
jugement négatif peut survenir à la Parousie
du Christ (2 Thessaloniciens 5 : 23; 1 Jean 2 :
28 – 29)
1. LA PAROUSIE EST IMMINENTE.
Dans les évangiles synoptiques, certains passages semblent ne laisser aucun doute à
cet égard. «Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela
n'arrive» (Mr 13:30,Mt 24:34,Lu 21:32); «Je vous le dis en vérité, quelques-uns de
ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son
règne» (Mt 16:28, cf. Mr 9:1,Lu 9:27). Et encore: «Vous n'aurez pas achevé de
parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu» (Mt 10:23). Le
quatrième évangile donne une note semblable; Jésus promet à ses disciples qu'il
reviendra du ciel pour les prendre à lui (Jn 14:3). L'un d'eux reçoit l'assurance
formelle qu'il demeurera sur terre jusqu'à cet événement (Jn 21:22 et suivant). La même
idée se retrouve dans 1Jn 2:28. L'apôtre Paul partage cette opinion, et la présente
comme «une parole du Seigneur» (1Th 4:15-17, cf. 1Co 1:7 et suivant). Enfin l'épître
de Jacques (Jas 5:7 et suivant) recommande la patience en rappelant l'imminence de la
parousie, et la seconde ép. de Pierre laisse entrevoir que ce retour du Christ peut être
hâté par l'attitude des chrétiens (2Pi 3:11 et suivant).
2. LA PAROUSIE EST LOINTAINE
D'autres textes, cependant, ne voient pas dans la parousie un événement imminent.
Plusieurs paraboles laissent supposer qu'un certain temps doit encore s'écouler
pendant lequel la vie terrestre se poursuivra dans les conditions habituelles. Ainsi la
parabole du grain de moutarde (Mr 4:30,32,Mt 13:31,Lu 13:18 et suivants), celles du
levain (Mt 13:33,Lu 13:20), des méchants vignerons (Mr 12:9,Mt 21:41,43,Lu 20:16).
Les malheurs que subira Jérusalem «jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplis» (Lu 21:24) semblent bien devoir durer plus longtemps qu'une génération.
Lorsque le Christ donne l'ordre à ses disciples de convertir toutes les nations (Mt
28:19), est-ce en accord avec une parousie immédiate? Puis, que signifieraient ces
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 37
appels à la vigilance, suivis de cette constatation que nous ne savons pas quand le
Seigneur viendra? (Mr 13:35,Mt 24:42,Lu 12:40) D'autre part le 1er évangile rapporte
que «cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir
de témoignage à toutes les nations» (Mt 24:14), et Mr 13:10 relève qu' «il faut
premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations». Il est certain
que de pareilles déclarations ne s'accordent guère avec la certitude d'un retour très
prochain du Seigneur. Dans les écrits pauliniens, nous faisons la même constatation.
Un texte comme 2Th 2:1 et suivants met en garde contre l'espoir d'une parousie
immédiate. Même prudence encore dans 2Pi 3:8,10.
3. LES SIGNES PRÉCURSEURS DE LA PAROUSIE
Les déclarations qui annoncent l'imminence de la parousie en font connaître
également les signes avant-coureurs. Les évangiles syn. parlent de faux prophètes, de
tribulations, de signes dans le ciel, d'une attaque contre Jérusalem: autant de preuves
du prochain retour du Christ (Mr 13:5,27,Mt 24:5,32,Lu 21:7,28). La venue de faux
prophètes est également prédite, sous le nom d'Antéchrists (voir ce mot), par 1Jn
2:18,22 4:1-3. De son côté, l'apôtre Paul (2Th 2:2,4,9) décrit l'apparition de «'homme
de péché» (voir art.) qui doit précéder le retour du Seigneur.
4. LA PAROUSIE, JOUR DU JUGEMENT
Ce retour du Christ marquera le temps du jugement (voir Jour de l'Éternel). Les
évangiles synoptiques développent cette conviction (Mc 8:38, Mt 16:27 25:31, Lc
9:26). Dans les épîtres de saint Paul, la parousie et le jour du jugement représentent
bien souvent une seule et même attente (1Co 1:8 3:13 4:4 5:5,2Co 1:14, Phi 1:6,10
2:16,1Th 5:23,2Th 1:9: et suivant); de même dans l’Apocalypse (Ap 20:12). Après ce
retour du Seigneur viendra la fin, soit immédiatement (1Co 1:8 15:24), soit après une
durée de mille ans (Ap 20:1,7; voir Millenium).
II La parousie: origine de cette attente. L'étude des différents textes bibliques
concernant la parousie est troublante; d'une part, en effet, deux tendances s'y
manifestent, celle qui affirme un retour imminent du Christ, et l'opinion opposée qui
reporte la parousie à des temps éloignés; d'autre part, le fait incontestable est que la
parousie ne s'est pas encore réalisée. Dès lors, une première question se pose au
chrétien: pourquoi le N.T. professe-t-il des sentiments contradictoires en cette
matière? Et cette question se transforme tout naturellement en celle-ci: quelle fut la
croyance du Christ lui-même? A-t-il annoncé à ses disciples son retour imminent, ou
leur a-t-il parlé d'une parousie à la fin des temps? Ce qui revient à se demander si
Jésus a partagé toutes les idées eschatologiques des Juifs de son temps (voir
Eschatologie). On a répondu à cette question de trois façons:
1° Certains ont dit: oui, le Christ a partagé toutes les idées eschatologiques de son
époque, y compris celles qui concernaient le jugement du monde par le Messie
descendant du ciel. Se considérant comme le Messie annoncé par les prophètes, Jésus
s'est appliqué à lui-même cette intervention messianique et surnaturelle après sa mort.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 38
Or, puisque la parousie ne s'est pas produite, c'est donc que le Christ s'est trompé.
2° Selon d'autres, Jésus n'a partagé aucune des croyances eschatologiques du judaïsme
contemporain. Par conséquent, tout ce que raconte le N.T. au sujet de son retour ici-
bas et du jugement qu'il présidera n'est qu'invention de la part des disciples, tant des
évangélistes que de l'apôtre Paul ou d'autres écrivains du Nouveau Testament.
3° Pour d'autres enfin--et leur opinion nous semble la plus sage--il faut adopter une
solution intermédiaire. D'une part, il est indéniable que le Christ s'est servi du langage
et des conceptions eschatologiques de son époque; il s'en est servi comme d'un moyen
pour se faire comprendre de ses contemporains, comme d'un cadre soutenant sa
pensée; il y a puisé des images d'une richesse incomparable et des tableaux qui parlent
directement au cœur. Mais d'autre part, les disciples ont exagéré l'importance des
mots employés; ils y ont vu le fond même de la pensée la plus intime du Christ, ils
ont voulu en faire une partie importante de l'enseignement du Maître. Prenant ce
langage au pied de la lettre, ils ont voulu y découvrir des prédictions relatives à des
événements locaux et immédiats, au lieu d'en dégager l'enseignement véritable
qui s'appliquait à tous les hommes, en tout pays et à toute époque.
III Identifications diverses de la parousie.
Devant le fait incontestable que jusqu'à présent la parousie ne s'est pas produite,
diverses solutions ont été proposées, qui consistent à identifier la parousie à quelque
événement connu. La parousie, a-t-on dit, ce fut:
1 La résurrection du Christ Semblable idée ne tient pas un grand compte des textes et
laisse de côté bien des éléments importants de cette attente d'une seconde venue; elle
ne fut d'ailleurs jamais acceptée d'une façon générale.
2 La descente de l'Esprit saint à la Pentecôte. C'est l'opinion souvent soutenue par
ceux qui repoussent l'interprétation littérale des éléments apocalyptiques du N.T., et
qui identifient l'influence du Christ ressuscité avec celle du Saint-Esprit. Cette
explication s'appuie surtout sur Jn 14:3 16:7.
3La destruction de Jérusalem. Cette solution s'ajoute à la précédente, et souligne
l'importance des prédictions contenues dans Mr 13 14:61,63.
4. Les venues successives du Christ, manifestées dans les grandes crises de l'histoire
humaine. Des événements comme la destruction de Jérusalem ou la chute de l'empire
romain, par exemple, seraient dus à l'action directe du Christ revenu sur terre pour y
exercer son jugement. Les faits saillants de l'histoire, qu'ils soient d'autrefois ou d'à
présent, représentent dès lors des parousies successives.
5. La mort du croyant. Cette opinion est exégétiquement insoutenable.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 39
6. Une survivance de l'eschatologie juive, sans valeur pour le chrétien actuel. Cette
explication, sans dénier une part de vérité à cette attente d'un retour du Christ,
considère cependant que les premiers chrétiens ont transporté sur la personne de Jésus
les rêves de l'eschatologie juive, dont la réalisation était apparue impossible.
Conclusion.
L'opinion la plus généralement répandue est faite d'un mélange de ces différentes
théories. Les apôtres et les premiers chrétiens, qui croyaient à la fin du monde à bref
délai, ont vu l'avenir dans une perspective prophétique plutôt qu'historique. Ils ont
interprété littéralement des paroles dont le sens spirituel seul importait. Pour nous,
cette seconde venue du Christ se place encore dans les événements à attendre, et rien
ne nous permet d'en fixer ni l'époque ni les circonstances. De siècle en siècle, des
chrétiens brûlant du désir de connaître l'avenir ont essayé de déterminer la date
précise de la parousie en se fondant sur le livre de Daniel ou sur les prophéties de
l'Apocalypse. Or, chaque fois, le cours des événements a prouvé la fragilité de leurs
calculs et l'inutilité de cette vaine curiosité.
La venue du Christ est associée avec la fin du temps de la foi et le début de la
rencontre directe avec le Christ. L’être humain verra le Christ son Sauveur face à face.
Au cours de l’histoire de l'Église, périodiquement, des chrétiens pensent que la venue
du Christ est imminente. Même la première Église et St. Paul parfois, partageait cette
conviction (Rm 11, 14-15). Les premiers chrétiens aimeraient que le Jour du Seigneur
s’achève et ils priaient pour revoir le Seigneur (Mt 25, 31-34 ; Ap 22, 20).
La bible affirme que personne, pas même Jésus, ne pouvait connaître l’heure de la fin
du monde et du retour du Christ (Mt 24, 36).
Petit à petit, les apôtres nous ont aidés à savoir que les prophéties sur le retour de Dieu
(exprimé par l’expression « le Jour du Seigneur » dans l’Ancien Testament avait déjà
commencé à se réaliser. En effet, la Parousie avait commencé le jour de la
Résurrection du Christ. C’est pourquoi Paul utilise des expressions telles que « la nuit
s’achève, c’est déjà le jour » (Rm 13, 12). Ici nous trouvons le principe et fondement
la phrase théologique du « déjà là et pas encore la du Jour du Seigneur».
Que se passera-t-il le jour de la parousie ? La parousie est suivie par le jugement
4. 3.3 Parousie selon le Catéchisme de l'Église Catholique
n° 830 (6) Le mot "catholique" signifie "universel" dans le sens de "selon la totalité"
ou "selon l'intégralité". L'Église est catholique dans un double sens:
(8) Elle est catholique parce qu'en elle le Christ est présent. "Là où est le Christ
Jésus, là est l'Église Catholique" (S. Ignace d'Antioche, Smyrn. 8,2). En elle subsiste
la plénitude du Corps du Christ uni à sa Tête (cf. Ep 1,22-23), ce qui implique qu'elle
reçoive de lui "la plénitude des moyens de salut" (AGd 6) qu'Il a voulus: confession
de foi droite et complète, vie sacramentelle intégrale et ministère ordonné dans la
succession apostolique. L'Église était, en ce sens fondamental, catholique au jour de la
Pentecôte (cf. AGd 4) et elle le sera toujours jusqu'au jour de la Parousie.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 40
n° 1001 (41) Quand? Définitivement "au dernier jour" (Jn 6,39-40 6,44 6,54 11,24);
"à la fin du monde" (LG 48). En effet, la résurrection des morts est intimement
associée à la Parousie du Christ:
(43) Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ
ressusciteront en premier lieu (1Th 4,16).
n° 1200 (6) De la première Communauté de Jérusalem jusqu'à la Parousie, c'est le
même Mystère pascal que célèbrent, en tout lieu, les Eglises de Dieu fidèles à la foi
apostolique. Le Mystère célébré dans la liturgie est un, mais les formes de sa
célébration sont diverses.
4.3.4 L’au-delà dans les Traditions Africaines
Devoir : Y a-t-il quelque chose comme la parousie dans les traditions Africaines ou
dans ton ethnie ? Si oui, Peux-tu comparer la conception de parousie dans la tradition
chrétienne et dans ta culture ?
4.4 LA RESURRECTION
4.4.1 La résurrection dans la Bible
Mt 22, 23; Mt 22, 28; Mt 22, 30; Mt 22, 31; Mt 27, 53 ; Mc 12, 18; Mc 12, 23; Lc 14,
14; Lc 20, 27; Lc 20, 33; Lc 20, 35; Lc 20, 36; Jn 5, 29; Jn 11, 24; Jn 11, 25; Ac 1, 22
; Ac 2, 31; Ac 4, 2; Ac 4, 33; Ac 17, 18 ; Ac 17, 32 ; Ac 23, 6 ; Ac 23, 8 ; Ac 24, 15 ;
Ac 24, 21 ; Rm 1, 4 ; Rm 6, 5 ; 1 Co 15, 12 ; 1 Co 15, 13 ; 1 Co 15, 21 ; 1 Co 15, 42 ;
Ph 3, 10 ; Ph 3, 11 ; 2 Tm 2, 18 ; He 6, 2 ; He 11, 35 ; 1 P 1, 3 ; 1 P 3, 21 ; Ap 20, 5 ;
Ap 20, 6.
4.4.2 La résurrection dans la tradition chrétienne
Le cardinal Jean Daniélou dit, « Le mot « ressuscité » n’a pas deux sens. Ou il
signifie que le corps du Christ n’est pas resté dans le tombeau, mais a été vivifié par la
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 41
puissance de Dieu et a donc pu être ainsi constaté comme toujours par les témoins –
où il ne signifie rien ». 88
La résurrection de Jésus marque l’eschatologie. Le Christ est l’alpha et l’oméga, « Ce
Jésus de Nazareth, crucifié par la main des impies, Dieu l’a ressuscité. Tel est le
témoignage apostolique originel. Dieu a donc approuvé de manière éclatante toute la
« prétention » qui avait habité l’existence du Jésus pré-pascal. Il éta it bien celui qu’il
prétendait être, celui qui s’exprimait comme étant la bouche même de Dieu, celui qui
appelait Die sont propre Père (Abba) et se présentait dans la relation unique de Fils.
Mais avec l’événement de la résurrection quelque chose de radicalement nouveau
vient de se produire, évidemment interprété dans l’horizon de sens des traditions
apocalyptiques qui attendaient la résurrection générale. « Si Jésus est ressuscité, c’est
déjà la fin du monde », dit W. Pannenberg dans son commentaire du message de la
résurrection. Tout le monde reconnaît la portée eschatologique de cet événement. Il
s’agit là sans doute d’une dimension qualitative, puisque le temps empirique de
l’histoire des hommes continue, au moins provisoirement aux yeux des premiers
chrétiens ». 89
Pour les chrétiens, la résurrection ne peut pas être dissociée du Christ. En parlant de
« la résurrection selon le Christianisme », Henri Bourgeois maintient : « Jésus croyait
à la résurrection comme beaucoup. Ce qui le distinguait, c’est qu’il la liait à son
propre destin. Il y avait là une nouveauté que le Christianisme issu de l’événement
pascal devait approfondir. La façon chrétienne de parler de la résurrection tient en
effet en deux affirmations que précisément le pharisaïsme n’accepta pas. D’une part,
la résurrection dont on parlait jusqu’ici comme d’une espérance était considérée
comme étant réellement arrivée. Ce n’était plus seulement une représentation, c’était
devenu une réalité. D’autre part, cette résurrection concernait pour l’instant un seul
être humain, Jésus Christ. Cela était étrange et même difficile à admettre par le
judaïsme pour lequel la résurrection était spontanément perçue comme collective.
Certes, disaient les chrétiens, Jésus était le premier-né d’une humanité nouvelle. Il
anticipait en son destin particulier l’avenir de tous. Mais, dans le présent, il était le
seul à être ressuscité. Ce qui, bien sûr, pouvait relancer l’espérance mais en même
temps laissait chacun en face de ce qui n’était pas encore ». 90
En parlant de la résurrection Durwell, d’abord, souligne que l’homme est « une
personne immortelle ». Le corps de l’homme est corruptible. Le fait que son âme est
immatérielle, elle est incorruptible et immortelle. La foi dans la résurrection va au-
delà de ce constat philosophique. Jésus est principe et fondement de notre
résurrection (Jn 11, 25 ; Lc 20, 35s. ; Jn 6, 39 ; 11, 25s. ; Ac 2, 24 ; Col 2, 12 ; 2 Co 5,
15 ; Ph 3, 10. Il aura la « résurrection finale » (1 Co 15, 23s. ; 1 Jn 3, 2 ; 1 Th 4, 16 ;
Jn 5, 25 ; Tt 2, 13 ; 1 Th 4, 17 ; 2 Co 4, 14 ; 1 Cor 15, 35-44 ; Lc 20, 35s. ; 1 Co 12,
88
J. Daniélou, La Résurrection, Paris, Le Seuil, p. 48. 89
Charles Perrot, et al., Le retour du Christ, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1983, p.
143. 90
Henri Bourgeois, Je crois à la résurrection du corps, Paris, Desclée, 1981, p. 139.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 42
27). Il tient que toutes les questions posées autour du dogme de la résurrection des
morts ont leur réponse dans le mystère de Jésus ressuscité. 91
Concernant la résurrection de la chair, Tertullien affirme, « Mais, me diras-tu,
comment une matière réduite en poussière pourra-t-elle être reconstituée ? Considère-
toi, ô homme, et ta surprise disparaîtra. Vois ce que tu étais avant de venir sur terre.
Tu n’étais rien : si tu avais été quelque chose, tu t’en souviendrais. Si donc tu es sorti
du néant, pourquoi ne pourrais-tu pas en sortir de nouveau quand tu y seras rentré ?...
Douteras-tu de la puissance de ce Dieu qui forma ce vaste organisme du monde en
l’arrachant à la mort du néant ? … Les semences ne germent qu’après avoir subi les
lois de la corruption. Tous les êtres doivent périr pour se maintenir dans l’existence, et
c’est dans la mort qu’ils puisent une nouvelle jeunesse. Et toi, ô homme, toi le chef-
d’œuvre de la création, toi qui domines sur tous ces êtres qui meurent et qui
renaissent, tu mourrais sans espoir de retour ? Non, n’importe où que soit dispersée ta
poussière, la terre la rendra ». 92
Dans le Symbole d’Athanase, il est écrit « Nous ne croyons pas que nous
ressusciterons dans un corps aérien ou dans quelque autre espèce de corps, selon les
divagations de certains, mais dans ce corps avec lequel nous vivons, nous existons et
nous mouvons ». Le IVe concile de Latran avait maintenu la même position, « Nous
ressusciterons avec le corps que nous possédons actuellement. L’eschatologique
classique se trouve aussi dans le supplément à la Somme théologique de Thomas
d’Aquin. Concernant la question le problème : ressusciterons-nous avec nos intestins,
il répond, « si, nous ressusciterons avec nos intestins, et ils ne seront pas vides, mais
pleins, non d’immondices mais de nobles humeurs » (Somme théologique,
Supplément, 80, 1 ; cf. 82, 4 ; Somme contre les Gentils, 4, 79). 93
Dans l’histoire de l’eschatologie, il y a eu un grand débat entre l’immortalité de l’âme
ou la résurrection des corps. Les grecs étaient pour l’immoralité de l’âme et les juifs
étaient plutôt pour la résurrection de la chair. La foi catholique reconnaît l’existence
d’une âme immortelle mais elle affirme avec beaucoup de force la résurrection de la
chair. Comment justifier l’identité du corps charnel avec le corps spirituel ou le corps
glorifié des élus ? Aura-il une partie de l’organisme qui restera inchangée comme
disait Pierre Lombard (Ne ressuscitera que ce qui aura été de veritate humanae
naturae) ? Thomas d’Aquin dit, non. 94
En parlant de « la “La mort de Dieu” et la Résurrection du Christ » dit, « C’est
pourquoi aussi la prédication de la Résurrection de Jésus d’entre le morts opérée par
Dieu est devenue en partie superflue, en partie facultative, tant que « Dieu » signifie
quelque chose que l’on connaît par histoire, par le monde ou par l’existence humaine.
Or il s’agit maintenant de pouvoir montrer, en liaison avec la connaissance de la
Résurrection de Jésus, et en confrontation avec la « la mort de Dieu » - qui nous est
connue par l’histoire, par le monde et par notre existence -, que « le Dieu de la
91
Cf. François-Xaxier Durrwell, Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris, Mediaspaul, 1994, p. 77-116. 92
Tertullien, Apologeticum, no. 48, trad. Turmel. 93
Cf. Pierre Philippe, Le Royaume des cieux, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1976, p. 25-29. 94
Cf. Thomas d’Aquin, Summa Theologica Supp., q. 80, art. 4.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 43
Résurrection » es « Dieu » : c’est alors seulement que la prédication de la
Résurrection, la foi et l’espérance au Dieu de la promesse, seront quelque chose de
nécessaire, de nouveau et de réellement et objectivement possible ». 95
Selon plusieurs écoles d’aujourd’hui, la conception de la résurrection a été
« détemporalisé », c’est-à-dire ramenée au moment de la mort. La conséquence de
cette conception est la « dématérialisation », c’est-à-dire la négation de la résurrection
corporelle au moment de sa mort. Pour corriger cette conception erronée il faut
revenir à la notion chrétienne originelle de l’immortalité de l’âme. Voici quelques
questions importantes sur la résurrection : « Y a-t-il quelque chose comme une fin du
temps ? Au-delà de l’«être-avec-le-Christ » que le fidèle escompte après sa mort, faut-
il ajouter quelque chose de plus ? Au nom de la foi, faut-il affirmer que l’histoire
humaine, comme telle et tout entière, aura une fin ? Qu’il y aura vraiment un « dernier
jour » ? Le second problème est le suivant : la résurrection a-t-elle ou non un rapport
quelconque avec la matière ? La foi espère-t-elle une métamorphose de la matière, et
donc quelque chose comme une résurrection corporelle ? » 96
Beaucoup des positions
modernes répondent par un non catégorique à ces questions.
A.Vögtle maintient que le Nouveau Testament ne donne pas un enseignement sur la
vie future : « Dans aucun des textes relatifs à ce sujet, on ne peut déceler l’intention
de donner ni même de rendre vrai un semblable enseignement prophétique sur le sort
futur de l’univers… Il n’est pas davantage prouvé que Jésus lui-même ou la première
prédication chrétienne de la foi aient parlé d’un effet futur de l’événement christique,
de nature à modifier l’état de l’univers… Le Nouveau Testament s’interdit tout
énoncé doctrinal sur l’aspect proprement cosmologique ». 97
Cette position a été
critiquée : « Il faut affirmer que Vögtle fonde ses analyses sur la confusion entre
catégories historique et spéculatives, sans expliquer le principe méthodologique, de
sorte que le résultat systématique reste finalement aussi contestable que le droit
d’introduire des principes spéculatifs dans un exposé historique. Ce disant, on ne nie
pas la valeur d’un grand nombre d’études particulières de ce livre ». 98
Paul affirme la
résurrection avec un corps glorifié (1 Co 15, 35-53). Irénée maintient que Jésus est
monté au ciel, avec un corps glorifié, immédiatement après sa mort et résurrection
(Adv. Haer. V, 31, 1). Origène défend la résurrection de la chair (du corps) et il
essaye de répondre à la question qu’est ce qu’une « résurrection des corps ». 99
Excursus : l’au-delà dans la tradition chrétienne - un article
I- Les faits
95
Cf. Jürgen Moltmann, Théologie de l’espérance, Théologie de l’espérance : Etudes sur les
fondements et les conséquences d’une eschatologie chrétienne, Paris, Edition Mame-Cerf, 1970, p.
179. 96
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 180. 97
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 180 ; Cf. A. Vögtle, Das Neue Testamentes und die Zukunft
des Kosmos, Düsseldorf, 1970, p. 232-233. 98
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 181. 99
Cf. M. R. Cadiou, La jeunesse d’Origène, Paris, 1936, p. 252-254.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 44
1- Existence de Jésus
2- Mort de Jésus lors de la crucifixion
3- Le tombeau vide
4- Des hommes transformés en quelques jours
a- Les disciples dans leur ensemble
b- Pierre
c- Thomas
d- Jacques le frère du Seigneur
e- Paul
5- Des hommes prêts à mourir martyrs pour annoncer Christ et la résurrection
6- Conversion massive et brutale de juifs
7- Divers
II- Examen des théories alternatives à la résurrection
1- Le tombeau n'était pas vide
a- Le corps de Jésus a été enterré en un lieu inconnu
b- Les femmes se sont trompées de tombeau
c- La résurrection est un ajout légendaire
d- Résurrection spirituelle
e- Des hallucinations
2- Le tombeau était vide
a- Les disciples ont pris le corps
b- Le corps a été pris par les Romains
c- Le corps a été pris par les Juifs
d- Jésus n'était pas mort, mais évanouit
3- Conclusion
III- Quelques citations
1- Thomas Arnold
2- Paul L.Maier
3- C.S. Lewis
4- John Singleton Copley
5- Simon Greenleaf
6- Lord Caldecote
IV- Bibliographie
I- Les faits
1- Existence de Jésus
Comme l'existence historique de Jésus n'est pas remise en question par les historiens
et que le sujet traité concerne sa résurrection, nous ne développerons pas ce point.
Nous nous contenterons de mentionner que son existence est attestée par de très
nombreux auteurs chrétiens (NT, Pères de l'Église, …) ainsi que par des auteurs non
chrétiens (Tacite, Josèphe, le Talmud[1], …).
2- Mort de Jésus lors de la crucifixion
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 45
Le fait que Jésus ait été crucifié est généralement admis par les historiens.
Le supplice de la crucifixion était généralement précédé de flagellation (ce qui a été le
cas pour Jésus, comme le rapportent les évangiles). Beaucoup mouraient lors de la
flagellation (fouet avec des lanières de cuir garnies de billes métalliques et d'éclats
d'os) qui déchiquetait le corps[2]. Ceux qui ne mourraient pas, subissaient les effets
d'une perte de sang importante (choc hypovolémique) : accélération du rythme
cardiaque, évanouissement ou collapsus, reins qui ne produisent plus d'urine, soif
intense[3]. Jésus devait se trouver dans cet état critique grave avant la crucifixion [4].
Il a ensuite été crucifié, puis a reçu un coup de lance dans le côté, d'où il est sorti du
sang et de l'eau. Cela confirme que Jésus était bien mort lorsqu'il a reçu le coup de
lance, car pour une mort par asphyxie il est médicalement connu qu'il y a une poche
de liquide qui se forme autour des poumons et du coeur[5]. C'est probablement ce
liquide que Jean appelle de l'eau.
Le fait que Jésus soit mort est encore confirmé par :
Le témoignage des évangiles qui parlent du moment où Jésus expira.
Le témoignage du centurion rapporté dans les évangiles. A cet égard, il faut souligner
que les soldats romains ayant l'habitude de ce genre d'exécution, ils savaient faire la
différence entre un mort et un mourant. De plus, si un prisonnier réussissait à s'enfuir,
les soldats responsables étaient exécutés à sa place : cela était donc un puissant motif
pour qu'ils s'assurent de façon certaine de sa mort[6].
L'absence de tout document de l'époque qui nierait le fait que Jésus soit mort[7].
Le fait qu'il ait été embaumé et mis dans un linceul par Joseph d'Arimathée et
Nicodème : s'il n'était pas mort ceux-ci s'en seraient rendu compte[8].
3- Le tombeau vide
Les évangiles rapportent que les femmes (Marie-Madeleine, Jeanne, Marie mère de
Jacques, ...), Pierre et Jean ont constaté que le tombeau était vide.
Les soldats qui gardaient le sépulcre ont constaté qu'il était vide (Mt 28.11-15).
Les principaux sacrificateurs (ennemis de Jésus) ne mettent pas en doute le fait que le
tombeau soit vide puisqu'ils soudoient les gardes pour qu'ils racontent que ce sont les
disciples qui ont volé le corps (Mt 28.11-15)
"Dans tous les fragments de documentation que nous possédons au sujet de cette
lointaine controverse, il n'est fait mention d'aucune personne autorisée ayant affirmé
que le corps de Jésus était toujours dans le tombeau. Seules les raisons pour lesquelles
il n'y était point se trouvent rapportées. De la totalité des anciens documents se dégage
la persistante impression qu'il était considéré comme notoire que le sépulcre était
vide."[9]
Il est de plus intéressant de noter qu'il n'existe aucune trace que ce soit dans la Bible
ou dans un document apocryphe, incontestablement d'époque ancienne, que qui que
ce soit ait jamais rendu hommage à la tombe de Jésus-Christ.[10]
4- Des hommes transformés en quelques jours
a- Les disciples dans leur ensemble
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 46
Lors de l'arrestation du Seigneur, "tous l'abandonnèrent et prirent la fuite" (Mc 14.50).
Après la crucifixion, ils se "barricadaient chez eux" par crainte des juifs (Jn 20.19).
Quelques jours après, ils sont dans la joie (Lc 24.41, 52, 53). De plus, affrontant la
persécution, ces hommes annoncent Christ (Ac 2.14, Ac 2.14, 5.42), et se
réjouissent même d'avoir souffert pour Lui (Ac 5.41) !
b- Pierre
Lors de l'arrestation du Seigneur il s'enfuit (Mc 14.50), puis lors de son jugement il le
renie (Jn 18.17, Jn 18.17, 25, 27).
Peu après, il annonce Christ avec assurance (Ac 2.14-40, 3.12-26) et affronte la
persécution (Ac 12.3-11).
c- Thomas
Lorsque les disciples lui disent qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité, il demande à voir
et toucher pour croire (Jn 20.25).
Peu après, Thomas est avec les onze pour annoncer Christ (Ac 2.14) ; il sera même
prêt à mourir martyr ! (cf. 5-Des hommes prêts à mourir martyrs pour annoncer
Christ et la résurrection).
d- Jacques le frère du Seigneur
Il ne croyait pas en Jésus de son vivant (Jn 7.5).
Il sera cependant prêt à mourir martyr pour Jésus, après la mort de celui-ci. (cf. 5-Des
hommes prêts à mourir martyrs pour annoncer Christ et la résurrection).
e- Paul
Persécuteur acharné des chrétiens ( Ga 1.13, Ac 8.3, 26.9-11).
D'un seul coup il se met à annoncer avec ferveur la foi qu'il détruisait, et affrontera
même la persécution pour cela (2 Cor 4.9-11, 11.23-33).
5- Des hommes prêts à mourir martyrs pour annoncer Christ et la résurrection
Parmi les douze apôtres, l'histoire nous apprend que onze sont morts martyrs :
Pierre, André, Jacques (fils d'Alphée), Philippe, Simon, Barthélémy : mourront
crucifiés.
Matthieu, Jacques (fils de Zébédée) : mourront par l'épée.
Thaddée tué par flèches, Thomas tué par une lance.
Jacques le frère du Seigneur est également mort martyr (d'après Flavius Josèphe).
6- Conversion massive et brutale de juifs
Si les juifs n'ont pas disparu au sein de la diaspora, c'est parce que les structures
sociales qui faisaient leur identité nationale comptaient beaucoup pour eux. Ils
croyaient qu'elles leur avaient été confiées par Dieu et que les abandonner revenait à
faire risquer l'enfer à leur âme après la mort. Ces structures s'articulaient notamment
autour des 5 points fondamentaux suivants : les sacrifices pour expier les péchés,
l'obéissance aux lois mosaïques pour faire partie du peuple de Dieu, le respect du
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 47
sabbat, un monothéisme qui leur interdisait de croire que quelqu'un puisse être
homme et Dieu, l'attente d'un Messie glorieux.
Or, environ 5 semaines après la crucifixion de Jésus qui se présentait comme le
Messie (drôle de Messie glorieux pour les juifs !) il y avait déjà 10 000 juifs qui se
réclamaient de lui et qui étaient prêts à abandonner ou à modifier les 5 points
précédents, qui pourtant, depuis des siècles, demeuraient incontournables pour un juif
!
Quel fait (si ce n'est celui de la résurrection …) peut-il être à même d'expliquer un tel
phénomène ?
7- Divers
C'est à Jérusalem (ville où Jésus a été mis au tombeau) et non à des milliers de km de
là que les disciples ont commencé à prêcher la résurrection : si Jésus n'étaient pas
ressuscité les habitants de Jérusalem auraient eu vite fait de réduire ce mensonge à
néant.
La communion : les disciples se retrouvaient régulièrement pour un repas festif, pour
se remémorer l'assassinat public, grotesque et humiliant enduré par Jésus ! Comment
expliquer cela si ce n'est parce qu'ils savaient qu'il avait vaincu la mort ?
Le supplice de la croix était considéré comme un supplice infamant. Comment
expliquer la propagation d'une religion basée sur l'adoration d'un homme ayant subi la
mort la plus ignominieuse qui soit ? Seule la résurrection permet d'expliquer
"raisonnablement" cela !
Joseph d'Arimatée est venu chercher le corps de Jésus pour l'ensevelir dignement dans
son sépulcre : si l'histoire de la résurrection de Jésus avait été inventée il serait assez
étonnant qu'on y ait mis ce fait car Joseph d'Arimatée était un des membres du
sanhédrin qui avait condamné Jésus !
II- Examen des théories alternatives à la résurrection
1- Le tombeau n'était pas vide
a- Le corps de Jésus a été enterré en un lieu inconnu
Cette théorie ne tient pas compte de l'inhumation, de la garde devant le tombeau, des
affirmations du tombeau vide, des apparitions de Jésus, de la transformation des
disciples.
De plus, si ceux qui avaient enterré Jésus étaient les Romains ou les chefs Juifs, ils
auraient alors pu facilement ressortir le corps pour tuer le christianisme naissant!
b- Les femmes se sont trompées de tombeau
Cette théorie implique alors que Pierre et Jean se seraient aussi trompés de tombeau.
Elle ne tient pas compte des apparitions de Jésus ainsi que de la transformation des
disciples.
De plus, si les femmes s'étaient effectivement trompées de tombeau, les chefs des
juifs ou les Romains auraient eu tôt fait de montrer le vrai tombeau avec le corps du
Seigneur : n'avaient-ils pas placé une garde devant celui-ci ?
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 48
c- La résurrection est un ajout légendaire.
Le tombeau vide est une donnée implicite de la "tradition" transmise par Paul en
1 Co 15.1-8 ; or ce texte est très ancien et il doit dater d'avant 50 av. JC[11]. Les
évangiles, bien que plus récents, sont aussi d'anciennes sources. Ces écrits circulaient
donc alors que des témoins des événements étaient toujours en vie : si ce qu'ils
racontaient était des légendes, ils n'auraient donc pu avoir aucune crédibilité !
"A.N. Sherwin-White, le grand historien classique de l'université d'Oxford (…) a fait
une étude serrée sur les enjolivements légendaires dans l'antiquité. Avec le résultat
suivant : même deux pleines générations ne suffisent pas pour que des ajouts
légendaires viennent effacer un noyau historique solide."[12]. Il a pu dire que "si les
Évangiles étaient corrompus par une légende au point d'en être aussi vite et aussi
fortement déformés, ce serait un fait unique dans l'histoire."[13].
Si le récit de la résurrection avait été inventé :
Ce ne sont probablement pas des femmes qui auraient été mises comme premiers
témoins de la résurrection : elles étaient placées tellement bas sur l'échelle sociale de
la Palestine au 1er
siècle, qu'on ne les autorisait même pas à témoigner dans un
tribunal juif : leur témoignage était considéré comme nul[14].
Il serait assez inconcevable qu'on ait imaginé la participation de Joseph d'Arimathée
pour ensevelir le Seigneur, car il était un des membres du sanhédrin qui avait
condamné Jésus !
Enfin, les juifs attendaient une résurrection à la fin de l'histoire, au dernier jour : "Au
lieu de cadrer avec l'espérance populaire en matière de résurrection, ce qui est arrivé à
Jésus la contredit. L'extraordinaire nouveauté de la position chrétienne d'alors a été
obscurcie par deux millénaires de compréhension chrétienne de la résurrection ;
pourtant, au moment où l'événement s'est produit, il n'avait rien d'orthodoxe. Il était
révolutionnaire."[16].
De plus, cette théorie n'explique pas la transformation des disciples. Elle implique
même que les disciples auraient accepté d'aller au martyr pour des fables qu'ils
auraient pertinemment su être des fables !..
Il faut enfin rajouter un mot sur la théorie selon laquelle la résurrection de Jésus ne
serait qu'une reprise de mythes païens[17] :
La théorie selon laquelle l'adoration de divinités mourant et revenant à la vie
(Tammuz en Mésopotamie, Adonis en Syrie, Attis en Asie Mineure, Osiris en Égypte)
était répandue, a été proposée par Sir James Frazer, en 1906. Cette théorie repose en
fait sur des preuves très fragiles.
En ce qui concerne la divinité mésopotamienne Tammuz (le Dumuzi Sumérien), sa
résurrection par la déesse Inanna-Ishatar a été affirmée alors que la fin des textes
manque. Akkadiens et Sumériens du mythe "La descente d'Inanna (Ishtar)" ; le seul
appui est une ligne dans un fragment de texte obscur, selon lequel, après que Dumuzi
ait été envoyé aux enfers, sa sœur l'aurait remplacé pour la moitié de l'année.
Quant à Adonis, les 4 textes qui parlent de sa résurrection sont tardifs puisqu'ils sont
datés entre le IIème
et IVème
ap. JC.
En ce qui concerne Attis, l'époux de Cybèle, ce n'est qu'à partir de 150 ap. JC. qu'on le
voit apparaître comme un dieu ressuscité !
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 49
Finalement, il ne reste qu'Osiris pour lequel on a des preuves anciennes de
"résurrection" ; la plus ancienne version complète du mythe de sa mort et de sa double
résurrection par Isis est trouvée chez Plutarque qui a écrit au IIème
ap. JC ; ce récit
s'accorde avec des affirmations de textes égyptiens bien plus anciens. Mais c'est une
erreur que de considérer que la résurrection de la tradition hébraïque corresponde à la
vue égyptienne de la vie après la mort ; pour atteindre l'immortalité, les égyptiens
devaient : être momifiés, être nourris (par de la nourriture amenée régulièrement dans
la tombe ou par des représentations magiques de nourriture sur les murs de la tombe),
être enterrés avec des formules magiques. Osiris qui est toujours dessiné sous forme
momifiée ne saurait être une inspiration du Christ ressuscité. Roland de Vaux affirme
que dire qu'Osiris a été ramené à la vie signifie que grâce aux soins d'Isis, il peut
mener une vie outre- tombe, qui est presqu'une réplique parfaite de la vie sur terre ;
mais il ne reviendra jamais parmi les vivants et ne régnera que sur les morts ; ce dieu
revivifié est en fait un dieu momie.
Outre toutes ces remarques, voici ce que souligne Mc Grath Alister, à propos de ces
mythes païens que certains voudraient voir comme la source d'inspiration de la
résurrection de Christ : "les documents du Nouveau Testament indiquent avec
précision le lieu et la date de la mort et de la résurrection de Christ, et n'hésitent pas à
citer le nom des témoins de ces deux événements. Le contraste avec la forme non
historique de la mythologie est saisissant. De plus il n'existe aucun exemple connu
dans la littérature païenne où ce mythe aurait été appliqué à un personnage historique
précis, si bien que les auteurs du Nouveau Testament auraient donné à cette
mythologie une formé étonnamment originale.".
d- Résurrection spirituelle
Par résurrection spirituelle il faut comprendre cette pensée selon laquelle Jésus ne
serait ressuscité que dans la foi et dans la prédication des disciples, sans réalité
historique derrière.
Cette explication ne tient pas compte du fait que "les juifs avaient une conception
physique de la résurrection. Pour eux, la résurrection concernait d'abord les os des
morts, pas même la chair qu'ils considéraient comme périssable. Une fois la chair
décomposée, les juifs avaient coutume de rassembler les os de leurs morts pour les
ranger dans des boîtes afin de les conserver jusqu'à la résurrection de la fin du monde,
où Dieu devait relever les justes d'Israël et les réunir sous son règne définitif."[15].
Cette explication ne tient pas non plus compte du tombeau vide : il aurait été
tellement facile pour les chefs juifs ou pour les romains de réduire au silence le
christianisme naissant en montrant le corps de Jésus. De plus, lors de certaines de ses
apparitions, Jésus prend soin de montrer qu'il n'est pas un simple esprit, mais qu'il a
un corps (Lc 24.36-43).
e- Des hallucinations
Cette explication n'est pas crédible car :
Seuls certains tempéraments sont sujets aux hallucinations. Il est difficile de faire
rentrer dans cette catégorie Pierre, Thomas, Paul, Jacques.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 50
Elles surviennent à des personnes qui pendant des années ont désiré ardemment
quelque chose. Ce n'était certainement pas le cas des disciples puisqu'ils étaient
incrédules face à la résurrection.
Elles affectent souvent une personne en un lieu et à des moments précis ; ici il s'agit
de groupes (2, 11, 500, ...), de lieux (lac, route, chambre, jardin, ...) et de moments
différents.
Elles se produisent en général pendant un certain temps, avec une fréquence et une
intensité qui augmentent : ici, tout s'arrête brusquement au bout de quarante jours.
Il est très improbable que des personnes différentes, provenant d'arrières plans
différents aient la même illusion.
De plus, s'il s'était agit d'hallucinations, les chefs des juifs ou les Romains auraient eu
tôt fait de montrer le corps de Jésus pour faire taire ce bruit.
2- Le tombeau était vide
a- Les disciples ont pris le corps
Cette théorie ne tient pas compte de la garde qui était placée devant le tombeau. Elle
ne permet pas non plus d'expliquer le brusque changement qui s'est opéré dans la vie
des disciples. Si les disciples avaient volé le corps, ils auraient cherché à s'enfuir le
plus rapidement possible du tombeau et n'auraient pas pris le temps d'enlever le
linceul et de le laisser dans le tombeau !
Elle implique de plus que les disciples auraient accepté de mourir martyrisés pour une
cause qu'ils auraient su fausse !
b- Le corps a été pris par les Romains
Cette théorie ne tient pas compte des apparitions, ni du changement qui s'est opéré
dans la vie des disciples. Elle ne tient pas non plus compte du fait que le linceul était
resté dans le tombeau : les Romains n'auraient sûrement pas pris le temps d'enlever le
linceul s'ils avaient volé le corps.
De plus, si les Romains avaient pris le corps, ils auraient eu vite fait de le "ressortir"
pour arrêter les troubles que cela générait.
c- Le corps a été pris par les Juifs
Cette théorie ne tient pas compte des apparitions, ni du changement qui s'est opéré
dans la vie des disciples. Elle ne tient pas non plus compte du fait que le linceul était
resté dans le tombeau : les Juifs n'auraient sûrement pas pris le temps d'enlever le
linceul s'ils avaient volé le corps.
De plus, si les Juifs avaient pris le corps, ils auraient eu vite fait de le "ressortir" pour
arrêter le christianisme naissant qui détruisait le judaïsme.
d- Jésus n'était pas mort, mais évanoui.
Cela n'explique pas comment il aurait pu sortir du tombeau : il y avait une pierre
énorme à l'entrée, ainsi que la garde devant. Que serait alors devenu Jésus par la suite
? Pourquoi n'en serait-il plus parlé ? Et puis, il aurait bien fallu qu'il meure un jour ...
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 51
Si Jésus n'était pas mort, il aurait été dans un état si lamentable que ses disciples
n'auraient pas pu le proclamer Seigneur de la vie, ayant triomphé de la mort !
De plus, il est impossible que Jésus ne soit pas mort après ce qu'il a subi. (Cf. 2-Mort
de Jésus lors de la crucifixion).
3- Conclusion
L'examen de l'ensemble des théories proposées révèle leur manque de crédibilité
lorsque ont pris en compte toutes les données du "problème".
Par contre, la résurrection est en accord avec tous les faits exposés dans les évangiles.
De plus, elle seule permet d'expliquer :
Que les disciples aient vécu une transformation subite dans leur vie.
Que des opposants à Christ (Jacques son frère, Paul, ...) soient devenus ses disciples.
Que des hommes aient été prêts à mourir martyrs parce qu'ils affirmaient avoir vu
Jésus ressuscité (si un homme est capable de mourir pour une chose qu'il croit vraie,
personne n'est capable de mourir pour ce qu'il sait être un mensonge !).
Qu'il y ait eu une conversion massive et subite de juifs au christianisme.
Que le christianisme soit basé sur l'adoration d'un homme ayant subi une mort
infamante et que ses deux symboles rappellent justement la mort infamante de Jésus.
III- Quelques citations
1- Thomas Arnold
Spécialiste profane de l'histoire romaine :
"J'ai eu l'habitude pendant de nombreuses années, d'étudier l'histoire ancienne,
d'examiner et d'évaluer les preuves avancées par ceux qui ont écrit à son sujet. Eh
bien, je ne connais aucun fait dans l'histoire de l'humanité qui puisse mieux être établi
par toutes sortes de preuves et mieux compris des personnes avides de vérité, que le
signe que Dieu lui-même nous a donné de la mort et de la résurrection du Christ".
(Sermons on the christian life - its hopes, its fears and its close, p324 ;
T.Arnold)
2- Paul L.Maier
Professeur d'histoire ancienne à Wetern Michigan University :
"Si toutes les preuves sont examinées attentivement et honnêtement, il est en effet
légitime, selon les critères de la recherche historique, de conclure que la tombe dans
laquelle Jésus avait été enseveli était vraiment vide au matin de Pâques. Pas la
moindre preuve n'a encore été découverte, ni dans les textes littéraires, ni en
épigraphie, ni en archéologie, qui puisse réfuter cette assertion."
(Independent press-telegram, long beach, Calif, april 21, 1973, p.A-10)
3- C.S. Lewis
Professeur de littérature à l'université de Cambridge ; il s'est converti en examinant les
preuves de la résurrection :
"Aucune autre religion (que le christianisme) ne présentait un tel caractère
d'historicité". "J'avais une trop grande expérience de la critique littéraire pour pouvoir
considérer les évangiles comme étant un mythe."
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 52
(Surprised by joy, London, Geoffroy Bles, 1955, p 215, 221, 223. C.S. Lewis)
4- John Singleton Copley
Procureur général ; reconnu comme l'une des plus grandes intelligences juridiques de
l'histoire d'Angleterre. Il est aussi connu sous le nom Lord Lyndhurst. Il fut avocat
général du gouvernement britannique, procureur général de G.B., trois fois grand
chancelier d'Angleterre :
"Je sais très bien ce que sont des preuves ; et j'affirme que des preuves comme celles
que nous possédons sur la résurrection n'ont jamais été réfutées".
(Therefore stand, Grand rapids, Mich., Baker Book house, 1965, p425, 584 ; Wilbur
Smith)
5- Simon Greenleaf
Expert en matière de preuves. A publié "traité sur la loi des preuves". Ce traité est
considéré comme l'un des plus importants de tous les écrits publiés sur la procédure
judiciaire.
Il a examiné la valeur des preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ ; il
leur a appliqué les principes retenus dans son traité sur les preuves. Il en conclut qu'il
existe plus de preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ qu'il n'en existe
pour aucun autre événement de l'histoire.
(An examination of the testimony of the 4 evangelists by the rules of evidence
admistrated in the courts of justice ; S.Greenleaf).
6- Lord Caldecote
Président du tribunal royal :
"... en essayant de tester les revendications de Jésus-Christ, c'est à dire sa résurrection,
j'ai toujours été amené, alors que j'examinais les preuves, à y croire en tant que fait
indiscutable."
(A layer examines the Bible, Grand Rapids, Mich., Baker Book House, 1943, p 14 ;
Linton H.Irwin).
IV- Bibliographie
Craig, W.L., The Historicity of the Empty Tomb of Jesus, (Source :
http://www.leaderu.com/offices/billcraig/docs/tomb2.html))
Green, M., La mort en deuil, Fontenay-sous-Bois, Farel, 1985, 117 p.
Green, M., Le grand dérapage, Fontenay-sous-Bois, Farel, 1988, pp. 52-61.
McDowell, J., Bien plus qu'un charpentier, Miami, Vida, 1982, 115 p.
McDowell, J., La résurrection, Braine-l'Alleud, Editeurs de Littérature Biblique,
1987, 225 p.
McDowell, J., Muller, P., Qui dites vous que je suis ?, Cergy-Pontoise, Sator, 1986,
pp.103-152.
Perman, M., Taylor, J., Harmony of the Resurrection Accounts, (source :
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/8449/harmonize.html)
Rhoton, D., La logique de la foi, Fontenay-Sous-Bois, Farel, 19874è
, pp. 23-62.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 53
Rueb G.E., http://www.crusade.org/francais/defense/resurrectionf.html.
Shallis, R., Jésus, qui en fait est Jésus-Christ ?, Marne-La-Vallée, Farel, 1983, pp. 32-
48.
Strobel, L., Jésus : la parole est à la défense, ?, Vida, 2001, pp.217-294.
Yamauchi Edwin M., Easter: Myth, Hallucination, or History?, (Source :
http://www.leaderu.com/everystudent/easter/articles/yama.html)
[1] A cet égard, il faut souligner que le Talmud qui est à priori hostile à Jésus, ne nie
pas l'existence de Jésus ; il reconnaît même que Jésus a fait des miracles puisqu'il
parle de lui comme d'un magicien …
[2] Voici ce qu'en dit Eusèbe, historien du IIIè : "Les veines de la victime étaient
mises à nu, et même les muscles, les tendons et les viscères devenaient visibles",
Strobel, L., Jésus : la parole est à la défense, ?, Vida, 2001, p222.
[3] D'après un expert en diagnostique médical, A. Metherell, cité dans : Strobel, L.,
Jésus : la parole est à la défense, ?, Vida, 2001, p223.
[4] Au début il portait sa croix ( Jn 19.17 ), puis quelqu'un a dû le remplacer (
Lc 23.26 ) ; sur la croix il a eu soif.
[5] D'après un expert en diagnostique médical, A. Metherell, cité dans : Strobel, L.,
Jésus : la parole est à la défense, ?, Vida, 2001, p226, le crucifié doit pousser sur ses
pieds pour pouvoir expirer ; lorsqu'il n'a plus la force de le faire, il s'asphyxie et meurt
par arrêt cardiaque ; le choc hypovolémique, consécutif à la flagellation, accélérait le
rythme cardiaque, favorisant la crise cardiaque avec pour effet une accumulation de
liquide dans la membrane péricardiaque (épanchement péricardiaque) et autour des
poumons (épanchement pleural). Voir aussi : C.Truman Davis, "The crucifiction of
Jesus", Arizona medicine, p185-186 ; Dr Bergsma, "Did Jesus die of a broken heart?",
The Calvin Forum, march 1948, p165.
[6]D'après A. Metherell, dans : Strobel, L., Jésus : la parole est à la défense, ?, Vida,
2001, p229.
[7] En soi même, cette absence n'est pas une preuve que de tels documents n'existaient
pas. Néanmoins, face aux documents qui attestent sa mort, cette absence rend
d'autant moins crédible la position de ceux qui affirment qu'il n'est pas mort !
[8] Pour ceux qui malgré tout soutiennent l'invraisemblance, il faut souligner que le
fait de supposer que Jésus n'était pas mort et que Nicodème et Joseph ne s'en soient
pas rendu compte, implique que Jésus aurait été dans une faiblesse extrême ; par
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 54
conséquent, le fait de lui entourer la tête d'un linceul avec une masse importante
d'aromates aurait alors largement suffit pour l'étouffer.
[9] Morrison, F, La résurrection : mythe ou réalité ?, Guebwiller, LLB, 1974 , p169,
182.
[10] Morrison, F, La résurrection : mythe ou réalité ?, Guebwiller, LLB, 1974 , p169,
182.
[11] Paul a écrit 1 Co entre 55-57 ap. JC ; en 1 Co 15.1-4 dit qu'a déjà transmis
cela à l'église : était là-bas en 51 ap. JC → ce credo est encore plus ancien.
[12] Strobel, L., Jésus : la parole est à la défense, ?, Vida, 2001, p 302.
[13] Strobel, L., Jésus : la parole est à la défense, ?, Vida, 2001, p 251.
[14] Strobel, L., Jésus : la parole est à la défense, ?, Vida, 2001, p 248 ; cite aussi des
vieux dictons rabbiniques : "Mieux vaut brûler les paroles de la Loi que de les confier
à des femmes" ou encore "Béni celui qui a des garçons, malheur à celui qui a des
filles".
[15] D'après W.L. Craig, dans : Strobel, L., Jésus : la parole est à la défense, ?, Vida,
2001, p 240.
[16] McGrath, Alister, Jeter des ponts l'art de défendre la foi chrétienne, Québec, La
Clairière, 1999, p. 157
[17] Les informations de ce paragraphe sont tiré de : Yamauchi M., Easter: Myth,
Hallucination, or History?, (Source :
http://www.leaderu.com/everystudent/easter/articles/yama.html)
[18] McGrath, Alister, Jeter des ponts l'art de défendre la foi chrétienne, Québec, La
Clairière, 1999, p. 157.
4.4.3 La résurrection selon le Catéchisme Catholique
Voici ce que dit « La Catéchisme de l'Église Catholique » sur la résurrection (no. 988-
1004 ; Cf. 1015-1017) :
I La résurrection du Christ et la nôtre
Révélation progressive de la Résurrection
n° 992 (6) La résurrection des morts a été révélée progressivement par Dieu à son
Peuple. L'espérance en la résurrection corporelle des morts s'est imposée comme une
conséquence intrinsèque de la foi en un Dieu créateur de l'homme tout entier, âme et
corps. Le créateur du ciel et de la terre est aussi Celui qui maintient fidèlement son
Alliance avec Abraham et sa descendance. C'est dans cette double perspective que
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 55
commencera à s'exprimer la foi en la résurrection. Dans leurs épreuves, les martyrs
Macchabées confessent:
(8) Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourons
pour ses lois (2M 7,9). Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu
l'espoir d'être ressuscité par lui (2M 7,14 cf. 2M 7,29 Da 12,1-13).
n° 993 (11) Les Pharisiens (cf. Ac 23,6) et bien des contemporains du Seigneur (cf.
Jn 11,24) espéraient la résurrection. Jésus l'enseigne fermement. Aux Sadducéens qui
la nient il répond: "Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, vous
êtes dans l'erreur" (Mc 12,24). La foi en la résurrection repose sur la foi en Dieu qui
"n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants" (Mc 12,27).
n° 994 (14) Mais il y a plus: Jésus lie la foi en la résurrection à sa propre personne:
"Je suis la Résurrection et la vie" (Jn 11,25). C'est Jésus lui-même qui ressuscitera au
dernier jour ceux qui auront cru en lui (cf. Jn 5,24-25 6,40) et qui auront mangé son
corps et bu son sang (cf. Jn 6,54). Il en donne dès maintenant un signe et un gage en
rendant la vie à certains morts (cf. Mc 5,21-42 Lc 7,11-17 Jn 11), annonçant par là sa
propre Résurrection qui sera cependant d'un autre ordre. De cet événement unique Il
parle comme du "signe de Jonas" (Mt 12,40), du signe du Temple (cf. Jn 2,19-22): il
annonce sa Résurrection le troisième jour après sa mise à mort (cf. Mc 10,34).
n° 995 (17) Être témoin du Christ, c'est être "témoin de sa Résurrection" (Ac 1,22 cf.
Ac 4,33), "avoir mangé et bu avec lui après sa Résurrection d'entre les morts" (Ac
10,41). L'espérance chrétienne en la résurrection est toute marquée par les rencontres
avec le Christ ressuscité. Nous ressusciterons comme Lui, avec Lui, par Lui.
n° 996 (20) Dès le début, la foi chrétienne en la résurrection a rencontré
incompréhensions et oppositions (cf. Ac 17,32 1Co 15,12-13). "Sur aucun point la foi
chrétienne ne rencontre plus de contradiction que sur la résurrection de la chair" (S.
Augustin, Psal. 88, 2, 5). Il est très communément accepté qu'après la mort la vie de la
personne humaine continue d'une façon spirituelle. Mais comment croire que ce corps
si manifestement mortel puisse ressusciter à la vie éternelle? Comment les morts
ressuscitent-ils?
n° 997 (25) Qu'est-ce que "ressusciter"? Dans la mort, séparation de l'âme et du
corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la
rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réunie à son corps glorifié. Dieu
dans sa toute-puissance rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les
unissant à nos âmes, par la vertu de la Résurrection de Jésus.
n° 998 (28) Qui ressuscitera? Tous les hommes qui sont morts: "ceux qui auront fait
le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal, pour la damnation" (Jn
5,29 cf. Da 12,2).
n° 999 (31) Comment? Le Christ est ressuscité avec son propre corps: "Regardez
mes mains et mes pieds: c'est bien moi" (Lc 24,39); mais Il n'est pas revenu à une vie
terrestre. De même, en Lui, "tous ressusciteront avec leur propre corps, qu'ils ont
maintenant" (Cc. Latran IV: DS 801), mais ce corps sera "transfiguré en corps de
gloire" (Ph 3,21), en "corps spirituel" (1Co 15,44):
(33) Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps
reviennent-ils? Insensé! Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie, s'il ne meurt. Et ce que
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 56
tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu... On sème de la
corruption, il ressuscite de l'incorruption; ... les morts ressusciteront incorruptibles ...
Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel
revête l'immortalité (1Co 15,35-37 15,42 15,52-53).
n° 1000 (36) Ce "comment" dépasse notre imagination et notre entendement; il n'est
accessible que dans la foi. Mais notre participation à l'Eucharistie nous donne déjà un
avant-goût de la transfiguration de notre corps par le Christ:
(38) De même que le pain qui vient de la terre, après avoir reçu l'invocation de Dieu,
n'est plus du pain ordinaire, mais eucharistie, constituée de deux choses, l'une terrestre
et l'autre céleste, de même nos corps qui participent à l'eucharistie ne sont plus
corruptibles, puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection (S. Irénée, hær. 4, 18,4-5)
n° 1001(41) Quand? Définitivement "au dernier jour" (Jn 6,39-40 6,44 6,54 11,24);
"à la fin du monde" (LG 48). En effet, la résurrection des morts est intimement
associée à la Parousie du Christ:
(43) Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ
ressusciteront en premier lieu (1Th 4,16).
Ressuscités avec le Christ
n° 1002 (48) S'il est vrai que le Christ nous ressuscitera "au dernier jour", il est vrai
aussi que, d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. En effet,
grâce à l'Esprit Saint, la vie chrétienne est, dès maintenant sur terre, une participation
à la mort et à la Résurrection du Christ:
(50) Ensevelis avec le Christ lors du Baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui,
parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts... Du moment
donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en-haut, là où se
trouve le Christ, assis à la droite de Dieu (Col 2,12 3,1)
n° 1003 (53) Unis au Christ par le Baptême, les croyants participent déjà réellement
à la vie céleste du Christ ressuscité (cf. Ph 3,20), mais cette vie demeure "cachée avec
le Christ en Dieu" (Col 3,3) "Avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir au cieux,
dans le Christ Jésus" (Ep 2,6). Nourris de son Corps dans l'Eucharistie, nous
appartenons déjà au Corps du Christ. Lorsque nous ressusciterons au dernier jour nous
serons aussi "manifestés avec lui pleins de gloire" (Col 3,3).
n° 1004 (56) Dans l'attente de ce jour, le corps et l'âme du croyant participent déjà à
la dignité d'être "au Christ"; d'où l'exigence de respect envers son propre corps, mais
aussi envers celui d'autrui, particulièrement lorsqu'il souffre:
(58) Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a
ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ne savez-vous
pas que vos corps sont des membres du Christ? ... Vous ne vous appartenez pas ...
Glorifiez donc Dieu dans votre corps (1Co 6,13-15 6,19-20).
4.4.4 La résurrection dans les Traditions Africaines
Devoir : Y a-t-il quelque chose comme la résurrection dans les traditions Africains ou
dans ton ethnie ? Si oui, peux-tu comparer la conception de la résurrection dans la
tradition chrétienne et dans ta culture ?
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 57
4.5 LE JUGEMENT
4.5.1 Le Jugement dans la Bible
4.5.1.1 Le jugement dans l’Ancien Testament
Le mot « jugement » se trouve beaucoup de fois dans l’Ancien Testament : Gn 18,
19 ; Ex 12, 12 ; Ex 21, 31 ; Ex 23, 2 ; Ex 23, 6 ; Ex 28, 15 ; Ex 28, 29 ; Ex 28, 30 ; Lv
19, 15 ; Lv 19, 35 ; Nb 27, 11 ; Nb 27, 21 ; Nb 35, 12 ; Nb 35, 29 ; Dt 1, 17 ; Dt 10,
18 ; Dt 16, 18 ; Dt 16, 19 ; Dt 17, 8 ; Dt 17, 9 ; Dt 17, 11 ; Dt. 24, 17 ; Dt 25, 1 ; Dt
27, 19 ; Dt 32, 4 ; Dt 32, 41 ; Jos 20, 6 ; Jg 4, 5 ; Jg 5, 10 ; 1 S 8, 3 ; 2 S 8, 15 ; 2 S 15,
2 ; 2 S 15, 6 ; 1 R 3, 11 ; 1 R 3, 28 ; 1 R 7, 7 ; 1 R 10, 9 ; 1 R 20, 40 ; 2 R 25, 6 ; 1 Ch
18, 14 ; 2 Ch 9, 8 ; 2 Ch 19, 6 ; 2 Ch 19, 8 ; 2 Ch 20, 9 ; 2 Ch 22, 8 ; 2 Ch 24, 24 ; Esd
7, 26 ; Esd 1, 13 ; Jb 8, 3 ; Jb 9, 19 ; Jb 9, 32 ; Jb 14, 3 ; Jb 19, 7 ; Jb 19, 29 ; Jb 22, 4 ;
Jb 27, 2 ; Jb 29, 14 ; Jb 32, 9 ; Jb 34, 4 ; Jb 34, 5 ; Jb 34, 12 ; Jb 34, 23 ; Jb 35, 14 ; Jb
36, 17 ; Jb 37, 23 ; Jb 40, 8 ; Ps 1, 5 ; Ps 7, 6 ; Ps 9, 7 ; Ps 9, 8 ; Ps 9, 16 ; Ps 25, 9 ; Ps
33, 5 ; Ps 35, 23 ; Ps 37, 6 ; Ps 37, 28 ; Ps 37, 30 ; Ps 72, 2 ; Ps 76, 8 ; Ps 76, 9 ; Ps 89,
14 ; Ps 94, 15 ; Ps 97, 2 ; Ps 99, 4 ; Ps 101, 1 ; Ps 103, 6 ; Ps 106, 3 ; Ps 106, 30 ; Ps
111, 7 ; Ps 119, 66 ; Ps 119, 84 ; Ps 119, 121 ; Ps 119, 149 ; Ps 122, 5 ; Ps 143, 2 ; Ps
146, 7 ; Ps 149, 9 ; Pr 1, 3 ; Pr 2, 8 ; Pr 2, 9 ; Pr 8, 20 ; Pr 13, 23 ; Pr 16, 10 ; Pr 17,
23 ; Pr 18, 5 ; Pr 19, 28 ; Pr 20, 8 ; Pr 21, 3 ; Pr 21, 7 ; Pr 21, 15 ; Pr 24, 23 ; Pr 28, 5 ;
Pr 29, 4 ; Pr 29, 26 ; Pr 31, 5 ; Qo 3, 16 ; Qo 5, 8 ; Qo 8, 5 ; Qo 8, 6 ; Qo 11, 9 ; Qo
12, 14 ; Is 1, 17 ; Is 1, 21 ; Is 1, 27 ; Is 3, 14 ; Is 4, 4 ; Is 5, 7 ; Is 5, 16 ; Is 9, 7 ; Is 10,
2 ; Is 16, 3 ; Is 16, 5 ; Is 28, 6 ; Is 28, 7 ; Is 28, 17 ; Is 30, 18 ; Is 32, 1 ; Is 32, 16 ; Is
33, 5 ; Is 34, 5 ; Is 40, 14 ; Is 40, 27 ; Is 41, 1 ; Is 42, 1 ; Is 42, 3 ; Is 42, 4 ; Is 49, 4 ; Is
51, 4 ; Is 53, 8 ; Is 54, 17 ; Is 56, 1 ; Is 59, 8 ; Is 59, 9 ; Is 59, 11 ; Is 59, 14 ; Is 59, 15 ;
Is 61, 8 ; Jr 4, 2 ; Jr 5, 1 ; Jr 5, 4 ; Jr 5, 5 ; Jr 7, 5 ; Jr 8, 7 ; Jr 9, 24 ; Jr 10, 24 ; Jr 21,
12 ; Jr 22, 3 ; Jr 22, 15 ; Jr 23, 5 ; Jr 33, 15 ; Jr 39, 5 ; Jr 48, 21 ; Jr 48, 47 ; Jr 49, 12 ;
Jr 51, 9 ; Jr 51, 47 ; Jr 51, 52 ; Jr 52, 9 ; Ez 18, 8 ; Ez 23, 10 ; Ez 23, 24 ; Ez 34, 16 ;
Ez 39, 21 ; Ez 44, 24 ; Ez 45, 9 ; Dn 4, 37 ; Dn 7, 10 ; Dn 7, 22 ; Dn 7, 26 ; Os 2, 19 ;
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 58
Os 5, 1 ; Os 5, 11 ; Os 10, 4 ; Os 12, 6 ; Am 5, 7 ; Am 5, 15 ; Am 5, 24 ; Am 6, 12 ;
Mi 3, 1 ; Mi 3, 8 ; Mi 3, 9 ; Mi 7, 9 ; Ha 1, 4 ; Ha 1, 7 ; Ha 1, 12 ; So 2, 3 ; So 3, 5 ; Za
7, 9 ; Za 8, 16 ; Ml 2, 17 ; Ml 3, 5.
4.5.1.2 Le Jugement dans le Nouveau Testament
Le mot “Jugement” est très répandu dans le Nouveau Testament: Mt 5, 21; Mt 5, 22;
Mt 7, 2; Mt 10, 15; Mt 11, 22; Mt 11, 24; Mt 12, 18; Mt 12, 20; Mt 12, 36; Mt 12, 41;
Mt 12, 42; Mt 23, 23; Mt 27, 19 ; Mc 6, 11 ; Lc 10, 14 ; Lc 11, 31 ; Lc 11, 32 ; Lc 11,
42 ; Jn 5, 22 ; Jn 5, 27 ; Jn 5, 30 ; Jn 7, 24 ; Jn 8, 16 ; Jn 9, 39 ; Jn 12, 31 ; Jn 16, 8 ; Jn
16, 11 ; Jn 18, 28 ; Jn 18, 33 ; Jn 19, 9 ; Jn 19, 13 ; Ac 8, 33 ; Ac 18, 12 ; Ac 18, 16 ;
Ac 18, 17 ; Ac 23, 35 ; Ac 24, 25 ; Ac 25, 6 ; Ac 25, 10 ; Ac 25, 15 ; Ac 25, 17 ; Rm
1, 32; Rm 2, 2; Rm 2, 3; Rm 2, 5; Rm 5, 16; Rm 5, 18; Rm 14, 10 ; 1 Co 1, 10 ; 1 Co
4, 3 ; 1 Co 7, 25 ; 1 Co 7, 40 ; 2 Co 5, 10 ; Ga 5, 10 ; Ph 1, 9 ; 2 Th 1, 5 ; 1 Tm 5, 24 ;
He 6, 2 ; He 9, 27 ; He 10, 27 ; Jc 2, 6 ; Jc 2, 13 ; 1 P 4, 17 ; 2 P 2, 3 ; 2 P 2, 4 ; 2 P 2,
9 ; 2 P 3, 7 ; 1 Jn 4, 17 ; Jude 1, 6 ; Jude 1, 15 ; Ap 14, 7 ; Ap 17, 1 ; Ap 18, 10 ; Ap
20, 4.
4.5.2 Le Jugement dans la Tradition chrétienne
Le Credo affirme, à l’aide de la bible : « Il reviendra dans la gloire pour juger les
vivants et les morts ». En fait, la venue du Christ c’est une mise en lumière, une
discrimination (du grec, krisis, jugement). Le jugement dernier sera la récapitulation
de toutes les vies dans la lumière de l’amour de Dieu, la constatation de leur poids.
En parlant du « jugement et purification » Durrwell donne comme sous-titres : « la
justice de Dieu », « un jugement appelé purgatoire », « joies et souffrances de la
purification » et « au secours de l’homme dans la mort ». Il maintient que la justice de
Dieu est différente de la justice humaine. Dieu est juge (Jn 9, 39) mais il cherche
d’abord le salut du monde (Jn 3, 17). Jésus est désigné comme le juge par excellence
(Ac 10, 42). Il est ressuscité pour notre justification (dikayosune) (Rm 3, 26 ; 4, 25 ; 1
Co 1, 30). L'Église enseigne qu’après la mort, la grâce est accordée à la personne
d’être purifié dans le purgatoire avant d’entrer saintement dans la communion du Dieu
de sainteté. Durwell maintient que si la justice du Christ à l’être humain est justifiante
et sanctifiante on peut penser que le jugement et le purgatoire constituent une seule et
même réalité. 1 Co 3, 11-15 est interprété par quelques théologiens comme une
preuve biblique de la doctrine du purgatoire. Les exégètes l’interprètent comme la
base du jugement dernier. Le jugement dernier qui est prononcé par Dieu dans le
mystère pascal de la mort et la résurrection de Jésus Christ (Jn 12, 31). Il dit que le
purgatoire n’est pas un espace. C’est l’état de la purification dans le Christ. C’est
laver les habits sales dans le sang de l’agneau. Le feu du purgatoire est le feu de
l’Esprit du Christ qui purifie (2 Tm 2, 11). 100
100
Cf. François-Xaxier Durrwell, Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris, Mediaspaul, 1994, p. 63-70.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 59
Il y a une continuité entre l’Ancien Testament et le Nouveau Testament concernant le
jugement dernier : « Le Nouveau Testament continue la tradition de l’Ancien. « Ce
Jour-là », pour Jésus, désigne le jugement final, le Yôm (Cf. Mt 24, 21 ; Mc 13,
21.24 ; Lc 18, 24.31). Il l’évoque dès le Sermon sur la montagne : « Beaucoup me
diront en ce Jour-là : Seigneur, Seigneur ! n’est-ce pas en ton Nom que nous avons
prophétisé ? (Mt 7, 22) » Ce jugement, Il l’appelle sur Bethsaïde et Corozaïn : « Au
jour du Jugement, Tyr et Sidon auront un sort moins rigoureux que vous » ; sur la
ville qui ne recevrait pas les Apôtres : « Au jour du Jugement, il sera fait à Sodome et
Gomorrhe un sort plus doux qu’à cette ville-là (Mt 11, 22.24 ; 10, 15) » ; sur la
« génération mauvaise et adultère qui réclame un signe » : « Les hommes de Ninive se
dresseront, lors du jugement, avec cette génération et ils la condamneront, car ils
firent pénitence à la proclamation de Jonas ; et il y a ici plus que Jonas ! La reine du
Midi se lèvera, lors du Jugement, avec cette génération et elle condamnera. Car elle
vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus
que Salomon (Mt 12, 39-42) ». 101
Affirmant « le jugement particulier » ajoute, « Les
textes chrétiens l’indiquent clairement: la Parousie ne se réduit pas au Yôm hébraïque,
au Jugement dernier. Si elle est imminente, si elle se produit maintenant, n’est-ce pas
qu’elle désigne d’autres rencontres avec le Seigneur, celles par exemples, qui ont lieu
au moment de la mort de chacun et durant toute sa vie ? » 102
Concernant le Jugement dernier, Ratzinger tient « Tout comme le retour du Christ, le
jugement échappe à nos efforts d’imagination. L’essentiel de ce que veut dire ce mot
apparaît au mieux quand nous nous demandons qui est sujet du jugement selon la
tradition biblique. Au premier regard, la réponse semble incohérente. C’est Dieu
d’abord qui est qualifié de juge (2 Thes 1, 5 ; 1 Co 5, 13 ; Rom 2, 3 suiv. ; 3, 6 ; 14,
10 ; cf. aussi Mt 10, 28 et par. ; Mt 6, 4-18) ; puis vient le Christ (Mt 25, 31-46 ; 7, 22
suiv. ; 13, 36-46 ; Lc 13, 25-27 ; 1 Thes 4, 6 ; 1 Co 4, 4 suiv. ; 11, 32 ; 2 Co 5, 10) ;
enfin, en Mt 19, 28, il est dit aux Douze que lorsque le monde sera « restauré », ce
sont eux qui siégeront sur douze trônes et jugeront les douze tribus d’Israël. Cette
formule est encore étendue en 1 Co 6, 2 suiv. : « ne savez-vous pas que les saints
jugeront le monde ?... Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? A plus forte
raison, les affaires de cette vie ! » (Voir en outre Dan 7, 22 ; Sag 3, 8 ; Apo 3, 21) ».
103
ll ajoute que ces récits du jugement final ne doivent pas être déconnectés du fait que
« Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui (Jn 3, 17) ». Le Christ dit, « Je ne suis pas venu pour juger le
monde, mais pour le sauver (Jn 12, 47) » et aussi « Qui me méprise et n’accepte pas
mes paroles a son juge ; la parole que j’ai dite le jugera au dernier jour (Jn 12,
48) ».104
101
Roger Troisfointaines, « …j’entre dans la vie », Paris, Editions universitaires, 1963, p. 105. Thérèse
de Lisieux a dit « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ». 102
Roger Troisfointaines, « …j’entre dans la vie », Paris, Editions universitaires, 1963, p. 122. 103
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 223. 104
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 223-224.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 60
4.5.3 Le Jugement selon le Catéchisme de L'Église Catholique
Voici ce que dit « La Catéchisme de l'Église Catholique » sur le jugement
particulier (no. 1021-1022) :
n° 1021 (4) La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou
au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ (cf. 2Tm 1,9-10). Le Nouveau
Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale
avec le Christ dans son second avènement, mais il affirme aussi à plusieurs reprises la
rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses oeuvres et de sa foi.
La parabole du pauvre Lazare (cf. Lc 16,22) et la parole du Christ en Croix au bon
larron (cf. Lc 23,43), ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament (cf. 2Co 5,8 Ph
1,23 He 9,27 12,23) parlent d'une destinée ultime de l'âme (cf. Mt 16,26) qui peut être
différente pour les unes et pour les autres.
n° 1022 (7) Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle
dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une
purification (cf. Cc. Lyon: DS 857-858 Cc. Florence: DS 1304-1306 Cc. Trente: DS
1820), soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel (cf. Benoît XII: DS
1000-1001 XXII: DS 990), soit pour se damner immédiatement pour toujours (cf.
Benoît XII: DS 1002).
(9) Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour (S. de la Croix, dichos 64)
Voici ce que dit « La Catéchisme de l'Église Catholique » sur le jugement dernier
(no. 1038-1041 ; Cf. no. 1059) :
n° 1038 (4) La résurrection de tous les morts, "des justes et des pécheurs" (Ac 24,15),
précèdera le Jugement dernier. Ce sera "l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en
sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'Homme; ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation" (Jn 5,28-29).
Alors le Christ "viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges... Devant lui seront
rassemblés toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le
berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa
gauche ... Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle"
(Mt 25,31 32 25,46).
n° 1039 (7) C'est face au Christ qui est la Vérité que sera définitivement mise à nu la
vérité sur la relation de chaque homme à Dieu (cf. Jn 12,49). Le jugement dernier
révèlera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou
omis de faire durant sa vie terrestre:
(9) Tout le mal que font les méchants est enregistré - et ils ne le savent pas. Le Jour
où "Dieu ne se taira pas" (Ps 50,3) ... Il se tournera vers les mauvais: "J'avais, leur
dira-t-il, placé sur terre mes petits pauvres, pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans
le ciel à la droite de mon Père - mais sur la terre mes membres avaient faim. Si vous
aviez donné à mes membres, ce que vous auriez donné serait parvenu jusqu'à la tête.
Quand j'ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos
commissionnaires pour porter vos bonnes œuvres dans mon trésor: vous n'avez rien
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 61
déposé dans leurs mains, c'est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi" (S.
Augustin, serm. 18,4,4).
n° 1040 (12) Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le
Père seul en connait l'heure et le jour, Lui seul décide de son avènement. Par son Fils
Jésus-Christ Il prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous
connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du
salut, et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels Sa Providence aura
conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de
Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est
plus fort que la mort (cf. Ct 8,6).
n° 1041 (15) Le message du Jugement dernier appelle à la conversion pendant que
Dieu donne encore aux hommes "le temps favorable, le temps du salut" (2Co 6,2). Il
inspire la sainte crainte de Dieu. Il engage pour la justice du Royaume de Dieu. Il
annonce la "bienheureuse espérance" (Tt 2,13) du retour du Seigneur qui "viendra
pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru" (2Th 1,10).
n° 1059 (28) "La très sainte Église romaine croit et confesse fermement qu'au jour du
Jugement tous les hommes comparaîtront avec leur propre corps devant le tribunal du
Christ pour rendre compte de leurs propres actes" (DS 859 cf. DS 1549).
4.5.4 Le Jugement dans les Traditions Africaines
Devoir : Y a-t-il quelque chose comme le Jugement dernier dans les traditions
Africains ou dans ton ethnie ? Si oui, peux-tu comparer la conception du Jugement
dernier dans la tradition chrétienne et dans ta culture ?
4.6 L’ENFER
4.6.1 L’enfer dans la Bible
4.6.1.1 L’enfer dans l’Ancien Testament
Voici des textes de l’Ancien Testament qui parlent de l’enfer : Dt 32, 22 ; 2 S 22, 6 ;
Jb 11, 8 ; Jb 26, 6 ; Ps 9, 17 ; Ps 16, 10 ; Ps 18, 5 ; Ps 55 15 ; Ps 86, 13 ; Ps 116, 3 ; Ps
139, 8 ; Pr 5, 5 ; Pr 7, 27 ; Pr 9, 18 ; Pr 15, 11 ; Pr 15, 24 ; Pr 23, 14 ; Pr 27, 20 ; Is 5,
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 62
14 ; Is 14, 9 ; Is 14, 15 ; Is 28, 15 ; Is 28, 18 ; Is 57, 9 ; Ez 31, 16 ; Ez 31, 17 ; Ez 32,
21 ; Ez 32, 27 ; Am 9, 2 ; Jon 2, 2 ; Ha 2, 5.
Nous pouvons considérer d’autres textes : Ps 88, 11-12) ; Qo 9, 10 ; Am 9, 2 ; Ps 16,
10 ; Ps 17, 5 ; (héb. 18, 5) : 2 R 22, 6 ; 2 S 22, 6 ; Ps 55, 16, (héb. 55, 15) ; Ps 9, 17 ;
Ps 85, 13 (héb. 86, 13) ; Ps 114, 3 ; (héb. 116, 3) ; Ps 138, 8 ; (héb. 139, 8) ; Dt 32,
22 ; 1 Th 2, 16 ; Jb 11, 8 ; Jb 26, 6 ; Pr 5, 5 ; Pr 7, 27 ; Pr 9,18 ; Prov. 15, 11 ; Pr 15,
24 ; Pr 23, 14 ; Pr 27, 20 ; Is 14, 9,15 ; Is 57, 9 ; Ez 31, 15-17 ; Ez 32, 21 ; Ez 32, 27 ;
Ha 2, 5 ; Is 28, 15-18 ; Gn 37, 35 ; Gn 44, 29, 31 ; 1 R 2, 6 ; 1 S 2, 6 ; Jb 14, 13 ; Jb
24, 19, 20 ; Ps 6, 6 ; (héb. 6, 5) ; Ps 30, 4 (héb. 30, 3) ; Ps. 30, 18 (héb. 31, 17) ; Ps
88, 49 (héb. 89, 48) ; Pr 1, 12 ; Pr 30, 15-16 ; Ct 8, 6 ; Is 14, 11 ; Nb 16, 30 -33 ; Ez 3
1, 15 ; Os 13, 14.
4.6.1.2 L’enfer dans le Nouveau Testament
Voici des textes du Nouveau Testament qui parlent de l’enfer: Mt 5, 22 ; Mt 5, 29 ;
Mt 5, 30 ; Mt 10, 28 ; Mt 11, 23 ; Mt 16, 18 ; Mt 18, 9 ; Mt 23, 15 ; Mt 23, 33 ; Mc 9,
43 ; Mc 9, 45 ; Mc 9, 47 ; Lc 10, 15 ; Lc 12, 5 ; Lc 16, 23 ; Ac 2, 27 ; Ac 2, 31 ; Jc 3,
6 ; 2 P 2, 4 ; Ap 1, 18 ; Ap 6, 8 ; Ap 20, 13 ; Ap 20, 14.
Voici d’autres textes : 1 Co 15, 54, 55 ; Lc 16, 22 ; Ac 2, 1 ; 14, 22-31; Ac 2, 36 ; 1
Co 15, 3 ; 1 Jn 2, 2 ; 1 Co 15, 26 ; Apo 21, 4 ; Mt 5, 22 ; 29- 30 ; 10, 28 ; 18, 9 ; 23,
15.33 ; Mc 9, 43-47; Lc 12, 5 ; Jc 3, 6 ; Ap 21, 10-27 ; Ap 20, 15 ; He. 10, 26 ; Ap 19,
20 ; Mt 5, 21-22 ; Mt 5, 22-30 ; Lc 12, 4-5 ; Mt 18, 8-9 ; Mc 9, 43-48 ; Mt 23, 15.33 ;
Jc 3, 6 ; 2 P 2, 4 ; Ap 20, 14 ; Ap 19, 20 ; Ap 19, 20 ; 20, 10. 14-15 ; Ap 20, 13.12 ;
Ap 21, 8.
4.6.2 L’enfer dans la Tradition chrétienne
Qu’est-ce que l’enfer ? Quel est le sens de la descente aux enfers ? Le mot hebreu
pour l’enfer c’est « géhenne (en araméen « gê hinnûm », abbréviation de « gèben-
hinnûm, la vallée des fils de Hinnôm). Etait un ravin où se pratiquait, au temps de la
monarchie, le culte idolâtrique comprenant le passage des enfants à travers le feu (2 R
23, 10 ; 2 Chr 28, 3 ; 33, 6 ; Jér 7, 31 ; 32-37). Au premier siècle avant le Christ, le
mot, lié à une conflagration de nature punitive dans les périodes plus reculées de
l’Ancien Testament, se précise, dans Dan 7, 10 ; Enoch 18, 11-16 ; 27, 1-3 ; Judith 16,
17 ; les apocryphes et Qumrân, et devient « lac de feu », « abîme de feu » (origine
iranienne). Au temps du Nouveau Testament il signifie « lac de feu » dans lequel
L’Hadès (shéol » lui-même sera jeté (Ap 20, 14) ». 105
Géhenne qui est quelque chose
comme « anti-pays » ou un « non-pays ». Au premier, le mot grec c’est Hadès qui est
lié avec un mythe Grec qui parle de la répartition de l’univers entre trois fils de
Chronos (Zeus, Poseidon et Hadès). L’Hadès est sans pitié et abhorré. Un ancien
105
Jean-Marc Dufort, A la rencontre du Christ Jésus : Précis d’Eschatologie chrétienne, Paris, Les
Editions Desclée & Cie, p. 151.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 63
chateur Grec Orphée parle de hadès comme le monde inférieur (Lt. Inferna, Gc
inferos). 106
L’histoire de l’enfer est plus ancienne que la religion judéo-chrétienne. Georges
Minois nous parle des « enfers des grandes religions orientales anciennes » : « Les
enfers mésopotamiens », « les enfers égyptiens », « les enfers hindouistes » et « les
enfers mazdéiques ». Il étudie également « les enfers païens classiques » : « les enfers
grecs : poètes et philosophes », « l’enfer existentiel de Lucrèce », « l’enfer
philosophique platonicien » et « l’enfer poétique et populaire de Virgile ». En outre, il
expose « les enfers bibliques et hébraïques » : « les hésitations des hébreux sur
l’enfer », « Les enfers rabbiniques et talmudiques » et « l’enfer dans le Nouveau
Testament ». 107
L'Ancien Testament est lent à admettre l’enfer : « Tout est pareil pour tous, un sort
identique échoit au juste et au méchant, au bon et au pur comme à l’impur, à celui qui
sacrifie comme à celui qui ne sacrifie pas ; il en est du bon comme du pécheur, de
celui qui prête serment comme celui qui craint de le faire » (Qohélet 9, 2). Il y a
même la notion du châtiment terrestre « Que tu vives dix ans, cent ans, mille ans, au
shéol on ne te reprochera pas ta vie » (Siracide 41, 3-4). C’est le livre de Daniel qui a
annoncé pour la première foi un enfer éternel : « En ce temps-là, ton peuple en
réchappera, quiconque se trouvera inscrit dans le Livre. Beaucoup de ceux qui
dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là
pour l’opprobre, pour l’horreur éternelle » (Dn 12, 1-2).
Dans les écrits de Paul, le mot enfer n’apparaît qu’une fois « Afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers » (Ph 2, 10).
Pourtant, il fait quelques allusions au jugement final et que chacun aura sa rétribution
(Rm 2, 5-12). Il y a une hypothétique descente de Jésus au royaume des morts (Rm
10, 7 ; Eph 4, 8-10). Matthieu parle le l’enfer (Mt 8, 12). Il parle de « portes de
l’enfer » et de la « Géhenne du feu ». Luc donne la parabole de Lazare et du mauvais
riche (Lc 16, 19-31). L’apocalypse parle de l’enfer (Ap 14, 10-11). Pourtant, nous
devons affirmer que l’enseignement du Nouveau Testament concernant l’enfer est
vague et ambigu. Bien que la tradition chrétienne a popularisé l’enfer, l’enfer
n’occupe que peu de place dans la tradition biblique.
Parlant de l’enfer, François Varillon se permet de pressentir une différence : « 1
Genèse 19, 24 : embrasement de Sodome et Gomorrhe par une pluie de soufre et de
feu : l’idée véhiculée par cette image est celle de l’infécondité de la terre brûlée (il est
permis de penser à la bombe atomique. 2 Image de la dévastation du site de Tophet,
dans la vallée de la Géhenne, au bas des pentes du mont Sion. C’était un lien de
plaisance où, sous le règne du roi Achaz (second livre des Rois 16, 3), on fit des
sacrifices d’enfants au dieu Moloch ; on l’appela la vallée du carnage, car les cadavres
y étaient entassés sans être enterrés (comme du fumier sur la terre, dit Jérémie) ; après
106
Cf. Hans Küng, Vie éternelle ?, Paris, Editions du Seuil, 1985, p. 175-176. 107
Cf. Georges Minois, Histoire de l’enfer, Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 14-45 ; Cf.
P. Dhorme, l’idée de l’au –delà dans La religion hébraïque, « Revue de l’histoire des religions », 1941,
p. 113-140 ; P. Dhorme, Le séjour des morts chez les Assyriens et les Babyloniens, « Rev. Bibl. »,
1907, p. 59-78.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 64
l’exil, on y brûla les détritus de la ville. L’idée ainsi véhiculée est l’idée de déchet, de
rebut, de non-valeur (ce que l’on brûle parce que sans valeur) et aussi
d’emprisonnement. 3 Image du ver : les Hébreux sont plus frappés par le
grouillement collectif que par le rongement isolé. Isaïe dit que les vers sont le lit et la
couverture du cadavre (14, 11). C’est toujours l’idée de rebut à quoi s’ajoute l’idée de
corruption. 4 Image du feu, enfin : la colère de Yahvé est un torrent de soufre, dit
Isaïe ». 108
Voici quelques textes qui parlent de l’enfer :
L’enfer est considéré comme un lieu de supplice pour les damnés. Il constitue un
séjour définitif. Exceptionnellement et temporairement on peut sortir pour une courte
promenade sur la terre. Selon Thomas d’Aquin, ces sorties provisoires ont pour but
« d’instruire et de terrifier ». Les damnés qui sortent doivent revenir très vite et y
demeurer à jamais. Les textes officiels du christianisme médiéval rejettent la thèse de
l’apocatastase défendue par Origène, selon laquelle au dernier jour l’enfer serait
détruit et que Dieu sauverait tous les êtres humains. Le Concile de Constantinople
(543) déclare « Si quelqu’un dit ou pense que le châtiment… des impies est
temporaire, et qu’il prendra fin après un certain temps… qu’il soit anathème ». Le
pape Innocent IV écrit en 1254 : « Si quelqu’un meurt sans pénitence, dans un état de
péché mortel, il ne fait pas de doute qu’il est tourmenté pour toujours par les feux le
l’enfer éternel ». 109
On parlait de plusieurs catégories de l’Enfer : le premier est pour ceux qui sont
damnés uniquement à cause de la faute originelle sans avoir péché personnellement. Il
s’agit des bébés morts sans avoir reçus le baptême et aussi les malades mentaux. Ils
subissent la peine du dam qui est la privation de Dieu sans tourments. On parle de
limbes pour éviter le mot « enfer » pour cette région de l’enfer. La seconde catégorie
de damnés consiste en ceux qui, en plus du péché originel, ont commis des fautes dont
ils ne se sont pas repentis. Ils sont dans une agonie interminable, ils sont en train de
mourir, jamais morts. Les peines se proportionnent aux crimes commis. On parle de
plusieurs « cercles » dont les derniers sont plus terribles que les premiers. Pour
l’Eglise du Moyen Age, l’Eglise ne sait pas quels vivants iront à l’enfer. Une seconde
de repentir sincère au dernier moment permet d’échapper à la damnation. La
miséricorde de Dieu est immense. 110
Bernard Sesboüé parle de l’enfer comme une « tragique possibilité ». Pourtant, il nous
invite à nous convertir concernant nos idées sur le sujet de l’enfer. Le point de départ
qui est une certitude de notre foi est que Dieu est amour (Deus caritas est, 1 Jn 4, 16-
18). Si Dieu est amour, d’emblée il ne veut pas l’enfer. Dans ce sens, l’enfer peut être
un refus tragique et définitif d’amour (d’aimer et d’être aimé). L’être humain dans sa
liberté peut vouloir ne pas aimer. La possibilité de refuser d’aimer peut donner une
108
F. Varillon, Conférences, Pau, Publication B. Housset, Octobre 1976, p. 28. 109
Cf. André Gounelle et François Vouga, Après la mort qu’y-a-t’il ?, Paris, Les Editions du Cerf,
1990, p. 26, 27. 110
Cf. André Gounelle et François Vouga, Après la mort qu’y-a-t’il ?, Paris, Les Editions du Cerf,
1990, p. 27.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 65
possibilité de l’idée de l’enfer. Pourtant le désir de Dieu est que toutes les personnes
soient sauvées (1 Tm 2, 4). Jésus nous parle de la possibilité de l’enfer (Mt 13,
42 ; 25, 30.41; Mc 16, 16). 111
Dans le même sens Edith Stein, une philosophe,
carmélite en camp de concentration et récemment béatifiée, a écrit : « Il appartient à
l’âme de décider d’elle-même. Le grand mystère que constitue la liberté de la
personne, c’est que Dieu lui-même s’arrête devant elle. Il ne veut dominer les esprits
créés que par le don libre qu’ils lui font de leur amour ». 112
Bernard Sesboüé tient que « l’enfer est une création de l’homme » et non pas une
punition de Dieu parce que l’enfer surgit quand l’amour est totalement refusé.
Concernent la question de l’éternité de l’enfer, il se demande, la famille humaine
pourra-t-elle être totalement heureuse, si certains en sont exclus ? Comment
harmoniser l’enfer éternel et le Dieu d’amour et de sa volonté salvifique universelle ?
Comment des chrétiens, frères et sœurs du Christ, crées à l’image de Dieu pourraient-
ils se perdre éternellement dans l’enfer ?
Les Pères de l'Église se posaient des questions sur : « la nature des peines de l’enfer,
le moment de l’entrée en enfer, les habitants de l’enfer et la durée de l’enfer ».
Concernant la nature la majorité des Pères de l'Église (comme Polycarpe, Justin, etc)
étaient d’accord avec la seconde Épitre de St. Clément qui maintenait que pour ceux
qui n’auront pas gardé le sceau du baptême, leur ver et leur feu seront éternels (cf. Is
64, 24). Tertullien insistait sur l’incorruptibilité du feu infernal qui brûle et ne
consume pas (Apologet., XLVIII, 13-15 ; cf. De paenitentia, XII, 2-4 ; De
Spectaculis, XXX). Et son disciple, St. Cyprien de Carthage avait la même position
(Cf. Ad Demetrianum, XXIII-XXIV, De mortalitate, 14 ; Epist. VI, 3). Clément
d’Alexandrie et Origène maintenaient que le feu dans les Écritures est métaphorique.
Clément disait que ce feu s’exerce non sur les chairs mais sur les âmes pécheresses. Il
ne dévore pas mais il pénètre l’âme. Également, St. Grégoire de Nysse croyait au feu
métaphorique (Cf. Discours catéchétique, XL, 7-8). Les autres Cappadociens
acceptent aussi l’enfer : St. Basile de Césarée (Cf. In Psalm XXXIII, 4 et 8 ; De
spritu Sancto, XVI, 40) et St. Gregoire de Nanzianze (Oratio, XVI, 9). Jean
Chrysostome compare l’enfer avec la mer rouge (Cf. Exhortat., ad Theodorum, 1, 10 ;
In Matthaeum, homilia, XLIII, 4-8). St. Augustin confirme la tradition antérieure (Cf.
La Cité de Dieu, XX, 22, XXI, 9-10 ; In psalmum 49, enarratio, 7). 113
Dans son livre, l’enfer : une question Hans Urs von Balthasar après avoir visité la
tradition chrétienne concernant l’enfer insiste sur « le devoir d’espérer pour tous ». Il
dit, « Il faut donc donner raison à Karl Rahner quand il déclare : « Nous avons à tenir
ensemble sans hésiter la proposition que Dieu veut fermement le salut universel, que
tous sont sauvés par le Christ, que nous devons espérer le salut pour tous, et la
proposition que la perdition éternelle est une possibilité réelle » ». 114
Il termine sa
réflexion avec Apokatastasis pantôn (Ac 3, 21). Il y a deux traduction possibles pour
111
Cf. Bernard Sesboüé, La résurrection et la vie : Petite catéchèse sur les choses de la fin, Paris,
Desclée de Brouwer, 1990, p. 149-151. 112
Edith Stein, La science de la croix, Louvain, Nauwelaerts, 1957, p. 180. 113
Cf. Gustave Bardy et al., L’enfer, Paris, Les Editions de la Revue des Jeunes, 1950, p. 147-175. 114
Hans Urs von Balthasar, L’enfer : Une question, Paris, Desclée de Brouwer, 1988, p. 60
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 66
ces mots : « jusqu’aux temps du rétablissement de Tout, dont Dieu a parlé » ou bien
« jusqu’à l’établissement de tout ce que Dieu a parlé par ses prophètes ». 115
Ratsinger accepte la doctrine de l’existence de l’enfer. It tient « Inutile de pointiller :
l’idée d’un châtiment éternel, manifestement élaboré dans le judaïsme pendant les
derniers siècles qui ont précédé l’ère chrétienne, est solidement fondée tant sur
l’enseignement de Jésus (Mt 25, 41 ; 5, 29 et par. ; 13, 42.50 ; 22, 13 ; 18, 8 et par. ; 5,
22 ; 18, 9 ; 8, 12 ; 24, 51 ; 25, 30 ; Lc 13, 28), que sur les écrits des Apôtres (2 Thes 1,
9 ; 2, 10 ; 1 Thes 5, 3 ; Rom 9, 22 ; Phil 3, 19 ; Apo 14, 10 ; 19, 20 ; 20, 10-15 ; 21, 8)
et de l’éternité de ses châtiments (DS 411) ». 116
Le pape Benoît XII définit :
« Par la présente constitution, qui restera à jamais en vigueur, et de notre autorité
apostolique, Nous définissons que, d’après la disposition générale de Dieu, les âmes
de tous les saints qui ont quitté ce monde avant la Passion de notre Seigneur Jésus-
Christ: que celles des saints Apôtres, martyrs, confesseurs, vierges et autres fidèles
morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n’y a rien eu à purifier
lorsqu’ils sont morts ou en qui il n’y aura rien à purifier lorsqu’ils mourront dans la
suite ou encore, s’il y a eu ou qu’il a quelque chose à purifier, lorsque, après leur
mort, elles auront achevé de le faire; que, de même, les âmes des enfants régénérés
par ce même baptême du Christ ou encore à baptiser, une fois qu’ils l’auront été, s’ils
viennent à mourir avant d’user de leur libre-arbitre, (que toutes les âmes de ces
enfants), aussitôt après leur mort et la purification dont nous avons parlé pour celles
qui en auraient besoin, avant même la résurrection dans leur corps et le Jugement
général, et cela depuis l’Ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au Ciel, ont
été, sont et seront au Ciel, au Royaume des cieux et au paradis céleste avec le Christ,
admises dans la société des saints anges. En outre, nous définissons que, selon la
disposition générale de Dieu, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel
descendent aussitôt après leur mort en enfer, où elles sont tourmentées de peines
infernales.»
Excursus 1 : l’enfer dans la tradition chrétienne un article par Jean-Pierre
Schneider
Vocabulaire: Le mot «enfer» n'est pas dans la Bible; il provient de la version latine du
passage d'Eph 4.9: «régions inférieures» (lat. infernus).
Définition:
L'enfer fut créé par Dieu pour Satan et ses anges (Mat 25.41: cp 2 Pi
2.4). Lieu de châtiment éternel (Mat 25.46) à ne pas confondre avec
«shéol» ou «hadès» (= séjour des morts), où les morts attendent le
jugement ou la résurrection (dans la section paradis). Depuis la croix et
la résurrection. Christ détient la clé du hadès (Apoc 1.18), de sorte que le
115
Hans Urs von Balthasar, L’enfer : Une question, Paris, Desclée de Brouwer, 1988, p. 60 ; Cf.
Oepke, article, « Apokatastasis », dans Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (ThWNT), 1,
col. 390. 116
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 233.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 67
hadès ne peut affecter l'Église (Mat 16.18). Selon Luc 16, le sein
d'Abraham = paradis) est séparé du hadès par un abîme infranchissable.
Description de l'enfer dans la Bible
Les flammes éternelles
(Es 33.14) - le feu qui ne s'éteint pas (Es 66.24; Mat 3.12)
le feu éternel (Mat 18.8) - le feu et le soufre (Apoc 14.10)
l'étang de feu (Apoc
19.20; 20.15)
- la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des
grincements de dents (Mat 13.42,50)
«La
géhenne»
Vallée Gé-hinnom où l'Israël infidèle brûlait des enfants à Moloch (2 Rois
23.10); plus tard, on y consumait les ordures de Jérusalem. Jésus s'y réfère
plusieurs fois (p.ex. Mat 5.22; 18.9; Marc 9.43: Luc 12.5). et Jacques une
fois (3.6). Caractéristiques: «leur ver ne meurt point et le feu ne s'éteint
point (Marc 9.48).
L'enfer est donc le lieu des tourments éternels.
Cela fait partie du fondement de l'enseignement élémentaire (Héb 6.1-2). Ne pas
vouloir y croire mène à l'incrédulité sur d'autres points (voir plus bas).
Selon Apoc 9.11, «l'ange de l'abîme» règne sur l’enfer, et non Satan! Il peut l'ouvrir et
le fermer (Apoc 9.1; 20.1-3). On peut l'identifier avec l'ange destructeur de l'Éternel
(Ex 12.23; 2 Rois 19.35).
Le lieu: Il est toujours question de «descendre» au shéol/hadès, tout comme de
«monter» au ciel; le hadès et l'enfer pourraient donc être au centre de la terre, où la
température est quelque peu élevée... (cf Luc 10.15: «élevé jusqu'au ciel... abaissé
jusqu'au séjour des morts»). Note: Mat 12.40 signifie probablement la tombe.
La nature des tourments éternels
Le NT n'offre aucune description, par contre des images d'ordre spirituel: le ver
rongeur (= les remords); feu, flammes (= souffrances cuisantes); ténèbres (= coupé de
la lumière, donc de Dieu). Meilleure définition: 2 Thes 1.9.
Quelques caractéristiques: Selon Luc 16:
Es 57.21: point de paix - séparé du lieu de félicité
Dan 12.2: honte éternelle - conscience et mémoire intactes
Mat 13.42: pleurs et grincements - aucun espoir, aucune aide possible
La durée: éternelle, selon de nombreuses citations ci-dessus. Ces textes ne peuvent
être compris autrement, pas plus que ceux qui parlent de vie éternelle (Dan 12.2).
Un problème: L'enfer et l'amour de Dieu - sont-ils compatibles?
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 68
A la base, il y a une fausse idée du «Bon Dieu» indulgent qui passe l'éponge.
L'exemple le plus parlant: Gal 3.10-14 - la justice et la sainteté de Dieu demandaient
que son Fils bien-aimé fût maudit pour lever la malédiction qui repose sur le pécheur.
La preuve que la condamnation à l'enfer n'est pas contraire à l'amour de Dieu: Christ
lui-même en sera l'exécuteur (Mat 25.41)! Il y a plus: les condamnés seront
tourmentés «devant l'Agneau» (Apoc 14.10)! Si le Christ, Amour par excellence, peut
contempler l'enfer depuis le ciel, c'est que la félicité n'en souffrira pas.
Interprétations erronées
1. Le conditionnalisme
Triple argumentation:
- a) «Dieu seul possède l'immortalité» (1 Tim 6.16); il ne la communique qu'aux
croyants (1 Jean 5.12: «a la vie... - n'a pas la vie»).
- b) «L'âme qui pèche mourra» (Ez 18.4): elle serait anéantie comme le corps.
- c) Dieu va «détruire ceux qui détruisent la terre» (Apoc 11.18). c.-à-d. anéantir.
Triple réfutation:
- a) Les incrédules sont voués à «la seconde mort» qui est l'étang de feu éternel (Apoc
20.10,14).
- b) L'âme (la personnalité) est immortelle: les méchants ressusciteront à «l'abjection
éternelle» (Dan 12.2; cp Jean 5.29)
- c) Ceux qui détruisent la terre ne l'anéantissent pas: ils la ruinent et lis rendent
malheureuse; c'est ce qui leur arrivera. Note: une étude du mot «anéantir» montre que
le sens litt. est différent: frémir, dévaster, détruire, retrancher, engloutir, traductions
qui se trouvent dans la Segond révisée (Colombe), entre autres.
2. L'universalisme
Double argumentation:
- a) Après un temps quasi éternel, le Dieu d'amour sauvera tous ceux qui n'ont péché,
après tout, que pendant leur courte vie terrestre, qui ne saurait se comparer à des
tourments sans fin. Textes invoqués: Rom 11.32 (faire miséricorde à tous) et Col 1.20
(réconcilier tout avec lui-même). Même Satan et ses anges se tourneraient vers Christ
et recevraient grâce et pardon.
- b) Le triomphe de Christ ne serait pas complet et Dieu ne serait pas tout puissant s'il
restait une seule créature en enfer.
Double réfutation:
- a) Le «tous» dans Rom 11.32 et textes similaires doit être compris avec la restriction
«tous ceux qui croient». Comme quantité de textes le spécifient (p. ex. Rom 3.22; Gal
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 69
3.22).
- b) «Dieu veut que tous les hommes soient sauvés» (1 Tim 2.4) doit être lu avec les
paroles de Jésus: «J'ai voulu.. et vous ne l'avez pas voulu» (Mat 23.37) et «mes
ennemis n'ont pas voulu que je règne sur eux» (Luc 19.27). Dieu a souverainement
décidé qu'il n'obligerait personne à croire en lui; il laisse à l'homme le choix: Deut
30.19-20; Jos 24.15; Ps 119.30. (D'autre part: le choix de l'homme est précédé par le
choix du Dieu omniscient - Jean 15.16.)
Conclusion de René Pache*
Lire Apoc 21.6 et 22.17.
Les quatre pas qui
conduisent au salut:
avoir soif de pardon, de vie éternelle venir à Jésus-Christ
vouloir recevoir le salut prendre gratuitement le don de Dieu
La Bible affirme: Vont en enfer ceux qui veulent.
Vont au ciel ceux qui veulent.
*Lecture recommandée: René Pache, «L'enfer existe-t-il?» Edition Emmaüs 1962, 65
pages
Excursus 2 : l’enfer dans la tradition chrétienne - un article par Mikaël
(Publié dans « La Bible et ce qu'elle enseigne »)
Dans cet article, nous allons employer plusieurs traductions de la Bible. Si vous avez
votre propre Bible, vous pouvez suivre avec moi la lecture de tels versets Bibliques.
Nous allons examiner premièrement, les supposés versets bibliques soutenant l'enfer
de feu. Ensuite, les versets bibliques qui prouvent que la doctrine d'un enfer de feu
n'est pas Biblique. D'ailleurs, pour ce deuxième point, nous irons examiner les
véritables origines de cette doctrine.
Pourquoi y a-t-il confusion sur le sens que les Écritures donnent au mot enfer ?
Voici ce que dit la The Encyclopedia Americana : “Le fait que les premiers
traducteurs de la Bible ont invariablement rendu par enfer le mot hébreu Schéol et les
termes grecs Hadès et Géhenne, a été cause d’une grande confusion et
d’interprétations erronées. La simple transcription de ces mots, par les traducteurs des
éditions révisées de la Bible, n’a pas suffi à dissiper la confusion et les fausses
conceptions.” — The Encyclopedia Americana (1942), tome XIV, p. 81.
Des traducteurs ont laissé leurs croyances personnelles influencer leur travail et n’ont
pas été conséquents dans leur façon de rendre les termes originaux.
Ainsi, 1) la version de Saci rend she’ôl par “enfer”, “tombeau” et “fond de la terre”;
d’autre part, elle traduit haïdês par “enfer(s)”, et fait de même pour géénna.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 70
2) La Bible des moines de Maredsous rend haïdês par “séjour des morts”, “souterrain
séjour” ou “enfer(s)”; par ailleurs, elle écrit “séjour des morts” pour she’ôl et
“géhenne” ou “enfer” pour géénna.
3) La Bible de l’abbé Crampon (1905) met “séjour des morts”, “scheol”, “sombre
séjour” ou “sépulcre” pour she’ôl; “enfer(s)” ou “séjour des morts” pour haïdês; et
“géhenne” ou “enfer” pour géénna. Cette façon de faire obscurcit la signification des
vocables hébreu et grecs.
Que faut-il entendre par les ‘tourments éternels’ dont il est question en
Révélation 14:9-11; 20:10 ?
Il est intéressant de noter que selon Révélation 11:10 (TOB) des ‘prophètes causent
bien des tourments aux habitants de la terre’. Ces tourments sont dus aux messages
accusateurs et humiliants qu’ils proclament.
En Révélation 14:9-11 (TOB), nous apprenons que ceux qui adorent la “bête
[symbolique] et son image” ‘connaissent les tourments dans le feu et le soufre’. Il ne
peut s’agir de douleurs conscientes dans la mort, car “les morts ne savent rien du
tout”. (Eccl. 9:5, TOB.) Par conséquent, qu’est-ce qui vaut de tels tourments aux
adorateurs de la “bête” et de “son image” alors qu’ils sont encore vivants? C’est la
proclamation, faite par les serviteurs de Dieu, selon laquelle ces adorateurs subiront la
seconde mort, symbolisée par “l’étang embrasé de feu et de soufre”. La fumée qui
accompagne leur destruction par le feu s’élève aux siècles des siècles; autrement dit,
cette destruction sera éternelle et ne tombera jamais dans l’oubli.
.
Lorsque Révélation 20:10 déclare que le Diable doit ‘souffrir des tourments jour et
nuit aux siècles des siècles’ dans “l’étang de feu et de soufre”, qu’est-ce que cela
signifie? Révélation 21:8 (TOB) dit explicitement que “l’étang embrasé de feu et de
soufre” représente “la seconde mort”. Le Diable y est donc tourmenté à jamais en ce
sens qu’il n’en sortira pas; il sera retenu pour toujours dans ce qui correspond en fait à
la mort éternelle. Cette utilisation du mot “tourment” (du grec basanos) fait penser au
texte de Matthieu 18:34 où la même racine grecque désigne un ‘geôlier’.
.
Qu’est-ce que la “Géhenne de feu” mentionnée par Jésus
Le nom Géhenne apparaît 12 fois dans les Écritures grecques chrétiennes. À 5
reprises, le mot “feu” lui est associé. Les traducteurs ont rendu l’expression grecque
géénnan tou puros par “feu de l’enfer” (Sa, BFC), “enfer” (Ku), “géhenne de feu” (Jé,
TOB) ou “Géhenne ardente” (SO).
.
Rappel historique: La vallée de Hinnom (Géhenne) se trouvait en dehors des murailles
de Jérusalem. Pendant un temps, on y a pratiqué le culte idolâtrique, y compris les
sacrifices d’enfants. Au Ier siècle, la Géhenne servait à l’incinération des ordures de
la ville. On y brûlait les cadavres d’animaux en les jetant dans le feu, qu’on activait
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 71
avec du soufre. Les corps des criminels exécutés n’étaient pas jugés dignes d’être
ensevelis dans une tombe commémorative, aussi les lançait-on dans la Géhenne.
.
Voilà pourquoi Jésus parle en Matthieu 5:29, 30 du corps jeté tout entier dans la
Géhenne. Si le cadavre tombait au milieu du feu constamment entretenu, il se
consumait, mais s’il restait accroché sur un bord du profond ravin, sa chair en
putréfaction était infestée par les vers ou les asticots toujours présents (Marc 9:47,
48). Aucun humain vivant n’était lancé dans la Géhenne; ce n’était donc pas un lieu
où des êtres conscients étaient tourmentés.
En Matthieu 10:28, Jésus invite ses auditeurs à ‘craindre celui qui peut détruire et
l’âme et le corps dans la Géhenne’. Que voulait-il dire? Vous noterez qu’il n’est pas
question ici d’être tourmenté dans le feu de la Géhenne; Jésus dit plutôt qu’il faut
‘craindre celui qui peut détruire dans la Géhenne’. S’il parle de l’âme séparément,
c’est pour souligner que Dieu peut anéantir toute perspective de vie pour la personne
et lui ôter tout espoir de résurrection. Par conséquent, la “Géhenne de feu” désigne la
même chose que le “lac embrasé de feu” de Révélation 21:8, à savoir la destruction ou
“seconde mort”.
.
L’homme riche et de Lazare : récit littéral ou simple illustration?
Dans une note en bas de page, la Bible de Jérusalem reconnaît qu’il s’agit d’une
“histoire-parabole, sans aucune attache historique”. Si l’on prenait ce récit au pied de
la lettre, il faudrait conclure que ceux qui jouissent de la faveur divine vont tous dans
le sein d’un seul homme, Abraham; qu’un peu d’eau sur le bout d’un doigt ne
s’évapore pas dans le feu de l’Hadès; qu’une simple goutte d’eau soulage les
souffrances de quelqu’un qui s’y trouve.
Cela vous semble-t-il raisonnable? Si ces paroles étaient littérales, elles seraient en
contradiction avec d’autres parties de la Bible. Or, si les Écritures se contredisaient
ainsi, une personne sincère en ferait-elle le fondement de sa foi? En fait, la Parole de
Dieu ne se contredit pas.
.
Que signifie cette parabole?
L’“homme riche” représentait les Pharisiens. (Voir Luc 16:14)
Le mendiant, Lazare, symbolisait le commun peuple, autrement dit les Juifs que
méprisaient les Pharisiens, mais qui se sont repentis et sont devenus disciples de
Jésus. (Voir Luc 18:11; Jean 7:49; Matthieu 21:31, 32.)
Leur mort aussi est une image; elle marque un changement de condition à la suite
duquel ceux qui étaient méprisés reçoivent une position de faveur devant Dieu, tandis
que Dieu rejette ceux qui semblaient approuvés; ces derniers sont tourmentés par les
messages de jugement transmis par ceux qu’ils méprisaient. — Actes 5:33; 7:54.
.
La Bible enseigne que les morts ne souffrent pas
Eccl. 9:5, 10: “Les vivants, en effet, se rendent compte qu’ils mourront; mais quant
aux morts, ils ne se rendent compte de rien du tout (...). Tout ce que ta main trouve à
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 72
faire, fais-le avec ta force, car il n’y a ni œuvre, ni combinaison, ni connaissance, ni
sagesse dans le Schéol*, le lieu où tu vas.”
Puisqu’ils ne sont conscients de rien, il est évident qu’ils ne souffrent pas.
.
La Bible enseigne que les morts sortirons de "l'enfer"
Rév. 20:13, 14: “La mer rendit les morts qui étaient ensevelis dans ses eaux; la mort et
l’enfer* rendirent aussi les morts qu’ils avaient; et chacun fut jugé selon ses œuvres.
Alors l’enfer et la mort furent jetés dans l’étang de feu.”
Ainsi, les morts seront délivrés de l’enfer. Notez aussi que l’enfer est différent de
l’étang de feu, dans lequel il sera jeté.
Origines de la croyance à un enfer de feu
Dans la croyance babylonienne et assyrienne des temps antiques, l’“enfer (...) est
dépeint comme un lieu plein d’horreurs où dominent des dieux et des démons
particulièrement puissants et violents”. (The Religion of Babylonia and Assyria,
Boston, 1898, de Morris Jastrow Jr., p. 581.)
L’enfer de feu de la chrétienté a ses origines dans la religion de l’ancienne Égypte
(The Book of the Dead, New Hyde Park, New York, 1960, préfacé par E. Wallis
Budge, pp. 144, 149, 151, 153, 161).
Le bouddhisme, qui remonte au VIe siècle avant notre ère, en est venu à enseigner
l’existence d’un enfer brûlant et d’un enfer froid (The Encyclopedia Americana, 1977,
tome XIV, p. 68).
Des peintures de l’enfer que l’on peut voir en Italie, dans certaines églises
catholiques, sont d’inspiration étrusque. — La civiltà etrusca (Milan, 1979) de Werner
Keller, p. 389.
Mais il faut chercher bien plus loin les véritables origines de cette doctrine qui
déshonore Dieu.
Les croyances diaboliques rattachées à l’enfer en tant que lieu de tourments diffament
Dieu et ont pour auteur le principal calomniateur de Dieu, le Diable (dont le nom
signifie “calomniateur”), celui que Jésus a appelé “le père du mensonge”. — Jean
8:44.
4.6.3 L’enfer selon le Catéchisme de L'Église Catholique
Voici ce que dit « La Catéchisme de l'Église Catholique » sur l’enfer (no. 1033-1037 ;
Cf. no. 1056-1058) :
n° 1033 (4) Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de
l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre Lui,
contre notre prochain ou contre nous-mêmes: "Celui qui n'aime pas demeure dans la
mort. Quiconque hait son frère est un homicide; or vous savez qu'aucun homicide n'a
la vie éternelle demeurant en lui" (1Jn 3,15). Notre Seigneur nous avertit que nous
serons séparés de Lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et
des petits qui sont ses frères (cf. Mt 25,31-46). Mourir en péché mortel sans s'en être
repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 73
Lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion
définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le
mot "enfer".
n° 1034 (7) Jésus parle souvent de la "géhenne" du "feu qui ne s'éteint pas" (cf. Mt
5,22 5,29 13,42 13,50 Mc 9,43-48), réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur
vie de croire et de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps (cf.
Mt 10,28). Jésus annonce en termes graves qu'il "enverra ses anges, qui ramasseront
tous les fauteurs d'iniquité..., et les jetteront dans la fournaise ardente" (Mt 13,41-42),
et qu'il prononcera la condamnation: "Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel!"
(Mt 25,41).
n° 1035 (10) L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité.
Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement
après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, "le feu éternel"
(cf. DS 76 409 411 801 858 1002 1351 1575 SPF 12). La peine principale de l'enfer
consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu en qui seul l'homme peut avoir la vie et
le bonheur pour lesquels il a été crée et auxquels il aspire.
n° 1036 (13) Les affirmations de la Sainte Écriture et les enseignements de l'Église
au sujet de l'enfer sont un appel à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de
sa liberté en vue de son destin éternel. Elles constituent en même temps un appel
pressant à la conversion : "Entrez par la porte étroite. Car large et spacieux est le
chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui le prennent; mais étroite est
la porte et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent" (Mt
7,13-14):
(15) Ignorants du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur,
nous restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique
de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de
Dieu, au lieu d'être, comme de mauvais et paresseux serviteurs, écartés par l'ordre de
Dieu vers le feu éternel, vers ces ténèbres du dehors où seront les pleurs et les
grincements de dents (LG 48).
n° 1037 (18) Dieu ne prédestine personne à aller en enfer (cf. DS 397 1567); il faut
pour cela une aversion volontaire de Dieu (un péché mortel), et y persister jusqu'à la
fin. Dans la liturgie eucharistique et dans les prières quotidiennes de ses fidèles,
l'Église implore la miséricorde de Dieu, qui veut "que personne ne périsse, mais que
tous arrivent au repentir" (2P 3,9):
(20) Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille
entière: dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie,
arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus (MR, Canon Romain 88).
n° 1056 (19) Suivant l'exemple du Christ, l'Église avertit les fidèles de la "triste et
lamentable réalité de la mort éternelle" (DCG 69), appelée aussi "enfer".
n° 1057 (22) La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec
Dieu en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été crée et
auxquels il aspire.
n° 1058 (25) L'Église prie pour que personne ne se perde: "Seigneur, ne permets pas
que je sois jamais séparé de toi". S'il est vrai que personne ne peut se sauver lui-
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 74
même, il est vrai aussi que "Dieu veut que tous soient sauvés" (1Tm 2,4) et que pour
Lui "tout est possible" (Mt 19,26).
4.6.4 L’enfer dans les Traditions Africaines
Devoir : Y a-t-il quelque chose comme l’enfer dans les traditions Africains ou dans
ton ethnie ? Si oui, peux-tu comparer la conception de l’enfer dans la tradition
chrétienne et dans ta culture ?
4.7 LE PURGATOIRE
4.7.1 Le Purgatoire dans la Bible
Le mot « Purgatoire » ne se trouve pas dans la bible. Nous avons la purification :
Num. 19:9, Num. 19:17, 2 Chr. 30:19, Neh. 12:45, Est. 2:3, Est. 2:9, 2 :12, Lk. 2:22,
Acts 21:26.
4.7.2 Le Purgatoire dans la Tradition chrétienne
Ta tradition chrétienne (surtout celle du moyen âge) tient que l’au-delà est constitué
de trois lieux : Paradis, purgatoire et enfer. La conception du purgatoire est venue
tardivement dans l'Église. Les textes officiels de l'Église ne le mentionnent vraiment
qu’à partir du 13è siècle. Les Conciles de Lyon (1274), de Florence (1439) et de
Trente (1563) ont écrit sur le purgatoire. Sa base biblique n’est pas solide. On cite
souvent 1 Co 3, 11-15. Un résumé de l’enseignement officiel sur le purgatoire 117
:
1 C’est un lieu de transit pour aller au paradis ou on demeure définitivement. Ce
palier intermédiaire est imposé à quelques-uns, avant d’aller au paradis. Pour ceux qui
ne sont pas morts en état du péché mortel ou dont la pénitence s’avère insuffisante. Ils
se purifient avant d’accéder au paradis.
117
Cf. André Gounelle et François Vouga, Après la mort qu’y-a-t’il ?, Paris, Les Editions du Cerf,
1990, p. 28-29.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 75
2 On souffre au purgatoire. Dans ce sens il ressemble à l’enfer. Pour Thomas d’Aquin
le purgatoire se trouve contigu avec l’enfer pour que le même feu puisse servir aux
deux. Les peines du purgatoire sont dures et pénibles. Pourtant, il y a une différence
parce que les douleurs subies n’ont pas le même sens. En réponse à une remarque de
Luther, le Concile de Trente précise que les âmes du purgatoire sont « fixées dans la
grâce.
3 Les vivants ne peuvent rien faire pour les damnés dans l’enfer ou pour les
bienheureux au paradis, ils peuvent adoucir le sort des âmes au purgatoire par des
prières, des messes, des aumônes et des pratiques pieuses. Le catéchisme de Pie X
nous invite de prier pour les âmes du purgatoire pour implorer leur intercession.
4 Le purgatoire n’est pas éternel. Un jour il disparaîtra ou sera vide. A la fin du temps
les êtres humains seront repartis entre l’enfer et le paradis. La doctrine du purgatoire a
conduit à la pratique des indulgences. Il y a eu quelques abus dans ce sens qui a
contribué Luther de réagir en 1517 par ses thèses.
Ratsinger affirme que “La doctrine catholique du purgatoire a trouvé définitivement
sa dimension ecclésiale dans les deux conciles du Moyen Age qui ont tenté de susciter
l’union avec les églises d’Orient. Puis a été formulée succinctement encore une fois
au concile de Trente dans la discussion avec les mouvements de la Réforme. Ces
constatations indiquent déjà son lien historique et sa problématique œcuménique… le
Nouveau Testament avait laissé pendante la question de l’«état intermédiaire » entre
la mort et la résurrection au dernier jour, qui n’a pu progressivement s’éclairer que par
le développement de l’anthropologie chrétienne dans son rapport avec la christologie.
La doctrine du purgatoire est un élément de ce processus d’élucidation. L’Eglise y a
maintenu un peu de l’idée de l’«état intermédiaire ». Même si la décision de vie est
prise au moment de la mort de manière définitive et irrévocable (DS 1000) …dans la
tradition occidentale, cet « état intermédiaire » s’appelle le « purgatoire »… Les Grecs
n’admettent pas la doctrine d’un châtiment et d’une réconciliation dans l’au-delà ;
mais ils ont en commun avec les latins l’intercession pour les défunts, qui s’opère par
la prière, les aumônes. Les bonnes œuvres et surtout par l’offrande de l’eucharistie
pour les trépassés». 118
4.7.3 Le Purgatoire selon le Catéchisme de l'Église Catholique
Voici ce que dit « La Catéchisme de l'Église Catholique » sur le Purgatoire (no. 1030-
1032 ; Cf. no. 1054-1055) :
n° 1030 (4) Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement
purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une
purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaires pour entrer dans la joie du ciel.
n° 103 (7) L'Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à
fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative
au Purgatoire surtout aux Conciles de Florence (cf. DS 1304) et de Trente (cf. DS
118
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 237-238.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 76
1820 1580). La tradition de l'Église, faisant référence à certains textes de l'Écriture
(par exemple 1Co 3,15 1P 1,7), parle d'un feu purificateur:
(9) Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le
jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme Celui qui est la Vérité, en disant que
si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné
ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur (Mt 12,31). Dans cette sentence nous
pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais
certaines autres dans le siècle futur (S. Grégoire le Grand, dial. 4,39).
n° 1032 (12) Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les
défunts dont parle déjà la Sainte Écriture: "Voilà pourquoi il (Judas Maccabée) fit
faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leur péché"
(2M 12,46). Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert
des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique (cf. DS 856), afin
que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Eglise
recommande aussi les aumônes, les indulgences et les oeuvres de pénitence en faveur
des défunts:
(14) Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils de Job ont été
purifiés par le sacrifice de leur père (cf. Jb 1,5), pourquoi douterions-nous que nos
offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à porter
secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux (S. Chrysostome, hom.
in 1Co 41,5).
n° 1054 (13) Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement
purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une
purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie de Dieu.
n° 1055 (16) En vertu de la "communion des saints", l'Eglise recommande les
défunts à la miséricorde de Dieu et offre en leur faveur des suffrages, en particulier le
saint sacrifice eucharistique.
4.7.4 Le Purgatoire dans les Traditions Africaines
Devoir : Y a-t-il quelque chose comme le Purgatoire dans les traditions Africains ou
dans ton ethnie ? Si oui, peux-tu comparer la conception du Purgatoire dans la
tradition chrétienne et dans ta culture ?
4.8 LE CIEL
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 77
4.8.1 Le ciel dans la Bible
4.8.1.1 Le ciel dans l’Ancien Testament
Le mot ciel se trouve beaucoup de fois dans l’Ancien Testament : Gn 1, 1 ; Gn 1, 8 ;
Gn 1, 9 ; Gn 1, 14 ; Gn 1, 15 ; Gn 1, 17 ; Gn 1, 20 ; Gn 6, 17 ; Gn 7, 11 ; Gn 7, 19 ;
Gn 7, 23 ; Gn 8, 2 ; Gn 11, 4 ; Gn 14, 19 ; Gn 14, 22 ; Gn 15, 5 ; Gn 19, 24 ; Gn 21,
17 ; Gn 22, 11 ; Gn 22, 15 ; Gn 22, 17 ; Gn 24, 3 ; Gn 24, 7 ; Gn 26, 4 ; Gn 27, 28 ;
Gn 27, 39 ; Gn 28, 12 ; Gn 28, 17 ; Gn 49, 25 ; Ex 9, 8 ; Ex 9, 10 ; Ex 9, 22 ; Ex 9,
23 ; Ex 10, 21 ; Ex 10, 22 ; Ex 16, 4 ; Ex 17, 14 ; Ex 20, 4 ; Ex 20, 11 ; Ex 20, 22 ; Ex
24, 10 ; Ex 31, 17 ; Ex 32, 13 ; Lv 26, 19 ; Dt 1, 10 ; Dt 1, 28 ; Dt 2, 25 ; Dt 3, 24 ; Dt
4, 11 ; Dt 4, 19 ; Dt 4, 26 ; Dt 4, 32 ; Dt 4, 36 ; Dt 4, 39 ; Dt 5, 8 ; Dt 7, 24 ; Dt 9, 19,
14 ; Dt 10, 14 ; Dt 10, 22 ; Dt 11, 11 ; Dt 11, 17 ; Dt 11, 21 ; Dt 17, 3 ; Dt 25, 19 ; Dt
26, 15 ; Dt 28, 12 ; Dt 28, 23 ; Dt 28, 24 ; Dt 28, 62 ; Dt 29, 20 ; Dt 30, 4 ; Dt 30, 12 ;
Dt 30, 19 ; Dt 31, 28 ; Dt 32, 40 ; Dt 33, 13 ; Dt 33, 26 ; Jos 2, 11 ; Jos 8, 20 ; Jos 10,
11 ; Jos 10, 13 ; Jg 5, 20 ; Jg 13, 20 ; Jg 20, 40 ; 1 S 2, 10 ; 1 S 5, 12 ; 2 S 18, 9 ; 2 S
21, 10 ; 2 S 22, 8l ; 2 S 22, 14 ; 1 R 8, 22 ; 1 K 8, 23 ; 1 R 8, 27 ; 1 R 8, 30 ; 1 R 8,
32 ; 1 R 8, 34 ; 1 R 8, 35 ; 1 R 8, 36 ; 1 R 8, 39 ; 1 R 8, 43 ; 1 R 8, 45 ; 1 R 8, 49 ; 1 R
8, 54 ; 1 R 18, 45 ; 1 R 22, 19 ; 2 R 1, 10 ; 2 R 1, 12 ; 2 R 1, 14 ; 2 R 2, 1 ; 2 R 2, 11 ;
2 R 7, 2 ; 2 R 7, 19 ; 2 R 14, 27 ; 2 R 17, 16 ; 2 R 19, 15 ; 2 R 21, 3 ; 2 R 21, 5 ; 2 R
23, 4 ; 2 R 23:5, 1 Ch 21, 16 ; 1 Ch 21, 26 ; 1 Ch 29, 11 ; 2 Ch 2, 6 ; 2 Ch 2, 12 ; 2
Ch 6, 13 ; 2 Ch 6, 14 ; 2 Ch 6, 18 ; 2 Ch 6, 21 ; 2 Ch 6, 23 ; 2 Ch 6, 26 ; 2 Ch 6, 27 ; 2
Ch 6, 30 ; 2 Ch 7, 1 ; 2 Ch 7, 13 ; 2 Ch 7, 14 ; 2 Ch 18, 18 ; 2 Ch 20, 6 ; 2 Ch 28, 9 ; 2
Ch 30, 27 ; 2 Ch 32, 20 ; 2 Ch 33, 3 ; 2 Ch 33, 5 ; 2 Ch 36, 23 ; Esd 1, 2 ; Esd 5, 11 ;
Esd 5, 12 ; Esd 6, 9 ; Esd 6, 10 ; Esd 7, 12 ; Esd 7, 21 ; Esd 7, 23 ; Ne 1, 4 ; Ne 1, 5 ;
Ne 1, 9 ; Ne 2, 4 ; Ne 2, 20 ; Ne 9, 6 ; Ne 9, 13 ; Ne 9, 15 ; Ne 9, 23 ; Ne 9, 27 ; Ne 9,
28 ; Jb 1, 16 ; Jb 2, 12 ; Jb 11, 8 ; Jb 16, 19 ; Jb 20, 27 ; Jb 22, 12 ; Jb 22, 14 ; Jb 26,
11 ; Jb 28, 24 ; Jb 35, 11 ; Jb 37, 3 ; Jb 38, 29 ; Jb 38, 33 ; Jb 38, 37 ; Jb 41, 11 ; Ps
11, 4 ; Ps 14, 2 ; Ps 19, 6 ; Ps 20, 6 ; Ps 33, 13 ; Ps 53, 2 ; Ps 57, 3 ; Ps 69, 34 ; Ps 73,
25 ; Ps 76, 8 ; Ps 77, 18 ; Ps 78, 23 ; Ps 78, 24 ; Ps 78, 26 ; Ps 79, 2 ; Ps 80, 14 ; Ps 85,
11 ; Ps 89, 6 ; Ps 89, 29 ; Ps 89, 37 ; Ps 102, 19 ; Ps 103, 11 ; Ps 104, 12 ; Ps 105, 40 ;
Ps 107, 26 ; Ps 113, 6 ; Ps 115, 15 ; Ps 115,16 ; Ps 119, 89 ; Ps 121, 2 ; Ps 124, 8 ; Ps
134, 3 ; Ps 135, 6 ; Ps 136, 26 ; Ps 139, 8 ; Ps 146, 6 ; Ps 147, 8 ; Ps 148, 13 ; Pr 23,
5 ; Pr 25, 3 ; Pr 30, 4 ; Qo 1, 13 ; Qo 2, 3 ; Qo 3, 1 ; Qo 5, 2 ; Is 13, 5 ; Is 13, 10 ; Is
14, 12 ; Is 14, 13 ; Is 34, 4 ; Is 34, 5 ; Is 37, 16 ; Is 40, 12 ; Is 55, 10 ; Is 63, 15 ; Is 66,
1 ; Jr 7, 18 ; Jr 7, 33 ; Jr 8, 2 ; Jr 8, 7 ; Jr 10, 2 ; Jr 15, 3 ; Jr 16, 4 ; Jr 19, 7 ; Jr 19, 13 ;
Jr 23, 24 ; Jr 31, 37 ; Jr 32, 17, ; Jr 33, 22 ; Jr 33, 25 ; Jr 34, 20 ; Jr 44, 17 ; Jr 44, 18 ;
Jr 44, 19 ; Jr 44, 25 ; Jr 49, 36 ; Jr 51, 9; Jr 51, 15 ; Jr 51, 48 ; Jr 51, 53 ; Lm 2, 1 ; Lm
3, 50 ; Lm 4, 19 ; Ez 8, 3 ; Ez 29, 5 ; Ez 31, 6 ; Ez 31, 13 ; Ez 32, 4 ; Ez 32, 7 ; Ez 32,
8 ; Ez 38, 20 ; Dn 2, 18 ; Dn 2, 19 ; Dn 2, 28 ; Dn 2, 37 ; Dn 2, 38 ; Dn 2, 44 ; Dn 4,
11 ; Dn 4, 12 ; Dn 4, 13 ; Dn 4, 15 ; Dn 4, 20 ; Dn 4, 21 ; Dn 4, 22 ; Dn 4, 23 ; Dn 4,
25 ; Dn 4, 31 ; Dn 4, 33 ; Dn 4, 34 ; Dn 4, 35 ; Dn 4, 37 ; Dn 5, 21 ; Dn 5, 23 ; Dn
6:27, Dan. 7:2, Dan. 7:13, Dan. 7:27, Dan. 8:8, Dan. 8:10, Dan. 9:12, Dan. 11:4, Dan.
12, 7 ; Os 2, 18 ; Os 4, 3 ; Os 7, 12 ; Am 9, 2 ; Am 9, 6 ; Jon 1, 9, Na 3, 16 ; So 1, 3 ;
So 1, 5 ; Ag 1, 10 ; Za 2, 6 ; Za 5, 9 ; Ml 3, 10.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 78
4.8.1.2 Le ciel dans le Nouveau Testament
Également, le mot ciel se trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament : Mt 3, 2 ;
Mt 3:17 ; Mt 4, 17 ; Mt 5, 3 ; Mt 5, 10 ; Mt 5, 12 ; Mt 5, 16 ; Mt 5, 18 ; Mt 5, 19 ; Mt
5, 20 ; Mt 5, 34 ; Mt 5, 45 ; Mt 5, 48 ; Mt 6, 1 ; Mt 6, 9 ; Mt 6, 10 ; Mt 6, 20 ; Mt 7, 11
; Mt 7, 21 ; Mt 8, 11 ; Mt 10, 7 ; Mt 10, 32 ; Mt 10:33 ; Mt 11, 11 ; Mt 11, 12 ; Mt 11,
23 ; Mt 11, 25 ; Mt 12, 50 ; Mt 13, 11 ; Mt 13, 24 ; Mt 13, 31 ; Mt 13, 33 ; Mt 13, 44 ;
Mt 13, 45 ; Mt 13, 47 ; Mt 13, 52 ; Mt 14, 19 ; Mt 16, 1 ; Mt 16, 17 ; Mt 16, 19 ; Mt
18, 1 ; Mt 18, 3 ; Mt 18, 4 ; Mt 18, 10 ; Mt 18, 14 ; Mt 18, 18 ; Mt 18, 19 ; Mt 18, 23 ;
Mt 19, 14 ; Mt 19, 21 ; Mt 19, 23 ; Mt 20, 1 ; Mt 21, 25 ; Mt 22, 2 ; Mt 22, 30 ; Mt 23,
9 ; Mt 23, 13 ; Mt 23, 22 ; Mt 24, 29 ; Mt 24, 30 ; Mt 24, 31 ; Mt 24, 35 ; Mt 24, 36 ;
Mt 25, 1 ; Mt 25, 14 ; Mt 26, 64 ; Mt 28, 2 ; Mt 28, 18 ; Mc 1, 11 ; Mc 6, 41 ; Mc 7,
34 ; Mc 8, 11 ; Mc 10, 21 ; Mc 11, 25 ; Mc 11, 26 ; Mc 11, 30 ; Mc 11, 31 ; Mc 12,
25 ; Mc 13, 25 ; Mc 13, 27 ; Mc 13, 31 ; Mc 13, 32 ; Mc 14, 62 ; Mc 16, 19 ; Lc 2, 15
; Lc 3, 21 ; Lc 3, 22 ; Lc 4, 25 ; Lc 6, 23 ; Lc 9, 16 ; Lc 9, 54 ; Lc 10, 15 ; Lc 10, 18 ;
Lc 10, 20 ; Lc 10, 21 ; Lc 11, 2 ; Lc 11, 16 ; Lc 15, 7 ; Lc 15, 18 ; Lc 15, 21 ; Lc 16,
17 ; Lc 17, 24 ; Lc 17, 29 ; Lc 18, 13 ; Lc 18, 22 ; Lc 19, 38 ; Lc 20, 4 ; Lc 20, 5 ; Lc
21, 11 ; Lc 21, 26 ; Lc 21, 33 ; Lc 22, 43 ; Lc 24, 51 ; Jn 1, 32 ; Jn 1, 51 ; Jn 3, 13 ; Jn
3, 27 ; Jn 3, 31 ; Jn 6, 31 ; Jn 6, 32 ; Jn 6, 33 ; Jn 6, 38 ; Jn 6, 41 ; Jn 6, 42 ; Jn 6, 50 ;
Jn 6, 51 ; Jn 6, 58 ; Jn 12, 28 ; Jn 17, 1 ; Ac 1, 10 ; Ac 1, 11 ; Ac 2, 2 ; Ac 2, 5 ; Ac 2,
19 ; Ac 3, 21 ; Ac 4, 12 ; Ac 4, 24 ; Ac 7, 42 ; Ac 7, 49 ; Ac 7, 55 ; Ac 9, 3 ; Ac 10,
11 ; Ac 10, 16 ; Ac 11, 5 ; Ac 11, 9 ; Ac 11, 10 ; Ac 14, 15 ; Ac 14, 17 ; Ac 17, 24 ;
Ac 22, 6 ; Ac 26, 13 ; Rm 1, 18 ; Rm 10, 6 ; 1 Co 8, 5 ; 1 Co 15, 47 ; 2 Co 5, 2 ; 2 Co
12, 2 ; Ga 1, 8, Ep 1, 10 ; Ep 3, 15 ; Ep 6, 9 ; Ph 2, 10 ; Ph 3, 20 ; Col 1, 5 ; Col 1, 16 ;
Col 1, 20 ; Col 1, 23 ; Col 4, 1 ; 1 Th 1, 10 ; 1 Th 4, 16 ; 2 Th 1, 7 ; He 9, 24 ; He 10,
34 ; He 12, 23 ; He 12, 25 ; He 12, 26 ; Jc 5, 12 ; Jc 5, 18 ; 1 P 1, 4 ; 1 P 1, 12 ; 1 P 3,
22 ; 2 P 1, 18 ; 1 Jn 5, 7 ; Ap 3, 12 ; Ap 4, 1 ; Ap 4, 2 ; Ap 5, 3 ; Ap 5, 13 ; Ap 6, 13 ;
Ap 6, 14 ; Ap 8, 1 ; Ap 8, 10 ; Ap 8, 13 ; Ap 9, 1 ; Ap 10, 1 ; Ap 10, 4 ; Ap 10, 5 ; Ap
10, 6 ; Ap 10, 8 ; Ap 11, 6 ; Ap 11, 12 ; Ap 11, 13 ; Ap 11, 15 ; Ap 11, 19 ; Ap 12, 1 ;
Ap 12, 3 ; Ap 12, 4 ; Ap 12, 7 ; Ap 12, 8 ; Ap 12, 10 ; Ap 13, 6 ; Ap 13, 13 ; Ap 14,
2 ; Ap 14, 6 ; Ap 14, 7 ; Ap 14, 13 ; Ap 14, 17 ; Ap 15, 1 ; Ap 15, 5 ; Ap 16, 11 ; Ap
16, 17 ; Ap 16, 21 ; Ap 18, 1 ; Ap 18, 4 ; Ap 18, 5 ; Ap 18, 20 ; Ap 19, 1 ; Ap 19, 11 ;
Ap 19, 14 ; Ap 19, 17 ; Ap 20, 1 ; Ap 20, 9 ; Ap 20, 11 ; Ap 21, 1 ; Ap 21, 2 ; Ap 21,
3 ; Ap 21, 10.
4.8.2 Le ciel dans la Tradition chrétienne
Qu'est-ce que le ciel?
Une version anglaise de la Bible, la King James, emploie le mot ciel 582 fois dans
550 versets. Le mot hébreu shamayim, que l'on traduit habituellement par "ciel", est
un nom pluriel qui signifie littéralement "les hauteurs". Quant au mot grec, ouranos
(que l'on a utilisé pour désigner la planète Uranus), il se réfère à ce qui est élevé.
Aussi bien shamayim qu’ouranos sont utilisés dans l'Écriture pour décrire trois lieux
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 79
différents. Cela explique d'ailleurs pourquoi Paul dit avoir été ravi au "troisième ciel"
(cf. 2 Co 12:2).
Les textes ecclésiastiques parlent du ciel ce que le langage populaire appelle paradis.
Durrwell parle du ciel comme la demeure dans laquelle Dieu habite et trouve son
bonheur. Il identifie le Fils comme le ciel du Père (1 Co 8, 6 ; Eph 1, 4-10). En parlant
du « ciel christique », il cite la formule d’Origène In Matth tract. 14, 7. PG 13, 1197
(qui se trouve aussi chez Tertullien, Cyprien et Ambroise) « dans les évangiles, Jésus
est une personne de Règne » de Dieu (Lc 11, 20 ; 17, 20s ; 22, 29s. ; Mt 26, 64 ; Lc
23, 43). Il tient que le ciel est inauguré dans cette terre et il est l’au-delà profond de la
vie de l'Église. Le ciel se trouve dans notre communion avec le Dieu Trinitaire (Jn 14,
21 ; Ph 3, 20 ; Col 1, 13 ; Ep 2, 5 ; Jn 12, 32). 119
Également, Durrwell parle d’un « ciel trinitaire ». En effet, le ciel christique est aussi
le ciel Trinitaire parce que le Christ habite la Trinité. Comme le Père et le Fils,
l’Esprit Saint est dans cette communion céleste (Lc 1, 35 ; He 9, 14 ; Rm 8, 11). Il
tient qu’on habite la Trinité comme en un espace mais dans la communion : le Père
dans le Fils (Mt 11, 26s.) et le Père et le Fils dans l’Esprit et le Christ et l’Esprit dans
les fidèles. Il maintient que le Fils de Dieu a fait de nous les enfants de Dieu. Les
Saints sont « filialisés »dans l’Esprit (Rm 8, 17 ; Jn 6, 56 ; Jn 14, 20 ; 2 Tm 2, 11 ; 1,
13, 12 ; Lc 10, 21 ; Mt 26, 29). 120
En outre, Durrwell affirme « un ciel communautaire ». Il tient que l'Église terrestre est
réunie au nom de Dieu le Père, le Fils (1 The 1, 1) et l’Esprit Saint (2 Co 13, 13).
Nous sommes invités à entrer dans la communion Trinitaire (1 Jn 1, 3s. ; Ap 3, 20 ; 1
Co 15, 45 ; 2 Co 5, 15). 121
Bernard Sesboüé considère le ciel comme « le Royaume de Dieu accompli ». Le ciel
est la demeure de Dieu et non pas « un espace cosmique ou évoluent les différents
astres ». Le ciel symbolise quelque chose d’immensité insondable et d’une élévation
au-dessus des êtres humains qui dépasse toute limite. La considération du ciel comme
« l’en-haut » souligne ce qui nous domine et ce qui est bon et bien. Le langage des
religions a placé Dieu en haut, une représentation symbolique d’un lieu complètement
différent de tous les lieux du monde. Paul nous parle du troisième ciel (2 Co 12, 2).
Dans sa prière Jésus dit « Notre Père qui es aux cieux ». Mathieu parle du « Royaume
des cieux » (Mt 5, 3-12). Le jour de son ascension Jésus « monte au ciel » (Ac 1, 10).
Nous voyons aussi le ciel est aussi le « lieu » où demeurent ceux qui sont sauvés.
C’est le «paradis » des êtres humains avec Dieu. Le ciel avant d’être un « en-haut »,
c’est notre patrie un « en-avant » (Col 3, 1 ; Phil 3, 20). 122
Concernant le ciel, Augustin dit, « Tu sais quelle est la maison du Seigneur. Dans
cette maison du Seigneur, on chante les louanges de celui qui l’a fondée. Il fait lui-
même les délices de ceux qui habitent sa maison ; Il n’est ici-bas qu’un espoir, mais
là-haut il est la réalité. Que doivent faire ceux qui courent vers cette maison ? Faire
119
Cf. François-Xaxier Durrwell, Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris, Mediaspaul, 1994, p. 136-141. 120
Cf. François-Xaxier Durrwell, Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris, Mediaspaul, 1994, p. 142-151. 121
Cf. François-Xaxier Durrwell, Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris, Mediaspaul, 1994, p. 152-158. 122
Cf. Bernard Sesboüé, La résurrection et la vie : Petite catéchèse sur les choses de la fin, Paris,
Desclée de Brouwer, 1990, p. 17-18.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 80
comme s’ils y étaient déjà, comme s’ils y étaient fixés. C’est une grande chose en
effet que de se tenir là, au milieu des anges, sans déchoir. Celui qui est tombé ne
tenait pas dans la vérité, dit saint Jean (Jn 8, 44). Ceux qui ne sont point tombés se
tiennent dans la vérité et celui-là se tient dans la vérité qui jouit de Dieu, mais celui
qui jouit de soi-même tombe… Pense à ce que tu seras là-haut, et quoique tu sois
encore en chemin, regarde le but comme si tu y étais déjà, comme si, au milieu des
Anges, tu goûtais une joie sans fin, comme si déjà se réalisait en toi ce qui a été écrit :
‘Bienheureux ceux qui habitent la demeure et te louent à jamais (Ps 84, 5)’ ». 123
Augustin ajoute, « C’est dans une région qui dépasse mon âme que se trouve la
demeure de Dieu. C’est là qu’il habite, de là qu’il me regarde, de là qu’il m’a créé,
qu’il me gouverne, qu’il me conseille, qu’il m’encourage et m’appelle, de là qu’il me
dirige, me conduit et m’amène au terme. Dans la maison de Dieu, c’est une fête sans
fin. On n’ célèbre pas quelque chose qui passe. Fête sans fin, avec les chœurs des
Anges, visage de Dieu vu à découvert, joie sans déclin. Nul commencement à cette
fête et nulle fin qui la termine. De cette fête éternelle et perpétuelle s’échappe je ne
sais quelle harmonie agréable et douce aux oreilles du cœur…».124
Concernant le ciel, Ratzinger maintient que « Par l’image du ciel, qui a des points
d’attache dans la symbolique naturelle de l’« en haut », des hauteurs, la tradition
chrétienne désigne l’accomplissement définitif de l’existence humaine par l’amour
accompli à quoi tend la foi. Pour les chrétiens, un tel accomplissement n’est pas
simplement une musique futuriste, mais le simple exposé de ce qui se réalise dans la
rencontre avec le Christ et de ce qui est déjà présent en elle fondamentalement, selon
ses composantes essentielles. S’interroger sur le ciel, ce n’est donc pas glisser dans un
rêve pieux, mais connaître plus à fond ce présent caché qui véritablement nous fait
vivre et que nous laissons de plus en plus les réalités superficielles nous dérober et
nous arracher ». 125
Excursus : Le ciel dans la Tradition chrétienne - un article
Il y a tout d'abord le ciel atmosphérique, que nous appelons encore la troposphère –
couche d'air qui enveloppe la terre et nous permet de respirer. En rapport avec ce
premier ciel, le livre de la Genèse dit que "les sources du grand abîme jaillirent, et les
écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante
nuits" (Ge 7:11-12). Dans ce passage, le mot "ciel" se réfère à cette couche
atmosphérique qui enveloppe la terre, et qui est le lieu où les cycles hydrologiques se
forment. Le Psalmiste nous dit également que Dieu "couvre les cieux de nuages" (Ps
147:8). Ceci est le premier ciel.
Le second ciel, le ciel planétaire, est le lieu où se trouvent les étoiles, la lune et les
planètes. L'Écriture utilise le mot "ciel" pour décrire cette partie de l'univers. Ainsi,
toujours dans le livre de la Genèse, nous pouvons lire:
123
Augustin, In Ps. 123, 3, trad. Tissot, Saint Augustin maître de vie spirituelle, Mappus, p. 168-169. 124
Augustin, In Ps. 41, 9, Tissot, p. 169-170. 125
Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1979, p. 233252-253.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 81
"Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour
d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les
années; et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre.
Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour
présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les
étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre." (Genèse 1:14-
17)
Le troisième ciel, celui dont parle Paul en 2 Corinthiens 12, est le ciel où Dieu réside
avec ses saints anges et les croyants qui sont morts. Les deux autres cieux
passeront (2 Pi 3:10). Mais ce troisième ciel est éternel.
Quelqu'un se posera inévitablement la question suivante: si Dieu est omniprésent,
comment l'Écriture peut-elle nous dire que le ciel est sa demeure? Après tout,
comment un être omniprésent peut-il demeurer quelque part? Alors qu'il dédicaçait le
Temple de Jérusalem, Salomon fit cette prière: "Voici, les cieux et les cieux des cieux
ne peuvent te contenir: combien moins cette maison que je t'ai bâtie!" (1 Rois 8:27).
Il est tout à fait vrai que "les cieux et les cieux des cieux" ne peuvent pas contenir
Dieu. Il est omniprésent. Exaltant l'omniprésence de Dieu, le psalmiste s'est écrié: "Si
je monte aux cieux, tu es là; si je me couche au séjour des morts, te voilà" (Ps 139:8).
Toutefois, dire que Dieu demeure au ciel ne signifie pas qu'il ne demeure que là.
Cependant, c'est là sa demeure, son centre de commandement, en quelque sorte. Le
ciel est le lieu où se trouve son trône. C'est aussi le lieu où l'on peut trouver une
adoration parfaite. C'est dans ce sens que nous pouvons dire que le ciel est sa
demeure.
Le concept de ciel en tant que demeure de Dieu revient souvent dans l'Ecriture. Nous
pouvons lire, par exemple, dans l'Ancien Testament: "Car ainsi parle le Très-Haut,
dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint: J'habite dans les lieux élevés et
dans la sainteté" (Es 57:15). Dieu déclare ainsi solennellement lui- même qu'il
possède un lieu de résidence. Esaïe dit encore: "Regarde du ciel, et vois, de ta
demeure sainte et glorieuse" (Es 63:15). Le psalmiste nous parle également de la
demeure de Dieu: "L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de
l'homme; du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre" (Ps 33:13-
14).
Le Nouveau Testament mentionne en de nombreux endroits le ciel en tant que
demeure de Dieu. C'est en réalité un thème qui transparaît comme en filigrane dans le
Sermon sur la Montagne. Jésus a dit: "Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est
dans les cieux" (Mt 5:16). Il a mis en garde ceux qui ont tendance à jurer: "Moi, je
vous dis de ne jurer aucunement... par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu" (y.
34). Il a appelé ses disciples à aimer leurs ennemis "afin que vous soyez fils de votre
Père qui est dans les cieux" (v. 45). Puis, Jésus a dit: "Gardez-vous de pratiquer votre
justice devant les hommes, pour en être vus; autrement, vous n'aurez point de
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 82
récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux" (Mt 6:1). Il a enseigné cette
prière à ses disciples: "Notre Père qui es aux cieux! ..." (v. 9). Vers la fin du Sermon,
il a dit encore: "Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent" (Mt 7:11). De plus, "ceux
qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux" (v. 21).
Cette expression revient sans cesse, dans la prédication publique de Jésus aussi bien
que dans son ministère auprès des individus. Ainsi, nous pouvons lire en Matthieu
10:32-33: "C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me
déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux; mais quiconque
me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les
cieux". Matthieu 12:50 dit: "Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans
Les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère." Jésus a dit à Pierre: "Tu es
heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé
cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux" (Mt 16:17). Il a également comparé
les croyants aux petits enfants, et a mis en garde ceux qui pourraient les offenser:
"Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que leurs anges dans
les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux" (Mt
18:10). Puis il a ajouté: "Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux
qu'il se perde un seul de ces petits". Et, "si deux d'entre vous s'accordent sur la terre
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est
dans les cieux" (v. 19). Jésus se réfère constamment à Dieu comme son "Père céleste".
Le concept du ciel, en tant que demeure de Dieu, est également implicite dans
l'enseignement du Nouveau Testament concernant la divinité de Christ. Il est ainsi
décrit comme "le pain de Dieu ... qui descend du ciel" (Jn 6:33). La divinité de Christ
est également implicite dans le passage suivant: "Je suis descendu du ciel pour faire,
non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé" (Jn 6:38). Voici ce qu'il dit
de lui-même: "Je suis le pain qui est descendu du ciel" (v. 41). Au chapitre six de
l'Evangile de Jean, nous voyons Jésus répéter cette même affirmation (cf. vv. 50-51,
58). Ces paroles furent bien comprises par ceux qui écoutaient Jésus, et ils savaient
qu'il leur disait qu'il était Dieu.
L'étendue du ciel (royaume de Dieu)
Ce que nous venons de dire ne signifie pas que le ciel soit soumis aux contraintes
habituelles de l'espace et du temps. Nous avons vu que l'enseignement de l'Ecriture est
clair : le ciel est un endroit réel qui peut être contemplé, touché et habité par des êtres
ayant un corps matériel. Nous affirmons cette vérité sans aucune équivoque.
Mais l'Ecriture nous révèle également que le ciel ne se confine pas à un espace
limité dans sa longueur, largeur et hauteur. Il englobe non seulement ces dimensions,
mais bien d'autres encore. Dans son message à l'Église de Philadelphie, par exemple,
Jésus parle du royaume céleste comme de la "nouvelle Jérusalem qui descend du ciel
d'au près de mon Dieu" (Ap 3:12). Le nouveau ciel et la nouvelle terre se confondent
en un grand royaume qui embrasse ces deux dimensions. Ainsi, le paradis terrestre est
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 83
révélé comme étant un magnifique royaume où le ciel et la terre s'unissent dans une
gloire qui surpasse les frontières des dimensions terrestres autant que celles de
l'imagination humaine.
Le ciel ne se limite donc pas à un lieu aux frontières bien précises que l'on pourrait
trouver sur une carte et mesurer. Le ciel transcende les confins de l'espace et du
temps. Peut-être est-ce là ce que l'Écriture veut nous faire comprendre lorsqu'elle
affirme que "la demeure est éternelle" (Es 57:15). Il ne nous appartient pas de
spéculer sur le comment de son existence, il suffit de remarquer que c'est ainsi que la
Bible décrit le ciel. C'est un lieu réel, où des gens avec un corps physique habiteront
dans la présence de Dieu pour toute l'éternité; mais c'est également un royaume qui
dépasse nos facultés d'imagination.
Il y a un autre aspect important dans le fait que le ciel transcende les dimensions de
l'espace et du temps telles que nous les connaissons. L'Écriture nous enseigne que
le royaume de Dieu existe aussi sous une forme un peu mystérieuse, et qui incorpore
des éléments du ciel lui-même.
Il s'agit de la dimension spirituelle dans laquelle tout vrai chrétien vit déjà. Le
royaume de Dieu envahit la vie du croyant et commence à la diriger. Spirituellement
parlant, le chrétien fait partie du ciel, avec les droits de citoyenneté qui en découlent
même dans notre vie présente.
C'est précisément ce que Paul voulait dire lorsqu'il écrivait que "nous sommes
citoyens des cieux" (Ph 3:20). D'une certaine manière, les croyants vivent déjà dans le
royaume de Dieu.
En Ephésiens 1:3, Paul nous dit que Dieu "nous a bénis de toute bénédiction
spirituelle dans les lieux célestes en Christ!". De même, nous lisons en Ephésiens 2:5-
6: "morts par nos offenses, [Dieu] nous a rendus vivants avec Christ... il nous a
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-
Christ". Remarquez que, dans les deux passages, le verbe est conjugué au passé. Paul
parle d'une réalité qui est déjà effective. Il est vrai que nous ne sommes pas encore
physiquement au ciel. Mais, de par la position qui nous est conférée en Christ, nous
demeurons avec lui au ciel. Nous sommes déjà entrés dans le royaume céleste grâce à
notre union spirituelle avec lui. Nous possédons déjà la vie éternelle, et les richesses
spirituelles du ciel sont nôtres en Jésus-Christ.
Jésus lui-même a prêché que le royaume des cieux était proche (Mt 4:17). Cependant,
il a dit à ceux qui voulaient savoir quand le royaume serait visible et pleinement
établi: "Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira
point: Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous" (Lc
17:20-21).
Pensez-y: le ciel se trouve là où la sainteté, la communion avec Dieu, la paix, la joie,
l'amour, et où les autres vertus sont pratiquées à la perfection. Nous pouvons
expérimenter ces choses – au moins partiellement – dès à présent. Le Saint-Esprit
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 84
produit le bon fruit en nous: "l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi" (Gal 5:22). Une fois de plus, ces
mêmes choses caractérisent le ciel. De plus, nous avons la vie de Dieu en nous et la
souveraineté de Dieu au-dessus de nous. Nous pouvons connaître la joie, la paix,
l'amour, la bonté et la bénédiction. Nous sommes membres d'une même famille, nous
sommes devenus une nouvelle communauté. Nous avons laissé derrière nous le
royaume des ténèbres et nous sommes entrés dans le royaume de la lumière. Nous ne
sommes donc plus sous la domination de Satan, mais sous la souveraineté de Dieu en
Christ. 2 Corinthiens 5:17 nous dit que "si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
création. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles". Nous sommes de nouvelles créatures. C'est cela que Jésus a voulu dire
lorsqu'il a affirmé que "le royaume de Dieu est au milieu de vous".
4.8.3 Le ciel selon le Catéchisme de l'Église Catholique
Voici ce que dit « La Catéchisme de l'Église Catholique » sur le ciel (no. 1023-1029) :
n° 1023 (4) Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, et qui sont
parfaitement purifiées, vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours
semblables à Dieu, parce qu'ils le voient "tel qu'il est" (1Jn 3,2), face à face (cf. 1Co
13,12 Ap 22,4):
(6) De notre autorité apostolique nous définissons que, d'après la disposition
générale de Dieu, les âmes de tous les saints ... et de tous les autres fidèles morts après
avoir reçu le saint Baptême du Christ, en qui il n'y a rien eu à purifier lorsqu'ils sont
morts, ... ou encore, s'il y a eu ou qu'il y a quelque chose à purifier, lorsque, après leur
mort, elles auront achevé de le faire, ... avant même la résurrection dans leur corps et
le Jugement général, et cela depuis l'Ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
au ciel, ont été, sont et seront au ciel, au Royaume des cieux et au Paradis céleste avec
le Christ, admis dans la société des saints anges. Depuis la Passion et la mort de notre
Seigneur Jésus-Christ, elles ont vu et voient l'essence divine d'une vision intuitive et
même face à face, sans la médiation d'aucune créature (Benoit XII: DS 1000 cf. LG
49).
n° 1024 (9) Cette vie parfaite avec la Très Sainte Trinité, cette communion de vie et
d'amour avec Elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux est appelée
"le ciel". Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de
l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif.
n° 1025 (12) Vivre au ciel c'est "être avec le Christ" (cf. Jn 14,3 Ph 1,23 1Th 4,17).
Les élus vivent "en Lui", mais ils y gardent, mieux, ils y trouvent leur vraie identité,
leur propre nom (cf. Ap 2,17):
(14) Vita est enim esse cum Christo; ideo ubi Christus, ibi vita, ibi regnum (S.
Ambroise, Lc 10,12 ).
n° 1026 (17) Par sa mort et sa Résurrection Jésus-Christ nous a "ouvert" le ciel. La
vie des bienheureux consiste dans la possession en plénitude des fruits de la
rédemption opérée par le Christ qui associe à sa glorification céleste ceux qui ont cru
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 85
en Lui et qui sont demeurés fidèles à sa volonté. Le ciel est la communauté
bienheureuse de tous ceux qui sont parfaitement incorporés à Lui.
n° 1027 (20) Ce mystère de communion bienheureuse avec Dieu et avec tous ceux
qui sont dans le Christ dépasse toute compréhension et toute représentation. L'Ecriture
nous en parle en images: vie, lumière, paix, festin de noces, vin du royaume, maison
du Père, Jérusalem céleste, paradis: "Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas
entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour
ceux qui l'aiment" (1Co 2,9).
n° 1028 (23) A cause de sa transcendance, Dieu ne peut être vu tel qu'Il est que
lorsqu'il ouvre lui-même son Mystère à la contemplation immédiate de l'homme et
qu'Il lui en donne la capacité. Cette contemplation de Dieu dans sa gloire céleste est
appelée par l'Église "la vision béatifique":
(25) Quelle ne sera pas ta gloire et ton bonheur: être admis à voir Dieu, avoir
l'honneur de participer aux joies du salut et de la lumière éternelle dans la compagnie
du Christ le Seigneur ton Dieu, ... jouir au Royaume des cieux dans la compagnie des
justes et des amis de Dieu, les joies de l'immortalité acquise (S. Cyprien, ep. 56,10,1).
n° 1029 (28) Dans la gloire du ciel, les bienheureux continuent d'accomplir avec joie
la volonté de Dieu par rapport aux autres hommes et à la création toute entière. Déjà
ils règnent avec le Christ; avec Lui "ils règneront pour les siècles des siècles" (Ap
22,5 cf. Mt 25,21 25,23).
4.8.4 La mort dans les Traditions Africaines
Devoir : Comment le ciel est perçu dans les Traditions Africaines ou dans ton ethnie ?
Peux-tu comparer la conception du dans la tradition chrétienne et dans ta culture ?
4.9 LE PARADIS
4.9.1 Le Paradis dans la Bible
Le mot paradis figure très peu dans la Bible : Siracide (Ecclésiastique) 24, 30 et Lc
23, 43. Les textes qui sont attribués au paradis sont ceux qui parlent du jardin
(d’Eden) : Qo 2, 5 ; Ct 4, 12 ; Gn 2, 18s ; 3, 8.23 ; 13, 10 ; Ez 31, 8s.16s ; 36, 35 ; Is
51, 3
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 86
4.9.2 Le Paradis dans la Tradition chrétienne
Le paradis, c’est ce que dans le langage ecclésiastique nous appelons « ciel ».
L’enseignement ecclésiastique ne dit pas beaucoup sur le paradis. Pourtant, nous
pouvons résumer cet enseignement en quelques points126
:
1 Nous pouvons accéder directement ou immédiatement au paradis sans passer par le
purgatoire et sans attendre la fin du temps. Le pape Innocent IV en 1254 avait déclaré
« Les âmes des petits enfants qui meurent après le bain du baptême, et celles des
adultes qui meurent en état de charité… passent immédiatement à la patrie éternelle ».
Egalement le seconde concile de Lyon en 1274 avait maintenu « Pour les âmes des
ceux qui, après avoir reçu le saint baptême, n’ont contracté aucune souillure… pour
celles qui après avoir contracté la souillure du péché sont purifiées… elles sont
immédiatement reçues dans le ciel ». Le paradis est une demeure définitive.
Au ciel, les sauvés se réjouissent d’un état béatifique. Ils sont en communion avec
Dieu. Le pape Benoît VI en 1336 disait, « La divine essence se manifeste à eux
immédiatement à nu, clairement et à découvert ». Thomas d’Aquin cite, « nous le
verrons tel qu’il est ».
Il existe des degrés dans le ciel comme dans l’enfer. Pourtant, il n’y a pas des
jalousies. Thomas d’Aquin pensait que le spectacle des damnés en train de souffrir
augmente la béatitude des sauvés. Il maintenait, « pour que les saints, écrit-il,
jouissent davantage de leur béatitude et qu’ils en rendent de meilleures louanges, il
leur est donné de voir parfaitement la souffrance des impurs ». Les sauvés
n’éprouvent aucune compassion pour les damnes. Au contraire, ils réjouissent même
de leur supplice.
St. Athanase le Grand affirme « Jésus nous a ouvert l’entrée du paradis d’où Adam fut
expulsé et où il a de nouveau pénétré dans la personne du larron ainsi que le Seigneur
l’a dit : ‘aujourd’hui même tu seras avec moi dans le paradis’ ». Grégoire de Nysse
disait à Dieu, « Tu nous a chassés du paradis, tu nous y a rappelés » Jean
Chrysostome disait un Vendredi Saint, « Dieu nous ouvrit aujourd’hui le paradis
fermé depuis cinq mille ans et plus. Dieu y introduisit le larron le même jour, â la
même heure ». 127
Emprunté au latin chrétien paradisus (en grec παράδεισος) «parc clos où se trouvent
des animaux sauvages [en parlant des parcs des rois et des nobles]. Le paradis est
(selon [Luc XXIII, 43; 2 Cor. XII, 4]) un «parc, enclos» , un «jardin délicieux» (Cant.
IV, 12). C'est le « séjour des justes » (pareïs) opposé à l'enfer (inferi) (selon ca 1100,
Roland, éd. J. Bédier, 1855, 2396; 1121-35 parais terrestre Philippe de Thaon,
Bestiaire, éd. E. Walberg, 1456) Du persan pairi daiza signifiant jardin clôturé
(Paradiso ou paradeiso en vieux-perse), et du sanskrit "pardis", le paradis ou jardin
126
Cf. André Gounelle et François Vouga, Après la mort qu’y-a-t’il ?, Paris, Les Editions du Cerf,
1990, p. 30-31. 127
Cf. Jean Delumeau, Une histoire du paradis, Paris, Fayard, 1992, p. 45 ; Cf. Athanase, Expositio
fidei, 1, Patr. Gr., t. 25, c. 201 et suiv. ; Grégoire de Nysse, Oratio in baptismum Christi ; Oratio in
Christi resurrectionem, I ; Oratio II in XL Marytres : Patr. Gr., t. 46, c. 600, 617, 772 ; Jeans
Chrysostome, De Cruce et latrone : Patr. Gr., t. 46, c. 401.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 87
d'Éden est un concept important présenté au début de la Bible, dans le livre de la
Genèse. Il a donc un sens particulier pour les religions abrahamiques. Dans un sens
plus élargi, le concept de paradis est présent dans presque toutes les religions. Il
représente souvent le lieu final où les hommes seront récompensés de leur bon
comportement. Les croyants parlent aussi du Royaume de Dieu qui sera manifesté à la
fin du temps.
4.9.3 Le Paradis selon le Catéchisme de l’Eglise Catholique
Voici ce que dit « La Catéchisme de l'Église Catholique » sur le paradis (no. 1053) :
n° 1053 (10) "Nous croyons que la multitude de celles qui sont rassemblées autour de
Jésus et de Marie au Paradis forme l'Église du ciel, où dans l'éternelle béatitude elles
voient Dieu tel qu'il est et où elles sont aussi, à des degrés divers, associées avec les
saints anges au gouvernement divin exercé par le Christ en gloire, en intercédant pour
nous et aidant notre faiblesse par leur sollicitude fraternelle" (SPF 29).
4.9.4 La mort dans les Traditions Africaines
Devoir : Y a-t-il quelque chose comme le paradis dans les traditions Africains ou dans
ton ethnie ? Si oui, Peux-tu comparer la conception du paradis dans la tradition
chrétienne et dans ta culture ?
4.10 LA VIE ETERNELLE
4.10.1 La vie éternelle dans la Bible
La Bible fait 44 fois référence à la vie éternelle. Une fois dans l'Ancien Testament
(Daniel 12:2) et 43 fois dans le Nouveau Testament. L'auteur qui en fait le plus
mention est l'apôtre Jean (17 mentions dans son évangile, 6 dans sa première épître).
L'une de ces références est une définition énoncée par Jésus de la vie éternelle : « Or,
la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17:3).
Voici quelques textes sur la vie éternelle : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Jn 3.16.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 88
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui
m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie. - Jn 5.24.
Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mt 25.46.
Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la
gloire de sa force. - 2 Th 1, 10.
4.10.2 La vie éternelle dans la Tradition chrétienne
St. Augustin nous dit, « Il est plus facile de dire ce que la vie éternelle ne sera pas que
de dire ce qu’elle sera. J’en suis bien sûr, nous ne passerons pas notre temps à
dormir… Toute notre action sera ‘Amen’ et ‘Alléluia’… Ce n’est pas par des sons qui
s’envolent que nous disons Amen et Alléluia, mais pas l’affection du cœur. Que
signifie Amen ? et Alléluia ? Amen signifie ‘C’est vrai’. Alléluia veut dire’ louez
Dieu’. Dieu est la vérité sans changement, sans défaut, sans progrès, sans diminution,
sans augmentation, sans tendance à la fausseté, vérité éternelle, stable,
incorruptible…. Lorsque nous verrons face à face ce que nous ne voyons maintenant
qu’en reflet, alors, d’une manière bien différente, avec un mouvement d’amour
incroyablement différent, nous dirons : ‘c’est vrai’. En parlant ainsi, nous dirons
Amen avec une insatiable satiété… alors nous serons enflammés d’amour pour la
vérité, nous nous attacherons à elle dans une étreinte tout incorporelle, et nous la
louerons et nous dirons alléluia. En s’entraînant les uns les autres à cette louange,
dans un brûlant amour les uns pour les autres, les citoyens de cette cité diront
Alléluia, parce qu’ils diront Amen ».128
Concernant la vie éternelle, Hans Küng pose une question intelligente, « la vie
éternelle, désir ou réalité ? ». La ligne de Feuerbach l’être humain a un désir ou une
aspiration nature au bonheur (desiderium naturae beatitudinis). Un désir ne doit pas
nécessairement correspondre à la réalité. Seulement dans son épilogue, il dit « oui à la
vie éternelle ». Il dit « Credo… in vitam venturi saeculi, Je crois… en la vie du
monde à venir ».129
4.10.3 La vie éternelle selon le Catéchisme de l'Église Catholique
Voici ce que dit « La Catéchisme de l'Église Catholique » sur la vie éternelle (no.
1020 ; Cf. no. 1060) :
Article 12 "Je crois à la vie éternelle"
n° 1020 (4) Le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit la mort comme
une venue vers Lui et une entrée dans la vie éternelle. Lorsque l'Église a dit, pour la
dernière fois, les paroles de pardon de l'absolution du Christ sur le chrétien mourant,
l'a scellé pour la dernière fois d'une onction fortifiante et lui a donné le Christ dans le
viatique comme nourriture pour le voyage, elle lui parle avec une douce assurance:
128
Theo: L’Encyclopédie catholique pour tous, Paris, Droguet-Ardant, 1993, p. 896. 129
Cf. Hans Küng, Vie éternelle ?, Paris, Editions du Seuil, 1985, p. 50, 306.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 89
(6) Quitte ce monde, âme chrétienne, au nom du Père tout-puissant qui t'a créé, au
nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-
Esprit qui a été répandu en toi. Prends ta place aujourd'hui dans la paix, et fixe ta
demeure avec Dieu dans la sainte Sion, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec
saint Joseph, les anges et tous les saints de Dieu ... Retourne auprès de ton Créateur
qui t'a formé de la poussière du sol. Qu'à l'heure où ton âme sortira de ton corps,
Marie, les anges et tous les saints se hâtent à ta rencontre ... Que tu puisses voir ton
Rédempteur face à face ... (OEx "Commendatio animæ").
n° 1060 (31) A la fin des temps, le Royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Alors
les justes règneront avec le Christ pour toujours, glorifiés en corps et en âme, et
l'univers matériel lui-même sera transformé. Dieu sera alors "tout en tous" (1Co
15,28), dans la vie éternelle.
4.10.4 La mort dans les Traditions Africaines
Devoir : Comment la vie éternelle est perçue dans les Traditions Africaines ou dans
ton ethnie ? Peux-tu comparer la conception de la mort dans la tradition chrétienne et
dans ta culture ?
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 90
CONCLUSION
Nous avons approfondi notre connaissance de l’eschatologie. Notre étude de
l’eschatologie a été assez systématique et systémique. Le premier chapitre a analysé la
fondation biblique de l’eschatologie. L’eschatologie dans l’histoire a été traitée dans
le deuxième chapitre. Chapitre trois a regardé les différentes approches de
l’eschatologie. Le dernier chapitre va a analysé les différents éléments de
l’eschatologie : la mort, l’au-delà, la parousie, la résurrection, le jugement, l’enfer, le
purgatoire, le ciel, le paradis, et la vie éternelle. Ce chapitre a analysé la fondation
Biblique des ces éléments et la contribution théologique dans la tradition chrétienne.
En outre, ce chapitre a pris en compte l’enseignement de le Catéchisme Catholique
sur ces éléments. En plus, ce chapitre a creusé la présence de ces éléments de
l’eschatologie dans les cultures Africaines.
La méthode que nous avons utilisée a tenu compte de deux ‘loci theologici’ des
écritures (scriptura) et la tradition apostolique (traditio apostolica). Également, nous
avons pris au sérieux le troisième ‘locus theologicus’ du ‘contexte humain’ (contextus
humanus). Nous avons regardé et évalué dans les Traditions Africaines la présence
des éléments eschatologiques.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 91
QUELQUES QUESTIONS POUR / SUR L’ESCHATOLOGIE
1 L’eschatologie est elle fondée sur la Bible ?
2 Peux-tu analyser la contribution d’Origène dans l’eschatologie ? Y a-
t-il eu des réactions suite à sa contribution ?
3 Peux-tu développer la position d’un Père de l'Église sur
l’eschatologie ?
4 Peux-tu comparer les différences entre les Latins et le Grecs
concernant leur conception de l’eschatologie ?
5 Peux-tu comparer les différences entre les Catholiques et les
Protestants concernant leur conception de l’eschatologie ?
6 Peux-tu analyser les différentes écoles de l’eschatologie ?
7 Y a-t-il des différences entre les conceptions classiques et les
conceptions contemporaines de l’eschatologie ?
8 Que dis-tu sur cette phrase de Karl Barth « Un christianisme qui
n’est pas rigoureusement et absolument eschatologique n’a
rigoureusement et absolument rien de commun avec le Christ » ?
9 Qu’est ce que l’enfer ? Est-il une réalité ? Peux-tu harmoniser
l’existence de Dieu Amour Tout-Puissant et possibilité de la
condamnation de beaucoup (massa damnata) ?
10 Voici quelques éléments de l’eschatologie : la mort, l’au-delà, la
parousie, la résurrection, le Jugement, l’enfer, le Purgatoire, le ciel, le
paradis, et la vie éternelle. Peux-tu comparer la Tradition Chrétienne et
une Tradition Africaine (ou bien ta culture) sur un de ces éléments de
l’eschatologie ?
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 92
BIBLIGRAPHIE
Amigues, M., Le chrétien devant le refus de la mort, Paris, Les
Editions du cerf, 1981.
Antier, G., L’origine qui vient : Une eschatologie chrétienne pour
le XXI siècle, Genève, Editions Labor et Fides, 2010.
Athanase, Expositio fidei, 1, Patr. Gr., t. 25.
Aubert, J., Et après… Vie ou néant?: Essai sur l’au-delà, Paris,
Desclée de Brouwer, 1991.
Augustin, In Ps. 123, 3, trad. Tissot, Saint Augustin maître de vie
spirituelle, Mappus.
Augustin, In Ps. 41, 9, Tissot.
Augustin, La Cité de Dieu, traduction G. Bardy, t. XXXVII, 5e
série, Paris, Edition Desclée de Brouwer, 1960.
Augustin, Sermon, 259, 2, P. L. 38, 1197.
Augustin, Sur l’Evangile de saint Jean, Traité XLIX.
Augustin, Sur le Psaume 37, no. 3 ; P. L., 36.
Balthasar, H. U. von, « Eschatologie », Questions théologiques aujourd’hui,
tome II, traduction Y. C. Gélébart, Paris, Edition
Desclée de Brouwer, 1965.
Balthasar, H. U. von, Espérer pour tous, Paris, Declée de Brouwer, 1987.
Balthasar, H. U. von, L’enfer : Une question, Paris, Desclée de Brouwer,
1988.
Bardy, G. et al., L’enfer, Paris, Les Editions de la Revue des Jeunes,
1950.
Barth, K., L’Epitre aux Romains, traduction P. Jundt, Genève,
Editions Labor et Fides, 1978.
Bertrand, F., Mystique de Jésus chez Origène, coll. « Theologie » no.
23, Paris, Edition Aubier, 1951.
Bevans, S., Models of Contextual Theology, Revised and Expanded
Edition, New York: Orbis Books, 2002.
Bourgeois, H., Je crois à la résurrection du corps, Paris, Desclée,
1981.
Bultmann, R., Histoire et eschatologie, traduction R. Brandt, coll « Foi
vivante » no. 115, Neuchâtel, Ed. Delachaux, 1969.
Cadiou, M. R., La jeunesse d’Origène, Paris, 1936.
Calvin, J., L’Institution chrétienne, livre 3, 5, 6-10, Genève, Labor
et Fides, 1957.
Chareire, I., La résurrection des morts, Paris, Les Editions de
l’Atelier, 1999.
Chrysostome, In Eph. Hom. III.
Chrysostome, J., Homélie XXXI in Epist. Ad Romanos, c. 5; P. G.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 93
Cullmann, O., Christ et le Temps : Temps et histoire dans le
christianisme primitif, Neuchâtel, Edition Delachaux et
Niestle, 1947.
Cyprien de Carthage, « Sur la mort », no. 21, in Le Christ devant la mort,
Paris, DDB, 1980.
Daniélou, J., Essai sur le mystère de l’histoire, Paris, Editions du
Seuil, 1953.
Daniélou, J., La Résurrection, Paris, Le Seuil, 1969.
Daniélou, J., Origène, Paris, Édition la Table ronde, 1948.
Delumeau, J., Une histoire du paradis, Paris, Fayard, 1992.
Denzinger-Schönmetzer, Enchiridium Symbolorum, definitinum et
declarationum, 35è édition, Fribourg-en Brisgau,
Herder, 1973.
Dhorme, P., « l’idée de l’au –delà dans la religion hébraïque », dans
Revue de l’histoire des religions », 1941.
Dhorme, P., « Le séjour des morts chez les Assyriens et les
Babyloniens », dans Rev. Bibl., 1907.
Dodd, C. H., The Parables of the Kingdom, Londres, 1935 ;
l’Interprétation du quatrième évangile, (traduction M.
Montabrut, coll. « Lectio divina », no. 82, Paris,
Éditions du Cerf, 1975.
Dufort, J., A la rencontre du Christ Jésus : Précis d’Eschatologie
chrétienne, Paris, Les Éditions Desclée & Cie..
Durrwell, F., Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris, Mediaspaul,
1994.
Durrwell, F., Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris, Mediaspaul,
1994.
Gleason, R. W., Le monde à venir : Théologie des fins dernières,
traduction, René Mazas et Henri Rondet, Paris, P.
Lethielleux Éditeur, 1960.
Gounelle A. et al., Après la mort qu’y-a-t’il ?, Paris, Les Éditions du Cerf,
1990.
Grégoire de Nysse, Oratio II in XL Marytres : Patr. Gr., t. 46.
Grégoire de Nysse, Oratio in baptismum Christi.
Grégoire de Nysse, Oratio in Christi resurrectionem, I.
Grégoire le Grand, Dialogue, IV, 29 ; P. L., 96.
Grelot, P., Le monde à venir, Paris, Le Centurion, 1974.
Heidegger, M., Being and Time, New York, Harper and Row
Publishers, 1962.
Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre 5, tome II, coll « Sources
chrétiennes » no. 153, Paris, Edition du Cerf, 1969.
Jeans Chrysostome, De Cruce et latrone : Patr. Gr., t. 46.
Justin, Dialogue, V, 3 (Ed. Archambault, Ip. 31).
Küng, H., Vie éternelle ?, Paris, Editions du Seuil, 1985.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 94
Lubac, H. de, Catholicisme : Les aspects sociaux du dogme, 5e
Edition, Paris, 1952.
Lubac, H. de, Histoire et Esprit : L’intelligence de l’Ecriture d’après
Origène, coll. « Théologie », no. 16, Paris, Edition
Aubier, 1950.
Luther, M., Œuvres, t. I, traduction P. Jundt, Genève, Edition Labor
et Fides, 1957.
Manaranche, A., Celui qui vient, Paris, Editions du Seuil, 1976.
Marrou, H. I., Théologie de l’Histoire, Paris, Edition du Seuil, 1968.
Martelet, G., L’au-delà retrouvé : Christologie des fins dernières,
Paris, Desclée, 1974.
Martin Luther, Œuvres, t. VI, traduction Jean Bosc, Genève, Edition
Labor et Fides, 1964.
Médevielle, G., Les fins dernières, Paris, Desclée de Brouwer, 2008.
Minois, G., Histoire de l’enfer, Paris, Presses universitaires de
France, 1994.
Moltmann, J., L'Espérance en action, Paris, Édition du Seuil, 1973.
Moltmann, J., Le Dieu crucifié : La croix du Christ, Fondement et
critique de la théologie chrétienne, traduction B.
Fraigneau-Julien, coll. « Cogitatio Fidei » no. 80,
Paris, Edition Cer-Mame, 1974.
Moltmann, J., Théologie de l’espérance : Études sur les fondements et
les conséquences d’une eschatologie chrétienne, Paris,
Édition Mame-Cerf, 1970.
Monaranche, A., Celui qui vient, Paris, Éditions du Seuil, 1976.
Müssner, F., « Le Christ et la fin du monde », Le Christ devant nous,
traduction A Liefooghe, Paris, Édition Desclée de
Brouwer, 1968, p. 15-17. Il montre que les mots
Nossent, G., « Mort, Immortalité, résurrection », Nouvelle Revue
théologique, juin-juillet 1969.
Oepke, article, « Apokatastasis », dans Theologisches
Wörterbuch zum Neuen Testament (ThWNT), 1, col.
390.
Origène, Adv. Haer., V.
Origène, Coll. « Les Moralistes chrétiens », p. 99-100, et D. T.
C., t. XI, 1547.
Origène, Comment. A Rom. 7, 5.
Origène, De resurrectione, I, 22, Ed. Bonwetsch, 1917..
Origène, Des principes, II, 10, 4-5 ; P. G., II, 236-238, trad.
Bardy.
Origène, Homélie 7 sur le Lévitique, note 2, Edition Baehrens.
Origène, In Ps. I, 5 ; P. G., 12, 1093 A – 1096 B.
Pannenberg, W., Esquisse d’une christologie, Paris, Cerf, 1971.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 95
Pascal, B., Lettre à M. et Mme Périer : Œuvres complètes, Paris,
Pléiade.
Perrot, C. et al., Le retour du Christ, Bruxelles, Facultés universitaires
Saint-Louis, 1983.
Philippe, P., Le Royaume des cieux, Paris, Librairie Arthème Fayard,
1976.
Rahner, K., « Autour du concept de l’avenir », Écrits théologique
no. 10, traduction R. Givord, Paris, Édition Desclée de
Brouwer, 1970.
Rahner, K., « La vie des morts », Écrits théologiques, no. 9,
traduction R. Givord, Paris, Édition Desclée de
Brouwer, 1968.
Rahner, K., « La vie des morts », Ecrits théologiques, no. 9,
traduction R. Givord, Paris, Edition Desclée de
Brouwer, 1968.
Rahner, K., « Pour une théologie de la mort», Ecrits théologiques,
no. 3, traduction G. Daoust, Paris, Edition Desclée du
Brouwer, 1963.
Rahner, K., « Principes théologiques relatifs à l’herméneutique des
affirmations eschatologiques », Ecrit théologiques, no.
9, traduction R. Givord, Paris, Edition de Brouwer,
1968.
Rahner, R., « Death », dans Sacramentum Mundi, T. 2, London,
Burns & Oats, 1960.
Ratzinger, J., La mort et l’au-delà: Court traité d’espérance
chrétienne, trad. Henri Rochais, Paris, Librairie
Arthème Fayard, 1979.
Rondet, H., Fins de l’homme et fin du monde, Paris, Librairie
Arthème Fayard, 1966.
Sesboüé, B., La résurrection et la vie : Petite catéchèse sur les
choses de la fin, Paris, Desclée de Brouwer, 1990.
Stein, E., La science de la croix, Louvain, Nauwelaerts, 1957.
Tertullien, « Contre Marcion », 3, 24 ; P. L. 2.
Tertullien, Apologeticum, no. 48, trad. Turmel.
Tertullien, Corpus christianorum, t. II, p. 930-932, 1003, trad.
Turmel.
Tertullien, La résurrection de la chair, L IX, P.L. 2, 807 ab,
traduction. J. Moingt..
Tertullien, Sur la résurrection des corps, no. 7-9.
Thomas d’Aquin, Compendium Theologiae, Paris, Revue Thomiste, 2009.
Thomas d’Aquin, Contre le Gentils, livre IV, c. 79, trad. Bernier et
Kerouanton, Lethielleux, 1957.
Eschatologie: L’au-delà de l’au-deçà, W. Gobbo, M. Afr. CFMA, 2012/13 96
Thomas, L. et al., Réincarnation, immortalité, résurrection, Bruxelles,
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis,
1988.
Troisfointaines, R., « …j’entre dans la vie », Paris, Editions universitaires,
1963
Troisfointaines, R., « Je ne meurs pas… », Paris, Editions universitaires,
1960.
Varillon, F., Conférences, Pau, Publication B. Housset, Octobre
1976.
Vögtle, A., Das Neue Testamentes und die Zukunft des Kosmos,
Düsseldorf, 1970.
XXX, Catéchisme de l'Église Catholique, Paris, Edition de
Cerf, 1998.
XXX, Theo: L'Encyclopédie catholique pour tous, Paris,
Droguet-Ardant, 1993.