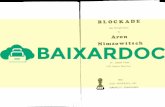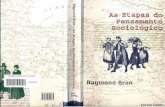Entre désir d'engagement et passion de l'indépendance. L'itinéraire politique singulier de...
-
Upload
univ-rennes1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Entre désir d'engagement et passion de l'indépendance. L'itinéraire politique singulier de...
1
Entre désir d’engagement et passion de l’indépendance.L’itinéraire politique singulier
de Raymond Aron
« La mission de celui qu’on a nommé "l’intellectuel" est en uncertain sens opposé à celle du politicien. L’œuvre de l’intellectuelaspire – souvent en vain – à éclaircir un peu les choses, tandis quecelle du politicien consiste souvent à les rendre plus confuses. »
José Ortega y Gasset
Depuis l’invention du terme en France, lors de l’affaire Dreyfus, on a pris l’habitudede définir l’« intellectuel » par son opposition aux pouvoirs en général et au pouvoir politiqueen particulier. L’intellectuel, entendu comme un savant qui critique le pouvoir d’Etat au nomde la vérité, serait ainsi l’incarnation parfaite de l’idéal alinien du « citoyen contre lespouvoirs1 ». Bien que très répandue, cette définition est cependant trop restrictive : elle sefocalise en effet sur un engagement uniquement protestataire qui ne permet pas de rendrecompte de tous les positionnements s’offrant aux savants désireux de s’engager dans les luttesdu forum.Les typologies les plus rigoureuses insistent sur l’existence de deux pôles fondamentaux : lacritique et la légitimation du pouvoir. Gérard Noiriel isole par exemple trois figures del’intellectuel : l’« intellectuel révolutionnaire » (devenu, avec le déclin du marxisme, un« intellectuel radical »), l’« intellectuel de gouvernement » et l’« intellectuel spécifique2 ».Ces trois figures s’ordonnent en fait autour de la polarité initiale : « intellectuelrévolutionnaire » et « intellectuel spécifique » du côté de la critique du pouvoir ; « intellectuelde gouvernement » du côté de sa légitimation.Pour Gérard Noiriel en effet, l’« intellectuel de gouvernement » se distingue des deuxpremiers idéaux types de trois manières : il se positionne au centre (gauche ou droit) del’échiquier politique ; il prend part au débat public en mobilisant son savoir pour tenter derépondre aux problèmes tels qu’ils sont posés par les journalistes et les hommes politiques ;dans ce but, il met sur pied des revues permettant de faire travailler ensemble les différentesfractions de l’élite3.
Cette polarité est au cœur des analyses émanant du courant qui domine actuellementen France l’étude des intellectuels, courant qui puise largement son inspiration dans lasociologie critique de Pierre Bourdieu. Cette sociohistoire des intellectuels ne s’embarrassepas toujours des nuances qu’introduit Gérard Noiriel : alors qu’il tente à titre personnel de se
1 Alain, Le citoyen contre les pouvoirs, Slatkine Reprints, 1979 (1926).2 Gérard Noiriel, Les fils maudits de la République. L’avenir des intellectuels en France, Fayard, 2005.3 Gérard Noiriel, « "Dire la vérité au pouvoir au nom des opprimés" », Agone. Histoire, politique et sociologie,n°41/42, 2009, p. 209.
2
rapprocher de l’idéal type de l’« intellectuel spécifique », il considère en effet qu’au XXesiècle, « ce sont peut-être les intellectuels de gouvernement qui ont rendu le plus de servicesau peuple4 ».Beaucoup de spécialistes de cette école rangent ainsi tous ceux qui ne relèvent pas descatégories – jugées nécessairement nobles – de l’« intellectuel critique » ou de l’« intellectuelspécifique » dans celles – jugées par essence infamantes – du « conseiller du Prince » ou du« gardien de l’ordre moralisateur5 ». En dépit des exhortations répétées au respect de laneutralité axiologique, la sociohistoire française des intellectuels confond en effetfréquemment analyse scientifique et combat politique : l’« intellectuel de gouvernement », endérogeant à l’impératif catégorique de dénonciation, aurait trahi une corporation dont lamission serait de dévoiler les mystifications de l’oligarchie politicienne.C’est le procès qui a souvent été fait à Raymond Aron : on ne compte plus les livres leprésentant comme l’un des principaux inspirateurs, sinon le grand ancêtre, de la « révolutionconservatrice6 » actuelle ou de la « pensée tiède7 ». Il aurait été l’incarnation parfaite del’intellectuel conservateur, de l’idéologue qui légitime et soutien le pouvoir ou encore ledéfenseur acharné de l’ordre néolibéral établi. Bref, l’image inversée de l’intellectuelauthentique – qu’il soit « révolutionnaire », « critique » ou « spécifique ».Dernier exemple en date de ce procès : l’analyse proposée par Didier Eribon. Il décrit en effetRaymond Aron comme l’archétype de l’« intellectuel de pouvoir » uniquement animé par le« ressentiment », la « rancœur » et la « haine » de « l’intellectuel critique » :
« Raymond Aron n’est que la désignation métonymique du bagage politique que ses livres véhiculaient,de l’univers mental qu’il incarnait, de la figure – ô combien laide ! – de l’intellectuel au service dupouvoir et de l’ordre établi à laquelle son image renvoie, c’est-à-dire de toute une tradition de la penséede droite opposée à la pensée critique, aux intellectuels de gauche, aux mouvements sociaux (etnotamment, bien sûr, aux mobilisations et manifestations publiques du mouvement ouvrier). Al’intellectuel critique qui pense et agit en se situant du côté des gouvernés et de leurs mobilisationss’oppose depuis toujours l’intellectuel qui agit et fait croire qu’il pense (quand il réagit à ceux quipensent) en se situant du côté des gouvernants8. »
L’auteur élargit ensuite sa critique aux « bavardages pseudo-philosophiques de ceux quiprétendaient revenir à la "démocratie" en promouvant la pensée principiellement anti-démocratique de Raymond Aron9 ». Résumons le réquisitoire qui tient en trois propositions :Raymond Aron a trahi la corporation en devenant l’idéologue en chef de la droite d’après-guerre ; cette trahison s’explique par une « haine de classe » dont il hérite en raison de son
4 Ibidem, p. 213.5 Gisèle Sapiro, « Modèles d’intervention politique des intellectuels. Le cas français », Actes de la recherche ensciences sociales, n°176-177, 2009, notamment p. 17-21.6 Didier Eribon, D’une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française, Léo Scheer, 2007.7 Perry Anderson, La pensée tiède. Un regard critique sur la culture française, Seuil, 2005. L’auteur évoquecertes Raymond Aron à deux reprises comme un esprit lucide et pénétrant (p. 36 et 97), mais il est clair qu’il leconsidère comme l’un des inspirateurs du front antitotalitaire dont il s’emploie à dénoncer la vacuité.8 Didier Eribon, D’une révolution conservatrice…, op. cit., p. 91.9 Ibidem, p. 97.
3
appartenance à la bourgeoisie10 ; il est donc devenu un faux intellectuel, un intellectuel ensecond, qui n’a existé que par son opposition aux vrais intellectuels, c’est-à-dire lesintellectuels de gauche.
Cette pseudo-analyse sociologique peut sembler pour le moins rapide, voirecaricaturale. Elle prolonge pourtant fidèlement, sur un mode plus directement polémique,celle qu’a formulée Pierre Bourdieu lui-même. Dans Les règles de l’art, ce dernier range eneffet Raymond Aron parmi les « intellectuels conservateurs issus de la grande bourgeoisie etreconnus par elle », ceci après l’avoir décrit comme un « intellectuel de droite » diffuseurd’une « littérature d’inspiration technocratique » qui a participé à la production de l’idéologiedominante11. Pierre Bourdieu le décrit encore comme l’archétype de l’intellectuel qui feint de« prendre des distances avec le conservatisme primaire, mais pour mieux le retrouver auterme de la polémique contre les "intellectuels de gauche"12 ».Dans ce livre consacré à l’étude du « champ littéraire », la « science des œuvres » quepropose Pierre Bourdieu aborde à plusieurs reprises la question du « champ intellectuel ». Or,il est clair que les analyses relationnistes de l’intellectuel conservateur qu’il développe sont depart en part hantées par la figure de son ancien « patron13 ». C’est particulièrement évidentdans la note intitulée « Effet de champ et formes de conservatisme ».Le sociologue y décrit des intellectuels conservateurs luttant simultanément sur deux fronts :en tant qu’intellectuels, ils cherchent à se distinguer de ceux qui les dominent dans le « champdu pouvoir » ; en tant que conservateurs, ils combattent les intellectuels de gauche qu’ilsdominent par leurs positions dans le « champ intellectuel ». Cette situation entraîne deuxconséquences : leur concurrence avec les dominants dans le champ du pouvoir les oblige à« se distinguer de toutes les formes de conservatisme de premier degré14 » ; leur concurrenceavec les dominés dans le champ intellectuel les amène à « réduire à l’absurde, parl’explicitation agressivement conséquente des ultimes conséquences, les thèses combattues »,et donc à « donner des leçons de réalisme politique, et de bon sens15 ».En somme, ils sont « et par leur position et par leur trajectoire, le lieu d’intentions politiquesopposées, contradictoires » qui les conduisent à « prendre position sur chaque prise de
10 Il écrit ainsi que « l’anti-marxisme de Raymond Aron était lié à son hostilité au mouvement ouvrier, et cequ’on décrit aujourd’hui comme sa lucidité ne fut que l’effet d’une appartenance sociale et politique et de lahaine de classe qui faisait corps avec elle (…) » (Ibidem, p. 136.). Notons au passage que cette supposée « hainede classe » génère en retour un sentiment similaire chez Didier Eribon, comme le révèlent plusieurs passages trèsviolents de son autobiographie socioanalytique. Cf. Didier Eribon, Retour à Reims, Fayard, 2009, notamment p.100-101.11 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, 1998 (1992), p. 317 et 364.Cf. également Luc Boltanski et Pierre Bourdieu, « La production de l’idéologie dominante », Actes de larecherche en sciences sociales, n°2, 1976, p. 3-73.12 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, op. cit., p. 365.13 Pour tenter de cerner les liens complexes existants entre ces deux clercs, on peut se reporter à leursautobiographies respectives : Raymond Aron, Mémoires. Cinquante ans de réflexion politique, Julliard, PressPocket, 1990 (1983), notamment p. 484 et 1038 ; Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse, Raisonsd’agir, 2004, p. 38 et surtout p. 47-50.14 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, op. cit., p. 457.15 Idem. C’est nous qui soulignons.
4
position politique à partir d’une autre position, reprochant à la gauche de n’avoir pas larigueur de la droite, à la droite de manquer de l’intelligence généreuse de la gauche16 ». Voilàpourquoi ils « excellent dans un usage polémique des apparences de l’objectivité, identifiée àune sorte de neutralisme qui prétend renvoyer dos à dos la droite et la gauche en renvoyant àchacune l’image que l’autre en a ou devrait en avoir17 ». Voilà pourquoi ils s’épuisent « àtenter de réunir l’intellectuel et l’homme d’action, le savant et le politique, au péril de n’êtrejamais ni l’un ni l’autre, et d’être et de se sentir étrangers, et suspects, aux uns et auxautres18 ». Triste destin, donc, que celui de l’intellectuel conservateur, dont il semble bien quel’analyse soit tout entière construite autour de la figure de Raymond Aron.
Cette analyse est désormais très répandue. Elle doit néanmoins, comme toute doxa,être interrogée. Il est inutile de s’arrêter sur les erreurs d’interprétation de la pensée aroniennequ’elle véhicule, dues tantôt à la paresse intellectuelle, tantôt à la mauvaise foi : quiconque apris la peine de lire sérieusement Raymond Aron sait qu’il a toujours défendu la démocratie etqu’il est faux de réduire sa pensée à une forme plus ou moins élaborée de conservatisme19.Christophe Prochasson a dénoncé avec raison l’erreur grossière à laquelle conduit, dans soncas, « l’usage paresseux des identités idéologiques20 ».Que la pensée de Raymond Aron ait été enfermée dans un carcan idéologique, par sesadmirateurs de droite comme par ses adversaires de gauche, est certain. Mais elle n’en restepas moins, comme l’ont noté récemment des chercheurs issus d’une génération délivrée desœillères imposées par la Guerre froide, « une pensée qui se voulait pluraliste, non dogmatiqueet ouverte à la complexité21 ». Cela rend d’autant plus nécessaire de rompre avec le cliché quifait de lui l’idéologue d’une contre-révolution néolibérale ou néoconservatrice.Dans cet article, on propose donc de revenir sur un itinéraire politique atypique. Cecheminement à travers le court XXe siècle nous permettra de mettre en évidence l’originalitéde son parcours, mais aussi la singularité de son rapport au pouvoir politique. On setromperait, en effet, à le décrire comme un simple conseiller du prince. Comme Jean-LouisMissika et Dominique Wolton l’ont noté, il a en effet constamment « refusé d’être lié aupouvoir même quand il le soutenait » et il n’a « jamais accepté ce qu’il faut de révérence et deréserve pour être un véritable "conseiller du prince"22 ».Pour comprendre la position qui fut la sienne, on reviendra sur les principaux engagementsqui ont jalonné l’itinéraire du « spectateur engagé ». Pour ce faire, on s’arrêtera sur plusieursmoments-clés de l’histoire politique française : l’entre-deux-guerres, avec notammentl’épisode du Front populaire (1) ; la période gaulliste que l’on peut scinder en deux phases :
16 Ibidem, p. 458.17 Idem.18 Idem.19 Cf. Serge Audier, Raymond Aron. La démocratie conflictuelle, Michalon, 2004.20 Christophe Prochasson, « Raymond Aron est-il un intellectuel de gauche ? », dans Serge Audier, Marc-OlivierBaruch et Perrine Simon-Nahum (dir.), Raymond Aron, philosophe dans l’Histoire, Ed. de Fallois, 2008, p. 219.21 Serge Audier, Marc-Olivier Baruch et Perrine Simon-Nahum, « Aron aujourd’hui », ibidem., p. 7.22 Jean-Louis Missika et Dominique Wolton, « Introduction », dans Raymond Aron, Le spectateur engagé, LeLivre de Poche, 2004 (1981), p. 23 et 24.
5
celle du gaullisme de guerre et d’opposition (2) et celle du gaullisme de gouvernement (3) ; lapériode postgaulliste avec l’interlude pompidolien et les débuts du giscardisme (4) ; la montéeen puissance de l’Union de la gauche et les débuts du socialisme de gouvernement (5). Achaque étape, on prendra soin de replacer ses différentes prises de position dans leur contexteet on constatera ainsi, au terme de ce parcours, que le monde réel est souvent beaucoup moinssimple que le monde construit par certaines écoles sociologiques.
1. Un jeune socialiste critique du Front populaire
Raymond Aron a commencé son itinéraire politique à gauche. Durant les années vingt,il est à la fois proche du pacifisme d’Alain et de la SFIO – il adhère en 1926 à la FédérationNationale des Etudiants Socialistes23. Il est donc logique que le jeune agrégé de philosophieen vienne à s’intéresser au marxisme : sa lecture du Capital, au début des années trente, est àl’origine d’une passion qui ne le quittera plus, et ceci en dépit des critiques qu’il adressera trèsvite au marxisme. En 1932, il estime certes que « l’asservissement des consciences aumarxisme est déplaisant », mais tout en s’indignant plus fortement encore de « la perpétuellehypocrisie ou naïveté de la politique bourgeoise24 ». Très rapidement, il va abandonner sesconvictions pacifistes : lecteur de français en Allemagne de 1930 à 1933, il est le spectateurhorrifié de la montée du nazisme. Il comprend alors que l’Histoire impose parfois d’assumerle risque de la guerre et que le pacifisme intégral est vain25.Obsédé par la guerre qui se profile, déstabilisé dans son adhésion au socialisme par l’étude del’économie politique, Raymond Aron se situe pourtant toujours à gauche durant les annéessuivantes. En 1936, il vote pour le Front populaire, mais il entretient de sérieux doutes sur unprogramme économique qui risque selon lui de conduire cette expérience à l’échec. Il partagecette inquiétude avec son ami Robert Marjolin, qui tente à de multiples reprises d’alerter legouvernement Blum26, comme avec Alfred Sauvy et le groupe X-Crise. Par contre, il décidede ne pas adhérer au Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes pour deux raisons : ilne croit pas que la France soit menacée par un authentique danger fasciste ; il ne se retrouveni dans les positions des communistes, ni dans celles des pacifistes.
Une fois l’expérience du Front populaire achevée, il décide de publier une tentatived’explication de l’échec et confie ce premier article politico-économique à la Revue demétaphysique et de morale. Deux raisons motivent le choix d’une revue de philosophie : ilpense qu’une revue politique de gauche le refuserait, mais surtout il n’entend pas donner prise
23 Pour une analyse détaillée des engagements aroniens durant ces années, cf. Jean-François Sirinelli, Sartre etAron, deux intellectuels dans le siècle, Hachette, 1995.24 Raymond Aron, « Lettre d’Allemagne », Libres propos, février 1932.25 Raymond Aron, « Réflexions sur le "pacifisme intégral" », Libres propos, février 1933.26 Entre 1936 et 1938, Robert Marjolin est chargé de mission au Secrétariat général à la Présidence du Conseil. Ilsemble que Raymond Aron ait, lui aussi, écrit une lettre à Léon Blum qui est restée sans réponse. Cf. RaymondAron, Le spectateur engagé, op. cit., p. 64. Il faut ici noter que Raymond Aron et Robert Marjolin ont donnéensemble un cours d’économie politique à l’Ecole Normale Supérieure en 1936 ou 1937.
6
à une récupération politique. Il exècre en effet aussi bien la droite réactionnaire que l’extrêmedroite antisémite de l’époque.Dans ce texte, il pointe deux erreurs qui ont selon lui entraîné l’échec du gouvernementBlum : le refus de la dévaluation du franc et la loi des quarante heures27. Il montre toutd’abord qu’une dévaluation limitée était inévitable et qu’elle est intervenue beaucoup troptard. Il montre ensuite qu’il fallait éviter à tout prix de faire une application stricte et rigidedes 40 heures, sous peine d’empêcher la reprise. En somme, il explique que les socialistes sesont condamnés à l’échec politique par inconséquence économique.S’il estime que la situation de 1936 est largement imputable aux erreurs des gouvernementsde droite précédents, s’il reconnaît que la législation sociale française était alors très en retardet qu’elle appelait une réforme, il reste que le programme économique du Front populaire l’aconduit à n’être qu’une occasion manquée. C’est pourquoi il considère que le ministèreChautemps doit revenir partiellement sur l’œuvre de Blum, en prenant « des mesuresdésagréables et impopulaires » comme l’assouplissement des lois sociales28. Et il estcondamné à réussir, sous peine de laisser la place soit à un gouvernement collectiviste, soit àun gouvernement de réaction, ce qui, dans les deux cas, conduirait la France vers la guerrecivile.
Raymond Aron apparaît ainsi, à la fin des années trente, comme un socialiste quiaccepte un minimum de problématique libérale en économie. Il n’est plus, comme en 1931,fasciné par le planisme d’Henri de Man29. En mars 1938, il ouvre encore sa soutenance dethèse par ces mots : « Pourquoi suis-je socialiste ? ». Mais à la même époque, il se passionnedéjà pour l’œuvre du penseur libéral Elie Halévy, qu’il a fréquenté avant sa mort30. Cet intérêtprécoce pour la pensée libérale est également révélé par un épisode qui a été passé soussilence par Raymond Aron et ses biographes, et qui est désormais bien documenté : lecolloque Walter Lippmann de 193831.En août 1938, Raymond Aron est en effet le secrétaire de ce colloque organisé par LouisRougier à Paris. Il réunit autour du columnist américain, qui vient de publier un livre intituléLa Cité libre, plusieurs théoriciens du néolibéralisme naissant : Ludwig von Mises, Friedrichvon Hayek, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow ou encore Jacques Rueff. Raymond Aron semontre alors très intéressé par la perspective d’une reformulation du libéralisme qui passe parune critique du libéralisme manchestérien. Durant ce colloque, il se situe en effet dans lecamp des participants les plus favorables à l’intervention de l’Etat, sur la « ligne » proposéepar Lippmann.
27 Raymond Aron, « Réflexions sur les problèmes économiques français », Revue de métaphysique et de morale,vol. XLIV, n°4, novembre 1937, p. 793-822. Repris dans Commentaire, n°28-29, février 1985, p. 312-326.28 Ibidem, p. 323.29 Raymond Aron, « De Man, Au-delà du marxisme », Libres propos, janvier 1931.30 C’est d’ailleurs chez lui qu’il a rencontré le théoricien italien du socialisme libéral, Carlo Rosseli.31 Cf. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Gallimard/Seuil, 2004 ; François Denord, Néo-libéralisme,version française. Histoire d’une idéologie politique, Demopolis, 2007 ; et surtout Serge Audier, Le colloqueLippmann. Aux origines du néo-libéralisme, Le Bord de l’eau, 2008.
7
Quelques mois plus tôt, dans sa thèse de doctorat, Aron soutenait que tout engagementpolitique s’élabore sur la base d’un choix premier entre la réforme et la révolution32. A laveille de la guerre, il se positionne clairement à gauche, dans le camp des réformistes, mais ils’autorise néanmoins à critiquer la première expérience socialiste menée en France et il nes’interdit pas de participer aux premiers efforts de reformulation du libéralisme. RaymondAron revendique en effet, dès son article de 1937, le point de vue de l’« observateurimpartial » contre celui de « l’intellectuel partisan33 » : l’engagement politique ne doit pasempêcher l’indépendance d’esprit ni nuire à la liberté de critique. En 1939, Raymond Aronappartient désormais à une gauche socialiste, fermement anticommuniste, qui connaît etaccepte les mécanismes de l’économie capitaliste. Il ne semble donc plus très loin de celuiqu’il sera après la guerre : un penseur libéral se plaçant, pour reprendre l’heureuse formule deSerge Audier, « dans la perspective d’un réformisme raisonné faisant droit aux exigences dejustice sociale34 ».
2. Du critique du gaullisme de guerre au compagnon de route du gaullismed’opposition
Raymond Aron s’exile à Londres en juin 1940. Il se rapproche rapidement dumouvement gaulliste, mais sans s’y rallier. Entre 1940 et 1945, il écrit des articles politiquesdans une revue intellectuelle influente : La France Libre35. Créée par un membre de l’état-major du général de Gaulle venu de la gauche, André Labarthe36, elle est à l’origine un organegaulliste. Mais elle va rapidement conquérir son indépendance, au point d’être regardée avecsuspicion par l’entourage du Général.
Cette défiance n’est pas sans lien avec les positions qu’y développe Raymond Aron. Ils’y singularise en effet par des prises de position qui ne correspondent pas à la propagandegaulliste : il accepte par exemple l’Armistice et, jusqu’en novembre 1942, il ne rejette pascatégoriquement Vichy. Il estime que l’Armistice permet d’atténuer les souffrances desFrançais et il espère que les fonctionnaires et les militaires reviendront du côté des Alliésaprès leur débarquement, qu’il prévoit en Afrique du Nord. En somme, il veut laisser la porteouverte aux attentistes qui souhaiteraient reprendre le combat dans des circonstances plusfavorables. On retrouve ici ce qui fut l’obsession de Raymond Aron, ce qui constitueprobablement l’une des clés permettant de comprendre son itinéraire politique : la recherchede l’unité nationale et la crainte de la guerre civile.
32 Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique,Gallimard, 1986 (1938).33 Raymond Aron, « Réflexions sur les problèmes économiques français », op. cit., p. 312.34 Serge Audier, Raymond Aron. La démocratie conflictuelle, op. cit., p. 14.35 Cf. les articles réunis dans Raymond Aron, Chroniques de guerre. « La France libre », 1940-1945, Gallimard,1990.36 Il a notamment été membre du cabinet de Pierre Cot dans le gouvernement de Front populaire.
8
Une autre raison explique sa distance vis-à-vis du gaullisme de guerre. Il est en effet très irritépar « le culte de la personnalité », le « fanatisme gaullien ou gaulliste » qui s’est mis en placetrès rapidement à Londres37. En août 1943, il a d’ailleurs attiré l’attention, dans un texte auxallusions transparentes, sur le danger bonapartiste qui menace la France. L’article, intitulé« L’ombre des Bonaparte », apparaît alors doublement scandaleux : Raymond Aron y définitle bonapartisme comme « la version française du fascisme » et il y explique qu’« à longueéchéance, le bonapartisme s’est toujours révélé une catastrophe pour le pays », car « loind’unir réellement les groupes et les partis, il laisse subsister, en les camouflant pour un temps,toutes les divisions et se borne à superposer l’arbitraire au chaos38 ». On ne s’étonnera pas quel’entourage du Général n’ait guère apprécié une telle analyse.Il est donc pour le moins paradoxal que cette période se termine par la participation deRaymond Aron à un éphémère gouvernement gaulliste : il accepte en effet, apparemment paramitié pour André Malraux, de devenir son directeur de cabinet au ministère de l’Informationentre novembre 1945 et janvier 1946. Mais en dépit de ce bref épisode, il reste qu’entre 1940et 1947, Raymond Aron se singularise par la « proximité distante » qu’il entretient vis-à-visdu gaullisme.Son attachement au gaullisme de guerre ne l’a d’ailleurs pas conduit à renier son engagementsocialisant. C’est ce dont semble témoigner un article publié en 1945 dans Les TempsModernes et consacré à « la chance du socialisme ». On peut y lire ces lignes : « L’ascensiondu parti socialiste a peut-être une signification plus large encore ; héritier tout à la fois duparti radical et des vieux rêves chiliastes, il a pour mission d’introduire dans la sociétéfrançaise les éléments de socialisme, direction de l’économie par l’Etat sous l’influence desmasses populaires, qu’elle peut assimiler tout en recueillant le libéralisme intellectuel etpersonnel que la France ne se résigne pas à sacrifier39. » Raymond Aron, qui devient aussiéditorialiste à Combat, l’un des plus brillants périodiques de gauche issu de la Résistance,défend donc la synthèse démocratico-libérale, un compromis entre la critique whig et lacritique socialiste40 qui constituera pour lui, au moins jusqu’au milieu des années soixante-dix, le régime le plus satisfaisant ou le moins insatisfaisant41.
Cependant, le positionnement de Raymond Aron va connaître une évolutionspectaculaire, puisqu’il va militer intensément entre 1947 et 1953 au Rassemblement duPeuple Français (RPF) : il siègera même à son Conseil national. Pourquoi Raymond Aron,dont la sensibilité politique le rapproche de la Troisième Force, s’engage-t-il aux côtés du
37 Raymond Aron, Le spectateur engagé, op. cit., p. 119.38 Raymond Aron, « L’ombre des Bonaparte », La France libre, août 1943. Repris dans Chroniques de guerre,op. cit., p. 775.39 Raymond Aron, « La chance du socialisme », Les Temps modernes, n°2, 1945, p. 235. C’est nous quisoulignons.40 Cette conviction sera argumentée au début de la décennie soixante dans un livre auquel il tenait toutparticulièrement, son Essai sur les libertés (Calmann-Lévy, 1965).41 Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à Gwendal Châton, « De l’optimisme au pessimisme ?Réflexions sur l’évolution tardive du libéralisme de Raymond Aron », Serge Audier, Marc-Olivier Baruch etPerrine Simon-Nahum (dir.), Raymond Aron, philosophe dans l’Histoire, op. cit., p. 205-217.
9
Général ? Comment expliquer cette « parenthèse militante » d’un intellectuel jaloux de sonindépendance à l’égard des partis ?Raymond Aron fournit quatre explications : la mauvaise conscience de ne pas s’être rallié aumouvement gaulliste, surtout après novembre 1942, et le regret de ses critiques vis-à-vis duGénéral ; le rejet de la Constitution de la IVe République, l’instabilité ministérielle qui lacaractérise ralentissant le relèvement français ; le fait que cette période corresponde aumoment où le gaullisme est le plus parlementaire ; l’anticommunisme du RPF – nous sommesalors au tout début de la Guerre froide42.Aron était pourtant en désaccord avec la ligne du RPF sur beaucoup de points : il était trèssceptique vis-à-vis de « l’association capital-travail », il ne partageait pas la méfiancegaulliste à l’égard de l’Allemagne, et surtout il était clairement atlantiste et proaméricain. Saposition est bien résumée en 1948 dans Le Grand Schisme : il soutient la possibilité d’ungaullisme modéré, sorte de bonapartisme démocratique, alors que beaucoup craignent unedérive autoritaire en cas d’arrivée au pouvoir du Général43. Ce gaullisme modéré permettraitselon lui d’en finir avec une IVe République impuissante.Devenu militant, Raymond Aron a même songé à entamer une carrière politique en seprésentant aux élections législatives de juin 1951 à Paris. Finalement, ce ne sera pas le cas,mais ce projet permet de comprendre que cette parenthèse militante doit être prise très ausérieux : l’observateur qui se voulait « impartial » en 1937 est devenu un authentique« spectateur engagé ». Mais il n’a pas pour autant revêtu le costume étouffant del’« intellectuel de parti » : il conserve en effet, dans ses articles de Liberté de l’esprit ou seséditoriaux du Figaro, une complète indépendance vis-à-vis des positions officielles du RPF.
Raymond Aron est entré au Figaro en 1947, l’année de la fondation du RPF. On saitqu’il a longuement hésité entre Le Monde et Le Figaro. Contrairement à ce que l’on ditsouvent, le choix de ce dernier n’est cependant pas un choix idéologique : à cette époque, ledirecteur du Figaro, Pierre Brisson, vote d’ailleurs socialiste. De ce point de vue, laprésentation du nouvel éditorialiste par ce dernier est très éclairante :
« Dans le temps où nous vivons, cette philosophie de l’Histoire à laquelle il se consacrait ramèneinvinciblement et à tout instant vers les problèmes du monde encore informe surgi de nos malheurs.Raymond Aron apporte à leur examen une lucidité, un savoir qui lui ont rapidement valu une autoritéexceptionnelle. Il y apporte surtout une indépendance qui nous est chère. Ennemi de toutes lesoppressions : sociales, politiques ou capitalistes, il est de ceux pour qui la démocratie est autre chosequ’un appât électoral, un mensonge asiatique ou une commodité pour l’oligarchie des affaires44. »
Cette appartenance au RPF et cette collaboration au Figaro seront à l’origine de sa réputationd’intellectuel de droite. Ceci d’autant qu’il officialisera de manière fracassante, en 1955 dansL’opium des intellectuels, sa rupture avec la gauche intellectuelle45. Notons cependant que 42 Raymond Aron, Le spectateur engagé, op. cit., p. 223-225.43 Raymond Aron, Le Grand Schisme, Gallimard, 1948.44 Le Figaro, 19 juin 1947. C’est nous qui soulignons.45 Raymond Arion, L’opium des intellectuels, Hachette, 2002 (1955).
10
dans son esprit, cette rupture avec la gauche intellectuelle – en fait Sartre et Merleau-Ponty –n’est pas une rupture avec les valeurs de la gauche. Il déclarait ainsi, au soir de sa vie, ceci :« Personnellement, je suis plutôt un aronien de gauche que de droite. (…) Cela veut dire quej’ai conservé probablement le système de valeur de la gauche, des socialistes, mais unscepticisme profond sur les moyens que les socialistes jugent opportun d’utiliser46. »
Critique du gaullisme à Londres, Raymond Aron est devenu un gaulliste militantquand le Général a quitté le pouvoir, mais sans pour autant renoncer à son indépendanced’esprit et à sa liberté de ton. De ce constat découle une nouvelle question : a-t-il été, entre1958 et 1969, un « compagnon de route » du gaullisme de gouvernement ? On peut tenter d’yrépondre en examinant deux moments-clés : le retour au pouvoir du Général en mai 1958 et larésolution du problème algérien ; les « événements » de Mai 1968.
3. Raymond Aron, censeur du gaullisme de gouvernement
Raymond Aron est d’emblée très critique sur les conditions d’arrivée au pouvoir duGénéral. Dans Le spectateur engagé, il écrit qu’« il eût été souhaitable que de Gaulle revînt aupouvoir à froid, plutôt qu’à la limite du coup d’Etat », à quoi il ajoute que cela l’alittéralement « indigné47 ». Les dernières pages de Démocratie et totalitarisme, issues d’uncours professé le 19 mai 1958 en pleine crise politique, portent la trace des interrogationsaroniennes : tout en expliquant qu’elle était probablement inévitable, il espère que « du malactuel un bien sortira48 ». Sept ans plus tard, il compare ce « coup d’Etat légal » à celui qui aporté au pouvoir le Maréchal Pétain, puisque de Gaulle a été investi par l’Assembléenationale après un vote contraint49. Dans ses Mémoires, il évoque encore l’humiliation qu’areprésentée pour lui « la capitulation de l’Assemblée nationale en 1958 devant la sédition desforces armées et la menace des prétoriens50 ».Cependant, l’urgence de la situation, qui appelle à trouver une solution rapide au problèmealgérien, le fait rapidement abandonner ses préventions. On sait qu’il a pris position très tôt,dès 1957, pour l’indépendance de l’Algérie51. Or, il considère que de Gaulle est le seulhomme ayant quelques chances de clore ce triste chapitre de l’histoire nationale. Dès juillet1958, lorsqu’il écrit L’Algérie et la République, il explique que le retour au pouvoir duGénéral donnera lieu à l’établissement d’une « monarchie semi-parlementaire » permettantpeut-être de résoudre le problème algérien. Mais cet espoir ne l’empêche pas de critiquerparfois très durement la politique suivie par de Gaulle. Entre 1958 et 1962, il s’en prend àplusieurs reprises dans Preuves à la lenteur du processus gaulliste et à la stratégie de
46 Yann Coudé du Foresto, « Conversation avec Raymond Aron (4 février 1983) », Pouvoirs, n°28, 1983, p. 175.47 Raymond Aron, Le spectateur engagé, op. cit., p. 229 et 282.48 Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Gallimard, 1965, p. 370.49 Raymond Aron, « Introduction » (1965), ibidem, p. 10.50 Raymond Aron, Mémoires, op. cit., p. 328.51 Raymond Aron, La tragédie algérienne, Plon, 1957 ; Raymond Aron, L’Algérie et la République, Plon, 1958.
11
négociation choisie52. Après l’indépendance de l’Algérie, il sera encore l’un des critiques lesplus virulents de la diplomatie gaulliste. Il n’a jamais adhéré à la focalisation gaullienne surl’indépendance de la France ni à son corollaire : l’opposition symétrique au capitalismeaméricain et au communisme soviétique53.
Face à Mai 1968, sa position a été plus complexe qu’on ne le dit souvent. S’il a soutenude Gaulle, il a aussi exprimé très clairement une critique acérée d’un gaullisme qu’il jugeaitexcessivement autoritaire54. On la trouve parfaitement résumée dans un éditorial du 10 juin1968. Dans ses « Propos pour adultes », il explique en effet que le gaullisme doitimpérativement modifier son mode d’exercice du pouvoir :
« Le gaullisme, tel qu’il a régné jusqu’au mois de mai 1968, est mort, victime du "naufrage de lavieillesse", victime de sa contradiction interne, trop libéral pour ce qu’il avait d’autoritaire, tropautoritaire pour ce qu’il avait de libéral. Victorieux demain, il aurait peut-être l’illusion de la puissance,mais s’il succombait à cette illusion, les sombres prophéties de Tocqueville, au soir du 25 février 1848,retrouveraient une tragique actualité : ou le gaullisme consent à une mutation, ou il perdra ce qu’il avaitde libéral et, par le durcissement, préparera un affrontement, déjà préfiguré mais non encoreinévitable55. »
La crainte qui hante Raymond Aron est donc bien que l’immobilisme du régime gaullisteouvre, par autisme politique, sur une crise encore plus dangereuse pour le pays.Cette critique est davantage développée dans La révolution introuvable, un livre qu’il dicte enquelques matinées à l’été 1968. Dans un chapitre intitulé « Mort et résurrection dugaullisme », il insiste sur les responsabilités du gaullisme dans le déclenchement de la crise. Ilpointe tout d’abord la politique économique menée par Georges Pompidou, qui a engendréune hausse des inégalités et une crainte du chômage inconnue depuis 1945, ainsi que lapolitique monétaire du franc fort voulue par de Gaulle. Il incrimine ensuite un moded’exercice du pouvoir qui se caractérise par une centralisation bureaucratique renforcée, parune mise au pas excessive du Parlement, par une colonisation des postes politiques par deshauts fonctionnaires enclins à l’autoritarisme, et par un certain mépris gaullien du peuple.Ceci le conduit à condamner fermement la pratique gaulliste des institutions :
« Le général de Gaulle a donc obtenu le résultat qu’il voulait : condamner la France à être cent pourcent gaulliste ou à s’éparpiller en morceaux. La crise de mai a surgi dans un régime fondé à ce point surla magie d’un homme qu’avec le charisme du chef, tout s’effondrait, société comme Etat. Aux élections
52 Cf. par exemple Raymond Aron, « Présomption », Preuves, n°117, 1960, p. 3-10 ; et surtout « Adieu augaullisme », Preuves, n°128, 1961, p. 3-16.53 Cf. par exemple Raymond Aron, Mémoires, op. cit., p. 602 et 622.54 Rappelons aussi qu’il a proposé dès 1969 de prendre au sérieux les critiques portées par Mai 1968 pour opérerune « extension du libéralisme », par le biais d’une « récupération libérale des revendications libertaires,partiellement réalisables », in Raymond Aron, « Liberté, libérale ou libertaire ? », dans Keba M’Baye (dir.), Laliberté et l’ordre social, Ed. La Baconnière, 1969. Repris dans Raymond Aron, Les sociétés modernes, PUF,2006, p. 698-699.55 Raymond Aron, « Propos pour adultes », Le Figaro, 10 juin 1968. Repris dans Raymond Aron, Penser laliberté, penser la démocratie, Gallimard, 2005, p. 733. C’est nous qui soulignons.
12
de juin, les Français ont été condamnés par le général de Gaulle à se déclarer cent pour cent gaullistesparce que l’autre terme de l’alternative, ils l’avaient reconnu, au mois de mai, n’était autre que le videabsolu. Ainsi le régime gaulliste est responsable à la fois de sa mort et de sa résurrection, de sonécroulement et de son triomphe. Le péril qu’il porte en lui pour le pays est apparu en mai, maisprécisément parce que le péril prit figure d’une catastrophe, la majorité a préféré choisir l’autre terme del’alternative56. »
Raymond Aron déplore l’affaiblissement de la démocratie française par son incarnation dansun chef : d’une certaine manière, il revient à sa critique libérale de 1943 qui visait ladimension bonapartiste du gaullisme. C’est la raison pour laquelle il considère que « lesvainqueurs sont aussi des vaincus parce que, dans cette histoire sans vrais vainqueurs, il y aun vaincu : la France tout entière57 ». La France, par la faute du Général, est de nouveauhantée par le spectre de la division.Dans le chapitre suivant, intitulé « Gaullistes et intellectuels en mal d’une révolution », ilexplique ensuite que la France est entrée dans un régime de « parti prédominant ouhégémonique », évolution « qui ne va pas sans dangers58 ». Le gaullisme, en effet, n’a pas suse réformer en tirant les leçons de l’événement :
« J’avais l’espoir – mais un espoir fragile – que le nouveau gaullisme accepterait une des leçons del’explosion de Mai. Non seulement la leçon économique : il ne faut pas imposer au pays une pressionsupérieure à celle que la masse des Français consent à tolérer, mais une leçon politique : il ne faut pasdonner l’impression de monopoliser le pouvoir et ses bénéfices. Il ne faut pas traiter avec mépris lesFrançais et avec d’autant plus de mépris qu’on prétend aimer davantage la France. Il ne faut pas ignorerceux qui ne sont pas représentés directement dans le parti au pouvoir. Il faut parler aux Français non-gaullistes comme s’ils étaient d’aussi bons Français que les autres59. »
Pour Raymond Aron, ce n’est pas le thème gaullien de la « participation » qui doit focaliserl’attention des gaullistes : il le juge vide de tout contenu. Il faut qu’ils consentent à unevéritable révolution culturelle afin de renouer avec « les traditions de dialogue et decommunication qui renvoient à la IIIe et à la IVe Républiques si méprisées60 ». Evidemment,Raymond Aron est bien conscient du fait que « le Général ne changera jamais de style61 ».C’est pourquoi il estime que « le gaullisme de demain, s’il veut survivre à la personne duGénéral, devrait apprendre ou réapprendre un langage acceptable aux non-gaullistes ou auxantigaullistes62 ». Néanmoins, Aron se montre très pessimiste à court terme, car « la réactiondu général de Gaulle et des siens aux événements a de quoi décourager les meilleures
56 Raymond Aron, La révolution introuvable. Réflexions sur les événements de Mai, Fayard, 1968. Repris dansRaymond Aron, Penser la liberté, penser la démocratie, op. cit., p. 675.57 Ibidem, p. 681.58 Ibidem, p. 701.59 Ibidem, p. 702.60 Ibidem, p. 703.61 Ibidem, p. 702.62 Idem.
13
volontés63 ». Ce qui l’amène à conclure son livre en se demandant si « l’aventure d’un hommes’achèvera […] en tragédie d’une nation64 ».
Contrairement à une légende tenace, Raymond Aron n’a donc rien fait pour devenir leconseiller du Prince. Deux raisons expliquent probablement cette distance. La première estqu’il était parfaitement conscient du fait que de Gaulle n’a jamais souhaité être conseillé65. Laseconde est que tout conseiller du prince doit transiger avec ses convictions pour être écouté,et peut-être entendu, exigence à laquelle il n’entendait pas se plier. En conséquence, il futconsidéré par l’entourage du Général, dans les dernières années du gaullisme, comme l’un desplus farouches opposants au régime.
4. Un soutien critique au postgaullisme
En 1969, Raymond Aron intervient pour la première fois directement dans unecampagne électorale : il prend clairement position pour Georges Pompidou. Deux raisons lemotivent alors. Il estime tout d’abord que Pompidou a géré Mai 1968 en homme d’Etat, etqu’il est donc mieux armé qu’Alain Poher pour réussir la routinisation du charisme gaullien.Il pense ensuite que Pompidou a compris la nécessité de « libéraliser » le gaullisme. En unmot, Pompidou lui semble être celui qui saura à la fois maintenir l’unité nationale etpoursuivre la modernisation de la France. On pourrait donc croire que l’avènement dupostgaullisme a correspondu à un rapprochement de Raymond Aron avec le pouvoir. Mais iln’en est rien : il a simplement perdu sa réputation d’adversaire acharné. Après les« événements », il retrouve une fois de plus la position de soutien critique du pouvoir –ni intellectuel d’opposition, ni intellectuel de parti, ni conseiller du Prince – qui constituedésormais sa marque de fabrique.En 1972, la signature d’un Programme commun de gouvernement (Pcg) entre le Partisocialiste, le Parti radical et le Parti communiste va cependant le rapprocher un peu plus dupouvoir pompidolien. Durant la campagne pour les législatives de 1973, il publie dans LeFigaro une critique sévère du Pcg. L’idée générale qui structure cet article est la même quecelle qu’il a développée en 1937 : les moyens projetés par l’Union de la gauche ne luipermettront pas de parvenir à ses fins. Il s’en prend notamment, comme en 1937, à unprogramme de nationalisations qu’il juge totalement inadéquat : il serait, au mieux, inefficaceau plan économique. Il dénonce avec vigueur le « cercle carré » qu’entend dessiner la gaucheunie, car il est impossible de « multiplier les dépenses, spolier les actionnaires, nationaliser lecrédit et, en même temps, maintenir le taux de croissance et poursuivre la constructioneuropéenne66 ».
63 Ibidem, p. 719.64 Ibidem, p. 720.65 En politique intérieure et en politique étrangère en tout cas. Car on connaît par exemple le rôle décisif joué, àcertaines périodes, par Jacques Rueff dans le domaine économique.66 Raymond Aron, « Le programme commun de la gauche ou le cercle carré », Le Figaro, 8 février 1973. Reprisdans Commentaire, n°28-29, op. cit., p. 488.
14
Cette dénonciation du Pcg est précieuse pour la majorité, car elle lui fournit d’excellentsarguments pour sa campagne. Mais au même moment, Raymond Aron n’hésite pas à critiquerla politique de Pompidou sur plusieurs points, ce qui est moins souvent relevé. De sa tribunedu Figaro, il intervient encore à deux reprises dans la campagne de 1973. Il réitère alors deuxcritiques dorénavant classiques : la première vise la perpétuation du style autoritaire dugaullisme, qui conduit à l’affaiblissement du Parlement ; la seconde porte sur la prolongationd’une politique étrangère trop favorable à l’URSS et qui conduit au renforcement du PCF67. Al’issue de cette campagne, les élections de mars 1973 écartent momentanément l’hypothèsed’une cohabitation, mais le PCF maintient ses positions et le PS progresse sensiblement. D’oùla volonté aronienne de poursuivre le combat pour l’élection présidentielle de 1974,provoquée par la disparition brutale de Georges Pompidou.
En 1974, la dégradation de la situation économique et l’évolution du contexteinternational conduisent Raymond Aron à s’engager en faveur du candidat de la « deuxièmedroite » : Valéry Giscard d’Estaing. A la veille du second tour, dans Le Figaro, il agite lespectre du « collectivisme » en expliquant que « le programme commun annonce moins uneréforme de la société qu’une autre société que les Français, en immense majorité, refuseraients’ils la voyaient telle qu’elle serait68 ». Par rejet du Pcg, il s’engage pour le candidat centriste,se sentant plus proche de l’orléanisme qu’il incarne que d’un gaullisme usé. On pourraitpenser que l’accession au pouvoir de la famille libérale a eu pour effet mécanique detransformer Raymond Aron en conseiller du prince. Tel n’est pourtant pas le cas : ValéryGiscard d’Estaing ne sera pas plus épargné que ses prédécesseurs par la plume acérée duprofesseur du Figaro.Raymond Aron publie par exemple, au lendemain de l’élection, un éditorial dans lequel ilconseille au nouveau Président de « se demander si le langage, la manière qui lui ont permisd’accéder à l’Elysée, la combinaison d’intelligence éclatante et de généralités sans contenudéfini suffiront pour rassembler et gouverner les Français69 ». Il entreprend également trèsvite la critique de la politique étrangère giscardienne, qui présente selon lui deux défauts : sesaxes ne font que prolonger la diplomatie gaulliste ; son style « décontracté » est totalementinadapté au contexte. En 1975, dans un article intitulé « Une jungle sans monstres », il décritainsi un Président qui, « à la différence du général de Gaulle formé par la culture historiqued’avant 1914, ne semble pas conscient du tragique propre aux relations entre Etats70 ». Eneffet, le nouvel occupant de l’Elysée « traite des affaires extérieures non en Machiavel maisen économiste, voire en naïf par volonté71 ». À quoi il ajoute cette sentence définitive :« Ministre des finances quasi permanent de la Ve République, il a risqué ses premiers pas
67 Raymond Aron, « La majorité en question : la carte forcée », Le Figaro, 13 février 1973 ; « Les enjeux », LeFigaro, 15 février 1973.68 Raymond Aron, « Le choix », Le Figaro, 15 mai 1974. Repris dans Commentaire, n°28-29, op. cit., p. 496.69 Raymond Aron, « Le choix d’une équipe », Le Figaro, 22 mai 1974.70 Raymond Aron, « Une jungle sans monstres », Le Figaro, 10 janvier 1975.71 Idem.
15
dans la jungle des Etats avec sa désinvolture coutumière et il n’a pas rencontré de monstresfroids. Souhaitons pour lui et pour nous qu’il n’y fasse jamais de mauvaises rencontres72. »
Après 1969, Raymond Aron a donc soutenu les droites au pouvoir, mais sans sacrifierson indépendance et sans ménager leurs chefs. Il a ainsi maintenu une position de soutiencritique qui l’a notamment conduit à s’en prendre sévèrement au « pouvoir ami73 » qui s’estinstallé en 1974, mais dont la naïveté en politique étrangère, dans un contexte de rupture del’équilibre stratégique, lui semblait coupable. Entre 1978 et 1981, il défendra néanmoins plusactivement que jamais la droite libérale contre les assauts répétés de l’Union de la gauche,avant de devenir pour la première fois, en 1981, un intellectuel d’opposition.
5. L’ultime bataille contre le « socialisme introuvable »
A l’approche des législatives de mars 1978, la gauche est donnée largement favorite.La rupture de l’Union de la gauche, en septembre 1977, ne suffit pas à rassurer RaymondAron et ses proches. En 1976-1978, le milieu aronien est en effet saisi d’une « grande peur »que résume bien le sociologue Jean Baechler :
« En 1978, là, oui, on a eu franchement peur, parce que tout de même, c’était la gauche pure et dure,c’était Georges Marchais. La fin du communisme n’était pas à l’ordre du jour. Et on a eu vraiment lesentiment que là, le sort de la France allait se jouer. Raymond Aron a publié une série d’articles qui ontprobablement eu une influence. Il m’a dit : "C’est peut-être la seule fois dans ma vie où un de mes écrits apesé sur l’événement." C’est plausible. Pour moi, ce fut la seule fois dans ma vie où j’ai envisagé lapossibilité de ne pas mourir en France, d’être obligé de m’exiler. Et je n’étais pas le seul : je ne suis pasparticulièrement peureux ou pessimiste74. »
Rien d’étonnant donc, à ce que Raymond Aron déploie une intense activité politique àl’automne 1977 et à l’hiver 1978. Il va ainsi publier coup sur coup deux livres de combat : unouvrage de vulgarisation qui se veut un Plaidoyer pour l’Europe décadente et une brochurepolitique intitulée Les élections de mars et la Ve République.Dans son Plaidoyer publié en 1977, il explique vouloir atteindre deux buts : convaincre lesEuropéens de leur supériorité économique et idéologique, et les éloigner de la « tentationtotalitaire ». La conclusion de ce livre, qui mérite d’être longuement citée, révèle l’importanceaccordée aux élections à venir, car il y met clairement en garde les lecteurs – et électeurs –Français :
72 Idem.73 Raymond Aron, Mémoires, op. cit., p. 795.74 Entretien, 8 novembre 2005. Précisons que les « aroniens » ne forment pas un groupe soudé autour d’unedoctrine : il s’agit avant tout d’une mouvance qui regroupe des amis partageant une acceptation du pluralisme,un rejet vis-à-vis du communisme, et se retrouvant dans la plupart des positions politiques de Raymond Aron.Par-delà ces points communs, ils se répartissent politiquement entre la gauche, le centre et la droite. Le « noyaudur » de cette mouvance est constitué à cette époque de Jean Baechler, Alain Besançon, François Bourricaud,Jean-Claude Casanova, Marc Fumaroli, Pierre Hassner, Pierre Kende, Annie Kriegel, Pierre Manent, KostasPapaïoannou et Dominique Schnapper.
16
« La France, par sa position géopolitique, par son potentiel moral plus encore qu’économique, (…)déterminera en une large mesure la survie de la Communauté européenne et atlantique, elle prendra,en 1978, une décision probablement historique. Ou bien la coalition socialiste-communiste l’emporteraet, en cette hypothèse, le pays entrera dans une de ces périodes de troubles dont il garde le mystérieuxsecret. Le programme, établi par les socialistes-communistes, exclut, pendant des années, laparticipation franche à l’ensemble européo-atlantique dans lequel s’est opérée la mutation de notreéconomie. Il ne s’agit pas des intentions de François Mitterrand et de ses compagnons mais desconséquences prévisibles de leur projet. Le socialisme qu’ils proposent n’existe nulle part et n’existerajamais. (...) Ce que les socialistes n’ont pas encore compris – les communistes eux l’ont compris –, c’estque la décision prioritaire, pour chaque pays, n’est pas nationale mais internationale : à quel marchémondial veux-tu appartenir et je te dirais qui tu es. Cette contrainte, François Mitterrand et MichelRocard la méconnaissent, les socialistes de gauche et le parti communiste comptent sur elle pourpousser le parti socialiste là où ses chefs ne souhaitent pas les conduire. Si, en revanche, la majoritél’emporte en 1978, peut-être le parti socialiste finira-t-il enfin par comprendre qu’il y a une place pourlui dans un gouvernement du centre gauche ; peut-être la majorité comprendra-t-elle enfin qu’il fautsurmonter l’actuelle confrontation entre deux blocs et deux modèles de société. (…) Alors que, detoutes parts, les communautés locales, les personnes aspirent à la libéralisation, les socialistes, parignorance, et les communistes, par calcul, veulent rendre le pouvoir "plus étendu encore et plus détaillé"que celui qu’exerça aucune de nos républiques. Quel prix faudra-t-il donc payer pour dissuader lesFrançais de partir à la recherche d’un socialisme introuvable75 ? »
La brochure consacrée aux élections, publiée à la fin du mois de janvier 1978, constitue uneultime tentative pour influencer les électeurs français. Sans dramatiser à outrance l’enjeu, iltient néanmoins à rappeler les nombreuses incertitudes que font naître ces élections car, « auxides de mars, le régime politique, lui aussi, joue son avenir76 ». Il regrette notamment que faceà une crise qui nécessite « des vertus tout opposées », les Français soient tentés de se tournervers un « conservatisme [qui] se drape sous les oripeaux d’une idéologie vieillie dusocialisme », un réflexe qui relève de « la répugnance aux aléas et aux contraintes du marché,enracinée au fond des Français77 ». Le ton se fait parfois très vif : il décrit le Pcg comme une« escroquerie » qui présente « un changement de régime comme une réplique à nosproblèmes », ou encore comme une tromperie qui introduit « subtilement des réformes bientôtincompatibles avec la société libérale que l’immense majorité des Français souhaitentconserver78 ».A cette date, Raymond Aron ne craint donc pas seulement que la victoire de la gaucheaboutisse rapidement à renforcer les effets délétères de la crise économique. Il s’inquiète plusfondamentalement d’une déstabilisation du bloc occidental, et ceci dans un contexteinternational qui est de plus en plus tendu : on commence alors à parler de « nouvelle Guerrefroide ». Son angoisse est ainsi que l’application du Pcg et la pression des communistes surles socialistes conduisent à une sortie de la France du Marché commun, et ensuite à sa« finlandisation » voire, pire encore, à son basculement dans le bloc de l’Est.
75 Raymond Aron, Plaidoyer pour l’Europe décadente, Hachette, 1977, p. 550-551. C’est nous qui soulignons.76 Raymond Aron, Les élections de mars et la Ve République, Julliard, 1978, p. 11.77 Ibidem, p. 22-23.78 Ibidem, p. 85-86. Souligné par l’auteur.
17
Quelques semaines auparavant, au début du mois de janvier 1978, paraît avec retard lepremier numéro d’une nouvelle revue baptisée Commentaire. Dirigée par Jean-ClaudeCasanova, elle entend défendre les couleurs du libéralisme aronien dans un contexte marquépar les incertitudes. C’est d’ailleurs le thème qui est choisi par Raymond Aron pour l’articlequi ouvre ce premier numéro et qui se conclut ainsi : « si le PS va au bout de son programmepour obtenir les voix communistes au deuxième tour ou la participation communiste augouvernement, la France vivra des années de troubles, peut-être révolutionnaires, peut-êtredespotiques79 ». Il interviendra encore sur ce sujet dans les colonnes de L’Express, qu’il arejoint après son départ du Figaro en 1977, mais à cette date, l’essentiel a été dit80.On retrouve enfin Raymond Aron au sein d’un regroupement d’intellectuels baptisé Comitédes Intellectuels pour l’Europe des Libertés (CIEL) : il en assure, avec Eugène Ionesco, lepatronage. Le 27 janvier 1978, le CIEL publie dans Le Monde un manifeste à tonalité libéraleintitulé « La culture contre le totalitarisme. La liberté ne se négocie pas81. » Ce texte vaagréger, autour d’un noyau dur aronien, une centaine de signatures, dont celles de grandsnoms de l’intelligentsia de gauche comme Claude Mauriac, Jean-Marie Domenach, JeanLacouture, Edgar Morin, Philippe Sollers ou Julia Kristeva82. Tous ne savent pas qu’ilsadhèrent, en fait, à une très habile opération de manipulation politique.Dans le sillage de la publication en 1974 de L’Archipel du Goulag, l’émergence d’un frontantitotalitaire réunissant des intellectuels de gauche et de droite dans l’opposition aucommunisme est en train de se préciser. C’est le moment choisi par Jean-Claude Casanova,qui est au centre de la mouvance aronienne mais aussi au cœur de la machine giscardienne,pour mettre sur pied le CIEL. Cet aronien de la première heure, le seul qui succombera àplusieurs reprises à la tentation politique, est officiellement le conseiller pour l’enseignementsupérieur du Premier ministre Raymond Barre. Mais il est en fait l’un de ses plus prochesconseillers politiques et également un proche du Président qui travaille, entre autres, à lapréparation des élections. Il explique ainsi que c’est lui, de son bureau de Matignon, qui piloteet finance les activités de ce comité : « Non seulement j’ai participé au CIEL, mais c’est moiqui l’ai fait faire et fait financer. Alain Ravennes [son président] était payé sur fonds secrets.C’est une manipulation politique, c’est une opération politique anti-Mitterrand. Nous l’avonsaidé intellectuellement et financièrement, parce que cela faisait partie du combat politique83. »
Activisme éditorial, fondation de Commentaire, mise sur pied du CIEL : RaymondAron et les aroniens sont présents, en ce mois de janvier 1978, sur tous les fronts. Cetinvestissement sera récompensé, car les élections législatives de 1978 aboutissent, à lasurprise générale, à une victoire de la majorité.
79 Raymond Aron, « Incertitudes françaises », Commentaire, n°1, janvier 1978, p. 15.80 Cf. les éditoriaux repris dans Raymond Aron, De Giscard à Mitterrand, 1977-1983, Ed. de Fallois, 2005.81 « La culture contre le totalitarisme », Le Monde, 27 janvier 1978.82 Cf. Michael Christofferson, Les intellectuels contre la gauche. L’idéologie antitotalitaire en France (1968-1981), Agone, 2009, p. 356-357.83 Entretien, 10 novembre 2005.
18
Dans les trois années qui suivent, Raymond Aron soutient la politique de rigueur menéedepuis 1976 par Raymond Barre : bien que peu populaire et socialement coûteuse, elle luiapparaît comme étant la seule possible84. Mais cette adhésion à la politique économique de lamajorité n’empêche pas qu’il appelle de ses vœux, plus intensément que jamais, une politiqueétrangère plus ferme face au nouvel « hégémonisme soviétique » sur lequel il attire l’attentiondans Commentaire dès 197985.En 1981, Raymond Aron prend une dernière fois position en faveur du président sortantcontre Jacques Chirac et François Mitterrand : le programme économique du leader gaullistelui apparaît « aussi inconsistant que celui de Mitterrand », puisqu’il ne fait que combiner« quelques thèmes du néolibéralisme avec le volontarisme politique86 ». Raymond Aronréitère certes sa critique de la politique étrangère giscardienne, mais il juge néanmoins que leprésident sortant demeure le meilleur candidat dans le contexte d’un nouvel « hégémonismesoviétique » :
« Ni les gaullistes ni les socialistes alliés au PC ne sont qualifiés pour donner des leçons de fermetéantisoviétique. Giscard conserve l’héritage gaulliste sur ce sujet ; du moins s’est-il rapproché des Etats-Unis et a-t-il pris conscience du danger. J’espère et je crois que le candidat sortant se fait, désormais,une idée plus juste des oligarques moscoutaires. Les messages transmis à Moscou sur les conséquencesd’une intervention militaire en Pologne ont été, sur son insistance, plus précis et plus rigoureux. Plusque nos partenaires européens, il a augmenté le budget militaire. Plus que tout autre, grâce à sesrelations avec le chancelier Schmidt, il peut prévenir une dérive dangereuse de l’opinion allemande. Jene vois pas pour la France, au cours des années prochaines, un président préférable au présidentsortant87. »
A la veille du second tour, il met une dernière fois en garde l’opinion sur le danger quereprésente le « socialisme introuvable », tout en appelant la droite à l’entente88. On sait cequ’il advint : François Mitterrand conquiert la charge suprême en se donnant pour objectif la« rupture avec le capitalisme ».
En conséquence, Raymond Aron considère que la mission des libéraux est maintenantde « contenir le socialisme89 ». En effet, s’il concède que Valéry Giscard d’Estaing afinalement « concentré, le pouvoir entre ses mains tout autant que Pompidou et plus encoreque le général », il espère cependant que « les nouveaux [maîtres] n’abuseront pas plus deleur pouvoir que le firent les maîtres d’hier90 ». En 1981, devenu un intellectuel d’opposition,
84 Cf. par exemple Raymond Aron, « De Rueff à Barre », L’Express, 8-14 mai 1978 ; « La politique Barre, ouquelle autre ? », L’Express, 3-9 mars 1979 ; « La politique Barre : leçons d’un débat », L’Express, 8 avril 1979 ;« La critique est aisée », L’Express, 1-7 septembre 1979 ; « Barre par lui-même », L’Express, 20-26 septembre1980.85 Raymond Aron, « De l’impérialisme américain à l’hégémonisme soviétique », Commentaire, n°5, printemps1979 ; « L’hégémonisme soviétique : An I », Commentaire, n°11, automne 1980.86 Raymond Aron, « La campagne en clair-obscur », L’Express, 28 mars-3 avril 1981.87 Idem.88 Raymond Aron, « Nos actes nous suivent », L’Express, 5-11 mai 1981.89 Raymond Aron, « Contenir le socialisme », L’Express, 12-18 juin 1981.90 Raymond Aron, Le spectateur engagé, op. cit., p. 460.
19
il se décrit comme « isolé et opposant », ce qui est selon lui « le destin d’un authentiquelibéral91 ». Le propos est partiellement vrai, mais inutilement pathétique : tandis qu’il scruterales débuts du socialisme de gouvernement de sa tribune de l’Express92, les aroniens réunisautour de Commentaire s’emploieront à aiguiser le tranchant de la pensée libérale93.
Raymond Aron, penseur réaliste atypique
Arrivé au terme de ce parcours, on peut revenir à la critique politique qui sous-tendl’analyse de Pierre Bourdieu et toutes celles qui s’en inspirent. Raymond Aron a-t-il été unintellectuel conservateur qui opposait un réalisme de droite à l’utopisme de la gauche ? A-t-ilété l’un des théoriciens du grand rollback néolibéral ? A-t-il été le porte-drapeau de l’anti-intellectualisme en délivrant, sur la base d’un bon sens exaltant le réel, un plaidoyer pour lestatu quo ? A-t-il alimenté la bonne conscience de la droite en jouant le rôle de mauvaiseconscience de la gauche ?
L’itinéraire qui vient d’être retracé incite à répondre à ces questions de manière trèsnuancée. De l’entre-deux-guerres au milieu des années 1970, Raymond Aron a maintenu uneposition d’intellectuel engagé sans pour autant devenir un « intellectuel de pouvoir » ou un« conseiller du Prince ». Il s’est situé, suivant les enjeux, tantôt à gauche (Etat Providence,décolonisation), tantôt à droite (anticommunisme, atlantisme) de l’échiquier politique, et il n’aépargné aucun des pouvoirs successifs, même ceux qu’il a soutenus. Ce n’est qu’au milieu desannées 1970 qu’il décide de soutenir plus fermement la droite libérale au pouvoir, mais cesoutien renforcé doit être remis dans son contexte pour être correctement saisi.Le positionnement de Raymond Aron en politique intérieure est alors fondé sur une analysede la situation internationale. Depuis les années trente, il insère toujours ses prises de positionen politique intérieure dans une analyse plus générale du contexte géopolitique. Or, il apparaîtde plus en plus inquiet, comme on l’a vu, d’une rupture de l’équilibre stratégique et d’unnouvel hégémonisme soviétique. Il n’est d’ailleurs pas le seul : c’est aussi le cas de penseursde gauche importants, comme Cornélius Castoriadis qui forge à cette époque le concept de« statocratie » pour décrire l’emprise de l’armée sur le système politique soviétique94.Cette situation rend donc dangereuse l’alliance du Parti socialiste avec le Parti communiste.La crainte qui monte, à droite comme dans une partie de la gauche, est que la participation descommunistes à un gouvernement socialiste et la mise en œuvre du Pcg n’entraînent, à terme,une sortie de la France du bloc occidental. Rétrospectivement, il est aisé de juger cette crainteexcessive, mais il faut se garder de tout anachronisme : le fait même qu’elle soit partagée pardes intellectuels de droite et de gauche rappelle qu’elle n’était pas le simple fantasme d’un
91 Ibidem, p. 465.92 Cf. Raymond Aron, De Giscard à Mitterrand, op. cit., p. 683-860.93 Le lecteur intéressé par cette question pourra se reporter à notre thèse : Gwendal Châton, La liberté retrouvée.Une histoire du libéralisme politique en France à travers les revues aroniennes Contrepoint et Commentaire,Université Rennes I, 2006.94 Cornélius Castodiaris, Devant la guerre, Fayard, 1981.
20
groupe d’anticommunistes primaires. Cette crainte a d’ailleurs perduré jusqu’au départ desministres communistes du gouvernement95.Le soutien donné par Raymond Aron, entre 1976 et 1981, au couple Giscard-Barre tient doncen grande partie au contexte : au-delà de son appréciation globalement positive de la gestionde la crise économique par ce tandem, il estime qu’il faut tout faire pour empêcher lebasculement de la France dans une ère d’incertitude qui risquerait de déstabiliser l’ensembledu camp occidental. Son positionnement n’est donc pas prioritairement inspiré par sonlibéralisme ou son supposé conservatisme, mais par une analyse réaliste du contexte nationalet international.
On retrouve ici l’argument avancé par Pierre Bourdieu : le réalisme ne serait en faitqu’une idéologie conservatrice. Si l’on étudie les réalistes classiques, c’est effectivementsouvent le cas. Mais le réalisme aronien se distingue nettement de cette tradition. On peut eneffet soutenir, avec Alessandro Campi, que la démarche aronienne a « contribué à éliminerl’hypothèque conservatrice, voire réactionnaire, qui a toujours pesé sur la tradition duréalisme politique96 ». La spécificité du réalisme aronien est justement qu’il constitue « uneforme de critique du pouvoir en place, quel qu’il soit », qu’il débouche sur « une théoriecritique, et comme telle désacralisante vis-à-vis de n’importe quel régime, idéologie oumodèle d’organisation politique97 ».Les sceptiques pourraient alors objecter que Raymond Aron a toujours défendu le libéralismeet la démocratie représentative. Mais cela reviendrait à oublier deux choses : il a critiqué trèstôt le libéralisme dogmatique, celui de Friedrich Hayek par exemple, qu’il ne jugeait possibleque dans le cadre d’un régime autoritaire98 ; il a défendu la démocratie libérale avec passion,mais sans exclure que, « dans des circonstances données », le totalitarisme puisse lui être« préférable99 ». Contre les terribles simplificateurs qui analysent les positions politiques
95 Sur ce point, on lira avec profit les pages que Michael Christofferson consacre aux réactions du mondeintellectuel face aux déclarations faites par Claude Cheysson après la proclamation de l’état de siège en Pologne,en décembre 1981 (Michael Christofferson, op. cit., p. 360 et s). La fameuse « sortie » du ministre des Affairesétrangères provoque le lancement de deux pétitions, à l’initiative de Cornélius Castoriadis d’un côté, de MichelFoucault et de Pierre Bourdieu de l’autre.96 Alessandro Campi, « Raymond Aron et la tradition du libéralisme politique », Raymond Aron et la libertépolitique, Ed. de Fallois, 2002, p. 246.97 Ibidem, p. 247. Souligné par l’auteur.98 Raymond Aron, Introduction à la philosophie politique. Démocratie et révolution, Ed. de Fallois/Livre dePoche, 1997, p. 127. Ce livre est la publication d’un cours professé à l’ENA en 1952. L’exemple chilien est venuconfirmer, vingt ans plus tard, la pertinence de cette critique.99 Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, op. cit., p. 354. On ne peut évidemment que regretter qu’il neprécise pas davantage les circonstances en question. Un développement de Paix et guerre entre les nationséclaire heureusement cette formule quelque peu énigmatique. Il écrit en effet ceci : « Il n’est pas exclu que lepréférable, en une conjoncture donnée, soit autre que le préférable, résultant d’une comparaison entre les deuxidéaux types. Quand font défaut les entrepreneurs, les mécanismes du crédit, quand seul l’Etat et sa bureaucratiesont capables de promouvoir l’industrialisation, le régime de parti monopolistique idéocratique estéventuellement le moyen le moins déplorable d’accomplir une tâche historiquement nécessaire » (Calmann-Lévy, 1962, p. 656. C’est nous qui soulignons). Sur cette question, on peut se reporter aux réflexions de ClaudeLefort, « Raymond Aron et le phénomène totalitaire », Raymond Aron et la liberté politique, op. cit., p. 87-92.Ajoutons enfin que, malgré le souci de la nuance qui est celui de Raymond Aron, il n’en affirme pas moins trèsfermement dans Paix et guerre la nécessité de distinguer deux sortes de régimes « radicalement hétérogènes » et
21
uniquement comme le reflet des positions sociales, il faut donc revendiquer le droit à la priseen compte de la complexité qui soutient toute véritable pensée du politique.Ce réalisme atypique est sans doute ce qui fonde la position de soutien critique vis-à-vis dupouvoir que Raymond Aron a soigneusement entretenu. La singularité de son itinérairepolitique tient ainsi à ce qu’il a pris soin, en fidèle disciple de Max Weber, de tenir les deuxbouts de la chaîne : analyser la politique avec réalisme, partir des faits, bannir les préjugés ;assumer la nécessité d’opérer des choix qui sont toujours, en politique, incertains etinsatisfaisants.Le désir d’engagement a conduit Raymond Aron à prendre clairement parti, d’ailleurs souventpar défaut, mais la passion de l’indépendance l’a amené à critiquer tous les pouvoirs, mêmeceux qu’il soutenait et pour lesquels il s’engageait parfois. Cette double exigenced’engagement et d’indépendance à l’égard du pouvoir est assurément l’un des legs les plusprécieux de Raymond Aron : puisse-t-il à l’avenir inspirer les clercs et leur éviter de sombrerdans le sommeil dogmatique des idéologies.
Gwendal Châton est maître de conférences en science politique à la Faculté de droit,économie et gestion d’Angers. Il est membre du Centre Jean Bodin (Université d’Angers,UPRES EA 4337) et membre associé du Centre d’Etudes et de Recherches Autour de laDémocratie (Université Rennes 1, UPRES EA 2238). Contact : [email protected]
qui « s’opposent comme le négatif ou positif », et donc de défendre les démocraties libérales occidentales contrela menace totalitaire soviétique (op. cit., p. 656).