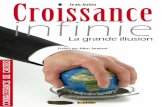Dans quelle mesure l'agrobusiness contribue-t-il à la croissance économique du Burkina Faso ?
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Dans quelle mesure l'agrobusiness contribue-t-il à la croissance économique du Burkina Faso ?
Mémoire de fin d'études
Master 2 Langues Étrangères Appliquées à l'Internationalisation des Organisations
Analyse de crises et action humanitaire
Titre : Dans quelle mesure le phénomène de l'agrobusiness contribue-t-il à la croissance
économique du Burkina Faso ? Analyse de l'impact de l'agrobusiness sur l'équilibre entre croissance
économique et respect de la population et de l'environnement
Année universitaire 2014 - 2015
Étudiant : SAVOINI Fabio
Directeur de mémoire : M HUTIN Hervé
Tuteur de stage : GODEAU-SANOU Lucile
Association Koorongo, avril 2015 - juillet 2015 Ouagadougou, Burkina Faso
1
Table des matières
Table des matières.......................................................................................................................................................3
Liste des annexes........................................................................................................................................................4
Fiche d'évaluation du document écrit..........................................................................................................................5
PARTIE I : Rapport de stage.......................................................................................................................................6
Sigles et acronymes...................................................................................................................................................6
1 Contexte géographique, social, économique et politique.......................................................................................7
1.1 Le Burkina Faso...............................................................................................................................................7
1.2 Le quartier populaire de Gounghin.................................................................................................................10
2 L'association Koorongo........................................................................................................................................12
2.1 Historique de l'association..............................................................................................................................12
2.2 Organigramme................................................................................................................................................14
2.3 Les objectifs....................................................................................................................................................14
2.4 Les activités....................................................................................................................................................15
2.5 Les projets futurs............................................................................................................................................16
3 Le rôle de l'étudiant ….........................................................................................................................................17
3.1 Les missions menées......................................................................................................................................17
3.2 Bilan des activités...........................................................................................................................................18
3.3 Impressions finales.........................................................................................................................................21
PARTIE II : Développement de la problématique.....................................................................................................24
Sigles et acronymes.................................................................................................................................................24
Annonce du plan......................................................................................................................................................26
Introduction.............................................................................................................................................................27
1 Historique du développement agricole au Burkina Faso......................................................................................28
1.1 Situation géographique et climatique.............................................................................................................28
1.2 Principaux produits et modalités de production.............................................................................................29
1.3 Contribution de l'agriculture à l'économie......................................................................................................34
2 L'agrobusiness au Burkina Faso...........................................................................................................................36
2.1 Définition, application et particularités du cas burkinabé..............................................................................36
2.2 Les nouveaux acteurs.....................................................................................................................................39
2.3 Les grands producteurs familiaux..................................................................................................................43
3 Bilan et perspectives de l'agrobusiness au Faso...................................................................................................46
3.1 Les changements apportés par les nouveaux acteurs.....................................................................................46
3.2 Bilan de l'impact de l'agrobusiness.................................................................................................................52
3.3 Perspectives sur l'agrobusiness et alternatives pour l'avenir..........................................................................56
Conclusion...............................................................................................................................................................60
Bibliographie...........................................................................................................................................................62
Annexes...................................................................................................................................................................65
3
Liste des annexes
Annexe 1 : Carte des zones climatiques du BF
Annexe 2 : Compte de transactions courantes du BF 2012
Annexe 3 : Profil des dépenses alimentaires de base sur la décennie 2000
Annexe 4 : Contribution des secteurs économiques au PIB du BF
Annexe 5 : Évolution du PIB et du PIB par tête du BF
Annexe 6 : Carte des provinces du Houet et du Ziro
Annexe 7 : Part de l'agriculture dans le PIB du BF
Annexe 8 : PIB du BF
Annexe 9 : Évolution des superficies équipées
Annexe 10 : Périmètres irrigués
Annexe 11 : Cultures irriguées sur les superficies équipées
Annexe 12 : Évolution de l'IDH du BF
Annexe 13 : Évolution du taux de mortalité
Annexe 14 : Évolution de l’espérance de vie à la naissance
Annexe 15 : Indice de Gini du BF
Annexe 16 : Carte géographique du BF
Annexe 17 : Carte de Ouagadougou
Annexe 18 : Attestation de stage
Annexe 19 : ÉVALUATION par le stagiaire de l'organisme d'accueil
Annexe 20 : Observations
Annexe 21 : Grille d'évaluation du stagiaire par son tuteur dans l'entreprise
Annexe 22 : Attestation de non-plagiat
4
Sigles et acronymes
CEDAO : Communnauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest
UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine
UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
BF : Burkina Faso
ONU : Organisation des Nations Unies
NU : Nations Unies
UNITAR : United Nations Institute for Training and Research
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNAMID : United Nations Mission in Darfur
UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development
VIH : Virus de Immuodéficience Humain
IDH : Indice de Développement Humain
PIB : Produit Intérieur Brut
EICV : Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des ménages
RSP : Régime de Sécurité Présidentielle
SONABEL : Société Nationale de l’Électricité du Burkina Faso
ONEA : Office National de l'Eau et de l'Assainissement
OMD : Objectifs Millénaires pour le Développement
ONG : Organisation Non-Gouvernementale
FCFA : Franc des Colonie Françaises d'Afrique
6
1 Contexte géographique, social, économique et politique
1.1 Le Burkina Faso
Le Burkina Faso est un pays enclavé situé au milieu de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne1. Les
frontières avec le Mali au Nord, le Niger à l'Est, le Bénin au Sud-Est, le Togo et le Ghana au Sud et
la Côte d'Ivoire à l'Ouest font du « pays des hommes intègres » un important pôle commerciale
entre les États de la CEDEAO. En effet, le BF fait partie de la Communauté Économique des États
de l'Afrique de l'Ouest ainsi que de l'Union Africaine, d'où l'UMOA (Union Monétaire Ouest
Africaine) et l'UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine). À l'international, l'état
fait partie de l'OIF et de l'ONU (à partir du 20 septembre 1960, 46 jours après la déclaration
d'indépendance de la France), de l'Organisation Mondiale du Commerce, de plusieurs agences des
NU telles que l'UNESCO, l'UNITAR, l'UNAMID, l'UNCTAD et encore de l'Interpol, du G-77, de
l'Organisation Mondiale de la Santé, etc.
La population, de environ 16 400 000 habitants, compte sur une faible espérance de vie : environ 52
ans pour les hommes, 56 pour les femmes (FAO, 2013). D'un point de vue anthropologique, le pays
est constitué de nombreuses ethnies d'où la présence de 67 langues et dialectes parlés, malgré la
seule langue officielle reste le français. Les ethnies majeures sont les Mossi, présents dans le nord-
est du pays et autochtones de la région du Kadiogo (où se trouve la capitale, Ouagadougou) et dont
la langue est le mooré, et les Bobo, habitants du sud-ouest du pays, dont la langue est le dioula. Les
premiers sont connus pour leur sens du commerce, les deuxièmes, pour leur esprit accueillant et leur
propension pour l’élevage et l'agriculture. Cette différence fait du pays une véritable ellipse dont les
deux feux sont les deux villes principales : Ouagadougou, capitale administrative, politique et
économique, et Bobo-Dioulasso, capitale culturelle. Cette dichotomie est toujours perceptible dans
la vie quotidienne des burkinabés, même si l'origine de leur rencontre date du XV siècle.
La croissance démographique est importante nonobstant les forts taux de mortalité infantile et de
décès par le VIH : 3,05% de croissance démographique annuelle enregistrée en 2014.
L'IDH2 est l'un des plus faibles au monde, précisément le 183ème sur 187 recensés, avec un résultat
de 0,343 en 2013 (pourtant en hausse de 10% depuis 2005). Le IDH exprime la condition de vie à
partir de trois éléments fondamentaux : le PIB par habitant, l’espérance de vie à la naissance et le
niveau d'éducation. Ces chiffres se traduisent aussi par le fait que « l’Enquête Intégrale sur les
1 Voir Annexe 16 : carte du Burkina Faso2 Indice de Développement Humain, indicateur développé par le Programme des Nations Unies pour le
Développement
7
Conditions de Vie des Ménages (EICV 2009/2010) révèle que 43,9% de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté avec plus de 60% dans certaines régions du pays » (FAO,2013).
Au niveau économique, le BF enregistre, depuis une décennie, un taux de croissance économique
relativement élevé : au cours de la période 2000 – 2009, le taux moyen a été de environ 5%
(DARANKOUM, 2014). Les taux de croissance de 2011, 2012 et 2013 ont été respectivement de
5%, 9% et 6,6%. Nonobstant ces chiffres plutôt satisfaisantes, la richesse produite n'est pas pro-
emploi. En effet, le niveau de vie de la population est resté faible : en raison de la forte croissance
démographique, l'augmentation du PIB par tète est situé à 2%.
Pour ce qui concerne l'emploi, le taux de chômage enregistré au cours des dernières années est très
décourageant pour les jeunes. La forte majorité de la population active habite en milieu rural, dont
une répartition de l'emploi dans les secteurs assez nette : 80% pour le primaire, 4,8% pour le
secondaire et 14,5% pour le tertiaire. Malgré un taux d'emploi élevé en milieu rural (94,5% de la
population active travaille dans l'agriculture) les conditions de vie demeurent précaires en raison de
la faible rentabilité du secteur (dictée en général par les aléas climatique, le manque de
professionnalisation et l'absence de moyens techniques développés). Cela ce traduit par une
présence de travailleurs pauvres dans le secteur primaire à hauteur de environ 45%.
Enfin, au niveau politique, le Burkina Faso a connu, de manière analogue à nombreux autres pays
africain, une instabilité plutôt constante depuis l'indépendance de la France en 1960. Les chroniques
politiques contemporaines du Burkina Faso commencent véritablement avec la révolution du 4 août
1984. Le militaire avec formation politique Thomas Isidore Noël Sankara prend le pouvoir par
moyen d'un coup d'état militaire, succédant l'ancien chef d'état Jean-Baptiste Ouédraogo (putschiste
lui aussi, comme trois autres Présidents du Faso dans l'histoire du pays). Sankara fut l'acteur plus
charismatique, révolutionnaire et important de l'histoire du BF, considéré par toute l'Afrique de
l'Ouest subsaharienne le « Che Guevara africain ». Le « capitan » gouverna pendant environ quatre
ans avec une attitude révolutionnaire et populaire jamais vue en Afrique de l'Ouest. Pour cette
raison aussi, il s'aliéna de presque tous les autres dirigeants des pays africain au pouvoir à l'époque.
Parmi ses actions et reformes, les plus remarquable sont celles visant à faire du peuple burkinabé la
force de la nation : chaque personne doit planter un arbre une fois par année pour réduire la
désertification ; les luxueuses voitures des fonctionnaires sont remplacés par des Renault 5 ; tous les
fonctionnaires sont obligés à s'habiller avec un Faso Dan Fani3 dans les bureaux ; le caractère
traditionnel favorisant l'inégalité est annulé par la réduction des pouvoirs des chefs de tribus ; les
3 Pagne traditionnellement utilisé par les hommes adultes burkinabé. Sankara décida d'en obliger la présence dans tout bureau des établissements publics, pour favoriser la filière coton du Burkina Faso.
8
femmes sont invitées à participer activement à la vie politique ; le Conseil National de la Révolution
coordonne des équipes qui s'occupent de la construction de puits et retenues d'eau pour faciliter
l'accès à l'eau ; tout le monde est invité à contribuer réellement à la construction du chemin de fer
reliant Ouagadougou à Bamako (et, initialement, Abidjan) pour permettre au Faso de s'ouvrir des
routes commerciales ; les « vaccinations commandos » sont mises en place, par lesquelles des
opérateurs distribuaient des vaccins à chaque enfant de toutes les familles ; les « opérations alpha »
mettent à disposition de chaque village et quartier des grandes villes des cours d'alphabétisation
gratuits, grâce auxquelles le taux des études primaires complétés monta de 11,31% en 1983 à
15,83% en 1987. Naturellement, Sankara participait en première ligne à chacune de ses reformes.
L'histoire de Sankara se termine le 15 octobre 1987 avec son assassinat, perpétré lors d'un coup
d'état par son ancien bras droit et meilleur ami Blaise Compaoré. L'acteur de l'assassinat demeure
inconnu jusqu'à présent ainsi que les dynamiques du meurtre et la position du corps de Sankara. À
partir de sa mort, le révolutionnaire burkinabé devient un symbole de la renaissance des peuples
africains et la représentation de l'espoir de développement burkinabé.
Néanmoins, le gouvernement Compaoré se montrera capable de faire remonter progressivement
l'économie du BF, si bien que d'enrichir l'élite politique à détriment des citoyens par moyen de la
corruption et de la négligence. En effet, l’égoïsme de Compaoré est prouvé (et arrête) en 2014, lors
de la préparation aux élection présidentielles : le chef d'État déclara de vouloir amender l'article 37
limitant le nombre de candidatures afin de se représenter en 2015. Le peuple se révolta provoquant
des émeutes, ayant par conséquence les démissions de Blaise Compaoré et sa fuite en Côte d'Ivoire.
Les protestations durèrent du 28 octobre au 1er novembre 2014. Après les démissions de Compaoré,
deux militaires tentèrent le coup d'état, sans succès : le chef de l'état-major Honoré Traoré et
l'officier Isaac Zida. Le deuxième s'autoproclame chef d'État et reste au pouvoir pendant 21 jours,
jusqu'à la nomination du Président de la transition Michel Kafando, lequel nomme Zida Premier
Ministre.
Ensuite, la transition mène les modification de la loi électorale et prépare les élections prévues pour
le 11 octobre 2015, jusqu'à la tentative de coup d'état par Gilbert Diendéré, commencée le 16
septembre 2015. Le Conseil National de la Transition modifia l'article 135 du Code électoral en date
17 avril 2015, empêchant aux anciens proches de Blaise Compaoré de présenter une candidature
pour la présidence. Cette décision provoqua une réaction parmi les simpatisant de l'ancien régime
qui mena à la tentative de prise de pouvoir par Gilbert Diendéré. Encore une fois, le peuple
manifesta pendant tous les jours des négociations entre Diendéré (lequel demandait les démission
de Kafando et Zida) et Kafando (lequel résistait aux pressions des putschistes). De plus, la
communauté internationale intervint à faveur de la transition et contre Diendéré et les forces du RSP
9
(Régime de Sécurité Présidentielle, corps militaire mis en place par Compaoré, dont Diendéré fut le
chef pendant l'ancien régime). Enfin, le coup d'état fut éventé et le Conseil National de Transition
recomposé pour aboutir à la postposition des élections en date 25 novembre 2015, à l’arrêt de
Diendéré et à la dissolution du RSP.
1.2 Gounghin, Ouagadougou
Le quartier populaire de Gounghin est situé au sud-ouest du centre de la capitale du Faso,
Ouagadougou4. Avec Samandin, il est un des quartiers les plus anciens de la capitale et accueille le
cœur de la population ouagalaise. Il est le majeur de Ouaga par population totale et densité de
population. Le haut taux démographique est dû aussi à une forte migration de bobolais (habitants de
Bobo-Dioulasso), lesquels ont choisi Gounghin en raison des bas prix des logement et du simple
accès aux marchés et à la presque totalité des services de la vie quotidienne (les bureaux de la
SONABEL et de l'ONEA, où les ouagalais paient les factures respectivement de l'électricité et de
l'eau). La forte présence de bobolais dans le quartier le rend culturellement différent des autres
quartiers de Ouagadougou : en effet, plusieurs traits distinguent les susdits et les ouagalais.
Premièrement, l'origine ethnique, étant les bobolais des Bobos et les ouagalais des Mossi (en règle
générale). D'où, le fait que deux langues soient parlées à Gounghin au-delà du français : le dioula
par les bobolais et le mooré par le ouagalais. Deuxièmement, comme décrit précédemment, les
premiers conduisent une vie plutôt sédentaire et avec des liens communautaires très étroites, les
secondes sont plus orientés vers le commerce, l'activité continue et cela les rend, pour les habitants
de Bobo-Dioulasso, des individualistes. Cette dichotomie, déjà exprimée lors de la présentation du
pays ci-dessus, rend le quartier de Gounghin extrêmement intéressant sur les plans sociologique et
anthropologique.
Malheureusement, la densité de la population pénalise au niveau des conditions de vie les habitants
de Gounghin. En plus, étant le gouvernement orienté vers la promotion des quartiers plus aisés,
plusieurs infrastructures de base manquent ou ne sont pas effectives.
L'association qui a hébergé l'étudiant durant la période du stage a décidé de s'installer à Gounghin
en raison d'une particularité importante : le quartier compte nombreux établissements scolaires, plus
précisément, dans un rayon de 2 km du siège de l'association se trouvent 12 écoles entre primaires
et secondaires. Néanmoins, étant Gounghin un des quartiers les plus pauvres de la capitale, les
4 Voir Annexe 17: carte de Ouagadougou
10
élèvent ne disposent pas de moyens complémentaires pour s'assurer les équipements et un
accompagnement nécessaire à leur réussite. En plus, les familles ne peuvent pas, dans la majorité
des cas, se permettre les textes scolaires ou des cours de soutien en cas de faillite de l'élève (il faut
remarquer que le nombre moyen d'élève par classe dans les lycées de Gounghin, qu'ils soient
publics ou privés, est d'environ 80 jeunes, donc la qualité de l'enseignement s'avère médiocre).
11
2 L'association Koorongo
2.1 Historique de l'association
L'association Koorongo naît en 2014 d'une idée de l'actuelle présidente de la susdite Mme Godeau-
Sanou. Elle était enseignante auprès du lycée technique George Ilboudo, situé dans le quartier
populaire de Gounghin, au sud-ouest du centre ville de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou.
Elle constata le manque de moyens fournis aux élèves, pour garantir une participation active et un
intérêt réel, de leur part, pour les études et la lecture. Les jeunes, à Gounghin, doivent
quotidiennement faire face à tous les problèmes qui parviennent dans ce type de quartier populaire -
au niveau familial, économique, climatique, sanitaire - et manifestent une totale indifférence envers
les possibilités que l'éducation peut leur garantir pour l'avenir.
Pour les rapprocher au principal outil de l'éducation et de la culture, le livre, elle décida de ramener
de France des romans pour jeunes et de les mettre à disposition de sa classe, à condition qu'ils ne
prennent pas cette possibilité comme un devoir pour l'école. Les élèves profitèrent avec surprenante
motivation des livres et demandèrent spontanément de pouvoir partager avec la classe le contenu de
tel ou tel livre au début du cours.
L'enthousiasme des étudiants porta Mme Godeau-Sanou à conduire une étude de terrain, pour
finalement constater que dans un rayon de deux kilomètres du lycée ils existent onze différents
lycées mais même pas une seule structure culturelle ou liée au savoir. En s'élargissant au quartier
entier, elle ne trouva qu'une seule bibliothèque : pourtant inaccessible à ses étudiants à cause de la
grande distance de leur établissement.
Elle décida donc de constituer une association qui s'appelle « Koorongo » (ce qui signifie « le
savoir, la lecture » en mooré, langue locale) et d'ouvrir une bibliothèque au nom de l'association.
Grâce à des financements obtenus par la plate-forme de crowd-funding online (financement
participatif) « Ulule » et grâce au financement de la région de « PACA » elle arriva à trouver un
bâtiment apte à devenir une bibliothèque au centre du quartier concerné. En plus, elle organisa,
après avoir reçu une somme considérable d'ouvrages de différentes bibliothèques et librairies
françaises et suisses, le transport des livres par container jusqu'à Ouagadougou.
En décembre 2014 le classement des œuvres et la mise sur rayon sont accomplis : la bibliothèque
ouvre les portes aux jeunes du quartier. Entre temps, l'association prend forme et un conseil
d'administration est crée (la présidente, un trésorier et un secrétaire général) pour en suite chercher
une bibliothécaire qui puisse gérer les utilisateurs et les ouvrages. Un système de prêt et
12
abonnement est également mis en place.
Néanmoins, les utilisateurs ne sont pas nombreux et la structure n'attire pas les habitants du
quartier : traditionnellement, au Burkina Faso le savoir est transmis de façon orale et la culture et
l'histoire non plus ne font pas l'objet des livres. En plus de cette différence culturelle, il manque
dans la mentalité des burkinabés (surtout des moins aisés et instruits) le concept de démocratisation
du savoir, et par conséquent le fait que la structure et son contenu soient accessibles gratuitement
génère de la méfiance vis-à-vis de la bibliothèque.
Pour cette raison, il est nécessaire de mettre en place une campagne de sensibilisation, notamment
dans les nombreux lycées, pour présenter la structure aux élèves et pour transmettre l'identité et
l'aptitude qui relèvent d'une bibliothèque : l'accès est libre, la consultation est gratuite, un lieu
d'étude avec lumière et tableau est mis à disposition, « n'ayez pas peur ! »
Aujourd'hui, la bibliothèque compte environ 3000 titres de toute sorte, des romans pour jeunes aux
romans classiques, des BD aux recueils de poésies. Les entrées ont fortement augmentées à partir
du mois d'avril.
La structure, suite à l'obtention du consensus du Directeur Régional de l’enseignement secondaire, a
porté à connaissance de la bibliothèque les élèves des lycées du quartier à travers la susdite
campagne de sensibilisation, après laquelle les élèves ont pu profiter des ouvrages et des espaces
pour préparer le Bac.
En parallèle, Koorongo souhaite promouvoir la culture en proposant des activités extra-scolaires
(peinture, sculpture, danse, création de bijoux), tenues par des artistes locaux, lesquelles poussent
les jeunes à apprécier toute forme d'art traditionnel et à exploiter les connaissances obtenues
pendant les cours dans la vie quotidienne et, éventuellement, dans le futur.
La bibliothèque et ses acteurs permettent donc d'apporter un soutien dans les cursus scolaires des
élèves et étudiants par des cours de soutiens et par la mise à disposition de manuels faisant partie du
programme ainsi que de dictionnaires, y compris en langues locales (mooré, dioula) et de matériel
de recherche (encyclopédies, livres spécialisés, livres d'histoire, de géographie, etc.).
L'association propose aussi un lieu d'étude à des créneaux où les établissements scolaires sont
fermés pour la plupart, et où l'éclairage n'est pas toujours accessible dans le quartier.
Ces activités permettent d'améliorer la pratique de la langue et l’orthographie, mais poussent aussi
les jeunes à ouvrir leurs esprits à l'imagination et à la créativité. Savoir s'exprimer en public,
prendre confiance en soi, être capable de créer, innover, que cela soit dans le domaine culturel,
social, ou encore économique, est synonyme d'avenir individuel mais aussi collectif. Les livres sont
un moyen de transmettre et de préserver les traditions, les récits, la musique et les idées d'une
population, d'un peuple et l'accès à tous à ces ouvrages est essentiel.
13
2.2 Organigramme
Jusqu'à présent, s'agissant d'une association jeune et au début de ses activités, toute action est
centrée autour de la bibliothèque. En conséquence, les salariés ne sont que ceux qui s'occupent de
ladite bibliothèque et de toute activité qui la concerne. Dans l'organigramme ici présenté ne figurent
pas les personnes en stage, les membres signataires non-actif de l'association Koorongo ni les
donateurs de prestations occasionnelles telles que le nettoyage, la maintenance, la construction des
étagers, etc.
2.3 Les objectifs
En général, l'objectif principal de Koorongo est celui de favoriser la culture et l'éducation dans un
milieu ou celles-là ne sont pas suffisamment considérées en tant que moyens pour améliorer les
conditions de vie individuelles et communautaires. À travers la démocratisation du livre, la mise en
œuvre de cours de soutien et la création de moyens pour rapprocher les plus jeunes à la lecture,
Koorongo souhaite créer, dans l'avenir, un réseau de bibliothèques de lecture publique burkinabés.
Cette démarche s'inscrit et prend toute sa valeur dans le cadre du 2º (assurer l'éducation primaire
pour tous) et 3º (promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes) Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), et le droit à l'éducation et au savoir pour tous.
L'objectif actuel de l'association Koorongo est celui de rendre autonome la bibliothèque en trouvant
un moyen pour s'autofinancer. Jusqu'à présent, les dons initiales ont permis de satisfaire les besoins
prioritaires (matériels, fixes et humains) de la structure : l'acheminement des containers pour le
14
PrésidenteMme Godeau - Sanou
TrésorierM Sanou
Secrétaire généralM Ouedraogo
Secrétaire adjointM Ouattara
BibliothécaireMme Sanou
AnimateurM Sawadogo
GardienM Zan
transport des ouvrages (l'association a loué des mètres cubes d'espace auprès d'une association
externe qui les offrait), le matériel pour la construction de l'intérieur de la bibliothèque, le paiement
des salaires (gardien et bibliothécaire ; l'animateur perçoit comme rétribution les entrées des cours
de soutien qu'il fournit au sein de Koorongo ; les membres de l'administration ne perçoivent pas le
salaire), le paiement du loyer et des factures d'eau et d'électricité, le matériel de bureau.
L'objectif de rendre autonome la structure inclut d'autres objectifs spécifiques :
créer des emplois ;
maintenir une identité entièrement burkinabé de la structure, à travers une gestion totalement
en charge des acteurs locaux, pour ne pas imposer la culture française plutôt que celle
nationale (ajouter des romans en langue locale, trouver des solutions et des activités qui
puissent être reconnues et appréciés par les jeunes burkinabé, établir un contact avec les
utilisateurs par l'usage de la langue mooré ou dioula au moment des animations et de
l'accueil, etc.), pour que Koorongo puisse devenir un espace burkinabé de rencontre entre
cultures à travers les livres ;
créer la possibilité de pouvoir ouvrir d'autres bibliothèques similaires dans différents villes
ou villages au Burkina Faso, notamment par l'exploitation des compétences acquises par les
acteurs de Koorongo avec cette première expérience ;
2.4 Les activités
L'association Koorongo propose, aujourd'hui, quatre typologies d'activités :
Consultation gratuite des ouvrages et possibilité d’emprunter les livres après abonnement
Cours de soutien par l'animateur de la bibliothèque, à des prix très favorables par rapport à
ceux proposés par les professeur donnant cours particuliers
Activités culturelles extra-scolaires : peinture, sculpture, danse, création de bijoux
à partir de la rentrée 2015 (octobre 2015), la connexion internet et une photocopieuse seront
à disposition gratuitement pour les abonnés à la bibliothèque
15
2.5 Les projets futurs
Pour pouvoir rendre autonome la structure, l'association a prévu la mise en place d'un cybercafé
dans la salle d'étude de la bibliothèque. Un budget a été prévu et Koorongo compte ouvrir le
« cyber » en octobre-novembre 2015. À plusieurs reprises l'association a été sollicité par les usagers
pour la mise à disposition d'un réseau internet, à cause du fait que les autres cybers se trouvent assez
loin de la bibliothèque et que évidemment l'accès à internet est désormais devenu fondamental pour
les recherches des informations.
Les recettes provenant de tel service pourraient financer les coûts fixes (loyer, eau, électricité) et les
salaires des opérateurs de la bibliothèque.
En outre, un projet culturel est en train d'être conçu par l'administration de Koorongo. Ledit projet
consiste à proposer aux jeunes fréquentant la bibliothèque des cours de danse qui aboutiraient à la
création d'une équipe de danse sous le nom de « Koorongo ». Cette équipe pourrait participer aux
nombreux concours de danse burkinabés et, ensuite, créer un réseau de cours de danse au sein de la
bibliothèque. La danse est l'une des activités les plus appréciées par les jeunes burkinabés. Cette
discipline est fortement reconnue comme art par la société et elle est profondément perçue comme
instrument culturel.
Enfin, pour les enfants moins âgés, les animateurs choisiront un thème à leur proposer chaque
semaine, pour ensuite travailler avec eux en lisant des livres qui concernent le thème et en leur
expliquant le langage et le contenu. Donc, chaque fin de semaine, un film ou un dessin animé sera
projeté à la bibliothèque pour terminer avec un dialogue avec les enfants. Ceux-ci pourront ainsi
apprendre à participer à des discussions, à respecter leur entourage pour la prise de parole, à
réfléchir et s'exprimer autour d'un thème choisi.
16
3 Le rôle de l'étudiant dans l'association
3.1 Les missions menées
Le stage effectué par l'étudiant est dénommé « stage en administration de projet humanitaire ».
S'agissant d'une petite et jeune association, l'administration joue un rôle central dans toute activité
menée par l'association : de la création et la mise en œuvre du projet, jusqu'au suivi et à l'évaluation
dudit.
Les missions de l'étudiant au sein de l'association, préalablement accordées avec l'administration,
sont les suivantes :
l'élaboration de budgets et bilans financiers pour les diverses activités de l’association en
collaboration avec le trésorier qui nécessite une aide dans l'utilisation des outils et en
comptabilité en général ;
la recherche de financements et de partenariats, afin de pérenniser les activités, les moyens
étant très réduits ;
l'appui à l'organisation administrative de l’association (gestion des ressources humaines,
communication interne et externe, appui à la formation du personnel sur les outils de travail
dont ils disposent) ;
renforcement des liens et des partenariats avec d’autres structures et administrations
publiques.
Donc, la mission générale a été celle d'appuyer l'administration (principalement la présidente et le
trésorier) dans toute démarche concernant le domaine décisionnel. Puis, occasionnellement et
surtout pendant les deux derniers mois de stage, l'étudiant a réalisé des évaluations des activités de
la bibliothèque et il a prévu un plan pour le futur de l'association en terme de budget, de possibilité
de partenariats et de financements et de projet complémentaires à la bibliothèque.
En règle générale, la journée de travail se déroulait sur deux axes : dans la matinée (8h – 12h) les
activités concernaient l'appui du personnel de l'association (formation par rapport au moyens pour
gérer les entrées et l'accueil des usagers de la bibliothèque, par rapport au développement de
l'identité de la bibliothèque, à la gestion du matériel, à la classification des ouvrages et la gestion
des outils pour le prêt, par rapport au déroulement des activités proposées par la structure et enfin
pour toute technique de sensibilisation et communication avec le public) ; en suite, dans la
deuxième partie de la journée (14h – 18h), l'étudiant devait s'occuper des démarches et des
17
opérations purement administratives, telles que la gestion du budgets, la formulation des budgets
prévisionnels pour les activités, la gestion de la communication avec le public et les partenaires, la
recherche de financement auprès des institutions et des organisations opérant dans le même
domaine et lieu (avec la priorité sur celles de Ouagadougou), la prévisions de nouvelles activités ou
projets complémentaires aux actions de la bibliothèque et enfin la rédaction de rapports et résumés
par rapport à la situation de l'association.
3.2 Bilan des activités
La recherche de financement
Le principal problème de l'association est celui de l'absence de moyens pour pérenniser les activités
et pour permettre le paiement des salaires, du loyer, des frais de l'eau et de l'électricité et du matériel
pour les activités (en particulier, pour les activités qui requièrent des matériaux spécifiques et non
possédé par l'association, telles que les ateliers de sculpture, peinture, batik et danse proposées aux
jeunes élèves du quartier). En effet, toute activité est pénalisé par le manque de moyens financiers :
de l'impression des flyers pour la communication et la sensibilisation sur la présence de la
bibliothèque, à l'achat de nouveaux ouvrages, à l'installation d'un réseau internet très demandé par
les usagers, jusqu'au transport des salariés pour les opérations prévues lesquelles comportaient un
déplacement (par exemple, un cours de formation pour la bibliothécaire proposé par une structure
située à une dizaine de kilomètres de Koorongo ; la démarche de sensibilisation dans les classes des
lycées du quartier ; toute démarche administrative pour laquelle soit nécessaire se rendre à la mairie
située à 6 kilomètres de l'association ; la participation à séminaires et conférences utiles pour les
membres de Koorongo se déroulant au centre ville ; la proposition d'un service de déplacement pour
les élèves habitant excessivement loin de la bibliothèque ; etc.)
Donc, parmi les activités, la plus importante et urgente était celle de trouver un financement ou un
moyen pour permettre à l'association de s'autofinancer et de devenir autonome financièrement.
Cette recherche a été conduite par le trésorier, appuyé par l'étudiant, à partir du deuxième mois de
stage. Tout d'abord, des budgets réels et prévisionnels ont été réalisés pour présenter la situation
économique aux potentiels bailleurs. En suite, un document de présentation (en version de une page
et en version complète) a été rédigé par l'étudiant afin de communiquer les objectifs principaux et
spécifiques, l'historique, les détails et les activités menées et prévues par Koorongo aux potentiels
18
partenaires et bailleurs. Puis, l'équipe a réalisé une étude de terrain pour comprendre quelles
associations, organisations et/ou institutions auraient pu accompagner Koorongo financièrement,
techniquement ou au niveau des matériaux à Ouagadougou ou dans la région du Kadiogo et, enfin,
au Burkina. Une fois la liste des potentiels partenaires formulée, l'étudiant a procédé avec l'envoi
des demandes.
À côté de celle de simple financement, la recherche d'une activité rentable pour permettre
l'autofinancement de l'association a été accomplie. Parmi les solutions envisagées, plusieurs se sont
révélées impraticables faute de moyens initiaux ou faute de l'absence de personnel disponible.
Pendant le dernier mois de stage, après avoir constaté le rejet systématique des demandes
d'accompagnement, l'étudiant, avec le consensus de l'administration, a formulé un plan pour la
création d'un espace de navigation internet à l'intérieur de la bibliothèque. En effet, la réalisation
d'un « cyber » (cybercafé), aurait permis à l'association de gagner des entrées suffisantes pour payer
(au moins) les salaires des employés et le loyer (lequel s'avère très cher par rapport aux prix moyens
des logements au Burkina : 100 000 FCFA, correspondant à environ 150 euros par mois).
Malheureusement, la fin du stage et le conséquent rapatriement n'a pas permis à l'étudiant de suivre
la réalisation du cyber ni d'en constater l'efficacité ou l'échec.
Enfin, une seconde récolte de fonds à travers la plate forme de crowdfunding « Ulule » a été mise
en place pour permettre la concilier la communication avec le public (montrer à travers la page du
site les résultats obtenus jusqu'à présent) avec la recherche de financements.
Cette activité a permis à l'étudiant de découvrir les modalités de communication avec les potentiels
bailleurs lors d'une recherche de fonds. Encore plus, lorsqu'il s'agit d'une petite association laquelle
ne peut pas se permettre des outils professionnels ni la consultation d'experts pour améliorer les
caractéristiques des demandes formulées, l'étudiant a été en contact direct avec les dynamiques de
ce domaine et les acteurs des « transaction ». En plus, cette activité a permis la découverte du
fonctionnement des plate formes de crowdfunding et de financement participatifs, concernant
importantes notions de communication et de marketing en milieu humanitaire. Enfin, l'étudiant a eu
l'occasion de fréquenter nombreux acteurs de l'humanitaire à Ouagadougou et plus en général au
Burkina Faso, aspect lequel a de fait accru ses connaissances et expérience au BF. La recherche de
financement a donc essentiellement influencé les sphères professionnelle, culturelle et humaine :
trois domaines fondamentaux propres à un opérateur humanitaire.
19
La formation du personnel
Une autre partie importante dans les activités menées par l'étudiant a été l'appui aux salariés de la
bibliothèque. En particulier, le premier mois de stage correspondant au premier mois de la mise à
disposition du service de prêt de la bibliothèque, la bibliothécaire et l'animateur nécessitaient
d'outils efficients et efficaces pour la sauvegarde des données relatifs aux ouvrages et aux usagers.
Toutefois, les moyens à disposition de l'équipe ne leur permettait pas l'utilisation de logiciels
professionnels de gestion des opérations bibliothécaires tels que PMB, MiCla ou AIB-CUR5. Donc,
avec les logiciels de base et des outils alternatifs l'étudiant a accompagné les salariés dans une
formation concernant : accueil et communication avec les usagers, gestion des matériaux, des
ouvrages et de la caisse, la classification des ouvrages et la mise en place des étagères,
l'organisation des activités pour les élèves, la création d'un règlement interne, la mise en place des
réunions mensuelles et des rapports mensuels, la communication avec l'administration et enfin la
recherche de structures potentiellement aptes à collaborer.
Dans ce contexte l'étudiant a pu constater les dynamiques de la gestion d'une équipe, des relations
entre l'administration et le salariat (stagiaire compris), de la formation du personnel et de la
communication interculturelle. Ce dernier aspect en particulier a dominé les relations et toute
situation produite au début du stage : savoir s'insérer dans une équipe, un environnement, un
quartier et une ville avec patiente et compréhension s'avère fondamental pour la création d'une
ambiance collaborative, productive et claire. À partir de la transmission des informations et des
compétences jusqu'à l'instauration d'une hiérarchie à respecter, dans une petite ONG locale les
facteurs clés du succès sont souvent représentés par ce domaine : la communication interne et
l'application d'un règlement interne, pourtant en gardant toujours intacte la sphère « familiale » qui
se crée naturellement dans les organisation de petite envergure.
L'organisation et la mise en place des activités
Les activités décrites précédemment dans le paragraphe 2.4 ont été définies, organisées et mises en
place à partir des réunions de l'administration auxquelles l'étudiant a participé durant toute la
période de stage. Le domaine de l'organisation d'activités à proposer au public s'avère fondamental
pour la sensibilisation sur la présence de la bibliothèque (puisque le quartier n'est pas totalement à
connaissance du service mis à disposition des élèves) et pour obtenir des gains utiles au paiement
des matériaux et à l'organisation d'ultérieures activités.
5 Les trois logiciels professionnels de gestion d'un catalogue bibliothécaire les plus utilisés en Europe.
20
Toutes les opérations nécessaires à la réalisation des activités ont été programmées minutieusement
en raison du manque de moyens financier pour les déléguer et de personnel pour les coordonner.
Encore une fois, l'aspect financier a joué un rôle négativement essentiel dans la vie de l'association :
si une petite organisation peut se permettre la réalisation de projet importants (tels que des visites à
la bibliothèque pour les élèves des lycées du quartier, l'organisation de conférences sur thèmes
différents pour adultes et étudiants, concours littéraires ou artistiques avec des prix à gagner, etc.),
plus facilement pourra s'autofinancer et garantir l'autonomie des activités grâce notamment à une
plus forte participation du public et à la visibilité auprès de potentiels partenaires, bailleurs ou
sponsors. Au contraire, les petites associations qui ne bénéficie que d'un budget restrictif et ponctuel
(puisque les donations ne sont pas continues ni mensuellement ni annuellement, mais seulement au
début Koorongo a reçu les dons) sont obligées à proposer une offre modeste aux bénéficiaires et
avec des moyens réduits.
Pour cette typologie d'activité, toujours présente dans les ONG qui s'occupent d'éducation,
formation, ou plus en général dans celles dont le domaine implique le contact direct avec les
bénéficiaires, les compétences requises sont principalement : la capacité d'organiser le travail en
équipe, en particulier avec le sens d'adaptation des ressources financières, matérielles et humaines
aux projets à réaliser ; l'adaptation au contexte, puisqu'il s'avère nécessaire d'évaluer les dynamiques
relatives à l'âge des usagers, la provenance, la culture de base, les goûts et l'environnement afin de
proposer une activité efficace et apte à satisfaire le public ; le savoir-faire et la capacité d'animer
certaines situations, comme dans tout autre occasion de contact direct avec le public et non
seulement, puisque à l'intérieur de l'équipe un membre portant et entreprenant est fondamental ;
enfin, la capacité d'évaluer de façon impartiale et constructive le succès ou l'insuccès de l'activité,
afin de comprendre le potentiel de l'équipe et la réaction du public.
3.3 Impressions finales
À un mois de la fin du stage, des conclusions peuvent se dégager sur l'expérience de façon lucide,
sur la base de trois critères de jugement: la sphère humaine, celle professionnelle et celle culturelle.
En outre, il est possible d'évaluer la situation générale de l'association et du rôle joué par l'étudiant
au cours des mois du stage, afin de comprendre dans quelle mesure il a contribué à l'action de
l'ONG et éventuellement de proposer des solutions pour l'avenir. Évidemment, toujours en
considérant le domaine, l'environnement et la taille de l'association en question.
21
Au niveau professionnel, l'expérience a permis à l'étudiant de constater les vicissitudes d'une
association avec des caractéristiques analogues à celles d'autres milliers d'ONG dans le monde : les
moyens réduits, la petite envergure et le personnel novice. Premièrement, la difficulté de trouver les
moyens d'auto-financement pour permettre à l'association de contribuer dans son propre domaine
aux bénéficiaires ciblés se manifeste. Effectivement, au cours des six premiers mois de vie d'une
petite ONG, ainsi que d'avoir à obtenir une base d'idées et de résoudre toutes les questions
administratives et juridiques, la plus haute priorité devrait être accordée à la recherche de
financements ou d'activités rentables à mettre en place. Cet aspect a éclairé la situation sur le terrain
et fourni à l'étudiant une expérience fondamentale par rapport à la création d'une structure éducative
dans un environnement et une situation interne précaires. Deuxièmement, il s'avère fondamental de
savoir gérer tous les aspects relatifs à l'interculturalité : savoir proposer une offre apte à
l'environnement culturel, géographique et humain afin d'éviter des effets négatifs sur les
bénéficiaires ; prendre conscience du public ciblé et éviter des situations ou ce dernier est trop vaste
ou trop réduit par rapport à l'offre proposée ; apprendre d'abord à vivre sur le terrain, pour pouvoir
mieux gérer la vie professionnelle ; enfin, savoir évaluer et éventuellement modifier toute
caractéristique de l'association afin de satisfaire les besoins des bénéficiaires.
Au niveau humain, le stage a fourni à l'étudiant une vision réelle du monde des expatriés sur le
terrain, dans toutes ses nuances positives et négatives. En premier lieu, la présence d'autres
opérateurs humanitaires dans la même ville (ou village, quartier, etc.) s'avère utile dans le cas ou un
réseau se crée et des échanges d'avis, idées, informations se dégagent. Clairement, dans une ville
telle que Ouagadougou, grande capitale ou le monde des associations et des organisations est
présent depuis longtemps, ce type de réseau est désormais consolidé et des points de repère sont
connus par tous les expatriés (au contraire, le cas de missions en milieu rural diffère et d'autres
dynamiques se vérifient). Effectivement, le soutien réciproque entre opérateurs humanitaires lors de
difficultés (qu'elles soient de nature culturelle ou professionnelle) est fondamental pour réussir dans
le travail et donc contribuer efficacement aux activités menées par l'association.
Dans ce cas, l'étudiant n'a pas rencontré telle typologie de difficulté mais il a plutôt exploité les
connaissances à Ouagadougou pour apprécier l'environnement et connaître nombreux éléments
intéressants de la ville et de la région et obtenir des conseils afin d'améliorer sa contribution à
l'association.
Enfin, au niveau culturel, ce sont le quartier, la ville et ses habitants qui ont joué le rôle principal,
plutôt que la structure Koorongo. En effet, Ouagadougou est une ville extrêmement intéressante et
22
propose une infinité d'histoires, d’événements et d'aspects culturels non négligeables, inclus des
centaines de projets humanitaires innovants et réellement efficaces. La sphère culturelle ne peut que
favoriser la bonne réussite du travail, puisqu'elle motive et encourage à la découverte et à l'action.
De plus, cet esprit permet de mieux comprendre les dynamiques sociales et anthropologiques du
terrain, ce qui se révèle fondamental lors de la mise en place de toute sorte de projets de coopération
ou de développement. La volonté de comprendre l'histoire des burkinabés, des « hommes intègres »,
est l'élément clé pour créer une véritable coopération, par le transfert de compétences, l'échange
constant d'idées, la compréhension réciproque et la détermination.
23
PARTIE II : Développement de la problématique
Sigles et acronymes
AFD : Agence française pour le développement
APRICES : Association professionnelle inter-régionale des commerçants et exportateurs de sésame
BCEAO : Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
BDP : Balance des paiements
BF : Burkina Faso
BM : Banque mondiale
CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CFDT : Compagnie française pour le développement des fibres textiles
CPF : Confédération paysanne du Faso
DGPER : Direction générale de la promotion de l'économie rurale
EICV : Enquete intégrale sur les conditions de vie des ménages
FAC : Fond d'aide et de coopération de la France
FAO : Food and agricultural organisation of united nations
FCFA : Franc des colonie françaises d'Afrique
FEB : Fédération des éleveurs du Burkina
FENAFER-B : Fédération nationale des femmes rurales du Burkina
FENOP : Fédération nationale des organisations paysannes
FEPA-B : Fédération des professionnels agricoles du Burkina
FILSAH : Filature du Sahel
FMI : Fond monétaire international
FNGN : Fédération nationale des groupements naam
FNJPA-B : Fédération nationale des jeunes producteurs agricoles du Burkina
GES-B : Groupement des exportateurs de sésame et autres oléagineux du Burkina
GPF : Grand producteur familial / Grands producteurs nationaux
GRAF : Groupe de recherche et d'action sur le foncier
IDH : Indice de développement humain
JNP : Journée nationale du paysan
MEF : Ministère de l'économie et des finances
NA : Nouvel acteur / Nouveaux acteurs
OCDE : Organisation pour la coopération et le développement de l'économie
24
OIF : Organisation internationale de la francophonie
OMD : Objectifs du millénaire pour le développement
ONEA : Office national de l'eau et de l'assainissement
ONG : Organisation non-gouvernementale
ONU : Organisations des nations unies
OP : Organisation paysanne
PIB : Produit intérieur brut
PVP : Procès-verbal de palabre
RAF : Réforme agraire et foncière
SCADD : Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
SEDELAN : Service d'édition en langues originales
SOFITEX : Société burkinabé des fibres textiles
SONABEL : Société nationale d'électricité du Burkina
SONACOR : Société nationale de collecte, de traitement et de commercialisation du riz
UE : Union européenne
UEMOA : Union économique et monétaire ouest africaine
UMOA : Union monétaire ouest africaine
UNPCB : Union nationale des producteurs de coton du Burkina
UNPR-B : Union nationale des producteurs de riz du Burkina
VIH : Virus d'immunodéficience humaine
WFP : World food programme
25
Annonce du plan
Une introduction générale à la thématique du mémoire débute le présent document, pour définir les
clés de lecture nécessaires à comprendre le fil logique et l'objet de la problématique centrale.
Le mémoire est constitué par trois parties subdivisées en trois sous-parties chacune.
Dans le premier chapitre, « Historique du développement agricole au Burkina Faso », nous allons
découvrir la situation burkinabé en terme de géographie, de climat, de typologies et modalités de
production agricole et enfin nous allons analyser en quelle mesure l'agriculture contribue à
l'économie du pays.
Dans le deuxième chapitre, « L'agrobusiness au Burkina Faso », une présentation du phénomène de
l'agrobusiness est fournie, à partir de la définition du concept, jusqu'à l'identification et description
des acteurs principaux du cas burkinabé et des dynamiques spécifiques de l'Afrique de l'Ouest et du
BF.
Le troisième chapitre représente un bilan de l'insertion et de la contribution – positive et négative –
des agrobusinessmen au Burkina, accompagné par l'analyse des perspectives du secteur primaire et
par la définition des solutions alternatives possibles. L'objectif est celui de comprendre comment
l'agrobusiness puisse devenir une solution saine, durable et respectueuse de l'environnement et des
personnes et en même temps être le moteur de l'économie burkinabé.
Enfin, une conclusion reprend le développement en le projetant sur la situation actuelle du BF de
façon impartiale. L'objectif est celui de comprendre sur quels facteurs les acteurs principaux de la
scène politique, agricole et commerciale burkinabé devraient se concentrer pour permettre à
l'agriculture de suppléer aux besoins du BF en termes de sécurité alimentaire et de revenus.
26
Introduction
Le présent mémoire se développe sur une problématique récente (ressortie à partir des années 1995
– 2000) et commune à plusieurs États du continent africain : l'application du concept de
agrobusiness et ses conséquences. Cette problématique concerne l'agriculture et le milieu rural
africain sur différentes sphères : économique, sociologique, anthropologique, politique et
commerciale. Pour chacune de ces sphères, nombreux acteurs jouent des rôles différents, lesquels
parfois sont liés, parfois ils ne le sont guère. Pour cette raison, l'analyse des facteurs fondamentaux
pour comprendre exhaustivement les dynamiques qui règlent ce domaine s'avère compliquée et les
variables présentes empêchent de formuler un jugement complet et donc de tirer des conclusions
nettes et définitives. En plus, le cas pris en considération, celui du Burkina Faso, diffère de tous les
autres cas africains et des véritables analogies sont rarement possibles à repérer.
En raison de ces aspects, le présent document s'avère une tentative de comprendre de façon générale
les éléments clés pour déterminer un moyen équitable, correct, respectueux de l'environnement et
des personnes et efficace pour valoriser l'agriculture burkinabé.
Le développement de telle problématique passe par une analyse de la situation burkinabé actuelle en
termes de productivité, de éléments favorables et défavorables à l'agriculture, par la définition du
concept de agrobusiness et l'adaptation de ses caractéristiques au cas burkinabé, par le bilan des
actions menées par les acteurs concernés dans le domaine agricole et commercial et enfin par la
formulation des perspectives et des solutions envisageables.
Une grande partie de ce travail s'appuie sur les rapports et les données réalisés et fournies par les
majeures experts de l'étude du secteur agricole au Burkina Faso : le Groupe de Recherche et
d'Action du Foncier (GRAF), le World Food Programme (WFP), le Ministère de l'Agriculture et de
la Sécurité Alimentaire (MASA) et le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) du Burkina
Faso.
27
1.Historique du développement agricole au Burkina Faso
1.1 Situation géographique et climatique
Comme décrit précédemment, lors de la présentation du BF dans la section « Contexte » du rapport
de stage, le Burkina est un pays de 274 200 km2 de superficie totale qui ne compte pas sur l'accès
direct à la mer et se situe dans la zone sahélo-soudanienne.
L'altitude moyenne ne dépasse pas les 400 mètres et le seul point culminant, le piton de
Ténakourou, est de 747 mètres. Le relief du pays se résume en identifiant deux parties
contrastantes : la pénéplaine centrale, laquelle couvre 85% du territoire burkinabé, avec une altitude
moyenne entre 150 et 350 mètres, et les plateaux du sud-ouest (région des Hauts-Bassins, celle qui
regroupe les villes de Bobo-Dioulasso et de Banfora), lesquelles culminent avec le Ténakourou.
Étant un pays à climat tropical, le BF possède deux saisons contrastantes : la saison sèche, laquelle
démarre en octobre et se termine en mai-juin (avec des variations de quelques semaines selon les
régions) et qui se caractérise par la présence du vent Harmattan, un vent chaud provenant du
Sahara ; la saison des pluies, avec des précipitations entre 350 mm au nord et 1000 mm au sud-
ouest, laquelle se vérifie durant les quatre mois entre mai et septembre.
Cette mauvaise répartition de la variation pluviométrique – et spatiale (différence nord – sud) et
temporelle (quatre mois de pluies contre huit de sécheresse) – oblige les agriculteurs à mener des
cultures saisonnières et donc principalement de subsistance. De plus, le climat provoque une très
faible utilisation des terres pour l'agriculture : 17,49% en 2011 (DGPER), nonobstant un apport de
35,5% à la formation du PIB par le secteur primaire (FAOSTAT 2012).
En outre, le BF est divisé en trois grandes zones climatiques6 :
zone sahélienne (nord-est) : présente une pluviométrie de moins de 500 mm et une
végétation du type steppe à arbrisseaux et arbustes ;
zone soudano-sahélienne (centre) : zone intermédiaire par pluviométrie, température et
végétation ;
zone soudano-guinéenne (sud-ouest) : zone à précipitations supérieures à 500 mm durant la
saison des pluies, avec une végétation du type grande savane laquelle présente différentes
zones de forêts claires ;
Cette dernière zone est menacée par la forte croissance démographique (3,1% en 2006, dont 77% se
6 Voir Annexe 1: carte zones climatiques Burkina Faso
28
vérifie en milieu rural) et par le fait que l'agriculture se pratique de façon essentiellement extensive.
Ainsi, la déforestation a atteint une intensité préoccupante au niveau environnemental et
décourageant pour les productions : 1,3% du territoire a été privé du renouvellement de la
végétation sur la période 2005-2010.
Les aléas climatiques ne favorisent guère la production agricole du pays. Cette condition de
dépendance aux pluviométries favorables de la part des agriculteurs est certes une cause du haut
taux de malnutrition enregistré au BF : celle chronique est du 39% et celle aigue est du 19%
(TRAORÉ, AUDET-BÉLANGER, TRAORÉ, 2011).
Cependant, un tiers de la superficie totale du pays est à vocation agricole, soit 9 millions d'hectares,
dont 3,5 à 4 millions sont réellement exploités et performants (le reste du sol burkinabé est à
vocation pastorale pour 47% et 17% de forêts). En outre, le secteur primaire occupe plus de 70% de
la population active constituant la principale source de revenu et d'emploi du pays. Sur la période
1998 – 2003 il représente 40% du PIB et contribue pour environ 80% des exportations du BF.
1.2 Principaux produits et modalités de production
Le coton
L'histoire de la saga cotonnière burkinabé démarre, suivant l'information tirée par la tradition orale
du Faso, dans l'époque pré-coloniale, en tant que culture secondaire du pays (après l'élevage). En
1919, la colonie française de la Haute-Volta est créée et cinq années plus tard, celle du coton devient
une culture obligatoire imposée par le gouvernement de l'Hexagone. En particulier, les colons
s'aperçoivent du potentiel de la région occidentale du pays en raison des conditions écologiques
propices et des espaces déjà consacrés par les autochtones à la culture du coton.
Dans ce contexte, exactement à partir de 1951, la croissance de ce segment prend son élan : les
paysans producteurs de coton reçoivent l'appui institutionnel de la Compagnie française pour le
développement des fibres textiles (CFDT). L'accompagnement par cette institution joue un rôle
fondamental dans le développement de la filière du coton notamment grâce à la polyvalence des
contributions fournies : un encadrement technique efficace aux agriculteurs, lequel sera, jusqu'à
aujourd'hui, suivi par différents acteurs locaux et internationaux ; la création de projets de
développement agricole financés par la Banque Mondiale et le Fond d'Aide et de Coopération de la
France (FAC) ; la création de la SOFITEX (Société burkinabé des fibres textiles) en 1979, laquelle
29
comptait sur la participation de la CFDT avec un capital à hauteur de 34% (SCHWARTZ, 2008) ;
indirectement, l'attention portée à cette culture par les susdites opérations a mené à la création d'un
réseau de recherche scientifique favorisant l'amélioration des systèmes de production. Ce réseau a
convaincu les agriculteurs à accepter un « paquet technologique » (SCHWARTZ, 2008)
indispensable à l'intensification des systèmes de culture : l'utilisation des semences sélectionnées et
des engrais (naturels et chimiques) et l'application de produits phytosanitaires pour protéger les
plantes.
Donc, en général, à partir de la tradition, traduite par l’intérêt des paysans envers la culture du coton
en tant que source de revenus, et puis avec les importants appuis institutionnels entamés par celui de
la CFDT, le coton reste le produit le plus valorisé de l'agriculture burkinabé.
Néanmoins, à partir de 2006, le BF a connu un véritable « boom minier » qui a provoqué la chute de
la contribution en pourcentage des produits agricoles dans les exportations du pays, parmi lesquels,
clairement, le coton. L'or non monétaire contribue avec un poids de 79,4% dans le total de la valeur
des exportations en 2012. En 2009, le métal jaune représentait 43% des produits exportés ; il a donc
connu une hausse de 36,4% en trois ans (toutes les données font référence à la balance des
paiements 2012 rédigée par la BCEAO et le MEF).
Nonobstant la position prédominante de l'or – laquelle d'ailleurs détermine une balance
commerciale excédentaire de 108 482 millions de FCFA en 20127 – les exportations du coton en
masse ont affiché une valeur de 167 154 millions pour la même année, marquant une hausse de
28,5% sur un an. De plus, le prix moyen à l'export du coton fibre a augmenté de 6,4%, passant de
931 978 FCFA la tonne en 2011 à 991 669 en 2012. En raison de cette hausse due à l'augmentation
du prix plancher annoncé au producteur de 210 FCFA/kg à 245 FCFA/kg, en 2012 les sociétés
cotonnières ont exporté 28 971 tonnes en plus par rapport à l'année précédente.
Malheureusement, le manque de moyens techniques avancés, en appui à la simple production et
vente du coton brut (ni tissé ni filé), ainsi que la volatilité des cours sur les marchés internationaux,
ne permettent pas aux producteurs burkinabés de valoriser véritablement leur agriculture de rente.
Cet aspect pénalise le pays au niveau de l'insertion dans le marché international, malgré le BF
résulte l'un des pays majeur de l'Afrique de l'Ouest pour la production de coton (en 2005-2006, le
BF a été le majeur producteur africain de cette matière première agricole). L'importance de cette
filière est témoignée aussi par la couverture des exploitations diffusées sur le territoire : la culture
7 Voir Annexe 2: compte de transactions courantes Burkina Faso, 2012
30
du coton est pratiquée dans 36 des 45 provinces en 2006 (SCHWARTZ, 2008). Ainsi, malgré ce
titre, tout est remis en question chaque fois que la filière connaît une crise, voire à cause des baisses
des cours sur les marchés internationaux, et à cause des aléas climatiques.
Pour prouver l'absence d'une évolution de l'industrie textile, laquelle soutiendrait ce segment du
secteur primaire, il suffit de regarder le nombre des entreprises de filature présentes au Faso : une
seule, la Filsah (Filature du Sahel), est active depuis 1999 et produit des fils de qualité destinés à
l'exportation. De même, on considère le cas d’un des produits dérivés du coton traditionnellement
burkinabé, le Faso Dan Fani (en dioula : le pagne créé au Faso), pour prouver le manque
d'organisation dans l'exploitation du coton. Une fois le coton filé auprès de Filsah, à part les tonnes
destinées à l'exportation vers l'Europe et le sud-ouest asiatique, le reste est vendu en détail dans tous
les marchés principaux des villes du Faso. Les femmes expertes en tissage achètent ainsi les fils
pour en faire du Faso Dan Fani. Très souvent, elles se réunissent en associations (lesquelles ne
dépassent pas les cent membres) pour produire et vendre le Faso Dan Fani à l'intérieur du pays, en
profitant rarement de la vente à l'extérieur. Elles demandent des financements à l'état pour créer des
véritables usines, lesquelles seraient liées avec Filsah, pour valoriser la production du Dan Fani,
mais elles demeurent sans réponse.
Donc, la production de ce pagne traditionnel, qui pourrait faire l'objet d'exportations avec valeurs
ajoutées majeures par rapport aux ventes locales, est freinée par le manque de moyens
technologiques et par l'absence de chaînes de production organisées et structurées. En outre, ces
manques expliquent également la faible compétitivité sur le marché mondial du coton, au sein
duquel le Burkina Faso subit la concurrence de pays tels que les États-Unis, la Chine et le Brésil.
Néanmoins, la concurrence ne s'avère cruelle qu'au niveau de la quantité, puisque pour ce qui
concerne les prix, la récolte manuelle laissant la matière intacte et propre, ils s'avèrent très
compétitifs par rapport à ceux proposés par les sud-américains (245 FCFA/kg pour les burkinabés
contre 479 FCFA/kg pour les sud-américains) (HAUCHART, 2006). Au contraire, les vrais
concurrents sont les États-Unis et la Chine, lesquels profitent de leurs immenses budgets pour
subventionner les producteurs locaux et de leurs opérations de dumping économique à l'échelle
internationale: actions que le Burkina ne peut évidemment pas se permettre.
Finalement, le potentiel du segment coton au Faso est réellement important : des nouveaux outils de
production, stockage et distribution, mais surtout l'évolution du maillon de la transformation qui
demeure embryonnaire, pourraient concrètement faire de cette filière le point fort du secteur
primaire et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de certains milieux ruraux du pays.
31
Les céréales
Selon les données fournis par la BCEAO et le MEF dans la balance des paiements du Burkina de
2013, les céréales occupent une place importante dans l'économie du pays. Ils dominent la
production agricole avec en moyenne plus de 77% des superficies totales et avec une contribution à
la production totale de 71% dans la période 2001 – 2010.
La consommation de céréales à l'intérieur du Faso est très importante – le riz et le maïs au milieu
urbain, le sorgho et le mil au milieu rural, sont les premières sources d'alimentation de la
population, avec les principaux produits de l'élevage8 – par conséquent leur production s'avère
l'objet des attentions des politiques et des réformes du gouvernement depuis plusieurs décennies.
Étant l'objet de la consommation interne, dans la plupart des petits villages, la production céréalière
demeure le résultat d'une agriculture de subsistance de type extensif.
Au niveau national, la production des céréales est dominée par le sorgho et le mil, respectivement à
44% et 31% de la totalité, suivis par le riz (21% et une production de 2572 kg/ha) et le maïs (4%,
1944 kg/ha) (FAO, 2013).
En terme de valeur ajoutée, le riz et le maïs ont les plus fortes valeurs nettes à l'hectare, ce qui
provoque le fort intérêt par le gouvernement à financer la production des deux céréales, surtout dans
le cadre des politiques pour la sécurité alimentaire et pour la réduction de la pauvreté.
Cependant, le pays n'est pas encore autosuffisant pour le riz et il doit recourir à des importations
copieuses (le riz est le produit le plus importé parmi les denrées alimentaires). En effet, pour ce qui
concerne le riz, le gouvernement burkinabé a mis en place des mesures d'aide aux producteurs,
notamment à partir de 2008.
Premièrement, les droits de douane à l'importation ont été suspendus, fixant le prix plancher du riz
paddy à 128 FCFA/kg en 2009. Deuxièmement, notamment après la crise de 2008, le gouvernement
du BF a soutenu la riziculture à travers l'intensification de l'encadrement des producteurs
(subvention des engrais jusqu'à 50% du total, distribution de semences améliorées) et à travers
l'achat du riz auprès des producteurs nationaux. (WFP, Country Report).
Ces mesures, accompagnées par la participation de l'État à l'acquisition des intrants par les
riziculteurs, ont fortement changé les résultats de cette filière dans la période post-crise : de 195 102
tonnes de riz produits en 2008 à 218 804 tonnes en 2009 jusqu'au pic de 270 658 tonnes en 2010
(FAO, 2013). En outre, l'État a proposé la répartition des marges parmi tous les acteurs de la filière :
producteurs (30 FCFA/kg), transformateurs (15 FCFA/kg), grossistes (10 FCFA/kg), détaillants (15
8 Voir Annexe 3: profil des dépenses alimentaires de base durant la décennie 2000 au Burkina Faso
32
FCFA/kg) (FAO, 2013).
Malgré ces résultats positifs et le fait que la riziculture soit l'activité la plus rentable du segment au
niveau de la valeur ajoutée, le mil et le sorgho sont encore les céréales les plus produites au BF. En
effet, il suffit de regarder la contribution des différents produits pour constater qu’une majeure
partie du territoire devrait être consacrée à la riziculture.
Pour ce qui concerne le mil, le maïs et le sorgho, ils demeurent des produits de consommation
interne, lesquels sont rarement ou jamais échangés à l'extérieur. Pour cette raison, ces céréales n'ont
pas connu un véritable avancement en termes d’intensification et diversification de la production ni
en termes d’innovations technologiques appliquées à leur culture.
Néanmoins, pour faire face à la crise alimentaire engendrée par celle financière mondiale de 2008,
le gouvernement a soutenu leur production à travers la distribution de semences améliorées et des
subventions pour l'achat de moyens techniques de base et d'engrais, même si en moindre mesure par
rapport au cas du riz. En outre, le gouvernement a focalisé l'attention sur la création de stocks de
sorgho et de maïs avec l'objectif de garantir la sécurité alimentaire (surtout en zone rurale) dans la
période 2008 - 2012.
Donc, ces produits non-échangés ne constituent pas l'objet de politiques agricoles importantes et par
conséquent ne sont pas considérés en tant que moyens de croissance économique.
Sésame
Selon le Rapport Pays de la FAO daté de juillet 2013, « la filière sésame connaît une absence de
décisions et de mesures de politiques remarquable. La culture du sésame est certes soutenue à
travers une série de projets et de programmes mais le gouvernement n'a pas pris dans la période
2005 – 2010 de décision visant à soutenir la production, la transformation ou la commercialisation
de cette culture ». Néanmoins, le sésame est un produit qui pourrait équilibrer les différences de
production agricole entre la zone aride (Sahel, Nord et Centre-Nord) et la zone plus fertile du Sud-
Ouest (Hauts-Bassins, Cascades, Boucle du Mouhoun) du BF.
En effet, le sésame est une culture praticable sur des terres dégradées (sauf celles inondables), tels
que les sols de la zone climatique supérieure du BF dénommé zone sahélienne. Pour cette raison la
culture du sésame apparaît dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable
(SCADD), mise en place à partir du 3 février 2012 lors de la Conférence Internationale pour le
financement de la SCADD à Paris. Cette stratégie vise à corriger le déficit chronique de la balance
commerciale à travers la promotion du secteur primaire. Différentes sont les mesures prévues par la
33
SCADD : la promotion des pôles de croissance (notamment celui de Bagré, réalisé par la Banque
Mondiale), le développement des filières porteuses, la diversification de la production et
l'accompagnement institutionnel pour l'augmentation des exportations.
L'évolution de la production de sésame pendant la dernière décennie est plutôt encourageante : de
2008 à 2012, la production brute a progressé avec un taux de croissance moyen par année de 20,4%,
aboutissant à un chiffre de 100,5 milliers de tonnes en 2012. Pour ce qui concerne les exportations,
les cours mondiaux des produits favorables, elles ont augmenté de 47,9% en moyenne annuelle
depuis 2008 (BDP 2013).
Malgré ces chiffres positifs, les producteurs ne sont pas organisés. Un encadrement desdits doit être
envisagé par le gouvernement, pour permettre la spécialisation des producteurs, ainsi que la création
d'une véritable filière, éventuellement en se référant à l'exemple du coton (appui institutionnel,
création d'une entreprise porteuse, recherche scientifique, valorisation des exportations). En outre,
les politiques de soutien à la filière devraient concerner la transformation du produit, puisque
jusqu'à présent la transformation est menée par des acteurs artisanaux et semi-artisanaux lesquels
rarement forment des entreprises pour percevoir un profit satisfaisant. En effet, la transformation est
pratiquée par des petites pâtisseries qui ne proposent leurs produits qu'au niveau local. Néanmoins,
la présence d'acteurs professionnels dans la sphère de la commercialisation du sésame a mené à la
création de la GES-B (le Groupement des Exportateurs de Sésame et autres oléagineux du Burkina
Faso), de l'APRICES (l'Association Professionnelle Inter-régionale des Commerçants et
Exportateurs de Sésame) et du Groupe Noyau Sésame, lesquels favorisent l'exportation du sésame
et des produits dérivés et capturent l'attention du gouvernement pour faire du sésame un produit à
haute rentabilité pour le BF.
1.3 Contribution de l'agriculture à l'économie du pays
La contribution du secteur agricole à la croissance économique est strictement liée aux oscillations
des deux autres secteurs. Notamment, on observe le phénomène de la relation entre coton et or se
disputant pour le rôle de produit dominant la production et les exportations burkinabés. Se disputer
cette place signifierait garantir de subventions supplémentaires pour faire avancer un ou l'autre
secteur ; à l'heure actuelle, le secteur minier bénéficie de majeures attentions par rapport à la filière
coton. Après la crise financière globale et par la suite alimentaire de 2008, la recherche de nouvelles
sources de revenus ont mené à la découverte d'importantes réserves d'or au BF. En conséquence, la
production de coton a connu une baisse d'attention par les investisseurs étrangers et par le
34
gouvernement qui a provoqué une chute de la contribution du secteur primaire à la croissance
économique du Faso9 (FAO, 2013).
En règle générale, le secteur primaire occupe la deuxième position après le secteur tertiaire, lequel
domine la contribution à la croissance économique depuis vingt années. Le secteur primaire
contribue, sur la période 1990 – 2010, à 33% de moyenne annuelle au PIB du BF10 (FAO,2013).
Une analyse de l'évolution de la part du primaire sur les vingt dernières années montre : une forte
hausse, de 1990 au 1996, de 27% à 35% du PIB ; une légère baisse jusqu'à 34,1 en 2006 ; enfin une
nouvelle baisse tendancielle due notamment à la susdite crise de 2008 (FAO,2013). Ce dynamisme
et la marge d'amélioration des techniques agricoles pour chaque filière sont susceptibles d’accroître
l'importance et la contribution de l'agriculture au PIB du pays.
Le contexte de cette contribution est dominé par les petits producteurs familiaux pendant toute
l'histoire du Faso, jusqu'aux années '90. La population vivant en grande majorité en milieu rural,
subvient à ses besoins en pratiquant une agriculture de subsistance. « Les petits producteurs qui
exploitent une terre familiale produisent 70% de la production totale des denrées agricoles »
(TRAORÉ, AUDET-BÉLANGER, TRAORÉ, 2011).
L'agriculture constitue de ce fait la première source de revenus pour les burkinabés, malgré la
position dominante du tertiaire pour contribution au PIB. Ce sous-secteur du primaire « fournit au
total 44,7 % des revenus des ménages dont 24,3% pour l'agriculture (au sens production végétale) et
20,4% pour l'élevage. À cela il faut ajouter les revenus tirés de la pêche/aquaculture, de l'artisanat et
de l'exploitation forestière » (MASA, 2013).
9 Voir Annexe 4 : contribution des secteurs au PIB du Burkina Faso (FAO,2013)10 ibid
35
2. Agrobusiness au Burkina Faso
2.1 Définition, application de l'agrobusiness et particularités du cas burkinabé
Définition
La première formalisation de la notion d’agrobusiness (ou agribusiness, en préservant la version
anglaise) apparaît en 1957 dans la recherche conduite par John H. Davis et Ray A. Goldberg de
l'Université de Harvard : « A concept of agribusiness ». La définition donnée par les deux
chercheurs de Harvard est toujours valable et ainsi récite : "Agribusiness means the sum total of all
operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies; production operations on
the farm; and the storage, processing, and distribution of farm commodities and items made from
them". L’agrobusiness est constitué par l'ensemble des opérations concernant la production, la
transformation, la distribution de tout produit agricole. Il s'agit donc d'une notion très vaste, qui se
réfère à une multitude de procès, opérations, aspects, éléments et phénomènes concernant toujours
l'agriculture.
Le mot agrobusiness a été créé pour permettre la définition d'une relation intime, qui naquit lors de
la création spontanée d'une interdépendance entre la ferme (sa production) et tous les services
externes qui contribuent à la valorisation de telle production. En effet, le terme agrobusiness définit
un processus qui date de presque 150 ans (DAVIS, GOLDBERG, 1957) et qui se vérifie lors du
dépassement de l'agriculture de subsistance par une famille d'agriculteurs. À partir du moment où la
production familiale surmonte le besoin fondamental pour nourrir le foyer, c'est-à-dire quand un
surplus se crée, le commerce se lie à l'agriculture. La famille ne consume désormais qu'une seule
partie des produits et le reste devient l'objet d'une transaction commerciale. Ce processus nécessite,
ensuite, d'une série d'outils et/ou services pour être accompli : savoir rentabiliser les ventes,
communiquer la disponibilité à la vente ou à l'échange, gérer les opérations de conservation des
produits, etc. Tels services liés à l'agriculture sont à la base de la création du concept
d’agrobusiness.
Aujourd'hui, les opérations externes liées à la transformation, à la distribution et parfois à la
production elle-même sont effectuées par des acteurs tiers. Tous les services fournis par ces acteurs
deviennent fondamentaux pour la production et sont au service de l'amélioration de telle filière ou
telle entreprise. L'agriculteur moderne est un spécialiste qui confine ses tâches à la pure production
36
de cultures ou à l'élevage. Les fonctions de stockage, de traitement et de distribution des produits
ont été largement transférées à des entités externes. Une interdépendance a donc été créée et
aujourd'hui, il est difficile pour l'agriculteur et ses collaborateurs externes d’être séparés. Il s'avère
nécessaire de comprendre dans quelle mesure ce lien puisse servir ou desservir l'agriculture, à partir
des particularités spécifiques de chaque agriculture traditionnelle.
Apparition de l'agrobusiness en Afrique de l'Ouest et au Faso
La notion d’agrobusiness dérive notamment d'une manière de profiter de l'agriculture qui est propre
à l'Occident et à l’extrême Orient. Ainsi, il s'avère qu’un tel concept fut importé de l'extérieur à la
culture de l'Afrique de l'Ouest. L'agrobusiness est envisagé par les gouvernements, à partir des
années '90, comme l'instrument fondamental pour garantir l'autosuffisance alimentaire, pour rendre
moderne et compétitive l'agriculture africaine et pour favoriser l'insertion des pays de l'Afrique
subsaharienne dans le marché international, à travers la professionnalisation des agriculteurs,
l'injection de capital à faveur du secteur primaire, la modernisation des moyens techniques agricoles
(GRAF, 2011). En particulier, les gouvernements soutiennent avec vigueur la constatation que les
services ajoutés par l'agrobusiness à l'agriculture traditionnelle – la transformation après récolte, la
logistique, la commercialisation, la gestion de la qualité et des stocks, la recherche scientifique, la
finance – puissent contribuer à une croissance à long terme qui manque aujourd'hui dans la majorité
des pays de Afrique de l'Ouest.
En effet, nonobstant une croissance du PIB11 satisfaisante durant les dix dernières années, il est
constaté que celle-ci ne couvre que les courts et moyens termes, à cause du fait que les seules
grandes contributions à la croissance dérivent de l'exportation de ressources primaires, telles que les
minéraux, le pétrole et les produits agricoles de base.
Pour ce qui concerne le Burkina Faso, la notion d’agrobusiness a été importée à partir de la
deuxième moitié de la décennie 1990 – 2000. Les chefs d'états imputant les petits et les grands
producteurs familiaux de ne pas suppléer aux croissants besoins alimentaires du pays, l'agrobusiness
(et l'implication massive d'acteurs privés dans l'agriculture) apparut comme la solution idéale pour
créer un élan vers la croissance économique durable sur le long terme.
Le gouvernement explique ainsi la nécessité d'un tel changement dans une interview apparue dans
11 Voir Annexe 5: évolution du PIB et du PIB par tête Burkina Faso
37
« Le Pays » du 18 juillet 2002 (reporté plus tard par le GRAF dans leur analyse) : « […] un manque
de professionnalisme terrible. Nous avons des paysans pauvres qui étaient liés (et qui le sont
toujours d’ailleurs) à une agriculture de subsistance… Les exploitations familiales dont on parle
aujourd’hui, toutes regroupées, ne produisent pas plus que 2 ou 3 fermiers européens ou américains.
Le paysannat, c’est bien beau, mais il lui faut une autre dimension, celle de l’entreprenariat agricole
» car « on n’a jamais vu, dans aucun pays, une agriculture émerger sans des professionnels, des
gens qui viennent d’autres branches pour acquérir ou diffuser des connaissances et gagner leur vie
(…) qui vont avoir des superficies plus grandes, employer même des ouvriers agricoles ».
De plus, il s'avère nécessaire d'ajouter aux piètres performances de l'agriculture (dont les causes
sont naturelles et humaines) l'incapacité de la part de l'État de régler ce secteur et d'appliquer des
politiques agricoles efficaces, en tant que moteur de la recherche de solutions alternatives pour
l'agriculture. En effet, toute tentative de la part du gouvernement d'encadrer les agriculteurs résulte
vaine jusqu'à présent : à partir de la Réforme Agricole et Foncière de 1996 jusqu'à sa modification
de 2008. L'application des lois et reformes s'avère presque impossible au milieu rural.
Les modalités de changements du secteur primaire envisagées étaient les mêmes que pour toutes les
autres applications de l'agrobusiness dans le monde : modernisation des moyens de production,
spécialisation et appel aux acteurs externes pour la commercialisation ainsi que la distribution,
appui de la recherche scientifique pour la diversification des cultures.
Au Burkina, le concept a été formalisé lors d'une rencontre baptisée « Forum des nouveaux
acteurs », tenue à Bogandé en 1999. L'objet du Forum était la conceptualisation des moyens d'appui
aux nouveaux acteurs, lesquels auraient pu investir dans le secteur primaire burkinabé (notamment
sur la filière coton et dérivés) et donc trouver une solution pour intégrer lesdits acteurs dans le
système d'agriculture traditionnelle au BF.
Nonobstant les justifications – concernant le besoin de divulguer l’agrobusiness au BF – employées
par le gouvernement burkinabé qui paraissaient vraisemblables, elles négligeaient la présence,
depuis une décennie, de producteurs familiaux qui étaient en train de se développer et de devenir
déjà de véritables « agrobusinessmen ». Par volonté de moderniser la production, par capacité
technique de gérer les stocks, par développement des filières de transformation des produits et par
propension à l'exportation, les producteurs familiaux burkinabés possédaient l'élan pour rentrer
potentiellement dans la catégorie de l'agrobusiness. La majorités des filières déjà en développement
pendant les deux décennies précédentes, à partir de la révolution de Sankara12 suggestionnaient déjà
12 Thomas Isidore Noël Sankara (21 décembre 1949 – 15 octobre 1987), politicien, militaire et révolutionnaire
38
au début la « collaboration » entre agriculture et commerce, pour répondre au besoins alimentaires
du Faso.
Donc, il paraît évident que l'un des critères fondamentaux pour juger l'impact de l'application de
l'agrobusiness au BF réside dans le rapport entre les nouveaux acteurs, que nous allons définir et
découvrir dans le chapitre suivant, ainsi que les grands producteurs familiaux qui géraient
l'agriculture avant de leur arrivée.
2.2 Les nouveaux acteurs
Qui sont les nouveaux acteurs ?
Pour définir cette catégorie de nouveaux acteurs, il s'avère nécessaire de pointer l'attention sur la
différence fondamentale entre agriculture familiale (ou paysanne) et agro-entreprises (représentées
par des agrobusinessmen). Dans l'ouvrage Défis agricoles africain, sous la direction de Jean-Claude
Devèze, ce dernier constate la susdite différence et ainsi déclare : « Les agricultures familiales
peuvent être définies comme des organisations de modes de vie et de production caractérisées par
les liens étroits existant entre les activités sociales et économiques, les structures de la famille et les
conditions locales (terroirs, groupes d'appartenance) ; on les appelle aussi agricultures paysannes
pour souligner leur forte insertion dans un « pays », au sens de terroir. Les agro-entreprises se
caractérisent par un recours important au salariat agricole et à des capitaux pour investir »
(DEVÈZE, 2008).
Pourtant, les nouveaux acteurs de l'agrobusiness burkinabé ne peuvent pas être catégorisés avec la
précision propre à la définition de Devèze. Les raisons sont plusieurs :
l'origine professionnelle des nouveaux acteurs, et donc le niveau de compétences techniques
dans le domaine agricole. Dans l'étude de 2011, le Groupe de Recherche et d'Action sur le
Foncier individualise trois typologies de nouveaux acteurs, en se référant aux zones prises
en considération par le rapport (la province du Houet, au sud-ouest du pays, et la province
burkinabé, acteur principal de la révolution burkinabé du 4 août 1983. Il fut assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'état par Blaise Coimpaoré.
39
du Ziro, dans le centre-ouest13). Premièrement, il est constaté la forte participation à
l'agrobusiness par des cadres supérieurs du secteur public (36%) et privé (34%) pour 70%
du total des acteurs repérés. Deuxièmement, l'élite de l'armée (très souvent des retraités déjà
engagés dans d'autres types de commerce, voire l'import/export de véhicules, voire le
transport ou les infrastructures) se lance de plus en plus dans l'achat et l'exploitation agricole
de terres. Enfin, plusieurs professionnels de différents secteurs se retrouvent : médecins,
religieux, juristes, artisans, lesquels achètent des petits terrains et seulement parfois
exploitent la terre. Donc, l'origine professionnelle des NA modifie profondément la structure
du développement du secteur agricole si ceux-ci sont censés représenter la nouvelle vague
d'entrepreneurs du secteur agricole. Notamment, parce que le recours aux acteurs externes
(souvent provenant d'Europe ou d'Asie) spécialisés dans les techniques de culture de tel ou
tel autre produit devient un poids lourd dans tout type d'opération. Dans le chapitre 3, nous
allons comprendre les dynamiques compliquées qui se créent lorsqu'une négociation, un
achat, un accord, un partenariat, un contrat se réalise entre un NA ne connaissant pas la
culture et la tradition burkinabé et un acteur local.
le vrai intérêt de tel ou tel acteur, parce que parfois l'acquisition d'une terre est déclarée
comme volonté de contribuer à la croissance économique par l'agriculture, mais en réalité ne
représente qu'un indicateur de fierté et de bien-être.
Les cas des provinces du Ziro et du Houet
L'élan mené par le soutien du gouvernement portant à l'intensification des pratiques de
l'agrobusiness pendant les années '90 a conduit principalement vers les terroirs de deux provinces
du BF : le Ziro (centre-sud du pays) et le Houet (sud-ouest). Le GRAF a réalisé une étude sur les
deux cas pour produire un bilan des activités par les NA sur les deux territoires.
Le choix des provinces analysées a été dicté en raison du fait que celles-ci représentent
exhaustivement la situation générale du pays.
Le Ziro, dont le chef-lieu est Sapouy, est une province située à sud de la capitale Ouagadougou et il
a été visée par les intérêts des NA pour différentes raisons : la proximité à la capitale, environ 100
km (cette raison inclut le fait que la majorité des NA, cadres et militaires, vivent et travaillent dans
13 Voir Annexe 6: carte des provinces du Houet et du Ziro, Burkina Faso
40
la capitale administrative et économique, Ouagadougou) ; le récent bitumage de la route pour
Sapouy, lequel favorise l'accessibilité à la zone ; la présence d'une réserve foncière importante et la
présence de cultures déjà existantes au niveau rural. Suivant les données recueillies par le GRAF,
les NA ont acheté principalement des terres de moyenne ampleur : le 52% des NA possèdent des
terrains de moins de 20 ha ; un tiers d'entre eux ont acheté des superficies entre 21 et 50 ha ; les
grands terrains (entre 51 et 100 ha) sont dans les mains du 13% des NA et les très grands (plus de
100ha) du 2% (GRAF, 2011). Cette province est exploitée principalement à travers quatre
typologies de stratégies, lesquelles concernent différents produits : agriculture de type extensive
(porte sur des cultures annuelles et les principaux produits en sont le maïs, le niébé, l'arachide et
parfois le sésame) ; agriculture extensive et de diversification (les investissement visent
l'arboriculture - de manguiers, anacardiers et jatropha - et l'élevage bovin) ; stratégie d'attente (les
NA possèdent les superficies mais ils ne les exploitent pas : parfois il s'agit de terrain destinés à la
construction de villas, parfois le but est celui de constituer un patrimoine personnel pour le NA en
attendant le bon moment pour se lancer dans un marché, parfois il s'agit d'une simple mode, l'achat
d'un terrain comme symbole de puissance économique personnelle) ; enfin, il existe une stratégie de
mise en œuvre progressive d'un projet (dans ce cas, le NA achète le terrain avec un projet mais il ne
dispose pas des moyens pour l'exploiter et pour le rendre actif et rentable). Enfin, il est constaté un
niveau moyen d'exploitation assez faible par rapport aux attentes longtemps induites par le
gouvernement : seulement 39% des terrains acquis sont effectivement exploités et productifs14.
Le Houet (la ville de Bobo-Dioulasso en est le chef-lieu) est une province située dans la zone
climatique méridionale, celle plus fertile et avec une plus intense pluviométrie, la zone soudano-
guinéenne. Le cas du Houet est différent par rapport à celui de la province du Ziro puisque des
acteurs étaient déjà présents et actifs sur le territoire, avant que les NA recueillissent l'appel à
l'investissement par l'agrobusiness des années '90. En effet, des autochtones cultivaient déjà
abondamment les terres autour de Bobo-Dioulasso et dans le cours de l'histoire ils furent confrontés
à différentes vagues de migrants internes et externes intéressés par la fertilité du terroir : dont la
dernière est celle des NA contemporains. Tout d'abord, en 1974, lors des escarmouches entre BF et
Mali15, les habitants de la province du Houet se trouvèrent face à une forte migration des ethnies –
les peuls et les mossis, pour la majeure – du centre-nord et du nord-est (zones plus fortement
14 « les chiffres sont basées sur des déclarations par les villageois lors de l’enquête » (GRAF, 2011)15 Escarmouches lesquelles aboutiront dans la Guerre de la Bande d'Agacher (14 – 30 décembre 1985), conflit
concernant la possession d'un terrain à la frontière entre Mali et Burkina Faso: résolu par le jugement de la Cour Internationale de Justice avec la division du territoire.
41
touchées par le conflit), lesquelles se réfugièrent dans l'accueillante zone soudano-guinéenne dans la
partie opposé du pays. En plus, d'autres mossis vivant au Niger et en Cote d'Ivoire se firent expulser
et au lieu de revenir dans leur zone d'origine, ils s'installèrent dans le Houet. Ces derniers
occupèrent plusieurs champs de la région visant à l'autosuffisance alimentaire, sans vouloir recourir
aux onéreux achats de produits de subsistance. Deuxièmement, à rebours, les premiers autochtones
de la ville de Bobo-Dioulasso, les Bobò, dûment subir l'arrivée des peuples nomades de l'empire
Malinké (l'empire du Mali dominé par l'ethnie des Malinké, laquelle aujourd'hui regroupe les
ethnies des Dioulas, Diakhankés, Soussous, Bambara, Jalonkés pour un total d'environ 4 000 000
d'individus). En effet, comme décrit précédemment16 les cultures traditionnelles des Bobò furent
bouleversées par les nouvelles méthodes apportées par les Dioula. Donc, aujourd'hui, les autorités
locales n'acceptent pas avec bienveillance les investissements étrangers (tels que ceux qui se
présentent comme moteur de l'agrobusiness à partir des années 2000) et demeurent réticents face
aux propositions d'achat par les NA à cause de faits historiques. Néanmoins, la promotion de
l'agrobusiness par le gouvernement n'a pas été négligée. Les NA de la province du Houet sont les
acteurs locaux, très souvent résidents à Bobo-Dioulasso depuis plusieurs générations, lesquels
profitent des terrains déjà possédés ou ils en achètent de nouveaux comme investissement. À cause
de la présence d'anciens propriétaires et de grands producteurs familiaux déjà actifs dans la région,
les acquisitions des NA sont moins importantes en superficie par rapport au cas du Ziro. 84% des
NA possèdent des petits terrains (moins de 20 ha), 12% de 21 à 50 ha, 3% des grands terrains (de 51
à 100 ha) et seulement 1% ont acquis de très grands terrains (plus de 100 ha) (GRAF, 2011). Dans
la province du Houet, comme dans celle du Ziro, le taux d'exploitation demeure faible, à un taux
d'environ 39%. Néanmoins, il est constaté une importante différence si l'on considère le taux
d'exploitation des petites acquisitions (50%) et celui des grandes et très grandes (12%). En ce qui
concerne les stratégies d'exploitation appliquées dans la province du Houet, une analogie par
rapport à celles du Ziro est observée : stratégie d'agriculture extensive, stratégie d'agriculture
extensive et de diversification, stratégie d'attente et stratégie de mise en œuvre progressive d'un
projet original (GRAF, 2011).
16 cf. Rapport de stage: 1.1 Le Burkina Faso
42
2.3 Les grands producteurs familiaux et leurs performances avant l'arrivée des NA
Après une présentation générale des caractéristiques des NA, il s'avère nécessaire d’analyser les
acteurs qui portaient l'agriculture burkinabé avant l'arrivée du concept d’agrobusiness. Avec
l'analyse de leur réaction au phénomène de l'agrobusiness et aux investissements par les NA, nous
pourrons enfin tracer un bilan et comprendre si le bouleversement apporté par l'agrobusiness aux
traditions agricoles, à l'environnement et aux GPF est la voie pour un sain et efficace
développement agricole burkinabé.
Définition de GPF
La définition de « grands producteurs familiaux » dérive de la façon dont les burkinabés cultivent la
terre sur laquelle ils vivent et dont laquelle se procurent les aliments pour nourrir eux-mêmes. La
différence clé entre les NA et les GPF se manifeste par quatre critères fondamentaux : les GPF
possèdent la terre par héritage et depuis plusieurs générations, donc les terrains occupés et exploités
n'ont pas été acquis par échange ou transaction monétaire ; les GPF vivent sur le terrain qu'ils
cultivent ; des cultures de subsistance sont forcément présentes sur leurs terrains, en règle générale
les produits les plus consommés en milieu rural sont le mil et le sorgho ; le salariat n'existe pas dans
le milieu des GPF, uniquement les membres de la famille travaillent la terre et bénéficient des
produits et de la rente.
L'Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina (l'origine des GPF est clairement liée à la
production du coton au BF) a ainsi classifié quatre typologies de producteurs familiaux, selon le
niveau de leur équipement (au contraire, en règle générale les catégories sont déterminées par les
superficies exploitées) : les petites familles, lesquelles pratiquent la céréaliculture en rotation,
cultivent le riz sur des plaines alluviales ou implantent peu à peu des vergers ; les familles
moyennes, lesquelles cultivent les cotonniers et les céréales en rotation à l'aide de la traction asine
ou pratiquent de l'élevage pastoral ; enfin les grandes familles, lesquelles adoptent la culture
continue de céréales et élèvent les bovins de traction ou pratiquent les cultures cotonnières moto-
mécanisées17 (BAINVILLE, DUFUMIER, 2009).
17 Bainville S. et Dufumier M., 2009. Diversité des exploitations agricoles en zone cotonnière du Burkina Faso. AFD, SupAgroMontpellier, AgroParisTech
43
Performances de l'agriculture familiale avant l'agrobusiness
Suivant les données déclarées par le ministre en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire,
François Lompo, l'agriculture familiale contribue en moyenne à 34% au PIB national18. Pourtant, les
données fournies par la Banque Mondiale diffèrent de l'affirmation de Lompo : en 2014 la part de
l'agriculture dans le PIB est de 22,4%, dans l'histoire du BF il est constaté un pic de 40,5% en 1964
et le pourcentage le plus faible se révèle en 2000 avec 19,2%19. En moyenne, la contribution entre
1990 et 2000 est de 32,8%, tandis qu'une baisse pour la période 2001 – 2014 avec un taux de 24,3%
est enregistrée.
Ces chiffres sont évidemment à confronter avec le PIB national, lequel connaît une augmentation
continue depuis le 2001, allant de 2,633 milliards de dollars en 2001 jusqu'à 12,202 milliards en
201420. Donc, tandis que le pourcentage révèle une baisse de la contribution de l'agriculture au PIB,
la contribution réelle en richesse a fortement augmenté : en appliquant le pourcentage de la part de
l'agriculture aux chiffres du PIB le résultat montre que la progression de la productivité du primaire
a connu une hausse importante depuis 2000 (718,8 millions de dollars en 2001 contre 2733,2
millions en 2014) alors que dans les années '90 la productivité est résultée stable (de 761,2 millions
de dollars en 1990 à 914,4 en 1999, avec un pic de 1136 millions en 1994 et un creux de 689,1
millions l'année suivante).
Avec ces chiffres, considérant la véritable application des procédures prévues par le concept de
l'agrobusiness à partir de la décennie 2000-2010, une énorme différence en positif pour ce qui
concerne la productivité agricole au Faso est remarquée. Mais, si ces derniers chiffres paraissent
encourageants, ils ne correspondent pas aux performances des NA révélées par l'étude du GRAF et
de la FAO et représentées dans le sous-chapitre précédent. En effet, le taux d'exploitation des terres
acquises par les NA s'avère très faible et il peut en être déduit que la progressive augmentation de la
productivité agricole ne dérive pas totalement, des nouveaux acteurs de l'agrobusiness.
Cette affirmation est soutenue par le phénomène du développement connu par les GPF et par le fait
que ces derniers, en réalité, s'avèrent être les acteurs de l'agrobusiness burkinabé. Il est d'ailleurs
reconnu une spécialisation des familles d'agriculteurs dans le domaine de la gestion des stocks et de
18 cf. www.sidwaya.bf article du 23 avril 2015 : « 18e JNP: les problèmes de l'agriculture familiale cherchent solutions »
19 Voir Annexe 7 : part de l'agriculture dans le PIB national du Burkina Faso20 Voir Annexe 8 : PIB Burkina Faso
44
la commercialisation de leur produits (à partir du moment où ils divisent leurs champs entre les
produits de subsistance pour la famille et les produits destinés à la distribution).
Néanmoins, il est évident que ce développement est lent et subit les forts aléas climatiques, le
manque de spécialisation dans la transformation et l'absence de recherche scientifique pour rendre
plus efficace et efficient le secteur primaire participent à ce retard Ces problèmes sont aussi,
malheureusement, fortement liés à un manque de subventions et financements de la part de l'État
vers le milieu de l'agriculture.
45
3. Bilan et perspectives sur l'agrobusiness au Faso
3.1 Les changements apportés par les NA et l'agrobusiness
Après une présentation générale des NA installés au BF, il s'avère nécessaire de constater les
changements apportés par leur arrivée pour déterminer l'impact de l'agrobusiness sur le secteur
agricole burkinabé. En effet, l'arrivée des acteurs de l'agrobusiness a modifié plusieurs aspects de la
vie, des coutumes et des techniques des grands producteurs familiaux déjà présents au Burkina
(parmi lesquels, évidemment, les GPF), positivement et négativement.
Changements dans les transactions foncières au BF
Jusqu'aux années 2000, la terre, chez les producteurs familiaux, possédait un caractère inaliénable et
patrimonial, par lequel les terrains ne pouvaient être exploités par des tiers (hors famille) que par le
biais d'un prêt à durée indéterminée. Ce type de prêt, bien que formalisé uniquement par contrat
verbal nommé Procès-verbal de palabre (PVP), existait et était employé dans tout le pays. Il s'avère
nécessaire, pour comprendre les dynamiques des transactions et d'acquisition des terres décrites
dans le présent chapitre, de définir les acteurs de ce type de négociation chez les burkinabés du
milieu rural. La négociation pour une transaction foncière a gardé, avec l'arrivée des NA, les mêmes
procédures nonobstant les dynamiques aient été modifiées.
Les intermédiaires. Lorsqu'un NA (ou tout autre acteur, même du passé, voulant acquérir un
terrain déjà occupé par des paysans) exprime la volonté de vouloir acheter un terrain pour
toute sorte de raison, il doit se présenter à la communauté autochtone en approchant le chef
du village. Évidemment, le chef du village représentant le détenteur des droits coutumiers, le
NA doit obtenir le consensus du susdit par le biais d'un intermédiaire. En règle générale, ils
existent deux typologies d'intermédiaire au Faso : des professionnels représentant la
communauté ou simplement des natifs jouant le même rôle. Dans le premier cas, il s'agit de
personnes, très souvent des fonctionnaires, lesquels s'occupent de gérer l'administration de la
zone occupée par la communauté : ils peuvent s'avérer être des agents de services techniques
qui connaissent profondément le territoire (des administrateurs pour les services de
l'environnement, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, etc.) ou des commerçants
46
experts de la zone et avec des liens étroits avec la population ou encore des fonctionnaires
vivant en ville (instruits et formés) qui proviennent du village en question et qui ont gardé de
forts liens avec la communauté villageoise. Le deuxième cas est constitué par les natifs de la
zone en question. Ces hommes, très souvent illettrés mais avec beaucoup d'expérience dans
les négociations (voire par métier, voire par vocation), représentent les chefs coutumiers des
villages en question et font le rôle d'intermédiaire leur métier principal. Les deux catégories
opèrent de façons différentes, en raison de leur provenance et formation. Les premiers, se
contentent d'introduire les acheteurs au chef du village et présentent les règles d'acquisition
ainsi que les caractéristiques détaillées des terrains en question. Les deuxièmes, devant
rentabiliser leur rôle d'intermédiaire, non seulement ils proposent le même service offert par
la première catégorie, mais ils s'occupent aussi des services complémentaires à l'acquisition
des terrains : modification de contrats existants, aide aux négociations, interprétariat,
recrutement de la main-d’œuvre, consultation lors des achats du matériel, etc.
Les chefs de village. Ils sont, en règle générale, les détenteurs des droits coutumiers et ils
représentent donc le susdit caractère inaliénable et patrimonial de la terre. Néanmoins, il ne
s'agit pas toujours de chefs de village proprement dit. En raison de différentes
caractéristiques des villages et des villageois, parfois le détenteur des droits coutumiers est
désigné par le fils du chef de village, soit par un représentant de l'administration du village
(dans le cas, par exemple, où un Comité villageois de développement existe). Toute
transaction menée par l'acheteur doit passer par ce représentant après consultation de
l'intermédiaire. Cette figure s'avère très importante pour les dynamiques des transactions
puisque plusieurs variables jouent un rôle dans ladite : niveau d'expérience dans les
négociations, niveau d'instruction, approche à la vente et au prêt, disponibilité à la
coopération ou naïveté complète.
L'administration publique. Selon la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 l'administration et
les services techniques devraient régler à tout moment toute opération concernant les
transactions foncières21. Les agents sont censés éviter des problèmes de toutes sortes lors des
négociations, des PVP et des conclusions ou modifications des contrats de vente ou location.
Néanmoins, l'administration joue un rôle dans la forte minorité des transactions foncières,
voire par le manquement de sollicitation par le vendeur, voire par déloyauté de l'acheteur.
Les pouvoirs publics, jusqu'à présent, sont sollicités par les agrobusinessmen à titre
21 cf. RAF et www.Droit-Afrique.com
47
personnel lorsque des opérations techniques sont à effectuer après les négociations et la
« signature » du contrat : les labours, la délimitation des superficies, la consultation pour la
valorisation du terrain, etc. Récemment, les cas enregistrés des NA gonflant leurs terrains en
superficie avec la complicité de l'administration publique sont de plus en plus fréquents.
Dans le cadre des négociations entre les différents acteurs définis, l'arrivée des NA a modifié
plusieurs dynamiques qui jouent positivement ou négativement sur la productivité des terrains en
question.
Tout d'abord, l'insertion du concept de propriété privée et du fait de déclarer une valeur de la terre
pour la vente ou le prêt a bouleversé les valeurs même des terrains et de leur rentabilité.
Notamment, le changement le plus important a été la monétarisation des transactions foncières. La
vente et la location, selon le susdit caractère patrimonial et inaliénable de la terre propre aux
villageois de la tradition burkinabé, étaient effectuées par moyen de contreparties. Ordinairement,
les contreparties prévues pour l'exploitation d'un terrain étaient des produits de la terre ou de
l'élevage : chèvres, coqs, tabac, cola, dolo22, etc. Ces produits, durant la période 2000 – 2010, ont
été progressivement substitués par des sommes d'argent ou des services tels que la construction de
routes (pour relier le village au centre urbain le plus proche), de greniers, d'écoles ou églises, ou
encore des services liés au transport de personnes ou de marchandises (par exemple, si un village
manque de tracteur, mobylettes ou accès aux transports communs, le vendeur peut demander
l'intervention de l'acheteur dans ce sens). La méconnaissance de la monétarisation des transactions
par les producteurs familiaux a engendré plusieurs cas d'expropriation illicite par des NA qui ont
profité de la situation23.
En outre, la non-participation aux transactions de l'administration publique (dans certains cas il
s'agit de véritable exclusion perpétrée par les acteurs de la négociation) a provoqué un phénomène
d'installation non coordonnée des agrobusinessmen sur le territoire burkinabé, dont les
conséquences risquent de jouer sur le long terme. Par exemple, le manque de la formalisation des
transactions a empêché aux institutions d'enregistrer les espaces occupés et la première des
conséquences est la presque totale disparition de réserves foncières lignagères. Ce problème se
répercute sur la déforestation d'un territoire déjà assez en danger à cause des aléas climatiques.
Indirectement, l'acquisition « aléatoire » de terrains par les NA provoque un manque de travail pour
22 Le dolo est une bière de mil très consommé au Burkina Faso, surtout en milieu rural (dans certaines régions elle prend le nom de “Tchapalo”)
23 cf. GRAF, 2011
48
les jeunes en milieu rural, par faute de l'aridité des terrains ou par la simple diminution de la
productivité de la terre. Bien que les chiffres concernant l'emploi au milieu rural soient positifs, le
chômage afflige toujours plus les jeunes agriculteurs en raison de la faible rentabilité du secteur24.
Enfin, la tendance apportée par l'insertion des NA est celle du non respect des règles pour
l'acquisition des terres, et de la part des acheteurs, et de celle des vendeurs. De plus, la
monétarisation de la vente ou de la location des exploitations n'étant pas réglée par des normes
juridiques spécifiques, a mené les vendeurs à appliquer des contreparties qui diffèrent selon le statut
de l'acheteur : si celui-ci est un fonctionnaire ou un acteur étranger, le prix sera très élevé
(importantes sommes d'argent, services onéreux, contreparties en produits copieuses et temps des
négociations dilaté) ; au contraire, si l'acheteur se révèle un simple migrant (un mossi déplacé dans
la province de Houet, un fonctionnaire qui entretien des liens avec la communauté ou encore un
médecin ayant déjà eu un contact avec le village), la contrepartie sera modeste et le chef de village
n'appliquera pas de normes trop sévères pour ce qui concerne l'exploitation de la terre.
Ce phénomène déstabilise la bonne réussite des transactions foncières, puisque les intérêts et les
relations personnels priment sur l’intérêt général de la communauté et sur une bonne productivité de
la terre, en ne considérant pas les règles environnementales et les conséquences sur le long terme.
Mauvaise interprétation de la loi 034-2009/AN
À partir du 23 mai 1996 le gouvernement burkinabé a conduit une série de reformes pour organiser
le système législatif en fonction du domaine de l'agriculture. Cette date coïncide en effet avec la
promotion de la loi portant réorganisation agraire et foncière (RAF). Bien que l'intention de l'État
ait été celle de promouvoir la bonne gestion de l'aménagement des terres, la réalité montre des
maigres résultats : la loi ne travaille que sur la délivrance des droits. Donc, jusqu'à sa modification
annoncée le 6 mai 2008 (un article seulement fut rectifié), la RAF ne concernait que l'aménagement
des territoires au milieu urbain et elle fut ignorée presque totalement par les acteurs du foncière
burkinabé. Avec l'arrivée de l'agrobusiness et sa propulsion par l'État dans les années 2000, les
institutions s'occupant du primaire ont remarqué et cherché à combler un vide juridique visant la
réglementation des transactions foncières, pour favoriser l'insertion des NA dans le secteur. Cette
tentative fut la susdite modification, laquelle, néanmoins, ne produisit pas les résultats attendus. La
24 cf. Rapport de stage, 1.1 Le Burkina Faso
49
preuve en est l'absence totale de pouvoirs politiques dans le domaine des acquisitions des terres et
dans la gestion de l'aménagement : les règles ne sont pas respectées et aucun plan exécutif pour
l'application de la loi n’a été prévu. Au contraire, des effets négatifs de telles absences se produisent
jusqu'à présent : par exemple, le cas de la mauvaise interprétation de la loi 034.
L'article 36 de la loi 034 annoncée en 2009 stipule : « Sous réserve de l’identification des espaces
locaux de ressources naturelles d’utilisation communes identifiées et intégrées au domaine de la
commune concernée, constituent notamment des faits de possession foncière :
• la reconnaissance unanime de la qualité de propriétaire de fait d’une personne ou d’une famille
sur une terre rurale par la population locale, notamment les possesseurs voisins et les autorités
coutumières locales ;
• la mise en valeur continue, publique, paisible et non équivoque et à titre de propriétaire de fait
pendant trente ans au moins, de terres rurales aux fins de production rurale ;
• Les prêts et locations reconnus ou prouvés de terres rurales ne peuvent en aucun cas être
constitutifs de faits de possession foncière rurale. »
Cet article a été mal interprété dans plusieurs cas analysés par le GRAF. Effectivement, les
détenteurs des terres, lors de l'annonce de la loi, ont été sollicités à reconsidérer le statut de ceux qui
exploitaient leur terre : si leur cas coïncidait avec l'un de ceux exprimés par la loi, ils auraient dû
prévoir la possibilité de vendre la terre avant d’être expropriés de celle qui leur appartenait, mais
exploitée par des tiers. Autrement dit, les détenteurs ont subit de manière implicitement coercitive
(quand, en réalité, d'autres options alternatives existaient pour éviter la vente ou l'expropriation : le
renouvellement du prêt à long terme, la modification du contrat existant par PVP) la vente de leurs
terrains pour éviter l'expropriation sans gain. Par conséquent, nombreuses familles de producteurs
ont vu retiré leur patrimoine, lequel représentait la seule source de revenus.
En somme, l'ensemble des effets pervers analogues à celui présenté ci-dessus témoigne l'incapacité
du gouvernement de conduire le tant divulgué agrobusiness, montrant aussi le fait que la
participation de l'État dans ce type de processus et l'accompagnement progressif des acteurs
« traditionnels » du primaire soit nécessaire pour qu'une efficace intégration entre GPF et NA puisse
s'avérer.
50
Changement des modalités d'acquisition des terres par les NA
Précédemment aux années 2000, un seul moyen de pouvoir exploiter la terre appartenant à un tiers
existait : le prêt de longue durée. Ceci permettait à des agriculteurs de s'insérer sur un terrain donné
sans pour autant devoir l'acheter. Ce moyen a été le moteur de nombreux GPF et il a permis
l'expansion de nombreuses fermes et familles d'agriculteurs. Progressivement, en raison de la
création de familles stables dans le territoire d'un tiers, la majorité de ces prêts sont devenus des
prêts à durée indéterminée.
Cette typologie de prêt a été choisie par les NA aussi, lesquels l'ont ensuite transformé en règle
générale pour définir la propre installation dans un territoire. Dans les cas recensés par le GRAF et
par l'UNPCB, 62% des acquisitions par les NA se fait par prêt à durée indéterminée, 36% par achat
(dans ce cas les contreparties sont uniquement en argent, tandis que pour le prêt les négociations se
font suivant les dynamiques exprimées dans le paragraphe précédent) et 2% des acquisitions
s'avèrent le fruit d'un héritage.
Pour ce qui concerne les modes d'acquisition, récemment un problème se vérifie pour les familles
détentrices des droits coutumiers. Très souvent, dans les cas de prêts, des manques de
communication (ou de compréhension) se constatent entre le chef du village et son héritier. Si le
chef stipulait dans le contrat par PVP que le prêt aurait été renouvelable après une somme d'années
donnée, le fils peut (ou décide de) mal interpréter tel prêt comme se concluant par la vente.
Autrement dit, le fils, prétendant une contrepartie généreuse, change à l'insu des autorités la nature
du contrat du prêt à la vente. Donc, tandis que les autorités sont à connaissance d'un prêt, l'acheteur
est convaincu de posséder la terre. Ce type d'inconvénients se conclue souvent par des
expropriations par l'acheteur, lequel prétend l'expulsion des communautés habitant ces terrains.
L'exemple récent le plus important est celui du déguerpissement des populations des villages de
Kounkoufoanou et Kaboanga dans la région de l'Est, province de Gourma. Le cas présente des
dynamiques analogues à celle exprimées ci-dessus : le 18 février 2015, les villageois de la zone
pastorale de Kaboanga ont été menacés d’être déguerpis de leur terre puisque les exploitations de
type agricoles par eux perpétrées ont été jugées de illicites. Dans ce cas, la terre que ceux-ci
cultivaient avait été acheté par un tiers, lequel imposa au gouvernement la délimitation du territoire
acquis sans considérer la présence active d'une population. Encore une fois, la faute n'est
formellement attribuable ni au gouvernement, ni au tiers, ni à la population. Simplement, au fait que
51
aucune règle pour déterminer la possession du terrain fut appliquée.
3.2 Bilan de l'impact de l'agrobusiness
Les performances agricoles burkinabés, bien que susceptibles des aléas climatiques et des
dynamiques des marchés internes et externes, sont satisfaisantes et contribuent de façon non
négligeable à la forte croissance économique du pays25. Pour déterminer dans quelle mesure le
phénomène de l'agrobusiness a joué sur la croissance économique burkinabé, il s'avère nécessaire
de considérer si tel phénomène a freiné les facteurs défavorables à l'agriculture burkinabé.
Aléas climatiques
Pour identifier et quantifier l'influence des aléas climatiques sur la productivité du secteur agricole,
les indicateurs à prendre en considération sont nombreux et compliqués à interpréter (à cause de
l'incomplétude des données). En général, la fluctuation de la productivité du secteur primaire
(obtenue par le rapport entre le PIB et la part de l'agriculture dans le PIB) devrait être comparée à
des statistiques concernant la pluviométrie pour comprendre dans quelle mesure les moyens fournis
à l'agriculture ont permis à celle-ci de résister aux aléas climatiques sur une période donnée. De
telle manière, en considérant le rapport entre tels éléments dans la période de l'insertion des NA et
des processus de l'agrobusiness (2000-2010), les résultats seront visibles.
Les chiffres fournis par la Banque Mondiale26 montrent le PIB en croissance continue, tandis que la
part de l'agriculture dans le PIB s'avère fluctuant de façon modérée (avec un pic de 28,2% en 2005
et un creux de 19,8% en 2007). Du rapport entre ces deux éléments pris en considération, une
productivité agricole croissante en est déduite : de 718,8 millions de dollars en 2001 à 1955 millions
en 2010, jusqu'aux 2733,2 millions de 2014.
En ce qui concerne la pluviométrie et l'accès à l'eau, le BF a connu une importante sécheresse en
1973, laquelle a mené le gouvernement à conduire une série de processus d'aménagement hydro-
agricole : le programme « 40 barrages » et l'aménagement de 4461 ha de superficies irriguées et de
25 Voir Annexes 5 et 826 Voir Annexe 8
52
800 ha de bas fonds entre 1974 et 1987 à l'aval des barrages existants (AQUASTAT, 2015). En
1990, le BF s'est engagé à un Programme d'Ajustement Structurel (PAS) lequel a provoqué le
désengagement de l'État du secteur primaire pour le céder au privé, ce qui a mené à la création de
mesures d'aménagements hydro-agricole privées ou communautaires. De ce fait, seuls les acteurs
privés (NA inclus) ont contribué, à partir de 1990 à l'aménagement des superficies, à l’exclusion des
projets communautaires et ceux conduits par des ONG. Donc, jusqu'en 2004 un total de 32 258 ha
de superficies a été aménagé (y compris les bas fonds) ; ensuite, un développement progressif des
terres irriguées s'est produit sur la période 2004 – 2011, lequel a mené à un total de 54 275 ha de
superficies aménagées27. Enfin, un développement rapide des superficies équipées (dotées
d'irrigation de toute typologie) s'est vérifié depuis 2001, avec une augmentation moyenne de 7,8%
d'hectares équipés par an, contre seulement 4,4% de 1992-2012. Cette évolution a contribué
sensiblement aux productions vivrières, en particulier pour celles assurant la sécurité alimentaire en
milieu rural : la part des production irriguées est évaluée à 10% de la production agricole totale,
pour seulement 1% des superficies cultivées ; l'irrigation a favorisé de façon remarquable la
rentabilité des cultures du riz et des légumes28.
Or, pour déterminer le réel apport des agrobusinessmen (donc, sans compter les anciens GPF) à
cette évolution qui contraste les problèmes liés aux aléas climatiques, des statistiques précises
concernant le nombre de NA actifs dans le domaine de l'aménagement de la terre seraient
nécessaires. Malheureusement, l'installation et les opérations menées par ces derniers ne sont
presque jamais formalisées, raison pour laquelle les données à disposition ne permettent pas de
juger de façon précise l'action des NA dans ce sens. Malgré ce manque, des améliorations se sont
vérifiées sensiblement à partir de la décennie d'insertion des agrobusinessmen dans le secteur
primaire burkinabé.
Donc, en ce qui concerne le domaine de l'irrigation et des innovations visant à suppléer les
conditions climatiques défavorables, l'action des NA s'avère neutre, dans les cas où tout
développement a été apporté par les anciens producteurs familiaux, ou positive, dans les cas où les
NA ont contribué à l'aménagement des terres lors de leur installation.
Encadrement et professionnalisation des agriculteurs
27 Voir Annexes 9 et 1028 Voir Annexe 11: cultures irriguées sur les superficies équipées pour l'irrigation
53
Comme décrit précédemment, dans le chapitre 2.2, l'origine professionnelle des NA montre une
marge d'amélioration dans le domaine technique, en tant que conséquence de leur installation, plutôt
réduite. Les NA identifiés et pris en considération dans le présent mémoire (néanmoins, ils
représentent de façon exhaustive la totalité des cas) proviennent du fonctionnariat et ils sont pour la
majorité des administrateurs, des professionnels privés de haut niveau et des militaires. Pour cette
raison l'apport au niveau des compétences agricoles est faible. Par contre, au niveau financier,
généralement ils possèdent les moyens nécessaires pour fournir des compétences par le recours à
des spécialistes du secteur agraire à embaucher sur les terrains acquis.
En outre, ils pourraient employer les finances pour valoriser la diversification de la production avec
l'appui de la recherche scientifique, puisque malgré les moyens offerts par le gouvernement au
monde de la recherche et de l'université soient déficients, nombreuses s'avèrent les opportunités
d'appui technique proposées par différentes ONG, organisations internationales et organismes
nationaux29.
Dégradation des sols et situation environnementale
Les régions du Faso se situant dans les zones climatiques où la pluviométrie varie entre 300 et 800
mm par an subissent fortement les changements climatiques récents. Cette situation accentue la
fluctuation de la quantité des terrains fertiles et en conséquence la vulnérabilité de la production
agricole. Pour cette raison, le respect de l'environnement est un aspect fondamental dans le cadre
des mesures à adopter pour garantir la sécurité alimentaire des populations vivant dans les susdites
zones. En plus, la grande majorité des cultures de subsistance (le sorgho, le mil, le maïs et le riz)
est pratiquée sous l'arbitraire enjeu de la saisonnalité.
Malheureusement, tel aspect est presque totalement négligé par le gouvernement, si bien qu'aucune
contrainte n’a été appliquée lors de l'acquisition des terrains par les NA. En effet, un processus de
défrichement au bulldozer s'est soudain produit une fois la terre achetée. Bien que l'origine de cette
pratique demeure inconnue, les dynamiques courantes parmi les NA venant d'acheter un grand
terrain (de 51 à 100 ha) sont visibles et analogues entre les différents cas. Très souvent, le
défrichement est pratiqué sans respecter la loi existante pour la protection des espèces ligneuses
29 Par exemple les sept projets actifs de développement rural par LuxDev (Agence du Luxembourg pour le développement), les programmes d'aide lancés par le United Nations Capital Development Fund ou encore les programme de la FAO pour la “Coopération Sud-Sud”
54
telles que les karités, les tamariniers, les nérés ou les baobabs. Avec le défrichement, le sol perd la
couche d’humus, laquelle rend le terrain fertile, grâce aux substances nutritives pour la végétation,
et résistent à l'érosion provoquée par l'ensoleillement, les pluies violentes et les tempêtes de sable.
Tel phénomène est sous-estimé par les NA qui appliquent le défrichement, si bien que certains
parmi eux ont tenté, en vain, de substituer la végétation présente par des plantations de vergers
(manguiers, anacardiers) ou d'eucalyptus (plante qui relâche des substances empêchent le
renouvellement de la couche de humus).
Les cas de défrichement en zone tropicale sont à attribuer à une mauvaise approche à la terre
achetée : l'acheteur ayant les moyens pour se permettre l'action des bulldozers voit dans la grande
densité de la végétation : un profit. En effet, les coûts du défrichement sont presque totalement
couverts par la vente du bois enlevé dans les centres urbains, où le bois possède une valeur majeure
par rapport à celle attribuée en milieu rural. Cependant, une fois le défrichement complet, la terre
perdra en moins de cinq ans la fertilité initiale laquelle, pour être rétablie, impliquera l'onéreux
apport de fumure organique et d'engrais. En plus, si le NA ne considère pas, préalablement,
l'application de mesures anti-corrosives, l'opération de fertilisation du sol risque de s'avérer
inefficace.
Donc, ce processus est dangereux au niveau environnemental et social, puisque les NA, une fois
quitté le terrain, ne sont pas obligés de rétablir la fertilité et les conditions des sols initiales. Encore
un fois, les services techniques de l'administration jouent un rôle « phantasme » dans cette pratique,
puisque parfois ils ne sont pas au courant de l'installation et du conséquent défrichement (faute de
l'absence d'un cahier de charge exigé par l'État), parfois ils le savent mais les NA jouissent d'un
« réseau de connaissances » au plus haut niveau de l'administration et gagne l'immunité pour faire
de son terrain ce qu'il croit sans aucun respect des normes. À ce propos, le GRAF a recueilli un
témoignage par un agent des services techniques lequel se résigne impuissant : « Le fait qu'ils ne
passent pas par nous fait que nous ne sommes pas associés à leur installation ; conséquences : les
paysans leur vendent des zones réservées, des forêts classées, etc. Il y a aussi leurs techniques de
coupe des bois qui ne favorisent pas la régénérescence des espèces ; ils mettent le sol à nu. Quand
on veut intervenir, ils nous disent que nous faisons de la politique » (GRAF, 2011).
55
3.3 Perspectives pour l'agrobusiness et alternatives pour le futur
Le bilan sur les trois aspects fondamentaux - nécessaires à améliorer les conditions de la production
agricole au Burkina Faso, concernant l'action des NA et les phénomènes liés à l'agrobusiness,
montre l'inefficacité des acteurs (jusqu'à présent) et l'incohérence du gouvernement se plaçant entre
la vigoureuse promotion de l'agrobusiness et la paralysie en ce qui concerne les mesures prises pour
le soutenir. Néanmoins, se référant aux données économiques fournies par le Ministère de
l’Économie et des Finances dans la balance des paiements, l'agriculture est un secteur en croissance
depuis désormais une décennie, et malgré les difficultés, le primaire ne semble pas pouvoir être
remplacé par d'autres secteurs. De plus, le taux de la population vivant de l'agriculture est encore
supérieur à 80% et surtout en milieu rural ce fait a par conséquence un taux de chômage de moins
de 3% (BDP, 2013).
Donc, malgré l'insuccès de l'agrobusiness, d'autres facteurs, actions, acteurs, jouent un rôle
important pour le développement de l'agriculture burkinabé. Il s'avère fondamental de comprendre
quels sont ces facteurs et comment pourraient-ils influencer les dynamiques de l'agrobusiness pour
en produire une « version » efficace et efficiente.
La coopération avec les organisations paysannes : GPF et NA collaborent
Ils existent de nombreuses organisations paysannes (OP), de différentes ampleurs et capacités,
auxquelles les acteurs de l'agrobusiness pourraient demander un accompagnement technique et
matériel, de manière à instaurer une coopération guidée ou encore de recevoir un moyen financier.
Les organisations paysannes présentes au BF sont souvent le fruit du développement des
groupements villageois, lesquels naquirent dans le Faso post-colonial pour faire en sorte que
différents agriculteurs de la même zone puissent accéder aux aides du gouvernement. Avec l'arrivée
des premières ONG, ces groupements reçurent un appui technique important et commencèrent à se
développer pour devenir les organisations paysannes actives d’aujourd'hui. Il faut constater que la
véritable structuration du « mouvement paysan » du Burkina est né contemporainement à l'arrivée
de l'agrobusiness : dans la décennie 2000 – 2010, ensuite au désengagement de l'État dans le
domaine agricole.
Aujourd'hui, les majeures OP pour efficacité, organisation, envergure et longévité, sont :
L'Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina Faso (UNPR-B) : il s'agit d'une OP
56
née comme réaction au désengagement du gouvernement représenté par la dissolution de la
SO.NA.CO.R. (Société Nationale de Collecte, de traitement et de commercialisation du Riz)
due à une banqueroute (en 2000, le directeur de la structure, une fois reçu le dernier
financement annoncé par le gouvernement direct aux riziculteurs, prit la fuite avec l'argent et
laissa les paysans en grave difficulté). Cette faillite fut une conséquence de l'exécution du
PAS conduit par le FMI et la BM. Le 2 décembre 2005, des cendres de la SO.NA.CO.R est
née l'UNPR-B, OP dont la tâche est celle d'accompagner et soutenir les riziculteurs depuis la
fourniture des intrants, jusqu'à la distribution en passant par les opérations intermédiaires
telles que l'irrigation, l'aménagement, le choix des produits, etc. Dans l'article 10 du statut
sont énumérées les missions et les objectifs de l'OP, lesquels peuvent ainsi être résumés :
développer des partenariats et impliquer l'état au soutien des membres, sauvegarder la
démocratie et le respect des normes, augmenter la rentabilité de l'activité par la
professionnalisation des acteurs, créer un réseau collaboratif entre les producteurs, stimuler
la recherche pour l'amélioration du segment riz.
L'Union Nationale des Mini Laiteries et Producteurs du Lait Local au Burkina
(BurkinaLait) : cette union est née à Ouagadougou le 13 juillet 2007 et regroupe 23 laiteries
et producteurs de lait avec le soutien du SEDELAN (Service d'édition en langues nationales
du Burkina Faso), de la FEB (Fédération des éleveurs du Burkina Faso) et de Oxfam
International. Les objectifs de BurkinaLait sont déclarés dans leur charte des statuts et ainsi
se présentent : « défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, encourager et
travailler à la professionnalisation de la filière lait local au Burkina Faso, promouvoir le
développement de la production et transformation du lait local au Burkina Faso, lutter
contre la concurrence déloyale de lait en poudre, faciliter l'accès des membres aux
financements, les intrants zootechniques et vétérinaires, créer des services communs entre
les membres, favoriser la concertation et la coopération entre ses membres et d'autres
organisations faîtières nationales et internationales ».
L'Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina (UNPCB) : cette OP créée le 15
avril 1998 regroupe aujourd'hui 7005 groupements de producteurs de coton, répartis dans
4162 villages pour un total de 210150 producteurs. Les objectifs sont analogues à ceux
déclarés par les OP présentées ci-dessus : faciliter l'approvisionnement en intrants,
l'augmentation de la production et de la rentabilité et la gestion des financements et des
crédits, la professionnalisation des acteurs par le biais de la conviction que l'agriculture soit
57
le moteur de l'économie et du bien-être du pays. L'UNPCB est la première OP à avoir stipulé
un accord avec une entreprise nationale pour valoriser la transformation du produit visant à
l'exportation. En plus, avec le soutien de l'AFD et de l'UE, l'UNPCB a mis en place une
équipe pour améliorer la coopération entre groupements et la gestion des financements, pour
favoriser l'insertion de la femme dans le domaine de la culture du coton et pour la
préservation des écosystèmes et le respect des normes environnementales.
La Confédération Paysanne du Faso (CPF) : à son tour, l'UNPCB, avec la FEB, la
Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina (FEPA-B), la Fédération Nationales des
Femmes Rurales du Burkina (FENAFER-B) et la Fédération Nationale des Jeunes
Producteurs Agricoles du Burkina (FNJPA-B) fait partie de la CPF, créée en novembre 2002
pour représenter les susdites organisations au niveau national et international, pour favoriser
la solidarité et la coopération entre les membres et pour rassembler les intérêts communs
afin de gagner attention auprès des institutions nationales et internationales.
La Fédération Nationale des Organisations Paysannes (FENOP) : il s'agit encore une fois
d'une organisation représentative des OP burkinabés. En 1994, une organisation non-
gouvernementale dénommée « Six S » organisa une rencontre entre les majeurs
représentants du milieu agricole et rural pour organiser un réseau avec l'objectif initial de
récolter une cotisation. Deux années plus tard, en 1996, ces rencontres se formalisèrent sous
le nom de la FENOP, laquelle aujourd'hui représente les OP auprès des institutions
nationales et internationales, elle offre l'opportunité d’échanger les idées et les
préoccupations entre les différents groupements de producteurs et fournit un appui lorsque
des problèmes se manifestent.
La Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN) : cette idée prend forme en 1967
et est reconnue comme association en 1978. Il s'agit d'une Fédération communautaire à
laquelle participent des acteurs provenant de toute l'Afrique de l'Ouest. Elle compte
aujourd'hui 653931 membres actifs. Elle se distingue parmi toutes les autres organisations
par sa méthode et ses procédures : elle opère à travers différentes « directions » lesquelles
s'occupent des domaines fondamentaux du monde agricole et rural. Par exemple, la direction
« Plate-Forme » s'occupe des politiques de promotion de la femme, la direction « RGSA »
opère dans le domaine de la sécurité alimentaire, la direction « UAAE » représente l'Unité
d'Appui Agro-Alimentaire, la direction « Communication » est active pour l'alphabétisation
en milieu rural et les moyens techniques pour coordonner les membres distants dans
58
l'espace, ou encore la direction « UBTEC » est celle qui gère la caisse, les épargnes et les
crédits.
La présence de telles associations a été totalement négligées par les NA, lesquels se sont installés
par pure et simple volonté de posséder un terrain, sans aucune perspective de développement
agricole dans le domaine rural. Pourtant, il faut réaliser que les OP développées comme celles
présentées ci-dessus possèdent toutes les caractéristiques propres au concept de l'agrobusiness. La
coopération entre acteurs opérant l'un dans la gestion du stock, l'autre dans la commercialisation,
l'autre encore dans la transformation, coordonnée par une entité visant au profit au-delà de la simple
subsistance, est de fait l'esprit essentiel de l'agrobusiness. L'évolution des OP pourrait être liée au
potentiel financier et relationnel (c'est-à-dire tout ce qui concerne le lobbying, les appuis
institutionnels, les liens aux structures étatiques, etc.) des NA, avec la simple intervention de l'État à
travers l'imposition de conditions de vente visant à la collaboration entre NA et OP.
59
Conclusion
Les deux dernières décennies ont confirmé la puissance des facteurs – climatiques, professionnels,
de réglementation – lesquels défavorisent la croissance continue du secteur primaire nécessaire à
répondre aux préoccupations de sécurité alimentaire du Burkina Faso. Plusieurs réactions se sont
vérifiées, parmi lesquelles ressort la vigoureuse promotion de l'insertion de nouveaux
agrobusinessmen dans la scène agricole burkinabé, soutenue avec constance par le gouvernement
du Faso.
L'intervention de ces acteurs s'est effectivement produit, notamment durant la décennie 2000 –
2010, comportant des conséquences dans le monde rural : parfois positives, parfois négatives.
L'analyse de l'impact de l'agrobusiness ne peut pas s'avérer nette et claire, puisque les données à
disposition et la quantité de variables due au nombre de cas différemment spécifiques empêchent de
formuler un jugement ponctuel. Pourtant la somme d'éléments repérés par les nombreux rapports et
études sur ce phénomène, sommés aux résultats économiques du pays, mettent en évidence la
présence d'intenses problèmes de nature différente : la coordination entre gouvernement et acteurs,
la coopération entre les acteurs traditionnels de l'agriculture (qu'ils soient des OP de grande
envergure ou des petits agriculteurs familiaux) et les NA, le respect des normes (au cas où il en
existent) et, plus en général, la volonté commune de progresser et développer le système pour le
bien-être commun.
L'intensification des réseaux liant les organisations paysannes, les agrobusinessmen, les migrants,
les acteurs externes en faveur d'un échange de compétences, moyens et idées doit se mettre en place
afin d'améliorer les conditions générales de production. Clairement, ce processus nécessite d'un
acteur super partes, lequel puisse coordonner, planifier, analyser et opérer évitant les mauvaises
pratiques qui endommagent les personnes et la terre, tels que plusieurs fléaux profondément
présents aujourd'hui au Burkina Faso : la corruption, le clientélisme, l'anarchie au milieu rural, le
non respect des droits humains et la négligence des normes environnementales.
Malheureusement, le Faso a connu pendant 27 ans une instabilité politique constante due à la
présence du président Blaise Compaoré, acteur de nombreux méfaits internationalement reconnus
lesquels ont fortement ralenti la croissance humaine et économique du pays. Nonobstant
l'amélioration des conditions humaines soit visible30, des pratiques défavorables à un
30 Voir Annexes 12, 13 et 14
60
développement équitable ont été instaurées et celles-ci font du BF une nation pauvre avec une élite
énormément riche (de la corruption endémique à l'inégalité de la distribution de la richesse 31,
jusqu'à la négligence des domaines fondamentaux telles que l'instruction ou la santé). Plus
récemment, un coup d'état perpétré par le général et ex-garde du corps personnelle de Compaoré,
Gilbert Diendéré, a bouleversé le pays socialement et économiquement, provoquant la postposition
des élections. Grâce aux protestations du peuple, à la ténacité du gouvernement de transition32 et à
l'intervention médiatique de la communauté internationale, le coup d'état s'est conclu relativement
en positif avec l'insuccès de Diendéré et la réinstallation de la transition. Néanmoins, ce type de
problème est toujours un risque à prévoir au BF comme dans nombreux pays d'Afrique et,
notamment, ils ne représentent guère un facteur favorable au développement, en particulier celui de
domaines qui comportent manœuvres à long terme tels que l'agriculture.
Cette instabilité empêche notamment celle qui est censé être la solution aux problèmes liés à
l'agrobusiness : la création d'une politique nationale visant à définir le rôle de chaque acteur de
l'agriculture. Le gouvernement doit régler toute installation et intervention des nouveaux acteurs,
pour éviter l'acquisition des terres par des non professionnels. En plus, il doit favoriser le
développement et la professionnalisation des agriculteurs déjà présents, lesquels possèdent le
savoir-faire nécessaire à l'amélioration de la production, mais qui ne disposent pas des matériaux et
des finances pour l'appliquer. Tel accompagnement doit forcement passer par les nombreuses
organisations paysannes actives, lesquelles sont évidemment aptes à coordonner et diriger les aides
du gouvernement. En même temps, l'état doit favoriser l'accès aux intrants et encadrer les
opérations de transformation et commercialisation des produits, actions pouvant être soutenues par
les moyens financier des nouveaux acteurs. L'appui des projets internationaux ou communautaires,
tels que ceux de la Banque Mondiale, de l'Agence Française de Développement, des
Gouvernements canadien, japonais et allemand, doit aussi implémenter cette idéale politique
nationale de développement agricole et rural du Burkina Faso.
31 Voir Annexe 1532 Après la révolution populaire déroulée du 28 au 31 octobre 2014, laquelle a mené à la dissolution du gouvernement
Compaoré après que ce dernier avait proclamé une modification de l'article 37 éliminant la restriction des nombres de mandats, un gouvernement de transition (dont Michel Kafando est Président et Isaac Zida Premier Ministre) a été mis en place pour permettre l'organisation des élections prévues en octobre 2015.
61
BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE
AUBERT S., LIDOUREN E. ; Pratiques et adaptations paysannes en pays Mossi ; Septembre 2004
; 110 p.
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES DU BURKINA FASO ; Balance des paiements et position
extérieure globale ; 2012 49 p.
BÉLIÈRE JEAN-FRANÇOIS, BOSC PIERRE-MARIE, FAURE GUY, FOURNIER STÉPHANE,
LOSCH BRUNO ; Quel avenir pour les agricultures familiales en Afrique de l'Ouest dans un
contexte libéralisé ? ; International Institute for Environment and Development, Dossier n. 113 ;
Octobre 2002 ; 46 p.
COALITION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE GÉNÉTIQUE AFRICAIN ;
Recherche participative sur les acquisitions massives de terres agricoles en Afrique de l'Ouest et
leur impact sur l'agriculture familiale et la sécurité alimentaire des populations locales ; Décembre
2012 ; 55 p.
DARANKOUM L. C. ; Emploi des jeunes au Burkina Faso : état des lieux et perspectives ;
Ouagadougou, Avril 2014 ; 40 p.
DAVIS JOHN H., GOLDBERG RAY A., A concept of agribusiness, Boston, Division of Research,
Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1957, 136 p.
DUMONT RENÉ ; Afrique noire : Développement agricole. Reconversion de l'économie agricole ;
1965 ; Paris ; P.U.F. ; 212 p.
FAO ; Suivi des politiques agricoles et alimentaires en Afrique. Revue des politiques agricoles et
alimentaires au Burkina Faso. Rapport pays ; Juillet 2013 ; 234 p.
FOOD AND AGRICULTURAL ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS, AQUASTAT ;
62
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/BFA/index.stm
GIRARD PIERRE, NANA PATRICE DJAMENA, SIDIBÉ ADAMA ; AGRIDAPE, Volume 30 n. 1
; Fonctions, modalités et défis de la diversification culturale dans la Boucle du Mouhoun (Burkina
Faso) ; Mars 2014 ;
GROUPE DE RECHERCHE ET D'ACITON SUR LE FONCIER ; Agrobusiness au Burkina Faso.
Quels effets sur le foncier et la modernisation agricole ? ; Janvier 2011 ; Ouagadougou –
Amsterdam ; 77 p.
HAUCHART VALÉRIE ; The Burkina Faso, A Cotton-growing Faced with Mondialization and
Economic Dependence Country. Look at One South ; 2006 ; 8 p.
KORMAWA P., WOHLMUTH K. AND DEVLIN J., Agribusiness for Africa’s Prosperity: Country
Case Studies, Working Paper, Second Edition, April 2012, 336 p.
LECLÈRE CÉCILE, LIGNON MÉLANIE ; Développement agricole au Burkina Faso ; 2006 ; 26
p.
LOADA M., OUÉDRAOGO A.; Burkina Faso. Rapport Panorama 1 sur les statistiques agricoles
et alimentaires; Projet CGP/GLO/208/BMG CountrySTAT pour l'Afrique Sub-Saharienne;
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture; Rome; Septembre 2009; 65 p.
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, TDR pour l'atelier
sectoriel: Quelles stratégies de renforcement de la résilience de la population face aux
changements climatiques pour une sécurité alimentaire durable, Mars 2013, 4p.
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE
L'ASSAINISSEMENT ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE; Résultats définitifs de la
campagne agricole 2014/2015 et perspectives de la situation alimentaire et nutritionnelle; Mars
2015; Ouagadougou; 73 p.
63
MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES, MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'HYDROLIQUE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DES REPRÉSENTANTS DES
CHAMBRES RÉGIONALES DE L'AGRICULTURE, Analyse de la filière bétail-viande au
Burkina Faso, Novembre 2007, 163 p.
NACKONEY JANET, WHITE ROBIN P. ; Drylands, People and Ecosystem Goods and Services :
A Web-based Geospatial Analysis ; Février 2003 ; 58 p.
OUÉDRAOGO MOUSSA; Land Tenure and Rural Development in Burkina Faso: Issues and
Strategies. Dryland Issue Paper n. 112; IIED; 2002; 24 p.
SCHWARTZ ALFRED, L'évolution de l'agriculture en zone cotonnière dans l'Ouest du Bukina
Faso, (dans Défis agricoles africains, dd. aa., sous la direction de Devèze Jean-Claude, Karthala,
2008, 414 p.), 19 p.
TRAORÉ ALAIN, AUDET-BÉLANGER GENEVIÈVE, TRAORÉ ALLADARI ; Contribution du
p4p au renforcement des capacités des organisations paysannes. Rapport pays: Burkina Faso
2011 ; WFP et Royal Tropical Institute ; 2011 ; 50 p.
ZOUGMORÉ C.; Déguerpissement annoncé des populations de Kounkoufoanou : le MBDHP tire
la sonnette d’alarme; Le Pays; 29 april 2015; http://news.aouaga.com/h/66569.html
64
Annexe 2 : Compte de transactions courantes Burkina Faso 2012
Annexe 3 : Profil des dépenses alimentaires de base sur la décennie 2000 en Afrique de l'Ouest
66
Annexe 4 : Contribution des secteurs économiques au PIB (FAO, 2013)
Annexe 5 : Évolution du PIB et du PIB par tête du Burkina Faso (décennie 2000 – 2010)
67
Annexe 6 : Carte des province du Houet et du Ziro, Burkina Faso
Annexe 7 : Part de l'agriculture dans le PIB du Burkina Faso
68
Annexe 10 : Périmètres irrigués du Burkina Faso (Source : Comité Inter-États de Lutte Contre la
Sécheresse au Sahel )
Annexe 11 : Cultures irriguées sur les superficies équipées pour l'irrigation
70
Annexe 12 : Évolution de l'IDH du Burkina Faso
Annexe 13 : Évolution du taux de mortalité du Burkina Faso
71
Annexe 14 : Évolution de l'espérance de vie à la naissance du Burkina Faso
Annexe 15 : Indice de Gini Burkina Faso 2009
72