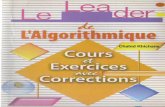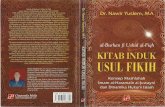D. Genequand, Trois sites omeyyades de Jordanie centrale: Umm al-Walid, Khan al-Zabib et Qasr...
Transcript of D. Genequand, Trois sites omeyyades de Jordanie centrale: Umm al-Walid, Khan al-Zabib et Qasr...
1 INTRODUCTION
Entre 1988 et 2000, la Fondation Max van Ber-chem, basée à Genève, a soutenu un projet archéo-logique suisse en Jordanie. Le projet, dirigé parJacques Bujard, était orienté vers l’étude de la tran-sition entre Byzance et l’Islam et a travaillé surquatre sites différents dans le centre de la Jordanie.Trois de ces sites étaient des établissementsomeyyades et les principaux acquis des douzeannées de travail de terrain (fouilles, études archi-tecturales et prospections) vont être présentés ici.Il s’agit des sites d’Umm al-Walid, Khan al-Zabibet Qasr al-Mshatta1.
Les trois sites se trouvent dans la même régions’étendant à l’est et au sud-est de la ville de Mada-ba (Fig. 1). C’est une région particulièrementriche en sites de l’Antiquité tardive et de la hauteépoque islamique, qui a appartenu d’abord à laprovince d’Arabie, puis au sous gouvernorat de laBalqa√ dans le jund de Damas. C’est une région desteppe semi-aride, où l’on passe très rapidementd’un climat presque méditerranéen à un climataride. En règle générale, les précipitations et laqualité des sols diminuent d’ouest en est et dunord au sud. Les sites d’Umm al-Walid et de Qasral-Mshatta se situent approximativement sur l’iso-hyète des 180–200 mm de précipitations annuelleset ont des sols encore relativement fertiles compo-sés de terre rouge (décompositions des calcaires etmatières organiques). Par contre, Khan al-Zabibest placé en dessous de l’isohyète des 150 mm,dans une zone aux sols jaunâtres maigres, pauvresen matières organiques et particulièrement peufertiles sans un recours abondant à l’irrigation. Àtitre de comparaison, on situe généralement lalimite des cultures sèche (sans recours à l’irriga-tion) sur l’isohyète des 250 mm de précipitationsannuelles.
Les trois sites relèvent de ce que l’on a appeléimproprement les ‘châteaux du désert’ ou ‘châ-teaux omeyyades’ et ont été construits par l’aristo-
cratie arabe musulmane durant la première moitiédu IIe siècle de l’Hégire/VIIIe siècle après J.-C.
2 UMM AL-WALID
Situé à 12 km au sud-est de Madaba, Umm al-Walid est le site où les travaux de terrain ont étéles plus importants. Le site est connu dès le XIXe
siècle et a été décrit à plusieurs reprises, en particu-lier à cause d’une petite mosquée interprétéed’abord comme un temple dorique et d’un bâti-ment quadrangulaire à cour centrale généralementinterprété comme un édifice militaire romain2. Lesvestiges archéologiques s’étendent sur le sommetet les flancs d’une colline allongée (Fig. 2). Cettedernière est réoccupée depuis les années 1950 parun village des Banu Sakhr qui recouvre progressive-ment les ruines.
Le site d’Umm al-Walid – dont le nom ancienn’est pas connu – a eu trois phases d’occupationprincipales aux époques romaine, omeyyade etmédiévale. L’époque romaine est caractérisée parun village comportant un grand sanctuaire avecdeux temples géminés, plusieurs nécropoles detombes individuelles au nord-ouest, à l’est et ausud du village, ainsi que deux monuments funé-raires. L’époque byzantine semble marquée par undéclin de l’établissement. Si de la céramique atteste
1 Plusieurs articles ont déjà présenté une partie des résultatsde ces travaux: Bujard – Schweizer 1992; Haldimann 1992;Bujard – Schweizer 1994; Bujard 1997; Bujard – Gene-quand 2001; Bujard – Joguin 2001; Genequand 2001;Bujard 2002. Au cours des différentes missions, ce sontprincipalement Jacques Bujard (directeur de la mission,SPMS/Neuchâtel), Wilfried Trillen (SCA/Fribourg),Michèle Joguin (SCA/Genève), Denis Genequand et Marc-André Haldimann qui ont mené les recherches sur les troissites.
2 Tristram 1874, 178–182; Brünnow – Domaszewski 1905,87–90; King et al. 1983, 399–405; Parker 1986, 41–43.168–169. 196–199.
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale: Umm al–Walid, Khan al–Zabib et Qasr al–Mshatta (travaux de la Fondation Max van Berchem 1988–2000)Denis Genequand
d’une permanence de l’occupation, aucun monu-ment ne permet d’y voir un site important. L’idéed’un déclin d’Umm al-Walid à l’époque byzantineest d’ailleurs renforcée par le fait qu’une partie desblocs des édifices romains, qui ont été démantelés,est remployée au VIe siècle dans la constructiondes églises du site voisin de Nital3.
L’époque omeyyade correspond à la deuxièmephase de prospérité d’Umm al-Walid et voit laconstruction de trois châteaux (qaßr/qußür), dedeux mosquées successives et d’importantes instal-lations hydro-agricoles (barrages et pressoir à vin)dans le Wadi al-Qanatir à 2 km à l’est. C’est sur cesvestiges omeyyades que se sont principalementconcentrés les travaux de la mission archéologiquesuisse. On remarquera qu’un grand nombre deruines de maisons se trouvent sur la colline, entreles châteaux et autour des temples, mais n’ont pasété fouillées et peuvent se rapporter aussi bien àl’Antiquité qu’aux débuts de l’Islam.
Après un abandon prolongé à partir de la fin duIIe/VIIIe siècle, Umm al-Walid sera réoccupédurant l’époque médiévale (époque ayyoubide etmamelouke) par un nouveau village dont les mai-sons sont installées sur la pente de la colline, enbordure sud-est de l’établissement antique etomeyyade.
2.1 LE CHÂTEAU ORIENTAL
Le plus grand des châteaux forme un quadrilatèrede 70.40 x 71 m de côté (Fig. 3). Son mur d’encein-te est large de 1.20 m et est percé d’une seule porte,à l’est. Il est renforcé par seize tours-contreforts deplan semi-circulaire le long des courtines et entrois-quarts de cercle aux angles. Du côté est, lecontrefort axial est nettement plus grand et estdivisé en deux quarts de cercle de part et d’autre dela porte. À l’intérieur, les pièces sont organisées surun seul niveau en quatre ailes et sur un rang autourd’une cour centrale à portique. Les pièces sontregroupées en appartements distincts (bayt/buyüt), d’une manière assez inhabituelle, par desmurs subdivisant la cour centrale et les portiquesen cinq petites cours particulières (Fig. 4). Seulesles deux pièces flanquant le vestibule d’entrée sontisolées. Chaque appartement comprend quatre oucinq pièces et des latrines. La pièce centrale dechaque appartement est systématiquement plusgrande et plus haute que les autres et devait servirde pièce principale ou de réception. La plupart despièces sont accessibles directement depuis la cour;dans quelques cas, généralement à côté des piècesprincipales, il existe des communications latérales.Il y a peu d’aménagements à l’intérieur des pièces.Quelques banquettes, foyers et bassins ou man-geoires ont été installés dans les cours particu-
lières. Le vestibule d’entrée est doté de deuxgrandes banquettes latérales. Les latrines, à l’extré-mité de pièces plus étroites, sont situées dansl’épaisseur du mur d’enceinte et sont précédées parun petit podium semi-circulaire qui devait aussiservir de bassin pour se laver (Fig. 5).
L’ensemble de l’édifice est construit en moyen àgrand appareil de calcaire local. Les blocs ne sontque grossièrement équarris et les assises, toutcomme les joints entre les blocs, sont réglées avecde petites pierres et des déchets de taille. Lesmaçonneries sont liées à la terre et recouvertes deplusieurs couches de mortier de chaux. Toutes lespièces étaient couvertes par des charpentes platesrecouvertes de terre argileuse et d’un enduit dechaux. Les charpentes reposaient sur les murs etsur des arcs transversaux. Les sols des pièces sonten terre battue. Un dallage de pierre recouvre parcontre toute la surface de la cour, y compris lescours particulières des appartements. Toutefois,ces dernières et la partie centrale de la cour ne sontpas toutes au même niveau, ce qui atteste de cettesubdivision dès le projet originel, tout comme l’in-tégration des murs de clôture dans le portique. Cesont les preuves de la conception de l’édifice avecces subdivisions de la cour, même si architecturale-ment il paraît aberrant de cacher les portiques de lasorte (Fig. 6).
Le château oriental n’a reçu qu’un décor parci-monieux dont les éléments marquants sont desmerlons à trois ressauts sur le couronnement dumur d’enceinte (ces merlons sont incurvés versl’intérieur sur les tours-contreforts), de très raresfragments de peintures murales (fragments épigra-phiés sur fond blanc ou de couleur) et un linteaude l’une des pièces de l’aile nord portant un décorde scène de chasse en stuc (panthère poursuivantune gazelle). Les bases des colonnes du portiquesont moulurées et les chapiteaux sont tronco-niques. Aux extrémités du vestibule d’entrée, desdemi-colonnes engagées doubles supportent lesarcs.
La date de construction de ce château est à pla-cer durant la première moitié du IIe/VIIIe siècle.Cette datation est basée sur plusieurs éléments quiseront passés en revue plus loin.
La fouille du château a montré que toute samoitié orientale s’est écroulée brutalement et sou-dainement lors d’un tremblement de terre, pié-geant ainsi un abondant mobilier, principalementen céramique, en verre et en bronze (Fig. 7 et8a/b). L’autre moitié du château ne s’est pas effon-drée à ce moment, mais il semble que tout ce quipouvait être récupéré l’a été et que l’édifice a alorsété abandonné.
3 Observations personnelles; Piccirillo 2001, 272–275.
Denis Genequand126
L’assemblage céramique lié au tremblement deterre comprend des éléments qui, pris individuelle-ment, peuvent être datés entre la première moitiédu IIe/VIIIe siècle et le début du IIIe/IXe siècle.Dans cette fourchette chronologique, le tremble-ment de terre le plus important et le plus dévasta-teur qui soit connu par les sources textuelles estcelui de 131/749 (ou peut-être plus exactement lestremblements de terre de 129–131/747–749)4. Lesuivant à être documenté dans la région est daté de139/757, mais ni son ampleur, ni sa localisationexacte ne sont connues. D’autres, apparemment deplus faible amplitude, suivent assez régulièrementdurant la seconde moitié du IIe/VIIIe et la premiè-re moitié du IIIe/IXe siècle. Deux propositions dif-férentes de datation du tremblement de terre qui adétruit le château oriental d’Umm al-Walid ont étéfaites dans des publications antérieures: premièremoitié du IIIe/IXe siècle5 et, plus vague, IIIe/IXe
voire IVe/Xe siècle6. Cependant, rien dans l’assem-blage céramique ne s’oppose à une date un peuplus haute et le tremblement de terre de 131/749qui est bien documenté ailleurs dans la régionparaît être un candidat probable, à moins que cesoit l’un des séismes de plus faible amplitude de laseconde moitié du IIe/VIIIe siècle.
2.2 LES CHÂTEAUX CENTRAL ETOCCIDENTAL
Le château central est très oblitéré et est situémaintenant au milieu des maisons du villagemoderne, juste à côté du château oriental. Il n’a faitl’objet que de repérages en surface et de petitsdégagements pour préciser certains éléments deson plan. Il mesure 48 m de côté et a un mur d’en-ceinte large de 1.20 m, sans tours-contreforts etpercé d’une seule porte à l’est (Fig. 9). La disposi-tion intérieure est la même que celle du châteauoriental, soit quatre ailes à une rangée de piècesautour d’une cour centrale à portique. Quatreappartements de quatre à sept pièces sont définispar des murs de clôture subdivisant les portiqueset une partie de la cour centrale. De petits couloirssont laissé libres à la jonction des différentes aileset aucun des appartements n’a de latrines. L’anglesud-ouest du bâtiment réutilise un mur plus anciend’époque romaine en bel appareil à bossage et unvaste édifice médiéval est appuyé contre la façadeouest. Seule une pièce de ce dernier a été fouillée. Ils’agit d’une longue salle dallée dont la couvertureétait assurée par sept arcs transversaux.
Le château occidental, en limite sud-ouest dusite, a un plan assez proche. C’est un édifice de45.60 x 46.20 m de côté qui est dans un état deconservation relativement bon, puisque la plupartdes murs sont conservés jusqu’au niveau des lin-
teaux (Fig. 10). Tout comme l’édifice précédent, iln’a fait l’objet que de relevés architecturaux et dedégagements mineurs. Il possède un mur d’enceintelarge de 1.50, qui n’a pas de tours-contreforts. Ilest subdivisé en cinq appartements par des murs declôture dans la cour centrale à portique. Chacundes appartements possède des latrines qui font par-tie du projet originel. Les pièces sont accessiblespar des portes directement depuis la cour, à l’ex-ception de quelques pièces situées en particulierdans les angles et pour lesquelles il existe des com-munications latérales. Les maçonneries des mursde ce château sont sensiblement différentes decelles du château oriental, soit avec des blocséquarris un peu plus régulièrement et avec beau-coup moins de petites pierres dans les intersticesentre les blocs. C’est cet édifice, dont le plan avaitété levé par Rudolf Brünnow et Alfred vonDomaszewski7, qui a été interprété auparavantcomme un camp militaire ou un relais routierd’époque romaine.
Malgré l’absence de données stratigraphiquessûres, les caractéristiques architecturales de cesdeux édifice, en particulier la subdivision en appar-tements distincts par le biais de murs de clôturedans les cours, ne laissent guère de doute quant àleur contemporanéité avec le château oriental.
2.3 LA MOSQUÉE
La mosquée se trouve à une soixantaine de mètresà l’est de la façade principale du château oriental.La fouille complète de ce petit monument a mis enévidence deux édifices successifs superposés(Fig. 11). Le plus ancien est un édifice rectangulai-re de 10.30 m de large pour 14 m de long. Le faitqu’il ait exactement la même orientation que ledeuxième plaide pour que ce soit aussi une mos-quée, mais rien ne subsiste de son mur de qibla,qui en aurait assuré la fonction.
Le second édifice est une petite mosquée de11.50 de large pour 12.50 m de long subdivisée pardeux rangées de trois arcades transversales définis-sant deux nefs latérales et une nef centrale pluslarge (Fig. 12). Ces arcades étaient portées par descolonnes, respectivement des demi-colonnes enga-gées contre les murs, sur bases cubiques et avec deschapiteaux tronconiques. Le mur de qibla est mar-qué par un profond mi˛rb semi-circulaire saillantà l’extérieur. Deux portes, au nord et à l’est, don-
4 Kallner-Amiran 1950; Russell 1985, 47–49; Tsafrir – Foers-ter 1992; sur la possibilité de plusieurs tremblements deterre, voir en particulier Karcz 2004, 778–787.
5 Haldimann 1992, 232; Bujard – Joguin 2001, 142.6 Bujard 1997, 363.7 Brünnow – Domaszewski 1905, Fig. 670.
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 127
naient accès à l’édifice, qui était aussi bordé, à l’est,par une petite cour dans laquelle se trouvaient desbanquettes. Les murs sont montés dans le mêmeappareil que ceux du château oriental.
Il s’agit donc d’une mosquée hypostyle à nefaxiale, mais elle se distingue des grandes mosquéescontemporaines par l’absence d’une cour précé-dant la salle de prière au nord. Ce plan se trouveaussi à Qasr al-Hallabat8 (avec un portique) ou, demanière réduite, au Jabal Says9.
2.4 LES INSTALLATIONS DU WADIAL-QANATIR
Le Wadi al-Qanatir est un grand cours d’eau tem-poraire avec une orientation générale du nord-nord-est au sud-sud-ouest qui passe à l’est d’Ummal-Walid. Dans l’un de ses méandres, à 2 km à l’estdu village, d’imposantes installations hydro-agri-coles ont été construites. Il s’agit de deux barragesde retenue, de plusieurs bâtiments de fonctionindéterminée, d’un pressoir à vin et d’un cellier(Fig. 13).
Les deux barrages sont construits en travers duwadi, à 1 km de distance l’un de l’autre. Ces sontdes barrages-poids destinés à créer des retenuesd’eau pour l’irrigation des terres cultivées. Sur leplan architectural et technique, les deux barragessont assez semblables l’un à l’autre.
2.4.1 Le barrage amont
Le barrage amont, aujourd’hui contourné par lecours d’eau, comprend deux états (Fig. 14 et 15).Le premier barrage construit est long de 135 m,épais à sa base de 6.10 m et haut de 9 m au maxi-mum. Les deux parements de cet ouvrage sont for-més d’assises régulières de blocs rectangulaires degrand appareil en calcaire local et enserrent un blo-cage, également monté par assises, de moellonsbruts noyés dans un abondant mortier de chauxtrès cendreux. Le parement amont est vertical,alors que le parement aval est échelonné, chaqueassise étant en retrait d’une dizaine de centimètresde la précédente. Sur ce dernier, légèrement décalévers la rive droite et dans l’axe du thalweg antique,se trouve un contrefort long de 15 m et épais de1.20 m. La stabilité de l’ouvrage était encore accruepar un talus de remblai qui s’élevait jusqu’à mi-hauteur du parement aval. Le couronnement dubarrage est recouvert par une chape de mortier.
Des exutoires permettant une utilisationcontrôlée de l’eau traversent l’ouvrage de part enpart; ce sont deux petits conduits disposant d’unsystème de vannes – panneaux métalliques ou debois coulissant dans des rainures – à leur débou-ché. Ces exutoires étaient prolongés par des
canaux destinés à conduire l’eau en contrebas versdes surfaces cultivées. À l’une des extrémités dubarrage, un déversoir était destiné à évacuer le sur-plus d’eau en cas de forte crue; détruit lors des tra-vaux du deuxième état, il devait se présenter sousla forme d’un plan incliné qui échancrait le barragesur 8 m de longueur à une altitude inférieure de3 m à celle du couronnement.
Le deuxième état du barrage correspond à unimportant remaniement destiné à augmenter levolume de la retenue ou, si les alluvions n’ont pasété enlevées régulièrement, de lui redonner unvolume rentable. Le plan incliné du déversoir estreconstruit au même emplacement et sous la mêmeforme, mais le niveau de son seuil est surélevé deplus de 1 m. Cette surélévation augmente la capa-cité de la retenue, mais diminue la stabilité de l’ou-vrage et il faut probablement y voir la raison desautres modifications, qui participent d’un renfor-cement du barrage. Ce dernier est épaissi de 2.45 msur toute sa longueur par l’ajout, contre la faceamont, d’un nouveau parement précédé d’un blo-cage. Le nouvel appareil, très semblable à celui del’enceinte du château oriental d’Umm al-Walid, estcomposé de blocs de grandes dimensions grossière-ment équarris et posés par assises égalisées par desdéchets de taille; trois couches de mortier de chauxcendreux le rendaient parfaitement étanche. Lesexutoires sont prolongés à travers la nouvellemaçonnerie et leurs ouvertures, également pour-vues de vannes, sont légèrement surélevées, afind’éviter une mise hors d’usage trop rapide par l’al-luvionnement. Une canalisation, rapidementcondamnée et dont la fonction reste obscure, estaussi installée sur toute la longueur du couronne-ment du barrage.
En amont du barrage, sur les flancs de la vallée,le wadi est ceinturé de deux murets, longs de prèsde 1 km. Ils servaient à protéger la retenue dessédiments amenés par les eaux de ruissellement. Àune soixantaine de mètres au nord du barrage, setrouve en outre un petit bâtiment, peut-être l’habi-tation d’un gardien. Il s’agit simplement d’unenclos rectangulaire dont deux des angles sontoccupés par de petites pièces.
La datation du premier état de ce barrage estassurée par des fragments de céramique contenusdans la maçonnerie, qui empêchent d’y voir unédifice antérieur aux premiers temps islamiques.Les similitudes des techniques de construction,que ce soit dans l’appareil du parement ou dans lesmortiers utilisés, entre le deuxième état et le châ-teau oriental d’Umm al-Walid permettent d’ensupposer la contemporanéité. Ainsi, les deux états
8 Bisheh 1980, 73–74; cf. aussi Arce 2006.9 Brisch 1965, 147–149.
Denis Genequand128
du barrage peuvent-ils être datés de la périodeomeyyade.
2.4.2 Le barrage aval
Le barrage aval est construit selon le même planque le barrage amont. Il est toutefois plus long(187 m), moins épais (4.20 m à sa base) et moinshaut (7 m au maximum) et son contrefort est trèsnettement décalé vers la rive droite pour se trouverdans l’axe du thalweg antique, point le plus fragilede l’ouvrage (Fig. 16 et 17). L’appareil des pare-ments est semblable à celui du deuxième état dubarrage précédent. Le parement aval est aussi éche-lonné et se caractérise par la présence, à mi-hau-teur, d’une assise principalement composée degrands blocs à bossage de remploi provenant desbâtiments antiques d’Umm al-Walid. Les élémentsdécrits précédemment – deux exutoires à vannes,un déversoir, une canalisation sur le couronnement– existent aussi et sont construits de la mêmefaçon. En outre, quelques réaménagements ont étéeffectués alors que la retenue était déjà passable-ment comblée par les alluvions; en effet, l’un desexutoires a été condamné et l’autre a vu son ouver-ture amont pourvue d’un canal maçonné d’amenéed’eau aménagé en tranchée dans les sédiments allu-viaux. Sur la face aval, le même exutoire est doté,peut-être dès l’origine, d’un petit plan incliné, quidevait servir de support à un départ de canal.L’ouvrage présente enfin, en son centre, unebrèche longue d’une quarantaine de mètres et attri-buable à l’action conjointe de l’érosion et des infil-trations dans la maçonnerie après son abandon10.
Des murets de protection contre un alluvion-nement important de la retenue sont égalementconstruits sur les flancs de la vallée et ne sont inter-rompus qu’à faible distance du barrage amont.L’observation du même type d’aménagements endessous du barrage aval se laisse moins bien expli-quer. Peut-être ne servaient-ils qu’à délimiter unezone cultivée ?
Le mobilier récolté aux alentours de ce secondbarrage, tant en surface que dans la fouille du pres-soir adjacent, est datable exclusivement del’époque omeyyade. Par ailleurs, les nombreusesanalogies entre les techniques de construction dece barrage, du renforcement du précédent et duchâteau oriental d’Umm al-Walid, assurent unecertaine contemporanéité des trois chantiers.
La fonction de ces barrages, dans une régionqui ne reçoit guère plus de 200 mm de pluie parannée, est de créer des réserves d’eau à mêmed’être utilisées durant la saison sèche. La présencedes exutoires prolongés par des départs de canauxpermet de reconnaître l’existence, immédiatementsous les barrages, de deux secteurs irrigués. En rai-
son des contraintes topographiques, les surfacesutilisables pour une irrigation directe étaient del’ordre de 2 hectares pour le premier barrage et4 hectares pour le second. L’eau y était vraisembla-blement répartie par des canaux en terre. À côté decette irrigation directe, on ne peut pas exclure uneutilisation de l’eau, par portage, pour des culturesplacées sur les flancs de la vallée. Des analysespalynologiques attestent d’un paysage déboisédominé par les graminées et les céréales (seigle, bléet orge)11. Elles attestent aussi de la culture del’olivier.
Ces deux barrages s’intègrent dans une petitesérie de grands barrages-poids construits sous lesOmeyyades au Bilad al-Sham. Il s’agit, en plus deceux d’Umm al-Walid, des deux barrages deQastal12 et des deux barrages de Qasr al-Hayr al-Gharbi en Syrie (barrage de Harbaqa et barragedu ‘jardin’)13.
2.4.3 Le pressoir
Un groupe de bâtiments composé de deuxensembles se trouve à côté de l’extrémité sud dubarrage aval (Fig. 17). Le premier, à l’est, s’organiseautour d’un édifice primitif subdivisé en deuxpièces, contre lequel sont venus successivements’ajouter les murs fermant une cour, puis un édificede plan identique, mais d’orientation inversée. Ils’agit peut-être d’un ensemble domestique.
Le second ensemble, à l’ouest, comprend unbâtiment divisé en trois pièces allongées. C’estcontre son mur sud qu’a été édifié le pressoir à vinet il faut probablement y voir un cellier.
Le pressoir à vin présente deux états. Le pre-mier état correspond à un bâtiment carré de 9 m decôté partiellement excavé, construit en blocs decalcaire et entièrement voûté en berceau. Il estcomposé d’une vaste pièce bordée par quatre petitslocaux (Fig. 18 et 19). La grande pièce est acces-sible par quelques marches et a un sol recouvertd’une mosaïque de grosses tesselles blanches. Elleétait destinée au foulage, qui se faisait à même lesol, et au pressurage des raisins. Au centre de lapièce, une pierre d’ancrage dans laquelle est tailléeune mortaise au profil en queue d’aronde servait àencastrer la base de l’axe vertical d’un pressoir à visdirecte (Fig. 20). Une cuve, d’une contenance de4500 litres, dans laquelle le moût pouvait s’écouler
10 Pour d’obscures raisons, cette brèche a été entièrementcomblée par de nouvelles maçonneries en 2000–2001.
11 Analyses palynologiques réalisées au laboratoire Archéo-labs par Laurence Marambat en juin 1999; Archéolabs réf.ARC99/R2172P.
12 Calier – Morin 1987, 231–233; observations personnelles.13 Schlumberger 1986; pour la datation du barrage de Har-
baqa, voir Genequand 2006.
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 129
directement après les deux opérations est placéedans un des angles. Les quatre petits locaux bor-dant la grande pièce étaient destinés à entreposer leraisin avant qu’il ne soit foulé; leurs sols sontégalement recouverts d’un pavement de mosaïque.Chacun de ces locaux dispose aussi d’un systèmede récupération du moût issu des raisins écraséssous leur propre poids14; ce sont, au bout de courtsconduits, des bassins placés sous des niches dansl’épaisseur du mur de refend. Toutes les paroisintérieures de l’édifice sont recouvertes par deuxou trois couches d’un enduit étanche de mortier dechaux cendreux. La seule incertitude à propos duprocessus de fabrication du vin dans cette installa-tion est le lieu où se faisait la fermentation. Cettedernière a pu se faire soit à même la cuve, ce qui neva pas sans poser des problèmes d’organisation encas de fort rendement, soit dans des jarres à l’inté-rieur d’un autre local, probablement dans le celliervoisin.
Le deuxième état est un agrandissement dupressoir qui passe par la destruction de sa façadeorientale, où se trouvait l’entrée, afin de permettrela construction de quatre entrepôts supplémen-taires pour garder le raisin avant traitement et d’uncouloir d’accès. Ses dimensions passent alors à13.50 x 9/9.60 m. La couverture des nouveauxlocaux était assurée par une charpente plate, recou-verte de terre argileuse, qui reposait sur les murs etsur un arc remplaçant la façade primitive détruite.
La construction de ce pressoir remonte à lapremière moitié du IIe/VIIIe siècle. Comme pourles barrages, cette datation est assurée par la céra-mique récoltée durant la fouille – datable exclusive-ment du début de l’ère islamique – et par les tech-niques de construction qui sont extrêmementproches de celles du château oriental d’Umm al-Walid. L’édification du pressoir, celle des bâti-ments adjacents et celle du barrage aval sont trèsprobablement à regrouper dans un seul et mêmegrand chantier.
D’un point de vue technique, ce pressoir s’ins-crit dans la tradition romaine tardive et byzantine.De nombreuses installations du même genre ontété documentées pour les Ve, VIe, et VIIe sièclesdans et autour des villages de Jordanie, de Palestineet de Syrie du Sud15. Le pressoir proprement ditest du type de ceux qui sont représentés sur lesmosaïques des églises des Saints Lot et Procope etde Saint Georges à Khirbat al-Mukhayyat, ainsique de l’Evêque Serge à Umm al-Rasas, toutesdatées du VIe siècle16. Toutefois, le contexte pure-ment islamique dans lequel le pressoir d’Umm al-Walid est construit entraîne à constater une per-sistance de ces installations durant la périodeomeyyade, ce que le site d’Umm al-Summaq, ausud de fiAmman, ou les installations de Sifi 8 enSyrie du Sud avaient déjà démontré17.
2.5 DATE DU COMPLEXE
Au vu de la présentation qui précède, il semble évi-dent qu’Umm al-Walid présente un ensemble deconstructions – trois châteaux, deux mosquéessuccessives et les installations hydro-agricoles dansle Wadi al-Qanatir – qui sont contemporaines, for-ment un tout cohérent et ont été superposées à unétablissement de l’Antiquité. Le mobilier qui a étéretrouvé en fouille, en particulier dans les niveauxdu tremblement de terre dans le château oriental,mais aussi dans les couches d’abandon du pressoir,met en évidence une occupation qui s’arrête aumilieu ou dans la seconde moitié du IIe/VIIIe
siècle. Il reste donc à définir quand ces construc-tions ont été édifiées. Évidemment, toutes ne l’ontpas été exactement en même moment, comme lemontrent les deux mosquées successives ou lesdeux états du barrage amont, mais au cours d’unlaps de temps de quelques années à quelquesdécennies, en fonction des besoins de l’établisse-ment et de son agrandissement.
Les éléments stratigraphiques pouvant fournirune date sont rares (contextes avec du matérieldatant antérieurs aux constructions). Mais d’autreséléments entrent en ligne de compte. La présenced’une mosquée hypostyle à mi˛rb semi-circulaireet nef axiale ne permet pas de remonter la date au-delà des deux premières décennies du IIe/VIIIe
siècle (reconstruction de la mosquée de Médine etgrandes mosquées de Damas et Jérusalem). Le plandu château oriental trouve aussi de bons parallèlesdans la longue série des châteaux omeyyades duProche-Orient, dont aucun n’est assurément anté-rieur au IIe/VIIIe siècle. Ces parallèles sont, parexemples, les tours-contreforts semi-circulaires, larépétition d’appartements semblables au sein d’unseul bâtiment ou la présence de latrines danschaque appartement. Les techniques de construc-tion des différents monuments vont dans le mêmesens et les appareils, les marques sur les enduitsd’accrochage, etc., sont assez caractéristiques desconstructions d’époque omeyyade en Jordanie.
Tout porte donc à placer la fondation et laconstruction des différents monuments d’Umm al-Walid à l’époque omeyyade et plus précisémentdans le courant de la première moitié du IIe/VIIIe
siècle.
14 Pline, Nat. Hist., XIV, 85; Géoponiques, Florentinus, VI,16, 1.
15 Par exemple Saller 1941, 193–195; Piccirillo 2002, 556–557;Roll – Ayalon 1981; Hirschfeld 1983; Dentzer – Feydy etal. (eds.) 2003.
16 Saller – Bagatti 1949, pl. 24/1; Piccirillo 1993, 158 Fig. 206;208 Fig. 334.
17 Rashdan 1989; Dentzer – Feydy et al. (eds.) 2003.
Denis Genequand130
3 KHAN AL-ZABIB
Le site de Khan al-Zabib se trouve à 36.5 km ausud-est de Madaba et présente un complexe trèsproche architecturalement de celui d’Umm al-Walid. Khan al-Zabib est néanmoins situé dansune zone déjà beaucoup plus sèche et, hormisquelques enclos, ne présente pas de traces de miseen valeur agricole de ses environs. Le site a déjà étéétudié superficiellement à plusieurs reprises18 etcomprend principalement deux châteaux et unemosquée rassemblés dans un petit périmètre(Fig. 21). À un peu moins de 200 m à l’est, se trou-vent aussi les ruines de quelques maisons associéesà des citernes. Ces maisons ne sont plus matériali-sées que par une à deux assises de pierres au sol etleurs élévations devaient être en briques crues, àmoins que les matériaux de leurs murs n’aient étérécupérés lors de la construction des châteaux. Unpetit peu de céramique d’époque romaine etromaine tardive a été trouvée en surface dans lazone des châteaux et publiée19. Cette céramiqueatteste d’une occupation à cette époque, mais peud’éléments permettent d’en définir la nature.
Les travaux de terrain, menés en 1999, ontcompris la fouille de la mosquée et des sondagesdans le château oriental, alors que le château occi-dental, dans un état de conservation bien meilleur,n’a fait l’objet que d’une étude architecturale. Lamosquée et le château oriental ont passablementsouffert de destructions faites avec des engins dechantier lourds au cours des dernières décennies.
3.1 LE CHÂTEAU OCCIDENTAL
Le château occidental de Khan al-Zabib mesure63.40 x 64.40 m de côté et présente un plan éton-namment proche de celui du château orientald’Umm al-Walid, au point qu’il est difficile de nepas admettre des liens étroits entre les architectesou les propriétaires des deux sites (Fig. 22 et 23). Lemur d’enceinte est percé d’une porte et renforcé pardix-sept tours-contreforts en demi-cercle, trois-quarts de cercle et quart de cercle, respectivementle long des courtines, aux angles et de part etd’autre de la porte. À l’intérieur, quatre ailes d’uneseule rangée de pièces et séparées par des couloirsouverts sont organisées autour d’une cour centraleà portique. Cinq appartements de quatre à sixpièces sont définis par des murs de clôture subdivi-sant la cour centrale. Toutes les pièces sont acces-sibles depuis cette dernière, à l’exception de deuxpièces de l’aile sud qui sont reliées à leur voisine.Aucun des appartements n’est équipé de latrines.Comme à Umm al-Walid, les deux pièces encadrantl’entrée ne sont pas rattachées à un appartement.
L’édifice est construit en blocs de calcaire local
grossièrement équarris et présente un appareiltypique avec tous les joints remplis de petitespierres et déchets de taille. Les toitures étaientplates et reposaient sur les murs et sur des arcstransversaux (deux arcs dans les pièces de l’ailenord). Les photographies anciennes montrent quecertaines portes des pièces autour de la cour étaientsurmontées de petites ouvertures20.
La céramique trouvée dans cet édifice indiqueune occupation durant le IIe/VIIIe siècle et desréoccupations durant les périodes médiévale etmoderne.
3.2 LE CHÂTEAU ORIENTAL
Bien que plus petit, 48 x 51 m, le château orientalprésente presque le même plan, mais diffère par sesmatériaux de construction (Fig. 24). Il est en effetconstruit avec des murs de briques crues sur sou-bassement de pierre, une technique de construc-tion plutôt inhabituelle dans la région. Seule laporte d’entrée était entièrement construite en pier-re. Le mur d’enceinte, large de 1.10 m, est renforcéde quatorze tours-contreforts semi-circulaires(quart de cercle, demi-cercle et trois-quarts decercle) sur soubassements carrés. À l’intérieur del’édifice, autour de l’habituelle cour à portique, setrouvent deux pièces indépendantes de part etd’autre de l’entrée et quatre appartements de troisou quatre pièces définis par des murets subdivisantla cour. Toutes les pièces ouvrent directement surla cour et, pour en augmenter le nombre, un descouloirs séparant les différentes ailes a été fermé.
Comme dans tous les autres monumentsd’Umm al-Walid et de Khan al-Zabib, les pièces dece château étaient couvertes par des toitures platesreposant sur des arcs (charpentes de bois et terreargileuse). Les colonnes et chapiteaux du portiquesont en calcaire; les seconds ont la forme de chapi-teaux corinthiens, mais ne portent aucun décor etsont simplement épannelés. L’entrée était encadréepar des demi-colonnes doubles engagées.
Le mobilier des sondages pratiqués dans lacour et dans certaines des pièces indique une occu-pation de relativement courte durée au IIe /VIIIe
siècle et qui ne s’est en tout cas pas prolongée au-delà du début du IIIe/IXe siècle.
18 Tristram 1874, 170–174; Brünnow – Domaszewski 1905,76–83; Parker 1986, 45–48. 170. 190–193.
19 Parker 1986, 47. 170. 190–193. Contrairement à Parker quilocalise la grande majorité de la céramique romaine/romai-ne tardive dans le château oriental, les travaux de la missionsuisse n’y ont trouvé, que ce soit en fouille ou en surface,que de la céramique datable de l’époque omeyyade.
20 Brünnow – Domaszewski 1905, Fig. 657.
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 131
3.3 LA MOSQUÉE
La mosquée est située en avant des façades princi-pales des deux châteaux. Elle avait déjà été partiel-lement détruite par des bulldozers et a été complè-tement fouillée. Elle présente le même plan quecelle d’Umm al-Walid. Toutefois, comme le châ-teau voisin, elle était construite avec des murs debriques crues sur des soubassements de pierres.C’est un petit édifice hypostyle de 12.60 de largepour 13 m de long (Fig. 25). Deux rangs de troisarcades la subdivisent en deux nefs latérales et unenef centrale plus large. Le mur de qibla est marquépar un profond mi˛rb semi-circulaire et saillant àl’extérieur. Il n’y a pas de cour. Les arcades repo-saient sur des colonnes et des demi-colonnesdoubles engagées qui devaient porter des chapi-teaux corinthiens simplifiés, comme dans le châ-teau voisin.
3.4 DATE DU COMPLEXE
Au vu du mobilier trouvé sur le site et des carac-tères architecturaux des trois monuments, il paraîtimpensable de ne pas associer Khan al-Zabib etUmm al-Walid. Il faut donc voir dans Khan al-Zabib un autre complexe omeyyade cohérent dela première moitié du IIe/VIIIe siècle et non plusun ensemble disparate de monuments romains etislamiques.
4 QASR AL-MSHATTA
Qasr al-Mshatta est probablement l’un des plusconnus des ‘châteaux du désert’ omeyyades et l’unde ceux qui ont fait couler le plus d’encre. C’estaussi l’un des premiers à avoir été redécouvert etintégré au débat sur leur datation. Qasr al-Mshattase trouve à 21 km à l’est-nord-est de Madaba et esttout proche des sites de Qastal et Zizia.
4.1 ÉTAT DE LA RECHERCHE
Qasr al-Mshatta a été documenté pour la premièrefois par le chanoine Henry Tristram en 187221.Autour de 1900, le monument a été de nouveauétudié par Rudolf Brünnow, puis par Alois Musil22.Le plan le plus complet a été levé par Bruno Schulzen 1903, au moment où le sultan fiAbd al-Hamid IIa donné la façade sculptée à Guillaume II, qui l’afaite transporter à Berlin où elle est toujours expo-sée23. La documentation architecturale a été com-plétée par K.A.C. Creswell24.
Qasr al-Mshatta a été l’objet d’un très longdébat sur sa datation préislamique ou islamique,
débat qui n’est pas complètement clos puisqueencore récemment il a été proposé à deux reprisesque le monument ne soit pas omeyyade, maisabbasside25. Il y a eu les tenants de la datation pré-islamique (byzantin, ghassanide ou sassanide) ouislamique (omeyyade, abbasside ou médiéval).Néanmoins, c’est Ernst Herzfeld qui va plus oumoins clore le débat en 192126. La datationomeyyade du monument est alors assez générale-ment acceptée, de même que son attribution aucalife al-Walid b. Yazid (125–126/743–744) sur labase d’un passage de Sévère ibn al-Muqaffafi dansl’Histoire des patriarches coptes d’Alexandrie27. Ily est rapporté que, avant son assassinat, al-Walid b.Yazid avait commencé à faire construire une ville(madına) dans le désert, ville qui aurait porté sonnom et se serait trouvée loin de tout point d’eau.Bien que souvent acceptée, cette identification neva pas sans poser des problèmes et il est aussi pos-sible que Qasr al-Mshatta a eu un autre comman-ditaire, par exemple un puissant chef tribal ou unriche gouverneur28.
4.2 DESCRIPTION
Qasr al-Mshatta est un monument dont la con-struction n’a jamais été achevée. Il présente unplan carré de 147 m de côté (144 m de côté dansl’œuvre). Seuls ont été construits le mur d’enceinteet une partie des élévations de la bande centrale dumonument qui est marqué par une subdivision tri-partite (Fig. 26 et 27). Une des caractéristiques decet édifice est d’avoir été construit en briquescuites sur un important soubassement de pierre.Toutes les voûtes assurant la couverture des piècessont aussi en briques cuites. Ces modes deconstruction – briques cuites, usage systématiquede la voûte – sont importés du domaine mésopota-mien, soit de la province d’Irak, et l’on verra quenombre de parallèles architecturaux sont à recher-cher dans la même province.
Le mur d’enceinte est renforcé de quatre tours-contreforts en trois-quarts de cercle aux angles, dedix-neuf tours-contreforts en demi-cercles le longdes côtés (dont plusieurs abritent des latrines) et dedeux tours-contreforts polygonales flanquant la
21 Tristram 1874, 195–215. 367–385.22 Brünnow – Domaszewski 1905, 105–176. 308–311; Musil
1907, 196–203.23 Schulz 1904; Enderlein – Meinecke 1992.24 Creswell 1969, 578–606.25 Grabar 1987; Whitcomb 2000.26 Herzfeld 1921.27 Sawirus ibn al-Muqaffafi 1947, 114–115.28 Bisheh 1987, 193. Les découvertes épigraphiques et numis-
matiques présentées dans cet article confirment amplementune datation omeyyade du monument.
Denis Genequand132
porte. Sur le parement intérieur du mur d’enceinte,des harpes verticales signalent l’emplacement desmurs planifiés, mais qui n’ont jamais étéconstruits. De part et d’autre de la porte d’entrée,la façade et les deux tours-contreforts polygonalessont entièrement recouvertes d’un riche décorsculpté29.
La partie centrale du monument comprend, dusud au nord: un bloc d’entrée avec différentespièces réparties en quatre groupes ou apparte-ments, une cour aux parois rythmées par despilastres et une mosquée; le bloc d’entrée est suivipar une grande cour centrale; puis vient une partieofficielle incluant une salle à trois nefs ouverte enfaçade et prolongée par une salle de réception tri-conque et quatre appartements latéraux.
4.3 TRAVAUX DE TERRAIN ETNOUVELLES DONNÉES SUR LEPLAN DE QASR AL-MSHATTA
Les pierres d’attente mise en place par lesconstructeurs sur le parement intérieur du murd’enceinte ont entraîné de nombreuses proposi-tions de restitution du plan qu’aurait eu le monu-ment s’il avait été terminé. Lors de visites sur lesite, alors que la mission suisse travaillait à Ummal-Walid, il a été remarqué que des dégagementseffectués par le Département des Antiquités deJordanie avaient mis au jour des fondations demurs dans la partie occidentale, non terminée, dumonument. Partant de l’idée que ces fondationsdevenues visibles étaient celles des éléments nonconstruits en élévation et qu’elles devaient aussiavoir été posées sur le reste de la surface, un projeta été mis sur pied pour reprendre l’étude du plande Qasr al-Mshatta. Après un nouveau relevéarchitectural de toutes les parties construites en1999, il a été décidé de procéder à de grandsdégagements sur l’ensemble de la surface de la par-tie occidentale du monument en 2000.
Les structures qui ont été mises au jour sont dedeux types. Il s’agit soit de tranchées de fondationsqui ont été creusées mais dans lesquelles les fonda-tions n’ont pas été construites, soit de fondationsconstruites jusqu’au niveau du ressaut marquantleur sommet. Ces fondations sont construitesd’une manière assez particulière. Des murets depierre perpendiculaires à l’axe de la tranchée etespacés de 1 m sont d’abord construits, puis lescaissons ainsi définis sont remplis par un blocage,avant qu’une chape de mortier de chaux ne viennerecouvrir le tout (Fig. 28 et 29). C’est sur cettedernière que les élévations auraient dû êtreconstruites.
L’étroite correspondance entre les fondations etles pierres d’attente dans le mur d’enceinte permet
d’assurer que les éléments mis au jour correspon-dent bien au projet de construction interrompu.On dispose ainsi d’un plan fiable, au niveau desfondations, de la partie occidentale du monument(Fig. 30). Des incertitudes subsistent toutefois aumilieu de la partie occidentale, où aucune tranchéede fondation n’avait encore été creusée. La partieorientale est restituée par symétrie, symétrie queconfirment quelques petits sondages de vérifica-tions et surtout l’emplacement des pierres d’atten-te dans le mur d’enceinte.
Évidemment, un plan au niveau des fondationsn’indique ni les portes, ni de manière claire lesespaces qui étaient des cours. Certaines de ces der-nières apparaissent cependant assez clairement etd’autres peuvent être déduites pour des questionsde répartition des appartements et d’accès auxpièces, mais aussi de lumière (Fig. 31). Enfin, lacomparaison avec le plan des constructions de lapartie centrale du monument permet d’envisager lamanière dont les pièces étaient regroupées entreelles pour former des appartements (bayt / buyüt).L’ensemble du monument aurait compris trente-deux appartements en tout, correspondant à desregroupements de quatre ou cinq pièces et un seulde trois pièces (Fig. 31 et 32). Le regroupement quia traditionnellement été appelé le ‘bayt syrien’, soitune grande pièce centrale distribuant sur quatrelocaux plus petits, est fréquemment utilisé.
Chacune des deux parties latérales du monu-ment comprend deux vastes cours accessiblesdepuis la cour centrale et distribuant sur six appar-tements. Deux de ces derniers, au nord et au sud dechacune des vastes cours, ont le plan du ‘baytsyrien’ et des pièces de grandes dimensions. Lesquatre autres, alignés le long du mur d’enceinte,ont des pièces plus petites; deux d’entre eux ontégalement le plan du ‘bayt syrien’, alors que lesdeux autres incluent un couloir d’accès, une petitecour, une grande pièce et quatre petits locauxcontigus.
4.4 DISCUSSION
Le plan de Qasr al-Mshatta diffère passablementde celui des qußür ou ‘châteaux du désert’ clas-siques, comme Qastal30 ou Qasr al-Hayr al-Ghar-bi31. Mais, malgré ses grandes dimensions et unnombre important d’appartements, ce plan n’estpas non plus complètement comparable à celui desvilles nouvelles omeyyades comme fiAnjar32, la
29 Brünnow – Domaszewski 1905, 105–176; Trümpelmann1962.
30 Carlier – Morin 1987.31 Schlumberger 1986.32 Voir en dernier lieu Hillenbrand 1999.
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 133
citadelle de fiAmman33, al-fiAqaba34 ou Qasr al-Hayr al-Sharqi35, en ce qu’il manque une voirieplus développée, une véritable mosquée congréga-tionelle de grandes dimensions et surtout des bâti-ments ou des installations à caractère économique,commercial ou industriel36. On peut cependantobjecter que Qasr al-Mshatta n’a pas été terminé etqu’on ne sait pas ce qui aurait pu prendre placeautour du mur d’enceinte. Dans cette série de villesnouvelles omeyyades, le parallèle le plus procheest la partie palatiale de la citadelle de fiAmman,soit la partie au nord du hall d’entrée cruciforme,c’est-à-dire sans la grande mosquée, le marché/süqet toutes les autres constructions de la terrassesupérieure. On y retrouve alors un axe central avecbloc d’entrée, rue à colonnades, puis salle de récep-tion, alors que des appartements autour de courssont répartis sur les côtés. Si, comme l’a proposéAlastair Northedge, le palais de Qasr al-Hayr al-Sharqi avait été intégré dans la grande encein-te37, on aurait alors aussi un complexe plus compa-rable à Qasr al-Mshatta. Au vu de ces deux compa-raisons – citadelle de fiAmman et Qasr al-Hayral-Sharqi – on peut considérer que Qasr al-Mshattaest plus proche, dans sa conception et son organi-sation, des villes nouvelles omeyyades que desqußür ou ‘châteaux du désert’.
Par contre, le plan de Qasr al-Mshatta gardequand même un caractère palatial très marqué, audétriment d’un caractère urbain dont le palais neserait qu’un seul élément. Il annonce assez claire-ment certains des grands monuments abbassidesde la seconde moitié du IIe/VIIIe et du IIIe/IXe
siècle, en particulier al-Ukhaydir, vraisemblable-ment construit par fiIsa b. fiAli, oncle d’al-Mansur,durant la seconde moitié du IIe/VIIIe siècle38. Lepalais d’al-Ukhaydir présente en effet une divisiontripartite et un agencement intérieur très sem-blable. La bande centrale est aussi subdivisée en unbloc d’entrée flanqué par une mosquée, suivi d’unevaste cour, puis de la partie officielle avec iwn,salle de réception et appartements latéraux. Demême, les bandes latérales possèdent deux vastescours distribuant vers des appartements.
On évoquera aussi les palais C et D d’al-Raqqa,qui présentent le même type de division tripartiteet ont été construits entre 180/796 et 192/808,durant la période de résidence du calife Harun al-Rashid dans la ville39. Si le palais C n’a guèreque la division tripartite en commun avec Qasr al-Mshatta, le palais D, quoi qu’incomplètementconnu, en est plus proche avec ses subdivisionsintérieures.
Enfin, le plan de Qasr al-Mshatta n’est pas nonplus sans évoquer certains des palais et desgrandes maisons de Samarra√, comme le palaisd’al-fiAshiq ou certaines des maisons d’al-Muta-wakkiliyya40.
5 CONCLUSION
Les travaux menés à Umm al-Walid, Khan al-Zabib et Qasr al-Mshatta ont révélé ou permisde mieux appréhender trois sites omeyyades ducentre de la Jordanie. Parmi ceux-ci, Qasr al-Mshatta était déjà bien connu et l’apport desnouvelles recherches sur son plan permet surtoutde mieux replacer le monument dans le contexte del’architecture palatiale et des villes nouvelles de lahaute époque islamique.
Avec Umm al-Walid et Khan al-Zabib, ce sontdeux établissements d’un type assez différent quiont été étudiés. En effet, s’ils se rapportent à lalongue série des ‘châteaux du désert’ ou ‘châteauxomeyyades’, ils présentent toutefois plusieurscaractères particuliers. Il y a en premier lieu l’ab-sence de caractère palatial. Ni les plans des édifices– sans espace de réception clairement marqué – nile soin apporté à leur décoration n’en font de véri-tables palais, à l’image de Qasr al-Hayr al-Gharbiou de Qastal, mais plutôt ce que l’on pourrait qua-lifier de riches résidences. L’identité des comman-ditaires des deux sites est inconnue, mais on peutpenser que c’étaient plutôt des chefs tribaux ou desmembres du clan omeyyade élargi plutôt qu’uncalife ou un prince.
La nature même des différents châteaux, quiprésentent tous le même plan comprenant plu-sieurs appartements identiques et apparemmentégaux, pourrait aller dans le sens de petits établis-sements tribaux, dont les châteaux représenteraientl’habitat du groupe dominant. Il ne faut cependantpas imaginer ces établissements comme des villesnouvelles41, ainsi que le montrent très clairementles mosquées des deux sites, reflets de communau-tés musulmanes plutôt restreintes.
Sur le plan architectural, on ne manquera pasde remarquer l’originalité de la manière dont lesappartements des différents châteaux ont été sub-divisés par des murets dans les cours centrales. Onretrouve cette forme de subdivision dans les cinqchâteaux d’Umm al-Walid et Khan al-Zabib, alorsqu’elle est parfaitement inconnue dans tous lesautres monuments contemporains, où les apparte-ments sont définis par des regroupements depièces qui communiquent entre elles. Outre les
33 Northedge 1992; Almagro et al. 2000.34 Whitcomb 1995.35 Grabar et al. 1978; Genequand dans ce volume.36 Sur les villes nouvelles omeyyades en général, voir Nor-
thedge 1994.37 Northedge 1994, 236.38 Reuther 1912; Northedge 2002.39 Saliby 2004a; Saliby 2004b; Meinecke 1998.40 Northedge 2005, 220–221 (maisons d’al-Mutawakkiliyya).
233–235 (al-fiAshiq).41 Northedge 1994; Genequand dans ce volume.
Denis Genequand134
techniques de constructions, c’est surtout cet élé-ment du plan des châteaux qui dénote un très fortlien de parenté entre les deux sites.
Si Umm al-Walid et Khan al-Zabib doiventquand même être distingués dans leurs fonctions,c’est avant tout à cause de leurs installations péri-phériques. On l’a vu, à Khan al-Zabib, il n’y a,autour des châteaux et de la mosquée, quequelques petites maisons et des enclos indiquantde l’élevage difficile à quantifier. À Umm al-Walid,il y a par contre les installations du Wadi al-Qana-tir qui montrent que le ou les propriétaires des
châteaux étaient impliqués dans des activités deproduction agricole et qu’ils n’ont pas hésité àinvestir massivement dans cette direction. C’est enfait l’un des rares sites de la série des ‘châteauxomeyyades’ qui présente d’indiscutables preuvesarchéologiques montrant qu’une importante partiede l’établissement était tournée vers l’économieagricole. Il ne faut toutefois pas réduire Umm al-Walid à une grande exploitation agricole omeyya-de, mais bien y voir un établissement de la nouvel-le aristocratie musulmane, dont l’agriculture n’aété qu’une des ressources.
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 135
BIBLIOGRAPHIE
ALMAGRO, A. – JIMÉNEZ, P. – NAVARRO, J. 2000El Palacio Omeya de ‘Amman III. Investi-gacíon Arqueológica y Restauracíon 1989–1997. Granada.
ARCE, I. 2006Qasr al-Hallabat (Jordan) Revisited: Reassess-ment of the Material Evidence, in: H. Kennedy(ed.), Muslim Military Architecture in GreaterSyria, From the Coming of Islam to the Otto-man Period, Leiden-Boston, 26–44.
BISHEH, GH. 1980Excavations at Qasr al-Hallabat, 1979, AAJ 24,69–77.
BISHEH, GH. 1987Qasr al-Mshatta in the Light of a RecentlyFound Inscription, Studies in the History andArchaeology of Jordan III, 193–197.
BRISCH, K. 1963Das omayyadische Schloss in Usais, MDAIK19, 141–187.
BRISCH, K. 1965Das omayyadische Schloss in Usais (II),MDAIK 20, 138–177.
BRÜNNOW, R. E. – DOMASZEWSKI, A. VON 1905Die Provincia Arabia. II. Band: Der äussereLimes und die Römerstrassen von El-Mafian bisBosra. Strassburg.
BUJARD, J. (avec la collaboration de W. TRILLEN)1997
Umm al-Walıd et Khn Az-Zabıb, Cinq QußürOmeyyades et Leurs Mosquées Revisités, AAJ41, 351–374.
BUJARD, J. 2002Palais et châteaux omeyyades de Jordanie.Mchatta, Umm al-Walid et Khan al-Zabib,Archéologie Suisse, 25/3, 24–31.
BUJARD, J. – GENEQUAND, D. (avec la collabora-tion de W. TRILLEN) 2001
Umm al-Walid et Khan az-Zabib, deux établis-sements omeyyades en limite du désert jorda-nien, in: B. Geyer (ed.), Conquête de la steppeet appropriation des terres sur les marges aridesdu Croissant fertile, Lyon (TMO 36), 189–218.
BUJARD, J. – JOGUIN, M. 2001La céramique d’Umm el-Rasas/Kastron Mefaaet d’Umm al-Walid, in: E. Villeneuve – P.M.Watson (eds.), La céramique byzantine etproto-islamique en Syrie-Jordanie (IVe–VIIIe
siècles apr. J.-C.), Beyrouth, 139–147.BUJARD, J. – SCHWEIZER, F. (eds.) 1992
Entre Byzance et l’Islam, Umm er-Rasas etUmm el-Walid, fouilles genevoises en Jordanie,Catalogue d’exposition du Musée d’Art etd’Histoire, Genève.
BUJARD, J. – SCHWEIZER, F. 1994Aspects métallurgiques de quelques objets
byzantins et omeyyades découverts récemmenten Jordanie, in: A. Rinuy – F. Schweizer (eds.),L’œuvre d’art sous le regard des sciences, Cata-logue d’exposition du Musée d’Art et d’Histoi-re, Genève, 191–209.
CARLIER, P. – MORIN, F. 1987Archaeological Researches at Qastal, SecondMission, 1985, AAJ 31, 221–246.
DENTZER-FEYDY, J. – DENTZER, J.-M. – BLANC, P.-M.(eds.) 2003
Hauran II: les installations de Si‘ 8, du sanctuaireà l’établissement viticole. 2 Vols. Beyrouth.
CRESWELL, K.A.C. 1969Early Muslim Architecture. Oxford.
ENDERLEIN, V. – MEINECKE, M. 1992Graben-Forschen-Präsentieren. Probleme derDarstellung vergangener Kulturen am Beispielder Mschatta-Fassade, JbBerlMus, Neue Folge34, 137–172.
GENEQUAND, D. 2001Wadi al-Qanatir (Jordanie): un exemple de miseen valeur des terres sous les Omeyyades, Stu-dies in the History and Archaeology of JordanVII, 647–654.
GENEQUAND, D. 2006Some Thoughts on Qasr al-Hayr al-Gharbi, itsDam, its Monastery and the Ghassanids,Levant 38, 63–84.
GRABAR, O. 1987The Date and Meaning of Mshatta, DOP 41,243–247.
GRABAR, O. – HOLOD, R. – KNUSTAD, J. – TROUS-DALE, W. 1978
City in the Desert: Qasr al-Hayr East. Cam-bridge (MA).
HALDIMANN, M.-H. 1992Umm el-Walid: prolégomènes céramologiques,in: P. Canivet – J.-P. Rey-Coquais (eds.), LaSyrie de Byzance à l’Islam, VIIe–VIIIe siècles,Damas, 229–235.
HERZFELD, E. 1921Mshatt, Hıra und Bdiya. Die Mittelländerdes Islam und ihre Baukunst, Jahrbuch derPreußischen Kunstsammlungen 42, 104–146.
HILLENBRAND, R. 1999fiAnjar and Early Islamic Urbanism, in: G. Bro-giolo – B. Ward-Perkins (eds.), The Idea andIdeal of Town between Late Antiquity and theEarly Middle Ages, Leiden, 59–98.
HIRSCHFELD, Y. 1983Ancient Wine Presses in the Park of Aijalon,IEJ 33, 207–218.
KALLNER-AMIRAN, D. H. 1950A Revised Earthquake-Catalogue of Palestine,IEJ 1, 223–246.
Denis Genequand136
KARCZ, I. 2004Implications of Some Early Jewish Sources forEstimates of Earthquake Hazard in the HolyLand, Annals of Geophysics 47, 2/3, 759–792.
KING, G. – LENZEN, C. J. – ROLLEFSON, G. O.1983
Survey of Byzantine and Islamic Sites in Jor-dan. Second Season Report, 1981, AAJ 27,385–436.
MEINECKE, M. 1998From Mschatta to Samarra’: the Architectureof ar-Raqqa an its Decoration, in: R. Gayraud(ed.), Colloque international d’archéologie isla-mique, Le Caire, 141–148.
MUSIL, A. 1907Arabia Petraea, Bd I: Moab. Wien.
NORTHEDGE, A. 1992Studies on Roman and Islamic fiAmman. Vol. 1:History, Site and Architecture. Oxford.
NORTHEDGE, A. 1994Archaeology and New Urban Settlement inEarly Islamic Syria and Iraq, in: G.R.D. King –A. Cameron (eds.), The Byzantine and EarlyIslamic Near East. II, Land Use and SettlementPatterns, Princeton, 231–265.
NORTHEDGE, A. 2002Ukhaydir, Encyclopédie de l’Islam, 2e édition,T. X, Leiden, 853–854.
NORTHEDGE, A. 2005The Historical Topography of Samarra. Samar-ra Studies I. London.
PARKER, S. T. 1986Romans and Saracens: a History of the ArabianFrontier. Winona Lake.
PICCIRILLO, M. 1993Mosaics of Jordan. Amman.
PICCIRILLO, M. 2001The Church of Saint Sergius at Nitl. A Centreof the Christian Arabs in the Steppe at theGates of Madaba, Liber Annuus 51, 267–284.
PICCIRILLO, M. 2002The Ecclesiastical Complex of Saint Paul atUmm ar-Rasas-Kastron Mefaa, AAJ 46, 535–559.
RASHDAN, W. 1989Um es Summaq, in: D. Homès-Fredericq – B.Hennessy (eds.), Archaeology of Jordan II 2,Leuven, 616–621.
REUTHER, O. 1912Ocheidir. Leipzig.
ROLL, I. – AYALON, E. 1981Two Large Wine Presses in the Red SoilRegions of Israel, PEQ 130, 111–125.
RUSSELL, K. W. 1985The Earthquake Chronology of Palestine andNorthwest Arabia from the 2nd through theMid-8th Century AD, BASOR 260, 37–59.
SALIBY, N. 2004aLes fouilles du palais C 1953, in: V. Daiber –A. Becker (eds.), Raqqa III. Baudenkmäler undPaläste I, Mainz, 105–120.
SALIBY, N. 2004bLes fouilles du palais D 1954 et 1958, in:V. Daiber – A. Becker (eds.), Raqqa III. Bau-denkmäler und Paläste I, Mainz, 121–130.
SALLER, S. J. 1941The Memorial of Moses on Mount Nebo. Jeru-salem.
SALLER, S. J. – BAGATTI, B. 1949The Town of Nebo (Khirbet el-Mekhayyat).Jerusalem.
SAWIRUS IBN AL-MUQAFFAfi 1947History of the Patriarchs of the Coptic Churchof Alexandria. Vol. III: Agathon to Michael I(766). Edited and translated by B. Evetts. Paris(Patrologia Orientalis, Tome V, Fascicule 1).
SCHLUMBERGER, D. 1986Qasr el-Heir el-Gharbi. Paris.
SCHULZ, B. 1904Mschatta I: Bericht über die Aufnahme derRuine, Jahrbuch der Königlich PreußischenKunstsammlungen 25, 205–224.
TRISTRAM, H. B. 1874The Land of Moab. Travels and Discoveries onthe East Side of the Dead Sea and the Jordan.London (2nd edition).
TRÜMPELMANN, L. 1962Mshatta. Ein Beitrag zur Bestimmung desKunstkreises, zur Datierung und zum Stil derOrnamentik. Tübingen.
TSAFRIR, Y. – FOERSTER, G. 1992The Dating of “the Earthquake of the Sabbati-cal Year” of 749 C.E., BSOAS 55, 231–235.
WHITCOMB, D. 1995The Misr of Ayla: New Evidence for the EarlyIslamic City, Studies in the History andArchaeology of Jordan V, 277–288.
WHITCOMB, D. 2000Hesban, Amman, and Abbasid Archaeology inJordan, in: L.E. Stager – J.A. Green – M.D.Coogan (eds.), The Archaeology of Jordan andBeyond. Essays in Honor of James A. Sauer,Winona Lake, 505–515.
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 137
Fig. 1 Carte de la région de Madaba avec les principaux sites antiques et omeyyades.
Fig. 2: Plan du site d’Umm al-Walid (dessin Wilfried Trillen).
Denis Genequand138
Fig. 3 Umm al-Walid, plan du château oriental (dessin Wilfried Trillen).
Fig. 4 Umm al-Walid, vue de la cour centrale du château oriental depuis l’angle sud-ouest, avec le portique et une descours particulières (photo Jacques Bujard).
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 139
Fig. 5 Umm al-Walid, latrines du château oriental (photo Jacques Bujard).
Fig. 6 Umm al-Walid, reconstitution du château oriental (dessin Wilfried Trillen).
Denis Genequand140
Fig. 7 Umm al-Walid, céramiques de l’assemblage du tremblement de terre. 15–18: céramique peinte; 19, 21: céra-mique à pâte claire; 20, 22–23: céramique culinaire (dessin Michèle Joguin/Cyril Eyer).
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 141
Fig. 8 Umm al-Walid, mobilier en bronze: a) bouilloire tripode à bec verseur zoomorphe, b) brûle-parfum (photoFabienne Bujard-Ebener).
Fig. 9 Umm al-Walid, plan du château central (dessinWilfried Trillen).
Fig. 10 Umm al-Walid, plan du château occidental (des-sin Wilfried Trillen).
Denis Genequand142
ba
Fig. 11 Umm al-Walid, plan des deux mosquées successives (dessin Wilfried Trillen)
Fig. 12 Umm al-Walid, reconstitution de la seconde mosquée (dessin Wilfried Trillen).
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 143
Fig. 13 Umm al-Walid, plan de la région avec le réseauhydrographique et le Wadi al-Qanatir (dessin Wilfried
Trillen/Denis Genequand).
Fig. 14 Wadi al-Qanatir, vue du barrage amont (photo Jacques Bujard).
Fig. 15 Wadi al-Qanatir, coupe dans le barrage amont,avec les deux états et un des exutoires (dessin Wilfried
Trillen).
Denis Genequand144
Fig. 16 Wadi al-Qanatir, vue du barrage aval (photo Jacques Bujard).
Fig. 17 Wadi al-Qanatir, plan du barrage aval et des installa-tions voisines (dessin Wilfried Trillen/Denis Genequand)
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 145
Fig. 18 Wadi al-Qanatir, plan du pressoir (état II) (dessin Wilfried Trillen).
Fig. 19 Wadi al-Qanatir, vue du pressoir (photo Jacques Bujard).
Denis Genequand146
Fig. 20 Wadi al-Qanatir, reconstitution du pressoir (dessin Wilfried Trillen).
Fig. 21: Plan du site de Khan al-Zabib (dessin Wilfried Trillen).
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 147
Fig. 22 Khan al-Zabib, plan du château occidental (dessin Wilfried Trillen).
Fig. 23 Khan al-Zabib, vue de la cour du château occidental; au premier plan, un des chapiteaux épannelés (photoJacques Bujard).
Fig. 24 Khan al-Zabib, plan du château oriental (dessin Wilfried Trillen).
Denis Genequand148
Fig. 25 Khan al-Zabib, plan de la mosquée (dessin Wilfried Trillen).
Fig. 26 Qasr al-Mshatta, vue de la partie centrale du palais (photo Jacques Bujard).
Fig. 27 Qasr al-Mshatta, vue de la partie occidentale du palais (photo Jacques Bujard).
Fig. 28 Qasr al-Mshatta, vue des fondations dégagées dans la partie occidentale du palais; murs construits perpendiculairement dans une tranchée de fondation (photo Jacques Bujard).
Trois sites omeyyades de Jordanie centrale 149
Fig. 29 Qasr al-Mshatta, reconstitution du mode de construction des fondations (dessin Wilfried Trillen).
Fig. 30 Qasr al-Mshatta, plan du palais, avec les éléments restitués (dessin Wilfried Trillen).
Denis Genequand150